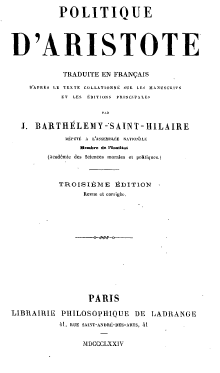
ARISTOTE
POLITIQUE
PREFACE
Traduction française : BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE.
POLITIQUE
PREFACE
|
La Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen est le résumé de toute la science politique. - Utilité et méthode de cette science. - Platon ; vérité et grandeur de sa politique à la fois rationnelle et historique ; ses erreurs. - Aristote ; sa méthode , presque entièrement historique ; ses défauts et ses mérites. - Montesquieu ; sa méthode est plus historique encore que celle d'Aristote ; l'Esprit des Lois; ses lacunes et sa grandeur. - Polybe. - Cicéron. - Machiavel. - Hobbes. - Spinosa. - Rousseau. - Conclusion ; devoirs de la science politique. - Postscriptum de la troisième édition. La révolution française a marqué dans le destin des sociétés, et dans l'histoire de la science politique, une ère nouvelle. La Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen a rappelé aux peuples, et même aux philosophes, quelles sont les véritables bases de l'ordre social ; et c'est d'elle que l'on peut dire avec toute justice qu' « elle a présenté à la nature humaine ses titres perclus dans la plus grande partie de la terre » . En proclamant que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, et que l'ignorance, l'oubli ou le mépris de ces droits sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, la Constituante a fait plus encore peut-être qu'elle n'a cru : elle prétendait stipuler pour le genre humain, au nom du peuple français ; elle a en outre stipulé pour la science, au nom de la vérité. La politique a pu ne pas tenir grand compte d'une sorte de dissertation philosophique mise en tête d'une constitution éphémère. Tout absorbée dans les intérêts et les préoccupations du moment, la politique n'a pas le temps de remonter aux principes. Comme elle ne songe qu'aux conséquences et aux applications, elle n'a pas toujours su voir que c'est de ces droits reconnus et proclamés que la Révolution tirait non seulement sa légitimité, mais encore sa puissance ; qu'ils étaient les fondements de l'ordre nouveau tout entier, la source intarissable de laquelle devaient sortir et découler toutes les institutions nécessaires à son organisation et à sa durée ; et que ce sont ces droits qui donnent à la société française, prise dans son ensemble, une supériorité incontestable sur toutes les sociétés contemporaines, ses imitatrices au moins autant que ses rivales. La politique emploiera bien des siècles de travaux en Europe et dans le reste du monde, avant d'avoir tiré de la Déclaration des Droits tous les fruits qu'elle recèle ; et les hommes d'État, malgré le dédain qu'ils affectent souvent pour ces théories, ne font cependant rien de sérieux que par elles et pour elles. Mais l'histoire, qui sait à quel prix furent achetées ces conquêtes de la raison et de la justice, en connaît mieux toute la valeur. A ses yeux, la Déclaration des Droits résume quarante siècles d'efforts et de luttes, de même qu'elle prépare des siècles plus longs encore de progrès et d'espérance. La Constituante en a su plus que tous les sages qui l'avaient précédée, parce qu'elle a pu mettre à profit leurs leçons. Les sociétés ont ignoré bien longtemps ces conditions légitimes de leur vie et de leur bonheur ; les législateurs ne les ont entrevues qu'obscurément ; la philosophie même ne les a pas toujours comprises, et les religions les plus saintes n'ont pas su les consacrer. Mais les efforts des nations, des législateurs, des philosophes et des religions n'ont pas été stériles ; et, après une bien longue attente, il s'est trouvé un peuple capable de recueillir cet héritage et digne de le féconder. La philosophie qui applaudit sans réserve à ce code éternel des sociétés, est heureuse de le recevoir tout fait des mains de la grande assemblée qu'elle seule anima. Elle n'a rien à y ajouter, rien à en retrancher; et c'est du haut de cet impérissable monument qu'elle doit porter ses regards, et sur le passé qui contribua à l'élever, et sur l'avenir qui ne l'ébranlera pas. A la splendeur de cette lumière, il n'est plus possible de s'égarer. S'il est vrai que la nature de l'homme ait des droits inaliénables, l'homme ne doit point les perdre dans la société, qui est sa vraie fin et sa perfection. La société, quelle que soit la forme politique qu'elle se donne, c'est-à-dire son gouvernement, doit, dans la mesure où elle connaît ces droits, les respecter et les garantir, en eux-mêmes d'abord, et ensuite dans toutes les conséquences légitimes qu'ils entraînent. La meilleure société sera celle qui assurera le plus complètement le libre exercice de ces droits ; le meilleur gouvernement, celui qui saura le mieux les développer et les maintenir dans les citoyens ; le politique le plus habile, celui qui les suivra et les appliquera le mieux. A cette large et équitable mesure, on peut apprécier sans erreur, et les sociétés passées, et les gouvernements qui les ont régies, et même les oeuvres des philosophes. Platon et Aristote, Montesquieu et Rousseau, peuvent comparaître devant ce tribunal dont ils invoquèrent souvent la juridiction sans en bien voir toute l'étendue ; les sociétés antiques et les sociétés modernes peuvent y être également jugées ; les hommes d'État et les législateurs de tous les temps, le paganisme et la religion. chrétienne, s'y peuvent présenter tour à tour. La nature humaine, se connaissant enfin après tant d'études et tant d'épreuves, petit leur demander à tous ce qu'ils ont fait pour elle ; car c'est elle seule que tous durent avoir en vue, puisqu'ils se sont chargés de la conduire et de l'améliorer, au milieu de tous les obstacles et de toutes les souffrances que la Providence suscite à la sagesse des hommes et à leur courage. Parmi ces travaux de genres si divers, tous dignes de la reconnaissance de l'humanité, ceux qui méritent le plus d'attention sont ceux des philosophes. D'abord, ils ont contribué au résultat commun ; et leur part, qui souvent y est la plus secrète, n'y est ni la moins belle ni la moins efficace. Mais, en outre, ils ont, sur tous les autres, l'avantage incontestable d'être les plus clairs. Le législateur, même le plus prudent, fait son oeuvre sans chercher à approfondir ni analyser les principes ; il obéit à l'instinct heureux, parfois même infaillible, de son expérience et de son patriotisme. L'homme d'État réfléchit moins profondément encore que le législateur; les intérêts qu'il doit servir, les passions qu'il doit concilier, bien que trop souvent il les partage, le troublent et l'aveuglent. Dans les conflits de chaque jour, il serait bien embarrassé de dire par quelle lumière supérieure il se guide. De plus, les travaux du législateur sont déposés dans des codes où sa pensée se perd sous des détails obscurs et incertains ; celle de l'homme politique va s'éteindre le plus ordinairement dans les archives moins sûres encore de l'histoire. Le philosophe seul parle en son propre nom, à l'abri, autant que l'homme peut l'être, de l'erreur et des illusions. Il se place directement, et sans l'intermédiaire des lois ou des affaires, en face de la nature humaine ; et rien ne paraît devoir l'empêcher de la bien observer. Ni le temps ni les lieux ne lui font obstacle ; il n'a point même à s'inquiéter des conditions matérielles de la société, ni des circonstances de toutes sortes qui ont tant d'empire sur la destinée des nations, ni des événements qui les élèvent ou qui les ruinent. Il ne s'adresse qu'à la raison, et il semble qu'il n'ait qu'à recueillir ses réponses. Pourtant le philosophe, tout indépendant qu'il est, ne se soustrait jamais entièrement à l'influence du siècle où il vit ; il a beau s'abstraire, il tient toujours à son temps ; et l'État idéal que traçait Platon se sent encore de la politique grecque, comme la monarchie rêvée par Montesquieu est la copie de la seule monarchie constitutionnelle que l'Europe possédât alors. Les oeuvres des philosophes, quelque individuelles qu'elles paraissent, sont aussi des manifestations sociales ; c'est toujours étudier les nations que d'étudier les grands hommes qui les représentent et qui les honorent. Ainsi, essayer de juger les philosophes sera tout à la fois plus aisé, plus sûr et même plus utile que de juger les législations et les peuples. Quels sont donc, depuis deux mille ans et plus, les philosophes qui se sont appliqués à comprendre la société et à l'éclairer sur sa nature et ses réels. intérêts ? Il en est bien peu dont la gloire ait sanctionné les noms et qui aient été immortalisés par elle : d'abord Platon, Aristote et Montesquieu ; l'un, le fondateur de la morale ; l'autre, l'organisateur de la science ; et le troisième, le plus sagace interprète des lois ; puis, au-dessous d'eux et à des dis-tances diverses, de vigoureux et même de faciles esprits, Polybe et Cicéron dans l'antiquité, Machiavel à l'aurore des temps modernes, Hobbes et Spinosa au XVIIe siècle, Rousseau sur le seuil de la révolution française ; les uns ne demandant leurs théories qu'à l'expérience et à l'enseignement de l'histoire, les autres ne les tirant que des déductions de la logique. Les voilà tous ou à peu près ; et encore, dans cette élite des penseurs politiques, combien il en est qui sont inférieurs en mérite et surtout en utilité ! Dans la science politique, comme dans toute autre science, il n'y a que deux méthodes possibles : ou l'on part de principes rationnels pour juger et régler les faits, ou l'on part des faits convenablement interprétés pour les ériger en principes. Ici, la nature humaine observée directement à la lumière d'un examen attentif, dont le philosophe porte en soi tous les éléments ; là, la nature humaine observée sur cette scène plus vaste et plus obscure qu'on appelle l'histoire. Connaître l'homme dans ce qu'il est et dans ce qu'il doit être, ou le connaître dans ce qu'il a été, voilà les deux seuls procédés qu'ont suivis les écrivains politiques, le plus souvent à leur insu. De fait, il n'y en a point d'autre. Ces deux méthodes, avec les avantages et les inconvénients qu'elles présentent, expliquent fort clairement la grandeur ou l'insuffisance de certains systèmes politiques, et les erreurs qui déparent même les plus beaux et les plus vrais. Il a été démontré que, dans toutes les sciences, la méthode rationnelle, malgré ses périls, vaut mieux que l'empirisme. L'homme est plus lui-même dans sa raison que dans sa sensibilité, bien que parfois la raison s'égare. En politique, cette supériorité de la raison est de toute évidence. Comme les faits dont la politique s'occupe sont des faits humains, c'est-à-dire volontaires, la science peut, jusqu'à un certain point, ainsi que l'homme lui-même, en disposer à son gré ; elle n'a point à les subir. De tous les êtres, l'homme est le seul qui change et s'améliore ; le progrès de la civilisation l'atteste d'une manière éclatante ; et si le sentiment irrésistible de la liberté ne vivait pas dans la conscience humaine, le spectacle de l'histoire suffirait à démontrer que l'homme est libre puisqu'il se modifie. Voilà pourquoi la politique est la seule science où l'utopie puisse tenir une place. Sans doute l'utopie n'a pas toujours été fort raisonnable en politique ; mais enfin elle a pu s'y introduire ; les hommes, même les plus pratiques, ne s'en sont pas défendus ; ils s'en sont fait, non pas un jeu d'esprit, mais un instrument et une arme. Bien plus, la fortune soudaine de quelques grands hommes qui ont créé des États et bouleversé le monde, a paru souvent n'être qu'un rêve merveilleux ; et l'on eût dit, même de nos jours, que le fondateur de l'Empire ne faisait que réaliser un roman prodigieux dont lui seul avait le secret. Quand les faits de l'histoire donnent eux-mêmes la démonstration d'une telle mobilité, la science n'est pas coupable de prétendre, elle aussi, à les modifier. Elle doit s'interdire des utopies impraticables, qui ne seraient que ridicules , mais elle ne doit s'épargner ni les espérances ni les conseils ; car, sous peine d'être inutile, elle doit se croire la puissance, et même le devoir, d'agir sur les hommes et sur leur destinée. La science politique doit ne jamais oublier qu'elle relève immédiatement de la morale, et que la morale est éminemment le domaine de la liberté. Si donc il est une science où l'emploi de la raison soit légitime et fécond, c'est la science politique sans contredit. Les hommes d'État le savent bien ; car ils s'inquiètent assez peu des leçons de l'histoire et profitent rarement de l'expérience du passé. Les philosophes le savent encore mieux que les hommes d'État ; et les plus grands d'entre eux sont ceux aussi qui ont le plus donné à la raison. Qu'a donc à faire le philosophe, quand il veut comprendre ce que c'est que la société, et quelles sont les lois générales qui la doivent régir ? Une seule chose : c'est de se rendre compte de la nature humaine. Une fois qu'il aura pénétré le secret de l'homme, il possédera le secret de la société, dont les membres ne sont que des hommes semblables entre eux, si ce n'est tous égaux. Le but de l'association, quelque nombreuse qu'elle soit, ne peut être essentiellement autre que le but de chacun des êtres associés ; et la loi suprême de l'individu sera la loi suprême de l'État ; méthode aussi simple qu'elle est puissante, que les philosophes ont parfois pratiquée, mais dont ils ne tirèrent point, même à l'aide du génie, des conséquences assez rigoureuses ni assez complètes. Demandons à Platon d'abord, qui, grâce à Socrate, en a tant su et nous en a tant appris sur l'homme, ce que c'est que la société. Si jamais philosophe a conçu la nature humaine dans toute sa grandeur et dans son divin caractère, c'est bien lui. La vertu n'a point eu de précepteur plus fécond ni plus aimable ; le christianisme même est venu s'instruire à son école. Personne n'a mieux compris la loi morale de l'homme, et n'a plus profondément analysé son âme ; personne n'a donné pour la pratique de la vie de plus utiles ni de plus nobles conseils. Pourtant la politique de Platon est entachée dès sa base d'une énorme et déplorable erreur. Il ne l'a point commise sans doute lui seul ; il l'a reçue des préjugés et des nécessités de son temps. Mais, comme tous les législateurs de son pays, comme toutes les constitutions de la Grèce, Platon divise la société en deux classes, les hommes libres et les esclaves. Il est vrai qu'il n'a pas essayé, ainsi que l'a fait son disciple, une explication, et comme une apologie détournée, de l'esclavage, pour lequel il se sent une véritable répugnance ; mais il ne l'a pas combattu au nom de ces principes supérieurs qu'il voyait si bien, et que la psychologie de Socrate lui avait révélés ; il ne l'a point proscrit au nom de la nature humaine analysée par la philosophie, bien qu'il pût entendre non pas seulement les plaintes inconsolables des esclaves, mais aussi les protestations formelles que la pitié et la raison arrachaient dès lors à quelques coeurs moins éclairés que le sien. Platon connaît admirablement l'homme en soi et dans toute sa généralité ; mais en fait, il ne le reconnaît que dans l'homme libre, qui seul est membre de la cité. Il a beau recommander bienveillance et douceur envers l'esclave ; l'esclave, à ses yeux, ne fait point partie de l'association civile, en d'autres termes, de l'humanité. Le philosophe sait cependant que l'âme de l'esclave n'a point perdu, même sous le joug qui l'avilit, les traits divins qu'elle a reçus dans une autre vie. L'esclave du Ménon répond à Socrate aussi bien que pourrait le faire un homme libre ; et la réminiscence, gage actuel d'une existence antérieure, que l'esclavage apparemment n'a point flétrie, n'est en lui ni moins vive ni moins sûre. Platon, sans doute, a voulu imposer à l'esclavage de son temps quelques limites, et il a conseillé à ses compatriotes de l'Hellade de ne plus faire d'esclaves parmi eux ; le barbare seul était fait pour porter des chaînes ; mais cette nouvelle erreur repose sur un préjugé national, comme l'autre reposait sur un préjugé civil, qui n'était ni plus coupable ni plus aveugle. Jetons un voile sur cette portion de la politique de l'antiquité. Quand il y a tant à admirer dans Platon, ne nous arrêtons pas à des défauts qui ne sont pas tout à fait les siens. L'esclavage tel qu'il l'a connu a duré mille ans encore après lui ; le christianisme ne l'a pas plus proscrit que le philosophe ; l'Évangile s'est efforcé de l'adoucir, mais ne l'a pas détruit ; et Sénèque a été plus hardi que ne l'était la loi nouvelle. Au VIe siècle de notre ère, quels que soient les changements profonds qu'a subis le droit romain, l'esclavage subsiste encore avec toute sa force légale, quoique les moeurs le rendent moins dur. Justinien, tout réformateur qu'il est, ne l'a point aboli ; et même plus tard, il ne disparaît que pour faire place au servage, ce dernier anneau de la chaîne féodale. Déplorons l'erreur de la philosophie grecque, mais ne nous en étonnons pas. Les temps ne sont pas venus : c'est la civilisation seule qui, en modifiant la société, l'assoira sur des fondements tout nouveaux, que le génie des philosophes n'avait pu deviner, parce que de tels secrets n'appartiennent qu'à Dieu. Souffrons donc que le philosophe bannisse les esclaves de la cité, puisqu'ils n'y doivent entrer à pas lents que quinze ou vingt siècles plus tard. Mais la cité telle qu'il la conçoit, sa cité d'hommes libres, quelle est-elle ? Quels principes lui a-t-il donnés ? Rendons ici un éclatant hommage à Platon. Le premier il a montré que l'association civile n'a qu'une base solide, la justice ; et que tout État qui ne sait pas s'assurer celle-là est à la fois un État corrompu, et un État qui menace ruine. C'est de Socrate qu'il tenait cette maxime suprême et impérissable, que Socrate lui-même avait reçue de sa conscience, maxime qui vit au fond de toutes les sociétés, bien qu'elle y soit souvent méconnue, éternel refuge pour les opprimés, éternel avertissement pour les oppresseurs, qui fit la force politique du christianisme, qui éclairait les législateurs de la Constituante, et qui est imprescriptible comme les droits qui en sont la sainte expression. On se rappelle la pensée qui a dicté la République et l'occasion qui fait naître cet incomparable dialogue. Socrate discute avec ses amis sur la nature du juste et de l'injuste, un des sujets les plus ordinaires de dissentiment et d'examen parmi les hommes. Mais comme sur le théâtre de la conscience, quelque lumineuse qu'elle soit, les traits du juste et de l'injuste trop délicats et trop fins pourraient n'être pas bien aperçus, le sage transporte ses recherches dans un champ plus large ; c'est à l'État et à ses vastes dimensions qu'il emprunte un tableau que l'individu lui eût présenté moins net et moins clair. Mais à quel État s'adresser pour y trouver cette peinture éclatante et fidèle ? Certes aucun des États existants ne mérite qu'on le prenne pour modèle ; tous ils sont dégradés par des vices, qui les placent bien loin de ce type que demande le philosophe. C'est un État idéal qui seul pourra le lui offrir. Et de là la République, et même les Lois, où Platon se complaît à tracer cet exemplaire d'une cité que la justice seule anime, et dont la vertu règle toutes les institutions, comme elle en inspire les moeurs irréprochables. L'imagination de Platon a pu s'égarer ; tout en voulant ne suivre que la justice et la raison, il a plus d'une fois méconnu la nature. Qui pourrait le nier ? Mais cette conception générale de l'État, qui ne doit avoir pour base que le juste et la vertu, n'est-elle pas tout ensemble pleine de grandeur et pleine de vérité ? Le philosophe pourra se tromper clans les applications de ce principe ; il en pourra tirer des conséquences erronées et même dangereuses. Mais ce principe suprême, sur lequel il tient ses regards sans cesse fixés, est le seul vrai ; et c'est une gloire bien grande d'avoir le premier fait briller aux yeux des hommes une si pure lumière. De nos jours, il n'y a plus de discussion possible sur un axiome aussi évident, du moins dans le domaine de la science, bien que la réalité, même au sein des sociétés les mieux organisées, semble encore si loin de l'admettre et de le reproduire. Mais au temps de Platon, au milieu de tous ces gouvernements qui, pour la plupart, ne devaient qu'au hasard et à la violence leur origine et leur durée, n'était-ce pas un trait de génie que de découvrir, sous tant d'abus et tant d'iniquités, le principe qui seul pouvait les guérir, et qui reste à jamais l'inépuisable remède des maux dont les sociétés sont affligées ? N'était-ce pas comprendre admirablement l'État que de l'identifier ainsi à l'individu, et de vouloir imposer à l'association civile la loi qui seule peut faire le mérite véritable et le bonheur de l'homme ? Cette règle souveraine une fois posée, voici les règles secondaires, non moins vraies et non moins fécondes, qu'y rattache le philosophe. D'abord, le pouvoir dans la société n'aura jamais pour but que l'intérêt de ceux auxquels il s'applique. Les citoyens n'instituent les magistrats que pour le service de la communauté. Aucun art, quel qu'il soit, n'a en vue l'intérêt propre de celui qui l'exerce, et l'art politique moins encore que tout autre. L'architecte construit une maison, le médecin procure la santé, l'homme d'État régit la cité, sans qu'aucun d'eux ait à s'inquiéter, en tant qu'homme d'État, médecin ou architecte, du salaire plus ou moins élevé qui nécessairement récompensera son oeuvre. Le politique en particulier s'en inquiétera d'autant moins que la mission qui lui est confiée est à la fois plus utile et plus haute. Il ne prendra jamais le pouvoir pour lui-même ; il le subira comme un devoir que lui imposent à la fois et les vertus spéciales qui le distinguent, et le libre voeu de ses concitoyens. Probablement Platon n'était guère moins loin des réalités de son temps, quand il demandait le désintéressement aux hommes politiques, que quand il demandait la justice à la cité. Probablement, aujourd'hui même, l'abnégation n'est pas la vertu ordinaire des hommes d'État, et la plupart pourraient encore profiter des leçons que Platon adressait, il y a vingt-deux siècles, à ses contemporains. Mais la règle qu'il a recommandée au pouvoir n'en est pas moins vraie, bien qu'elle soit si souvent méconnue des politiques vulgaires ; et l'exemple de tous les grands hommes rend témoignage à la sagacité du philosophe. Les âmes des Lycurgue, des Périclès, des Alexandre, des Charlemagne, des Henri IV, n'ont point été des âmes intéressées, et leur patriotisme a été plus grand encore que leur ambition. Oui, le pouvoir social doit s'exercer au profit de ceux qui le délèguent, et non au profit de ceux à qui on le remet. Sous une autre forme, la souveraineté nationale, ce grand principe des constitutions libres, n'est point autre chose que cette maxime ; et la Constituante était encore profondément platonicienne quand elle déclarait « que la force publique est instituée pour l'avantage de tous, et non pour. l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». De ce second principe, sortent des conséquences pratiques qui sont de la plus haute importance, et qui s'appliquent à tous les États sans exception. A qui doit appartenir le pouvoir ? La réponse ne peut être douteuse : c'est aux plus dignes. Quelle que soit d'ailleurs la forme politique de la cité, quelle que soit sa constitution, la justice exige impérieusement, comme l'intérêt même de l'association, que les mains à qui l'on remet ce périlleux fardeau, soient aussi les plus capables de le porter. Voilà comment Platon fait parfois l'éloge de la royauté, pourvu que le roi, comme un divin pasteur, sache régir, d'une main bienveillante et ferme, le noble troupeau dont la garde lui est attribuée. Voilà comment, pour obtenir l'amélioration de la société, il accepterait même le joug temporaire d'un tyran éclairé, dont l'âme jeune et amie du bien serait ouverte à tous les sages conseils, et aux énergiques résolutions qui doivent sauver l'État en le renouvelant. Voilà surtout comment il exalte le gouvernement aristocratique, dont le nom même, s'il n'est point un mensonge, est une garantie de lumières et de vertu. On a parfois raillé Platon d'avoir déclaré que les peuples ne seraient heureux que quand leurs chefs seraient philosophes, ou quand les philosophes seraient leurs chefs. On a cru démêler dans ce voeu, qui n'est que celui du bon sens et de l'expérience, une sorte de requête présentée par l'ambition, et peut-être aussi par la naïveté philosophique, comme si le philosophe était autre chose qu'un amant de la sagesse, comme si la sagesse n'était pas plus utile encore au salut des États qu'elle ne l'est à la félicité des individus. Au fond, il n'y a pour Platon qu'un seul gouvernement, c'est celui des meilleurs, c'est l'aristocratie (Voir Le Politique de Platon, page 458, trad. de M. V. Cousin. C'est toujours en ce sens platonicien que la science politique doit prendre le mot aristocratie. Montesquieu, pour n'avoir point eu ce soin, et pour avoir adopté le langage vulgaire, a fait bien des confusions. Il n'a parlé que des oligarchies sous le nom d'aristocraties.) au vrai sens de ce « nom d'heureux augure » ; les autres gouvernements, quels qu'ils soient, méritent à peine le nom dont ils se parent ; car il n'y a de gouvernement véritable que celui où l'intelligence et la raison sont dépositaires et maîtresses de la puissance publique. Les faits, tels que l'histoire nous les montre, ont trop souvent donné tort à la théorie du philosophe ; ce sont bien rarement les plus dignes que les nations oui vus à leur tête. Mais il n'est point un peuple libre qui n'ait tout fait pour que le mérite seul arrivât au pouvoir, ainsi que Platon le recommande ; et c'est un honneur pour le gouvernement représentatif de tâcher, par ses savantes combinaisons, d'assurer mieux encore que tout autre cette possession durable de l'autorité aux mains des citoyens les plus capables de l'exercer. La théorie de Platon est donc aussi vraie qu'elle serait utile, si d'ailleurs elle était d'une application moins difficile et plus ordinaire. Autre conséquence tout aussi grave et tout aussi sage. A quelques mains qu'on remette le pouvoir, quelque pures et quelque fortes qu'elles soient, la prudence exige qu'on prenne des garanties contre les erreurs et les abus que commet et qu'excuse la faiblesse humaine. Les yeux les plus éclairés ne sont pas toujours vigilants ; la vertu, même la plus active, se lasse ; et quelque confiance que méritent les hommes appelés au gouvernement, il est plus sûr encore de s'en fier aux institutions. Les entraînements du pouvoir, quel qu'il soit, sont à peu près irrésistibles ; et la pratique des affaires, rapide et tumultueuse comme elle l'est nécessairement, ne permet pas toujours, même aux intentions les plus droites et les plus éprouvées, de discerner les véritables limites que le pouvoir doit toujours s'imposer. Il faut donc, si l'on veut que l'État soit heureux et durable, tempérer le pouvoir lui-même. Ne le faire reposer que sur un seul principe, c'est risquer que ce principe ne s'exagère bientôt, et ne se détruise en s'exagérant. Sans contredit, il faut toujours que les meilleurs soient chargés de la direction des intérêts communs. Mais il faut qu'au-dessous d'eux, à côté d'eux, la foule, quelque inférieure qu'elle soit, conserve ses droits, et prévienne, en les exerçant, les excès mêmes du bien où la vertu pourrait se laisser emporter. Il n'y a de gouvernements stables que les gouvernements tempérés. Le despotisme s'est perdu en Perse par sa puissance sans bornes. La démocratie athénienne, à l'autre extrémité, n'a pas été plus sage. Ici, la liberté sans frein a produit une déplorable licence ; et là, l'obéissance aveugle des sujets a enfanté une monstrueuse tyrannie. Entre ces deux excès, Sparte a été plus modérée, et par suite elle a été plus vertueuse et plus tranquille. Mais Sparte même n'a pas su pousser assez loin ce principe fécond ; il est possible de supposer un État où le pouvoir serait encore mieux tempéré que dans celui-là. Platon cherche donc cet État parfait. Sans doute il ne l'a pas trouvé. Mais n'est-ce pas un mérite immense de l'avoir cherché ? Et cet équilibre sagement combiné des divers éléments de l'État, n'est-ce pas le but qu'ont poursuivi et que poursuivent encore les sociétés civilisées ? D'où sont venues la plupart des révolutions, si ce n'est de l'excès du pouvoir remis à quelques mains ? Les sociétés n'ont-elles pas été troublées le plus souvent parce que les privilégiés, par la pente naturelle des choses, y devinrent bientôt des oppresseurs ? Les constitutions qui ont vécu le plus longtemps n'ont-elles pas été celles où cette pondération équitable du pouvoir a été le mieux établie, qu'elle le fût d'ailleurs par la volonté intelligente du législateur, ou par le concours fortuit des circonstances ? Sparte et Rome ne sont-elles pas d'assez grands exemples ? Et que font aujourd'hui les peuples les plus éclairés de l'Europe, si ce n'est de donner à leurs gouvernements, quand ils les réforment, les bases solides et larges dont Platon a fait la condition d'un pouvoir qui veut vivre et remplir ses devoirs sociaux ? Cette nécessité de tempérer le pouvoir pour le rendre durable et fort, en le faisant légitime et régulier, d'autres l'ont recommandée après Platon ; mais lui seul l'a bien comprise dans toute sa profondeur, parce que seul il a bien connu les intimes rapports de la modération dans le principe et la conduite de l'État avec la tempérance dans l'âme de l'individu. Mais cette première garantie, déjà fort efficace, ne suffit pas. A cette barrière puissante et presque infranchissable, puisqu'elle embrasse le pouvoir entier, et le circonscrit à son insu, il faut ajouter d'autres barrières plus évidentes, et non moins respectables. Les délégués auxquels la cité a confié le dépôt du pouvoir devront rendre compte de l'usage qu'ils en ont fait. Comme tous les citoyens, en tant que tels, sont égaux, et qu'ils ont tous concouru dans des proportions diverses à l'élection des magistrats, depuis les sénateurs, les généraux et les pontifes jusqu'aux simples officiers de police urbaine, tous les magistrats sans exception auront à justifier de leur administration devant ceux mêmes qui la leur ont accordée, et qui l'ont supportée en leur obéissant. Il y aura des époques périodiques et assez rapprochées où s'exercera cette censure sévère. Les punitions que lés coupables pourront encourir seront déterminées à l'avance, et appliquées suivant les formes prescrites par la loi. La responsabilité du pouvoir organisée à tous les degrés assurera la régularité de l'administration ; et sérieuse autant qu'elle pourra l'être, cette responsabilité repoussera des fonctions publiques ces ambitions subalternes et peu sûres d'elles-mêmes, qui risqueraient trop en l'affrontant. De plus, cette institution aura l'avantage de maintenir tout à la fois et les magistrats dans le devoir et les citoyens dans la vigilance. Les affaires n'en seront que mieux gérées, lorsque de part et d'autre des craintes légitimes et réciproques tiendront les esprits en éveil. Tout État où la responsabilité du pouvoir n'a pas été sagement prévue et réglée par la loi même, doit savoir qu'il s'est confié, pour le redressement des abus, au hasard et à la violence des révolutions. On cherche toujours à réparer le mal quand il est devenu intolérable, et l'on rejette le fardeau quand on en est écrasé. Mais il valait mieux prévenir le désordre en le surveillant avec soin ; car on ne le guérit par ces terribles remèdes qu'en faisant au corps social bien des blessures, qu'un peu de prévoyance pouvait facilement lui épargner. Enfin, une dernière garantie contre l'État entier, contre les entraînements de la foule aussi bien que contre les erreurs des magistrats, ce sera l'institution d'une assemblée spéciale à qui sera confié le soin de veiller au maintien de la constitution. L'âge et la vertu seuls ouvriront l'entrée de cette assemblée auguste ; qui réunira tout ce que la cité renferme de plus sage et de plus expérimenté. Les Gardiens des lois n'auront qu'une mission : ce sera d'empêcher ces déviations secrètes, et par cela même d'autant plus redoutables, que peut éprouver le principe de l'État. Il ne s'agit pas seulement des mesures qui y portent une atteinte directe ; celles-là, tous les yeux les discernent, tous les bons citoyens les comprennent et les repoussent. Mais il est dans les mesures et les résolutions de chaque jour des tendances profondes et des résultats éloignés que les yeux les plus sagaces ne pourront y découvrir. Le patriotisme et la probité n'y suffiront pas ; car ce sont là des fautes que le patriotisme et la probité politique peuvent aussi commettre, quand un prudent conseil ne les leur signale point. Il faut donc à côté du pouvoir qui agit, soit par les magistratures, soit même par l'assemblée publique, un corps qui dans l'État n'agit pas, mais qui protège le principe d'où vient la vie de la cité entière, et l'entretient dans toute sa vigueur, en le défendant contre les influences qui le peuvent altérer. Les Gardiens des lois seront le pouvoir qui conservera l'État, entre les citoyens, dont la liberté peut le compromettre par son énergie même, et les magistrats, qui, en exagérant l'ordre, qu'ils doivent maintenir, pourraient l'exposer à des dangers non moins graves.Ainsi, les conditions du pouvoir, selon Platon, sont la justice d'abord, régulatrice souveraine de l'État, comme elle l'est de l'individu ; puis le désintéressement, les lumières, la modération, la responsabilité et le respect des lois.
Pour un pouvoir ainsi constitué, il
est bien facile de connaître les relations qu'il doit entretenir
avec les citoyens. D'abord, tous les citoyens sont unis entre eux
par les liens les plus étroits et les plus doux. Magistrats,
guerriers, artisans, laboureurs, ils sont tous nés d'une même terre
; une même patrie est « leur mère et leur nourrice commune : ils
doivent tous la défendre contre quiconque oserait l'attaquer, et,
tous sortis du même sein, ils doivent tous se traiter en frères »
(Les Lois, livre III, page I87, traduction de M. V. Cousin.) Dieu,
dans ses décrets impénétrables, a, en quelque sorte, mêlé aux
diverses natures des hommes de l'or, de l'argent, de l'airain et du
fer. C'est une première et suprême distinction qui appelle les uns
au commandement et les autres à l'obéissance. La cité, se réglant
sur ces différences, qu'elle n'a point faites, Mais, en dépit de ces distinctions que la société établit, en dépit même de celles que sanctionne la souveraine volonté des dieux, la cité n'en forme pas moins une famille dont tous les membres doivent être mutuellement animés d'une bienveillance fraternelle. Le lien social, c'est la fraternité ; et Platon qui exprime ce grand et admirable principe en termes exprès, eût devancé le christianisme de quatre siècles, si à ses yeux tous les hommes, y compris même ceux qui n'étaient pas libres, eussent été membres de la cité. De cette charité sociale naissent de bien précieux effets : d'une part, les citoyens obéissent avec une soumission toute dévouée à des lois qui n'ont été faites que dans l'intérêt universel ; et cette obéissance même devient la mesure de leur vertu civique, et le premier témoignage de leur aptitude aux emplois de l'État ; d'autre part, des magistrats qui ont à s'adresser à des frères au nom de la justice, peuvent dans la plupart des cas n'employer que la persuasion et sa douce autorité. La loi elle-même, toute reine qu'elle est, avant d'ordonner et de prescrire, expliquera les motifs sur lesquels elle se fonde. Elle aussi commencera par persuader avant de contraindre ; et le châtiment même, quelle que soit son équitable rigueur, ne frappera jamais sans se justifier, pour ainsi dire, par les conseils austères qui l'auront précédé, et qui devaient le prévenir. Du reste, l'emploi de la force, quand il sera nécessaire, deviendra légitime parce qu'il sera toujours appuyé sur la justice, loi suprême et inviolable de l'État tout entier. Un politique éclairé obligerait alors les citoyens à bien faire, malgré leur résistance, comme le médecin guérit le malade qui résiste à la science faite pour le sauver. Mais ces cas sont bien rares ; la raison du bon citoyen est en général très clairvoyante sur les devoirs qu'il doit remplir ; le malade se soumet d'ordinaire même aux remèdes les plus douloureux ; et c'est un art bien peu savant que celui de ces législateurs vulgaires qui n'emploient jamais que la méthode simple d'un commandement impérieux et dur, au lieu de cette méthode double qui persuade les esprits, avant de les enchaîner par un texte précis et étroit. Appuyé sur de si fermes bases, aidé par de tels moyens, animé et soutenu par des sentiments si purs et si puissants, le pouvoir accomplira sans peine sa noble tache. Le but de l'homme d'État ainsi compris est parfaitement évident : c'est de faire, autant qu'il dépend de lui, des citoyens accomplis. Les vertus qu'il a le devoir de leur inspirer par ses propres exemples et par ses conseils, c'est la justice et la tempérance. La philosophie a dû lui apprendre ce qu'elles valent en elles-mêmes ; et l'expérience des choses, s'il a su les bien observer, a dû le lui apprendre encore mieux. Le salut des individus n'est qu'à ce prix ; celui de l'État, qui est aux mêmes conditions, n'est ni plus difficile, ni plus incertain. La voie qu'il doit suivre est tout aussi claire et tout aussi sûre. Cette éloquence, dont les orateurs politiques font tant de cas, et qui est en effet si puissante, bien qu'elle soit trop souvent dangereuse et coupable, ne peut pas avoir un autre objet. L'homme politique, qui ne sait point tout d'abord prendre pour ses conseillères et ses compagnes fidèles la vérité et la justice, est bien à plaindre. Il ne voit pas qu'il compromet tout à la fois et l'intérêt de la cité et le sien propre. Ce n'est qu'un sophiste livré à tous les hasards et à toutes les bassesses du mensonge, à toutes les intempérances de la passion, et aussi à tous les périls de la faveur populaire. Le véritable orateur est avant tout celui qu'on peut définir, comme il sera défini plus tard par un disciple de Platon, consul de Rome et grand orateur lui-même : « Un homme de bien, doué d'éloquence ». L'orateur qui se laisse guider par d'autres règles satisfait peut-être quelquefois son ambition ; mais à côté de ce salaire si disputé et si douteux, il en trouve sur sa route un autre qui ne lui manque jamais : c'est le mépris de tous les coeurs éclairés et de toutes les âmes honnêtes. Le vrai politique nourrit des desseins bien différents. Comme il n'a jamais eu dans son noble coeur qu'un intérêt, l'intérêt du bien, il ne croit pas que l'État puisse en avoir un autre. Les agrandissements matériels de la cité lui importeront assez peu ; il ne tiendra qu'à son perfectionnement moral. Socrate, quand il assigne à l'homme d'État des devoirs si simples quoique si hauts, n'ignore pas qu'il fera sourire les habiles de son temps ; il est assez probable même qu'il ferait sourire encore ceux du nôtre, si par hasard ils consentaient à entendre sa voix. Mais Socrate et son infaillible sagesse en appellent aux faits de l'histoire et à leur impitoyable témoignage. Comment tant d'hommes d'État illustres, qui n'étaient point des sophistes cependant, qui étaient même de bons citoyens, ont-ils donc usé du pouvoir, pour que le peuple qu'ils gouvernaient ait eu contre eux de si terribles retours ? Thémistocle banni, Miltiade condamné à la prison, Cimon frappé d'ostracisme, Périclès traîné en jugement, et tant d'autres, comment se sont-ils donc mépris à ce point sur la redoutable science qu'ils prétendaient pratiquer et connaître ? Loin de rendre leurs concitoyens meilleurs, comme ils le devaient, comme ils le croyaient peut-être, ils n'en ont fait que des êtres féroces toujours prêts à se ruer sur leurs guides, à déchirer leurs chefs, sans justice, sans reconnaissance, sans pitié, dans les caprices d'une rage insensée, comme ces animaux que d'inhabiles gardiens rendent indomptables, tout en se chargeant de les apprivoiser. C'est que la science politique dans sa simplicité et dans sa candeur, telle que la conçoit le sage, est chose bien rare, malgré les leçons de tous les professeurs qui s'offrent à l'enseigner à leurs élèves et à leurs dupes. Il n'y a que bien peu d'hommes dans l'État, quelques-uns à peine, un seul peut-être, qui soient capables de diriger les autres, parce qu'il en est bien peu qui sachent se diriger eux-mêmes. Au fond, le politique doit avant tout être philosophe, c'est-à-dire, aussi sage qu'il est donné à l'homme de le devenir au prix de longs et sincères labeurs. Mais en fait, et la plupart du temps, le politique n'est qu'un sophiste ; et le citoyen rare, le citoyen unique qui pourrait conduire l'État au bien et le sauver, n'est que trop souvent la victime des passions furieuses qu'il ne partage pas, et qu'il aurait pu corriger dans ses frères, comme il les a corrigées en lui-même. L'art de la politique n'est ni aussi compliqué ni aussi savant que le suppose l'ignorance de la foule, ou que le croit même la vanité des hommes d'État ; mais la leçon que jadis Socrate donnait au jeune Alcibiade, presque tous les politiques en sont encore à la recevoir et à la mettre à profit : « Il faut avant toutes choses, mon ami, que tu penses à acquérir de la vertu, toi et tout homme qui veut avoir soin, non pas seulement de lui et des choses qui sont à lui, mais aussi de l'État et des choses qui sont à l'État », maxime profonde qu'on écoutait fort peu sans doute à Athènes, et qu'aujourd'hui l'on n'écouterait guère davantage. Mais si le politique a tant de peine à régir et à changer ses concitoyens, il est du moins une partie de la cite qu'il peut façonner à son gré, et dont le germe précieux renferme tout l'avenir de l'État : c'est l'enfance. Par l’éducation, l'homme peut presque tout sur l'homme ; car elle modifie profondément toutes les qualités que chacun de nous apporte en naissant. Et sans parler de cette action intime et puissante, ne fit-elle que découvrir et développer les natures d'élite, elle rendrait déjà un immense service à la société, et accomplirait par là même les décrets mystérieux de la Providence. L'éducation, comprise dans toute sa portée par l'homme d'État qui sait étendre au loin ses prévoyants regards, est presque le seul point important, ou du moins c'est le seul qui suffise. Grâce à elle, « les heureux naturels qu'elle fait, deviennent d'abord des hommes plus accomplis, des citoyens meilleurs que ceux qui les ont précédés ; mais en outre, ils ont cet avantage de mettre au monde des enfants qui valent encore mieux que leurs pères. » Et l'État va sans cesse s'améliorant et grandissant en bonheur et en vertu. Il n'est donc pas dans la société un seul intérêt, une seule affaire, qui mérite plus de sollicitude, ni plus de soins délicats et constants que l'éducation. Évidemment, ce qu'un pouvoir intelligent doit former avant tout, c'est l'âme des futurs citoyens, parce que c'est l'âme seule qui est en rapport avec la justice, sans laquelle l'homme et l'État ne sont rien. Mais la culture régulière du corps, la gymnastique, occupera dans l'éducation une place considérable quoique secondaire, parce que c'est elle qui doit préparer pour l'âme l'instrument énergique et docile d'un corps sain et vigoureux. De plus, l'éducation s'étendra nécessairement aux deux sexes ; et celle des femmes ne différera pas beaucoup de celle des hommes. Quelle que soit plus tard la destination des femmes, n'ont-elles pas besoin aussi d'une âme éclairée, et d'une constitution robuste ? La sagesse et la vigueur des mères n'est-elle pour rien dans la vigueur et la raison des enfants ? Hommes et femmes, il importe également au bonheur et à la force de l'État que tous soient des êtres aussi accomplis qu'ils peuvent l'être. Pour l'éducation de la jeunesse, il n'y aura donc jamais dans ceux qui la dirigent et la surveillent trop de science ni de vertu. C'est aux plus sages parmi les sages que ce sacré dépôt sera confié ; tous les enfants méritent l'égale vigilance du magistrat, afin qu'il puisse distinguer de bonne heure entre eux ces personnages exceptionnels, ces natures d'or que plus tard la philosophie pourra rendre dignes du commandement. Il ne suffira pas d'ailleurs d'éloigner de l'âme des enfants tout ce qui pourrait en ternir la pureté ; il ne suffira pas de les éclairer par la science, de les former à la vertu par des conseils et des exemples. Il faudra de plus développer en eux ces germes de religion que la nature a mis dans tous les coeurs, et d'où sortent les fortes croyances qui rattachent l'homme à Dieu. Dieu est le commencement, le milieu et la fin de tous les êtres. Il est pour les mortels qu'il a créés la juste mesure de toutes choses ; et la foi à son existence est le fondement même des lois. Ces grandes et indispensables croyances qu'il faudra cultiver dans les enfants, que le législateur, s'il est sage, inspirera aux citoyens par tous les moyens dont il dispose, douceur, violence même, ces croyances sont aussi simples qu'importantes. Elles se réduisent à trois : l'existence de Dieu, sa providence et son inflexible équité. Sans elles, l'individu erre au hasard en ce monde, livré à tous les emportements, à toutes les ténèbres de ses passions et de son ignorance. Il se méconnaît profondément lui-même tant qu'il ne sait ni d'où il vient, ni quel est le parfait et divin exemplaire qu'il doit se proposer sans cesse pour modèle et pour appui. L'État n'a point de base tant qu'il ne repose pas sur celle-là ; car la justice même, qui fait la vie et l'ordre de l'État, ne vient que de Dieu, avec lequel elle se confond en son essence éternelle. Il faut donc s'y prendre dès les premières années pour faire germer ces convictions saintes dans tous les coeurs. La loi même ne doit pas négliger plus tard de s'en faire l'apologiste persuasif ou sévère, auprès de ceux qui les oublient et les lais-sent périr, par faiblesse ou perversité. Toute éducation qui n'est pas religieuse est incomplète et fausse ; tout État où les citoyens sont indifférents ou aveugles sur ces grandes questions, est bien près de sa perte. Il ne s'agit pas, comme l'ont cru des politiques vulgaires, de trouver dans la religion des instruments de gouvernement. Elle est plus qu'un besoin des sociétés et de l'État, plus qu'une garantie d'ordre, toujours douteuse suivant l'usage qu'on en fait ; la religion est née de l'irrésistible élan de la raison humaine ; elle en est, sous ses diverses formes, l'expression la plus naturelle à la fois et la plus profonde. L'homme vénère les dieux, comme il respecte son père ; il les adore comme la source sacrée de tous les biens, et surtout de la vertu et de la raison. Et n'est-ce pas déjà presque un sacrilège que de discuter l'existence de Dieu ? L'État, tel que le comprend Platon, est donc une association spontanée d'êtres égaux et libres, mettant en commun leur travail et leur intelligence, cultivant tous ensemble les semences divines que renferme l'âme de l'homme, unis entre eux par des relations de frères, obéissant, pour que l'ordre subsiste dans la cité, aux magistrats éclairés, bienveillants et sévères, qu'ils se sont donnés, soumis « aux lois qui ne sont que les préceptes de la raison même, » formés par une éducation vigilante à toutes les vertus, à toutes les sciences, et passant une vie sainte sous l'oeil de la Divinité. Il est presque inutile de dire qu'un tel État, organisé pour maintenir la paix et l'union dans son propre sein, ne cherchera que des relations toutes pareilles avec ses voisins. Il sera toujours prêt à la guerre pour repousser une agression ; et ses défenseurs, préparés de longue main par les plus rudes exercices, et par les plus savantes études, sont assurés de la victoire autant que peuvent l'être le courage et le patriotisme, même contre des ennemis plus nombreux. Mais la cité ne fera jamais de la guerre l'objet unique de ses soins, comme l'ont fait quelques peuples illustres. « Elle réglera tout ce qui concerne la guerre en vue de la paix , plutôt que de subordonner la paix à la guerre. » Elle évitera les luttes du dehors, presque avec autant de soin que les séditions intestines ; et comme elle est résolue à ne jamais commettre d'iniquité envers les autres, elle supprimera la moitié des occasions qui mettent si souvent les États en armes, et elle n'aura qu'à se défendre avec toute l'énergie d'une bonne cause, si, malgré toutes ses vertus, elle était attaquée par d'injustes rivaux. Tels sont les traits principaux de la politique platonicienne. Ne sont-ils pas remplis de vérité, de grandeur et de fécondité ? Cette noble et sage politique a-t-elle rien d'exclusif ? A-t-elle rien de chimérique ? Est-ce qu'elle s'applique uniquement à la cité grecque où elle est née ? La vue du philosophe ne s'est-elle pas étendue fort au delà de l'étroite enceinte où la vue de tant d'autres s'est renfermée ? Il ne s'est pas borné à savoir seulement ce qu'était l'État dans les républiques de la Grèce. En cherchant à comprendre ce que l'État est en lui-même, il a trouvé ce que l'État doit être ; et comme dans ce drame immense, que joue l'humanité sur tant de théâtres divers de temps et de lieux, ces grands acteurs, qu'on appelle les nations, poursuivent sans cesse un dénouement qui s'éloigne toujours devant elles, bien que toujours elles en approchent, il s'est trouvé que l'idéal du philosophe est la réalité même que les sociétés humaines conquièrent peu à peu, et dont elles jouissent dans la proportion de leurs lumières et de leurs vertus. C'est là, qu'on le sache bien, le grand côté de la politique de Platon ; c'est là ce qui la rend éternelle et la recommande pour jamais aux méditations des sages, et, s'il se peut, à celles des hommes d'État. On parle souvent des rêves de Platon ; de grands esprits même les ont quelquefois tournés en ridicule. Mais déclarer que ces admirables principes sont des chimères, déclarer qu'ils n'ont rien d'applicable et de réel, ce n'est pas critiquer le philosophe qui le premier eut la gloire de les découvrir et de les exprimer ; c'est déclarer que la justice, la raison, la vertu sont de vains noms parmi les hommes ; c'est nier la nature humaine, l'histoire et la civilisation, qui, autant qu'elles le peuvent, et souvent à leur insu, réalisent ce type divin. La vraie politique est celle qui le reproduit le mieux ; les systèmes sociaux et les gouvernements sont d'autant plus dégradés qu'ils s'en écartent davantage ; et ces préceptes du disciple de Socrate sont tout ensemble et les plus purs et les plus pratiques de tous. C'est vraiment avec quelque peine que, de ces théories irréprochables, il nous faut descendre à ces applications qu'en a tentées le philosophe lui-même, et qui sont loin d'avoir toujours répondu à ses propres desseins : la communauté des biens, celle des femmes et des enfants, la destruction de la propriété, l'éducation toute virile d'un sexe dont la destinée n'est pas tout à fait celle de l'homme, etc. Toutes ces théories ont été réfutées, il y a vingt-deux siècles, par Aristote, et elles ont succombé dès lors sous ses critiques. Plus tard, elles devaient se reproduire encore plus d'une fois avec tout autant de fausseté et avec la grâce platonicienne de moins. Mais, n'en déplaise au génie d'Aristote, ces théories ne sont pas précisément la politique de son maître. Certes il est bon de relever de telles erreurs, quand même le juste blâme dont elles ont été frappées ne devrait pas les empêcher de renaître. Mais il eût été bon aussi de signaler les vérités immortelles qui rachètent, et qui, suivant moi, effacent toutes ces fautes. On s'est arrêté à cette république idéale dont Platon a tracé le tableau indécis et peu complet. Mais lui-même, fidèle à l'ironie socratique, en a plus d'une fois souri. Il prévoit les réclamations de toutes sortes qu'elle soulèvera ; il les admet sans peine ; et s'il trouve les gouvernements de son temps fort éloignés de l'idéal qu'il poursuit, il ne croit pas non plus que le gouvernement nouveau qu'il propose le réalise entièrement. Le but direct de la République n'est donc pas cet état plus ou moins réel, plus ou moins possible, dont Socrate ne s'occupe qu'incidemment ; l'objet premier et essentiel de la République, c'est l'étude de la justice considérée dans l'individu et dans l'État. Sans doute, Socrate croit aussi obéir à la justice dans ce gouvernement modèle qu'il décrit ; mais il sent et avoue mille fois qu'il peut se tromper dans cette copie, que tant de sociétés et de gouvernements ont faite encore plus infidèle que la sienne ; et le seul point où il est sûr de ne pas errer, c'est la nature de la justice et sa souveraineté sociale. Quant à ces théories-là, il n'y a point à les discuter ; il n'y a qu'à les admirer, et, si on le peut, à les mettre en pratique mieux que Platon et les peuples n'ont su le faire. Il est utile d'ajouter encore que les erreurs du philosophe, comme les erreurs de toutes les grandes âmes, viennent de l'exagération d'excellents principes ; elles ne naissent que de l'excès du bien. S'il veut la communauté des terres, des enfants et des femmes, c'est pour établir d'autant plus solidement l'unité civile ; la fraternité des citoyens lui semble un avantage si considérable qu'il voudrait de la cité ne faire qu'une famille, et, s'il le pouvait, un grand individu ; il immole la nature elle-même, qu'il méconnaît, pour sauver l'État. S'il veut détruire la propriété, c'est surtout pour les guerriers, qui ne posséderont rien en propre, et qui, n'ayant pour tout bien que l'insatiable amour de la vertu et de la patrie, dépendront absolument du reste des citoyens, et ne deviendront jamais les tyrans de ceux qu'ils doivent défendre. Il sait tout ce que le courage qui protège la cité peut entreprendre pour l'asservir ; il redoute la tyrannie, même de ces hommes qui joignent les lumières de l'intelligence et de la raison à la force que les armes leur assurent ; il veut prévenir le despotisme dans une république où la seule liberté, sage et réglée, doit trouver à jamais place. Enfin, s'il veut donner aux femmes une éducation militaire que les héroïnes de Sparte n'eussent pu supporter ; s'il veut leur donner une éducation philosophique dont si peu d'hommes sont capables, c'est qu'il se fait de la nature de la femme une idée sublime. La femme était dégradée au temps de Platon ; ce n'est pas pour elle qu'était l'amour, même dans les désirs les plus chastes et les plus purs du philosophe ; c'est parce qu'il veut la relever de cet abaissement qu'il est conduit à l'exalter outre mesure. Ainsi, lorsque Platon s'égare dans sa route, le but qu'il poursuit sans l'atteindre n'en est pas moins respectable : c'est ou l'unité de l'État, ou la liberté civile, ou la dignité des femmes. Telles sont à peu près les grandes vérités qui immortalisent la politique de Platon, et telles sont aussi les erreurs qui la déparent. Les unes et les autres, c'est la méthode rationnelle qui les lui a imposées. Platon ne s'est guère adressé qu'à la raison pour découvrir les immuables conditions du pouvoir, et les formes variables que peut recevoir l'organisation sociale. Cette méthode l'a porté à observer avant tout les faits de l'âme humaine ; et comme il les a connus admirablement dans l'individu, il a pu transporter à l'État les traits essentiels du tableau que lui révélait la psychologie. Certainement, une analyse plus profonde encore et plus complète aurait pu lui montrer dans la nature de l'homme les fondements de la propriété et du mariage, comme elle lui a montré les bases du pouvoir. Elle lui aurait épargné des théories insoutenables, qui sont réprouvées par le coeur humain avant de l'être par la société. Mais ces fautes, quelque graves qu'elles soient, ne doivent pas nous rendre injustes. En général, on les a trop exclusivement reprochées à Platon ; et la critique si sagace pour découvrir le mal, qui n'est que trop réel, a eu le tort d'omettre le bien, qui ne l'est pas moins, et qui, tout pesé, est infiniment plus considérable. Mais si la méthode rationnelle surtout conduit Platon, il n'a pas négligé, comme l'opinion vulgaire le croit trop aisément, cette autre méthode qui demande des théories et des enseignements à l'histoire et à l'expérience du passé. Platon connaît fort bien les gouvernements de son temps ; et dans chacun d'eux, il a discerné d'un regard profond et sûr le principe qui le constitue et qui le maintient ou le perd. La peinture qu'il a faite du despotisme en Perse et de ses excès, est aussi vive qu'exacte ; et, quand un demi-siècle plus tard ce vaste empire succomba en trois batailles sous les coups d'un jeune conquérant, les contemporains d'Alexandre durent être frappés de la sagacité du philosophe, qui leur avait expliqué, à l'avance, le secret de tant de faiblesse, et avait pressenti la facilité merveilleuse de la victoire. D'une autre part, le tableau de la démocratie athénienne, au milieu de laquelle vivait Platon, a été vingt fois reproduit par lui avec des couleurs aussi vraies que tristes. Il a peint les démagogues d'Athènes avec une fidélité qui dut les courroucer, mais qui a le grand mérite, grâce à cette fidélité même, d'instruire à jamais la postérité sur les desseins et les manoeuvres des démagogues de tous les siècles. Platon qui cherche dans sa république idéale la véritable égalité, c'est-à-dire l'égalité proportionnelle à la vertu civique, la véritable liberté, c'est-à-dire la liberté qui s'appuie sur la justice et la raison, faisait très peu de cas de cette liberté turbulente, et de cette égalité inique qui n'amènent que le désordre dans l'État, en autorisant tous les excès populaires, et en abaissant sous un même niveau toutes les aptitudes politiques. Il a bien vu l'abîme où sa patrie, « enivrée de cette liberté et de cette égalité que lui versaient toutes pures de mauvais échansons, » devait infailliblement tomber ; et sous l'âpre éloquence du philosophe, on sent la douleur du citoyen qui a dès longtemps compris les dangers, et qui se désole de les signaler en vain. On peut se rappeler aussi avec quelle exactitude Platon a tracé l'histoire de la Confédération Dorienne, et quelle est la grande leçon qu'il en tire. C'est aux faits qu'il emprunte sa théorie si pratique, quoique si rarement pratiquée, du pouvoir tempéré; ou plutôt c'est par les faits qu'il l'appuie et la démontre ; car c'est seulement à la psychologie et à la raison que d'abord il la doit. Mais il fait voir, par les désordres dont les gouvernements excessifs sont victimes, qu'ils ne périssent que pour avoir ignoré cette admirable loi de la tempérance, que quelques autres États plus sages ont mieux sentie et mieux employée. C'est encore de l'histoire heureusement combinée avec la raison que Platon a fait sortir cette autre théorie, plus célèbre quoique moins profonde, des trois gouvernements. Il avait pu trouver, entre les diversités du caractère moral des hommes et les différentes espèces de gouvernements, les ressemblances les plus frappantes et les plus vraies. Il avait pu signaler les qualités et les vices qui font la fortune ou le malheur de l'État tout comme des individus. Mais ce n'est pas uniquement dans l'étude de l'âme, c'est aussi dans les faits extérieurs qu'il a puisé cette classification générale des gouvernements qui, sous des nuances très variées, ne sont jamais que de trois espèces principales : la monarchie, l'aristocratie ou gouvernement des meilleurs, et la démocratie, constitutions régulières et bienfaisantes, tant que les chefs qui dirigent la société ne songent qu'à l'intérêt commun ; constitutions vicieuses et déviées, quand l'intérêt général est sacrifié par les dépositaires du pouvoir à des intérêts particuliers d'individu, de classe ou même de simple majorité. La royauté, quand elle oublie son devoir social, devient une tyrannie ; l'aristocratie tourne à l'oligarchie, et la démocratie tombe dans la démagogie. A ne consulter que les faits, il n'y a donc en réalité que six gouvernements, qui se correspondent deux à deux, et dont les trois mauvais ont été malheureusement pour l'humanité plus fréquents que les trois bons. Cette théorie, plus historique encore que rationnelle, appartient tout entière à Platon. Aristote n'a fait que la reproduire en lui donnant plus de précision ; et de ses mains, elle a passé dans la science qui l'a recueillie et consacrée. Elle y vit encore, comme pourrait l'attester le grand ouvrage de Montesquieu. On a contesté parfois la justesse de cette classification ; et l'on a dit que jamais un gouvernement n'était absolument pur ; que de fait, il n'y avait jamais eu un État sans mélange, quelles que fussent la violence et l'exagération du principe qui le gouvernait. L'objection est vraie ; et Platon moins que personne l'eût repoussée. Mais il faut bien que la science donne des noms aux choses qu'elle étudie ; il faut bien qu'elle les distingue et les appelle d'après leurs caractères les plus saillants. Par exemple, est-il possible de nier que la démocratie n'ait été dominante à Athènes, et que Sparte ne se soit régie en république, ainsi que Rome devait le faire plus tard depuis l'expulsion des Tarquins jusqu'à l'usurpation du premier des Césars ? Cette théorie, qui assigne aux choses politiques le nom et la définition convenables, est aussi vraie qu'elle est indispensable à la science ; et c'est à Platon qu'on la doit, bien que lui non plus il n'ait peut-être pas été le premier à en parler.(Voir Hérodote, liv. III, ch. LXXX, LXXXI, LXXXII et LXXXIII.) La Politique de Platon s'appuie donc aussi sur l'histoire, bien que l'histoire n'en soit ni la base la plus ferme, ni la source la plus profonde. A côté de tant de mérites, vérité, sagesse, simplicité, réalité, grandeur, cette politique en possède encore un autre qui n'y est pas moins éclatant, et qui doit nous toucher, s'il ne doit pas nous surprendre. Ce dernier et suprême mérite, c'est l'honnêteté. On sent en étudiant Platon que son âme est dévouée tout entière au bien, et qu'elle est aussi pure qu'intelligente. On peut signaler dans ces théories des erreurs et des lacunes ; mais la conscience la plus scrupuleuse n'y surprendra ni une mauvaise intention, ni un sentiment douteux. C'est que Platon est avant tout moraliste, et qu'il sait inspirer la vertu parce qu'il est inspiré par elle. On vit avec lui dans une atmosphère sereine, où n'habitent pas toutes les âmes certainement, mais où toutes devraient habiter. La politique qui, dans le maniement des affaires, abaisse et fausse si souvent le droit, par des transactions de toutes sortes, où elle se croit fort habile et où elle n'est que faible ou coupable, n'a pas seulement altéré les principes dans la pratique. Ses calculs peu honorables sont entrés parfois jusque dans la théorie, et y ont corrompu les plus grands esprits. Machiavel en serait à lui seul un exemple, pour ne point parler de son royal contradicteur. Mais sans même descendre jusque-là, les théories d'Aristote et celles de Montesquieu, toutes belles qu'elles sont encore, ne sont pas parfaitement pures comme celles de Platon. Ce n'est certes point la grandeur de l'intelligence qui manque à l'un ou à l'autre. Mais, par des causes très diverses, ni l'un ni l'autre n'avaient pénétré aussi profondément que Platon clans l'étude et la connaissance du bien ; leur vue a été moins ferme et moins nette, bien qu'elle regardât au même but. Tous deux se sont laissé égarer, ou par une préoccupation un peu trop exclusive des événements passés, ou même par des concessions aux préjugés de leur temps. Platon, habitué à n'interroger que la justice, n'a jamais écouté qu'elle ; et l'auteur du Gorgias a voulu avant tout faire de la politique une école de morale et de vertu. Les droits du citoyen n'ont jamais eu de défenseur plus probe ni plus éloquent. L'injustice et la tyrannie dans la cité n'ont jamais eu d'adversaire plus implacable ni plus sagace ; et si le vice peut être banni de l'État et du coeur de l'homme, ce ne sera jamais qu'au nom des principes et des sentiments dont s'est nourrie cette âme admirable, pour qui la sagesse et la vertu n'ont point eu de secrets. (Cicéron, dans la République, livre II, chap. XXX, édit de Leclerc, fait un éloge parfaitement juste de la politique de Platon, « qui s'est proposé non de tracer le plan d'un État qui pût exister, mais d'établir d'une manière sensible les vrais principes politiques. ») Pour passer de Platon à son disciple, il faut déjà descendre. Quelque grand que soit Aristote, il est bien loin de son maître. Ce n'est pas qu'il ait méconnu les nobles leçons qu'il a reçues dans l'Académie ; le souffle socratique et platonicien l'anime encore ; il sait quels sont les liens étroits et indestructibles qui enchaînent la politique à la morale ; et s'il étudie l'organisation sociale, après avoir étudié la vertu et le bonheur, « c'est pour compléter, comme il le dit lui-même, la philosophie des choses humaines. » Mais il perd trop souvent de vue les principes pour ne s'attacher qu'aux faits. Platon s'était fié, avant tout, à la raison pour comprendre et juger l'État. C'était à la raison qu'il avait demandé les lois fondamentales du pouvoir, tout comme il lui avait demandé les conditions du véritable bonheur. Aristote, sans repousser la raison, l'interroge cependant avec moins d'attention et de sécurité ; il s'en rapporte davantage à l'histoire. C'est à l'observation des faits extérieurs et des phénomènes sociaux, qu'il emprunte ses théories presque entières. Il est bien vrai que c'est l'observation seule qui doit toujours guider une philosophie prudente. Mais les faits sont de deux espèces. L'âme de l'homme en contient d'aussi réels que le monde du dehors ; et si quelque part les faits psychologiques doivent tenir une grande place, c'est surtout dans la science politique, où il n'est question que de l'humanité. Platon avait tiré les enseignements les plus utiles de la psychologie appliquée à la politique. Il avait su passer, avec une sûreté presque égale, de la conscience observée sur le théâtre un peu circonscrit de l'individu, à la conscience observée sur le théâtre plus vaste de la cité. Aristote n'a point imité cet exemple fécond. Soit qu'il regardât les vérités démontrées par son maître comme désormais acquises, soit qu'emporté par un système différent, il ne reconnût pas toujours la grandeur de ces vérités, il a préféré le spectacle de la société à celui de la conscience ; et trop souvent il a cru que ce qui est était précisément ce qui doit être. En un mot, si Platon a été surtout rationnel, Aristote a été surtout historique. Mais, comme des génies de cet ordre n'ont rien d'exclusif, la raison n'est pas tout à fait omise par le disciple, de même que le maître n'a pas tout à fait négligé l'histoire.
De là, tous les mérites d'Aristote, et
par suite tous ses défauts; les premiers, bien que très inférieurs à
ceux de Platon, l'emportant de beaucoup sur les seconds. Il étudie les États comme il a étudié les autres êtres. Il suit, pour la politique, sa méthode habituelle, comme il se hâte de le déclarer dès les premières lignes de son ouvrage ; et cette méthode, c'est l'analyse. Il ne pense pas, comme Platon, qu'il puisse, en quelque sorte, créer l'État et le façonner, suivant les lumières de son esprit ou les voeux de son coeur. Il le prend tel qu'il existe, bien ou mal constitué. Il recherche quels en sont les éléments indécomposables. Il fait la théorie de ces éléments essentiels d'après les faits évidents et exacts que l'observation lui fournit. Puis, sans prétendre les combiner conformément aux lois d'une raison supérieure, il se contente de montrer comment ils se sont le plus ordinairement combinés ; et mettant à profit cette immense érudition, qu'il avait puisée dans le Recueil des Constitutions, formé par lui, et qui n'en renfermait pas moins de cent cinquante, il classe et distingue les États jusque clans leurs nuances les plus subtiles. Mais dans cette classification même, il s'en tient aux constitutions politiques qui se produisent le plus habituellement. Enfin, il couronne son oeuvre par la théorie des changements politiques qui bouleversent ou améliorent les sociétés ; et comme ces changements ont des causes très diverses, suivant les diversités mêmes des États, il enseigné, l'histoire toujours en main, quelles sont ces causes si nombreuses, et souvent si cachées ou si faibles, appliquant toute sa sagacité et son expérience consommée à indiquer les moyens de prévenir tant de maux. Si l'on se rappelle quelques-unes des principales circonstances de la vie d'Aristote, on verra qu'indépendamment de son génie propre, ces circonstances ont pu contribuer puissamment à imprimer à sa politique cette direction toute historique. Aristote était fils du médecin d'Amyntas II, roi de Macédoine. Il avait été élevé dès sa plus tendre enfance à la cour de ce roi ; et dès lors, avaient commencé ces relations qui en firent d'abord le camarade des jeux de Philippe, puis son ami, et enfin le précepteur de son fils. Plus tard, Aristote vécut dans l'intimité d'Hermias, tyran d'Atarnée en Asie Mineure ; et quand il fut appelé par Philippe pour achever l'éducation d'Alexandre, il se trouva placé, à l'âge de quarante et un ans, et pendant sept ou huit années de suite, au centre et dans le secret des plus grandes choses de son temps : la lutte de Philippe contre la Grèce, l'avènement de son jeune élève au trône, et les préparatifs de l'expédition qui devait détruire l'empire des Perses. Aristote passa donc une grande partie de sa vie dans les cours ; et il put y voir de très près la pratique des affaires. Il paraît que lui-même n'y resta pas non plus étranger. Il fut, dit-on, chargé par les Athéniens d'une mission diplomatique auprès de l'ancien compagnon de son enfance, et il donna des lois à Stagire, sa patrie. Ainsi, tout en restant philosophe, Aristote fut presque constamment un personnage politique. Platon aussi l'avait été durant quelque temps ; et il avait nourri pour le service des peuples les plus nobles projets, que Denys repoussa et que Dion ne put pas réaliser. Mais ce contact des affaires avait eu peu d'influence sur Platon ; il en eut au contraire beaucoup sur Aristote, qui, s'exagérant peut-être l'importance des faits, comme y sont portés la plupart des hommes d'État, n'a pas su toujours remonter assez haut vers leur origine, et s'est contenté d'en retracer le tableau fidèle, au lieu de les juger au nom des principes de la justice et de la raison. Cette préoccupation est si vive dans Aristote que, pour la science politique comme pour le reste de la philosophie, il a fait de l'étude de l'histoire une loi expresse, et l'a, par ses conseils et son exemple, élevée à la hauteur d'une méthode. Le second livre de la Politique est consacré tout entier à l'examen critique des théories antérieures et des constitutions les plus célèbres. Aristote interroge ses devanciers, non pas pour les combattre, comme la critique l'a prétendu ; non point pour faire briller son esprit aux dépens du leur, comme il s'en défend lui-même ; mais pour recueillir ce que ces théories et ces constitutions peuvent renfermer de bon et d'applicable, en évitant ce qu'elles ont de défectueux. Dans un autre ordre d'études, le premier livre de la Métaphysique a un but tout pareil ; le premier livre du Traité de l'Ame est rempli par des recherches et des discussions du même genre ; et quelques autres traités moins considérables reproduisent des procédés analogues. C'est ainsi qu'Aristote a pu justement être appelé le premier historien de la philosophie ; et, de nos jours, la philosophie, en se livrant à l'étude de l'histoire, n'a fait que l'imiter, et suivre ses excellents préceptes avec plus de rigueur encore que lui-même. Entre les mains d'Aristote, quelque habiles qu'elles soient, la méthode historique a porté, comme on pouvait s'y attendre, quelques-unes des conséquences assez peu louables qu'elle renferme. Quand on se borne à l'étude des faits, on est trop souvent conduit à s'en faire l'apologiste. C'est sur cette pente à peu près irrésistible qu'Aristote a glissé quand il a traité de l'esclavage. Il ne s'en est pas fait l'aveugle défenseur, comme on l'a répété plus d'une fois. Loin de là, l'esclavage, tel qu'il est établi de son temps, fondé d'ordinaire sur la violence, et résultant de la guerre, lui semble injustifiable. Il reconnaît en outre que bien des esclaves seraient dignes de la liberté, pour laquelle la nature les a faits, et que bien des hommes libres mériteraient l'esclavage, que le hasard seul leur a épargné. Mais s'il ne défend pas dans l'esclavage les désordres trop évidents qui l'accompagnent et les iniquités flagrantes qui le souillent, il essaye de l'expliquer théoriquement ; et cette explication est bien près d'être une apologie. Exagérant les différences que Platon avait signalées dans les diverses natures des hommes, et qui sont bien réelles, il ne soutient pas seulement, comme son maître, que les uns sont faits pour le commandement politique et les autres pour l'obéissance. Il va jusqu'à soutenir que les uns sont faits naturellement pour la liberté et les autres pour l'esclavage. L'esclave est celui qui ne doit point s'appartenir, parce qu'il ne saurait se guider lui-même, et qui ne peut rendre service à la société que comme ces bêtes vigoureuses que l'homme associe à ses travaux. Ainsi qu'elles, l'esclave est un instrument vivant ; et puisque la cité et la ville ne doivent point se passer des instruments qui leur sont indispensables, l'esclavage est légitime, l'esclavage est naturel, au même titre que l'acquisition des biens nécessaires à la vie. Et « si la chasse est permise contre les bêtes fauves, cette autre chasse qu'on appelle la guerre, doit être permise également contre ces hommes qui, faits par lu nature pour obéir, refusent de se sou-mettre. » Voilà la théorie de l'esclavage dans toute sa profondeur, mais aussi dans toute son horrible fausseté. Chose vraiment incroyable ! le même philosophe qui trace cette hideuse théorie avec tant de sang-froid, n'hésite pas à accorder aux esclaves des vertus, tout comme il en accorde aux hommes libres. Il voit bien qu'il va détruire par cette concession morale la différence essentielle qui sépare les uns et les autres, et qui justifie le despotisme et la soumission. Mais, subjugué par l'évidence même des faits, il déclare que refuser aux esclaves toute vertu, la sagesse, l'équité, la tempérance, est chose absurde ; car « ils sont hommes, dit-il, et ils ont leur part de raison. » Ils sont hommes ! telle est la grande, l'invincible raison qu'il faut opposer à l'esclavage. Il est inutile d'en alléguer une autre. C'est un attentat contre l'humanité que de réduire son semblable en esclavage. C'est une sorte d'attentat contre Dieu même, qui a fait l'homme avec des caractères qu'il n'est jamais permis de méconnaître ni d'effacer. Aristote, qui ne craint pas de se contredire, n'en prétend pas moins que l'esclave est absolument privé de volonté ; comme si un homme privé de volonté était encore un être humain !
On comprend que l'esclavage, quelque
monstrueux qu'il soit, ait existé en fait. Il existe encore de nos
jours, quoique la nature humaine soit aujourd'hui bien mieux connue
et bien plus respectée des peuples civilisés. On comprend que les
nécessités sociales qu'indique le philosophe, sans d'ailleurs les
approfondir, aient pu faire de l'esclavage une loi des nations
antiques, qui toutes l'ont admis, sans en excepter le peuple même
qui se disait le peuple de Dieu. Mais ce qui doit nous confondre
d'étonnement, c'est que des philosophes qui avaient analysé aussi
exactement les facultés de la nature humaine, n'en aient pas mieux
senti la dignité, et n'aient pas protesté de toute la puissance de
leur génie contre l'affreux usage qui l'anéantissait. Platon, qui,
plus profondément initié aux mystères de l'âme, aurait dû réclamer
le premier et le plus haut, n'a pas du moins introduit l'esclavage
dans sa république idéale. Les laboureurs et les artisans chargés
des gros ouvrages de la société y sont des citoyens ; le hasard de
la naissance n'est point pour eux une cause d'exclusion ; et si Dieu
les a doués de facultés rares, les hautes fonctions de l'État les
attendent et les réclament. Mais si la méthode historique a conduit Aristote à de telles aberrations, elle le mène souvent aussi à la vérité, quand les faits qu'il constate sont légitimes et conformes à la raison. C'est ainsi que pour bien comprendre l'État, il étudie d'abord la société, dont l'État n'est que la forme, et proclame que la société est un fait de nature, et que l'homme est un être éminemment sociable. Celui qui s'isole et qui ne se réunit pas à ses semblables, est plus ou moins qu'un homme ; il est en dehors de l'humanité ; « c'est ou une brute ou un dieu. » L'institution d'une société réglée par des lois a donc été un immense service rendu au genre humain. Cette théorie d'Aristote est aussi simple que juste. Elle n'est que la traduction de ce grand fait qui nous montre partout les hommes en société, parce que, comme le dit Aristote lui-même, la société est la fin et la perfection de l'être humain, et que l'homme reste incomplet et mutilé, s'il ne communique à ses égaux et ne reçoit d'eux les sentiments moraux de tout ordre qui sont sa véritable vie. Quand on se rappelle que tant de philosophes, à commencer par Hobbes et Rousseau, ont méconnu ces grandes vérités, et défiguré l'homme en le faisant insociable et farouche, on accorde à ces opinions d'Aristote plus d'importance que ne semblerait en mériter leur simplicité même. Les lumières d'un siècle fort éclairé n'ont pas empêché Rousseau de se tromper ; les obscurités d'une civilisation beaucoup moins avancée n'ont pas égaré le philosophe antique ; et l'on doit savoir quelque gré à celui qui le premier a montré des faits de cet ordre avec leur véritable caractère. Des observations tout à fait analogues ont mené Aristote à une découverte considérable, si d'ailleurs le germe qu'elle renfermait n'a point été fécondé, et s'il est demeuré, malgré ses efforts, à peu près inconnu et stérile : c'est la découverte, qu'on excuse ce mot, de l'Économie politique. La société ne se compose pas seulement des personnes ; elle se compose aussi des choses, sans lesquelles les personnes ne subsisteraient pas. Si donc on peut, en étudiant la nature et les conditions des personnes, fonder une science qui n'est autre que la science politique, on doit pouvoir aussi fonder une science des choses, non moins réelle et tout aussi utile. Comment les choses sont-elles produites ? Comment se répartissent-elles dans la société ? Quelle est la valeur des choses ? Qu'ajoute l'échange à cette valeur ; et, après l'échange, le commerce ? Quel rôle joue la monnaie ? Et qu'est-ce que c'est que la richesse ? Telles sont les principales questions que cette science doit approfondir dans sa partie théorique, sans parler de ces autres questions toutes pratiques, et par exemple, celle des monopoles, qu'elle doit discuter également. Cette science nouvelle qu'Aristote distingue de toutes les autres, et de l'économie domestique, qui en est si voisine, il l'appelle d'un nom spécial qu'elle a parfois conservé : la Chrématistique, la science des richesses. Changez le mot ; c'est bien l'Économie politique, avec le cortège des principaux phénomènes qu'elle doit expliquer, et régler même, si elle le peut. Ce serait aller trop loin de dire qu'Aristote a fondé l'Économie politique. Le XVIIIe siècle a raison de revendiquer cet honneur pour Quesnay, et surtout pour Adam Smith ; et l'illustre Écossais n'a rien emprunté à son antique devancier, qu'il n'avait peut-être même pas lu. Mais on peut affirmer sans exagération que l'Économie politique, avec ses vraies limites, si ce n'est avec tous ses développements, est déjà dans Aristote ; et c'est sa méthode historique qui la lui a révélée. Omettre les choses, c'est supprimer la moitié du grand fait social ; et le philosophe est trop bon observateur pour commettre une telle négligence. Seulement, il ne fait qu'indiquer la Chrématistique, et ne lui consacre que deux chapitres d'un ouvrage où il avait tant d'autres problèmes à traiter. Maintenant, comment une théorie si formelle, et si importante, a-t-elle passé presque inaperçue ? Comment, depuis Aristote jusqu'au XVIIIe siècle, les faits si graves qu'elle avait signalés à l'attention des politiques, n'ont-ils pas été de nouveau systématiquement étudiés ? Comment, lorsque la science est venue à naître après un si long oubli, n'a-t-on pas eu un souvenir pour le philosophe qui jadis avait le premier tenté la carrière ? Ce sont là des questions que l'on pourrait en partie résoudre, en pensant à la nature même de cette science, qui n'a d'attraits que pour bien peu d'esprits, en se rappelant que la Politique d'Aristote a été très peu connue dans l'antiquité et dans le moyen âge, et surtout en remarquant que les phénomènes qu'étudie l'Économie politique, tout vulgaires qu'ils sont, ne frappent que des yeux fort clairvoyants. Quoi qu'il en soit, la Chrématistique d'Aristote a devancé de vingt-deux siècles l'Économie politique de Quesnay, d'Adam Smith, de Turgot. Peut-être cette revendication en faveur d'Aristote paraîtra quelque peu tardive. Mais en est-elle moins équitable? Autre avantage qui recommande la méthode d'Aristote. Grâce à elle, il nous a conservé cette foule de détails curieux et uniques, que seul il nous a transmis, sur les États de l'antiquité. Rien sans doute ne peut réparer la perte du Recueil des Constitutions. Mais sans la sollicitude historique qui le lui fit entreprendre, nous serions encore bien moins informés que nous ne le sommes de l'organisation politique de tant de peuples illustres. Qui nous a fait, par exemple, mieux connaître le gouvernement de Carthage ? Chose étrange ! C'est à un auteur grec, antérieur aux Scipions de plus de cent cinquante ans, que nous devons les renseignements les plus précis et les moins incomplets sur la rivale de Rome ! Les historiens romains ont effacé presque tous les souvenirs, comme les vainqueurs ont dispersé les ruines de la cité détruite. C'est le précepteur d'Alexandre qui conservera les archives d'une ville africaine ; comme il nous eût conservé, si le temps l'eût permis, les annales de tant de nations barbares dont le nom même a disparu de l'histoire. Enfin, c'est la méthode historique qui donne au philosophe la base de son ouvrage, on ne peut pas dire de son système. C'est de l'observation des événements passés et de Platon, son maître, qu'il reçoit la grande théorie des trois gouvernements, à laquelle il a ramené tous les autres. Platon avait exposé cette opinion ingénieuse, mais il la tirait moins des faits sociaux que de l'analyse de l'âme humaine ; et malgré les formules expresses du Politique, on peut croire que le disciple de Socrate avait puisé bien plus dans la psychologie que dans l'histoire. Aristote, du premier mot, écarte toute équivoque. Il n'y a que trois gouvernements possibles, parce que le pouvoir ne peut, par la nature même des choses, qu'être remis ou à un seul, ou à plusieurs, ou à tous ; règle aussi profonde qu'elle est claire, bien que plus tard on l'ait méconnue, et que Montesquieu lui-même s'y soit trompé. Aristote admet aussi les trois déviations signalées par Platon ; et il leur donne des noms que depuis lors elles ont gardés. La tyrannie est la déviation de la royauté ; l'oligarchie, celle de l'aristocratie ; la démagogie, celle de la démocratie. Et comme Platon encore, il assigne à la corruption des trois gouvernements une cause unique : la substitution illégitime d'un intérêt particulier à l'intérêt général. Jusque-là, le disciple n'a fait que suivre et copier son maître. Mais voici le développement original qu'il donne à cette théorie fondamentale : il montre comment elle s'applique à l'histoire ; et c'est à la pratique des peuples qu'il demande les diverses espèces qu'en réalité présente chacun de ces gouvernements. Les nuances de la royauté sont fort nombreuses, depuis la royauté absolue et héréditaire jusqu'à la royauté élective et temporaire, dont les peuples grecs ont usé à plusieurs époques longtemps avant que Rome eût ses consuls annuels et ses dictateurs. Les nuances des autres gouvernements ne sont pas moins variées ; Aristote en fait l'exact dénombrement ; et à chaque variété qu'il enregistre, il rappelle avec une scrupuleuse exactitude le peuple qui la lui fournit et qui en enrichit la science. Pourtant ici la méthode historique lui fait un instant défaut. Après la royauté, il devrait étudier l'aristocratie. Mais l'aristocratie proprement dite est bien rare, ou plutôt elle n'existe jamais dans les sociétés humaines. Au lieu des plus dignes, c'est aux plus puissants, aux plus riches, qu'est remis ordinairement le pouvoir ; et l'aristocratie, telle que la théorie l'exige, ne se rencontre guère que dans les cadres de la science, ou dans les utopies des philosophes. Aristote est donc obligé de se jeter dans l'idéal à la suite de Platon ; et il essaye lui aussi de tracer le plan d'un État parfait. Il ne consacre pas moins de deux livres entiers à cette tentative un peu aventureuse pour un génie tel que le sien. Il est à peine besoin de dire que, dans ces régions élevées, Aristote ne plane pas aussi haut, ni aussi sûrement, que son modèle inimitable. Le tableau de sa cité parfaite est peut-être moins complet encore que celui de la République tant reprochée par lui à Platon. On y trouve des traits admirables sans doute, des enseignements nombreux et très pratiques sur toutes les parties de la politique, et spécialement sur l'éducation. Mais cette cité fondée par Aristote ne vit point. Ce n'est pas qu'il y propose quoi que ce soit d'inapplicable. Tout au contraire, il s'est attaché à recueillir dans les faits réels ceux qui lui semblent les meilleurs ; et quand il traite du territoire de l'État, de son étendue, de la position de la cité, des qualités naturelles des habitants, des éléments indispensables à l'association politique, des droits essentiels des citoyens, on sent partout que c'est la pratique qui le guide et le retient dans les plus sages limites. Mais ces fragments juxtaposés avec grand soin, et chacun à part fort précieux, ne forment point un ensemble systématique et profond, comme celui de la cité platonicienne. L'oeuvre d'Aristote n'a point de défauts choquants ; mais elle est sans beauté, si ce n'est sans utilité. Au risque de quelques faux pas, il vaut bien mieux s'égarer dans les routes fécondes de son maître ; et cette république semi-idéale, semi-réelle, est si pâle et si morte qu'elle est à peine connue. En parler, c'est presque la découvrir pour la première fois ; et la postérité n'a pas été injuste en immortalisant la République de Platon, et en laissant l'autre presque dans l'oubli. Mais si le génie a failli quelques moments, il reprend toute sa puissance et tous ses avantages, quand de la spéculation il redescend à l'histoire et ne prétend plus que généraliser les faits. Il n'est pas un homme d'État, quelque habile qu'il soit, qui n'ait à profiter de ses études sur les oligarchies, les démocraties, les républiques, sur l'organisation du pouvoir dans chacun de ces gouvernements, et surtout sur les révolutions, sujet qu'il a traité avec une sorte de prédilection et avec un succès incomparable. Platon est en ce dernier point infiniment moins pratique ; et sur cette question, toute d'expérience, Socrate, qui cherche à la résoudre par la psychologie, se trompe à peu près complètement, comme Aristote le lui reproche avec raison. La théorie des révolutions termine la Politique d'Aristote, comme lui-même l'indique ; et l'on ne comprend pas en effet que cette théorie puisse y occuper une autre place. La science politique commence par étudier la société et l'État ; elle parcourt ensuite toutes les formes que l'État peut revêtir ; et la fin de ses recherches, c'est l'examen des causes qui le détruisent, et des moyens qui le conservent. Ici Aristote n'est pas seulement supérieur à Platon ; il est supérieur à tout ce qui a suivi, et jusqu'à ce jour, il est absolument sans rival. Sans doute le Recueil des Constitutions lui fournissait des matériaux abondants ; et nous voyons encore assez, par les fragments qui en ont été conservés et par l'ouvrage qui n'en est que le résumé, quelle devait être la richesse de ces matériaux. En ceci, l'oeuvre de génie a consisté à réunir dans une théorie systématique tous ces faits, qui certainement sont analogues entre eux, mais que l'histoire offrait épars et sans lien. Aristote a classé une à une toutes les causes des révolutions ; il en détermine le nombre, en se bornant aux généralités les plus vastes à la fois et les plus exactes. Puis, ces causes une fois énumérées, il montre comment chacune d'elles agit selon les principes divers des gouvernements ; et de même qu'il avait considéré les révolutions dans leur ensemble, il les étudie dans leurs détails les plus minutieux, apportant sans cesse à l'appui de ses théories l'autorité des faits historiques. La vue du philosophe a été si perçante et si sagace qu'aujourd'hui même , avec deux mille années d'expérience de plus, avec cette variété infinie de phénomènes nouveaux qu'elles ont fournis à l'histoire des sociétés humaines, il serait difficile de dire plus que n'en a dit Aristote. Il n'est pas une de ces grandes catastrophes politiques venues après lui, qui ne rentre dans les cadres qu'il a tracés à l'avance ; et l'on n'a pas à presser beaucoup ses théories pour en faire sortir comme d'infaillibles prédictions. Sans doute on pourrait trouver encore des leçons très profitables dans l'étude des révolutions modernes, et surtout dans cette grande révolution qui, à la fin du XVIIIe siècle, a renouvelé la société française. Mais les enseignements que le philosophe a tirés des révolutions antiques n'en sont pas moins certains ; et jusqu'à présent, il est le seul dont la sagesse les ait recueillis. D'ailleurs, la théorie des révolutions n'en reste pas moins toujours un vaste et très curieux sujet, qui quelque jour peut-être tentera le génie d'un second. Aristote. En attendant, c'est à son école qu'il faut aller s'instruire ; et malgré les travaux de détail qui depuis lors ont été faits, et dont quelques-uns ont illustré leurs auteurs, l'école péripatéticienne est la seule où puisse étudier quiconque veut embrasser d'un regard général les causes et les remèdes des révolutions. Une autre théorie fort importante encore, et qui appartient aussi tout entière au philosophe de Stagire, c'est celle des trois pouvoirs. Aristote distingue dans la puissance publique trois modes suivant lesquels elle s'exerce : pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Il traite séparément de chacun d'eux, comme pour indiquer combien il est nécessaire au bon ordre de la société que ces pouvoirs soient distincts, et ne soient jamais réunis dans les mêmes mains. Suivant lui, il n'est pas une seule question dont le législateur, s'il est sage, doive s'occuper avec plus de soin que de celle-là. Quand la division de ces pouvoirs est bien faite, l'État tout entier est bien organisé ; et les États se distinguent surtout entre eux par la pondération différente de ces trois éléments. Il va sans dire que, pour Aristote, le pouvoir législatif réside dans l'assemblée générale des citoyens, qui, dans toutes les petites cités de la Grèce, pouvaient se réunir si aisément. Il énumère les attributions de l'assemblée générale ; et l'une des plus graves, après la confection même des lois et l'élection des magistrats, c'est l'apurement des comptes de l'État. On comprend sans peine que les attributions varient suivant les diverses espèces de gouvernements ; et l'assemblée générale elle-même peut être composée de bien des manières différentes, suivant le nombre de ceux qui la forment, la quotité variable du cens qui en donne l'entrée, etc., dans les démocraties, dans les oligarchies, et même dans les aristocraties et les républiques.
Des questions non moins nombreuses, et
non moins intéressantes, pourront être soulevées pour le pouvoir
exécutif. Quelles sont les principales fonctions publiques ? Quelle
en doit être la durée ? A qui seront-elles confiées ? Comment y
nommera-t-on ? Quelles fonctions peuvent être cumulées sans danger,
ou même avec avantage ? De plus, toutes les magistratures
convieraient-elles à tous les gouvernements ? N'y a-t-il pas
certaines fonctions essentiellement propres à telle forme politique,
et contraires à telle autre ?
Il est à peine besoin de faire
remarquer combien toutes ces théories méritent d'attention. La
division des pouvoirs est encore pour nous et dans tous les
gouvernements représentatifs une question capitale. Toutes les
constitutions libres les séparent, comme le fait le philosophe ; et
quelles que soient les différences de temps et de circonstances
politiques, ici encore Aristote est un guide qu'on peut suivre non
pas seulement avec curiosité, mais toujours avec profit.
Ailleurs, Aristote traite de
l'ostracisme, expédient fort employé parla politique des républiques
grecques, et que dans les gouvernements parlementaires le jeu
régulier des majorités supplée avec grand, avantage. Mais à la suite
de cette question toute spéciale, le philosophe s'en pose une plus
générale, et il se demande quelle doit être la place du génie dans
la cité. Quand le ciel fait naître parmi les membres de
l'association politique, qui tous doivent être égaux, un de ces
personnages rares dont le mérite individuel l'emporte sur le mérite
réuni de tous les autres, que doit-on en faire ? Le réduire au
niveau commun, n'est-ce pas lui faire injure ? « Ces êtres
supérieurs sont des dieux parmi les hommes ; la loi n'est pas faite
pour eux, parce qu'ils sont eux-mêmes la loi vivante. » Si l'on
prétend les soumettre à la constitution, ils répondront ce que les
lions répondirent au décret rendu par l'assemblée des lièvres sur
l'égalité générale des animaux : « Il faudrait soutenir de telles
prétentions avec des dents et des ongles comme les nôtres. » Bannir
les grands hommes dans l'intérêt de l'égalité commune, base
nécessaire de la cité, a pu être utile quelquefois à l'État ; Argo,
le merveilleux navire de la mythologie, marcha plus rapidement après
avoir déposé sur le rivage le trop pesant Hercule. Mais c'est là une
violence qu'il faut laisser à la Fable et aux États corrompus. Reste une dernière théorie qui tient d'assez près à celle-là, et qui, dans l'état actuel de la société française, doit particulièrement nous intéresser : c'est celle de la classe moyenne. Platon avait placé dans la tempérance le bonheur de l'individu, l'ordre de l'État, et la stabilité du pouvoir. Aristote, transportant cette forte doctrine dans sa Morale, avait essayé de prouver que la vertu est en général un terme moyen entre deux excès contraires. Une suite de ces théories, c'était en politique de placer la véritable force de l'État dans la classe des citoyens dont la fortune est également éloignée et d'une excessive richesse et d'une extrême pauvreté. Ces citoyens-là sont les meilleurs de tous, parce qu'ils sont les plus sages. La misère ne les réduit pas à l'insurrection ; et l'enivrement de la fortune ne les pousse pas aux tentatives, non moins coupables, d'une aveugle ambition. Ils assurent à la cité un équilibre puissant et calme qui fait sa tranquillité et son honneur. C'est dans Aristote qu'il faut lire ces pages empreintes du plus admirable bon sens (liv. VI, ch. IX). Mais que dirait le philosophe, s'il pouvait aujourd'hui contempler cette grande idée, réalisée dans un pays qui est peuplé soixante ou quatre-vingts fois plus que ne le fut jamais l'Attique ? Que dirait-il s'il voyait la société la plus équitable et la plus intelligente de toutes reposer sur cette large base ? Il voulait, il y a deux mille ans, la donner à la cité, qui sans elle est toujours chancelante. La civilisation, après vingt-deux siècles, est restée de l'avis du philosophe ; et c'est un de ses plus nobles triomphes de créer peu à peu et d'accroître sans cesse, dans tous les États qu'elle éclaire, cette classe moyenne qu'Aristote souhaitait vainement aux États de son temps.
A côté de tous ces mérites d'Aristote,
il en est un qui les rehausse en les accompagnant toujours, et qu'il
serait injuste de passer sous silence : c'est celui du style. Le
style de Platon reste à jamais inimitable, non pas seulement par la
grâce, la simplicité et le goût exquis des détails, mais encore par
la forme dramatique et vivante qu'il a revêtue. Chacun de ses
dialogues est un chef-d'oeuvre d'art en même temps que de
philosophie. Mais le dialogue ne peut être la forme de la science ;
et si cette forme, qu'Aristote admirait ; autant que personne et
qu'il loue dans sa Politique, a été permise au disciple de Socrate,
elle est inaccessible à toute imitation heureuse, parce que le
personnage de Socrate ne se représentera jamais dans l'histoire de
l'esprit humain. Aristote, qui a tant emprunté de son maître, tout
en le critiquant souvent, s'est bien, gardé de chercher à lui
emprunter son style, du moins dans les ouvrages qui nous restent de
lui ; et s'il est une différence frappante entre les deux écrivains,
c'est bien celle-là. Le style d'Aristote, toujours concis, grave,
austère même, est cependant toujours d'accord avec les matières si
diverses qu'il traite, depuis la Logique jusqu'à la Poétique et la
Météorologie. Dans la Politique en particulier, il a toutes les
qualités que réclame le sujet. Ici même, la sobriété, loin de nuire
au mouvement et à la vie de la pensée, a quelque chose de
spécialement convenable. Quoique Aristote ne parle pas avec la
brièveté du commandement, on sent partout l'énergie impérieuse d'un
homme qui pouvait être législateur ; et, ce qui ne doit point
échapper aux esprits délicats, le style de la Politique a gardé, par
une réminiscence bien rare et sans doute involontaire, quelques
reflets de l'éclat platonicien. Il y a peu de morceaux dans la
littérature grecque qui surpassent en couleurs vigoureuses et
sévères la discussion de l'esclavage, celle de la souveraineté,
celle de l'ostracisme, et surtout ce tableau de la tyrannie, qui
serait le plus beau de ce genre, si Platon n'avait eu déjà tracé le
sien. On doit insister sur ces qualités du style d'Aristote. Tous
les écrivains politiques n'ont pas été aussi heureux ; et le style
de Montesquieu, par exemple, tout brillant qu'il est, est bien loin
d'avoir cette convenance accomplie. Le ton d'Aristote est celui que
la science politique doit toujours prendre, de même qu'elle doit en
général se renfermer dans les limites qu'il lui a tracées. A deux mille ans de distance, les mêmes éloges à peu près et les mêmes critiques s'adressent à Montesquieu. La pensée qui se déroule dans l'Esprit des Lois est moins profonde que celle d'Aristote, et surtout que celle de Platon. Montesquieu ne veut pas comme eux étudier la société et l'État dans leurs éléments essentiels et dans toutes leurs formes. Il recherche seulement ce qu'ont été les lois, chez les divers peuples, sur les matières essentielles, et comment le principe des gouvernements a modifié ces lois ; sujet immense encore, qui pouvait embrasser indirectement toutes les questions de la politique, et qui s'étendait avec les événements eux-mêmes et avec les progrès de l'histoire universelle. Mais l'esprit qui anime Montesquieu est presque tout historique, et il a été d'autant moins complet qu'il a moins donné à la raison, dans une science où la raison doit fournir toutes les théories ou juger tous les faits. Ce n'est pas que Montesquieu ignore la vraie méthode ou qu'il la dédaigne. Il croit très sincèrement être remonté « aux principes qu'il veut tirer, non de ses préjugés, mais de la nature des choses. » Il sait que l'homme, « cet être flexible, se pliant dans la société aux pensées et aux impressions des autres, est également capable de connaître sa propre nature lorsqu'on la lui montre, et d'en perdre jusqu'au senti-ment quand on la lui dérobe. » Il voit donc très clairement que c'est à la nature humaine bien étudiée qu'il faut demander le secret des lois qui doivent régir les sociétés, et même celui des lois qui les ont régies dans les conditions les plus dissemblables. C'est là la méthode platonicienne, et même, jusqu'à certain point, celle d'Aristote. Mais Montesquieu qui aperçoit la lumière, ne la suit presque jamais ; et malgré toute sa sagacité, il n'a pu éviter, je ne dis pas des chutes, mais des fautes nombreuses de détail, qui ont enlevé à son ouvrage une partie de sa grandeur et de son utilité. On a pu admirer à bon droit la définition gravée au frontispice du monument : « Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. » Mais pourtant, comme il s'agit ici non des lois de l'univers, ni de celles de Dieu, mais des lois positives, c'est celles-là uniquement qu'il convenait de définir. Les autres ne tiendront pas la moindre place dans un ouvrage où les seules lois dont il soit question, sont ces conventions variables que fonde ou renverse la libre volonté des hommes. Ainsi Montesquieu débute par un défaut de méthode ; et tout son premier livre qui traite des lois en général, est « d'une métaphysique faible et obscure, » comme le lui reprochent Voltaire, qui ne veut pas le suivre dans ce labyrinthe, et Helvétius, dont les critiques sont souvent beaucoup plus justes qu'on ne pouvait s'y attendre. Montesquieu est sans doute un esprit philosophique. Mais il n'avait point suffisamment assez cultivé la philosophie elle-même. Entraîné par les études que lui inspirait son propre génie, et que lui avaient imposées longtemps ses fonctions de judicature, il n'a pas accordé le temps nécessaire à ces autres études plus profondes, qui devaient lui révéler les vrais principes ; quand on place son oeuvre auprès de celles de Platon et d'Aristote, on est frappé de tout ce qui lui manque, en même temps qu'on voit aussi d'où lui viennent tant de lacunes.
Il n'est personne qui n'ait remarqué
le désordre de l'Esprit des Lois. La pensée générale est fort
claire, mais l'exécution est loin de l'être autant. Les livres, fort
nombreux, se suivent sans avoir entre eux des liens assez évidents,
et quelquefois même sans que l'examen le plus attentif et le plus
bienveillant puisse leur en découvrir aucun. On pourrait citer
spécialement le XXVIIe et le XXIXe. Toutefois, en terminant son
ouvrage, Montesquieu croit enfin toucher au but qu'il a si
laborieusement cherché, ou du moins au but de la dernière partie de
l'Esprit des Lois ; et comme les matelots qui, après une aventureuse
traversée, aperçoivent enfin la terre et poussent des cris
d'allégresse, lui aussi semble saluer le régime féodal, comme jadis
les compagnons d'Énée saluaient l'Italie, et il s'applaudit « de
finir le traité des Fiefs où la plupart des auteurs l'ont commencé.
» Montesquieu doit beaucoup à ses devanciers, dont il fait parfois un bel éloge. Mais il est loin de savoir exactement tout ce qu'il leur doit ; et son érudition, qu'on a trouvée si fréquemment en défaut, n'est pas en ceci non plus très complète. Aristote avait largement emprunté à Platon, le plus souvent sans le dire ; mais il était son disciple ; et de plus, il ne faisait pas oeuvre d'érudit. Montesquieu n'a pas moins emprunté de Platon et d'Aristote ; et s'il ne les a pas toujours nommés, c'est qu'il a ignoré plus d'une fois les sources où il puisait. Il faut même ajouter, pour être tout à fait juste, qu'il ne les a pas toujours entièrement comprises. Il y a vraiment quelque embarras à prononcer une sentence aussi sévère. Mais les droits de la vérité sont plus sacrés encore que ceux du génie ; et Montesquieu lui-même devrait approuver cette franchise, qu'il nous pardonnera. Que l'on prenne, par exemple, la théorie des trois gouvernements. Il n'en est point de plus importante, non pas seulement pour la science en général, mais pour l'ouvrage de Montesquieu, tel que l'auteur lui-même l'a conçu. Cette théorie est parfaitement claire dans Platon. Elle est plus développée et plus simple encore dans Aristote, qui en a fait comme la trame de son livre, et a transmis ce fécond exemple à ses successeurs. Il semble qu'il n'y ait pas à s'y tromper. Dans la souveraineté, un, plusieurs et tous, voilà les trois seuls termes possibles. Pourtant, que fait l'auteur de l'Esprit des Lois ? Il distingue bien trois gouvernements, qu'il croit recevoir des mains de la tradition. Mais ce sont : le républicain, le monarchique et le despotique. Et Montesquieu ne voit en ceci ni les oublis ni les confusions qu'il commet. En principe, le gouvernement despotique se confond avec la monarchie. Montesquieu lui-même sera forcé de le reconnaître à diverses reprises (liv. III, ch. X, p. 187). Le monarque ne diffère du despote que par l'exercice seul du pouvoir. La tyrannie est une espèce de la monarchie, corrompue et déviée, comme l'ont si bien dit les politiques grecs. Mais au fond ce ne sont pas deux gouvernements distincts ; et de nombreux exemples nous attesteraient, sans sortir de notre propre histoire, que la monarchie absolue se change, toutes les fois qu'elle le veut, en tyrannie, et que rien ne la sépare du despotisme proprement dit que les moeurs et les lumières des peuples auxquels elle s'applique. Helvétius, Voltaire et, après eux, M. Destutt de Tracy ont remarqué cette confusion singulière. Mais elle a eu des conséquences plus graves peut-être qu'ils ne l'ont vu. Elle n'est pas uniquement une faute contre la théorie ; elle a de plus entraîné Montesquieu à donner au despotisme une importance exagérée. Les politiques grecs, vantés si justement par lui, s'étaient bien gardés d'en accorder une aussi grande à la tyrannie. Il faut la flétrir sans doute comme ils l'ont fait, comme l'a fait Montesquieu. Mais si le despotisme est malheureusement le régime auquel est soumise une bonne partie de la terre, les peuples qu'il écrase et qu'il dégrade ne méritent pas l'attention du philosophe. Ce sont presque tous des barbares, sans annales, sans histoire, et dont les destins, en admettant qu'ils nous fussent mieux connus, devraient nous faire horreur ou pitié, mais ne nous instruiraient pas. De là, dans Montesquieu, ces considérations si fréquentes et si peu exactes sur les despotes de l'Orient. De là, ces citations vagues et incertaines de témoignages qui sont au moins douteux, quand ils ne sont pas ridicules. Montesquieu aurait dû se rappeler l'excellente maxime d'Aristote dans sa Politique : « Il importe d'étudier la nature développée suivant ses lois régulières, et non point dans les êtres dégradés. » Helvétius est plus sage et plus pratique que le grand esprit qu'il commente, quand il dédaigne et repousse l'étude d'un pareil gouvernement. Montesquieu ne distingue pas seulement deux gouvernements de principe identique ; il en oublie un de principe spécial ; car la tradition qu'il accepte et qu'il ne prétend pas changer, ne parle que de trois gouvernements. Ce gouvernement oublié dans l'énumération générale, c'est l'aristocratie, celui des trois qui, tout au moins par le nom qu'il porte, doit attirer l'examen le plus sérieux. Mais comme l'aristocratie, bien qu'elle soit à peu près introuvable dans l'histoire des sociétés, y tient cependant une grande place sous la forme dégénérée de l'oligarchie, Montesquieu, après avoir fixé le nombre des gouvernements à trois, est contraint pour être exact, si ce n'est conséquent, d'en ajouter un quatrième, et de faire intervenir cet élément nouveau dans toutes ses théories. C'est ainsi qu'il recherche pour l'aristocratie, tout aussi bien que pour la démocratie, la monarchie et le despotisme, ce que sont sa nature, son principe, ses lois et sa corruption. Sans doute, les cadres transmis à la science par la tradition ne sont pas immuables. Mais il ne faut les changer que pour les rendre plus complets. L'aristocratie est si peu une espèce de la démocratie, que c'est à elle que se sont toujours adressées les haines les plus violentes des peuples, et que la plupart des révolutions démocratiques sont nées des oligarchies excessives. C'est du reste une chose assez remarquable que Montesquieu n'ait pour ainsi dire jamais prononcé le nom de l'oligarchie ; sans doute ce nom lui semblait odieux ; mais pourtant il est essentiel à la science, parce que la puissance de l'oligarchie est encore plus fréquente qu'elle n'est déplorable. Ne pas parler de l'oligarchie, c'est supprimer par une réticence peu louable une bonne partie de l'histoire ; et Platon non plus qu'Aristote n'a point eu cette réserve, dont les mauvais gouvernements ne profitent pas, et qui ne fait tort qu'à la vérité.
Une théorie qui appartient à peu près
en propre à Montesquieu, c'est celle du principe des trois
gouvernements. Il distingue entre la nature du gouvernement qui le
fait être ce qu'il est, et le principe qui le fait agir, ressort qui
le meut. Ainsi, le principe de la démocratie, c'est la vertu ; celui
de la monarchie, c'est l'honneur ; celui du despotisme, c'est la
crainte ; de même que la nature de la démocratie, c'est d'être régie
par le peuple en corps ou par une partie du peuple ; la nature de la
monarchie, d'avoir un chef unique dont le pouvoir est limité par des
lois ; et enfin la nature du despotisme, de n'avoir pour règle que
la volonté du maître, quels qu'en soient les désordres et les
caprices monstrueux. C'est que Montesquieu ne s'était pas aperçu qu'en croyant étudier la monarchie en général, il n'avait réellement étudié que celle de Louis XIV et de Louis XV. L'honneur avait fait faire, il est vrai, beaucoup de choses sous ces deux rois ; mais la vertu politique n'avait pas été tout à fait inconnue du temps qui produisait Vauban, Fabert, Catinat, Fénelon, Montausier et tant d'autres. L'honneur, avec ses délicatesses puissantes et puériles, mène parfois les cours, dont Montesquieu a fait un portrait si peu flatté ; et les cours ne sont connues que dans les monarchies. Mais la monarchie française elle-même avait vécu près de mille ans, sans que ce principe s'y fût développé. Ce n'était donc qu'un accident qui n'exerçait point dans l'État, même quand il y avait passagèrement régné, l'influence décisive que Montesquieu lui prêtait ; et la science ne doit s'attacher qu'à l'essentiel et à l'immuable. Qu'eussent dit les politiques grecs, si on leur eût parlé de plusieurs principes dans l'État ? Supposer qu'on puisse guider les hommes, les citoyens, par des moyens aussi bas ou aussi vains ; supposer qu'on peut transporter de l'État à un individu tous les sentiments qui font la force et le bonheur de la cité ; qu'on peut donner à un roi le dévouement qu'on ne doit qu'à la patrie, et éprouver devant un despote cette crainte salutaire qu'on ne doit ressentir que devant la justice et devant Dieu, c'étaient là des maximes qui auraient bien étonné Aristote et Platon, et qu'ils n'eussent pas comprises sans quelque peine. Au fond, il n'y a qu'un principe dans l'État, tout aussi bien qu'il n'y en a qu'un seul dans l'individu : c'est celui du bien, de la justice, de la raison, auquel sont tenus de se soumettre les citoyens et les magistrats, les tyrans et les sujets, et auquel tous rendent au moins un hommage apparent. Que, d'ailleurs, il arrive trop souvent que ce noble et puissant ressort n'ait pas toute son action, et qu'il soit remplacé par d'indignes expédients, le fait n'est que trop réel. Mais il faut que le philosophe ne l'observe que pour le blâmer ; et il doit craindre, en s'arrêtant trop complaisamment à l'examen de ces vices politiques, à la fois de se méprendre sûr l'humanité et d'encourager ses erreurs. De ces prétendus principes, il en est deux qui méritent si peu l'attention du sage, que ce sont eux précisément qui perdent les États, qu'ils devraient pourtant animer et faire vivre. L'honneur, tel que l'entend Montesquieu, a précipité la ruine de la monarchie française : « Le préjugé de chaque personne et de chaque condition » a contribué à relâcher tous les liens politiques, à fausser tous les vrais rapports du monarque et des sujets; et il s'est trouvé tout à coup qu'une royauté entourée de sa cour dévouée, mais impuissante, fui isolée dans la nation, qui ne la connaissait pas, et qui ne tarda pas à l'anéantir. L'honneur ; « avec ses préférences et ses distinctions, » avait fait un vide immense autour du monarque ; et cette atmosphère factice, qui n'était point à l'usage du reste de l'État, étouffa bientôt ceux même qui croyaient y respirer. Si l'honneur perd les monarchies, la crainte n'est guère plus favorable au despote. Sans doute, il l'impose ; mais il la ressent lui-même ; et le plus souvent il succombe aux conspirations de ses peuples et même de ses favoris. Aristote ne se trompait point quand il proclamait, d'accord avec l'histoire, que le moins stable des gouvernements, c'est la tyrannie, malgré toutes ses précautions et toutes ses manoeuvres. Reste enfin le principe de la vertu pour la démocratie. Celui-là est profondément vrai. Mais Montesquieu aurait dû voir qu'il ne s'appliquait pas seulement aux États démocratiques. La vertu politique, c'est à-dire, l'amour des citoyens pour le gouvernement qui les régit, est la condition nécessaire de durée pour tous les gouvernements sans exception. C'est là un axiome que les politiques grecs ont répété sous toutes les formes, que le bon sens de Voltaire ( Montesquieu dit, dans une lettre à l'abbé de Guasco, août 1752 : « Quant à Voltaire, il a trop d'esprit pour m'entendre. » Le mot est piquant; mais il n'est pas très juste ; les observations de Voltaire le prouvent.) a signalé comme eux, et qui condamne irrévocablement, bien qu'à des degrés divers, et le despotisme, parce que nul ne peut aimer l'injustice, et l'honneur, parce que trop souvent ses maximes subtiles contredisent la raison, qui seule est digne d'être aimée par l'homme. Mais cette théorie du principe des gouvernements, fausse en elle-même, devait en outre porter des conséquences qui ne le sont pas moins. Platon et Aristote avaient donné à l'éducation une importance qui n'avait rien d'exagéré, quelque grande qu'elle fût. Montesquieu a consacré aussi tout un livre de son ouvrage à cet objet essentiel. Mais, entraîné par son système, il pose d'abord en règle que les lois de l'éducation doivent être relatives au principe du gouvernement, et il conclut sans la moindre hésitation que « ces lois, dans les monarchies, doivent avoir pour objet l'honneur ; dans les républiques, la vertu ; et dans le despotisme, la crainte. » Montesquieu a dit certainement des choses pleines de finesse et de grâce sur l'éducation monarchique. Il a de plus rendu toute justice à la mâle éducation que des États de l'antiquité surent imposer à leurs enfants ; parfois même, dans son admiration pour la Grèce et pour Rome, il n'a pas été fort équitable envers son temps, qui n'est guère fait, selon lui, que pour « les petites âmes .» Mais n'est-ce pas se méprendre profondément sur ce noble sujet de l'éducation, que d'ériger, en principes nécessaires et utiles, les aveugles abus qui la faussent et la dénaturent ? Helvétius n'a-t-il pas mille fois raison quand il s'étonne que, dans l'Esprit des Lois, « on enseigne ce qu'il faut qu'on fasse pour maintenir ce qui est mal ; » et qu'on puisse s'imaginer « qu'en matière de gouvernement et d'éducation, il y ait une autre question que de savoir ce qui est le plus propre à assurer le bonheur des hommes. » Une fois sur cette pente, Montesquieu ne peut s'y arrêter, et il en arrive à préconiser le gouvernement des Jésuites au Paraguay, les mettant, en compagnie de Guillaume Penn, sur la même ligne que Lycurgue. Il en arrive à recommander la communauté des biens proposée par Platon, la suppression du commerce et de tous rapports avec les étrangers. C'est vraiment obéir bien aveuglément à la logique ; et les principes qui poussent un tel esprit à de pareilles conséquences sont bien faux, puisqu'ils l'ont tant égaré. Une erreur non moins grave, qui sort des précédentes, remplit tout le livre suivant : c'est que les lois décrétées par le législateur sur toutes les matières doivent être, comme celles de l'éducation, relatives au principe du gouvernement. Les lois, pour être bien faites, sont donc tenues, dans les républiques, d'inspirer la vertu, c'est-à-dire l'amour de l'égalité et de la frugalité ; dans les monarchies, de se rapporter à l'honneur, « enfant et père de la noblesse ; » enfin dans les États despotiques, où elles sont d'ailleurs fort peu nombreuses, de maintenir perpétuellement les sujets dans la terreur. Montesquieu attache à tout ceci tant d'importance que ses considérations sur le despotisme sont plus longues que celles qu'il consacre à la démocratie et à la monarchie ; et comme dans un tel chemin on ne peut faire que de faux pas, c'est là qu'il se déclare pour la vénalité des charges. Afin de justifier ce déplorable abus, il en vient à préférer l'avis de Suidas et d'Anastase à celui de Platon. Mais « Platon, ajoute-t-il, parle d'une république fondée sur la vertu, et nous parlons d'une monarchie. Or, dans une monarchie où, quand les charges ne se vendraient pas par un règlement public, l'indigence et l'avidité des courtisans les vendraient tout de même, le hasard donnera de meilleurs sujets que le choix du prince. » Et l'on sait de quelles charges Montesquieu entend parler. Ce n'est pas seulement des charges de finances ; c'est encore des charges de judicature ; et le préjugé est si fort en lui qu'il ne balance pas à sanctionner ce monstrueux trafic, qui en entraîne tant d'autres plus monstrueux encore. En ceci, il faut en revenir aux principes qu'Aristote posait, en blâmant la vénalité des charges à Carthage : « Il est naturel que ceux qui ont acheté leurs charges cherchent à s'indemniser par elles, quand, à force d'argent, ils ont atteint le pouvoir. L'absurde est de supposer qu'un homme pauvre, mais honnête, veuille s'enrichir, et qu'un homme dépravé, qui a chèrement payé son emploi, ne le veuille pas. » Les philosophes grecs en savaient sur ce point délicat beaucoup plus que le publiciste du XVIIIe siècle, bien qu'ils n'eussent pas sous les yeux tant d'abus et de hontes.
Autres égarements qui découlent de la
même source. Montesquieu réclame, quoique assez timidement, contre
la torture, et il n'ose pas aller au delà de cette déclaration : «
qu'elle n'est pas nécessaire par sa nature, puisqu'une nation
très-bien policée, la nation anglaise, a pu la rejeter sans
inconvénient. » Mais comme la sévérité des peines convient
évidemment au gouvernement despotique, dont le principe est la
terreur, Montesquieu voudrait maintenir la torture dans ce
gouvernement. Il l'y trouverait convenable. Il irait presque jusqu'à
justifier les atrocités des Grecs et des Romains contre leurs
esclaves ; mais « il entend la voix de la nature qui crie contre lui
; » et il s'arrête dans cette triste route, où l'a poussé l'exigence
d'un faux système, et où la voix des sages, avant celle de la
nature, n'avait pu le retenir. Enfin Montesquieu, méconnaissant les témoignages de l'histoire, et spécialement ceux de l'histoire romaine, soutient que la république est faite pour les États de petite étendue, la monarchie pour les États d'étendue médiocre, et que le despotisme seul est capable de régir un grand empire. Il cite en preuve la Chine, que l'on connaissait fort peu de son temps, que nous connaissons encore fort mal même aujourd'hui ; et il récuse l'exemple de la monarchie espagnole, où le despotisme a été certainement moins fatal que le fanatisme religieux, et que « la superstition furieuse, » dont il l'accuse avec tant de raison. Il serait possible de signaler encore dans Montesquieu d'autres erreurs, que lui a inspirées cette fausse théorie du principe des gouvernements. Mais ne vaut-il pas mieux s'attacher à ce qu'il y a d'admirable dans l'Esprit des Lois ? Jamais ces graves matières que règle la législation chez tous les peuples, n'avaient été étudiées avec tant de largeur de vues, tant de clarté, et l'on peut ajouter, avec tant de charme. Après la théorie générale des gouvernements, la guerre défensive et offensive, la liberté constitutionnelle et civile, les impôts, le climat, l'esclavage civil, domestique et politique, le territoire, les moeurs, le commerce, la monnaie, la population, la religion, etc., Montesquieu passe tout en revue ; et sur tous ces sujets, il répand d'éclatantes lumières. Il ne les emprunte pas, comme un autre aurait pu tâcher de le faire, à la seule raison ; il les demande le plus souvent à l'histoire, interprétée par une sagacité supérieure. Les législateurs de tous les temps, les moeurs de tous les peuples, les témoignages de tous les historiens, les idées de tous les philosophes, sont mis à contribution, si ce n'est toujours avec une parfaite exactitude, du moins avec une ardeur et une vivacité d'esprit qui font beaucoup lire et beaucoup penser. Montesquieu, qui, dans les Lettres Persanes, avait porté la critique et l'amour du paradoxe jusqu'à l'audace, est encore novateur dans son grand ouvrage ; mais il l'est avec plus de réserve, en même temps qu'il l'est avec plus de gravité. Respectueux, quoique toujours indépendant envers la religion, il signale avec force les abus de l'Église ; il veut limiter les richesses du clergé ; il montre les dangers et l'inutilité du monachisme et des couvents. Son éloquence contre le tribunal atroce de l'inquisition et contre l'esclavage des nègres, ne perd rien de son énergie pour être railleuse. Il se fait l'apôtre de la raison et de l'humanité, à un moment du XVIIIe siècle où ces nobles questions n'étaient encore traitées que par quelques écrivains, et n'étaient point devenues en quelque sorte le mot d'ordre de la philosophie. Il révèle à la France l'importance de son droit féodal, trop peu compris et trop oublié. Il donne un attrait puissant à ce sujet, qui tient sans doute beaucoup trop de place clans l'Esprit des Lois, mais qui est rempli d'intérêt pour la nation. Il lui rendait un plus grand service encore en lui expliquant le mécanisme d'un gouvernement voisin, et en offrant à tous ceux qui dès lors entrevoyaient la réforme politique de la monarchie, un texte pour les plus sérieuses et les plus fécondes méditations. L'analyse de la constitution anglaise, telle que la présente Montesquieu, peut nous sembler aujourd'hui insuffisante, et même peu exacte. Lui-même contredisait ses propres théories ; et l'un des trois pouvoirs dont l'accord était, suivant lui, la base même de la constitution d'Angleterre, n'y occupait en réalité aucune place : c'était le pouvoir judiciaire. Mais malgré ces défauts, cette analyse, alors si nouvelle, dut frapper bien vivement tous les esprits, en donnant une direction à peu près unanime à toutes les espérances. Le temps s'est rangé du côté de Montesquieu. La France n'a pas copié la constitution anglaise ; mais, par la force même des choses, elle a dû essayer de fonder son gouvernement sur des principes analogues, bien qu'avec des éléments très dissemblables. Ce qu'il y a d'admirable dans la constitution anglaise, c'est une certaine pondération du pouvoir, assez sage pour lui laisser toute son action, en lui ôtant presque tous ses excès, et assez équitable pour satisfaire suffisamment toutes les prétentions légitimes qui se disputent la gestion des intérêts sociaux. Seulement Montesquieu obéissait un peu trop à ce goût du paradoxe et de la singularité qui l'avait égaré plus d'une fois, en prétendant que « les Anglais ont tiré des Germains l'idée de leur gouvernement, et que ce beau système a été trouvé dans les bois. » Cette étrange opinion a été réfutée ; mais souvent aussi elle a été reproduite depuis Montesquieu, et sous l'égide de son grand nom. Elle n'en est pas moins fausse. L'Angleterre n'a dû qu'à la force de certaines circonstances le bonheur d'avoir la première une forme de constitution politique, où tous les éléments sociaux sont combinés ; et ce juste équilibre des pouvoirs est si bien le résultat des lumières et de la civilisation, que, dès l'antiquité, la raison des sages, qui devance toujours de si loin celle des peuples, avait entrevu cette profonde solution du problème social. Si Montesquieu avait lu Platon plus attentivement, il aurait pu lui faire honneur de cette découverte avec plus de justice peut-être qu'aux sauvages compagnons d'Arminius.
Le style de l'Esprit des Lois a
certainement contribué beaucoup à son succès. Cependant on peut y
trouver plus d'un défaut. Voltaire, ardent admirateur de
Montesquieu, tout en le critiquant, les a souvent signalés avec un
goût infaillible, et ils ne sont que trop réels. Il est vrai que les
qualités qui les rachètent sont éblouissantes, et que c'est grâce à
elles surtout que, ce sérieux sujet a été tant lu et tant médité. Le
mot de madame du Deffand, pour être mordant, n'en reste pas moins
juste ; il n'est pas un lecteur intelligent qui ne le répète, et que
ne choquent ces saillies, qu'il fallait laisser dans la bouche
d'Usbeck, et ces recherches de langage qui ne conviennent guère
qu'au Temple de Guide. On se rappelle que Montesquieu voulait placer
son livre sous la protection des Muses, et que ce n'est pas sans
peine que le bon sens d'un de ses amis lui fit retrancher
l'invocation qui devait ouvrir le second volume de l'Esprit des
Lois. L'auteur croyait que « cette singularité pouvait devenir une
raison de succès pour un ouvrage où il faut, plus que dans tout
autre, songer à délasser le lecteur, à cause de la longueur et de la
pesanteur des matières. » Il est encore resté des traces de ce goût
bizarre ; et l'on peut lire, non sans quelque surprise, en tête du
livre XXIII, sur la population, l'invocation de Lucrèce à Vénus.
Sans doute Montesquieu avait raison de vouloir rendre, s'il le
pouvait, attrayant et facile l'austère sujet qu'il traitait ; mais
qu'il est délicat de donner à ces graves matières l'ornement qui
leur sied ! Platon y a réussi. Mais Montesquieu ne faisait pas des
dialogues. Le cadre qu'il s'était imposé ne comportait pas les
libertés qu'il a prises, et que le bon goût ne peut pas toujours
approuver. La première et la plus indispensable qualité du style,
c'est d'être propre au sujet. Aristote en avait donné un modèle
excellent ; et l'on pouvait suivre ses traces, tout en étant un peu
moins sévère que lui.
Mais, en dépit de toutes nos conquêtes
et de tous nos progrès, la place prise par l'Esprit des Lois, il y a
précisément un siècle, est encore parmi nous occupée par lui seul.
Pour trouver quelque chose de plus grand, il faut remonter aux temps
d'Aristote et de Platon. Mais les sources antiques, quelque
abondantes qu'elles soient, ne sont visitées que rarement, parce
qu'il faut, pour les goûter, savoir accorder fort peu à la curiosité
de l'esprit, et donner beaucoup à la raison, s'intéresser moins à ce
qui a été qu'à ce qui doit être, et préférer la calme étude de la
justice au spectacle tumultueux de l'histoire. Montesquieu a, pour
nous éclairer et nous plaire, vingt-deux siècles d'expérience de
plus, l'empire romain tout entier, le christianisme, l'invasion des
barbares et les annales de toutes les nations modernes. II connaît
et nous fait connaître plus de choses que Platon et Aristote. Les
connaît-il plus profondément ? C'est ce dont il est permis de douter
; ou, pour mieux dire, quelque instruit qu'il soit, il pourrait
encore s'instruire à l'école de ces maîtres, qu'il n'a point assez
pratiquée, tout en la pratiquant beaucoup. Ce qui lui manque
surtout, et ce qui fit la gloire et la grandeur de la politique
platonicienne, c'est l'idée de la perfection. Il a trop souvent
transigé avec les préjugés et les abus de son temps. « L'idée de la
perfection, » comme le lui disait si bien Helvétius, dans un conseil
sincère et sage, « ne fait à la vérité qu'amuser nos contemporains ;
mais elle instruit la jeunesse et sert à la postérité. » Il était
digne de Montesquieu de pressentir un avenir qui était si prochain,
et ce n'est pas trop demander à son génie que de croire qu'il
pouvait, à quarante ans de distance, précéder la Constituante et la
Déclaration des Droits.
Polybe n'est pas précisément un
écrivain politique. C'est un homme de guerre et un historien. Il vit
un siècle et demi environ après Aristote il assiste à la ruine de la
Grèce, qu'il défend avec un patriotisme sage mais inutile. Il
assiste surtout au prodigieux spectacle de la puissance romaine,
qui, victorieuse de Carthage, s'avance à grands pas, et désormais
sans danger, vers la domination universelle ; et pour faire
comprendre à son siècle et à la postérité le secret de ces
événements inouïs, il se propose de raconter la suite des faits qui,
dans l'espace de cinquante ans, de la seconde guerre Punique à la
chute du royaume de Macédoine, ont préparé au peuple romain l'empire
du monde. Il réside de longues années à Rome, intimement lié avec
les Scipions, dont il instruit les fils dans l'art de la guerre et
de la politique. Il visite les contrées principales du monde
civilisé, l'Égypte, l'Afrique, l'Espagne, la Gaule ; et il connaît
aussi bien le théâtre où la puissance romaine va dominer, que les
ressorts puissants qui lui assurent son inévitable conquête. Lorsque
Polybe écrit, il a pour s'éclairer l'expérience d'une vie consacrée
aux affaires, et traversée par les plus rudes épreuves. Il a fait
personnellement la guerre et l'a vue pendant longtemps, et le
commerce continuel des plus illustres personnages a fortifié encore
son esprit naturellement observateur et profond. Aussi ne se
contente-t-il pas de raconter les faits ; il veut en tirer d'utiles
enseignements, et il déclare, en commençant son récit, que
l'histoire est la véritable école de la politique. voilà comment,
parvenu au sixième livre, il interrompt sa narration pour remonter à
la cause de ces merveilleux succès, et demander à la constitution de
Rome le secret de tant de triomphes.
Mais cette analyse de Polybe
n'intéresse pas seulement l'histoire, la science politique doit y
jeter aussi un regard. C'est à la science qu'appartiennent les
principes qui ont éclairé l'historien, et ils marquent un progrès et
un changement dignes de quelque attention. Polybe ne se borne pas à
louer la constitution de Rome ; il la proclame la plus parfaite de
toutes celles qui ont existé, parce que c'est elle qui a valu au
peuple heureux qui la possède la plus vaste et la plus solide
domination. Les Perses, les Lacédémoniens, les Macédoniens, malgré
l'étendue de leur empire, leur héroïsme, leur courage, ne peuvent
entrer en parallèle avec les Romains, qui ont subjugué l'univers.
Mais à quoi tient cette excellence de la constitution romaine ? A
une seule cause : elle a réuni et sagement combiné tous les
principes que les autres États n'ont développés qu'isolément. La
monarchie, l'aristocratie, la démocratie y sont si habilement
mélangées, qu'il serait impossible de dire précisément si cet État
est monarchique, aristocratique ou démocratique. Les consuls, le
sénat, le peuple, ont chacun une juste part aux affaires, et l'exact
équilibre de ces trois puissances a fait la stabilité et la grandeur
de l'empire. Mais en signalant à l'imitation des peuples et aux méditations des sages les savantes combinaisons de la constitution romaine, Polybe croit qu'il adopte en politique la seule méthode qu'il convienne de pratiquer. On dirait qu'il ne veut rien devoir à la raison, et qu'il demande toute la science à l'observation des faits extérieurs. S'il a comparé quelques instants l'empire des Perses et les royaumes de Sparte et de Macédoine à la république de Rome, c'est parce que ces États, bien que fort inférieurs, ont vécu comme elle d'une vie réelle et puissante. Mais il se reprocherait d'arrêter un seul moment ses regards sur cette république idéale proposée par Platon. « L'expérience n'en a pas démontré la véritable valeur. Établir un parallèle entre cette République, telle qu'elle a été jusqu'ici dans les livres, et celles de Rome, de Lacédémone et de Carthage, serait l'erreur d'un artiste qui s'en irait comparer des statues à des hommes vivants, fussent-elles, sous le rapport de. l'art, admirables de tout point. La comparaison d'un objet inanimé avec des êtres qui respirent ne saurait jamais être que défectueuse et déplacée (Polybe, ibid., p. 366.) » Ainsi Polybe ne voit pas ce que la science politique doit à Platon. Choqué de quelques erreurs trop évidentes, il oublie toutes les vérités pratiques que Platon a découvertes ou démontrées ; et il rejette du même coup la méthode rationnelle pour y substituer exclusivement la méthode historique, employée déjà par Aristote, mais avec plus de réserve. Cet exemple sera dangereux ; et, depuis Polybe, l'histoire usurpera trop souvent une place qui ne lui appartient point. La politique, ainsi conçue, devient une sorte d'empirisme, qui n'aura plus de règle que le succès et la victoire. La morale aura disparu de ses théories, la justice ne sera plus qu'un vain mot, et Machiavel pourra quelque jour, en toute sûreté de conscience, et sous la dictée des faits, tracer le portrait monstrueux de son Prince. Cette nouvelle méthode est due à un homme d'action, à un historien qui n'en a pas aperçu d'abord toutes les conséquences, et qui les eût certainement repoussées, plus scrupuleux ou moins conséquent que ses imitateurs. D'ailleurs Polybe est loin d'être aveugle dans son enthousiasme; il sait bien que « tout ici-bas est sujet au changement et à la mort ; » il connaît la loi fatale qui régit les gouvernements comme les individus, et « le cercle où roulent les constitutions. » A l'en croire, la constitution romaine atteignait déjà sa perfection à l'époque même d'Annibal. Bientôt à la maturité doit succéder « la décadence, qui commencera par la passion de dominer et par la jalousie de ceux qui seront hors du pouvoir, puis , par le faste et l'orgueil des particuliers. » (Polybe, ibid., p. 536.) Polybe n'ose pas appliquer directement ces infaillibles et sinistres prédictions à la ville des Scipions ; il craindrait peut-être de blesser ses amis. Mais l'histoire, impitoyable dans ses enseignements, lui apprend qu'une démocratie corrompue engendre nécessairement la tyrannie ; et ne dirait-on pas d'un prophète, quand on entend Polybe exprimer ces tristes pressentiments : « Des ligues se forment ; ce ne sont plus qu'animosités, proscriptions et partages de terre, jusqu'à ce qu'au milieu de ses fureurs, la multitude trouve encore un maître qui la ramène à la monarchie ? » (Ibid., p. 495.) Polybe écrivait quarante ans environ avant Sylla, et soixante ans avant César ; il ne s'est pas fait illusion sur la destinée prochaine de cette constitution qu'il admirait si passionnément. Mais il ne s'est pas dit, bien que Platon pût le lui apprendre, que la guerre, source de tant de puissance et de tant de corruption, n'est pas le but que l'État doit se proposer, et que ce funeste principe ferait bientôt expier aux Romains les triomphes et les richesses qu'il leur avait valus. Ainsi, l'on peut trouver dans Polybe une excellente théorie, démontrée par un grand exemple, celle des constitutions mixtes, et une méthode périlleuse, qu'il n'a point inventée, mais dont il use déjà trop peu sobrement, sans la porter aux excès où d'autres la pousseront plus tard. Par un concours assez singulier de circonstances, Cicéron a pu être tout ensemble l'admirateur et le disciple de Polybe, d'Aristote et de Platon. Il leur emprunte à tous trois ses principes, ses théories, l'idée et le titre de ses ouvrages, et parfois des morceaux tout entiers. Mais il ne se cache pas de ses emprunts. Il ne les ignore pas non plus, comme il est arrivé à quelques écrivains politiques, et il cite souvent ses devanciers, avec des éloges qui justifient l'imitation qu'il en a faite. A Polybe, il a pris son admiration pour la constitution de Rome ; et le consul, qu'anime le plus sincère patriotisme, se montre plus ardent encore dans son enthousiasme que le grave historien de Mégalopolis. Comme lui, Cicéron repousse la république imaginaire de Platon, dont il sent d'ailleurs la beauté, et même l'utilité, beaucoup mieux que n'avait pu le faire un homme de guerre ; comme lui encore, il évite de rechercher la meilleure forme de gouvernement, et il donne la constitution romaine pour le modèle réel et parfait, auquel il convient de mesurer toutes les autres. Il est également le partisan des constitutions mixtes ; et selon lui, comme selon Polybe, si Rome a été puissante et prospère, c'est qu'elle a su pondérer les pouvoirs dans un juste équilibre, et faire une part équitable aux trois principes, en évitant le développement exclusif d'un seul, qui a perdu tant d'autres Etats. La monarchie, l'aristocratie, la démocratie, vivent ensemble dans la constitution romaine, assurant ensemble et l'égalité et la liberté des citoyens. Non seulement Cicéron admire l'organisation politique de Rome, mais il n'admire pas moins ses lois, qu'il propose au respect et à l'imitation de tous les autres peuples. Il ne faut pas s'étonner que Cicéron suive d'aussi près les traces de Polybe. Le principal interlocuteur de sa République est Scipion, le second Africain, l'élève du général grec ; et l'esprit historique de Polybe anime partout l'entretien que Lélius a provoqué de son illustre ami. Cependant Scipion peut croire ne parler qu'en Romain, parce qu'en effet le savant étranger dont il reproduit les théories, avait parlé de Rome aussi bien qu'eût pu le faire un des enfants les plus instruits de la ville éternelle. Mais à côté de Polybe, Cicéron consulte encore un autre inspirateur plus puissant et plus profond : c'est Platon. A Platon d'abord, il a demandé le titre de ses deux principaux ouvrages politiques, la République et les Lois. Il lui en a même demandé la forme ; et ses dialogues ont montré, dans une langue peu philosophique, non pas un rival, mais parfois un heureux imitateur d'une grâce dont le disciple de Socrate a gardé le secret. Bien plus, il lui a demandé toutes ses théories essentielles sur la nature du pouvoir social, et sur le but que ce pouvoir doit se proposer. Cicéron a rendu au principe de la justice des hommages parfois dignes de Platon lui-même ; et ces nobles études que la Grèce avait instituées, trois siècles auparavant, sur l'organisation et le destin des sociétés, furent alors pour la première fois connues de Rome et appréciées à toute leur valeur. Ce fut la gloire de Cicéron de les populariser en les revêtant de son style ; et ce patronage leur servit à la fois dans le monde romain et dans le Moyen âge, qui, sans lui, auraient eu beaucoup plus de peine à les connaître et à les goûter. D'ailleurs, Cicéron ne s'est pas donné pour un inventeur ; sa modestie s'est bornée à se faire l'interprète des pensées d'autrui ; dans l'histoire de la science politique, il joue le rôle qu'il joue dans le reste de la philosophie, celui de traducteur intelligent et fidèle. Le génie romain n'a point en général été davantage ; et quand on a devant soi Aristote et Platon, ce qu'on peut faire de mieux, c'est de les reproduire, quand on ne peut les surpasser. Les ouvrages de Cicéron manquent donc d'originalité ; ils sont infiniment précieux pour l'histoire de la philosophie et celle du droit romain ; ils sont loin de l'être autant sous le rapport de la science politique, qu'ils ont entretenue, mais qu'ils n'ont pas développée. L'idée principale de la République et des Lois est dans Polybe ; le genre de la composition appartient à Platon, qui, avec Aristote et Polybe, a fourni presque tous les détails ; le style seul est à Cicéron, avec les admirables qualités qui le distinguent, et qui en font un écrivain de la famille de Platon et de Voltaire tout ensemble. De Cicéron à Machiavel, il faut franchir un espace de quinze siècles à peu près sans rencontrer un seul monument. Le Moyen âge étudiait peu les ouvrages politiques de Platon et d'Aristote, parce qu'il n'avait guère à les mettre à profit. On spéculait rarement, dans ces époques de désordre social, sur les lois essentielles des sociétés. Mais les théories, en très petit nombre, qui se montrent alors, sont toutes empruntées à la politique grecque, ou sont inspirées par elle. Le livre faussement attribué à saint Thomas, de Regimine principum, et les Questions de Buridan sur la Politique d'Aristote, voilà tout ce que l'on peut citer. On y trouve parfois des pensées audacieuses de liberté politique, que notre temps même ne dépasse point ; ce sont des échos de la liberté grecque et romaine, et les pouvoirs les tolèrent, parce qu'elles ne tirent point à conséquence. Mais avec Machiavel, à la fin du XVe siècle et au début du XVIe, la science politique prend un développement original et nouveau. Il appartenait à l'Italie de le lui donner, parce que c'était la terre où avait vécu la tradition de la politique romaine, bien qu'elle y fût étrangement corrompue, et par les papes, et par les petits princes qui dominaient et désolaient depuis longtemps cette malheureuse contrée. On a tout dit sur l'exécrable politique de Machiavel, et son nom seul est devenu une sorte d'opprobre pour les hommes d'État même les plus pervers. Ce ne sont pas uniquement les moralistes qui l'ont flétrie. Les rois, à l'usage desquels on prétendait qu'elle avait été faite, l'ont hautement répudiée ; et ,le grand Frédéric s'est honoré en la réfutant avec plus d'énergie que personne. Cet anathème universel est mérité, et il est impossible de ne pas le sanctionner quand on a lu le Prince avec quelque attention. La pensée de l'auteur, bien qu'elle ait été diversement interprétée, est fort claire. Ce sont des conseils qu'il veut donner à Laurent de Médicis, et il lui offre les maximes du Prince comme le fruit le plus précieux qu'il ait pu recueillir de sa propre expérience, et de ses études sur l'histoire des personnages les plus célèbres. C'est Machiavel lui-même qui l'avance dans sa dédicace, et la postérité doit l'en croire. Ce n'est donc pas un jeu d'esprit, comme on l'a supposé quelquefois ; c'est une étude sérieuse, profonde et pleine de la sagacité la plus rare, si l'immoralité en est flagrante. Il semble que Machiavel a perdu tout discernement du bien et du mal ; il conseille le crime sous toutes ses formes avec le plus calme sang-froid. Les personnages qu'il prend le plus ordinairement pour modèles sont ceux que l'horreur publique a signalés comme des monstres : c'est César Borgia ; c'est son abominable père Alexandre VI ; ce sont leurs instruments devenus leurs victimes, Ramiro, Oliverotto; c'est, dans l'antiquité, Agathocle : misérables tout couverts de sang, souillés d'atroces parjures ou de forfaits plus repoussants encore. Si par hasard Machiavel risque contre eux quelque blâme, ce n'est presque jamais aux crimes qu'il s'adresse ; c'est aux fautes de conduite, à des peccadilles, auxquelles vraiment ce grand esprit attache une importance presque ridicule. Il dit en propres termes, en parlant du duc de Valentinois : « Je ne saurais lui reprocher d'avoir manqué à rien ; il mérite qu'on le propose, comme je l'ai fait, pour modèle à tous ceux qui, par fortune ou par les armes d'autrui, sont arrivés à la. souveraineté avec de grandes vues et les plus grands projets. » Voilà donc tous les crimes de César Borgia jugés dignes d'une apothéose. Mais il a fait une faute dans sa vie, une seule ! c'est d'avoir laissé Jules II monter sur le trône pontifical, et de ne lui avoir pas donné l'exclusion. Ce n'est pas Machiavel qui a trouvé cette affreuse maxime, inventée plus tard : « C'est plus qu'un crime, c'est une faute ; » mais on le voit, si la formule n'est pas chez lui aussi précise, la pensée n'en est pas moins la même, et cette pensée est hideuse. Après avoir traité des principautés diverses et des milices, Machiavel trace le tableau des vertus que le prince doit posséder, et il mesure avec une exactitude parfaitement ingénieuse ce que doivent être la libéralité et la parcimonie, la cruauté et la clémence, la bonne foi et la ruse. Il approuve sans la moindre hésitation le mensonge, le parjure, le poison, l'assassinat, toutes les fois que ces moyens atroces peuvent être utiles. Le seul point, c'est de se maintenir dans son autorité, peu importe à quel prix, et le succès absout les attentats. Si Machiavel proscrit la flatterie, c'est qu'elle est dangereuse en dissimulant le véritable état des affaires ; ce n'est pas parce qu'elle ment, c'est parce qu'elle aveugle et qu'elle peut perdre. Pour peindre d'un mot toute cette politique, c'est le génie appliqué à la scélératesse. Deux choses doivent surprendre dans Machiavel : c'est qu'il ait pu consacrer à des théories aussi repoussantes d'aussi rares facultés, et ensuite qu'un esprit qui se croyait positif ait pu se repaître de si vaines chimères. On dirait vraiment que l'histoire ne lui a rien appris, non plus que la conscience. L'exemple de tous ces brigands, un instant heureux et bientôt écrasés des plus justes châtiments, ne l'a point détrompé. Il ne voit pas que la fortune fondée sur le crime est la plus instable de toutes, et que le succès, auquel il prétend tout immoler, humanité, vertu, religion, ne s'achète pas à ce prix. Cette politique est donc aussi absurde qu'elle est effroyable, et l'on pourrait croire que Machiavel, en la préconisant, partage ce vertige et cette ivresse dont le crime est toujours atteint. On ne voit pas d'ailleurs à qui peut servir un tel enseignement. Les scélérats n'ont que faire qu'on les instruise ; leurs passions forcenées et les occasions soin d'incomparables maîtres, et ce n'est pas Machiavel apparemment qui a formé le Valentinois. Rousseau, dans un de ses accès de paradoxe, a dit, en reproduisant une idée de Bacon, que le Prince devait être le livre des républicains (Contrat social, liv. III, ch. VI). Les amis de la liberté n'ont pas attendu ce manuel pour exécrer et châtier les tyrans, et le Prince n'a pas contribué à la délivrance de l'Italie, malgré le voeu patriotique qui le termine. Les seuls hommes auxquels ce livre puisse plaire et s'adresser, ce sont les scélérats qu'il peint, et qui ne se seraient pas crus dignes de tant d'étude et de tant d'admiration. Ce n'est pas à dire que le Prince ne contienne que cet affreux venin. Loin de là ; un esprit sage et ferme peut y profiter beaucoup ; il y peut apprendre tout ce que les affaires exigent de vigilance, d'activité, de résolution, et tout ce que la volonté de l'homme peut opposer de ressources à la fortune. Il ne faut parfois que changer le but : à la place du succès mettez le bien, et bon nombre des conseils de Machiavel deviendront aussi utiles qu'ils sont judicieux. Il avait lui-même une pratique consommée des affaires ; et comme il n'avait point été prince, il avait personnellement moins cultivé le crime que les qualités qui font le véritable homme d'État. En passant du Prince aux Discours sur les Décades de Tite-Live, on respire plus à l'aise ; on quitte la politique des assassins et des parjures pour celle du plus grand des peuples ; et bien que la manière de Machiavel ne change pas, bien que les principes restent à peu près les mêmes, l'effet général de l'ouvrage est très différent. On le comprend sans peine : quand il s'agit de sauver Rome, la ville éternelle, les maximes du sénat peuvent être quelquefois presque impunément celles des petits souverains dont Machiavel nous a donné, dans le Prince, les hideux portraits. La grandeur et la majesté du but ont dû couvrir jusqu'à un certain point l'immoralité des moyens, aux yeux même de ceux qui les employaient. On peut dire avec les consuls et les dictateurs : Salus populi suprema lex esto ; on ne peut pas le dire avec César Borgia. Sans doute, il n'est pas permis, fût-ce pour le salut d'une nation, de violer les lois de la morale ; et il est préférable de laisser périr les colonies plutôt qu'un principe. Mais le patriotisme excuse bien des erreurs et bien des crimes pour les juges vulgaires. Au contraire, l'égoïsme et l'intérêt d'un individu ne sont jamais que des motifs misérables ; car il n'est pas possible, malgré ce qu'en a pensé Machiavel, d'avoir de grands projets quand on n'a que soi-même en vue. Machiavel a deux mérites considérables dans les Discours. D'abord il y donne sur toutes les matières de gouvernement, et selon que les faits se présentent, les résultats les plus exquis de son expérience personnelle et les vues de son génie sur le maniement des affaires. Comme les résolutions du sénat et du peuple Romains sont la plupart du temps inspirées par les sentiments les plus magnanimes, et que les événements sont immenses, Machiavel se met sans peine à la hauteur de tant d'héroïsme, de vertu, de sagesse ; il ne laisse paraître que de loin à loin ce fonds déplorable qu'il avait puisé à la politique de son temps. En second lieu, il explique. les ressorts de la puissance Romaine et le véritable sens des faits historiques avec une incomparable sagacité. Il la doit sans doute en bonne partie à Polybe, qui le premier avait su jeter des regards assurés dans les détours de ce prodigieux édifice. Mais Polybe, s'il est l'inventeur de cette méthode, ne l'avait pas appliquée clans toute son étendue ; les destins de Rome n'étaient pas encore accomplis quand Polybe écrivait ; et bien qu'il prévît la décadence prochaine, il n'avait que le spectacle du triomphe, et ne pouvait avoir celui de la chute qu'il pressentait. Machiavel a eu l'enseignement complet, et il en a tiré les plus précieuses leçons. L'histoire, comprise comme il la comprend, serait une école de politique à peu près infaillible, si la pureté morale de l'intelligence qui l'étudie était égale à la pénétration du coup d'oeil qui la scrute.. Montesquieu n'avait donc que bien peu de chose à faire après ses deux prédécesseurs. Les Considérations sur la grandeur et la décadence des Romains sont à la fois un résumé et un développement de Polybe et de Machiavel. Polybe a ouvert la voie ; Machiavel l'a beaucoup agrandie en prenant les Décades de Tite Live pour canevas ; Montesquieu n'avait plus qu'à les suivre l'un et l'autre, en appliquant avec plus de méthode et de régularité, à l'histoire tout entière de Rome, les idées que celui-ci avait dû borner à la seconde guerre contre Carthage ; et celui-là, sur les pas de Tite Live, aux premiers siècles de la République. C'est sans doute en s'inspirant des maximes du sénat Romain que Machiavel s'est montré si indépendant envers la religion : il la traite uniquement en homme politique, et il soumet sans hésiter le pouvoir spirituel au pouvoir temporel. Cette question, si grave dans les temps modernes, n'en était pas une heureusement pour les philosophes de l'antiquité. Jamais l'antagonisme des deux puissances ne les avait occupés, parce qu'il n'avait jamais existé dans l'État. Il était réservé au Moyen âge de voir cette division désastreuse, qui tenait d'ailleurs aux causes les plus profondes. Mais à la fin du XVe siècle, il était rare que les esprits fussent sur ce problème aussi décidés que Machiavel ; il est un des premiers qui se soient rangés du côté du pouvoir politique, et qui aient soutenu la vraie solution. L'Église ne s'y est pas trompée, et l'historien de Florence a été un des ennemis qu'elle a le plus craints et le plus haïs. En outre, Machiavel attribuait à la papauté la désunion fatale de l'Italie. C'était la papauté, suivant lui, qui livrait la patrie commune à l'invasion de l'étranger ; les reproches du patriote étaient amers et justes ; l'indépendance du publiciste paraissait une hérésie et une insulte. De là, les calomnies dont l'Église n'a pas cessé de poursuivre la mémoire de celui qui l'avait si bien jugée, et qui la blâmait avec une liberté redoutable. Ce qu'on peut admirer sans réserve dans Machiavel, c'est son style. Les Discours sur les Décades ne sont pas, il est vrai, un ouvrage très bien composé ; ils présentent souvent peu d'ordre et de méthode. Le Prince même, quoique plus régulier, n'est pas à l'abri de toute critique. Mais si l'ensemble n'est pas irréprochable, les détails sont parfaits. Platon, Aristote, Montesquieu, Polybe, Cicéron, ont tous leur manière et leur grandeur. Mais le style de chacun d'eux a ses défauts : celui de Platon, tout incomparable qu'il est, ne peut être la forme de la science ; celui d'Aristote est un peu trop didactique ; celui de Montesquieu est trop brillant, et n'est pas toujours assez grave Polybe a souvent la sécheresse du commandement, sans exclure la prolixité du pédantisme ; Cicéron est trop élégant et trop littéraire. Machiavel seul a le vrai style des affaires et de la politique : simplicité, justesse, vigueur, concision, mouvement. Il est plus occupé des choses que des mots, et l'homme d'État ne saurait prendre pour écrire un meilleur modèle ; les principes ne valent rien, mais la forme qui les revêt est accomplie. Ce qui manque surtout à Machiavel, ce sont les idées générales ; il les proscrit non seulement dans la théorie, dont il s'occupe fort peu, mais surtout dans la pratique ; il veut que l'homme d'État vraiment intelligent s'inspire des circonstances ; et comme il voit souvent dans l'histoire les mêmes résultats obtenus par des moyens très différents, il repousse comme dangereuses toutes les maximes inflexibles. L'une et l'autre conduite lui semblent également bonnes, et il prouve, par l'exemple frappant de Scipion et d'Annibal, que les qualités les plus contraires peuvent amener des effets absolument identiques. Quels que soient les mérites de Machiavel, sa politique n'en reste pas moins justement flétrie et son nom déshonoré. Comment un tel esprit a-t-il pu tomber dans ces déplorables égarements ? Comment des yeux aussi sagaces ont-ils à ce point méconnu la vraie lumière ? On en peut fournir deux raisons. D'abord, la perversité du coeur, qu'aura développée l'habitude des affaires, et dont tout lui donnait l'irrésistible exemple autour de lui ; puis ensuite, sa méthode, qu'il n'a point inventée, mais qu'il a poussée à l'extrême. La méthode historique discrètement employée par Platon avait déjà produit quelques conséquences peu louables dans Aristote. Ces conséquences sont plus fâcheuses encore dans Polybe, qui croit trouver la perfection dans la constitution Romaine. Cicéron tempère, grâce à son enthousiasme platonicien, ces tendances périlleuses, tout en imitant Polybe. Montesquieu, en s'y laissant aller, fait plus d'un faux pas. Machiavel, dans cette voie, n'a plus de frein. Il ne veut interroger que l'histoire ; il ne se fie qu'à elle ; et comme il l'interprète avec un merveilleux talent, il veut en faire l'unique et la suprême école. Or l'histoire offre des exemples bien divers ; si la conscience n'y apporte pas son discernement, on est exposé aux plus graves méprises. On admire un César Borgia, comme le reste des hommes admire un Socrate ou un Marc-Aurèle ; on adore le crime parce qu'il triomphe, et l'on dédaigne la vertu qui succombe ; on emploie le mensonge, comme le genre humain emploie la vérité ; on joue avec les parjures, avec les forfaits, parce que l'histoire du passé rappelle bien des succès achetés à ce prix indigne. Alexandre VI est un personnage historique tout aussi bien que Régulus ou César ; et puisqu'il a réussi, il est plus grand qu'eux. Voilà le dernier terme où aboutit la méthode historique et si Platon, qui a presque tout donné à la raison, est le plus honnête des écrivains politiques, Machiavel, qui a tout donné à l'histoire, en est le plus immoral et le plus dépravé ; redoutable exemple que personne n'a essayé de suivre, et qui restera certainement unique, et toujours détesté.
Dans le XVIe siècle, la science
politique ne compte pas un seul ouvrage éminent. Celui de Bodin, qui
eut de son temps une grande réputation, n'est qu'un écho très
affaibli des théories antiques, et son succès tint surtout à ce
qu'il était écrit en langue vulgaire. Dans le siècle suivant, on ne
trouve parmi les philosophes que Hobbes et Spinosa qui se soient
occupés de politique. Bacon, homme d'État pendant de longues années,
a craint d'aborder un sujet qui lui était familier. Mais les hontes
de sa carrière publique font assez comprendre quels devaient être
ses principes, et la postérité n'a pas regretter beaucoup son
silence.
La politique de Hobbes est assez
connue. C'est une théorie et une justification du despotisme. Hobbes
part des principes les plus faux sur la nature humaine, qu'il n'a
pas très bien observée ; et il en tire une société monstrueuse où la
liberté, qu'il a méconnue et mal interprétée clans l'homme, ne se
trouve plus, et où l'empire absolu d'un seul existe sans contrôle et
sans limites. Il blâme vivement Aristote d'avoir soutenu que l'homme
est un être sociable ; l'état naturel des hommes entre eux est, si
l'on en croit la misanthropie du philosophe anglais, un état de
guerre. C'est la peur qui a formé la société ; ce n'est aussi que la
peur qui peut la maintenir. C'est parce que les hommes se
redoutaient mutuellement qu'ils se sont unis ; et comme ils sont
portés sans cesse à se déchirer, même dans la vie sociale, le
pouvoir qui leur impose l'ordre et la loi ne saurait être trop fort. On a fait honneur à l'indépendance de Hobbes d'avoir établi nettement la suprématie du pouvoir civil sur le pouvoir religieux. La remarque est vraie ; mais le mérite de Hobbes n'en est guère accru. Cette question était nouvelle au temps de Machiavel ; elle l'était beaucoup moins à la fin du XVIIe siècle, après la victoire de la Réforme, après l'exemple de Louis XIV et celui de tant d'autres princes. Il appartenait du reste à l'Angleterre plus qu'à tout autre pays de formuler précisément cette théorie, puisque c'était en Angleterre, et un siècle avant Hobbes, que Henri VIII avait, le premier parmi les souverains, réuni les deux puissances et s'était fait le pape de son royaume. On a parfaitement montré d'où viennent toutes les erreurs de Hobbes (M. Cousin. Voir ses oeuvres, première série, t. II, p. 215 et suiv.). Sa politique et sa morale sont fausses, parce qu'elles s'appuient sur une métaphysique et une psychologie fausses comme elles. La méthode de Hobbes est toute rationnelle, et l'histoire n'apparaît en rien dans son système. Mais il interroge fort mal la raison ; il ne sait pas étudier l'âme humaine avec une attention suffisante et une sincère exactitude. Il a recueilli dans la philosophie de Bacon des germes fatals, qu'il développe à peu près comme le firent plus tard les disciples de Locke et de Condillac. Un siècle avant eux, il a tiré de la doctrine de la sensation toutes les conséquences sociales qu'elle contient ; et l'on a pu, sans anachronisme, prendre sa politique pour le complément de l'école sensualiste d'Helvétius et de Saint-Lambert. Il faut bien que cette école le sache : le système de Hobbes, une fois ses principes admis, est d'une rigueur irréfutable, et Hobbes est un ennemi déclaré de la liberté. Le sensualisme est donc dans cette alternative en politique, ou de renier ses principes ; ou, s'il veut être conséquent, d'aboutir nécessairement au despotisme, sans échapper à aucun de ses excès. Avec Platon, la méthode rationnelle arrivait à fonder la liberté sur les bases inébranlables de la justice, et à donner au pouvoir d'infranchissables limites. Avec Hobbes, elle arrive à des résultats tout opposés. Mais Platon avait observé, sans erreur, les faits de l'esprit humain ; Hobbes les a méconnus, tout aussi bien que Bacon, son maître ; et sa politique, qui ne sort ni de l'histoire qu'il dédaigne, ni de la psychologie qu'il néglige, est l'échafaudage d'une logique qui outrage scandaleusement la nature humaine, et qui n'a pour elle ni la vérité ni même la grandeur. On peut adresser des reproches identiques à Spinosa. Sa doctrine sur la société reproduit fidèlement celle de Hobbes, bien qu'elle parte de principes métaphysiques absolument différents. Spinosa, qui nie la liberté en psychologie, ne pouvait point la retrouver dans l'État ; et le pouvoir qu'il imagine et qu'il transfère à la communauté, au lieu de le laisser au monarque, comme l'avait fait Hobbes, est également un despotisme effréné. L'état de nature est selon lui aussi un état de guerre ; et le portrait qu'il fait de l'homme à ce premier et misérable degré est hideux, bien que ce soit un portrait de pure fantaisie. Spinosa observe moins encore que Hobbes les faits psychologiques, s'il est possible. Son homme naturel est une sorte de Monstre, qui n'a aucun discernement du bien et du mal, sans raison, sans moralité. Bien plus, en s'élevant à la vie civile, l'homme de Spinosa n'en reste pas moins dégradé ; sa conscience est morte dans la société, aussi bien que dans l'état de nature. La puissance publique décide pour lui ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et prononce souverainement sur le juste et l'injuste, que la raison imbécile du citoyen ne peut discerner par elle seule. Sous prétexte que l'individu est impuissant contre la communauté, Spinosa le sacrifie sans réserve et sans pitié au pouvoir, qui n'agit sur les sujets que par l'espérance et la crainte. Il admet du reste la division reçue des trois gouvernements. Il comptait dans son Traité politique, qu'il n'a pu achever, faire la théorie de la monarchie, de l'aristocratie et de la démocratie. Il n'a rempli que les deux premières parties de sa tâche. La monarchie, telle qu'il l'imagine, est fort étrange. Elle dispose de tout dans l'État ; tout lui appartient, y compris même les maisons des citoyens, qu'elle loue à bons deniers comptants. De plus, le roi est assisté d'un conseil, qu'il renouvelle tous les ans, et « qui est comme le sens externe de la cité, dont le monarque est l'âme. » A côté de ce conseil qui administre, il en est un autre qui juge, et dont les membres sont payés de leurs hautes et importantes fonctions sur les biens des condamnés. L'armée n'a pas de solde en temps de paix ; et en temps de guerre, elle vit du butin fait sur l'ennemi. Les autres institutions de la monarchie que rêve Spinosa sont au niveau de celles-là. Il serait fort inutile de les citer. Mais ce qui est plus singulier peut-être, c'est que Spinosa trouve qu'elles sont très pratiques. Sa monarchie est la meilleure de toutes celles qui ont existé ; elle est fort supérieure aux utopies imaginées par les philosophes. Il admire son oeuvre ; et, malgré sa modestie habituelle, il consacre tout un chapitre à démontrer l'excellence incomparable de ses théories. Il est vrai que parfois il s'arrête, craignant de provoquer le sourire de ses lecteurs. Mais cette circonspection même n'est pas assez prudente; elle ne saurait conjurer le danger que craint le philosophe ; et Spinosa, qui dédaigne la spéculation en politique, et qui ne veut s'en remettre qu'à l'expérience, ne voit pas qu'il ne poursuit que des chimères extravagantes, très peu dignes de son génie. Ainsi donc, au XVIIe siècle, Hobbes et Spinosa, c'est-à-dire l'école de Bacon et celle de Descartes, n'ont pas fait avancer la science politique d'un seul pas ; loin de là, elles lui ont nui, en la rendant tantôt odieuse et tantôt ridicule. Bossuet même ne la releva pas de cette déchéance. La Politique tirée de l'Écriture Sainte, que Voltaire a condamnée avec tant de raison, n'est qu'une théorie de la monarchie absolue. Bossuet ne s'est peut-être pas aperçu qu'il n'étudiait la Bible que pour en tirer le portrait beaucoup trop flatté de son maître, et une apologie assez peu équitable du despotisme. Dans le XVIIIe siècle, et quinze ans à peine après l'Esprit des Lois, le Contrat social vint donner tout à coup une face nouvelle à la science politique. jusqu'à Rousseau elle n'avait été qu'une spéculation ; il en fit une arme et un instrument de révolution. Le Contrat social fut un pamphlet. Extrait d'un plus grand ouvrage, les Institutions politiques, il ne développait d'un vaste système qu'une seule idée. Mais cette idée était fondamentale, bien qu'elle ne fût pas toute neuve. C'était celle de ta souveraineté. Aristote l'avait résolue deux mille ans avant le citoyen de Genève, et dans le même sens que lui. Locke venait de la traiter dans un ouvrage parfaitement clair, et traduit vingt ans avant que parût celui de Rousseau, qui lui emprunta ses principes. Au sein des démocraties antiques, cette question était fort simple, et pouvait à peine être discutée.
Le peuple en corps exerçait une
souveraineté incontestable et permanente ; il s'en montrait si
jaloux, que non seulement il frappait les tyrans, mais que de plus
il prévenait par l'ostracisme tous les dangers lointains qui
pouvaient menacer sa puissance. Le tyran pouvait bien usurper par la
force et la surprise ; mais il n'était jamais légitime. Quant au
pouvoir des rois, dans les États qui les avaient conservés, ce
n'était qu'une simple délégation. Le roi était le monarque dont
l'autorité, librement consentie par les sujets, pouvait toujours lui
être retirée par eux. La retenir contre leur gré, c'était renoncer à
la royauté, c'était se changer en tyran et s'exposer à un châtiment
qui se faisait rarement attendre. Dans les temps modernes, il en fut
tout autrement ; et, par suite de causes nombreuses et profondes,
l'idée véritable de la souveraineté avait complètement disparu. Le
monarque ne tenait plus son pouvoir que de Dieu seul ; il n'en
devait compte à qui que ce soit sur la terre. Cette théorie, bien
que démentie plus d'une fois par des révolutions, bien que combattue
par quelques philosophes, la Boëtie par exemple, était généralement
admise ; Montesquieu n'avait pas osé la discuter, loin de penser à
la combattre. Rousseau retrouvait en partie la cité antique dans la
petite république de Genève : il y voyait régner le peuple ; il
pouvait lui-même se vanter d'être « membre du souverain ; » et,
grâce à cet enseignement, grâce à ses propres réflexions, et
peut-être aussi à son amour du paradoxe, il soutint une doctrine
qui, dans ce temps, avait quelque chose d'inouï, tout ancienne et
toute vraie qu'elle était. De là toute l'importance du Contrat
social, malgré l'erreur essentielle sur laquelle il repose, et qu'on
a trop souvent réfutée pour qu'il soit utile d'y insister de
nouveau. Je me borne à la théorie de la souveraineté, et je laisse
de côté celle du contrat primitif, que Rousseau a si vainement
cherché. On peut donc dire que Rousseau a été le précurseur de la Révolution, et qu'il a eu la gloire de développer le principe qui devait la rendre légitime, puissante et durable. Si le principe de la souveraineté nationale n'est pas encore organisé complètement parmi nous, il est désormais incontestable ; et la démocratie de nos jours doit savoir gré à Jean-Jacques de l'avoir devinée près d'un siècle à l'avance, quoiqu'il ne l'ait pas toujours bien comprise.
D'ailleurs, il professe pour la
démocratie la plus haute admiration : « S'il y avait, dit-il, un
peuple de Dieux, il se gouvernerait démocratiquement. » Cet
enthousiasme est fort raisonnable ; et pour un philosophe qui sait
ce que c'est que la dignité de l'homme et «sa divine nature, » la
démocratie doit être, en théorie du moins, le seul gouvernement
légitime, si elle n'est pas toujours un gouvernement applicable.
Mais cette apothéose ne tire pas à conséquence clans la pratique
pour Rousseau, et il se hâte de déclarer, peut-être par un reste de
sa misanthropie ordinaire, « qu'un gouvernement si parfait ne
convient pas à des hommes (Contrat social, liv. III, chap. IV, p.
197.) » Voilà déjà une restriction qui limite singulièrement dans la
réalité le principe de la souveraineté nationale ; et il eût
peut-être été sage à ce compte de retrancher complètement de la
science politique, qui ne doit pas s'occuper de chimères, la théorie
de la démocratie. Il est vrai que Platon n'avait pas négligé
d'étudier le gouvernement aristocratique, bien que ce gouvernement
de la vertu, comme il l'entend, fût moins possible encore que la
démocratie de Jean-Jacques. Mais c'est que, tout en croyant la
démocratie digne d'un peuple de Dieux, Rousseau n'en désespère pas
tout à fait parmi les hommes. Il y met seulement une condition assez
facile à remplir. Il faut, à l'en croire, que l'État démocratique
soit très petit pour que le peuple puisse aisément s'y rassembler,
et pour que chaque citoyen y puisse connaître les autres. Ainsi,
l'idéal de Rousseau ne sort pas de l'enceinte de Genève, plus
étroite, malgré sa prétendue liberté, que les limites mêmes de la
cité antique. Rousseau se laisse évidemment entraîner par l'amour de
sa ville natale, on ne peut pas dire de sa patrie, et par les
souvenirs de ses premières lectures. Genève, qu'il admire pour
l'opposer surtout à Paris, Sparte et Athènes, qu'il ne connaît que
par Plutarque, telles sont les démocraties qu'il a toujours en vue ;
et c'est à cette mesure insuffisante et restreinte qu'il veut peu
sagement rapporter toutes les autres. Mais si ce principe, posé dans toute son étendue, était en partie inexact relativement aux démocraties antiques, si jamais elles n'avaient pu l'appliquer dans toute sa rigueur, il devenait surtout complètement faux pour les démocraties que le génie de Rousseau pouvait prévoir, et que son coeur républicain devait souhaiter à d'autres peuples que le peuple de Genève. La France en particulier, à qui le citoyen de Genève devait sa gloire et l'hospitalité, était-elle donc condamnée éternellement à la monarchie ? Et si elle devait dans un jour prochain briser le joug, comme l'y invitait Jean-Jacques , à quelle forme de gouvernement pouvait-elle s'adresser si ce n'est à la démocratie ? C'est ce qu'aurait dû pressentir Rousseau. Il aurait pu se dire que son prétendu principe, qui repoussait toute représentation de la souveraineté, n'était qu'une erreur. Pensait-il par hasard à diviser la France en petites républiques fédératives ? Pensait-il à rompre l'unité nationale en fractions dont aucune n'aurait été plus grande que le canton de Genève, l'Attique ou la Laconie ? Je ne voudrais pas l'accuser d'une telle rêverie ; mais il s'était beaucoup occupé de l'étude des fédérations, sujet tout neuf, à ce qu'il disait, et où sans doute son aventureux génie ne se serait pas épargné les innovations même les plus contestables. II est donc évident que tout en prêchant le dogme de la souveraineté nationale, Rousseau n'y a point cru comme doivent y croire les nations modernes. Il n'a pas vu comment ce dogme pouvait se réaliser bientôt. La représentation n'est certainement pas sans inconvénient ; elle n'est pas toujours, même dans les moments les plus solennels de la vie des. peuples, l'expression parfaitement fidèle des volontés qui l'ont déléguée. Mais là représentation est nécessaire ; l'état actuel de la politique n'est pas le seul motif qui la justifie ; et tant que la nature des choses n'aura pas changé, les mandataires seront indispensables, et même ils vaudront mieux en général que ceux qui se confient à eux. La souveraineté d'ailleurs, ainsi que l'a pensé Rousseau, ne se délègue pas, en ce sens qu'elle est inaliénable comme la liberté même, et que les révolutions sont toujours là pour prouver à qui ne le comprendrait pas que les peuples n'abdiquent point. Mais proscrire aujourd'hui le système représentatif, c'est à la fois nier les faits les plus évidents, et se jeter, sous prétexte d'une équité impossible, dans les rêves les plus extravagants et les utopies les plus dangereuses. Une distinction très juste et très utile qu'a faite Rousseau, mieux que personne avant lui et même après lui, c'est celle du souverain et du gouvernement, qu'il appelle aussi le Prince. Cette distinction est capitale, et elle découle très naturellement de sa théorie de la souveraineté. Dans les républiques antiques, il était à peu près impossible de la faire : le peuple, qui était le souverain, gouvernant par lui-même, et ne reconnaissant tout au plus que des magistratures amovibles et de très courte durée, le gouvernement et la souveraineté se trouvaient confondus, et personne ne les distinguait. Platon n'en parle même pas ; et Aristote, tout sagace qu'il est, ne se pose la question que pour la résoudre mal. Bien qu'il connaisse la véritable souveraineté, bien qu'il la place théoriquement dans la raison et pratiquement dans la majorité, il n'hésite point ce-pendant à dire que le gouvernement est le souverain de l'État (Voir notamment liv. III, chap. IV, § I.). Montesquieu commet la même erreur ; et rien n'indique dans son grand ouvrage que pour lui le monarque qui gouverne ne soit pas le légitime souverain de la nation. Rousseau voit seul la vérité, et il sait la dire avec une netteté qui ne peut plus laisser place à l'équivoque. Le Prince, le gouvernement, quelle qu'en soit la forme, et parfois même la toute puissance, n'est jamais qu'un délégué du peuple, révocable par lui, et responsable devant sa justice, qui est souveraine, si elle n'est pas infaillible. « Le gouvernement, dit formellement Rousseau, a été confondu mal à propos avec le souverain, dont il n'est que le ministre. » Ces théories pouvaient n'être pas fort goûtées du temps de Louis XV ; mais elles étaient profondément vraies ; et vingt-cinq ans ne s'étaient pas écoulés que la Constituante, les mettant en pratique, faisait redescendre la monarchie, qui s'était crue souveraine, à une place toute subalterne, qui désormais ne pouvait plus être changée. Aujourd'hui, croire que le gouvernement est le souverain est une méprise qui n'est plus possible, même pour les esprits les plus aveuglés. Que Rousseau garde la gloire d'avoir le premier dissipé toute obscurité sur ce point essentiel. Un dernier mérite qu'il ne faut pas oublier dans le Contrat social, bien que parfois on l'ait fort exagéré, c'est celui du style. Rousseau n'a jamais écrit, il est vrai, avec plus de vigueur et de sobriété. Mais il n'a pu se défaire, même en un sujet politique, de ce ton déclamatoire qu'il portait jusque dans ses romans. Malgré la justesse générale des idées, on sent le rhéteur bien plus encore que l'homme d'État ; et, quand on vient de lire Machiavel, on voit trop que Rousseau n'a jamais manié les affaires, et que s'il manque de simplicité, c'est surtout parce qu'il manque d'expérience. Le livre d'ailleurs est beaucoup mieux composé clans son ensemble que le Prince ou les Discours sur les Décades ; mais, en dépit de cette ordonnance régulière et systématique, il y règne une sorte d'hésitation et d'incertitude, qui perce sous ces dehors austères, et qu'il est bien difficile de ne pas avoir quand on n'a point touché soi-même les réalités dont on parle.
Depuis le Contrat social, la science
politique n'a pas produit de grand monument, bien qu'elle ait
produit des oeuvres estimables et même des oeuvres illustres. La
démocratie, dont Rousseau a proclamé le principe, attend encore d'un
homme de génie une théorie complète. Mais peut-être faut-il qu'elle
se développe pendant bien des siècles, et qu'elle passe par bien des
épreuves et des progrès, avant que la philosophie, pour la bien
comprendre, puisse recevoir de l'histoire de suffisants matériaux. Mais il ne suffit pas de connaître l'homme en lui-même, dans toute la dignité de sa noble nature. L'homme de la psychologie ne vit pas, ou du moins il n'agit point ; et l'action et la vie sont soumises à des nécessités fatales qui font trop souvent déchoir l'âme humaine, quelque belle, quelque vertueuse qu'elle soit. Je ne veux point parler des crimes et des attentats dont retentit l'histoire. Mais, sans sortir de nous-mêmes, et sans recourir à d'autre exemple que celui que chacun de nous peut retrouver en soi, combien il est difficile de mettre d'accord les actes de notre conduite avec les conseils de notre raison, et de conformer notre vie aux inspirations de notre conscience ! Ce désaccord, qui trouble si souvent l'individu, se reproduit plus violent et plus durable dans les peuples, dans l'humanité ; et le philosophe qui croirait pouvoir réaliser sans peine dans le monde du dehors tout ce qu'il a trouvé dans le monde serein et pur de son âme, commettrait une erreur honorable peut-être, mais bien grave. C'est l'étude de l'histoire qui l'en garantira, s'il sait comprendre l'histoire comme il a compris son propre coeur, et y recueillir d'instructifs échos, comme il a recueilli la voix secrète et infaillible qui parle en lui. L'étude de l'histoire servira donc à contrôler, à limiter la psychologie: l'une apprend au sage ce que l'homme doit être ; l'autre lui dira presque aussi sûrement ce qu'il a été, et ce qu'on peut espérer de lui, selon les temps et selon les lieux. Il ne s'agit pas de rêver pour l'homme une perfection impossible, un inaccessible bonheur ; il s'agit de le conduire simplement à un but qu'il peut atteindre, et par des voies où ses faibles pieds peuvent le soutenir. La tâche ainsi restreinte est encore assez vaste pour que les plus puissants génies suffisent à peine à la remplir ; elle est assez belle pour séduire les plus généreux coeurs. Il faut donc que la science politique s'appuie à la fois sur la psychologie et sur l'histoire, empruntant à celle-là ses principes, et à celle-ci ses exemples, les unissant toutes deux dans la mesure exacte qui doit leur laisser à chacune toute leur puissance et toute leur utilité, empruntant à l'une et à l'autre ce qu'elles ont de profitable, l'idéal et le possible, évitant ce qu'elles ont de dangereux, l'utopie et l'empirisme, en un mot les tempérant dans une savante et féconde harmonie. C'est beaucoup demander sans doute au philosophe politique ; et c'est là peut-être une utopie d'un autre genre. Mais pourtant, quand on connaît tout ce qu'ont pu faire dans des temps moins favorisés Platon et Aristote, Machiavel même et Montesquieu, on aurait tort de désespérer de l'esprit humain. Il n'est pas impossible qu'un jour quelque mortel heureux réunisse en lui seul, et grâce à ses prédécesseurs, toutes les qualités éparses qui les ont signalés à l'estime ou à l'admiration des hommes. Celui-là, quel qu'il soit, sera marqué pour la gloire qui tente les sages ; une place jusqu'à présent inoccupée l'attend dans l'histoire de la philosophie et dans la reconnaissance des peuples. Si, parmi les nations modernes, il en est une qui puisse justement prétendre à cueillir cette palme, c'est la nôtre. Elle en a pour gage son passé ; et l'on ne voit pas jusqu'à présent ce que le reste de l'Europe peut mettre à côté de Montesquieu et de Rousseau. La terre qui les a portés l'un et l'autre n'est pas apparemment devenue stérile, et l'on peut en attendre des fruits non moins beaux. Un motif plus grave encore d'espérance, c'est l'état même de la société dans notre pays. Nulle part, l'organisation sociale n'est moins imparfaite ; nulle part, les droits de la nature humaine ne sont mieux définis et plus respectés ; nulle part, les problèmes essentiels n'ont été mieux résolus. Nos révolutions, quelque douloureuses qu'elles aient été, furent souvent de bienfaisants progrès pour nous et pour le monde. Les destins des sociétés civilisées tiennent en grande partie aux nôtres, et les conquêtes que fait chez nous la science politique sont des conquêtes universelles. A moins que notre pays ne s'arrête dans sa carrière, a moins qu'il ne manque à la mission que la Providence même semble lui avoir assignée, il est impossible que le spectacle de cette admirable société n'émeuve pas et n'instruise encore quelque grand esprit qui voudra la comprendre et l'expliquer.
C'est là d'ailleurs, qu'on le sache
bien, une des sources où s'inspire la pensée du philosophe. La
démocratie athénienne a, malgré ses vices, beaucoup éclairé Platon,
qui la censurait ; si Machiavel a connu profondément les ressources
pratiques de la politique, tout en les pervertissant, c'est qu'il
avait pour enseignement l'exemple des Républiques italiennes ; si la
France au XVIIIe siècle a produit Montesquieu et Rousseau, c'est que
la société française était encore la meilleure et la plus avancée de
toutes, quoiqu'elle appelât tant de réformes. C'est un avantage
précieux qu'elle n'a point perdu et que Dieu ne lui ôtera pas. Nous.
sommes arrivés, après bien des traverses et bien des douleurs, à ce
résultat inouï que tous les membres de la société, sans aucune
exception, sans aucune limite, jouissent des droits de la cité, qui
avaient été jusqu'alors le privilège de quelques-uns. Le suffrage
universel, qui apparaît de loin en loin dans les annales de
l'histoire, ne s'est jamais produit dans une nation aussi nombreuse;
et les conséquences qu'il doit porter sont à peu près aussi
incalculables que les forces mêmes de l'esprit humain.
Mais je dois prendre garde d'imiter
les novateurs que je critique, et de faire des prédictions qui ne
seraient peut-être pas plus justes que les leurs. Au lieu de
prophétiser au nom de la science ce qui sera dans un temps plus ou
moins éloigné, il vaut mieux, sous sa sévère discipline, étudier ce
qui est, et demander à la psychologie et à l'histoire bien comprises
les résultats utiles et durables que seules elles peuvent nous
donner. La science, appuyée sur la vérité, est plus belle encore que
l'espérance.
POST-SCRIPTUM. - Mes espérances ne se
sont pas réalisées ; et les vingt-cinq années qui viennent de
s'écouler n'ont pas produit chez nous l'ouvrage politique que je
dois encore souhaiter aujourd'hui comme je le souhaitais en 1848.
Dans cet intervalle, la France a été, tantôt opprimée par un pouvoir
dictatorial qui étouffait toute grande pensée, tantôt bouleversée
par les événements les plus considérables et les plus tristes. Notre
pays n'a donc pas joui du calme qui est indispensable pour
l'enfantement de ces travaux. Peut-être l'avenir sera-t-il meilleur
et plus fécond ; peut-être, après tant d'épreuves, trouverons-nous
enfin le vrai et durable repos dans la République, si nous savons la
maintenir par notre fermeté et par notre sagesse. La science
politique pourrait y gagner autant que la société. |