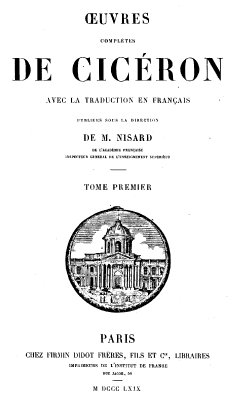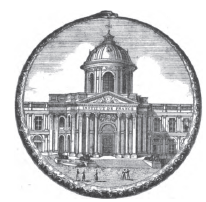ŒUVRES
COMPLÈTES
DE CICÉRON,
AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,
PUBLIÉES
SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,
DE L'ACADEMIE FRABCAISE
INSPECTEUR GENERAL DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TOME PREMIER
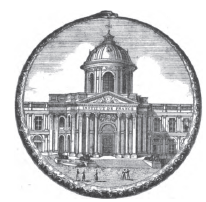
PARIS,
CHEZ FIRMIN DIDOT FRERES, FILS ET CIE, LIBRAIRES,
IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE
RU JACOB, 56
M DCCC LIX
précédent
César avait pris Domitius dans Corfinium, et l'avait renvoyé libre, avec
tous les sénateurs tombés en son
(xxv)
pouvoir, au nombre desquels était Lentulus Spinther, ami intime de Cicéron.
Celui-ci se crut obligé d'en remercier le vainqueur. César lui répondit par
une lettre pleine d'adresse: il espérait le voir bientôt à Rome, afin d'y
prendre ses conseils. De son côté, Pompée n'épargnait rien pour engager
Cicéron à le suivre, et lui écrivait lettres sur lettres. Cicéron lui
répondit qu'il n'avait pas été libre de le rejoindre, s'étant vu plusieurs
fois menacé d'être coupé par César. Mais ce n'étaient là, comme il le
confessait à Atticus, que des prétextes pour gagner du temps, afin de
délibérer sur une démarche aussi importante. D'ailleurs il regardait encore
la paix comme possible, et ne voulait pas que César eût à se plaindre de lui
quand il serait réconcilié avec Pompée, ce que César faisait espérer
toujours. Les instances recommençaient de part et d'autre, trouvant,
laissant Cicéron dans la même incertitude, mais témoignant de la haute
estime où il était alors. On voyait, dans une querelle où il était question
de l'empire du monde, et que la force devait décider, les chefs de deux
partis puissants s'efforcer à l'envi de gagner un homme qui ne pouvait pas
les servir dans la guerre, et qui n'avait d'autre force que son tapent et
l'autorité de son nom, comme s'il eût dû rendre meilleure la cause qu'il
aurait embrassée.
N'osant se promettre de le faire entrer ouvertement dans ses intérêts, César
lit tous ses efforts pour le tenir dans une espèce de neutralité. Il lui
écrivit plusieurs fois lui-même, dans la rapidité de sa marche; lui fit
écrire, dans le même sens, par Balbus et Oppius, ses amis; lui envoya de ses
agents. “On le sollicitait, écrit-il, de retourner à Rome; César ne devait
s'y conduire que d'après ses avis. Il pouvait no prendre parti pour
personne; César ne lui en demandait pas davantage.” Il lui lit même offrir
une garde, comme Pompée lui en avait donné une dans le procès de Milon;
offre qui, sous l'apparence d'une marque d'honneur, cachait le projet de le
rendre prisonnier, et de lui ôter la liberté de quitter l'Italie.
Cicéron crut devoir répondre à ces avances par une lettre où, sans rien
promettre ni accepter, il reconnaissait qu'on avait fait une injustice à
César en voulant lui retirer son commandement, et où il le louait de sa
modération. Habile à se prévaloir d'une semblable lettre, César la rendit
publique, et Cicéron, un peu embarrassé, prétendit qu'il n'y avait mêlé
quelques flatteries que par un motif qui l'excusait, le désir de la paix.
César, en venant de Brindes, devait passer par Formies. Cicéron attendait sa
visite avec inquiétude. Il aurait voulu l'éviter. Il ne l'osait pas; il
résolut du moins de le recevoir avec toute la fermeté possible. En effet, il
lui refusa formellement, dans cette entrevue, de se rendre à Rome. César
reçut mal ses raisons, le quitta même avec une menace, et partit mécontent.
“Mais en récompense, dit Cicéron, je suis fort satisfait de moi, ce qui ne
ni était pas arrrivé depuis longtemps.”
Entraîné par ce premier mouvement de fermeté, il ne songea plus qu'à
rejoindre Pompée. Ce n'est pas qu'il se fit illusion sur l'issue de la
guerre. Il reconnaissait la supériorité de César; mais il ne pouvait
supporter l'idée d'abandonner Pompée, ni se pardonner même d'avoir tant
tardé à le suivre. “Je l'aime, écrivait-il, et sa cause est la meilleure, et
je préfère être vaincu avec lui que de vaincre avec César.”
Sa conduite, et le soin qu'il prenait de ne pas s'éloigner de ses campagnes,
qui étaient proches de lamer, persuadèrent à tout le monde qu'il n'attendait
plus qu'un vent favorable pour s'embarquer. César lui écrivit encore, dans
l'espoir de l'arrêter. Rien de plus pressant que ses instances, de plus
rassurant que ses protestations. “1I n'avait aucun ressentiment de son refus
de se rendre à Rome. Il lui connaissait trop de prudence pour prendre un
mauvais parti, pour suivre Pompée, maintenant que ses affaires étaient en si
mauvais état, lui qui n'avait pu s'y résoudre quand elles pouvaient inspirer
quelque confiance. Il devait céder à la fortune; il y allait de son intérêt.
Après tout, quel meilleur parti pour un bon citoyen que de garder une exacte
neutralité? Beaucoup l'auraient voulu prendre. Cicéron pouvait s'y tenir
avec aussi peu de danger pour sa sûreté que pour son honneur.”
Marc Antoine, à qui César avait confié la garde de l'Italie, lui écrivit
aussi le même jour et dans le même but. “Cicéron ne voudrait pas se déclarer
contre le parti de César, où il n'avait que des amis, où était son gendre
Dolabella, pour celui d'un homme qui lui avait été hostile.” Avec sa lettre,
Antoine lui envoya un de ses amis pour en confirmer le contenu, et il l'alla
plusieurs fois visiter lui-même. Célius, lieutenant de César, lui en écrivit
une où il essaya de faire céder sa résolution à la peur. “Prenez garde, lui
disait-il, de faire un choix contraire à votre sûreté. Si vous vous figurez
que César aura toujours la même indulgence pour ses ennemis, vous vous
trompez. Il se lassera de faire des offres inutiles, et je vous avertis que
son humeur est déjà changée; il prend un ton sévère, et ne paraît pas
disposé à pardonner toujours. Pourquoi suivre un fugitif, et embrasser une
cause désespérée? Attendez du moins l'issue de la guerre d'Espagne, qui ne
saurait être ni douteuse ni longue: ne vous perdez pas volontairement avec
tout ce qui vous appartient.”
Curion alla passer deux jours avec lui, en se rendant pour César en Sicile,
et s'efforça de l'ébranler par les mêmes raisons. “César n'avait pas pris le
parti de la douceur par inclination, mais par politique; et ce parti ne lui
ayant pas réussi, il ne garde-
(xxvi)
rait plus de ménagements.” Il venait d'en donner une preuve à son entrée à
Rome, en brisant les portes du temple de Saturne, où les consuls avaient
laissé le trésor sacré, dont ils avaient emporté la clef, dans la persuasion
qu'il était assez défendu par la sainteté du lieu. Il s'empara de force de
toutes les richesses que les siècles y avaient accumulées, et voulut tuer le
tribun Métellus, qui s'était opposé à cette violence.
Cicéron était toujours décidé à partir, et en avait d'autant plus de hâte,
comme il le dit lui-même, que “ses lauriers, ses licteurs, ses faisceaux,
tout cet appareil d'un futur triomphateur, l'exposait à de continuelles
railleries.” En effet, dès son retour de Cilicie, il avait 'sollicité le
décret de son triomphe. Le sénat l'avait rendu; mais le consul Lentulus
avait demandé que cotte cérémonie fût différée de quelques jours, pour
laisser aux affaires, qui ne firent qu'empirer, le temps de s'améliorer; et
Cicéron n'avait pas triomphé. Il n'attendait donc que le moment de passer la
mer avec Pompée. Les menaces, les violences de César, la conduite déjà
infâme de cet Antoine qui lui demandait une bassesse, l'insolence de ces
factieux avant la victoire, leurs plans, leurs desseins, lui faisaient
horreur. “Voilà donc, s'écrie-t-il, par quelles indignes mains il nous faut
périr. Pour moi, si j'avais le malheur de ne pas trouver un vaisseau, je
prendrais plutôt une barque, pour échapper à leurs mains parricides.”
Toutefois n'ignorant pas que ses démarches étaient surveillées, surtout par
Antoine, alors dans le voisinage, et qui avait ordre de César de ne pas le
laisser partir, il s'efforçait encore de dissimuler, et il écrivit à ce
surveillant qu'il n'avait aucun dessein qui pût blesser César; qu'il ne
pouvait oublier leur amitié, ni ce qu'il devait à Dolabella son gendre; et
que sa principale raison pour vivre dans la retraite était l'embarras de ses
licteurs, avec lesquels il n'aimait plus à paraître en public. Marc Antoine
lui fit une réponse froide, sèche, impérieuse, dont Cicéron envoya une copie
à Atticus, pour lui “montrer, disait-il, quel air de tyrannie on prenait
déjà.
Il fallait partir. Sa fille Tullie se jeta éplorée à ses genoux, le supplia
d'attendre du moins l'issue de la guerre d'Espagne: sans y consentir, il
différa son départ.
Ses préparatifs terminés, et quand il n'attendait plus qu'un vent favorable,
il se retira dans sa maison de Pompéi, qui étant moins commode pour un
embarquement, servait à en écarter le soupçon. Là, on vint lui dire que les
chefs de trois cohortes, en garnison à Pompéi, demandaient à le voir le
lendemain, pour lui livrer la place et les troupes. Le lendemain, Cicéron
s'esquiva avant le jour, pour ne pas les recevoir, croyant un si petit corps
insuffisant pour la défense du pays, et surtout se déliant de quelque piége.
Enfin, après cinq mois d'hésitations, il mit à la voile le 11 juin 704, “se
précipitant, dit-il, les yeux ouverts et volontairement, dans sa ruine.”
Loin de gêner Quintus dans ses inclinations, il lui représenta que les
obligations qu'il avait envers César lui faisaient peut-être un devoir de ne
pas quitter l'Italie. Quintus lui déclara qu'il ne reconnaissait d'autre
parti que celui auquel s'attachait son frère.
Il arriva heureusement au camp de Pompée, à Dyrrachium, en Épire, avec son
fils, âgé de seize ans, son frère et son neveu; et, pour réparer un peu le
tort de sa lenteur, et s'attirer plus de considération dans son parti, il
commença par remettre à Pompée une somme considérable de ses propres
revenus.
“Il fut reçu avec joie par tout le monde, dit Plutarque, excepté par Caton,
qui, en le voyant, le prit à part, pour lui reprocher d'être venu. Il eût
été plus utile à ses amis, lui dit Caton, à ses concitoyens, si, gardant la
neutralité dans Rome, il eût attendu l'occasion de les servir, au lieu de se
déclarer sans motif, sans nécessité contre César, et de venir partager avec
eux de si grands dangers.”
Ces paroles le bouleversèrent, et il acheva de se refroidir en voyant que
Pompée ne le chargeait d'aucune affaire importante, ne lui demandait aucun
conseil. S'il avait embrassé le parti de la guerre avec répugnance, il n'y
trouva rien qui ne fût propre à augmenter son dégoût. “Ce qu'on avait conçu,
ce qu'on avait exécuté, lui déplut également; il n'était satisfait que de la
cause.” Les plus fidèles amis de Pompée se perdaient eux et lui par leurs
conseils. Ils étaient pleins d'une confiance insensée. Pompée affectait une
supériorité insupportable; il se proposait en tout Sylla pour modèle; il
méditait les mêmes vengeances.
Cicéron entreprit de modérer cette présomption, en représentant les hasards
de la guerre, les forces et l'habileté de l'ennemi, et la vraisemblance même
d'une défaite, si l'on prenait légèrement le parti d'en venir aux mains. Ses
remontrances, méprisées, ne servirent qu'à le faire accuser de faiblesse et
de lâcheté. Il prit alors le parti de faire sentir par des railleries les
fautes qu'il ne pouvait empêcher par son autorité. Il laissa voir son
repentir d'être venu. Il ne cessa de rabaisser les préparatifs de Pompée, de
blâmer ses plans, de lancer en toute occasion des sarcasmes. Il n'était pas
gai cependant; et on le voyait se promener tout le jour dans le camp, d'un
air morne et soucieux; niais il faisait rire par ses reparties ceux même qui
songeaient le moins à rire. “Vous êtes venu bien tard, lui dit un jour
Pompée. – Je suis venu encore trop tôt, répondit Cicéron; car je ne vois
rien de prêt. – Où est votre gendre? lui demanda une autre fois Pompée d'un
air d'ironie. – Avec votre beau-père,” dit-il aussitôt. Un Romain qui
arrivait du camp de César dans celui des Pompéiens, racontait que, dans la
précipitation de son
(xxvii)
départ, il avait oublié son cheval. Cet homme, dit Cicéron, a mieux pourvu à
la sûreté de son cheval qu'à la sienne. Pompée venait d'accorder le droit de
cité à un transfuge gaulois. “Le plaisant homme! dit Cicéron; il donne à des
Gaulois une patrie, et ne peut nous rendre la nôtre!”
Fatigué de ces plaisanteries, Pompée lui dit enfin: “Passez à César, et vous
verrez si je suis à craindre.” Cicéron avait tort de semer le découragement
dans son parti, de jeter sur le chef un ridicule qui rejaillissait sur la
cause; et, comme dit avec force M. Villemain, (3) “d'apporter dans le camp
de Pompée les craintes qui pouvaient l'empêcher d'y venir.” Il se hâta,
ajoute le même écrivain, de désespérer de la victoire, et laissa entrevoir
cette défiance du succès, qui ne se pardonne pas, et cette prévention contre
les hommes et contre les choses, qui choque d'autant plus qu'elle se trahit
par le sarcasme. Cicéron ne modérait pas assez son penchant à la raillerie;
et, sur ce point, il parait avoir manqué souvent de prudence et de dignité.”
Tandis que César, maître de l'Espagne et de l'Italie, créé, à Rome,
dictateur et consul, accourait pour combattre Pompée, Cicéron, désespérant
toujours du succès de la guerre, faisait tous ses efforts pour disposer son
parti à la paix. Pompée défendit qu'on en parlât davantage dans le conseil;
il commençait à reconnaître ses fautes, voulait reconquérir sa gloire, et
avait pris la résolution de périr ou de vaincre.
César le tenait bloqué dans Dyrrachium; Dolabella écrivit à Cicéron de
profiter de la fuite de Pompée, dont on ne doutait pas, pour se retirer à
Athènes ou dans quelque autre ville éloignée du théâtre de la guerre;
retraite que César approuvait d'avance. Mais ce dernier se vit lui-même
contraint, par un revers imprévu, de fuir devant Pompée jusqu'en Macédoine.
Cicéron revint au conseil qu'il avait déjà donné, de traîner la guerre en
longueur, et de ne pas s'exposer aux chances d'une bataille. La force de ses
raisons les lit goûter de Pompée. Mais le succès de Dyrrachiuin avait achevé
de tourner la tête à cette troupe sénatoriale; elle entraîna son chef. La
résistance lui était difficile au milieu de tous ces magistrats fugitifs,
ses égaux en dignité, qui, ayant commandé, triomphé comme lui, voulaient
avoir part à toutes les résolutions; qui, n'ayant avec lui d'autre
engagement que leur inclination, et libres de l'abandonner au moindre
dégoût, en exigeaient d'autant plus de complaisance; qui, s'ennuyant de
cette vie des camps, aspiraient à retourner à Rome pour y jouir de leurs
richesses et de leurs honneurs; qui, las de lui obéir, l'accusaient de
vouloir se perpétuer dans le commandement, et l'appelaient Agamemnon, le roi
des rois; qui, enfin, pleins d'une présomptueuse confiance dans l'issue du
combat, couvraient déjà leurs tentes de lauriers, y faisaient dresser par
leurs esclaves des tables chargées de mets dont l'armée victorieuse et
affamée de César allait vanter le goût exquis, se disputaient toutes les
places que donnerait la victoire, et jusqu'à celle de souverain pontife, que
la mort de César devait laisser vacante. Enfin, entraîné, harcelé, poussé en
avant, Pompée céda, malgré l'avis de Cicéron, malgré les conseils d'une
prudence un peu tardive.
Cicéron ne se trouva point à la bataille de Pharsale, étant demeuré malade à
Dyrrachium. Il avait promis à Pompée de le suivre aussitôt que le lui
permettrait sa santé; et pour gage de sa sincérité, il lui avait laissé son
fils, qui se distingua, dans cette journée, à la tête d'un corps de
cavalerie.
Caton avait à Dyrrachium le commandement de quinze cohortes et d'une flotte
considérable. Il l'offrit à Cicéron, qu'y appelait son rang de consulaire.
Cicéron le refusa; et, si l'on en croit Plutarque, le jeune Pompée en fut si
indigné, qu'ayant tiré son épée, il l'aurait tué, si Caton n'eût arrêté son
bras. Tous ceux qui voulaient continuer la guerre exhortèrent Cicéron à les
suivre; et comme ils lui répétaient sans cesse qu'il leur restait encore
sept aigles, “cela serait excellent,” répondit-il par un dernier trait de
moquerie, “si vous aviez des geais à combattre.” II déclara que la guerre
était finie pour lui, et se retira, sous la protection de Caton, qui eut
quelque peine à le soustraire à de nouvelles violences.
Cicéron reprit le chemin de l'Italie, et descendit à Brindes vers la lin
d'octobre 705, toujours précédé de ses licteurs et de ses faisceaux
couronnés de lauriers. Il y reçut une lettre d'Antoine qui l'avertissait que
César lui avait défendu de recevoir personne en Italie sans un ordre de sa
main. Cicéron lui dépêcha aussitôt L. Lamia, pour l'assurer que Dolabella
lui avait écrit de la part de César qu'il pouvait s'y rendre; il n'était
venu que sur la foi de cette lettre. Antoine publia l'édit qui excluait de
l'Italie tour les partisans de Pompée; mais, dans cet édit même, il excepta
Cicéron, affectant de l'y nommer, pour achever de le rendre suspect et
odieux à ses anciens amis. Cicéron éprouvait de vives contrariétés de la
part de sa famille. Son frère et son neveu avaient suivi César en: Afrique
pour en obtenir leur pardon. Quintus rejetait sur son frère le blâme qu'il
croyait mériter, et ne cessait de l'accuser dans ses discours et dans ses
lettres. Son fils avait même pris les devants, en composant contre son oncle
un discours qu'il devait prononcer devant le vainqueur. Cicéron, tout irrité
qu'il fût de cette conduite, en tenait une fort opposée, et appuyait
généreusement leurs accusations contre lui-
(xxviii)
même. Informé que, dans plusieurs occasions, César, loin de croire aux
dénonciations de Quintus, l'avait au contraire accusé d'avoir entraîné toute
sa famille dans le parti de Pompée, Cicéron lui écrivit aussitôt afin d'en
revendiquer le tort, et le pria de recevoir son frère en grâce.
Dolabella, son gendre, à peine en possession du tribunat, où il était
parvenu autant par ses intrigues que par la protection de César, avait
excité de nouveaux troubles à Rome, en faisant revivre une loi qui éteignait
toutes les dettes: lui-même en avait tant, que sa femme avait été forcée de
venir chercher sa subsistance auprès de son père. Cicéron n'avait pas achevé
de payer la dot de sa fille. Ce qu'il avait donné à Pompée, et la mauvaise
gestion de sa femme, l'avaient mis dans une gêne qui ne lui permettait plus
de fournir aux dépenses les plus indispensables de sa maison; il n'en put
sortir qu'avec l'aide d'Atticus.
Il reçut à Brindes la nouvelle de la mort de Pompée, et en fut peu surpris.
Dès qu'on en sut la nouvelle à Rome, César y fut élu dictateur pour la
seconde fois, et Antoine, maître de la cavalerie.
Cicéron continua de séjourner à Brindes, mais dans une situation d'esprit si
pénible, “qu'elle lui paraissait, dit-il, pire que tous les supplices.” II
n'osait se rapprocher de Rome sans la permission formelle de ses nouveaux
maîtres; et Antoine ne laissait pas échapper une occasion de l'humilier.
Tout sou espoir était dans le retour de César; et s'il restait à Brindes,
c'était pour se faire un mérite de le recevoir à son débarquement. I1 était
si honteux de son triste rôle, qu'il évitait d'en parler dans ses lettres,
et demandait en grâce à ses amis de ne plus le questionner à ce sujet.
Cependant les restes du parti de Pompée s'étaient ralliés en Afrique; et
leurs forces réunies étaient si supérieures à celles de César, qu'ils
parlaient de passer en Italie avant qu'il fût revenu d'Égypte. Le bruit s'en
répandit bientôt; et Cicéron devait s'attendre à être traité par eux en
déserteur; car ils avaient publié qu'ils tenaient pour ennemi quiconque ne
se rendrait pas dans leur camp. Il ne restait donc plus à Cicéron qu'à
souhaiter le succès des armes de César, et le triomphe d'un parti qu'il
avait toujours détesté.
A Rome, on ne lui pardonnait pas de s'être soumis sitôt à la discrétion du
vainqueur. Il était blâmé, condamné, méprisé, sans que personne entreprît de
le justifier.. Ému de tant de reproches, il chargea son cher Atticus de
prendre sa défense, lui suggéra les raisons qui pouvaient y servir, et le
pria de les répandre. Mais ces raisons ne pouvaient que faire ressortir la
situation équivoque où il se trouvait placé.
Pour comble d'inquiétude et de honte, il ne recevait aucune marque
d'attention de César, qui, tout entier à l'expédition d'Égypte, n'avait pas,
il est vrai trouvé le temps d'écrire une seule fois en Italie dans l'espace
de six mois. Instruits des craintes de Cicéron, plusieurs de ses amis de
Rome imaginèrent, pour les dissiper, de lui écrire, sous le nom même de
César, et de dater d'Alexandrie une lettre bienveillante et affectueuse.
Mais les termes en étaient si vagues qu'il soupçonna, ce qu'il apprit en
effet plus tard, qu'elle venait d'Oppius et de Balbus, dont l'amitié,
vainement ingénieuse à le tromper, n'avait trouvé que ce moyen de relever
son courage.
César lui donna enfin lui-même une marque de souvenir, et lui fit remettre
les lettres injurieuses de sou frère, comme un témoignage de son affection
et de l'horreur que lui avait inspirée la conduite de Quintus. Mais la
tristesse habituelle où vivait Cicéron tant de fois abusé, abandonné, trahi;
les noires pensées dont-il nourrissait son esprit; son humeur devenue
soupçonneuse et défiante, lui faisaient chercher, même dans les bons
traitements de nouvelles raisons de craindre. Au lieu d'expliquer
favorablement fa conduite de César, il ne voulut y voir que la politique
d'un vainqueur irrité qui, remettant la vengeance à un autre temps, voulait,
pour la mieux assurer, lui inspirer une sécurité trompeuse; et cet
empressement même à lui envoyer par des intermédiaires les lettres de
Quintus lui paraissait moins une avance qu'une marque de mépris.
Ces sombres idées furent dissipées par une lettre de César qui lui
confirmait, dans les termes les plus affectueux, la possession de son rang,
et lui accordait même la liberté de reprendre ses faisceaux et ses licteurs,
qu'il venait de quitter. En même temps Quintus, dont César n'avait permis le
retour qu'a la considération de Cicéron, changeant bientôt de langage,
écrivit à son frère pour le féliciter du rétablissement de sa fortune.
Cicéron voulait faire partir son fils au-devant de César; mais dans
l'incertitude du chemin qu'il prendrait, il changea de résolution. Dès qu'il
eut appris son arrivée a Tarente, il quitta Brindes pour se présenter à lui
sur sa route. Il avoue dans ses lettres qu'il ressentit quelque trouble à
l'approche d'un vainqueur contre lequel il avait pris les armes; et
quoiqu'il pût compter sur un accueil favorable, “il ne savait, dit-il, s'il
valait la peine de lui demander une vie qui cesse d'être à nous lorsqu'elle
est le bienfait d'un maître.” Mais, dans leur entrevue, il ne se vit obligé
à rien qui fût au-dessous de sa dignité. César, du plus loin qu'il le vit
venir, descendit de cheval, courut l'embrasser, et, continuant de marcher
avec lui, l'entretint seul avec familiarité.
Cicéron ne pensa plus qu'à se rendre à Rome; et, après quelques jours passés
dans sa villa de Tusculum, avec ses meilleurs amis, il prit le chemin
(xxix)
de la ville, dans la résolution de s'y consacrer à l'étude, et d'attendre,
dans cette tranquille occupation, que des jours meilleurs eussent lui pour
la république. “Heureusement, écrivit-il à Varron, que j'ai fait la paix
avec mes livres, qui n'ont pas été fort satisfaits de me voir si longtemps
oublier leurs préceptes.”
Pressé de repartir pour l'Afrique, César donna le consulat, pour les trois
mois qui restaient de l'année, à Vatinius et à Fufius Calénus, et se nomma
lui-même consul avec Lépide pour l'année suivante (707). Un usage si
arbitraire de sa nouvelle autorité, fit juger tout d'un coup par quelles
maximes il se proposait de gouverner, et jeta une grande tristesse dans la
ville.
La guerre d'Afrique tenait encore l'univers en suspens. Cicéron, n'attendant
rien d'heureux de l'un ni de l'autre parti, continua de mener une vie
solitaire au milieu de ses livres. Il se lia plus étroitement avec Varron,
qui passait pour le plus savant des Romains, et leur amitié s'immortalisa
par l'honneur qu'ils se firent mutuellement de se dédier leurs ouvrages. Ce
fut dans cette retraite que Cicéron, outre des traductions d'Homère, du
Timée de Platon et des tragiques grecs, composa son traité des Partitions
oratoires, pour l'instruction de son fils, âgé de dix-huit ans. Un autre
fruit de son loisir fut le Dialogue sur les orateurs fameux, qu'il publia
sous le titre de Brutus, ouvrage qui devait servir de complément aux trois
livres de l'Orateur déjà publiés.
Cicéron, au commencement de la guerre civile, était le débiteur de César. Il
eu était devenu à son tour le créancier. Il était gêné; il aurait voulu être
remboursé, mais ne savait quel moyen employer. Sa gêne était d'autant plus
grande, qu'un divorce venait de le séparer de Térentia, depuis trente ans sa
femme; divorce que tout le monde n'approuva pas, quoique Térentia, outre son
caractère difficile et ses profusions sans bornes, prêtât aussi au soupçon
d'accueillir les ennemis de son mari. Elle lui avait apporté de grands
biens, qu'il fallut lui restituer en la quittant.
Ces difficultés forcèrent Cicéron de s'engager dans un autre mariage. “Dans
un temps si misérable, je n'aurais jamais pensé, dit-il, à changer ma
situation, si je n'avais trouvé à mon retour mes affaires en aussi mauvais
état que celles de la république. Des intrigues et des perfidies entretenues
contre moi dans ma propre maison, m'en ont fait une obligation; et je me
suis vu forcé de chercher, par de nouvelles alliances, à me défendre contre
la trahison des anciennes.” Ses amis lui proposèrent plusieurs partis. Il se
détermina pour une jeune fille, nommée Publilia, sa pupille, belle, riche,
bien alliée. La disproportion de leur âge (il avait soixante-deux ans) lui
attira quelques railleries. “Elle est bien jeune,” lui disait-on. – “Demain
elle sera femme,” répliqua-t-il.
De son côté, Térentia, qui vécut, dit-on, cent trois ans, prit, suivant
saint Jérôme, pour second mari Salluste, ennemi de Cicéron, et Messala pour
le troisième. Dion lui en donne même un quatrième, Vibius Rufus, qui fut
consul sous le règne de Tibère, et qui se vantait de posséder deux choses
qui avaient appartenu aux deux plus grands hommes du siècle précédent, la
femme de Cicéron et le siége sur lequel avait été tué César.
Ce dernier revint victorieux d'Afrique. L'incertitude où l'on était de
l'issue de la guerre avait fait garder jusque-là quelques ménagements au
sénat; mais bientôt la flatterie ne connut plus de bornes, et les honneurs
qui furent prodigués à César surpassèrent tout ce qu'on avait jamais vu. Le
dégoût que ces bassesses inspirèrent à Cicéron, et la certitude que son rôle
était fini et son éloquence inutile, lui firent prendre la résolution
d'acquérir à Naples une maison qui pût lui servir de prétexte pour se tenir
désormais éloigné de Rome, “où, suivant ses expressions, loin de le mettre
au gouvernail, on ne le jugeait pas même digne de travailler à la pompe.”
Mais ses amis l'en détournèrent, en le pressant de se soumettre à la
nécessité, et d'éviter que César expliquât sa retraite comme une marque
d'aversion pour lui. Il lui fallut se rendre à leurs avis. “Aussi longtemps
que notre préfet des mœurs,” dit-il par une allusion moqueuse à la censure
de César, “fera son séjour à Rome, j'y resterai. Mais lui parti, vite je
cours à Naples.”
César, qui ne songeait guère à consulter Cicéron, ne dédaignait pas de
s'appuyer parfois de l'autorité de son nom, et en souscrivait à son insu les
décrets du sénat, lesquels se fabriquaient chez lui et par lui. “J'apprends
quelquefois, dit Cicéron, qu'un sénatus-consulte, passé à mon avis, a été
porté en Syrie et en Arménie, avant que j'aie su qu'il ait été fait; et j'ai
reçu des lettres de plusieurs rois, qui me remercient de leur avoir accordé
ce titre, tandis que j'ignorais non-seulement qu'ils l'eussent obtenu, mais
qu'ils fussent au monde.”
Cependant il était recherché des chefs du parti victorieux, des favoris de
César, qui vivaient môme avec lui dans la plus grande familiarité, et lui
“composaient, comme il le dit, une espèce de cour:” c'étaient Balbus,
Oppius, Marius, Pansa, Hirtius et Dolabella: il soupait presque tous les
jours avec eux, et les deux derniers s'exerçaient sous lui à la déclamation.
“Pourquoi, écrivait-il à Varron, pourquoi me défendrais-je de souper avec
ceux qui nous gouvernent? Que voulez-vous? II faut céder au temps.” Et pour
céder au temps, il cherchait dans ses livres de philosophie et d'histoire,
ne pouvant sans doute les trouver dans sa conscience, des maximes, des
exemples, des raisons qui lui servissent d'excuse
(xxx)
à lui-même. – “Le sage n'appartient qu'a lui. Le sage ne doit pas blesser
inutilement ceux qui sont en possession de l'autorité. – Quand on a cru que
le meilleur parti était de vivre, il faut bien aimer ceux dont on tient
cette vie, qu'on a préférée à la mort. - L'histoire nous montre une infinité
de sages vivant sous la tyrannie dans Athènes et dans Syracuse, et y
conservant la liberté de leur esprit. – Quand il e pris les mesures les plus
justes, et qu'il en a été trompé, le sage ne doit pas lutter sans espoir
contre la force des choses.” A force d'invoquer les maximes des sages,
Cicéron oubliait qu'il ne l'était plus. Dans cette communauté d 'études et
de plaisirs avec ses maîtres, il évitait de se mêler des affaires de Rome,
même de marquer quelque curiosité de les savoir; et il n'employa la faveur
où il était auprès d'eux qu'à rendre service à plusieurs de ses amis, que
l'exil punissait de leur attachement à une cause naguère la sienne. Il
n'épargnait alors ni ses instances, ni ses peines. Il ne quittait plus la
demeure de César; et s'il se plaignait parfois de la difficulté des
audiences, et d'avoir à les attendre, avec tousses clients, dans le
vestibule de son palais, il n'en accusait que la multitude et le grandeur de
ses devoirs.
Recherché des amis de César, il l'était aussi des partisans de la
république, et sa maison était plus fréquentée que jamais. “On cherche,
disait-il, à voir un bon citoyen comme une espèce de prodige. Les visites
étaient si nombreuses, qu'il en avait réglé l'ordre. Il recevait les
républicains de grand matin; audience mélancolique et triste. Après eux
arrivaient “les joyeux vainqueurs,” comme il les appelait; et tous ces
visiteurs partis, il se retirait dans sa bibliothèque pour lire ou composer.
Toutefois, il protestait par des bons mots contre la tyrannie de César et la
bassesse de ses créatures. Andrea de Laodicée, qu'il avait connu en Cilicie,
étant venu le saluer, lui apprit que ses concitoyens l'avaient envoyé à Rome
pour demander à César la liberté de leur patrie. “Si vous réussissez, lui
dit Cicéron, sollicitez aussi pour nous.” - “Ne vous étonnez pas,” disait-il
un autre jour de César, en faisant allusion à son commerce de débauche avec
le roi de Bithynie; “ne vous étonnez pas qu'après avoir aimé un roi, il aime
tant la royauté.” Ses amis, craignant que cette liberté de langage ne
l'exposât au ressentiment du dictateur, l'exhortèrent à plus de retenue.
Mais il leur répondit, “que lui demander d'étouffer dans sa bouche une
raillerie, c'était vouloir qu'il renonçât à toute réputation d'esprit.
D'ailleurs, ajoutait-il, César a le jugement admirable; il faut lui rendre
cette justice. Il s'est tellement familiarisé avec mes bons mots, que si on
lui en donne comme de moi qui n'en soient pas, il les rejette aussitôt. Ce
discernement lui est d'autant plus facile, que ses meilleurs amis vivant
très familièrement avec moi, ils ne manquent point de lui répéter tout ce
qui m'échappe d'ingénieux ou de plaisant dans la variété de nos discours. Je
sais qu'ils ont reçu de lui cette commission.”
César ne pouvait douter de l'horreur secrète que Cicéron avait pour son
usurpation; mais l'amitié qu'il lui portait et un reste de respect lui
avaient fait prendre le parti, non-seulement de le traiter avec assez de
considération pour adoucir ses chagrins, mais de contribuer de tout son
pouvoir à lui rendre la vie douce et agréable. Cependant tout ce qu'il fit
dans cette vue n'obtint de Cicéron que des louanges sur sa clémence, et sur
l'intention qu'il lui prêtait de rétablir la république. Du reste, il ne
traite jamais son gouvernement que de tyrannie, et le dictateur, que
d'ennemi et d'oppresseur de Rome; et sa conduite envers lui, toujours
prudente et réservée, suivait les vicissitudes de ses espérances et de ses
craintes.
Il donna dans le même temps une preuve éclatante de son indépendance: il
composa l'Éloge de Caton. Ses amis voulurent qu'il considérât longtemps de
quelle manière il devait traiter un sujet si délicat, et lui conseillèrent
de se borner à des louanges générales, et d'éviter des détails qui ne
pouvaient manquer d'offenser César. Il appelait lui-même cette difficulté
“un problème d'Archimède.” Mais sans se rendre à ces conseils timides, il
éleva jusqu'au ciel, suivant l'expression de Tacite, les vertus et le
caractère de Caton.
Ce livre hardi eut un grand succès. César même, loin d'en témoigner aucun
ressentiment, affecta d'en paraître satisfait mais il déclara que son
dessein était d'y répondre, et, par son ordre sans doute, Brutus composa de
suite un petit écrit, en forme de lettre, qui contenait plusieurs
objections, mais où Cicéron était traité avec beaucoup d'égards.
La réponse de César (l'Anti-Caton) ne fut publiée qu'à son retour d'Espagne,
c'est-à-dire, l'année suivante. C'était une invective laborieuse; on y
répondait à chaque point du panégyrique. Toutefois l'auteur y marquait une
grande admiration pour Cicéron; il le comparait pour la vertu aux Périclès
et aux Théramène, noms bizarrement rapprochés. Ce qu'il ajoutait était plus
juste, “que Cicéron était au-dessus de tous les triomphateurs, parce qu'il
est plus glorieux d'avoir reculé pour les Romains les limites du génie que
celles de leur empire.”
Ce combat littéraire partagea Rome. Chacun prenait parti suivant ses
intérêts ou son inclination, et les vertus de Caton, le plus beau caractère
de son siècle, n'étaient plus qu'un vain sujet de conversation dans une
ville corrompue et esclave.
Cicéron entreprit ensuite, à la prière de Brutus, un ouvrage qu'il intitula
l'Orateur, et dans lequel il voulut donner l'idée la plus parfaite de
l'éloquence. L'accueil que reçut ce livre confirma l'opi-
(xxxi)
nion qu'il en avait lui-même: il le regardait comme coup de peine, à ce
dernier dessein; mais il ne put non plus beau titre.
C'est à la même époque qu'il prononça dans le sénat sa fameuse harangue à
César pour le rappel de Marcellus, son ami, retiré, depuis la journée de
Pharsale, à Mitylène. Il y menait une vie si tranquille, que Cicéron put à
peine le décider à profiter de son pardon. Quelques sénateurs s'étaient
jetés aux pieds de César pour obtenir la grâce de l'exilé; tous les autres
s'étant levés à leur tour et approchés du dictateur, avaient joint leurs
prières à ces instances. Le seul Volcatius déclara qu'à la place de
Marcellus, il protesterait contre cette humiliation. César se laissa
fléchir. Cicéron, dans sa reconnaissance, abandonna la résolution qu'il
avait prise de garder au sénat un silence éternel, et lui adressa ce
discours qui, pour l'élégance du style, est supérieur à tout ce que
l'antiquité nous a laissé dans ce genre. Les louanges de César y sont
poussées si loin, qu'elles ont fait douter de la sincérité de l'orateur. On
a donné pour excuse l'espérance où il était encore de voir César rétablir la
république. En effet, il lui conseillait ce grand dessein avec toute la
force d'un ancien Romain; et l'on s'étonne moins qu'une telle exhortation
eût besoin d'être tempérée par quelque flatterie.
Ce succès encouragea Cicéron. Un autre de ses amis, Ligarius, était aussi en
exil pour avoir combattu contre César en Afrique; il lui demanda son rappel,
et reçut une réponse favorable. Mais Tubéron, ennemi du proscrit, réveilla
contre lui le ressentiment du dictateur, et l'accusa publiquement de
rébellion. César l'avait donc condamné de nouveau; mais il voulut que la
cause fût plaidée devant lui, au forum; et il avait dit à ses amis, à ce que
rapporte Plutarque: Qui nous empêche d'entendre Cicéron, dont l'éloquence
est depuis si longtemps muette, lorsque Ligarius est déjà condamné? Cicéron
défendit son ami; et ce juge, qui s'était cru inflexible, ému, troublé,
changeant de visage, y laissa voir toutes les agitations d'une âme qui cède
à un sentiment nouveau; des papiers qu'il tenait à la main lui échappèrent.
Cicéron lui arracha le pardon de Ligarius. On lut avec avidité, dans Rome,
cet admirable plaidoyer, dont César voulut avoir un exemplaire. Tubéron, qui
n'y était pas ménagé, employa l'entremise de sa femme, parente de Cicéron,
pour le prier d'y mettre quelque adoucissement en sa faveur. Cicéron n'en
voulut rien faire.
Il n'avait pas trouvé dans son nouveau mariage les consolations qu'il en
attendait. De graves sujets de plainte naissaient fréquemment entre ses
enfants et leur belle-mère. Son fils demandait avec instance un revenu
séparé, et la permission de servir en Espagne sous César, qui venait d'y
aller combattre les fils de Pompée, et que le jeune Quintus y avait suivi.
Cicéron le fit renoncer, quoique avec beaucoup de peine, à ce dernier
dessein; mais il ne put l'empêcher de quitter sa maison, et d'en prendre une
dans la ville. Pour détruire le fâcheux effet d'une séparation si éclatante,
il imagina de l'envoyer à Athènes, sous prétexte de l'y faire étudier; et,
pour lui faire goûter ce projet, il lui offrit une forte pension. L'offre
fut acceptée. Le jeune Cicéron partit avec deux affranchis de son père, qui
devaient lui tenir lieu de gouverneurs; et la direction de ses études fut
confiée aux philosophes grecs, particulièrement à Cratippe, chef des
Péripatéticiens.
A peine délivré de ce souci, il ressentit une affliction bien plus cruelle.
Tullie mourut. Elle avait trente-deux ans, et passait pour la plus lettrée
des Romaines. Cette perte causa à Cicéron une des plus grandes douleurs dont
l'histoire ait consacré le souvenir. Plutarque assure que tous les
philosophes se rassemblèrent pour le consoler. Afin d'échapper à ces
consolateurs, il se retira dans la maison d'Atticus; et là, enfermé tout le
jour, toute la nuit, dans la bibliothèque, son unique occupation était de
feuilleter tous les livres qui pouvaient lui offrir quelque secours contre
sa tristesse. Il voulut l'étouffer sous l'excès du travail. “Ceux,
disait-il, qui me reprochent mon abattement, ne pourraient peut-être pas
lire autant que j'ai écrit; bien ou mal, peu importe. II est vrai que je ne
connais pas le sommeil.”
Cette retraite n'était pas encore assez impénétrable; il se rendit dans une
de ses terres, nommée Astur, près de celle d'Antium, et l'endroit le plus
propre à nourrir son désespoir, étant remplie de grottes profondes et
couverte de bois aux allées sombres et ténébreuses. “Là, disait-il, je vis
sans commerce avec les hommes. Dès la pointe du jour, je m'enfonce dans
l'épaisseur des bois, et je n'en sors que le soir. Je n'ai d'entretien
qu'avec mes livres, et cet entretien n'est interrompu que par mes larmes.”
Atticus et Luccéius le pressèrent de quitter ce triste lieu, lui
représentant que cet excès d'abattement pouvait nuire à sa considération et
le faire accuser de faiblesse. Tous ses amis lui écrivirent pour le
consoler; Brutus, dans des termes touchants qui l'attendrirent beaucoup; L.
Sulpicius, dans une forme qui a fait de sa lettre un modèle dans ce genre;
César même, de ses champs de bataille en Espagne.
Toutes ces lettres, une fois lues, le laissaient à sa douleur. Il essaya de
la combattre en composant un Traité de la Consolation, dont il avoue avoir
reçu un puissant secours. Fait sur le modèle d'un pareil traité de Cranter
l'académicien, ce livre était très lu des premiers Pères de l'Église,
particulièrement de Lactante, à qui nous devons le peu de fragments qui en
restent. Le dessein de Cicéron en l'écrivant, était moins encore de soulager
son cœur, que d'immortaliser la mémoire et les vertus de sa fille.
(xxxii)
Sa douleur lui inspira même le projet d'une consécration réelle; il voulut
bâtir un temple à cette fille adorée, et l'ériger en divinité. “Oui,
s'écriait-il dans le transport de sa tendresse, oui, je veux te consacrer,
toi la meilleure et la plus éclairée des femmes. Je veux te placer dans
l'assemblée des dieux, et t'offrir à l'adoration des mortels.” Dans ce but,
il avait fait venir de Chio des colonnes de marbre et un sculpteur; et l'une
des raisons qui le déterminèrent à élever un temple plutôt qu'un tombeau,
était que pour le premier de ces monuments, rien ne limitait la dépense,
tandis que les lois bornaient celle des sépultures.
Mais l'exécution de ce projet rencontra bien des obstacles. Il avait voulu
acquérir au delà du Tibre, mais près de Rome, à quelque prix que ce fût,
eût-il dû engager son bien, un jardin où ce temple magnifique, exposé à la
vue de toute la ville, eût attiré un plus grand nombre d'adorateurs à la
nouvelle divinité. Il fallut y renoncer. Atticus lui conseilla d'ériger ce
monument dans l'une de ses terres. Mais les terres changent de maîtres, et
un étranger pouvait, après lui, le laisser tomber en ruine ou le convertir à
un autre usage. Enfin, il ne paraît pas que ce temple ait été bâti, soit que
les troubles qui agitèrent bientôt la république l'en eussent empêché, soit
que sa douleur ayant cédé au temps, il eût considéré son projet d'un œil
plus philosophique, et reconnu la vanité de ces monuments éternels dont la
durée est bornée à quelques siècles. Toutefois, ce désir lui resta quelque
temps encore; et l'on voit par ses lettres qu'il continua, dans cette vue,
de mettre en réserve toutes les épargnes qu'il pouvait faire sur les
dépenses de sa maison. Il en avait renvoyé Publilia, qui avait paru se
réjouir de la mort de Tullie.
Marcellus était parti de Mitylène pour revenir à Reine. En route, il fut
assassiné par un de ses amis, qui se tua après lui; meurtre dont on n'a pu
pénétrer la cause. César fut soupçonné; et cette pensée lit tout d'un coup
tant de progrès, que chacun commença de trembler pour soi-même. Cicéron ne
se défendit pas de la frayeur commune; et ses amis augmentèrent ses craintes
en lui faisant observer que de tous les orateurs consulaires il était le
plus exposé à l'envie. Atticus même l'exhorta à se tenir sur ses gardes, et
à s'assurer de la fidélité des gens qui le servaient.
Le goût de Cicéron pour la solitude n'était pas diminué et il y avait repris
ces mêmes études de philosophie qu'il avait tant aimées dans sa jeunesse. Il
avait entrepris d'initier Rome à toutes les doctrines des écoles grecques,
et de faire passer dans sa langue les termes de la dialectique et de la
physique, empruntés à la Grèce. Ces matières étaient encore si neuves à
Rome, que les Latins n'avaient pas même de ternies pour rendre les
abstractions de la métaphysique des Grecs; et ce fut lui qui créa pour les
Romains la langue philosophique. “On assure, par exemple, dit Plutarque,
qu'il exprima le premier en latin l'objet, l'essence, la catalepsie, les
atomes, le simple, le vide, et d'autres idées de ce genre, ou qui du moins
les rendit intelligibles et familiers aux Romains.” “Dans la nécessité où je
suis, dit Cicéron, de renoncer aux affaires publiques; je n'ai pas d'autre
moyen de me rendre utile. Je me flatte qu'on me saura gré de ce qu'après
avoir vu tomber le gouvernement au pouvoir d'un seul, je ne me suis ni
dérobé absolument au public, ni livré sans réserve à ceux qui se sont saisis
de l'autorité. Mes écrits ont remplacé mes harangues au sénat et au peuple,
et j'ai substitué les méditations de la philosophie aux délibérations de la
politique et aux soins de l'État.”
Le premier fruit de son travail fut un dialogue philosophique, qu'il
intitula Hortensius, pour honorer la mémoire de son illustre ami,
mort depuis cinq ans. Il y faisait à la fois l'éloge de la philosophie, et
sa propre apologie contre ceux qui lui reprochaient ce genre d'étude et de
composition, comme étant au-dessous de sa dignité personnelle. Cet ouvrage
est perdu. Quelque temps après, il publia un traité en quatre livres, pour
expliquer les principes de la secte académique, qui était la sienne. Il
avait déjà donné deux ouvrages sur le même sujet, sous les titres de
Catulus et de Lucullus, auxquels il le substitua les noms de
Caton et de Brutus. Varron ayant désiré de lui voir mettre aussi
le sien à la tête d'un de ses ouvrages, il changea le plan de celui-ci, et
le partagea en quatre livres, qu'il adressa à Varron. C'est aussi de l'année
708 que date une de ses meilleures productions, le traité de Finibus,
ou des vrais biens et des vrais maux. Il l'adressa à Brutus, en échange du
traité de la Vertu, que celui-ci lui avait dédié.
Les Tusculanes suivirent immédiatement. Cicéron avait recommencé de
réunir dans ses maisons de campagne quelques-uns de ses meilleurs amis; ils
n'y cherchaient ensemble qu'à s'éclairer par de graves conversations. C'est
ainsi qu'ayant passé cinq jours avec eux dans sa villa de Tusculum, il
écrivit ces entretiens dans une forme plus méthodique, et leur donna pour
titre le nom même de sa maison.
Il composa, vers le même temps, l'Éloge funébre de Porcia, sœur de
Caton. Varron et Lollius traitèrent le même sujet; mais le temps nous a ravi
les trois ouvrages, ainsi que plusieurs autres de Cicéron, composés à cette
époque, et particulièrement des poèmes; car il avait repris aussi le goût
des vers, et l'on assure qu'il en faisait parfois jus-qu'à cinq cents dans
une nuit.
Cependant César poursuivait en Espagne les fils de Pompée. Le jeune Quintes,
persuadé de nouveau que le plus sûr moyen de plaire au vainqueur et
d'avancer sa fortune, était de mal parler de son
(xxxiii)
oncle, se livra plus que jamais à cet odieux penchant, disant que son père
et lui étaient d'irréconciliables ennemis de César. “Rien ne me serait plus
cruel, disait à ce sujet Cicéron, si je ne savais que notre roi ne me croit
plus le moindre courage.” Il put se rassurer: il reçut de César, à cette
époque, les mêmes témoignages d'affection qu'auparavant. Toutefois, à Rome,
les amis de Cicéron l'exhortaient à marquer pour lui plus d'estime. Atticus,
Brutus même, le pressèrent de composer quelque chose qu'il pût lui adresser.
Cicéron s'en défendait toujours. Les instances étant devenues plus vives, il
écrivit à César une lettre politique, sur laquelle, pour plus de sûreté, on
lui conseilla de prendre le sentiment d'Hirtius et de Balbus. Cette lettre
était une exhortation à rétablir, avec la paix, la liberté. Hirtius et
Balbus n'en approuvèrent pas le sujet, quoique le prudent Atticus la trouvât
convenable. Cicéron prit le parti de détruire sa lettre, ne voulant pas la
refaire moins libre, et déjà honteux même de l'avoir faite telle qu'elle
était, avec les ménagements qu'il y avait mis.
On suspectait jusqu'à ses éloges. César venait d'envoyer à Rome sa réponse à
l'Éloge de Caton. Cicéron lui écrivit pour le remercier des égards
avec lesquels il l'avait traité dans cet ouvrage, et en louer le style.
Cette lettre ne put partir qu'après avoir passé par les mains et le contrôle
de Balbus et d'Oppius.
César revint à Rome. Son triomphe surpassa en magnificence tous ceux qu'on
avait vus jusque-là. Mais au lieu des applaudissements qu'il attendait, il
n'obtint que le silence. Déjà la même tristesse avait régné aux jeux du
cirque, où la statue du dictateur avait été promenée solennellement par
l'ordre du sénat. Cicéron, toujours absent de Rome, apprit toutes ces
circonstances avec une joie extrême. Mais Lépide le pressa d'y revenir,
l'assurant que César serait très sensible à cette démarche. Cicéron s'y
rendit.
Peu de jours après son arrivée, il défendit le roi Déjotarus, son ami,
accusé par son petit-fils d'un attentat contre la vie de César; accusation
dénuée de vraisemblance et de preuves, mais que César avait accueillie. Le
plaidoyer de Cicéron fut prononcé cette fois dans le palais du dictateur.
César ajourna la sentence, qu'il ne paraît pas avoir rendue plus tard.
Pour donner à Cicéron un témoignage éclatant de confiance et d'amitié, César
s'invita lui-même à aller passer un jour avec lui dans une de ses maisons de
campagne. Cicéron fit à Atticus le récit de cette visite. Sa lettre est
curieuse. “Quel hôte: et que je le croyais redoutable! Cependant Je n'ai pas
sujet de m'en plaindre, et il a paru très content. II était arrivé la veille
chez Philippe, mon voisin, dont toute la maison avait été aussitôt inondée
de soldats; à peine laissa-t-on libre la salle où César devait souper: il y
avait avec lui deux mille hommes. Je craignais pour moi le lendemain. Mais
Barba Cassius me délivra de cette inquiétude; il mit une garde chez moi, et
fit camper les soldats dehors. Ma maison était sur un bon pied de défense.
César demeura chez Philippe jusqu'à une heure après midi, ne vit personne,
et s'occupa, si je ne me trompe, à régler des comptes avec Balbus. Arrivé
chez moi à deux heures, il se mit dans le bain. Il s'y fit lire des vers sur
Macourra (nom sous lequel Catulle invectivait César), et il les écouta sans
changer de contenance. On le parfuma, et il se mit à table. II avait pris.
un vomitif (ce qu'il faisait avant tous ses repas); il mangea bien, but
mieux encore, et fut d'une “humeur charmante. Le souper était bon et bien
servi. Mais c'était peu:
Une aimable gaieté mêlait à nos propos
Les grâces de l'esprit et le sel des bons mots.
(4)
Outre la table de César, j'en avais trois autres pour sa suite, qui ne
furent pas servies avec moins de recherche. Ses affranchis et ses esclaves
ne manquèrent non plus de rien. Enfin, je m'en suis tiré avec honneur. Mais
en vérité ce n'est point un hôte à qui l'on puisse dire: Faites-moi le
plaisir de repasser chez moi à votre retour: une fois suffit. Nous n'avons
pas dit un seul mot qui eût rapport aux affaires: la littérature fut notre
seul sujet d'entretien. Le passe-temps lui a plu. II parlait de s'arrêter un
jour à Pouzzoles et un autre à Baies. Voilà cette réception. J'en ai
souffert un peu d'embarras, mais sans trop de désordre. En passant près de
la maison de campagne de Dolabella, son escorte, dans ce seul endroit,
marcha sur deux colonnes, à droite et à gauche de son cheval. Je l'ai su de
Nicias.”
Le dernier jour de décembre, le consul Q. Fabius étant mort subitement,
César lui donna pour successeur, à une heure après midi, C. Rébilus, dont la
charge ne devait durer que le reste du même jour. Il plut de tous côtés des
bons mots sur ce consulat ridicule. Cicéron y eut la plus grande part. “On
demandera, disait-il, sous quels consuls Rébilus a été consul.” “La
vigilance de Rébilus a été si merveilleuse, ajoutait-il, qu'il n'a pas dormi
de tout son consulat.” Et l'on applaudissait dans Rome à cette critique
détournée des fantaisies dictatoriales de César, lequel entouré de favoris
qui lui demandaient tous le consulat, ne trouvait d'autre moyen de les
satisfaire que de le donner à ceux-ci pour quelques mois, à ceux-là pour
quelques jours, à d'autres enfin pour quelques heures, afin d'en faire
autant de sénateurs. Il en porta ainsi le nombre à neuf cents, et admit
parmi eux Jusqu'à des Gaulois, à qui l'on avait fait changer leurs saies
grossières en
(xxxiv)
robes sénatoriales. C'était à qui en plaisanterait le plus; et Cicéron
disait: “Ce sera faire une bonne action que de ne pas montrer à ces
sénateurs le chemin du sénat.” Un de ses clients le priait de faire entrer
son fils dans le sénat de Pompéi, sa ville municipale. “A Rome, si vous le
voulez, lui répondit Cicéron; mais à Pompéi, la chose est moins facile.”
Enfin ses plaisanteries ne tarissaient pas sur l'abus de ces promotions qui
ne tendaient qu'à décréditer cet ordre, auquel il appartenait. Mais un jour
ce fin railleur fut, à cette occasion, raillé plus finement encore.
Labérius, chevalier romain, avait, par l'ordre de César, rempli un rôle dans
une de ses pièces, où il avait lancé contre sa tyrannie nombre de traits
sanglants. La pièce finie, il alla chercher une place dans les rangs des
chevaliers, lesquels se serrèrent à son approche, de manière à ne lui en pas
laisser. Cicéron lui cria de loin, du banc des sénateurs: “Je vous ferais
volontiers place, mais je suis bien à l'étroit. – Cela m'étonne, répliqua
vivement Labérius, de la part d'un homme habitué à s'asseoir sur deux
siéges;” allusion mordante à la versatilité de l'orateur, ami de Pompée, ami
de César.
A l'ouverture de l'année suivante (709), César se revêtit, pour la cinquième
fois, de la dignité consulaire, et choisit Antoine pour son collègue. Il ne
manquait rien à sou pouvoir: la dictature lui était abandonnée sans
interruption. Il avait reçu du sénat les honneurs les plus extravagants que
la flatterie puisse inventer, un temple, des autels, des prêtres, des
sacrifices. Sa statue était placée entre celle des rois. Il était appelé le
père de la patrie, titre que Cicéron avait si glorieusement acquis. Celui-ci
s'efforça de ramener tous ces excès aux bornes de la raison. Ses efforts
furent inutiles. César ambitionna jusqu'au vain titre de roi. Antoine offrit
le diadème à cet ambitieux insatiable, dans les fêtes des Luperques, prêtres
nouvellement institués, et parmi lesquels le jeune Quintus s'était fait
admettre, du consentement de son père, mais contre le gré de son oncle. Le
peuple murmura. Deux tribuns protestèrent avec énergie. César en fut réduit
à se faire un mérite de son affectation à repousser ce diadème dont il
n'aurait pu impunément se laisser couvrir.
Il avait achevé ses préparatifs pour l'expédition contre les Parthes, et
réglé pour deux ans la succession des magistrats. Dolabella était nommé
consul à sa place, avec Antoine, pour le reste de l'année; Hirtius et Pansa,
pour la suivante; D. Brutus et. I. Plancus, pour celle d'après. Mais ce
pouvoir excessif, ce mépris superbe de toutes les lois, ses violences contre
des magistrats, de nouvelles tentatives pour se faire donner le titre de
roi, firent enfin éclater une conjuration, formée depuis longtemps, dont les
chefs étaient M. Brutus et C. Cassius, et dans laquelle étaient entrés plus
de soixante sénateurs. César fut tué dans le sénat, aux ides de mars. On
épargna Antoine, faute souvent reprochée depuis aux conjurés par Cicéron, et
qui leur fit perdre en effet tout le fruit de leur entreprise, dont il ne
cessa de vanter la gloire.
Cicéron était présent à la mort de César. Il lui vit recevoir le coup
mortel, et pousser les derniers soupirs. Il ne dissimula point sa joie. Les
conjurés le regardaient comme un de leurs plus sûrs partisans. Après avoir
frappé César, Brutus, levant son poignard sanglant, avait appelé Cicéron
pour le féliciter du rétablissement de la liberté; et tous les conjurés,
ayant pris le chemin du forum, pour l'y annoncer, avaient mêlé son nom à
leurs cris.
Ce fut plus tard pour Marc Antoine un prétexte pour l'accuser publiquement
d'avoir participé à la conspiration, et même d'en avoir été l'auteur. Mais
il paraît certain qu'il ne la connut pas, quoiqu'il fût étroitement uni avec
les conjurés, et qu'ils eussent en lui beaucoup de confiance. Son caractère
et son fige (il avait soixante-trois ans) le rendaient peu propre à une
entreprise de cette nature. Il n'aurait pu leur être fort utile dans
l'exécution, et pan crédit, au contraire, devait avoir d'autant plus de
force pour la justifier, que n'y ayant pas pris part, on ne pouvait le
soupçonner d'aucun intérêt personnel. Telles furent sans doute les raisons
qui empêchèrent Brutus et Cassius de lui communiquer leur dessein. Ils se
contentèrent d'être sûrs qu'il les approuverait.
Toutefois, il est évident qu'il s'attendait à cet événement, et qu'il
l'appelait de tous ses vœux. Il avait écrit à Atticus “que le règne de César
ne pouvait pas durer six mois; qu'on le verrait finir violemment, et qu'il
souhaitait de vivre assez pour être témoin de cette catastrophe.” Atticus
lui ayant écrit que la statue de César avait été placée dans le temple de
Quirinus, voisin de celui de la déesse Salus, “J'aime mieux,” avait-il
répondu en faisant allusion au sort de Romulus, “qu'il soit avec le dieu
qu'avec la déesse.” Une de ses lettres prouve qu'il devait s'être entretenu
avec son ami des moyens d'inspirer à Brutus quelque résolution généreuse, en
lui rappelant la gloire de sa famille, dont l'origine remontait à deux
hommes, Ahala et Brutus, qui avaient, par leur courage, assuré la liberté de
Rome. “Brutus croit-il donc qu'on doive attendre de César des nouvelles qui
puissent plaire aux bons citoyens? Je n'en connais qu'une, ce serait qu'il
se fût pendu. A-t-on donc oublié ce tableau d'Ahala et du vieux Brutus, avec
l'inscription que vous savez?” On doit remarquer aussi que, dans les
ouvrages qu'il adressa vers le même temps à Brutus, il tombe toujours avec
beaucoup d'art sur le malheur public, mais particulièrement sur celui de
Brutus. qui se voyait sans aucune espérance d'employer des talents dianes
d'un peuple libre. On ne peut sur-
(xxxv)
tout méconnaître cette intention dans les pensées qui terminent le dialogue
des orateurs: “Quand je jette les yeux sur vous, Brutus, quelle n'est pas ma
douleur de voir votre jeunesse arrêtée comme au milieu de sa carrière par la
malheureuse destinée de la patrie! Atticus et moi nous souhaitons de vous
voir recueillir le fruit de votre vertu, et vivre dans une république, où
vous puissiez trouver l'occasion de renouveler et d'augmenter la gloire de
vos ancêtres. Vous étiez le maître du forum; votre gloire y était déjà bien
établie: vous avez besoin de la république, et la république a besoin de
vous.”
Tout semble indiquer que s'il ignorait le fond et les circonstances du
complot, il savait en général qu'on s'occupait de quelque grand dessein; et
il y avait contribué autant qu'il était en lui. Dans ses réponses à Antoine,
il s'honore d'être soupçonné d'y avoir eu part. “Si l'on excepte, dit-il,
Antoine et d'autres flatteurs, il n'y avait point à Rome un citoyen qui ne
souhaitât que César fût tué de sa main. Tous les bons citoyens avaient
concouru à l'exécution par leurs désirs; et si les moyens ont manqué aux
uns, aux autres le courage, la volonté n'a manqué à personne.”
Après la mort de César, les conjurés se dirigèrent vers le forum. Brutus
voulait haranguer le peuple. Mais l'agitation que cette nouvelle causait
autour de lui, et la présence d'un grand nombre de soldats qui s'étaient
rendus à Rome pour accompagner César dans son expédition contre les Parthes,
lui firent prendre le parti de se retirer au Capitole. Cicéron l'y suivit
avec la plus grande partie du sénat. On y tint conseil sur l'état des
affaires publiques, et sur les moyens d'assurer le fruit de cette
révolution. Brutus finit par convoquer le peuple et dans un discours composé
d'avance, il l'exhorta à défendre, contre les partisans de la tyrannie, la
liberté nouvellement reconquise.
Cependant Marc Antoine, tremblant pour sa vie, s'était dépouillé de sa robe
consulaire, et avait, sous un déguisement, gagné sa maison, où il se tint
caché. Rassuré par la modération des conjurés, il reparut le lendemain en
public.
Les conjurés n'avaient guère porté leurs vues plus loin que la mort de
César, et s'étaient fiés entièrement à la justice de leur cause, qui ne
pouvait seule les soutenir. Cicéron stimulait leur inaction. II savait que
le peuple était pour eux, mais il craignait qu'ils ne donnassent à leurs
ennemis le temps de se reconnaître et de s'armer. Aussi avait-il conseillé,
dès le premier moment, à Brutus et à Cassius, de convoquer le sénat, en
qualité de préteurs, et d'y porter quelques décrets vigoureux. Mais Brutus
trouva ce conseil trop hardi. Il se crut obligé à plus de respect pour
l'autorité du consul; et se flattant qu'Antoine, qui, dans un autre temps,
avait aussi conspiré contre la vie de César, pouvait être ramené au bon
parti, il proposa de députer quelques sénateurs pour parler de paix à cet
ennemi qui tremblait devant eux la veille. En vain Cicéron combattit cette
idée, en vain fit-il sentir qu'il n'y avait aucune sûreté à traiter avec un
homme qui s'engagerait à tout, tant qu'il aurait quelque chose à craindre,
et qui reviendrait à son caractère après le danger. Le sentiment de Brutus
prévalut; mais pendant que les députés perdaient en négociations un temps
précieux, Cicéron demeura ferme dans son opinion, ne quitta point le
Capitole, et laissa même passer les deux premiers jours sans voir Antoine.
L'événement répondit à ses prédictions. Antoine, qui ne voulait que gagner
du temps pour se préparer à la guerre, protesta qu'il n'avait d'autre désir
que la paix et le rétablissement de la république. Deux jours se passèrent à
répéter des deux côtés les mêmes protestations. Le troisième, Antoine
convoqua le sénat pour régler les conditions de cette paix trompeuse, et les
confirmer par un acte solennel. Il dit quelques mots vagues sur le besoin de
la concorde: Cicéron, dans un discours plus étendu, demanda au sénat de
décréter une amnistie générale. L'assemblée applaudit à cette proposition.
Les conjurés n'étaient pas venus au sénat. A leur tour, ils craignaient pour
eux-mêmes. Antoine proposa de les inviter à prendre part aux délibérations,
en offrant de livrer son fils pour gage de leur sûreté. A cette condition,
ils descendirent du Capitole, et la confiance sembla renaître entre les deux
partis. Brutus soupa le même soir avec Lépide; Cassius, avec Antoine; et la
nouvelle de cette réconciliation fut reçue aux acclamations de toute la
ville, qui crut la paix et la liberté affermies à jamais.
Lépide avait fait rentrer à Rome, dans la nuit qui suivit le meurtre de
César, une partie des troupes à la tête desquelles il allait partir pour
l'Espagne, dont le dictateur lui avait donné le gouvernement. Ne voyant
personne qui lui fût égal en puissance, il avait pensé à se jeter sur les
conjurés, et à s'emparer du gouvernement. Mais Antoine, en le détournant de
ce dessein, eut l'adresse de le faire servir à ses propres vues. Il maria sa
fille au fils de Lépide, lui fit donner la dignité de grand pontife, usa de
son crédit et de ses forces pour effrayer les conjurés, jusqu'à les forcer
d'abandonner Rome; et quand il eut tiré de lui tout ce qu'il en voulait, il
lui persuada de partir pour son gouvernement, sous prétexte de contenir les
provinces dans la soumission.
La terreur qu'Antoine commençait à inspirer, et l'autorité dont il
disposait, firent consentir le sénat à divers décrets qui étaient autant de
pas vers le but où il marchait. L'un confirmait tous les actes de César;
l'autre assurait des récompenses à ses vétérans; un troisième lui décernait
de magnifiques fu-
(xxxvi)
nérailles: cérémonie qu'Antoine regardait comme la plus favorable occasion
de susciter des embarras et des ennemis au parti républicain. On sait que
dans le tumulte qu'il y sut exciter par l'insidieuse éloquence de l'éloge
funèbre de César, Brutus et Cassius eurent beaucoup de peine à se garantir
de la fureur de ses agents, mélange confus d'étrangers et d'esclaves,
auxquels s'étaient joints les Juifs, qui avaient toujours pris le parti de
César contre Pompée, depuis que celui-ci avait profané leur temple.
Les conjurés virent enfin ce qu'ils devaient attendre d'Antoine. Ils
demandèrent une garde au sénat. Antoine les fit avertir que, dans la fureur
où il voyait les soldats et le peuple, il croyait une garde insuffisante.
Cet avis leur fut aussi donné par d'autres bouches. Ils prirent donc la
résolution de quitter Rome. Trébonius se rendit dans son gouvernement
d'Asie, et Déeimus Brutus, dans la Gaule cisalpine, pour y attendre les
événements. Manus Brutus se retira avec Cassius dans une de ses terres près
de Lanuvium.
Antoine acheva de se fortifier dans le sénat; et gardant quelque temps
encore le masque de la modération, il proposa une loi pour abolir la
dictature: la loi passa au milieu des plus vives acclamations, et des
remercîments lui furent votés pour l'avoir proposée. Il profita de ces
dispositions pour se faire donner une garde de six mille hommes.
Il fallait abuser les conjurés assez longtemps pour leur faire abandonner
toutes les résolutions vigoureuses, surtout celle de se saisir de quelques
provinces où ils eussent trouvé des troupes et de l'argent. Antoine continua
de parler avec respect, dans le sénat, de Brutus et de Cassius, lesquels se
laissèrent tellement tromper par ces apparences, qu'ils eurent avec lui,
vers le même temps, une conférence dont ils furent très satisfaits.
Après le départ des principaux conjurés, Cicéron s'était déterminé aussi à
quitter Rome, non sans se plaindre dans toutes ses lettres que l'indolence
de ses amis eût fait manquer l'occasion de rétablir la république. En
traversant les cantons voisins, il remarqua sur son passage la satisfaction
qu'avait causée partout la mort de César.
“Il
n'y a point d'expression, écrivait-il à Atticus, qui puisse vous retracer
les témoignages de joie qui éclatent de tous côtés; on vient au-devant de
moi, on m'entoure, on veut entendre de ma bouche le récit de ce grand
événement. Mais quelle est à présent notre politique! que de contradictions!
comment pouvons-nous craindre ceux que nous avons terrassés, défendre les
actes de ceux dont nous approuvons le châtiment, souffrir que la tyrannie
subsiste après la destruction du tyran, et voir la république presque
anéantie après le rétablissement de la liberté?”
Peu de temps après, il reçut d'Antoine une lettre pleine d'adresse, où ce
dernier le priait de consentir au rappel de Sextus Clodius, parent du
fougueux tribun qui l'avait exilé, et le principal ministre de ses fureurs.
En épousant la veuve de Clodius, Antoine s'était chargé du soin de toute sa
famille. L'artificieux consul disait à Cicéron
“que,
bien qu'il eut déjà le consentement de César pour le retour de Sextus, il ne
voulait pas en faire usage sans avoir obtenu le sien, et qu'il l'attendait
de sa générosité si connue; que s'il ne l'obtenait pas, il cesserait de
servir Clodius, pour convaincre Cicéron du pouvoir qu'il avait sur lui.”
Cicéron, dans une réponse fort polie, lui envoya son agrément.
Antoine, ayant ainsi réglé ses affaires, ajourna au Ier de juin l'assemblée
du sénat, et profita de cet intervalle pour visiter l'Italie dans le but
d'engager à son service les vétérans qui s'y trouvaient disséminés sur
plusieurs points. Il avait laissé le gouvernement de Rome à Dolabella, son
collègue. Quoique Cicéron n'eût jamais eu qu'une très mauvaise opinion des
principes de son gendre, il avait toujours vécu dans de bons rapports avec
lui. Le voyant alors dans une position où il pouvait servir les intérêts de
la république, il s'attacha plus que jamais à s'insinuer dans sa confiance.
L'absence d'Antoine rendait l'entreprise plus facile; et Dolabella confirma
bientôt les espérances de Cicéron. Il fit détruire un autel élevé à César,
et punir de mort quelques-uns de ses plus furieux partisans. Toute la ville
applaudit à cette fermeté. Cicéron qui, dans l'opinion de tous, partageait
le mérite d'un acte qu'on attribuait à ses conseils, écrivit de Baies à
Dolabella une lettre pleine de marques d'admiration.
Il s'était proposé d'employer le temps qu'il passait hors de Rome à faire un
voyage en Grèce, pour y voir son fils, dont la conduite lui causait de vifs
chagrins. Ce jeune homme s'était en effet précipité dans tous les vices, et
se ruinait en folles dépenses, entraîné par Gorgias, son maître de
rhétorique, qui aimait beaucoup le plaisir, et en particulier celui du vin.
L'élève avait, à cet égard, tellement profité aux leçons de son maître,
qu'il buvait, dit-on, jusqu'à deux conges (environ 6 litres) d'un seul
trait. Ce n'était pas trop de la présence de Cicéron pour redresser de
pareils égarements. Toutefois, la joie d'avoir trouvé dans Dolabella un chef
qui assurait au parti de la liberté l'appui de l'autorité publique, lui fit
ajourner son départ après l'assemblée du 1er juin. Il se contenta d'écrire
en grec à Gorgias une lettre fort sévère, et lui ordonna de cesser tout
commerce avec son fils, lequel, cédant lui-même aux remontrances de ses
amis, surtout à celles d'Atticus, répara toutes ses fautes, et reprit tant
de goût pour ses devoirs, que son père paya toutes ses dettes, et porta sa
pension annuelle à une somme qui peut être évaluée à plus de vingt mille
francs.
(xxxvii)
Les principes bien
connus de Cicéron ne l'empêchaient pas d'avoir de fréquentes entrevues avec
les derniers ministres de César, Pansa, Hirtius, Balbus, qui continuaient à
lui témoigner beaucoup de respect et d'amitié. Ils passèrent avec lui une
partie de l'été dans ses maisons de campagne. Mais cet empressement n'était
pas désintéressé. Ils étaient persuadés que, si le parti républicain
l'emportait, personne n'était en meilleure position pour les protéger, et
que si les intrigues d'Antoine faisaient revivre la tyrannie, Cicéron serait
contre lui leur plus puissante ressource. Pansa et Hirtius avaient été
désignés consuls pour l'année suivante. Brutus et Cassius, sentant de quelle
importance il était de les faire entrer dans la parti de la république,
pressaient Cicéron d'y employer toute son adresse, surtout à l'égard
d'Hirtius, qui leur était le plus suspect. Les futurs consuls ne cessèrent
pas de l'assurer qu'il disposerait de toute leur autorité pendant leur
consulat; et, s'il lui resta quelque défiance d'Hirtius, il put croire que
Pansa était sincère.
Brutus et Cassius continuaient de vivre dans leur retraite de Lanuvium,
irrésolus, formant et abandonnant mille projets, attendant les événements et
le jour de l'assemblée du sénat. Brutus travaillait avec soin un discours
qu'il voulait y prononcer, et dont il envoya une copie à Cicéron. Préteurs
de Rome, et réduits à n'y point exercer leur charge, ils y faisaient passer
des édits sans autorité, où ils protestaient de leur amour pour la patrie,
pour la liberté, pour la paix, et proposaient même de se soumettre à un exil
perpétuel, si on les croyait des obstacles au rétablissement de la concorde.
Cependant il s'était élevé depuis quelque temps sur la scène du monde un
nouveau personnage, que son âge et sa première obscurité ne semblaient pas
appeler au grand rôle qu'il allait jouer. C'était le petit-neveu de César,
et l'héritier de sa fortune et de son nom. “Cétait, dit un historien moderne
(5), un enfant de dix-huit ans, petit et délicat, souvent malade, timide et
parlant avec peine, au point que plus tard il écrivait d'avance ce qu'il
voulait dire à sa femme; une voix sourde et faible: il était obligé
d'emprunter celle d'un héraut pour parler au peuple; assez d'audace
politique: il en fallait pour venir à Rome réclamer la succession de César.
D'autre courage, point; craignant le tonnerre, craignant les ténèbres, et
implacable pour qui lui faisait peur.” A la première nouvelle de la mort de
César, il était parti d'Apollonie, célèbre école de Macédoine, où il faisait
ses études, et il avait pris le chemin de l'Italie. Balbus, Hirtius et
Pansa, alors à Gènes, étaient allés au-devant de lui, et l'avaient présenté
à Cicéron, sous le consulat duquel il était né. Octave lui marqua les plus
grands égards, et prit envers lui l'engagement de ne se gouverner que par
ses conseils.
Ses prétentions alarmèrent à la fois les républicains et Antoine, qui
aspirait lui-même à la succession de César. Présenté au peuple par un
tribun, le jour même de son arrivée à Rome, Octave célébra par des
spectacles les victoires de son oncle, et fit porter dans ces jeux la chaire
d'or dont le sénat avait décerné le privilège au dictateur. Les tribuns la
firent enlever, et furent applaudis par tout le corps des chevaliers.
Cicéron ressentit une grande joie de cet acte d'énergie, et il surveilla
Octave.
Antoine mettait à profit tous les moments, et marchait à son but avec autant
de vigueur que d'adresse. Dans son voyage en Italie, il s'était attaché les
vétérans par de magnifiques promesses, et il en avait fait avancer vers Rome
un corps considérable, pour s'en servir au besoin contre ses ennemis. Sa
politique prévoyante avait fait approuver par le sénat tous les actes de
César: maître de ses papiers et de son secrétaire Fabérius, il forgeait de
nouveaux actes ou insérait dans ceux qui existaient déjà tout ce qui pouvait
favoriser ses vues. Il s'était ménagé par ce moyen un pouvoir absolu: tout
ce qu'il voulait faire, il le disait écrit par le dictateur, et il
l'exécutait sans avoir désormais besoin du concours du sénat, dont
l'indignation demeurait impuissante. Il vendait aux villes, aux États, aux
rois, des privilèges et des immunités, disant que ces faveurs leur avaient
été destinées par César, et qu'il les trouvait toutes réglées dans ses
papiers. “Est-ce la, écrivait Cicéron, ce que nous devions voir? L'œuvre de
Brutus se réduit donc à le faire vivre dans sa maison de Lanuvium, et à
donner aux actes, aux promesses, aux discours de César mort, plus de force
qu'ils n'en ont jamais eue pendant sa vie?” Antoine disposait de tout; il
distribuait des royaumes, et il tirait de ces marchés, ordinairement conclus
dans l'appartement de Fulvie, sa femme, des sommes si énormes, qu'ayant près
de huit millions de dettes aux ides de mars, il les avait payées avant les
calendes d'avril. Ces trafics scandaleux, le pillage du trésor public, des
sommes déposées par César dans le temple d'Ops, et de tout ce que le
dictateur avait laissé d'argent dans sa propre maison, lui avaient donné
plus de cent trente-cinq millions, qu'il employa en partie à augmenter le
nombre de ses troupes, et à acheter des partisans. Dolabella était accablé
de dettes. Il lui offrit de les payer, et de l'associer dans la suite à la
dépouille de l'empire, à la seule condition de rompre avec son beau-père et
d'abandonner son parti. Dolabella promit tout,et devint l'un des plus
redoutables ennemis du parti républicain.
Brutus ouvrit enfin les yeux sur la conduite d'Antoine, et, de concert avec
Cassius, il lui demanda
(xxxviii)
par une lettre l'explication de ses desseins. “Que veulent, lui
disaient-ils, ces vétérans dont Rome s'emplit tous les jours et ceux qu'on y
attend pour le 1er juin? Y aura-t-il sûreté pour nous à l'assemblée du
sénat?” On ne voit pas qu'Antoine ait répondu à cette lettre: il n'avait
plus besoin de feindre.
Pendant le séjour de Cicéron à la campagne, où il recevait beaucoup d'amis,
il trouva le loisir de composer plusieurs ouvrages philosophiques, qui nous
sont heureusement parvenus. Le plus important est son traité de la Nature
des Dieux, adressé à Brutus. Cet ouvrage fut bientôt suivi d'un traité
de la Divination, où l'auteur expose dans deux livres tout ce qu'on
peut dire pour et contre cette science; et d'un traité du. Destin,
qui est le complément du précédent, comme celui-ci l'est du premier. Il
composa encore à cette époque un traité des Avantages de la vieillesse,
publié sous le nom de Caton, et adressé au plus fidèle de ses amis, à
son cher Atticus; ouvrage dont on a dit qu'il donnait envie de vieillir. Peu
de temps après, il fit à cet ami un nouveau présent du même genre, et plus
précieux encore par le rapport particulier qu'il avait à la plus douce et à
la plus longue habitude de leur vie; c'était le traité de l'Emilie.
On suppose que sa traduction du Tîmée de Platon fut achevée à cette
époque. Il s'occupait aussi constamment d'un autre ouvrage commencé depuis
plusieurs années, qu'il appelle ses Anecdotes
(Ἀνέκδοτα), et qui
était l'histoire secrète de son temps. Celui-là ne devait pas être publié de
son vivant; il ne voulait le communiquer qu'à un petit nombre d'amis; et
Atticus, le premier confident de ce travail mystérieux, le pressait souvent
de l'achever. Dion raconte que Cicéron remit cette histoire, cachetée, entre
les mains de son fils, avec ordre de ne la lire et de ne la publier qu'après
sa mort. Mais la suite des événements ne lui permit plus de revoir son fils,
et l'ouvrage resta probablement imparfait. Il s'en répandit toutefois des
copies, et Asconius, son commentateur, nous en a conservé quelques traits.
Cicéron, vers la fin de mai, prit le chemin de Rome, afin de se trouver le
1er de juin à l'assemblée du sénat. Des nouvelles qu'il reçut en chemin lui
causèrent quelque effroi. On lui mandait que la ville était peuplée de
soldats, qu'Antoine en appelait de toutes parts, qu'il ne dissimulait plus
ses projets de guerre, qu'il était résolu de retirer à D. Brutus le
gouvernement de la Gaule, pour s'en emparer lui-même. Hirtius lui conseilla
de ne pas s'avancer davantage, et paraissait décidé à s'absenter aussi.
Varron lui écrivit que les vétérans tenaient des discours menaçants contre
ceux dont ils ne se croyaient pas favorisés. Greccéius l'avertit, de la part
de Cassius de se tenir sur ses gardes, et de se précautionner surtout contre
une tentative à main armée que des furieux méditaient contre Tusculum. Il
n'en fallait pas tant pour le déterminer à rebrousser chemin, et à ne pas
paraître à l'assemblée. La plupart des sénateurs, tremblants comme lui,
suivirent son exemple, laissant les consuls libres de faire avec les
sénateurs restants tous les décrets dont ils avaient besoin.
Cicéron reprit alors le projet de son voyage en Grèce, ne voulant plus
rentrer dans Rome que sous les successeurs des consuls en charge. Mais il
n'était pas permis à un sénateur de quitter l'Italie sans congé; il fallait
qu'il fût chargé d'une de ces missions libres (legatio libéra) qui
cachaient, sous un titre pompeux, l'inutilité du voyage, et donnaient droit
aux mêmes honneurs que les ambassadeurs. Cicéron sollicita de Dolabella une
de ces députations honorifiques; il la sollicita aussi d'Antoine: tous deux
n'eurent garde de refuser sa demande.
Brutus et Cassius devaient aussi quitter l'Italie, avec la commission de
faire des approvisionnements de blé, l'un dans l'Asie, l'autre en Sicile.
Leurs amis avaient sollicité pour eux cette charge subalterne, pour donner
un prétexte à leur absence, et leur procurer les moyens de pourvoir à leur
sûreté, et d'armer quelques provinces pour la défense de la
république. Mais cette commission était au-dessous de leur dignité; et
Antoine, en mettant de l'empressement à la leur faire donner, avait trouvé
une double satisfaction dans leur éloignement et dans leur humiliation.
Hirtius, craignant qu'ils ne commençassent la guerre, écrivit à Cicéron de
les détourner de partir. Cicéron les alla joindre à Antium, où ils devaient
tenir conseil avec leurs meilleurs amis. Son sentiment fut qu'il fallait
accepter cette commission. Brutus était d'avis de partir; Cassius, de
rester. Cicéron vit avec peine ce désaccord. “Je n'ai, dit-il, trouvé ici
que la division. Il n'y a ni prudence, ni ordre, ni raison dans tout ce
qu'ils entreprennent. Aussi suis-je plus déterminé que jamais à partir au
plus tôt, et à me retirer dans quelque coin du monde où je n'entende plus
parler de toutes les fautes qui se commettent.”
Octave, en arrivant à Rome, avait reçu d'Antoine un accueil fort dur. Plein
de mépris pour un jeune homme sans expérience, et de haine contre un rival,
le consul l'avait fait échouer dans ses prétentions au tribunal, dignité que
l'inclination du peuple semblait lui promettre. Mais tandis qu'Antoine, par
ses intrigues, ses menaces, son avarice, s'aliénait peu à peu tous les
esprits, Octave, par une conduite habile et prudente, sut gagner peu à peu
la faveur du sénat, du peuple et des vétérans. Il n'était besoin que de
l'inimitié d'Antoine et d'Octave pour attirer sur ce dernier les regards du
parti républicain. Cicéron parut changer d'opinion sur son caractère, et
concevoir de lui de meilleures espérances. “Je trouve, écrivait-il,
qu'Octave ne manque ni
(xxxix)
d'esprit ni de courage;
mais son âge, son nom, ses prétentions, ses conseillers, tout cela demande
que l'on examine sérieusement si l'on peut se fier à lui. Son beau-père ne
le croit pas (1); mais il faut toujours le ménager, ne fût-ce que pour
l'empêcher de se lier avec Antoine.”
(1) L. Philippe, consulaire.
Cicéron, pour se dérober à l'affluence des visiteurs, quitta sa maison de
Baies, et se rendit à celle qu'il avait dans le voisinage de Naples. C'est
là qu'au milieu des préparatifs de son départ et des préoccupations
de la politique, il commença, pour l'instruction de son fils, son traité
des Devoirs et un traité des Vertus. Son histoire secrète n'était
pas non plus négligée; et il envoya bientôt à Atticus ce fameux traité de
la Gloire, qui s'est conservé jusqu'au quatorzième siècle. Pétrarque,
qui en possédait le seul manuscrit que l'on connût, le prêta, dit-on, à un
vieillard, autrefois son précepteur, lequel était si pauvre, qu'il le mit en
gage dans un moment de besoin. On ne le retrouva plus.
Cicéron et Atticus reçurent vers le même temps, dans leur famille, une
consolation inattendue. Le jeune Quintus, leur neveu, qui, après la mort de
César, s'était attaché à Antoine, et était même appelé son bras droit, prit
tout à coup la résolution de se joindre à Brutus, en protestant de son
horreur pour les desseins secrets d'Antoine. Il apprit à son père que ce
consul l'avait engagé à se saisir des points les mieux fortifiés de la
ville, et à le proclamer dictateur; proposition qu'il avait repoussée.
Quintus, charmé de ces sentiments, présenta son fils à Cicéron, lui
répondant de sa sincérité, et le priant de le réconcilier avec Atticus.
Cicéron fut beaucoup plus difficile à persuader que son frère, et ne douta
pas que ce retour ne fût un nouvel artifice pour tirer d'eux de l'argent,
dont ce jeune homme endetté avait alors un pressant besoin. Mais celui-ci
parvint enfin à détruire les soupçons et les défiances de sa famille.
Cicéron, après l'avoir observé quelque temps, fut si persuadé de sa bonne
foi, qu'à son tour il le recommanda tendrement à Atticus, et le présenta
même à Brutus, comme un de ses plus sûrs partisans. Quintus fut fidèle à ses
promesses; et pour donner un témoignage éclatant de sa sincérité, il eut la
hardiesse, avant la fin de l'année, d'accuser Antoine devant le peuple
d'avoir pillé le temple d'Ops. Mais quelque motif qui eût déterminé ce
changement de conduite, il fut fatal à son père et à lui-même, et dut être
compté parmi les griefs d'Antoine contre Cicéron.
Le voyage en Grèce, projeté depuis si longtemps, fut enfin entrepris au
milieu de l'été (709). Cicéron avait fait préparer trois petits navires pour
sa suite et pour lui. Mais informé qu'il arrivait de tous côtés des légions,
et que la mer était toujours infestée de pirates, il jugea qu'il y aurait
plus de sûreté à s'embarquer avec Brutus et Cassius, qui avaient rassemblé
une flotte considérable sur les côtes de Campanie. Brutus reçut froidement
sa proposition. Cicéron, persuadé par les lettres d'Atticus que tout le
monde approuvait son départ, pourvu qu'il fût de retour au commencement de
l'autre année, suivit lentement la côte jusqu'à Rhêgium, sortant chaque nuit
de son vaisseau pour la passer chez quelque ami. S'étant arrêté un jour à
Vélie, il y commença ses Topiques, et il avait achevé cet ouvrage
avant son arrivée à Rhégium. Ayant aussi, dans sa route, ouvert son traité
sur la Philosophie académique, il s'aperçut que la préface du 3e
livre était la même qu'il avait déjà publiée en tête de son traité de la
Gloire. Ce double emploi s'explique par l'habitude où il était d'avoir
toujours en réserve un grand nombre de préfaces appropriées aux sujets
habituels de ses études, et qu'il pouvait appliquer, sans trop de
changements, à chaque ouvrage qu'il publiait. II en écrivit aussitôt une
nouvelle pour le traité de la Gloire, et la fit parvenir à Atticus,
en le priant de la substituer à la première dans son exemplaire de ce
traité.
A Rhégium, il reçut la visite des principaux habitants de la ville, qui lui
apportèrent des nouvelles arrivées le même jour de Rome, et auxquelles il
était loin de s'attendre. Il s'était fait, disait-on, dans Antoine un
changement inespéré; il renonçait à ses prétentions sur la Gaule; il se
soumettait à l'autorité du sénat; il allait se réconcilier avec Brutus et
Cassius: on ne s'entretenait plus que d'une pacification générale; et les
affaires, pour prendre la direction la plus heureuse, ne demandaient plus
que la présence de Cicéron, dont on blâmait le départ. Cicéron abandonna son
projet de voyage. Atticus le confirma dans cette résolution nouvelle, et le
pressa de revenir. Dès que Brutus le sut de retour à Vélie, il alla le
saluer, et lui apprit ce qui s'était passé dans le sénat à l'assemblée du
1er juin. Pison s'y était signalé par un discours plein de fermeté. Il avait
fait des propositions vigoureuses en faveur de la liberté; mais personne ne
l'avait secondé. Quoique, au fond, Cicéron continuât de s'applaudir de son
retour, il lui parut qu'il n'était pas aussi nécessaire à Rome qu'il se
l'était imaginé, puisque aucun sénateur n'avait osé soutenir Pison, et que
Pison ne s'était pas assez soutenu lui-même pour reparaître le lendemain au
sénat.
Cicéron voyait alors pour la dernière fois Brutus, qui quitta bientôt
l'Italie avec Cassius. César leur avait donné pour l'année qui suivrait leur
préture, à l'un la Macédoine, à l'autre la Syrie; mais Antoine les
dépossédant tous deux du gouvernement de ces importantes provinces, avait
fait donner celui de la Crète à Brutus, de la Cyrène, à Cassius; et prenant
pour lui-même la Macédoine, avait abandonné la Syrie à Dolabella. Tous ces
arrangements
(xl)
faits, il avait aussitôt
envoyé son frère Caïus prendre en son nom possession de la première, tandis
que, de son côté, Dolabella courait s'emparer de la sienne. Ils voulaient
prévenir leurs ennemis, auxquels ils supposaient le dessein de s'en saisir
et qui, en effet, s'étaient enfin déterminés à s'établir dans leurs
provinces, pour y faire l'essai de leurs forces.
Dès que l'on sut à Rome que Cicéron allait y rentrer, il se porta une telle
foule à sa rencontre, qu'il mit presque un jour à se rendre des portes de la
ville à sa maison. Le sénat s'assemblait le lendemain (1er septembre).
Antoine l'invita à s'y trouver. Cicéron se tint couché, prétextant le
mauvais état de sa santé et la fatigue du voyage, mais en réalité dans la
crainte de quelque embûche. Antoine, offensé du motif injurieux qu'on
pouvait donner à cette absence, voulut envoyer des soldats avec l'ordre de
l'amener de force, ou de brûler sa maison. Mais à la prière de plusieurs
personnes qui s'entremirent, il révoqua cet ordre, et se contenta de faire
prendre des gages sur ses biens. L'intention d'Antoine était de faire
décerner ce jour-là des honneurs extraordinaires à la mémoire de César; et
il s'était flatté, en forçant Cicéron de prendre part à la délibération, de
le rendre ou méprisable aux yeux de son parti, si la peur le faisait
consentir à ce nouveau décret, ou odieux aux vétérans, s'il avait assez de
fermeté pour s'y opposer. En son absence, le décret passa sans opposition.
Le sénat s'étant assemblé le jour suivant, Antoine s'absenta à son tour, et
Cicéron prononça la première de ces harangues fameuses qui portent le nom de
Philippiques, et qui furent le dernier monument de son éloquence. Il
se plaignit de la violence qu'Antoine avait exercée contre lui, déclara
qu'il n'aurait jamais consenti au décret de la veille; et, entamant la
discussion des affaires publiques, il exprima son sentiment avec une
noblesse et une fermeté dignes des meilleurs temps de la république,
conservant à peine d'ironiques ménagements pour Antoine et pour ceux qui
tenaient après lui le premier rang.
Furieux de ce discours, Antoine indiqua pour le 19 une assemblée, à laquelle
il invita nommément Cicéron. Son dessein étant de lui répondre, il employa
tout l'intervalle à préparer sa harangue; et il passait des jours entiers
dans sa maison de Tibur pour assurer sa déclamation. Il se trouva des
premiers au sénat, avec une garde nombreuse,dans l'espoir d'y voir venir son
adversaire, qu'il attendit en vain. Antoine qui, selon l'expression de
Cicéron, parut plutôt vomir que parler, se livra contre lui, dans son
discours, aux derniers excès de la fureur, et l'accusa d'être le premier
auteur de la conspiration contre César, afin de pousser à quelque violence
les vétérans qu'il avait eu soin de placer à portée de sa voix, aux portes
du temple où était assemblé le sénat.
Cicéron s'était retiré dans la maison qu'il avait près de Naples. C'est dans
cet asile qu'il composa sa seconde Philippique, la plus célèbre de toutes,
que les Romains appelaient une “œuvre divine,” et qui a fait admirer
comment, sur le déclin de la vie, il a pu retrouver la chaleur et l'énergie
des plus belles productions de sa jeunesse. Cette harangue ne fut pas
prononcée. Il en envoya seulement une copie à Brutus et à Cassius, qui
l'admirèrent.
Octave se fortifiait tous les jours. Il sollicitait avec ardeur les soldats
de son oncle, leur donnait de fortes sommes, leur en promettait de plus
fortes, et en détachait un grand nombre du parti d'Antoine. Il fit tout pour
gagner la confiance des républicains, et obtenir le commandement des troupes
dont il prévoyait qu'on aurait besoin contre son rival. Il écrivit tous les
jours à Cicéron; il lui demanda une entrevue secrète à Capoue, que celui-ci
refusa; Il le fit prier par ses amis de revenir à Rome, l'engageant à se
mettre à la tête des affaires, à combattre avec lui leur ennemi commun, à
sauver une seconde fois la république, lui promettant de suivre tous ses
conseils, et l'appelant son père. Mats tant de promesses et de flatteries
demeuraient sans succès. Cicéron se défiait toujours d'un enfant (c'est
l'expression qu'il emploie, et dont Octave devait plus tard lui faire un
crime), d'un enfant qui ne lui paraissait pas capable de se mesurer avec
Antoine, et qui, en cas de succès, se signalerait à son tour par des
violences. Il était d'ailleurs bien décidé à ne reparaître à Rome que
lorsque Antoine en serait sorti; et il en attendait le jour dans l'étude et
le travail. Outre la seconde Philippique, il acheva son Traité des
Devoirs, et commença celui des Paradoxes, espèce de développement
des principaux points de la doctrine des stoïciens.
Antoine était allé à Brindes au-devant de quatre légions qui revenaient de
Macédoine; il espérait les gagner à sa cause, et rentrer avec elles à Rome
pour l'asservir. Trois d'entre elles repoussèrent obstinément ses offres. Il
en fit venir les centurions, au nombre de trois cents, et les fit massacrer
l'un après l'autre. Fulvie, avide comme lui d'un tel spectacle, eut le
visage couvert du sang qui jaillissait.
(xli)
des menaces terribles
contre ceux qui se dispenseraient d'y assister. Cependant il s'absenta
lui-même, et indiqua une autre assemblée pour le 28.
Mais deux des trois légions qu'il avait trouvées inflexibles, avaient pris
parti pour Octave, et s'étaient saisies d'Albe, dans le voisinage de Rome. A
cette nouvelle, il abandonna précipitamment la ville, pour aller s'emparer
avec son armée de la Gaule cisalpine, qu'il s'était fait donner, et que
Décimus Brutus occupait déjà.
Dès que Cicéron le sut parti, il quitta ses livres et la campagne, et revint
à Rome, où il eut aussitôt des conférences avec les consuls désignés et avec
Octave. Le sénat était convoqué pour le 20 décembre. Cicéron avait résolu de
n'y paraître qu'après l'installation des nouveaux consuls; mais comme on
avait reçu la veille un édit de D. Brutus, par lequel il interdisait à
Antoine l'entrée de sa province, et lui déclarait qu'il la conserverait au
sénat et au peuple, Cicéron crut nécessaire, pour encourager Décimus,
d'obtenir du sénat un décret en sa faveur. Il se rendit de bonne heure à
l'assemblée; et le bruit qui s'en répandit aussitôt y attira tous les
sénateurs.
Cicéron ouvrit la délibération. Il commença (iiie Philipp.) par
s'étonner qu'on voulût attendre le 1er de janvier pour agir contre Antoine,
qui n'attendait pas ce terme pour agir contre la république; il se plaignit
qu'on laissât de simples particuliers soutenir une guerre qui intéressait
tout l'État; il demanda qu'on récompensât leurs efforts; il exalta le
dévouement de Décimus et les obligations qu'on avait au jeune César, dont le
courage avait empêché Antoine d'exécuter les projets funestes qu'il méditait
contre Rome. La conclusion de son discours fut “que les nouveaux consuls,
Pansa et Hirtius, devaient être chargés de la sûreté de la ville et du sénat
dans l'assemblée du 1er janvier; qu'il fallait décerner des
remercîments à D. Brutus, à son armée, aux villes et aux colonies de sa
province; des éloges et de nouveaux honneurs à Octave et aux légions qui
l'avaient suivi.” Toutes ces propositions furent adoptées unanimement, et le
sénatus-consulte rédigé sur les conclusions de Cicéron.
Du sénat, Cicéron se rendit au forum. Là (ive Philipp.),
il rendit compte au peuple de ce qui venait de se passer au sénat. Il combla
de nouvelles louanges le jeune César, D. Brutus et leurs légions. II appela
Antoine ennemi de l'État, quoique le sénatus-consulte ne lui eût pas donné
ce nom; il lui refusa celui de consul, et le peuple applaudit à tout. Il
inspira aux Romains les sentiments qui avaient animé leurs ancêtres; il leur
montra une victoire facile, et les enflamma par l'amour d'une liberté que le
sénat, à sa voix, à son exemple, allait reconquérir avec eux. Cicéron, en
rappelant dans la suite le jour où il avait prononcé ces deux harangues,
déclara que s'il avait dû perdre la vie en descendant de la tribune, il
aurait cru qu'il ne manquait rien à sa gloire, puisqu'il avait entendu le
peuple romain s'écrier: “II a sauvé encore une fois la patrie.” On pense que
ce fut alors qu'il publia sa seconde Philippique; elle fut répandue dans
Rome et dans l'Italie, et lue partout avec avidité. Antoine ne la pardonna
jamais à l'auteur, et ce fut la principale cause de sa mort.
Le reste de cette orageuse année fut employé à lever des troupes pour la
garde des nouveaux consuls et pour la défense de l'État. On pressa les
préparatifs de la guerre avec d'autant plus de diligence, qu'on apprit
bientôt qu'Antoine avait formé le siège de Modène, où D. Brutus, qui ne se
trouvait pas assez fort pour tenir la campagne, avait pris le parti de se
renfermer. Octave, sans attendre l'ordre du sénat, mais par le conseil de
Cicéron, sortit de Rome à la tête de ses troupes, et marcha sur les traces
d'Antoine. Lui-même n'était pas en état de le combattre; mais il espérait
qu'en l'observant de près, il trouverait l'occasion de lui nuire, et que
cette diversion encouragerait Décimus à se défendre avec assez de vigueur
pour donner aux nouveaux consuls le temps de s'avancer à son secours avec
leur grande armée.
Tous les partis attendaient impatiemment l'ouverture de l'année (710),pour
juger des dispositions des nouveaux consuls. Cicéron, dans les fréquents
entretiens qu'il avait eus avec eux, en avait obtenu la promesse de
combattre avec vigueur les ennemis de l'État. Mais ce qu'ils devaient à
César, et leurs liaisons avec ses partisans, leur laissaient des scrupules
qui arrêtèrent leur zèle et embarrassèrent leurs premières démarches. Ils
voulaient, avant de recourir à la voie des armes, employer celle des
négociations. Ils montrèrent toutefois, à la première assemblée du sénat
(1er janvier), beaucoup de noblesse et de fermeté, et exhortèrent les
sénateurs à prendre des mesures dignes de la grande cause dont ils se
disaient les chefs. Mais sachant que le sentiment de Cicéron était que l'on
commençât par déclarer Antoine ennemi public, ils invitèrent Fufius Calénus,
ami d'Antoine, à dire le premier son avis, dans l'espoir que son opinion,
contraire aux mesures de rigueur, disposerait les esprits à la modération.
L'opinion de Calénus fut “de suspendre les hostilités, et d'envoyer une
députation à Antoine, pour le prier de renoncer à ses prétentions sur la
Gaule, et de reconnaître l'autorité du sénat.” Plusieurs sénateurs se
rangèrent à cet avis.
Cicéron le combattit avec force (ve Philipp.). “La
république ne pouvait traiter sans honte avec un citoyen armé contre elle,
que divers arrêtes du sénat avaient implicitement déclaré ennemi public, et
qu'il fallait flétrir de ce nom par un décret formel. Une députation ne
serait pas seulement inutile,
(xlii)
mais nuisible. Antoine ne se soumettrait à rien de juste, et ces lenteurs
retarderaient les opérations de la guerre, refroidiraient l'ardeur des
troupes. Il fallait, au contraire, ne pas perdre un seul moment, presser la
levée des troupes à Rome et dans l'Italie, suspendre les affaires civiles,
fermer les tribunaux, déclarer la patrie en danger, faire prendre à tous les
citoyens, aux sénateurs même, l'habit de guerre, et charger les consuls de
pourvoir à la sûreté de la république, en les armant de l'autorité d'une
dictature temporaire.” Passant ensuite à ce qui regardait les honneurs
décernés dans la dernière assemblée du sénat, aux citoyens qui en avaient
été jugés dignes, il présenta un modèle de décret séparé pour chacun d'eux,
pour D. Brutus, pour Octave et pour Lépide. Les actes de ce dernier ne
méritaient pas, il est vrai, une telle faveur, et sa fidélité même était
suspecte; mais se trouvant à la tête de la meilleure armée de l'État, il
était peut-être de tous les citoyens celui dont il y avait le plus de mal à
craindre et le plus de services à espérer; Cicéron croyait d'ailleurs le
gagner, par des marques de confiance, au parti du sénat. Quant à Octave,
après l'avoir de nouveau comblé d'éloges, il proposa de lui accorder par un
décret le commandement des troupes qu'il avait rassemblées, et demanda pour
lui le rang et les privilèges de propréteur. Il motiva cette demande, en
faveur d'un citoyen aussi jeune que César, sur les espérances qu'il donnait
à la patrie. Il se rendit le garant de ses intentions; “il connaissait,
dit-il, jusqu'aux plus secrets sentiments de son cœur; il engageait sa
parole qu'Octave ne cesserait jamais d'être ce qu'il était alors,
c'est-à-dire, tel qu'on souhaitait qu'il fût toujours.” Il demanda enfin des
récompenses pour les légions qui l'avaient suivi. Il voulut que les consuls
fussent chargés de leur assigner des terres, et leur remissent, après la
guerre, les sommes qui leur avaient été promises.
Le sénat sanctionna par un décret ces dernières propositions de Cicéron; et
quoique les distinctions sollicitées pour Octave parussent si excessives à
Cicéron même, qu'il n'avait cru pouvoir les proposer sans offrir sa caution,
plusieurs sénateurs allèrent encore plus loin que lui, et demandèrent pour
l'héritier de César, l'un l'érection d'une statue, l'autre le privilège de
posséder avant l'âge toutes les magistratures.
Mais les débats sur la députation furent plus longs et plus violents.
Quelques-uns des principaux sénateurs appuyèrent cet avis, et les consuls
qui le favorisaient, voyant que la majorité des suffrages inclinait à celui
de Cicéron, laissèrent durer la discussion jusqu'à la nuit. Elle recommença
le lendemain avec la même chaleur, fut de nouveau prolongée jusqu'au soir,
et reprise le troisième jour. On allait enfin rédiger un sénatus-consulte
conforme à l'opinion de Cicéron; mais le tribun Salvius s'y opposa, et les
partisans de la députation finirent par l'emporter.
On nomma sur-le-champ pour députés trois sénateurs consulaires, S.
Sulpicius, L. Pison, et L. Philippus; et Cicéron régla lui-même ou plutôt
restreignit leurs pouvoirs. Ils ne pouvaient traiter avec Antoine; on les
chargeait seulement de lui porter, au nom du sénat, l'ordre absolu de lever
le siège de Modène, et de cesser les hostilités dans la Gaule.
Une si longue délibération intéressait si vivement le peuple que, tous les
jours, il se tenait assemblé au forum, afin d'en avoir des nouvelles, et
d'en connaître plus tôt l'issue. Le nom, l'éloge de Cicéron étaient dans
toutes les bouches; et le jour où la discussion fut close au sénat, toutes
les voix l'appelèrent à la tribune aux harangues. Il y monta, conduit par le
tribun Apuléius. Il rappela (vie Philipp.) ce qu'on avait
arrêté, d'après son opinion, dans l'assemblée du 20 de décembre; exposa
ensuite en peu de mots l'avis qu'il avait ouvert dans la séance du 1er de
janvier, et qui, après avoir prévalu pendant trois jours, venait d'être
abandonné. Toutefois, pour soutenir les courages, il s'attacha à prouver que
la décision du sénat était moins une mesure de conciliation qu'une
déclaration de guerre à Antoine, lequel refuserait certainement d'obéir. Il
fallait donc, sans hésitation, sans délai, prendre les armes et l'habit de
guerre. On le verrait lui-même à la tête des défenseurs de la liberté; tout
son zèle, toute sa vigilance seraient consacrés à cette noble cause, qui ne
pouvait périr.
Pendant que les députés se rendaient au camp d'Antoine, celui-ci pressait
vigoureusement le siège de Modène; et les amis qu'il avait à Rome voulant
engager le sénat dans de nouvelles négociations, cherchaient à prévenir, par
des raisons spécieuses le mauvais effet qu'y devait produire la réponse
présumée d'Antoine. Calénus, qui était à la tête de ce parti, entretenait
avec lui une correspondance active, et publiait celles de ses lettres qu'il
jugeait le plus propres à jeter le doute et le découragement parmi leurs
adversaires.
Cicéron ne fut pas trompé longtemps par ces intrigues. Il s'efforça de
ranimer le courage des sénateurs (viie Philipp.). Il
déclara qu'il ne fallait, à aucun prix, consentir à la paix avec Antoine,
parce que cette paix serait honteuse, parce qu'elle serait funeste, parce
qu'elle serait impossible; trois points qu'il démontra victorieusement. Il
dévoila les projets de ceux qui la demandaient, et laissa tomber quelques
railleries amères sur Calénus, qui n'y trouva d'autre réponse que des
injures dans le goût de cette apostrophe: “Voilà ce que j'ai voulu, ô
Cicéron, ou Cicercule, ou Cicérace, ou Cicérathe, ou quelque autre nom que
tu choisisses.”
Cependant les consuls, animés par Cicéron, avaient hâté les préparatifs de
guerre. Hirtius s'é-
(xliii)
tait déjà dirigé vers la Gaule à la tête d'une armée, tandis que Pansa,
resté à Rome, continuait de presser les levées. Hirtius espérait que ses
forces réunies à celles d'Octave suffiraient pour contenir Antoine, en
attendant que Pansa parût avec des légions nouvelles, et le mît en état de
livrer une bataille dont le succès lui semblait certain.
Antoine refusa de se soumettre aux ordres du sénat. Il ne permit même pas
aux députés de parler à D. Brutus, comme le prescrivaient leurs
instructions; défense qui les lit recourir à des stratagèmes dont l'histoire
a conservé le souvenir. Ils s'étaient procuré quelques plongeurs qui
portaient sous l'eau à Décimus des avis gravés sur des lames de plomb.
Antoine, qui découvrit la ruse, coupa ces communications en faisant placer
dans le fleuve des trappes et des filets. Il en fut alors établi une autre
par les airs, et des pigeons devinrent des messagers plus sûrs. Antoine fit
porter à Rome par les députés même des conditions qu'ils eurent la faiblesse
de recevoir et l'imprudence de transmettre au sénat. Ces conditions étaient
celles d'un maître: des récompenses et des terres pour ses troupes; pour
lui, le gouvernement de la grande Gaule pendant cinq ans; une armée de six
légions, formée en partie des troupes retirées à Décimus; le maintien de
toutes ses lois judiciaires, de tous les décrets portés par lui au nom de
César.
Ce rapport souleva l'indignation de Rome entière, et donna beaucoup
d'avantage à Cicéron pour ramener le sénat à son sentiment. Toutefois le
parti de Calénus fut encore assez fort pour obtenir quelques ménagements en
faveur d'Antoine; par exemple, pour faire qualifier son entreprise de
“tumulte” au lieu de guerre et de révolte; et le rebelle, “d'adversaire,” et
non d'ennemi public. Pansa concourut même par son suffrage à ces mesures
timides.
Mais Cicéron fit prévaloir à son tour des résolutions plus importantes. Les
partisans d'Antoine avaient proposé une seconde ambassade: il la fit
repousser. Il blâma ces ménagements honteux que l'on gardait encore avec
Antoine, releva l'arrogance et l'absurdité de ses demandes, fit honte aux
députés d'avoir eu la bassesse de les rapporter, de les entendre, dénonça
les manœuvres de ses partisans, reprocha leur mollesse aux consulaires,
proposa un terme (le 15 mars) au delà duquel tous ceux qui resteraient
attachés à Antoine seraient regardés comme ennemis publics, et fit d'autres
propositions qu'adopta le sénat. Il paraît même que le consul, à qui il
avait adressé, dès le début de son discours, de sévères remontrances, le
seconda dans toutes ses demandes. Il rendit compte de cette séance à
Cassius: “Nous avons, lui dit-il, d'excellents consuls, mais d'infâmes
consulaires. Le sénat est plein de courage; mais ce n'est pas dans les
premiers rangs que sont les gens de cœur. Rien de plus ferme, rien de mieux
disposé que le peuple et toute l'Italie. Rien de si méprisable que nos
députés. Tout le monde a recours à moi, et je suis, grâce au ciel, devenu
populaire dans une bonne cause.”
Les consulaires, à cause de leur dignité, étaient exemptés de revêtir
l'habit de guerre comme les autres citoyens. Pour rendre plus frappante
encore l'imminence du danger, Cicéron renonça de ce jour à son privilège, et
prit le sagum avec le reste de la ville.
Pansa convoqua le lendemain l'assemblée du sénat, pour y faire décerner des
honneurs à la mémoire de l'un des trois députés, L. Sulpicius, qui, parti
malade de Rome, était mort en arrivant sous les murs de Modène. Il demanda
pour lui des funérailles publiques, un tombeau, une statue. P. Servilius,
qui donna son avis après lui, approuva les deux premières parties de sa
proposition, mais repoussa l'autre. Lié par une étroite amitié à Sulpicius,
celui des députés sur lequel les bons citoyens avaient fondé le plus
d'espérances, Cicéron reprit la demande du consul, et y donna même une
nouvelle extension dans le décret qu'il proposa (ixe Philipp.),
et qui portait “qu'il serait élevé sur la tribune aux harangues une statue
d'airain à Sulpicius, avec une inscription sur la base où on lirait qu'il
était mort au service de la patrie; que l'on concéderait, autour de cette
statue, un espace de cinq pieds carrés à ses enfants et à sa postérité, pour
assister aux combats des gladiateurs; qu'on lui ferait de magnifiques
funérailles aux frais de l'État, et que le consul Pansa marquerait, dans le
champ Esquilin ou ailleurs, une place de trente pieds carrés, pour servir de
sépulture à lui et à tous ses descendants.”
Le sénat adopta le décret dans la forme même dont Cicéron l'avait revêtu, et
un jurisconsulte du troisième siècle affirme que la statue subsistait encore
de son temps.
Ni Brutus ni Cassius n'avaient écrit au sénat depuis leur départ d'Italie.
Le consul Pansa reçut enfin du premier une lettre qui l'informait des
avantages remportés par lui sur Caïus, frère d'Antoine, avec les troupes qui
lui servaient à contenir dans la soumission les provinces de Macédoine,
d'Illyrie et de Grèce. Ces dépêches faisaient en outre mention de quelques
autres succès, dont une partie était due au jeune Cicéron, qui commandait la
cavalerie de Brutus.
Le sénat aussitôt convoqué, le consul demanda pour Brutus des actions de
grâces et des honneurs, et, suivant son usage, il invita Calénus, son
beau-père, à dire son opinion. Calénus l'avait rédigée; il ne fit que la
lire; elle portait en substance: “Que la lettre de Brutus était correctement
écrite, mais qu'ayant agi sans autorisation, il devait être prié de remettre
son armée à celui qui en recevrait le commandement du sénat.” Cicéron, avec
son ironie
(xliv)
habituelle, attaqua la
forme d'une telle proposition avant d'en ruiner le fond (xe
Philipp.):
“Que
la lettre de Brutus fut correctement écrite, c'était le sujet d'un mince
éloge, et qui le regardait moins que son secrétaire; il n'y avait au monde
que Calénus qui eût imaginé de proposer un décret ainsi conçu: Telle
lettre est écrite correctement.”
II combattit ensuite
avec énergie le reste de la proposition, fit le plus grand éloge de Brutus,
opposa sa conduite, dans cette guerre, à celle de Caïus, qu'il flétrit des
mêmes couleurs dont il avait coutume de peindre son frère Antoine; et il
soumit à la sanction du sénat un décret qui laissait à Brutus la garde des
provinces de Macédoine, d'Illyrie et de Grèce, et le commandement de l'armée
levée par lui. Celui-ci pouvait, en conséquence, employer à la solde de ses
troupes les revenus de l'État, et, en cas d'insuffisance, imposer des
contributions nouvelles. Enfin il lui était permis d'approcher avec ses
troupes aussi près qu'il voudrait de l'Italie.
Cicéron envoya cette harangue à Brutus avec celle du 1er de janvier. Brutus
en fut si satisfait, que Cicéron se crut autorisé à lui envoyer toutes les
autres.
Des nouvelles sinistres corrompirent bientôt la joie causée par ces heureux
événements. Dolabella avait fait prisonnier le proconsul Trébonius, un des
conjurés; et il avait souillé sa victoire par une horrible cruauté.
Trébonius avait subi la torture pendant deux jours; après quoi on lui avait
coupé la tête, et promené ses tristes restes dans le camp de Dolabella.
Celui-ci fut aussitôt déclaré ennemi public par le sénat assemblé; tous ses
biens furent confisqués; et Calénus même déclara que si l'on ouvrait un avis
plus sévère, il n'hésiterait pas à l'embrasser. Il se flattait de jeter
Cicéron dans quelque embarras, à cause de son alliance avec Dolabella, en
faveur duquel il pensait que l'illustre consulaire hasarderait un avis plus
modéré. Mais s'il se trompa sur ce point, il l'embarrassa en effet par une
autre proposition: c'était celle de choisir un général pour commander les
forces de la république contre Dolabella. Calénus ouvrit à la fois deux
avis: l'un, que P. Servilius fût envoyé contre lui avec une commission
extraordinaire du sénat; l'autre, que l'on donnât aux consuls les provinces
d'Asie et de Syrie. La seconde de ces deux propositions fut accueillie avec
faveur, surtout par le parti d'Antoine, qui n'y voyait que des avantages. En
effet, on détournait l'attention des consuls de la guerre d'Italie; on
donnait à Dolabella le temps de se fortifier en Asie; on jetait des semences
de froideur entre les consuls et Cicéron; et on faisait un affront à
Cassius, qui, se trouvant sur les lieux, semblait avoir plus de droit que
personne à continuer la guerre.
Le débat ayant duré tout le jour sans amener aucun résultat, l'assemblée fut
remise au lendemain. Servilie, belle-mère de Cassius, et tous ses amis,
s'efforcèrent, dans cet intervalle, d'obtenir de Cicéron qu'il renonçât à
parler en sa faveur, dans la crainte d'exciter contre Cassius et de
s'attirer à lui-même le ressentiment de Pansa. Aucune considération ne put
l'ébranler, et le lendemain il appuya de toutes les forces de son éloquence
le décret qui devait sauver l'honneur de Cassius (xie
Philipp.). Il s'éleva avec énergie contre la cruauté de Dolabella,
présage de celles d'Antoine, si jamais il était vainqueur. Il fit du premier
un portrait affreux, demanda pardon aux dieux et aux hommes de l'avoir eu
pour gendre, et s'applaudit de ce qu'on l'avait déclaré ennemi public. Puis
réfutant l'une après l'autre les deux propositions de Calénus, il prouva que
Cassius seul pouvait faire la guerre avec succès.
Cicéron sortit du sénat après la délibération, et alla droit au forum, pour
y recommander Cassius au peuple. Il le fit d'une voix qui, écrit-il, remplit
le forum.” “Les applaudissements surpassèrent, dit-il ailleurs, tous ceux
qui avaient jamais accueilli ses harangues.” Mais Pansa l'avait suivi: pour
affaiblir l'autorité de ses paroles, il déclara au peuple que l'avis de
Cicéron était repoussé par ses meilleurs amis, et par les parents même de
Cassius. Quelques historiens ont prétendu que le résultat de ce débat fut à
l'avantage de Cicéron; il paraît au contraire, par une lettre qu'il écrivit
de suite à Cassius, pour expliquer sa conduite, que le crédit de Pansa
l'ayant emporté sur le sien, ce fut aux consuls qu'on décerna les deux
provinces. Mais Cassius suivit le conseil de Cicéron, qui était de ne se
point embarrasser des décrets portés à Rome; il continua la guerre sous ses
propres auspices, et défit Dolabella, qui se donna la mort pour se
soustraire à la vengeance du vainqueur.
Cependant D. Brutus était pressé si vigoureusement dans Modène, que ses amis
en conçurent de vives alarmes. On ne doutait pas que s'il tombait au pouvoir
d'Antoine, il n'éprouvât le même sort que Trébonius; et cette crainte agit
si puissamment sur le cœur de Cicéron, que sur de nouvelles propositions de
paix faites au sénat, il consentit non-seulement au décret d'une seconde
ambassade, mais à en faire lui-même partie avec quatre autres consulaires.
Puis s'étant bientôt convaincu que les partisans d'Antoine n'avaient donné
que de fausses espérances, et qu'il exposerait inutilement sa vie pour
sauver celle de Décimus, dès la première assemblée du sénat il demanda
instamment que le projet de.cette ambassade fût abandonné (xiie
Philipp.), et démontra qu'il y était d'ailleurs moins propre qu'un
autre. “Il s'était trompé, tout le monde s'était trompé avec lui; l'erreur
est le partage de l'humanité, mais il n'y a que le sage qui sache réparer
ses fautes.” Et l'assemblée sanctionna par un
(xlv)
nouveau décret l'incontestable vérité de ces maximes.
Vers la fin du même mois (avril), Pansa sortit de Rome à la tête d'une
armée, pour joindre Hirtius et Octave, et tenter une bataille décisive qui
délivrât Décimus.
Tandis qu'Antoine jetait ainsi dans Rome l'incertitude et la confusion, il
s'efforçait d'ébranler la fidélité d'Hirtius et d'Octave. Mais leurs
réponses, toujours pleines de fermeté, le renvoyaient constamment à
l'autorité du sénat. Il fit un nouvel effort; et dans une lettre adroitement
mêlée de reproches et de flatteries, il les plaignit d'oublier leurs
véritables intérêts, pour se laisser conduire aveuglément par Cicéron, qui
ne pensait qu'à rétablir la faction de Pompée, et qu'à se créer un pouvoir
dont ils seraient les premières victimes. Hirtius et Octave, au lieu de
répondre à cette lettre, l'envoyèrent à Cicéron, pour en faire l'usage qu'il
jugerait convenable.
De son côté, le sénat en recevait une de Lépide, qui se contentait de
l'exhorter à la paix, et ne donnait aucune marque de reconnaissance pour les
honneurs que Cicéron lui avait fait décerner. Ce silence blessa les
sénateurs, et confirma le soupçon de ses intelligences avec Antoine.
L'assemblée ordonna par un décret, a qu'on lui ferait des remercîments de
son zèle pour la paix; mais qu'on le prierait de ne s'en plus mêler, et d'en
laisser le soin à ceux qui étaient persuadés qu'elle était impossible, si
Antoine ne mettait bas les armes et ne la demandait lui-même.” Toutefois, la
lettre de Lépide fut, pour les amis d'Antoine, une nouvelle occasion de
proposer un traité avec ce rebelle. Cicéron combattit aussitôt (xiiie
Philipp.) la proposition de ce traité de paix, qu'il appelait “un
traité d'esclavage,” tout en protestant de sa considération pour Lépide;
puis s'emportant contre Antoine à ses invectives ordinaires, il montra que
toute espérance de paix était avec lui trompeuse et funeste; et il en donna
pour nouvelle preuve la lettre à Hirtius et à Octave, qu'il lut à
l'assemblée, relevant avec une raillerie ingénieuse et vive, l'extravagance,
les rancunes, la fureur dont chaque mot était empreint.
Aussitôt après ce débat, dont le résultat fut conforme à son discours, il
écrivit à Lépide une lettre courte et froide, comme pour lui faire entendre
qu'on était fort tranquille à Rome, et que ses actions, quelles qu'elles
fussent, y causeraient peu d'inquiétude.
Plancus, qui commandait dans la Gaule, avait écrit au sénat dans le même
sens que Lépide. Ses exhortations reçurent le même accueil, et Cicéron lui
fit une réponse encore plus froide qu'à Lépide.
Cicéron avait fait tout ce qu'on pouvait attendre de la prudence humaine
pour le rétablissement de la république. C'est à ses conseils, à son
autorité, à son exemple, qu'elle devait l'élan généreux qui retarda
l'instant de sa ruine; il avait soulevé contre Antoine toutes les forces de
l'Italie. Si Octave était aussi dangereux qu'Antoine pour la cause publique,
l'opposition de leurs intérêts personnels et la jalousie qu'ils avaient déjà
fait éclater mutuellement, pouvaient servir à les ruiner tous deux. Cicéron
en ménageait adroitement les occasions, avec l'attention toutefois de se
précautionner contre Octave, en mettant la supériorité des forces du côté
des consuls, dont il était parvenu à faire les zélés partisans de la
liberté. Outre les difficultés qu'il avait rencontrées à conduire ainsi les
affaires d'Italie, il trouvait d'autres obstacles au dehors dans les
gouverneurs de provinces. Presque tous devaient leur élévation à César; ils
avaient été les soutiens de sa tyrannie, et désormais détachés du parti de
la vieille république, ils espéraient ou s'élever eux-mêmes au souverain
pouvoir, ou du moins le partager, en épousant la cause de quelque ambitieux
qui eût plus de puissance avec les mêmes prétentions. De tels citoyens,
chefs d'armées nombreuses, n'étaient guère disposés à marquer de la
soumission pour le sénat qu'ils s'étaient accoutumés à mépriser, ni à mettre
le pouvoir militaire, qui avait longtemps gouverné, dans la dépendance de
l'autorité civile. C'est cependant ce que tenta Cicéron, avec une activité,
une adresse, une autorité, qui le rendaient digne de ce rôle.
Il était déjà l'âme du sénat; il en dictait les délibérations; il y
jouissait d'une autorité immense, qu'il ne devait à aucune grande charge,
mais à la supériorité de son éloquence et de ses vues. Il voulut que son
influence s'étendit au delà de Rome, au delà de l'Italie. Il n'épargna ni
les exhortations dans ses lettres aux gouverneurs des provinces, ni les
séductions par l'offre des dignités, et la perspective d'une grande part
dans le gouvernement légitime. Il entretenait avec eux une correspondance
régulière. Ceux qui lui inspiraient le plus de défiance, et qu'il pressait
avec le plus d'énergie, étaient Lépide, Plancus, Pollion, Cornificius, que
le nombre de leurs troupes et l'importance de leurs gouvernements rendaient
plus capables de servir la république ou de lui nuire. Il leur représenta si
vivement les avantages et les forces de la bonne cause, l'union du sénat, du
peuple, des consuls, de toute l'Italie, qu'il en gagna entièrement
quelques-uns, et força les autres de dissimuler du moins leurs intentions
coupables, d'en affecter de pures, et surtout, ce qui était important, de
demeurer neutres jusqu'à la conclusion des affaires d'Italie, dont le sort
de la république semblait dépendre.
Pour prix de tant de soins et de peines, il avait sans cesse à lutter, dans
le sein de Rome, contre les intrigues et la rage des factieux. Ceux-ci
rendaient sa
(xlvi)
position de plus en plus
embarrassante par les nouvelles qu'ils feignaient de recevoir tous les jours
sur la situation de Modène; ils ne parlaient que des succès d'Antoine, et de
son union avec les consuls. Ces bruits répandirent même dans la ville une
telle frayeur, que beaucoup de citoyens ne pensaient plus qu'à la quitter.
Au milieu de cette consternation, Cicéron affecta de paraître tranquille et
gai; et s'il éprouva quelque chagrin sensible, ce fut du bruit injurieux que
ses ennemis firent courir, qu'il voulait se rendre maître de Rome, et se
faire nommer dictateur. Il devait même, ajoutait-on, se montrer en public,
avant deux jours, avec les faisceaux. Mais le tribun Apuléius, un de ses
plus fidèles amis, ayant répété devant le peuple cette misérable calomnie,
l'assemblée répondit d'une voix unanime “que Cicéron n'avait jamais rien
fait ni voulu qui n'eût pour objet le plus grand bien de la république.”
Quelques heures après ce grand acte de justice populaire, Cicéron reçut,
avec non moins de joie, la nouvelle d'une victoire remportée sur Antoine.
Cette nouvelle causa dans Rome une allégresse égale à la terreur qu'y
avaient répandue les bruits contraires. Le peuple s'assembla aussitôt devant
la maison de Cicéron, et le conduisit au sénat, comme en triomphe. A son
retour, le même cortège l'accompagna jusqu'à la tribune aux harangues, où il
montra tout ce que la république avait à espérer de ce premier avantage;
après quoi il fut reconduit chez lui par la foule, au milieu des
applaudissements.
Dans le sénat, il combattit l'opinion de Servilius, qui voulait que l'on
quittât l'habit de guerre (xive Philipp.). “L'unique objet
de cette guerre étant la délivrance de Décimus, on ne pouvait reprendre la
toge avant que Décimus fut délivré. Il réclama le titre d'imperator
pour les trois généraux Hirtius, Pansa et Octave, qui avaient vaincu
Antoine, et il fit longuement le panégyrique de chacun d'eux. Il demanda en
leur nom cinquante jours d'actions de grâces; il provoqua un nouveau
sénatus-consulte qui garantît aux soldats de la république les récompenses
qui leur étaient réservées après la guerre, et les transmît aux parents de
ceux qui n'y auraient pas survécu. Il voulut en outre qu'un monument
magnifique fut érigé en l'honneur de ces illustres morts, et qu'on y gravât
en lettres d'or les témoignages éternels de leur vertu. Il s'étonnait
qu'Antoine, après toutes les horreurs qu'il avait commises, après toutes
celles qu'il méditait, n'eût pas encore été déclaré ennemi public. Il est
vrai qu'en décernant des actions de grâces pour la victoire remportée sur
lui, on lui donnait en réalité ce titre; n'y ayant aucun exemple qu'un tel
honneur eût été accordé à d'autres qu'à ceux qui avaient vaincu un ennemi.
Cicéron lui-même n'avait-il pas manqué, peu de jours auparavant, d'être,
avec toute la ville, victime de ses fureurs. Si on avait répandu les bruits
odieux de dictature, c'était dans le dessein de tomber sur lui comme sur un
tyran; et sa mort devait être le signal du massacre de toute la ville. Lo
complot était manifeste, et il se réservait d'en prouver plus tard la
réalité.”
Le sénat adopta sans restriction toutes les propositions contenues dans son
discours, le dernier qu'il ait prononcé, ou qui, du moins, nous reste de
lui.
Les consuls et Octave remportèrent bientôt sur Antoine un autre avantage
encore plus décisif et qui délivra Décimus. Mais Hirtius fut tué; et Pansa,
blessé dans la première action, mourut quelques jours après à Bologne.
La mort des deux consuls portait tout d'un coup Octave au plus haut degré de
la puissance, en le plaçant à la tête de deux armées nouvelles, et de tous
les vétérans, qui n'avaient pas voulu se rallier à Décimus. Cicéron prévit
les conséquences funestes de cet événement. Il fit part de ses alarmes à
Brutus et à Cassius, les pressa, dans toutes ses lettres, de revenir en
Italie; et pour donner plus d'autorité à ses instances, il obtint du sénat
un décret qui les rappelait, avec leurs légions, à la défense de la patrie.
Mais il ne paraît pas qu'ils en eussent le moindre désir; et Cicéron fut
réduite lutter presque seul contre les événements et contre les hommes, qui
devaient tour à tour tromper sa prévoyance.
Il imagina de faire décerner le triomphe à Octave, ce qui était d'une
politique habile; car, sous une apparence d'honneur, elle tendait à le
dépouiller de son autorité, l'usage étant que le commandement finit et que
l'armée fût congédiée le jour où un général mettait le pied dans Rome comme
triomphateur. Mais le sénat voulut user d'une autre politique. Il chercha
d'abord à s'attacher les armées par l'appât des distinctions et des
récompenses, pour les congédier ensuite sous prétexte que la république,
délivrée d'Antoine, n'avait plus besoin de tant de soldats armés pour elle.
Ce moyen n'ayant pas réussi, on eut recours à un autre; ce fut de combler
les uns d'honneurs, d'argent, de privilèges, et de tout refuser aux autres,
dans l'espoir de les affaiblir en séparant leurs intérêts et en semant entre
eux des germes de jalousie et de haine. On leur envoya des députés en
l'absence d'Octave; mais ils refusèrent de les entendre s'il n'était
présent, et déjouèrent ainsi les projets du sénat.
Fort de l'appui de ses troupes, Octave demanda le consulat. Plutarque
prétend qu'il fit prier Cicéron d'obtenir cette dignité pour tous deux,
l'assurant qu'il disposerait de tout à son gré, qu'il jouirait seul de leur
commune autorité. Il ajoute même que Cicéron, séduit par les flatteries et
les promesses d'Octave, favorisa ses prétentions, et lui donna les suffrages
du sénat; mais plusieurs des lettres de Cicéron prouvent que cet historien
s'est trompé. Le
(xlvii)
seul qui sollicita pour
Octave fut ce centurion qui, fatigué des retards du sénat, dont aucun
membre, pas même Cicéron, ne voulait proposer le décret du consulat, s'écria
en montrant son épée: “Voici qui le lui donnera.” Octave marcha en effet sur
Rome avec ses légions, se fit nommer consul avec Pédius, son parent,
assembla les comices, qui confirmèrent son adoption, s'empara de tout
l'argent qu'il trouva dans le trésor public, le distribua à ses soldats, fit
condamner à mort les meurtriers de César, et reprit enfin son rôle
véritable.
Il n'avait pas voulu poursuivre Antoine vaincu; il en fut en vain sollicité
par le sénat; il trouva mille excuses; et lorsqu'il feignit d'y penser, il
fit comprendre aisément qu'il était trop tard. Pressé par Cicéron, D.
Brutus, après avoir hésité quelque temps, se mit, avec Plancus, à la
poursuite de l'ennemi, à la tête d'une armée en partie composée de recrues,
et qu'il était obligé de soutenir à ses frais. Mais les forces d'Antoine
grossissaient tous les jours. Ventidius lui avait amené trois légions;
Lépide vint se joindre à lui avec toutes les siennes, et se contenta
d'écrire au sénat qu'il avait été contraint d'obéir à ses troupes mutinées.
Le sénat le déclara ennemi public, et fit abattre la statue qu'on lui avait
élevée récemment. Lépide avait épousé la sœur de M. Brutus, et il en avait
eu plusieurs enfants dont la fortune se trouvait ruinée par ce décret, qui
entraînait la confiscation des biens de leur père. Servilie, leur
grand'mère, et la femme de Cassius, leur tante, supplièrent Cicéron d'en
empêcher l'adoption, ou d'obtenir une exception en faveur des enfants. Mais
il ferma l'oreille à leurs prières. Brutus lui écrivit sur le même sujet une
lettre des plus pressantes, et Cicéron fit suspendre l'exécution du décret
en ce qui regardait la confiscation.
Deux légions qui revinrent alors d'Afrique, d'où le sénat les avait
rappelées, furent reçues dans Rome avec une joie incroyable. Mais cette joie
dura peu; ces légions embrassèrent le parti d'Octave. Pollion, qui revint
aussi d'Espagne avec deux de ses meilleures légions, alla se joindre à
Antoine. Plancus abandonna D. Brutus, qui, en butte aux menaces d'une armée
séditieuse, se sauva, sous un déguisement, auprès de M. Brutus; mais il fut
tué en route, par des soldats d'Antoine, qui portèrent sa tête à leur
général.
Dès qu'Antoine vit son parti fortifié par toutes ces défections, il établit
une correspondance avec Octave, qui ne lui renvoya plus ses lettres. Ce
jeune ambitieux ne dissimulait plus son mépris pour l'autorité du sénat et
pour Cicéron. Quand il eut tout réglé à Rome, et réduit le sénat à la
soumission, il alla joindre Antoine et Lépide, pour avoir avec eux une
conférence où ils devaient régler tous trois les conditions de leur
alliance, et se partager le pouvoir. Le lieu qu'ils choisirent fut une
petite île du Réno, près de Bologne. Ils s'y rendirent par des chemins
différents, avec toutes les précautions qui convenaient à leur caractère
soupçonneux et jaloux, accompagnés de leurs meilleures troupes, qui avaient
séparément leur camp en vue de l'île. Lépide y entra le premier, comme l'ami
commun des deux autres, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de trahison à
craindre. Lorsqu'il eut donné le signal convenu, Antoine et Octave
s'avancèrent des deux côtés du fleuve, et passèrent dans l'île sur des ponts
de bateaux, où ils laissèrent chacun de leur côté une garde de trois cents
hommes. Leur premier soin en s'abordant fut, dit-on, de visiter
réciproquement leurs habits, de peur qu'il ne s'y trouvât quelque arme
cachée. Octave, en qualité de consul, prit ensuite place entre les deux
autres, et ils passèrent ainsi trois jours à former le plan du second
triumvirat.
Le dernier article de cette fameuse convention fut une liste de
proscriptions qui comprenait trois cents sénateurs et trois mille
chevaliers. La publication en fut ajournée jusqu'à l'arrivée des triumvirs à
Rome; ils exceptèrent toutefois de l'ajournement ceux, au nombre de
dix-sept, qu'ils avaient le plus d'intérêt à ne pas laisser vivre plus
longtemps: Cicéron était le premier. Ils firent partir aussitôt des
émissaires pour les surprendre et les massacrer, avant qu'ils eussent la
moindre défiance du danger.
Cicéron était, avec son frère et son neveu, dans sa maison de Tusculum,
quand il reçut la première nouvelle des proscriptions, et du sort qui
l'attendait. Il partit sur-le-champ avec eux pour sa terre d'Asture, voisine
de la mer, dans l'espoir d'y trouver quelque vaisseau. Mais comme ils
étaient sans argent, Quintus résolut de retourner avec son fils à Rome, pour
y recueillir de quoi subvenir à leurs besoins dans quelque contrée
lointaine. Dans cet intervalle, Cicéron ayant trouvé un vaisseau prêt à
partir d'Asture, s'embarqua; les vents contraires le contraignirent bientôt
de prendre terre à Circeii. II passa la nuit dans le voisinage de cette
ville, en proie aux plus cruelles perplexités. Il délibéra s'il irait
chercher un refuge auprès de Brutus, de Cassius ou de Sextus Pompée. Enfin,
fatigué de la vie et des soins, peut-être inutiles, qu'il prenait pour la
conserver, il résolut de mourir “dans un pays qu'il avait si souvent sauvé,”
disait-il une dernière fois. Plutarque rapporte qu'il forma le projet de
retourner à Rome, et de se tuer de sa propre main dans la maison d'Octave,
pour faire retomber son sang sur la tête de ce perfide. Mais les
importunités de ceux qui l'entouraient le firent consentir à faire voile
jusqu'à Caïète, où il prit terre encore une fois, pour se reposer dans sa
maison de Formies, située près de la côte. Il y dormit quelques heures; puis
ses esclaves le mirent dans une litière, qu'ils se hâtèrent de porter vers
le vaisseau par des chemins détournés, le bruit ayant couru qu'on avait vu
dans les
(xlviii)
environs des soldats qui
le cherchaient. Leur chef était le tribun Popillius Lénas, que Cicéron avait
autrefois sauvé dans une accusation de parricide. Les soldats ne tardèrent
pas en effet à rejoindre la litière, où Cicéron lisait la Médée
d'Euripide. Ses esclaves se rangèrent autour de lui, résolus de le défendre
au péril de leur vie; mais Cicéron leur défendit défaire la moindre
résistance; et s'avançant hors de la litière, il dit aux soldats de faire
leur devoir. Ceux-ci lui coupèrent la tête, ainsi que les deux mains, et
retournèrent à Rome pour porter à Antoine cet odieux trophée.
Popillius trouva le triumvir dans le forum, au milieu de ses gardes, lui
montra de loin sa proie, et reçut en échange une couronne d'or et une somme
considérable. Antoine ordonna que la tête fût clouée, entre les deux mains,
à la tribune aux harangues, “du haut de laquelle, suivant l'expression de
Tite-Live, l'orateur avait fait entendre une éloquence que n'égala jamais
aucune voix humaine.”
Mais avant qu'on exécutât l'ordre d'Antoine, on porta cette tête chez
Fulvie, cette femme dont on a dit qu'elle n'avait de son sexe que le corps,
qui portait l'épée, haranguait les soldats, tenait conseil avec les chefs,
et qui ajouta sur la liste des proscriptions des noms inconnus même à son
mari. Se saisissant de cette tête, elle inventa pour elle des outrages qui
répugnent à retracer. Elle la mit sur ses genoux, vomit contre elle de sales
injures, cracha dessus, en tira la langue, et la perça avec l'aiguille d'or
qu'elle portait dans ses cheveux.
La mort des autres proscrits n'excita, dit un historien de ce siècle, que
des regrets particuliers; mais celle de Cicéron causa une douleur
universelle. C'était triompher de la république, et fixer l'esclavage à
Rome. Antoine en était si persuadé, qu'il s'écria devant ces restes
sanglants: “Maintenant les proscriptions sont finies!” Tué le 7 décembre de
l'an 710 de Rome (44 avant J. C.), Cicéron avait soixante-trois ans
onze mois et cinq jours.
Les restes mutilés de Cicéron furent, dit-on, ensevelis par un certain
Lamia, célébré pour cet acte de courage par plusieurs poètes latins; mais
une autre tradition veut qu'ils aient été brûlés par ses esclaves mêmes, et
ses cendres transportées à Zante, où, en creusant en 1544 les fondations
d'un monastère, on trouva un tombeau qui portait son nom.
Le lieu que sa mort avait rendu célèbre fut longtemps visité par les
voyageurs avec un respect religieux. Quoique la haine de ce crime s'attachât
particulièrement à Antoine, Octave ne put s'en garantir; et c'est là ce qui
explique le silence que les écrivains de son siècle ont gardé sur Cicéron.
Aucun des poètes de sa cour n'a osé le nommer. Virgile même aima mieux
dérober quelque chose à la gloire de Rome, en cédant aux Grecs la
supériorité de l'éloquence (orabunt causas melius...), qu'ils avaient
eux-mêmes cédée à Cicéron. Il n'y eut guère que Tite-Live qui rendît à ses
talents un hommage pour lequel il ne croyait pas avoir assez de tout le
sien; “car, dit-il, pour louer dignement Cicéron, il faudrait être lui-même.
Dans le palais d'Auguste, dans sa famille, on se cachait pour lire les
ouvrages du plus grand orateur de Rome.
Dans la génération suivante, c'est-à-dire, après la mort de ceux que
l'intérêt, l'envie, les dissentiments politiques avaient forcé de le haïr
vivant et de décrier sa mémoire, sa réputation reprit tout l'éclat dont elle
avait brillé; et sous le règne de Tibère, lorsqu'un historien mourait pour
avoir loué Brutus, un autre écrivain quittait le ton grave et pacifique de
l'histoire, pour apostropher Antoine et lui reprocher le crime inutile de
cette mort. Depuis ce temps, tous les écrivains de Rome, poètes et
historiens, louèrent à l'envi Cicéron; et environ trois siècles après le
sien, les empereurs lui rendaient une espèce de culte dans la classe des
divinités secondaires.
(3) Biographie universelle, article Cicéron.
(4) Vers traduits de Lucilius.
(5) M. Michelet.