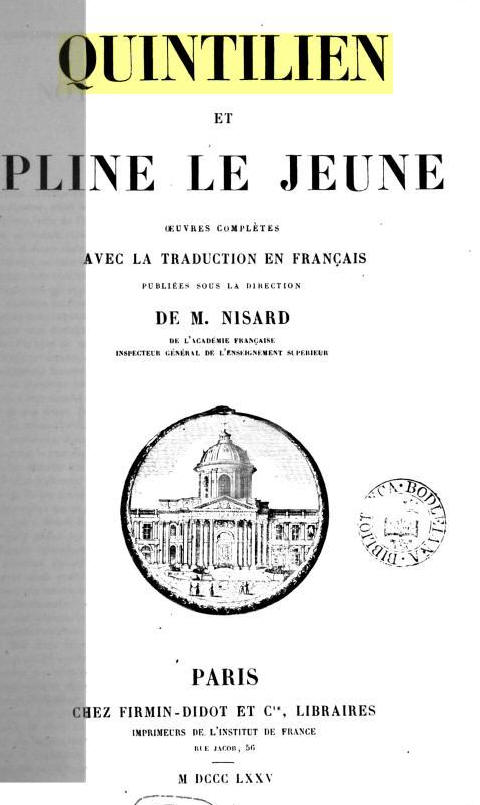|
SOMMAIRE.
Quintilien à Tryphon. — Introduction à Marcellus Victorius. — Chap.
I. Des précautions que réclame l'enfant dans les commencements de
son éducation. Des nourrices et des précepteurs. — II. L'éducation
privée est-elle préférable à l'éducation publique ? — III. Comment on
parvient à connaître l'esprit des enfants, et comment il faut le
manier. — IV. De la grammaire. — V. Des qualités et des vices du
discours. — VI. Des mots propres et métaphoriques, usités et
nouveaux. Des quatre choses qui constituent le langage. — VII. De
l'orthographe. — VIII. De la lecture de l'enfant. — IX. Des devoirs
du grammairien. — X. La connaissance de plusieurs arts est-elle
nécessaire à l'orateur ? — XI. De la prononciation et du geste.
— XII. Les enfants sont-ils capables d'apprendre plusieurs choses en
même temps ?
QUINTILIEN À TRYPHON
Vous n'avez pas laissé passer un jour sans renouveler vos
instances, je dirai
presque vos reproches, pour me déterminer à publier le traité que
j'avais adressé à
mon ami Marcellus sur l'Institution de l'orateur. À vrai dire, mon
travail ne me
semblait pas encore assez mûr, n'y ayant consacré, comme vous le
savez, qu'un
peu plus de deux ans, et distrait par tant d'autres soins : encore ce
temps fut-il
employé moins à le rédiger qu'à faire les recherches presque
infinies qu'il exigeait, et
à lire une foule innombrable d'auteurs.
Ensuite, d'après le conseil d'Horace, qui, dans son Art
poétique, recommande
aux écrivains de ne point trop se presser de produire leurs
ouvrages, et de les
garder pendant neuf ans en portefeuille, je laissai reposer le mien
et refroidir mon
amour d'auteur, afin d'être en état de le revoir avec plus de
sévérité, et de le juger
avec l'impartialité d'un lecteur. Toutefois s'il est aussi impatiemment attendu que vous le
dites, livrons la voile au
vent, et faisons des vœux pour un heureux voyage. Au reste, je
compte beaucoup
sur vos soins consciencieux pour qu'il parvienne au public avec
toute la correction
possible.
INTRODUCTION
A MARCELLUS VICTORIUS
Après vingt années de travaux, consacrées à l'instruction de la
jeunesse, j'avais
obtenu le repos, lorsque je fus sollicité par des amis de com-
2 poser
un traité sur l'art
oratoire. Je résistai longtemps, leur alléguant que de célèbres
auteurs, grecs et
latins, avaient laissé à la postérité un grand nombre d'écrits où
cette matière est
traitée à fond. Mais cette raison, qui me semblait de nature à faire admettre
mon excuse sans
observations, ne fit, au contraire, que les rendre plus pressants.
Ils m'opposaient
qu'au milieu des opinions différentes, quelquefois même contraires,
des premiers
auteurs, il était difficile de se déterminer : de sorte que, si je
n'avais rien de nouveau
à dire, je ne pouvais du moins me dispenser de porter un jugement
sur ce qui avait
été dit. Je cédai donc moins à l'espérance de réussir dans ce qu'on
exigeait de moi, qu'à
l'embarras d'un refus ; puis, mon sujet venant à se développer sous
ma plume, je me
chargeai volontairement d'un fardeau plus lourd que celui qu'on
m'avait imposé,
autant pour satisfaire par une entière déférence aux droits de
l'amitié, que pour
n'avoir pas, dans un sentier si battu, à me traîner servilement sur
les traces d'autrui. En effet, la plupart de ceux qui ont écrit sur l'art oratoire
ont débuté comme s'il ne
se fût agi que de donner le dernier poli de l'éloquence à des
esprits déjà consommés
dans toute espèce de science : soit qu'ils méprisassent, comme peu
important, tout
ce qu'on apprend avant d'en venir là ; soit qu'ils crussent que ces
études
préliminaires n'étaient pas de leur ressort, à cause du partage des
professions de
l'enseignement ; soit enfin, ce qui est plus vraisemblable, qu'ils
désespérassent de
pouvoir briller dans des choses qui, quoique nécessaires, ne sont
susceptibles
d'aucun éclat ; de même que dans un édifice c'est le faîte qui frappe
la vue, tandis
que les fondements restent cachés. Pour moi, qui estime que rien n'est étranger à l'art oratoire de
ce qui est
indispensable pour devenir orateur, et que dans aucun art on ne peut
arriver au
sommet si l'on n'a passé par les degrés inférieurs, je ne
dédaignerai pas de
m'abaisser à des choses qui, bien que peu relevées, sont la
condition des grandes ;
et, comme si j'étais chargé de l'éducation d'un orateur, je
commencerai ses études
avant même qu'il sache parler.
C'est à vous, Marcellus Victorius, que je dédie cet ouvrage.
Quoique votre tendre
amitié pour moi et votre noble amour des lettres soient des titres
qui justifient
suffisamment ce gage de notre affection mutuelle, j'ai eu aussi en
vue l'instruction de
votre fils, qui dès ses tendres années aspire manifestement à
briller un jour par la
beauté de l'esprit et de l'éloquence. J'ai pensé que ce traité ne
lui serait pas inutile,
en ce que mon dessein est de prendre, pour ainsi dire, l'orateur au
berceau, de le
faire passer par tous les arts qui peuvent contribuer en quelque
chose à sa
perfection, et de ne le quitter qu'après être arrivé au terme ; ce que j'ai entrepris d'autant plus volontiers qu'on a fait
paraître sous mon nom et
sans ma participation deux traités de Rhétorique, qui même n'étaient
pas destinés à
être publiés : l'un est le résumé d'une conférence de deux jours que
j'avais eue avec
mes élèves, et qu'ils avaient retenue de mémoire ; l'autre, ce sont
encore eux qui
recueillirent mes leçons pendant plusieurs jours, il est vrai, mais
autant que des
notes pouvaient le permettre ; et ces bons jeunes gens, par un excès
de zèle pour la
gloire de leur maître, leur accordèrent témérairement les honneurs
de la publication. Aussi trouvera-t-on dans ce traité quelques parties semblables,
un assez grand
nom- 3 bre de changements, beaucoup d'additions, et le tout dans un
meilleur ordre, et
élaboré avec tout le soin dont je suis capable.
Or, quand je parle d'un orateur parfait, je le prétends tel
qu'il n'y ait que l'homme
de bien qui le puisse être. Je n'exige donc pas seulement de lui un
rare talent pour
l'éloquence, mais encore toutes les qualités de l'âme ; et je n'accorde pas qu'il faille, comme quelques-uns l'ont
pensé, renvoyer aux
philosophes ce qui regarde la morale et les devoirs. Car le vrai
politique, l'homme né
pour l'administration des affaires publiques et privées, capable de
régir un État par
ses conseils, de le fonder par des lois, de le réformer par la
justice, cet homme n'est
autre, à coup sûr, que l'orateur. Ainsi, quoique je
confesse que j'aurai quelquefois recours aux principes contenus dans
les livres des philosophes, je les revendique à bon droit comme
étant véritablement de mon domaine, et comme appartenant en propre à
l'art oratoire. Quoi ! lorsqu'on a si souvent occasion de
discourir sur la justice, le courage, la tempérance, et les autres
vertus de même espèce ; lorsqu'il n'est presque point de cause où il
ne s'élève quelque question sur ces points de morale, qui tous ont
besoin du secours de l'invention et de l'élocution pour être bien
traités, peut-on douter que, partout où il faut déployer toutes les
ressources de l'esprit et de l'éloquence, ce ne soit à l'orateur
qu'appartient le rôle principal ? Ces choses sont si étroitement unies entre elles par la nature
et par le besoin
qu'elles ont mutuellement les unes des autres, comme Cicéron l'a
démontré jusqu'à
l'évidence, qu'autrefois le sage n'était point distingué de
l'orateur. Avec le temps, les
soins se partagèrent, et la paresse fit qu'au lieu d'un art il
sembla y en avoir
plusieurs. En effet, dès que l'on commença à faire une marchandise
de la parole et à
abuser des dons de l'éloquence, ceux qui passaient pour diserts
abandonnèrent le
soin de la morale, qui devint alors la proie des esprits les plus médiocres.
D'autres, à leur tour,
méprisant le soin de bien parler, retournèrent à la morale, se
réservant ainsi la
partie, sans contredit, la plus importante des fonctions de
l'orateur, si toutefois elles
pouvaient être divisées. Mais en voulant passer pour être les seuls
amis de la
sagesse, ils s'arrogèrent insolemment un titre que n'osèrent jamais
prendre ni les
plus fameux capitaines ni les plus grands politiques, plus jaloux de
pratiquer la vertu
que de la professer. Toutefois, j'accorderai sans peine que beaucoup de ces anciens
professeurs de
la sagesse ont émis d'excellents préceptes, et qu'ils les ont
pratiqués. Mais, de notre
temps, ce nom a le plus souvent servi de masque aux vices les plus
honteux. Car ce
n'était point par la vertu et le travail que la plupart de nos
philosophes tâchaient de
mériter ce titre, mais par un air triste, un extérieur singulier,
dont l'affectation n'était
qu'un voile destiné à couvrir des mœurs infâmes.
Au reste, ce qu'on regarde comme le partage exclusif de la
philosophie est le
bien de tout le monde. Quel est l'homme (et plût aux dieux que
souvent les plus
pervers ne fussent pas de ce nombre) qui ne discoure sur la justice,
l'équité, le bien ?
quel est l'ignorant, même le plus grossier, qui ne s'avise
quelquefois de raisonner sur
la physique ? Pour ce qui est de la dialectique, qui a pour objet la
propriété et la
différence des mots, l'étude en est commune à tous ceux qui donnent
quelque soin à
leur langage. Mais tout cela, l'orateur le saura parfaitement, et en parlera
de même ; et certes,
s'il en eût jamais existé de parfait, ce n'est pas dans les écoles
de philosophie 4 qu'on
serait allé chercher les préceptes de la vertu. De là la nécessité
de recourir
aujourd'hui à ces auteurs, qui se sont emparés de la plus noble
partie de l'art
oratoire, qu'on avait abandonnée, ainsi que je l'ai dit, et de la
revendiquer comme
notre propre bien ; non comme des gens qui s'approprient les
découvertes d'autrui,
mais pour faire voir que ce sont eux qui se sont servis d'un bien
qui ne leur
appartenait pas.
Je veux donc que l'orateur soit tel, qu'il mérite véritablement
le nom de sage :
parfait, non seulement dans ses moeurs (car cela, dans mon opinion
même, ne suffit
pas, quoique certaines personnes pensent le contraire), mais encore
dans toutes les
sciences et dans tous les genres d'éloquence ; tel enfin qu'il ne
s'en est peut-être
jamais rencontré. Toutefois, je n'en ferai pas moins tous mes efforts pour le
conduire à la
perfection, à l'exemple de la plupart des anciens, qui, tout en
reconnaissant que le
vrai sage était encore à trouver, n'ont pas laissé de donner des
préceptes sur la
sagesse. Car certainement l'éloquence parfaite est quelque chose de
réel, et la nature de
l'esprit humain n'empêche pas qu'on ne puisse y atteindre. Que si
l'on n'est pas
assez heureux pour cela, toujours est-il qu'en aspirant au sommet,
on s'élèvera plus
haut que ceux qui, désespérant d'avance du succès, s'arrêteront dès
le premier pas.
C'est pourquoi on me pardonnera de descendre à des détails
inférieurs, mais
nécessaires à l'oeuvre que je me suis proposée. Ainsi, mon premier
livre contiendra
tout ce qui précède les fonctions du rhéteur. Dans le second, je
traiterai des
premiers éléments de la rhétorique, et des questions qui ont pour
objet la nature
même de la rhétorique. Je consacrerai les cinq livres suivants à l'invention et à la
disposition, les quatre
autres à l'élocution, y compris la mémoire et la prononciation.
Enfin, dans un dernier
livre, qui regardera la personne même de l'orateur, j'expliquerai,
autant que ma
faiblesse me le permettra, quelles doivent être ses moeurs, ce qu'il
doit observer
dans les causes qu'il entreprend, qu'il étudie, qu'il plaide
; quel
genre d'éloquence il y
doit employer, quel doit être le terme de ses travaux oratoires, et
à quelles études il
doit se livrer dans sa retraite. J'accommoderai aussi ma manière d'écrire à la nature des choses
qui se
présenteront. Ainsi, je ne me bornerai pas à donner à mes lecteurs
la connaissance
de ces principes, qui seuls, selon quelques-uns, composent l'art
dont il est question,
ni à leur expliquer la rhétorique comme on enseigne le droit ; mais
j'écrirai de telle
sorte, que la lecture de mon ouvrage puisse nourrir leur faconde et
fortifier leur
éloquence. Car le plus souvent la sécheresse affectée de ces traités, qui
ne contiennent
que des préceptes nus, énerve et brise ce qu'il y a de plus généreux
dans le style,
boit pour ainsi dire le suc de l'esprit, et met à nu les os. Sans
doute il faut qu'il y en
ait, et qu'ils soient liés par des muscles ; mais encore faut-il
qu'ils ne soient pas
décharnés. C'est pour cela que je ne donne pas un traité en raccourci,
comme la plupart
des rhéteurs ; mais tout ce qui m'a paru utile à l'institution de
l'orateur, je l'ai fait
entrer dans ces douze livres, sans toutefois m'étendre longuement
sur chaque
partie ; car, s'il fallait donner à chaque chose tout le
développement dont elle est
susceptible, je ne verrais pas la fin de mon ouvrage .
Cependant je dois déclarer, avant de commencer, que l'art et
les traités ne
peuvent rien, si la 5 nature ne les seconde. Ainsi, mon livre n'est
pas plus fait pour
celui qui est dépourvu d'esprit, qu'un traité sur l'agriculture ne
l'est pour un terrain
stérile. Il y a aussi d'autres auxiliaires naturels, tels que la voix,
la force des poumons,
la santé, l'assurance, la beauté des formes. Si ces qualités
extérieures ont été
médiocrement départies, l'art peut y ajouter ; mais quelquefois elles
sont tellement
défectueuses, qu'elles corrompent jusqu'aux qualités de l'esprit et
aux fruits de
l'étude ; comme aussi, sans un maître habile, sans un travail
opiniâtre et un exercice
patient et continuel à écrire, à lire, à parler, ces mêmes avantages
ne servent à rien.
CHAP. I. Vous est-il né un fils, concevez d'abord de lui les plus hautes
espérances : cela
vous rendra plus soigneux dès le commencement. On dit tous les jours
qu'il n'est
donné qu'à un très petit nombre d'hommes de comprendre ce qu'on leur
enseigne,
et que la plupart, faute d'intelligence, perdent leur peine et leur
temps. Cette plainte
n'est pas fondée : il s'en rencontre beaucoup, au contraire, qui ont
autant de facilité à
concevoir que d'aptitude à apprendre. C'est que cela est dans la
nature de l'homme ;
et de même que l'oiseau est né pour voler, le cheval pour courir, la
bête féroce pour
nuire ; de même l'homme est né pour penser, et exercer cette
intelligence active et
subtile qui a fait attribuer à l'âme une origine céleste. Les esprits stupides et rebelles à toute instruction sont dans
l'ordre intellectuel ce
que les monstres sont dans l'ordre physique : le nombre en est
infiniment petit. Ce
qui le prouve, c'est qu'on voit briller dans les enfants des lueurs
très vives
d'espérance, qui s'évanouissent avec l'âge ; d'où il faut conclure
que ce n'est pas la
nature qui leur a manqué, mais les soins. Il y en a pourtant qui ont
plus d'esprit que
d'autres : d'accord ; mais de ce qu'on montre plus ou moins de capacité, il
ne s'ensuit pas
que personne n'ait jamais rien gagné à l'étude. Quiconque est
pénétré de cette
vérité, dès qu'il sera devenu père ne saurait cultiver avec trop de
soin l'espérance de
former un orateur.
Avant tout, choisissez des nourrices qui n'aient point un
langage vicieux.
Chrysippe les souhaitait savantes, si cela se pouvait, ou du moins
aussi vertueuses
que possible ; et sans doute c'est à leurs mœurs qu'il faut
principalement regarder. Il
faut tenir aussi pourtant à ce qu'elles parlent correctement. Ce sont elles que l'enfant entendra d'abord, ce sont elles dont
il essayera d'imiter
et de reproduire les paroles ; et naturellement les impressions que
nous recevons
dans le premier âge sont les plus profondes. Ainsi un vase conserve
toujours l'odeur
dont il a été imbu étant neuf, et la laine, une fois teinte, ne
recouvre jamais sa
blancheur primitive. Mais ce sont surtout les mauvaises impressions
qui laissent les
traces les plus durables. Le bien se change aisément en mal : mais
quand vient-on à
bout de changer le mal en bien ? Que l'enfant ne s'accoutume donc
pas, si jeune qu'il
soit, à un langage qu'il lui faudra désapprendre.
Pour ce qui est des parents, je voudrais en eux beaucoup de
savoir ; et ici je ne
parle pas seulement des pères. On sait combien Cornélie, dont le
langage élégant a
passé jusqu'à nous avec ses lettres, influa sur l'éloquence des
Gracques. On dit
aussi que la fille de Lélius ne parlait pas moins bien que son père
;
et nous lisons
encore un discours de la fille de Q. Hortensius, prononcé de-
6 vant les
triumvirs, qui fait
honneur à son sexe et n'en ferait pas moins au nôtre.
Ce n'est pas à dire que les pères, qui ont été privés du
bienfait de l'instruction,
doivent être moins soigneux de faire étudier leurs enfants ; c'est au
contraire un motif
pour eux de veiller de plus près aux accessoires. Ce que j'ai dit des nourrices, je le dis également des esclaves
au milieu desquels
sera élevé l'enfant qu'on destine à être orateur. Enfin, à l'égard
des pédagogues, ce
que j'ai à recommander par-dessus tout, c'est qu'ils soient
véritablement instruits, ou
qu'ils sachent du moins qu'ils ne le sont pas ; car je ne connais
rien de pire que ces
gens qui, pour avoir une légère teinture des lettres, s'imaginent
être savants : dans
cette fausse opinion d'eux-mêmes, ils croient en savoir plus que
tous les maîtres ; et,
abusant d'un certain pouvoir qui enfle ordinairement la vanité des
hommes de cette
espèce, ils sont impérieux, quelquefois cruels, et communiquent leur
sottise à leurs
élèves. Leur défaut de jugement n'est pas moins nuisible aux moeurs
:
témoin Léonidès,
gouverneur d'Alexandre, qui, au rapport de Diogène le Babylonien,
avait fait
contracter à ce prince certains défauts qui le poursuivirent jusque
dans un âge
avancé, et lorsqu'il était déjà un très grand roi.
Si je parais exiger beaucoup, que l'on considère qu'il s'agit
de former un orateur, œuvre laborieuse, en supposant même que nous n'aurons manqué à rien
dans les
commencements ; qu'il reste encore beaucoup plus à faire, et des
choses plus
difficiles ; que nous aurons besoin et d'une étude continuelle, et
des maîtres les plus
habiles, et des connaissances les plus variées. Je dois donc
prescrire la perfection : si le fardeau paraît trop pesant, ce sera
la faute du maître et non de la méthode. Cependant s'il arrive qu'on
ne puisse donner aux enfants des nourrices telles que je les veux,
qu'on ait au moins un pédagogue instruit, qui soit toujours là pour
reprendre à l'instant ce qu'elles auraient dit d'incorrect en
présence de l'enfant, afin qu'aucun défaut n'ait le temps de
s'enraciner. Il est, au reste, bien entendu que ce que j'ai prescrit
d'abord c'est le bien, et que ceci n'est que le remède.
Je
suis d'avis que l'enfant commence par la langue grecque, parce que
le latin étant plus usité, l'habitude nous le fait apprendre, pour
ainsi dire, malgré nous ; ensuite, parce que l'ordre veut qu'il
étudie d'abord les grecs, qui ont été nos devanciers dans toutes les
sciences. Toutefois, je ne voudrais pas que cela fût observé trop
scrupuleusement, et
qu'un enfant fût longtemps à ne parler que grec ou à n'étudier que
dans cette
langue, comme on le fait généralement ; car il arrive de là qu'on
s'accoutume à une
prononciation qui sent l'étranger, et à des formes de langage qui
sont vicieuses dans
un idiome différent, et dont on a de la peine à se corriger. Le latin ne doit donc pas venir trop longtemps après le grec
;
mais les deux
langues ne doivent pas tarder à marcher de front ; et alors, en les
cultivant
simultanément, on ne risquera pas de nuire à l'une par l'autre. Quelques-uns ont pensé que les études de l'enfant ne devaient
commencer
qu'à sept ans, parce que ce n'est guère qu'à cet âge qu'on a le
degré d'intelligence
et la force d'application convenables pour apprendre. C'était
l'opinion d'Hésiode, au
rapport d'un grand nombre d'écrivains antérieurs au grammairien
Aristophane, et
cela se trouve en effet dans son poème intitulé Préceptes ; mais
Aristophane nie que
cet ouvrage soit de ce poète. D'autres, et notamment Éra-
7 tosthène, ont prescrit la même chose.
Mais ceux-là
pensent plus sagement, qui veulent qu'aucun âge ne soit privé de
soin : de ce
nombre est Chrysippe, qui, tout en accordant trois ans aux
nourrices, est d'avis
qu'elles s'appliquent à faire germer dès cet âge les meilleurs
principes dans le coeur
des enfants. Or, pourquoi la culture de l'esprit ne trouverait-elle pas
place dans un âge qui
appartient déjà à la morale ? Je sais bien que, pendant tout le temps
dont je parle, on
obtiendra à peine ce qu'une seule année donnera dans la suite. Mais
il me semble
que ceux que je combats ont voulu encore plus ménager les maîtres
que les élèves
dans cette partie de l'éducation. Après tout, que pourront faire de mieux les enfants, du moment
qu'ils
commencent à parler ? car enfin faut-il qu'ils fassent quelque chose.
Or, pourquoi
dédaignerait-on, si petit qu'il soit, le gain qu'on peut faire
jusqu'à sept ans ? En effet,
si peu que rapporte le premier âge, l'enfant ne laissera pas d'être
à sept ans capable
d'études plus fortes, que si l'on eût attendu jusque-là pour
commencer. Ce bénéfice, accumulé chaque année, formera avec le temps un
capital qui,
prélevé sur l'enfance, sera autant de gagné pour l'adolescence.
Appliquons la même
règle aux années suivantes, afin qu'aucun âge ne soit arriéré dans
les études qui lui
sont propres. Hâtons-nous donc de mettre à profit les premières
années, avec
d'autant plus de raison que les commencements de l'instruction ne
portent que sur
une seule faculté, la mémoire ; que non seulement les enfants en ont
déjà, mais
qu'ils en ont même beaucoup plus que nous. Toutefois, je connais trop la portée de chaque âge, pour
vouloir qu'on tourmente
tout d'abord un enfant, et qu'on exige de lui une application qui ne
laisse rien à
désirer. Car il faut bien prendre garde de lui faire haïr l'étude
dans un temps où il est
encore incapable de l'aimer, de peur que sa répugnance ne se
prolonge au-delà des
premières années avec le souvenir de l'amertume qu'il aura une fois
sentie. Que
l'étude soit un jeu pour lui : je veux qu'on le prie, qu'on le loue,
et qu'il soit toujours
bien aise d'avoir appris ce qu'on veut qu'il sache. Quelquefois, ce
qu'il refusera
d'apprendre, on l'enseignera à un autre ; cela piquera sa jalousie.
Il luttera de temps
en temps avec lui, et le plus souvent on lui laissera croire qu'il
l'a emporté. Enfin, on
le stimulera par les récompenses que comporte cet âge.
Voilà de bien petits préceptes pour un aussi grand dessein que
celui que je me
propose. Mais les études ont aussi leur enfance ; et de même que les
corps les plus
robustes ont eu de faibles commencements, tels que le lait et le
berceau, de même
l'éloquence la plus sublime a commencé quelquefois par des
vagissements, bégayé
ses premiers mots, et hésité sur la forme des lettres. D'ailleurs,
parce qu'une chose
ne suffit pas, en est-elle pour cela moins nécessaire ? Que si personne ne blâme un père qui tient à ces petits
détails, peut-on
désapprouver un auteur de professer publiquement ce dont on le
louerait, s'il le
pratiquait chez lui ? Ajoutez à cela que les petites choses sont plus
proportionnées à
l'intelligence des enfants. De même qu'il est certains mouvements
auxquels le corps
ne peut se plier que dans l'âge où les membres sont encore tendres,
de même il est
une foule de choses auxquelles l'esprit est inhabile, par cela même
qu'il a acquis
plus de force. Philippe, roi de Macédoine, aurait-il voulu qu'Alexandre, son
fils, apprit à lire du
plus grand philosophe de son temps, d'Aristote, et celui-ci se
fût-il chargé de cet
emploi, si l'un et l'autre
8 n'eussent senti combien il importait,
pour le présent et pour
l'avenir, que les premières études fussent dirigées par le maître le
plus parfait ? Représentons-nous donc Alexandre, cet enfant si cher, si digne
de soins (et
quel enfant n'en est digne pour son père !) ; figurons-nous qu'on
l'ôte d'entre les bras
des femmes pour le confier à nos soins ; et si j'ai quelque secret
pour apprendre à
lire en peu de temps, aurai-je honte de le mettre en usage ? Car
j'avoue que je
n'aime pas ce que je vois faire généralement, qu'on apprenne aux
enfants les noms
et l'ordre des lettres avant qu'ils n'en connaissent la forme. Cette méthode les retarde, en ce que, songeant bien moins à ce
qu'ils voient
qu'à ce qu'ils ont dans la mémoire, qui va plus vite que les yeux,
ils ne portent point
leur attention sur la forme. Aussi les maîtres, quand ils jugent que
les enfants ont
suffisamment retenu les lettres dans l'ordre où on a coutume de les
écrire, se
mettent-ils à intervertir et à bouleverser tout l'alphabet, jusqu'à
ce qu'enfin leurs
élèves parviennent à les reconnaître à leurs caractères et non,
d'après leur ordre. Il
sera donc mieux de les leur faire distinguer en même temps, comme on
distingue les
hommes et par leur extérieur et par leurs noms. Mais ce qui est un obstacle à la connaissance des lettres n'en
est pas un pour
les syllabes. Je ne blâme pas au surplus l'usage d'exciter le zèle
des enfants en leur
donnant pour jouets des lettres figurées en ivoire, ou toute autre
bagatelle qui les
amuse, et qu'ils aient du plaisir à manier, à voir, à nommer.
Lorsque l'enfant commence à écrire, il sera bon de faire graver
les lettres le
mieux qu'on pourra sur une tablette, dont les sillons servent à
guider leur style. Étant
ainsi contenu de chaque côté par des bords, il ne sera pas sujet à
s'égarer comme
sur la cire, et ne pourra pas sortir des proportions voulues.
L'habitude de suivre avec
célérité des traces déterminées formera ses doigts, et il n'aura pas
besoin que la
main d'un maître vienne se poser sur la sienne pour la diriger. Ce n'est pas un soin indifférent, quoique parmi les personnes
de distinction il
soit presque d'usage de le négliger, que celui d'écrire bien et
vite. Ce qu'il y a de
plus essentiel dans les études, ce qui seul leur fait porter des
fruits véritables et jeter
de profondes racines, c'est d'écrire, et cela dans l'acception
propre du mot. Or une
écriture trop lente retarde la pensée ; grossière et confuse, elle
est inintelligible ; d'où
résulte un second travail, celui de dicter ce que l'on veut
transcrire. On se trouvera donc toujours bien, et en tout lieu, mais
particulièrement dans
les correspondances secrètes ou familières, de n'avoir pas négligé
ce point.
Quant aux syllabes, point d'abréviation. Il faut les apprendre
toutes, et sans
ajourner, les plus difficiles, comme on le fait ordinairement ; et
cela, afin qu'en
écrivant les enfants, embarrassés par leur rencontre, soient obligés
de s'y arrêter. Bien plus, il ne faut pas se fier au premier effort de leur
mémoire ; mais il sera
bon de leur faire répéter plusieurs fois la même chose, et de la
leur bien inculquer.
Et quand ils liront, qu'on ne les presse pas trop d'abord, soit pour
articuler des mots
entiers, soit pour lire avec vitesse, à moins qu'ils ne voient tout
d'un coup et sans
hésiter la liaison des lettres. Alors on pourra leur faire prononcer
un mot tout entier,
puis des phrases. On ne saurait croire combien la précipitation retarde les
enfants dans la lecture.
9 Car il arrive de là qu'ils hésitent, qu'ils s'interrompent, qu'ils
se répètent, et cela parce
qu'ils veulent dire mieux qu'ils ne peuvent ; et une fois qu'ils se
sont trompés, ils se
défient même de ce qu'ils savent. Que la lecture soit donc d'abord sûre, ensuite liée
; qu'elle
soit longtemps très
lente, jusqu'à ce que, à force d'exercice, ils parviennent à lire
vite et bien. Car, quant à ce que tous les maîtres recommandent, de regarder
à droite et de
porter les yeux en avant, le précepte ne suffit pas, c'est aussi une
affaire de
pratique, puisque, pendant que vous prononcez ce qui précède, vous
avez à voir ce
qui suit ; et, chose très difficile, l'attention de l'esprit doit
être partagée de manière
que la voix fasse une chose et les yeux une autre. Lorsque l'enfant
commencera,
suivant l'usage, à écrire des noms, on ne se repentira pas d'avoir
veillé à ce qu'il ne
perde pas sa peine sur des mots vulgaires et pris au hasard. Il peut, dès lors, tout en s'occupant d'autre chose, être
initié à ce que les grecs
appellent glose, et acquérir, au milieu des premiers éléments, ce
qui, dans la suite,
exigerait un temps particulier. Et puisque je suis en train de
donner de petits
préceptes, je voudrais encore que les lignes d'écriture qui leur
sont données comme
modèles continssent non des pensées oiseuses, mais quelque moralité. Le souvenir en reste jusque dans la vieillesse
; et, empreint
dans une âme
neuve, il influe jusque sur les mœurs. Rien n'empêche enfin qu'il
n'apprenne, tout en
jouant, les paroles mémorables des hommes illustres, et des morceaux
de choix,
tirés principalement des poètes, dont la lecture est celle qui a le
plus d'attraits pour
les enfants. Car la mémoire, ainsi que je le dirai en son lieu, est
très nécessaire à
l'orateur ; et ce qui contribue le plus à l'entretenir et à la
fortifier, c'est l'exercice. Or, à
l'âge dont nous parlons, et où l'on ne peut encore rien produire par
soi-même, la
mémoire est presque la seule faculté qui puisse être secondée par le
soin des
maîtres.
Il ne sera pas non plus indifférent, pour délier la langue des
enfants et leur
donner une prononciation nette, d'exiger qu'ils répètent avec le
plus de vitesse et de
volubilité possible certains mots et certains vers d'une difficulté
étudiée, dont les
syllabes enchaînées comme par force se heurtent et s'entrechoquent,
et que les
grecs appellent χαλεποὶ. Cette recommandation peut paraître
minutieuse ;
cependant, si on la néglige, il se glisse dans la prononciation une
infinité de défauts,
qui, lorsqu'on n'y remédie pas dans les premières années,
s'enracinent à tel point,
qu'il n'est plus possible de s'en corriger dans la suite.
CHAP. II. Cependant l'enfant grandit
: il est temps qu'il sorte du giron et
qu'il commence à
travailler sérieusement. C'est ici le lieu de traiter cette
question : S'il vaut mieux faire
étudier un enfant dans la maison paternelle et dans le sein de sa
vie privée, que de
le livrer au monde des écoles, et à des professeurs pour ainsi dire
publics ? Je vois que les législateurs les plus célèbres et les auteurs
les plus éminents se
sont déclarés pour l'éducation publique. Mais il ne faut pas
dissimuler que quelques
personnes ont sur ce point une conviction personnelle, opposée à
l'usage presque
général. Deux raisons semblent surtout les déterminer : la première,
c'est que les mœurs doivent être plus en sûreté loin de la foule des hommes de
cet âge,
naturellement plus enclins au vice, et dont le contact (plût au ciel
que ce reproche fût
sans fondement !) a été souvent la cause de dérè-
10 glements honteux. La
seconde, que
le maître, quel qu'il soit, semble devoir dispenser plus largement
son temps à un
seul élève, que s'il avait à partager le même temps entre plusieurs. Le premier motif est tout à fait grave
; car s'il était certain
que les écoles fussent
avantageuses aux études, mais nuisibles aux mœurs, je serais d'avis
qu'on apprît
plutôt à bien vivre qu'à bien parler. Mais, selon moi, ces deux
choses sont
inséparables ; je ne pense pas qu'on puisse être orateur sans être
homme de bien ;
et, quand cela serait possible, je ne le voudrais pas. Examinons
donc d'abord ce
premier motif.
On dit que les mœurs se corrompent dans les écoles, et, en
effet, cela arrive
quelquefois ; mais ne se corrompent-elles pas aussi dans l'intérieur
des familles ?
Combien d'exemples prouvent que, soit dans les écoles, soit dans la
maison
paternelle, un enfant peut également perdre ou conserver son
innocence ! Le naturel
et l'éducation font toute la différence. Supposez un enfant
naturellement enclin au
mal, supposez qu'on aura négligé, dans le premier âge, de former ses
mœurs et de
les surveiller, la solitude lui fournira-t-elle moins d'occasions de
se livrer à ses
penchants vicieux ? En effet, le précepteur domestique ne peut-il pas
être un homme
dépravé ; et le commerce d'esclaves corrompus est-il plus sûr que
celui d'hommes
libres de peu de retenue ? Mais si l'enfant est bien né, si les parents ne sont pas
aveugles et endormis dans
une coupable insouciance, on peut (et c'est le premier soin des
personnes sages)
faire choix d'un précepteur vertueux, et soumettre l'enfant à une
discipline sévère ; on
peut en outre attacher à ses côtés un ami de mœurs graves, ou un
affranchi fidèle,
dont la présence assidue tienne en respect ceux mêmes que l'on
redoute.
Au surplus, le remède à ces craintes était facile. Plût aux
dieux qu'on n'eût pas à
nous imputer à nous-mêmes les dérèglements de nos enfants ! À peine
sont-ils nés,
nous les énervons par toutes sortes de délicatesses. Cette molle
éducation, que
nous appelons indulgence, brise tous les ressorts de l'âme et du
corps. Que ne
convoitera-t-il pas, quand il sera adulte, l'enfant accoutumé à
ramper sur la pourpre ?
Il peut à peine bégayer quelques mots, que déjà il connaît ce qu'il
y a de plus délicat
et de plus exquis. Nous formons leur palais avant de dénouer leur langue. Ils
grandissent dans des
litières ; essayent-ils de toucher la terre, des mains empressées les
soutiennent de
chaque côté ; s'il leur échappe quelque mot licencieux, c'est un
divertissement pour
nous. Des paroles qui ne seraient pas supportables dans la bouche de
ces enfants
d'Égypte, les délices de leurs maîtres, sont accueillies d'un
sourire ou d'un baiser. Et cela n'a rien qui doive étonner
: nous avons été leurs
maîtres, ils ne font que
répéter ce qu'ils nous ont entendus dire. Ils sont témoins de nos
amours et de nos
passions les plus infâmes ; il n'est point de repas qui ne retentisse
de chants
obscènes ; des choses qu'on n'oserait dire sans rougir sont exposées
en spectacle à
leurs yeux. Tout cela passe en habitude, et bientôt en nature. Les
malheureux ! ils se
trouvent vicieux avant de savoir ce que c'est que le vice. Puis, ne
respirant que
mollesse et volupté, ils viennent languir dans nos écoles. Y
prennent-ils ces mœurs ? non, mais ils les y apportent.
Venons aux études. Un maître, dit-on, qui n'a qu'un élève, sera
tout à lui. Et
d'abord rien n'empêche que ce maître, si précieux, ne soit aussi
attaché à l'enfant
qui suit les écoles. Que si ces deux avantages ne peuvent s'allier,
je préférerais
encore le grand jour d'une honorable assemblée
11 aux ténèbres et à la
solitude. Car
tout bon maître aime un nombreux auditoire, et se croit digne d'un
grand théâtre ; tandis que d'ordinaire les hommes médiocres, par la conscience
qu'ils ont de
leur faiblesse, s'accommodent assez d'un seul élève, et descendent
volontiers au
rôle de pédagogues. Mais je veux que, par une faveur spéciale,
par amitié ou par argent, on puisse avoir chez soi le maître le plus
savant, un homme incomparable : pourra-t-il consumer toute sa journée
auprès d'un seul enfant ? L'attention de l'élève lui-même
pourra-t-elle être si continue, qu'elle ne se lasse, comme la vue,
d'être trop longtemps fixée sur un même objet ? d'ailleurs l'étude
demande le plus souvent que l'on soit seul. Ainsi, lorsque
l'enfant écrit, apprend sa leçon ou médite, la présence du maître
est inutile ; et quiconque survient pendant ce temps-là, précepteur
ou autre, il dérange l'élève dans son travail. Toute lecture n'exige
pas toujours qu'un maître la prépare ou l'explique. Autrement, quand
l'élève parviendrait-il à connaître un si grand nombre d'auteurs
? Il ne s'agit donc que de lui assigner sa tâche de chaque jour
:
ce qui ne
demande pas beaucoup de temps ; et c'est pour cela qu'on peut
enseigner à
plusieurs à la fois tout ce qu'on a à enseigner à chacun en
particulier. Telle est en
effet la nature de la plupart des choses, que la même voix peut les
communiquer à
tous en même temps. Je ne parle pas des partitions et des
déclamations des
rhéteurs : quel que soit le nombre de leurs auditeurs, chacun peut
profiter de tout. Car il n'en est pas de la voix d'un professeur comme d'un
repas, qui diminue à
mesure que croît le nombre des convives ; mais il en est comme du
soleil, qui
dispense à tous toute sa lumière et toute sa chaleur. Est-ce un
grammairien qui
disserte sur les lois du langage, qui développe des questions, lise
quelque trait
historique ou fabuleux, ou commente un poème ; autant l'entendront,
autant en
profiteront.
Mais, dira-t-on encore, avec tant d'élèves comment suffire à la
correction et à
l'explication qui précède la lecture de chacun d'eux ? C'est un
inconvénient, sans
doute ; mais où n'y en a-t-il pas ? bientôt nous en ferons voir la
compensation.
D'abord je n'entends pas qu'on envoie l'enfant dans une école où
l'on croit qu'il sera
négligé ; en second lieu, un bon maître ne se chargera jamais d'un
nombre d'élèves
au-dessus de ses forces ; et, de notre côté, faisons en sorte de
l'avoir je ne dis pas
seulement pour ami, mais pour ami de la famille, afin qu'il agisse
non par devoir,
mais par affection : de cette manière, notre enfant ne sera pas
confondu dans la
foule. Ajoutez à cela qu'il n'est pas de maître, pour peu qu'il soit
lettré, qui ne donne
des soins particuliers, dans l'intérêt de sa propre gloire, à
l'élève en qui il aura
distingué du zèle et de l'esprit. Au surplus, de ce qu'on doive fuir
les écoles trop
nombreuses, (ce que je n'accorde pas quand c'est le mérite du
professeur qui justifie
le concours), ce n'est pas une raison pour les fuir toutes. Autre
chose est de les
éviter, autre chose est de les choisir.
J'ai tâché de réfuter ce que l'on objecte contre les écoles
; il
me reste maintenant
à dire ce que je pense. Appelé à vivre dans le mouvement du monde et au grand jour des
affaires
publiques l'orateur doit, avant tout, s'accoutumer dès l'enfance à
ne point redouter
les hommes, et à ne point s'étioler dans l'ombre d'une vie
solitaire. L'esprit veut être
sans cesse excité, aiguillonné. Il languit dans l'isolement, et se
rouille, pour ainsi
dire, dans 12
les ténèbres, ou bien il s'enfle d'une vaine présomption
:
comment, en
effet, ne pas s'en faire accroire quand on n'a jamais occasion de se
comparer avec
personne ? Vient-on ensuite à se produire en public, le grand jour
éblouit, on trébuche à
chaque pas dans un chemin où tout est nouveau, parce qu'on a appris
dans la
solitude ce qu'il faut, au contraire, pratiquer au milieu du monde. Je ne parle pas de ces amitiés, empreintes d'un sentiment
presque religieux, qui
se prolongent avec la même vivacité jusque dans la vieillesse. Avoir
partagé les
mêmes études est un lien non moins sacré que d'avoir été initié aux
mêmes
mystères. Et ce qu'on appelle le sens commun, où le prendra-t-on, si
l'on a fui la
société, dont le besoin n'est pas seulement naturel aux hommes, mais
aux animaux
eux-mêmes, tout privés qu'ils sont de la parole ? Ajoutez à cela que l'enfant n'apprend dans la maison paternelle
que ce qu'on lui
enseigne, et que dans une école il apprend encore ce qu'on enseigne
aux autres. Il
entend chaque jour approuver ou reprendre tantôt une chose, tantôt
une autre ;
gourmander la paresse de celui-ci, louer l'activité de celui-là
; et
il en fait son profit.
L'amour de la gloire pique son émulation : il attache de la honte à être vaincu par ses égaux, et de
l'honneur à surpasser
ses aînés. Tout cela enflamme l'esprit ; et quoique l'ambition soit
en elle-même un
vice, elle est souvent l'occasion des vertus. Je me souviens d'un usage que mes maîtres avaient adopté avec
succès : ils
distribuaient les enfants par classes, et assignaient les rangs pour
parler suivant la
force de chacun, en sorte que, plus on avait fait de progrès, plus
le rang était élevé.
Cet ordre était soumis à des jugements, et c'était à qui
remporterait l'avantage. Mais d'être le premier de la classe, c'était surtout ce qui
faisait l'objet de notre
ambition. Cette distribution n'était pas d'ailleurs irrévocablement
fixée une fois pour
toutes. Tous les trente jours, les vaincus pouvaient prendre leur
revanche. Par là, le
vainqueur ne se reposait pas sur son triomphe, et la douleur
excitait le vaincu à laver
sa honte. Autant que je puis me le rappeler, cette lutte nous inspirait
plus d'ardeur pour
l'étude de l'éloquence que les exhortations de nos maîtres, et la
surveillance des
pédagogues, et les vœux de nos parents.
Quant à ceux qui sont déjà avancés dans l'étude des lettres,
c'est à qui
approchera le plus du maître ; mais les commençants d'un âge encore
tendre imitent
plus volontiers leurs condisciples que leurs maîtres, parce que cela
leur est plus
facile. En effet, un élève qui n'en est encore qu'aux premiers
éléments osera
difficilement élever ses espérances jusqu'à son maître, et aspirer à
reproduire une
éloquence qu'il regarde comme le type de la perfection. Il
embrassera de préférence
ce qui est à sa portée, comme la vigne s'attache d'abord aux rameaux
inférieurs de
l'arbre qui lui sert d'appui, avant de s'élancer au faîte. Cela est tellement vrai, que le maître lui-même, si toutefois
il songe plus à se
rendre utile qu'à briller, a bien soin, en maniant des esprits
encore neufs, de ne pas
surcharger d'abord leur faiblesse, mais de tempérer ses forces et de
descendre à
leur intelligence. Si vous versez de l'eau trop abondamment dans un vase dont
l'embouchure est
étroite, rien n'entre ; mais versez-la avec ménagement, ou même
goutte à goutte,
vous finirez par le remplir. Il faut de même calculer ce que
l'esprit des enfants est
capable de recevoir ; car ce qui excédera leur intelligence
13 n'entrera
pas dans leur
esprit, pour ainsi dire faute d'ouverture. Il est donc utile d'avoir quelqu'un qu'on se propose d'imiter,
en attendant qu'on
soit en état de le surpasser. C'est ainsi qu'on s'élèvera peu à peu
à de plus hautes
espérances. Ajoutons à cela que le maître ne peut parler avec la
même force et la
même chaleur en présence d'un seul élève, que s'il était animé par
la présence d'un
nombreux auditoire. Le véritable foyer de l'éloquence, c'est l'âme
: il faut qu'elle
soit émue, il faut
qu'elle se remplisse d'images, et qu'elle s'identifie pour ainsi
dire avec les choses
dont on a à parler. Plus l'âme est généreuse et élevée, plus il lui
faut de puissants
leviers pour l'ébranler. C'est pour cela que la louange lui donne
plus d'essor, que la
lutte redouble ses forces, et qu'elle se complaît dans les grands
rôles. Au contraire, on ressent un secret dédain d'abaisser à un seul
auditeur ce talent
de la parole, acquis au prix de tant de travaux ; on rougit de
s'élever au-dessus du
ton de la conversation. Représentez-vous, en effet, l'air d'un
rhéteur qui déclame, ou
la voix, le geste, la prononciation d'un orateur qui sue et
s'escrime de corps et
d'âme, et cela face à face avec un seul auditeur : ne serez-vous pas
tenté de le
prendre pour un fou ? L éloquence n'existerait pas sur la terre, si
l'on n'avait jamais à
parler qu'en particulier.
CHAP. III. Un maître habile doit commencer par bien connaître l'esprit et
la nature de
l'enfant qui lui est confié. Le principal indice de l'esprit dans le
jeune âge, c'est la
mémoire, laquelle consiste à apprendre aisément et à bien retenir.
Après la
mémoire, c'est l'imitation, qui annonce aussi de l'aptitude, pourvu
cependant que
l'enfant se borne à reproduire ce qu'on lui enseigne, et non à
contrefaire l'air et la
démarche des gens, et ce qu'ils ont de ridicule. Je n'aurai pas bonne opinion du naturel d'un enfant qui, dans
son goût pour
l'imitation, ne cherchera qu'à faire rire. L'enfant vraiment
spirituel, comme je
l'entends, sera bon avant tout. Autrement, j'aimerais autant qu'il
eût l'esprit lourd que
de l'avoir méchant. Mais cette bonté n'aura rien de commun avec la
pesanteur et
l'inertie. Celui dont je me fais l'idée comprendra sans peine ce qu'on lui
enseigne, il
interrogera même quelquefois ; mais son allure sera plutôt de suivre
que de courir en
avant. Ces espèces d'esprits précoces n'arrivent presque jamais à
maturité. On les reconnaît à leur facilité à faire de petites choses
;
secondés d'une certaine
audace, ils font voir tout d'abord ce qu'ils peuvent en ce genre
;
mais ce qu'ils
peuvent ne s'étend pas loin. Ils articulent plusieurs mots de suite,
et les prononcent
d'un air assuré, sans hésiter, sans crainte de mal dire ; ils ne font pas beaucoup, mais ils font vite. Leur force est
toute superficielle ; elle
ne s'appuie pas sur de profondes racines, et ressemble à ces
semences tombées à
fleur de terre, qui lèvent incontinent, et dont les petites herbes
ne produisent que des
épis vides, avant le temps de la moisson. Cela plaît dans l'enfance,
à cause du
contraste ; mais tout à coup les progrès s'arrêtent et le charme
s'évanouit.
Après avoir fait ces remarques, le maître examinera comment
l'esprit des enfants
veut être manié. Il en est qui se relâchent, si on ne les presse
incessamment ; il en
est qui ne peuvent se plier à aucun joug ; la crainte retient les
uns, elle énerve les
autres. Ceux-ci ne produisent rien qu'à force de labeur ; ceux-là
vont plutôt par
impétueuses saillies. Pour moi, je veux un enfant que la louange
excite, qui soit
sensible à la gloire, qu'une dé-
14 faite fasse pleurer. L'ambition sera son aliment
: un reproche le piquera au vif,
l'honneur
l'aiguillonnera. Jamais je ne craindrai la paresse dans un enfant de
cette nature. Cependant il faut accorder à tous quelque relâche, non seulement
parce que rien
n'est à l'épreuve d'un travail continu, et que les choses même
privées de sentiment
et de vie ont besoin d'une alternative de repos, qui les détende en
quelque sorte,
pour se conserver ; mais encore parce que l'amour de l'étude a son
principe dans la
volonté, sur laquelle la contrainte ne peut rien. Aussi les enfants se remettent-ils avec plus de vigueur au
travail quand ils sont,
pour ainsi dire, renouvelés et rafraîchis, et que l'air de la
liberté a retrempé leur âme. L'amour du jeu ne me déplaît pas dans les enfants, il est même
un signe de
vivacité. Un enfant que je verrais toujours morne, abattu et fuyant
les ébats de cet
âge, me donnerait une mauvaise idée de son activité pour les
exercices de l'esprit. Mais en cela, comme en tout, il y a
un milieu à garder : trop de travail leur ferait prendre l'étude en
aversion ; trop de délassement leur ferait contracter l'habitude de
l'oisiveté. Il y a des amusements qui peuvent servir à exercer
l'esprit des enfants et qui consistent dans de petites questions de
toute espèce qu'ils se proposent tour à tour. C'est aussi dans le jeu que les inclinations se décèlent avec
le plus de naïveté,
pourvu qu'on se souvienne qu'il n'est pas d'âge si tendre qui ne
sache discerner le
bien du mal, et qu'il n'est peut-être point de temps plus favorable
pour former les moeurs que celui où la dissimulation est inconnue et
où la voix du maître a tant d'autorité. Mais vous parviendrez plutôt
à rompre qu'à redresser ce qui a crû dans une mauvaise direction. On ne saurait donc avertir trop tôt un enfant de ne rien faire
avec passion, avec
méchanceté, avec emportement ; et il faut se souvenir toujours de ce
mot de Virgile :
Tant de nos premiers ans l'habitude a de force
!
Il y a une chose que je condamne absolument, quoique l'usage
l'autorise et que
Chrysippe ne la désapprouve pas : c'est de fouetter les enfants.
D'abord c'est un
châtiment bas et servile ; et l'on ne saurait, au moins, disconvenir
qu'à tout autre âge
ce serait un affront cruel. Ensuite, l'enfant assez malheureusement
né pour que les
réprimandes ne le corrigent pas, s'endurcira bientôt aux coups comme
les plus vils
esclaves. Enfin on n'aura pas besoin de recourir à ce châtiment en
plaçant près de
l'enfant un surveillant assidu, chargé de lui faire rendre compte de
ses études ; car on peut dire qu'aujourd'hui c'est plutôt la négligence des
pédagogues qu'on
punit dans les enfants, puisqu'on les châtie, non pour les forcer à
bien faire, mais
pour n'avoir pas fait. Au surplus, si vous traitez ainsi l'enfant,
que ferez-vous au
jeune homme, que vous ne pourrez plus menacer de ce châtiment, et à
qui vous
aurez à enseigner des choses plus importantes ? Ajoutez à cela que la douleur ou la crainte leur fait faire des
choses, qu'on ne
saurait honnêtement rapporter, et qui ne tardent pas à les couvrir
de honte.
Oppressée par d'ignominieux souvenirs, l'âme s'attriste jusqu'à fuir
et détester la
lumière. Que sera-ce, si l'on a négligé de s'assurer des
mœurs des
surveillants et des
précepteurs ? je n'ose dire à quelles infamies se portent des hommes
abominables
par suite du droit de châtier ainsi les enfants, ni les
15
attentats
dont la crainte de ces
malheureux enfants est quelquefois une occasion pour d'autres. Je ne
m'arrêterai
pas plus longtemps sur ce point ; on ne m'a que trop compris : qu'il
me suffise d'avoir
protesté qu'il n'est permis à personne de trop entreprendre sur un
âge faible, et
naturellement exposé aux outrages.
Je vais maintenant parler des arts nécessaires à l'institution
de l'orateur, en
déterminant les études propres à chaque âge.
CHAP. IV. Dès que l'élève sait lire et écrire, le rôle du grammairien
commence. Il n'importe
que ce soit du grammairien grec ou du grammairien latin que je
veuille parler,
quoique, selon moi, le premier doive avoir la priorité. La méthode
est la même pour
tous les deux. Bien que la division de la grammaire soit très succincte et se
réduise à deux
parties : l'art de parler correctement, et l'explication des poètes,
la grammaire est plus
importante au fond qu'elle ne le paraît par sa définition. En effet, l'art d'écrire correctement est inséparable de l'art
de parler
correctement, et pour expliquer les poètes, il faut savoir
parfaitement lire. C'est de
tout cela que se compose la critique, que les anciens grammairiens
exerçaient avec
tant de sévérité, que non seulement ils se permettaient de marquer
les passages qui
leur paraissaient défectueux, et d'éliminer comme des enfants
supposés ceux des
ouvrages d'un écrivain qu'ils jugeaient leur avoir été faussement
attribués ; mais
encore, dans la revue qu'ils faisaient des auteurs, ils reléguaient
les uns dans la
foule des écrivains vulgaires et excluaient les autres de toute
classification.
Mais ce n'est pas assez d'avoir lu les poètes, il faut encore
approfondir les écrits
de tout genre, non seulement pour les traits d'histoire qui s'y
rencontrent, mais aussi
pour les mots qui tirent souvent leur autorité de ceux qui s'en sont
servis. Ce n'est
pas tout : sans la musique, la science grammaticale ne peut être
complète,
puisqu'elle a à traiter de mesures et de rythmes. Elle ne peut non
plus se passer de
l'astronomie pour l'intelligence des poètes, lesquels, sans parler
d'autre chose,
déterminent si souvent le temps par le lever et le coucher des
astres. Comment,
sans le secours de la philosophie, entendra-t-on les nombreux
passages qui se
trouvent dans presque tous les poèmes, et qui appartiennent aux
questions les plus
abstraites de la physique ? Comment pourra-t-on lire, par exemple,
Empédocle chez
les grecs, Varron et Lucrèce chez les Latins, qui ont enseigné la
sagesse en vers ? Enfin, il ne faut pas une médiocre éloquence pour traiter
pertinemment et avec
abondance chacune des connaissances dont nous venons de parler. On
peut juger
par là s'il faut écouter ceux qui se moquent de la grammaire comme
d'une science
vide et stérile, tandis que, si elle n'a servi a établir sur un
fondement solide
l'éducation de l'orateur, cette éducation aura la destinée de tous
les édifices qui
manquent par la base. La grammaire, indispensable aux enfants, est
un
délassement pour la vieillesse, et fait le charme de la retraite. De
toutes les
sciences, c'est peut-être la seule qui ait plus de fond que
d'apparence. Ne dédaignons donc pas comme peu importants les éléments de la
grammaire ;
non qu'il soit bien difficile de distinguer les consonnes des
voyelles, ou de diviser
celles-ci en demi-voyelles et muettes, mais parce que plus on
pénètre dans les
mystères de cette science, plus on y découvre de finesses, qui ne
sont pas moins
propres à aiguiser l'esprit des enfants qu'à exercer l'érudition et
la science la plus
profonde. En effet, toutes les oreilles sont-elles capables de bien saisir
les tons 16 de chaque
lettre ? Non sans doute, pas plus que de bien saisir les sons des
cordes d'un
instrument. Mais du moins tout grammairien voudra-t-il descendre
dans tous ces
détails, jusqu'à reconnaître si nous manquons de quelques lettres
nécessaires, non
lorsque nous écrivons des mots tirés du grec, car alors nous
empruntons à cette
langue deux lettres, mais dans les mots purement latins, comme
seruus et uulgus, où le besoin du digamma éolien se fait
sentir ? Il est
certain aussi qu'il y a un son qui tient le milieu entre U et I
; car
nous ne prononçons
pas optimum comme opimum, et dans le mot here on n'entend pleinement
ni l'e ni l'i. Le grammairien examinera, d'un autre côté, si, indépendamment de
ce signe
d'aspiration, qu'on ne peut employer sans admettre le signe
contraire, nous n'avons
pas de lettres surabondantes, comme le K, qui sert, ainsi que l'H, à
caractériser
certains noms ; le Q, qui répond à peu près pour l'effet et pour la
forme au Koppa des
grecs, si ce n'est que nous l'écrivons un peu plus obliquement, et
que les grecs n'en
font maintenant usage que dans les nombres ; et enfin la dernière de
nos lettres, X,
dont nous aurions pu nous passer, si nous n'eussions été la
chercher.
À l'égard des voyelles, le grammairien examinera encore si
l'usage n'a point
donné à quelques-unes force de consonne, puisque l'on écrit iam
comme tam, et
uos comme Cos. Il aura aussi à remarquer comment on les joint
ensemble. Car,
par le moyen de cette jonction, tantôt on en fait une diphtongue, à
la manière des
anciens, chez qui ce redoublement tenait lieu d'accent ; et tantôt on
les fait longues
toutes deux, ce qui ne peut aller plus loin, à moins qu'on ne
s'imagine qu'on peut
faire une syllabe de trois voyelles : mais cela ne saurait jamais
être, si l'une de ces
voyelles ne fait l'office de consonne. Il recherchera comment deux voyelles semblables ont seules la
propriété de se
confondre, tandis qu'aucune consonne ne peut s'unir à une seconde
sans l'affaiblir.
Cependant la lettre I s'appuie sur elle-même dans coniicit formé de
iacit, et la lettre U
dans uulgus et seruus, comme on les écrit à présent. Il remarquera à
ce sujet que
Cicéron aimait le redoublement de l'i dans aiio et Maiia et que
dans ce cas l'un des deux i devient consonne.
L'enfant doit donc apprendre ce que chaque lettre a de
particulier, ce qu'elle a
de commun avec d'autres, et quelles sont celles qui ont de
l'affinité entre elles. Il ne
s'étonnera plus que de scamno on ait fait scabellum, ou que de
pinna, qui veut
dire aigu, on ait fait bipennis, qui signifie une hache à deux
tranchants ; il ne tombera
pas dans l'erreur de ceux qui, persuadés que le mot bipennis vient
de duabus
pennis, veulent qu'on dise pinnas pour signifier les ailes des
oiseaux. Non seulement il connaîtra toutes ces modifications qui
tiennent ou à la
conjugaison ou à une préposition, comme secat secuit,
cadit excidit,
caedit excidit,
calcat exculcat, et comment de lauando on a fait
lotus et son
contraire illotus, et
mille autres semblables ; mais encore il saura comment des nominatifs
ont changé
avec le temps. Car de même que Valesius et Fusius sont devenus
Valerius et
Furius, de même arbos, labos, vapos, clamos et
lases ont eu leur
temps. Et cette même lettre S, que nous avons exclue de tous ces mots,
a succédé
dans quelques-uns à une autre lettre. Ainsi on disait mertare et
pultare pour mersare
et pulsare. Bien plus, on disait jadis fordeum et faedus pour
hordeum
et haedus, en se
servant, au lieu d'aspirations, d'une lettre
17 semblable au vav
;
tandis que les grecs
aspirent ordinairement le φ. De là vient que Cicéron se moque d'un
témoin qui
ne pouvait prononcer la première lettre du mot Fundanius. Il fut aussi un temps où nous mettions un b à la place d'autres
lettres : de là Burrhus, Bruges et Belena. De duellum on a fait
bellum, d'où
quelques-uns ont osé
dire bellios pour duellios. Parlerai-je de stlocum et de
stlites ? de
l'affinité qui existe entre
le t et le d ? Aussi ne faut-il pas s'étonner si, sur les vieux monuments de
notre ville, et dans
quelques-uns de nos temples les plus célèbres, on lit Alexanter et
Cassantra. L'o et
l'u n'ont-ils pas été employés l'un pour l'autre ? On écrivait
Hecoba
et notrix, Culchidis
et Pulyxena, et cela, non seulement dans les mots tirés du grec,
mais dans les mots
latins dederont et probaueront. C'est ainsi que d'Ὀδυσσεὺς les
Éoliens ont
fait Ὀὐδυσσέα, puis les Latins Ulysses. Enfin l'e n'a-t-il pas été mis à la place de l'i, comme dans
Menerua, leber et
magester, et Deioue et Vejove pour Dijoui
et Vejovi ? Mais il me suffit
d'indiquer l'endroit ;
car je n'enseigne pas, je montre la route à ceux qui auront à
enseigner. Ensuite on
s'occupera des syllabes ; sur quoi je ferai quelques observations,
quand je parlerai
de l'orthographe. Puis le maître fera voir combien le discours a de
parties et quelles
sont ces parties, quoiqu'on soit peu d'accord sur le nombre
; car les anciens, et entre autres Aristote et Théodecte, ont
enseigné qu'il n'y en
avait que trois, le verbe, le nom et la conjonction : sans doute
parce que le verbe,
étant la parole même, est la substance du discours ; le nom, étant ce
dont on parle,
en est la matière ; et que ces deux mots ne peuvent s'unir sans le
secours d'un
troisième, c'est-à-dire d'une conjonction, coniunctio, mot dont on
se sert
généralement, et qui correspond moins exactement que conuinctio au
mot
συνδέσμος. Peu à peu les philosophes, et surtout les stoïciens, ont
augmenté ce nombre ; et
d'abord aux conjonctions on a ajouté les articles, puis les
prépositions ; puis on a
ajouté aux noms l'appellation ; ensuite le pronom, ensuite le
participe, qui tient de la
nature du verbe ; enfin on a joint aux verbes mêmes les adverbes.
Notre langue
n'exigeant pas d'articles, ils se trouvent confondus avec les autres
parties ; mais à
toutes celles que j'ai nommées on a encore ajouté l'interjection. D'autres néanmoins, mais qui peuvent être comptés parmi les
auteurs
compétents, comme Aristarque, et de nos jours Polémon, n'en ont
admis que huit,
ne regardant ce que nous nommons vocable, ou appellation, que comme
dépendance ou espèce du nom. Mais ceux qui ont vu une différence
entre le nom et
le vocable en admettent neuf. Il en est néanmoins qui, établissant
une distinction
plus subtile entre vocable et appellation, veulent que le premier se
rapporte
seulement aux objets qu'on peut voir ou toucher, comme maison,
lit ;
et la seconde à
ceux qui manquent d'une de ces propriétés ou de toutes deux à la
fois, comme vent,
ciel, dieu, vertu. Ils ajoutaient aussi deux parties, l'une
d'affirmation, comme heu,
l'autre d'agrégation, comme fasciatim, ce que je n'approuve pas. Au surplus, le mot grec
προδηγορία est-il bien rendu par
vocable ou par
appellation, et doit-on ou ne doit-on pas considérer cette partie
comme une
dépendance du nom ? La question est peu importante, et je laisse à
chacun la liberté
de la décider comme il lui plaira.
Mais surtout que les enfants sachent bien dé-
18 cliner les noms et
conjuguer les
verbes, car c'est le seul moyen de parvenir à l'intelligence de ce
qui suivra. Cet
avertissement serait superflu, sans la précipitation fastueuse de la
plupart des
maîtres, qui commencent par où l'on doit finir, et qui, pour faire
briller leurs élèves
par des connaissances spécieuses, les retardent en voulant leur
abréger le chemin. Mais le maître qui aura et l'instruction suffisante, et la
volonté quelquefois non
moins rare d'enseigner ce qu'il sait, ne se contentera pas de faire
observer qu'il y a
trois genres dans les noms, et quels sont les noms qui ont deux
genres et même les
trois. Cependant je ne verrai pas tout d'abord un maître dont les
soins ne laissent rien
à désirer dans celui qui aura fait remarquer qu'il y a des genres
communs, appelés
épicènes, qui comprennent les deux sexes ; et qu'il y a des noms
masculins dont la
terminaison est féminine, comme Murena, et des noms féminins dont la
terminaison
est neutre, comme Glycerium.
Un maître qui aime à pénétrer plus avant dans les secrets de
son art scrutera
l'origine d'une infinité de noms : de ceux, par exemple, qui
proviennent de certains
signes extérieurs, tels que Rufus et Longus (parmi lesquels il y en
a dont
l'étymologie a quelque chose de plus obscur, tels que Sylla,
Burrhus, Galba, Plautus,
Pansa, Scaurus, et autres semblables) ; de ceux qui rappellent des
accidents qui ont
accompagné la naissance, comme Agrippa, Opiter, Cordus,
Postumus ; ou
des
accidents qui l'ont suivie, comme Vopiscus ; de ceux enfin qui
tiennent à d'autres
raisons diverses, comme Cotta, Scipion, Laenas,
Seranus. On trouve aussi des noms tirés de certains peuples, de certains
lieux, et de
beaucoup d'autres causes. C'était autrefois un usage, tombé depuis
en désuétude,
d'appeler les esclaves d'un nom où entrait celui de leurs maîtres,
comme Marcipores, Publipores. Le maître recherchera encore si la langue
grecque ne
possède pas virtuellement un sixième cas, et la nôtre un septième.
Car lorsque je dis
hasta percussi, blessés d'une lance, ce mot hasta n'a pas la nature
de l'ablatif, de
même qu'en grec le mot τῷ δορί n'a pas celle du datif.
Quant aux verbes, il n'est personne qui ne sache qu'ils ont le
genre, le mode, la
personne, et le nombre. C'est ce qu'on apprend aux petites écoles,
et ce qu'il y a de
plus vulgaire dans la science. Mais on peut être embarrassé dans
certains temps où
la terminaison est équivoque. En effet, il y a certains mots qui
donnent lieu de douter
si ce sont des participes ou des noms, parce qu'ils ont l'une ou
l'autre acception
suivant la place qu'ils occupent, comme lectus et sapiens. Il y a aussi des verbes qu'on prendrait pour des noms, comme
fraudator,
nutritor.
Cette locution, itur in antiquam siluam,
n'a-t-elle pas encore une règle particulière ? car quelle est la
première personne
d'itur ? Il en est de même de fletur. L'acception
du passif dans ce vers :
Panditur interea domus omnipotentis Olympi,
n'est pas la même que dans celui-ci :
Totis
usque adeo turbatur agris !...
Il y a enfin une troisième forme, comme
urbs habitatur, d'où campus curritur, mare
nauigatur.
Pransus et potus ont une signification différente de celle
qu'ils indiquent. Que
dirai-je de cette foule de verbes qu'on ne conjugue pas dans tous
les modes ? Les
uns sont irréguliers, comme fero au prétérit ; les autres ne
s'emploient qu'à la
troisième personne, comme licet, piget ; d'autres
19 enfin ont quelque
ressemblance
avec certains mots qui se prennent adverbialement ; car de même qu'on
dit noctu et
diu, on dit aussi dictu et factu ; les deux derniers mots sont, en
effet, des participes,
qu'il ne faut pourtant pas confondre avec dicto et facto.
CHAP. V. Le discours a trois qualités
: la
correction, la clarté, et
l'ornement ; car pour la
convenance, qui est la qualité principale, la plupart en font une
dépendance de
l'ornement. À ces qualités sont opposés autant de défauts. Le maître
recherchera
donc en quoi consistent les règles de la correction, lesquelles
constituent la première
des deux parties de la grammaire. Ces règles portent sur les mots pris isolément, ou
joints
ensemble. Je prends ici
le mot uerbum dans une acception générale ; car il s'entend de deux
manières : ou il embrasse dans sa signification tous les mots dont
la phrase est composée, et a le sens que lui donne Horace dans ce
vers :
Verbaque prouisam rem non inuita
sequentur :
Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément ;
ou il est une partie du discours, comme
je lis, j'écris. Pour éviter
cette équivoque,
quelques écrivains ont mieux aimé dire uoces, dictiones,
locutiones.
Les mots considérés isolément sont ou essentiellement
latins ou
étrangers ;
simples ou composés ; propres ou métaphoriques
;
usités ou nouveaux.
Le plus
souvent la qualité d'un mot, pris en lui-même, est purement
négative. Car lors même
que notre langage est exact, élégant, sublime, ces qualités sont
uniquement le
résultat de l'ensemble et de l'enchaînement du discours, puisque
nous ne louons
dans les mots que leur convenance avec les choses. La seule qualité qu'on puisse y remarquer, c'est la
vocalité ou
l'euphonie. Voilà
pourquoi entre deux mots qui ont même signification et même valeur,
on choisit celui
qui sonne le mieux.
Ce qu'il faut d'abord fuir comme une difformité, c'est le
barbarisme et le
solécisme. Mais comme ces vices trouvent quelquefois leur excuse
soit dans
l'usage, soit dans l'autorité, soit dans l'antiquité, soit enfin
dans un rapport avec
quelque beauté (car il est souvent difficile de les distinguer des
figures), le
grammairien qui ne veut pas se méprendre sur un point d'observation
aussi fugitif,
doit s'appliquer à bien saisir cette nuance délicate. J'en parlerai
plus au long, lorsque
je traiterai des figures. Quoi qu'il en soit, le vice qui affecte les mots pris isolément
s'appelle barbarisme.
Est-ce donc à cela, me dira-t-on peut-être, que se réduisent vos
magnifiques
promesses ? Qui ne sait qu'il y a des barbarismes qu'on fait
en
écrivant, et d'autres
qu'on fait en parlant, par la raison que ce qui est mal écrit doit
nécessairement être
mal dit, au lieu qu'on peut prononcer d'une manière vicieuse, sans
tomber dans la
même faute en écrivant ? qui ne sait que les premiers ont lieu par
addition ou par
retranchement, par substitution ou par transposition ; et les
seconds, dans la manière
de séparer ou d'assembler les syllabes, d'aspirer ou d'accentuer
? Tout cela est peu de chose ; mais ce sont des enfants qu'il
s'agit d'enseigner, et
c'est à des grammairiens que j'adresse mes avis. Que, parmi ces
derniers, il s'en
trouve qui n'aient que des connaissances grossières et qui ne soient
pas allés au-
delà du seuil de cette science, ils s'en tiendront aux préceptes
vulgaires que
renferment les abrégés de certains professeurs ; les doctes, au
contraire, y
ajoute- 20 ront beaucoup
; et d'abord ils feront remarquer qu'on reconnaît
des
barbarismes de plusieurs sortes : le premier, qui naît d'un mot étranger, si, par exemple, on
introduit dans le latin
un mot africain ou espagnol comme le mot cantus, dont on se sert
ordinairement
pour désigner la bande de fer qui lie les roues, et que Perse
néanmoins emploie
comme un mot reçu. Ainsi, dans Catulle, on trouve le mot ploxenum,
qui n'est usité
que dans les environs du Pô ; et dans le discours de Labiénus, ou, si
l'on veut, de
Cornelius Gallus, contre Pollion, un séducteur amoureux est appelé
casnar, terme
emprunté aux Gaulois. Quant au mot mastraca, qui est sarde, Cicéron
s'en est servi
à dessein et par raillerie. Le second genre de barbarisme est celui qui est purement
intellectuel ; ainsi nous
disons d'un homme dont le langage a été emporté, menaçant ou cruel,
qu'il a parlé
comme un barbare. Le troisième genre de barbarisme, dont il y a une infinité
d'exemples vulgaires,
est celui dont on peut se faire une idée en ajoutant une lettre ou
une syllabe à un
mot quelconque, ou en la retranchant, ou en mettant l'une pour
l'autre, ou en la
plaçant où elle ne doit pas être. Mais il y a des maîtres qui,
pour faire parade d'érudition, se plaisent à chercher des exemples
de barbarisme dans les poètes, et en lisant le texte d'un auteur
comme on fait d'abord, commencent par lui faire son procès. Or, il
faut qu'un enfant sache que ces fautes sont excusables chez les
écrivains en vers, et doivent même quelquefois être regardées comme
des beautés. Il vaudra donc mieux choisir des exemples moins
ordinaires, comme celui de Tinga de Plaisance, qui, s'il faut en croire les
reproches
d'Hortensius, faisait deux barbarismes dans un seul mot, precula
pour pergula ;
d'abord, par changement de lettre, c pour g ; puis, par transposition
r devant e.
Ennius fait la même faute deux fois dans Metieo Fufetioeo ; mais il
a pour lui le privilège de la poésie. On admet aussi en prose certaines modifications. Cicéron dit
Canopitarum
exercitum, quoique les gens du pays disent Canobon ; beaucoup
d'écrivains ont
autorisé Tharsomenum pour Thrasumenum, quoiqu'il y ait là
transposition. Il en est de
même de plusieurs autres mots. Car si l'on soutient qu'assentior est
conforme au
génie de la langue, Sisenna a dit assentio, et beaucoup d'autres
l'ont imité,
s'appuyant d'ailleurs sur l'analogie ; et si l'on soutient, au
contraire, qu'assentio est le
vrai mot, on s'écarte de l'usage, qui a accrédité assentior.
Et cependant un grammairien puriste et méticuleux s'imaginera qu'il
y a retranchement dans l'un ou addition dans l'autre. Que dire aussi
de quelques mots qui, pris en particulier, seraient certainement
vicieux, et qui joints ensemble sont très corrects ? Dua,
tre, pondo, sont des barbarismes de différents genres
;
cependant tout le
monde a dit duapondo et trepondo jusqu'à nous, et ces deux mots ont
encore pour
eux l'autorité de Messala. Il peut paraître absurde d'avancer que le barbarisme, qui n'est
que le vice d'un
mot pris isolément, a lieu aussi par rapport aux nombres et aux
genres, comme le
solécisme : pourtant scala et scopa, hordea et
mulsa, quoiqu'on n'ait
à y reprendre ni
changement, ni retranchement, ni addition de lettres, ne sont
vicieux que par cela
seul que le pluriel y est transformé en singulier, et le singulier
en pluriel ; et ceux qui
ont dit gladia ont péché contre le genre. Mais je me contente, ici comme plus haut, de signaler en
passant cet endroit,
pour ne pas ajouter moi- 21 même une question de plus à un art que
l'entêtement de
quelques rhéteurs n'a déjà que trop compliqué.
Il faut plus de
sagacité pour
distinguer les fautes qui se font en parlant, parce qu'on ne peut
pas en donner
d'exemples par écrit, si ce n'est lorsqu'elles se rencontrent dans
les vers, comme
cette diérèse Europaï, ou le défaut contraire appelé par les
grecs synérèse et
synalèphe, que nous traduisons par complexion. Tel est
ce vers qu'on lit dans Varron :
Cum te flagranti deiectum fulmine Phaeton.
Car, si c'était en prose, on pourrait prononcer toutes les
lettres et conserver
chaque syllabe. Il y a en outre des fautes contre la mesure, soit
lorsqu'on allonge
une syllabe brève, comme dans
Italiam fato profugus,
ou qu'on fait brève une syllabe longue, comme dans
Unius ob noxam et furias ;
Mais ces fautes ne peuvent être remarquées que dans les vers, et
même n'y
doivent-elles pas être regardées comme telles. Quant à celles qui altèrent les sons, c'est l'oreille seule qui
en est juge,
quoiqu'on puisse pourtant demander si dans notre langue une
aspiration ajoutée ou
supprimée mal à propos n'est point une faute d'orthographe, en
admettant que H soit
une lettre, et non pas seulement un signe. En effet, l'aspiration a
subi chez nous de
fréquentes variations avec le temps. Les anciens en usaient très sobrement, même devant les
voyelles ; car ils
disaient oedos et ircos. Ensuite on observa longtemps de ne pas
employer l'aspiration
avec des consonnes, comme dans Graccis et triumpis. Puis tout à coup
l'usage en
devint si excessif, qu'on voit encore aujourd'hui dans quelques
inscriptions,
choroncae, chenturiones, praechones : usage qui a donné lieu à une
épigramme fort
connue de Catulle. C'est ainsi que sont venus jusqu'à nous
uehementer,
comprehendere, mihi. On
trouve même dans les vieux livres des anciens écrivains, et surtout
des poètes
tragiques, mehe pour me.
Des fautes plus difficiles encore à remarquer sont celles qui
se font contre les
tons, tenores, que je trouve appelés tonores par les anciens, sans
doute par
dérivation du mot grec τόνους ou contre les accents, que les
grecs appellent
προσῳδίας, lorsqu'on met une syllabe aiguë pour une syllabe
grave, et
réciproquement, comme si l'on faisait aiguë la première syllabe de
Camillus ; ou
quand on emploie l'accent grave au lieu de l'accent circonflexe, comme si l'on plaçait l'accent aigu sur la première syllabe de
Cethegus, car
alors celle du milieu changerait de nature ; ou bien lorsqu'on met un
accent
circonflexe pour un grave, en confondant les deux dernières syllabes
en une, au
moyen d'un signe : en quoi on pèche doublement. Mais cela ne se fait guère que dans les noms grecs, comme
Atreus. Dans ma
jeunesse, des vieillards fort savants prononçaient ce mot avec un
accent aigu sur la
première syllabe en sorte que la seconde était nécessairement grave
:
il en était de
même des mots Terei et Nerei. Telles étaient les
règles des accents. Je sais au reste qu'aujourd'hui des savants, et
même quelques grammairiens, recommandent et observent de donner
quelquefois un ton aigu à la dernière syllabe d'un mot, pour le
distinguer d'un autre avec lequel on pourrait le confondre, comme
dans ce passage de Virgile :
quae circum litora, circum
piscosos scopulos...
de peur que, si l'on faisait grave la dernière syll-
22 abe, on ne
confondît circum,
préposition, avec l'accusatif de circus. C'est par la même raison
qu'ils prononcent
quantum, quale, avec la dernière syllabe grave, lorsque ces mots
sont interrogatifs ;
et qu'ils font cette même syllabe aiguë, lorsque ces mêmes mots
servent de termes
de comparaison. Ce n'est, au surplus, que pour les adverbes et les
pronoms qu'ils
tiennent à cette distinction ; dans tout le reste, ils suivent
l'ancienne règle. Pour moi, je crois que l'exception vient de ce que, dans
l'exemple tiré de Virgile,
nous lions les mots entre eux. Car lorsque je dis circum litora,
j'ai l'air de ne
prononcer qu'un seul mot sans division ; et alors, ainsi que dans un
seul mot, il n'y a
qu'une syllabe aiguë : ce qui a lieu dans cet hémistiche :
...Troiae qui primus ab oris.
Il arrive aussi que la loi de la mesure change l'accent
: par
exemple,
pecudes pictaeque uolúcres ;
car il faut mettre l'accent aigu sur la seconde syllabe de
uolucres,
parce que, bien
que cette syllabe soit brève de sa nature, elle devient longue par
position, ou
autrement serait un ïambe, sorte de mesure que ne comporte pas le
vers héroïque. Mais, pris séparément, les mots dont nous parlions rentrent
dans la règle ; ou, si
la coutume l'emporte, il faut abolir les anciennes lois du langage.
Ces lois sont plus
difficiles à observer chez les grecs, à cause de la diversité des
dialectes, et parce
que ce qui est vicieux dans l'un est quelquefois correct dans
l'autre. Chez nous, au
contraire, les règles de l'accentuation sont très simples. Dans tout mot, sur trois syllabes qui le composent ou qui le
terminent, il y en a
une d'aiguë, et de ces trois, c'est toujours la pénultième ou
l'antépénultième. Si celle
du milieu est longue, elle aura l'accent aigu ou circonflexe ; si
elle est brève, elle aura
toujours un accent grave, et alors l'accent aigu passera sur la
syllabe qui la précède,
c'est-à-dire l'antépénultième. Dans tous les mots donc il y a une syllabe aiguë, mais jamais
plus d'une, et ce
n'est jamais la dernière ; en sorte que dans les mots de deux
syllabes c'est toujours
la première. En outre, le même mot ne peut pas avoir un accent
circonflexe et un
accent aigu, puisque le circonflexe se forme du grave et de l'aigu
:
aussi ni l'un ni
l'autre ne peut terminer un mot latin : je dis un mot de plusieurs
syllabes, car pour
ceux qui n'ont qu'une syllabe, ils reçoivent l'accent aigu ou
circonflexe, afin qu'il soit
vrai de dire qu'il n'est pas un mot qui n'ait l'accent aigu.
Il faut ranger parmi les fautes contre les accents ces
prononciations vicieuses
qu'il n'est pas possible de démontrer par écrit, et qui tiennent à
des défauts
d'organe. Les grecs, plus heureux que nous à forger des mots, les
appellent ἰωκατισμοὺς et
λαμδακισμοὺς, ἰσχνότητας,
πλατειασμούς,
ils ont encore inventé le mot κειλοστομίαν pour peindre l'effet
de la voix
quand elle semble sortir du fond de la gorge. Il y a enfin certains sons particuliers et inénarrables, que
nous reprochons
quelquefois à toute une nation. C'est en se préservant de tous ces
défauts qu'on
obtiendra une prononciation pure et agréable, ce parler correct que
les grecs
appellent ὀρθοέπειαa.
Tous les autres vices sont ceux qui affectent un assemblage de
mots. De ce
nombre est le solécisme. Cependant on n'est pas d'accord sur ce
point. Car ceux
même qui reconnaissent que le solécisme gît dans la contexture du
discours
induisent, de ce qu'on peut le faire disparaître en
23
corrigeant un
seul mot, que c'est
un vice qui est dans le mot, et non dans le tissu du discours. Ainsi, par exemple, amarae corticis
ou medio cortice font un
solécisme de
genre. Je ne blâme ni l'un ni l'autre, parce qu'ils sont de Virgile
;
mais supposons que
l'un des deux soit mal dit, et qu'en corrigeant le mot où il y a
faute, on rende la
phrase correcte, ce n'en sera pas moins une mauvaise chicane ; car
amarae ou
medio ne sont ni l'un ni l'autre vicieux, pris isolément
; ils ne le
deviennent que parce
qu'ils sont joints à un autre mot : or cette jonction ne
constitue-t-elle pas le discours ?
Mais on fait une question plus savante. Peut-il y avoir
solécisme dans un mot
seul ? si, par exemple, en appelant à soi une seule personne, on dit
uenite, ou si, pour en congédier plusieurs, on dit : abi, discede
? Ou bien y a-t-il solécisme, quand la réponse ne s'accorde pas avec
l'interrogation, comme si à ces mots : quem uideo ? on
répondait : ego ? Quelques-uns vont même jusqu'à penser qu'il y a
solécisme
dans le geste, toutes les fois que, par un mouvement de la tête ou
de la main, on fait
entendre le contraire de ce qu'on dit. Je n'adopte ni ne rejette entièrement ces opinions
; car j'avoue
qu'il peut y avoir
solécisme dans un mot seul, mais seulement en ce sens qu'il y a
quelque chose de
sous-entendu qui tient lieu d'un second mot, et à quoi se rapporte
le premier : en
sorte que le solécisme est dans l'assemblage même de ce qui sert à
signifier les
choses et de ce qui sert à manifester l'intention de celui qui
parle. Enfin, pour éviter toute subtilité, je dirai que le solécisme a
lieu quelquefois dans
un mot, mais jamais dans un mot pris absolument.
Combien y a-t-il
d'espèces de
solécismes, et quelles sont-elles ? c'est un point sur lequel on
n'est guère plus
d'accord. Ceux dont la division me paraît la plus complète en
reconnaissent de
quatre sortes, avec la même distinction que pour les barbarismes : le
solécisme qui
se fait par addition, comme veni de Susis in Alexandriam ;
celui qui a lieu par
retranchement, ambulo uiam, Aegypto uenio, ne hoc fecit ; celui qui résulte d'une inversion, qui détruit l'ordre, quoque
ego, enim hoc uoluit,
autem non habuit. Quant à igitur placé au commencement d'une phrase,
on peut
douter si c'est un solécisme de ce dernier genre ; car je vois que
les plus grands
auteurs ont été partagés sur ce point, puisque les uns l'ont souvent
placé ainsi, et
que chez les autres on n'en trouve aucun exemple. Quelques-uns ne considèrent pas comme solécismes ces trois
vices de
langage, et ils appellent l'addition pléonasme ; le retranchement,
ellipse ; l'inversion,
anastrophe ; prétendant que, si ces figures sont des solécismes, on
peut en dire
autant de l'hyperbate. Pour la quatrième espèce, qui consiste à mettre un mot pour un
autre, c'est, de
l'aveu de tous, un solécisme. Toutes les parties du discours sont
susceptibles de ce
genre de solécisme, mais particulièrement le verbe, à cause de ses
nombreuses
modifications. Aussi donne-t-il lieu à des solécismes de genres, de
temps, de
personnes et de modes, que d'autres appellent état, ou qualités, et
qui sont au
nombre de six ou de huit ; car il y aura autant de formes de
solécismes qu'il y aura
d'espèces de modifications. Ajoutons encore les nombres. Nous en avons deux, le singulier
et le pluriel ; les
grecs ont de plus le duel. Quelques-uns, cependant, ont voulu voir
un duel dans scripsere, legere ; mais la terminaison de ces mots n'a d'autre
raison que l'euphonie,
comme male merere pour male mere-
24 ris, qu'on trouve chez les anciens
;
de sorte que
ce qu'on appelle duel, en latin, n'occupe que ces deux places tandis
que chez les
grecs, le duel existe dans presque toute la conjugaison du verbe et
dans les noms,
quoique pourtant ils s'en servent très rarement. Mais pour le nôtre, aucun de nos auteurs ne s'est avisé d'en
faire la distinction ;
au contraire, ces locutions, deuenere locos,
conticuere omnes,
consedere duces,
prouvent évidemment qu'elles ne s'appliquent nullement à deux
personnes. Il en est
de même de dixere, quoique Antonius Rufus cite cet exemple comme une
preuve du
contraire ; car il est certain que l'huissier prononce ce mot après
les plaidoiries des
avocats, quel qu'en soit le nombre. Mais quoi ! Tite-Live, dès le début de son histoire, ne dit-il
pas : tenuere arcem
Sabini ; et peu après : in aduersum Romani subiere ? Enfin quelle
autorité préférerai-je
à celle de Cicéron, qui s'exprime ainsi dans son Orateur
: 'Je ne
blâme pas scripsere,
mais je crois que scripserunt est plus vrai ?'
Le solécisme a lieu dans les noms appellatifs et dans les noms
proprement dits,
en genre, en nombre, comme dans les verbes, et en cas. On peut
étendre aux
comparatifs et aux superlatifs le solécisme qui consiste à mettre
une de ces trois
choses à la place d'une autre ; il faut en dire autant de l'emploi du
nom patronymique
au lieu du nom possessif, et réciproquement. À l'égard du vice qui affecte la quantité, comme dans magnum
peculiolum, il y
en a qui pourront y voir un solécisme, parce que le diminutif est
mis au lieu du mot
intégral. Pour moi, j'y vois plutôt une impropriété ; car c'est dans
la signification qu'est
l'erreur : or, le solécisme n'est jamais dans le sens, mais dans
l'union des mots. Le participe peut pécher en genre et en cas, comme le nom
appellatif ; en
temps, comme le verbe ; et en nombre, comme tous les deux. Le pronom
comporte
aussi le genre, le nombre, et les cas ; et ces diverses propriétés
sont susceptibles de
cette espèce de faute. Enfin on fait des solécismes, et en grand nombre, dans les
parties des discours ;
mais il ne suffit pas de faire cette observation générale, de peur
que l'enfant ne
s'imagine qu'il n'y a faute que lorsqu'on emploie une partie pour
une autre, un verbe
au lieu d'un nom, un adverbe au lieu d'un pronom, et autres
substitutions
semblables. Car il y a des mots qui ont une sorte de parenté, c'est-à-dire
qui appartiennent
au même genre, et à l'égard desquels on ne pèche pas moins par le
changement
d'espèce que par le changement de genre. Ainsi, an et
aut sont des conjonctions, et cependant ce serait mal parler
que de dire dans la forme interrogative : hic, aut ille, sit
? ne et
non sont
des adverbes ; et
cependant celui qui dirait non feceris pour ne feceris,
tomberait dans la même faute, parce que non est un adverbe de
négation, et ne un adverbe de prohibition. Un autre exemple : intro et intus sont des adverbes de lieu
: cependant
eo
intus, intro sum, sont
des solécismes. Les mêmes fautes peuvent avoir lieu dans les différentes
espèces de pronoms,
d'interjections, et de prépositions. Il y a aussi solécisme,
lorsque, dans une phrase
sans division, les mots qui précèdent et ceux qui suivent ne
s'accordent pas entre
eux. Cependant il y a des locutions qui ont l'apparence de
solécismes, et qui
pourtant ne peuvent pas être regardées comme vicieuses, telles que
tragoedia
Thyestes, ludi Floralia ac Megalesia,
25 quoiqu'elles soient
aujourd'hui tombées en
désuétude, les anciens ne parlaient pas autrement. Nous appellerons
donc figures
ces locutions, plus fréquentes, à la vérité, chez les poètes, mais
permises aussi aux
orateurs. Au reste, une figure est ordinairement fondée sur une raison
quelconque,
comme je le démontrerai en son lieu, ainsi que je l'ai promis tout à
l'heure. Mais ces
locutions, qu'on appelle figures, ne laissent pas d'être des
solécismes, si celui qui les
a employées n'a pas cru parler en style figuré. Il faut ranger dans la même espèce, quoiqu'ils n'aient rien de
figuré, ces noms
dont j'ai parlé plus haut, qui sont masculins avec la forme du genre
féminin, ou
féminins avec celle du genre neutre. Je n'en dirai pas davantage sur
le solécisme,
car je n'ai pas prétendu composer un traité de grammaire ; mais comme
cet art s'est
rencontré dans mon chemin, je n'ai pas voulu le laisser passer sans
lui faire
honneur.
Maintenant, pour suivre l'ordre que je me suis prescrit, les
mots, comme je l'ai
dit, sont ou latins ou étrangers. Or, par mots étrangers, j'entends
ceux qui nous sont
venus de presque toutes les nations, comme il nous en est venu
beaucoup
d'hommes et beaucoup d'institutions. Je passe sous silence les
Toscans, les Sabins et même les Prénestins ; car
quoique Lucilius reproche à Vettius de se servir de leur langage, de
même que
Pollion a cru remarquer dans Tite-Live quelque chose qui sent le
terroir de Padoue,
je puis considérer comme Romains tous les peuples de l'Italie. Plusieurs mots gaulois ont prévalu, tels que
rheda et
petorritum, qu'on trouve
l'un dans Cicéron, l'autre dans Horace. Les Carthaginois
revendiquent mappa, usité
dans le cirque ; et j'ai entendu dire que gurdus, dont le peuple se
sert pour désigner
un niais, a une origine espagnole. Au surplus, dans ma division, j'ai particulièrement en vue la
langue grecque,
parce que c'est d'elle que la nôtre s'est formée en grande partie,
et que même nous
nous servons au besoin de mots purement grecs, comme aussi
quelquefois les
grecs nous font des emprunts. De là naît une question, si ces mots
étrangers
doivent se décliner de la même manière que les nôtres. D'abord un grammairien, zélateur de l'antiquité, ne manquera
pas de vous dire
qu'il ne faut rien changer à la manière latine, attendu que, les
Latins ayant un ablatif
que les grecs n'ont pas, il serait peu convenable de se servir de
leurs cinq cas, et de
n'en apporter qu'un seul pour notre part. Il louera même le zèle de ceux qui, jaloux d'accroître la
puissance de la langue
latine, ne voulaient pas avouer qu'elle eût besoin de recourir à des
lois étrangères.
C'est pour cela qu'ils prononçaient Castorem, en faisant longue la
syllabe du milieu,
parce que c'est ainsi que se prononce notre accusatif dans tous les
noms qui ont le
nominatif terminé en or. C'est par la même raison qu'ils
persistaient à dire Palaemo,
Telamo, Plato (Cicéron même appelle ainsi ce dernier), parce qu'ils
ne trouvaient
pas de nom latin terminé en on. Ils répugnaient même à la terminaison en as au nominatif des
noms grecs
masculins : aussi lisons-nous dans Caelius Pelia Cincinnatus, et dans
Messala bene fecit Euthia, et dans Cicéron Hermagora. Ne nous étonnons donc plus
si la plupart
des anciens ont dit Aenea et Anchisa. Leur raison était que, si l'on eût écrit ces noms comme
Maecenas, Suffenas,
Asprenas, il aurait fallu que le génitif, au lieu de finir en
ae, se
terminât par la syllabe
tis. De là vient qu'ils mettaient l'accent aigu sur la pénultième
des mots Olympus, tyrannus, parce que le génie de notre langue s'oppose
26 à ce qu'on
mette l'accent aigu
sur la première syllabe, quand c'est une brève suivie de deux
longues. C'est ainsi qu'au génitif ils ont dit
Achilli, Ulyssi, et
beaucoup d'autres. Les
grammairiens modernes ont établi l'usage de donner aux noms grecs
les
déclinaisons grecques : ce qui pourtant n'est pas toujours possible.
Pour moi, je crois
qu'il vaut mieux suivre la manière latine, tant que la convenance le
permet ; car je ne
dirai pas Calypsonem comme on dit Iunonem, quoique C. César, à
l'imitation des
anciens, ait adopté cette manière de décliner. Mais l'usage l'a
emporté sur l'autorité. Dans les autres mots qui pourront comporter l'une et l'autre
déclinaison, celui
qui préfère la forme grecque ne parlera pas latin, à la vérité, mais
on n'aura pas sujet
de le blâmer.
Les mots simples sont ceux qui conservent leur état primitif,
c'est-à-dire ceux à
la nature desquels on n'a rien ajouté. Les mots composés sont des
mots simples,
précédés tantôt d'une préposition, comme innocens, tantôt de deux,
qui quelquefois
s'accordent mal entre elles, comme imperterritus, et quelquefois
sont compatibles,
comme incompositus, reconditus, et comme subabsurdum, dont se sert
Cicéron ; ou
bien ce sont pour ainsi dire deux corps en un, comme maleficus. Car je n'accorde pas que notre langue comporte un mot composé
de trois,
quoique Cicéron dise que capsis est formé de cape si uis, et qu'il y
ait des gens qui
prétendent également que Lupercalia est composé de trois parties du
discours, luere
per caprum. Car pour le mot Solitaurilia, on ne doute plus qu'il ne vienne
de sus, ovis et taurus, et
en effet ce sont les trois animaux que l'on immole dans ce
sacrifice, dont on voit
aussi la description dans Homère : mais ces composés sont moins
trois mots que trois particules de mots. Et Pacuvius, qui a voulu
joindre à deux mots, non pas un troisième, mais seulement une
préposition, a fait évidemment un assemblage insupportable dans le
vers suivant :
...Nerei
repandirostrum incuruiceruicum pecus.
La seconde espèce de mots, dont nous parlons, se compose soit
de deux mots
latins entiers, comme superfui, subterfugi (encore est-ce une
question si ce sont là
des mots entiers), soit d'un mot entier et d'un mot corrompu, comme
maleuolus ; soit
d'un mot corrompu et d'un mot entier, comme noctiuagus
; soit de deux
mots
corrompus, comme pedisequus ; soit d'un mot latin et d'un mot
étranger, comme
biclinium, ou d'un mot étranger et d'un mot latin, comme
epitogium,
Anticato ; soit
enfin de deux mots étrangers, comme epirhedium, car dans ce dernier
la préposition
ἐπὶ est grecque, rheda est gaulois, et ni les grecs ni les
Gaulois ne se
servent de ce composé. De ces deux mots empruntés à deux langues
étrangères,
les Romains en ont fait un qui leur appartient.
Souvent aussi les prépositions sont corrompues par cette
alliance, comme dans abstulit, aufugit, amisit, quoique isolément la préposition soit
ab ;
et dans coit,
quoique la préposition soit con. Il en est de même dans ignaui,
erepti, et autres
semblables. Mais en général cet alliage de mots différents nous réussit
moins qu'aux grecs ;
et cela, je crois, tient moins à la nature des deux langues qu'à
notre engouement
pour ce qui est étranger : ainsi nous admirons le
κυρταύχενα des
grecs ; et
notre incuruiceruicum, nous avons peine à l'entendre sans rire.
Les mots propres sont ceux qui conservent
27
leur signification
primitive ; les
métaphoriques sont ceux qui reçoivent du lieu où ils sont placés un
sens autre que
celui qu'ils ont naturellement.
Quant aux mots usités, ce sont ceux
dont l'emploi est
le plus sûr. Ce n'est pas sans quelque danger qu'on en crée de
nouveaux ; car s'ils
sont accueillis, ils ajoutent peu de mérite au discours ; et s'ils ne
le sont pas, ils nous
donnent même du ridicule. Cependant il faut oser, parce que, comme le dit Cicéron, ce qui
d'abord a paru
dur s'adoucit par l'usage. Quant aux onomatopées, elles ne sont
nullement permises
à notre langue. Qui en supporterait du genre de celles qu'on admire
avec raison
dans la langue grecque, comme λίγξε βιὸς et
σίζε ὀφθαλμός ? On
oserait à peine dire baIare et hinnire, si ces mots n'étaient
consacrés par l'antiquité.
CHAP. VI Il y a des règles à observer, soit en parlant, soit en écrivant.
Le langage a pour
fondement la raison, le temps, l'autorité, l'usage. La
raison
s'appuie principalement
sur l'analogie et quelquefois sur l'étymologie. Le
temps donne aux
mots anciens une
sorte de majesté, et, pour ainsi dire, de sanction religieuse. L'autorité
se tire ordinairement des orateurs et des historiens. Car, pour les
poètes, ils ont leur excuse dans la nécessité de la mesure, si ce
n'est lorsqu'étant libres de choisir entre deux manières de parler,
ils préfèrent l'une à l'autre, comme dans les exemples suivants : imo de stirpe recisum..
aëriae quo congessere palumbes...
silice in nuda, et autres semblables : en quoi on peut fort bien les
imiter, parce
qu'alors le jugement de ces maîtres en éloquence supplée la raison,
et qu'il y a
même de l'honneur à s'égarer sur les traces de pareils guides. Quant à l'usage, c'est le maître le plus sûr, et l'on doit se
servir hardiment du
langage établi, comme de la monnaie marquée au coin de l'État.
Mais
tout cela exige
beaucoup de discernement, surtout l'analogie, mot tiré du grec, et
auquel
correspond dans notre langue celui de rapport.
L'analogie consiste à rapporter ce qui est douteux à quelque
chose de semblable
qui ne l'est pas, à prouver l'incertain par le certain : ce qui a
lieu de deux manières,
ou par la comparaison de deux mots semblables, principalement par
rapport aux
syllabes finales (voilà pourquoi l'on dit qu'il ne faut pas demander
raison de ceux qui
n'en ont qu'une), ou par les diminutifs. Par la
comparaison, on découvre le genre ou la déclinaison des
noms : le genre ;
on veut savoir si funis est masculin ou féminin, on le compare, par
exemple, à panis :
la déclinaison ; on doute s'il faut dire hac domu ou hac domo,
domuum
ou domorum :
on compare domus à des mots semblables, anus, manus. Par les
diminutifs, on trouve seulement le genre : ainsi, pour
m'en tenir au même
exemple, funiculus démontre que funis est masculin. La comparaison se fait de la même manière pour les verbes. Si
quelqu'un, à
l'imitation des anciens, prononçait brève la pénultième de feruere,
il serait convaincu
de mal parler, parce que tous les verbes qui ont l'indicatif terminé
en eo, lorsque
l'infinitif de ces verbes est en ere, ont toujours ce premier
e
long, prandeo, pendeo,
spondeo, prandere, pendere, spondere ; tandis que ceux qui n'ont qu'un
o à l'in-
28
dicatif, et qui ont
aussi l'infinitif en ere,
comme lego, dico, curro, ont cet e bref, legere,
dicere, currere, quoique Lucilius ait dit :
Feruit aqua et feruet : feruit nunc, feruet ad annum.
Car, avec tout le respect que je dois à un homme si savant, si,
selon lui, feruit est
semblable à currit et legit, il faudra dire feruo, comme on dit
curro et lego ; ce que je
n'ai jamais vu. Aussi la comparaison n'est-elle pas exacte ; car
l'analogue de feruit
est seruit, et il faudra dire conséquemment feruire comme on dit
seruire. On découvre aussi quelquefois l'indicatif à l'aide des temps
obliques. Je me
souviens d'avoir ramené à mon avis des personnes qui me reprenaient
de m'être
servi du prétérit pepigi. Ils convenaient bien que de grands
écrivains l'avaient
employé ; mais ils prétendaient que la règle ne le permettait pas,
parce que le
présent de l'indicatif ayant la nature de la voix passive, devait
faire au prétérit pactus
sum ; et moi, outre l'autorité des orateurs, je me fondais encore sur
l'analogie. En
effet, en lisant dans les XII Tables ni ita pagunt, j'étais conduit
par son analogue
cadunt à reconnaître que l'indicatif, tombé depuis en désuétude,
était pago comme
cado, et qu'ainsi il n'était pas douteux qu'en disant
pepigi je
suivais la même règle
que pour cecidi.
Souvenons-nous néanmoins que l'analogie ne peut être une règle
universelle,
puisqu'on la trouve en contradiction avec elle-même dans beaucoup de
cas. Il est
vrai que certains érudits la défendent autant qu'ils peuvent. Par
exemple, qu'on leur
fasse remarquer que lepus et lupus, qui ont le même nominatif, sont
néanmoins fort
différents dans les cas et dans les nombres, ils répondront que ces
deux noms ne
sont pas de même espèce, que lepus est épicène et lupus masculin,
quoique Varron
dans son livre sur les commencements de Rome fasse lupus féminin,
après Ennius
et Fabius Pictor. Si vous leur demandez pourquoi aper fait
apri, tandis que pater
fait patris, ils
diront que le premier est un nom absolu et le second un nom relatif
;
en outre,
comme ces deux mots viennent du grec, ils recourront à cette raison,
que le latin suit
la déclinaison grecque, patris πατρὸς, apri
κάρπου. Mais comment s'en tireront-ils quand on leur fera remarquer que
des noms,
même féminins, qui ont le singulier nominatif en us, n'ont jamais le
génitif terminé en
ris, et que cependant Venus fait Veneris ; que ceux qui ont le
nominatif en es,
quelque diversifié que soit le génitif, ne l'ont jamais en ris
; et
qu'il faut dire cependant Ceres Cereris ? Parlerai-je des mots qui, avec un nominatif ou un indicatif
entièrement
semblables, reçoivent des inflexions différentes, comme Alba qui
fait Albanos et
Albenses ; uolo qui fait uolui et uolaui
? L'analogie reconnaît
elle-même que les verbes
dont l'indicatif est terminé en o à la première personne varient à
l'infini leurs prétérits, cado cecidi, spondeo
spopondi, pingo pinxi, lego legi,
pono posui,
frango fregi, laudo
laudaui. C'est que l'analogie n'est pas descendue du ciel au moment de
la formation de
l'homme, pour lui apprendre à parler ; mais elle a été découverte
après la parole, et
après que le langage eut donné lieu à des remarques sur les
désinences de certains
mots. Ce n'est donc pas sur la raison que se fonde l'analogie, mais
sur l'exemple ;
elle n'est donc pas la loi du langage, mais le résultat de
l'observation ; de sorte que
l'analogie n'a d'autre origine que
29 l'usage. Il se rencontre pourtant des gens qui, par un travers
insupportable et sous
prétexte de rester fidèles à l'analogie, s'obstinent à dire
audaciter au lieu d'audacter, quoique tous les
orateurs emploient ce dernier ; emicauit au lieu de
emicuit, conire au
lieu de coire. Laissons-leur donc aussi audiuisse, sciuisse,
tribunale, faciliter ;
souffrons qu'ils disent frugalis et non frugi ; car autrement d'où
viendrait frugalitas ? qu'ils relèvent deux solécismes dans
centum millia nummum et
fidem deum,
parce que ces locutions pèchent contre les cas et contre les
nombres. Nous ne nous
en doutions pas, en effet et c'était sans le savoir que nous nous
conformions à
l'usage et à la convenance, en cela comme en bien d'autres façons de
parler que
Cicéron a discutées divinement, comme tout le reste, dans l'Orateur. Citerai-je Auguste, qui, dans ses lettres à C. César, le blâme
de préférer calidum à caldum ; non que le premier ne soit pas latin, dit-il, mais
parce qu'il a
quelque chose de choquant et de recherché, περίεργον, mot grec
dont il se
sert ?
Voilà pourtant, suivant certaines personnes, ce qui seul
constitue la correction
du langage. Certes, je suis loin de l'exclure. Quoi de plus
nécessaire, en effet, que la
correction ? Je veux même qu'on s'y attache autant que possible, et
qu'on résiste
longtemps aux novateurs. Mais quand des mots n'ont plus cours, quand
ils sont
abrogés, il y a une sorte d'impertinence et de prétention puérile
dans les petites
choses à vouloir les conserver. Car ce savant, qui en saluant prononçait
auete sans aspiration
et en allongeant
la pénultième (la règle veut en effet auere), aurait pu dire aussi
calefacere et
conseruauisse plutôt que calfacere et conseruasse
; il aurait pu dire
encore face, dice, et autres. C'est le droit chemin, dira-t-on
; qui le nie ? mais à côté il y
en a un plus doux et
plus fréquenté. Cependant, ce qui me moleste le plus, ce n'est pas
de les voir se
permettre, je ne dis pas de chercher le nominatif par les cas
obliques, mais de le
changer, et de dire, par exemple, ebor et robor pour
ebur et robur,
que les grands
auteurs ont toujours dit et écrit de la sorte ; et cela sous prétexte
que ces mots font
eboris et roboris au génitif, tandis que sulfur et
guttur gardent
l'u au même cas. C'est
par la même raison que iecur et femur ont fait question
: ce qui n'est pas moins exorbitant que si
l'o était substitué à
l'u dans le génitif
de sulfur et de guttur, parce qu'on dit eboris et
roboris, à
l'exemple d'Antonius
Gniphon, qui convient à la vérité qu'on doit dire robur,
ebur, et
même, ajoute-t-il,
marmur ; mais qui veut que ces mots fassent au pluriel robura,
ebura,
marmura. Mais si l'on eût fait attention à l'affinité des lettres, on
aurait vu que de robur on
a fait roboris, comme de miles, limes, on a fait
militis, limitis,
de iudex, uindex, iudicis,
uindicis, et autres dont j'ai déjà touché quelque chose. D'ailleurs, comme je le disais, n'y a-t-il pas des noms qui,
avec la même
terminaison au nominatif, prennent des formes toutes différentes
dans les cas
obliques ? Virgo, Iuno ; fusus, lusus ; cuspis, puppis, et mille
autres ? N'y a-t-il pas
même quelques noms qui n'ont pas de pluriel, d'autres pas de
singulier ? N'y en a-t-il
pas qui sont indéclinables, d'autres qui, immédiatement après le
nominatif, changent
totalement, comme Iuppiter ? Ce qui a lieu aussi dans les verbes, comme
fero, dont le
prétérit parfait tuli ne
se 30 retrouve pas dans les autres temps. Au reste, il importe peu que
certains mots
n'existent pas, ou soient insupportables à l'oreille. Quel sera, par
exemple, le génitif
singulier de progenies, ou le génitif pluriel de spes
? comment
arrivera-t-on à former
les prétérits passifs et les participes de quire et ruere
? Que dirai-je d'autres mots du genre de
senatus ? doit-on dire senatus senatus
senatui ou senatus senati senato ? C'est pourquoi il me semble qu'on
a dit assez
heureusement qu'autre chose est de parler latin, autre chose de
parler
grammaticalement. Mais en voilà peut-être trop sur l'analogie.
L'étymologie, qui s'occupe de l'origine des mots, est appelée
par Cicéron notatio, parce qu'elle est désignée chez Aristote sous le nom de
σύμνολον
qui veut dire signe ; car il se défie du mot ueriloquium, qu'il a
créé lui-même, et qui
est la traduction littérale d'ἐτυμολογία. D'autres, qui se sont
attachés au sens
virtuel du mot l'appellent originatio. L'étymologie est nécessaire toutes les fois que la chose dont
il s'agit a besoin
d'interprétation. Ainsi M. Caelius prétendait qu'il était ce qu'on
appelle homo frugi,
non pas qu'il fût tempérant, car il ne pouvait mentir à ce point,
mais parce qu'il était
utile à beaucoup de monde, c'est-à-dire fructueux, fructuosus, d'où
venait, disait-il,
frugalitas. C'est donc dans les définitions qu'on fait
particulièrement usage de
l'étymologie. Elle sert aussi quelquefois à distinguer des termes barbares de
ceux qui sont
corrects : elle examine par exemple, si on doit appeler la Sicile Triquetram ou
Triquedram ; si l'on doit dire meridies ou medidies
; et ainsi
d'autres mots, qui se plient
à l'usage. Au surplus, elle réclame beaucoup d'érudition, soit qu'elle
s'exerce sur les mots
que nous avons tirés du grec, et qui sont en grand nombre, surtout
ceux qui se
déclinent suivant le dialecte éolien, avec lequel notre langue a le
plus de rapport, soit
qu'elle recherche dans les traditions des anciens historiens
l'origine des noms
d'hommes, de lieux, de nations, de villes ; d'où sont venus les noms
de Brutus,
Publicola, Pythicus ; ceux de Latium, d'Italie, de
Beneuentum ; quelle
raison on a eue
de dire le Capitole, le mont Quirinal, l'Argilète.
Je ne parle pas de ces recherches minutieuses dans lesquelles
se consument
particulièrement certains amateurs passionnés de l'étymologie, qui
se servent de
mille détours pour y ramener les mots un peu altérés, et qui pour
cela font brèves les
lettres ou syllabes qui sont longues, ou longues celles qui sont
brèves, en ajoutent
ou en retranchent, ou même les changent. Cela dégénère, dans les
esprits faux, en
puérilités tout à fait misérables, jusqu'à rechercher, par exemple,
si consul vient de consulere dans le sens de pourvoir ou dans
celui de juger. En effet, les anciens employaient ce mot dans cette
dernière acception, d'où nous est resté : rogat boni
consulas, c'est-à-dire bonum iudices ; si c'est à cause de l'âge qu'on a appelé les sénateurs de ce
nom, car on les
appelle aussi patres ; si rex vient de regere, et une foule d'autres
mots qui ne font
pas question. Je veux bien qu'on recherche l'origine de tegulae, de
regulae, et
d'autres semblables ; je veux que classis vienne de calare,
lepus de
leuipes, uulpes
de uolipes : mais sera-ce une raison pour admettre que l'étymologie de
quelques mots doive
se tirer précisément de leurs contraires ? que lucus, bois sacré,
vient de lucet, parce
que l'épaisseur du feuillage laisse à peine entrer le jour, parum
lucet ; que ludus,
école, vient de lusus, jeu, parce qu'il n'y a rien qui ait moins de
31
rapport avec le jeu ;
que Pluton est appelé ditis parce qu'il n'est rien moins que riche
?
que homo vient
d'humus, parce que l'homme est né de la terre ; comme si tous les
animaux n'avaient
pas la même origine, ou comme si les premiers hommes avaient donné
un nom à la
terre avant de s'en donner un à eux-mêmes ? Croirai-je que uerbum est
une
contraction de aer uerberatus, parce que la parole frappe l'air
? Continuons, et nous en viendrons jusqu'à croire que
stella,
étoile, vient de
luminis stilla, goutte de lumière. L'auteur de cette étymologie est
pourtant un homme
distingué dans les lettres : mais il serait peu convenable à moi de
le nommer dans un
endroit où je ne fais mention de lui que pour le blâmer. Mais quant à ceux qui ont composé des livres sur ces sortes de
recherches,
comme ils n'ont pas craint d'y mettre leurs noms, je citerai, entre
autres, Gavius qui
s'applaudissait de dire caelibes, célibataires, dans le sens de
caelites, habitants des
cieux, parce que les célibataires sont exempts du plus pesant des
fardeaux ; et qui
alléguait, à l'appui de son interprétation, le mot grec
ἠϊθέος, qui veut dire
aussi célibataire, et a, selon lui, la même origine. Modestus ne lui
cède en rien pour
l'invention ; car il prétend qu'on a donné le nom de caelebs à celui
qui n'a point de
femme, à cause de Caelus, que Saturne avait mutilé. Pituita, dit
AeIius, a pour
étymologie quia petat vitam, parce que la pituite attaque la vie. Mais qui n'aura pas droit à l'indulgence après Varron, qui
voulait persuader à
Cicéron qu'ager, champ, vient du mot agere, agir, parce qu'il y a
toujours à faire
dans un champ ; et que graguli, les geais, sont ainsi nommés parce
qu'ils volent par
troupe, gregatim ; tandis qu'il est évident qu'ager est tiré du grec,
et que gragulus est
imité du cri de ces oiseaux ? Mais Varron attachait tant de prix aux étymologies, que, selon
lui, merula, merle,
s'appelle ainsi parce qu'il vole seul, mera uolans. Quelques-uns
n'ont pas fait
difficulté de comprendre dans l'étymologie toutes les causes des
noms : par exemple,
les qualités extérieures, d'où sont venus, comme je l'ai dit, les
surnoms de Longus et
de Rufus ; le son, dont l'imitation a produit stertere,
murmurare.
Ils y ont joint les
dérivés, comme uelocitas de uelox, et les composés, qui, pour la
plupart, ont
incontestablement, comme les dérivés, quelque primitif d'où ils
tirent leur origine,
mais pour lesquels il est superflu de recourir à la science, dont on
doit, en matière
d'étymologie, réserver l'emploi pour les cas douteux.
Pour ce qui est des vieux mots, non seulement ils ont
d'illustres partisans, mais
il est certain qu'ils donnent au discours une sorte de majesté qui
n'est pas sans
charme. À l'autorité du temps ils joignent l'attrait de la
nouveauté, à cause de leur
désuétude. Mais il faut en user sobrement, et n'en faire un emploi ni trop
fréquent ni trop
saillant, car rien ne déplaît tant que l'affectation. Il faut se
garder surtout de les aller
chercher dans des temps trop reculés et trop obscurs, comme les mots
topper,
antegerio, exanclare, prosapia, ou comme les vers des Saliens, à
peine compris de
ces prêtres eux-mêmes. Quant à ceux-ci, la religion interdit d'y rien changer, et il
faut s'en servir comme
de choses consacrées. Mais pour le langage ordinaire, dont la clarté
est la qualité
principale, que serait-ce s'il avait besoin d'interprétation
? En un
mot, il faut préférer
dans les mots nouveaux les plus anciens, et dans les anciens les
plus nouveaux.
Il faut procéder de la même manière par rapport à l'autorité.
Quoiqu'à la rigueur
on ne pèche pas en se servant des mots qu'ont émis de grands
écrivains, il importe
beaucoup de regarder non seulement à ce qu'ils ont dit, mais encore
jusqu'à 32
quel
point ce qu'ils ont dit est accrédité. Qui de nous tolérerait
aujourd'hui tuburchinabundum ou lurchinabundum, quoique ces mots soient de
Caton ; ou hi lodices que Pollion aimait ; ou gladiola de Messala
; ou
parricidatus
qui paraît à peine
supportable dans Caelius ? Calvus ne me fait pas approuver colli, et
tous ces
écrivains eux-mêmes ne parleraient pas ainsi aujourd'hui.
Reste donc l'usage ; car il serait presque ridicule de préférer
la langue qu'on a
parlée à celle qu'on parle. Ce vieux langage, en effet, qu'est-ce
autre chose que
l'ancien usage de parler ? Mais ce que je dis a besoin d'être
raisonné, et il faut
d'abord établir ce qu'on doit entendre par usage. Si nous appelons ainsi ce que fait la majorité, nous émettrons
un précepte très
dangereux, non seulement pour le langage, mais, ce qui est plus
important, pour les mœurs. D'où nous viendrait tant de bonheur, en effet, que ce qui
est bien eût le
suffrage de la majorité ? De même donc que, bien que la manie de
s'épiler, de se
couper les cheveux par étages, de boire avec excès dans le bain, ait
envahi la ville,
cette manie n'a rien de commun avec l'usage, parce que rien de tout
cela n'est à
l'abri du blâme, et que l'usage se borne à se baigner, à se raser, à
prendre ses
repas ; de même, dans le langage, si des locutions vicieuses viennent
à se propager,
elles ne doivent pas pour cela faire autorité. Car, sans parler des fautes qui échappent journellement aux
ignorants,
n'entendons-nous pas souvent le peuple entier, dans les théâtres ou
au cirque,
pousser des exclamations barbares ? J'appellerai donc usage, pour
parler, le
consentement des personnes éclairées, comme j'appellerai usage, pour
la manière
de vivre, le consentement des honnêtes gens.
CHAP. VII. Nous avons exposé les règles qu'il faut observer en parlant
:
passons à celles
qu'il faut observer en écrivant. Ce que les grecs appellent
ὀρθογραφία, nous
l'appelons l'art d'écrire correctement : art qui ne consiste pas à
connaître de quelles
lettres se compose chaque syllabe (ce qui serait même au-dessous de
la profession
du grammairien), mais qui, selon moi, consiste uniquement à
éclaircir l'ambiguïté des
mots. Sans doute ce serait une ineptie que de marquer d'un accent
toutes les syllabes
longues, la plupart se reconnaissant facilement pour telles par la
nature même du
mot qu'on écrit ; mais quelquefois cet accent est nécessaire lorsque
la même lettre
donne lieu à un sens différent, selon qu'elle est brève ou longue, comme dans
malus, où l'accent indique s'il s'agit d'un arbre ou
d'un homme
méchant, et dans palus, qui a deux significations, suivant que la
première ou la
seconde syllabe est longue ; et comme la même lettre est brève au
nominatif et
longue à l'ablatif, cette marque est ordinairement nécessaire pour
indiquer si c'est
l'un ou l'autre qu'il faut entendre. C'est par la même raison que des grammairiens voulaient qu'on
distinguât les
verbes composés de la préposition ex, et qui commencent par une s,
d'avec ceux
qui commencent par un p, comme specto et pecto, en écrivant
exspecto
et expecto,
l'un avec une s et l'autre sans s. Beaucoup ont observé aussi d'écrire
ad, quand il est
préposition, avec un d, et,
quand il est conjonction, avec un t ; ou encore d'écrire
quum par
quom, quand il
marque le temps ; par un c, suivi
33 de um quand il est préposition, et autres minuties plus insipides encore, comme d'écrire
quidquid avec un c à la
quatrième lettre, quicquid, de peur qu'on ait l'air de faire une
double interrogation ; et
quotidie au lieu de cotidie, comme plus conforme à quot diebus. Mais
tout cela est
aujourd'hui abandonné de ceux mêmes qui se complaisaient dans ces
sortes de
puérilités. On demande souvent si, en écrivant, il convient de conserver le
son que rendent
les prépositions quand elles sont jointes à un mot, ou celui qui
leur est propre quand
elles sont isolées, comme dans le mot obtinuit, où la raison demande
un b à la
seconde lettre, quoique l'oreille entende plutôt le son du p, et
dans le mot inmunis, où cette n, qui est la lettre véritable, se trouvant surmontée
par le son de la
syllabe suivante, se change en une double m. Il faut aussi prendre garde, quand on est obligé de partager les
mots, si la
consonne du milieu appartient à la syllabe qui précède, ou à celle
qui suit. Ainsi,
dans haruspex, la dernière partie de ce mot venant du verbe
spectare, la lettre s
appartient à la troisième syllabe, et dans abstemius, mot composé de
abstinentia temeti, abstinence de vin, la lettre s sera laissée à la première
syllabe. Quant au k, je crois qu'on ne doit jamais s'en servir, si ce
n'est lorsqu'étant seul
il signifie tout un mot. Je fais cette remarque parce qu'il y a des
gens qui se
persuadent que cette lettre est nécessaire toutes les fois qu'elle
est suivie d'un a,
quoique nous ayons la lettre c, qui communique sa force à toutes les
voyelles. Au reste, l'orthographe est aussi soumise à l'usage,
et c'est pour cela qu'elle a souvent changé. Car je ne parle pas de
ces temps reculés où la langue n'avait qu'un petit nombre de
lettres, qui même différaient encore de celles d'aujourd'hui pour la
forme et pour la valeur, comme la lettre o, qui, chez les grecs
ainsi que chez nous, est tantôt brève, et quelquefois est employée
pour la syllabe qu'elle exprime par son nom : ne savons-nous pas que les anciens Latins terminaient plusieurs
mots par un d,
comme on le voit encore sur la colonne rostrale élevée à Duillius
dans le forum. Ils
en terminaient d'autres par un g, comme nous le voyons aussi sur
l'autel du Soleil,
près le temple de Quirinus, où on lit uesperug pour uesperugo. Il est inutile encore de répéter ici ce que j'ai dit de
certaines lettres qu'ils
changeaient en d'autres ; car probablement ils parlaient comme ils
écrivaient. Il a été longtemps fort en usage de ne pas doubler les demi-voyelles
; et au
contraire, jusqu'au temps d'Accius et par-delà, on écrivait les
syllabes longues en
doublant, comme je l'ai dit, les voyelles. On a conservé plus longtemps encore celui de joindre l'e et
l'i, et de s'en servir
comme les grecs se servent de ει. On a même
établi des règles pour marquer les cas et les nombres où cette
jonction avait lieu, comme on le voit dans Lucilius :
Jam pueri uenere : E postremum facito, atque i,
ut pueri plures fiant.
et ailleurs :
Mendaci furique addes E, quum dare furi
Jusseris.
Mais cela me paraît superflu, parce que l'i est aussi bien long
que bref de sa
nature ; et même cela peut avoir quelquefois de l'inconvénient. En
effet, dans les
mots qui ont un e pour pénultième et qui se terminent par un
i long,
si on adoptait
cette manière, il faudrait dire aureei, argenteei, etc., ce qui serait fort embarrassant pour ceux
34 qui apprennent à
lire. C'est ce qui
arrive aux grecs par l'addition de la lettre i qu'ils mettent non
seulement à la fin des
datifs, mais quelquefois au milieu même du mot, comme dans
ΛΗΙΣΤΗΙ
parce
que cette interposition est nécessaire pour faire ressortir
l'étymologie en divisant les
syllabes. Quant à leur diphtongue αι, dont nous avons changé la seconde
lettre en
e, les anciens en variaient la prononciation par a et i, les uns
toujours à la manière
des grecs, les autres seulement au singulier, pour le génitif et le
datif. De là vient
qu'on trouve dans Virgile, qui était passionné pour l'antiquité,
pictaï uestis et aquaï ; mais au pluriel des mêmes noms ils mettaient un e au milieu de
l'i, et disaient hi Galbae, Syllae. Nous avons là-dessus un précepte de Lucilius, que je
ne rapporte
pas parce qu'il est trop longuement développé, mais qu'on peut lire
dans son
neuvième livre.
Mais sans remonter si haut, du temps de Cicéron, et même un peu
après,
n'était-on pas dans l'usage de doubler la lettre s, soit qu'elle fût
entre deux voyelles
longues, soit qu'elle en fût précédée, comme caussae, cassus,
diuissiones ? C'est
ainsi que cet orateur et même Virgile écrivaient : leurs manuscrits
autographes en
font foi. Or, un peu avant eux, le mot iussi, que nous écrivons avec deux
s, ne s'écrivait
qu'avec une. On tient que c'est dans une inscription de C. César
qu'on a commencé
à écrire optimus, maximus, au lieu d'optumus,
maxumus. Nous disons maintenant here, et je lis dans nos anciens
comiques heri ad me
uenit ; et même dans des lettres qu'Auguste a écrites ou corrigées de
sa main, on
trouve aussi heri. Caton le Censeur n'écrivait jamais
dicam, faciam, mais dice facie, et il modifiait
ainsi, dans les autres verbes, les temps qui ont cette terminaison.
On peut le voir
dans les anciens livres qui nous restent de lui ; et Messala en a
fait l'objet d'une
remarque dans son traité sur la lettre s. On trouve dans beaucoup de livres
sibe et quase ; mais peut-être
était-ce
l'intention des auteurs. Pédianus m'apprend que Tite-Live écrivait
ainsi, et lui-même
a suivi Tite-Live. Nous terminons maintenant ces mots par un i.
Que dirai-je de uortices, uorsus, et autres mots semblables,
dans lesquels
Scipion l'Africain passe pour avoir le premier changé l'e en o
? Nos maîtres, dans mon enfance, écrivaient
ceruos et seruos par
un u et un o,
parce que deux mêmes voyelles, à la suite l'une de l'autre, ne
pouvaient se réunir et
se confondre en un même son. Maintenant ces mots s'écrivent avec un
double u,
comme on vient de le voir ; mais ni l'une ni l'autre de ces deux
manières ne rend le
son que nous voudrions exprimer ; et ce n'était pas à tort que
Claudius employait,
pour ce cas, le digamma éolien. Une réforme que nous avons eu raison de faire, c'est d'écrire
cui au datif avec
les trois lettres dont je me sers ici, au lieu de quoi, si épais à
prononcer, et qu'on
écrivait ainsi dans mon enfance, pour le distinguer du nominatif
qui.
Que dire enfin de ces mots qui s'écrivent autrement
qu'ils ne se prononcent ? Par exemple, la lettre majuscule C signifie
Gaius, et cette même lettre renversée désigne une femme ; car on voit
par nos cérémonies nuptiales que ce nom se donnait aux femmes comme
aux hommes. Gnaeus ne répond nullement, pour la prononciation, à la lettre
dont on se sert
pour indiquer ce prénom. 35
Nous lisons columa pour columna, et coss.
avec deux s
pour consules ; enfin quand on veut écrire Subura en abrégé, la
troisième lettre est
un C. Je pourrais rapporter beaucoup d'autres exemples de ce genre,
mais je
craindrais d'excéder les bornes dans une question aussi peu
importante. C'est au grammairien à interposer son jugement, qui, en tout
ceci, est la
meilleure autorité.
Pour moi, j'estime qu'à moins que l'usage n'en
ait autrement
ordonné, tous les mots doivent s'écrire comme ils se prononcent. Car les lettres servent à conserver les paroles, et à les
rendre comme un dépôt
au lecteur. Elles doivent donc exprimer ce que nous dirions.
Voilà à peu près tout ce qui constitue l'art de parler et
d'écrire correctement.
Quant aux deux autres parties, qui consistent dans la clarté et
l'ornement, je ne les
ôte pas au grammairien ; mais comme il me reste à parler des
fonctions du rhéteur, je
les réserve pour une place plus importante.
Il me revient encore à l'esprit que quelques personnes pourront
regarder ce que
je viens de dire comme peu digne d'attention, et de nature même à
nuire à des
études d'un ordre plus relevé. Je leur réponds que moi-même je ne
crois pas qu'on
doive porter le scrupule à l'excès, et descendre à de misérables
minuties, qui ne
sont bonnes qu'à appauvrir et rapetisser l'esprit ; mais je crois en même temps que, dans la grammaire, il n'y a de
nuisible que ce
qui est superflu. Cicéron a-t-il été moins grand orateur pour avoir
approfondi cette
science, et pour avoir été envers son fils un censeur rigoureux du
langage, ainsi
qu'on le voit dans ses lettres ? Les livres publiés par César sur
l'analogie ont-ils ôté
quelque chose à la vigueur de son génie ? Messala est-il un écrivain moins brillant pour avoir composé
des traités entiers,
non seulement sur les mots en particulier, mais même sur les
lettres ? ces
connaissances ne nuisent pas à ceux qui les traversent pour aller
plus loin, mais à
ceux qui s'y arrêtent.
CHAP. VIII. Reste la lecture. Elle a pour objet d'apprendre à l'enfant quand
il doit s'arrêter
pour reprendre haleine, où le vers se partage, où le sens finit, où
il commence,
quand il faut élever ou abaisser la voix, ce qui doit être prononcé
avec une inflexion
lente ou rapide, douce ou animée : ce qui ne peut guère se démontrer
que dans la
pratique. Or, je n'ai qu'une chose à recommander à cet égard
: pour bien
faire tout cela,
qu'il comprenne bien ce qu'il lit. Qu'il s'accoutume surtout à lire
d'un ton mâle, qui ait
à la fois de la gravité et de la douceur. Et puisque ce sont des
vers, et que les
poètes disent eux-mêmes qu'ils chantent, le ton ne doit pas être le
même que pour
la prose, sans dégénérer pourtant en une modulation languissante et
efféminée ; défaut presque général aujourd'hui, et qui donna
occasion à un bon mot de C. César, lorsqu'il portait encore la robe
prétexte : Si vous chantez,
disait-il, vous
chantez mal ; si vous prétendez lire, vous chantez. Je ne suis pas non plus de l'avis de certaines personnes qui
veulent qu'on lise
les prosopopées sur le ton d'un comédien ; seulement, une certaine
inflexion est
nécessaire pour les distinguer des endroits où le poète parle
lui-même.
La lecture, sous les autres rapports, réclame des préceptes plus
sérieux.
D'abord, comme les impressions ne sont jamais plus profondes qu'à
l'âge où l'on
ignore tout, l'âme tendre des enfants exige qu'on ne regarde pas
moins à l'honnêteté
36
qu'à l'éloquence dans le choix des livres ; et c'est fort sagement qu'on fait commencer la lecture par
Homère et Virgile,
quoique, pour comprendre les beautés de ces deux poètes, il faille
un jugement plus
formé ; mais il reste du temps pour cela, et ils ne les liront pas
qu'une fois. En
attendant, la sublimité du poème héroïque élèvera leur âme, la
grandeur du sujet
excitera leur enthousiasme, et cette lecture jettera en eux les
semences du beau et
du bon.
La lecture des tragiques est utile ; celle des lyriques nourrit
aussi l'esprit, pourvu
néanmoins que, pour ceux-ci, on fasse un choix, non seulement parmi
les auteurs,
mais encore dans leurs ouvrages. Car les grecs sont souvent
licencieux, et il y a des
endroits dans Horace que je ne voudrais pas expliquer. Quant à
l'élégie, qui ne roule
que sur l'amour, et aux hendécasyllabes, où il y a des bouts de vers
sotadéens (car
pour les vers sotadéens purs et simples, il ne faut pas même en
faire mention), c'est
un devoir d'en préserver les enfants, s'il est possible, ou au moins
d'en différer la
lecture jusqu'à un âge plus avancé. À l'égard de la comédie, qui, par la peinture générale des
hommes et des
passions, peut être d'un grand secours par l'éloquence, je dirai
bientôt, et en son
lieu, l'usage que, selon moi, on doit en faire avec les enfants. En
effet, dès qu'il n'y
aura plus lieu de craindre pour les mœurs, la comédie devra faire
leur principale
lecture. Je veux parler de Ménandre, sans toutefois exclure les autres
;
car les comiques
latins ne seront pas non plus sans utilité. Mais il faut commencer
par ce qui peut
nourrir l'esprit et élever l'âme des enfants ; pour le reste,
c'est-à-dire pour ce qui ne
regarde que l'érudition, ils auront assez de temps devant eux.
La
lecture des anciens
poètes latins sera aussi d'un grand secours, quoique pour la plupart
ils aient plus
d'esprit que d'art. L'élocution peut surtout s'y enrichir, et puiser
dans la tragédie la
gravité, dans la comédie l'élégance, et partout une sorte
d'atticisme. L'économie y est aussi plus soignée que dans la plupart des
modernes, qui font
consister tout le mérite des ouvrages de l'esprit dans les pensées.
C'est chez eux
surtout qu'il faut aller chercher cette chasteté, et, pour ainsi
dire, cette virilité que
nous ne connaissons plus, aujourd'hui que les raffinements d'une
fausse délicatesse
ont gagné jusqu'à l'éloquence. Enfin croyons-en les grands orateurs, qui, pour le succès de
leurs causes ou
l'ornement de leurs discours, ont fait des emprunts aux poèmes des
anciens. Ne voyons-nous pas, en effet, Cicéron surtout, et souvent même Asinius et les
autres orateurs qui touchent à la même époque, citer des vers
d'Ennius, d'Accius, de
Pacuvius, de Lucilius, de Térence, de Cécilius, etc., et recueillir
le double avantage de laisser, pour ainsi dire, respirer l'oreille
fatiguée de l'âpreté du style judiciaire, et, indépendamment
du charme de la poésie, d'apporter à l'appui de leurs propositions
les pensées de ces poètes, comme des espèces de témoignages ? Au
surplus, ce qui regarde les enfants est ce que j'ai dit d'abord
; ce
que je viens de dire s'adresse à un âge plus avancé, car l'amour des
lettres et le goût de la lecture ne sont point limités au temps des
classes : ils n'ont de bornes que celles de la vie.
Il est de petits soins que le grammairien ne doit pas négliger
dans la première
explication des poètes, comme d'exiger que l'enfant fasse l'analyse
des parties du
discours en décomposant le vers, et remarque les propriétés du
nombre, dont la
con- 37
naissance est d'autant plus nécessaire dans la versification,
qu'elle se fait désirer
même dans la composition oratoire ; de lui faire observer ce qui est barbare, impropre, ou
contraire aux règles du
langage ; non pour en faire un reproche aux poètes, qui, obligés la
plupart du temps
de s'asservir à la mesure, ont droit à l'indulgence, et dont nous
déguisons les
défauts, comme je l'ai déjà dit, sous des noms honorables,
attribuant en quelque
sorte à la nécessité le mérite de la vertu ; mais pour familiariser
l'enfant avec les
termes de l'art et pour exercer sa mémoire. Il ne sera pas inutile non plus de lui enseigner, parmi les
premiers éléments, de
combien d'acceptions les mots sont susceptibles. À l'égard de la
glose, c'est-à-dire
de l'interprétation des mots peu usités, le grammairien ne devra pas
la regarder
comme une chose indifférente. Mais ce qu'il devra enseigner plus scrupuleusement encore, ce
sont les tropes,
qui sont un des principaux ornements de la prose comme de la poésie,
et ce qu'on
appelle figures de mot et figures de pensée. Je remets à parler de
ces figures, ainsi
que des tropes, lorsque je traiterai des ornements du discours.
Enfin, ce qu'un grammairien doit surtout s'appliquer à faire
remarquer à son
élève, c'est l'art avec lequel toutes les parties du poème sont
distribuées, et la
convenance observée soit par rapport aux choses, soit par rapport
aux personnes ;
c'est la beauté des pensées et des expressions, les endroits où
l'écrivain a été tantôt
abondant, tantôt sobre, selon la circonstance.
À cela se joindra l'explication des traits tirés de l'histoire
ou de la fable, qu'il faut
sans doute traiter avec soin, mais sans la surcharger de
superfluités. Il suffit
d'exposer ce qui est généralement reçu, ou du moins ce qui est
rapporté par des
auteurs célèbres. S'attacher à tout ce qui a été dit par de
misérables écrivains serait
un excès d'ineptie ou une vaine parade d'érudition, outre que cela
embarrasse et
surcharge l'esprit, et fait perdre un temps qu'on emploierait plus
utilement à autre
chose. Quiconque serait curieux d'étudier toutes ces rhapsodies,
indignes d'être lues,
pourrait aussi trouver de quoi s'instruire dans les contes de
vieilles femmes.
Cependant les cahiers des grammairiens sont remplis d'un pareil
fatras, et à peine
peuvent-ils se reconnaître dans leur propre travail. On sait ce qui arriva à Didyme, qui poussa si loin la manie des
compilations : on
racontait devant lui une histoire à laquelle il refusait d'ajouter
foi : pour le convaincre,
on lui présenta un livre de lui, qui la contenait. Mais c'est surtout dans les récits fabuleux que cet abus va
jusqu'au ridicule, et
même jusqu'à l'effronterie. Comme alors la fiction peut se donner
carrière, rien
n'arrête un grammairien sans conscience ; il va jusqu'à supposer des
livres entiers,
des auteurs, au gré de son imagination ; et il peut mentir en toute
sûreté, bien certain
qu'on ne le convaincra pas d'imposture sur ce qui n'exista jamais,
tandis que sur des
choses véritables on s'expose à être relevé par les érudits. Je mets
donc au rang
des qualités d'un grammairien d'ignorer certaines choses.
CHAP. IX. Nous avons terminé les deux parties qui composent tout
l'enseignement
grammatical, c'est-à-dire l'art de parler correctement, et
l'explication des auteurs. La
première est appelée méthodique, et la seconde historique. Les
grammairiens
devront y joindre cependant quelques éléments de composition,
propres à exercer
les enfants à l'âge où ils ne sont point encore en état de suivre
les leçons du rhéteur. On leur apprendra
38 donc à raconter de vive voix dans un langage
correct et
simple les fables d'Ésope, qui viennent après les contes des
nourrices, et à les écrire
ensuite avec soin, en conservant la même simplicité : ce qui consiste
premièrement à
rompre le vers, puis à le traduire en d'autres mots, et enfin à le
paraphraser avec
plus de hardiesse, tantôt en abrégeant, tantôt en amplifiant, mais
en conservant
toutefois le sens du poète. L'enfant qui s'acquittera comme il faut de ce travail, qui a ses
difficultés même
pour des professeurs consommés, ne peut manquer de réussir à tout
autre.
C'est
encore près du grammairien que l'enfant s'exercera à traiter ces
petites matières de
composition appelées sentences, chries, éthologies, dont la lecture
fournit
l'occasion, et qui consistent dans certaines paroles remarquables,
dont il faut rendre
raison. L'art de tous ces développements est le même au fond, et ne
diffère que par
la forme. La sentence est une proposition générale ; l'éthologie se
renferme dans les
personnes. Quant aux chries on en reconnaît de plusieurs sortes
: la première, comme la sentence, consiste dans un simple mot : il disait, ou il avait
coutume de dire, etc. ; la seconde a pour objet une réponse : interrogé pourquoi, ou comme on
lui demandait
pourquoi, il répondit, etc. ; la troisième, qui diffère peu de
la seconde, a trait, non à une question, mais à une action. On
pense que la chrie peut consister dans l'action seule de celui dont
on la rapporte, par exemple : Cratès ayant vu un enfant ignorant, se mit à
battre le
précepteur ; et cette autre à peu près semblable, qu'on n'ose
pourtant pas appeler du
même nom, mais qu'on exprime par celui de chriose : Milon s'étant
habitué à porter
tous les jours le même veau, finit par porter un taureau. Dans tous
ces exemples, les
déclinaisons passent par les mêmes cas, et on peut rendre également
raison des
actions et des paroles. Quant aux petits traits historiques ou fabuleux, si fréquents
chez les poètes, il ne
faut s'y arrêter que pour les faire connaître, et non par rapport à
l'éloquence. Il y a
d'autres exercices plus importants et de plus longue haleine, que
les rhéteurs latins
ont abandonnés, et qui par là sont devenus nécessairement le partage
des
grammairiens. Les grecs connaissent mieux la gravité et la mesure de
leurs devoirs.
CHAP. X. Voilà ce que j'avais à dire sur la grammaire. Je l'ai fait le
plus brièvement
possible, n'ayant pas prétendu épuiser la matière, ce qui serait
infini, mais seulement
exposer ce qu'il y a de plus essentiel. Je vais maintenant ajouter
un mot sur les
autres arts dont je crois la connaissance utile aux enfants avant
qu'ils ne passent
entre les mains du rhéteur, afin de parcourir le cercle de science
que les grecs
appellent encyclopédie, ἐγκύκλιον παιδείαν. C'est en effet, à peu près dans le même temps qu'on associe
d'autres études à
celle des lettres ; et comme ces études ont pour objet des arts
particuliers, qui ne
peuvent être perfectionnés sans l'art oratoire, et que d'un autre
côté ces arts ne
peuvent suffire seuls à former l'orateur, on demande si l'étude de
ces arts lui est
nécessaire, en tant qu'il s'agit de l'orateur.
À quoi sert, dit-on, pour plaider une cause ou pour exprimer son
avis, de savoir
comment dans une ligne donnée on peut tracer des triangles
équilatéraux ? En quoi
défendra-t-on mieux un accusé, ou traitera-t-on mieux une
délibération, parce qu'on
saura distinguer les noms d'un instrument par leurs noms et leurs
intervalles ? On citera même des orateurs, et peut-être en grand
39
nombre, qui
ont été très
utiles au barreau sans avoir jamais entendu parler de géométrie, ni
connu la
musique autrement que par le plaisir sensible qu'elle cause à tout
le monde.
À cela
je répondrai d'abord ce que Cicéron déclare si souvent dans le
traité qu'il a adressé
à Brutus, que je ne prétends pas former un orateur sur le modèle de
ceux qui
existent ou qui ont existé, mais d'après le type idéal d'un orateur
parfait et accompli
sous tous les rapports. Quand les philosophes veulent former un sage, destiné à être un
jour le type de
la perfection, et qui soit, comme ils le disent, un dieu revêtu d'un
corps mortel ; non
contents de l'initier aux sciences divines et humaines, ils le font
passer par certaines
épreuves intellectuelles qui, considérées en elles-mêmes, sont assez
misérables,
telles, par exemple, que les cératines et les crocodilines. Ce n'est
pas que ces
arguments d'une ambiguïté recherchée puissent jamais faire un sage
;
mais c'est
qu'un sage doit être infaillible jusque dans les plus petites
choses. De même l'orateur, qui, lui aussi, doit être un sage, ne
deviendra pas tel parce
qu'il saura la géométrie ou la musique, ou parce qu'il possédera les
autres
connaissances dont je parlerai après celle-ci ; mais tout cela ne
laissera pas de
l'aider à s'élever à la perfection. C'est ainsi que l'antidote et
les autres remèdes
préparés contre les maladies et les blessures se composent de
plusieurs
substances, qui même, prises séparément, produisent des effets
contraires, dont la
variété forme une mixtion qui n'a plus de rapport avec aucun de ses
éléments, et qui
tire une vertu particulière de leur ensemble ; c'est ainsi que
des insectes dépourvus d'intelligence composent du suc de
différentes fleurs un miel dont toute l'industrie humaine ne saurait
imiter la saveur. Et nous nous étonnerons que l'éloquence, ce don
par excellence que la Providence a fait à l'homme, réclame
l'assistance de plusieurs arts, qui, sans se manifester ouvertement
dans le discours, lui communiquent cependant une force secrète, qui
ne laisse pas de se faire sentir confusément ! Un tel, dira-t-on,
est devenu disert sans tout cela ? Mais c'est
un orateur que je
demande. Cela n'ajoute pas beaucoup à l'art. Mais un tout n'est
complet qu'autant
qu'il n'y manque pas la moindre partie, et il est certain qu'il n'y
a de perfection qu'à
cette condition. Que si cette perfection est placée à une hauteur
qui semble
inaccessible, nous n'en devons pas moins demander tout, pour en
obtenir le plus
possible. Mais pourquoi nous découragerions-nous ? La nature ne
s'oppose pas à ce
qu'il y ait un orateur parfait, et il est honteux de désespérer de
ce qui est possible.
Je pourrais m'en tenir ici au jugement des anciens. Qui ignore,
en effet, que la
musique, pour parler d'abord de cet art, était, dans l'antiquité,
non seulement
cultivée, mais en si haute vénération qu'Orphée et Linus entre
autres étaient
indistinctement appelés musiciens, poètes et sages ? N'a-t-on pas cru
qu'ils étaient
tous deux de la race des dieux, et que le premier attirait à lui non
seulement les
bêtes féroces, mais jusqu'aux rochers et aux forêts, parce qu'il
adoucissait les mœurs d'une multitude ignorante et sauvage ? Timagène avance que de tous les arts littéraires, la musique
est le plus ancien ;
et si nous en croyons le témoignage des poètes les plus célèbres,
c'était l'usage de
chanter sur la lyre, à la table des rois, les louanges des héros et
des dieux. Iopas,
dans Virgile, ne chante-t-il pas la lune errante et les phases
laborieuses du soleil ?
Par où ce grand poète nous confirme manifeste-
40 ment que la musique est
inséparable
de la connaissance des choses divines, ce qu'on ne peut
admettre sans reconnaître en même temps qu'elle est nécessaire à
l'orateur, puisque, ainsi que nous l'avons dit, cette partie,
abandonnée par les orateurs, et dont les philosophes se sont
emparés, fut toujours de notre ressort, et que l'éloquence ne
saurait être parfaite sans elle.
Qui peut douter que les
hommes les plus renommés par leur sagesse n'aient été passionnés
pour la musique, lorsqu'on voit Pythagore et ses disciples répandre
l'opinion, accréditée sans doute de toute antiquité, que le monde
lui-même avait été créé selon les lois de la musique, et que la lyre
avait été depuis formée à l'imitation du système planétaire ? Et
même, non contents de l'idée de cette concorde entre des choses
contraires, qu'ils appellent harmonie, ils prêtaient encore des sons
aux mouvements des sphères célestes. Platon lui-même, dans quelques-uns de ses écrits, et notamment
dans le
Timée, n'est intelligible que pour ceux qui ont fait une étude
approfondie de cette
partie de la science.
Mais que parlé-je des philosophes ? Le père de
la philosophie,
Socrate, a-t-il rougi, dans sa vieillesse, de prendre des leçons de
lyre ? L'histoire nous apprend que les plus grands capitaines jouaient
de la lyre et de
la flûte, et que les armées des Lacédémoniens s'enflammaient aux
accents de la
musique. Les clairons et les trompettes de nos légions ne
produisent-ils pas le
même effet ? La supériorité des armes romaines semble être en rapport
avec la
véhémence de leurs accents. C'est donc avec raison que Platon a cru que la musique était
nécessaire à
l'homme public que les grecs appellent πολιτικόν. Les chefs mêmes
de cette
secte, qui paraît aux uns si sévère, aux autres si dure, ont été
d'avis que quelques
sages pouvaient accorder quelque chose à cette étude ; et Lycurgue,
cet austère
législateur de Sparte, a approuvé l'enseignement de la musique. La nature elle-même semble nous en avoir fait présent pour nous
aider à
supporter plus facilement nos peines. C'est le chant qui encourage
le rameur ; et non
seulement le chant d'une voix agréable anime un travail commun et
semble y
présider, mais chacun isolément charme son labeur en modulant
quelque air de sa
façon. Mais je m'oublie dans l'éloge d'un très bel art, sans en
démontrer les rapports
avec l'éloquence. Je passe donc rapidement aussi sur l'alliance qui
existait autrefois
entre la grammaire et la musique. Elle était telle qu'Archytas et
Euenus considéraient
la grammaire comme une partie de la musique. C'étaient aussi les
mêmes maîtres
qui enseignaient l'une et l'autre, comme on le voit dans Sophron, ce
poète mimique
si goûté de Platon, qu'on trouva, dit-on, ses livres sous le chevet
du lit de ce
philosophe lorsqu'il mourut. Dans les comédies d'Eupolis, un certain Prodamus enseigne à la
fois la
musique et les lettres ; et Maricas, c'est-à-dire Hyperbolus, avoue
que de toutes les
parties de la musique, il ne connaît que la grammaire. Aristophane
témoigne en plus
d'un endroit qu'autrefois la musique faisait partie de l'éducation
des enfants ; et dans
l'Hypobolomaeos de Ménandre, un vieillard opposant à un père, qui
lui redemande
son fils, le remboursement de ses dépenses, dit qu'il lui en a coûté
beaucoup en
maîtres de musique et en géomètres. C'est de là qu'était venu l'usage de se passer la lyre à la fin
41
des repas.
Thémistocle, ayant confessé qu'il n'en savait pas jouer, passa pour
ignorant, suivant
les propres expressions de Cicéron. La lyre et la flûte égayaient aussi les repas des anciens
Romains. Les vers des
Saliens n'ont-ils pas leur chant ? Or ces vers et leur musique
remontent au roi Numa :
ce qui fait voir que nos ancêtres, quoique grossiers et uniquement
adonnés à la
guerre, ne laissaient pas de cultiver la musique, autant que le
comportaient ces
premiers temps. Enfin il est passé en proverbe chez les grecs que
les ignorants
n'ont commerce
ni avec les Muses ni avec les Grâces.
Examinons maintenant l'utilité particulière que l'orateur peut
retirer de la
musique. La musique a deux sortes de nombres, les uns pour la voix,
les autres
pour le corps : car il faut que les mouvements de l'une et de l'autre
soient réglés. Le
musicien Aristoxène divise ce qui regarde la voix en rythme et en
mélodie cadencée.
Le premier consiste dans la modulation, l'autre dans le chant et les
sons. Or, tout
cela n'est-il pas nécessaire à l'orateur ? Le rythme du corps se
rapporte au geste, le
rythme de la voix à l'arrangement des mots, la mélodie aux
inflexions de la voix, qui
varient à l'infini dans le discours, à moins qu'on ne s'imagine qu'il n'y a que les vers et les
chansons qui soient
susceptibles de rythme et d'harmonie, et que tout cela est superflu
pour l'orateur ; ou
que celui-ci ne varie pas sa diction et sa prononciation, suivant
les sujets qu'il traite,
aussi bien que le musicien. Car de même que le musicien, fidèle aux lois du chant et de la
modulation,
exprime tour à tour avec élévation, avec douceur, avec calme, les
sentiments
nobles, agréables ou modérés, et s'applique à bien peindre les
sentiments
renfermés dans les paroles ; de même l'orateur, selon qu'il élève ou abaisse la voix,
suivant les inflexions
qu'il lui donne, remue différemment l'âme des auditeurs ; et, pour me
servir des mots
de la définition qui précède, nous varions la modulation de la
phrase et de la voix
selon que nous voulons exciter l'indignation ou la pitié des juges.
Qui pourrait nier
ces effets de l'éloquence, quand on voit que des instruments
inanimés, qui ne
peuvent exprimer la parole, produisent cependant sur l'âme des
impressions si
différentes ?
La convenance dans les mouvements du corps, que les grecs
appellent
εὐρυθμία, est également nécessaire ; et c'est encore à la musique
qu'il faut
emprunter cette partie de l'action, qui n'est pas la moins
importante, et dont je
parlerai en son lieu. Si enfin il est vrai que l'orateur doive prendre un soin
particulier de sa voix, quoi
de plus essentiel à la musique ? Mais, sans anticiper sur ce sujet,
contentons-nous
pour le moment d'un seul exemple, de celui de C. Gracchus, le plus
grand orateur de
son temps. Toutes les fois qu'il parlait en public, un musicien se
tenait derrière lui, et,
sur une flûte appelée τονάριον, lui donnait le ton qu'il devait
prendre. II eut toujours cette attention au milieu de ses harangues les
plus turbulentes,
alors qu'il était la terreur des patriciens, et même alors qu'il les
craignait.
Pour mettre
certaines personnes, tout à fait étrangères au commerce des Muses,
en état
d'apprécier l'utilité de la musique, je veux me servir d'une preuve
qui leur ôtera
jusqu'au moindre doute. Elles m'accorderont certainement que l'orateur doit lire les
poètes. Or, comment
le pourra-t-il sans la musique ? Que si l'on est assez aveugle pour
contester cette
vérité à l'égard des poètes en général, au moins sera-t-on forcé de
la reconnaître à
l'égard des poètes lyriques. Je m'é-
42 tendrais davantage sur cette
matière, si c'était
une nouveauté que je voulusse introduire. Mais comme l'étude de la musique est consacrée de toute
antiquité, depuis
Chiron et Achille jusqu'à nous, par tous ceux qui tiennent compte de
la tradition et de
l'autorité, je dois me garder de rendre cette vérité douteuse par
trop de sollicitude à
la défendre.
Quoique j'aie assez fait connaître, ce me semble, par les
exemples que j'ai
cités, quelle est la musique que j'approuve, et jusqu'à quel point
je l'approuve, je
crois pourtant devoir déclarer ouvertement que je recommande, non
cette musique
efféminée qui ne fait entendre aujourd'hui sur nos théâtres que des
sons lascifs et
languissants, et qui n'a pas peu contribué à détruire ce qui pouvait
nous rester de
mâle vigueur, mais cette musique qui célébrait les louanges des
héros, et que les
héros eux-mêmes chantaient ; non ces instruments, tels que le luth et
le spadix, que
les jeunes filles elles-mêmes devraient s'interdire ; mais la
connaissance des moyens
que la musique emploie pour émouvoir ou apaiser les passions. C'est ainsi que Pythagore, dit-on, voyant des jeunes gens prêts
à forcer une
maison respectable, calma leur fureur en ordonnant à la musicienne
de jouer sur un
ton plus grave. Chrysippe assigne un air particulier aux nourrices
pour allaiter les
enfants ; il y a dans les écoles un sujet de déclamation assez ingénieux.
On suppose
qu'un joueur de flûte a fait entendre le mode phrygien pendant un
sacrifice ; le prêtre
devient fou, et s'élance dans un précipice ; le musicien est accusé
comme auteur de
sa mort. Que si un orateur, ayant à plaider une cause de cette
espèce, ne peut le
faire sans connaître la musique, comment donc ne pas demeurer
d'accord que cet
art entre nécessairement dans mon dessein, quelque prévenu qu'on
soit du
contraire ?
On convient qu'il y a une partie de la géométrie qui est utile
à l'enfance ; qu'elle
donne de l'activité à l'esprit, qu'elle l'aiguise, et qu'elle rend
par là la conception plus
prompte ; mais on veut qu'à la différence des autres sciences qui
sont utiles quand
on les a acquises, la géométrie ne serve à quelque chose que dans le
temps qu'on
l'apprend. Voilà l'opinion du vulgaire. Mais ce n'est pas sans raison que
de grands
hommes ont fait une étude particulière de cette science. En effet,
la géométrie traite
des nombres et des dimensions : or la connaissance des nombres n'est
pas
seulement nécessaire à l'orateur, mais à quiconque a la moindre
teinture des lettres.
Elle trouve très fréquemment sa place dans les plaidoiries ; et un
avocat qui hésite
sur un produit, ou qui seulement montre de l'incertitude ou de la
gaucherie en
comptant sur ses doigts, donne une mauvaise idée de son habileté. Quant à la partie linéaire, souvent aussi elle trouve son
application dans les
causes, car on a tous les jours des procès sur les limites et sur
les mesures ; mais la
géométrie a, sous un autre rapport, une affinité plus intime avec
l'art oratoire.
Et d'abord, l'ordre est de l'essence de la géométrie
: n'en
est-il pas de même de
l'éloquence ? La géométrie prouve les conséquences par les prémisses,
et l'incertain
par le certain : n'est-ce pas ce que nous faisons dans le discours
?
La plupart des
problèmes, en géométrie, ne se résolvent-ils pas uniquement par le
syllogisme, ce
qui fait qu'en général on lui trouve plus d'analogie avec la
dialectique qu'avec la
rhétorique ? Il est
43 vrai que l'orateur se sert peu de la dialectique
; mais il en use pourtant ; car il emploie, au besoin, le
syllogisme, ou, à coup sûr,
l'enthymème, qui est le syllogisme de la rhétorique. Enfin, les
preuves les plus
puissantes sont celles qu'on appelle vulgairement preuves
géométriques,
γραμμικαὶ ἀποδείξες : et quelle est la fin principale de
l'éloquence, si ce n'est
de prouver ?
La géométrie découvre aussi, par le calcul, le faux dans le
vraisemblable : par
exemple, en fait de nombres, elle fait voir l'erreur de certaines
propositions appelées
ψευδογραφίας, qui, de mon temps, servaient d'amusement à
l'enfance. Mais
prenons pour exemples des questions plus sérieuses. Qui ne croirait
à l'exactitude
de cette proposition : Soient donnés deux lieux dont la circonférence
est égale, ils
contiendront le même espace. Cependant cela est faux, car il importe beaucoup de savoir
quelle est la forme
du contour ; et des historiens ont été repris par les géomètres, pour
avoir cru que la
dimension des îles était suffisamment indiquée par le circuit de la
navigation. En
effet, plus une forme est parfaite, plus elle a de capacité. Si donc la circonférence figure un cercle, qui est la ligne
plane la plus parfaite,
elle contiendra un plus grand espace, que si elle formait un carré
d'une égale
circonférence. À son tour le carré en renfermera plus que le
triangle, et le triangle
équilatéral plus que le triangle à côtés inégaux. Mais ces exemples sont peut-être un peu abstraits
: je me
renfermerai dans
l'expérience commune. Presque personne n'ignore que la mesure d'un
arpent est de
deux cent quarante pieds en longueur, et de moitié en largeur ; d'où
il est aisé de
juger quel est son contour et quelle est sa surface. Mais supposons un carré de cent quatre-vingts pieds sur toutes
ses faces : il
aura la même circonférence que l'arpent, et contiendra néanmoins un
espace
beaucoup plus grand. Si l'on ne veut pas se donner la peine de faire
ce calcul, on
peut s'en convaincre en opérant sur un plus petit nombre. Dix pieds
en carré font
quarante pieds de tour et cent pieds de superficie ; mais quinze
pieds en longueur,
sur cinq en largeur ont la même circonférence, et donnent un quart
de moins en
surface ; et dix-neuf pieds de long sur un seulement de large, n'ont pas
plus en superficie
qu'ils n'ont en longueur, et cependant le contour est le même que
celui du carré, qui
contient cent pieds. Ainsi tout ce que vous ôterez à la forme du
carré sera de moins
en surface : donc il peut arriver qu'un espace soit renfermé dans un plus
grand circuit. Ceci
est pour les terrains planes ; car pour les collines et les vallées,
il est évident, même
pour l'homme étranger à la géométrie, que le sol qu'elles couvrent
est plus étendu
que l'espace aérien qu'elles embrassent.
Mais la géométrie ne s'arrête pas là
: elle s'élève jusqu'à la
connaissance des
lois du monde et, en nous démontrant par les nombres le cours réglé
et déterminé
des astres, elle nous apprend que rien n'est désordonné ni fortuit
:
ce qui peut
quelquefois être du domaine de l'orateur. Lorsque Périclès rassura les Athéniens, qu'effrayait une
éclipse de soleil, en
leur expliquant les causes de ce phénomène ; quand Sulpicius Gallus,
au milieu de
l'armée de Paul-Émile, raisonna de même sur une éclipse de lune,
afin que les
soldats n'en fussent pas épouvantés comme d'un prodige surnaturel,
l'un et l'autre
ne firent-ils pas alors l'office d'orateurs ? Si Nicias eût eu ces connaissances, il n'eût pas perdu en
Sicile la belle armée
44
d'Athéniens qu'il y commandait, par le trouble où le jeta un pareil
accident : il aurait
fait comme Dion, qu'un phénomène de cette espèce n'arrêta pas,
lorsqu'il vint
renverser la tyrannie de Denys. Mais je veux bien admettre que la
tactique soit
étrangère à la question ; je ne parlerai pas non plus d'Archimède,
qui suffit lui seul à
traîner en longueur le siège de Syracuse : du moins m'accordera-t-on une chose qui établit pertinemment ma
proposition,
que ce n'est la plupart du temps qu'à l'aide des preuves linéaires
que fournit cette
science qu'on parvient à résoudre un grand nombre de questions qui
seraient
difficilement expliquées d'une autre manière, telles que la
division, la section à l'infini,
la puissance des progressions : de sorte que si, comme je le
démontrerai dans le
livre suivant, l'orateur doit être prêt à parler sur tout, on ne
peut en aucune façon
devenir orateur sans la géométrie.
CHAP. XI. Il faut aussi accorder quelque chose à l'art du comédien, pourvu
qu'on s'en tienne
à ce que l'orateur doit savoir pour bien prononcer ; car je ne veux
pas que l'enfant
que je forme pour cette noble fin s'habitue à imiter la voix faible
et brisée des
femmes ou la voix tremblante d'un vieillard, ni à contrefaire les allures d'un ivrogne ou d'un esclave
bassement obséquieux,
ni à exprimer l'amour, l'avarice, ou la crainte : tout cela n'est pas
nécessaire à
l'orateur et ne contribue qu'à gâter le cœur, surtout à l'âge où il
est encore neuf, et
prompt à recevoir l'impression du vice ; car la fréquente imitation
passe jusque dans
les moeurs. Il ne faut pas même qu'il emprunte aux comédiens tous leurs
gestes et tous leurs
mouvements. Quoique ces deux parties de l'action doivent être,
jusqu'à un certain
point, réglées dans l'orateur, il ne laissera pas de se tenir à une
grande distance du
comédien, et d'éviter l'exagération dans le regard, dans le geste et
dans la
démarche ; car si tout cela exige un certain art, il y en a encore un
plus grand à
savoir dissimuler l'art.
Quel est donc ici le devoir du maître
? d'abord, de corriger les
vices de
prononciation, et de faire énoncer les mots de manière que chaque
lettre conserve le
son qui lui est propre. Car il y en a dont la prononciation est
difficile, parce qu'elles
sont trop grêles ou trop pleines. Quelques-unes sont trop dures, et
nous en éludons
la prononciation en les changeant en d'autres dont le son est à peu
près semblable,
mais émoussé. Ainsi à la lettre ρ, qui donnait tant d'exercice à Démosthène,
succéda
λ ; et ces deux lettres ont chez nous la même affinité entre elles.
Il en est de
même du c et du t, que nous amollissons en g et en d. Le maître ne souffrira pas non plus que l'élève s'appuie avec
complaisance sur la
lettre s, ni qu'il parle du gosier ou grossisse sa voix dans la
bouche, ni (ce qui est
tout à fait contraire à la pureté du langage) qu'il farde la nature
simple de la voix, en
prenant ce ton emphatique que les grecs appellent
καταπεπλασμένον, du nom qu'on donne au son grave que rend la flûte, lorsqu'en
bouchant les trous
destinés aux tons aigus, on ne laisse libre que l'issue directe de
l'instrument. Il aura soin aussi que les syllabes finales ne soient point
tronquées ; que le débit
se soutienne toujours également ; que, dans les exclamations,
l'effort parte des
poumons et non de la tête ; que le geste soit en harmonie avec la
voix, et le visage
avec le geste. Il recommandera à son élève de regarder en face en parlant, de
ne point tordre
ses lèvres, de ne point trop ouvrir la bouche, de ne point se tenir
le visage en l'air ou
les yeux fixés vers la terre, ni de laisser aller sa tête
45
de côté et
d'autre. Car le front pèche en bien des manières : j'ai vu beaucoup
d'orateurs qui, à
chaque effort de voix, haussaient les sourcils, d'autres qui les
fronçaient. J'en ai vu à
qui l'un montait en haut, tandis que l'autre lui couvrait l'œil
presque en entier. Tout cela est d'une conséquence infinie,
comme nous le dirons bientôt ; car rien de ce qui est contraire à la
convenance ne saurait plaire. C'est encore au comédien à
enseigner le ton qui convient à la narration, avec quelle autorité
on persuade, avec quelle impétuosité éclate la colère, quel accent
sied à la pitié. Pour bien faire, il choisira dans les comédies les
passages qui ont le plus de rapport avec le ton des plaidoiries. Ces morceaux de choix, en même temps qu'ils sont très utiles à
la
prononciation, sont très propres à nourrir l'éloquence. Voilà pour l'âge où l'intelligence ne comporte pas encore un
plus haut
enseignement ; car lorsque le temps sera venu de lire des discours,
et que l'élève
sera en état d'en apprécier les beautés, je veux qu'il soit assisté
d'un maître vigilant
et habile, qui, non content de le former à la lecture, le force à
apprendre par cœur
des passages choisis de ces discours, et à les réciter à haute voix,
comme s'il avait
véritablement à parler en public ; en sorte qu'il exerce à la fois,
par la prononciation,
son organe et sa mémoire.
Je ne désapprouve pas même qu'ils prennent quelques leçons des
maîtres de palestrique. Je n'entends pas parler de ces hommes dont une partie
de la vie se
consume dans l'huile, l'autre dans le vin, et qui abrutissent
l'esprit à force de soigner
le corps. Mon élève ne sera jamais trop éloigné de cette espèce de
gens. Mais on donne le même nom à des maîtres particuliers, auprès
desquels on
apprend à régulariser ses gestes et ses mouvements, à bien
développer ses bras, à
donner de la grâce à ses mains, de la noblesse à son attitude, à
marcher sans
gaucherie, à ne point tenir la tête et les yeux dans une autre
direction que le reste du
corps. Peut-on nier que tout cela n'entre dans la prononciation, et
que la prononciation
ne soit une partie considérable de l'art oratoire ? Il ne faut donc
pas rougir
d'apprendre ce que l'on doit pratiquer, d'autant moins que cette
chironomie, qui est,
comme l'indique son nom, la loi du geste, remonte aux temps
héroïques, et a été
approuvée par les plus grands hommes de la Grèce, et par Socrate
lui-même ; que
Platon l'a mise au rang des qualités politiques, et que Chrysippe ne
l'a point oubliée
dans ses préceptes sur l'éducation des enfants. On sait que les Lacédémoniens avaient parmi leurs exercices une
sorte de
danse qu'ils jugeaient utile à l'homme de guerre. Les anciens
Romains eux-mêmes
ne rougissaient pas de s'y livrer : témoin cette danse consacrée par
la religion et les
prêtres, et qui s'est perpétuée jusqu'à nous ; témoin ce que Cicéron
met dans la
bouche de Crassus, au troisième livre du de Oratore, où il
recommande à l'orateur
une attitude mâle et forte, empruntée non à la scène et aux
histrions, mais aux gens
de guerre, et même à la palestrique, dont l'usage s'est maintenu
jusqu'à nos jours
sans que personne y ait trouvé à redire. Je ne veux pas cependant que ces exercices se prolongent
au-delà de
l'enfance, ni même que l'enfant y donne beaucoup de temps, car je
travaille à former
un orateur et non un danseur ; mais je veux seulement qu'il
46
contracte
par là une
certaine facilité, qui plus tard mêle, sans qu'il y pense, une grâce
secrète à tous ses
mouvements.
CHAP. XII. On demande si, en supposant que toutes ces connaissances soient
nécessaires,
elles peuvent s'enseigner et s'apprendre toutes en même temps.
Quelques
personnes le nient, sous prétexte que tant d'études différentes
doivent confondre les
idées et fatiguer l'esprit ; que ni la volonté, ni le corps, ni même
le temps, ne doit
pouvoir y suffire ; et que lors même qu'on le pourrait dans un âge
plus avancé, ce
n'est pas une raison pour surcharger ainsi l'enfance. Mais ces personnes ne réfléchissent pas assez sur la puissance
de l'esprit
humain, dont la nature est si active et si prompte, qui a tellement
la faculté de
partager, pour ainsi dire, ses regards de tous côtés, qu'il ne sait
pas même se
réduire à ne faire qu'une chose, et peut, au contraire, s'appliquer
à plusieurs, non
seulement dans le même jour, mais dans le même moment. Les joueurs d'instruments ne sont-ils pas obligés de surveiller
à la fois leur
mémoire, le ton et les diverses inflexions de leur voix, tandis
qu'attentifs aux sons
des cordes, ils pincent les unes de la main droite, et de la gauche
tirent, contiennent
ou lâchent les autres ? leurs pieds même ne sont pas oisifs, occupés
qu'ils sont à
battre la mesure : et tout cela simultanément. Que nous nous trouvions dans la nécessité imprévue de plaider
sur-le-champ,
n'avons-nous pas à dire une chose, à prévoir une autre ? Invention
des moyens,
choix d'expressions, composition, geste, prononciation, physionomie,
mouvements,
tout cela veut être improvisé tout ensemble. Si, au premier signal,
tant de facultés
différentes sont, pour ainsi dire, à nos ordres, pourquoi ne
pourrions-nous pas
partager les heures de la journée entre plusieurs études ? surtout si
l'on considère
que la variété ranime et répare les forces de l'esprit, et que rien
n'est plus fatigant
que la continuité d'un travail uniforme. Ainsi nous nous délassons
en passant de la
composition à la lecture, et nous prévenons encore l'ennui de la
lecture par la variété
des livres. Après avoir fait mille et mille choses, on n'en est pas moins,
en quelque sorte,
tout frais pour en commencer une nouvelle. Qui ne s'hébéterait pas,
quelque
agréable que soit un art, à écouter un même maître pendant tout un
jour ? Le
changement est nécessaire à l'esprit pour le récréer, comme la
diversité est
nécessaire à l'estomac pour réveiller l'appétit.
Ou bien donc qu'on m'indique une autre manière d'apprendre.
Faut-il n'étudier
que la grammaire, puis la géométrie, et laisser de côté la
grammaire ? passer de là à
la musique, et oublier ce qui l'a précédée ? s'occuper du latin,
comme s'il n'y avait
pas de grec ? en un mot, ne penser qu'à ce qu'on entreprend en
dernier ? Que ne conseillons-nous aussi aux agriculteurs de ne point
cultiver à la fois leurs
champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs vergers, et de ne point
donner en même
temps leurs soins à leurs prairies, à leurs bestiaux, à leurs
jardins, à leurs ruches ?
Pourquoi nous-mêmes accordons-nous quelque chose aux affaires du
barreau, au
besoin de voir nos amis, à nos intérêts domestiques, au soin de
notre corps, quelque
chose même à nos plaisirs ? Une seule de ces occupations nous
fatiguerait, si nous
n'y donnions quelque relâche : tant il est vrai qu'il est plus facile
de faire plusieurs
choses que de faire longtemps la même.
Il ne faut nullement appréhender que les enfants ne puissent
supporter le travail
des études. 47
Il n'est pas d'âge où l'on se fatigue moins. Cela a
l'air d'un paradoxe,
mais l'expérience est là pour le démontrer. Il est certain que plus
l'esprit est tendre,
plus il a de facilité pour apprendre. Une preuve de ce que je dis, c'est qu'une fois que les enfants
ont la langue
déliée, en moins de deux ans ils parviennent d'eux-mêmes à bien
parler et à savoir
presque tous les mots. Que de temps, au contraire, ne faut-il pas
aux esclaves
récemment achetés, pour se familiariser avec la langue latine ! Qu'on
essaye
d'apprendre à lire à un adulte, et l'on verra que ce n'est pas sans
raison que les
grecs donnent l'épithète de g-paidomaqei'" (instruits dès l'enfance)
à ceux qui
excellent dans leur art. Il est même vrai de dire que l'enfance porte plus légèrement le
travail qu'un âge
plus avancé. De même qu'on les voit tomber à chaque instant, ramper
sur leurs
mains et leurs genoux, se relever un moment après pour jouer sans
interruption,
courir çà et là du matin au soir, et cela sans danger ni fatigue,
parce qu'ils sont
légers et ne pèsent pas sur eux-mêmes ; de même leur esprit se
fatigue moins que le
nôtre, parce qu'ils se meuvent par un moindre effort, ne
s'appliquent pas à l'étude
par un mouvement qui vient d'eux-mêmes, et ne font que se prêter à
l'action de la
main qui les forme. Un autre avantage de cet âge, c'est de
suivre avec simplicité les leçons du maître, sans regarder en
arrière pour mesurer le chemin qu'ils ont fait. De plus, ils ne
connaissent pas encore ce que c'est que le véritable travail ; et en
effet, comme nous l'éprouvons tous les jours, il est moins pénible
de remplir une tâche donnée que de produire de soi-même. On
peut ajouter qu'on n'aura jamais plus de temps disponible, parce
qu'à cet âge tout consiste à écouter, tandis que plus tard, lorsque
l'élève sera en état d'écrire, de composer et de faire quelque chose
de lui-même, il pourra bien n'avoir ni le loisir ni même la volonté
de se mettre à ces études. Puis donc que le grammairien ne peut ni ne doit occuper la
journée tout entière,
de peur de rebuter son élève, à quelle étude donnera-t-on de
préférence ces
moments de loisir ? car je ne prétends pas que l'élève doive se consumer sur ces
arts, qu'il chante
ou accompagne sur un instrument la voix d'un chanteur, ni qu'il
descende aux
opérations les plus subtiles de la géométrie. Je ne demande pas que
sa
prononciation soit celle d'un comédien, ni son maintien celui d'un
danseur : encore ne
serait-ce pas le temps qui manquerait, quand je demanderais la
perfection ; car l'âge
où l'on apprend dure longtemps, et je ne suppose pas des esprits
lourds. Enfin pourquoi Platon a-t-il excellé dans tous ces arts dont
l'étude me paraît
nécessaire à l'orateur ? Non content des sciences qu'Athènes pouvait
lui fournir, et
de celles des pythagoriciens, auprès desquels il s'était rendu par
mer en Italie, il alla
encore trouver les prêtres de l'Égypte, et se fit initier à leurs
mystères. Nous alléguons la difficulté pour excuser notre paresse. Nous
n'aimons pas l'art
pour lui-même ; et si nous recherchons l'éloquence, ce n'est point
parce qu'elle est la
plus honorable et la plus belle chose du monde, mais pour en faire
un vil usage, et
nous ne cédons qu'à l'attrait d'un gain sordide. Eh bien
! que tant d'orateurs se fassent entendre au barreau
sans le secours de
ces connaissances, et ne songent qu'à s'enrichir ; mais on
m'accordera aussi que le
premier marchand venu s'enrichit davantage, et qu'un crieur public
gagne encore
plus avec sa voix que tous ces ora-
48 teurs. Pour moi, je ne voudrais
pas même pour
lecteur d'un homme qui calculerait ce que ses études peuvent lui
rapporter. Mais celui qui se sera formé de l'éloquence une idée toute
divine, celui qui, pour
me servir de l'expression d'un illustre poète tragique, l'aura
toujours devant les yeux
comme la reine du monde, celui qui ne cherchera pas sa récompense
dans la
bourse de ses clients, mais dans son âme et dans la contemplation de
la science,
récompense que ni le temps ni la fortune ne pourront lui enlever :
celui-là se
persuadera facilement qu'il vaut mieux employer à la géométrie et à
la musique le
temps que donnent les autres aux spectacles, aux exercices du champ
de Mars, au
jeu, aux conversations oiseuses, pour ne pas dire au sommeil et aux
festins ; et il y
trouvera infiniment plus de charme que dans tous ces plaisirs
grossiers. Car c'est un
des bienfaits de la Providence d'avoir voulu que les choses les plus
honnêtes
fussent aussi les plus agréables. Mais cette douceur même m'a peut-être entraîné trop loin. Que
ce que j'ai dit
suffise donc pour les études qui conviennent à l'enfant, jusqu'à
l'âge où il sera
capable d'en entreprendre de plus importantes. Dans le livre suivant
je vais ouvrir en
quelque sorte une nouvelle carrière, et passer aux devoirs du
rhéteur.
|