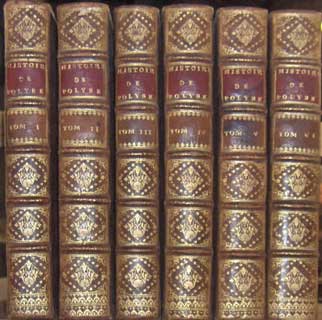
POLYBE
HISTOIRE GÉNÉRALE
TOME PREMIER : LIVRE IIΙ.
Traduction française : Pierre WATZ.
autres traductions : Thuillier - Bouchot
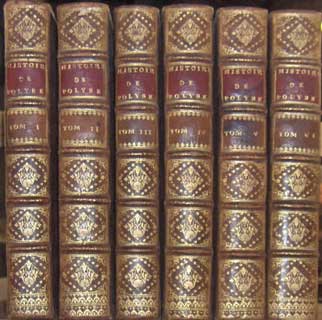
autres traductions : Thuillier - Bouchot
HISTOIRE GÉNÉRALE.
LIVRE III.
.
[31] On a vu dans le premier livre de mon histoire que l'ouvrage commencerait par la guerre sociale, celle d'Hannibal et celle de Coelé-Syrie; j'y ai montré également pourquoi je reprenais les choses d'un peu plus haut et consacrais aux événements antérieurs les deux livres qui précèdent celui-ci. Je vais maintenant faire le récit de ces guerres et essayer de démontrer d'abord pourquoi elles se sont produites, puis pour quelles raisons elles ont pris une si grande extension ; mais auparavant, indiquons notre plan en quelques mots. Le but et l'objet unique de tout mon ouvrage est de montrer comment, quand et pourquoi les Romains se sont rendus maîtres de toutes les parties connues du monde habité ; or le point de départ de cette évolution est bien établi, la date en est déterminée et le résultat universellement reconnu ; j'ai donc jugé utile de rappeler et d'exposer d'abord brièvement les principaux événements qui se sont déroulés entre le début et la fin de la période qui nous intéresse; car il me semble que c'est le meilleur moyen de donner aux lecteurs une idée complète de mon sujet. Comme la connaissance de l'ensemble contribue puissamment à l'intelligence des faits particuliers et la connaissance des faits particuliers à l'intelligence de l'ensemble, j'ai pensé que le meilleur procédé d'exposition était l'emploi simultané des deux méthodes; et, comme je viens de le dire, je vais commencer par esquisser le plan de mon ouvrage. Pour ce qui est de l'ensemble, j'ai déjà défini et délimité l'objet de mes études ; quant aux faits particuliers qui ont eu lieu pendant le temps dont je m'occupe, ils commencent par les guerres que j'ai citées et finissent par la destruction de la monarchie macédonienne, soit une durée de cinquante-trois ans, pendant lesquels il se passa des événements comme on n'en avait jamais vu jusqu'alors dans un égal nombre d'années. J'en commencerai le récit à la cent quarantième olympiade et le poursuivrai dans l'ordre suivant.
[32] Quand j'aurai expliqué pourquoi la guerre dite d'Hannibal éclata entre Rome et Carthage, nous verrons comment les Carthaginois envahirent l'Italie, brisèrent la puissance des Romains, leur inspirèrent des craintes pour leur existence et pour celle de leur patrie, et purent sérieusement espérer, chose incroyable, d'entrer en vainqueurs dans leur capitale. Ensuite, j'essaierai de montrer comment Philippe de Macédoine, parvenu vers la même époque à vaincre les Étoliens et à soumettre toute la Grèce, fit cause commune avec les Carthaginois ; comment des contestations s'élevèrent à propos de la Coelé-Syrie entre Antiochos et Ptolémée Philopator, et comment ils finirent par se faire la guerre pour cette province ; comment les Rhodiens et Prusias déclarèrent la guerre aux Byzantins et les forcèrent à renoncer au droit de péage qu'ils imposaient aux navigateurs du Pont-Euxin. A cet endroit j'interromprai ma narration, pour étudier la constitution de Rome ; je ferai voir que la forme du gouvernement a été pour beaucoup non seulement dans le rétablissement de la puissance romaine en Italie et en Sicile, dans la conquête de l'Espagne et de la Gaule, mais aussi dans le projet que formèrent les Romains, une fois Carthage vaincue, de soumettre l'univers entier. Je ferai ensuite une digression sur la chute de Hiéron, tyran de Syracuse. De là, je passerai aux troubles qui éclatèrent en Égypte, quand, après la mort de Ptolémée, Antiochos et Philippe complotèrent pour se partager le royaume qu'il laissait à son fils et cherchèrent à s'emparer, soit par trahison soit de vive force, celui-ci des bords de la mer Égée, de la Carie et de Samos, celui-là de la Coelé-Syrie et de la Phénicie.
[33] Ensuite viendra un bref exposé des opérations que firent les Romains et les Carthaginois en Espagne, en Afrique et en Sicile ; puis je m'occuperai uniquement des affaires de la Grèce et des changements qui se produisirent dans ce pays. Je raconterai les batailles navales d'Attale et des Rhodiens contre Philippe, puis la guerre entre Philippe et les Romains, ses péripéties, les généraux qui la dirigèrent, son issue. Après quoi, je rapporterai l'irritation des Étoliens, l'appel qu'ils adressèrent à Antiochos et la guerre qu'ils suscitèrent ainsi en Asie aux Achéens et aux Romains. J'en montrerai les causes ; je dirai comment Antiochos passa en Europe, comment il dut quitter précipitamment la Grèce, puis fut vaincu et contraint d'abandonner tous les territoires situés en deça du Taurus; je dirai enfin comment les Romains réprimèrent l'insolence des Galates, devinrent les maîtres incontestés de l'Asie, délivrèrent de la crainte des barbares et des violences des Galates toute la région située en deça du Taurus. Je mettrai ensuite sous les yeux des lecteurs les malheurs des Étoliens et des Céphalléniens ; je passerai de là aux guerres qu'Eumène fit d'abord contre Prusias et les Galates, puis contre Pharnace avec l'appui d'Ariarathe ; je dirai enfin comment se constitua l'union du Péloponnèse et quels progrès furent effectués par la république de Rhodes. Je ferai alors une courte récapitulation de tous les points que j'aurai traités, et je terminerai par le récit de l'expédition qu'Antiochos Épiphane entreprit en Égypte, de la guerre contre Persée et de la destruction de la monarchie macédonienne. On verra par là grâce à l'application constante de quels principes les Romains parvinrent à étendre leur domination sur le monde entier.
[34] Si le succès ou l'infortune était un critérium suffisant pour déterminer les blâmes ou les éloges que mérite la conduite d'un homme ou d'un état, je devrais borner là ma carrière et terminer mon histoire, conformément au plan que je me suis tracé, par le récit de ces derniers événements ; c'est avec eux en effet que prend fin notre période de cinquante-trois ans, et c'est par eux que la puissance romaine fut portée à son plus haut point ; il n'y eut plus personne qui ne se reconnût dans l'obligation d'obéir aux Romains et de se soumettre à leur autorité. Mais le pur et simple résultat des batailles ne nous permet pas de porter un jugement décisif sur les vainqueurs et les vaincus; dans bien des cas, des succès qui paraissaient très considérables ont été la source des pires désastres, quand on n'usait pas comme il convenait des avantages ainsi acquis; et inversement, on a vu bien des fois les revers les plus terribles être fort utiles à ceux qui les avaient subis, quand ils les supportaient courageusement. Il y a donc lieu d'étudier, outre les événements que j'ai cités, la conduite qu'ont tenue les Romains après leurs victoires, la manière dont ils ont gouverné l'univers, les dispositions et les sentiments des autres nations à l'égard des hommes qui les gouvernaient, enfin les penchants et les inclinations qui ont dominé, chez chaque peuple, dans la vie privée et publique. C'est évidemment par là que nos contemporains pourront apprendre s'il faut se soustraire ou se soumettre à la domination romaine et que la postérité pourra juger si la manière dont elle s'est exercée mérite un jugement élogieux ou sévère. Voilà quel est le plus grand profit qui se puisse tirer de mon histoire soit pour le présent soit pour l'avenir. Il ne faut pas croire en effet que les hommes d'action n'aient pour but que de vaincre et de subjuguer tout l'univers, ni qu'on doive les juger sur leurs victoires et leurs conquêtes ; on ne fait jamais la guerre à ses voisins dans la seule intention de triompher d'un adversaire, pas plus qu'on ne part en mer uniquement pour passer d'un bord à l'autre, ni qu'on n'étudie les sciences ou les arts pour le plaisir d'en être instruit ; dans tout ce que nous entreprenons, nous avons en vue soit notre agrément, soit le bien, soit notre intérêt. Mon ouvrage ne sera donc achevé que si j'y montre quel fut l'état de chaque peuple après le triomphe des Romains et l'établissement de leur domination sur la terre entière, jusqu'au moment où de nouveaux troubles et de nouveaux changements se sont produits. J'ai donc conçu le projet de recommencer pour ainsi dire mon histoire et d'écrire encore celle de ces derniers événements, d'abord à cause de leur importance et de leur cours imprévu, mais surtout parce que j'ai assisté à la plupart d'entre eux, que j'y ai pris une part active et parfois même prépondérante.
[35] Cette période de troubles est celle où les Romains portèrent la guerre chez les Celtibères et les Vaccéens, où en Afrique les Carthaginois la déclarèrent au roi Masinissa, où en Asie Attale et Prusias se la firent l'un à l'autre, et où Ariarathe, roi de Cappadoce, chassé du trône paternel par Oropherne grâce à l'appui du roi Démétrios, put y remonter avec l'aide d'Attale. C'est à la même époque que Démétrios, fils de Séleucos, après avoir régné douze ans sur la Syrie, perdit à la fois la vie et son royaume, écrasé par une coalition des autres rois, et que les Romains autorisèrent les Grecs soupçonnés d'avoir pactisé avec Persée à retourner dans leur patrie, quand on eut reconnu le peu de fondement de l'accusation portée contre eux. Peu de temps après, ils s'attaquèrent aux Carthaginois, dans l'intention d'abord de les obliger à émigrer, puis de les anéantir complètement, pour des raisons que j'indiquerai plus tard. En même temps, les Macédoniens ayant renoncé à l'alliance de Rome et les Lacédémoniens ayant quitté la confédération achéenne, la ruine générale de toute la Grèce commença et fut aussitôt consommée. Telle est la matière que je me propose de traiter ; fasse la fortune que je vive assez longtemps pour mener mon oeuvre à bonne fin ! Mais quand je viendrais à succomber, elle ne restera pas inachevée, j'en suis convaincu ; il ne manquera pas d'hommes éminents pour se remettre à la tâche et la poursuivre jusqu'au bout. Et maintenant que, pour donner aux lecteurs un aperçu de l'ensemble de mon histoire et de ses diverses parties, j'en ai relaté sommairement les faits les plus saillants, il est temps de revenir à mon sujet et de reprendre les choses par le commencement.
[36] Quelques-uns des historiens d'Hannibal, voulant nous expliquer pourquoi la guerre a repris entre Rome et Carthage, attribuent ce fait à deux causes : la première serait le siège de Sagonte par les Carthaginois, et la seconde l'infraction à leur engagement de ne pas dépasser le fleuve que les indigènes appellent l'Èbre. J'accorde que ce fut là le point de départ de la guerre, mais je ne puis admettre que c'en ait été le motif. Loin de là ! C'est comme si l'on prétendait que l'invasion de l'Asie par Alexandre a été la cause de ses guerres contre les Perses ou que c'est le débarquement d'Antiochos à Démétrias qui a provoqué celle que ce roi fit aux Romains: deux assertions aussi insoutenables l'une que l'autre. Qui pourrait voir dans l'expédition d'Alexandre la raison de toutes les mesures et de toutes les dispositions qu'il avait prises antérieurement, et Philippe avant lui de son vivant, en vue de la guerre contre les Perses ? Il en est de même pour les préparatifs militaires que les Étoliens avaient faits contre les Romains avant l'occupation de Démétrias par Antiochos. Pour raisonner ainsi, il faut n'avoir jamais compris combien le point de départ est chose différente de la cause ou de l'occasion, qui précèdent toute action, tandis que le point de départ ne vient qu'après elles. Pour moi, je considère comme le point de départ les premières tentatives, les premiers pas vers la réalisation d'un projet bien arrêté, et comme les causes les faits antérieurs à toute décision, à toute détermination : ce sont les pensées qui nous viennent à l'esprit, les dispositions où nous sommes, les raisonnements que nous faisons à ce propos, bref tout ce qui nous inspire nos projets et nos résolutions. Quelques exemples rendront plus clair ce que je dis là. Quelles furent en réalité les causes et l'origine de la guerre contre les Perses, n'importe qui peut aisément le discerner : ce fut d'abord le retour des Grecs, que Xénophon ramena depuis les satrapies les plus reculées de l'Asie, à travers tout un continent peuplé d'ennemis, sans qu'aucun barbare osât lui tenir tête ; en second lieu, le passage en Asie d'Agésilas, roi de Lacédémone, qui ny rencontra aucune résistance sérieuse, bien qu'il ait dû repartir sans avoir obtenu aucun résultat, rappelé en Grèce par les troubles qui y avaient éclaté. C'étaient ces événements qui avaient montré à Philippe jusqu'où allaient la mollesse et la lâcheté des Perses ; il connaissait d'autre part sa valeur guerrière et celle de ses sujets ; mais surtout il songeait à la grandeur et à l'éclat des avantages qu'il retirerait de cette expédition. Il sut ranger tous les Grecs à son parti, puis, sous prétexte d'aller venger sur les Perses le mal qu'ils avaient fait à la Grèce, il se mit à l'oeuvre, résolut de déclarer la guerre et fit tous ses préparatifs. Les premières raisons que j'ai données doivent donc être considérées comme les véritables causes de la guerre contre les Perses, la dernière en fut l'occasion et l'invasion de l'Asie par Alexandre le point de départ.
[37] Pour la guerre d'Antiochos et des Romains, il est clair que la cause en fut l'irritation des Étoliens : se croyant méprisés par les Romains vainqueurs de Philippe, ils ne se contentèrent pas, comme je l'ai dit plus haut, de faire appel à Antiochos ; mais ils se laissèrent emporter par leur ressentiment au point de tout oser et de tout endurer. Le prétexte fut la libération des Grecs, que les Étoliens allaient avec Antiochos proclamer de ville en ville avec autant de déraison que d'impudence ; le point de départ de la guerre fut le débarquement d'Antiochos à Démétrias. Si j'ai insisté aussi longuement sur cette distinction, ce n'est pas pour critiquer les historiens, mais pour instruire mes lecteurs. Comment un médecin pourrait-il exercer utilement son métier, s'il ignorait les causes des maladies ? Quel service pourrait rendre un homme d'État qui serait incapable de discerner comment, pourquoi et sous quelle influence les événements se produisent? Le premier ne saurait évidemment pas donner à un malade les soins qui lui conviennent, pas plus que le second, sans la connaissance des faits dont je parlais, ne saura gouverner habilement. Aussi n'y a-t-il rien à quoi il faille accorder autant d'attention et qu'on doive rechercher avec autant de soin que les raisons de chaque événement ; car souvent les plus graves conséquences résultent des moindres causes, et d'autre part c'est toujours aux premières atteintes, aux premières manifestations du mal qu'on porte remède le plus facilement.
[38] L'historien romain Fabius attribue la guerre d'Hannibal, en dehors de l'attaque de Sagonte, à l'avidité et à l'ambition d'Hasdrubal. Selon cet auteur, Hasdrubal aurait acquis en Espagne une puissance considérable, puis serait revenu en Afrique pour essayer de renverser la constitution de Carthage et de s'y faire proclamer roi ; les principaux magistrats auraient découvert ses projets et s'y seraient unanimement opposés ; Hasdrubal, sentant cette résistance, aurait quitté l'Afrique et serait revenu en Espagne, où il aurait exercé l'autorité la plus arbitraire, sans aucun égard pour le Sénat de Carthage. Hannibal aurait été dès sa jeunesse le complice et l'émule de son beau-frère; il aurait marché sur ses traces, quand il lui succéda au gouvernement de l'Espagne ; c'est pour cela qu'il aurait provoqué la guerre avec les Romains de sa propre autorité, contre la volonté de son pays : personne en effet, parmi les notables carthaginois, n'aurait approuvé le coup de main d'Hannibal sur Sagonte. Fabius ajoute qu'après la prise de cette ville les Romains vinrent à Carthage, pour exiger qu'on leur livrât Hannibal et déclarer la guerre en cas de refus. Mais si l'on demandait à notre historien quelle meilleure occasion les Carthaginois auraient pu trouver, quelle conduite plus conforme à l'équité et à leurs intérêts ils auraient pu tenir — puisque, comme il le dit lui-même, ils désapprouvaient les actes d'Hannibal — que de faire droit aux réclamations des Romains en leur livrant le coupable, de se faire fort habilement débarrasser par autrui d'un ennemi de l'État, d'assurer la tranquillité de leur pays,le maintien d'une paix fort menacée et l'assouvissement de leur vengeance, tout cela par un simple décret, que pourrait-il répondre à cette question ? Rien, évidemment. Or les Carthaginois furent si loin d'agir ainsi qu'ils firent la guerre pendant dix-sept années consécutives sous la conduite d'Hannibal, qu'ils ne déposèrent les armes que lorsqu'ils eurent perdu tout espoir et se virent, ainsi que leur patrie, réduits à toute extrêmité.
[39] Si j'ai parlé de Fabius et de ses écrits, ce n'est pas dans la crainte qu'il trouve crédit auprès de quelques lecteurs par la vraisemblance de ses récits : leur extravagance saute aux yeux, même sans mes commentaires. J'ai seulement voulu recommander à ceux qui auront son livre entre les mains de ne pas en juger d'après la suscription, mais d'après le contenu. Car il y a des gens qui font moins attention à ce qui est dit qu'à la personnalité de l'auteur et qui s'imaginent, parce qu'il était le contemporain des faits qu'il raconte et qu'il faisait partie du Sénat, que l'on doit ajouter foi à tout ce qu'il avance. Je déclare, moi, qu'il ne faut pas lui dénier toute autorité, mais qu'on ne doit pas non plus le considérer comme infaillible et que c'est surtout l'examen des faits eux-mêmes qui doit servir aux lecteurs de pierre de touche. Pour en revenir à la guerre des Romains et des Carthaginois, on peut affirmer que la première cause en fut le ressentiment d'Hamilcar Barca, père d'Hannibal. Il ne s'était pas laissé décourager par l'issue défavorable de la guerre de Sicile, parce qu'il avait conservée intacte son armée d'Éryx et la voyait dans les mêmes dispositions que lui : s'il avait cédé aux circonstances et consenti à traiter après la défaite navale des Carthaginois, il restait prêt à reprendre les armes et en guettait l'occasion. Si les mercenaires ne s'étaient pas révoltés contre Carthage, il aurait immédiatement fait tout ce qui dépendait de lui pour recommencer la guerre. Mais les troubles intérieurs l'en détournèrent et absorbèrent tous ses soins.
[310] Quand ces troubles furent apaisés et que les Romains déclarèrent la guerre aux Carthaginois, ces derniers relevèrent d'abord le défi, comptant sur leur bon droit pour leur assurer la victoire, comme je l'ai exposé dans les livres précédents, sans lesquels on ne pourrait bien comprendre ni ce que je dis maintenant ni ce que je dirai dans la suite. Mais les Romains ne témoignèrent aucun respect de l'équité, et les Carthaginois durent s'incliner devant la nécessité : à leur grand regret, mais sans pouvoir faire autrement, ils évacuèrent la Sardaigne et se résignèrent à payer douze cents talents en plus de l'indemnité qui leur était déjà imposée, plutôt que de faire la guerre dans de pareilles conditions. Ce fut là une seconde cause, et la plus importante, de la guerre qui eut lieu ensuite; car Hamilcar, animé à la fois par son propre ressentiment et par l'indignation de ses compatriotes, n'eut pas plutôt assuré la paix à son pays en triomphant des mercenaires révoltés qu'il tourna toute son activité du côté de l'Espagne, pour pouvoir en tirer des subsides en cas de guerre avec les Romains. D'où la troisième cause que l'on doit assigner à cette guerre : la rapidité des progrès que les Carthaginois firent en Espagne ; car les renforts qu'ils en tirèrent purent seuls leur donner la confiance et le courage nécessaires pour se mettre en campagne. C'est donc Hamilcar qui a le plus contribué à provoquer la seconde guerre punique, quoiqu'il soit mort dix ans avant qu'elle ait commencé. On pourrait invoquer bien des arguments en faveur de cette assertion ; mais le fait suivant suffira à en démontrer le bien-fondé.
[311] Quand Hannibal, vaincu par les Romains, fut obligé de quitter sa patrie et se réfugia chez Antiochos, les Romains, qui commençaient à discerner les projets des Étoliens, envoyèrent une ambassade au roi de Syrie pour s'assurer de ses intentions. Les députés constatèrent qu'il était favorable aux Étoliens et que ses dispositions à l'égard de Rome étaient des plus hostiles ; ils firent alors la cour à Hannibal, pour le rendre suspect à Antiochos ; et ils arrivèrent à leurs fins. Le temps s'écoulait, et le roi se défiait de plus en plus de son hôte, quand une occasion se présenta de s'expliquer sur la mésintelligence qui s'était glissée entre eux. Hannibal se défendit longuement ; mais il vit que toutes ses raisons ne convainquaient pas le roi et il finit par lui raconter l'anecdote suivante : « Mon père était sur le point de partir pour aller guerroyer en Espagne ; j'avais alors neuf ans ; il faisait un sacrifice à Zeus et je me tenais près de lui, devant l'autel. Quand il eut versé les libations et accompli tous les rites, il pria les assistants de s'éloigner un peu, me fit approcher et me demanda affectueusement si je voulais le suivre à l'armée. J'acceptai avec joie, je le suppliai même, avec une ardeur enfantine, de m'emmener avec lui ; il me prit alors par la main droite, me conduisit jusqu'à l'autel et là me fit jurer que je ne serais jamais l'ami des Romains. » Après avoir fait ce récit à Antiochos, il le pria d'avoir confiance en lui et de vouloir bien le considérer comme son collaborateur le plus fidèle, tant qu'il serait disposé à combattre les Romains; s'il traitait ou se réconciliait avec eux, c'est alors qu'il devrait se méfier et se garder d'Hannibal, sans attendre qu'on vînt l'accuser auprès de lui. [312] Antiochos, à ces mots, sentit bien qu'Hannibal parlait en toute sincérité, et tous ses soupçons se dissipèrent. N'est-ce pas là un témoignage irrécusable de la haine d'Hamilcar et des desseins qu'il méditait ? Du reste, les faits eux-mêmes rendent la chose évidente : il suscita en effet aux Romains de tels ennemis, dans la personne d'Hasdrubal, le mari de sa fille, et de son propre fils Hannibal qu'il lui était impossible, après cela, de manifester sa haine plus violemment. Hasdrubal mourut avant d'avoir pu mettre tous ses projets à exécution ; quant à Hannibal, les circonstances lui permirent de montrer d'une façon éclatante ses sentiments héréditaires envers le peuple romain. Cela prouve que les hommes d'État doivent avant tout mettre leurs soins à découvrir les véritables dispositions de ceux qui font la paix ou se réconcilient avec leurs ennemis : c'est tantôt parce que les circonstances le leur imposent, tantôt parce que leur ressentiment est réellement apaisé qu'ils se soumettent ; il faut se méfier des premiers et se rappeler qu'ils sont toujours à l'affût d'une occasion ; on peut être sûr des autres, les considérer comme des sujets fidèles ou comme des amis sincères et leur demander sans hésitation les services qu'ils sont en état de vous rendre. Voilà donc quelles sont, à mon avis, les causes de la guerre d'Hannibal ; voici quels en furent les débuts.
[313] Les Carthaginois ne se résignaient pas aux défaites qui leur avaient coûté la Sicile ; mais, comme je l'ai dit plus haut, leur ressentiment était encore accru par la perte de la Sardaigne ainsi que par le tribut considérable qui leur avait été imposé. Aussi, dès qu'ils eurent conquis la plus grande partie de l'Espagne, s'empressèrent-ils de favoriser tout ce qui leur semblait dirigé contre les Romains. En apprenant la mort d'Hasdrubal, qui avait succédé à Hamilcar comme gouverneur de l'Espagne, ils attendirent d'abord de savoir quels seraient les désirs de l'armée ; quand on vint leur annoncer qu'à l'unanimité les troupes avaient choisi Hannibal pour chef, l'assemblée du peuple fut aussitôt convoquée et le choix des soldats ratifié d'un consentement universel. Hannibal prit donc le commandement et entreprit immédiatement de soumettre la tribu des Olcades ; il vint camper devant Althée, leur principale ville, dont ses assauts d'une impétusioté déconcertante eurent bientôt raison. Après la chute d'Althée, les autres villes, épouvantées, se rendirent aux Carthaginois. Hannibal leur imposa des contributions, amassa ainsi des sommes considérables et revint passer l'hiver à Carthagène. Il se montra très généreux envers ses soldats, les paya libéralement, leur fit toutes sortes de promesses, leur inspira ainsi une grande affection et de belles espérances.
[314] L'été suivant, il repartit en expédition contre les Vaccéens, emporta Helmantique au premier assaut, mais eut beaucoup de mal à s'emparer d'Arbucale, place importante, dont la nombreuse population se défendait héroïquement. A son retour, il courut un très grand danger : il fut attaqué à l'improviste par les Carpésiens, la peuplade la plus puissante peut-être de tout le pays, auxquels s'étaient jointes les tribus voisines, soulevées surtout par les Olcades réfugiés chez elles et enflammées également par les survivants d'Helmantique. Si les Carthaginois avaient été obligés de se mesurer avec eux en bataille rangée, ils auraient certainement été vaincus ; mais Hannibal eut la prudence de battre en retraite pied à pied et de mettre le Tage entre lui et ses ennemis ; puis il les attaqua au moment où ils passaient le fleuve; les difficultés que présentait cette traversée lui donnaient l'avantage de la position et, de plus, il avait une quarantaine d'éléphants ; ces circonstances lui permirent de remporter un succès complet et inespéré. Les barbares essayèrent de forcer le passage sur plusieurs points; mais la plupart d'entre eux furent tués, au moment où ils prenaient terre, par les éléphants qui circulaient le long de la rive et prévenaient quiconque tentait d'aborder ; d'autres furent massacrés dans le lit même de la rivière par les cavaliers, dont les montures résistaient mieux au courant et qui dominaient leurs adversaires à pied. Enfin, ce fut Hannibal qui, à son tour, traversa le fleuve, prit l'offensive et mit les barbares en fuite, bien qu'ils eussent plus de cent mille hommes. Après cette victoire, il n'y eut plus au sud de l'Èbre personne qui osât lui tenir tête, en dehors de Sagonte. Mais il se gardait bien de rien tenter contre cette place, pour ne pas donner trop ouvertement aux Romains l'occasion de déclarer la guerre tant qu'il n'aurait pas assuré son autorité il suivait en cela les conseils qu'Hamilcar, son père, lui avait prodigués.
[315] Les Sagontins envoyaient à Rome ambassade sur ambassade : ils appréhendaient l'avenir et craignaient pour leur propre salut ; mais en même temps, ils tenaient à ne pas laisser ignorer aux Romains les progrès que les Carthaginois faisaient en Espagne. Les Romains, qui pendant longtemps les avaient écoutés d'une oreille distraite, finirent par envoyer des députés pour se renseigner exactement sur la situation. A ce moment, Hannibal, après avoir achevé les conquêtes qu'il projetait, était rentré avec son armée dans ses quartiers d'hiver, à Carthagène, la capitale et pour ainsi dire le joyau de la partie de l'Espagne soumise aux Carthaginois. Il s'y rencontra avec les députés de Rome, leur donna audience et les écouta exposer leur mandat. Les Romains, prenant les dieux à témoin, l'invitèrent à respecter Sagonte, qui était sous leur protectorat, et à tenir l'engagement pris par Hasdrubal de ne pas dépasser l'Èbre. Hannibal, en jeune homme plein d'ardeur belliqueuse et dont la fortune favorisait les entreprises, animé d'ailleurs par une haine déjà ancienne contre Rome, se posa en champion des Sagontins ; il reprocha aux Romains d'avoir profité d'une sédition récente, où les Sagontins les avaient pris comme arbitres, pour mettre à mort injustement quelques-uns des principaux citoyens ; il déclara qu'il ne laisserait pas impunie une pareille perfidie ; car c'était une coutume héréditaire, chez les Carthaginois, de ne jamais abandonner les opprimés. En même temps, il envoyait demander à Carthage ce qu'il devait faire, en présence des violences exercées sur les tributaires par les Sagontins, alliés des Romains. En proie à la plus vive colère, il en perdait tout sang-froid ; au lieu d'invoquer ses véritables griefs, il recourait aux prétextes les plus futiles ; c'est l'habitude des gens qui se laissent dominer par leurs passions jusqu'à perdre la notion de ce qui est juste et raisonnable. Ne valait-il pas beaucoup mieux réclamer aux Romains la restitution de la Sardaigne et de l'indemnité qu'ils avaient naguère imposée injustement à Carthage, en abusant des circontances, — quitte à leur déclarer la guerre, s'ils refusaient ? En omettant au contraire ses griefs les plus sérieux pour en inventer un sans aucun fondement, celui de Sagonte, il passa pour avoir engagé la guerre non seulement contre toute raison, mais contre toute justice. Les députés de Rome, comprenant bien que la rupture était inévitable, s'embarquèrent pour Carthage, afin d'y renouveler leur dé- marche. Mais c'était en Espagne, et non en Italie, qu'ils pensaient que la campagne aurait lieu, et il comptaient faire de Sagonte leur base d'opérations.
[316] Le Sénat prit ses mesures en vue de cette éventualité : prévoyant que la guerre serait sérieuse, durerait longtemps et se ferait loin de Rome, il décida de mettre ordre d'abord aux affaires d'Illyrie. Voici en effet ce qui s'y passait : Démétrios de Pharos, oubliant les services que les Romains lui avaient rendus, plein de mépris pour un peuple à qui les Gaulois avaient inspiré tant de craintes et à qui les Carthaginois en inspiraient encore, escomptant l'appui de la Macédoine en raison de son alliance avec Antigone contre Cléomène, s'était mis à ravager et à piller les villes de l'Illyrie soumises aux Romains ; il avait, contrairement aux conventions, dépassé les bouches du Lissos avec cinquante bâtiments et exercé ses déprédations dans plusieurs des îles Cyclades. Les Romains, dont l'attention était attirée tant par ces méfaits que par la prospérité du royaume de Macédoine, résolurent d'assurer leur situation à l'est de l'Italie ; ils pensaient avoir le temps, avant la guerre, de faire repentir les Illyriens de leurs erreurs et de châtier la téméraire ingratitude de Démétrios. Ils furent déçus dans leurs prévisions : ce fut Hannibal qui les prévint en s'emparant de Sagonte, si bien que la guerre eut lieu non pas en Espagne, mais aux portes même de Rome et dans toute l'Italie. Néanmoins les Romains, pour la raison que j'ai dite, envoyèrent L. Emilius avec une armée opérer en Illyrie, au printemps de la première année de la cent quarantième olympiade.
[317] Hannibal, parti de Carthagène avec ses troupes, marchait sur Sagonte. Cette ville est située au pied d'une chaîne de montagnes qui s'avance jusqu'à la mer, aux confins de l'Ibérie et de la Celtibérie, à sept stades environ de la côte. Elle se trouve dans une région extrêmement fertile, la plus riche de toute l'Espagne. Hannibal campa devant la place et en mena vivement le siège, car il prévoyait que la prise de cette ville lui serait par la suite d'un grand profit : d'abord, elle enlèverait aux Romains tout espoir de faire de l'Espagne le théâtre de la guerre ; puis, elle frapperait de terreur tous les Espagnols, rendrait plus dociles ceux qui étaient déjà soumis et plus circonspects ceux qui étaient encore indépendants ; mais surtout, elle lui permettrait de partir en expédition sans laisser aucun ennemi derrière lui. En outre, il espérait qu'il se procurerait ainsi les approvisionnements abondants dont il avait besoin pour mener à bien son entreprise, que l'ardeur de ses soldats serait excitée par le butin qu'ils feraient et qu'enfin les dépouilles qu'il enverrait à Carthage lui concilieraient la faveur de ses concitoyens restés clans leur patrie. C'est pour toutes ces raisons qu'il menait vivement le siège, donnant l'exemple à ses troupes, mettant la main aux travaux les plus pénibles, prodiguant ses encouragements aux soldats, s'exposant audacieusement à tous les dangers. Enfin, après huit mois de souffrances et de soucis de toute sorte, il emporta la place d'assaut et y fit un butin considérable en argent, en hommes et en meubles. Il mit l'argent de côté, comme il en avait l'intention, pour l'employer à réaliser ses projets ; il partagea les prisonniers entre ses soldats, proportionnellement à leur mérite; quant à tous les meubles, il les envoya immédiatement à Carthage. Son espoir n'était pas trompé, son plan réussissait : ses soldats affrontèrent plus hardiment le danger, ses compatriotes furent plus disposés à lui accorder ce qu'il leur demanderait et lui-même put, grâce à l'abondance de ses ressources, effectuer ensuite une grande partie des préparatifs indispensables à son entreprise.
[318] Cependant Démétrios, à la nouvelle que les Romains préparaient une expédition contre lui, se hâta d'envoyer pour garder Dimale un fort détachement pourvu des munitions nécessaires. Dans les autres villes, il fit mettre à mort ses adversaires politiques et confia le gouvernement à ses amis. Il choisit parmi ses sujets six mille hommes d'un courage éprouvé pour tenir garnison à Pharos. Le consul romain, arrivé en Illyrie avec son armée, s'aperçut que l'ennemi comptait si bien sur la forte position de Dimale et la manière dont elle était défendue qu'il la croyait imprenable ; il résolut donc de commencer par attaquer cette place, pour frapper l'esprit des Illyriens. II fit ses recommandations à chacun de ses officiers, poussa ses travaux d'approche de plusieurs côtés à la fois et mena si vivement le siège qu'au bout de sept jours la ville fut prise d'assaut. Les ennemis, démoralisés, vinrent aussitôt de toutes les villes pour se rendre à discrétion. Le consul accepta la soumission de chaque cité aux conditions qu'il crut devoir lui accorder et fit voile vers Pharos pour se mesurer avec Démétrios en personne. Mais, apprenant que la place était bien fortifiée et défendue par une nombreuse garnison composée d'hommes d'élite, que de plus elle était abondamment pourvue de vivres et d'autres munitions, il craignit que le siège n'en fût long et difficile. Dans cette appréhension, il eut recours au stratagème suivant. Il fit la traversée de nuit avec toutes ses troupes, en débarqua la plus grande partie, qu'il cacha dans des endroits boisés et encaissés, puis revint en plein jour, aux yeux de tous, aborder avec vingt vaisseaux dans le port le plus voisin de la ville. Démétrios aperçut cette escadrille ; pensant avoir bon marché d'ennemis aussi peu nombreux, il sortit de la ville et marcha vers le port pour s'opposer à leur descente.
[319] Le combat s'engagea et devint aussitôt des plus ardents ; de nouveaux renforts arrivaient sans cesse de la place, si bien qu'a la fin toute la garnison était sortie et entrait en ligne. Les Romains qui avaient pris terre pendant la nuit arrivent à ce moment, après une marche dans des lieux couverts ; ils prennent fortement position sur une hauteur située entre la ville et le port, coupant la retraite aux troupes sorties de la place. Quand Démétrios s'aperçut de cette manoeuvre, il ne songea plus à empêcher la descente, mais il rassembla ses soldats, les harangua et se mit en marche pour attaquer le détachement qui occupait la colline. Les Romains, voyant les bataillons illyriens s'avancer avec impétuosité et en bon ordre, les chargent, de leur côté, avec une vigueur extraordinaire, Leurs compagnons, après avoir achevé leur débarquement, jugent d'un coup d'oeil la situation et fondent sur les derrières de l'ennemi ; les Illyriens se voient attaqués de toutes parts ; un désordre, une confusion extrêmes règnent parmi eux ; enfin, pressés en tête et en queue, les soldats de Démétrios sont mis en déroute; quelques-uns prennent la fuite vers la ville, la plupart se dispersent dans l'île à travers champs. Quant à Démétrios, il s'embarqua sur un des navires qu'il tenait à l'ancre dans un endroit écarté pour parer à toute éventualité, mit à la voile la nuit suivante et eut la chance de pouvoir arriver chez le roi Philippe, où il passa le reste de ses jours. C'était un homme hardi et courageux, mais d'un courage aveugle et irréfléchi. Sa mort ne démentit pas le caractère qu'il avait montré toute sa vie : il essayait de prendre Messène pour le compte de Philippe; au cours d'une attaque follement téméraire, il périt les armes à la main. Mais je reparlerai plus longuement de ces faits en temps et lieu. Le consul Émilius s'empara de Pharos sans aucune peine, rasa la ville, se rendit maître du reste de l'Illyrie, prit toutes les mesures qu'il jugea nécessaires, puis rentra à Rome à la fin de l'été; il y fit une entrée triomphale, avec toute la pompe méritée par la réputation d'habileté et surtout de bravoure qu'il avait acquise en cette affaire.
[320] Quand on apprit à Rome la prise de Sagonte, on ne délibéra pas pour savoir s'il fallait faire la guerre, comme certains historiens le prétendent, en rapportant à l'appui de leurs dires les discours prononcés pour et contre. Cette manière de présenter les choses est absolument invraisemblable. Comment les Romains, qui l'année précédente avaient notifié aux Carthaginois qu'ils leur déclareraient la guerre s'ils mettaient le pied sur le territoire de Sagonte, pouvaient-ils tenir conseil et se demander s'il fallait la faire ou non, alors que la ville venait d'être prise d'assaut ? Comment les croire, quand ils racontent que le Sénat était dans la consternation la plus complète, que les pères y amenèrent leurs fils âgés de douze ans, que ces enfants prirent part aux délibérations et ne révélèrent à personne, pas même à leur famille, aucun des secrets dont ils se trouvèrent être les dépositaires ? Il n'y a dans toute cette légende rien d'authentique ni même de vraisemblable, à moins que la Fortune n'ait ajouté aux autres dons qu'elle a faits aux Romains celui de posséder la sagesse dès leur naissance. Il n'y a pas lieu d'insister sur les récits de ce genre, tels que ceux de Chéréas et de Sosylos ; je n'appelle pas cela de l'histoire ; on dirait plutôt des racontars recueillis dans quelque boutique de barbier, des ragots comme en colportent les gens du peuple. Quand les Romains apprirent la prise de Sagonte, ils désignèrent sur-le-champ des ambassadeurs et les envoyèrent à Carthage en toute hâte pour poser un ultimatum, dont la première alternative ne pouvait être admise par les Carthaginois qu'à leur honte autant qu'à leur préjudice, tandis que l'acceptation de la seconde devait être le prélude d'un conflit terrible. Les Romains réclamaient qu'on leur livrât Hannibal et ses complices sulbaternes ; en cas de refus, la guerre était déclarée. Les ambassadeurs, introduits dans le Sénat de Carthage, exposèrent leurs conditions ; les Carthaginois frémirent en entendant la proposition qui leur était faite et chargèrent le plus qualifié d'entre eux de soutenir leur cause.
[321] Les Carthaginois ne parlaient pas plus du pacte conclu avec Hasdrubal que s'il n'avait jamais existé ou que s'il ne les engageait à rien, puisqu'ils ne l'avaient pas ratifié. Ils prétendaient prendre en cela modèle sur les Romains, qui, pendant la guerre de Sicile, avaient annulé la convention passée par Lutatius, sous prétexte qu'elle avait été faite sans l'autorisation du peuple. Leur porte-parole insistait et revenait sans cesse, pendant tout son plaidoyer, sur le traité qui avait mis fin à la guerre de Sicile : il soutenait qu'il n'y était fait aucune mention de l'Espagne, que sans doute il y était dit explicitement qu'aucun des deux contractants ne molesterait les alliés de l'autre, mais qu'à cette époque les Sagontins n'étaient pas les alliés des Romains ; et il relisait indéfiniment les clauses relatives à cette question. Les Romains se refusaient catégoriquement à entrer dans toute discussion ; la chose aurait été possible, disaient-ils, si Sagonte n'avait pas été saccagée : on aurait alors pu régler la contestation par une conférence. Mais les traités avaient été violés ; les Carthaginois devaient soit livrer les coupables, pour prouver qu'ils n'étaient pas de connivence avec eux, mais que l'attentat avait été commis sans leur assentiment, soit refuser et reconnaître ainsi leur complicité : telle était l'argumentation générale à laquelle les Romains s'en tenaient. J'ai pensé qu'il ne fallait pas passer trop rapidement sur ce point, mais qu'il fallait faire savoir la vérité d'abord aux gens qui, dans des délibérations fort importantes, ont besoin de la connaître très exactement, puis aux lecteurs désireux d'approfondir cette question et que l'ignorance ou la partialité des historiens ne manquerait pas d'égarer ; voilà pourquoi j'ai voulu donner sur les conventions passées entre les Romains et les Carthaginois depuis les origines jusqu'à nos jours des renseignements qui ne pussent être contestés.
[322] Le premier traité entre Rome et Carthage date du temps de L. Junius Brutus et de M. Horatius, les premiers consuls nommés après l'expulsion des rois, par qui fut consacré le temple de Jupiter Capitolin ; il fut conclu vingt-huit ans avant l'invasion de Xerxès en Grèce. Je vais en donner le texte, interprété aussi exactement qu'il m'a été possible ; car la langue de cette époque archaïque diffère tellement du latin actuel que les plus habiles ont parfois de la peine à la comprendre, quelque attention qu'ils y apportent. En voici la teneur : « Entre les Romains et leurs alliés d'une part, les Carthaginois et leurs alliés de l'autre, il y aura paix et amitié aux conditions suivantes : Les Romains et leurs alliés ne navigueront pas au-delà du cap Beau, à moins d'y être poussés par la tempête ou chassés par leurs ennemis ; s'ils le dépassent en cas de force majeure, il ne leur sera permis d'acheter ou de prendre que ce qui leur sera nécessaire pour radouber leur vaisseau ou pour faire un sacrifice. Les mar- chands pourront trafiquer à Carthage, mais aucun marché ne sera valable s'il n'a été conclu par l'intermédiaire du crieur public et du greffier. Pour tout article vendu en leur présence, la foi publique sera garante à l'égard du vendeur; il en sera ainsi pour les marchés conclus en Afrique et en Sardaigne. Si un Romain aborde dans la partie de la Sicile soumise à Carthage, tous ses droits seront respectés. Les Carthaginois ne feront aucun tort aux habitants d'Ardée, d'Antium, de Laurentium, de Circée et de Terracine, ni à aucun autre des Latins sujets de Rome ; ils s'abstiendront d'attaquer les villes non sujettes des Romains et, s'ils en prennent une, ils la remettront aux Romains sans lui causer aucun dommage. Ils ne bâtiront aucun fort dans le Latium ; s'ils débarquent en armes sur les terres des Latins, ils n'y passeront pas la nuit.»
[323] Le cap Beau est le promontoire qui s'étend devant Carthage du côté du Nord ; les Carthaginois interdisent absolument aux Romains de le dépasser vers le sud sur des vaisseaux de course, pour ne pas leur laisser voir, à ce que je crois, de quelle fertilité sont la Byzacène et la région voisine de la petite Syrte qu'ils appellent les Empories. Si quelqu'un y est contraint par la tempête ou par la poursuite des ennemis, ils consentent à ce qu'il se procure ce qui peut lui être nécessaire pour le radoub de son vaisseau ou pour un sacrifice, mais rien d'autre ; et ils exigent que ceux qui abordent dans ces conditions repartent dans les cinq jours. Ils autorisent les Romains à venir trafiquer à Carthage, sur toutes les côtes d'Afrique situées en deçà du cap Beau, en Sardaigne et dans la partie de la Sicile qui leur est soumise; et ils promettent solennellement de respecter les droits de chacun. Dans ce traité, les Carthaginois parlent de la Sardaigne et de l'Afrique comme de pays leur appartenant ; pour la Sicile, au contraire, ils spécifient que les conventions ne concernent que la partie où s'exerce leur domination. De même, les Romains ne traitent que pour le Latium ; ils ne font pas mention du reste de l'Italie, parce qu'il ne leur était pas encore soumis.
[324] Après ce traité, ils en conclurent un second, où les Carthaginois firent comprendre les habitants de Tyr et d'Utique, et où ils ajoutèrent au nom du cap Beau ceux de Mastia et de Tarséion, points au-delà desquels ils défendaient aux Romains de faire du butin ou de fonder une ville. En voici à peu près les termes. « Entre les Romains et leurs alliés d'une part, les Carthaginois, les habitants de Tyr, d'Utique et leurs alliés de l'autre, il y aura paix et amitié aux conditions suivantes ; Les Romains s'abstiendront de faire du butin, de trafiquer ou de fonder une ville au-delà du cap Beau, de Mastia et de Tarséion. Si les Carthaginois s'emparent, dans le Latium, d'une place qui ne soit pas sujette de Rome, ils garderont l'argent et les prisonniers, mais remettront la place aux Romains. Si les Carthaginois prennent quelque citoyen d'un peuple qui soit en paix avec Rome de par un traité formel, mais sans lui être soumis, ils ne le débarqueront pas dans un port romain ; s'il y est débarqué et qu'un Romain mette la main sur lui, il sera remis en liberté. Les Romains, de leur côté, observeront les mêmes réserves. Si un Romain prend de l'eau ou des vivres dans une contrée soumise aux Carthaginois, il ne s'en servira pour porter tort à aucun ami ou allié de Carthage. Si cette clause est transgressée, on ne devra pas se faire justice soi-même ; si quelqu'un le fait, la nation entière sera rendue responsable de ses actes. Les Romains ne pourront ni trafiquer ni fonder une ville en Sardaigne ou en Afrique ; ils n'y aborderont que pour prendre des vivres ou radouber leurs vaisseaux; si une tempête les y pousse, ils en repartiront dans les cinq jours. A Carthage et dans la partie de la Sicile où s'exerce la domination des Carthaginois, ils auront le droit d'agir et de trafiquer comme les citoyens. Il en sera de même pour les Carthaginois à Rome. » Dans ce traité, les Carthaginois parlent encore de l'Afrique et de la Sardaigne comme de pays qui leur appartiennent, et n'accordent pas aux Romains le droit d'y débarquer; au contraire, en ce qui concerne la Sicile, ils spécifient qu'il s'agit seulement de la partie qui leur est soumise. Les Romains font de même pour le Latium : ils interdisent aux Carthaginois de porter tort aux habitants d'Ardée, d'Antium, de Circée et de Terràcine, c'est-à-dire des villes situées sur la côte du Latium, car c'est cette province que vise la convention.
[325] Lors de l'invasion de Pyrrhus, les Romains conclurent encore avec les Carthaginois un troisième traité, le dernier avant la guerre de Sicile. Il maintenait toutes les clauses des pactes précédents, mais en y ajoutant les suivantes : « Si l'un ou l'autre des deux états fait alliance avec Pyrrhus, il devra spécifier par écrit cette condition : il leur sera permis de se venir en aide mutuellement, si l'un des deux est attaqué sur son territoire ; quel que soit celui des deux qui ait besoin de secours, c'est Carthage qui fournira les vaisseaux et pour le transport et pour les combats ; mais chaque pays paiera la solde de ses troupes. Les Carthaginois porteront secours aux Romains même sur mer, en cas de besoin, mais les équipages ne seront jamais obligés de débarquer, s'ils s'y refusent. » Voici par quels serments ces traités étaient confirmés : pour le premier, les Carthaginois jurèrent par les dieux de leurs pères et les Romains, suivant une coutume antique, par Jupiter Lapis ; pour le dernier, ils ajoutèrent une invocation à Mars et à Ényalios. Le serment par Jupiter Lapis se fait ainsi : le prêtre chargé de sanctionner le traité prend une pierre à la main et, après avoir juré par la foi publique, prononce ces paroles : « Si je dis vrai, qu'il m'arrive bonheur ; si je pense autrement que je ne parle, que tous les autres gardent tranquillement, dans leur patrie et sous leurs lois, leurs biens, leurs pénates et leurs tombeaux ; que moi seul je sois rejeté comme je rejette cette pierre. » En disant ces mots, il lance la pierre loin de lui.
[326] Les textes de ces traités existent encore : on les conserve gravés sur des tables de bronze, dans les archives des édiles au temple de Jupiter Capitolin. On ne saurait reprocher à l'historien Philinos de ne pas les avoir connus : cette ignorance est excusable, car j'ai vu des Romains et des Carthaginois, même des des plus vieux et des plus instruits dans l'histoire de leur pays, qui ne les connaissaient pas non plus ; mais on est en droit de se demander pourquoi et comment il a osé écrire le contraire de ce qui s'y trouve : il prétend qu'il y avait entre Rome et Carthage des conventions qui fermaient aux Romains toute la Sicile, aux Carthaginois toute l'Italie, et que les Romains les ont transgressées, au mépris de leurs serments, quand ils ont pour la première fois passé en Sicile ; or il n'y a jamais eu une clause de ce genre, on n'en trouverait nulle part la moindre trace. C'est pourtant ce qu'il affirme catégoriquement dans son second livre. J'avais déjà dit un mot de cette question dans mon introduction, mais j'avais attendu jusqu'à maintenant pour en parler en détail, afin de redresser l'erreur où un certain nombre de lecteurs sont tombés sur la foi de Philinos. Sans doute, à propos de cette expédition en Sicile, on peut reprocher aux Romains d'avoir voulu se faire à tout prix des alliés des Mamertins et de s'être ensuite rendus à leurs appels en leur portant secours, malgré la perfidie qu'ils avaient montrée à l'égard de Messine et de Rhégium; leur conduite, en cette circonstance, est peu défendable. Mais prétendre qu'en débarquant en Sicile ils ont violé leurs traités et leurs serments, c'est faire preuve d'une ignorance notoire.
[327] Quand la guerre de Sicile fut terminée, ils conclurent un autre traité, dont voici les principales dispositions : « Les Carthaginois évacueront toutes les îles situées entre l'Italie et la Sicile. Chacun des deux contractants s'abstiendra de molester les alliés de l'autre, de prélever de force quoi que ce soit sur un territoire appartenant à l'autre, d'y construire aucun bâtiment public, d'y lever des mercenaires, de traiter avec les alliés de l'autre. Les Carthaginois paieront en dix ans deux mille deux cents talents, dont mille seront versés immédiatement. Tous les prisonniers romains seront rendus sans rançon par les Carthaginois. » Ensuite, quand après la guerre d'Afrique les Romains déclarèrent la guerre à Carthage, ils firent inscrire l'article additionnel suivant : « Les Carthaginois évacueront la Sardaigne et paieront une indemnité supplémentaire de douze cents talents. » J'avais déjà parlé de cette convention. Il y en eut enfin une dernière, celle que les Romains firent en Espagne avec Hasdrubal, et qui interdisait aux Carthaginois de s'avancer en armes au-delà de l'Èbre. Tels furent les pactes conclus entre Rome et Carthage depuis les origines jusqu'à l'époque d'Hannibal.
[328] Les Romains n'avaient donc pas, nous l'avons vu, manqué à leur parole en passant en Sicile; quant à la seconde guerre, celle qui donna lieu au traité relatif à la Sardaigne, ils n'avaient ni raison, ni prétexte plausible pour la susciter ; il faut bien reconnaître qu'ils ont abusé des circonstances en forçant les Carthaginois, contre toute justice, à leur céder la Sardaigne et à leur verser une somme aussi considérable. lls ont beau objecter que leurs commerçants avaient subi des vexations pendant la guerre d'Afrique ; ce grief était oublié depuis que les Carthaginois avaient relâché tous les navires qu'ils avaient arrêtés et que, par reconnaissance, les Romains leur avaient restitué sans rançon tous leurs prisonniers. Mais j'ai exposé ces incidents en détail dans le livre précédent. Il ne nous reste donc plus qu'à examiner auquel des deux partis incombe la responsabilité de la guerre d'Hannibal.
[329] J'ai déjà rapporté les allégations des Carthaginois ; voyons maintenant celles des Romains. Il ne s'agit pas d'arguments qu'ils auraient alors fait valoir, car ils étaient si indignés du sac de Sagonte qu'ils ne songeaient pas à discuter, mais de raisons qu'on les entend souvent invoquer aujourd'hui. Ils soutiennent en premier lieu que les Carthaginois avaient tort de ne tenir aucun compte de la convention passée avec Hasdrubal, car elle ne portait pas, comme celle de Lutatius : « Le présent traité aura force de loi s'il est ratifié par le peuple romain. » Mais Hasdrubal avait eu pleine autorité pour conclure ce pacte, où il était dit simplement que « les Carthaginois ne s'avanceraient pas en armes au-delà de l'Èbre. » Dans le traité relatif à la Sicile, il était bel et bien stipulé, comme l'affirment les Romains, que « chacun des deux contractants s'abstiendrait de molester les alliés de l'autre » ; ce texte ne s'applique pas uniquement aux alliés qu'ils avaient alors, comme le prétendaient les Carthaginois ; car on aurait ajouté, en ce cas, qu'aucune alliance ne serait conclue en dehors de celles qui existaient déjà ou que le traité ne concernait pas les peuples avec qui l'on ferait alliance ultérieurement. Puisqu'aucune de ces deux restrictions n'avait été énoncée, il était clair que chaque état devait s'abstenir de molester les alliés que l'autre avait alors ou qu'il se créerait ensuite. Cette interprétation était tout à fait logique : ils n'allaient évidemment pas signer un traité qui leur enlevât la liberté de contracter les amitiés et les alliances que les circonstances exigeraient ou qui les contraignît de laisser en butte à des vexations des gens qui se seraient placés sous leur protection. Tout ce que l'on entendait stipuler de part et d'autre par ce traité, c'était, pour les alliés que les deux états avaient alors, qu'aucun des deux ne devait soit faire tort à ceux de l'autre, soit les admettre dans son alliance ; pour les alliés qu'ils feraient ensuite, qu'on ne lèverait pas chez eux des mercenaires, qu'aucun des deux peuples ne prélèverait de force quoi que ce fût dans les possessions de l'autre ou chez ses alliés, et que les alliés de l'un seraient toujours en sûreté chez l'autre.
[330] Ceci posé, il était incontestable que les Sagontins s'étaient placés sous la protection de Rome bien des années avant l'époque d'Hannibal. La meilleure preuve — et les Carthaginois eux-mêmes reconnaissent le fait — en est que, lorsqu'une sédition éclata à Sagonte, ce ne furent pas les Carthaginois, leurs voisins pourtant et les maîtres de l'Espagne, mais les Romains dont les habitants sollicitèrent l'intervention pour rétablir l'ordre. Par conséquent, si l'on considère le sac de Sagonte comme la cause de la guerre, il faut reconnaître que les Carthaginois la provoquèrent au mépris de toute justice, puisqu'ils violaient et le traité de Lutatius, qui défendait d'attaquer les alliés de l'autre parti, et celui d'Hasdrubal, qui interdisait aux Carthaginois de porter leurs armes au delà de l'Èbre ; mais si on attribue l'origine de cette guerre d'Hannibal à la confiscation de la Sardaigne et à l'amende infligée en même temps, il faut avouer que les Carthaginois avaient quelque raison de s'y engager : ils ne faisaient que saisir l'occasion favorable pour se venger des Romains, comme ceux-ci avaient profité d'une occasion favorable pour les opprimer.
[331] Des esprits peu réfléchis diront peut-être qu'il n'était pas nécessaire de tant insister sur cette question. Si l'homme pouvait se suffire à lui-même en toute circonstance, la connaissance du passé serait sans doute intéressante, mais non pas nécessaire ; mais personne n'oserait prétendre qu'il en soit ainsi, ni dans la conduite de sa vie privée, ni dans celle des affaires publiques ; les gens sensés n'escompteront jamais l'avenir en se fondant sur le présent, quelque heureux qu'il soit. Voilà pourquoi il n'est pas seulement intéressant, mais il est surtout nécessaire, à mon avis, de savoir ce qui est arrivé avant nous. Comment trouverons-nous, autrement, des alliés disposés à nous porter secours, quand nous serons, nous ou notre patrie, en butte à quelque vexation? Si nous voulons étendre nos possessions ou nous lancer dans quelque entreprise, comment pourrons-nous faire entrer les autres dans nos vues et nous assurer leur concours ? Sommes-nous satisfaits de la situation présente : comment les gagnerons-nous à notre cause et les déciderons-nous à s'en faire les défenseurs, si nous ignorons complètement l'histoire du passé? Les gens s'accommodent toujours aux circonstances, comme s'ils jouaient un rôle ; ils parlent et agissent de telle manière qu'il est difficile de pénétrer leurs pensées et que la vérité est bien des fois enveloppée de ténèbres. Pour le passé, au contraire, ce sont les faits eux-mêmes qui nous permettent de porter un jugement, qui dévoilent clairement les pensées et les sentiments de chacun, qui nous font savoir de qui nous devons attendre reconnaissance, bienfaits, assistance, ou l'inverse; c'est par eux que nous pouvons bien souvent prévoir qui aura pitié de nous, qui ressentira nos offenses et nous aidera à en tirer vengeance Or aucune connaissance n'est plus précieuse dans notre vie privée ou publique. Aussi doit-on attacher moins d'importance, quand on lit ou qu'on écrit l'histoire, au récit des faits qu'à ce qui s'est passé auparavant, en même temps et après ; car si l'on supprime la recherche des causes, des moyens, des intentions et des conséquences heureuses ou malheureuses de chaque événement, l'histoire n'est plus qu'un jeu d'esprit, elle ne sert plus à l'instruction du lecteur ; elle distrait sur le moment, mais on n'en tire absolument aucun profit pour l'avenir.
[332] Les gens qui s'imaginent que mon ouvrage, composé d'un grand nombre de gros volumes, leur coûtera trop à acheter et à lire, sont par conséquent dans l'erreur. N'est-il pas bien plus facile d'acheter et de lire quarante livres tissés, pour ainsi dire, d'affilée pour suivre méthodiquement la trame des événements qui se sont déroulés en Italie, en Sicile et en Afrique depuis l'époque de Pyrrhus jusqu'à la prise de Carthage, et dans les autres pays du monde depuis la fuite de Cléomène, roi de Sparte, jusqu'à la rencontre des Achéens et des Romains dans l'isthme de Corinthe, — n'est-ce pas plus facile, dis-je, que de lire ou d'acheter les ouvrages qui traitent en particulier chacune de ces questions ? Outre que ces livres sont en beaucoup plus grand nombre que les miens, les lecteurs ne peuvent en tirer aucune conclusion bien solide, d'abord parce que la plupart des auteurs donnent des versions différentes des mêmes faits, puis parce qu'ils négligent de faire des rapprochements avec les événements contemporains, rapprochements qui nous font juger des choses tout autrement que si nous les examinions séparément ; sans compter que dans les ouvrages de ce genre les questions les plus importantes ne peuvent même pas être effleurées. Comme je l'ai dit, rien n'est plus nécessaire en matière d'histoire que d'établir les conséquences d'un fait, les circonstances qui l'ont accompagné et surtout ses causes. C'est ainsi que nous trouvons l'origine de la guerre d'Antiochos dans celle de Philippe, de celle de Philippe dans celle d'Hannibal, de celle d'Hannibal dans celle de Sicile, et nous voyons que les incidents nombreux et variés qui se sont produits dans l'intervalle tendaient tous vers la même fin. Tout cela, on peut le trouver et l'apprendre dans une histoire universelle, mais non dans le pur et simple récit de chaque guerre, celle de Persée, par exemple, ou celle de Philippe ; à moins qu'en lisant chez les auteurs dont je parlais la description des batailles on ne croie discerner nettement le plan et l'économie de toute une campagne. Mais ce serait une singulière aberration ; autant donc il vaut mieux avoir appris une chose que de l'avoir seulement entendu raconter, autant, à mon avis, mon histoire est supérieure à toutes ces narrations particulières.
[333] Pour en revenir à notre sujet, les ambassadeurs romains ne répondirent rien à la harangue des Carthaginois ; mais le plus âgé d'entre eux, montrant son giron aux sénateurs, leur déclara qu'il y apportait pour eux la guerre ou la paix, et qu'en secouant les plis de sa toge il en laisserait tomber ce qu'ils préféreraient: «Choisissez vous-mêmes, répliqua le suffète de Carthage. — Ce sera donc la guerre », dit le Romain. Les sénateurs s'écrièrent qu'ils l'acceptaient; et là-dessus les ambassadeurs quittèrent le Sénat. Hannibal était alors à Carthagène, dans ses quartiers d'hiver. Il commença par renvoyer ses Espagnols dans leurs foyers, pour leur donner du zèle et de l'ardeur en vue des entreprises qu'il méditait. Puis il indiqua à son frère Hasdrubal comment il faudrait gouverner l'Espagne et quelles mesures il y aurait à prendre contre les Romains, s'il venait à se séparer de lui. En troisième lieu, il se préoccupa d'assurer la tranquillité en Afrique ; il eut pour cela l'idée très prudente et très judicieuse de faire passer des soldats d'Afrique en Espagne, et réciproquement, pour resserrer par cet échange les liens de fidélité mutuelle des deux pays. Ceux qui passèrent en Afrique furent les habitants de Tarséion et de Mastia, les Orètes et les Olcades, soit en tout douze cents cavaliers et treize mille huit cent cinquante fantassins, plus un détachement de Baléares; ce nom signifie proprement frondeurs, mais désigne aussi ces peuplades et l'île qu'elles habitent, par suite de l'usage qu'elles font de la fronde. La plus grande partie de ces troupes fut dirigée sur la Métagonie et le reste sur Carthage même. Il tira des villes de Métagonie quatre mille fantassins, qu'il envoya également à Carthage, pour y servir à la fois d'otages et de réserves. Il laissa à son frère Hasdrubal, en Espagne, cinquante vaisseaux à cinq rangs de rames, deux à quatre rangs, cinq à trois ; trente-deux de la première catégorie et les cinq de la dernière avaient leurs équipages; il lui laissa encore une cavalerie composée de quatre cent cinquante Carthaginois et Africains, de trois cents Lergètes, de dix-huit cents Numides, Massyliens, Masésyliens, de Maccéens et de Maures des bords de l'Océan, un corps d'infanterie qui comprenait onze mille huit cent cinquante Africains, trois cents Ligures et cinq cents Baléares, enfin vingt et un éléphants. Il ne faut pas s'étonner de me voir donner sur l'administration d'Hannibal en Espagne des détails dont la précision serait difficilement égalée, même par quelqu'un qui l'aurait dirigée en personne ; je prie le lecteur de n'avoir aucune prévention contre moi et de ne pas m'accuser d'avoir imité les écrivains dont l'unique ambition est de faire prendre leurs inventions pour la vérité. Mes informations proviennent d'un mémoire que j'ai découvert moi-même au cap Lacinium, sur une table de bronze où Hannibal l'avait fait graver pendant son séjour en Italie; j'ai considéré comme certaine l'authenticité des faits qu'il contient et j'ai cru pouvoir me fier à ce document.
[334] Après avoir tout réglé pour la sûreté de l'Afrique et de l'Espagne, Hannibal n'attendit plus que l'arrivée des messagers que lui envoyaient les Gaulois; il avait fait prendre des renseignements précis touchant la fertilité de la région située au pied des Alpes et sur les bords du Pô, le nombre de ses habitants et leur courage guerrier ; il voulait surtout savoir s'ils avaient gardé contre les Romains quelque rancune de leurs défaites, que j'ai racontées dans le livre précédent pour faciliter aux lecteurs l'intelligence de ce que je vais dire maintenant. Il comptait beaucoup sur leur appui et ne ménageait pas les promesses ; il envoyait de fréquentes ambassades aux chefs gaulois, tant à ceux de la Cisalpine qu'à ceux des Alpes mêmes; il pensait en effet qu'il ne lui serait possible de faire la guerre aux Romains en Italie que s'il surmontait d'abord les difficultés du trajet jusqu'aux pays dont nous parlons, et s'il s'assurait l'alliance et le concours des Gaulois. Ses messagers, de retour, l'informèrent des dispositions favorables et de l'impatience des Gaulois ; ils lui dirent que la traversée des Alpes serait extrêmement pénible, vu la hauteur de ces montagnes, mais non pas impossible. Le printemps venu, il fit sortir son armée de ses quartiers d'hiver. Il venait de recevoir des nouvelles de Carthage ; l'approbation de ses compatriotes lui donnant du courage et de la confiance, il excita dès lors ouvertement ses troupes à la guerre contre Rome. Il rappelait comment les Romains avaient demandé qu'on le leur livrât avec tous ses officiers, vantait la fertilité du pays où on allait se rendre, faisait valoir l'alliance et l'amitié des Gaulois. Ses soldats se déclarant prêts à le suivre, il les remercia, leur indiqua le jour qu'il avait fixé pour le départ et les congédia.
[335] Après avoir fait tous ses préparatifs pendant l'hivernage et pourvu à la sûreté de l'Afrique comme de I'Espagne, il se mit en marche au jour dit, avec quatre-vingt-dix mille fantassins et douze mille cavaliers. Il passa l'Ébre et soumit toutes les peuplades qu'il rencontra jusqu'aux Pyrénées : les Ilurgètes, les Bargusiens, puis les Érénosiens et les. Andosiniens. Il fit ces conquêtes et prit d'assaut quelques places en moins de temps qu'il n'eût pu l'espérer, mais au prix de plusieurs combats sanglants et de pertes considérables. Il confia à Hannon le gouvernement de toute la région située au nord de l'Èbre et le chargea surtout de contenir les Bargusiens, dont il se méfiait le plus en raison de l'amitié qui les unissait aux Romains. Il détacha de son armée dix mille fantassins et mille cavaliers, qu'il laissa à Hannon avec tous ses bagages. Il en renvoya un égal nombre dans leurs foyers, à la fois pour se concilier les bonnes grâces de ceux qu'il congédiait ainsi et pour donner l'espoir d'une semblable libération à tous leurs compagnons, aussi bien à ceux qu'il emmenait avec lui qu'à ceux qui restaient en Espagne ; de la sorte, tous seraient prêts à se lever s'il avait un jour besoin de leur assistance. Il partit alors avec le reste de ses troupes, légèrement chargées, au nombre de cinquante mille fantassins et d'environ neuf mille cavaliers, pour aller passer d'abord les Pyrénées, puis le Rhône. Son armée n'était pas extrêmement nombreuse ; mais elle était solide et bien aguerrie par les luttes continuelles qu'elle avait soutenues en Espagne.
[336] Pour que l'ignorance des lieux ne rende pas mon récit tout à fait obscur, il est bon que j'indique l'endroit d'où Hannibal est parti, toutes les régions par où il est passé et la partie de l'Italie par où il est entré. Il ne s'agit pas de nommer simplement les contrées, les rivières et les villes, comme font quelques historiens, qui s'imaginent que cela suffit pour les faire connaître et en donner une idée claire. En ce qui concerne les endroits connus, je crois que l'indication des noms est un excellent moyen de nous les remettre en mémoire ; mais pour ceux que nous ne connaissons pas du tout, cette énumération n'a pas plus de valeur que des vocables dénués de toute signification : ce n'est qu'un son qui frappe notre oreille ; l'esprit n'a aucun point d'appui, il ne peut faire aucun rapprochement entre ce qu'on lui dit et les connaissances qu'il possède déjà ; si bien que le récit devient confus et inintelligible. Il faudrait donc trouver une méthode qui permît, tout en parlant de choses inconnues, de les rattacher, dans une certaine mesure, à des concepts bien établis et familiers aux lecteurs. La première de ces notions, la plus importante et la plus universelle, accessible à tous ceux qui ont une lueur d'intelligence, est celle de la division de l'espace en quatre parties et de la répartition des lieux par leur position relative à l'un des quatre points cardinaux: l'Orient, le Couchant, le Midi, le Nord. La seconde est celle par laquelle, en distribuant ainsi les diverses régions terrestres et en plaçant toujours par la pensée les endroits dont on nous parle dans une des zones ainsi déterminées, nous rapportons aux sites inconnus et nouveaux pour nous des images déjà acquises et familières.
[337] Après avoir ainsi procédé pour l'ensemble du globe terrestre, il n'y a plus, pour donner aux lecteurs une juste idée du monde que nous habitons, qu'à le sectionner d'après le même système. Or, il se divise en trois continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, qui ont pour bornes deux fleuves, le Tanaïs et le Nil, et un détroit, les Colonnes d'Hercule. L'Asie s'étend depuis le Nil jusqu'au Tanaïs et occupe la partie de l'univers située entre le Midi et le point où le soleil se lève en été. L'Afrique va du Nil aux Colonnes d'Hercule ; elle est située au Midi et du côté où le soleil se couche en hiver, et s'étend jusqu'au couchant équinoxial, qui se trouve précisément aux Colonnes d'Hercule. Ces deux continents, considérés dans leur ensemble, forment le rivage méridional de la Méditerranée, de l'Orient à l'Occident ; l'Europe leur fait face du côté du Nord d'un bout à l'autre, depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. C'est dans sa partie septentrionale qu'elle atteint sa plus grande largeur, entre le Tanaïs et la rivière de Narbonne, qui coule un peu à l'Ouest de Marseille et des bouches par où le Rhône se jette dans la mer de Sardaigne. Tout le pays situé entre la rivière de Narbonne et la région qu'elle arrose, d'une part, la chaîne des Pyrénées, de l'autre, est habité par des Gaulois. Cette chaîne s'étend sans interruption de la Méditerranée à la mer Extérieure. Le reste de l'Europe, c'est-à-dire la partie qui va depuis les Pyrénées jusqu'au Couchant et aux Colonnes d'Hercule, est borné d'un côté par la Méditerranée, de l'autre par la Mer Extérieure ; la région voisine de la Méditerranée jusqu'aux Colonnes d'Hercule s'appelle l'Espagne; celles qui baignent la Mer Extérieure ou Grande Mer n'ont pas encore de dénomination commune, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on les a découvertes; elles sont entièrement habitées par des peuplades barbares très nombreuses, dont je ferai plus tard l'énumération détaillée
[338] Personne, jusqu'à nos jours, n'a encore pu dire d'une manière certaine si la région où se rejoignent l'Asie et l'Afrique (c'est en Éthiopie que se trouve ce point de jonction) constitue un continent qui se prolonge vers le Midi ou si elle est entourée par la mer ; de même, les contrées qui s'étendent vers le Nord, entre le Tanaïs et la rivière de Narbonne, nous sont jusqu'ici complètement inconnues ; peut-être dans I'avenir, en multipliant nos recherches, en apprendrons-nous quelque chose ; mais on peut affirmer que ceux qui parlent ou écrivent à ce sujet le font à la légère, sans rien savoir, et ne débitent que des fables. Voilà ce que j'avais à dire pour que mon récit ne fût pas complètemennt inintelligible aux lecteurs qui ne connaîtraient pas les lieux; je voulais, en me fondant sur l'orientation pour diviser la terre en quelques grandes régions, fournir un point de repère qui permît de situer par la pensée le théâtre des événements que je raconterais. De même que pour voir un objet nous avons l'habitude de tourner les yeux du côté qu'on nous indique, de même nous devons toujours nous transporter en esprit dans les endroits dont un auteur nous parle.
[339] Mais laissons cela et reprenons notre récit. Les Carthaginois étaient, à l'époque dont nous parlons, les maîtres de toute la côte méditerranéenne de l'Afrique depuis les autels des Philènes, situés sur la grande Syrte, jusqu'aux Colonnes d'Hercule, ce qui fait une longueur de plus de seize mille stades. Ils avaient en outre franchi ce détroit des Colonnes d'Hercule et conquis toute l'Espagne jusqu'au promontoire rocheux par où se termine, sur la Méditerranée, la chaîne des Pyrénées, qui sépare l'Espagne de la Gaule. Ce point est à huit mille stades environ des Colonnes d'Hercule, puisqu'il y en a trois mille du détroit à Carthagène, d'où Hannibal partit pour son expédition en Italie, deux mille six cents de Carthagène à l'Èbre et seize cents de l'Èbre à Emporion. De cette ville au passage du Rhône, il y en a encore seize cents ; puis, si l'on remonte le fleuve depuis ce point jusqu'à l'endroit où l'on commence à gravir les Alpes pour passer en Italie, on en compte quatorze cents. La traversée des Alpes fait encore à peu près douze cents stades ; c'est ainsi qu'on arrive en Italie, dans la plaine du Pô. Hannibal avait donc en tout, depuis Carthagène, environ neuf mille stades à parcourir ; il avait déjà fait presque la moitié du chemin, mais la partie du trajet qui lui restait à effectuer était de beaucoup la plus pénible.
[340] — Hannibal se préparait à passer les défilés des Pyrénées, où il craignait fort d'être arrêté par les Gaulois. C'est à ce moment que les Romains surent, par les ambassadeurs qu'ils avaient envoyés à Carthage, ce qui s'y était dit et décrété. Apprenant qu'Hannibal avait passé l'Èbre avec ses troupes plus tôt qu'ils ne s'y attendaient, ils prirent la résolution d'expédier une armée en Espagne sous les ordres de P. Cornélius Scipion et une autre en Afrique avec Ti. Sempronius. Pendant que les consuls procédaient à l'enrôlement des soldats et aux autres préparatifs, on se hâta d'achever l'organisation des colonies qu'on avait décidé auparavant d'envoyer dans la Gaule Cisalpine. On activa, dans les villes, la construction des remparts et on donna l'ordre à ceux qui devaient y habiter de s'y rendre dans les trente jours. On créa ainsi deux villes de six mille colons chacune : la première, en deçà du Pô, fut nommée Plaisance ; la seconde, sur l'autre rive du fleuve, fut appelée Crémone. A peine étaient- elles fondées que les Boïens, qui depuis longtemps ne feignaient d'être les amis des Romains que pour les attirer dans quelque piège, mais n'en avaient pas encore trouvé l'occasion, apprirent l'arrivée des Carthaginois ; ils sentirent renaître leur espoir, relevèrent la tête et se détachèrent des Romains, en abandonnant les otages qu'ils leur avaient donnés après la dernière guerre, que j'ai racontée dans le livre précédent. Ils firent des ouvertures aux Insubres, dont le ressentiment n'était pas encore apaisé, et, de concert avec eux, ravagèrent le territoire que les Romains avaient partagé entre leurs colons ; ces derniers s'enfuirent; les Gaulois les poursuivirent jusqu'à la colonie romaine de Modène et mirent le siège devant cette place. Ils y tinrent enfermés, entre autres, trois personnages considérables, qui avaient été envoyés pour faire le partage des terres : C. Lutatius, ancien consul, et deux anciens préteurs. Les magistrats demandèrent aux assiégeants une entrevue ; les Boïens la leur accordèrent ; mais à peine furent-ils sortis de la ville que les ennemis s'emparèrent traîtreusement de leurs personnes, dans l'espoir de recouvrer leurs otages en les échangeant avec eux. A cette nouvelle, le préteur L. Manlius, qui tenait garnison dans ces parages, vint en hâte à la rescousse. Mais en apprenant son arrivée, les Boïens se mirent en embuscade dans une forêt ; dès que les Romains furent entrés sous bois, ils fondirent sur eux de tous les côtés à la fois et en tuèrent un grand nombre. Les autres commencèrent par s'enfuir, puis ils gagnèrent des hauteurs et s'y rallièrent ; mais c'était une retraite à peine honorable. Les Boïens se mirent à leur poursuite et les investirent dans un bourg nommé Tannès. Quand on apprit à Rome que la quatrième légion était cernée et vivement pressée par les Boïens, on se hâta d'envoyer à son secours, sous le commandement d'un préteur, les troupes qu'on avait équipées pour Scipion; et l'on donna au consul l'ordre d'aller en lever de nouvelles chez les alliés.
[341] Tels furent les événements qui se déroulèrent en Gaule jusqu'à l'arrivée d'Hannibal ; je les avais déjà exposés en partie précédemment avant d'y revenir ici. Cependant les consuls romains, qui avaient l'un et l'autre terminé leurs préparatifs, partirent chacun de son côté pour la destination qui leur avait été assignée : Scipion se dirigea vers l'Espagne avec soixante vaisseaux, Ti. Sempronius vers l'Afrique avec cent soixante bâtiments à cinq rangs de rames. Ce dernier montrait une telle ardeur belliqueuse, équipait sa flotte à Lilybée de façon si formidable, rassemblait de toutes parts des troupes si nombreuses qu'on eût dit qu'il allait, dès son débarquement, mettre le siège devant Carthage. Quant à Scipion, il longea la côte de Ligurie, fit en cinq jours le trajet de Pise à Marseille, vint aborder à la première bouche du Rhône, qu'on appelle Bouche de Marseille, et fit débarquer ses troupes. Il apprit qu'Hannibal avait déjà franchi les Pyrénées, mais pensa qu'il était encore loin, vu les difficultés naturelles de la route et le grand nombre de Gaulois dont il avait à traverser le pays. Mais Hannibal, qui avait acheté les uns et bousculé les autres, arriva brusquement avec son armée, ayant à main droite la mer de Sardaigne, pour tenter le passage du Rhône. A la nouvelle que l'ennemi était tout près, Scipion, se refusant à croire à une marche aussi rapide et voulant être exactement renseigné à ce sujet, envoya en reconnaissance trois cents de ses cavaliers les plus braves, guidés et appuyés par des Gaulois à la solde des Marseillais ; pendant ce temps, il faisait reposer ses soldats des fatigues de la traversée et délibérait avec ses tribuns afin de savoir quels postes il convenait d'occuper pour livrer bataille.
[342] Hannibal établit son camp sur les bords du fleuve, qu'il avait atteint à environ quatre jours de marche de la mer, et se disposa aussitôt à le traverser en cet endroit, où il n'avait qu'un lit. Il usa de tous les moyens pour se concilier la bienveillance des habitants, à qui il acheta toutes leurs pirogues et toutes leurs chaloupes ; ils en possédaient une grande quantité, parce que la plupart des riverains du Rhône pratiquent le commerce par mer. Il leur acheta en outre tout le bois dont on pouvait se servir pour la construction des pirogues ; et en deux jours on eut fait un nombre incalculable de ces embarcations ; car chacun s'efforçait de n'avoir pas à compter sur autrui et de se mettre en état de franchir le fleuve par ses propres moyens. Mais à ce moment, une foule de barbares se groupèrent sur l'autre rive pour empêcher les Carthaginois de traverser. Hannibal examina la situation et se dit qu'il ne lui était possible ni de forcer le passage, étant donné le nombre des ennemis postés en face, ni de rester où il était sans risquer d'être enveloppé : il détacha donc, la troisième nuit, une partie de son armée sous la conduite de guides indigènes et sous le commandement de Hannon, fils du suffète Bomilcar. Ce détachement remonta le cours du Rhône pendant environ deux cents stades, arriva à un endroit où le fleuve, se divisant en deux bras, formait une petite île et s'y établit. Les soldats coupèrent des troncs d'arbres dans la forêt voisine, les ajustèrent, les lièrent et en peu de temps eurent fait un nombre suffisant de radeaux, sur lesquels ils traversèrent le fleuve sans que personne tentât de s'opposer à leur passage. Ils occupèrent une forte position et y restèrent toute la journée, pour se reposer des fatigues de la nuit précédente et se préparer à la prochaine exécution des ordres qui leur avaient été donnés. Hannibal, de son côté, faisait de même pour les troupes qui étaient restées avec lui ; ce qui l'embarrassait le plus, c'était de faire traverser le fleuve à ses éléphants, qui étaient au nombre de trente-sept.
[343] La cinquième nuit arriva ; ceux qui avaient passé les premiers sur l'autre rive se mirent en route au point du jour et marchèrent, en longeant le fleuve, contre les barbares campés en face d'Hannibal. Ce dernier, qui tenait ses soldats tout prêts, fit embarquer ses cavaliers armés de boucliers sur les chaloupes, son infanterie légère sur les pirogues et se disposa à passer le fleuve. Les chaloupes étaient placées en amont et les petits canots au-dessous d'elles ; la traversée était ainsi rendue plus aisée pour les canots, parce que les chaloupes, directement exposées au courant, en rompaient la violence. Pour les chevaux, on imagina de les faire suivre à la nage derrière les chaloupes : un homme se tenait à la proue et en tirait trois ou quatre par la bride de chaque côté de l'embarcation; un nombre considérable de chevaux se trouvèrent ainsi transportés sur l'autre rive dès le premier convoi. Quand les barbares s'aperçurent de cette tentative, ils se précipitèrent en désordre hors de leur camp, persuadés qu'il leur serait facile d'empêcher les Carthaginois de prendre terre. Cependant Hannibal comprit que les soldats qu'il avait fait traverser les premiers approchaient ; car une fumée, signal convenu, annonçait leur arrivée. Il fit alors embarquer toutes ses troupes et donna l'ordre aux rameurs de lutter de toutes leurs forces contre le courant. On lui obéit aussitôt : les soldats montés sur les bateaux s'encourageaient mutuellement à grands cris et rivalisaient d'efforts pour résister à la violence du fleuve ; sur l'une des rives, leurs compatriotes les animaient et les suivaient, pour ainsi dire, de la voix, tandis que sur le bord opposé les barbares poussaient leurs cris de guerre et demandaient à combattre ; c'était un spectacle saisissant et fait pour inspirer la terreur. Les barbares avaient quitté leur campement, quand tout-à-coup surgirent les Carthaginois qui avaient déjà passé le Rhône ; les uns mettent le feu au camp ; les autres, en plus grand nombre, fondent sur les ennemis qui guettaient la descente de leurs compagnons. Pris à l'improviste, les barbares essayent les uns d'aller secourir leur campement, les autres de se défendre contre les assaillants. Hannibal, voyant le succès répondre à son attente, rangeait ses soldats à mesure qu'ils débarquaient, les exhortait et les menait à l'ennemi. Les Gaulois, surpris en désordre et déconcertés par le tour imprévu que prenait l'affaire, furent bientôt enfoncés et prirent la fuite.
[344] Maître du passage et, de plus, victorieux, le général carthaginois s'occupa aussitôt de faire transporter les soldats qui restaient encore sur la rive droite ; en peu de temps, toutes les troupes eurent traversé, et l'on campa cette nuit-là sur les bords même du fleuve. Le lendemain, à la nouvelle que la flotte romaine avait mouillé aux bouches du Rhône, il chargea cinq cents de ses cavaliers numides d'aller reconnaître la position, le nombre et les mouvements des ennemis. En même temps, il assigna à ceux qui en étaient le plus capables la tâche de faire passer les éléphants. Puis il convoqua son armée, introduisit dans l'assemblée un roitelet nommé Magile, qui était venu le trouver de la plaine du Pô, et fit expliquer aux troupes par un interprète les résolutions que les Gaulois avaient prises. Trois choses, dans le discours de Magile, étaient particulièrement faites pour encourager les soldats : en premier lieu, l'impression que produisait sur eux la présence de gens qui venaient les appeler à leur secours et leur promettaient leur appui dans la guerre contre les Romains ; ensuite, la confiance qu'inspirait cette promesse de les conduire en Italie par des chemins rapides et sûrs, où ils ne manqueraient jamais du nécessaire ; enfin la description qu'on leur faisait de la fertilité du pays où ils allaient, de son étendue et des dispositions belliqueuses où étaient les populations qui devaient les aider à combattre les armées romaines. Après cet exposé, les Gaulois se retirèrent. Hannibal s'avança alors en personne et commença par rappeler à ses soldats les hauts faits qu'ils avaient déjà accomplis : au cours de cette campagne, disait-il, ils avaient affronté bien des difficultés, bien des dangers redoutables, sans jamais éprouver aucun revers, parce qu'ils avaient suivi exactement ses instructions et ses avis ; il les exhortait donc à montrer encore la même bravoure, en se disant que le plus dur de leur tâche était fait, puisqu'ils avaient réussi à passer le fleuve et qu'ils s'étaient procuré des alliés dont ils constataient par eux-mêmes la sympathie et le dévouement ; ils n'avaient donc point à s'inquiéter de chaque détail, mais ils devaient s'en remettre à lui, se montrer dociles à ses ordres, courageux et dignes de leurs exploits antérieurs. Les soldats applaudirent, manifestèrent leur enthousiasme et leur ardeur ; il les félicita, adressa des prières aux dieux pour toute l'armée, puis il les envoya prendre du repos et hâter leurs préparatifs de départ, car il avait l'intention de lever le camp le lendemain.
[345] L'assemblée venait d'être congédiée, quand revinrent les Numides détachés en éclaireurs : la plupart d'entre eux avaient été massacrés, les autres avaient pris la fuite en désordre. A peu de distance de leur propre camp, ils s'étaient heurtés à l'escadron de cavalerie romaine que Scipion avait également envoyé en reconnaissance; une escarmouche s'était engagée, et l'on y avait mis de part et d'autre un tel acharnement qu'environ cent quarante cavaliers tant romains que gaulois et plus de deux cents Numides étaient restés sur le terrain. Après le combat, les Romains, en poursuivant les Numides, s'avancèrent assez près des retranchements carthaginois, examinèrent tout en détail, puis s'en retournèrent en toute hâte pour annoncer au consul la présence de l'ennemi ; ce qu'ils firent dès leur arrivée au camp. Aussitôt, Scipion chargea ses bagages sur les vaisseaux et se mit en marche avec toutes ses troupes, en remontant le fleuve, pour attaquer les Carthaginois. De son côté, Hannibal, le lendemain du jour où il avait réuni l'assemblée, détacha dès l'aurore toute sa cavalerie du côté de la mer pour en constituer un corps de réserve, tandis que l'infanterie quittait les retranchements et se mettait en mouvement ; pour lui, il attendit que les éléphants et les soldats qui avaient mission de les escorter l'eussent rejoint. Or voici comment cette traversée s'effectua.
[346] On construisit un certain nombre de solides radeaux, dont deux furent liés ensemble, ce qui faisait un appareil d'environ cinquante pieds de largeur, que l'on fixa fortement à terre à l'endroit de l'embarcadère. Au bout qui était hors de l'eau, on ajusta et on attacha encore deux autres radeaux, si bien que l'ensemble constituait une sorte de jetée se prolongeant sur le fleuve. Le côté qui supportait le choc du courant fut retenu par des câbles noués aux arbres qui bordaient le rivage ; on voulait éviter ainsi que tout l'ouvrage fût emporté par le flot. Quand la partie de la jetée qui avançait sur l'eau eut atteint une longueur de deux plèthres, on fit encore deux radeaux, dont la construction fut très soignée; on les plaça contre les derniers, puis on les attacha l'un à l'autre solidement, et aux autres de telle façon qu'il ne fût pas difficile de couper leurs amarres. On avait également attaché beaucoup de cordages à ces radeaux pour pouvoir les faire remorquer par des barques, les empêcher d'aller à la dérive et les amener, malgré le courant, jusqu'au bord opposé avec les éléphants qui y seraient embarqués. Ensuite on couvrit de terre tous les radeaux, de façon à en faire un chemin aussi uni et de même couleur que celui par où on descendait, sur la terre ferme, vers le lieu de l'embarquement. Les éléphants ont bien l'habitude d'obéir à leurs conducteurs indiens tant qu'ils sont sur un terrain solide; mais ils craignent de se mettre à l'eau; c'est pour cela qu'on les faisait passer sur cette espèce de digue ; deux femelles venaient en tête et les mâles les suivaient. Quand ils eurent pris place sur les derniers radeaux, on coupa les câbles qui les liaient aux autres; les barques les remorquèrent et eurent bientôt emporté loin de la digue les éléphants avec le plancher qui les soutenait. Ces animaux, inquiets, commencèrent alors par tourner en tous sens et par se précipiter de tous les côtés ; mais en se voyant complètement entourés d'eau, ils eurent peur et furent obligés de rester en place. C'est en répétant plusieurs fois la même manoeuvre avec des radeaux liés deux par deux qu'Hannibal fit passer le fleuve à la plupart de ses éléphants ; quelques-uns seulement, affolés, se jetèrent dans le fleuve au milieu de la traversée ; tous leurs conducteurs indiens se noyèrent, mais les animaux eux-mêmes purent se sauver, grâce à la force et à la longueur de leur trompe : ils élevaient cet appendice au-dessus de l'eau, ce qui leur permettait à la fois de respirer et d'expulser toute l'eau qu'ils avalaient ; ils purent ainsi faire toute la traversée sans presque jamais se laisser entraîner ni renverser par le courant.
[347] Quand les éléphants furent passés, Hannibal les plaça à l'arrière-garde ainsi que la cavalerie et se mit en marche le long du fleuve, en allant de la mer vers l'Orient, comme s'il se fût dirigé vers le centre de l'Europe. Le Rhône prend sa source au-dessus du fond de l'Adriatique, sur le versant occidental de la partie des Alpes qui s'infléchit vers le nord ; il coule vers le couchant d'hiver et va se jeter dans la mer de Sardaigne. Pendant la plus grande partie de son cours, il traverse une vallée, dont le flanc nord est habité par la tribu gauloise des Ardyens et dont le flanc sud est limité sur toute sa longueur par les contreforts des Alpes exposés au nord. La plaine du Pô, dont j'ai longuement parlé, est séparée de cette vallée du Rhône par les sommets des Alpes, qui s'étendent depuis Marseille jusqu'au golfe qui forme le fond de l'Adriatique ; Hannibal avait donc à les franchir pour passer du bassin du Rhône en Italie. Quelques-uns des écrivains qui ont raconté ce passage des Alpes ont voulu éblouir les lecteurs en introduisant du merveilleux dans leur description de ces montagnes ; ils ne se sont pas aperçus qu'ils tombaient ainsi fatalement dans deux défauts tout à fait incompatibles avec l'esprit historique : ils altèrent la vérité et ils se contredisent. Ils représentent en effet Hannibal comme un général d'une hardiesse et d'une sagesse inimitables ; et la conduite qu'ils lui attribuent est incontestablement de la dernière imprudence. D'autre part, quand ils ne peuvent trouver un dénouement et ne savent comment se tirer de leurs inventions, ils ont recours aux dieux et aux demi-dieux, qu'ils mettent en scène dans une histoire soi-disant scientifique! Les Alpes, à les en croire, seraient si escarpées et si inaccessibles que, loin de pouvoir les faire passer à des chevaux, à toute une armée, à des éléphants, on aurait beaucoup de peine à les franchir avec de l'infanterie légère ; de plus ils nous dépeignent cette région comme si déserte que, si un dieu ou un héros n'était apparu pour montrer le chemin à Hannibal, il se serait égaré et aurait péri avec tous ses compagnons. N'est-ce pas là tomber manifestement dans les deux travers que je leur ai reprochés ?
[348] Pourrait-on en effet trouver un général plus inconsidéré, un chef moins avisé qu'Hannibal, si, comme ils le prétendent, il s'était mis en marche à la tête d'une armée aussi nombreuse, sur laquelle il comptait fermement pour remporter le triomphe le plus complet, sans s'être le moins du monde informé de la route à suivre, des pays qu'on devait traverser, des peuples chez lesquels il faudrait passer ? N'était-ce pas tenter une entreprise absolument impossible? Cette action, devant laquelle reculeraient même des gens perdus sans ressources et réduits à toute extrémité, de s'engager avec une armée dans une région inconnue, ils l'attribuent à Hannibal à un moment où ses plus belles espérances de victoire n'étaient même pas entamées. En outre, quand ils nous représentent ces montagnes comme désertes, abruptes et inaccessibles, il est évident qu'ils sont bien loin de la réalité. Ils ne savaient donc pas qu'avant la venue d'Hannibal les Gaulois des bords du Rhône avaient plus d'une fois passé les Alpes et qu'ils venaient encore de le faire tout récemment, avec des forces considérables, pour aller — comme je l'ai dit plus haut — se joindre à leurs frères des plaines du Pô en guerre avec les Romains? Ils ignoraient également que les Alpes même sont habitées par une population très nombreuse ? Il fallait ne rien connaître de tout cela, pour se croire obligé de faire apparaître je ne sais quel héros, qui vient servir de guide aux Carthaginois. Ils ont donné, ce me semble, dans le même écueil que les auteurs tragiques : ces poètes ont toujours besoin, pour le dénouement de leurs pièces, d'un "deus ex machina", parce qu'ils partent de données fictives et invraisemblables ; c'est pour la même raison que nos historiens se voient forcés d'avoir recours à des apparitions de dieux et de héros, quand ils ont commencé par raconter des faits incroyables et mensongers : comment ferait-on finir raisonnablement un récit dont le début est contraire à la raison ? Pour ce qui est d'Hannibal, loin de tenir la conduite que ces écrivains lui attribuent, il agit en cette circonstance avec la plus grande prudence : il s'était soigneusement assuré des ressources du pays où il allait s'engager et des sentiments hostiles aux Romains qui y régnaient ; pour les passages difficiles, il se faisait conduire par des guides indigènes, qui avaient les mêmes intérêts que lui et qu'animaient les mêmes espérances. Je puis parler de ces événements avec assurance, parce que je tiens mes renseignements de témoins contemporains et que j'en ai visité le théâtre au cours d'un voyage que j'ai fait dans les Alpes pour observer de mes propres yeux ce qui en était.
[349] Trois jours après que les Carthaginois eurent levé le camp, Scipion, le consul romain, arriva à l'endroit où ils avaient passé le fleuve et fut extrêmement surpris en constatant qu'ils étaient partis : jamais il n'aurait imaginé qu'ils eussent l'audace de prendre ce chemin pour gagner l'Italie, vu le grand nombre de barbares dont il fallait traverser le pays et le peu de fonds qu'on pouvait faire sur leur fidélité. Quand il vit que ces obstacles ne les avaient pas arrêtés, il revint au plus vite à ses vaisseaux et y embarqua ses troupes. Il envoya son frère diriger les opérations en Espagne, vira de bord et cingla vers l'Italie ; son intention était de traverser l'Étrurie, pour arriver avant l'ennemi au débouché des défilés alpestres. Après avoir marché quatre jours de suite depuis l'endroit où il avait passé le Rhône, Hannibal parvint dans une région peuplée et fertile, l'Ile, ainsi nommée parce qu'elle est entourée d'un côté par le Rhône, de l'autre par la rivière de l'Isère, si bien qu'elle affecte, vers le confluent, la forme d'une pointe. Elle est comparable, par son étendue et sa forme, à la partie de l'Égypte qu'on appelle le Delta, — à ceci près que ce Delta est limité par la mer sur la face où il n'est pas borné par les branches du Nil, tandis que l'Ile l'est par des montagnes escarpées, peu accessibles, à peu près inabordables. Hannibal y trouva, à son arrivée, deux frères qui se disputaient la royauté les armes à la main. L'aîné l'appela à son secours et le pria de l'aider à assurer son autorité ; Hannibal accueillit sa demande, car il voyait clairement l'intérêt immédiat qu'il avait à le faire. Il prit donc parti pour lui, l'aida à chasser le cadet et obtint du vainqueur des subsides de toute sorte : non seulement on fournit à ses soldats des vivres et d'autres munitions en abondance ; mais il put renouveler fort à propos toutes leurs armes, qui étaient vieilles et usées; en outre, la plupart d'entre eux furent habillés et chaussés, ce qui leur permit de franchir les montagnes dans de bien meilleures conditions. Mais le plus grand service que ce roi rendit aux Carthaginois, ce fut de prendre avec ses troupes la suite de leur colonne et de les accompagner jusqu'à l'entrée des Alpes ; ils purent ainsi traverser sans encombre le pays des Allobroges, qu'ils n'abordaient pas sans appréhension.
[350] Hannibal avait remonté la rivière pendant dix jours, il avait parcouru environ huit cents stades et gravissait les premières pentes des Alpes, quand il se trouva en butte au plus pressant danger. Tant qu'il avait été en terrain plat, aucun des chefs allobroges n'avait osé attaquer les Carthaginois, par crainte soit de leur cavalerie, soit des barbares qui les escortaient. Mais quand ces derniers s'en furent retournés dans leur pays et qu'Hannibal commença à s'engager dans la montagne, les chefs allobroges se concertèrent, réunirent un contingent considérable et allèrent occuper les positions qui commandaient les lieux par où il devait nécessairement passer. S'ils avaient su dissimuler le piège qu'ils lui tendaient, l'armée punique aurait été complètement détruite; mais ils se laissèrent voir et, s'ils firent beaucoup de mal à Hannibal, ils ne s'en firent pas moins à eux-mêmes. Informé de leur manoeuvre, le général carthaginois campa au pied de la montagne, envoya en reconnaissance quelques-uns de ses guides gaulois, pour tâcher de découvrir les intentions et le plan de l'ennemi, et attendit le résultat de leur mission. Ces éclaireurs lui apprirent que pendant le jour les Allobroges montaient la garde attentivement pour surveiller le passage, mais que la nuit ils se retiraient dans une ville voisine. Hannibal résolut d'adapter sa tactique à ces circonstances. Il fit mettre son armée en marche, s'avança en plein jour jusqu'à l'entrée du passage dangereux et campa à petite distance de l'ennemi. La nuit venue, il fit allumer les feux et laissa au camp la plus grande partie de ses troupes, tandis qu'à la tête de ses soldats d'élite légèrement armés il profitait de l'obscurité pour franchir les défilés et aller occuper les positions des barbares ; ceux-ci les avaient abandonnées, comme à l'ordinaire, pour se retirer dans la ville.
[351] Quand le jour reparut et que les barbares s'aperçurent de ce qui était arrivé, ils commencèrent par renoncer à leur entreprise ; mais quand ils virent les bêtes de somme et la cavalerie traverser les gorges péniblement et en longue file, ils furent tentés par l'occasion et attaquèrent la colonne ; ils fondirent de plusieurs côtés à la fois sur les Carthaginois, qui perdirent un grand nombre d'hommes, de chevaux de selle et de bêtes de charge, moins de la main des ennemis qu'en raison des difficultés du terrain. Le chemin n'était pas seulement étroit et raide ; il était encore bordé de précipices, où le moindre mouvement, le moindre désordre faisait à chaque instant rouler les bêtes de somme avec leur fardeau. Cette confusion était causée surtout par les chevaux blessés ; les uns, affolés par les coups qu'ils avaient reçus, se retournaient et heurtaient de front les animaux placés derrière eux ; les autres se précipitaient en avant et renversaient, sur ces pentes déjà si dangereuses, tout ce qui se trouvait sur leur passage. A cette vue, Hannibal, considérant que, même après avoir échappé à l'embuscade, il serait dans une situation désespérée s'il perdait ses bagages, se mit à la tête des soldats qui, la nuit, avaient les premiers occupé les hauteurs et marcha au secours de ceux qui étaient encore en route. Il tomba d'en haut sur les Allobroges et en tua un grand nombre, mais perdit autant d'hommes qu'eux, parce que le tumulte était encore augmenté, de part et d'autre, par les cris et le choc des combattants. Cependant, quand la plupart des Allobroges eurent péri, les survivants furent réduits à prendre la fuite et le laissèrent maître de la place ; il put enfin, à grand' peine d'ailleurs, faire franchir le défilé à ce qui lui restait de chevaux et de bêtes de charge ; puis il prit avec lui tout ce qu'il put, après un pareil combat, rassembler d'hommes valides et marcha sur la ville d'où les ennemis étaient partis pour l'attaquer. Comme les habitants étaient sortis en foule, attirés par l'appât du butin qu'ils comptaient faire, il la trouva presque déserte et n'eut pas de peine à s'en emparer. Il tira de ce succès un grand avantage, tant pour le présent que pour la suite : le profit immédiat fut qu'il trouva beaucoup de chevaux et de bêtes de somme, sans compter les prisonniers qu'il y fit ; en ce qui concernait l'avenir, il s'y procura des provisions de blé et de bétail pour deux ou trois jours ; mais surtout il répandit la terreur parmi les habitants des pays où il allait passer et ôta à ces montagnards l'envie de se mesurer avec lui.
[352] Il campa à cet endroit et y demeura toute une journée, puis il se remit en marche. Les jours suivants, l'armée poursuivit sa route sans encombre ; mais le quatrième jour on retomba dans un grave danger. Voici en effet le piège que lui tendirent les populations dont il devait traverser le territoire : des hommes vinrent au-devant de lui, avec des rameaux à la main et des couronnes sur la tête, ce qui, chez presque tous les barbares, est le symbole de la paix, comme le caducée chez les Grecs. Hannibal, à qui ces protestations semblaient suspectes, s'enquit soigneusement de leurs intentions et de ce qui les amenait. Ils répondirent qu'ils avaient su qu'attaqué par leurs voisins il les avait défaits et s'était emparé d'une de leurs places ; qu'en conséquence ils étaient venus prier qu'on ne leur fît point de mal et s'engager à n'en faire aucun ; qu'ils étaient prêts à lui donner des otages. Il hésita longtemps : il se défiait de leurs promesses; mais il se représenta qu'en accueillant leurs offres, il les rendrait peut-être plus circonspects et plus traitables, tandis que s'il repoussait leurs avances il en ferait ses ennemis déclarés; il accepta donc leurs propositions et fit semblant de devenir leur allié. Les barbares lui remirent des otages, lui fournirent du bétail en abondance, s'abandonnèrent à lui sans aucune marque de défiance ; si bien qu'Hannibal finit par avoir confiance en eux et par les prendre pour guides dans les passages difficiles qui lui restaient à franchir. Après deux jours de marche, comme les Carthaginois s'étaient engagés dans un ravin abrupt et encaissé, les Gaulois en question, qui s'étaient rassemblés sur leurs derrières, fondirent tout à coup sur eux.
[353] Toute l'armée aurait été anéantie dans cette rencontre, si Hannibal, qui avait conservé malgré tout quelque méfiance et appréhendé ce qui arrivait, n'avait eu la prudence de placer en tête les bagages avec la cavalerie et l'infanterie lourde à l'arrière-garde. Ce fut elle qui soutint le choc de l'ennemi et lui opposa un rempart, sans lequel le désastre aurait été complet. Néanmoins, on perdit là beaucoup d'hommes, de bêtes de charge et de chevaux de selle ; car les barbares avaient l'avantage de la position : à mesure que les Carthaginois avançaient, ils les suivaient sur le flanc de la montagne, d'où ils les dominaient et faisaient rouler ou jetaient sur eux des pierres qui leur firent beaucoup de mal et répandirent la confusion dans leurs rangs. Hannibal fut obligé de se tenir toute la nuit, avec la moitié de son armée, sur un rocher nu et escarpé, d'où il surveillait et protégeait le passage des chevaux et des bêtes de somme ; leur défilé dura la nuit entière, et ce temps leur suffit à peine pour sortir de la gorge. Le lendemain, les ennemis s'étaient éloignés; Hannibal rejoignit sa cavalerie et ses convoyeurs, et continua sa route vers la cime des Alpes; il n'eut plus à essuyer aucune attaque générale des barbares, mais il fut encore harcelé, sur tel ou tel point, par quelques détachements : ils saisissaient le moment favorable et tantôt fondaient sur l'arrière-garde, tantôt enlevaient quelques bagages à l'avant-garde. Les éléphants, surtout, lui furent d'un grand secours ; car à quelque endroit de la colonne qu'ils fussent placés, l'ennemi, effrayé par l'aspect fantastique de ces animaux, n'osait pas en approcher. Au bout de neuf jours, Hannibal atteignit la crête et y campa ; il demeura là pendant deux jours, tant pour laisser reposer ceux de ses soldats qui étaient arrivés sains et saufs que pour laisser aux traînards le temps de le rejoindre. On eut alors la surprise de voir reparaître un grand nombre de chevaux, qui s'étaient égarés dans leur affolement, et de bêtes de somme, qui s'étaient délivrées de leur fardeau ; ces animaux avaient suivi les traces de l'armée et rallié ainsi le campement.
[354] Les sommets étaient déjà couverts de neige, car le coucher des Pléiades approchait. Hannibal voyait ses soldats découragés par le souvenir des maux passés et par l'appréhension de nouvelles souffrances ; il les réunit et s'efforça de ranimer leur ardeur ; une circonstance — unique d'ailleurs - le servait ; c'est que l'Italie apparaissait au pied des montagnes ; les Alpes semblent en effet, pour qui regarde alternativement les hauteurs et le bas pays, comme la citadelle de toute la contrée. Il leur montrait donc les plaines du Pô, leur rappelait les dispositions sympathiques des Gaulois qui y habitaient, leur indiquait du doigt la direction où se trouvait Rome. Il parvint ainsi à dissiper leurs craintes et le lendemain il fit lever le camp pour commencer la descente. Il n'y rencontra plus d'autres ennemis que quelques malfaiteurs embusqués, mais la neige et les difficultés du terrain lui firent perdre presque autant de monde qu'il en avait déjà perdu à la montée. La pente était si raide et le sentier si étroit que, pour peu qu'on manquât le chemin, on glissait dans un précipice ; et la neige rendait la piste extrêmement difficile à discerner. Cependant les troupes supportaient bien ces misères, auxquelles elles étaient maintenant aguerries. Mais on finit par arriver à un endroit où le défilé se resserrait tellement que ni les éléphants ni les autres animaux ne pouvaient passer ; en outre, sur une longueur de près d'un stade et demi, la pente, qui était déjà auparavant des plus abruptes, l'était devenue encore plus à la suite d'un récent éboulement. Le découragement et la frayeur saisirent de nouveau les soldats. Le général songea d'abord à éviter ce mauvais pas en faisant un détour ; mais la neige qui tombait rendait la chose impossible et il y renonça.
[355] Ils se trouvèrent fort gênés en cet endroit par un phénomène assez étrange et particulier à cette région. Sur la neige qui restait de l'hiver précédent, d'autre neige était fraîchement tombée ; la couche récente était molle, encore peu épaisse, et par conséquent on y enfonçait aisément ; mais une fois qu'on l'avait traversée et que le pied portait sur la couche inférieure, qui était plus compacte et qui résistait, on patinait et on glissait des deux jambes à la fois, comme il arrive quand on marche dans un terrain fangeux. Le plus fâcheux, c'étaient les conséquences de ces chutes : quand les soldats, incapables d'implanter leurs pieds dans cette neige, tombaient et s'efforçaient de se redresser en s'appuyant sur les genoux ou sur les mains, ils recommençaient à glisser et entraînaient avec eux, tant la pente était raide, tout ce à quoi ils s'accrochaient. Quand c'étaient les bêtes de charge qui tombaient, elles trouaient la croûte de neige en essayant de se relever, et elles restaient là, avec leur fardeau, comme congelées, tant à cause de leur poids que parce que cette vieille neige s'était condensée en glace. Désespérant de passer dans ces conditions, Hannibal campa sur la croupe même, après l'avoir fait déblayer; puis, par ses ordres, les soldats creusèrent un chemin sur les flancs du précipice. Ce fut un travail extrêmement pénible ; néanmoins, en un jour, le sentier fut assez bien tracé pour qu'on pût l'employer au passage de la cavalerie et des bagages. Dès que cette besogne fut achevée, on s'empressa de camper en dehors de la zone des neiges et d'envoyer tous les animaux au pâturage. Cependant, Hannibal faisait élargir le chemin par les Numides, qui, travaillant par équipes, parvinrent à grand'peine, en trois jours, à le rendre praticable aux éléphants. Ces pauvres bêtes étaient presque mortes de faim; car sur les cimes et dans les hautes régions des Alpes on ne trouve absolument aucun arbre, aucune végétation, parce que la neige n'y fond jamais et y persiste été comme hiver ; au contraire, les deux flancs du massif sont boisés, plantés d'arbres et parfaitement habitables.
[356] Quand Hannibal eut concentré toutes ses troupes, il descendit dans la plaine, où il arriva trois jours après avoir franchi le précipice en question. Il avait perdu beaucoup de monde au cours de tout le trajet, soit dans les combats, soit au passage des rivières ; les abîmes et les escarpements des Alpes avaient également été funestes à ses soldats, mais plus encore aux animaux. Bref, quand, cinq mois et demi après son départ de Carthagène (en comptant quinze jours pour la traversée des Alpes), il fit son entrée audacieuse dans la plaine du Pô, sur le territoire des Insubres, il ne lui restait plus, comme infanterie, que douze mille Africains et huit mille Espagnols, et comme cavalerie, que six mille hommes en tout. C'est lui-même qui en témoigne, dans l'inscription du cap Lacinium où il fait le dénombrement de ses troupes. Pendant ce temps, P. Scipion, qui, comme je l'ai dit plus haut, avait confié le commandement de ses troupes à son frère Cnéus et l'avait chargé d'aller combattre Hasdrubal en Espagne, était venu, de son côté, débarquer à Pise à la tête d'un petit nombre d'hommes; en passant par l'Étrurie, il prit avec lui les légions qu'on y avait envoyées sous les ordres des préteurs pour combattre contre les Boïens et vint camper dans la plaine du Pô; là, il attendit l'ennemi, brûlant de se mesurer avec lui.
[357] Mais interrompons pour un moment notre récit et laissons les deux généraux face à face en Italie, prêts à engager les hostilités. Avant de commencer la relation des combats qu'ils se sont livrés, je veux justifier en quelques mots ma méthode historique. On se demandera peut-être, en effet, pourquoi, après avoir parlé si longuement de l'Afrique et de l'Espagne, je n'ai rien dit sur le détroit des Colonnes d'Hercule, ni sur la mer Extérieure et ses caractères particuliers, ni sur les Iles Britanniques, la préparation de l'étain, les mines d'or et d'argent que renferme l'Espagne, sujets sur lesquels les historiens se sont longuement étendus et se trouvent en contradiction. Ce n'est pas que j'aie négligé ces questions en les considérant comme étrangères à l'histoire ; mais, tout d'abord, je ne voulais pas couper continuellement ma narration par des digressions qui eussent égaré les lecteurs sérieux; en second lieu, il me semblait que ces points ne devaient pas être traités à bâtons rompus et comme des développements accessoires, mais qu'il valait mieux exposer à part, en temps et lieu, ce que je pourrais savoir de certain à ce propos. Il ne faut donc pas s'étonner si, dans la suite, il m'arrive, en parlant de certaines régions, de laisser de côté des détails de ce genre : je viens de donner les raisons de ces omissions. Les gens qui veulent à tout prix apprendre point par point tout ce qui concerne chaque pays ne voient pas, je présume, combien ils ressemblent à des gourmands à table : les convives de cette espèce, qui goûtent à tous les plats qu'on leur sert, ne jouissent véritablement d'aucun mets au moment même où ils mangent, et ensuite ils digèrent fort mal, de sorte que l'organisme ne tire aucun profit — bien au contraire — d'une nourriture prise dans ces conditions ; ceux qui apportent dans leurs lectures des habitudes analogues ne peuvent en retirer ni un plaisir réel sur le moment ni un avantage quelconque pour l'avenir.
[358] Ce n'est pas que cette partie de l'histoire ne mérite, au moins autant que toute autre, d'être traitée en détail et avec l'exactitude la plus scrupuleuse ; bien des exemples le montreraient clairement, mais je ne citerai que le plus probant. Tous ou presque tous les écrivains qui ont essayé de faire la géographie des pays situés aux extrémités de la terre et d'en décrire les particularités ont commis de nombreuses erreurs ; on ne doit pas manquer de les relever ; il faut les réfuter, non pas ça et là, en passant, mais par une discussion serrée. Il ne faut pas cependant leur reprocher trop âprement ces défaillances, mais plutôt leur accorder des éloges et corriger ces erreurs où leur manque de connaissances les a induits ; soyons persuadés que, s'ils étaient encore de ce monde, ils modifieraient et rectifieraient d'eux-mêmes un grand nombre de leurs assertions. Il y avait autrefois chez les Grecs bien peu de gens désireux de savoir ce qui se passait aux extrémités de la terre ; désir qu'il eût été d'ailleurs impossible de réaliser. Un long trajet sur mer vous exposait alors à des dangers innombrables, et les voyages par terre étaient encore plus périlleux. Et si quelqu'un poussait, volontairement ou non, jusqu'à ces régions si reculées, cela ne suffisait pas à lui donner les notions qu'il cherchait à acquérir. Car s'il n'est pas commode de visiter à fond des contrées dont les unes sont plongées dans la barbarie et les autres inhabitées, il est plus difficile encore de se faire donner de vive voix des renseignements et des explications sur ce que l'on a pu voir, quand on ne connaît pas la langue du pays. Enfin, fût-on parvenu à apprendre quelque chose, ne reste-il pas à vaincre une tentation, plus malaisée à surmonter que tous les obstacles précédents? Saura-t-on être assez raisonnable pour ne jamais tomber dans l'invraisemblance ou dans le merveilleux, pour respecter toujours la vérité et ne rien raconter qui ne soit authentique ?
[359] Il était donc autrefois, je ne dirai pas difficile, mais presque impossible de connaître exactement les faits dont nous parlons ; aussi, quand les historiens ont commis quelque omission ou quelque erreur, ne faut-il pas trop la leur reprocher; ils ont droit plutôt à nos félicitations et à notre admiration, pour les quelques notions qu'ils ont su acquérir et pour les progrès qu'ils ont fait faire à la science, dans les conditions où ils se trouvaient. A notre époque, depuis la conquête de l'Asie par Alexandre et celle du reste du monde par les Romains, il n'y a presque plus d'endroits où l'on ne puisse aller par terre ou par mer ; et les hommes exercés aux affaires, une fois délivrés des soins de la guerre ou de la politique, profitent volontiers de leur expérience pour faire sur ces questions beaucoup de recherches et de travaux; nous sommes donc tenus de connaître mieux et de façon plus certaine ce que les générations précédentes ignoraient. C'est cet idéal que je m'efforcerai moi-même de réaliser dans mon histoire, quand j'en trouverai une occasion favorable ; et je prierai alors les lecteurs désireux de s'instruire de m'accorder toute leur attention. C'est en effet pour en être digne que j'ai affronté les dangers et les fatigues d'une croisière à travers l'Afrique, l'Espagne, la Gaule et la mer qui baigne extérieurement ces pays ; mon but était de rectifier les idées fausses que s'en faisaient nos pères et de faire connaître ces contrées aux Grecs. Mais cessons cette digression, reprenons le fil de notre récit et abordons la relation des batailles qui eurent lieu en Italie entre Romains et Carthaginois.
[360] J'ai déjà dit de quelles forces disposait Hannibal lorsqu'il envahit l'Italie. Une fois entré dans le pays, il commença par camper au pied même des Alpes, pour faire reposer ses troupes. Tous les soldats étaient épuisés, non seulement par les difficultés de la montée, de la descente et de la rude traversée des cimes, mais encore par la rareté des vivres et le manque de soins corporels, qui les avaient mis dans un état lamentable. Plus d'un parmi eux, accablé par les privations et les souffrances ininterrompues, se laissait aller à un complet découragement. Il n'avait pas été possible de transporter, dans un pareil trajet, des approvisionnements en quantité suffisante pour tant de milliers d'hommes ; et ceux qu'on avait emportés avaient été détruits, en majeure partie, quand on avait perdu les bêtes de charge. Après le passage du Rhône, Hannibal avait encore trente-huit mille fantassins et plus de huit mille cavaliers ; or la traversée des Alpes lui avait coûté, comme je l'ai dit plus haut, près de la moitié de son armée. Encore les survivants étaient-ils si changés, au physique et au moral, par cette continuité de fatigues dont je parlais, qu'on les eût pris pour une horde de sauvages. Hannibal mit donc tous ses soins à relever leur courage et à réparer leurs forces, ainsi que celles des chevaux. Puis, quand tous furent rétablis, il essaya d'amener les habitants de Turin, dont le pays est juste au pied des Alpes, à lier avec lui alliance et amitié; cette peuplade était alors en guerre avec les Insubres ; mais, se méfiant des Carthaginois, elle repoussa leurs avances. Hannibal mit alors le siège devant leur principale ville et l'emporta en trois jours. Il fit passer au fil de l'épée ceux qui s'étaient montrés hostiles à ses propositions ; cette rigueur inspira une telle crainte aux tribus barbares du voisinage que toutes vinrent faire leur soumission. La plupart des autres Gaulois de la plaine auraient bien voulu se joindre aux Carthaginois, conformément à leur projet primitif ; mais, comme les légions romaines avaient déjà passé et interceptaient leurs communications avec leurs alliés, ils ne bougèrent pas ; quelques-uns d'entre eux étaient même obligés de servir dans l'armée romaine. Cette situation décida Hannibal à avancer sans plus tarder, pour frapper un grand coup, qui donnât confiance aux populations disposées à prendre son parti.
[361] Tandis qu'il méditait ce projet, il fut avisé que Scipion avait déjà franchi le Pô avec son armée et qu'il était tout près. Hannibal commença par se refuser à le croire : il supputait le petit nombre de jours écoulés depuis qu'il avait laissé son adversaire sur les bords du Rhône ; il songeait à la longueur et aux difficultés de la traversée depuis Marseille jusqu'à l'Étrurie et savait celles que présente, pour une armée, une marche à travers l'Italie de la mer Tyrrhénienne aux Alpes. Mais comme ce bruit se confirmait de plus en plus, il fut extrêmement surpris que le consul eût conçu un pareil dessein et eût pu le réaliser. Scipion éprouvait le même étonnement : il avait cru, tout d'abord, qu'Hannibal ne tenterait même pas le passage des Alpes avec ses troupes hétérogènes et que, s'il s'y risquait, il y périrait infailliblement. Aussi, quand on lui annonça qu'Hannibal était arrivé sain et sauf en Italie et avait déjà mis le siège devant plusieurs places, fut-il vivement frappé par la hardiesse et l'intrépidité du général carthaginois. Il en fut de même à Rome quand la nouvelle y fut connue : on venait seulement de recevoir les derniers détails concernant la prise de Sagonte, on avait eu tout juste le temps de délibérer sur cet événement, puis d'envoyer les deux consuls, l'un en Afrique pour assiéger Carthage, l'autre en Espagne pour y combattre Hannibal ; et on apprenait que ce même Hannibal était en Italie à la tête d'une armée, qu'il avait déjà mis le siège devant plusieurs places ! Cela paraissait invraisemblable. Dans le trouble qui en résulta, on fit dire immédiatement à Ti. Sempronius, qui se trouvait à Lilybée, que l'ennemi avait envahi l'Italie et qu'il fallait, toute affaire cessante, venir sur-le-champ au secours de la patrie. Sempronius rassembla ses troupes de mer et leur fit reprendre la route de Rome ; quant à son armée de terre, il lui fit prêter serment entre les mains des tribuns et lui fixa la date ou elle devait être rendue avant la nuit à Ariminum. Cette ville est située sur les bords de l'Adriatique, à la limite méridionale de la plaine du Pô. On s'agitait de tous les côtés en même temps, les informations les plus inattendues se succédaient, et chacun se demandait anxieusement comment les choses allaient tourner.
[362] Cependant Hannibal et Scipion marchaient l'un vers l'autre. Chacun de son côté, les deux généraux adressèrent à leurs troupes les encouragements que comportaient les circonstances. Voici comment Hannibal s'y prit pour donner du coeur à ses soldats. Il convoqua toute son armée et fit amener de jeunes prisonniers faits sur les peuplades qui l'avaient harcelé pendant le passage des Alpes. Pour préparer cette mise en scène, il les avait durement traités : ils étaient chargés de chaînes, mouraient de faim et avaient reçu tant de coups que leur corps n'était plus qu'une plaie. Après les avoir fait avancer, il mit devant eux de ces armures gauloises dont se parent les rois de leur pays pour lutter en combat singulier, des chevaux et des sayons d'un grand prix. Puis il leur demanda quels étaient ceux qui voulaient se battre contre un de leurs compagnons, aux conditions suivantes : le vainqueur aurait comme récompense les prix exposés devant eux, et le vaincu verrait ses souffrances se terminer avec sa vie. Tous s'écrièrent d'une seule voix qu'ils demandaient à combattre. Il fit alors tirer au sort les deux qui devaient prendre les armes et lutter l'un contre l'autre. Dès qu'ils l'eurent entendu donner cet ordre, tous les jeunes gens levèrent les mains au ciel et chacun pria les dieux de faire tomber le sort sur lui. Quand le tirage eut été fait, autant ceux qui étaient désignés se réjouissaient, autant les autres se désolaient ; et lorsque le combat fut terminé, ceux des prisonniers qui n'y avaient pas pris part ne félicitèrent pas moins le mort que le vainqueur : il étàit délivré de tous les maux cruels auxquels eux-mêmes restaient soumis. Ce spectacle produisit une impression analogue sur la majorité des Carthaginois. En compaparant la destinée misérable des captifs encore en vie à celle du mort, c'était lui qu'ils jugeaient heureux, c'étaient les vivants qu'ils trouvaient à plaindre.
[363] Après avoir fait naître ainsi dans l'âme de ses soldats les sentiments qu'il souhaitait, Hannibal s'avança en personne et leur déclara que, s'il avait fait paraître les prisonniers devant eux, c'était pour leur faire juger clairement, par l'exemple d'autrui, de leur propre situation et des résolutions qu'elle devait leur inspirer. La Fortune, disait-il, les acculait à la même nécessité et mettait le même enjeu à la lutte qu'ils allaient livrer : il n'y avait d'autre alternative que de vaincre, de mourir ou de tomber vivants aux mains de l'ennemi ; la récompense attachée à la victoire ne consistait pas en chevaux ou en sayons, mais dans les trésors qu'ils prendraient aux Romains et qui feraient d'eux les plus heureux de tous les hommes ; s'ils succombaient sur le champ de bataille, ils auraient la consolation d'avoir lutté jusqu'à leur dernier souffle pour la plus belle des causes et de mourir les armes à la main sans avoir rien souffert; mais pour ceux qui, en cas de défaite, n'auraient pas honte de fuir ou d'avoir recours à quelque autre lâcheté pour sauver leur vie, aucune souffrance, aucune misère ne leur serait épargnée. Ils n'avaient qu'à se rappeler la longueur du trajet parcouru depuis leur pays, le nombre des ennemis qu'ils avaient rencontrés en chemin, la largeur des rivières qu'ils avaient passées ; ils verraient alors quelle folie, quelle sottise ce serait d'espérer regagner leur patrie en fuyant ! Il fallait donc, pensait-il, renoncer complètement à cet espoir et envisager leur situation du même oeil qu'ils avaient tout à l'heure regardé celle des Gaulois. Après le combat, ils félicitaient tous aussi bien le mort que le vainqueur et réservaient leur pitié pour les prisonniers encore vivants ; or c'étaient les mêmes sentiments qu'ils devaient éprouver quand leur propre sort était en jeu : il fallait vaincre, si c'était possible, ou sinon mourir. A aucun prix, il ne fallait conserver l'espoir de survivre à une défaite : s'ils étaient décidés à affronter la lutte dans ces dispositions, ils pouvaient être sûrs et de remporter la victoire et de sauver leur vie. Quand une armée, volontairement ou par nécessité, avait pris une pareille résolution, jamais elle n'avait manqué de triompher de ses adversaires ; et lorsque les ennemis se trouvaient dans une situation contraire, comme étaient alors les Romains, dont la patrie était toute proche et qui pouvaient espérer, en cas de déroute, trouver presque tous une retraite facile et sûre, il était évident qu'ils ne sauraient tenir tête à des gens qui combattaient avec l'énergie du désespoir. Ce spectacle et cette allocution impressionnèrent vivement les soldats ; ils sentirent renaître dans leurs coeurs l'ardeur et l'intrépidité que leur général avait voulu leur inspirer. Il les en félicita, les congédia et fixa le départ au lendemain matin.
[364] Scipion, qui à ce moment avait déjà franchi le Pô, décida de passer le Tessin pour continuer sa marche en avant ; il donna donc à ses pontonniers l'ordre de jeter un pont sur la rivière, convoqua pendant ce temps le reste de ses troupes et les harangua. Il leur parla surtout de la grandeur de leur patrie et des exploits de leurs ancêtres, puis il en vint aux circonstances présentes. Bien qu'ils n'eussent pas encore pris contact avec l'ennemi, ils ne devaient pas oublier qu'ils avaient affaire à des Carthaginois, car alors ils ne douteraient plus de la victoire ; c'était une chose indigne, inimaginable, que les Carthaginois, tant de fois vaincus par les Romains, depuis si longtemps contraints à leur payer un tribut et presque réduits par eux en esclavage, eussent l'audace de se révolter contre eux. « En outre, ajoutait-il, nous commençons à connaître assez bien nos adversaires actuels, nous voyons qu'ils n'osent pas nous regarder en face : quelles doivent être, si nous savons raisonner, nos prévisions pour l'avenir ? » Il rappelait alors la rencontre des cavaliers romains avec ceux de l'ennemi sur les bords du Rhône ; elle n'avait pas mal tourné, mais on avait tué un grand nombre d'hommes et forcé les survivants à s'enfuir jusque dans leurs retranchements. Quand leur général avait appris que les troupes romaines étaient proches, il avait levé le camp avec toute son armée, et sa retraite ressemblait fort à une déroute ; c'était la crainte qui l'avait contraint, malgré sa volonté, à affronter la traversée des Alpes. On se retrouvait en présence d'Hannibal, mais il avait perdu la plus grande partie de son armée et ce qui en restait, épuisé par les privations, était sans aucune valeur ; il avait perdu également la plupart de ses chevaux et ceux qu'il avait encore, exténués par la longueur et les difficultés de la route, ne pouvaient lui être d'aucun service. Il essayait ainsi de persuader ses soldats qu'ils n'avaient qu'à se montrer pour vaincre l'ennemi. Ce qui devait surtout leur donner de la confiance, c'était sa présence au milieu d'eux : aurait-il jamais abandonné sa flotte et la mission dont il était chargé en Espagne pour revenir avec une telle hâte, s'il n'avait eu les raisons les plus sérieuses de croire son retour indispensable à la patrie et s'il n'avait considéré la victoire comme certaine ? L'autorité de l'orateur et l'exactitude des faits qu'il alléguait inspira à tous les soldats un vif désir de combattre ; le consul les félicita de leur ardeur et les congédia, en leur donnant l'ordre d'être prêts à se mettre en mouvement au premier signal.
[365] Le lendemain, les deux adversaires marchèrent l'un contre l'autre sur la rive du Tessin la plus proche des Alpes ; les Romains avaient la rivière à leur gauche, les Carthaginois à leur droite. Le jour suivant, quand on apprit de part et d'autre, par les fourrageurs, qu'on était tout près de l'ennemi, les deux armées s'arrêtèrent et campèrent à l'endroit où elles se trouvaient. Le troisième jour, les deux généraux firent avancer toute leur cavalerie dans la plaine, chacun voulant reconnaître les forces de l'autre : Scipion avait également pris avec lui ses fantassins armés de javelots. Quand ils virent, à la poussière qui s'élevait, qu'ils étaient tout près l'un de l'autre, tous deux rangèrent aussitôt leurs troupes en bataille : Scipion plaça en première ligne ses tirailleurs avec ses cavaliers gaulois, forma son front avec le reste et marcha à l'ennemi au petit pas ; Hannibal vint à sa rencontre, ayant au centre l'élite de ses cavaliers à chevaux bridés et la cavalerie numide sur les deux ailes, pour envelopper l'ennemi. Les deux généraux et leurs soldats ne demandaient qu'à combattre. L'effet du premier choc fut que les tirailleurs, effrayés par la charge des cavaliers ennemis et craignant d'être foulés aux pieds par les chevaux qui fonçaient sur eux, s'enfuirent dès qu'ils eurent lancé leur premier javelot et se faufilèrent entre les escadrons romains, derrière lesquels ils s'abritèrent. Les deux centres s'élancèrent alors l'un sur l'autre. La lutte resta longtemps indécise. Beaucoup d'hommes sautaient à bas de leurs montures, si bien que ce même engagement était tour à tour un combat de cavalerie et d'infanterie. Pendant ce temps, les Numides tournaient les Romains et venaient tomber sur eux par derrière ; les fantassins qui avaient échappé une première fois à l'élan de la cavalerie ennemie furent alors écrasés sous le nombre et la violence de l'attaque. Quant au corps qui combattait de front contre la cavalerie carthaginoise, il avait perdu beaucoup de monde, tout en infligeant à l'adversaire des pertes encore plus considérables ; les Numides le prirent en queue et le mirent en déroute : la plupart des Romains se dispersèrent; quelques-uns restèrent groupés autour de leur général.
[366] Scipion leva le camp, traversa la plaine jusqu'au pont construit sur le Pô et se hâta de le faire passer à ses légions avant que l'ennemi pùt le rejoindre; se voyant en terrain plat, en face d'un adversaire supérieur en cavalerie, et de plus grièvement blessé, il jugeait nécessaire de mettre son armée hors de danger. Hannibal attendit un certain temps que l'infanterie romaine sortît pour l'attaquer ; puis, quand il vit les légions abandonner leur camp, il les suivit jusqu'au pont jeté sur le fleuve; mais quand il arriva, il en trouva presque toutes les planches arrachées. Il fit prisonniers six cents hommes environ, qui avaient été placés sur la rive pour garder le pont ; il apprit d'eux que le reste de l'armée était déjà loin, rebroussa chemin et longea le fleuve, à la recherche d'un endroit où l'on pût facilement jeter un pont. Il s'arrêta au bout de deux jours, fit faire un pont de bateaux et chargea Hasdrubal de faire effectuer le passage de l'armée : il passa d'abord lui-même, pour donner audience aux ambassadeurs envoyés par les peuples du voisinage ; en effet, dès sa victoire, tous les Gaulois de la région s'étaient empressés de donner suite à leur premier projet, c'est-à-dire de s'allier aux Carthaginois, de leur fournir des vivres et de se joindre à eux. Il leur fit l'accueil le plus cordial ; puis, quand son armée l'eut rejoint sur la rive droite, il reprit sa marche le long du fleuve, mais en sens inverse, en descendant le courant, pour atteindre l'ennemi. Scipion, en effet, après avoir traversé le Pô, avait établi son camp dans les environs de la colonie romaine de Plaisance ; obligé de se soigner ainsi que ses hommes blessés, et croyant son armée en sûreté, il ne bougeait pas. Deux jours après avoir franchi le fleuve, Hannibal arriva jusque dans le voisinage immédiat des Romains et le lendemain, il rangea ses troupes en bataille sous leurs yeux. Mais, comme personne ne se portait à sa rencontre, il campa, en laissant un intervalle d'à peu près cinquante stades entre l'ennemi et lui.
[367] C'est alors que les Gaulois qui combattaient dans les rangs de l'armée romaine, voyant la fortune sourire aux Carthaginois, tramèrent un complot contre les Romains. Ils commencèrent par rester dans leurs tentes, épiant l'occasion de mettre leur projet à exécution ; quand on eut dîné et que tout le camp fut endormi, ils laissèrent encore passer la plus grande partie de la nuit ; puis, à la dernière garde avant le jour, ils prirent les armes et se jetèrent sur les Romains campés le plus près d'eux. Ils en tuèrent une grande quantité, en blessèrent également beaucoup, coupèrent la tête aux morts et passèrent aux Carthaginois, au nombre de deux mille fantassins et de près de deux cents cavaliers. Hannibal les accueillit avec empressement, les encouragea à persévérer, promit à chacun d'eux la récompense que ses services mériteraient et les renvoya dans leur pays, en les chargeant d'informer leurs concitoyens de ses succès et de les engager à faire alliance avec lui ; il savait bien que tous se trouveraient forcés de prendre parti pour lui, quand ils connaîtraient l'attentat commis contre les Romains par leurs compatriotes. En même temps qu'eux se présentèrent les Boïens, qui venaient livrer à Hannibal les trois magistrats que Rome avait envoyés procéder au partage des terres et dont les Gaulois s'étaient traîtreusement emparés dès le début de la guerre, comme je l'ai dit plus haut. Hannibal fut très sensible à cette preuve qu'ils fournissaient de leurs dispositions favorables ; il leur donna des gages de l'amitié et de l'alliance qu'il contractait avec eux et leur conseilla de garder les prisonniers qu'ils lui avaient amenés : ils s'en serviraient pour se faire rendre leurs propres otages, ainsi qu'ils en avaient d'abord eu l'intention. Scipion était fort inquiet de la trahison dont il avait été victime : elle lui faisait craindre que les Gaulois, déjà fort mal disposés à l'égard des Romains, ne prissent tous parti maintenant pour les Carthaginois ; pour se mettre en garde contre ce qui pouvait en résulter, il leva le camp vers la fin de la nuit suivante pour se diriger vers la Trébie et les collines qui bordent cette rivière ; il se fiait à la force de cette position et à sa situation au milieu de populations alliées.
[368] Quand Hannibal fut informé de son départ, il expédia sur-le-champ ses cavaliers numides et peu après ceux des autres nations, qu'il suivit de près lui-même avec le reste de l'armée. Les Numides, trouvant le camp abandonné, y mirent le feu. Ce fut très heureux pour les Romains ; car si la cavalerie ennemie les avait poursuivis et avait atteint leurs bagages, ils auraient, en terrain plat, éprouvé de grosses pertes. Mais ils avaient presque tous pu passer la Trébie sans être rejoints; l'arrière-garde seule fut surprise : une partie en fut détruite, le reste pris par les Carthaginois. Après avoir traversé la rivière, Scipion s'établit sur les hauteurs les plus voisines, fit construire un camp avec un fossé et un retranchement, et attendit les renforts que Sempronius devait lui amener, tout en soignant attentivement sa blessure pour pouvoir prendre part au combat qui allait avoir lieu. Hannibal vint camper à une quarantaine de stades des Romains ; les peuplades gauloises qui habitaient la plaine, et qui étaient de coeur avec les Carthaginois, leur apportaient des vivres en abondance et étaient prêtes à seconder Hannibal dans toutes les opérations qu'il entreprendrait. Quand on sut à Rome comment s'était passé le combat de cavalerie, on fut surpris de cette nouvelle inattendue ; mais on ne manqua pas de raisons pour ne pas considérer cet accident comme une défaite : les uns accusaient le consul de précipitation ; les autres s'en prenaient aux Gaulois, qu'ils soupçonnaient, en raison de leur défection ultérieure, de s'être laissé battre volontairement. D'ailleurs, l'infanterie étant intacte, les espérances de succès n'étaient pas non plus entamées. Aussi, lorsque Sempronius arriva et traversa Rome avec ses légions, crut-on qu'il n'aurait qu'à se montrer avec de pareilles forces pour assurer la victoire. Les soldats se concentrèrent à Ariminum, conformément, au serment qu'ils avaient prêté ; le consul se mit à leur tête et se hâta d'aller rejoindre son collègue. Il opéra sa jonction avec lui, établit son propre camp à côté du sien et fit reposer ses troupes, qui avaient marché quarante jours de suite pour se rendre de Lilybée à Ariminum; puis il prit toutes ses dispositions pour la bataille ; en même temps, il conférait souvent avec Scipion, se renseignait sur ce qui s'était passé, délibérait avec lui sur la situation présente.
[369] Cependant Hannibal avait réussi à s'emparer de Clastidium, en se faisant livrer la place par le gouverneur, un citoyen de Brindes qui commandait au nom des Romains. Maître de la garnison et des magasins, il mit immédiatement à profit les approvisionnements qu'il avait trouvés et incorpora ses prisonniers dans son armée, sans leur faire aucun mal ; il voulait montrer par cet exemple de quelles dispositions il était animé envers ceux que les circonstances auraient forcés à se soumettre aux Romains, mais qui ne craindraient pas de se fier à sa clémence. Quant au traître qui lui avait ouvert les portes, il le récompensa magnifiquement, pour inciter les magistrats nommés par les Romains à passer du côté des Carthaginois. Sur ces entrefaites, il s'aperçut que quelques Gaulois d'entre le Pô et la Trébie, qui avaient fait alliance avec lui, entretenaient aussi des relations avec Rome ; ils espéraient ainsi n'avoir rien à redouter de la part du vainqueur, de quelque côté que la chance tournât. Hannibal envoya contre eux deux mille hommes d'infanterie et un millier de cavaliers, tant gaulois que numides, avec ordre de ravager leur pays. Ils suivirent ses instructions et firent un butin considérable. Les Gaulois coururent aussitôt au camp romain, pour demander du secours. Sempronius, qui depuis longtemps ne cherchait qu'une occasion de se faire valoir, saisit ce prétexte pour faire sortir la plus grande partie de sa cavalerie, avec un millier de fantassins armés de javelots. Ce détachement passa rapidement la Trébie, attaqua les Gaulois et les Numides qui revenaient chargés de butin, les mit en déroute et les força à battre en retraite vers leurs retranchements. A cette vue les troupes qui gardaient le camp punique font une sortie pour secourir leurs compagnons pressés par l'ennemi ; les Romains sont repoussés à leur tour et se retirent jusque dans leur propre camp. Quand Sempronius les voit reculer, il fait entrer en ligne toute sa cavalerie et tous ses tirailleurs. Ce sont alors les Gaulois qui plient encore une fois et se réfugient en lieu sûr. Hannibal ne se sentait pas prêt à engager une action générale ; il pensait d'ailleurs qu'un bon chef d'armée ne doit pas s'y risquer à toute occasion et qu'il ne faut jamais courir une pareille chance que d'après un plan prémédité ; il se contenta donc d'arrêter la fuite de ses soldats qui se repliaient sur leur camp et de les obliger à faire front, mais leur fit donner par ses aides de camp et par les trompettes l'ordre de ne pas poursuivre l'ennemi et de renoncer à l'attaquer. Les Romains attendirent quelque temps, puis se retirèrent; ils n'avaient perdu que peu de monde, les Carthaginois beaucoup plus.
[370] Sempronius, tout heureux et tout fier de ce succès, désirait vivement engager le plus tôt possible une action décisive. Il aurait volontiers profité de l'état de Scipion pour tout régler à son gré ; il crut pourtant devoir prendre l'avis de son collègue et conféra avec lui sur ce qu'il y avait à faire. Or Scipion était d'une opinion toute contraire à la sienne : il pensait que leurs troupes seraient plus solides quand elles auraient passé l'hiver à s'aguerrir et que les Gaulois, avec leur versatilité ordinaire, ne tiendraient pas leurs engagements, mais qu'ils se retourneraient contre les Carthaginois, s'ils les voyaient arrêtés et réduits à l'inaction. En outre, il espérait pouvoir prendre part utilement aux opérations, quand il serait guéri de sa blessure. Pour ces diverses raisons, il priait Sempronius de ne rien précipiter. L'autre savait bien que tout cela était fort juste et fort bien dit ; mais l'amour de la gloire et une confiance excessive le poussaient, contre toute sagesse, à tenter de frapper par lui-même un coup décisif, avant que Scipion fût en état d'assister au combat et que les consuls de l'année suivante fussent nommés, — ce qui allait arriver incessamment. Ce n'était pas l'intérêt général qu'il avait en vue, c'était le sien ; il ne pouvait donc manquer de prendre de fâcheuses résolutions. Hannibal, de son côté, pensait comme Scipion sur la situation présente, mais il tirait de ses réflexions des conclusions tout opposées ; il avait hâte de livrer bataille; il voulait, d'abord, profiter des bonnes dispositions des Gaulois sans les laisser se refroidir, puis se mesurer avec les jeunes recrues romaines avant qu'elles fussent exercées, en troisième lieu engager l'action avant que Scipion fût rétabli, enfin et surtout agir, au lieu de laisser le temps se perdre inutilement. Il n'y a en effet qu'un moyen de succès pour un général qui entre en pays ennemi et tente une entreprise aussi extraordinaire, c'est de renouveler sans cesse, par des exploits continuels, les espérances de ses alliés. Bref, sachant bien que l'impétuosité de Sempronius le pousserait à risquer la bataille, Hannibal s'y préparait.
[371] Il avait depuis longtemps reconnu le terrain qui séparait les deux armées : c'était une plaine très nue, mais où l'on pouvait aisément dresser une embuscade, grâce à la présence d'un ruisseau, dont les berges étaient escarpées et, de plus, hérissées d'une haie ininterrompue de ronces et d'épines. La ruse avait toutes chances de réussir ; car si les Romains étaient en garde contre les embuscades que les Gaulois avaient l'habitude de tendre dans les endroits boisés, ils ne se méfiaient pas des lieux plats et découverts. Ils ne savaient pas combien une région de ce genre est préférable à un bois pour s'y embusquer sans être vu et sans courir aucun danger ; on peut voir de loin de tous les côtés et on ne manque généralement pas d'accidents de terrain où l'on peut se dissimuler. Il suffit du premier ruisseau venu, avec une berge légèrement élevée, de roseaux, de broussailles ou d'épines quelconques pour cacher non seulement de l'infanterie, mais parfois même de la cavalerie ; on n'a qu'à prendre la précaution très simple de poser à terre les armes trop visibles et de mettre les casques sous les boucliers. Le général carthaginois tint donc conseil avec son frère Magon et ses autres lieutenants; il leur communiqua son plan pour la bataille qui allait avoir lieu et tout le monde l'approuva. Dès que les troupes eurent dîné, il fit appeler Magon ; c'était encore un jeune homme, mais plein de fougue et qui s'exerçait depuis son enfance au métier des armes. Il mit à sa disposition cent cavaliers et autant de fantassins ; tandis qu'il faisait encore jour, il avait désigné à cet effet les soldats les plus vigoureux de toute l'armée et leur avait ordonné de venir le trouver dans sa tente quand ils auraient pris leur repas. Après leur avoir inspiré par ses exhortations l'ardeur qu'exigeaient les circonstances, il leur donna l'ordre de choisir chacun dans leur propre compagnie les dix hommes les plus courageux et de se rendre avec eux à un endroit déterminé du camp. Ils constituèrent ainsi un corps de mille cavaliers et de fantassins en nombre égal ; Hannibal les envoya alors de nuit se poster en embuscade, en leur donnant des guides et en indiquant à son frère le moment où il convenait d'attaquer. Pour lui, au point du jour, il assemble ses cavaliers numides, gens des plus endurcis à la fatigue, leur adresse des encouragements, promet des récompenses à ceux qui se conduiront bien et leur ordonne d'approcher du camp romain, de passer rapidement la rivière, de provoquer l'ennemi par des escarmouches et de le faire sortir de ses retranchements ; son intention était de surprendre ses adversaires à un moment où ils n'auraient encore pris aucune nourriture et ne s'attendraient pas à ce qu'une bataille fût engagée. Puis il convoque le reste de ses officiers, les anime également au combat, donne l'ordre de faire déjeuner tous les hommes, fait préparer les armes et les chevaux.
[372] Dès que Sempronius vit approcher la cavalerie numide, il fit sortir la sienne en lui ordonnant de prendre contact avec l'ennemi et d'engager l'action. A sa suite, il envoya environ six mille fantassins armés de javelots ; enfin il se mit en mouvement avec le reste de son armée, si fier de ses troupes innombrables et du succès qu'il avait remporté la veille dans le combat de cavalerie qu'il croyait n'avoir qu'à se montrer pour déterminer la victoire. Mais on était alors aux environs du solstice d'hiver; la journée était neigeuse et très froide; de plus, hommes et chevaux s'étaient presque tous mis en marche sans avoir pris aucune nourriture. Au début, les soldats étaient pleins d'ardeur et d'entrain: mais quand ils eurent traversé la Trébie, grossie par des pluies tombées la nuit dans son cours supérieur et que les hommes à pied avaient grand'peine à passer avec de l'eau jusqu'à la poitrine, ils souffrirent beaucoup du froid et de la faim, d'autant que la journée s'avançait. Les Carthaginois, au contraire, avaient mangé et bu sous leurs tentes, avaient soigné leurs chevaux, s'étaient tous frottés d'huile et armés devant le feu. Dès qu'Hannibal, qui guettait ce moment, vit que les Romains avaient passé la rivière, il envoya ses lanciers et ses frondeurs baléares, au nombre d'à peu près huit mille, pour soutenir l'avant-garde ; puis il les suivit à la tête de toute l'armée. Arrivé à huit stades environ de son camp, il rangea sur une seule ligne son infanterie, composée de vingt milliers d'hommes, Espagnols, Gaulois et Africains ; la cavalerie fut divisée en deux corps, qui constituèrent les deux ailes : elle comprenait dix mille hommes, en comptant les Gaulois auxiliaires ; enfin, les éléphants furent placés les uns devant l'aile droite, les autres devant la gauche. En même temps, Sempronius ramenait en arrière sa cavalerie, qu'il voyait s'escrimer contre l'ennemi sans aucun résultat : les Numides en effet, selon leur tactique ordinaire, se dispersaient, s'échappaient sans aucune peine, puis revenaient à la charge avec intrépidité. Le consul rangea selon l'ordonnance habituelle son infanterie, composée de seize mille Romains et de vingt mille alliés ; c'est l'effectif d'une armée complète dans une action générale où les deux consuls combattent avec leurs forces réunies. Il répartit entre les deux ailes ses quatre mille hommes de cavalerie et marcha à l'ennemi fièrement, en bon ordre, au petit pas.
[373] Quand les deux armées furent en présence, les soldats d'infanterie légère, placés en tête des troupes, engagèrent la bataille. Cet épisode fut des plus défavorables aux Romains, et les Carthaginois eurent l'avantage ; les tirailleurs romains souffraient depuis le matin, ils avaient lancé presque tous leurs javelots dans la rencontre avec les Numides et ceux qui leur restaient étaient si imprégnés d'eau qu'ils ne pouvaient plus s'en servir. La cavalerie et tout le reste de l'armée n'étaient pas en meilleur état. Pour les Carthaginois, c'était tout l'opposé : ils marchaient au combat bien en forme, tout frais, en parfaites dispositions pour donner tous les efforts nécessaires. Aussi, dès que les voltigeurs se furent retirés par les intervalles qui séparaient les bataillons et que les troupes pesamment armées entrèrent en ligne, la cavalerie carthaginoise n'eut-elle aucune peine à refouler l'adversaire aux deux ailes ; elle était beaucoup plus nombreuse et, d'autre part, hommes et chevaux étaient en bien meilleur état, grâce aux précautions qu'ils avaient prises avant de se mettre en mouvement. Comme le recul de la cavalerie romaine découvrait des deux côtés la grosse infanterie, les lanciers carthaginois et les Numides dépassant la tête de leur armée, fondirent de flanc sur les Romains et les harcelèrent si vivement qu'ils ne leur laissaient pas le loisir de combattre contre les ennemis qui les attaquaient de front. Cependant les troupes pesamment armées, qui occupaient dans les deux armées le premier rang et le centre, luttaient de pied ferme, et sur ce point le combat resta longtemps indécis.
[374] C'est alors que les Numides, sortant de leur embuscade, fondirent tout à coup à revers sur le corps qui combattait au centre, ce qui répandit parmi les troupes romaines le trouble et la confusion. Les deux ailes de Sempronius, attaquées de front par les éléphants et de tous les côtés par l'infanterie légère, finirent par lâcher pied et, poursuivies par les assaillants, furent culbutées dans la rivière. Dans le centre romain, les soldats placés en seconde ligne furent surpris et écrasés par le détachement placé en embuscade ; ceux des premiers rangs, au contraire, animés par la nécessité, vinrent à bout des Gaulois et d'une partie des Africains, en firent un grand carnage et se frayèrent un chemin à travers les lignes carthaginoises. Quand ils virent que les deux ailes étaient défaites, jugeant impossible de leur porter secours et désespérant de regagner leur camp, dont ils étaient coupés par la cavalerie ennemie et par la rivière, épuisés enfin par la pluie qu'ils ne cessaient de recevoir sur la tête, ils serrèrent les rangs et se retirèrent en bon ordre à Plaisance, au nombre de dix mille au moins. La plupart de leurs compagnons furent tués sur les bords de la Trébie par les éléphants et les cavaliers ennemis; ceux des fantassins qui échappèrent et la majeure partie de la cavalerie se replièrent sur le corps dont nous parlions et le rejoignirent à Plaisance. Les Carthaginois poursuivirent leurs adversaires jusqu'à la rivière ; mais la rigueur de la saison ne leur permit pas d'aller plus loin et ils retournèrent à leur camp. Ils étaient tous heureux d'avoir remporté un pareil succès. Les Espagnols et les Africains n'avaient perdu que quelques hommes; c'étaient les Gaulois qui avaient été le plus éprouvés. En revanche, ils souffrirent beaucoup de la pluie et de la neige : de tous les éléphants il n'en resta qu'un seul, sans compter tous les hommes et les chevaux qui moururent de froid.
[375] Sempronius, qui ne se dissimulait pas la gravité du désastre, mais qui voulait autant que possible la laisser ignorer à Rome, fit annoncer par des courriers qu'un combat avait eu lieu et que sans le mauvais temps une victoire eût été remportée. Les Romains prirent d'abord la chose au pied de la lettre ; mais bientôt ils surent que leur camp était aux mains des Carthaginois, que tous les Gaulois étaient passés à l'ennemi, que leurs troupes avaient abandonné leurs positions pour battre en retraite et se réfugier toutes dans les villes voisines, que les ravitaillements ne leur arrivaient plus que de la mer par le Pô ; c'est ainsi qu'ils connurent la vérité sur la bataille. Malgré leur surprise, ils ne manquèrent pas de prendre les mesures nécessaires pour réparer cette défaite : on mit, notamment, des garnisons aux points exposés ; on expédia des troupes en Sardaigne et en Sicile ; on envoya des renforts à Trente et dans les autres places faciles à défendre ; on équipa soixante vaisseaux à cinq rangs de rames. Les nouveaux consuls, Cn. Servilius et C. Flaminius, firent des levées chez les alliés et procédèrent à l'enrôlement des légionnaires. Ils firent diriger les convois de vivres en partie sur Ariminum, en partie sur l'Étrurie, car c'était par ces régions qu'ils comptaient passer pour marcher à l'ennemi. On fit également demander du secours à Hiéron, qui envoya cinq cents Crétois et mille soldats légèrement armés. Tous ces préparatifs furent partout menés activement : les Romains ne sont jamais aussi redoutables, dans une action collective ou individuelle, que lorsqu'ils ont eux-mêmes de sérieux sujets de crainte.
[376] Pendant que se déroulaient ces événe- ments, Cn. Cornélius Scipion, à qui son frère Publius avait laissé, comme je l'ai dit plus haut, le commandement de ses troupes de mer, était parti des bouches du Rhône avec toute sa flotte et était allé aborder en Espagne, près d'Emporion. Il opéra depuis cet endroit jusqu'à l'Èbre une série de descentes le long de la côte, s'emparant des villes qui refusaient de le recevoir, traitant avec douceur celles qui lui faisaient bon accueil et veillant, dans la mesure du possible, à ce qu'il ne leur fût causé aucun dommage. Après avoir mis des garnisons dans les places qu'il avait conquises sur le littoral, il pénétra dans l'intérieur des terres avec toute son armée, déjà grossie d'un grand nombre d'auxiliaires indigènes ; il gagnait à son parti les villes qu'il rencontrait sur son passage ou les réduisait de vive force. Les Carthaginois qu'Hannibal avait laissés dans cette région sous le commandement d'Hannon vinrent camper en face de lui, non loin d'une localité nommée Cissa; Cnéus les vainquit en bataille rangée et s'empara d'un butin considérable, parce que c'était là que les troupes qui partaient pour l'Italie avaient laissé tous leurs bagages. Il lia alliance et amitié avec toutes les peuplades qui habitaient au nord de l'Èbre, fit prisonnier le chef des Carthaginois, Hannon, et celui des Espagnols, Androbalès ; ce dernier avait établi sa domination dans l'intérieur du pays et s'était toujours montré fort attaché à la cause punique. Dès qu'Hasdrubal sut ce qui était arrivé, il passa l'Èbre et vint à la rescousse. Apprenant que les soldats de la flotte laissés par les Romains sur la côte montaient la garde avec négligence et se reposaient sur les succès remportés par l'armée de terre, il prend avec lui un détachement d'infanterie d'environ huit mille hommes, surprend ses ennemis dispersés de côté et d'autre, en massacre un grand nombre et force les survivants à s'enfuir vers leurs vaisseaux. Puis il bat en retraite, repasse l'Èbre, prend les dispositions nécessaires pour assurer la défense des régions situées au sud du fleuve et revient hiverner à Carthagène. Quand Cn. Scipion fut de retour, il punit selon toute la rigueur des lois romaines les officiers responsables de la défaite subie par l'armée navale, puis il réunit en un seul corps ses troupes de terre et de mer et alla prendre ses quartiers d'hiver à Tarragone. Il divisa le butin en parts égales entre ses soldats, conquit ainsi leurs bonnes grâces et entretint leur ardeur en vue de la campagne suivante.
[377] Telle était la situation en Espagne. Au début du printemps, C. Flaminius prit avec lui ses légions, traversa l'Étrurie et vint camper devant la ville d'Arrétium, tandis que Cn. Servilius faisait route vers Ariminum, pour prévenir une invasion de ce côté. Quant à Hannibal, il avait passé l'hiver dans la Gaule cisalpine ; il gardait en captivité les Romains qu'il avait faits prisonniers sur le champ de bataille et leur donnait tout juste le nécessaire ; au contraire, il traitait leurs alliés avec la plus grande douceur. Un jour, il les rassembla et leur dit qu'il n'était pas venu leur faire la guerre, mais la faire pour eux contre les Romains ; ils devaient par conséquent, s'ils entendaient bien leurs intérêts, embrasser son parti; il n'était là en effet que pour rendre aux Italiens leur indépendance, pour leur restituer les villes et les terres que les Romains leur avaient enlevées. Là-dessus, il les renvoya tous chez eux sans rançon ; il espérait ainsi attirer à lui les peuples de l'Italie, les détacher des Romains et décider à se soulever ceux dont les places ou les ports subissaient le joug de la domination romaine.
[378] Voici le stratagème, bien digne d'un Carthaginois, qu'Hannibal imagina pendant cet hivernage. Connaissant l'inconstance des Gaulois et n'étant lié avec eux que depuis peu de temps, il craignait de les voir attenter à sa vie ; il se fit donc faire un certain nombre de perruques, convenant aux âges les plus différents ; il les mettait toutes alternativement et en changeait continuellement ; en même temps, il changeait de vêtements, et ceux qu'il prenait allaient toujours bien avec la perruque qu'il portait alors. Ainsi, personne ne le reconnaissait, pas plus ceux qui le voyaient fréquemment que ceux qui ne l'avaient aperçu qu'en passant. Les Gaulois, d'ailleurs, étaient mécontents que la guerre se fît sur leur territoire; ils ne demandaient qu'à la porter en pays ennemi, pour se venger des Romains, prétendaient-ils, mais en réalité pour se livrer au pillage. Hannibal constata ces dispositions et, pour leur donner satisfaction, il décida d'entrer en campagne le plus tôt possible. Dès que la mauvaise saison fut passée, il s'enquit auprès des gens qui lui paraissaient le mieux connaître la contrée de la route à suivre pour aller attaquer l'ennemi chez lui. Il y avait deux chemins possibles: l'un était long et très familier aux Romains ; l'autre, qui traversait les marais d'Étrurie, était pénible, mais court, et il était probable que Flaminius ne l'attendrait pas par là. Fidèle à sa tactique ordinaire, ce fut ce dernier qu'il préféra. Mais quand le bruit se répandit parmi les soldats que le général allait les mener à travers des marécages, ce ne fut pas sans appréhension qu'ils se préparèrent à en aborder les ravins et les fondrières.
[379] Après s'être soigneusement assuré que tous les endroits par où il fallait passer étaient guéables et que le sol en était assez ferme, Hannibal leva le camp. Il forma son avant-garde avec les Africains, les Espagnols et toutes les troupes d'élite ; ce fut dans le même corps qu'il rangea les bagages, afin de ne pas manquer de vivres en route ; car pour l'avenir il ne se préoccupait pas du tout de cette question : vaincu en territoire ennemi, il n'aurait plus besoin de rien ; vainqueur et maître du pays, il trouverait facilement à se ravitailler. Après l'avant-garde il plaça les Gaulois et, en dernière ligne, la cavalerie. Il confia le commandement de l'arrière-garde à son frère Magon, pour diverses raisons, mais surtout parce qu'il craignait de voir les Gaulois manquer d'énergie et d'endurance : s'ils se rebutaient et faisaient mine de vouloir rebrousser chemin, les cavaliers de Magon avaient ordre de les en empêcher de gré ou de force. Les Espagnols et les Africains accomplirent sans trop de peine la traversée des marais, parce qu'on n'y avait pas encore marché ; c'étaient d'ailleurs tous des soldats endurcis à la fatigue et accoutumés aux difficultés de cette sorte. Mais les Gaulois avaient beaucoup de mal à avancer : le sol du marais était foulé et bouleversé à une grande profondeur, et ils supportaient fort mal cette marche pénible, parce qu'ils n'étaient pas du tout habitués à ce genre d'exercice. Cependant ils ne pouvaient retourner sur leurs pas : la cavalerie qui venait derrière eux leur barrait la route. Toute l'armée eut beaucoup à souffrir, principalement du manque de sommeil : on marcha en effet les pieds dans l'eau, sans discontinuer, pendant quatre jours et trois nuits ; mais ce furent les Gaulois qui furent incontestablement le plus éprouvés. La plupart des bêtes de somme tombèrent dans la boue et y moururent ; mais dans leur chute même, elles étaient encore de quelque utilité pour les hommes : ils se couchaient sur des ballots qu'ils entassaient sur le dos des animaux morts et pouvaient ainsi dormir hors de l'eau une petite partie de la nuit. Un grand nombre de chevaux perdirent leurs sabots, à force de marcher dans un terrain aussi fangeux. Hannibal, monté sur le seul éléphant qui lui restât, eut toutes les peines du monde à se tirer de là : il souffrait violemment d'une grave ophtalmie qu'il avait contractée et qui finit par lui faire perdre un oeil, parce que les circonstances ne lui laissaient pas le loisir de s'arrêter pour se soigner.
[380] Sorti de ce bourbier comme par miracle, il arriva en Étrurie au moment où Flaminius avait établi ses quartiers devant Arrétium ; il campa sur le bord même du marais, pour faire reposer ses troupes, tout en cherchant à surprendre les intentions de l'ennemi et à se renseigner sur la nature des lieux par où l'on devait passer. On lui dit que le pays qui s'étendait devant lui était des plus florissants ; quant à Flaminius, c'était un homme très habile à capter la faveur populaire et le type parfait du démagogue, qui, sans aucune pratique réelle des affaires et sans aucun talent militaire, avait en lui-même une confiance absolue. Hannibal en conclut que, s'il parvenait à tourner le camp du consul et à pénétrer plus avant, Flaminius ne pourrait supporter de voir le pays ravagé ; poussé soit par la crainte d'encourir les railleries de ses soldats, soit par le dépit que lui causerait ce spectacle, il accourrait à sa rencontre et le suivrait pas à pas, pour essayer de remporter la victoire par lui-même, sans attendre l'arrivée de son collègue ; et Hannibal comptait bien que son adversaire lui fournirait ainsi mainte occasion de l'attaquer. Tout cela était fort sagement, fort habilement calculé.
[381] On doit le reconnaître, en effet, quiconque s'imagine qu'il y a dans la stratégie une question plus importante que de connaître le naturel et les penchants du général ennemi n'y entend absolument rien. Dans un combat singulier ou quand on lutte rang contre rang, il faut, si l'on veut être vainqueur, bien regarder comment on peut atteindre le but visé, c'est-à-dire en quelle partie de son corps l'adversaire est le plus découvert et le moins défendu ; de même, un chef d'armée doit examiner chez son antagoniste non pas quelle est la partie du corps la plus découverte, mais quel est le point faible de son caractère, par où on pourra le mieux le surprendre. Il en est beaucoup qui par leur mollesse et leur inertie trahissent non seulement tous les intérêts de l'État, mais les leurs propres; d'autres aiment tellement le vin qu'ils ne peuvent se coucher sans être ivres à en perdre l'esprit ; quelques-uns sont si insatiables dans la débauche qu'ils sacrifient à cette passion honteuse leur patrie, leur fortune et jusqu'à leur vie. La lâcheté, la poltronnerie sont toujours déshonorantes ; mais chez un général, un pareil défaut est une calamité publique ; car il n'a pas seulement pour effet de paralyser l'action des troupes que commande un tel chef, mais il fait souvent courir les plus grands dangers au pays qui a mis sa confiance en lui. La précipitation, la présomption, un emportement irréfléchi, la gloriole, la vanité, sont des travers non moins favorables à l'ennemi et funestes au parti qu'on défend; il n'y a pas de piège, pas de traquenard, pas de guet-apens où ils ne vous exposent à tomber. Quelqu'un qui connaîtrait bien les faiblesses d'autrui et attaquerait ses adversaires en prenant leur chef par le point où il est le plus vulnérable serait bientôt le maître du monde entier. Si l'on prive un navire de son pilote, il ne manquera pas de tomber aux mains de l'ennemi avec tout son équipage; de même, si l'on sait surprendre un général par des machinations et des artifices, on arrivera souvent à s'emparer de toute son armée. C'est ainsi qu'Hannibal, avec une intelligente perspicacité, en usa à l'égard de Flaminius ; et son stratagème réussit pleinement.
[382] En effet, dès qu'Hannibal eut quitté la région de Fiesole, légèrement dépassé le camp romain et poussé une pointe plus au sud, le consul, transporté de fureur, considéra cette incursion de l'ennemi comme une insulte à son égard. Puis, quand il vit le pays ravagé et la fumée s'élever de tous côtés, annonçant la ruine de la contrée, il fut ému par ce triste spectacle. En vain on l'engagea à ne pas se hâter de prendre l'offensive, on lui représenta qu'il fallait se méfier d'une cavalerie aussi nombreuse et se bien tenir en garde contre elle, on le conjura d'attendre l'arrivée de son collègue et de ne livrer bataille qu'avec toutes leurs forces réunies ; il méprisa tous les avis, s'emporta même contre ceux qui les lui donnaient : « Songez, répliquait-il, à ce que doivent dire ceux qui sont restés à Rome, en voyant que la campagne est dévastée presque jusqu'aux portes de la ville et que nous restons immobiles dans nos quartiers d'Étrurie, avec l'ennemi devant nous. » Là-dessus, il lève le camp et se met en marche avec son armée, sans choisir son moment, sans connaître les lieux, ne songeant qu'à une chose : fondre sur l'ennemi, comme si la victoire lui était déjà acquise. Il avait inspiré à la foule une telle confiance qu'il avait avec lui moins d'hommes armés que de non-combattants, qui le suivaient pour ramasser les dépouilles des vaincus, munis seulement de chaînes, d'entraves et de tout un attirail de ce genre. Pendant ce temps, Hannibal avançait toujours vers Rome à travers l'Étrurie ; il avait à sa gauche la ville et les montagnes de Cortone, à sa droite le lac de Trasimène ; sur son passage, il mettait tout à feu et à sang, pour achever d'exaspérer son adversaire. Quand il vit que Flaminius approchait, il reconnut les postes de combat qui lui seraient le plus avantageux et se tint prêt à livrer bataille.
[383] Il trouva sur son chemin un vallon au sol uni, bordé dans sa longueur, sur chacun des deux versants, par une chaîne ininterrompue de collines élevées ; dans sa largeur, il était fermé au fond par un tertre escarpé et d'accès difficile, à l'entrée par un lac, entre lequel et le pied de la montagne il n'y avait qu'un défilé très étroit pour pénétrer dans le vallon. Il longea les bords du lac, traversa toute la vallée, gagna le tertre qui la barrait, s'y établit avec ses Espagnols et ses Africains ; il détacha les frondeurs baléares et les lanciers en avant-garde et les développa en une longue file, qu'il dissimula derrière les collines situées à droite du vallon ; il fit faire aux cavaliers et aux Gaulois le tour des collines de gauche, de façon que leurs lignes s'étendissent d'un bout à l'autre sans interruption, les derniers se trouvant tout près du défilé situé entre le lac et la montagne. Après avoir pris de nuit toutes ces dispositions et dressé ses embuscades de toutes parts, il attendit tranquillement. Flaminius le suivait et brûlait de l'atteindre. La veille du combat, il arriva à une heure assez tardive au bord du lac et y campa ; le lendemain, au point du jour, il donna l'ordre à son avant-garde de pénétrer dans le vallon en longeant la berge, pour attaquer l'ennemi.
[384] La journée était extrêmement brumeuse. Quand la majeure partie de l'armée romaine se fut engagée dans le vallon et que son avant-garde toucha presque l'endroit où Hannibal s'était établi, le général carthaginois donna le signal, le fit donner à ses détachements postés en embuscade, et de tous côtés en même temps ses troupes fondirent sur l'ennemi. Surpris par cette attaque imprévue, ne distinguant rien dans ce brouillard épais, pressés par les assaillants qui surgissaient de toutes les hauteurs environnantes, Flaminius, ses centurions et ses tribuns ne pouvaient pas se porter aux points où leur présence eût été nécessaire et ne savaient même pas ce qui se passait. Chargés à la fois en tête, en queue et de flanc, ils furent tués pour la plupart avant que la colonne eût seulement pu se mettre en état de défense ; ils se trouvaient pour ainsi dire livrés à l'ennemi par la sottise de leur chef ; on se demandait encore ce qu'il y avait à faire, qu'on recevait soudain un coup mortel. Flaminius, indécis, désespéré, fut assailli dans la mêlée par quelques Gaulois, qui le tuèrent. Près de quinze mille Romains succombèrent dans ce vallon, sans avoir pu ni se battre ni se retirer; c'est d'ailleurs à leurs yeux le premier de tous les devoirs de ne jamais fuir ou abandonner leur poste. D'autres, surpris dans leur marche entre le lac et la montagne, furent cernés dans le défilé et y trouvèrent une mort honteuse, mais surtout lamentable ; quelques-uns, poussés dans le lac, perdirent la tête au point de se jeter à la nage avec leurs armes et se noyèrent ; mais la plupart d'entre eux avançaient dans l'eau tant qu'ils avaient pied et s'arrêtaient quand leur tête seule émergeait ; voyant arriver sur eux la cavalerie et se sentant perdus, ils levaient les mains, suppliaient de toutes leurs forces qu'on leur laissât la vie ; les uns tombèrent enfin sous les coups des Carthaginois; les autres, affermissant leur volonté par des encouragements mutuels, se tuèrent de leurs propres mains. Six mille hommes seulement, dans le vallon, vinrent à bout du corps qui les avait attaqués de front, mais ils ne purent ni porter secours à leurs compagnons ni tourner l'ennemi, parce qu'ils ne voyaient rien de ce qui se passait ; leur intervention eût pu cependant avoir une influence décisive sur l'issue du combat. Ils allaient toujours de l'avant, pensant rencontrer encore les Carthaginois, et arrivèrent ainsi, sans s'en apercevoir, jusque sur les hauteurs. De là, comme le brouillard était tombé, ils virent que la bataille était perdue, qu'il n'y avait plus rien à tenter, que les Carthaginois étaient vainqueurs et restaient maîtres du terrain ; ils se replièrent alors, en rangs serrés, vers un village d'Étrurie. Hannibal lança à leur poursuite Maharbal à la tête des Espagnols et des lanciers ; assiégés dans le village, réduits à toute extrémité, ils déposèrent les armes et se rendirent à condition qu'ils auraient la vie sauve. Ainsi finit la grande bataille qui se livra en Étrurie entre Romains et Carthaginois.
[385] Quand on eut amené à Hannibal les prisonniers qui avaient capitulé et ceux qui avaient été faits sur le champ de bataille, il les assembla tous (il y en avait plus de quinze mille) et déclara aux premiers que Maharbal avait outrepassé ses droits en prenant un engagement envers eux sans son autorisation ; et il partit de là pour se livrer à une violente diatribe contre les Romains. Après quoi, il répartit entre ses divers bataillons, pour y être tenus sous bonne garde, ceux d'entre les captifs qui étaient Romains ; au contraire, il libérait sans rançon tous les auxiliaires ; il les assura encore, comme il l'avait déjà fait, qu'il n'était pas venu faire la guerre aux Italiens, mais qu'il la faisait aux Romains pour l'affranchissement de l'Italie. Il fit reposer son armée et rendre les honneurs funèbres à une trentaine de ses principaux officiers qui étaient morts dans le combat ; il avait perdu en tout quinze cents hommes, des Gaulois pour la plupart. Ensuite, il délibéra avec son frère et ses amis pour savoir de quel côté et comment il pousserait son offensive ; car il comptait bien, maintenant, sur le succès définitif. Cependant la nouvelle de la défaite était arrivée à Rome. Le désastre était trop grand pour qu'il fût possible aux magistrats de l'atténuer ou de le dissimuler ; on réunit le peuple en assemblée et il fallut bien lui dire la vérité. Dès que le préteur fut monté à la tribune et eut proféré ces paroles : "Nous avons été vaincus dans une grande bataille", une telle consternation s'empara de la foule que. ceux des citoyens qui avaient déjà assisté au combat eurent alors l'impression d'un malheur plus considérable que lorsqu'ils étaient sur les lieux. Et c'était fort naturel : il y avait si longtemps que les Romains n'avaient pas subi de défaite et n'avaient entendu prononcer ce mot ; aussi ne savaient-ils pas supporter avec calme et dignité l'annonce officielle de ce revers. Le Sénat seul ne perdit pas la notion de son devoir : il se mit à délibérer sur les mesures à prendre et la conduite à tenir dans la suite de la campagne.
[386] Au moment même où la bataille avait lieu, Cn. Servilius, le consul qui avait ses quartiers à Ariminum, — c'est-à-dire sur les côtes de l'Adriatique, aux confins des plaines de la Cisalpine et du reste de l'Italie, non loin des bouches du Pô, — venait d'apprendre qu'Hannibal avait envahi l'Étrurie et campait en face de Flaminius ; il aurait bien voulu aller rejoindre son collègue avec toutes ses troupes ; mais elles étaient trop pesantes pour que ce fût possible ; il confia donc quatre mille cavaliers à C. Centénius et le fit partir en avance, pour prêter main-forte à Flaminius, en cas de besoin, avant qu'il arrivât lui-même. Quand Hannibal fut informé, après la bataille, qu'on voyait approcher des renforts envoyés par les Romains, il expédia contre eux Maharbal avec les lanciers et une partie de la cavalerie. Les deux détachements n'eurent pas plus tôt pris contact que Centénius perdit presque la moitié de ses hommes ; les autres se réfugièrent sur une colline, où les Carthaginois les poursuivirent et les firent tous prisonniers le lendemain. La nouvelle de ce second échec parvint à Rome trois jours après celle de la bataille de Trasimène, quand la blessure était encore toute saignante ; cette fois, non seulement le peuple, mais le Sénat lui-même furent consternés. On décida de surseoir au règlement des affaires courantes et à l'élection des consuls, pour songer avant tout à la situation présente; l'opinion générale fut que les circonstances exigeaient la nomination d'un dictateur. Malgré sa confiance dans le succès, Hannibal ne crut pas le moment venu de marcher sur Rome ; il se contenta de parcourir la campagne et de la ravager librement, en faisant route vers l'Adriatique. Il traversa l'Ombrie, puis le Picénum, et arriva en dix jours au bord de la mer. Il avait fait tellement de butin que ses soldats ne pouvaient l'emporter avec eux. Il avait, en outre, massacré sur son passage une multitude d'habitants ; comme lorsqu'on prend une ville d'assaut, il avait donné l'ordre à ses soldats d'égorger tous les hommes en âge de porter les armes qu'ils rencontreraient ; tant était enracinée dans son coeur la haine héréditaire qu'il avait vouée aux Romains.
[387] Campé sur les bords de l'Adriatique, dans une région fertile en productions de toute espèce, Hannibal se préoccupa vivement de réconforter et de soigner non seulement ses soldats, mais aussi leurs montures. Leur hivernage de Cisalpine en plein air, dans le froid et dans la boue, puis les fatigues de la marche à travers les marais les avaient fort éprouvés : presque tous les chevaux, et les hommes également, étaient atteints de la maladie qu'on appelle la « gale de la faim ». Leur séjour dans ce pays plantureux permit aux chevaux de retrouver leur embonpoint, aux hommes de reprendre forces et courage. Le général équipa ses Africains à la romaine, en leur choisissant des armes parmi les dépouilles innombrables des vaincus. Ce fut alors qu'il adressa par mer à Carthage un rapport sur sa campagne ; car c'était la première fois qu'il atteignait la côte depuis son entrée en Italie. Ses compatriotes furent très heureux des nouvelles qu'il leur transmettait ; ils ne s'occupaient plus que des opérations en Espagne et en Italie, ne cessaient pas d'y penser et ne négligeaient rien de ce qui pourrait en assurer le succès. A Rome, on avait élu dictateur Q. Fabius, homme aussi éminent par son intelligence que par sa naissance. De notre temps encore, les représentants de cette branche de la famille Fabia portent le surnom de Maximus, c'est-à-dire de « très grand », que leur ont valu les brillants exploits de leur ancêtre. Voici les différences qui existent entre la dictature et le consulat: chacun des deux consuls est suivi de douze licteurs, le dictateur de vingt-quatre; les consuls ne peuvent, dans la plupart des cas, faire appliquer aucune décision sans que le Sénat l'ait sanctionnée, tandis que l'autorité du dictateur est absolue: dès qu'il est installé, tous les pouvoirs sont suspendus à Rome, excepté ceux des tribuns; nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir plus longuement sur cette distinction. En même temps que le dictateur, on nomma M. Minucius commandant de la cavalerie ; cet officier est le subordonné du dictateur; mais, quand ce dernier est obligé de s'absenter, il est pour ainsi dire son suppléant.
[388] Hannibal changeait de quartiers de temps en temps, mais sans s'éloigner de l'Adriatique ; il faisait laver les chevaux avec du vin vieux, dont il avait trouvé des provisions abondantes, et parvint ainsi à les guérir de la gale dont ils souffraient. Il fit également soigner les blessés et restaurer toutes ses troupes, ce qui ranima leur ardeur belliqueuse. Puis il traversa le territoire des Prétutiens, celui d'Hadria, le pays des Marrucins et celui des Frentaniens, dévasta tout sur son passage, puis se remit en route et se dirigea vers l'Apulie. Cette province se subdivise en deux parties, la Daunie et la Messapie. Hannibal envahit d'abord la Daunie et ravagea toute la contrée en commençant par Lucéria, colonie romaine ; puis il alla s'établir à Hippone, d'où il fit sans être inquiété des razzias à Argyrippe et dans toute la Daunie. Aussitôt entré en fonctions, Fabius avait fait des sacrifices aux dieux, puis il s'était mis en marche avec son lieutenant et quatre légions qu'il venait de lever. Il rencontra sur les confins de la Daunie les renforts qui arrivaient d'Ariminum, releva le consul Servilius du commandement de l'armée de terre et le renvoya à Rome avec une escorte, en le chargeant, si les Carthaginois effectuaient quelque mouvement par mer, de se porter au secours des endroits menacés. Il prit lui-même la tête des troupes et alla, toujours en compagnie de Minucius, camper en face des Carthaginois, près d'un endroit nommé Èques, à cinquante stades de l'ennemi.
[389] Quand Hannibal se vit en présence de Fabius, il voulut jeter tout de suite l'épouvante dans les rangs ennemis ; il fit donc sortir son armée, approcha des retranchements romains et se rangea en bataille. Il attendit quelque temps, puis, comme personne ne venait à sa rencontre, il rentra dans son camp. C'est que Fabius était résolu à ne rien risquer et à ne pas courir les chances d'une bataille ; sa première, sa principale préoccupation était de ne pas exposer ses troupes ; et rien ne put le faire dévier de cette ligne de conduite. Dans les premiers temps, cette méthode ne lui valut que du mépris : on prétendait qu'il était lâche, qu'il avait peur du danger ; mais plus tard tout le monde fut obligé de reconnaître et d'avouer que dans les circonstances où l'on se trouvait il était impossible de prendre un parti plus prudent ou plus sensé; il ne fallut pas longtemps pour que sa tactique fût justifiée par les événements. Et il ne pouvait manquer d'en être ainsi : l'armée ennemie était composée de soldats qui, depuis leur plus jeune âge, ne cessaient de s'exercer à la guerre ; ils étaient commandés par un général élevé au milieu d'eux et habitué dès son enfance à vivre dans les camps ; ils avaient gagné bien des batailles en Espagne, ils avaient vaincu deux fois de suite les Romains et leurs alliés ; mais surtout ils luttaient en désespérés et n'avaient de salut possible que dans la victoire. Pour les Romains, la situation était tout opposée ; si Fabius avait eu l'imprudence d'engager une action générale, la défaite était certaine; mais il eut l'habileté de transporter la lutte sur un terrain où tous les avantages étaient de son côté et la fermeté de s'y tenir. Or ces avantages qu'avaient les Romains, c'étaient des approvisionnements inépuisables et une grande réserve d'hommes.
[390] Aussi, à partir de ce moment, le dictateur se borna-t-il à suivre l'ennemi de près et à occuper avant lui les points qu'il savait favorables à l'exécution de son plan. Pouvant recevoir par ses derrières des ravitaillements abondants, il interdit à ses soldats d'aller fourrager ou de s'éloigner des retranchements sous aucun prétexte ; il tenait toujours ses troupes réunies et concentrées, étudiant les lieux, guettant les occasions. C'est ainsi qu'il put surprendre et détruire un grand nombre de fourrageurs ennemis, qui s'avançaient isolément jusqu'à une grande distance de leur camp pour narguer les Romains. Il espérait par ce moyen affaiblir de plus en plus l'armée ennemie, qui ne pouvait renouveler ses effectifs, et ranimer peu à peu, grâce à des succès partiels, l'énergie de ses soldats que les grandes défaites avaient découragés ; mais jamais il ne voulut consentir à engager un combat général. Cette méthode ne plaisait pas à Minucius, le commandant de la cavalerie : pour flatter les sentiments de la soldatesque, il dénigrait Fabius devant tout le monde, l'accusait de lâcheté et d'irrésolution ; quant à lui, il ne demandait qu'à aller de l'avant et à affronter les hasards d'une bataille. Après avoir dévasté l'Apulie, les Carthaginois passèrent l'Apennin et envahirent le Samnium. C'était une province très riche, qui depuis longtemps ne connaissait plus la guerre, et si fertile que les Carthaginois, malgré tout ce qu'ils consommèrent et saccagèrent, ne purent en épuiser les ressources. Ils poussèrent une pointe sur la colonie romaine de Bénévent et s'emparèrent de Venouse, ville ouverte, qui regorgeait d'approvisionnements de toute sorte. Les Romains les suivaient toujours à une ou deux journées de marche, sans jamais s'approcher ni les attaquer. Quand Hannibal vit que Fabius refusait décidément le combat sans cesser néanmoins de tenir la campagne, il entra hardiment dans la plaine de Capoue et en particulier dans le territoire de Falerne ; il espérait que, de deux choses l'une, ou il forcerait ses adversaires à livrer bataille, ou il serait évident pour tout le monde que son triomphe était complet et que les Romains n'osaient pas lui tenir tête en rase campagne. Il espérait frapper ainsi l'esprit des populations et les décider à abandonner le parti des Romains. Jusqu'alors, en effet, en dépit des deux victoires qu'il avait remportées, aucune ville d'Italie n'avait fait défection ; toutes restaient fidèles à leurs engagements, bien que quelques-unes eussent fort à en souffrir. On peut juger par là de l'admiration et du respect que la république romaine inspirait à ses alliés.
[391] Le raisonnement d'Hannibal était d'ailleurs fort juste : la plaine de Capoue est la région la plus renommée de toute l'Italie pour son opulence, sa beauté, sa situation dans le voisinage de la mer et ses ports de commerce, où se rencontrent les navigateurs venus en Italie de toutes les parties du monde. C'est là que se trouvent les villes les plus célèbres et les plus belles de l'Italie : sur la côte, Sinuessa, Cumes, Pouzzoles, puis Naples, enfin Nucéria et son territoire ; dans l'intérieur des terres, au Nord de Capoue, Cales et Téanum ; à l'Est et au Sud, Caudium et Noles ; au milieu de la plaine, la plus riche de toutes, Capoue. Aussi n'est-il pas surprenant que les mythographes aient donné à cette région, comme à d'autres plaines célèbres, le nom de Champs-Phlégréens ; il est très naturel que ce soit une contrée si fertile et si merveilleuse dont les dieux se soient disputé la possession. En outre, c'est un pays très fortifié et où il est extrêmement difficile de pénétrer ; il est borné d'un côté par la mer, de tous les autres par une chaîne continue de hautes montagnes, que l'on ne peut traverser, quand on vient de l'intérieur, que par trois défilés resserrés et peu accessibles : le premier le fait communiquer avec le Samnnium, le second avec le Latium, le dernier avec le territoire des Hirpins. En s'établissant dans ces parages, les Carthaginois montaient en quelque sorte sur un théâtre, d'où ils comptaient étonner le monde par leur hardiesse, faire éclater aux yeux des spectateurs la lâcheté de leurs adversaires et montrer qu'ils étaient les maîtres incontestés de toute la contrée.
[392] Telles furent les raisons qui décidèrent Hannibal à sortir du Samnium en traversant les gorges du mont Ériban et à venir se fixer sur les bords du Vulturne, rivière qui divise la Campanie en deux parties à peu près égales. Il établit son camp sur la rive la plus voisine de Rome et fit ravager toute la plaine par ses fourrageurs, sans que personne tentât de s'y opposer. Fabius fut surpris de cette entreprise audacieuse, mais il n'en fut que plus affermi dans sa résolution. Au contraire, son lieutenant Minucius, tous ses tribuns militaires et ses centurions, s'imaginant qu'ils tenaient l'ennemi à leur merci, étaient d'avis qu'il fallait se hâter de l'attaquer en plaine et ne pas le laisser dévaster impunément le joyau de l'Italie. Fabius fit semblant de partager leurs dispositions belliqueuses; il s'avança rapidement jusqu'à ce qu'il fût à proximité de l'ennemi ; mais, arrivé dans les environs de Falerne, il se contenta de faire apparaître son armée au pied de la montagne, en suivant son adversaire pas à pas, pour ne pas faire croire aux alliés de Rome qu'il n'osait pas lui tenir tête ; mais il ne s'aventurait pas dans la plaine et évitait toujours d'engager une action générale ; et cela parce que, en dehors des raisons que j'ai déjà exposées, il était manifeste que la cavalerie ennemie était très supérieure à la sienne. Quand Hannibal l'eut bien tenté et qu'il eut récolté un butin immense en pillant tout dans la plaine, il se décida à lever le camp pour ne pas gaspiller le fruit de ses rapines, mais le mettre en sûreté dans un endroit où il pourrait prendre ses quartiers d'hiver : il ne voulait pas seulement assurer à son armée un bien-être momentané, il tenait aussi à ce que par la suite elle ne manquât jamais de rien. Fabius comprit qu'il avait l'intention de se retirer par où il était venu ; comme le passage était étroit et se prêtait admirablement à une embuscade, il envoya quatre mille homme, se poster à l'issue du défilé, avec ordre de profiter le mieux possible, si l'occasion s'en présentait, des avantages de la situation ; quant à lui, il alla, avec le gros de son armée, prendre position sur une colline qui dominait l'entrée de la gorge.
[393] Les Carthaginois arrivent et campent dans la plaine, au pied des hauteurs. Le dictateur espérait leur reprendre sans difficulté tout leur butin et croyait même, vu sa position favorable, remporter une victoire qui mettrait fin à la guerre. Il ne songeait plus à autre chose qu'à savoir quels points il occuperait, quel rôle il assignerait à chaque poste, par quelles troupes et de quel côté il ferait donner l'attaque. Tous ses plans étaient tirés pour le lendemain ; mais Hannibal, comprenant le danger qu'il courait, ne lui laissa ni le temps ni le loisir de les mettre à exécution. Il fit appeler un officier nommé Hasdrubal, qui était préposé au service de l'intendance, et lui donna l'ordre d'amasser au plus vite le plus qu'il pourrait de bois sec de toute espèce, d'en former des torches, puis de choisir parmi tout le butin environ deux mille boeufs de labour des plus vigoureux et de les rassembler en avant du camp. La chose faite, il réunit tous les gens d'Hasdrubal, leur désigna une hauteur située entre son camp et le défilé par où on devait passer, et leur ordonna de chasser vivement les boeufs jusqu'au sommet, quand on leur en donnerait le signal. Ensuite il les fit dîner et se reposer en attendant le moment propice. Vers la fin de la troisième garde, il les fit sortir du camp pour aller attacher les torches aux cornes des boeufs. Ce fut vite terminé, vu le nombre des ouvriers. Il fit alors allumer toutes les torches et pousser les boeufs vers les hauteurs ; à la suite des toucheurs de boeufs, il envoya ses lanciers pour les aider un peu dans leur besogne ; une fois que les animaux auraient pris leur course, ils devaient passer à leur droite et à leur gauche, se précipiter à grand bruit sur la colline et en occuper la crête, pour pouvoir prêter main-forte aux leurs et attaquer les ennemis s'ils en rencontraient en haut. En même temps, il fit avancer l'infanterie lourde, puis la cavalerie avec le butin, enfin les Espagnols et les Gaulois, et marcha vers le défilé par où on devait sortir du pays.
[394] A la vue de ces feux qui s'avançaient vers les hauteurs, les Romains qui gardaient l'issue du défilé pensèrent qu'Hannibal cherchait à passer par là ; abandonnant leur poste, ils s'élancèrent à la rescousse du côté de la colline. Arrivés près des boeufs, ils ne comprennent rien à ces lueurs, s'exagèrent le danger, s'attendent à quelque surprise. Surviennent les lanciers carthaginois ; les deux partis escarmouchent quelque temps ; mais les boeufs se jettent au milieu d'eux, et ils restent sur la crête sans pouvoir se joindre, guettant avec impatience le retour du jour pour comprendre ce qui se passait. Fabius ne savait que penser de ce qu'il voyait et, comme dit le poète, il "soupçonnait dessous encor quelque machine" ; d'autre part, il ne voulait toujours pas se départir de son principe : ne pas jouer toute la partie sur un coup de dés en risquant une bataille générale ; il demeura donc immobile derrière ses retranchements et attendit le jour. Hannibal profita de ce que toutes ses prévisions se réalisaient, et notamment de ce que les soldats chargés de garder le passage avaient quitté le défilé, pour le franchir sans encombre avec son armée et ses bagages. Au point du jour, il vit sur la colline ses lanciers aux prises avec l'ennemi ; il envoya à leur secours un détachement d'Espagnols, qui chargèrent les Romains, leur tuèrent un millier d'hommes, dégagèrent sans peine l'infanterie légère et se replièrent. Sorti par cette ruse du territoire de Falerne, Hannibal campa depuis lors en sûreté, et n'eut plus d'autre souci que celui de choisir et d'organiser ses quartiers d'hiver. Son succès répandit la terreur et le découragement dans toutes les cités, chez tous les peuples de l'Italie. La plupart des gens s'en prenaient à Fabius, l'accusaient de lâcheté pour avoir laissé échapper l'ennemi quand il avait la partie si belle. Mais il ne se laissa pas ébranler. Obligé, à quelques jours de là, de revenir à Rome pour célébrer un sacrifice, il confia ses légions au commandant de la cavalerie et lui fit, en le quittant, des recommandations pressantes : il fallait moins songer à remporter une victoire qu'à éviter une défaite. Mais Minucius était si peu sensible à ces conseils qu'au moment même où le dictateur les lui donnait il ne pensait qu'à livrer bataille.
[395] Telle était la situation en Italie. Tandis que ces événements se déroulaient, Hasdrubal, le gouverneur de l'Espagne, avait équipé pendant l'hivernage les trente navires que son frère lui avait laissés, ainsi que dix autres bâtiments ; quand la belle saison fut venue, il fit partir de Carthagène ces quarante vaisseaux de guerre, dont il donna le commandement à un certain Hamilcar. En même temps, il rassemblait ses troupes de terre et quittait ses quartiers d'hiver. Sa flotte et son armée firent route parallèlement le long de la côte, de façon à arriver en même temps à l'embouchure de l'Èbre. Quand Cn. Scipion découvrit les projets des Carthaginois, il eut d'abord l'intention de quitter ses quartiers d'hiver, pour marcher à leur rencontre par terre et par mer ; mais, quand il sut de quelles forces Hasdrubal disposait et quels préparatifs il avait faits, il renonça à l'affronter sur terre, équipa trente-cinq vaisseaux, y fit monter ceux de ses soldats qui lui semblèrent le plus capables de constituer de bonnes troupes d'embarquement et se rendit en deux jours de Tarragone aux bouches de l'Èbre. Il aborda à quatre-vingts stades environ de l'ennemi et envoya deux navires rapides de Marseille pour observer ses positions. Les Marseillais remplissaient en effet l'office d'éclaireurs ; ils s'acquittaient de cette tâche avec intrépidité et rendaient, en cette qualité, les plus grands services aux Romains ; personne n'était plus attaché qu'eux à la cause de Rome ; ils eurent souvent, plus tard, l'occasion de le prouver, mais jamais autant que pendant la guerre d'Hannibal. Les navires envoyés à la découverte rapportèrent que l'escadre ennemie était mouillée à l'embouchure du fleuve ; Scipion fit aussitôt mettre à la voile pour fondre sur elle à l'improviste.
[396] Mais il y avait longtemps qu'Hasdrubal était informé par ses sentinelles de l'arrivée de la flotte ennemie ; il fit aussitôt ranger ses troupes de terre sur la côte et embarquer ses équipages ; quand les Romains furent tout près, il fit sonner la charge et engager le combat. La victoire resta quelque temps incertaine ; mais bientôt les Carthaginois commencèrent à plier. La présence des troupes de terre sur le rivage leur fut plus préjudiciable qu'utile : au lieu de leur inspirer plus de confiance, elle leur assurait un refuge facile en cas de défaite. Quand deux vaisseaux eurent été pris avec leur équipage et quatre autres désemparés, ils virèrent de bord et s'enfuirent vers la terre. Comme les Romains s'acharnaient à leur poursuite, ils se jetèrent à la côte, sautèrent à bas de leurs navires et se sauvèrent du côté de leur armée de terre. Les Romains s'approchèrent hardiment, lièrent à leurs vaisseaux tous ceux de la flotte ennemie qu'ils purent mettre à flot et repartirent, débordant de joie : ils avaient vaincu au premier abordage, ils étaient maîtres de la mer, ils avaient pris à l'ennemi vingt-cinq bâtiments. Ce fut depuis lors et en raison de ce succès que les Romains commencèrent à mieux augurer de leur campagne d'Espagne. Quant aux Carthaginois, lorsqu'ils apprirent la défaite qu'ils avaient subie, ils équipèrent immédiatement soixante-dix vaisseaux et les firent aussitôt mettre à la voile ; car la maîtrise de la mer leur semblait indispensable à toutes leurs entreprises. Cette flotte se rendit d'abord en Sardaigne, puis de là en Italie, du côté de Pise, où elle espérait opérer sa jonction avec l'armée d'Hannibal. Mais les Romains envoyèrent contre eux, de Rome même, cent vingt vaisseaux à cinq rangs de rames. Quand les Carthaginois surent qu'ils avaient pris la mer, ils retournèrent en Sardaigne, puis à Carthage. Cn. Servilius, qui commandait l'escadre romaine, les poursuivit quelque temps, dans l'espoir de les atteindre ; mais ils avaient trop d'avance sur lui, et il y renonça. Il vint d'abord jeter l'ancre à Lilybée, en Sicile ; puis il cingla vers l'île de Cercina, en Afrique ; à prix d'argent, il consentit à ne pas ravager le pays et reprit sa route. En passant, il occupa l'île de Cossyros, laissa une garnison dans sa petite ville et revint aborder à Lilybée. Il y fit mettre sa flotte au mouillage et partit peu de temps après pour rejoindre l'armée de terre.
[397] A la nouvelle de la victoire navale remportée par Cn. Scipion, le Sénat jugea bon et même nécessaire de ne pas se désintéresser des affaires d'Espagne, mais d'y poursuivre les opérations contre les Carthaginois et d'en étendre le champ ; on équipa vingt vaisseaux, on en donna le commandement à P. Scipion, qui déjà avait reçu la même mission au début de la guerre, et on l'envoya rejoindre en toute hâte son frère Cnéus, pour agir de concert avec lui. Le Sénat craignait de voir les Carthaginois, une fois maîtres de l'Espagne, y réunir des approvisionnements et des forces considérables, et redoubler d'efforts pour établir leur domination sur mer, afin de pouvoir aider Hannibal à conquérir l'Italie, en lui fournissant des troupes et de l'argent. C'est pour cela qu'il attachait tant d'importance à cette campagne et qu'il avait envoyé en Espagne l'escadre de P. Scipion. Quand ce général fut arrivé à destination et eut rejoint son frère, il rendit de grands services à l'État. Jamais encore les Romains n'avaient osé passer l'Èbre : ils estimaient avoir assez fait en contractant alliance et amitié avec les peuples qui habitaient en deçà du fleuve ; ce fut alors que, pour la première fois, ils le franchirent et osèrent porter la guerre au delà. Le hasard, en ces circonstances, les servit beaucoup. Ils commencèrent par intimider les habitants de l'endroit où ils voulaient passer l'Èbre, puis vinrent camper devant Sagonte près d'un temple d'Aphrodite situé à quelque quarante stades de la ville. La position était admirablement choisie, parce qu'on y était à la fois à l'abri des ennemis et en communication avec la mer ; ils pouvaient donc être ravitaillés par la flotte, qui avait, le long de la côte, réglé sa navigation sur leur marche. Or voici l'incident imprévu qui se produisit alors.
[398] Au moment où Hannibal était parti pour l'Italie, il avait pris comme otages, dans toutes les villes d'Espagne dont il se défiait, les fils des personnages les plus considérables ; il les avait tous transférés à Sagonte, parce que cette place était bien fortifiée et qu'il était sûr des gens qu'il y laissait. Il y avait là un Espagnol, du nom d'Abilyx, dont personne parmi ses compatriotes n'égalait la réputation et le faste, et qui paraissait, bien plus que tout autre, dévoué à la cause de Carthage. Jugeant, à la tournure que prenaient les événements, que les chances étaient du côté des Romains, il forma le projet de leur livrer les otages, par un calcul bien digne d'un Espagnol et d'un barbare; il était persuadé que les Romains lui sauraient le plus grand gré du service qu'il leur rendrait et du témoignage de fidélité qu'il leur donnerait ainsi. Il ne songeait donc qu'aux moyens de perpétrer la trahison qu'il méditait envers les Carthaginois. Ils avaient pour commandant un officier nommé Bostar, qu'Hasdrubal avait chargé d'empêcher les Romains de passer l'Èbre, mais qui n'avait pas osé leur tenir tête et s'était retiré à Sagonte, où il campait du côté de la mer ; c'était un homme simple et doux de sa nature, peu porté à la défiance. Abilyx alla le trouver, mit la conversation sur les otages. Maintenant que les Romains avaient franchi le fleuve, disait-il, les Carthaginois ne pourraient plus contenir les Espagnols par la crainte ; ils devaient, vu les circonstances, s'attacher leurs sujets par l'amitié. Les Romains étaient tout près, ils menaçaient Sagonte, la ville était en danger ; si le général en retirait les otages pour les rendre à leur famille et à leur patrie, il ruinerait tous les beaux projets des Romains; car c'était là précisément ce qu'ils voulaient faire des otages, s'ils parvenaient à s'en emparer ; ce geste vaudrait à Carthage le dévouement de tous les Espagnols, qui seraient reconnaissants au gouverneur d'avoir songé à pourvoir à la sûreté de leurs enfants. Si Bostar voulait le charger de cette mission, il saurait faire valoir ce bienfait : en ramenant les enfants dans leur pays, il lui concilierait non seulement la gratitude de leurs parents, mais encore celle de tous leurs compatriotes : il n'aurait qu'à leur mettre sous les yeux par cet exemple la bonté et la générosité des Carthaginois envers leurs alliés. Bostar lui-même devait s'attendre à recevoir, pour sa part, les présents les plus riches de la part de ces parents à qui il aurait rendu leurs enfants ; après avoir recouvré, contre toute espérance, ce qu'ils avaient de plus cher au monde, ils rivaliseraient entre eux pour récompenser celui à qui ils devraient ce bonheur. Par ces propos et beaucoup d'autres du même genre, Abilyx réussit à obtenir l'assentiment de Bostar.
[399] Le traître se retira alors, après avoir convenu du jour où il viendrait avec des gens sûrs chercher les enfants. Il se rendit de nuit au camp des Romains, s'aboucha avec quelques Espagnols qui servaient dans leurs rangs et se fit présenter par eux aux généraux. Après leur avoir longuement démontré quel changement d'opinion se produirait parmi les Espagnols et quel serait leur attachement à la cause romaine s'ils rentraient en possession de leurs otages, il s'offrit à leur livrer les enfants en question. Publius accueillit cette proposition avec des transports de joie ; il promit à Abilyx des présents considérables et ce dernier repartit, après avoir indiqué le jour, le moment précis et l'endroit où ses complices devraient l'attendre. Il revint ensuite trouver Bostar avec ses amis les plus fidèles, se fit remettre les otages de Sagonte, quitta la ville de nuit, comme s'il voulait éviter d'être aperçu, dépassa le camp romain, arriva à l'heure dite au lieu fixé et remit les otages entre les mains des généraux romains. Publius lui fit un accueil chaleureux et le chargea de ramener les jeunes gens dans leur patrie, en le faisant d'ailleurs escorter par des gens sûrs. Dans toutes les villes où Abilyx passait et remettait des otages, il vantait la bonté et la générosité des Romains, qu'il opposait à la méfiance et à la dureté des Carthaginois, et donnait en exemple son propre revirement ; il entraîna ainsi beaucoup d'Espagnols dans le parti des Romains. Bostar passa pour s'être, malgré son âge, conduit comme un enfant, et la faute qu'il avait commise en se laissant enlever les otages lui fit par la suite courir les dangers les plus graves. Au contraire, l'heureuse chance que les Romains avaient eue en cette occasion leur fut d'un grand profit dans l'exécution de leurs projets. Mais pour l'instant, comme la saison était déjà fort avancée, les deux armées se retirèrent dans leurs différents quartiers d'hiver. Voilà quel était l'état des affaires en Espagne.
[3100] Hannibal — pour en revenir à ce général — avait appris par ses éclaireurs qu'il trouverait des vivres en abondance dans les environs de Lucéria et de Gérunium, et que cette dernière place était admirablement disposée pour servir de magasin ; il résolut donc d'y passer l'hiver et conduisit ses troupes dans cette région en longeant le pied du mont Liburne. Il arriva à Gérunium, qui est à deux cents stades de Lucéria ; là, il commença par parlementer, essaya de gagner les habitants par ses promesses et par les gages qu'il leur en offrait; puis, comme ses efforts demeuraient infructueux, il mit le siège devant la place. Il s'en rendit maître assez rapidement, massacra tous les habitants, mais laissa debout la plupart des maisons et les remparts, pour pouvoir faire de la ville un dépôt de vivres pendant l'hivernage ; il cantonna ses troupes en dehors des murs, dans un camp fortifié avec un fossé et un retranchement. Ces dispositions prises, il organisa les ravitaillements de la manière suivante : les deux tiers de l'armée allaient au fourrage ; chaque soldat devait rapporter quotidiennement une mesure déterminée de blé et chaque équipe remettait sa contribution aux hommes chargés de l'administration des vivres. Le dernier tiers avait pour mission de garder le camp et de détacher des postes avancés pour la protection des fourrageurs. Comme le pays était presque partout en plaine et fort peu accidenté, que les travailleurs étaient pour ainsi dire innombrables, que de plus c'était le meilleur moment pour rentrer les blés, on amassait chaque jour des provisions en quantité prodigieuse.
[3101] Minucius, à qui Fabius avait délégué son commandement, commença par suivre à flanc de coteau les mouvements des Carthaginois; il gardait toujours l'espoir qu'une occasion se présenterait d'engager un combat sur les hauteurs. Mais quand il sut qu'Hannihal avait pris Gérunium, qu'il moissonnait toutes les récoltes du pays et qu'il s'était retranché devant la ville, il quitta les sommets et descendit sur les contre-forts qui donnaient accès dans la plaine. Arrivé à la colline de Calène, sur le territoire de Larinum, il y installa son camp, avec l'intention bien arrêtée d'attaquer l'ennemi à tout prix. A son approche, Hannibal, n'envoyant au fourrage que le tiers de son armée, s'avança avec les deux autres tiers jusqu'à seize stades de la place et vint camper sur un tertre, d'où il comptait à la fois tenir les Romains en respect et pourvoir à la sûreté de ses fourrageurs. Il y avait entre les deux armées une autre élévation de terrain, avantageusement située et très voisine des positions romaines ; Hannibal la fit occuper pendant la nuit par un détachement de deux mille lanciers. Quand le jour revint et que Minucius les aperçut, il lança ses troupes légères à l'assaut de la colline. La lutte fut vive ; mais enfin les Romains l'emportèrent et toute leur armée vint s'établir sur cette hauteur. Pendant quelque temps, Hannibal garda avec lui le gros de ses forces, car les deux camps étaient très rapprochés. Mais comme les jours passaient, il fut obligé d'en détacher une partie pour mener les bêtes au pâturage et d'autres pour fourrager ; car il ne renonçait pas à son premier projet, de ne pas gaspiller ses prises et d'amasser le plus possible d'approvisionnements, afin d'avoir des vivres en abondance, pendant tout l'hiver, pour les hommes, les bêtes de somme et les chevaux de selle. C'était en effet sur la cavalerie qu'il fondait ses plus belles espérances.
[3102] Cependant Minucius s'aperçut que la plus grande partie des ennemis s'étaient répandus dans la campagne pour les raisons que j'ai dites ; il choisit l'heure du jour qui lui parut la plus propice, fit sortir son armée, approcha du camp punique, rangea en bataille son infanterie lourde et, divisant en pelotons sa cavalerie et ses troupes légères, il les lança sur les fourrageurs avec ordre de n'en prendre aucun vivant. Dans ces conjonctures, Hannibal se trouva fort embarrassé : il n'était en état ni de se porter au devant de l'armée ennemie, ni de marcher au secours de ses soldats dispersés à travers champs. Aussi les patrouilles romaines tuèrent-elles un grand nombre de ces fourrageurs isolés; quant au corps qui avait attaqué de front, il brava les Carthaginois au point d'arracher les palissades de leur camp et presque de les y assiéger. La situation d'Hannibal était critique ; il résista pourtant à l'orage ; il repoussa les assaillants, défendit ses retranchements, non sans difficultés, et put tenir jusqu'au moment où Hasdrubal, qui avait rassemblé au camp placé devant Gérunium quatre mille fourrageurs échappés aux Romains, vint à la rescousse. Un peu enhardi par l'arrivée de ce renfort, il tenta une sortie, rangea ses troupes en avant de l'enceinte fortifiée et parvint, à grand'peine, à se tirer du danger qui le menaçait. Beaucoup d'ennemis avaient été tués dans l'assaut donné à leur campement, plus encore en rase campagne : Minucius, en se retirant, concevait de là les plus brillantes espérances pour l'avenir. Le lendemain, il revint prendre possession de cette redoute, abandonnée par les Carthaginois. Hannibal avait craint de voir les Romains surprendre de nuit le camp de Gérunium, qu'il avait laissé sans défense, et s'emparer de ses bagages avec tout ce qu'il avait mis en réserve ; il avait donc jugé sage de battre en retraite pour s'établir de nouveau devant la place. Depuis cette aventure, les Carthaginois n'allèrent plus au fourrage qu'avec beaucoup de prudence et de circonspection, tandis que les Romains montraient plus d'assurance et de hardiesse.
[3103] Quand on reçut à Rome la nouvelle de ce succès, que d'ailleurs on exagérait, la joie fut à son comble : après avoir désespéré du résultat final, on croyait voir la situation s'améliorer ; de plus, on s'imaginait que si jusqu'alors les troupes étaient restées inactives et comme paralysées ce n'était pas à la lâcheté des soldats qu'il fallait s'en prendre, mais à la timidité de leur général. Aussi ne ménageait-on pas à Fabius les critiques et les reproches ; tout le monde l'accusait d'avoir, par sa pusillanimité, laissé échapper les plus belles occasions. En revanche, on portait Minucius aux nues ; on prit même en sa faveur une mesure sans précédent : on lui donna, à lui aussi, une autorité absolue, tellement on était convaincu qu'il terminerait rapidement la guerre. Il y eut donc deux dictateurs pour la même campagne, ce qui ne s'était jamais vu à Rome. Quand Minucius fut informé des sentiments que la foule manifestait à son égard et des pouvoirs que le peuple lui conférait, il sentit redoubler son audace et son ardeur belliqueuse. Fabius, au contraire, revint à l'armée sans que les récents événements eussent rien changé à sa manière de voir et n'en resta que plus fidèle à son ancienne tactique. Mais, las d'entendre son collègue se vanter, le contredire tout le temps et ne parler que de se battre, il lui donna le choix entre deux alternatives : ou de prendre le commandement tour à tour, ou de partager l'armée et de faire chacun de ses légions l'usage qu'il jugerait à propos. Minucius s'empressa d'accepter le partage ; les troupes furent donc divisées et les deux généraux campèrent séparément, à douze stades environ l'un de l'autre.
[3104] Hannibal apprit, tant de la bouche des prisonniers que par ce qu'il voyait de ses propres yeux, les dissensions qui existaient entre les deux généraux, l'impétuosité dont Minucius faisait preuve et le vif désir qu'il éprouvait d'accomplir une action d'éclat ; jugeant que les dispositions d'esprit de ses adversaires ne pouvaient que lui être très favorables, il concentra son attention sur Minucius, dont il voulait abattre l'audace et prévenir les entreprises. Il y avait entre son camp et celui de Minucius une hauteur, d'où celui qui s'y établirait pourrait fort inquiéter l'autre ; il résolut de l'occuper ; mais, prévoyant bien que son antagoniste, enhardi par son récent succès, accourrait immédiatement pour s'opposer à ses tentatives, voici l'artifice qu'il imagina. La campagne environnante était très dénudée, mais le sol en était partout coupé de crevasses et de cavités ; Hannibal envoya pendant la nuit s'embusquer dans les meilleures de ces cachettes, par groupes de deux ou trois cents hommes, cinq cents cavaliers et cinq mille soldats d'infanterie, légère ou autre. Pour qu'ils ne fussent pas découverts le lendemain matin par des fourrageurs romains, il fit dès l'aube occuper la colline par ses fantassins légèrement armés. A cette vue, Minucius, trouvant l'occasion excellente, lance son infanterie légère à l'assaut, avec ordre de disputer énergiquement la position à l'ennemi ; il la fait suivre de sa cavalerie, puis avance lui-même avec les bataillons serrés de son infanterie lourde ; l'ordre de bataille était exactement le même que dans l'affaire précédente.
[3105] Le jour venait de se lever ; les Romains avaient tous l'esprit et les regards tournés vers la colline où l'on se battait et ne soupçonnaient pas l'embuscade dressée contre eux. Hannibal envoyait sans cesse de nouvelles troupes soutenir ses avant-postes ; il les suivit de près en personne avec ses cavaliers et le gros de son armée ; bientôt, un combat de cavalerie s'engagea. Les fantassins romains légèrement armés furent accablés sous le nombre et se réfugièrent dans les rangs de l'infanterie lourde, où ils causèrent un grand désordre. Au même instant, à un signal donné, les hommes placés en embuscade surgissent de tous côtés et fondent sur les Romains ; ce n'est plus seulement l'infanterie légère, c'est toute l'armée qui court le plus grand danger. C'est alors que Fabius, qui voyait la situation critique de son collègue et craignait qu'il ne fût complètement écrasé, fait sortir ses troupes et vole à son secours. A son approche, les Romains reprennent courage ; leur armée déjà complètement disloquée se reforme autour des étendards ; ils se replient et battent en retraite vers les renforts qui leur arrivent. Ils avaient perdu une grande partie de leur infanterie légère, plus encore de leurs légionnaires, et des meilleurs. Mais Hannibal, en présence des troupes fraîches qui s'avançaient en bon ordre, n'osa pas poursuivre les fuyards et fit cesser le combat. Pour ceux qui y avaient pris part, il était manifeste que Minucius avait tout compromis par sa présomption, tandis qu'en cette circonstance comme auparavant c'était Fabius qui, par sa circonspection, les avait sauvés d'un désastre. A Rome aussi, tout le monde comprit alors toute la supériorité d'une stratégie raisonnée, d'une méthode ferme et intelligente sur les élans irréfléchis de bravoure personnelle et sur l'amour d'une vaine gloire. Instruits par l'expérience, les Romains se réunirent de nouveau derrière les mêmes retranchements, campèrent tous ensemble et ne suivirent plus désormais que les avis de Fabius. Les Carthaginois tracèrent une ligne de fortifications entre la colline et leur camp ; ils construisirent un fortin au sommet de la hauteur qu'ils avaient conquise et y placèrent une garde ; après s'être ainsi garantis contre toute surprise, ils se préparèrent à prendre leurs quartiers d'hiver.
[3106] La date des comices approchait. On élut consuls L. Émilius et C. Térentius ; à leur entrée en fonctions, les dictateurs se démirent de leur charge et les consuls de l'année précédente, Cn. Servilius et M. Régulus (ce dernier avait été désigné après la mort de Flaminius pour lui succéder), furent délégués par Paul-Émile en qualité de proconsuls ; ils prirent le commandement des troupes de campagne et dirigèrent les opérations en toute autorité. D'accord avec le Sénat, le consul fit faire aussitôt de nouvelles levées pour compléter l'effectif des légions et envoyer les recrues à Servilius ; on lui interdit d'engager sous aucun prétexte une bataille générale; mais on lui donna comme instructions de livrer des escarmouches aussi vives et aussi fréquentes que possible, pour exercer et aguerrir les jeunes soldats en vue d'une action décisive; on estimait en effet que les défaites subies jusque-là provenaient surtout de ce qu'on avait fait donner des troupes récemment enrôlées et tout à fait novices. En même temps, on confia une légion au préteur L. Postumius et on l'envoya faire une diversion en Cisalpine, pour obliger les Gaulois, alliés d'Hannibal, à se séparer de lui ; on s'occupa aussi de faire rentrer l'escadre qui hivernait à Lilybée et d'expédier aux chefs de l'armée d'Espagne toutes les munitions dont ils pouvaient avoir besoin; bref, on eut soin de prendre, sur ces points et sur d'autres, toutes les mesures nécessaires. Servilius suivit à la lettre toutes les instructions qu'il avait reçues des consuls, de sorte que je n'ai rien de plus à dire à ce sujet. Se conformant à la fois aux ordres qui leur avaient été donnés et à la conduite que leur imposaient les circonstances, les deux proconsuls ne firent rien de considérable ni de bien mémorable ; ils se bornèrent à livrer un assez grand nombre d'escarmouches et de petits combats, où ils se firent fort apprécier, car ils y firent preuve de beaucoup de courage et d'intelligence.
[3107] Les deux armées passèrent ainsi l'hiver et le printemps en face l'une de l'autre ; mais quand le moment de la moisson fut arrivé, Hannibal quitta son camp de Gérunium et, pensant qu'il aurait intérêt à mettre l'ennemi dans l'obligation de combattre, il s'empara de la citadelle de Cannes. C'était là que les Romains serraient le blé et les autres approvisionnements qui leur venaient de Canusium, et c'était de là qu'ils faisaient venir leurs convois de vivres au fur et à mesure des nécessités de la campagne. La ville avait été déjà détruite antérieurement ; mais alors, la perte des magasins et de la citadelle mit l'armée romaine dans un très grand embarras; non seulement la prise de cette place les privait de leurs ravitaillements, mais Cannes était une position stratégique très avantageuse, qui dominait toute la contrée environnante. Les proconsuls envoyaient à Rome courrier sur courrier pour demander ce qu'ils devaient faire : s'ils approchaient de l'ennemi, il ne leur était pas possible d'éviter une rencontre ; le pays était ravagé ; les alliés étaient tous hésitants. Le Sénat fut d'avis qu'il fallait livrer bataille ; mais il donna à Servilius l'ordre d'attendre encore et fit partir les consuls. Chacun avait les yeux tournés vers Paul-Émile ; c'était en lui que Rome mettait le meilleur de ses espérances, tant à cause des qualités dont il avait fait preuve pendant toute sa vie que pour le courage et l'habileté avec lesquels il avait, peu de temps auparavant, conduit la guerre d'Illyrie. Chose qui ne s'était encore jamais vue à Rome, on leva une armée de huit légions, composée chacune de cinq mille hommes, sans compter les auxiliaires. Les Romains, comme je l'ai déjà dit, n'équipent chaque année que quatre légions, dont chacune comprend environ quatre mille hommes à pied et deux cents à cheval; dans les circonstances très graves, ils portent l'effectif de la légion à cinq mille fantassins et trois cents cavaliers ; leurs alliés leur fournissent une infanterie sensiblement égale à celle des légions et une cavalerie ordinairement trois fois plus nombreuse; on confie à chacun des deux consuls la moitié des troupes auxiliaires et deux légions, avec lesquelles il part en campagne ; dans la plupart des cas, il n'y a qu'un des consuls qui donne avec deux légions et son contingent d'auxiliaires ; il est rare que toute l'armée soit engagée dans une seule et même bataille. Il fallait qu'on fût bien inquiet, qu'on redoutât bien vivement les conséquences de l'action qui allait avoir lieu, pour qu'on mît en ligne non pas quatre, mais huit légions à la fois.
[3108] On convoqua donc au Sénat Paul-Émile et son collègue; on mit sous leurs yeux l'importance des conséquences qu'aurait une victoire ou une défaite ; on les engagea à bien choisir leur moment pour livrer un combat décisif et à s'y conduire avec une vaillance digne de leur patrie ; puis on les congédia. Quand ils eurent rejoint leurs troupes, ils les réunirent en assemblée, leur firent part des décisions du Sénat et leur prodiguèrent les encouragements que comportaient les circonstances. Paul-Émile parla avec une émotion sincère : il s'étendit surtout sur les revers éprouvés récemment ; car les soldats en avaient été si découragés qu'il était nécessaire de dissiper cette impression. Il s'efforça donc de leur démontrer que les échecs antérieurs étaient explicables par bien des causes, mais que cette fois, s'ils étaient des hommes, ils ne pouvaient manquer d'être vainqueurs. Jamais, dans les affaires précédentes, les deux consuls n'avaient combattu avec toutes les légions réunies ; jamais on ne s'était servi de troupes suffisamment exercées, mais seulement de nouvelles recrues qui n'avaient aucune expérience de la guerre et qui ne connaissaient pas du tout l'ennemi, puisqu'elles allaient se mesurer avec lui dans une action générale sans presque l'avoir vu. Ceux qui avaient été vaincus à la Trébie étaient arrivés la veille de Sicile et avaient donné dès le lendemain matin ; quant à ceux qui avaient combattu en Étrurie, non seulement ils n'avaient pas vu l'ennemi auparavant, mais le brouillard les avait même empêchés de le voir pendant la bataille.
[3109] « Aujourd'hui, ajouta-t-il, c'est tout le contraire. Non seulement nous sommes ici tous les deux pour partager vos périls, mais les consuls de l'année dernière sont restés, sur notre demande, pour combattre à nos côtés. Vous avez vu de vos yeux l'armement, l'ordonnance, le nombre des ennemis ; que dis-je ? voici plus d'un an que vous vous mesurez avec eux presque chaque jour. Toutes les conditions sont à l'opposé de ce qu'elles étaient dans les combats précédents, le résultat aussi doit être opposé. Il est invraisemblable — ou plutôt impossible — qu'après avoir presque toujours été vainqueurs dans de légères escarmouches où vous luttiez à forces égales, vous soyez vaincus dans une bataille générale où vous serez de plus de la moitié supérieurs en nombre. Camarades, tout est prévu pour la victoire ; il ne vous faut plus qu'une chose, l'ardeur, la volonté de vaincre, et il m'est inutile, je pense, de vous faire à ce sujet de plus amples recommandations. Si je parlais à des mercenaires ou à des auxiliaires qui prêtent leur concours à une autre nation en vertu d'un traité d'alliance, qui courent tous les risques d'un combat dont le résultat n'a guère d'intérêt pour eux, c'est alors que des exhortations seraient nécessaires ; au contraire, ceux qui, comme vous, se battent non pour autrui, mais pour eux-mêmes, pour leur patrie, pour leurs femmes, pour leurs enfants, et qui sont bien plus sensibles aux conséquences d'une bataille qu'aux dangers qui les y menacent, ceux-là peuvent avoir besoin d'avis, mais non d'encouragements. Qui n'aimerait mieux vaincre ou, si c'était impossible, mourir en combattant que de vivre pour voir outragés et maltraités ceux qui lui sont chers? Mais à quoi bon tant de paroles? Représentez-vous par vous-mêmes, camarades, quelle différence il y a entre une défaite et une victoire, entre les suites de l'une et de l'autre, et vous marcherez au combat avec cette pensée que ce n'est pas le sort des légions qui est en jeu, mais celui de la patrie tout entière. Si les choses tournent mal, elle n'a pas une nouvelle armée pour tenir tête à l'ennemi. Tous ses soins, toutes ses ressources, tous ses espoirs de salut, c'est en vous qu'elle les a mis. N'allez pas tromper son attente, rendez-lui tout le bien qu'elle vous a fait et montrez à l'univers que, si nous avons essuyé quelques défaites, ce n'est pas que les Romains aient moins de valeur que les Carthaginois, mais que nos combattants manquaient d'expérience et que les circonstances leur ont été contraires. » Après avoir encouragé ses soldats par ces considérations et d'autres analogues, Paul-Émile congédia l'assemblée.
[3110] Le lendemain, les consuls se mirent en marche vers l'endroit où on leur avait dit qu'Hannibal était campé ; ils y arrivèrent en deux jours et campèrent eux-mêmes à une cinquantaine de stades de l'ennemi. Paul-Émile, voyant qu'on était au milieu d'une plaine unie et nue, était d'avis de ne pas y engager le combat contre un adversaire supérieur en cavalerie ; il trouvait qu'il valait mieux l'attirer sur un terrain où ce serait l'infanterie qui jouerait le rôle principal ; Varron, qui n'avait pas son expérience, soutenait l'opinion inverse; les deux généraux étaient donc en désaccord et en discussion, ce qui est la chose du monde la plus pernicieuse. Le lendemain, c'était au tour de Varron de prendre le commandement, car c'est l'usage que chaque consul commande un jour sur deux ; il leva le camp et donna l'ordre d'approcher de l'ennemi, quoi que Paul-Émile pût lui objecter pour l'en détourner. Hannibal marcha à sa rencontre avec son infanterie légère et sa cavalerie, attaqua brusquement les Romains encore en marche et répandit ainsi le désordre dans leurs rangs. Le consul lui opposa un corps de troupes pesamment armées, qui soutint le premier choc, puis il fit charger les tirailleurs et la cavalerie. L'avantage resta aux Romains, parce que les Carthaginois n'avaient aucun soutien sérieux sur lequel ils pussent s'appuyer, tandis que chez les Romains plusieurs compagnies de légionnaires étaient mêlées aux troupes volantes et combattaient avec elles. La nuit mit fin à ce combat, qui n'avait pas réussi au gré des Carthaginois. Le jour suivant, Paul-Émile, qui n'était pas d'avis de livrer bataille, mais qui ne pouvait battre en retraite sans danger, s'établit avec les deux tiers de son armée sur les bords de l'Aufide, le seul cours d'eau qui traverse l'Apennin. On nomme ainsi une chaîne de montagnes qui va d'un bout à l'autre de l'Italie et sert de ligne de partage des eaux entre les versants de la mer Tyrrhénienne et de l'Adriatique ; or l'Aufide passe à travers cette chaîne, si bien qu'il prend sa source dans le bassin de la mer Tyrrhénienne et se jette dans l'Adriatique. Quant au dernier tiers de l'armée, le consul lui donna l'ordre de passer la rivière, puis de remonter vers l'est pour se retrancher à environ dix stades de son propre camp et un peu plus loin de celui des ennemis ; cette manoeuvre avait pour but de protéger les fourrageurs qui partiraient de ce second campement et en même temps de menacer ceux des Carthaginois.
[3111] Quand Hannibal vit que les événements rendaient la bataille inévitable, il craignit que ses troupes ne fussent découragées par leur récent échec et jugea nécessaire de leur adresser quelques paroles réconfortantes. Il les rassembla donc, les invita à porter leurs regards sur tout le pays environnant et leur demanda quel champ de bataille plus avantageux ils pourraient souhaiter, si les dieux leur donnaient le choix, avec la supériorité écrasante de leur cavalerie sur celle de l'ennemi. Tous les soldats l'approuvèrent, tant la chose était évidente. « Eh bien ! reprit-il, commencez donc par rendre grâces aux dieux, car ce sont eux qui ont conduit ici nos adversaires pour vous aider à remporter la victoire ; mais sachez-moi gré, à moi aussi, d'avoir mis l'ennemi dans l'obligation d'engager la lutte — car il ne peut plus l'éviter maintenant — dans des conditions qui nous sont si manifestement favorables. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de vous encourager plus longuement à vous montrer braves et résolus en face du danger ; c'était bon lorsque vous ne vous étiez pas encore mesurés avec les Romains ; alors, je vous ai cité beaucoup de faits qui devaient vous inspirer confiance. Mais aujourd'hui que vous avez trois fois de suite remporté sur eux des victoires éclatantes, quel discours serait plus encourageant que les événements eux-mêmes ? Les combats précédents vous ont rendus maîtres de la campagne et de toutes les ressources qu'elle produit ; je vous l'avais promis, et ce que je vous avais annoncé s'est réalisé de point en point ; maintenant, l'objet de la lutte, ce sont les villes et les richesses qu'elles contiennent. Si vous êtes vainqueurs, c'est toute l'Italie qui tombe par là même en votre pouvoir ; cet unique combat mettra fin aux peines que vous endurez, vous livrera tous les trésors de Rome, soumettra le monde entier à votre domination. Ce n'est donc plus le moment de parler, mais d'agir ; avec l'aide des dieux, j'en ai la conviction, vous n'attendrez pas longtemps l'effet de mes promesses. » Ces paroles et d'autres qu'il prononça dans le même sens furent acclamées par tous les assistants ; l'orateur les félicita vivement de leur ardeur et les congédia. Puis aussitôt, il alla s'établir et se retrancher sur la rive du fleuve où se trouvait le plus grand des deux camps romains.
[3112] Le lendemain, Hannibal ordonna à ses troupes de faire leurs préparatifs et de prendre du repos. Le jour suivant, il leur fit prendre leurs positions de combat au bord de l'eau. Il était visible qu'il était prêt à soutenir une attaque ; mais Paul-Émile trouvait le terrain défavorable et voyait, d'autre part, que les Carthaginois seraient bientôt obligés de lever le camp pour se ravitailler ; il ne bougea donc pas et se contenta de renforcer la garde de ses deux camps. Hannibal attendit un certain temps, puis, comme l'ennemi ne se présentait pas, il ramena son armée derrière ses retranchements, à l'exception des Numides, qu'il détacha contre les Romains qui sortaient du petit camp pour aller chercher de l'eau. Les Numides s'avancèrent jusqu'aux limites mêmes du camp et empêchèrent leurs adversaires de descendre à la rivière. Cet incident mit le comble à la fureur de Varron ; quant aux soldats, ils ne demandaient plus qu'à se battre et supportaient avec impatience tous ces atermoiements. Car l'attente est pour chacun de nous ce qu'il y a de plus pénible ; une fois que le sort en est jeté, il n'y a plus à hésiter : on affronte n'importe quel danger, si grave qu'il paraisse. Quand on sut à Rome que les deux armées étaient face à face et que des engagements d'avant-garde se produisaient tous les jours, toute la ville fut comme en suspens et pleine d'anxiété; on se souvenait dans le peuple des nombreuses défaites qu'on avait essuyées et on tremblait pour l'avenir ; on prévoyait, on imaginait d'avance tous les malheurs qu'entraînerait une défaite. On n'avait partout à la bouche que toutes les prophéties relatives à Rome ; toutes les maisons, tous les sanctuaires étaient pleins d'apparitions et de prodiges; aussi n'étaient-ce en ville que sacrifices, supplications et voeux adressés aux dieux. Car les Romains connaissent toutes sortes de rites pour apaiser les dieux et les hommes dans les circonstances critiques ; et aucune des pratiques auxquelles on a recours en pareil cas ne leur semble alors malséante ou indigne.
[3113] Le lendemain, dès que Varron eut pris le commandement, au lever même du soleil, il fit sortir ses troupes des deux camps à la fois ; celles du plus grand passaient l'Aufide et prenaient aussitôt leurs positions de combat ; celles du plus petit venaient les rejoindre et se rangeaient à leur suite sur la même ligne; tout le front de l'armée était tourné vers le Midi. La cavalerie romaine était placée à l'aile droite, sur le bord même de la rivière, et les fantassins à sa suite, toujours sur la même ligne ; les compagnies étaient en ordre plus serré qu'à l'ordinaire et offraient bien plus de profondeur que de largeur. La cavalerie auxiliaire formait l'aile gauche ; l'infanterie légère se tenait à quelque distance en avant de l'armée, sur tout le front. L'armée romaine comprenait en tout, en comptant les auxiliaires, à peu près quatre-vingt mille fantassins et un peu plus de six mille cavaliers. En même temps, Hannibal faisait passer le fleuve aux Baléares et aux lanciers, qu'il plaça en tête ; puis le reste des troupes sortit du camp, fit la traversée en deux endroits et vint prendre position en face de l'ennemi. Le général posta à l'aile gauche, sur la rive même, les cavaliers espagnols et gaulois pour les opposer à la cavalerie romaine ; à côté d'eux, il rangea la moitié de ses fantassins africains pesamment armés ; puis venaient, successivement, l'infanterie espagnole et gauloise, le reste des Africains, enfin à l'aile droite la cavalerie numide. Après avoir ainsi disposé toute son armée sur une seule ligne, il prit la tête des bataillons espagnols et gaulois qui occupaient le centre, et les fit avancer en maintenant le contact entre eux et les troupes qui les flanquaient, de sorte que la ligne de bataille présentait la convexité d'un croissant et perdait progressivement de sa profondeur. L'intention d'Hannibal était de constituer avec ses Africains un corps de soutien pour les Espagnols et les Gaulois qui engageraient l'action.
[3114] Tous les Africains étaient armés à la romaine, car Hannibal leur avait fait revêtir les dépouilles des ennemis tués dans la précédente bataille. Les Espagnols et les Gaulois portaient le même bouclier, mais leurs épées étaient très différentes : celle des Espagnols pouvait frapper d'estoc aussi bien que de taille, tandis que le sabre des Gaulois ne pouvait donner que des coups de taille ; et encore un certain recul était-il nécessaire. Les troupes de ces deux peuples étaient rangées par cohortes alternées ; les Gaulois étaient nus et les Espagnols vêtus, selon leur coutume nationale, de tuniques de lin bordées de pourpre, qui leur donnaient un aspect extraordinaire et effrayant. Les Carthaginois avaient en tout dix mille cavaliers et un peu plus de quarante mille fantassins, en comptant les Gaulois. Du côté des Romains, l'aile droite était commandée par Paul-Émile, la gauche par Varron, le centre par Servilius et Atilius, les consuls de l'année précédente. Chez les Carthaginois, l'aile gauche était commandée par Hasdrubal, la droite par Hannon ; Hannibal se tenait au centre et avait avec lui son frère Magon. Le front de l'armée romaine était, comme je l'ai dit plus haut, tourné vers le Midi et celui de l'armée punique vers le Nord ; de sorte que, quand le soleil se leva, ni l'une ni l'autre ne souffrit de ses rayons.
[3115] La bataille commença par une escarmouche entre les soldats armés à la légère qui, de part et d'autre, avaient été placés en tête ; cette première passe ne donna aucun résultat. Mais quand la cavalerie espagnole et gauloise de l'aile gauche eut pris contact avec l'ennemi, le combat devint plus sérieux ; au lieu de se replier pour revenir ensuite à la charge, suivant leur tactique ordinaire, les Romains se battaient comme de vrais barbares : à peine entrés dans la mêlée, ils sautaient à bas de leurs chevaux et engageaient une lutte corps à corps. Les Carthaginois finirent cependant par l'emporter ; la plupart des Romains restèrent sur le terrain, malgré l'énergie et le courage avec lesquels ils se défendaient tous ; les survivants de ce carnage furent poursuivis le long du fleuve et massacrés à leur tour sans pitié ; c'est alors que la grosse infanterie, prenant la place des troupes légères, entra en jeu. Pendant quelque temps, les Espagnols et les Gaulois tinrent bon et résistèrent vigoureusement aux Romains; mais ils finirent par être accablés sous le poids de l'ennemi, leur front en croissant fut enfoncé, ils lâchèrent pied et battirent en retraite. Les bataillons romains les poursuivirent avec impétuosité et rompirent sans peine les lignes gauloises, qui avaient assez peu de profondeur ; ils étaient d'ailleurs renforcés eux-mêmes par des détachements qui venaient des ailes pour appuyer le centre, où était le fort du combat. C'était en effet par là que l'action avait commencé, tandis que les ailes ne donnaient pas encore ; cela tenait à la disposition des Gaulois en demi-lune : présentant à l'ennemi la convexité du croissant, ils laissaient les ailes loin derrière eux. Les Romains, disais-je, les poursuivirent et s'enfoncèrent ainsi profondément dans les rangs ennemis, à l'endroit où ils cédaient devant eux ; les Africains pesamment armés surgirent alors des deux côtés sur leur flanc, ceux de l'aile droite en opérant une conversion à gauche et en se reformant ensuite face à droite, ceux de l'aile gauche en effectuant le même mouvement par le flanc droit et en se reformant face à gauche. Le résultat de cette manoeuvre — que les circonstances même imposaient — fut bien celui qu'Hannibal avait prévu ; en s'acharnant après les Gaulois, les Romains s'étaient laissé envelopper par les Africains. Les légions ne pouvaient donc plus conserver leur ordre de bataille, mais il fallait se défendre individuellement ou par petits groupes contre les attaques de flanc.
[3116] Paul-Émile, qui au commencement se trouvait à l'aile droite et avait pris part au combat de cavalerie, n'avait pourtant pas été tué. Voulant tenir la promesse qu'il avait faite solennellement à ses troupes, d'être sans cesse au plus fort de l'action, et voyant que c'était par l'infanterie légionnaire que le sort de la bataille allait se décider, il pousse son cheval au milieu de la mêlée, frappe les ennemis qu'il rencontre sur son passage, encourage et excite ses propres soldats. Hannibal, qui dès le début avait pris le commandement de cette partie de l'armée, faisait de même de son côté. Les Numides de l'aile droite, opposés à la cavalerie romaine de l'aile gauche, n'eurent ni à agir ni à souffrir beaucoup, en raison de leur manière de combattre ; néanmoins, en fondant de tous côtés sur leurs adversaires, ils les tinrent occupés et les mirent dans l'impossibilité d'intervenir. Mais quand Hasdrubal, après avoir massacré à l'aile gauche presque tous les cavaliers romains rangés le long du fleuve, vint renforcer les Numides, la cavalerie auxiliaire lâcha pied et s'enfuit sans attendre leur approche. En cette occurrence, Hasdrubal donna une grande preuve d'intelligence et d'habileté : comme les Numides étaient en nombre et qu'ils sont surtout à craindre pour des ennemis qui ont commencé à plier, parce que c'est alors que leur tactique est le plus efficace, il leur confia la mission de poursuivre les fuyards, tandis qu'il se portait avec ses propres troupes au secours de l'infanterie africaine. Il tomba par derrière sur les légions romaines, les fit charger successivement sur plusieurs points par ses divers bataillons et ranima ainsi l'ardeur des Africains, tandis que les Romains, saisis d'épouvante, se décourageaient. C'est à ce moment que Paul-Émile succomba, les armes à la main, aux blessures terribles qu'il avait reçues : ce grand homme, pendant toute sa vie comme dans cette dernière circonstance, avait plus que tout autre rempli fidèlement ses devoirs envers sa patrie. Tant que les Romains réussirent à faire face aux ennemis qui les encerclaient de toutes parts, ils leur opposèrent une résistance énergique ; mais à mesure que tombaient ceux qui se trouvaient à la périphérie, le cercle se rétrécissait de plus en plus, et tous, enfin, restèrent sur la place. Là périrent, entre autres, Atilius et Servilius, les consuls de l'année précédente, deux braves, qui avaient donné dans cette affaire un exemple digne de Rome. Pendant qu'avaient lieu cette mêlée et ce carnage, les cavaliers en déroute étaient poursuivis par les Numides : la plupart d'entre eux furent tués, d'autres jetés à bas de leurs chevaux ; quelques-uns se réfugièrent à Venouse ; parmi eux se trouvait le consul Térentius Varron, qui couronna par cette fuite honteuse son commandement si funeste à sa patrie.
[3117] Ainsi finit la bataille que se livrèrent à Cannes les Romains et les Carthaginois ; vainqueurs et vaincus y montrèrent le même courage, comme les faits eux-mêmes suffisent à le prouver. Sur les six mille cavaliers romains, soixante-dix s'enfuirent à Venouse avec Varron, et environ trois cents auxiliaires dispersés trouvèrent un refuge dans différentes villes; dix mille fantassins en armes furent bien faits prisonniers, mais ils n'avaient pas pris part à l'action ; du champ de bataille, trois milliers seulement purent se sauver dans les places voisines ; tous les autres, au nombre de soixante-dix mille, y trouvèrent une noble fin. Dans cette rencontre comme dans les précédentes, ce fut surtout à la supériorité numérique de leur cavalerie que les Carthaginois durent la victoire. C'est une leçon frappante qu'ils ont donnée là à la postérité : il vaut mieux, en temps de guerre, avoir moitié moins d'infanterie et une cavalerie très supérieure à celle de l'ennemi que de l'affronter avec des forces en tout point égales aux siennes. Quant à Hannibal, il avait perdu environ quatre mille Gaulois, quinze cents Espagnols ou Africains et deux cents cavaliers. Voici pourquoi les Romains qui furent pris vivants n'avaient pas participé au combat. Paul-Émile avait laissé dans son camp ces dix mille fantassins avec mission de fondre, au milieu de de la bataille, sur celui des ennemis : si Hannibal négligeait de le faire garder et menait toutes ses troupes au combat, on s'emparerait de ses bagages ; s'il prévoyait cette manoeuvre et laissait une forte garde, on aurait d'autant moins d'adversaires à combattre. Voici comment ils furent faits prisonniers. Hannibal avait laissé dans ses retranchements une garde assez importante ; dès le début du combat, les Romains, suivant l'ordre qu'ils avaient reçu, vinrent l'attaquer. Les Carthaginois assiégés dans leur camp leur opposèrent d'abord une vive résistance ; ils commençaient cependant à faiblir, quand Hannibal, resté maître de tout le champ de bataille, accourut à leur secours, refoula les Romains et les cerna dans leur propre camp. Il en tua deux mille et prit tous les autres vivants. Le même sort était réservé aux cavaliers qui s'étaient réfugiés, au nombre d'environ deux mille, dans les forteresses répandues par tout le pays : les Numides emportèrent d'assaut leurs refuges et les emmenèrent en captivité.
[3118] La bataille s'étant terminée comme nous l'avons vu, les conséquences en furent celles qu'on attendait d'un côté comme de l'autre. Grâce à leur succès, les Carthaginois se trouvèrent aussitôt les maîtres de presque toute la côte : les Tarentins se rendirent immédiatement, les habitants d'Argyrippe et quelques peuples de la Campanie appelèrent Hannibal ; tous les autres commençaient à pencher pour Carthage ; les vainqueurs avaient le ferme espoir de s'emparer de Rome sans coup férir. Les Romains avaient compris tout de suite que leur défaite leur enlevait l'empire de l'Italie ; mais ils se sentaient menacés par un danger plus grave encore : c'était pour leur propre vie, pour le sol même de leur patrie qu'ils tremblaient, car ils s'attendaient à voir Hannibal arriver d'un moment à l'autre. La fortune sembla même vouloir mettre le comble à leur malheur : quelques jours après le désastre, au milieu de l'angoisse qui étreignait toute la ville, on apprit que le préteur envoyé en Cisalpine était tombé à son tour dans une embuscade et que son armée tout entière avait été massacrée par les Gaulois. Malgré cela, le Sénat ne laissa pas de faire tout ce qui était en son pouvoir : il releva le courage du peuple, pourvut à la sûreté de la ville, prit d'énergiques résolutions pour parer à la situation. La suite des événements le fit bien voir : Rome avait beau avoir subi une défaite incontestable et être déchue de sa gloire militaire, sa forme de gouvernement et la sagesse de ses décisions lui permirent non seulement de prendre sa revanche sur Carthage et de recouvrer l'empire de l'Italie, mais d'étendre au bout de très peu de temps sa domination sur tout l'univers. C'est là-dessus que je vais clore ce livre, où j'ai rapporté les faits qui se sont passés en Espagne et en Italie pendant la cent-quarantième olympiade ; quand j'aurai raconté l'histoire de la Grèce pendant la même olympiade et que j'en serai arrivé à notre époque, je consacrerai, comme j'en ai dès maintenant l'intention, un développement spécial à l'étude de la constitution romaine. Je crois d'abord que cet exposé est bien à sa place dans un traité d'histoire, mais surtout qu'il sera des plus utiles aux hommes de science et aux hommes d'État qui voudraient réformer, les institutions de leur pays ou en créer de nouvelles.