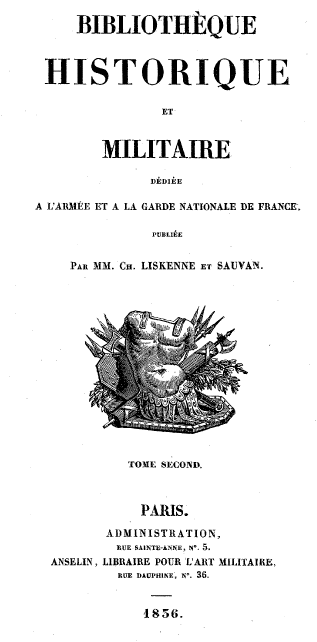
POLYBE
HISTOIRE GÉNÉRALE
LIVRE VII.
Autre traduction française : Félix BOUCHOT.
POLYBE
Histoire générale
FRAGMENTS DU LIVRE HUITIÈME.
I
En quels cas il est pardonnable ou non de se fier à certaines personnes. - Archidamus, roi de Lacédémone, Pélopidas de Thèbes, Cnéius Cornélius, sont blâmables de l'avoir fait. - Achéus fut aussi surpris, mais on ne peut lui en faire un crime.
Ce serait une chose trop hasardeuse, que de décider en général si l'on doit blâmer ceux qui se sont fiés à certaines personnes, ou si l'on doit leur pardonner de l'avoir fait : la raison en est, qu'il arrive souvent qu'après avoir pris toutes les précautions raisonnables, on ne laisse pas d'être trompé; car il y a des hommes contre la mauvaise foi desquels toutes les lois du monde ne mettraient pas à couvert. Cela ne doit ce-pendant pas nous empêcher d'assurer qu'il est des temps et des circonstances où l'on doit blâmer les chefs qui se fient à certains hommes, et d'autres où la justice demande qu'on leur pardonne. Éclaircissons ce fait par des exemples.
Archidamus, roi des Lacédémoniens, s'était retiré de Sparte, parce que l'ambition de Cléomène lui était suspecte; mais peu de temps après, s'étant laissé persuader, il revint et se remit entre les mains de son rival. Il en fut puni par la perte de sa dignité et de la vie, sans qu'aucune raison puisse justifier sa crédulité aux yeux des siècle futurs; car, les choses étant au même état qu'elles étaient quand il se retira, et l'ambition de Cléomène n'ayant fait que s'accroître, était-il probable qu'il pût éviter de périr en se fiant à des gens à la fureur desquels il n'était échappé que par une espèce de miracle?
Pélopidas de Thèbes, connaissant la scélératesse du tyran Alexandre, et persuadé de cette maxime , que tout tyran regarde comme ses plus grands ennemis ceux qui prennent la défense de la liberté publique, engagea Épaminondas à prendre les armes pour défendre non seulement la république de Thèbes, mais encore toutes les autres de la Grèce. Malgré cela, et quoiqu'il fût venu en Thessalie pour abattre et détruire la tyrannie d'Alexandre, ayant eu la faiblesse d'accepter deux fois les fonctions d'ambassadeur auprès de ce tyran, il tomba en sa puissance, nuisit par là beaucoup aux intérêts des Thébains, et, pour s'être fié témérairement à ceux-là même dont il devait le plus se défier, il détruisit d'un coup toute la gloire qu'il s'était précédemment acquise par ses belles actions. Le consul Cnéius Cornelius fit la même faute pendant la guerre de Sicile. On pourrait citer quantité d'exemples semblables, qui font voir combien sont blâmables ceux qui, sans discernement, s'abandonnent à la bonne foi de leurs ennemis.
On ne doit pas en user de même à l'égard de ceux qui prennent toutes les précautions qu'il est raisonnablement permis de prendre; car, ne s'en fier absolument à personne, c'est ne vouloir jamais terminer les affaires. On n'est donc pas coupable lorsqu'on se risque après s'être assuré tous les gages de sûreté que comporte la circonstance. Or, les meilleures assurances contre la mauvaise foi sont les sermons, les enfants, les femmes prises en otage, mais surtout les antécédents de ceux avec qui l'on traite. Quand, malgré tout cela, on tombe dans quelque piège, ce n'est plus ceux qui sont trompés, mais ceux qui trompent, que l'on doit blâmer. Aussi la chose la plus importante est d'enchaîner la bonne foi de celui avec qui l'on traite par des liens qu'il ne puisse pas rompre; mais comme il est rare d'en trouver de cette nature, la dernière ressource est de chercher de telles sûreté si nous sommes surpris, au moins on ne pourra pas nous en imputer la faute Nous avons quantité d'exemples de cette sage conduite dans l'antiquité mais il y en a un illustre dans les temps dont nous faisons l'histoire, c'est celui d'Achéus, qui, ayant pris, pour se mettre parfaitement à l'abri de la perfidie , toutes les sûretés qu'il. est possible à un homme de prendre, tomba cependant au pouvoir des ennemis mais loin qu'on lui en fit un crime, on eut compassion de son malheur, au lies qu'on n'a eu que de la haine et de l'horreur pour ceux qui l'avaient trompé. (DOM THUILLIER.)
II.
Grandes actions des Romains et des Carthaginois, constance opiniâtre de ces deux peuples dans leurs entreprises.- Utilité d'une histoire générale.
Je ne crois m'éloigner ni de mon sujet, ni du but que je me suis proposé au commencement de cet ouvrage, et arrêtant ici mes lecteurs pour leur faire considérer la grandeur des actions de deux républiques de Rome et de Carthage, et la constance opiniâtre avec la quelle elles poursuivaient leurs entreprises ; car n'est-il pas surprenant que toutes deux, ayant deux guerres importantes à soutenir, l'une en Italie, l'autre en Espagne; que, ne pouvant fonder toutes deux que des espérances fort incertaines sur l'avenir; que, courant toutes deux le même risque, elles ne se soient pas bornées à ces deux luttes, mais se soient encore disputé la Sardaigne et la Sicile, et que non seule ment elles aient embrassé et fait réussir en espérance tant d'entreprises, mais encore aient fourni des vivres et des munitions pour les mettre à exécution? On sera plus frappé encore, si l'on examine les choses en détail. Les Romains avaient en Italie deux armées complètes, commandées chacune par un consul; ils en avaient encore deux en Espagne : une sur terre, que commandait Cnéius Cornelius, l'autre sur mer, qui avait pour général Publ. Scipion. Il en était de même des Carthaginois. Les Romains avaient, en outre, une flotte à l'ancre sur les côtes de la Grèce, pour suivre Philippe et observer ses desseins; flotte qui fut commandée successivement par Marcus Valerius et Publius Sulpicius. Appius, commandait de plus cent galères, à cinq rangs de rames, et Marcus Claudius, avec une armée de terre, menaçait la Sicile; et Hamilcar faisait la même chose du côté des Carthaginois.
Après tous ces faits, je ne pense pas que l'on puisse douter de la vérité de ce que j'ai avancé au commencement de cet ouvrage : qu'il n'est pas possible, par la lecture des histoires particulières, de voir l'ordre et l'économie qui règnent dans l'enchaînement des faits; car comment, en ne lisant que les histoires de Sicile et d'Espagne, connaîtra-t-on quels moyens la fortune a employés, ou de quelle sorte de gouvernement elle s'est servie pour faire de nos jours ce qui ne s'était jamais fait et ce qui peut passer pour un prodige, pour soumettre enfin à un seul empire et à une seule puissance toutes les parties connues de l'univers? On peut bien apprendre par des histoires particulières comment les Romains ont pris Syracuse, comment ils ont soumis l'Espagne à leur domination; mais, sans une histoire générale, il est difficile de comprendre comment ils ont soumis tonte la terre, quels obstacles particuliers ils ont rencontrés dans le vaste dessein de conquérir le monde entier, et quels sont les événements et les circonstances qui ont secondé leurs efforts. On ne peut donc non plus, sans cette histoire générale, bien concevoir la grandeur des actions, ni les forces d'un gouvernement; car, que les Romains se soient mis en marche pour subjuguer l'Espagne ou la Sicile, qu'ils aient fait la guerre sur terre et sur mer, ces entreprises, à ne les regarder qu'en elles-mêmes, ne sont pas fort extraordinaires ; mais quand on considère que toutes ces entreprises et beaucoup d'autres s'exécutaient en même temps par la même puissance et le même gouvernement, et qu'on joint à cela les malheurs et les guerres dont l'Italie même était en même temps accablée, c'est alors que les faits se développent à l'esprit, et que l'on y voit tout ce qui mérite notre admiration. C'est ainsi qu'on les connaît comme ils doivent être connus. Cela soit dit contre ceux qui s'imaginent que la lecture des histoires particulières suffit pour nous donner la connaissance d'une histoire générale et universelle. (DOM THUILLIER.)
III.
Siège de Syracuse.
Les Romains, assiégeant Syracuse, pressaient les travaux avec soin; c'était Appius qui les dirigeait. À partir de cette partie de la ville que l'on appelle le portique Scythique, et où le parapet du rempart s'avance au-dessus de la mer même, il le fit entourer d'une circonvallation par son infanterie. Ayant mis eu oeuvre les béliers, les traits, et toutes les autres machines de guerre à l'usage des assiégeants, il espérait, à cause de la multitude de ses travailleurs, parvenir en cinq jours à prendre l'ennemi tout à fait au dépourvu : c'est qu'il ne songeait pas, en effet, à l'énergie et à l'adresse d'Archimède, et qu'il ne réfléchissait pas que souvent le génie d'un seul homme est plus puissant que les bras les plus innombrables. Mais c'est ce que les Romains apprirent à leurs dépens; car la ville étant d'ailleurs très-forte, puisque ses remparts étaient bâtis sur des lieux très élevés et s'avançant en saillie, au point d'être inaccessibles, même lorsqu'ils n'étaient pas défendus, Archimède, de plus, avait rassemblé dans les murs de Syracuse une telle quantité de moyens de défense, tant contre les attaques par terre que contre les attaques par mer, que les assiégés non seulement n'avaient pas besoin de beaucoup de temps pour se préparer à soutenir le siège, mais pouvaient encore faire promptement face à toutes les tentatives des Romains. Appius, ayant donc tout préparé pour le siège, se disposait à appliquer les béliers et les échelles aux murailles, du côté d'Hexapyle, à l'orient. (Ex Suida).
SCHEIGHAEUSER.
Marcus Marcellus attaque, avec une armée navale l'Achradine de Syracuse.- Description de la sambuque. - Inventions d'Archimède pour empêcher l'effet des machines de Marcellus et d'Appius.
Lorsque Marcus Marcellus attaqua l'Achradine de Syracuse, sa flotte était composée de soixante galères à cinq rangs de rames, qui étaient remplies d'hommes armés d'arcs, de frondes et de javelots pour balayer les murailles. Il avait encore huit galères à cinq rangs de rames, d'un côté desquelles on avait ôté les bancs, aux unes à droite, aux autres à gauche, et que l'on avait jointes ensemble deux à deux par les côtés où il n'y avait pas de bancs. C'étaient ces galères qui, poussées par les rameurs du côté opposé à la ville, approchaient des murailles les machines appelées sambuques, et dont il faut expliquer la construction. C'est une échelle de la largeur de quatre pieds, qui, étant dressée, est aussi haute que les murailles. Les deux côtés de celte échelle sont garnis de balustrades et de courroies de cuir qui règnent jusqu'à son sommet. On la couche en long sur les côtés des deux galères jointes ensemble, de sorte qu'elle passe de beaucoup les éperons; et au haut des mâts de ces galères on attache des poulies et des cordes. Quand on doit se servir de cette machine, on attache des cordes à l'extrémité de la sambuque, et des hommes l'élèvent de dessus la poupe par le moyen des poulies; d'autres, sur la proue, aident aussi à l'élever avec des leviers. Ensuite, lorsque les galères ont été poussées à terre par les rameurs, des deux côtés extérieurs, on applique ces machines à la muraille. Au haut de l'échelle, est un petit plancher bordé de claies de trois côtés, sur lequel quatre hommes repoussent en combattant ceux qui des murailles empêchent qu'on n'applique la sambuque. Quand elle est appliquée, et qu'ils sont arrivés sur la muraille, ils jettent bas les claies, et, à droite et à gauche, ils se répandent dans les créneaux des murs ou dans les tours. Le reste des troupes les suivent sans crainte que la machine leur manque, parce qu'elle est fortement attachée avec des cordes aux cieux galères. Or, ce n'est pas sans raison que cette machine a été appelée sambuque; on lui a donné ce nom, parce que, l'échelle étant dressée, elle forme avec le vaisseau un ensemble qui a l'air d'une sambuque.
Tout étant préparé , les Romains se disposaient à attaquer les tours; mais Archimède avait aussi de son côté construit des machines propres à lancer des traits à quelque distance que ce fût. Les ennemis étaient encore loin de la ville, qu'avec des balistes et des catapultes plus grandes et plus fortement bandées, il les perçait de tant de traits qu'ils ne savaient comment les éviter. Quand les traits passaient au-delà, il en avait de plus petites proportionnées à la distance, ce qui jetait une si grande confusion parmi les Romains, qu'ils ne pouvaient rien entreprendre; de sorte que Marcellus, ne sachant quel parti prendre, fut obligé de faire avancer sans bruit ses galères pendant la nuit. Mais quand elles furent vers la terre à la portée du trait, Archimède inventa un autre stratagème contre ceux qui combattaient de dessus leurs vaisseaux. Il fit percer à hauteur d'homme et dans la muraille des trous nombreux et de la largeur de la main. Derrière ces meurtrières il avait posté des archers et des arbalétriers qui, tirant sans cesse sur la flotte, rendaient inutiles tous les efforts des soldats romains. De cette manière, soit que les ennemis fussent éloignés ou qu'ils fussent près, non seulement il empêchait tous leurs projets de réussir, mais encore il en tuait un grand nombre. Et quand on commençait à dresser des sambuques, des machines disposées au dedans des murailles, et que l'on n'apercevait pas la plupart du temps, s'élevaient alors sur les forts et étendaient leurs becs bien loin en dehors des remparts : les unes portaient des pierres qui ne pesaient pas moins de six cents livres, les autres des masses de plomb d'une égale pesanteur. Quand les sambuques s'approchaient, alors on tournait avec un câble les becs de ces machines où il était nécessaire, et, par le moyen d'une poulie que l'on lâchait, on faisait tomber sur la sambuque une pierre, qui ne brisait pas seulement cette machine, mais encore le vaisseau, et jetait ceux qui s'y trouvaient dans un extrême péril.
Il y avait encore d'autres machines qui lançaient sur les ennemis qui s'avançaient, couverts par des claies, afin de se garantir contre les traits lancés des murailles, des pierres d'une grosseur suffisante pour faire quitter la proue des navires à ceux qui y combattaient.
Outre cela, il faisait tomber une main de fer attachée à une chaîne, avec laquelle celui qui dirigeait le bec de la machine comme le gouvernail d'un navire, ayant saisi la proue d'un vaisseau, abaissait l'autre bout du côté de la ville : quand, soulevant la proue dans les airs, il avait dressé le vaisseau sur la poupe , alors liant le bras du levier pour le rendre immobile, il lâchait la chaîne par le moyen d'un moulinet ou d'une poulie. Il arrivait nécessairement alors que les vaisseaux ou bien tombaient sur le côté, ou bien étaient entièrement culbutés; et, la plupart du temps, la proue retombant de très haut dans la mer, ils étaient submergés, au grand effroi de ceux qu'ils portaient. Marcellus était dans un très grand embarras : tous ses projets étaient renversés par les inventions d'Archimède; il faisait des pertes considérables. Les assiégés se riaient de tous ses efforts. Cependant il ne laissait pas que de plaisanter sur les inventions du géomètre.
« Cet homme, disait-il, se sert de nos vaisseaux comme de cruches pour puiser de l'eau; et il chasse ignominieusement nos sambuques à coups de bâton, comme indignes de sa compagnie. » Tel fut le succès du siège par mer.
Appius, ayant souffert les mêmes difficultés, s'était aussi désisté de son entreprise. Quoique son armée fût encore loin de la ville, elle était accablée des pierres et des traits que lançaient les balistes et les catapultes : tant était prodigieuse la quantité de traits qui en partaient, et la force avec laquelle ils étaient lancés! C'étaient des machines dignes du prince qui en faisait les frais, et d'Archimède, qui les construisait et les faisait agir. Et lorsque les ennemie s'approchaient de la ville, repoussés par les traits qui leur étaient lancés à travers les meurtrières dont nous avons parlé, ils faisaient des efforts superflus. Si, couverts de leurs boucliers, ils tentaient de monter à l'assaut, ils étaient écrasés par les pierres et les poutres qu'on leur faisait tomber sur la tête, sans parler des pertes que leur causaient ces mains de fer dont nous avons fait mention plus haut, et qui, enlevant les hommes avec leurs armes, les brisaient en les laissant retomber contre terre.
Ce consul s'étant retiré dans son camp avec Marcellus, et ayant assemblé son conseil, on y résolut de tenter toutes sortes de moyens pour surprendre Syracuse, à l'exception d'un siège en forme, et cette résolution fut exécutée; car pendant huit mois qu'ils restèrent devant la ville, il n'y eut sorte de stratagème que l'on n'inventât, ni d'actions de valeur que l'on ne fît, à l'assaut près, que l'on n'osa jamais tenter : tant un seul homme a de force lorsqu'il sait employer son génie à la réussite d'une entreprise! Ôtez de Syracuse un seul vieillard, et les Romains, avec de si grandes forces sur terre et sur mer, s'en rendront immanquablement maîtres. Mais sa seule présence fait que l'on n'ose pas même l'attaquer, au moins de la manière qu'Archimède pouvait empêcher. L'unique ressource que les Romains crurent qu'il leur restait, fut de réduire par la faim le peuple nombreux qui était dans la ville. Pour cela, avec l'armée navale, on intercepta tous les vivres qui pouvaient leur venir par mer, et l'autre armée coupa tous les convois qui leur venaient par terre. Et pour ne point perdre entièrement le temps qu'ils devaient rester devant Syracuse, mais l'employer ailleurs à quelque chose d'avantageux , les consuls partagèrent leur armées. Appius, avec les deux tiers, continua le siège de la ville; et Marcellus, avec l'autre tiers, alla porter le ravage dans les terres de ceux des Carthaginois qui avaient embrassé la cause des Siciliens. (Dom THUILLIER.)
IV.
Affaires de Philippe. - Théopompe.
Philippe, arrivé dans la Messénie, saccagea tout le pays, et y fit de cruels ravages ; la colère le transportait et ne lui permettait pas de réfléchir sur cette violence. Se peut-il qu'il espérât que les peuples infortunés qu'il frappait sans cesse, recevraient ses coups sans se plaindre et sans le haïr? Au reste, si dans ce livre et dans le précédent, j'ai rapporté naïvement ce que je savais des mauvaises actions de Philippe, ce qui m'y a engagé, c'est, outre les raisons que j'ai déjà dites, le silence que gardent quelques historiens sur les affaires des Messéniens, et la faiblesse des autres, qui, par inclination pour ce prince, ou par crainte de lui déplaire , non seulement ne blâment pas ses méfaits, mais lui en font un mérite. Ce défaut se remarque dans les historiens des autres princes comme dans ceux sur roi de Macédoine. Aussi sont-ils bien moins historiens que panégyristes.
Dans l'histoire d'un monarque, on ne doit jamais ni blâmer ni louer contre la vérité. Il faut faire attention à ne pas démentir dans un endroit ce qu'on a dit dans un autre, et prendre garde surtout que ses inclinations y soient peintes au naturel. Il est vrai que ce conseil, qu'il est aisé de donner, est très difficile à mettre en pratique; car dans combien de circonstances ne se trouve-t-on pas, où il n'est pas possible de dire ou d'écrire tout ce que l'on pense? Je pardonne donc à quelques-uns de n'avoir pas suivi , en écrivant, les règles que le bon sens prescrit, et que je viens d'exposer; mais on ne peut pardonner à Théopompe de les avoir violées si grossièrement.
À l'entendre, il n'a entrepris l'histoire de Philippe, fils d'Amynthas, que parce que l'Europe n'a jamais produit d'homme comparable à ce prince. Cependant, dès la première page et dans la suite de son ouvrage, il nous le représente comme un homme passionné à l'excès pour les femmes, et qui, par là, s'est exposé à perdre sa propre maison. Il nous le peint injuste et perfide à l'égard de ses amis et de ses alliés, asservissant les villes par ruse et par violence, adonné au vin jusqu'à- paraître ivre en plein jour. Que l'on jette les yeux sur le commencement du neuvième et du quarantième de ses livres, on sera frappé des emportements de cet écrivain. Voici, entre autres choses, ce qu'il a eu la hardiesse de dire; je me sers de ses propres ter-mes : « Si, chez les Grecs ou chez les Barbares, il se trouvait de ces insignes débauchés qui ont perdu toute pudeur, ces hommes-là s'assemblaient en Macédoine autour de Philippe; et c'étaient là ses favoris. L'honneur, la sagesse, la probité n'entraient pas dans son cœur. Pour être bien reçu chez lui, y être considéré et élevé aux plus grandes charges; il fallait être prodigue, ivrogne, joueur; et il n'encourageait pas seulement ses amis dans ses criminelles inclinations, il les piquait encore d'émulation à qui se signalerait davantage dans tout autre désordre. En effet, par quelle sorte de honte et d'infamie leur âme n'était-elle point souillée? quel sentiment de vertu et d'honneur pouvait entrer dans leur cœur? Les uns affectaient une toilette efféminée, les autres se livraient, avec des hommes faits, aux plus sales débauches. On en voyait qui menaient partout avec eux deux ou trois enfants, tristes victimes de leur détestable volupté, et qui se prêtaient à d'autres pour le même usage. À voire cette cour plongée dans la mollesse et dans les plus honteux plaisirs, on pouvait dire que Philippe y avait non des favoris, mais des mignons, et plutôt des femmes prostituées que des soldats ; car, quoique les courtisans dont il était environné fussent naturellement cruels et sanguinaires, leur manière de vivre était telle qu'on ne peut rien s'imaginer de plus mou et de plus dissolu. Pour abréger, car j'ai trop de choses à dire pour m'arrêter longtemps sur chaque sujet, ceux qu'on appelait amis et favoris de Philippe, étaient pires que les Centaures, les Lestrigons, et les animaux les plus féroces. »
Ces exagérations sont-elles supportables? Quel fiel ! quelle langue empoisonnée! Théopompe est coupable ici sur bien des chefs : premièrement, il n'est pas d'accord avec lui-même; en second lieu, rien de plus calomnieux que ce qu'il avance contre Philippe et contre ses amis; enfin, il calomnie en termes indignes d'un écrivain qui a quelque pudeur. Quand il aurait eu à peindre Sardanapale et sa cour, à peine eût-il osé employer les mêmes couleurs; ce Sardanapale, dis-je, ce roi si décrié pour sa vie molle et luxurieuse, et sur le tombeau duquel on lit cette épitaphe « J'emporte avec moi tous les plaisirs que les excès de l'amour et de la table ont pu me donner. » Mais à l'égard de Philippe et de ses amis, il s'en faut qu'on puisse rien leur reprocher de lâche ou de déshonorant; et tout écrivain qui entreprendrait leur éloge, ne pourrait rien dire de leur courage, de leur fermeté et de leurs autres vertus, qui ne fût beaucoup au-dessous de ce qu'ils méritent. C'est par leurs travaux et par leur intrépidité qu'ils ont reculé les bornes du royaume de Macédoine. Sans parler de ce qu'ils ont fait sous Philippe, combien après sa mort n'ont-ils pas signalé leur courage dans les combats où ils se sont trouvés avec Alexandre? Ce prince a eu la principale part dans ces exploits, j'y consens; ce n'est pas à dire pouf cela que ses amis ne lui aient été d'un grand secours. Combien de fois ont-ils défait leurs ennemis? quelles fatigues n'ont-ils pas supportées? à quels dangers ne se sent-ils pas exposés? Quand, dans la suite, possesseurs de grands états, ils ont eu tous les moyens de satisfaire leurs passions, jamais ils ne s'y sont livrés jusqu'à altérer leur santé ou faire quelque chose contre la justice ou contre la bienséance. On leur a toujours vu, soit du temps de Philippe, soit du temps d'Alexandre, la même noblesse de sentiments, la même grandeur d'âme, la même prudence et le même courage. Je ne les nomme pas, leurs noms sont assez connus.
Après la mort d'Alexandre, ils se disputèrent les uns aux autres lés plus grandes parties de l'univers , et ils nous ont transmis eux-mêmes, par un grand nombre de monuments historiques, la gloire qu'ils se sont acquise pendant ces guerres. Timée s'est emporté contre Agathoclès, tyran de Sicile, beaucoup au-delà des bornes d'une juste modération; cependant on ne peut pas dire que ce soit sans raison : il avait à parler d'un ennemi, d'un homme méchant, d'un tyran. Mais rien ne justifie Théopompe : il se propose d'écrire l'histoire d'un prince que la nature semblait avoir formé pour la vertu, et il n'est point d'accusations honteuses et infâmes dont il ne le charge et le poursuive. II faut donc, ou que l'éloge qu'il fait de Philippe au commencement de son histoire soit faux et bassement flatteur, ou que, dans la suite de son ouvrage, il ait perdu l'esprit, s'il s'est imaginé qu'en blâmant quelquefois son héros, sans mesure et sans raison, il rendrait plus croyables les louanges qu'il devait lui donner en d'autres endroits.
Je doute que l'on approuve davantage le plan général de cet historien. Il entreprend d'écrire l'histoire de la Grèce, en la prenant où Thucydide l'a laissée; et quand on s'attend à lui voir décrire la bataille de Leuctres et les plus brillantes actions des Grecs, il laisse là la Grèce et se jette sur les exploits de Philippe. Or, il aurait été, ce me semble, bien plus raisonnable d'insérer l'histoire de Philippe dans celle de la Grèce, que d'envelopper l'histoire de la Grèce dans celle de Philippe. Quelque ébloui que l'on fût de la dignité, et peut-être de la puissance royale, on ne saurait pas mauvais gré à un historien qui, en parlant d'un roi, ferait mention des affaires de la Grèce; mais jamais historien sensé, après avoir commencé par l'histoire de la Grèce et l'avoir un peu avancée, ne l'interrompra. pour écrire celle d'un roi. Mais quelle raison a forcé Théopompe à ne pas s'embarrasser de ces sortes d'écarts? C'est que d'un côté il n'y avait que de la gloire, et que, de l'autre il trouvait son intérêt. Après tout , si on lui demandait pourquoi il a changé de dessein, peut-être aurait-il des raisons à alléguer pour sa défense. Mais je ne pense pas qu'il pût dire pour quelle raison il a si cruellement diffamé la cour de Philippe. Il conviendrait apparemment qu'en cela il a manqué au devoir d'historien. (Vertus et vices.)
Don THUILLIER..
Philippe fait empoisonner Aratus. - Modération de celui-ci, et honneurs qu'on lui rendit après sa mort.
Quoique les Messéniens se fussent déclarés ennemis de Philippe, ce prince n'en put tirer une vengeance qui soit digne d'être rapportée, bien qu'il ait entrepris de ravager leurs terres. Mais on ne peut rien voir de plus infâme que la manière avec laquelle il a traité ceux qui lui étaient le plus étroitement attachés. Il fit empoisonner Aratus, parce que ce vieillard vénérable n'avait point approuvé sa conduite à Messène, et pour commettre ce crime il eut recours au ministère de Taurion, qui, sous ses ordres, gouvernait le Péloponnèse. Cette infamie n'éclata point d'abord; car le poison n'était pas de la nature de ceux qui tuent sur-le-champ, mais de ceux qui conduisent lentement à la mort. Voici comment on découvrit ce crime : Aratus, qui n'avait confié ce secret à personne, ne put le cacher à un domestique fidèle et affectionné qui l'avait secouru avec beaucoup de soin et de zèle pendant sa maladie; un jour que Céphalon (c'était le nom de ce domestique) avait aperçu contre la muraille un crachat mêlé de sang, et l'avait fait remarquer à son maître : « Telle est, dit Aratus, la récompense de l'amitié que j'ai eue pour Philippe. » Tel est le grand, l'admirable effet de la modération, que celui qui est victime d'une action criminelle en a plus de honte que celui même qui en est auteur ! Et c'est ce que fit alors Aratus, qui, après avoir partagé avec Philippe les périls et la gloire. de tant d'exploits, en fut si mal récompensé. Ainsi mourut Aratus, que les Achéens, par reconnaissance pour les bienfaits infinis qu'ils en avaient reçus, avaient mis à leur tête, et à qui ils avaient confié le timon de leur république. Ils lui rendirent après sa mort les honneurs qu'ils lui devaient ; car on lui décerna des sacrifices et les honneurs que méritent les héros; on fit, en un mot, tout ce qu'il fallait pour consacrer sa mémoire à l'immortalité. De sorte que, s'il reste quelque sentiment aux morts, il n'y a pas lieu de douter qu'Aratus n'ait vu avec plaisir la manière dont les Achéens reconnaissaient les tourments et les fatigues qu'il avait supportés pour eux. (DOM THUILLIER.)
Prise de Lisse et de la citadelle par Philippe.
Il y avait longtemps que Philippe convoitait Lisse et sa citadelle, et qu'il pensait sérieusement à s'en rendre maître. Il partit enfin à la tête d'une armée, et, après avoir marché deux jours et traversé les défilés, il campa le long de l'Ardaxane assez près de la ville. Mais comme l'art et la nature avaient concouru à fortifier l'enceinte de cette place, tant du côté de la mer, que du côté de la terre, et que la citadelle, qui n'était pas loin de la ville, paraissait être d'une hauteur et d'une force à ne craindre aucun assaut, il perdit toute espérance d'emporter celle-ci, et se borna à n'attaquer que la ville. Entre Lisse et le pied de la montagne où est la citadelle, est un espace tout à fait propre à livrer une attaque. Là Philippe résolut de faire une attaque simulée, et de saisir le moment favorable pour mettre à exécution un stratagème qu'il imagina. Il donna aux Macédoniens un jour entier pour se reposer ; et après les avoir exhortés à se conduire avec courage, il cacha avant le jour la plus grande et la meilleure partie de ses troupes légères dans des vallons boisés qui étaient du côté des terres; au dessus de l'espace dont nous avons parlé, et le jour suivant, il mena ses soldats pesamment armés avec le reste de ses troupes légères, de l'autre côté de la ville en côtoyant la mer. Puis ayant fait le tour de la ville, et étant revenu à l'endroit dont nous avons parlé, alors on ne douta point qu'il ne fît attaquer la ville par là.
Sur l'avis qu'on avait eu de l'arrivée de Philippe, il s'était assemblé, de toute l'Illyrie, un grand nombre de troupes dans Lisse. Dans la citadelle, que l'on croyait assez forte d'elle-même, on n'avait mis qu'une garnison médiocre. Dès que les Macédoniens approchèrent, les assiégés, comptant sur leur nombre et leurs fortifications, sortirent en foule de la ville. Le roi avait posté ses soldats pesamment armés dans les lieux plats et unis, et avait donné ordre à ses troupes légères d'avancer vers les hauteurs, et d'en venir courageusement aux mains avec les ennemis. Le combat fut quelque temps douteux; mais ensuite les troupes de Philippe, ne pouvant tenir contre les difficultés du terrain et le nombre des ennemis, cédèrent et se replièrent sur l'infanterie pesamment armée. Alors les assiégeants, comme pour les insulter, marchent en avant, descendent dans la plaine, et livrent combat aux soldats pesamment armés. La garnison de la citadelle s'aperçut que Philippe faisait marcher lentement en arrière ses cohortes les unes après les autres, et, croyant que Philippe battait entièrement en retraite, elle quitta imprudemment son poste, persuadée que sans elle sa situation même le défendait assez. Ces troupes sortent peu à peu de la citadelle, et, par différents défilés, descendent avec impétuosité dans la plaine, où, après la fuite des ennemis, elles espéraient faire quelque butin. Alors celles du côté de Philippe, qui étaient cachées dans des fonds boisés, sortent de leur embuscade et fondent sur la garnison : les soldats pesamment armés reviennent à la charge; l'épouvante et la confusion se répandent parmi les ennemis. La garnison de Lisse prend la fuite en désordre et se réfugie dans la ville; mais celle de la citadelle fut coupée par l'embuscade. D'où il arriva, ce que l'on attendait le moins que, Phi-lippe prit la citadelle sans aucun danger; pour la ville, elle fut attaquée si vivement par les Macédoniens, qu'elle ne put tenir que jusqu'au lendemain. Philippe, devenu le maître Lisse et de sa citadelle d'une manière si extraordinaire, le devint en même temps de tous les lieux voisins. Entre autres, la plupart des villes d'Illyrie lui ouvrirent d'elles-mêmes leurs portes. Après la prise de ces deux forteresses, on vit bien qu'il n'y en avait plus où l'on pût être à couvert contre ce prince, et que l'on ne pouvait lui résister impunément. (DOM THULLIER.)
V.
Achéus, assiégé dans la citadelle de Sardes, est livré à ses ennemis par la trahison de Bolis, et condamné à une mort honteuse par Antiochus.
Bolis était Crétois de naissance, considéré pendant longtemps à la cour des Ptolémées, et honoré du commandement. Il avait la réputation d'un homme adroit, et d'une grande hardiesse à tout entreprendre, et passait pour n'être inférieur à personne dans l'art de la guerre. Sosibe, se l'étant gagné par des entretiens fréquents et s'en étant fait un ami, lui dit qu'il ne pouvait, dans les circonstances présentes, faire un plaisir plus sensible au roi, que de trouver un moyen de sauver Achéus. Bolis après l'avoir entendu, lui répondit qu'il y penserait, et se retira. Après y avoir bien songé, il alla au bout de deux ou trois jours trouver Sosibe, et lui dit qu'il se chargeait de l'affaire, qu'il avait demeuré quelque temps dans Sardes, qu'il avait une grande connaissance des lieux, et que Cambyle, qui y commandait les Crétois au service d'Antiochus, était non, seulement son concitoyen, mais encore son parent et son ami. Or, Cambyle était chargé de la garde d'un des forts qui sont derrière la citadelle; car, comme on n'y peut établir aucune fortification, il n'avait pour défense que la troupe de Cambyle. Sosibe fut ravi de cette particularité, et demeura persuadé que, ou bien il était absolument impossible de tirer Achéus du péril où il était, ou que, si cela était possible, nul autre plus que Bolis n'était capable de le faire. Cette chaleur avec laquelle Bolis se chargeait de cette entreprise, fit espérer un prompt succès. Sosibe, de son côté, lui promettait que l'argent ne lui manquerait pas pour l'exécution, et lui en promettait beaucoup plus quand l'affaire serait terminée, sans compter les récompenses qu'il devait attendre de la reconnaissance du roi et d'Achéus, récompenses qu'il exagéra le plus qu'il put, pour exalter le courage et les espérances de Bolis.
Celui-ci prit la chose si fort à cœur, que, s'étant muni de bonnes lettres de créance, il se mit sans délai sur mer. Il alla d'abord à Rhodes trouver Nicomaque, qui avait pour Achéus une tendresse de père, et qui avait autant de confiance en lui que s'il eût été son propre fils. De Rhodes il alla à Éphèse, où il s'aboucha avec Mélancome, car c'était de ces deux hommes qu'Achéus s'était prudemment servi pour communiquer avec Ptolémée. Après leur avoir fait part de ses projets, et les ayant trouvés prêts à le seconder de tout leur pouvoir, il envoya un de ses gens nommé Arion, à Cambyle, avec ordre de lui dire que Bolis était venu d'Alexandrie pour lever quelques troupes étrangères, mais qu'il avait à conférer avec lui sur quelques affaires importantes et qu'il lui marquât le temps et le lieu où ils pourraient conférer sans témoins. Cambyle n'eut pas plus tôt entendu ces instructions, qu'il se rendit atout ce que l'on demandait de lui, et renvoya le messager, qui dit à son maître le jour et le lieu où ils devaient tous deux se rendre pendant la nuit.
Bolis, en homme fourbe et artificieux, selon le génie de sa nation, avait établi tout son plan dans sa tête, et l'avait considéré sous toutes les faces; arrivé au rendez-vous, il donne une lettre à Cambyle, et sur cette lettre ils tiennent un conseil vraiment digne de deux Crétois. On n'y délibéra point sur les mesures qu'il fallait prendre pour tirer Achéus du danger où il était; on n'y parla point de la foi qui se devait garder aux hommes qui lui avaient confié cette mission ; ils ne songèrent qu'à leur sûreté propre et à ce qui pourrait leur apporter le plus de profit. Il ne fallut pas beaucoup de temps à ces deux hommes perfides pour convenir, premièrement que les dix talons reçus de Sosibe seraient partagés en commun, et en second lieu qu'après avoir reçu d'Antiochus de l'argent et des espérances dignes d'un si grand service, ils lui déclareraient toute l'affaire, et lui promettraient que pourvu, qu'il voulût les seconder, ils lui livreraient Achéus.
Cambyle prit sur lui ce qu'il y avait
à faire auprès d'Antiochus, et Bolis donna sa parole que, dans
quelques jours, il enverrait Arien à Achéus avec des lettres de
Nicomaque et de Mélancome; mais il laissa à l'autre le soin de faire
en sorte qu'Arien pût entrer dans la citadelle et en sortir en toute
sûreté. Ils étaient encore convenus que si Achéus tombait dans le
piège, et répondait à Nicomaque et à Mélancome, Bolis se chargerait
de l'exécution et viendrait se joindre à Cambyle. Les emplois ainsi
partagés, ils se séparèrent, et chacun de son côté fit ce dont on
était convenu.
Cambyle, à la première occasion, s'ouvrit au roi sur le projet. Une
nouvelle si extraordinaire produisit dans Antiochus des mouvements
différents. Tantôt, ne se possédant pas de joie, il promettait tout
ce qu'on lui demandait; tantôt, n'osant y ajouter foi, il se faisait
répéter et les projets et les moyens de l'exécuter. Puis, revenant à
croire ce que Cambyle lui disait, et se persuadant que c'était une
protection visible des dieux, il priait et pressait avec instance
Cambyle d'achever ce qu'il avait commencé.
Bolis agissait avec le même
empressement auprès de Nicomaque et de Mélancome, qui, ne doutant
pas qu'il n'agît avec bonne foi, donnèrent à Arien, sans hésiter,
des lettres écrites en certains caractères, dont ils étaient
convenus de se servir, et l'envoyèrent à Achéus. Ces lettres
l'exhortaient à s'en fier entièrement à Bolis et à Cambyle, mais
elles étaient écrites de manière que, quand elles eussent été
interceptées, on n'aurait pu déchiffrer rien de ce que qu'elles
contenaient.
Arien, ayant été introduit par Cambyle dans la citadelle, remit les
lettres à Achéus; et comme dès le commencement il avait été initié à
tous les projets, il lui rendait exactement compte du plan que l'on
avait conçu. Interrogé sur différentes particularités qui
regardaient, ou Sosibe, ou Bolis, ou Nicemaque, on Mélancome, ou
Cambyle, il répondait juste à toutes les questions; et il répondait
avec autant d'aplomb et de fermeté que s'il se fût agi de lui-même,
parce que la conjuration que tramaient entre eux Cambyle et Bolis
lui était inconnue. Ces réponses d'Arien jointes aux lettres de
Nicomaque et de Mélancome, ne permirent pas à Achéus de révoquer en
doute ce qu'assurait Arien. Il le renvoya avec des lettres pour ceux
qui lui avaient écrit.
Après plusieurs voyages semblables, enfin Achéus ne trouva rien de mieux à faire que de s'en fier entièrement à Nicomaque, d'autant plus qu'il ne lui restait aucune autre espérance de sortir du péril où il était. Il manda qu'il était prêt à se mettre entre les mains de Bolis et d'Arien, et qu'on n'avait qu'à les envoyer. Son dessein était d'abord de se tirer du danger qui le menaçait, et ensuite de prendre la route de la Syrie; car, il se persuadait que, paraissant tout d'un coup chez les Syriens après une délivrance si extraordinaire, et pendant qu'Antiochus était encore devant Sardes, sa présence ne manquerait pas de causer parmi eux de grands mouvements, et de faire beaucoup de plaisir aux peuples d'Antioche, de la Coelo-Syrie et de Phénicie. L'esprit rempli de ces grands projets, il attendait Bolis avec impatience. Mélancome, ayant reçu ces lettres, fait de nouvelles instances auprès de Bolis, se flatte de nouvelles espérances et l'envoie. Celui-ci avait fait auparavant partir Arien, pour avertir Cambyle de la nuit qu'il avait choisie pour aller le joindre au lieu marqué : ils passèrent ensemble un jour entier à délibérer sur les mesures qu'ils avaient à prendre, et la nuit suivante, ils entrèrent dans le camp. Le résultat de la délibération fut que, si Achéus sortait de la citadelle, ou seul, on accompagné d'un second avec Bolis et Arien, il serait aisé de s'en saisir; mais que la chose ne serait pas facile si sa suite était plus nombreuse, surtout avec le dessein qu'ils avaient de l'amener vivant à Antiochus, pour faire de plus plaisir à ce prince; et par cette raison, il fallait qu'Arien; en amenant Achéus dans la citadelle, marchât devant lui, comme, connaissant mieux qu'un autre ce chemin qu'il avait fait souvent, et que Bolis marchât derrière, afin que quand on serait arrivé à l'endroit où, par les soins de Cambyle, tous ceux qui étaient d'intelligence dans cette affaire se trouveraient prêts, il s'emparât de la personne d'Achéus, de peur ou que, pendant le tumulte et dans l'obscurité, il ne parvînt à s'enfuir dans des lieux couverts, ou que dans le désespoir il ne se précipitât du haut de quelque rocher, et ne fit ainsi manquer le dessein qu'ils avaient de le mener vivant à Antiochus.
Tout étant ainsi disposé, Bolis retourna trouver Cambyle, qui, dans la même nuit, le conduisit à Antiochus, et le laissa seul avec lui. Le roi lui fit mille caresses, lui confirma les promesses qu'il lui avait déjà faites, et les exhorta vivement l'un et l'autre à se hâter autant que possible. Les deux perfides retournent au camp, et, avant le jour, Bobs part avec Arien pour aller à la citadelle, où ils entrèrent avant que le jour parût.
Achéus reçut Bolis avec beaucoup de marques d'amitié, et lui demanda de nombreux détails sur tout ce qui regardait l'affaire qui les amenait, et, jugeant sur son air et sa conversation, qu'il était homme à faire bien espérer de ce qu'il entreprendrait, il se livrait à la joie que lui donnait l'espoir d'une délivrance prochaine; mais cette joie n'était pas telle, qu'elle ne fût quelquefois troublée par l'inquiétude où le jetait la vue des graves conséquences que sa sortie de la citadelle pouvait avoir. Dans cette incertitude, comme il avait joint à une grande pénétration une longue expérience, il ne jugea pas à propos de s'abandonner entièrement à la bonne foi de Bolis, C'est pourquoi il lui dit que, dans le moment, il ne lui était pas possible de le suivre, mais qu'il enverrait avec lui trois ou quatre amis à Mélancome, et que, sur leur rapport, il se tiendrait prêt à sortir. Achéus, par là, prenait toutes les précautions qu'il pouvait prendre, mais il ne songeait pas qu'il avait affaire à un Crétois; car Bolis s'était préparé à tout ce qu'on lui pourrait objecter sur cette entreprise.
La nuit venue, pendant laquelle Achéus avait dit qu'il enverrait trois ou quatre de ses amis, il fit aller Arien et Bolis à la porte de la citadelle, et leur donna ordre d'y attendre ceux qui devaient partir avec eus. Pendant ce temps-là il révéla enfin à sa femme ce qu'il avait entrepris. Laodice fut si effrayée d'une nouvelle si extraordinaire, qu'elle en pensa mourir. Achéus, l'ayant encouragée, et ayant flatté sa douleur par l'espérance d'un meilleur sort, il prit quatre de ses amis, à qui il fit revêtir des habits grossiers, il en prit un lui-même des plus simples, et, dans cet état, tous cinq se mirent en chemin. Il avait donné ordre à un de ses amis de répondre seul à tout ce qu'Arien dirait, de s'informer de lui seul, de ce qu'il y aurait à faire, et de dire que les autres étaient des Barbares. Quand ils eurent joint Arien, celui-ci marcha devant comme sachant le chemin; Bolis suivit, selon qu'on était convenu, non sans inquiétude sur le succès de sa trahison; car, quoiqu'il fût Crétois, et par conséquent toujours sur ses gardes contre tout le monde, il ne pouvait, dans l'obscurité, ni reconnaître Achéus; ni savoir même s'il était dans la troupe. Mais comme la descente était difficile et escarpée, qu'il y avait même des pas glissais et dangereux, l'attention que l'on eut, tantôt à soutenir, tantôt à attendre Achéus, donna moyen à Bolis de le distinguer : ce qu'il aurait eu peine à faire sans ces attentions qu'on avait coutume d'avoir pour lui, et dont on ne pensa point alors à s'abstenir.
Quand on fut arrivé au lieu désigné par Cambyle, Bolis donna le signal par un coup de sifflet. Alors ceux qui étaient en embuscade saisissent les quatre amis; mais Bolis se jeta lui-même sur Achéus, qui avait les bras cachés sous ses habits, et le serra par le milieu du corps, de peur qu'il ne lui prît idée de se percer d'un poignard qu'il avait apporté. Le malheureux Achéus se trouve en un moment environné de tous côtés; ses ennemis se rendent maîtres de lui, et le conduisent sur-le-champ à Antiochus.
Ce prince attendait, rêveur et inquiet, l'issue de l'entreprise. Il avait congédié ses convives; et restait seul, et privé du sommeil dans sa tente, avec deux ou trois de ses gardes. Quand la troupe de Cambyle fut entrée, et qu'elle eut assis contre terre Achéus, lié et garrotté, ce spectacle lui interdit tellement la parole, qu'il fut longtemps sans pouvoir proférer un seul mot. Il fut si sensiblement touché de ce spectacle, qu'il ne put retenir ses larmes. Peut-être se représentait-il alors combien il est difficile de se mettre à l'abri des coups imprévus de la fortune. Cet Achéus, qui était fils d'Andromaque, frère de Laodice, femme de Seleucus, qui avait épousé Laodice, fille du roi Mithridate, qui avait régné sur tout le pays d'en deçà du mont Taurus, que ses troupes et celles de ses. ennemis croyaient en sûreté dans la place la plus forte de l'univers, cet Achéus était là assis contre terre, au pouvoir de ses ennemis les plus acharnés, sans que personne connût alors cette trahison, excepté ceux qui en étaient les auteurs. Le lendemain, au point du jour, quand les courtisans se furent assemblés suivant l'usage dans la tente du roi, et qu'ils aperçurent Achéus, sa vue produisit sur eux le même effet que sur le roi; à peine osèrent-ils en croire leurs propres yeux. On délibéra ensuite, pour savoir quels supplices on ferait souffrir à cet infortuné prince. Il fut conclu qu'après avoir été d'abord mutilé, il aurait la tête tranchée et cousue dans une peau d'âne, et que le reste de son corps serait pendu à un gibet. Cette exécution causa une si grande surprise et une si grande consternation dans l'armée, que Laodice, qui savait seule que son mari était sorti de la citadelle, conjectura son sort en voyant du haut des remparts la confusion et le trouble qui régnaient parmi les soldats. Un héraut étant venu ensuite apprendre à Laodice le sort de son mari, et lui commander de ne se plus mêler des affaires et de sortir de la citadelle, la garnison ne répondit d'abord que par des larmes et des gémissements inexprimables, non tant à cause de l'amour qu'ils avaient pour Achéus, que parce qu'ils ne s'attendaient à rien moins qu'à un événement si extraordinaire. Après les pleurs, ce fut un embarras extrême de savoir quel parti on prendrait. Antiochus, après la mort d'Achéus, pressa la citadelle sans relâche, persuadé que quelque occasion se présenterait d'y entrer, et que ce serait surtout la garnison qui la lui ferait naître. C'est ce qui ne manqua pas d'arriver. Une sédition s'étant élevée parmi les soldats, il se forma deux partis, l'un pour Ariobaze, l'autre pour Laodice. Et comme ils se défiaient l'un de l'autre, ils ne furent pas longtemps sans se rendre à Antiochus, eux et la citadelle. Ainsi périt Achéus, qui, après avoir vainement pris toutes les précautions que la raison réclame pour se défendre contre la perfidie, laisse deux grandes leçons à la postérité : la première, qu'il ne faut ajouter foi facilement à personne; l'autre, que l'on ne doit point s'enorgueillir de la prospérité, mais bien se persuader qu'étant hommes, nous devons nous attendre à tout ce qui peut arriver aux hommes. (DOM THULLIER.)
VI.
Cavarus, chef des Gaulois dans la Thrace.
Cavarus, chef des Gaulois qui habitaient la Thrace, pensait noblement et avait des sentirons dignes d'un roi; il fit en sorte que les marchandises pussent naviguer sur le Pont-Euxin sans courir de dangers, et fut d'un grand secours aux Byzantins pendant les guerres qu'ils eurent à soutenir contre les Thraces et les Bithyniens. (Excerpta Valesian.) SCHWEIGH.
Polybe, dans le huitième livre de son Histoire, rapporte que Cavarus le Gaulois, qui était, du reste, un homme vertueux, fut perverti par Sostrate de Calcédoine, son conseiller. (Athaenaei lib. VI, c. 13.) SCHWEIGH.
VII
Belle conduite d'Antiochus.
Antiochus était venu camper devant Armosate (ville située entre l'Euphrate et le Tigre, dans le territoire appelé la Belle-Plaine), et se préparait à en faire le siège. Xerxès, gouverneur de cette place, ayant bien compris les préparatifs du roi, eut d'abord le dessein de fuir. Quelque temps après, craignant que, la capitale prise, il ne fût dépouillé de tous ses états, il changea de sentiment et envoya demander une conférence à Antiochus. Les courtisans du roi étaient d'avis qu'il se saisît de ce jeune prince qui se présentait de lui-même, et qu'il donnât le royaume à Mithridate, son neveu; mais le roi de Syrie, loin de suivre ces conseils violents, reçut le jeune roi, fit la paix avec lui, et lui fit remise de la plus grande partie des tributs que son père lui devait; il se contenta de trois cents talents, de mille chevaux et de mille mulets avec leurs harnais. Il mit ordre aux affaires du royaume, et donna en mariage à Xerxès, Antiochis sa fille. Un procédé si noble et si généreux lui fit beaucoup d'honneur et lui gagna les cœurs de tous les peuples de cette contrée. (Excerpta Valesian.) SCHWEIGH.
VIII.
Hannibal prend la ville de Tarente par trahison.
Les Tarentins n'étaient d'abord sortis de la ville que comme pour faire quelque expédition. S'étant, une nuit, approchés du camp des Carthaginois, quelques-uns restèrent cachés dans un bois qui était sur le chemin; mais Philémène et Nicon allèrent jusqu'aux portes du camp. Saisis par les gardes, ils furent conduits à Hannibal, sans dire ni d'où ils étaient, ni qui ils étaient, mais annonçant seulement qu'ils voulaient parler au général. Quand ils lui eurent été présentés, ils lui dirent qu'ils seraient bien aises de l'entretenir sans témoins. Hannibal ne demandant pas mieux, ils commencèrent par une longue apologie de leur conduite et de celle de leur patrie, et finirent en chargeant les Romains de quantité d'accusations différentes, pour faire entendre à Hannibal que ce n'était pas sans raisons qu'ils avaient pris le parti de les abandonner. Ce général, après les avoir loués de leur résolution et leur avoir témoigné beaucoup d'amitié, les renvoya en leur ordonnant de revenir au plus tôt lui parler une seconde fois de cette affaire; et pour avoir le temps de penser mûrement à ce que ces jeunes gens lui avaient proposé, et faire croire aux Tarentins que ceux-ci étaient, en effet, sortis de la ville pour butiner, il leur dit que quand ils seraient à une distance raisonnable du camp, ils n'avaient qu'à pousser devant eux les bestiaux qui paissaient et les hommes qui les gardaient, qu'ils ne craignissent pas d'être poursuivis, qu'il veillerait à leur sûreté.
Nicon suivit exactement les ordres qu'il avait reçus, et Hannibal était charmé de voir que l'occasion se fût enfin présentée de se rendre maître de Tarente. Philémène poussait encore l'affaire avec plus de chaleur, excité à cela, tant par la sûreté avec laquelle il pouvait parler à Hannibal et par l'accueil que lui faisait ce général, que parce que la quantité de butin qu'il faisait entrer dans la ville le mettait hors de tout soupçon. Eu effet, il amenait assez de bestiaux et pour les sacrifices, et pour nourrir ses concitoyens; non seulement on le croyait de bonne foi, mais encore il excitait beaucoup de gens à l'imiter.
Étant sortis pour la seconde fois, et ayant agi tout à fait de la même manière, ils donnèrent des assurances à Hannibal et en reçurent de lui. Les conditions du traité furent : qu'il mettrait les Tarentins en liberté; qu'il n'exigerait d'eux aucun tribut; qu'il ne leur imposerait aucune loi, et que, quand il serait entré dans la ville, le pillage des maisons qu'y possédaient les Romains, appartiendrait aux Carthaginois. Ils convinrent aussi avec Hannibal d'un signal, pour être promptement reconnus par la garde de son camp quand ils y viendraient de la ville. Par ce moyen, ils avaient toute liberté de venir trouver Hannibal aussi souvent qu'ils le voulaient, tantôt sous le prétexte de butiner, et tantôt pour aller à la chasse.
Après avoir pris ses mesures pour l'avenir, pendant que la plupart des conjurés épiaient l'occasion d'exécuter leur projet, on envoyait Philémène à la chasse : car; comme 'il avait une forte passion pour cet exercice, on s'imaginait qu'il n'y en avait point qu'il eût plus à cœur. C'est pour cela qu'il fut chargé de se concilier, en faisant des présents du produit de sa chasse, premièrement l'amitié de Caïus Livius qui commandait dans la ville, et ensuite celle des gardes de la porte appelée Témenide. Philémène s'étant acquis cette confiance, faisait entrer sans cesse du gibier dans la ville; soit celui qu'il avait pris lui-même à la chasse, soit celui qui lui avait été préparé par Hannibal; il en donnait une partie au commandant; il faisait part de l'autre aux gardes de la porte, afin qu'ils fussent toujours prêts à lui ouvrir le guichet: car il entrait et sortait, la plupart du temps, pendant la nuit, en apparence par la crainte des ennemis, mais, en effet , parce que ses projets le réclamaient ainsi.
Philémène ayant ainsi accoutumé les gardes à lui ouvrir le guichet sans délai, toutes. les fois qu'approchant de la muraille pendant la nuit, il donnerait un coup de sifflet pour les avertir, les autres conjurés, qui avaient appris que Livius commandant pour les Romains dans la ville, devait donner certain jour un festin à de nombreux convives dans le musée près du forum, choisirent ce jour avec Hannibal pour l'exécution de leur dessein. Avant ce temps-là ce général avait déjà feint une indisposition, afin que les Romains ne fussent pas surpris de le voir rester si longtemps dans le même endroit; mais alors il s'était fait passer pour beaucoup plus gravement malade, et se tenait éloigné de Tarente de trois jours de marche.
Le temps de l'exécution étant venu, il choisit, tant cavaliers que fantassins, dix mille hommes des plus agiles et des plus braves, et leur ordonna de prendre des vivres pour quatre jours, et au point du jour il se mit en marche, donnant ordre à quatre-vingts cavaliers numides de marcher devant l'armée à environ trente stades, et de s'écarter à droite et à gauche du chemin, de peur que l'armée ne fût aperçue, et afin de prendre ceux qui se rencontreraient sur la route, ou de crainte que ceux qui échapperaient ne portassent à la ville la nouvelle que la cavalerie numide parcourait le pays. Quand cette cavalerie eut avancé environ cent vingt stades, Hannibal fit reposer ses soldats sur le bord d'une rivière; où l'on ne pouvait les découvrir, et là, ayant assemblé les chefs, sans leur expliquer ouvertement son dessein, il se contenta, pour les porter à se signaler dans cette occasion, de les assurer que jamais leur valeur n'aurait été mieux récompensée. Il leur recommanda ensuite de faire garder exactement, à chacun son rang dans la marche, de punir sévèrement ceux qui le quitteraient, de faire attention aux ordres qui leur seraient donnés, et de ne faire exactement que ce qui leur serait commandé.
Ensuite ayant renvoyé ces officiers chacun à son poste, le soir venu, il fait avancer son avant-garde, dans le dessein d'être au pied des murs vers minuit. Philémène servait de guide, portant avec lui un sanglier pour se faire ouvrir la porte. Livius, comme les conjurés l'avaient prévu, était ce jour-là avec ses amis dans le musée, et il était au milieu du festin, lorsque le soir on vint l'avertir que les Numides fourrageaient dans la campagne. Ne pensant pas qu'il y eût autre chose, le soupçonnant même beaucoup moins à cause de cette nouvelle, il fit appeler quelques centurions, et leur commanda de prendre au point du jour la moitié de la cavalerie pour arrêter ces courses.
Dès que la nuit fut venue, Nicon, Tragisque et les autres conjurés s'étant rassemblés dans la ville, épiaient le moment où Livius reviendrait chez lui. Il ne tarda point à sortir, parce que le repas s'était fait de jour. Alors pendant que quelques conjurés se tenaient à l'écart, quelques autres vont au devant de Livius, et plaisantent entre eux comme pour imiter des gens qui sortaient de table. Quant ils furent proche de Livius que le vin avait beaucoup égayé, on rit, on dit force bons mots de part et d'autre, et, rebroussant chemin, on conduit ainsi le commandant jusqu'à son logis, où n'ayant rien de fâcheux ou de triste dans l'esprit , et ne respirant au contraire que la joie et la mollesse, il succomba d'abord à ce sommeil profond où fait tomber le vin que l'on prend pendant le jour. Ce fut alors que Nicon et Tragisque allèrent rejoindre leurs compagnons, et que, se divisant en trois bandes, ils se portèrent aux avenues les plus commodes du forum, afin que rien de ce qui se passerait au dehors ou dans la ville ne leur fût caché. Il y en eut aussi qui se mirent auprès du commandant, persuadés que s'il naissait quelque soupçon de ce qui menaçait Livius, ce serait à lui qu'on en apporterait les premières nouvelles; et que ce qui se ferait pour détourner le danger, se ferait d'abord par lui. Enfin quand les convives se furent retirés, que le tumulte eut cessé, et que toute la ville fut endormie, au milieu de la nuit, toutes choses semblant réussir aux conjurés, ils se réunirent pour l'exécution de leur complot.
Ils étaient convenus avec les Carthaginois, qu'Hannibal s'approcherait de la ville du côté des terres qui regardent l'orient, en prenant le chemin de la porte Témenide; qu'il allumerait un feu sur le tombeau appelé par quelques-uns d'Hyacinthe, et par quelques autres d'Apollon Hyacinthe; que Tragisque, voyant ce feu, en allumerait un autre au dedans de la ville; et qu'ensuite Hannibal ayant éteint son feu s'avancerait lentement et sans bruit vers la porte. Cet arrangement pris, nos conjurés traversent la partie habitée de la ville, et viennent ans tombeaux; car le côté oriental de la ville est tout couvert de ces sortes de monuments, parce que, pour obéir à un ancien oracle qui leur avait prédit que plus ils seraient d'habitants plus ils seraient heureux, entendant et oracle des morts comme des vivants, ils enterrent tous leurs morts au dedans de la ville. Arrivés au tombeau de Pythionique, ils attendirent qu'Hannibal allumât son feu, qui ne fut pas plus tôt allumé, que Nicon et Tragisque, pleins de confiance, firent aussi le leur; et quand celui d'Hannibal fut éteint, ils courent avec impétuosité à la porte pour en égorger la garde, avant que les Carthaginois qui devaient marcher lentement y arrivassent. L'expédition réussit; on surprend la garde, et pendant qu'une partie des conjurés la tue, l'autre brise la porte. Hannibal arrive à propos, ayant si prudemment disposé la marche qu'on n'en eut dans la ville aucune connaissance.
Cette entrée s'étant faite sûrement et sans bruit selon le projet, Hannibal croit déjà la chose fort avancée et traverse hardiment la grande rue qui conduit au marché. Il avait laissé sa cavalerie, au nombre de deux mille chevaux, hors de la porte, pour servir au besoin, en cas qu'il parât quelques ennemis au dehors, ou qu'il arrivât quelque accident imprévu, comme c'est assez l'ordinaire dans ces sortes d'entreprises. Quand il fut aux environs du forum, il fit faire halte à ses troupes, en attendant qu'il eût des nouvelles de Philémène, dont il était fort inquiet; car après avoir décidé d'entrer par la porte Témenide, il avait envoyé Philémène avec son sanglier et mille Africains à la porte voisine, afin qu'usant non d'un seul moyen, mais de plusieurs, selon qu'on était convenir, on eût aussi plus d'espérance de réussir.
Or Philémène s'étant approché de la muraille suivant son habitude, et ayant donné un coup de sifflet, un garde descendit pour lui ouvrir le guichet. Pour le presser, Philémène lui dit de dehors qu'il se hâtât d'ouvrir, parce qu'ils étaient fort chargés, et qu'ils apportaient un sanglier. À ces mots ce garde espérant qu'il lui reviendrait quelque chose de cette chasse, parce qu'il avait toujours eu sa part des précédentes, ouvrit avec beaucoup d'empressement. Philémène, qui était aux deux premiers bras du brancart, entra le premier avec un autre, en habit de pâtre, qu'il fit passer pour un paysan. Deux autres le suivent portant les deux autres bras de la civière. Entrés tous quatre, ils commencent par poignarder le garde qui leur avait ouvert le guichet, et qui s'occupait imprudemment à regarder et à manier le sanglier; ensuite ils font entrer par le guichet les trente premiers Africains, dont les uns brisent la porte, les autres tuent le reste des gardes. On donne après cela le signal , les autres Africains entrent et sont conduits au forum selon ce qui avait été publié.
Hannibal, en les voyant, ravi de ce que tout lui réussissait à souhait, pensa à faire réussir le reste. Il partagea les deux mille Gaulois qu'il avait, en trois corps, et mit à la tête de chacun deux des conjurés. Il y joignit deux de ses capitaines, avec ordre de se saisir des avenues les plus commodes du forum. Aux conjurés, il leur ordonna de ne faire aucun mal aux citoyens qu'ils rencontreraient, et de leur crier de loin qu'ils ne sortissent point de chez eux, et qu'ils n'avaient rien à craindre. Mais les officiers des Gaulois et des Carthaginois eurent ordre de faire main-basse sur tout ce qui se présenterait de Romains; toutes choses qui furent d'abord exécutées.
Quand on sut dans la ville que les ennemis y étaient entrés, tout fut rempli de clameurs et de confusion. Livius en fut averti ; mais, sentant que le vin ne lui permettait pas d'agir, il sortit de sa maison avec ses domestiques, et, se faisant ouvrir le guichet de la porte qui conduit au port, il entra dans un des vaisseaux qui étaient à l'ancre, et, se rendit avec ses gens dans la citadelle. Après cela Philémène, qui avait disposé des trompettes romaines et des gens qui s'étaient accoutumés à en jouer, fit sonner de cet instrument de dessus le théâtre; aussitôt les Romains courent en armes à la citadelle, et entrent par là dans les vues des Carthaginois; car se répandant sans ordre dans les places, les uns tombèrent entre les mains des Carthaginois, les autres entre celles des Gaulois, qui en firent un carnage horrible.
Pendant ce temps-là, les Tarentins ne pouvant savoir au vrai ce qui se passait, restaient tranquilles chez eux. Comme ils n'entendaient que des trompettes romaines, et que dans la ville il ne se faisait ni désordre ni pillage, ils crurent que ce mouvement ne venait que des Romains. Mais quand le jour fut venu, et qu'ils virent leurs troupes tuées sur la place, et des Gaulois qui les dépouillaient, alors ils soupçonnèrent qu'il fallait que les Carthaginois fussent entrés.
Hannibal ayant rangé ses troupes en bataille sur la place publique, après que les Romains se furent retirés dans la citadelle où ils tenaient garnison, et que le jour fut plus avancé, fit publier par un héraut, que les Tarentins eussent à s'assembler sans armes dans le forum. Aussitôt les conjurés coururent de côté et d'autre dans la ville, criant liberté, et exhortant les habitants à ne rien craindre sous la protection des Carthaginois. Ceux des citoyens qui étaient attachés aux Romains entendant ces cris, allèrent les joindre dans la citadelle; mais le reste aima mieux obéir à l'ordre d'Hannibal. Ce général leur parla avec beaucoup de douceur, et il ne dit rien qui ne fût reçu avec applaudissement : tant on était surpris d'une délivrance si extraordinaire! Il congédia ensuite l'assemblée, enjoignant à chacun à son retour dans sa maison, d'écrire sur-le-champ sur la porte, TARENTIN, et défendant sous peine de la vie, d'écrire le même mot sur la porte d'aucun Romain. Puis, distribuant dans différents quartiers ceux de ses soldats qu'il croyait les plus propres à ces sortes de coups de main; il les envoya piller les maisons des Romains, qu'ils connaîtraient en ne voyant rien d'écrit sur les portes, et retint les autres en ordre de bataille pour secourir les premiers en cas d'alarme. Les Carthaginois firent dans ce pillage un butin prodigieux, et qui répondait pour le moins aux espérances qu'il en avaient conçues.
Ils passèrent cette nuit sous les armes; mais le lendemain, Hannibal ayant tenu conseil avec les Tarentins, résolut d'élever une muraille entre la citadelle et la ville, afin que les citoyens n'eussent plus rien à appréhender de la part des Romains qui occupaient la citadelle. D'abord il commença par conduire un retranchement parallèle à la muraille et au fossé de cette forteresse; mais se doutant bien d'un côté que les ennemis ne le souffriraient pas, et qu'au moins dans cette occasion ils mettraient en oeuvre toutes leurs forces, et jugeant de l'autre que rien n'était plus nécessaire dans la conjoncture présente, que de donner de la terreur aux Romains et d'inspirer de la confiance aux citoyens de Tarente, il fit choix des meilleures troupes pour repousser tout ce qui s'opposerait à cet ouvrage. Les Romains se présentèrent en effet, dès que l'on eut commencé à jeter le retranchement. Hannibal vint et ne fit d'abord qu'une légère escarmouche, seulement pour les engager au combat. Quand il y en eut un certain nombre en deçà du fossé, Hannibal donne le signal à ses troupes; on fond sur les ennemis, il se livre un grand combat; autant du moins que cela pouvait être dans un terrain serré et enfermé de murailles. Enfin les Romains furent défaits, une partie passée au fil de l'épée, l'autre repoussée jusqu'au fossé où elle périt. Hannibal ensuite n'ayant plus rien qui l'inquiétât, et tout lui réussissant selon ses désirs, continua son retranchement. Par là il tenait ses ennemis renfermés et les forçait de rester dans leurs murailles, de crainte non seulement d'être pris eux-mêmes, mais encore d'être chassés de leur citadelle, et il donnait tant de courage et de confiance aux troupes de la ville, qu'avec elles seules, sans le secours des Carthaginois, il se croyait en état de tenir tête aux Romains. Un peu en deçà du retranchement du côté de la ville, il conduisit ensuite un fossé parallèle au retranchement et à la muraille de la citadelle, et le long du bord qui regardait la ville, il fit élever un rempart sur lequel il mit un nouveau retranchement, qui n'était guère moins sûr qu'une muraille. À quelque distance de ce rempart, en approchant toujours de la ville, il fit encore élever une muraille, en la conduisant depuis l'endroit appelé Soteira jusqu'à la rue Bathée. En sorte que sans le secours d'hommes les Tarentins par ces fortifications étaient à couvert de toute insulte et de toute surprise. Tous ces ouvrages achevés, laissant des troupes suffisantes tant à pied qu'à cheval pour garder la ville, il alla camper sur le bord de la rivière à cinq stades de Tarente. Cette rivière appelée par les uns Galèse, est appelée aussi par d'autres Eurotas, du nom du fleuve qui passe près de Lacédémone. Il y a plusieurs autres choses à Tarente et dans les environs auxquelles on donne le même nom qu'à Lacédémone, tant parce que ces peuples ne sont qu'une colonie des Lacédémoniens, que parce qu'ils conservent une étroite liaison avec cette république.
Quand la muraille fut entièrement achevée (ce qui arriva bientôt, à cause du zèle avec lequel les Tarentins y travaillaient, et du secours que leur donnaient les Carthaginois), Hannibal forma le dessein de prendre aussi la citadelle. Il avait déjà fait tous ses préparatifs pour le siège, lorsqu'un secours venu de Métaponte par mer dans la citadelle, enflamma de telle sorte le courage des Romains, que, faisant pendant la nuit une sortie, ils démolirent tous les travaux et renversèrent toutes les machines. Après cet échec, Hannibal perdit toute espérance de prendre d'assaut cette forteresse; mais comme il ne restait plus rien à faire à la muraille, ayant assemblé les Tarentins, il leur dit que dans les circonstances présentes ce qu'ils avaient de plus important à faire, était de se rendre maîtres de la mer; que l'entrée du port étant dominée par la citadelle, ils ne pouvaient ni employer de vaisseaux ni sortir du port; au lieu que les Romains recevaient par mer toutes leur munitions, que tant que les ennemis auraient cette facilité, il n'était pas possible d'assurer la liberté de la ville. Il montra ensuite aux Tarentins comment les Romains, privés des secours qui leur venaient par mer, seraient bientôt obligés de rendre les armes et d'abandonner la citadelle. Les Tarentins tombèrent assez d'accord que ce qu'il disait était juste, mais ils ne concevaient pas comment la chose pouvait s'exécuter, à moins qu'il ne parût une flotte de la part des Carthaginois; ce qui étant alors impossible, ils ne pouvaient deviner ce que voulait dire Hannibal. Mais quand ce général eut dit qu'ils n'avaient pas besoin des Carthaginois pour tenir la mer, ils furent bien plus surpris encore, et purent beaucoup moins entrer dans sa pensée.
Ce général avait remarqué que la place qui était entre la muraille que l'on venait de bâtir et la citadelle, et le long de laquelle on pouvait aller da port à la mer extérieure, était très commode pour transporter des vaisseaux du port au côté méridional de la ville. À peine eut-il fait cette ouverture aux Tarentins, que non seulement ils applaudirent à son dessein, mais encore qu'admirant ce grand homme ils reconnurent que rien n'était au dessus de sa pénétration et de son courage. C'est pourquoi ayant fait faire des chariots, le projet fut presque aussitôt mis à exécution qu'enfanté : tant on trouva d'ardeur dans le grand nombre des citoyens qui voulurent avoir part à cet ouvrage ! Les Tarentins ayant donc traîné des vaisseaux dans la mer extérieure et ayant par ce moyen coupé aux Romains tout secours étranger, poussèrent sans danger le siège de la citadelle; et Hannibal, après avoir laissé à Tarente assez de troupes pour la garder, se mit en marche avec son armée, arriva le troisième jour à son premier camp, et passa là tranquillement le reste de l'hiver. (DOM THUILLIER.)
IX.
Tiré de l'histoire du siège de Syracuse.
Mais ayant appris par un transfuge que les Syracusains célébraient une fête publique, et que tout en ménageant leurs vivres à cause de la disette où ils étaient réduits, ils faisaient cependant d'amples libations de vin, il résolut d'attaquer la ville. (Suidas in LitoÝw) SCHWEIGH.
Après la prise d'Épipolis, le courage et l'audace vinrent aux Romains. (Suidas in ƒEpipol‹w.) SCHWEIGH.
X.
C'est ainsi que la plupart des hommes peuvent le moins se résoudre à une chose pourtant bien facile, le silence. (In codice Urbin.) SCHWEIGH.
Ancara, ville d'Italie. Les habitants s'appellent Ancarites, selon Polybe, liv. III. (Stephan, Byzant.) SCHWEIGH.
Les Dassarites (ou plutôt Dassarètes), peuple d'Illyrie. (POLYBE, liv. VIII, ibid.)
Hyscana, ville d'Illyrie. (POLYBE, livre VIII, ibid.)
XI.
Les Tarentins, fatigués de l'excès de
leur bonheur, appelèrent Pyrrhus, roi d'Épire. Il est en effet dans
la nature de l'homme d'éprouver de la satiété quand il jouit d'une
grande liberté et d'un trop long pouvoir; bientôt il désire un
maître, qui devient un objet de haine aussitôt qu'on le rencontre;
car sa présence ne peut qu'empirer la situation. Les Tarentins en
firent la triste expérience :L'avenir nous semble toujours devoir
être meilleur que le présent. (ANGELO MAI, Scriptorum veterum nova
collectio, tom. II; JACOBUS GEEL, Polybii excerpta.)