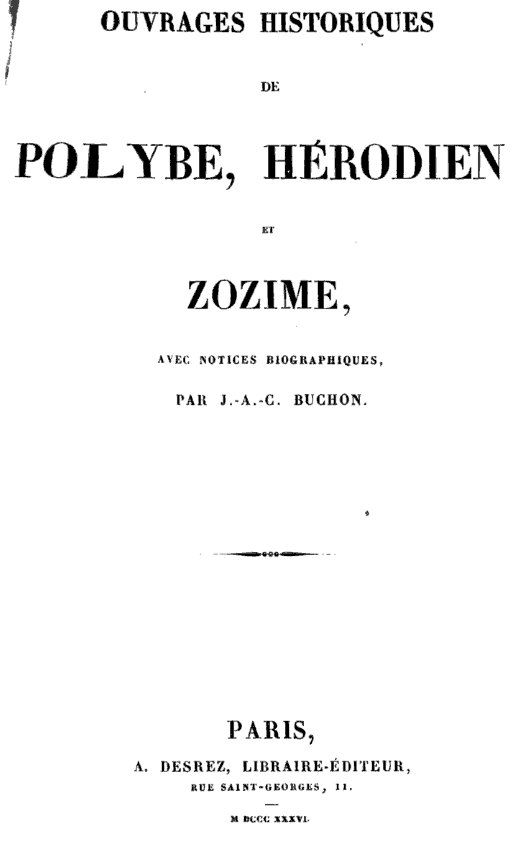
HÉRODIEN
HISTOIRE ROMAINE.
LIVRE II.
Traduction française : J. - A. - C. BUCHON.
autre traduction d'Halévy (+ texte grec)
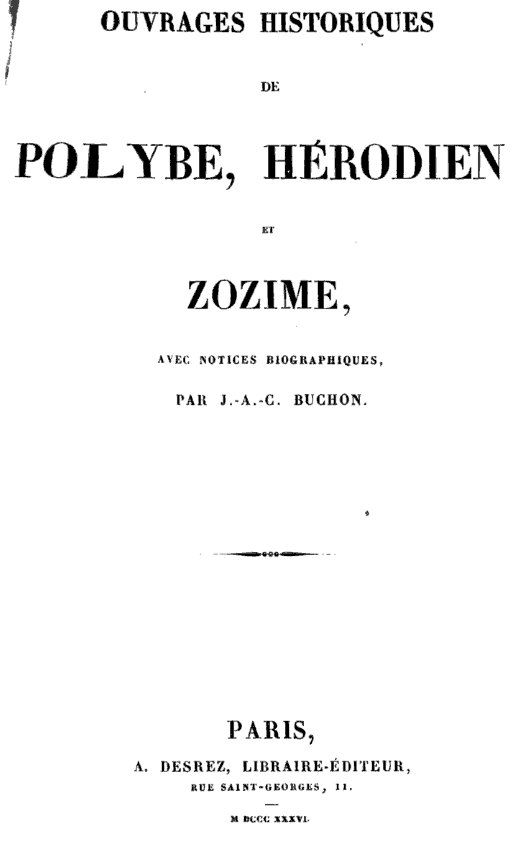
autre traduction d'Halévy (+ texte grec)
HISTOIRE ROMAINE
LIVRE DEUX.
M Les conjurés s'étant défaits de Commode de la manière que nous venons de rapporter dans le livre précédent, pensèrent d'abord à tenir cette affaire secrète, et, pour tromper les gardes de l'empereur, enveloppèrent son corps dans une méchante couverture, et le firent emporter, comme un paquet de vieilles hardes, par deux esclaves affidés. Ils passèrent au milieu des soldats : les uns, pris de vin, étaient ensevelis dans le sommeil; les autres, à moitié endormis, tenaient nonchalamment leurs hallebardes, et se mettaient peu en peine de visiter ce qui sortait de la garde-robe du prince, croyant que cela était sans conséquence. Les esclaves étant ainsi sortis du palais, mirent le corps sur un chariot et l'envoyèrent a Aristée. Marcia, Laetus et Électus, après avoir longtemps délibéré, conclurent qu'il fallait faire courir le bruit que Commode était mort d'apoplexie, que ses débauches fréquentes et excessives donneraient à cette nouvelle toute la vraisemblance nécessaire; mais qu'ils devaient avant toutes choses penser à leur sûreté, et faire eu sorte que le nouvel empereur leur fût redevable de son élection; qu'il fallait choisir un homme âgé, d'une modération et d'une prudence reconnues, qui fît respirer le peuple accablé sous la tyrannie du règne précédent. Après avoir jeté la vue sur plusieurs personnes, ils s'arrêtèrent à Pertinax. Il était originaire d'une province de l'Italie; la paix et la guerre avaient également fait paraître ses grandes qualités, il avait triomphé plusieurs fois du Nord et de l'Orient; c'était, de tous les anciens amis de Marc Aurèle, celui pour qui ce sage prince avait le plus d'estime et de considération et le seul qu'eût épargné Commode, peut-être parce que le mérite d'un si grand personnage avait retenu jusqu'alors ses ennemis, ou plutôt parce que sa grande pauvreté l'avait mis à couvert des poursuites des accusateurs et des soupçons du tyran ; car, entre ses autres vertus, ce qui lui faisait le plus d'honneur, c'était, qu'ayant passé par les plus grands emplois et les plus grandes dignités, il en était sorti aussi pauvre qu'il y était entré.
Laetus et Électus avec quelques-uns de leurs amis allèrent à sa maisons vers minuit, et éveillèrent son portier qui, leur ayant ouvert et ayant aperçu des soldais avec Laetus leur commandant, courut tout effrayé en avertir son maître. Il dit qu'on les fit entrer; qu'il voyait bien que son heure était venue; que ce coup m'avait rien qui le surprit. Quoiqu'il ne doutât point que ces officiers ne vinssent pour le tuer, il les vit toutefois paraître saris changer de visage, et se tenant sur son lit avec un air assuré :
« Je m'attendais, dit-il, toutes les
nuits à un pareil sort. Je restais seul des amis de Marc-Aurèle, et
je ne comprenais pas pourquoi son fils différait si longtemps de me
réunir à eux. Exécutez vos ordres, et délivrez-moi pour toujours
d'une incertitude plus cruelle que la mort même.
- N'ayez point, dit Laetus, des pensées si injustes sur nous, et
concevez des espérances qui répondent au mérite de vos grandes
actions. Nous sommes bien éloignés d'avoir aucun dessein contre
votre personne; nous venons au contraire implorer votre secours, et
nous remettre à vos soins de la liberté du peuple et du salut de
l'empire. Le tyran est mort, ses crimes ne sont pas demeurés
impunis; nous l'ayons prévenu, et nous avons sauvé notre vie en lui
ôtant la sienne. Il faut que sous preniez sa place ; votre autorité,
votre prudence, votre modération, votre âge même, tout vous en rend
digne. Le peuple a pour vous beaucoup l'affection, d'estime et de
respect; nous sommes persuadés qu'il nous avouera de notre choix, et
qu'il trouvera son avantage où nous cherchons notre sûreté.
- Pourquoi, reprit Pertinax, insulter un vieillard et vouloir éprouver sa constance? n'est-ce pas assez de me faire mourir, sans joindre la moquerie à la cruauté?
- Puisqu'il n'y a pas moyen de vous désabuser, dit Électus, lisez ce billet : vous connaissez la main de Commode; vous allez voir à quel péril nous avons été exposés, et vous serez convaincu que nous ne vous disons rien que de très sincère et de très véritable. »
Pertinax après cette lecture, revint enfin de sa méprise; il considéra que Laetus et Électus avaient toujours été de ses amis, et le détail qu'ils lui firent de la conjuration ayant achevé de le remettre, il s'abandonna à eux.
On fut d'avis d'aller d'abord trouver les soldats pour sonder leurs dispositions. Laetus, leur chef, à qui cette qualité donnait beaucoup de crédit parmi eux, se faisait fort de les gagner. Ils marchèrent tous ensemble vers le camp, la nuit étant fort avancée, et la fête des calendes de janvier prête à commencer. Ils répandirent en même temps dans la ville quelques-uns de leurs amis, qui publièrent partout que Commode était mort, et que Pertinax, choisi pour lui succéder, allait se faire reconnaître. A ce bruit, tout le peuple ne se possédant pas de joie, se mit à courir par les rues : chacun s'empressait de faire part de cette bonne nouvelle à ses amis, à ses voisins, et surtout aux personnes riches et de qualité., qui étaient les plus exposées à la cruauté et à l'avarice de Commode. On criait partout que ce tyran était mort; les uns l'appelaient le gladiateur, et d'autres lui donnaient des noms et des épithètes plus infâmes. On laissait paraître sans crainte ce qu'on n'avait tenu renfermé qu'avec beaucoup de peine, et l'on se dédommageait avec plaisir d'un silence forcé. On courait aux temples rendre aux dieux des actions de grâces. Mais la plus grande partie du peuple alla du coté du camp; les citoyens appréhendaient que les cohortes prétoriennes ne se portassent pas volontiers à reconnaître Pertinax, et ils se doutaient bien qu'un prince sage et modéré ne serait pas de leur goût : la tyrannie les accommodait mieux; c'était un temps très propre et très sûr pour exercer impunément leurs violences. Dans cette appréhension, le peuple se rendit en foule au camp pour soutenir Pertinax. Laetus et Électus le firent alors paraître, et le premier harangua ainsi ses soldats :
« Une apoplexie vient de vous enlever Commode; il ne s'en faut prendre de sa mort qu'à lui-même : il s'est moqué de l'avis que nous lui donnions tous les jours, et n'a rien diminué de ses excès : vous n'ignoriez pas ses débauches; le vin et les viandes l'ont à la fin suffoqué. Tous les hommes sont condamnés à mourir : ils ne meurent pas tous de la même manière ; ils vont par différentes voies au même terme, et celle-ci était marquée dans le destin pour l'empereur. En sa place, nous venons avec tout le peuple vous présenter un homme d'un âge vénérable, d'une probité reconnue et d'une expérience consommée dans la guerre. Vos vétérans, qui ont servi sous lui, peuvent vous en rendre compte; et vous avez vous-mêmes admiré ses vertu pendant longtemps qu'il a exercé la charge de gouverneur de Rome. La fortune vous offre moins un prince qu'un père; son élection ne sera pas agréable à vous seuls : ce sera aussi une heureuse nouvelle pour les soldats qui gardent les bords du Rhin et du Danube et les autres frontières de l'empire, car ils n'ont pas oublié ses plus beaux exploits. Nous n'en serons plus désormais réduits à acheter des Barbares une paix honteuse ; ils se souviennent encore de ses victoires, son nom seul les fera trembler. »
Le peuple impatient attendit à peine que Laetus eût achevé, et proclama tout d'une voix Pertinax empereur, l'appela père de la patrie, et y joignit beaucoup d'autres acclamations. Les soldats n'étaient pas si ardents, mais ils ne furent pas tout à fait les maîtres; ils étaient en petit nombre et sans armes, à cause de la fête; le peuple les environnait de tous côtes. Il fallut donc céder à la multitude; ils joignirent leurs voix à la sienne, et prêtèrent le serment de fidélité. On fit les sacrifices accoutumés, et ils reconduisirent tous ensemble, sur la fin de la nuit, le nouvel empereur au palais.
Il n'était pas encore bien revenu de son étonnement, et quoiqu'il eût beaucoup de fermeté, il sentit quelque trouble s'élever dans son esprit. Ce n'était point pour sa vie qu'il appréhendait, il avait soutenu sans pâlir de bien plus grands périls : mais il ne savait encore que penser d'un changement si subit; il craignait la jalousie de quelques nobles sénateurs, et s'imaginait qu'ils ne souffriraient jamais que l'empire passât des mains de Commode dans les siennes. Son prédécesseur était d'une maison fort illustre; pour lui, il avait à la vérité toutes les qualités qui forment les grands princes, tout le monde lui rendait cette justice, niais sa naissance ne répondait pas à son mérite, et il voyait au-dessus de lui beaucoup de patriciens. Dès que le jour parut, il se rendit au sénat. Il ne voulut point qu'un portât devant lui le feu ni les marques de sa dignité jusqu'à ce que cette compagnie eût confirmé son élection. Mais sitôt qu'il se montra, ils le saluèrent avec de grandes acclamations, l'appelant Auguste et empereur. Il refusa d'abord ces honneurs, comme trop exposés à l'envie et beaucoup au-dessus de sa naissance : il s'excusa aussi sur sa vieillesse, et ajouta qu'ils avaient parmi eux plusieurs patriciens qui rempliraient mieux que lui cette place. Il prit en même temps Glabrion par la main, et voulut le faire asseoir sur la chaire des empereurs. C'était de tous les sénateurs celui dont la noblesse était la plus ancienne; il en faisait remonter l'origine jusqu'à Énée; il était de plus consul pour la seconde fois.
« Puisque je suis, dit ce patricien, celui que vous croyez le plus digne de cet honneur, je suis le premier à vous le céder, et je me joins à tout le sénat pour vous prier d'accepter l'empire. »
Ils le pressèrent tous de la même manière. Enfin, après s'être fait longtemps prier, il se rendit; et ayant pris séance, il les harangua en ces termes :
« Le choix que vous avez fait de moi préférablement à tant de patriciens, et l'ardeur avec laquelle vous m'avez porté sur le trône, n'ont point un air de flatterie, et ce sont autant de preuves certaines de votre affection. Ces marques d'estime pourraient donner à d'autres plus d'assurance; ils accepteraient sans inquiétude les offres que vous venez de me faire; ils auraient quelque raison de bien augurer d'un règne dont les commencements sont si heureux, et pourraient se promettre de trouver dans vos dispositions de grandes facilités pour le gouvernement. Mais plus toutes ces choses sont grandes, plus elles me sont avantageuses, plus je ressens l'honneur que vous me faites, plus aussi je conçois les obligations qu'il m'impose, et combien il me sera difficile d'y répondre dignement. Lorsqu'une personne puissante paie de petits services par des bienfaits considérables, souvent on lui tient un grand compte d'une chose qui lui a peu coûté; et souvent aussi, lorsqu'une autre, après avoir reçu de grands services, n'en rend que de médiocres, on attribue à son peu de reconnaissance et de sensibilité ce qui ne vient que de l'impuissance où elle est d'en rendre de plus grands. Je me trouve dans cet embarras; je sens bien qu'il ne me sera pas aisé de remplir l'idée que vous avez de moi, et de me rendre digne de tant d'honneurs; car la gloire du trône n'est point dans son élévation, mais dans le mérite de celui qui en sait soutenir et rehausser l'éclat. L'horreur qu'on a des maux passés fait concevoir plus facilement de bonnes espérances pour l'avenir; on se persuade aisément ce que l'on souhaite. On n'oublie guère les injures; l'esprit aigri par ses malheurs en conserve longtemps le souvenir; mais on jouit des biens sans réflexion, et, quand on ne les possède plus, on en perd bientôt la mémoire. La douleur fait dans l'âme de plus vives impressions que le plaissir, et nous sentons beaucoup plus le malheur de la servitude que le bonheur de la liberté. Lorsqu'on nous laisse jouir en repos de nos biens, nous regardons cet avantage comme un droit naturel dont nous ne devons avoir obligation à personne; mais si on nous enlève ce que nous possédons, cette injustice nous révolte d'autant plus que le bienfait opposé nous touchait peu. S'il arrive quelque changement avantageux à la république, personne ne le met sur son compte; car on ne s'intéresse point au bien général de l'état, quoiqu'on en profite. Si au contraire on fait la moindre perte en particulier, on ne la croit jamais assez compensée par la tranquillité elle bonheur de tous les citoyens. Ceux qui, sous la tyrannie, s'accommodaient de ces largesses faites avec tant de profusion et si peu de discernement, lorsque sous un nouveau règne ils voient des fonds plus petits distribués avec plus de justice et de prudence, traitent cette sage dispensation d'avarice sordide, sans faire réflexion que les tyrans ne sont prodigues que du bien de leurs peuples, et qu'ils n'enrichissent les uns que des dépouilles des autres. Mais les princes qui ne font point de largesses mal à propos et qui ne récompensent que le mérite, ne grossissent point leur épargne aux dépens des malheureux, et bien loin de fournir aux plaisirs et aux débauches de leurs favoris, leur frugalité sert elle-même d'exemple à toute leur cour. J'espère, que toutes ces réflexions vous feront sentir le poids que j'ai à soutenir, que vous m'aiderez de vos conseils, et que vous partagerez mes soins. Nous ne sommes plus sous une injuste monarchie; il faut faire revivre la république et que le sénat rentre dans ses droits. Voilà mes intentions : vous pouvez en faire part au peuple : je ne doute point que vous n'en conceviez de bonnes espérances. »
Ce discours de Pertinax fut repu des sénateurs avec beaucoup d'acclamations et de louanges; ce rayon de liberté releva un peu leur esprit abattu sous une longue servitude. Ils lui firent de grands remerciements, et, après lui avoir rendu toute sorte d'honneurs, l'accompagnèrent au Capitole, et dans tous les temples, où il offrit des sacrifices pour ta prospérité de son règne.
Quand on eut appris le détail de ce qu'il avait dit dans le sénat, et qu'on eut vu les letIres qu'il écrivit au peuple, on en eut une joie incroyable: on se promit toute sorte de bonheur sous un prince d'un si grand mérite et d'une modération si peu ordinaire. Il commença par faire défense aux soldats prétorien d'insulter et de maltraiter les bourgeois, et tacha de rétablir partout l'ordre que la licence du règne passé avait banni. Il était d'un abord aisé et engageant, et donnait audience au moindres citoyens avec beaucoup de bonté. Il se proposait dans toutes ses actions Marc-Aurèle pour exemple; c'était pour les vieillards une grande joie de retrouver en lui ce bon prince: les autres, qui avaient gémi longtemps sous la tyrannie, goûtaient d'autant plus la douceur d'un règne paisible, qu'ils ne l'avaient jamais éprouvée, et ils étaient pleins de reconnaissance et d'attachement pour celui à qui ils en étaient redevables. Lorsqu'on eut appris dans les provinces tout ce qu'il avait fait à Rome, les peuples, les soldats et les alliés du peuple romain l'élevèrent jusqu'aux cieux et le comblèrent de louanges. D'un autre côté, les Barbares qui avaient secoué le joug, ou qui pensaient à se révolter, changèrent de résolution; son nom était redoutable parmi eux ; ils se sentaient encore de leurs pertes et de ses victoires; ils savaient d'ailleurs qu'il était d'une équité et d'une fidélité inviolables qu'il ne faisait jamais le premier des actes d'hostilité, et qu'il était également éloigné de la cruauté et d'une fausse et lâche condescendance. Tous ces motifs les engagèrent à se soumettre à lui volontairement. On vit venir en même temps de tous côtés des ambassades à Rome pour féliciter l'empereur sur son élection, et le peuple sur le bonheur qu'il avait de vivre sous un si grand prince. Tout le monde, en particulier et en général, était donc satisfait du nouveau gouvernement; mais ce qui faisait la félicité publique ne pouvait accommoder les soldats des gardes prétoriennes. Les rapines et les violences leur étaient interdites; on les avait assujettis à une discipline plus exacte; ils prétendaient qu'on les méprisait; que sous prétexte de les ranger à leur devoir, on ne cherchait qu'a les mortifier et à leur ôter leur liberté. Ils voyaient bien qu'ils trouveraient mieux leur compte dans le trouble d'une domination tyrannique que dans la tranquillité présente. Ils devinrent peu à peu moins soumis, leurs officiers n'en venaient à bout qu'avec beaucoup de peine; mais les choses allèrent bientôt plus loin. Les dieux ne laissèrent que deux mois à l'empire un prince qui pendant ce peu de temps lui avait déjà fait de grands biens, et qui lui donnait de plus grandes espérances. La fortune jalouse ne lui permit pas d'exécuter les admirables projets qu'il avait formés pour le bonheur de ses peuples.
D'abord, comme il y avait dans l'Italie et dans les provinces beaucoup de terres incultes, il fit une déclaration par laquelle il en abandonnait la propriété à tous ceux qui voudraient les faire valoir, sans qu'on pût jamais les troubler dans leur possession, quand même elles feraient partie des revenus de l'empire : il les exempta de plus de tout subside les dix premières années. Il ne voulait point que dans les registres publics on mit sous son nom les terres du domaine ; il disait qu'elles n'appartenaient point au prince en particulier, mais au peuple et à tout l'état. Il retrancha tous les impôts que l'avarice des tyrans avait inventés, et qu'ils avaient mis sur les passages des rivières, sur les ports et sur les grands chemins. Par ces sages règlements, il commençait à faire revivre l'ancienne liberté ; mais il n'en devait pas demeurer là, et l'on avait lieu de tout espérer de ces heureux commencements. Il avait chassé de la ville tous les délateurs, et ordonné qu'on les poursuivrait, quelque part qu'ils fussent, pour leur faire leur procès, afin que dans la suite on ne fût plus exposé à la calomnie, ni inquiété par des accusations sans fondement. Il fit paraître tant de modestie, qu'il ne voulut jamais souffrir que son fils, qui avait déjà dix ou douze ans, vînt loger dans le palais; il le fit demeurer dans la maison paternelle ; il allait, comme auparavant, au collège avec ses compagnons, sans aucune distinction et sans suite; il n'était exempt d'aucun des exercices ordinaires, et on ne reconnaissait par aucune marque de faste et d'ostentation qu'il fût le fils de l'empereur.
Cette modestie et l'ordre qui régnait partout étaient insupportables aux soldats; ils regrettaient le règne de Commode, sous lequel ils exerçaient impunément toute sorte de violences et de brigandages. Au milieu de leurs débauches, ils prirent la résolution de se défaire de Pertinax, et de se donner un empereur à leur fantaisie, qui ne mit aucun frein à leur licence. Leur dessein fut aussitôt exécuté que conçu; en plein midi, lorsqu'on y pensait le moins, et que chacun était retiré chez soi pendant la grande chaleur, ils coururent au palais comme des furieux, l'épée nue et la pique baissée. Les officiers de l'empereur, épouvantés d'une émeute si soudaine, se trouvant en petit nombre et sans armes, prirent la fuite. Quelques uns, plus fidèles et moins timides, allèrent avertir Pertinax, et lui conseillèrent de se sauver et de se jeter entre les bras du peuple. Ce parti, quoique le plus sûr, lui parut peu honnête et trop indigne de son rang, de son caractère et de la réputation qu'il s'était faite : il ne pensa donc ni à fuir, ni à se cacher; mais allant au devant du péril, il s'avança pour parler aux soldats il espérait de réprimer par sa présence cette fougue insensée. Il parut hors de sa chambre, et leur demanda quelle raison ou plutôt quelle fureur les animait. Il garda sa gravité ordinaire, ne perdit rien de sa majesté, et sans pâlir, sans trembler, sans prendre un ton de suppliant, il leur dit :
« Quel est votre dessein, et que prétendez-vous faire? Tuer un vieillard qui n'a que trop vécu, et qui a acquis assez de gloire pour n'avoir pas de regret de la vie? aussi bien faudra-t-il toujours en venir à ce terme, et je n'en suis pas fort éloigné. Mais que-vous, qui êtes commis à la garde du prince, qui êtes chargés de sa conservation et de sa vie, qui en répondez à tout l'empire; que vous, qui êtes armés pour sa défense, vous deveniez ses assassins; que vous trempiez vos mains dans le sang, non d'un simple citoyen, mais de votre empereur, c'est un attentat qui peut avoir pour vous d'aussi dangereuses suites qu'il est en lui-même horrible et inouï ! Je ne sache point que vous ayez aucun sujet de vous porter à ces extrémités. Si c'est la mort de Commode qui vous chagrine, prenez-vous en à la nature, qui ne dispense personne de ce tribut: si vous prétendez qu'il a été empoisonné. il est toujours sûr que je suis très innocent de ce crime; vous savez que je n'ai pas été plus instruit que vous de toute cette affaire, et que les soupçons qu'on a pu former ne sont jamais tombés sur moi. Au reste, vous ne perdez rien à sa mort, on ne prétend point vous retrancher aucune des choses que l'équité et la bienséance permettent qu'on vous laisse, et on vous accordera tout ce que vous demanderez sans vouloir l'emporter de force et aux dépens des citoyens. »
Ce discours eu avait déjà ébranlé un grand nombre, et quelques-uns s'étaient retirés, frappés par cet air de majesté que sa vieillesse augmentait; mais quelques autres, plus furieux, le tuèrent comme il achevait de parler.
D'abord qu'ils eurent consommé leur crime, ils en appréhendèrent les suites. Ils ne doutaient point que le peuple ne fût fort affligé de cette perte; et pour prévenir sa vengeance, ils s'enfuirent au plus tôt dans leur camp, en fermèrent les portes, et se mirent eu garde sur le rempart et sur les tours. Ainsi finit Pertinax, que ses vertus et ses grandes actions rendaient digne d'une meilleure destinée. Le peuple, à la nouvelle de sa mort, fut étrangement troublé; il courait dans les rues comme des furieux; il allait de tous côtés cherchant les meurtriers, quoiqu'il ne pût ni les trouver ni se venger. Les sénateurs étaient encore dans une plus grande consternation; ils perdaient un père, ils appréhendaient de retomber sous un tyran et voyaient bien que c'était le dessein des soldats. Après deux jours de tumulte, les simples citoyens, pensant chacun à sa sûreté particulière, se tinrent en repos dans leurs maisons; mais les personnes de qualité et de distinction se retirèrent dans leurs terres les plus éloignées de Rome, pour n'être point exposées aux dangers qu'une révolution traîne après elle. Les soldats voyant que le peuple s'était calmé et qu'il ne pensait plus à venger la mort de Pertinax, ne laissèrent pas de se tenir toujours enfermés dans leur camp; mais ils font monter sur les murs ceux qui pourraient se faire entendre de plus loin, et les fait crier que l'empire était à vendre au plus offrant, qu'ils en mettraient en possession celui qui aurait de plus grandes sommes à leur donner, et le conduiraient avec sûre garde à son palais. Cette proposition ne tenta pas ce qu'il y avait dans le sénat de graves personnages et de riches patriciens, triste et petit reste échappé à la tyrannie et à l'avarice de Commode.
On vint avenir Julien de la déclaration des soldats, pendant qu'il soupait et faisait la débauche à son ordinaire. Il avait été consul et passait pour avoir des richesses immenses. Sa femme, sa fille et tous ses parasites lui conseillèren de se lever au plus tôt de table et de courir au camp pour savoir la vérité de cette affaire. Ils l'accompagnèrent, et l'exhortaient pendant le chemin à ne pas manquer cette occasion qui s'offrait d'elle-même ; que l'empire étant à vendre, personne ne pouvait le lui disputer. Quand il fut au pied du mur, il dit aux soldats qu'il avait dans sa maison des coffres plein d'or et d'argent qu'il était prêt à répandre. En même temps un autre consulaire nommé Sulpicien, qui était gouverneur de la ville et beau-père de Pertinax, vint aussi faire ses offres ; mais cette alliance le rendit suspect aux soldais : ils appréhendèrent qu'il ne leur dressât quelque piège, et ne cherchât les moyens de se venger la mort de son gendre. Ils tendirent donc une échelle à Julien pour le passer dans le camp, car ils ne voulurent pas ouvrir les portes qu'ils n'eussent fait leurs conditions. Il promit d'abord de rétablir la mémoire de Commode, de lui faire décerner les honneurs que le sénat lui avait ôtés, et de relever ses statues; en second lieu, de leur rendre la première licence dont ils jouissaient sous son règne, et enfin de leur donner plus d'argent qu'ils n'oseraient en demander et n'en pourraient prétendre. Charmés de ces promesses, ils le proclamèrent aussitôt empereur avec le surnom de Commode, dont ils remirent les images à leurs enseignes. Après avolr fait dans le camp les sacrifices accoutumés, il en sortit avec une plus forte escorte qu'à l'ordinaire, et il avait sans doute sujet d'appréhender quelque émeute. Les soldats marchaient en ordre de bataille, afin de pouvoir tenir ferme si on les attaquait; ils avaient au milieu d'eux leur nouvel empereur; ils portaient leurs piques hautes et se couvraient de leurs boucliers, dans l'appréhension qu'on ne jetât sur eux des pierres de dessus les toits. Mais le peuple ne fit aucun mouvement ; il se contenta de charger Julien d'injures, au lieu des acclamations ordinaires, et de lui reprocher avec mépris d'avoir acheté l'empire qu'il n'avait pu mériter.
Cet attentat, qui réussit aux soldats mieux qu'ils ne l'avaient espéré, les gâta entièrement; et cette cupidité insatiable qui les domine encore prit de là naissance. La mort de Pertinax étant demeurée impunie, et l'empire ayant été mis à l'encan à la vue de tout le monde, sans que personne osât lui sauver cette infamie, les soldats, devenus insolents par la lâcheté des Romains, furent plus licencieux que jamais. Ils commencèrent à mépriser des princes qui étaient leur ouvrage; ils ne reconnurent plus une autorité si avilie, et n'épargnèrent pas le sang quand il fut question d'assouvir leur convoitise. Au reste, le nouvel empereur passait tout son temps dans les plaisirs, négligeait entièrement les affaires, et s'abandonnait à la mollesse et à un honteux repos. Il avait de plus trompé les gardes prétoriennes, étant hors d'état de leur payer les grandes sommes qu'il leur avait promises; car il n'était pas si riche qu'on le pensait et qu'il l'avait voulu faire croire. D'ailleurs, Commode avait épuisé l'épargne par ses débauches et ses folles dépenses. Les soldats étaient donc piqués de ce qu'on s'était moqué d'eux; et le peuple, profitant de leur aigreur, faisait paraître ouvertement le mépris qu'il avait pour Julien, jusqu'à lui reprocher, lorsqu'il passait, ses infâmes raffinements d'impudicité. Ils ne l'épargnaient pas même dans le cirque et aux spectacles; ils demandaient tout haut Niger pour qu'il vînt au plus tôt venger l'honneur de l'empire et les délivrer des indignités qu'ils souffraient.
Ce Niger avait été consul, et était alors gouverneur de Syrie, province des plus considérables, et dont la Phénicie et tout le pays qui s'étend jusqu'à l'Euphrate dépendaient. Il était d'un âge avancé, et avait exercé avec honneur les premières charges de l'état. Il passait pour un homme modéré, et l'on disait qu'il tenait assez de Pertinax : c'était ce qui lui attirait l'affection du peuple. On n'entendait que son nom dans les assemblées. Pendant qu'on insultait Julien, et qu'on lui disait des injures en sa présence, tous les vaux allaient vers Niger. Ils lui donnaient toutes les qualités attachées à la souveraine puissance, et les places publiques retentissaient d'acclamations en son honneur. Il en fut informé, et conçut que ces avances lui seraient très favorables. Il voyait que les cohortes prétoriennes ne soutenaient plus Julien, et que le peuple le jugeait indigne du trône où il était monté par des voies si honteuses. Il fut donc tenté de prendre une place qu'on lui offrait. Il faisait venir chez lui les uns après les autres des officiers généraux, des tribuns, et même quelques soldais; il leur communiquait les nouvelles qu'il recevait de Rome, afin qu'elles se répandissent plus vite dans toutes les armées et dans les provinces. Il espérait attirer par ce moyen dans son parti tout l'Orient, lorsqu'on saurait qu'il ne se portait point de lui-même, et par une ambition téméraire, à envahir l'empire, mais qu'il ne faisait que céder aux empressements du peuple romain. Ces nouvelles firent l'effet qu'il s'en était promis; on se rendait de tous côtés auprès de lui, et tout le monde le conjurait de prendre en main le gouvernement. Les Syriens sont naturellement légers et amateurs de la nouveauté; ils avaient de plus une affection particulière pour Niger, qui gouvernait sa province avec beaucoup de douceur, et leur donnait souvent des jeux, des spectacles et autres semblables divertissements dont ces peuples ne se lassent jamais. Ceux d'Antioche, surtout, passent presque toute l'année en fêtes et en réjouissances dans leur ville, qui est fort riche et fort peuplée. Le gouverneur entretenait cette passion, et, pour les gagner, fournissait à leurs plaisirs.
Quand il vit les choses si avancées, il crut qu'il était temps de se déclarer; il fit assembler les soldats dans la place d'Antioche; le peuple s'y étant aussi trouvé, il monta sur un tribunal et les harangua en ces termes :
« J'ose m'assurer que vous connaissez déjà ma modération, et l'éloignement naturel que j'ai pour toutes les entreprises hasardeuses. Ce ne sont ni des vues particulières, ni des espérances frivoles qui me font faire cette démarche mais je me rends aux prières et aux pressantes sollicitations du peuple romain qui me conjure de lui tendre une main salutaire, et de sauver l'honneur de l'empire si indignement prostitué. Dans une occasion moins favorable et moins juste, mon dessein passerait pour une témérité et pour un attentat; mais dans la conjoncture présente, où les voeux du peuple m'appellent et me convient, ce serait une lâcheté et une espèce de trahison de ne les pas écouter. Je vous ai donc assemblés pour prendre vos avis, je veux me servir de vos conseils dans un affaire si délicate; si elle me réussit, je partagerai avec sous mon bonheur. Il ne s'agit point ici d'une médiocre fortune, et nos espérances sont aussi grandes qu'elles sont réelles. C'est Rome même, le centre de l'empire qui nous appelle, et le trône chancelant et mal occupé nous attend pour le remplir. Les dispositions favorables du peuple, le peu de résistance de la part de notre compétiteur, tout nous répond du succès. Ceux qui viennent d'Italie assurent que les soldats mêmes qui ont vendu l'empire à Julien ne le soutiennent plus, et qu'il ne peut compter sur eux depuis qu'il leur a manqué de parole. Voilà où en sont les choses; c'est à vous maintenant à me déclarer vos sentiments. »
D'abord qu'il eut achevé, les soldats et le peuple le proclamèrent empereur, le couvrirent d'une robe de pourpre, et après avoir préparé à la hâte les autres ornements impériaux, ils firent porter le feu devant lui, le conduisirent en cérémonie dans tous les temples d'Antioche, et le ramenèrent dans sa maison, autour de laquelle on mit toutes les marques qui font reconnaître les palais des princes. Lorsqu'on eut appris ce qui s'était passé à Antioche, toutes les provinces de l'Orient s'empressèrent à l'envi de lui venir rendre hommage, et l'on voyait arriver de toutes les villes des députés, comme vers un prince déjà reconnu. Les satrapes mêmes qui habitent au-delà de l'Euphrate et du Tigre l'envoyèrent féliciter et lui offrirent du secours. Il fit à leurs ambassadeurs de grands présents, et les chargea de remercier leurs maîtres des offres qu'ils lui faisaient, disant qu'il n'avait point besoin de troupes et prétendant se mettre en possession de l'empire, sans répandre de sang. Ces premiers succès le jetèrent dans une nonchalance pernicieuse; il croyait déjà son trône affermi; il ne pensait qu'a se divertir, et s'amusait à donner des fêtes au peuple d'Antioche, au lieu d'aller d'abord à Rome, ce qui était de la dernière conséquence. Il n'écrivit pas même aux armées d'Illyrie qu'il aurait dû aller joindre, et qu'il lui était important de gagner. Il s'imaginait qu'elles suivraient le parti de Rome et de l'Orient, et gâtait ainsi ses affaires par un excès de méfiance. Cependant le bruit de ce qui s'était passé vint jusqu'à ces armées, et passa dans toutes celles qui campent sur les bonis du Rhin et du Danube.
Les armées de Pannonie avaient pour général Sévère, Africain de nation, homme entreprenant et expérimenté, d'un naturel violent, d'une vie dure et laborieuse, infatigable dans les travaux, ardent à former des desseins . et aussi prompt à les exécuter. Lorsqu'il eut appris que l'empire, sans maître légitime, était exposé en proie à tons ceux qui osaient y prétendre, la faiblesse de Julien et la négligence de Niger, qui les rendaient tous deux également méprisables, le firent penser à s'emparer d'une place si mal occupée et encore plus mal défendue. Son ambition était flattée par des songes, des oracles et autres présages dont on ne reconnaît la vérité qu'après l'événement. Il les a rapportés la plupart dans sa vie : ainsi je ne parlerai que du dernier, qui fut le principal, et sur lequel il compta le plus. Le jour qu'on eut la nouvelle que Pertinax avait été élevé à l'empire, Sévère ayant offert les sacrifices ordinaires et prêté le serment de fidélité, se retira sur le soir dans sa maison, et s'étant endormi, il vit en songe un cheval haut et vigoureux. richement enharnaché, et qui passait dans la rue Sacrée; mais lorsqu'il fut à l'entrée du marché où s'assemblait le peuple dans les temps de la république, il jeta par terre l'empereur, et, présentant sa croupe à Sévère qui était à coté du prince, le porta sans broncher jusqu'au milieu de la place, où tout le peuple le regardait avec respect et étonnement. On voit encore dans te même endroit un relief de bronze sur lequel ce songe est représenté.
Sévère, encouragé par ces présages, se persuadant que les dieux l'appelaient à l'empire, résolut de souder les soldats. Il s'entretenait chez lui avec les chefs des légions, les tribuns et les autres officiers principaux, de l'état présent des affaires. Il disait que l'empire était à l'abandon, et qu'il ne se trouvait personne qui eût ni assez de courage ni assez de prudence pour le gouverner. Il s'emportait contre les soldats prétoriens qui avaient violé leur serment de fidélité et trempé leurs mains dans le sang de leur prince, sans qu'on eût osé vengé la mort d'un si grand personnage. Ces discours faisaient plaisir aux soldats d'Illyrie qui avaient servi sous Pertinax du temps de Marc-Aurèle, et qui avaient tant de fois partagé avec lui l'honneur de ses triomphes. Pendant tout le temps qu'il les avait commandés, on n'avait pas moins admiré sa douceur envers les soldats que sa valeur et son intrépidité dans les batailles. Ils avaient sa mémoire en vénération, et étaient pleins de ressentiment contre ceux qui leur avaient enlevé un si bon prince. Sévère, profitant de ces dispositions, les conduisait à ses fins, et paraissait indifférent pour toute autre chose que pour venger un sang si cher aux soldats. Ils le croyaient bonnement; car autant qu'ils ont la taille avantageuse, et qu'ils portent au combat d'ardeur et d'intrépidité, autant ont-ils l'esprit épais et peu propre à démêler les véritables sentiments de ceux qui ont quelque dissimulation. Étant donc pleinement convaincus que Sévère ne pensait à rien moins qu'à sa propre élévation, ils se donnèrent à lui et le proclamèrent empereur. Lorsqu'il se fut assuré des armées d'Illyrie, il députa vers les nations voisines et vers tous les princes da nord qui sont soumis aux Romains, et les attira dans son parti à force de promesses. Personne ne savait mieux que lui l'art de dissimuler : il ne découvrait jamais ce qu'il pensait, disait souvent tout le contraire, et ne se faisait point un scrupule de violer ses serments, lorsqu'il y trouvait sort avantage. Il écrivit aux gouverneurs des provinces, et à ceux qui commandaient les troupes, des lettres insinuantes et artificieuses qui les gagnèrent facilement; il prit le surnom de Pertinax qui n'était pas moins agréable au peuple qu'aux armées, et s'étant, par ces justes mesures, aplani le chemin à l'empire, il fit assembler. ses soldats et leur parla de cette sorte :
« L'horreur que vous avez eue de l'attentat des cohortes prétoriennes est une preuve de votre fidélité pour vos princes et de votre religion pour les dieux, au nom desquels vous avez prêté le serment. Je ne m'étais jamais attendu à me voir a la place où vous m'avez mis; mon attachement pour mes légitimes souverains m'avait empêché d'y prétendre, et je ne souhaite maintenant que de seconder votre ardeur et de servir votre vengeance. Il ne faut pas laisser plus longtemps dans l'opprobre l'empire, dont l'éclat avait été si bien soutenu jusqu'à présent par ceux qui en ont eu l'administration. Car, si Commode n'a pas marché sur les traces de ses prédécesseurs, sa jeunesse l'excusait en quelque sorte; la mémoire de son père contrait ses défauts, et son illustre naissance les rendait plus supportables. On avait pour lui plus de compassion que de haine; nous rejetions ses fautes sur ses flatteurs et sur les ministres infâmes de ses voluptés. La souveraine puissance passa ensuite à ce vieillard vénérable dont la valeur et la modération seront toujours présentes à notre esprit. Les soldats prétoriens ne purent souffrir tant de vertus et osèrent porter sur lui leurs mains sacrilèges. Ils ont vendit à vil prix ce vaste empire qui s'étend sur la terre et sur la mer, mais ils ont été mal payés de leur perfidie; celui avec qui ils avaient si honteusement traité leur a manqué de parole, et ils l'ont abandonné au mépris et aux insultes du peuple. Quand ils lui seraient encore fidèles, ils n'en seraient guère plus en sûreté. Ce ne sont que des soldats de parade et de cérémonie; leur nombre et leur courage ne méritent pas d'être comparés au vôtre. Vous êtes accoutumés à voir l'ennemi; vous soutenez les plus longues marches; vous souffrez avec la même patience le froid et le chaud; vous passez tous les jours sur des fleuves couverts de glace qu'il vous faut rompre pour trouver à boire; les exercices de la chasse contribuent même à entretenir votre valeur; enfin il ne vous manque rien de ce qui fait les bonnes troupes et rend les armées invincibles : car, autant la mollesse affaiblit le soldat, autant le travail le rend vigoureux. Les cohortes prétoriennes, nourries dans le luxe et dans les délices de Rome, bien loin d'en venir aux mains avec vous, ne pourront pas même soutenir votre présence et ces cris que vous jetez à l'approche de l'ennemi. Si quelqu'un croit les forces de Syrie plus redoutables, il en sera bientôt désabusé, en considérant que Niger n'ose s'avancer vers Rome ni faire aucun mouvement. Il se trouve bien dans une ville voluptueuse, et, s'abandonnant au plaisir, il jouit par provision des honneurs d'une autorité mal affermie. Les Syriens, et surtout ceux d'Antioche, accoutumés à la raillerie et à se divertir aux dépens des simples, affectent pour lui de grands empressements; les autres provinces, ne voyant personne capable de gouverner, reconnaissent, en attendant mieux, le premier venu; mais lorsqu'ils apprendront que les armées d'Illyrie, d'un commun accord, ont choisi un empereur, et qu'ils m'entendront nommer (car je ne leur suis pas inconnu depuis que j'ai commandé avec quelque honneur les troupes de ces quartiers), ils n'auront à me reprocher, comme aux deux autres, ni lâcheté ni négligence, et n'étant ni si grands, ni si aguerris, ni si expérimentés que vous, ils n'oseront éprouver vos forces et votre vain. Allons d'abord à Rome : maîtres du siège et du centre de l'empire, rien ne pourra nous arrêter. Les oracles des dieux et la terreur de vos armes me répondent du succès. »
Ce discours de Sévère fut suivi des acclamations des soldats qui l'appelaient Auguste et Pertinax, lui faisaient mille protestations de fidélité et de zèle, et l'assuraient qu'il étaient prêts à le suivre. Sans perdre de temps il leur commanda de s'armer le plus à la légère qu'ils pourraient, et après leur avoir fait distribuer des vivres, il se mit en chemin. Il s'avançait avec une vitesse incroyable, soutenant sans peine la fatigue des plus longues marches, ne s'arrêtant nulle part, et ne donnant de repos à ses troupes qu'autant qu'il leur en fallait pour reprendre de nouvelles forces Il partageait avec elles tous les travaux, n'avait pas une meilleure tente, mangeait du même pain, et ne se distinguait en rien du simple soldat. Il augmentait par ces manières l'affection qu'ils lui portaient; il les piquait d'honneur, était le premier à tout; de sorte qu'ils auraient eu honte de ne pas suivre avec ardeur un tel exemple. Ayant traversé la Pannonie en peu de jours, il arriva sur les confins de l'Italie. Il avait prévenu la renommée, et on le vit paraître qu'on ne savait pas encore qu'il fut en chemin. Les villes d'Italie furent fort épouvantées à la vue d'une armée si nombreuse. On n'entendait plus dans ce pays le bruit des armes, et ses habitants, passaient leur vie dans une profonde paix à cultiver leurs terres. Pendait les temps de la république, lorsque le sénat nommait les généraux d'armées, tous les peuples de l'Italie allaient à la guerre; et ce sous eux qui, portant leurs armes victorieuses chez les Grecs et chez les Barbares, poussèrent leurs conquêtes jusque dans les pays les plus reculés et se rendirent les maîtres du monde. Mais Auguste, ayant changé la forme du gouvernement, ôta les armes à ces peuples, et, les laissant languir dans le repos, il prit a sa solde des étrangers qu'il lit camper sur les frontières, pour tenir en bride les Barbares. D'autre part, la largeur des fleuves, leur profondeur, la hauteur des montagnes, les vastes solitudes qui bornaient l'empire, lui servaient de retranchements. Quand on vit donc l'armée de Sévère répandue dans les campagnes, ce spectacle si nouveau jeta l'alarme partout; et bien loin de lui fermer les portes, on venait au devant de lui avec des branches de laurier. Il ne s'arrêtait que pour faire des sacrifices et pour haranguer les peuples, ne pensant qu'à gagner Rome en diligence.
Julien ayant appris ces nouvelles, ne savait quelles mesures prendre; il n'ignorait pas le nombre et la force des troupes d'Illyrie; il ne pouvait se fier, ni au peuple qui le baissait, ni aux soldats qu'il avait trompes. Il amassa tout son argent, celui de ses amis, dépouilla les temples, et essaya de faire revenir les prétoriens par ses largesses. Mais eux, sans lui en tenir compte, prétendaient que ce n'était point une gratification, et qu'on ne leur avait payé que ce qu'on leur devait. Ses amis lui conseillèrent d'aller au devant de l'ennemi et de s'emparer du passage des Alpes. Elles forment ensemble comme un mur fort élevé qui sert de rempart â l'Italie; la nature, outre les autres avantages qu'elle a donnés à cette heureuse contrée, a voulu la mettre à couvert du côté du nord par cette longue chaîne de montagnes qui joignent leu deux mers, celle du septentrion et celle du midi. Julien, au lieu d'occuper ce poste si avantageux, n'osa pas seulement sortir de Rome. Il se prépara à soutenir le siège, et envoya prier les soldats de se mettre en défense, de reprendre leurs exercices et de faire des retranchements. Il fit dresser au combat des éléphants qui ne lui servaient que pour la pompe, s'imaginant que la figure extraordinaire et monstrueuse de ces animaux étonnerait les soldats d'Illyrie et ferait peur à leurs chevaux. Dans toute la ville on forgeait des armes et les autres choses nécessaires pour défendre une place; mais pendant qu'on faisait avec assez de négligence ces préparatifs, on apprit que Sévère approchait. Il avait envoyé devant lui plusieurs de ses soldats, qui, s'étant partagés, entrèrent la nuit par différents chemins dans la ville avec des habits de paysans, sous lesquels ils avaient caché leurs armes. L'ennemi était donc au milieu de Rome avant que Julien eût pris aucune résolution.
Le peuple de son côté, étrangement troublé, commençait à se déclarer pour le plus fort; il blâmait la lâcheté de Julien et les retardements de Niger, mais il ne pouvait assez admirer l'activité et la promptitude avec laquelle Sévère les avait prévenus l'un et l'autre. Julien lui fit proposer un accommodement, et lui offrit de l'associer à l'empire. Il avait communiqué ce dessein au sénat, qui, voyant ses affaires abandonnées, et qu'il en désespérait lui-même, se tournait déjà tout entier du côté de son compétiteur. Mais, deux ou trois jours après, ayant su qu'il était fort près, les sénateurs se déclarèrent ouvertement. Les consuls convoquèrent le sénat : car l'administration de la république leur est dévolue lorsque l'empire est vacant ou disputé. Pendant qu'ils délibéraient, Julien, demeuré seul dans son palais, se lamentait et demandait en grâce qu'on lui laissât la vie, déclarant qu'il était prêt à se dépouiller lui-même et à céder à Sévère la souveraine puissance. Le sénat le voyant si épouvanté, et ayant été averti que ses gardes l'avaient abandonné, décréta sa mort, et déclara Sévère seul et légitime empereur. Il lui envoya une députation de sénateurs qui étaient en charge, ou qui avaient le plus d'autorité, pour lui conférer en son nom tous les titres et les honneurs de l'empire. On envoya en même temps un tribun pour tuer Julien. Il trouva ce lâche et infortuné vieillard qui déplorait le malheur qu'il s'était attiré lui même en achetant cette place dangereuse. Personne ne se mit en devoir de le défendre, et l'officier exécuta ses ordres.
Sévère. ayant appris lu mort de Julien et les délibérations du sénat, flatté de ce succès, voulut, avant d'entrer dans Rome, se rendre maître par adresse des cohortes prétoriennes. Pour venir à bout d'une entreprise si difficile, il écrivit en secret aux tribuns et aux centurions qu'ils devaient attendre de lui de grandes récompenses s'ils pouvaient engager les soldats à exécuter de point en point ce qu'il leur commanderait. Il envoya en même temps une déclaration qui leur ordonnait de laisser leurs armes dans le camp, et de venir au-devant de lui avec l'habit qu'ils prenaient les jours de fêtes pour accompagner le prince dans les sacrifices; il déclarait qu'ils n'avaient rien à craindre de son ressentiment, et qu'il voulait les rétablir dans leur fonction ordinaire, après qu'ils lui auraient prêté le serment de fidélité. Les soldats rassurés par leurs capitaines, et se fiant â la parole de Sévère, quittèrent leurs armes, et vinrent le trouver avec des branches de laurier et en habit de cérémonie. Lorsqu'ils furent arrivés, et qu'on eut averti l'empereur, il les fit approcher comme pour les haranguer et leur faire des largesses. Pendant qu'ils le saluaient avec de grandes acclamations, et qu'ils avaient les yeux attachés sur lui, les soldats d'Illyrie les investirent de toutes parts, sans en tuer ni en blesser aucun; ils se tinrent seulement fort serrés, et tournant contre eux la pointe de leurs piques, les empêchèrent de s'enfuir et de se défendre. Sévère les voyant enfermés comme dans un filet, prit un air et un ton menaçants, et leur dit :
« Vous voyez maintenant que nous sommes les plus forts, et que vous nous êtes autant inférieurs en adresse et en prudence qu'en nombre et en courage. Nous vous avons pris sans peine et sans aucun risque; vous êtes en ma puissance, comme des victimes prêtes à être égorgées. Si l'on voulait vous punir comme vous le méritez, on ne trouverait point de supplice qui répondit à l'énormité de votre crime. Vous avez porté vos mains sacrilèges sur un saint vieillard. sur votre prince, dont la vie vous était confiée et que sous deviez défendre aux dépens de la vôtre. Vous avez indignement vendu comme un bien qui vous appartenait, ou comme l'héritage d'un particulier, cet empire qui n'avait été jusqu'à présent que le prix d'une vertu éminente, ou le partage d'une naissance illustre ; et vous avez abandonné lâchement celui que vous aviez mis sur le trône. S'il fallait vous châtier à la rigueur, mille morts ne pourraient expier tant de forfaits; rendez-vous donc justice, et vous reconnaîtrez ma clémence. Je ne répandrai point votre sang, mes mains seront plus retenues que les vôtres. Mais ce serait une profanation et une injustice, qu'après que vous avez violé votre serment, manqué à la fidélité que vous deviez à votre prince, et trempé vos mains dans le sang d'une personne si sacrée, on vous confiât encore la tête et le salut des empereurs. Vous aurez la vie sauve, c'est tout ce qu'il m'est permis de faire pour vous. J'ordonne à mes soldats de vous ôter, tout à l'heure, les habits et les autres marques militaires que vous portez, et à vous-même de vous éloigner de Rome: je vous défends d'en approcher de plus près que de cent stades, et vous déclare avec serment que s'il se trouve quelqu'un d'assez hardi pour manquer à cet ordre, il lui en coûtera la vie.»
Les soldats d'Illyrie leur ôtèrent aussitôt ces petits coutelas garnis d'or et d'argent qu'ils portaient dans les cérémonies, avec leur ceinturon et les autres marques de la milice. Ces misérables, confus d'avoir été si honteusement surpris, souffrirent toutes sans se défendre; car enfin, que leur eût servi, en petit nombre et sans armes, de résister à toute une armée? Ils se contentaient de plaindre leur malheur; et quoiqu'ils s'en trouvassent quittes à bon marché, ils ne pouvaient se consoler d'avoir donné si follement dans le piège. Sévère prit encore une autre précaution : dans la crainte que ces malheureux, après avoir été cassés et dépouillés, ne retournassent au camp outrés de dépit et ne reprissent leurs armes, il envoya en avant, par des chemins détournés, les plus braves de ses soldats, afin qu'ils s'en emparassent et en défendissent l'entrée. Ainsi furent punis le meurtriers de Pertinax.
Sévère s'avança ensuite à la tête de son armée jusqu'aux portes de Rome. Cet appareil redoubla la crainte du peuple déjà étonné de tant de bonheur et de résolution. Les citoyens sortirent avec le sénat, tenant à leurs mains des branches de laurier, et vinrent au-devant de ce prince, le premier et peut-être le seul qui, sans répandre de sang et sans courir de hasard, ait conçu et exécuté une entreprise si délicate. On admirait ses grandes qualités, mais surtout cette patience à l'épreuve des plus grands travaux, cette fermeté d'esprit; cette activité, cette heureuse hardiesse qui formaient et animaient ses desseins. Les sénateurs vinrent le complimenter à la porte de la ville, et le conduisirent à son palais, après qu'il eût visité les temples des dieux, dans lesquels il offrit les sacrifices accoutumés. Le lendemain il vint au sénat, et y parla d'une manière très obligeante, flattant les sénateurs de bonnes espérances et leur faisant à tous des caresses en général et en particulier. Il les assurait qu'il n'était venu que pour venger la mort de Pertinax; qu'il fallait penser à rétablir l'ancienne forme du gouvernement, qu'il y contribuerait de tout son pouvoir ; qu'on ne confisquerait plus injustement les biens des accusés; qu'il ne souffrirait en aucune manière les délateurs, qu'enfin il tâcherait de suivre, en toutes choses, l'exemple de Marc-Aurèle, et ne se contenterait pas de porter le nom de Pertinax sans imiter ses vertus. Ces discours charmaient la plupart des sénateurs qui prenaient â la lettre toutes ces belles paroles. Mais les plus anciens, qui connaissaient l'empereur de longue main, avertissaient les autres de ne s'y fier que de la bonne sorte ; que c'était un esprit souple, adroit, impénétrable, dont toutes les paroles et toutes les démarches étaient étudiées; qu'il se repliait en mille manières selon ses différentes vues, et qu'il avait toujours fort avancé ses affaires par une profonde dissimulation. La suite fit voir que ce portrait était véritable.
Sévère, pendant le peu de séjour qu'il fit à Rome, après avoir distribué au peuple beaucoup de blé et fait à ses soldats de grandes largesses, ne s'occupa plus que de l'expédition d'Asie. Il voulait surprendre Niger, qui, sans prévoir l'orage dont il était menacé, s'abandonnait dans Antioche au repos et aux plaisirs. Il enrôla toute la jeunesse des environs de Rome, manda aux troupes qu'il avait laissées dans l'Illyrie de le venir joindre en Thrace, et arma une puissante flotte composée de toutes les galères qui se trouvèrent dans les ports de l'Italie. Il fit en fort peu de temps ces grands préparatifs, qu'il crut nécessaires pour les opposer aux forces de l'Orient qui tenait pour Niger. Après avoir pris ces mesures en habile général, il fit voir d'un autre côté qu'il n'était pas moins bon politique. Il ne s'était point encore assuré de l'armée d'Angleterre, qui était fort nombreuse et très aguerrie. Elle avait pour général Albin, d'une famille patricienne, qui avait été élevé dans le luxe et dans les délices. Sa qualité et sa mollesse étaient autant d'aiguillons puissants qui pouvaient exciter son ambition. Sévère appréhendait que ses richesses, les forces et le nombre des troupes qu'il avait en sa disposition, ne le tentassent; qu'il ne profitât de son absence, et que pendant qu'il serait dans le fond de l'Orient, il ne vint se rendre maître de Rome, dont il serait bien moins éloigné que lui. Afin donc de l'amuser, et de se mettre en sûreté de ce côté-là, il leurra de vains titres et d'honneurs chimériques cet homme qui n'était pas d'ailleurs trop fin, et qui le crut sans peine, sur la foi de ses protestations et de ses serments: il le déclara césar et l'associa à l'empire, pour contenter, par ce partage simulé, son ambition qui se laissait prendre aux apparences: Il lui écrivit des lettres pleines de démonstrations d'amitié; il l'exhortait à le soulager d'un fardeau sous lequel il succombait, disant que l'empire avait besoin d'un homme de sa qualité, et qui fût dans la fleur de l'âge; que pour lui, il était déjà vieux; que les douleurs de la goutte l'empêchaient souvent d'agir, et que ses enfants étaient encore trop jeunes pour prendre sa place. Albin, ne se doutant point de l'artifice, accepta ces offres avec joie, ravi de se voir parvenu où il prétendait, sans avoir répandu de sang ni couru de risque. Sévère, pour le convaincre entièrement qu'il agissait de bonne foi, lui fit donner les mêmes titres par le sénat, fit battre de la monnaie à son coin, lui fit dresser des statues, et accompagna ces honneurs de tout ce qui pouvait servir à le mieux tromper.
S'étant ainsi assuré d'Albin, et ne
laissant rien derrière lui qui pût le traverser, il marcha contre
Niger à la tête d'une puissante armée. Les auteurs qui out écrit sa
vie nous ont donné un journal exact de sa marche; ils ont rapporté
en détail tout ce qu'il fit dans chaque ville, les prodiges par
lesquels les dieux se déclarèrent pour lui, les pays qu'il
parcourut, les batailles qu'il gagna, et jusqu'au nombre des morts
et des blessés. Non seulement les historiens, les poètes mêmes se
sont fort étendus sur cette matière. Mais comme je ne me renferme
pas dans la vie de Sévère, et que j'ai dessein de faire l'histoire
de tout ce qui s'est passé pendant soixante ans sous différents
princes que j'ai tous vus sur le trône, je ne rapporterai ici que
les choses les plus importantes. et sans rien ajouter à la vérité,
ni donner dans l'exagération et la flatterie, comme ont fait ceux
qui ont écrit sous le règne de Sévère, je tâcherai de ne passer sous
silence aucun fait mémorable, ni aucune des circonstances qui
pourraient intéresser le lecteur.