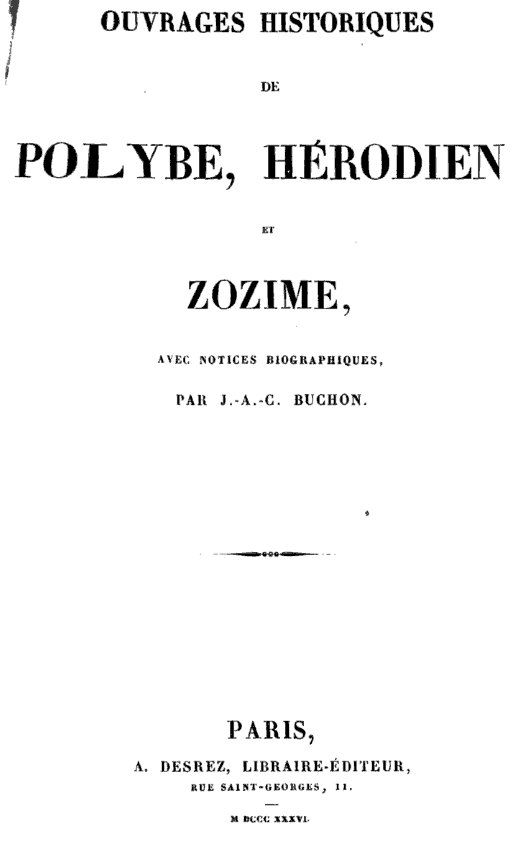
HÉRODIEN
HISTOIRE ROMAINE.
LIVRE I.
Traduction française : J. - A. - C. BUCHON.
autre traduction d'Halévy (+ tetxe grec)
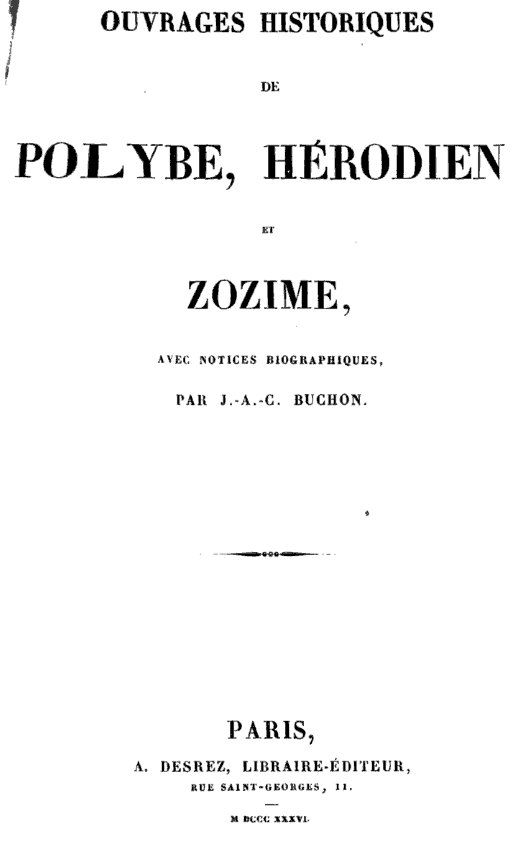
autre traduction d'Halévy (+ tetxe grec)
HISTOIRE ROMAINE
LIVRE PREMIER.
M Ceux qui donnent au public l'histoire des siècles reculés, n'ayant la plupart d'autre vue que de passer pour des écrivains polis, et ne pensant qu'à se faire un nom et à se tirer de la foule, négligent souvent la vérité et l'exactitude pour donner tous leurs soins à l'arrangement des mots et au choix des expressions ; c'est qu'ils comptent se faire honneur de la beauté de leur style sans avoir à craindre qu'on les recherche trop sur la fidélité de leur histoire. D'autres, par des motifs et des dispositions opposées, de haine ou de flatterie pour des princes, pour des villes ou pour de simples particuliers, relèvent avec art et beaucoup au-dessus de la vérité des actions d'elles-mêmes peu considérables et peu éclatantes.
Pour les choses que je vais écrire, je m'en suis instruit par moi-même : ce ne sont point des faits inconnus et qui se soient passés sans témoins ; la mémoire en est encore toute récente, et je les ai recueillis avec l'exactitude la plus scrupuleuse. J'espère que la postérité lira avec plaisir cette histoire, et qu'on n'en trouvera point qui, dans un si petit espace de temps, renferme une si grande quantité d'événements remarquables. L'empire, en soixante années, ayant changé de maître jusqu'à douze fois, il n'est pas surprenant que des révolutions si fréquentes fournissent à un historien beaucoup de faits et d'aventures extraordinaires. En effet, si l'on considère tout ce qui s'est passé depuis qu'Auguste changea la forme du gouvernement jusqu'au temps de Marc-Aurèle, on ne verra pendant deux cents ans ni l'empire passer par tant de mains, ni des guerres civiles et étrangères, dont les événements aient été si mêlés et la fortune si différente ; on n'y verra point tant de soulèvements de peuples, tant de places assiégées, tant de pestes et de tremblements de terre ; enfin on n'y verra point des princes dont la vie et la conduite aient été aussi bizarres et aussi étranges que celle des empereurs dont je vais écrire ici l'histoire. Les uns ont régné très longtemps ; le règne des autres a été très court, et quelques uns ont perdu la vie le jour même qu'ils avaient été revêtus de la pourpre. Ceux qui parvinrent à l'empire dans un âge avancé, profitant d'une longue expérience, devinrent de parfaits modèles de sagesse et de politique ; d'autres étant montés sur le trône dans une trop grande jeunesse, négligèrent les affaires et se permirent plusieurs choses qui jusqu'à eux n'avaient point eu d'exemple : c'est ce que je vais rapporter en détail et en suivant l'ordre des temps et des empereurs.
Marc-Aurèle eut deux fils, Commode et Verissimus : ce dernier mourut étant encore enfant ; pour se consoler de sa perte, son père donna tous ses soins à l'éducation de celui qui lui restait. Il fit venir de toutes les provinces de l'empire les personnes les plus célèbres par leur doctrine, et les mit auprès de lui en qualité de gouverneurs et de précepteurs. Pour ses filles, lorsqu'elles furent en âge, il les maria aux plus vertueux d'entre les sénateurs, sans avoir égard ni à la noblesse du sang, ni aux grandes richesses, persuadé que les bonnes moeurs et la probité sont les seuls biens qui nous sont propres, et qu'on ne peut nous enlever. Toutes les vertus lui furent également recommandables ; il estimait fort les anciens, les possédait parfaitement, et ne cédait en cela à pas un Romain, ni même à aucun Grec, comme on peut le voir encore par ce qui nous reste de ses écrits et de ses paroles remarquables. C'était un prince modéré, affable, d'un abord facile ; il présentait sa main à tous ceux qui s'approchaient de lui pour le saluer, et il ne voulait pas que ses gardes écartassent personne. De tous les princes qui ont pris la qualité de philosophe, lui seul l'a méritée. Il ne la faisait pas consister seulement à connaître tous les sentiments des sectes différentes, et à savoir discourir de toutes choses, mais plutôt dans une pratique exacte et sévère de la vertu. Les sujets se font un honneur d'imiter leur prince ; aussi ne vit-on jamais tant de philosophes que sous son règne. Plusieurs personnes habiles ont écrit sa vie ; ils ont dépeint ses vertus politiques et militaires, sa prudence et sa valeur ; nous avons les guerres qu'il a faites contre les peuples du nord et de l'orient. Je ne commencerai donc mon histoire qu'à sa mort, et je ne rapporterai que ce qui est arrivé de mon temps, ce que j'ai appris, ce que j'ai vu, et plusieurs choses même auxquelles j'ai eu part pendant que j'ai été employé par le prince ou par l'état, et que j'ai exercé différentes charges.
Marc-Aurèle tomba malade en Pannonie. Ce prince, alors fort vieux, était encore plus cassé par ses longs travaux et par ses soins et les peines du gouvernement que par son grand âge. Sitôt qu'il sentit sa fin approcher, il ne s'occupa plus que de son fils ; il n'avait que quinze ou seize ans, et l'empereur craignait qu'abandonné à lui-même dans une si grande jeunesse, il n'oubliât bientôt les bonnes instructions qu'on lui avait données, pour se livrer aux excès et à la débauche ; car les jeunes gens se portent naturellement aux plaisirs, et la meilleure éducation ne tient guère contre un tel penchant. L'histoire, qu'il savait parfaitement, lui fournissait des exemples qui redoublaient ses craintes. Il trouvait qu'entre les princes qui étaient montés sur le trône, Denys le Tyran avait poussé l'intempérance jusqu'à promettre de grosses sommes à ceux qui sauraient inventer des raffinements dans les voluptés ; que les successeurs d'Alexandre avaient, par leurs violences et leur cruauté, obscurci la gloire de celui dont ils avaient partagé l'empire ; que Ptolémée, par un mépris déclaré des lois et des coutumes reçues presque chez toutes les nations, avait osé épouser sa propre soeur ; qu'Antigonus affectait ridiculement d'imiter Bacchus en toutes choses ; qu'il portait, au lieu de diadème, une couronne de lierre, et au lieu de sceptre, un de ces bâtons dont on se sert dans les cérémonies de Bacchus. Les exemples domestiques, et moins éloignés, faisaient encore plus d'impression sur son esprit. Il se représentait les horreurs du règne de Néron, qui avait mis le comble à tous ses crimes par la mort de sa mère ; qui paraissait dans le cirque, montait sur le théâtre, et se donnait en spectacle à un peuple dont il devenait la risée. Enfin, il pensait souvent aux cruautés, encore plus récentes, de l'empereur Domitien. Mais ce n'était pas là l'unique chose qui lui donnât de l'inquiétude : les peuples de la Germanie étaient de dangereux voisins ; il ne les avait pas entièrement domptés ; il en avait vaincu une partie ; il avait traité avec les autres, et le reste s'était réfugié dans les forêts ; sa présence les retenait et les empêchait de rien entreprendre. Il craignait donc que la jeunesse de son fils ne relevât leur courage, et qu'ils ne reprissent les armes ; car il savait d'ailleurs que les barbares aiment la nouveauté, et qu'il faut peu de chose pour les mettre en mouvement.
Dans l'agitation et le trouble où le laissaient toutes ces réflexions, il fit appeler ses parents et ses amis ; et lorsqu'ils furent assemblés, il mit son fils au milieu d'eux, se leva un peu sur son lit, et leur parla en ces termes :
«Je ne suis nullement surpris que l'état où vous me voyez vous touche et vous attendrisse ; les hommes ont une compassion naturelle pour leurs semblables, et les malheurs dont nous sommes les témoins nous frappent plus vivement. Mais j'attends de vous quelque chose de plus que ces sentiments ordinaires qu'inspire la nature ; mon coeur me répond du vôtre, et mes dispositions à votre égard m'en promettent de pareilles de votre part. C'est à vous maintenant à justifier mon choix, à me faire voir que j'avais bien placé mon estime et mon affection, et à me prouver par des marques certaines que vous n'avez point perdu le souvenir de mes bienfaits. Vous voyez devant vous mon fils ; c'est à vos soins que je suis redevable de son éducation : il sort à peine de l'enfance ; dans la première chaleur de sa jeunesse, comme sur une mer orageuse, il a besoin de gouverneur et de pilote, de peur que sans expérience et sans guide il ne s'égare et n'aille donner contre les écueils. Tenez-lui tous lieu de père ; qu'en me perdant, il me retrouve en chacun de vous ; ne le quittez point, donnez-lui sans cesse de bons avis et de salutaires instructions. Les plus grandes richesses ne peuvent fournir aux plaisirs et au débauches d'un prince voluptueux. S'il est haï de ses sujets, sa vie n'est guère en sûreté, et sa garde est pour lui un faible rempart. Nous voyons que les princes qui ont régné longtemps, et qui ont été à couvert des conjurations et des révoltes, ont plus pensé à se faire aimer qu'à se faire craindre. Ceux qui se portent d'eux-mêmes à l'obéissance, sont dans leur conduite et dans toutes leurs démarches au dessus des soupçons ; sans être esclaves, ils sont bons sujets ; et s'ils refusent quelquefois d'obéir, c'est qu'on leur commande avec trop de dureté, et qu'on joint à l'autorité le mépris et l'outrage : car il est bien difficile d'user avec modération d'une puissance qu'on possède sans partage et qui n'a point de bornes. Donnez souvent à mon fils de semblables instructions, répétez-lui celles qu'il vient d'entendre ; par là vous formerez pour vous et pour tout l'empire un prince digne du trône : vous me marquerez votre reconnaissance, vous honorerez ma mémoire, et c'est l'unique moyen de la rendre immortelle.»
En achevant ces paroles, il lui prit une si grande faiblesse que, ne pouvant continuer, il se laissa retomber sur son lit. Tous ceux qui étaient présents furent si pénétrés de ce discours qu'ils ne purent retenir leurs larmes. Marc-Aurèle languit encore un jour, et mourut regretté de tous ses sujets, laissant à la postérité, dans l'histoire de sa vie, le modèle de toutes les vertus. Le peuple et les soldats furent également affligés de sa mort, et personne dans l'empire ne l'apprit sans la pleurer. Tous, d'une commune voix, lui donnaient les qualités de père de la patrie, de prince habile, de vaillant capitaine, d'empereur plein de prudence et de modération ; et ils ne disaient en cela que la vérité.
Lorsqu'on eut achevé les cérémonies des obsèques, et que les premiers jours du deuil furent passés, les amis de l'empereur défunt crurent qu'il était temps de faire voir Commode aux soldats, afin qu'il les haranguât et leur fît les largesses que les princes ont coutume de faire à leur avènement à l'empire. On les avertit de se trouver tous dans la place ; l'empereur s'y rendit, et après avoir fait les sacrifices ordinaires, il monta sur un tribunal qu'on avait dressé exprès, autour duquel se rangèrent les principaux amis de son père, et il parla en ces termes :
«Je suis très persuadé que vous partagez avec moi ma douleur, et que vous n'êtes guère moins affligés que je ne le suis d'une perte qui nous est commune. Tant que mon père a vécu, je ne me suis en rien élevé au-dessus de vous ; pour lui, il nous aimait tous également, et m'appelait plus volontiers son compagnon de guerre que son fils. Il disait que cette dernière qualité marque seulement le rapport que met entre nous la naissance, et que la première en marque une autre, qui ne vient que du courage et de la vertu. Souvent, lorsque j'étais encore au berceau, il me mettait entre vos bras, comme pour s'en remettre à vos soins et à votre zèle de mon éducation. J'espère que vous aurez tous pour moi beaucoup d'attachement. Les vieillards me le doivent comme à leur élève, et les jeunes gens, comme à leur compagnon dans les exercices militaires ; car mon père nous aimait tous comme ses propres enfants, et nous formait avec la même application. La fortune, après lui, m'a appelé à l'empire ; j'y ai un droit naturel, et il ne m'a point fallu l'acheter, comme ont fait plusieurs de mes prédécesseurs. Je suis né dans le palais et près du trône, j'ai été revêtu de la pourpre en sortant du sein maternel, et le jour qui me donna la vie m'assura l'empire. Il est donc bien juste, si vous faites toutes ces réflexions, que vous aimiez un prince qui n'est redevable de son élévation ni à de secrètes cabales, ni aux dissensions publiques. Mon père, déjà monté dans le ciel, a pris sa place au nombre des dieux, et il nous a remis le soin des choses d'ici-bas. Il ne tient qu'à vous d'achever ce qu'il avait commencé, d'assurer et d'étendre ses conquêtes. Vous pouvez terminer heureusement cette guerre, et par là vous travaillerez à votre propre gloire autant qu'à celle de mon père. Ne doutez pas qu'il n'entende tout ce que nous disons, et qu'il ne voie toutes nos actions ; quel bonheur pour nous de faire notre devoir sous les yeux d'un si grand témoin ! Toutes les victoires que vous avez remportées jusqu'ici, on a pu en attribuer la gloire au général, à sa bonne conduite, à sa grande expérience ; mais tout ce que vous ferez maintenant sous un jeune prince, vous sera propre : vous en aurez tout l'honneur, et vous ferez paraître en même temps votre fidélité et votre courage. Vos victoires donneront à ma jeunesse du poids et de l'autorité ; les Barbares réprimés dans le commencement du nouveau règne, et instruits par leurs pertes passées, n'oseront plus rien entreprendre.»
Commode joignit à ce discours de grandes largesses, et se retira dans son palais.
Pendant quelque temps, il ne fit rien que par le conseil des amis de son père ; ils ne le quittaient point ; ils le tenaient appliqué aux affaires, et ne lui laissaient prendre de relâche qu'autant qu'en pouvait demander le soin de sa santé. Dans la suite, il se glissa dans sa familiarité quelques officiers de la cour, qui n'oublièrent rien pour corrompre ses moeurs. C'était de ces flatteurs, parasites de profession, qui mettent tout leur bonheur dans la débauche et dans les plus infâmes voluptés. Ils le faisaient souvenir des délices de Rome, des musiques, des spectacles, et de l'abondance de toutes les choses qui peuvent servir au luxe et aux plaisirs. Ils opposaient aux campagnes fertiles de l'Italie la fertilité des bords du Danube, qui sont toujours couverts de glace, où le soleil ne se montre presque jamais, et où les saisons sont toutes également désagréables. «Jusques à quand, seigneur, lui disaient-ils, boirez-vous de l'eau à demi glacée, pendant que d'autres jouiront de ces bains chauds, de ces ruisseaux agréables, et de cet air tempéré qu'on ne trouve qu'en Italie ?» Par de tels discours et de si vives images, ils enflammaient les passions de ce jeune prince, et le portaient à la volupté. Lors donc qu'on y pensait le moins, il fit appeler ses amis, et leur déclara qu'il souhaitait revoir sa patrie. Il n'osait leur découvrir les véritables causes d'un départ si précipité. Il leur allégua pour prétexte qu'il appréhendait que pendant son absence quelqu'un des plus riches patriciens ne s'emparât du palais impérial, et que de l'élite du peuple romain on pourrait former un corps d'armée considérable. Ses amis reçurent ce discours avec un air triste, sombre, les yeux baissés, et dans un morne silence ; mais Pompéianus, l'un d'entre eux, et le plus distingué par son alliance avec le prince, dont il avait épousé la soeur aînée, prenant la parole, lui dit :
«Je ne suis pas surpris, seigneur, que vous souhaitiez revoir votre patrie, nous n'en avons pas moins d'envie que vous ; mais les grandes affaires qui nous retiennent ici l'emportent sur cette passion naturelle. Vous pourrez dans la suite goûter à loisir les douceurs de Rome (quoiqu'en effet Rome soit partout où se trouve l'empereur) ; mais il y a maintenant autant de danger que de honte à ne point achever la guerre. Par là vous enflerez le courage des ennemis : ils n'attribueront pas votre départ au désir de retourner dans votre capitale, mais ils le regarderont comme un effet de votre crainte et comme une véritable fuite. Qu'ils vous serait plus glorieux de dompter tous les Barbares, de porter les limites de l'empire jusqu'à l'Océan, et de rentrer dans Rome en triomphe, traînant à votre suite les rois et les chefs des peuples que vous auriez vaincus ! C'est par de tels exploits que vos prédécesseurs, que les anciens Romains se sont fait un nom immortel. Vous n'avez d'ailleurs aucun sujet de craindre qu'on profite de votre absence pour vous nuire ; les principaux du sénat sont ici auprès de vous ; l'armée que vous commandez met autant en sûreté votre autorité que votre personne. Tous les trésors de l'empire sont entre vos mains ; enfin, la mémoire de votre père vous répond de la fidélité et de l'attachement de tous ceux qui sont en place, et qui ont quelque crédit.»
Ces remontrances retinrent pour quelque temps le jeune prince : il n'avait rien de raisonnable à y opposer, et il était confus d'avoir laissé voir ses dispositions. Il renvoya donc ses amis, et leur dit qu'il penserait plus à loisir à cette affaire. Cependant les officiers de sa maison l'assiégeaient et le pressaient si vivement, qu'il résolut enfin de partir sans consulter davantage les amis de son père.
Il écrivit à Rome qu'on se préparât à le recevoir, nomma des officiers pour commander les troupes qu'il laissait sur les bords du Danube, et après avoir donné en secret tous ses ordres il déclara sa résolution. Ses généraux dans peu de temps ou domptèrent les Barbares par la force des armes, ou traitèrent avec eux, et les gagnèrent sans peine en leur offrant de grandes sommes. Ces peuples aiment fort l'argent ; et comme ils méprisent les dangers, ils vivent de courses et de brigandages, ou vendent chèrement la paix à ceux qui veulent se mettre à couvert de leurs insultes. Commode qui les connaissait, et qui avait des richesses immenses, voulant à quelque prix que ce fût se délivrer de l'embarras d'une guerre éloignée, leur accorda tout ce qu'ils demandaient. Sitôt que le bruit de son départ se fut répandu, cette nouvelle mit tout le camp en mouvement ; tout le monde voulait être du voyage, et quitter le pays ennemi pour aller jouir des délices de l'Italie. Lorsque les courriers furent arrivés à Rome, et qu'ils y eurent annoncé son retour, le peuple en eut une joie incroyable ; ils se promettaient de la présence du prince de grands avantages, et ne doutaient point qu'il ne tînt en tout de son père. Cependant il s'avançait à grandes journées, avec une ardeur et un empressement de jeune homme ; on lui faisait des réceptions magnifiques dans toutes les villes de sa route, et il trouvait les chemins bordés d'une multitude de peuple infinie, qui accourait de tous côtés pour le voir. Lorsqu'il approcha de Rome, le sénat et le peuple s'empressant à l'envi, et tâchant de se prévenir, sortirent de la ville portant des branches de laurier et des couronnes de fleurs, et allèrent fort loin au-devant de lui, pour voir les premiers leur empereur, que sa jeunesse rendait aussi aimable que la noblesse de son extraction le rendait illustre. Ils avaient pour lui une singulière affection, parce qu'il avait été élevé au milieu d'eux, qu'il était d'une maison fort ancienne, et comptait plusieurs empereurs entre ses aïeux : car l'impératrice Faustine, sa mère, était fille d'Antonin le Pieux, petite-fille d'Hadrien, et arrière-petite-fille de Trajan. Tels étaient les ancêtres de Commode, qui joignait à une fort grande jeunesse une beauté qui n'était pas moindre : il avait la taille bien prise ; son air n'avait rien d'efféminé ; son regard était doux et vif tout ensemble, ses cheveux frisés et fort blonds ; lorsqu'il marchait au soleil, ils jetaient un éclat si éblouissant, qu'il semblait qu'on les eût poudrés avec de la poudre d'or. Quelques-uns disaient que ces rayons naturels étaient une marque ou un heureux présage de sa divinité. Les Romains, charmés de voir un prince si accompli, le reçurent avec toute sorte d'acclamations et de cris de joie, et semèrent de festons de fleurs les chemins par où il devait passer.
Lorsqu'il fut arrivé, il alla d'abord offrir ses voeux dans tous les temples, et remercia ensuite le sénat et les soldats prétoriens de leur fidélité. Les premières années de son règne, il eut tous les égards possibles pour les amis de son père, et ne fit rien sans les consulter. Mais lorsqu'il voulut gouverner seul, et qu'il ne prit plus leurs avis, il donna le commandement des cohortes prétoriennes à un officier d'Italie nommé Pérennis, qui savait parfaitement la guerre, mais qui d'ailleurs n'avait aucune bonne qualité. Cet homme, abusant de la jeunesse du prince, le livrait à toutes sortes de débauches, et l'éloignait des affaires, pour se rendre maître du gouvernement. Il avait une avarice insatiable, et comptant pour rien toutes les richesses qu'il possédait, il ne pensait qu'à en amasser de nouvelles. Il osa le premier imputer des crimes à ceux qui avaient été attachés à Marc-Aurèle ; il donnait sans cesse au prince des impressions désavantageuses contre tous ceux qui étaient riches ou de qualité ; il les faisait condamner, obtenait la confiscation de leurs biens, et par cette voie il devint le plus riche particulier de son temps. Cependant Commode n'était pas entièrement changé ; le souvenir de son père, et la considération qu'il avait pour ses amis, le retenaient encore ; mais un malheureux hasard et la malignité de la fortune achevèrent de le corrompre.
Lucilla, l'aînée de ses soeurs, avait épousé en premières noces Lucius Vérus que Marc-Aurèle avait associé à l'empire, et à qui il avait donné sa fille pour se l'attacher plus étroitement par cette alliance. Après la mort de Lucius Vérus, son père la maria à Pompéianus, sans lui ôter les marques et les honneurs d'impératrice ; Commode les lui conserva aussi : au théâtre, elle était assise sur un trône ; et dans les rues, on portait le feu devant elle. Mais lorsque Commode eut épousé Crispine, il fallut lui céder le pas. Lucilla en fut piquée, et ne put se résoudre à marcher même après la femme de l'empereur. Elle savait que Pompéianus, son mari, avait une fidélité et un attachement inviolables pour Commode ; ainsi elle ne lui communiqua rien de ses pernicieux desseins ; mais elle s'adressa à un jeune patricien fort riche nommé Quadratus, avec qui on la soupçonnait d'être en commerce de galanterie. Elle le sonda peu à peu ; et commençant par se plaindre qu'on lui eût ôté son rang, elle l'engagea insensiblement dans une entreprise aussi fatale au sénat qu'elle le fut à lui-même. Il fit entrer dans sa conjuration quelques-uns des sénateurs les plus distingués, et entre autres Quintianus, jeune homme hardi et entreprenant, qui lui promit de porter toujours un poignard sous sa robe, et d'épier tous les moments et toutes les occasions pour tuer l'empereur. Quadratus se chargea de faire réussir tout le reste, et d'apaiser par ses largesses le peuple et les soldats. Quintianus se cacha donc dans le passage qui conduit à l'amphithéâtre, lieu fort obscur et propre à un tel dessein ; et lorsque Commode vint à passer, il se jeta sur lui le poignard à la main, en criant : Voici ce que t'envoie le sénat. Ces paroles avertirent l'empereur d'éviter le coup qu'on lui portait : l'assassin se découvrit lui-même ; les gardes l'arrêtèrent, et il fut puni sur-le-champ de sa témérité et de son imprudence. Ce fut là l'origine et la cause principale de la haine qu'eut depuis Commode pour le sénat. Ces paroles de Quintianus firent de profondes impressions dans son esprit ; cette plaie ne se referma jamais, et il regarda depuis tous les sénateurs comme ses communs ennemis. Pérennis ne manqua pas de profiter d'une si belle occasion, et lui persuada sans peine de se défaire de toutes les personnes puissantes dont l'élévation lui faisait ombrage. Il fit des informations exactes de cette conjuration ; la soeur de l'empereur et tous les complices furent condamnés à perdre la tête. On punit avec eux du dernier supplice plusieurs personnes contre qui on n'avait que de fort légers soupçons.
Par tous ces moyens Pérennis se délivra de ceux que Commode ménageait encore, et qui avaient pour lui une tendre affection et une fidélité inviolable. Lors donc qu'il se vit chargé seul du salut du prince, que sa vie fut entre ses mains, et que son crédit et sa puissance n'eurent plus de bornes, il porta ses vues plus loin, et pensa à s'emparer de l'empire. Il fit donner à son fils, qui était encore fort jeune, le commandement des armées d'Illyrie ; et il amassait des sommes immenses, pour corrompre par ses largesses les gardes prétoriennes. Son fils, de son côté, levait des troupes en secret, afin d'être en état de le seconder et de le soutenir, lorsqu'il aurait tué l'empereur. Cette conjuration se découvrit d'une manière fort étrange. Les Romains célèbrent des jeux en l'honneur de Jupiter Capitolin, avec un grand concours de peuple : l'empereur, avec les prêtres qui font des fonctions, préside aux jeux et distribue les prix. Commode étant donc venu pour entendre les plus excellents acteurs, était assis sur son trône ; l'amphithéâtre était rempli ; chacun y était placé selon son rang et sa qualité. Comme on allait commencer, une espèce de philosophe qui était à demi nu, et qui avait un bâton à la main et une besace à son côté, courut tout d'un coup au milieu du théâtre, et faisant signe au peuple de l'écouter : «Il n'est pas temps, seigneur, s'écria-t-il, de s'occuper de jeux, de fêtes et de spectacles ; l'épée de Pérennis pend déjà sur votre tête ; il amasse ici contre vous de l'argent et fait lever des troupes, pendant que son fils tâche de corrompre les armées d'Illyrie : ce n'est point un orage qui se prépare, il est tout formé ; si vous ne le prévenez, c'est fait de vous.» Cet homme se porta à une action si hardie, ou par un mouvement secret qui avait quelque chose de divin, ou pour acquérir de la gloire, et se tirer de l'obscurité dans laquelle il avait vécu jusqu'alors, ou dans l'espérance de recevoir du prince quelque récompense considérable. Commode, à ce discours, demeura interdit ; tout le monde se doutait bien que ces choses pouvaient être véritables, quoiqu'on fit semblant de n'en rien croire ; mais Pérennis, sans s'étonner, fit arrêter ce malheureux, et le condamna au feu, comme un insensé et un imposteur. Les courtisans qui voulaient paraître s'intéresser pour le salut de l'empereur, et qui haïssaient d'ailleurs Pérennis, que sa fierté et ses hauteurs rendaient insupportable, ne manquèrent pas cette occasion, et n'oublièrent rien pour le mettre mal dans l'esprit du prince.
La fin de Commode n'était pas encore venue, la conjuration devait être découverte, et l'attentat de Pérennis et de son fils ne devait pas demeurer impuni ; car, peu de temps après, quelques soldats de l'armée d'Illyrie s'étant échappés sans que le fils de Pérennis en sût rien, apportèrent à Rome des pièces de monnaie que ce jeune homme avait eu l'audace de faire frapper à son coin. Ils trouvèrent moyen de parler à l'empereur, quoique Pérennis fût capitaine de ses gardes ; ils lui montrèrent ces pièces d'argent, et lui découvrirent le détail de la conjuration. Commode leur donna de grandes récompenses, et sans perdre de temps envoya la nuit suivante couper la tête à Pérennis. Il dépêcha vers le fils ceux mêmes qui avaient exécuté le père. Ils arrivèrent eu Illyrie avant qu'on y eût rien appris de ce qui s'était passé, et lui remirent des lettres de l'empereur, qui, après plusieurs démonstrations d'amitié, lui faisait entendre qu'il ne le rappelait à la cour que pour l'élever à une plus grande fortune, et pour le mettre en position de concevoir de plus hautes espérances. Le jeune Pérennis ne se douta point du piège qu'on lui tendait. Il croyait son père encore en vie, et les courriers l'assuraient qu'il les avait chargés de vive voix de presser son départ, et qu'il n'eût pas manqué de lui écrire, s'il n'avait cru que sa lettre serait entièrement inutile après les ordres du prince. Il se laissa donc persuader ; et quoiqu'il n'abandonnât qu'à regret ses projets, il se résolut cependant à partir, se tenant fort du crédit et de la puissance de son père. Il fut tué en chemin, sur les confins de l'Italie, par ceux qui en avaient reçu l'ordre de l'empereur.
Commode créa ensuite deux préfets des gardes prétoriennes, dans la pensée qu'il y avait trop de danger à mettre une charge si importante sur une seule tête, et qu'il valait mieux affaiblir cette puissance en la partageant. Mais ces précautions ne le mirent guère en sûreté. Il se vit peu de temps après exposé à de nouvelles embûches. Un soldat nommé Maternus, coupable de plusieurs crimes, ayant déserté, persuada à quelques-uns de ses compagnons, qui ne valaient pas mieux que lui, de suivre son exemple, et assembla en fort peu de temps un assez grand nombre de bandits. D'abord il courait la campagne et pillait les villages ; mais quand il eut amassé de grandes sommes d'argent, l'espérance de faire fortune attirant tous les jours à sa suite beaucoup d'autres scélérats, il forma un corps qui avait plus l'air d'une armée réglée que d'une troupe de brigands. Ils s'attaquèrent alors aux plus grandes villes. Ils forçaient les prisons, délivraient tous les criminels, leur offraient un asile, et les engageaient, autant pour leur sûreté que par reconnaissance, à prendre parti avec eux. Ils coururent de la sorte les Gaules et l'Espagne ; ils entraient les armes à la main dans les villes les plus riches et les plus peuplées, y mettaient le feu, et se retiraient chargés de butin. Commode ayant été informé de tous ces désordres, écrivit aux gouverneurs des provinces des lettres pleines de menaces ; il leur reprochait leur lâcheté et leur négligence, et leur ordonnait de faire au plus tôt marcher des troupes contre ces brigands. Mais sitôt qu'ils surent les ordres qu'on avait donnés contre eux, ils cessèrent de piller et de courir le pays, se séparèrent en plusieurs petites bandes, et gagnèrent en toute diligence l'Italie par des chemins détournés. Cependant Maternus n'avait plus de vues médiocres, et ne pensait à rien moins qu'à l'empire. Tout lui avait réussi jusqu'alors au-delà de ses espérances ; il voyait bien qu'il s'était engagé trop avant pour reculer, et qu'il fallait pousser sa fortune jusqu'où elle pourrait aller, ou finir avec éclat et en homme de coeur. Ses forces n'étaient pas assez grandes pour les opposer à celles de Commode, et pour lui faire une guerre ouverte ; il savait d'ailleurs que ce prince était aimé du peuple et des soldats prétoriens. Il crut donc qu'il valait mieux avoir recours à l'artifice, et se servir de quelque stratagème. Voici ce qu'il imagina.
Au commencement du printemps, les Romains célèbrent en l'honneur de la mère des dieux une fête, dans laquelle on porte en cérémonie devant son image tout ce que l'empereur et les particuliers ont de plus précieux pour la matière et pour la délicatesse de l'art. Alors on a une liberté entière de faire toutes les folies et toutes les extravagances qui viennent dans l'esprit. On se déguise chacun à sa fantaisie ; il n'est dignité si considérable, personnage si sérieux, dont on ne puisse prendre l'air et les habillements. Maternus trouva ce jour très propre pour l'exécution de son projet ; il crut qu'il pourrait aisément se déguiser avec ses gens en soldat de la garde de l'empereur, se mettre à sa suite comme étant de la cérémonie, et le tuer lorsqu'on y penserait le moins. Mais il fut trahi par quelques-uns de ceux qui avaient son secret, et qui étaient entrés avec lui dans la ville. Ils ne purent se résoudre à avoir pour empereur celui qu'ils avaient bien voulu suivre comme un chef de brigands. Cette pensée leur inspira une secrète jalousie, et ils allèrent découvrir tout ce qu'il avait concerté. On arrêta Maternus avant la fête, et il eut la tête tranchée avec ses compagnons. Commode fit à la déesse des sacrifices en action de grâces, et parut dans la cérémonie avec un air fort gai et fort tranquille. Le peuple, de son côté, redoubla d'allégresse et de joie pour faire sa cour à l'empereur.
Je crois qu'il ne sera pas inutile de rapporter ici l'origine de cette fête, et de rechercher dans l'histoire pourquoi les Romains honorent si particulièrement la mère des dieux. Cette digression pourra faire quelque plaisir aux Grecs, qui la plupart ne sont pas instruits des antiquités romaines. La statue de la déesse vient du ciel, si l'on veut croire ce que l'on en dit. On n'en connaît point l'ouvrier, et on est persuadé qu'aucun homme n'y a mis la main. On raconte qu'elle tomba en Phrygie dans la ville de Pessinunte, qui a tiré son nom de cet événement. Je trouve néanmoins dans quelques auteurs que ce fut dans cet endroit qu'Ilus et Tantale en vinrent aux mains, et qu'après un combat fort long et fort opiniâtre, il demeura de part et d'autre beaucoup de morts sur le champ de bataille, qui depuis cette journée fut appelé Pessinunte. Ce fut aussi dans cette occasion que Ganimède disparut, pendant que son frère Ilus, et Tantale son ravisseur, se l'arrachaient l'un à l'autre ; et c'est sur cette histoire qu'on a inventé la fable de son enlèvement par Jupiter. C'est dans ce même lieu encore qu'autrefois les Phrygiens célébraient des mystères semblables à ceux des Bacchantes sur le bord du fleuve Gallus, d'où les prêtres de la déesse qu'on y honorait, et tous ceux qui sont eunuques comme eux, ont été appelés Galli. Lorsque les Romains eurent jeté les fondements de cette grandeur à laquelle ils sont depuis parvenus, ils apprirent par un oracle que leur empire se soutiendrait, et irait toujours en augmentant, s'ils faisaient venir à Rome la déesse de Pessinunte. On députa aussitôt vers les Phrygiens ; on fit valoir le degré d'alliance qui était entre eux et les Romains, qui, par Enée, tiraient d'eux leur origine, et l'on obtint sans peine ce qu'on demandait. On mit la déesse sur un vaisseau, qui, étant arrivé à l'embouchure du Tibre, fut arrêté soudain par une force invisible et insurmontable. Tous les efforts que l'on put faire, et les secours qu'on employa pour le mettre en mouvement, furent inutiles. On désespérait d'en venir à bout, lorsqu'une vestale, qu'on accusait d'avoir violé la virginité dont elle faisait profession, et qu'on allait condamner, demanda en grâce qu'on s'en rapportât au jugement de la mère des dieux. On le lui accorde ; elle détache sa ceinture, la lie à la proue, et prie la déesse de permettre, pour confondre ses accusateurs, que le vaisseau se laissât tirer sans peine, et suivît comme de lui même, ce qui ne manqua pas d'arriver, au grand étonnement de tout le peuple, qui reconnut par ce prodige et la puissance de cette nouvelle divinité et l'innocence de la vestale. Mais c'est assez parler de la déesse de Pessinunte ; je n'en ai peut-être que trop dit.
Commode, après tant de conjurations dans lesquelles il s'était vu si près de perdre la vie, se tenait plus sur ses gardes, et se montrait rarement au peuple ; il demeurait ordinairement dans ses jardins hors de la ville, ou dans ses maisons de campagne ; il ne donnait plus d'audiences et ne s'occupait plus des affaires de l'état. Dans le même temps, toute l'Italie fut affligée d'une peste très violente ; mais le mal fut beaucoup plus grand à Rome à cause du nombre infini des habitants et des étrangers qui y abordent de toutes parts. Commode, par l'avis de ses médecins, se retira à Laurente. C'est un lieu très frais, entouré de plusieurs bois de lauriers, d'où il a pris son nom. Ils disaient que la fraîcheur, l'ombrage agréable et l'odeur des lauriers étaient un fort bon préservatif contre le mauvais air. A Rome, on se remplissait les narines et les oreilles des senteurs les plus fortes et l'on brûlait sans cesse des parfums. Les médecins prétendaient que ces odeurs occupant les passages empêchaient le mauvais air de pénétrer, ou que leur force neutralisait la sienne et arrêtait son effet. Cependant ces remèdes furent assez inutiles ; le mal croissait tous les jours, et cette peste emporta une effroyable multitude d'hommes et d'animaux. Elle n'eut pas plus tôt cessé, que la famine prit sa place. Voici quelle en fut la cause.
Cléandre, Phrygien de nation et esclave d'origine, avait été acheté par les officiers de l'empereur. Sa fortune, qui avait commencé avec le règne de Commode, alla si vite sous ce prince, et il s'insinua si avant dans son esprit, qu'il devint son chambellan, capitaine de ses gardes et général de ses armées. Mais cet indigne favori ne se contenta pas d'avoir réuni en sa personne les premières charges de l'empire : les plaisirs irritèrent ses passions, et ses grandes richesses exaltèrent ses espérances. Il amassa beaucoup d'argent et fit de grands magasins de blé qui mirent la cherté dans Rome. Il se persuadait qu'il n'y avait point de moyen plus sûr pour gagner le peuple et les soldats, que de leur faire de grandes largesses dans le temps où ils en auraient le plus de besoin, et qu'ils lui tiendraient plus de compte d'une libéralité si bien placée. Il avait déjà fait bâtir à ses dépens des bains publics et une académie. Il prétendait par là s'attirer l'affection du peuple ; mais il réussissait fort mal : cette avidité insatiable qu'il ne pouvait cacher le rendait odieux à tout le monde, et l'on s'en prenait à lui de toutes les calamités présentes. D'abord le peuple s'amassa par troupes au théâtre et lui dit des injures : mais il n'en demeura pas là. Un jour que l'empereur était dans ses jardins hors de Rome, les citoyens y allèrent en foule et crièrent tous ensemble qu'on eût à leur livrer Cléandre pour le faire mourir. Pendant ce tumulte, Commode se livrait à la débauche dans les lieux les plus reculés de son palais, et ne savait rien de ce qui se passait. Cléandre empêchait qu'on ne l'en avertît ; et lorsque le peuple s'y attendait le moins, il fit sortir sur lui les cavaliers de la garde de l'empereur. Des gens à pied et sans armes ne pouvaient tenir contre des hommes armés et à cheval il fallut donc prendre la fuite et se retirer vers la ville. Cependant les soldats les poursuivaient et en tuaient plusieurs ; quelques-uns furent écrasés sous les pieds des chevaux et d'autres étouffés dans la presse. Les cavaliers les poussèrent ainsi jusqu'aux portes de Rome sans trouver de résistance ; mais lorsque ceux qui étaient dans la ville eurent appris ce désordre, ils pensèrent à venger leurs concitoyens. Ils ferment aussitôt les portes de leurs maisons, montent sur les toits et jettent d'en haut une grêle de pierres et de tuiles. Le peuple eut alors son tour, et, sans faire tête aux soldats, il combattait d'un lieu sûr et les contraignit à la fin à prendre la fuite. Mais pendant qu'ils se retiraient, les chevaux rencontrant sous leurs pieds les pierres dont les rues étaient pleines, faisaient à tous moments de faux pas et jetaient par terre ceux qui les montaient. Les soldats qui étaient de garde dans la ville, et qui haïssaient les cavaliers, se joignirent au peuple, et il se fit de part et d'autre un grand carnage.
La guerre civile étant ainsi allumée au milieu de Rome, on n'osait toutefois en avertir l'empereur, tant on redoutait la puissance et le ressentiment de Cléandre. Mais enfin Phadilla, l'aînée des soeurs de Commode depuis la mort de Lucilla et à qui sa qualité donnait à toute heure un libre accès auprès de lui, y courut au plus tôt. Elle avait les cheveux épars ; tout son extérieur triste et défiguré marquait son alarme et son épouvante. En entrant elle se jeta par terre, et déchirant ses habits, elle s'écria : «Vous êtes ici en repos, seigneur ; vous ignorez ce qui se passe et à quel danger vous êtes exposé. Vous venez de perdre une partie de votre peuple et de vos soldats, et nous-mêmes, votre propre sang, nous ne sommes pas en sûreté. Vos domestiques nous font éprouver des maux que les Barbares ne nous ont jamais fait craindre, et ceux que vous avez le plus comblés de bienfaits sont vos plus grands ennemis. Cléandre vient d'armer contre vous le peuple et les soldats ; animés, les uns par la haine qu'ils lui portent et les autres par l'affection qu'ils ont pour lui, ils se font une cruelle guerre, et le sang des citoyens coule dans les places de Rome. Mais les malheurs des deux partis retomberont sur nous, si vous ne sacrifiez au plus tôt ce vil esclave qui a déjà causé la mort de tant de personnes, et qui nous fera périr après elles.» Quelques-uns de ceux qui étaient présents, devenus hardis par ce discours de la soeur du prince, la secondèrent, et firent concevoir à Commode le danger où il était. Il en fut épouvanté et crut qu'on menaçait déjà sa tête. Il fit donc appeler Cléandre. D'abord qu'il parut on le saisit, on lui trancha la tête, et on la porta dans les rues au bout d'une lance, spectacle sans doute bien agréable pour un peuple maltraité ! Ce remède arrêta le mal sur-le-champ ; on mit bas les armes de part et d'autre : les soldats, voyant que celui pour qui ils combattaient n'était plus, appréhendaient les suites de cette affaire ; ils reconnurent qu'on les avait trompés, et que Cléandre n'avait reçu aucun ordre du prince. D'autre part, le peuple était satisfait et se croyait assez vengé par la mort de celui qui était l'auteur et la première cause de tout le désordre. Il tourna ce qui lui restait de rage contre les deux fils et contre les amis de ce favori. Ils furent tous massacrés : on traîna leurs corps par les rues, et après leur avoir fait toutes les indignités dont s'avise une populace en fureur, on les jeta dans les égouts. Telle fut la fin malheureuse de Cléandre. Il semble que la fortune ait affecté de faire voir en un seul homme tous ses caprices, et qu'il ne lui faut qu'un tour de roue pour élever ceux qui lui servent de jouet de la plus basse condition aux plus grandes places, et pour les faire retomber avec d'autant plus de rapidité qu'elle les avait portés plus haut.
Commode n'était pas encore bien revenu de sa peur ; il appréhendait que le peuple n'entreprît quelque chose contre sa personne. Il se rendit toutefois à l'avis de ses amis, et rentra dans Rome, où il fut reçu avec de grandes acclamations. Cependant les différents périls auxquels il s'était vu exposé le rendirent défiant à l'excès. Tout le monde lui devint suspect ; ses jours étaient tous marqués par quelque nouvelle proscription. D'abord qu'on était accusé, on était coupable ; il suffisait d'avoir quelque mérite pour n'être point admis dans sa familiarité. Aussi ne lui restait-il aucune bonne inclination : il s'était livré à toutes sortes de débauches ; elles l'occupaient tour à tour ; le jour et la nuit n'y pouvaient suffire. Pour peu qu'on eût de probité, ou quelque teinture des belles lettres, on était éloigné de sa cour, comme personne inutile ou dangereuse, pendant que les bouffons et les farceurs les plus infâmes y étaient fort bien reçus. Il passait tout son temps à conduire des chariots et à tirer sur des bêtes farouches. Les courtisans prenaient de là occasion de louer sa force et son adresse, et par leurs flatteries entretenaient sa passion pour des exercices dont ils auraient dû plutôt le détacher.
Il parut en même temps des prodiges dans le ciel : on vit des comètes et des étoiles en plein midi. Les animaux eurent des petits d'une espèce différente, ou d'une figure extraordinaire et bizarre, ou bien avec des membres mal placés et peu proportionnés. Mais il arriva un accident plus fâcheux, qui de soi-même très considérable, le devint encore plus par le trouble qu'il jeta dans les esprits. Le feu prit au temple de la Paix, sans qu'on pût en découvrir la cause. Le ciel était serein, et on n'avait point entendu tonner ; on avait seulement senti quelques légères secousses de tremblement de terre, et peut-être qu'alors il était sorti des feux souterrains qui s'étaient répandus dans le temple, ou que le tonnerre y était tombé pendant la nuit. C'était un des plus beaux et des plus somptueux édifices de Rome ; il était orné et enrichi d'offrandes d'or et d'argent que la piété de nos ancêtres y avait consacrées. Comme ce lieu était fort sûr, chacun y mettait en dépôt tout ce qu'il avait de plus précieux ; ainsi en une seule nuit le feu ruina un grand nombre de familles, et presque tout le monde, avec le malheur public, eut à pleurer ses pertes particulières. La flamme, après avoir réduit en cendres ce superbe bâtiment, gagna plus loin et brûla plusieurs autres temples. Celui de Vesta ne fut point exempt de ce malheur, et l'on vit à découvert, pour la première fois, le palladium qu'Énée apporta de Troie en Italie, et que les Romains tiennent caché avec tant de religion ; car, pour sauver cette ancienne statue, les vestales la portèrent sur leurs épaules par la rue Sacrée dans le palais de l'empereur. Les plus beaux quartiers de la ville furent entièrement brûlés, et le feu dura plusieurs jours avec la même violence, jusqu'à ce qu'il survint des pluies qui arrêtèrent son impétuosité. Ainsi l'on crut qu'il n'y avait rien de naturel dans cet accident ; tout le monde disait que les dieux qui avaient fait commencer l'incendie avaient pu seuls en arrêter le cours ; d'autres ajoutaient que la ruine du temple de la Paix était un présage infaillible de quelque guerre dont l'empire était menacé : ce pronostic ne se trouva que trop vrai, comme on le verra dans la suite de cette histoire.
Ces accidents funestes qui se suivirent de si près aigrirent l'esprit du peuple contre Commode. Il rejetait sur lui la cause de tous ses malheurs ; il disait hautement que les dieux vengeaient la mort de tant d'illustres personnages injustement condamnés, et que ses crimes attiraient sur Rome le courroux du ciel. Car on n'ignorait pas ses déportements ; il ne se mettait guère en peine de les cacher, et il n'eut pas honte de faire paraître au grand jour ses excès et ses infamies. Son extravagance alla si loin, qu'il prit fantaisie de changer de nom ; et au lieu de Commode, fils de Marc-Aurèle, il se faisait appeler Hercule, fils de Jupiter.
Il quittait souvent l'habit à la romaine et la pourpre impériale, et se montrait en public avec une peau de lion et une massue à la main. Il portait par dessous une veste brochée d'or ; et c'était une chose ridicule et bizarre de le voir faire parade en même temps de l'afféterie des femmes et de la force des héros. Il changea aussi les noms des mois, et leur en donna de nouveaux qui la plupart avaient rapport aux actions et aux combats d'Hercule. Entre les statues qui étaient placées dans tous les quartiers de la ville, il en fit mettre une devant le sénat, où il était représenté avec un arc à la main ; il voulait que ses images même inspirassent de la terreur, et que leur marbre eût un air menaçant. Mais dès qu'il fut mort on ôta cette statue, et on mit à sa place celle de la Liberté. Après tant d'extravagances, il ne garda plus de mesure. Il fit publier des jeux où il devait paraître en personne et se donner en spectacle dans le cirque, où on le verrait tuer lui seul toutes les bêtes qu'on lâcherait dans l'amphithéâtre, et combattre ensuite contre les gladiateurs les plus vigoureux. D'abord que cette nouvelle se fut répandue, il vint de toute l'Italie et des pays voisins une multitude de personnes pour voir des choses si nouvelles et si surprenantes. On ne parlait que de son adresse merveilleuse. Il s'était fait exercer à tirer des flèches par des Parthes très habiles, et à lancer le javelot par des Maures non moins expérimentés ; mais il surpassait tous ses maîtres.
Lorsque le jour des jeux fut arrivé, l'amphithéâtre fut bientôt rempli d'un nombre infini de spectateurs. On avait élevé à l'entour une galerie, de laquelle Commode tirait sur les bêtes sans s'exposer, faisant ainsi voir son adresse plutôt que son courage. Il tua d'abord des cerfs, des daims et autres bêtes à cornes ; il courait après eux de sa galerie, et prévenait par la vitesse de ses flèches la rapidité de leur course. Il se servit ensuite de dards contre les lions et les autres bêtes farouches ; il ne tira jamais deux fois sur le même animal, et toutes les blessures qu'il leur faisait étaient mortelles ; car pendant qu'elles couraient avec le plus de vitesse, il portait son coup juste au front ou dans le coeur. On lui amena des Indes, de l'Éthiopie, du midi et du septentrion les animaux les plus rares et les plus extraordinaires, et il nous fit voir pour la première fois en nature ce que nous n'avions vu jusqu'alors que dans des tableaux. Mais on admirait encore plus son adresse que la figure étrange de ces bêtes féroces. Un jour, ayant pris des flèches dont le fer était en croissant, il fit lâcher des autruches de Mauritanie. Ces oiseaux, sans quitter la terre, se servent de leurs ailes recourbées comme de voiles, et courent avec une rapidité surprenante. Cependant il les tirait si juste qu'il leur coupait le cou à toutes ; et dans cet état l'impétuosité de leur course les soutenait encore, et les emportait à quelques pas plus loin. Une autre fois un léopard s'étant lancé soudainement sur un homme qui était descendu dans le cirque, allait le dévorer, si Commode d'une main sûre n'eût tué cette bête furieuse, sans blesser le malheureux qui était déjà sous ses dents. Un autre jour on fit sortir de leurs loges cent lions qu'il tua tous les uns après les autres avec pareil nombre de javelots. Ils demeurèrent longtemps étendus sur le sable, et on put les compter à loisir. Jusque là il n'y avait rien que de supportable ; et quoique toutes ses actions ne fussent guère dignes de la majesté d'un empereur, elles avaient d'ailleurs un air de force et d'adresse qui ne déplaisait pas au peuple. Mais lorsqu'on le vit paraître tout nu dans l'amphithéâtre, et entrer en lice avec des gladiateurs, ce fut pour le peuple même un triste spectacle. On ne put sans horreur et sans indignation voir un empereur dont le père et les ancêtres avaient remporté tant de fois l'honneur du triomphe, au lieu de s'armer à la romaine et de porter la guerre chez les Barbares, déshonorer la pourpre et la majesté de l'empire, et paraître aux yeux de tout le monde dans le rôle infâme d'un gladiateur. Au reste, dans ces combats il était toujours le victorieux ; on n'en venait pas jusqu'aux blessures ; chacun à l'envi se faisait honneur de lui céder, et reconnaissait le prince sous cette figure empruntée. Il quitta le nom d'Hercule, et prit celui d'un fameux gladiateur qui était mort depuis peu. A la folie il voulut joindre l'impiété ; ayant fait ôter la tête de cette grande statue du Soleil, de tout temps si révérée par les Romains, il fit mettre la sienne à sa place ; et sur le piédestal, au lieu des qualités qu'il tenait de son père et que lui donnait sa dignité, il mit pour inscription : «Commode victorieux de mille gladiateurs.»
Il était temps enfin que ces extravagances cessassent et que l'empire fût délivré de ce tyran. Le premier jour de l'année, les Romains célèbrent une fête en l'honneur de Janus, le plus ancien de leurs dieux. Ils disent que ce fut lui qui reçut dans sa maison Saturne lorsque, détrôné par Jupiter son fils, il vint sur la terre, et que de là son pays fut appelé Latium, parce que ce dieu s'y était tenu caché. C'est pour cela encore que les saturnales sont immédiatement suivies de la fête de Janus, qu'ils représentent avec un double visage, pour faire entendre que par lui commence et finit l'année. Le jour de cette solennité, les Romains se rendent des visites mutuelles et se font des présents, ou en argent, ou en bijoux. C'est ce même jour que les consuls désignés entrent en charge et prennent les marques de leur dignité. Commode se mit donc en tête de sortir ce jour-là en cérémonie, non de son palais selon la coutume, mais du lieu des exercices, et de quitter la robe impériale pour se montrer au peuple armé de pied en cap et précédé de tous les gladiateurs. Il communiqua son dessein à Marcia : c'était de toutes ses concubines celle qu'il aimait et considérait le plus, et elle avait tous les honneurs des impératrices, à la réserve du feu qu'on ne portait pas devant elle. Cette femme, surprise d'une pensée si bizarre, se jeta à ses pieds, et les arrosant de ses larmes, elle le conjura de se souvenir de ce qu'il était, et de ne pas exposer son honneur et sa vie en livrant sa personne à des misérables sans nom et sans aveu. Mais après beaucoup d'insistances redoublées, n'ayant pu rien gagner sur lui, elle fut obligée de se retirer. Il fit ensuite appeler Laetus, le chef des cohortes prétoriennes, et Electus, son chambellan, et les chargea de lui faire meubler un appartement dans la maison des gladiateurs. Ces officiers employèrent à leur tour les remontrances et les prières pour le faire revenir de cette manie.
Commode, choqué de ce que personne n'entrait dans ses pensées, les renvoya et s'en alla dans sa chambre vers midi, comme pour y dormir à son ordinaire. Il prit une cédule faite d'une petite peau de tilleul fort mince, repliée en deux et roulée des deux côtés. Il écrivit dessus les noms de tous ceux qu'il voulait faire tuer la nuit suivante. A la tête étaient Marcia, Laetus et Electus ; suivait après une grande liste des sénateurs les plus distingués. Il voulait se défaire de ce qui restait des anciens amis de son père : leur présence le gênait, il appréhendait leur censure, et il était bien aise de n'avoir plus pour témoins de ses indignités des personnages si graves et si sérieux. Il avait mis sur la même cédule plusieurs personnes riches dont il voulait confisquer les biens pour en faire des largesses aux gladiateurs et aux soldats ; à ceux-ci afin qu'ils gardassent sa personne avec plus de vigilance et de fidélité, et à ceux-là afin qu'ils contribuassent avec plus d'ardeur à ses plaisirs. Il laissa cette cédule sous le chevet de son lit, ne s'imaginant pas que personne dût entrer dans sa chambre. Il avait à sa cour un de ces petits enfants qui servent aux plaisirs des Romains voluptueux, qu'on tient à demi nus, et dont on relève la beauté par l'éclat des pierreries. Il aimait celui-ci éperdument, et le faisait appeler Philocommode, afin que son nom même exprimât la passion qu'il avait pour lui. Cet enfant étant entré dans la chambre pendant qu'il était au bain, cherchant de quoi jouer, trouva le billet dont nous avons parlé, et l'emporta avec lui. Marcia le rencontra heureusement ; elle l'embrassa, le baisa, et après l'avoir caressé, lui ôta ce billet, appréhendant que ce ne fût quelque papier d'importance. Elle reconnut d'abord la main de l'empereur, ce qui augmenta sa curiosité ; mais lorsqu'elle eut lu l'arrêt de sa mort, et les noms de Laetus, d'Electus et de tant d'autres personnes de qualité, elle dit en jetant un profond soupir :
«Courage, Commode ! ne te démens point. Voilà le prix de ma tendresse et de la longue patience avec laquelle j'ai supporté tes brutalités et tes débauches ! Mais il ne sera pas dit qu'un homme toujours enseveli dans le vin préviendra une femme sobre et qui a toute sa raison.»
Elle fit aussitôt appeler Electus : sa charge de chambellan lui donnait souvent l'occasion de la voir en particulier, et on les soupçonnait même d'avoir ensemble un commerce secret. «Voyez, lui dit-elle en lui présentant le billet, quelle nuit et quelle fête on nous prépare.» Il en fut étrangement surpris. C'était un Égyptien, homme violent, emporté et capable de tout. Après l'avoir lu, il le cacheta et l'envoya, par une personne de confiance, à Laetus, qui vint les trouver aussitôt, comme pour prendre avec lui des mesures sur les ordres que leur avait donnés l'empereur.
Ils conclurent d'abord qu'il fallait
prévenir Commode, s'ils ne voulaient périr eux-mêmes ; qu'il n'y
avait point de temps à perdre, que tous les moments étaient
précieux. Ils crurent que la voie du poison serait la plus sûre et
la plus facile ; Marcia se chargea de l'exécution. Lorsqu'il se
mettait à table, elle lui versait toujours le premier coup à boire,
afin que de la main d'une maîtresse le vin lui parût meilleur. Quand
il fut donc revenu du bain, elle lui présenta une coupe empoisonnée.
Ses exercices l'avaient fort altéré, et il l'avala sans qu'on fît
l'essai, n'ayant pas lieu de se défier d'une personne qui lui en
avait servi tant de fois. Sa tête s'appesantit à l'heure même ; il
crut que c'était un assoupissement causé par la fatigue de la
chasse, et s'alla mettre sur son lit. Marcia et Electus firent dire
en même temps que le prince avait besoin de repos, et qu'on se
retirât. Ce n'était pas la première fois que pareille chose lui
était arrivée : comme il était toujours dans la débauche, qu'il se
baignait souvent et mangeait à toutes les heures du jour, il n'avait
point de temps réglé pour le sommeil. Les voluptés le possédaient
les unes après les autres, et dans quelque temps, à quelque heure
que ce fût, souvent presque malgré lui, il s'abandonnait à des excès
dont il était devenu l'esclave. Après qu'il eut un peu dormi, et que
le poison eut commencé à agir sur l'estomac et sur les entrailles,
il s'éveilla avec un tournoiement de tête qui fut suivi d'un grand
vomissement ; soit que le vin et les viandes dont il s'était rempli
repoussassent le poison ou que, suivant la coutume des princes, il
eût pris quelque préservatif avant de se mettre à table. Cet
incident épouvanta les complices ; ils ne doutaient point qu'il ne
les fît mourir sur-le-champ, s'il en réchappait, et, pour parer ce
coup, ils persuadèrent à force de promesses à un esclave appelé
Narcisse d'entrer dans sa chambre et de l'achever. Cet homme, hardi
et vigoureux, trouva l'empereur affaibli par les efforts du
vomissement, et lui serra si fort le cou qu'il l'étrangla. Ainsi
finit Commode, après treize ans de règne ; prince qui, par la
grandeur de sa naissance ne le cédait à aucun de ses prédécesseurs,
comme en beauté et en bonne mine il surpassait tous les hommes de
son temps, et pour dire quelque chose qui ressente un peu le courage
et la force, l'homme le plus adroit de son siècle à tirer de l'arc ;
qualités qui auraient pu lui mériter quelque estime, si elles
n'eussent pas été obscurcies par tant de vices et d'inclinations
indignes d'un empereur.