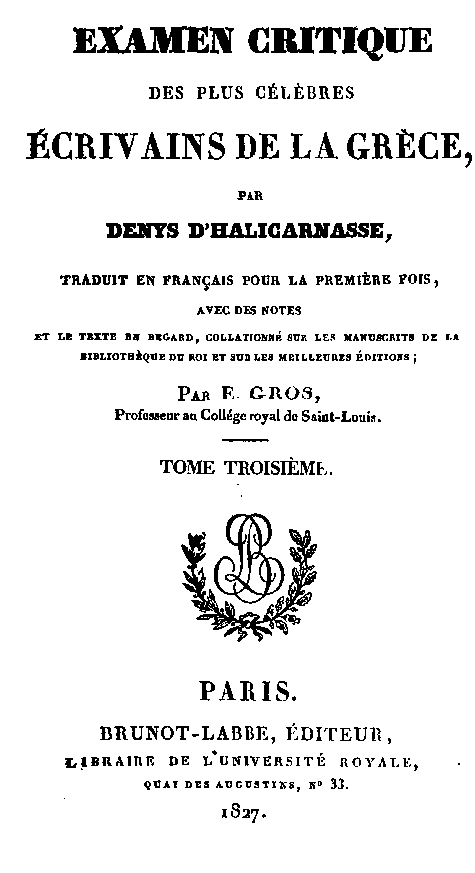|
ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE DENYS D'HALICARNASSE
DENYS D'HALICARNASSE
SUR L'EXCELLENCE DE L'ÉLOCUTION DE DÉMOSTHÈNE. Pour avoir le texte grec d'un chapitre, cliquer sur le chapitre
SUR L'EXCELLENCE DE L'ÉLOCUTION DE DÉMOSTHÈNE. SOMMAIRE. I. Exemple tiré de Thucydide. - II. Du style simple. - III. Du style moyen ou tempéré. - IV. Style d'Isocrate. - V-VII. Style de Platon. - VIII-IX. Style de Démosthène. - X. En quoi il diffère de celui de Thucydide.— XI-XV. En quoi il se rapproche de celui de Lysias. - XVI. Démosthène comparé avec Isocrate et Platon. - XVII-XX. Parallèle du style d'Isocrate avec celui de Démosthène. -XXI-XXII. Exemple du style de Démosthène. - XXIII-XXX. Examen du style de Platon; exemple. - XXXI-XXXIII. Parallèle du style de Démosthène avec celui de Platon. - XXXIV- XXXVI. En quoi Démosthène leur est supérieur. - XXXVII. Quels sont les trois caractères les plus remarquables de l'élocution. -XXXVIII-XXXIX. Caractère de l'élocution austère. - XL. Caractère de l'élocution douce. - XLI. Caractère de l'élocution moyenne. - XLII-XLIII. Démosthène a choisi l'élocution moyenne. - XLIV-XLVI. Pour quelles raisons il ne suit pas toujours la même marche. - XLVII-XLIX. Comment il est parvenu au meilleur genre d'élocution. - L-LII. A quels signes on peut reconnaître la manière de Démosthène. - LIII-LIV. Comment il donne de l'éclat à son éloquence par l'action oratoire. - LV-LVIII. Sur certains reproches faits à Démosthène. I. « Les villes étaient la proie à la sédition : celles qui s'y livraient les dernières, instruites des excès commis par les autres, mettaient toute leur industrie à se signaler par des attaques d'un nouveau genre, ou par l'atrocité des vengeances. Elles changeaient l'acception ordinaire des mots destinés à caractériser les actions, et les désignaient par d'autres. L'audace inconsidérée fut traitée de courage intrépide pour ses amis; la lenteur prévoyante, de lâcheté décorée d'un beau nom. La modestie fut regardée comme une pusillanimité; et une sage circonspection, comme une lenteur incapable de rien entreprendre : une aveugle témérité devint le trait caractéristique de l'homme de coeur. Délibérer mûrement pour ne rien entreprendre au hasard, c'était un prétexte honnête pour ne pas s'engager : l'homme violent fut un homme sûr; celui qui le contrariait, un homme suspect. Dresser des embûches et réussir, c'était avoir de l'esprit; les prévenir, c'était en avoir davantage ; prendre ses mesures d'avance, pour n'être jamais obligé de recourir à tous ces artifices, c'était trahir l'amitié et avoir peur des ennemis. Prévenir un adversaire prêt à nuire, ou pousser à mal faire un citoyen qui n'y pensait pas, c'était mériter des éloges. Les amitiés de parenté furent moins respecttées que les amitiés de faction, parce que celles-ci sont disposées à tout oser, sans jamais alléguer d'excuse. Les associations ne se formaient plus pour le maintien de lois établies, mais dans des vues de cupidité contraires aux lois. Ceux qui entraient dans ces ligues fondaient leur confiance réciproque non pas sur le nom des dieux témoins de leurs serments, mais sur des crimes qui rendaient leurs intérêts communs. On adoptait quelquefois ce que disait de bien le parti opposé, mais c'était pour se tenir en garde contre lui, s'il arrivait qu'il prit le dessus, et non par générosité. Le plaisir de la vengeance paraissait plus désirable que l'avantage de n'avoir pas reçu le premier une offense. Si quelquefois on faisait des serments de réconciliation, ils n'étaient respectés que pour le moment, parce qu'on se trouvait dans une crise violente et qu'on n'avait pas d'autre ressource. » Voilà un exemple de cette diction extraordinaire, pompeuse, pleine d'art et surchargée d'ornements empruntés : Thucydide peut être regardé comme la règle et le modèle de ce genre de style; aucun écrivain après lui ne l'a porté aussi loin, aucun même ne s'en est rapproché. II. L'autre genre de style simple, sans art, et qui dans sa formes et pour les effets qu'il produit, offre une grande ressemblance avec le style ordinaire, a été cultivé par plusieurs auteurs célèbres; historiens, philosophes ou orateurs. Les écrivains qui ont composé des généalogies ou d'histoires locales; ceux qui nous ont laissé des traités de physique ou des discours sur la morale ; et dans cette dernière classe il faut ranger tous les disciples de Socrate, excepté Platon; enfin, les orateurs qui ont écrit des harangues politiques on judiciaires, en ont fait presque tous usage. Lysias, fils de Céphalus, contemporain de Gorgias et de Thucydide, l'a perfectionné et lui a donné toute la beauté dont il est susceptible. Dans un autre traité, j'ai parlé du talent de cet orateur et du caractère de son éloquence : je ne crois pas nécessaire de m'en occuper de nouveau. Il suffira de dire que Lysias et Thucydide forment à eux deux l'harmonie entière qu'on appelle diapason. Ils se partagèrent les deux extrémités les plus opposées de l'élocution et s'attachèrent avec le plus grand soin à les perfectionner. Il y a entre la diction de l'un et la diction de l'autre le même rapport qu'entre la Néte et l'Hymne. Thucydide frappe vivement l'âme, Lysias la remplit de sensations calmes. Le style de l'un tend l'esprit et le tient en éveil ; le style de l'autre le charme doucement et lui donne du relâche. Thucydide fait naître les émotions les plus vives, et Lysias les émotions douces. Le premier renverse, entraîne tout ; le second se glisse imperceptiblement dans l'âme, et comme à notre insu. L'historien se distingue par les formes les plus hardies et les plus extraordinaires; l'orateur, par une marche simple et circonspecte : loin de courir après l'art, il s'efforce de le cacher. Leur style est travaillé avec le plus grand soin, et chacun dans son genre est arrivé à la perfection ; mais l'un veut paraître au-dessus de ce qu'il est, et l'autre au-dessous. Je ne crois pas nécessaire de transcrire des exemples en ce moment. Ces deux genres de style sont très diférents : les écrivains qui, suivant moi, les ont employés avec le plus de succès me paraissant mais ils ne présentent pas une entière ressemblance. III. Il est un troisième genre de style où les deux autres viennent se mêler et se confondre. Est-ce Thrasymaque de Chalcédoine, comme le croit Théophraste, qui l'a inventé et conduit au point où nous le voyons, ou bien est-ce tout autre? Je ne peux rien affirmer à cet égard. Quant aux écrivains qui l'ont adopté et qui, par leurs ouvrages, l'ont à-peu-près porté à toute sa perfection, ce sont parmi les orateurs, Isocrate d'Athènes, et parmi les philosophes, Platon, disciple de Socrate. A l'exception de Démosthène, il est difficile de trouver des écrivains qui aient mieux observé une juste mesure et donné plus heureusement à leur style les grâces et tous les ornements de l'art. Thrasymaque, dont il me reste à parler, semble avoir attaché à ce style tempéré le plus grand prix : sa diction est un sage mélange de ce qu'il y a de plus parfait dans le etyle élevé et dans le style simple. L'exemple suivant, qui est tiré d'une harangue politique, prouve qu'il ne s'attacha pas à un seul et même genre. « Athéniens, je voudrais vivre à cette époque et dans ces conjonctures, où il suffisait à la jeunesse de se taire, lorsqu'aucune affaire ne l'obligeait à prendre la parole, parce que la république était bien gouvernée par les vieillards. Mais une sorte de fatalité nous a fait naître dans un temps où nous ne pouvons connaître que par tradition la prospérité de la patrie; tandis que nous sommes témoins de ses désastres, et que les plus grands ne peuvent être imputés ni aux dieux, ni à la fortune, mais à nos magistrats : la nécessité me force donc à rompre le silence. Il faut être stupide ou patient à l'excès pour aller au-devant de la méchanceté du premier venu, et fournir soi-même in aliment à la perfidie et à l'injustice d'autrui. Le passé le prouve assez : c'est parce que, même au milieu des dangers, nous nous sommes jusqu'à ce moment contentés du passé, dans la crainte d'un plus triste avenir, que nous avons eu la guerre au lieu de la paix, et que, loin de vivre dans l'union, nous avons été entraînés à des haines et à de mutuelles dissensions. Les autres peuples ne s'abandonnent à de tels excès et aux divisions qu'au sein de la bonne fortune : nous, au contraire, sages dans la prospérité, nous nous livrons aux aveugles transports de la discorde dans l'adversité, qui d'ordinaire rend les hommes plus sages. Que pourra penser ou dire le citoyen accoutumé à s'affliger du sort de la patrie et à le regarder comme désespéré? Comment pourra-t-il affirmer que de semblables désastres ne viendront pas l'accabler encore ? Je prouverai d'abord que les orateurs et ceux qui délibèrent sont loin de s'entendre : ils en sont venus au point où doivent aboutir tous ceux qui ne prennent point la raison pour arbitre dans leurs discussions. Persuadés qu'ils soutiennent des opinions contraires, ils ne voient pas qu'ils pensent de la même manière, et que l'opinion de l'un est renfermée dans l'opinion de l'autre. Examinez, dans son principe, ce qu'ils veulent tous. La cause première de leurs débats, c'est la constitution de la république : elle est pourtant bien utile à connaître et commune à tous les citoyens. C'est de nos ancêtres que nous devons apprendre les choses que nous ne pouvons savoir que par tradition; quant à celles que les vieillards ont pu voir eux-mêmes, c'est à eux à nous les faire connaître, puisqu'ils en sont bien instruits. » Telle est la diction de Thrasymaque : on y trouve un heureux mélange du style élevé et du style simple; ou plutôt, c'est la limite placée entre l'un et l'autre. IV. Quant au style d'Isocrate dont le nom brilla d'un grand éclat dans la Grèce, et qui, s'il ne prononça des discours ni au barreau, ni dans les assemblées publiques, en composa du moins plusieurs dans tous les genres d'éloquence, j'ai montré quel est son caractère, et j'en ai exposé toutes les qualités. Mais rien n'empêche de rappeler ici les plus importantes. Il a la pureté et la correction de Lysias : il n'admet. ni les mots surannés, ni les mots étrangers ou nouveaux : les termes usités et ordinaires sont les seuls qu'il emploie. Il excelle à peindre les moeurs et se distingue par le naturel et la grâce. Il fuit le style figuré et s'attache au style simple, comme Lysias. Il emprunte quelquefois à Thucydide et à Gorgias le pompe, la grandeur et l'élévation. Quand il faut mettre dans tout son jour une question sous les yeux de l'auditeur, il imite la simplicité et le naturel de Lysias; mais lorsqu'il vise à frapper par la beauté de l'expression et à donner aux choses de l'élévation et de la noblesse, il emprunte à Gorgias la recherche et les ornements affectés de son style; il échoue toutes les fois qu'il veut rehausser son style par des figures puériles, Les antithèses, les périodes à membres symétriques, et les autres ornements tout aussi futiles dégradent son style, parce qu'il les prodigue outre mesure et à contre-temps; surtout, quand pour donner à la phrase la mélodie et le nombre du vers, il évite avec circonspection la rencontre des voyelles et tout ce qui pourrait troubler la douceur des sons. Il met tous ses soins à présenter sa pensée, non pas sous une forme vive et arrondie, mais sous une forme séduisante, mais lâche : en un mot, il ressemble à ces fleuves qui, loin d'avoir un cours direct, sont coupés par de nombreuses sinuosités. Ces ornements affectés rendent la période lente, désagréable et froide : ils conviennent plutôt aux discours d'apparat qu'aux discussinus vives. Je citerai quelques passages d'Isocate, quand le moment favorable sera venu. V. Le style de Platon participe en même temps du sublime et de la simplicité, comme je l'ai déjà observé ; mais il ne les manie point avec le même succès. Tant qu'il s'en tient à un style simple, naïf et sans art, sa composition est agréable, délicieuse au-delà de toute expression. Elle est pure et transparente, comme la source la plus limpide : elle l'emporte en correction et en élégance sur toutes les compositions du même genre. Il emploie les mots usités, s'attache à la clarté et dédaigne tous les ornements recherchés. Dans son style, il se mêle imperceptiblement je ne sais quoi d'inculte et d'antique, qui répand sur tout les grâces, la fraîcheur et l'éclat : son langage, doux et suave, est à l'oreille ce qu'est à l'odorat le parfum qu'exhale une prairie émaillée de mille fleurs ; jamais il n'emploie les mots bruyants ni les ornements de théâtre. Mais dès qu'il veut s'élever au grand et au sublime, ce qui lui arrive souvent, son style se précipite avec une rapidité que rien ne règle, et il tombe bien au-dessous de lui-même : il est moins doux, moins pur, et devient même lourd ; sa diction s'obscurcit et semble se couvrir de nuages : elle est diffuse et jette l'esprit dans le vague. Là où la pensée devrait être rendue avec concision, elle est noyée dans des périphrases fastueuses et dans une abondance de mots stériles. Il abandonne les expressions propres et sanctionnées par l'usage, pour des expressions nouvelles, étrangères ou surannées. Il court après les figures gigantesques et prodigue lés épithètes et les métonymies : ses métaphores sont forcées et contraires à l'analogie. Il emploie des allégories longues, fréquentes, et qui manquent de mesure et d'à-propos : enfin, il est surchargé de tours poétiques qui enfantent le dégoût; et surtout de ces formes introduites par Gorgias, toujours déplacées et toujours puériles. Il les entasse avec une sorte de luxe, comme le lui ont reproché Démétrius et d'autres critiques; car ces observations ne sont pas de moi. VI. Et qu'on ne pense pas que je blâme tous les ornements dont Platon fait usage, et cette heureuse variété qu'il sait donner à sou style : je ne suis ni assez barbare ni assez ignorant, pour refuser du mérite à ce grand écrivain. J'ai remarqué chez lui une foule de passages d'une rare beauté, et qui décèlent un génie sublime : je veux seulement prouver que les défauts dont je viens de parler, déparent ordinairement ses ouvrages, et qu'il reste au-dessous de lui-même toutes les fois qu'il vise au grand et au beau ; tandis qu'il laisse bien loin tous ses rivaux, lorsque, s'attachant à une diction simple, correcte et sans art, il emploie des ornements naturels : il ne faillit presque jamais, ou bien ses fautes sont légères et ne méritent pas d'être relevées. Je croyais qu'un tel écrivain s'était toujours tenu en garde contre le blâme; cependant, les critiques, ses contemporains (et il n'est pas nécessaire de citer leurs noms), blâment en lui ces défauts : il se les reproche lui-même, tout le monde le sait. Il parait avoir reconnu l'enflure de son style, et il le qualifie de dithyrambique; expression que j'aurais craint d'employer, quoique ce soit l'expression propre. A mon avis, ces défaute viennent de ce que Platon, formé d'abord à la diction simple et correcte de Socrate, n'y resta pas toujours fidèle. Il fut séduit par la manière de Gorgias et de Thucydide ; et il n'est pas étonnant qu'il ait imité les défauts qui se trouvent mêlés aux bonnes qualités de ces grands écrivains. VII. Je vais citer une de ses compositions dans le genre sublime; c'est l'un de ses dialogues les plus célèbres : il roule sur des questions d'amour adressées par Socrate à Phèdre, son disciple, qui a donné son nom à cet écrit. Il offre de grandes beauté; le début surtout est plein de grâces :
« Où vu-tu, et d'où
viens-tu, mon cher Phèdre ?
» Le même ton se soutient jusqu'à la lecture du discours de Lysias, et même un peu au-delà; mais ensuite, sa diction, naguères aussi pure que le ciel, quand il est sans nuage, se trouble comme l'air dans un temps d'orage, pendant les chaleurs de l'été, et se précipite à travers toutes les hardiesses du langage poétique; par exemple, quand il dit : « Muses, soit que la douceur de votre éclatante voix, soit que votre origine vous ait fait surnommer les filles de l'harmonie, inspirez moi. » Ces paroles ne forment que de vains sons, et ne peuvent trouver leur place que dans le dithyrambe; ce sont des mots stériles, qui ne renferment aucun sens : Platon l'avoue lui-même. En exposant les raisons qui ont fait donner le nom d'ἔρως à l'amour, il dit :
« Étrangère à la raison, et maîtresse de ce mouvement de
l'âme qui nous porte à la
vertu, cette passion nous subjugue par les attraits de la volupté : nous détachant de nos inclinations naturelles, pour nous enchaîner aux plaisirs des
sens, elle prend sur nous un
grand ascendant et nous retient sous son joug: c'est du nom de la force même qu'elle tire le sien, et qu'elle a été appelée
ἔρως. Mais, ô mon cher Phèdre! trouves-tu, comme moi, que je suis transporté par un souffle divin
? »
Plus loin, Socrate, dans sa Palinodie, rétracte ce qu'il a dis contre l'amour et commence en ces mots: « Le maître des cieux, Jupiter, porté sur un char ailé, s'avance le premier, réglant tout et veillant à tout. A sa suite, parait l'armée des dieux et des génies, divisée en onze rangs : Vesta seule reste dans le céleste séjour; les autres dieux, qui forment la classe des douze dieux des grandes nations, se rendent au poste qui leur est assigné. Ainsi s'accomplissent dans le ciel, et parmi ses heureux habitants, mille phénomènes merveilleux et mille courses diverses : chacun remplit la tâche qui lui est imposée; chacun marche comme il veut, et sans que rien s'oppose à ses désirs ; car l'envie est bannie de l'immortel cortège.» Si ce passage et d'autres semblables qu'on trouve à chaque instant dans Platon, avaient la mesure et le nombre du vers, comme les dithyrambes et les chants destinés aux danses, on pourrait les comparer à cette ode Pindare sur le soleil :
Soleil dont les regards embrassent la nature,
C'est toi qui des mortels ranimes la faiblesse;
Au nom de Jupiter, que tes coursiers rapides
Daigne écouter mes vœux ; et qu'ici ta présence
Effroi de l'univers, à la terre tremblante
Surchargé de vapeurs, le front ceint de nuages,
VIII. IX. Cette opinion est-elle fondée? On le verra, en examinant les discours de Démosthène, sous le double rapport du style et des pensées. Je vais citer un passage où il imite Thucydide : « Athéniens, on prononce de nombreux discours dans presque toutes vos assemblées sur les injustices dont Philippe, depuis la conclusion de la paix, s'est rendu coupable envers vous et envers les autres peuples de la Grèce. Vous reconnaissez tous, je le sais, mais vous le reconnaissez sans rien faire, que nous devons parler et agir pour mettre enfin un terme à son insolence, et pour qu'il en soit puni. Aussi, notre position est telle que je dois craindre de passer pour un calomniateur, en avançant (quoique ce soit la vérité ), que si les orateurs qui montent à cette tribune, vous donnaient les conseils les plus funestes et si vous les appuyiez par vos suffrages, la république ne serait pas dans un plus triste état. » En quoi ce style ressemble-t-il au style de Thucydide? Par les qualités mêmes, qui placent celui-ci au-dessus des autres écrivains; c'est-à-dire, en ce que les pensées ne sont point présentées sous une forme ordinaire, simple et sans figure, et qu'à la place d'un langage usité et sans art, nous trouvons un style nouveau et qui n'a rien du ton prescrit par la nature. Cette assertion est fondée. La diction de Démosthène aurait été simple et correcte, s'il se fût exprimé de cette manière : « Πολλῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, λόγων γιγνομένων καθ´ ἑκάστην σχεδὸν ἐκκλησίαν, περὶ ὧν ἀδικεῖ Φίλιππος ἐς ὑμᾶς τε καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, ἀφ´ οὗ τὴν εἰρήνην ἐποιήσατο. » Mais il met ὀλίγου δεῖν à la place de σχεδόν ; il sépare les mots ἀδικεῖ Φίλιππος de leurs corrélatifs , par de longs intervalles , et dit « Οὐ μόνον ὑμᾶς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας », quoiqu'il pût se passer de la négation, au moyen des copulatives : il a voulu donner à la phrase un tour extraordinaire et recherché. Dans le passage suivant, s'il eût été jaloux de s'exprimer simplement et sans affectation, il devait dire à-peu-près : « Ἅπάντων λεγόντων, καὶ εἴ τινες τοῦτο μὴ ποιοῦσιν *** δεῖ καὶ λέγειν, καὶ πράττειν ταῦτα, ἐξ ὧν ἐκεῖνος παύσεται τῆς ὕβρεως καὶ δίκην δώσει. » Il en est de même de celui–ci : « Καὶ πάντων εὖ οἶδ´ ὅτι φησάντων γ´ ἄν » ; la construction régulière n'y est pas observée : les mots οἶδ´ ὅτι n'étaient pas nécessaires, et ceux-ci : φησάντων γ´ ἂν, au lieu de γασκόντων, n'appartiennent pas au style ordinaire : ils ont quelque chose d'étrange et de recherché. On peut en dire autant de ce passage : « Εἶτ´ οἴεσθε, οἳ μὲν οὐδὲν ἂν αὐτὸν ἐδυνήθησαν ποιῆσαι κακόν, αὐτοὶ δὲ μὴ παθεῖν ἐφυλάξαντ' ἂν ἴσως, τούτους μὲν ἐξαπατᾶν αἱρεῖσθαι μᾶλλον, ἢ προλέγοντα βιάζεσθαι; Pensez-vous que si des peuples qui, loin de faire aucun mal à Philippe, ne cherchèrent jamais qu'à se mettre à l'abri de ses attaques, ont été tout à coup les victimes de sa perfidie, et non pas d'une violence dès longtemps annoncée, ce tyran ne vous déclarera la guerre qu'après vous en avoir avertis ? » Il n'y aurait eu rien de forcé, rien de contourné, s'il eût dit : « Εἶτ´ οἴεσθε αὐτόν, οὓς μὲν ἑώρα μηδὲν δυναμένους αὐτῶν, αὐτὸν διαθεῖναι κάκιον, φυλαξαμένους δὲ ἂν ἴσως μὴ παθεῖν, τούτους μὲν ἐξαπατᾶν αἱρεῖσθαι μᾶλλον, ἢ προλέγοντα βιάζεσθαι; » Mais la confusion des cas et la multiplicité des conjonctions dans quelques lignes me paraissent donner au style une marche pénible, extraordinaire, et même étrange. Ces observations s'appliquent surtout à ce passage : « Νῦν δὲ τοῦτο μὲν οὐκ ἐποίησεν, ἐν ᾧ τὸν δῆμον ἐτίμησεν ἄν, οὐδ´ ἐνεανιεύσατο τοιοῦτον οὐδέν. Ἐμοὶ δέ, ὅς, εἴτε τις, ὦ Ἀθηναῖοι, βούλεται νομίσαι μανίαν. μανία γὰρ ἴσως ἐστὶν ὑπὲρ δύναμίν τι ποιεῖν·, εἴτε καὶ φιλοτιμίαν· χορηγὸς ὑπέστην· οὕτω φανερῶς καὶ μιαρῶς ἐπηρεάζων παρηκολούθησεν, ὥστε μηδὲ τῶν ἱερῶν ἱματίων, μηδὲ τοῦ χοροῦ, μηδὲ τοῦ σώματος, τὼ χεῖρε τελευτῶν ἀποσχέσθαι μου. Il n'a rien fait de ce qui pouvait honorer le peuple; il n'a donné aucune preuve de sa magnificence; mais, Athéniens, lorsque, peutêtre par un trait de folie (car il y a de la folie à entreprendre une chose au-dessus de ses forces), peut-être aussi par générosité, je me suis présenté pour être chorège, il m'a poursuivi avec acharnement et d'une manière atroce : il a osé me dépouiller de mes vêtements sacrés, et porter ses mains impies sur ma personne et sur le choeur. » En quoi ce style s'éloigne-t-ii du langage de la nature ? D'abord, en ce que l'orateur, avant de compléter ce qu'il avait commencé, soit qu'on l'envisage comme une pensée entière, ou bien comme la partie d'une pensée, parle d'une chose nouvelle ; qu'avant d'achever celle-ci, il en ajoute une troisième, et met la suite de la seconde après la fin de la troisième : ce n'est qu'après avoir complété toutes les autres qu'il donne la fin de la troisième, lorsque l'esprit en est tout-à-fait détaché. Les mots Ἐμοὶ γὰρ ὃς ne présentent pas un sens complet, et ceux-ci : « Εἴτε τις, ὦ Ἀθηναῖοι, βούλεται νομίσαι μανίαν », forment un membre de phrase séparé du premier, et auquel il manque quelque chose. Le suivant : « Μανία γὰρ ἴσως ἐστὶν ὑπὲρ δύναμίν τι ποιεῖν », ne se rapporte à aucun des deux qui précèdent et présente un sens par lui-même : c'est une maxime générale. Les mots εἴτε φιλοτιμίαν complètent le second membre « Εἴτε τις βούλεται νομίσαι μανίαν », et ceux-ci χορηγὸς ὑπέστην, qui terminent la période, sont le complément du premier : « Ἐμοὶ γὰρ ὅς ». Il y a dans Démosthène mille passages semblables, surtout dans les Philippiques : ou plutôt, on n'en trouve chez lui qu'un très petit nombre qui soient exempts de ce défaut, si ce n'est dans un seul de ses discours intitulé : sur l'Halonèse. Les discours sur des causes judiciaires, qui tenaient aux affaires publiques, en offrent aussi plusieurs ; à vrai dire, c'est là. seulement et dans les harangues politiques qu'il faut les chercher. Comme je l'ai déjà dit, il n'est pas de signe plus certain pour reconnaître le style de Démosthène. Si l'on pense qu'il s'en est plus ou moins servi, d'après la nature du sujet ou la dignité des personnages, on est dans l'erreur : cependant, cela devrait être. X. Montrons maintenant en quoi le style de Démosthène s'éloigne de celui de Thucydide qu'il a pris pour modèle. Cette question se rapporte directement à mon sujet : je n'ai pas l'intention de faire voir par quels traits ils se ressemblent, puisqu'ils visent tous les deux au même but; c'est-à-dire, à s'écarter du style approuvé par l'usage et à employer, au lieu du langage ordinaire, une diction recherchée. Je veux seulement examiner jusqu'à quel point ils diffèrent l'un de l'autre, surtout pour l'à-propos. Thucydide prodigue, outré mesure , toutes les finesses de l'art : il en est l'esclave, plutôt qu'il ne les maîtrise; il ne sait jamais dans quelles circonstances il doit s'en servir; souvent même, il choisit mal le moment. Cet emploi excessif d'une diction affectée produit l'obscurité ; et ce manque de discernement, dans le choix des circonstances, rend le style désagréable. Démosthène, au contraire, a toujours devant les yeux le point où il doit s'arrêter, et saisit l'instant favorable : il ne se borne pas, comme l'historien, à un style pompeux et propre à séduire; il a surtout en vue l'utilité. Aussi, ne s'éloigne-t-il point de la clarté, la première de toutes les qualités dans les discussions du barreau : partout, on retrouve aussi chez lui cette vigueur à laquelle il attachait tant de prix. Tels sont les traits principaux qui caractérisent cette diction noble, travaillée, extraordinaire, et qui tire son principal mérite de la véhémence : Démosthène y est parvenu, en marchant sur les traces de Thucydide qui seul en offrait d'heureux exemples. XI. Quant à la simplicité, à la correction, à la pureté et autres qualités du style qu'on pourrait désigner par le nom même de l'orateur qui les a portées au plus haut degré, je veux dire Lysias, voyons jusqu'à quel point elles se trouvent dans Démosthène. Rien ne m'empêche de citer d'abord quelques passages de Lysias et de rapporter ensuite ceux de Démosthène qui en approchent le plus ; peut-être même, cette marche rendra-t-elle mon traité plus agréable. C'est la narration tirée d'un discours concernant des outrages : « Athéniens, Archippus et Tisis, qui est accusé, descendirent dans la même lice. Une vive dispute s'élève; et bientôt ils en viennent aux invectives, aux discussions, à la haine et aux outrages. Pythéas (car je vous dirai la vérité tout entière) entretenait des liaisons criminelles avec Tisis, à qui son père l'avait donné pour tuteur. Pythéas, aussitôt que Tisis lui eut raconté les insultes qu'il avait reçues, dans la lice, jaloux de lui être agréable et de paraître adroit et rusé, l'engagea, comme nous l'avons appris par l'événement et de ceux même qui savent ce qui s'est passé, à se réconcilier en apparence avec Archippus mais à épier l'occasion de le surprendre seul. Tisis suivit ce conseil, fit la paix avec Archippus, vécut en intimité avec lui et feignit d'être son ami... Après avoir dîné, et lorsque la nuit commençait, nous sortîmes ensemble et nous vînmes frapper à leur porte. Ils nous font entrer, mais à peine sommes-nous dans l'intérieur de la maison, qu'ils me chassent, saisissent Archippus et l'attachent à une colonne. L'un d'eux, armé d'un fouet, le déchire de coups et l'enferme dans une chambre. Ces mauvais traitements ne suffisent pas à Tisis; à l'exemple des jeunes gens les plus corrompus de la ville, et fier de la succession de son père qu'il venait de recueillir, il faisait le riche et le jeune : il ordonna à ses gens, qui avaient attaché Archippus à la colonne, de le fouetter une seconde fois, dès qu'il ferait jour. Quand son adversaire fut réduit à ce triste état, il mande Antimachus, et ne dit rien de ce qui s'était passé; seulement, il lui raconte qu'il était à souper, lorsque Archippus arriva, pris de vin, frappant les portes avec force, et il ajoute qu'à peine entré, il se permit le langage le plus indécent envers Antimachus et son épouse, ainsi qu'envers la sienne propre. Antimachus fut vivement choqué d'un procédé aussi inconvenant; il fit pourtant appeler des témoins, et, en leur présence, il demanda à Archippus pourquoi il était entré : celui-ci répondit que c'était sur l'invitation de Tisis et de ses gens. Ceux qui étaient venus avec Antimachus conseillent à Archippus d'en finir le plus tôt possible, et regardent ce qui s'était passé comme un événement malheureux : ils le remettent entre les mains de son frère. Comme il ne pouvait marcher, on le transporta sur un lit dans le digme, pour l'exposer, dans l'état où il se trouvait, aux regards des Athéniens et des étrangers; afin que tous ceux qui le verraient, fussent indignés contre les barbares qui avaient exercé sur lui un pareil traitement, et pussent blâmer la ville, où l'on ne punissait point, au nom de la patrie et à l'instant même, les hommes qui se rendaient coupables de pareils excès. » XII. Telle est la narration de Lysias dans le discours contre Tisis. Le morceau de Démosthène, que je vais citer, est tiré de la harangue contre Conon. Je ne dirai rien de la ressemblance qu'ils présentent par rapport aux choses : je les examinerai seulement sous le rapport du style. « II y a trois ans que je fus envoyé en garnison à Panacte avec d'autres citoyens. Près de nous se trouvait la tente des fils de Conon; et plût au ciel qu'il n'en eût pas été ainsi ! car ce fut la première source de notre inimitié et de nos disputes, comme vous allez l'apprendre. Après leur dîner, ils passaient le reste de la journée à boire : tout le temps que je suis resté à Panacte, ils ont tenu la même conduite. Pour moi, je vivais là, comme j'ai toujours vécu à Athènes ; eux, au contraire, étaient dans l'ivresse, à l'heure où tout le monde a coutume de se mettre à table. Ils commencèrent par insulter mes domestiques, et bientôt ils m'insultèrent moi-même. Sous prétexte que mes gens, en préparant le repas, les importunaient par la fumée, ou les accablaient des plus grossières injures, ils les frappaient et les couvraient d'ordures ; en un mot , ils se permettaient à leur égard les insultes les plus dégoûtantes. Témoin de tant d'insolences, et quelque affligé que j'en fusse, je dissimulai d'abord ; mais quand je me vis, moi-même en butte à leurs attaques, et comme ils n'y mettaient point de terme, je m'adressai au général; non pas seul, mais accompagné de tous ceux qui. vivaient avec moi et qui avaient aussi à se plaindre. Le général leur adressa de vifs reproches, blâma hautement leur conduite envers nous et envers l'armée tout entière. Eh bien, au lieu de se corriger ou d'éprouver quelque honte, le soir même, aussitôt qu'il fit nuit, ils m'attaquèrent encore : ils commencèrent par des injures et finirent par des coups. Ils poussaient de tels cris et faisaient tant de bruit autour de ma tente, que le général, quelques officiers et plusieurs soldats accoururent et empêchèrent qu'ils ne se portassent aux derniers excès contre moi, ou que poussé à bout par leurs violences je ne les leur fisse payer chèrement. Les choses en étaient à ce point, lorsque nous revînmes à Athènes : il existait entre nous des haines et des ressentiments, comme cela devait être; mais, j'en atteste les dieux, je ne pensais ni à lès appeler en justice, ni à leur demander raison de ce qui s'était passé : j'avais seulement résolu de me tenir sur mes gardes et de n'avoir plus aucun rapport avec des hommes de ce caractère. Je vais prouver, par les dépositions des témoins, la vérité de ce que j'ai avancé; ensuite, je vous ferai connaître tout ce que j'ai souffert de la part de mon ennemi. Par-là, vous verrez que loin de se repentir de ses premières injustices, il en a commis de plus révoltantes. - Déposition des témoins. - Tels sont les faits dont je ne croyais pas devoir demander raison. Peu de temps après, je me promenais vers le soir, suivant ma coutume, sur la place publique avec Phanostrate de Céphisie, qui est à-peu-près de mon âge. Ctésias, fils de Conon, vient à passer, dans un état complet d'ivresse, aux environs du Léocorium, non loin de la maison de Pythodore. A notre aspect, il pousse d'abord des cris, et puis murmure ensuite à voix basse quelques paroles, comme un ivrogne : nous ne pûmes comprendre ce qu'il disait. Il s'éloigne de nous et se dirige vers Mélite. Là, dans la maison du foulon Pamphile, Conon, un certain Théodore, Alcibiade, Spintharius, fils d'Eubulus, Théogénes, fils d'Andromène, et plusieurs autres, passaient le temps à boire. Ctésias les entraîne, accourt avec eux vers la place publique, et vient au devant de nous, au moment où, de retour du temple de Proserpine, nous nous promenions de nouveau sur la place, tout près du Léocorium : ils viennent au-devant de nous. Lorsque nous fûmes en sa présence, du milieu d'eux, un inconnu se jette sur Phanostrate et l'arrête. Conon, son fils, et le fils d'Andromène fondent sur moi, et commencent par me dépouiller: ils me saisissent par les cuisses, me traînent dans la boue et me foulent aux pieds, en me couvrant d'outrages : ils me fendent la lèvre, me remplissent les yeux de sang. et me laissent dans un si triste état que je ne pouvais ni me relever, ni proférer une parole: Couché à terre, j'entendis tous leurs propos : c'étaient des injures si grossières que je n'oserais les répéter. La preuve certaine que tous ces excès furent commis par son ordre et sous ses auspices, la voici : il chantait, comme les coqs qui célèbrent leur victoire; et ses compagnons le pressaient de se frapper les flans avec les coudes, pour imiter le battement des ailes. » XIII. Ce style n'est-il pas un modèle de pureté, de correction, de clarté et de l'emploi des mots propres et usités, comme celui de Lysias ? Pour moi, j'y trouve le même caractère. N'est-il pas concis, arrondi, naïf et remarquable par cette simplicité, qui exclut le travail et peint si bien la nature? Ces diverses qualités me paraissent réunies ici, au suprême degré. N'est-il point persuasif, n'exprime-t-il pas fidèlement les moeurs, ne se renferme-t-il pas dans les convenances prescrites pour les personnes et pour les choses ? La douceur, le. naturel , la grâce, l'à-propos ; en un mot les qualités qui embellissent le style de Lysias, n'y brillent-elles pas dans toute leur perfection ? Il me paraît difficile de soutenir le contraire. Si l'on ne connaissait point, par le titre, l'auteur de ce discours, et que le hasard les fit tomber entre nos mains, sans que rien. nous en indiquât le nom, je suis persuadé que fort peu de gens seraient à même de dire s'ils sont l'ouvrage de Démosthéne ou de Lysias; tant est grande la ressemblance qui existe entre l'un et l'autre. II en en de même : 1°. du discours pour Phormion contre Apollodore; 2. du discours contre Olympiodore accusé d'avoir causé du dommage ; 3°. du discours contre Boëtus, au sujet du nom; 4°. de l'appel contre Eubulide ; 5°. de la discussion contre Macartatus, et d'autres discours concernant de simples citoyens : on en compte vingt environ. Il suffit d'y jeter les yeux, pour reconnaître la justesse de mon opinion. Plusieurs de ses harangues politiques présentent le même caractère. Si je ne craignais que ce traité ne dépassât les bornes convenables, je pourrais montrer jusqu'à l'évidence, par des exemples, que Démosthène vise à la pompe ; à la grandeur et à toutes les finesses de l'art, bien plus qu'à la correction. Mais le discours intitulé Réponse à la lettre de Philippe et à ses Députés, auquel Callimaque donne pour titre sur l'Halonèse, et qui commence par ces mots : « Athéniens, il n'est point de motifs que Philippe puisse alléguer », se distingue par la correction et la simplicité : les formes du style de Lysias y sont copiées trait par trait ; la nouveauté de l'expression, la pompe, la véhémence, et les autres qualités qui constituent la manière de Démosthène s'y reproduisent rarement. Quelle différence y a-t-il donc entre ces deux orateurs , et par quelles qualités Démosthène, lorsqu'il reste fidèle à sen caractère, est-il supérieur à Lysias ? C'est une question dont la solution peut vous paraître intéressante : tâchons de la résoudre. Partout, comme je l'ai déjà dit, les discours de Lysias sont empreints d'une élégance et d'une grâce naturelles, qui le placent au-dessus des autres orateurs, à l'exception de Démosthène ; mais cette élégance, qu'on peut comparer au souffle léger du zéphir, ne l'accompagne pas au-delà de l'exorde et de la narration : à peine est-il arrivé à la confirmation, qu'elle devient faible et presque insensible ; elle s'évanouit tout-à-fait dès qu'il veut remuer les passions : car, elle manque de vigueur et de vie. Démosthène, au contraire, est plein de nerf, et il a assez de grâce; en sortes qu'il l'emporte sur Lysias par une supériorité assez marquée, pour l'élégante sagesse de ses compositions, et qu'il l'éclipse entièrement pour l'énergie. C'est le second trait caractéristique auquel on peut le reconnaître, quand il se renferme dans les limites convenables. Et en effet; s'il évite une diction étrange et nouvelle, les grâces affectées et tous les ornements d'emprunt, il ne néglige ni l'élévation ni la vigueur : elles se montrent toujours dans son .style, soit qu'elles fussent chez lui une qualité naturelle, soit qu'il les dût au travail. Il sait tantôt leur donner tout leur essor et tantôt les retenir dans une sage mesure, en respectant partout les convenances. Tout le monde est d'accord sur ce point. et je n'ai pas besoin d'exemples. XIV. Quant au style moyen, Démosthène le reçut imparfait, d'abord d'Isocrate ou de Thrasymaque, et ensuite de Platon. Mais il le perfectionna autant qu'on pouvait l'attendre d'un homme. On en trouve de nombreux exemples dans ses Harangues contre Philippe et dans ses autres discours politiques. L'apologie de Ctésiphon en renferme aussi plusieurs d'une grande beauté : elle me paraît écrite avec un style très remarquable et sagement tempéré. Si l'espace me le permettait, j'en rapporterais divers fragments; mais puisque j'ai laissé de côté beaucoup d'objets importants, je me bornerai encore ici aux citations les plus succinctes, comme il convient de le faire, en parlant à des lecteurs qui connaissent Démosthène. Voici donc quelques exemples du style moyen. Il dit dans le discours contre Eschine: « Nous devons en tout temps, Athéniens, accabler de notre haine et punir sévèrement les traîtres, et tous ceux qui se laissent corrompre par des présents : mais aujourd'hui surtout, en agissant ainsi, nous procurerons à tous les citoyens de grands avantages. Athéniens, un fléau terrible a fondu sur la Grèce; pour l'extirper, vous avez besoin que la fortune vous soit favorable et vous devez déployer toute votre vigilance. » Passons au discours contre Aristo¬crate : « Nous avons une foule d'institutions qui ne se trouvent chez aucun autre peuple. La première à laquelle on ne peut rein comparer, et la plus respectable de toutes, c'est le tribunal de l'Aréopage ; la fable, la tradition en racontent mille merveilles; et il en est plusieurs auxquelles nous pouvons rendre nous-mêmes témoignage, et qu'on ne saurait appliquer à aucun autre tribunal, etc. » Dans le discours sur les immunités, il dit : « Examinez d'abord s'il y a dans Conon et dans sa conduite quelque chose qui doive vous faire abroger les privilèges qui lui ont été accordés. D'après les dépositions de plusieurs témoins qui ont vécu de son remps, Conon, à l'époque où le peuple rentra du Pirée dans Athènes, et lordque notre ville était encore faible, etc. » Je termine ces citations par un passage de l'apologie de Ctésiphon : « Je ne dirai pas quelles contrées Philippe a soumises à sa domination, avant que je prisse part aux affaires publiques et que j'eusse commencé à prononcer des discours dans nos assemblées. Ces événements n'ont aucun rapport avec ma position, mais je parlerai des contrées dont il n'a pu se rendre maître, depuis que l'administration de la république m'a été confiée, et j'en rendrai compte; mais auparavant, Athéniens, je dois dire qu'un grand avantage s'est offert à Philippe : il a trouvé, non dans quelques contrées, mais chez tous les peuples de la Grèce un si grand nombre de traîtres, d'hommes avides de présents et ennemis des dieux que jamais on n'en vit autant ,etc...» XV. J'approuve surtout ce style sagement tempéré : si l'on me demande pourquoi je ne préfère ni la diction noble et extraordinaire de Thucydide, ni le style simple et coulant de Lysias, voici ma réponse. Les hommes qui se réunissent dans la palce publique, au bureau et dans les autres assemblées où doivent se prononcer des discours, ne sont pas assez graves et assez instruits pour s'élever à la hauteur du style de Thucydide ; ils ne sont pas non plus tout-à-fait grossiers, ou tout-à-fait insensibles aux charmes d'un discours travaillé avec soin. Les uns, pour se rendre aux réunions publiques, ont quitté les travaux de la campagne ou de la mer, et plusieurs, les arts mécaniques. L'orateur qui leur adresse un langage simple et ordinaire est sûr de les charmer ; tandis qu'une diction trop travaillée, pompeuse et qui s'éloigne du langage usité, les choque. De même que l'estomac rejette un assaisonnement ou une boisson désagréables ; de même, leur oreille est bientôt fatiguée de tous ces ornements. Les autres, au contraire , sont instruits , familiarisés avec l'éloquence politique, et initiés à toutes les connaissances : on ne peut donc leur parler le même langage. Il faut employer auprès d'eux un style soigné et qui joigne à l'éclat l'attrait de la nouveauté. Les auditeurs de cette dernière classe sont moins nombreux ou plutbt ils ne forment qu'une très faible minorité ; personne ne l'ignore, mais ce n'est pas une raison pour les perdre de vue. Le discours qui aura pour objet de plaire à ceux-ci ne persuadera point la multitude ignorante et grossière, comme celui qui méritera le suffrage de la multitude sera désapprouvé par les juges éclairés ; et l'orateur qui voudra plaire tout à la fois aux uns et aux autres ne contentera personne. Démosthène a su faire un sage mélange des deux autres genres de style ; et cet heureux tempérament, suivant moi, le place au-dessus de tous les orateurs : parmi ses discours, j'approuve surtout ceux où il évite l'emploi excessif de l'un et de l'autre. XVI. J'ai dit, en commençant, que Isocrate et Platon cultivèrent avec succès le genre moyen et qu'ils lui firent faire de grands progrès, sans le porter jus-qu'à la perfection. J'ai promis de prouver que Démosthène acheva ce qu'ils avaient laissé imparfait : je remplirai cet engagement, après avoir rapporté quelques morceaux de leurs plus beaux ouvrages. Je comparerai à ces extraits quelques fragments de Démosthène sur des sujets analogues, afin que le caractère de ces deux orateurs et de leur éloquence paraissent dans tout leur jour : le plus sûr moyen, pour bien les juger, est d'examiner avec soin comment ils ont traité des matières qui se ressemblent. XVII. Je citerai d'abord Isocrate, et je tirerai mes exemples du discours sur la paix. C'est la plus belle de ses harangues : Isocrate lui-même, dans son discours sur les échanges des biens, nous a fait connaître la haute idée qu'il en avait conçue. Dans cette harangue, il compare la forme du gouvernement d'Athènes dans les siècles passés avec la forme du gouvernement établie de son temps, et les moeurs anciennes avec celles de ses contemporains : il loue les unes, blâme les autres et trouve les causes de cette funeste révolution dans les menées des démagogues qui, loin de donner des avis salutaires, ne cherchaient qu'à plaire à la multitude. Comme ce parallèle est très étendu, je me borne aux passages propres à faire ressortir la justesse de mes observations : « Quel homme arrivant d'une contrée lointaine et encore exempt de vos erreurs, s'il paraissait tout à coup au milieu de nous, ne nous croirait pas en délire, à la vue de ce qui se passe dans notre ville ? Nous vantons les exploits de nos ancêtres ; nous les regardons comme l'honneur de la patrie, et loin de marcher sur leurs traces, nous suivons une route opposée. Ils ne cessèrent de défendre la Grèce contre les barbares ; et nous, nous avons attiré du fond de l'Asie au coeur de la Grèce une troupe de vils mercenaires. Nos ancêtres arrivèrent à la suprématie, en rendant la liberté à plusieurs villes, en les secourant; et nous qui les avons asservies, qui avons tenu une conduite tout à fait contraire, nous nous plaignons de ne pas jouir des mêmes prérogatives; nous qui, par nos actions et nos sentiments, sommes si différents des Athéniens de ce siècle ! Polir sauver la Grèce, ils eurent le courage d'abandonner le sol natal et de disputer la victoire aux barbares sur terre et sur mer; et nous, nous ne savons pas affronter le danger pour défendre nos propres biens ; nous prétendons à l'empire, et nous ne voulons pas même combattre ! Nous déclarons la guerre à presque tous les peuples, et nous ne voulons point supporter les fatigues : nous confions nos armes à des proscrits, à des transfuges; en un mot, à tout ce qu'il y a d'hommes perdus d'honneur et capables de marcher contre nous avec nos ennemis, pour un plus fort salaire. Cependant nous leur portons une affection, si tendre, que s'ils outrageaient nos propres enfants, nous ne voudrions pas les en punir ; et lorsque leurs rapines, leurs violences, leur mépris pour les lois nous attirent quelque accusation, loin de nous plaindre, nous nous réjouissons, en apprenant leurs excès. Nous sommes arrivés à un tel point de folie, que privés des subsistances les plus nécessaires, nous persécutons nos alliés et noue leur imposons des tributs pour fournir un salaire aux ennemis communs de l'humanité. Que nous sommes différents de nos ancêtres, non pas seulement de ceux qui brillent de tant de gloire, mais encore de ceux dont la mémoire est en butte à la haine l Quand ils avaient déclaré la guerre à une nation; quoique le trésor public fût rempli d'or et d'argent, ils se croyaient obligés de braver eux-mêmes tous les dangers, poux exécuter leur résolution; nous, au contraire, dans la plus grande détresse, et lorsque Athènes renferme une population nombreuse, à l'exemple du grand Roi, nous nous servons de soldats mercenaires. Quand ils équipaient des trirèmes, ils les chargeaient d'étrangers et d'esclaves: les citoyens seuls combattaient en qualité d'hoplites; nous, nous donnons les armes aux étrangers , et nous réduisons les citoyens à remuer la rame ; de sorte qu'au moment où nous avançons contre l'ennemi, ceux qui se croient faits pour gouverner la Grèce, paraissent la rame à la mais; tandis que les hommes méprisables dont je viens de parler, portent les armes. Mais peut-être la république, au dedans, est elle gouvernée de manière que son état inspire du moins quelque confiance ? Ah, qui pourrait plutôt ne pas s'en affliger ! Nous nous vantons d'être originaires de ce pays et d'avoir fondé une ville, avant les autres peuples : nous devrions donc leur donner l'exemple d'un gouvernement juste et sagement constitué ; tandis que, dans notre république règnent la confusion et le désordre, bien plus que dans les états qui ne font que de naître. Nous sommes fiers de notre origine ; nous la croyons plus noble que celle des autres peuples ; et cette illustration nous l'abandonnons au premier venu, plus facilement que les Triballes et les Lucaniens ne sacrifieraient leur obscurité. »
XVIII. Tel est ce
discours d'Isocrate, qui passe
pour la plus belle de ses compositions. II présente, en effet, des beautés du
premier ordre et dignes de notre admiration. Les pensées sont bien choisies, la
diction correcte, facile à comprendre et sanctionnée par l'usage; elle renferme
toutes les qualités qui contribuent le plus à la clarté, et même plusieurs
ornements accessoires : elle est élevée, noble, majestueuse, coulante, agréable
et assez gracieuse. Toutefois, elle n'est point parfaite sous ce rapport , et
l'on peut lui reprocher plusieurs défauts assez graves. D'abord, elle manque de
concision : trop occupé de la clarté, l'orateur néglige souvent une juste
mesure, tandis que les XX. Enfin, il manque de nerf et de ces traits qui attachent l'auditeur; par exemple, lorsqu'il dit : « Τοσοῦτον δὲ χείρους ἐσμὲν τῶν προγόνων, οὐ μόνον τῶν εὐδοκιμησάντων ἀλλὰ καὶ τῶν μισηθέντων, ὅσον ἐκεῖνοι μὲν, εἰ πολεμεῖν πρός τινα ψηφίσαιντο, μεστῆς οὔσης ἀργυρίου καὶ χρυσίου τῆς ἀκροπόλεως, ὅμως ὑπὲρ τῶν δοξάντων τοῖς ἑαυτῶν σώμασιν ᾤοντο δεῖν κινδυνεύειν· ἡμεῖς δ´ εἰς τοσαύτην ἀπορίαν ἐληλυθότες, καὶ τοσοῦτοι τὸ πλῆθος ὄντες, ὥσπερ βασιλεὺς ὁ μέγας, μισθωτοῖς χρώμεθα τοῖς στρατοπέδοις. » Mais, demandera-t-on peut-être, comment lui donner un tour plus vif et plus arrondi? Il devait dire : « Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως χείρους ἐσμὲν τῶν προγόνων, τὰ δ´ ἄλλα βελτίους· οὐ λέγω τῶν εὐδοκιμησάντων· πόθεν γάρ; ἀλλὰ τῶν μισηθέντων. Καὶ τίς οὐκ οἶδεν, ὅτι ἐκεῖνοι μὲν πλείστων ποτὲ πληρώσαντες χρημάτων τὴν ἀκρόπολιν, οὐ κατεμισθοφόρουν τὸν κοινὸν πλοῦτον εἰς τοὺς πολεμίους· ἀλλὰ ἀπὸ τῶν ἰδίων εἰσφέροντες, ἔστιν ὅτε καὶ τοῖς ἑαυτῶν σώμασι κινδυνεύειν ἠξίουν· ἡμεῖς δὲ, οὕτως ὄντες ἄποροι, καὶ τοσοῦτοι τὸ πλῆθος, μισθοφόροις τοῖς στρατεύμασι πολεμοῦμεν, ὥσπερ καὶ βασιλεὺς ὁ μέγας. » De plus, sa diction est inanimée : elle n'a presque jamais de ces mouvements qui répandent la vie dans les débats judiciaires : tout le monde, sans doute, en est convaincu ; et je n'ai pas besoin de citer des exemples. Toutefois, si l'on en désire, quoi-que je puisse en rapporter plusieurs, je me bornerai à un seul. C'est une antithèse placée après une autre, qui la précède immédiatement : « Καὶ τότε μέν, εἰ τριήρεις ἐπληροῦμεν, τοὺς μὲν ξένους καὶ δούλους ναύτας ἐνεβιβάζομεν, τοὺς δὲ πολίτας μεθ´ ὅπλων ἐξεπέμπομεν· νῦν δὲ τοῖς μὲν ξένοις ὁπλίταις χρώμεθα, τοὺς δὲ πολίτας ἐλαύνειν ἀναγκάζομεν· ὥσθ´ ὁπόταν ἀποβαίνωσιν εἰς τὴν τῶν πολεμίων, οἱ μὲν ἄρχειν τῶν Ἑλλήνων ἀξιοῦντες, ὑπηρέσιον ἔχοντες ἐκβαίνουσιν· οἱ δὲ τοιοῦτοι τὰς φύσεις ὄντες, οἵους ὀλίγῳ πρότερον εἶπον, μεθ´ ὅπλων κινδυνεύουσιν. » Je n'attaque point la pensée; elle est noble et pathétique : ce que je blâme, c'est la douceur et la délicatesse affectée de l'expression. Cette pensée exigeait un tour rapide, piquant et propre à frapper jusqu'au vif, tandis que celui qu'il emploie est lent, coule paisiblement à travers l'oreille , comme une huile limpide, sans effort et sans bruit, et tend à la flatter agréablement par une douceur enchanteresse. Mais peut-être Isocrate a-t-il semé son style de ces tours énergiques et variés, si propres à émouvoir? Bien au contraire : rien n'est plus opposé au pathétique, ni plus fait pour détourner l'attention que les ornements dont il fait usage; je veux parler des périodes à membres symétriques, des antithèses froides et des autres frivolités qui dégradent son style, même dans le discours que j'examine. Ce n'est partout qu'antithèses; et les parties même de la pensée se répondent l'une à l'autre par leur opposition : toutes les périodes sont hérissées d'antithèses qui fatiguent l'oreille et produisent le dégoût et l'ennui. La vérité de cette assertion est incontestable. Chaque pensée, chaque période, chaque proposition commence à-peu-près par ces mots : « Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ » - « Ἡμεῖς δέ » - « Τοῦτο μὲν, τοῦτο δέ »; et du commencement à la fin, elles forment un cercle parfait. Jamais de ces changements, jamais de ces inversions et de ces tours variés qui mettent l'esprit à l'abri d'une trop longue contention. On pourrait lui reprocher d'autres défauts; mais ces observations me paraissent suffisantes. XXI. Après Isocrate, citons Démosthène, et prenons pour exemple quelques passages de l'un de ses discours contre Philippe ; c'est un parallèle où il compare la conduite des Athéniens de son temps avec celle de leurs ancêtres, et les nouveaux orateurs avec les anciens. Il n'oppose point à chaque action de ses contemporains une action des Athéniens d'autrefois : loin de s'attacher à un parallèle minutieux, il embrasse le sujet en grand et dans tout son ensemble. Voici en quels termes il s'exprime : « Considérez, Athéniens, les traits principaux qui établissent une grande différence entre notre conduite et celle de nos ancêtres. Ce parallèle sera court et ne renfermera rien qui ne vous soit connu. Vous n'avez pas besoin de chercher des exemples chez les nations étrangères ; vos exemples domestiques vous suffisent pour être heureux. Nos ancêtres que les orateurs de leur temps ne flattaient pas et n'aimaient pas, comme vous aiment vos orateurs d'aujourd'hui, exercèrent pendant soixante-cinq ans une entière suprématie sur la Grèce, soumise volontairement à leur puissance. Ils entassèrent dans la citadelle plus de dix mille talents, et le roi de Macédoine était sous leur empire, comme il convient qu'un barbare soit sous les ordres des Grecs. Ils érigèrent de nombreux trophées après avoir gagné sur terre et sur mer des batailles, où ils avaient combattu eux - mêmes ; et seuls, entre tous les hommes, ils ont laissé, par leurs exploits, une gloire inaccessible aux traits de l'envie. Telle fut leur conduite envers la Grèce. Considérez maintenant quelle était leur conduite dans Athènes même, comme hommes publics et comme simples citoyens. Comme hommes publics, ils élevèrent tant de beaux édifices, tant de superbes temples, ornés des plus riches offrandes qu'ils n'ont laissé à leurs descendants aucun moyen de surpasser leur magnificence. Comme simples citoyens, ils furent si modestes, si attachés aux moeurs antiques de la patrie que ceux d'entre vous qui ont vu la maison d'Aristide, de Miltiade et des autres grands hommes de cette époque, ont dû remarquer qu'elles n'ont rien de plus somptueux que les maisons voisines. Alors on ne s'occupait point des affaires publiques pour s'enrichir ; mais chacun regardait comme un devoir de contribuer à l'accroissement de la prospérité publique. Par leur fidélité envers tous les peuples de la Grèce, par leur piété envers les dieux, et par l'esprit d'égalité qui présidait à leurs relations mutuelles, ils arrivèrent, comme ils le méritaient, à l'état le plus florissant. Tel fut l'état de notre république, lorsque la direction en était confiée à de semblables citoyens. Aujourd'hui, qu'est-elle entre les mains des excellents conseillers qui nous dirigent? Sa situation présente ressemble-t-elle à cette ancienne prospérité, ou du moins en approche-t-elle ? Que de réflexions n'aurais-je point à faire ; mais je les passerai sous silence, pour m'arrêter à un seul fait : nous nous trouvons sans rivaux, les Lacédémoniens sont abattus, les Thébains sont occupés chez eux, aucun autre peuple n'est assez puissant pour nous disputer la suprématie; et lorsque nous pourrions mettre nos possessions à l'abri de tout danger et nous établir les arbitres des autres peuples, nous avons perdu une partie de notre territoire, et dépensé plus de quinze cents talents sans aucun but d'utilité. Les alliés que nous nous étions procurés par la guerre, nous les avons perdus pendant la paix : nous avons élevé nous-mêmes notre plus redoutable ennemi ; car s'il n'en est pas ainsi, qu'on vienne à cette tribune m'apprendre à qui Philippe doit sa puissance, si ce n'est à nous. Oui , dira-t-on peut-être, nos affaires au dehors sont dans un triste état, mais du moins au dedans sont-elles florissantes! Eh quoi ! viendra-t-on me parler de remparts recrépis, de routes ouvertes, de fontaines et d'autres bagatelles de ce genre ? Songez, Athéniens, que les hommes publics à qui vous devez ces ouvrages ont passé de la pauvreté à l'opulence, de l'obscurité aux honneurs : quelques-uns même ont fait construire des maisons plus belles que les édifices publics ; plus la patrie s'achemine vers sa ruine, et plus leur prospérité grandit. Quelle est donc la cause d'un tel changement ? Pourquoi la république, heureuse du temps de nos ancêtres, est-elle réduite à un état si déplorable aujourd'hui ? D'abord, parce que le peuple, ne craignant pas de faire lui, même la guerre, tenait autrefois les magistrats sous sa dépendance : il était le dispensateur de tous les biens, et chaque citoyen se montrait jaloux de recevoir de lui les honneurs, l'autorité. De nos jours, au contraire, les magistrats ont tout dans leurs mains ; tout se fait par eux ; et vous, peuple sains force, privés d'argent et d'alliés, vous n'êtes plus qu'une troupe d'esclaves, destinés à faire nombre; vous estimant fort heureux, s'ils vous accordent quelques oboles pour le théâtre ou quelques distributions de viande; et pour comble de lâcheté, vous leur témoignez de la reconnaissance, pour des largesses qui sont votre bien! Ils vous retiennent comme en prison dans ces murs ; ils vous amorcent, ils vous apprivoisent par ces libéralités; mais ils ne vous caressent que pour vous enchaîner à leur joug. Non jamais, j'en suis certain, un sentiment noble et généreux ne pourra naître dans des coeurs dégradés par tant de bassesse; chez tous les hommes , les pensées ont le même caractère que leur conduite habituelle. Certes, je ne serais point surpris que ce langage vous rendît plus sévères à mon égard qu'envers les auteurs de vos maux; vous n'accordez pas toujours la liberté de tout dire : je m'étonne même que vous me l'ayez laissée aujourd'hui. » Qui pourrait contester la supériorité de ce style sur celui d'Isocrate? Démosthène a revêtu ses pensées d'une diction plus noble et plus majestueuse: elle est plus serrée, plus concise et plus finie. Il a plus de force et plus de nerf ; il évite les figures froides et puériles dont Isocrate pare son style, au-delà de toute mesure. Mais c'est surtout pour le mouvement, la véhémence et le pathétique que la palme appartient incontestablement à Démosthène. Je dirai uns détour ma pensée sur le style de ces deux orateurs ; et j'espère exprimer plutôt l'opinion de tout le monde qu'une opinion personnelle. XXII. Lorsque je lis un discours d'Isocrate, soit dans le genre judiciaire, soit dans le genre délibératif, ou sur un sujet de morale, je reste calme : mon âme est impassible, et je me trouve dans le même état qu'un homme dont l'oreille est frappée par des chants spondaïques, ou par des airs composés dans le mode dorien et d'une harmonie pleine de gravité. Mais quand je prends un discours de Démosthène, je suis transporté d'une fureur divine et poussé, en tous sens, par mille émotions qui me bouleversent. La défiance, l'esprit de parti, la crainte, le mépris, la haine, la compassion, la bienveillance, la colère, l'envie; toutes les passions qui se disputent le coeur de l'homme, m'agitent tour-à-tour, et je ne diffère plus en rien des prêtres de Cybèle, lorsqu'ils célèbrent les mystères de leurs dieux ; soit que leurs transports divers proviennent de l'odeur des parfums ou du son des instruments, soit qu'ils naissent d'une inspiration divine : plus d'une fois, je me demande quelles sensations vives devait éprouver son auditoire. Et en effet, si malgré l'intervalle des siècles qui nous séparent de cet orateur, et quoique les sujets qu'il traite soient étrangers â nos intérêts, il nous saisit, il nous subjugue et nous transporte comme il veut; à quel point les Athéniens et les autres Grecs de son temps ne devaient-ils pas être entraînés par cette éloquence, au moment même d'une délibération solennelle, sur des matières qui les touchaient de si près, et lorsque Démosthène parlait au milieu d'eux avec cette dignité qui fut son plus noble attribut; avec un accent passionné qui exprimait toute l'énergie de son âme; et lorsqu'il rehaussait toutes ses paroles par une action sublime, qu'il porta plus loin que tous les orateurs, de l'aveu même de tout le monde et comme il est facile de s'en convaincre par les harangues que je viens de citer? Elles ne procurent pas seulement une lecture agréable: elles nous apprennent, en outre, comment nous devons parler en public et employer tantôt l'ironie, la colère, la menace, la douceur ; tantôt les avis ou les exhortations, et proportionner toujours rection au caractère même du style. Mais si, à la simple lecture, nous retrouvons encore dans ses discours cet esprit de vie, qui nous transporte sur le lieu même de la scène; sans doute, son éloquence avait quelque chose de surnaturel et d'irrésistible. XXIII. Mais, pour ne pas m'arrêter trop longtemps sur ces détails, et dans la crainte d'être réduit à passer sous silence une partie des matières qu'il me reste à traiter, je n'ajouterai rien sur Isocrate et sur le caractère de son éloquence : je vais faire connaître mon opinion sur Platon avec une entière liberté, sans exagérer sa gloire, sans affaiblir la vérité. J'entreprends cette tache avec d'autant plus de zèle que certains critiques soutiennent qu'il a éclipsé tous les philosophes et tous les orateurs par une éloquence divine : ils prescrivent de le regarder comme le véritable modèle de la pureté et de la force. J'en ai même entendu plusieurs répéter que si les dieux voulaient parler le langage des hommes, Jupiter ne parlerait pas autrement que Platon. Je répondrai à toutes ces exclamations d'une admiration exagérée chez des hommes, qui ont une connaissance imparfaite de l'art d'écrire et pour qui la vérité sera toujours un mystère, en laissant, selon ma coutume, toute dissimulation de côté. Je crois nécessaire d'exposer d'abord la marche qui me paraît la plus convenable pour juger cet écrivain. Dans les dialogues, lorsqu'il conserve le ton de Socrate; dans son Philèbe, par exemple, j'admire et j'ai toujours admiré la vigueur de son style; mais, comme je l'ai déjà dit, je ne saurais approuver les ornements frivoles et forcés dont il fait quelquefois usage; surtout, lorsque traitant une question politique, il veut y mêler l'éloge ou la censure, une accusation ou une apologie. A l'instant, il tombe au-dessous de lui-même et avilit la dignité du philosophe. Je suis tenté de lui appliquer ce qu'Homère fait dire à Vénus par Jupiter :
Renonce donc, ma fille, à la guerre, au carnage : Et toi aussi, Platon, borne-toi aux dialogues socratiques; abandonne toutes ces questions aux politiques et aux orateurs. Je soumets volontiers mon opinion à tous Ies hommes instruits; je n'en excepte que ces esprits portés à la dispute, et qui jugent plutôt, d'après leur opinion que d'après la vérité. Je n'ai point, comme certains critiques, cherché dans Platon les morceaux les plus défectueux, pour les comparer avec les passages les plus parfaits de Démosthène; il m'a paru plus juste de prendre dans ces deux écrivains les endroits les plus estimés et de les mettre en parallèle, pour mieux voir quel est celui qui mérite la palme : telle est la marche que je vais suivre. Platon n'a laissé qu'un discours dans le genre judiciaire, l'Apologie de Socrate. Mais il n'a jamais été prononcé ni au barreau, ni dans la place publique; et puisqu'il l'avait composé pour une autre destination, on ne peut le mettre ni au nombre des discours, ni au nombre des dialogues ainsi, je ne m'en occuperai point. Platon n'a rien écrit non plus dans le genre délibératif, à moins qu'on ne veuille rapporter ses lettres à ce genre ; je les laisserai aussi de côté. Quant au genre démonstratif, il a inséré, il est vrai, dans le Banquet, plusieurs éloges de l'amour ; mais le plus souvent ils sont indignes de Socrate, quelque jugement qu'on veuille d'ailleurs en porter : je n'en parlerai pas en ce moment. Le meilleur de ses dialogues politiques est celui qui est intitulé Ménéxène, et qui renferme un éloge funèbre, où Platon, suivant moi, inmite Thucydide, quoiqu'il dise qu'il a pris Archius et Dion pour modèles. J'examinerai à fond ce discours, et je le comparerai non pas avec l'oraison funèbre qu'on attribue à Démosthène, et qui n'est pas son ouvrage; mais avec plusieurs de ses discours où il parle de l'honneur et de la vertu, ou plutôt avec un seul de ses discours. Le temps ne me permet point de citer, comme je le voudrais, des exemples tirés de tous : telle est la marche que je suivrai dans ce parallèle. XXIV. Je citerai d'abord Platon; et puisqu'il passe pour s'être distingué par la justesse et la noblesse de l'expression ; c'est sous ce rapport surtout que j'examinerai son style. Je prendrai pour premier exemple le début même de cet éloge funèbre : « Ἔργῳ μὲν ἡμῖν οἵδε ἔχουσι τὰ προσήκοντα σφίσιν αὐτοῖς· ὧν τυχόντες, πορεύονται τὴν εἱμαρμένην πορείαν. Ils ont déjà reçu de nous les honneurs auxquels ils avaient droit : riches de cegtte récompense, ils parcourent la route parquée par les destins. » Il est proportionné au sujet et remarquable par la grandeur, la noblesse et l'harmonie. La suite ne répond pas à un si beau commencement : « Προπεμφθέντες κοινῇ μὲν ὑπὸ τῆς πόλεως, ἰδίᾳ δὲ ὑπὸ τῶν οἰκείων. Comme citoyens, ils ont reçu de la patrie les honneurs suprêmes; comme hommes, ils ont été conduits par leurs amis à leur dernier asile. » Dire qu'on leur avait accordé tous les honneurs, c'était faire entendre que la république et leurs amis s'étaient acquittés envers eux des derniers devoirs : il n'était pas nécessaire de revenir sur cette pensée, à moins que Platon n'ait pensé que le plus bel ornement des funérailles, c'était la foule des citoyens qui les célébraient : il n'a pas cru qu'il fût ridicule de joindre d'abord cette pensée avec d'autres, et de les séparer ensuite. Comment être assez simple, pour voir le plus grand honneur qu'on pût rendre À un mort dans ces funérailles dont la patrie faisait les frais? Pour me borner à une seule observation, n'était-il pas plus honorable pour les morts que la patrie entretint, à ses dépens, leurs pères jusqu'à la fin de leurs jours, et fît élever leurs enfants jusqu'à leur adolescence. Cet hommage n'était-il pas plus glorieux que les frais des funérailles? Il l'était bien plus, à mon avis. La pensée que Platon ajoute est donc inutile. Mais si ce nouveau membre de phrase n'est pas nécessaire, peut-être ajoutet-il quelque grâce ou quelque ornement ? Il s'en faut de beaucoup : outre qu'il ne produit aucun bon effet et qu'il nuit à l'ordre général, il gâte même la période qui précède; il en trouble la symétrie et la douceur. Renfermée dans deux membres, elle était d'une juste mesure, harmonieuse et arrondie; elle avait une allure ferme : par l'addition de ce nouveau membre, toutes ces qualités disparaissent, et le ton oratoire fait place au ton historique. Si nous détachons ce troisième membre de ceux qui les précèdent, pour l'examiner à part, nous verrons que par lui-même il ne forme point une période, qu'il n'excite aucune émotion, ni douce ni vive; qu'il n'a rien de persuasif, rien de gracieux. Mais puisqu'il n'est point nécessaire, puisqu'il ne contribue pas non plus à la grâce; comme ce sont les deux sources de tous les ornements du style, on ne peut nier qu'il ne soit un véritable hors-d'œuvre. Platon ajoute : « Λόγῳ δὲ δὴ τὸν λειπόμενον κόσμον ὅ τε νόμος προστάττει τούτοις ἀποδοῦναι τοῖς ἀνδράσι, καὶ χρή. Les lois ordonnent que l'éloquence rende à ces grands citoyens un dernier hommage; et ce tribut est bien mérité. » Pourquoi ces mots καὶ χρή, à la fin de la phrase ? A quoi servent-ils ? Donnent-ils plus de clarté à la diction? Mais elle serait claire, quand même ils n'auraient pas été ajoutés. Si Platon avait dit: « Un éloge est le dernier honneur qu'il notls reste à rendre, d'après les lois, à ces citoyens », qui lui reprocherait de manquer de clarté ? Le tour qu'il emploie est-il plus agréable à l'oreille, a-t-il pins de noblesse ? Au contraire, il ternit, il altère la beauté de l'expression. Mais ce n'en pas à l'analyse à faire ressortir ces défauts ; chacun doit les remarquer, d'après les impressions qu'il reçoit : un sentiment intérieur, qui échappe à l'examen de la raison, peut seul juger de la dureté ou de la grâce du style; et ce sentiment n'a besoin ni de préceptes ni de conseils. XXV. Mais, dira-t-on peut-être, vous n'agissez pas loyalement, en demandant l'harmonie et la grâce à un écrivain peu jaloux de pareils ornements. Examinez ses pensées : sont-elles nobles, élevées ? Ne se trouvent-elles pas dans d'autres écrivains? Voilà ce que Platon recherchait avant tout ; voilà son plus beau titre de gloire. Sur ce point, exigez de lui le compte le plus sévère; mais laissez de côté les formes de la diction. Peut-on faire une pareille objection? Qui ne sait que Platon, quoique philosophe, attachait plus d'importance au style qu'aux choses. Je pourrais en donner mille preuves ; un seul de ses écrits montrera combien tous ses efforts furent malheureux, quand il voulait embellir sa diction par de frivoles ornements. Souvent, à une pensée qu'il vient d'exprimer, il en ajoute une autre qui n'a rien de frappant, rien de remarquable, et que plusieurs écrivains ont employée avant lui; par exemple, lorsqu'il dit que l'éloge des belles actions suffit pour immortaliser la gloire et le souvenir des grands hommes: cette pensée avait déjà été émise mille fois. Comme il sentait qu'elle n'a rien de profond, rien de saillant, il voulut sans doute la rendre agréable par la grâce de l'expression: à mon avis, il ne lui restait pas d'autre moyen. Plus loin, par une erreur puérile, il abandonne les expressions nobles et les figures majestueuses, pour des figures de déclamateur et dignes de Gorgias ; telles que des antithèses, des périodes symétriques ou qui ont les membres égaux, et d'autres futilités dont il se sert pour orner son style. XXVI. Écoutons ses propres paroles : « Ἔργων γὰρ εὖ πραχθέντων λόγῳ, καλῶς ῥηθέντι μνήμη καὶ κόσμος τοῖς πράξασι γίνεται παρὰ τῶν ἀκουσάντων. Les grandes actions reçoivent d'un éloge convenable un éclat qui les fait vivre à jamais dans la mémmoire de ceux qui les ont entendu célébrer. » Dans ce passage, λόγος est opposé à ἔργοις, πραχθῆναι à ῥηθῆναι, et l'adverbe καλῶς tient la place de l'adverbe εὖ; les membres de la période se correspondent trois à trois et sont d'une égalité parfaite. Pour donner à la période une chute ferme, sana la moindre nécessité et quoique la pensée présentât un sens complet, il ajoute : «παρὰ τῶν ἀκουσάντων.» N'est-ce pas la manière des poètes, pour lesquels Platon affectait un souverain mépris et qu'il a même bannis de sa république ? N'y a-t-il pas dans ce tour plus de pompe que dans cette strophe du Pindare :
« Ô lyre, pour chanter les héros, leur courage
Dans cette ode, en l'honneur d'Alexandre, roi de Macédoine, le poète dut
s'occuper de la coupe et de l'harmonie du vers bien plus que de l'expression;
mais Platon, lui qui enseignait la sagesse, a-t-il bien pu parer son style de
figures d'une douceur affectée ? Bien loin de s'arrêter dans la période suivante
il tombe
dans le même défaut, lorsqu'il dit :
«
Δεῖ δὴ τοιούτου τινὸς λόγου, ὅστις τοὺς μὲν τετελευτηκότας
ἱκανῶς ἐπαινέσει, τοῖς δὲ ζῶσιν εὐμενῶς παραινέσει.
Le discours, qui leur est consacré, doit renfermer tout à
la fois un éloge digne des morts, et une douce consolation pour les parents qui
leur ont survécu. »
Ici, l'adverbe n'est XXVII. Après avoir exposé le plan qu'il croit le plus convenable au sujet, il ajoute : « Ἐπὶ τούτοις τὴν τῶν ἔργων πρᾶξιν ἐπιδείξωμεν, ὡς καλὴν καὶ ἀξίαν ἀποφηναμένην. Montrons que les actions de ces grands citoyens, ont toujours été glorieuses et dignes de leurs parents » Je ne sais si un écrivain, jaloux d'employer une diction simple, correcte et pure, se serait exprimé de cette manière; car πράττεται se dit de πράγματα; ἐργάζεται de ἔργα, et ἀποφάσεως ne peut s'appliquer qu'aux choses difficiles à comprendre. Dans ce passage, la diction est lourde : dans le suivant, la pensée me paraît faible, lâche, incohérente, sans vigueur et contraire à la liaison naturelle des idées : « Τῆς δ´ εὐγενείας πρῶτον ὑπῆρξε τοῖσδε ἡ τῶν προγόνων γένεσις, οὐκ ἔπηλυς οὖσα, οὐδὲ τοὺς ἐκγόνους τούτους ἀποφηναμένη μετοικοῦντας ἐν τῇ χώρᾳ, ἄλλοθεν σφῶν ἡκόντων, ἀλλ´ αὐτόχθονας καὶ τῷ ὄντι πατρίδα οἰκοῦντας· καὶ ζῶντας καὶ τρεφομένους οὐχ ὑπὸ μητρυιᾶς, ὡς οἱ ἄλλοι, ἀλλ´ ὑπὸ μητρὸς τῆς χώρας, ἐν ᾗ ᾤκουν· καὶ νῦν κεῖσθαι τελευτήσαντας ἐν οἰκείοις τόποις, τῆς τεκούσης τε καὶ θρεψάσης καὶ ὑποδεξαμένης. Leur premier titre de noblesse, c'est qu'ils n'ont pas pour ancêtres des étrangers dont l'origine prouverait que leur postérité est établie depuis peu dans l'Attique, puisqu'ils étaient venus eux-mêmes d'une autre contrée. Véritables autochtones, ils ont habité et vécu dans le pays qui les vit naître; ils n'ont pas été nourris par une marâtre, mais par la terre qui fut leur mère; et aujourd'hui qu'ils ne sont plus, cette même terre, où ils avaient reçu le jour et qui les a nourris, les renferme dans son sein » Quel peuple, s'il parle purement, donnerait peur épithète à γένεσις tantôt αὐτόχθονα et tantôt ὑποδεξαμένης ! Les hommes sont par accident autochtones ou étrangers ; mais non pas la naissance. On peut être né dans un lieu et en habiter un autre; mais la naissance, dans le sens abstrait, ne le peut pas. Quel homme, pour peu qu'il tienne à s'exprimer correctement, oserait dire que la naissance des ancêtres fait que leurs descendants sont appelés autochtones, et non pas étrangers dans le pays où ils sont nés? La naissance n'a pas le privilège de donner une dénomination; et l'on ne peut pas dire d'un homme qu'il est étranger dans le pays où il est né : nous seuls avons la faculté d'établir des dénominations. D'ailleurs, la qualification d'étranger n'est applicable qu'à ceux qui sont tenus d'un autre pays, pour s'établir dans celui qui les a reçus. Quel écrivain, s'il veut observer le juste rapport des choses, après avoir dit τὴν γένεσιν, ferait accorder ces mots avec ceux-ci ἄλλοθεν σφῶν ἡκόντων, c'est-à-dire un masculin avec un féminin, un pluriel avec un singulier? La syntaxe eût été parfaitement respectée, si, après τήν γένεσιν, Platon avait mis ἄλλοθεν αὐτῆς ἡκούσης; et puisqu'il avait à placer le mot hommes, il devait, dès le commencement de la phrase, veiller à ce que tout s'accordât avec ce mot; par exemple, de cette manière : « Τῆς δ´ εὐγενείας πρῶτον ὑπῆρξαν τοῖσδε οἱ πρόγονοι, οὐχὶ ἐπήλυδες ὄντες, οὐδὲ τοὺς ἐκγόνους τούτους ἀποφήναντες μετοικοῦντας ἐν τῇ χώρᾳ, ἄλλοθεν σφῶν ἡκόντων, ἀλλ´ αὐτόχθονας. » XXVIII. Nous ne devons point passer légèrement sur les louanges qu'à l'occasion de la noble origine des citoyens, il donne au, pays. qui les a vus naître. Il dit que ce pays fut toujours chéri des. dieux, et il en donne pour preuve les débats nés. parmi les, dieux qui s'en disputèrent la possession : preuve banale et mille fois invoquée par tous ceux qui out fait l'éloge d'Athènes. Cependant, je critique moins la pensée que l'expression dont il l'a revêtue : « Μαρτυρεῖ δ´ ἡμῖν τῷ λόγῳ ἡ τῶν ἀμφισβητησάντων περὶ αὐτῆς θεῶν ἔρις. Ἣν δὲ θεοὶ ἐπῄνεσαν, πῶς οὐχ ὑπ´ ἀνθρώπων γε συμπάντων δικαία ἐπαινεῖσθαι; Nous pouvons prendre à témoin les débats nés parmi les Immortels, au sujet de l'Attique : si les dieux eux-mêmes l'ont célébrée, comment tous les hommes n'en feraient-ils à l'envi l'objet de leurs éloges ? » Ce style me parait bas et peu digne d'être imité : il n'a rien qui soit convenable à une république belliqueuse. Où est la richesse, la grandeur et le sublime de l'expression? N'est-elle pas lâche outre mesure, et bien au-dessous de la vérité? Platon devait-il parler, en ces termes, de la dispute qui s'éleva entre Pallas et Neptune, au sujet de l'Attique ? L'affection des dieux pour cette contrée devait-elle être rendue par ce tour faible et banal : « Ἣν δὲ θεοὶ ἐπῄνεσαν. » Pour compléter l'éloge du territoire d'Athènes, il ajoute que c'est le premier pays de la Grèce,. où des hommes aient pris naissance; le premier qui ait produit des fruits bienfaisants. Il s'exprime en ces termes : « Ἐξελέξατο δὲ τῶν ζῴων καὶ ἐγέννησεν ἄνθρωπον· ὃ συνέσει τε ὑπερέχει τῶν ἄλλων, καὶ δίκην, καὶ θεοὺς μόνον νομίζει. Au milieu de tant de créatures, elle s'était réservé la gloire de produire l'homme, le plus intelligent de tous les êtres; le seul qui ait le sentiment de la justice des dieux. » Je doute qu'une pensée aussi sublime puisse être revêtue d'une expression plus faible et plus triviale. Mais ne lui reprochons pas d'avoir fait l'éloge de l'homme d'une manière si commune : lors même qu'il parle de sa nourriture, sa diction est-elle plus noble ? « Μόνη γὰρ ἐν τῷ τότε καὶ πρώτη τροφὴν ἀνθρωπείαν ἤνεγκεν, τὸν τῶν πυρῶν καὶ κριθῶν καρπόν. Seule, à cette époque, et avant tous les autres pays, elle donnait à l'homme, pour aliment, l'orge et le blé. » Grands dieux, qu'est devenue cette source féconde, où Platon allait puiser la richesse et la grandeur des expressions ? Ces flots d'éloquence qui sortaient , comme par douze canaux de la bouche du philosophe, comment ne s'en échappent-ils plus qu'en petit nombre et comme à travers une étroite ouverture ? Il se montre plus sobre, il abandonne volontiers la pompe et l'éclat, me dira-t-on peut-être? Mais cette réponse est-elle admissible, quand il s'agit d'un écrivain, qui, ne trouvant point de noblesse dans le mot lait, l'appelle un peu plus loin la source de la vie. XXIX. Laissons de côté ce observations, pour examiner de quelle manière il parle de ce présent des dieux : « ὦ κάλλιστα καὶ ἄριστα τρέφεται τὸ ἀνθρώπειον γένος. C'est pour l'espèce humaine le meilleur aliment. » Si parmi les mortels qui couvrent la surface de la terre, tout autre que Platon s'était servi de ces mots « κάλλιστα καὶ ἄριστα », aurait-il échappé à la risée publique? Passons à une autre citation : « Τούτου δὲ τοῦ καρποῦ οὐκ ἐφθόνησεν, ἀλλ´ ἔνειμε καὶ τοῖς ἄλλοις. Elle ne s'est pas montrée libérale de cette nourriture seulement envers ses habitants; elle l'a donnée aussi aux autres peuples. » Pour observer l'ordre naturel de la construction, ne devait-il point placer d'abord le membre où il dit que l'Attique ne fut pas jalouse de ses productions ? C'est du moins mon opinion. Et quand il dit que l'Attique communiqua ses biens aux autres peuples et y fit participer également les Grecs et les Barbares, donne-t-il à sa pensée les ornements convenables , en s'exprimant ainsi : « ὅτι οὐκ ἐφθόνησε τῶν σπερμάτων, καὶ ὅτι ἔνειμεν αὐτὰ τοῖς ἄλλοις. » Il ne devait pas même dire que l'Attique ne se montra pas jalouse de ses productions à l'égard de ses voisins. A la place de cette location « νεῖμαι τοὺς καρποὺς », ne fallait-il pas une expression plus noble; par exemple δωρεᾶς, χάριτος, ou une autre semblable : je me bornerai à ces réflexions. Plus loin, il parle ainsi des dons de Pallas : « Ensuite Pallas fit présent à leurs descendants de l'huile, soulagement des fatigues. » Il emploie des périphrases et des locutions dithyrambiques. Qu'est-il besoin de nouvelles citations ? En parcourant le discours, on trouvera dans chaque ligne plusieurs expressions incorrectes ou triviales ; beaucoup d'autres, puériles et froides, sans vigueur et sans nerf, dépourvues de douceur et de grâce ; et quelques-unes d'une pompe à peine soutenable dans le dithyrambe. Je voudrais que tout ce dialogue fût parfait et digne d'être imité, puisqu'il est de Platon; de cet écrivain qui, s'il ne mérite point la première place, peut du moins disputer la seconde avec avantage. Ces observations me paraissent suffisantes. XXX. La fin, qui a été louée par plusieurs critiques, me paraît d'une grande beauté. Je vais la transcrire : je m'occuperai ensuite de Démosthène. Le panégyriste des guerriers d'Athènes raconte que ces braves, dans le moment où ils allaient affronter la mort au milieu des combats, chargèrent ceux qui combattaient à leurs côtés d'apporter à leurs pères et à leurs enfants leurs volontés dernières, s'ils venaient à périr sur le champ de bataille.
«Je vais vous transmettre, dit-il, les paroles recueillies de
leurs bouches mourantes : ils aimeraient à vous les répéter eux-mêmes, s'ils
pouvaient recouvrer l'existence ? Je dois, du moins, en être persuadé d'après
leur langage, à la dernière heure. Il vous faut supposer qu'ils parlent
eux-mêmes : voici quels furent leurs adieux. Ce dialogue est regardé comme le chef-d'oeuvre de Platon, et j'avoue qu'il renferme de rares beautés. Le seul reproche qu'on puisse lui faire, c'est qu'on y trouve plutôt le ton de l'éloquence délibérative que celui du barreau. XXXI. Comparons à ce morceau un exemple de Démosthène, tiré du discours pour Ctésiphon. Ce n'est point, comme dans Platon, une exhortation adressée aux Athéniens pour les animer à l'honneur et à la vertu; mais un éloge de leur république, où rien ne paraissait au-dessus de la gloire et des honneurs attachés aux grandes entreprises, lors même qu'elles n'aboutissaient; point à un heureux résultat. L'orateur s'exprime en ces termes : « Puisque mon adversaire insiste sur l'événement, je vais dire une chose qui peu paraître étrange; mais je vous en conjure, au nom de Jupiter et des dieux, que personne ne s'étonne de mon langage ! écoutez-moi plutôt avec bienveillance. Oui, quand même l'avenir se fût montré sans voile à nos yeux ; quand même tout le monde l'eût prévu; quand même vous l'auriez révélé à grands cris, ô Eschine, vous qui n'avez pas ouvert la bouche, la république ne devait pas renoncer à cette entreprise, pour peu qu'elle respectât la gloire de nos ancêtres et le jugement de la postérité. Nos efforts ont été malheureux ! Tous les hommes ne sont-ils pas sujets à de semblables revers, lorsque les dieux l'ordonnent? Mais si après avoir été jugée digne de dominer sur la Grèce, Athènes se fût dessaisie de la suprématie, ne l'aurait-t-on accusée de livrer la Grèce à Philippe. Si elle eût renoncé, sans combat, à des prérogatives que nos ancêtres ont conquises au prix des plus grands dangers, quel citoyen ne vous aurait pas accablé de mépris, Eschine? car le mépris n'aurait atteint ni la patrie, ni ma personne. Au nom de Jupiter, de quel oeil verrions-nous tous les Grecs accourir dans notre ville, si dans l'état où nos affaires sont réduites, et lorsque Philippe est devenu notre chef et le maître de tout, nous n'avions pris aucune part aux efforts des autres peuples, pour détourner un tel malheur; surtout, dans une ville qui, jusqu'à présent, n'a jamais préféré une sécurité honteuse à de glorieux dangers ? Quel peuple de la Grèce, quelle nation barbare ignore que les Thébains et les Lacédémoniens, qui furent puissants longtemps avant eux, et même le roi des Perses, auraient permis volontiers à notre patrie de garder sous sa domination toutes les terres qu'elle aurait voulu, et de conserver ses propres possessions, pourvu qu'elle se fût soumise à recevoir la loi et à laisser la suprématie à un autre peuple. Mais les Athéniens, à cette époque, trouvaient une telle dépendance indigne de leur pays; elle leur parut insupportable et contraire à leurs moeurs. Personne jamais n'a pu déterminer notre république à devenir l'alliée d'un peuple puissant, mais injuste, pour jouir d'un paisible esclavage; jamais elle n'a cessé de combattre pour la suprématie, et de braver tous les dangers pour l'honneur et pour la gloire. Ces sentiments vous paraissent si nobles, si élevés, si conformes à votre caractère, que parmi vos ancêtres, vous louez surtout ceux qui ne s'en écartèrent point dans leur conduite; et c'est avec raison. Qui pourrait, en effet, ne pas admirer la vertu de ces citoyens qui eurent le courage d'abandonner leur patrie et leur territoire, et de se réfugier sur des galères, plutôt que de subir les conditions dictées par l'étranger; qui prirent pour chef Thémistocle, principal auteur de cette détermination, et. lapidèrent Cyrsile qui les avait engagés à se soumettre. Leur haine ne tomba pas seulement sur lui : son épouse même fut massacrée par les femmes d'Athènes. Dans. ce siècle, les Athéniens ne cherchaient point un orateur ou un général capable de leur assurer un heureux esclavage : ils n'auraient pas même voulu vivre, s'ils n'avaient pu conserver la liberté avec la vie. Chacun se croyait né non seulement pour son père et pour sa mère, mais surtout pour sa patrie. Quelle influence un tel sentiment peut-il avoir sur la conduite ? Je vais vous l'apprendre. L'homme qui ne se croit né que pour ses parents, attend que l'ordre des destins s'accomplisse et que la mort vienne le frapper; tandis que celui qui se sent né pour la patrie, court volontiers au trépas, pour la sauver de l'esclavage. A ses yeux, la mort est moins terrible que l'ignominie qu'il faut dévorer dans un état enchaîné sous le joug de la servitude. Si j'osais prétendre que je vous ai inspiré des sentiments dignes de vos ancêtres, qui de vous n'aurait pas le droit de m'adresser des reproches? Mais je soutiens que tels ont toujours été vos principes; et qu'avant moi, ils furent l'âme de notre république : seulement, je demande aussi ma part dans les services que chacun de nous a rendus à la patrie. Eschine attaque toute ma conduite, il cherche à vous aigrir contre moi, il m'accuse d'être l'auteur de toutes les alarmes et de tous les périls qui ont assiégé l'état : en s'efforçant de me ravir la gloire que je viens d'acquérir, il vous prive vous-mêmes des louanges de la postérité. Si vous condamnez Ctésiphon, parce que je n'ai pas bien administré la république, on pourra dire que vous avez failli; et vos malheurs ne seront plus imputés à la malignité de la fortune. Mais non, vous n'avez point failli, Athéniens, en affrontant les plus grands dangers pour la liberté et le salut de la Grèce ! Non, vous n'avez point failli, j'en atteste les mânes de nos ancêtres qui périrent à Marathon, à Platée, à Salamine, à Artémise, et tant de braves citoyens qui reposent dans les tombeaux publics. La patrie, Eschine, leur a décerné à tous les mêmes honneurs; oui, à tous, et non pas seulement à ceux dont les efforts furent couronnés par la victoire. Elle a pourvu elle-même aux frais de leurs funérailles, et c'est avec justice ; car ils ont tous rempli le devoir de bons citoyens, mais chacun d'eux a subi le sort qui lui était réservé. » XXXII. Il n'est personne, sans doute, qui, avec la plus légère connaissance de l'art oratoire et un esprit exempt de jalousie et de prévention, ne sente que ce style diffère du style de Platon, autant que des armes destinées au combat diffèrent de celles qui sont faites pour une vaine parade; autant que la réalité diffère d'une image trompeuse, et un corps endurci aux ardeurs du soleil et aux fatigues, de celui qui est accoutumé à une douce fraîcheur ou à la mollesse. La diction de Platon, qui ne vise qu'à l'élégance, est défectueuse dans les véritables discussions ; celle de Démosthène, au contraire, tend toujours à rutile et au vrai. Il me semble qu'on pourrait, avec assez de justesse, comparer la première à une prairie émaillée de fleurs et toujours brillante d'une parure riche, mais qui ne dure qu'un jour, et la seconde à un champ couvert de moissons abondantes, et dont la fécondité ne laisse à désirer aucune production nécessaire à la vie, ou propre à la rendre agréable. Je pourrais, si je le voulais, examiner en détail toutes les qualités de ces deux écrivains, et faire voir combien Démosthène l'emporte sur Platon, non seulement parce que son style est plus naturel et plus convenable à l'éloquence du barreau (car tout le monde est d'accord sur ce point, et je n'ai pas besoin d'en donner de nouvelles preuves ); mais aussi par l'emploi des figures, quoique Platon passe pour le meilleur modèle sous ce rapport. Comme j'ai encore plusieurs questions à traiter, je m'occuperai de cet examen dans une autre occasion, si le temps me le permet. Je ne craindrai point de consacrer un traité particulier à cet objet : ce que je viens de dire suffira sans doute pour le moment. Je ne pouvais passer sous silence Platon, cet écrivain à qui plusieurs critiques décernent la palme; mais, en m'arrêtant trop longtemps sur un seul objet, je paraîtrais perdre de vue le but principal de cet écrit : je réserverai donc pour un nouveau traité les observations que j'ai encore à faire sur ce philosophe. Je vais résumer, en peu de mots, celles que j'ai présentées jusqu'ici, afin de montrer que je me suis acquitté de l'engagement que j'avais contracté, en mettant la main à ce traité sur le style. XXXIII. Mon but, comme je l'ai d'abord annoncé, était de prouver que Démosthène, par un sage tempérament, a su employer le meilleur style; celui qui s'adapte le mieux à la nature de l'homme. J'ai tâché de le démontrer. Je ne me suis point borné à des exemples tirés de ses discours, parce que je suis persuadé que pour connaître une chose à fond, il ne suffit pas de l'examiner isolément. J'ai comparé au style de Démosthène celui des philosophes et des orateurs les plus estimés; et après un examen impartial, j'ai déclaré à qui je donnais le premier rang. Afin de suivre la marche tracée par la nature, j'ai parlé des divers genres de style et des écrivains qui se sont le plus distingués dans chaque genre. J'ai prouvé ensuite qu'ils étaient imparfaits ; et après avoir indiqué, en peu de mots, pourquoi ils me paraissaient tous laisser quelque chose à désirer, je suis arrivé à Démosthène. J'ai fait voir qu'il ne s'attacha exclusivement à aucun genre, ni à aucun écrivain ; mais qu'il prit partout ce qu'il trouvait de parfait et se fit une diction à la portée de tout le monde, riche, élégante, et qui l'a placé au-dessus de tous les écrivains : j'ai confirmé toutes mes assertions par des exemples, J'ai établi trois genres de style, qui sont les plus usités : le simple, le sublime, et le moyen, J'ai montré que Démosthène a réussi dans ces trois genres beaucoup mieux que tout autre : j'ai rapporté plusieurs morceaux de ses discours, et je les ai mis en parallèle avec des passages analogues de plusieurs écrivains recommandables sans doute, mais chez lesquels on chercherait en vain la perfection et cette heureuse alliance de toutes les qualités qui se trouvent dans Démosthène. J'ai cité Isocrate, Platon et d'autres auteurs célèbres ; je les ai comparés avec Démosthène, et ce n'est pas sans raison. J'ai dit qu'ils cultivèrent le genre moyen, qui me paraît préférable à tous les autres; qu'ils acquirent par là une brillante renommée, et que s'ils éclipsèrent ceux qui les avaient précédés, ils ne sauraient disputer la palme à Démosthène. Je vais ajouter quelques nouvelles observations sur le style : je passerai ensuite à ce qui doit compléter ce traité. XXXIV. Tels sont donc les traits caractéristiques qui distinguent ordinairement les trois genres d'élocution, et qui se font sentir dans toutes les harangues de Démosthène. Je rappellerai d'abord que les qualités propres à ces divers genres se retrouvent dans Démosthène et Lysias, afin de répandre plus de clarté sur cet écrit. Parmi les orateurs qui ont employé un style sublime, élevé, extraordinaire, Démosthène me paraît s'être attaché mieux que tout autre à une diction claire et approuvée par l'usage ; il ne s'en écarte jamais dans les compositions les plus graves : elle forme le trait le plus saillant de son caractère, lors même qu'il vise au rand et au sublime. Quant aux écrivains qui se sont exercés dans le style simple et dépouillé d'ornements, il leur est supérieur par la force, la gravité, la vigueur et une sorte d'âpreté. Ces qualités et celles qui s'en rapprochent le plus, caractérisent sa manière dans ce genre. Enfin, il l'emporte sur tous ceux qui ont cultivé le style moyen que je mets au-dessus des deux autres, par la variété, la juste mesure, l'à-propos, le pathétique, l'énergie, le mouvement et la convenance : elle est portée chez lui au dernier degré de perfection. J'ai déjà dit que ces qualités peuvent séparément être employées dans les trois genres d'élocution ; et c'est d'après leur heureuse alliance qu'il faut juger Démosthène. Mais si l'on peut toujours s'en servir avec avantage, elles sont surtout utiles, quand elles occupent la place que je leur ai assignée. Si la division, d'après laquelle j'ai partagé en trois classes les divers genres de l'élocution, paraît vicieuse ; si l'on veut déterminer les qualités qui sont particulières à chacun, je répondrai que j'ai indiqué la place où elles peuvent avoir le plus d'utilité et d'agrément. C'est ainsi que, suivant les rhéteurs, la clarté, la précision et le naturel doivent se trouver dans la narration; mais serait-ce une raison pour ne point les rechercher dans les autres parties du discours ? Une telle hypothèse paraîtrait le comble de l'absurdité : seulement, ils veulent faire entendre que leur véritable place est dans la narration. XXXV. Après ces réflexions, je vais faire connaître l'arrangement de mots dont Démosthène a fait usage. Dire que, sous ce rapport, il est parfait et bien au-dessus de tous les orateurs, ce n'est pas exprimer une opinion personnelle : tous ceux qui ont quelque teinture de l'éloquence lui accordent cette supériorité. Ses contemporains mêmes regardèrent cet arrangement comme ce qui mérite le plus d'être imité dans ses compositions. Et qu'on ne dise pas qu'ils furent zélés pour sa gloire, au point d'être suspects de flatterie. Bien loin de là ; plusieurs, au contraire, étaient jaloux de sa célébrité et lui suscitèrent des luttes périlleuses. Dans ce nombre, il faut placer Eschine, qui, doué des plus heureuses dispositions pour l'éloquence, ne le cédait à aucun orateur et mérita le premier rang après Démosthène. Il attaquait avec un acharnement voisin de la haine, cette véhémence qui domine dans Démosthène ; il reprochait à sa diction de la nouveauté, de l'enflure, de la recherche, de l'obscurité, de la dureté, et d'autres défauts semblables. Mais, je le répète, si sa critiqué est souvent dictée par l'envie, elle ne manque pas toujours de fondement. Il ne lui adresse pas le moindre reproche sur l'arrangement des mots, et ce n'est pas étonnant : ce qui doit surprendre, c'est qu'en plusieurs endroits il le loue même sous ce rapport, et s'efforce de l'imiter. On peut s'en convaincre par ses propres paroles : « Lorsque Démosthène, dit-il, emploie une diction austère et recherchée. » Certes, il n'a pas eu en vue de louer le choix des mots. Quel mérite aurait-il pu trouver dans des expressions austères et recherchées » Dans un autre discours, il dit : « Je crains que vous ne rendiez une décision peu équitable, si vous vous laissez séduire par l'arrangement que Démosthène sait » donner à ses paroles.» Ici, Eschine n'appréhende pas que les Athéniens n'aiment trop la pompe et la grandeur du style de son rival ; mais plutôt que l'artifice de sa composition ne leur fasse illusion, à leur insu; et qu'entraînés par l'harmonie enchanteresse de son éloquence, ils n'aillent jusqu'à l'absoudre des fautes les plus manifestes. Ainsi, Eschine reconnaît dans Démosthène une énergie, qui ne se trouve au même degré dans aucun orateur ; et il n'hésite pas à comparer son style à la voix des sirènes. Cette admiration lui était inspirée moins par le choix que par L'arrangement des mots, dont il le regardait comme le meilleur modèle. XXXVI. Je ne crois pas nécessaire de recourir de plus longues observations. Ces preuves suffisent pour démontrer que Démosthène excelle dans l'arrangement des mots, et personne n'oserait le contester. Je laisserai donc cet objet de côté. Je vais essayer de aire connaître le caractère de l'harmonie qui domine dans ses discours, les exercices par lesquels il y est parvenu , et les signes auxquels on peut la distinguer de celle qu'on trouve dans les autres écrivains. Avant d'entamer cette question, je dirai que les anciens attachaient le plus haut prix à l'harmonie et qu'ils mettaient leurs soins à en orner leurs compositions, soit en vers, soit en prose. Tous ceux qui ont écrit se montrèrent jaloux, non seulement de revêtir leurs pensées de belles expressions, mais encore de les renfermer dans des tours mélodieux. Cependant, ils n'employèrent pas la même harmonie et ne suivirent pas tous la même route; et cela pour plusieurs raisons. D'abord, à cause des dispositions naturelles qui nous rendent propres à un genre particulier de travail ; en second lieu, à cause de nos penchants, qui nous portent à aimer ou à haïr certaines choses ; troisièmement, à cause de l'habitude qui nous fait regarder comme parfaits les discours que nous sommes accoutumés à admirer depuis longtemps; enfin, à cause de cet entraînement involontaire et de cette imitation, qui nous font estimer les choses qu'estiment ceux que nous voulons égaler. Il est plusieurs autres raisons que je pourrais indiquer encore; mais je m'attache aux plus importantes, et je ne rappellerai pas toutes celles qui ont déterminé divers écrivains à rechercher, les uns, un arrangement de mots ferme, grave, austère, antique, sévère, ennemi de tout ornement; les autres, un arrangement gracieux, doux, convenable à la scène, embelli de toutes les richesses de l'an, propre enfin à séduire la multitude dans les réunions solennelles, ou au milieu des assemblées politiques ; et quelques-uns, à prendre de côté et d'autre ce qu'il y a de parfait, pour en former un arrangement, qui tient, entre les deux autres, un juste milieu. XXXVII. Telles sont les trois principales espèces de l'arrangement des mots. Celles qui en dérivent sont en très grand nombre : elles diffèrent en ce qu'elles donnent aux mots, les unes une construction lâche, et les autres une construction où tout se presse. Un arrangement de mots pur et sans mélange ne se trouve ni chez aucun poète, ni chez aucun orateur : on en chercherait en vain des exemples. Dans la nature même, il n'est pas d'élément véritablement simple : la terre, l'eau, l'air, le feu se prêtent mutuellement quelque chose; mais on les désigne par le nom de la substance qui domine dans leur formation. Faut-il s'étonner après cela que l'harmonie du style, qui se divise en trois branches, ne soit jamais pure et sans mélange, et qu'elles reçoivent chacune leur nom et leur caractère des éléments mêmes qui y sont dominants. Ainsi, lorsque je cite des exemples à l'appui de mes observations; lorsque je compare les poètes et les prosateurs qui ont adopté telle ou telle espèce d'arrangement, on ne doit pas attaquer les traits de ressemblance qu'ils présentent, ni les qualités particulières qui les distinguent : il faut les juger d'après le ton général de leurs ouvrages et ne point perdre de vue que si tel est, presque toujours, le caractère de l'arrangement qu'ils ont suivi, cependant il ne se retrouve point partout. XXXVIII. Voici quel est le caractère de cette harmonie austère, antique, et qui cherche moins les ornements que la gravité. Elle aime les mots larges et composés de syllabes longues, de manière qu'ils aient une désinence ferme et qu'ils soient séparés par des intervalles sensibles. Elle est produite par le concours des voyelles, lorsqu'un mot finit par une voyelle qui se trouve au commencement du mot suivant : alors, il y a nécessairement un intervalle entre les deux mots. Et qu'on ne dise pas , à quoi bon cette remarque, et comment un intervalle entre les mots peut-il exister, quand des voyelles se rencontrent ? L'art du musicien et du poète prouve que l'espace entre deux voyelles peut être rempli par des semi-voyelles; ce qui n'arriverait pu, si les voyelles n'étaient point séparées par un intervalle sensible. Telle est la première qualité de cette espèce d'harmonie. Une autre propriété qui la caractérise, c'en qu'elle aime à supprimer certaines lettres, ou à les placer de manière qu'elles s'appuient les unes sur les autres ; enfin, à donner à la liaison des mots une sorte d'âpreté qui heurte légèrement l'oreille : c'est celle qui résulte de l'emploi des muettes et des semi-voyelles, lorsqu'un membre de la période se termine par la lettre qui se retrouve au commencement de l'autre, et que rien ne peut être retranché, ni absorbé. Cette rencontre produit la dureté, même dans le corps des mots, ai les syllabes sont composées de lettres rudes. Il faut alors beaucoup d'art pour qu'il n'en résulte point, à l'insu de l'écrivain, des sons durs et désagréables ; pour que le concours de ces lettres ne choque point l'oreille, et qu'elles produisent une harmonie qui ait un vernis antique et une grâce naturelle. Il suffit de dire aux esprits cultivés que toutes les expressions nobles ont une beauté et une élégance qui leur sont propres. XXXIX. Tels sont, par rapport aux premiers éléments des sons et par rapport aux lettres, les traits caractéristiques de cette espèce d'harmonie. Dans les membres de phrase qui sont composés de plusieurs mots et qui forment les périodes, ces qualités ne suffisent pas; il faut, en outre, les nombres qui leur servent de mesure : ces nombres ne doivent être ni traînants, ni lâches, ni sans élévation; mais nobles, rapides et majestueux. Il ne faut pas envisager le nombre dans le discours comme un ornement frivole, purement accessoire et sans importance : s'il m'est permis de dire ma pensée tout entière, rien n'est aussi propre à charmer les auditeurs et à séduire l'oreille. Outre le nombre, le discours exige que les figures de pensées et de mots soient nobles et pleines de dignité. Je ne dois pas énumérer ici les différentes figures de l'une et de l'autre espèce, ni parler de celles qui convient nuit à cette espèce d'harmonie, puisqu'elle exige que les périodes soient sans art et simples, qu'elles n'entraînent point l'esprit, qu'elles n'absorbent pas toute la respiration de l'orateur, qu'elles ne soient point chargées de mots superflus et qui n'ajoutent rien à la pensée; enfin, qu'elles ne se terminent point par des nombres faits pour le théâtre ou d'une douceur affectée. En général, elle n'admet pas les tours périodiques : elle doit être simple et exempte de travail, rechercher de préférence les membres courts et prendre la nature pour modèle. Si quelquefois elle a des membres ou des périodes travaillés avec art et des chutes nombreuses, c'est qu'elle ne les évite point, quand le hasard les lui présente. Voici d'autres qualités de cette harmonie antique et austère. Elle fait rarement usage des liaisons et des articles : souvent même, elle s'en sert moins qu'il ne faudrait. Elle n'affecte point des chutes uniformes : au contraire, elle les varie souvent. Elle ne s'attache pas à ce qu'une période corresponde parfaitement à celle qui précède; mais elle en unit les diverses parties par une liaison admirable, qui lui est propre et qui échappe aux yeux du vulgaire. On en trouve beaucoup d'exemples dans les poètes, et surtout chez les lyriques : ils abondent dans Eschyle et dans Pindare, si l'on excepte les chants destinés aux jeunes vierges, et d'autres passages analogues. Leurs écrits sont empreints de noblesse, de gravité, et d'une sorte de négligence antique. Parmi les historiens, Thucydide est bien supérieur à tous les autres, pour cette espèce d'harmonie : la palme ne saurait lui être disputée. Si l'on en veut un exemple, laissant de côté les poètes, je me bornerai à celui-ci : « La guerre dont j'entreprends le récit, fut d'une longue durée, et attira sur la Grèce des désastres tels que jamais on n'en vit d'aussi grands, dans le même espace de temps. Jamais autant de villes ne tombèrent au pouvoir des ennemis ou ne furent détruites ; les unes par les barbares, les autres par les deux peuples rivaux. Plusieurs même eurent de nouveaux maîtres et changèrent d'habitanτs. Jamais on ne vit tant d'exils ni tant de massacres, nés de la guerre ou des dissensions. Des événements connus par la tradition, mais rarement confirmés par les effets, ne doivent plus paraître incroyables, après les violents tremblements de terre qui, durant cette guerre, agitèrent une partie de l'univers. Il y eut aussi plus d'éclipses de soleil qu'on n'en compta dans tout autre temps ; de grandes sécheresses, et, avec elles, la famine et des maladies contagieuses, qui firent des ravages horribles et dévorèrent une partie de la population; en un mot, tous les fléaux à la fois vinrent fondre sur la Grèce. » Ainsi, ce qui constitue cette pre¬mière espèce d'harmonie , c'est qu'elle est grave , austère, noble, et a pour principal ornement un certain air d'antiquité. XL. Je vais faire connaître la seconde espèce d'harmonie; celle qui est travaillée avec art, qui a quelque chose de théâtral et qui préfère les ornements à la noblesse. Elle recherche les mots les plus doux et les plus coulants: elle court après l'euphonie, les périodes nombreuses et la douceur qui en découle. Jamais elle ne souffre un mot placé au hasard, ou joint inconsidérément à un autre. Elle examine avec le plus grand soin l'arrangement le plus propre à produire des sons agréables ; les tours qui peuvent donner à la phrase une mélodie musicale; et c'est à ceux-là qu'elle s'attache de préférence. Elle vise à ce que les mots se lient et se fondent convenablement, et à donner aux pensées un ton vif et rapide. Pour y parvenir, elle évite avec le plus grand soin le concours des voyelles, parce qu'il troublerait la marche douce et coulante du style. Elle fuit. aussi la rencontre des semi-voyelles et des muettes, qui produiraient des sons durs et pourraient blesser l'oreille. Cependant, comme les mots qui désignent les personnes ou les choses, loin d'être toujours composés de sons agréables et doux, ont souvent un son rude, elle s'attache au naturel, et s'efforce d'adoucir ces sons par l'ordre dans lequel elle les dispose, en les faisant suivre ou précéder de certains mots d'un son plus gracieux, et qui, au lieu d'être nécessaires au sens, sont quelquefois inutiles. Seulement, ils servent de lien entre les mots qui précèdent et ceux qui suivent : ils empêchent qu'un mot terminé par une lettre dure ne se joigne avec un autre qui commence par une lettre semblable ; ce qui rendrait le style rude et choquant : ces mots intercalés produisent des sons doux et unis. Cette espèce d'harmonie a pour principal objet de lier et de coudre, pour ainsi dire, les unes aux autres les diverses parties de la période; en sorte qu'elle ne paraisse former qu'une seule phrase, et qu'elle ait la mélodie douce et séduisante d'un concert, Or, pour que le discours ait cette harmonie musicale, il faut une grande justesse des sons; comme il faut une parfaite correspondance des choses, pour qu'il forme un tissu où tout soit étroitement lié : mais ce sujet est du ressort d'un autre art. La marche du style est ou vive et rapide, comme celle des corps qui roulent dans une plaine immense où rien ne les arrête; ou bien, il se fraie doucement une route à travers l'oreille sans le moindre effort, et avec la même facilité que les sons d'un instrument ou un chant mélodieux. De plus, cette harmonie tâche de donner aux incises la forme du vers, un son doux et uni : elle veille surtout à ce que les divers membres de la période soient pleins d'élégance et liés par une affinité naturelle. Dans les périodes qu'elle emploie, elle ne cherche point les nombres les plus nobles, mais les plus agréables; par ce moyen, elles paraissent bien tournées, sagement composées, et terminées par une chute ferme. Quant aux figures, elle s'attache surtout à celles qui agissent avec le plus de force sur la multitude. Elles forment tous ses ornements et toute sa beauté; toutefois, elle ne les prodigue pas de manière à fatiguer l'oreille : ces figures sont les périodes à membres symétriques, les chutes consonantes, les antithèses, les paronomases, les inversions, les répétitions, et d'autres de même espèce. Tels sont, à mon avis, les traits caractéristiques de cette harmonie. J'indiquerai pour modèles Hésiode, Sapho et Anacréon, parmi les poètes; Isocrate et ceux qui l'ont imité, parmi les prosateurs. J'ai déjà cité plusieurs passages propres à faite connaître la manière de cet orateur, et d'après lesquels il est facile de voir si, chez lui, l'arrangement des mots a les qualités dont je viens de parler. Pour qu'on ne m'accuse pas d'interrompre la suite de mon sujet, en renvoyant mes lecteurs aux exemples que j'ai rapportés, voici un fragment du panégyrique il ne nous arrêtera pas longtemps. C'est le passage où il raconte les exploits des Athéniens dans le combat naval auprès de Salamine : « Comme ils n'étaient pas à même de tenir tête à deux armées à la fois, ils rassemblèrent tous les habitants de la ville, sortirent d'Athènes et firent voile vers une île voisine, afin d'affronter les hasards de la guerre contre une seule partie des ennemis, et non contre l'une et l'autre armée. Où trouver des hommes plus généreux et plus dévoués à leur pays. que ces citoyens qui, pour ne pas être les auteurs de l'asservissement d'une partie de la Grèce, eurent la force de voir leur ville déserte, les champs dévastés, les temples pillés, les vaisseaux embrasés, et toutes les horreurs de la guerre réunies sur leur patrie. Ces prodiges de courage étaient peu de chose pour eux ils entreprirent d'attaquer seuls une flotte de douze cents vaisseaux; mais ils ne furent pas abandonnés à leurs seules forces. Leur bravoure fit rougir les peuples du Péloponnèse ; et bien convaincus que si Athènes succombait, ils ne pourraient se sauver, ou que si elle sortait triomphante de cette lutte, leur république serait flétrie d'un opprobre éternel, ils se virent réduits à partager tous les dangers. Quant au tumulte, aux cris, aux exhortations, cortège ordinaire des batailles navales, il serait inutile, je pense, de les rappeler en ce moment : mon devoir se borne à parler des actions dignes d'un peuple, qui dominait dans la Grèce, et des exploits que j'ai déjà racontés. Notre patrie, tant qu'elle conserva sa puissance, fut tellement au-dessus des autres républiques, qu'au moment de sa ruine, et dans une bataille qui allait décider du sort de la Grèce, elle fournit plus de galères que tous les peuples qui prirent part au combat. Il n'est personne assez jaloux de notre gloire, pour ne pas reconnaître que si la Grèce triompha dans cette mémorable bataille sur mer, Athènes peut s'arroger l'honneur de la victoire. Ainsi, lorsqu'une expédition se prépare contre les barbares, à quelle nation la suprématie doit-elle être déférée? N'est-ce pas à celle qui, dans une guerre antérieure, s'est couverte de gloire; qui seule a souvent bravé tous les périls pour d'autres peuples; à celle, enfin, qui, au milieu des communs dangers, se montra la plus brave, déserta sa patrie pour sauver la Grèce entière, fonda jadis plusieurs villes, et qui tout récemment encore les a préservées des plus grands désastres? Ne serait-ce pas le comble de l'injustice, si après avoir supporté les plus dures fatigues, nous étions moins bien partagés que les autres peuples pour les honneurs; si, alors au premier rang pour défendre les autres, aujourd'hui nous étirons réduits à marcher à leur suite ? » XLI. La troisième espèce d'harmonie, qui tient le milieu entre les deux autres, et leur emprunte ce qu'elles offrent de plus parfait, n'a point de caractère propre. Les écrivains, qui l'ont adopté, évitent certaines choses et en recherchent d'autres ; de sorte que leur style ressemble à ces couleurs habilement fondues que le peintre jette sur un tableau : le modèle le plus parfait de cette espèce d'arrangement est Homère. Il n'est point d'auteur dont le style soit un plus sage mélange de sublime et de simplicité : il a été imité par une foule de poètes épiques, lyriques, tragiques et comiques; par d'anciens historiens, par des philosophes et des orateurs. Comme il serait trop long de les citer tous, je me contenterai de rappeler les deux qui méritent le premier rang sous ce rapport ; Hérodote parmi les historiens, et Platon parmi les philosophes : ils donnent aux mots un arrangement qui unit la noblesse à la grâce. Mon opinion à cet égard est-elle juste et raisonnable? Pour en juger, il suffit d'un examen attentif de leurs ouvrages. Qui pourrait, par exemple, ne pas voir un arrangement où la grâce est jointe à l'austérité, et qui renferme ce que les deux autres genres ont de plus parfait, dans le discours qu'Hérodote met dans la bouche de Xerxès délibérant sur la guerre qu'il va déclarer à la Grèce. Je donnerai au style les formes du dialecte attique : « Peuples de la Perse, je ne viens point établir une nouvelle coutume : je me conforme à celle que j'ai reçue de mes pères. Les vieillards me l'ont appris, jamais none n'avons été exempts d'alarmes, depuis que l'expulsion d'Astyage par Cyrus a fait passer l'empire des Mèdes entre nos mains. Un dieu règle ainsi nos destinées et noms réserve de grands avantages, si nous suivons sa volonté. Il n'est pas nécessaire de rappeler à des hommes qui en sont instruits, les exploits de Cyrus, de Cambyse et de mon père, ni de leur dire quels peuples ils firent passer sons leur domination. Depuis le jour où je suis monté sur le trône, j'ai mis tous mes soins à ne pas rester au-dessous de la gloire de mes aïeux, et à agrandir, autant qu'ils l'ont fait, la puissance de la Perse. Toujours occupé de cette pensée, je trouve que mon règne n'est pas sans quelque gloire : les provinces dont se composent aujourd'hui mes états ne sont ni moins vastes, ni moins riches; quelques-unes sont même plus fertiles, et nous avons tiré de plusieurs peuples une vengeance éclatante. Je vous ai convoqués pour vous soumettre les projets que je médite. Je veux jeter un pont sur la mer et conduire nos armées en Europe, au sein même de la Grèce, pour punir les Athéniens de l'insulte qu'ils ont fait essuyer aux Perses et à mon père. Darius, vous le savez, avait le dessein de marcher avec une armée contre ce peuple ; mais la mort vint le surprendre, et il ne put se venger. Pour moi, je m'efforcerai de punir Athènes, et je ne goûterai point de repos avant d'avoir pris et brûlé cette ville dont les habitants ont commis tant d'injustices envers mon père et envers moi. D'abord, venus à Sardes avec Aristagoras de Milet, mi de mes esclaves, ils livrèrent aux flammes les bois sacrés et les temples. Personne n'ignore de quelle manière ils ont agi plus tard envers vous, lorsque vous pénétrâtes dans leur territoire, sous la conduite de Datis et d'Artapherne. Voilà les motifs qui m'engagent à leur déclarer la guerre. Que de biens vont passer dans nos mains, si nous subjuguons les Athéniens et les peuples qui habitent les contrées où régna le phrygien Pélops ! Alors, la Perse n'aura d'autres limites que le séjour même de Jupiter, et le soleil n'éclairera point de contrée qui serve de borne à mes états. En parcourant l'Europe entière, avec le secours de vos bras, de tout l'univers je ne ferai qu'un seul empire. Oui, j'en ai l'assurance, il n'y aura plus ni ville, ni nation capable de lutter contre nous, une fois que nous aurons vaincu les peuples dont je vous ai parlé. Les innocents et les coupables seront également réduits à I'esclavage. Si vous avez à coeur de bien mériter de votre roi, aussitôt que je ferai connaître le moment de marcher, hâtez-vous d'obéir. La tribu qui conduira sous ses drapeaux les soldats les mieux équipés, aura pour récompense les objets les plus précieux de mon palais. Telle est ma volonté : afin qu'on ne dise point que je ne prends que mon opinion pour guides je vous soumets mes projets et je vous engage à dire librement votre avis. » XLII. Je voulais rapporter plusieurs passages de cet historien, pour faire mieux apprécier le caractère de cet arrangement; mais le temps ne me le permet pas. Je dois me hâter d'arriver à mon but, et veiller surtout à ne point causer d'ennui. Platon lui-même, le divin Platon me pardonnera de ne pas le citer de nouveau. Cette dissertation n'est qu'un exposé rapide, qui doit suffire aux lecteurs instruits : les observations que je viens de présenter ont pour objet de faire connaître les diverses espèces d'arrangement des mots, leurs qualités principales, et les auteurs qui les ont le mieux employées. Après avoir avancé que Démosthène s'est attaché à celle qui, par un sage tempérament, tient le milieu entre les deux autres, j'ai fait en sorte qu'on ne puisse point me dire : Quelles sont les espèces que vous placez aux extrêmes opposés? Quelle est la nature de chacune? En quoi consiste l'art de les mêler et de les fondre ? car les deux extrêmes ne sont pas d'une grande utilité. Cette considération m'a obligé à m'en occuper, comme je l'ai déjà dit. J'ai taché d'ailleurs à de rendre, par quelque digression agréable, la marche de ce traité moins uniforme et moins sérieuse. Vouloir convaincre par des observations accessoires, ou les négliger lorsque le sujet les exige, ce serait manquer aux convenances. XLIII. Après ce que j'ai dit pour montrer que telle est la manière de cet orateur, si l'on examine ses phrases avec attention, ne trouvera-t-on pas que les unes ont un tour noble, austère, élevé ; les autres, beaucoup de grâce et de douceur? Si l'on désire de nouvelles preuves, qu'on prenne au hasard un de ses discours; qu'on parcoure avec le plus grand soin telle partie qu'on voudra, et l'on verra que, parmi ses périodes, les unes sont longuement développées, les autres rapides et arrondies ; que celles-ci frappent l'oreille par des sous rudes, et que celles-là plaisent par une douce mélodie; que certaines éveillent dans l'âme de l'auditeur les émotions fortes, et d'autres les émotions douces; en un mot, qu'elles présentent des différences sensibles, sous le rapport de l'arrangement : on peut s'en convaincre par les citations suivantes. Je ne rapporterai point des exemples choisis à dessein, mais le premier qui se présente : il est tiré de l'une de ses harangues contre Philippe. « Εἰ δέ τις ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὸν Φίλιππον εὐτυχοῦντα ὁρῶν ταύτῃ φοβερὸν προσπολεμῆσαι νομίζει, σώφρονος μὲν ἀνθρώπου προνοίᾳ χρῆται. Μεγάλη γὰρ ῥοπή, μᾶλλον δὲ ὅλον ἡ τύχη παρὰ πάντ´ ἐστὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων πράγματα. Οὐ μὴν ἀλλ´ ἔγωγε, εἴ τις αἵρεσίν μοι δοίη, τὴν τῆς ἡμετέρας πόλεως τύχην ἂν ἑλοίμην, ἐθελόντων ἃ προσήκει ποιεῖν ὑμῶν καὶ κατὰ μικρόν, ἢ τὴν ἐκείνου. Si quelqu'un d'entre vous, ô Athéniens, voyant la prospérité de Philippe, le regarde comme un ennemi redoutable; il pense sagement, car la fortune est d'un grand poids dans les choses humaines, ou plutôt elle est tout. cependant, si on me laissait la liberté de choisir, pour peu que vous fussiez déterminés à exécuter seulement une faible partie de ce que le devoir vous impose, je n'hésiterais pas à préférer votre fortune à la sienne. » Dans ces trois périodes, tous les membres ont de la cadence et de la grâce, parce qu'ils sont placés dans un ordre plein de nombre et d'harmonie. A peine y trouve-t-on quelques sons qui en troublent la douceur et y mêlent quelque rudesse. Dans la première, il y a deux concours de voyelles ; le premier dans ces mots : « ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι », et le second dans ceux-ci « εὐτυχοῦντα ὁρῶν » : ils rompent la liaison. Dans deux ou trois autres endroits, les semi-voyelles se rencontrent, quoiqu'elles ne soient pas de nature à s'unir : par exemple, dans les mots « τὸν Φίλιππον » et « ταύτῃ φοβερὸν προσπολεμῆσαι » ; elles troublent aussi la douceur des sons et leur ôtent tout agrément. Dans la seconde période, l'arrangement des mots est dur. Ainsi, dans cette phrase : « Μεγάλη γὰρ ῥοπή », les deux ρρ ne sauraient s'unir. Il en est de même de ces mots : « ἀνθρώπων πράγματα » la dureté des sons n'est pas adoucie par ce qui suit. L'arrangement devient lâche dans cette phrase « μᾶλλον δὲ ὅλον ἡ τύχη », où la multiplicité des brèves fait disparaître les intervalles. Dans la troisième période, si l'on élide les voyelles par des synalèphes, dans οἴομαι et δέον, par exessple, il n'y aura plus de concours de voyelles. On n'aura dans deux ou trois endroits que des consonnes entrelacées, qui rompront l'harmonie de la phrase « αἵρεσίν μοι δοίη », et « τῆς ἡμετέρας πόλεως ». Jusque-là, c'en la seconde espèce d'arrangement qui domine; dans la suite, la première est plus souvent employée : « Πολὺ γὰρ πλείους ἀφορμὰς εἰς τὸ τὴν παρὰ τῶν θεῶν εὔνοιαν ἔχειν ὁρῶ ὑμῖν ἐνούσας ἢ ἐκείνῳ· ἀλλ´ οἴομαι καθήμεθα οὐδὲν ποιοῦντες· οὐκ ἔνι δ´ αὐτὸν ἀργοῦντα οὐδὲ φίλοις ἐπιτάττειν, μή τί γε θεοῖς. Oui, j'en suis convaincu; nous avons plus de raisons que lui compter sur la bienveillance des dieux; mais nous restons dans l'inaction; et cependant, l'indolent ne peut rien exiger de ses amis, et bien moins encore des dieux. » Ici, nous trouvons un grand concours de voyelles, de semi-voyelles et de muettes qui impriment à l'arrangement des mots une marche ferme et soutenue, et aux sons une sorte de dureté. Dans d'autres périodes, pour rendre la composition plus rapide, il évite le concours des voyelles ; mais il enchâsse avec art les muettes et les semi-voyelles, afin de donner à sa diction une rudesse symétrisée : tel est, en général, le caractère de la composition de Démosthène. A quoi bon pousser plus loin ces observations ? Chez lui, ce n'est pas seulement dans les mots que domine cette harmonie, qui tient un juste milieu entre les deux autres; mais dans la structure des membres et dans leur arrangement; dans l'étendue, et le tour des périodes, et jusque dans les nombres mêmes de ces périodes et de leurs membres. Il fait un fréquent usage des incises ; et le plus souvent, il y suit le même arrangement. On peut en dire autant de la plupart de ses périodes : les unes sont nobles, rapides, arrondies; les autres, lâches, prolixes, et ne se terminent point par une chute frappante. Quelques-unes ont une marche trop précipitée et absorbent, par leur étendue, foui le volume de la respiration de l'orateur; d'autres sont tellement longues, que ce n'est qu'après avoir repris haleine trois ou quatre fois qu'on arrive à la fin. Quant aux figures, elles sont quelquefois nobles, antiques, graves, redondantes; et d'autres fois d'une grâce affectée, puériles, déclamatoires. Quant aux nombres, ils sont presque partout mâles, nobles, pleins de dignité; et rarement sautillants, mous ou brusques. Je reviendrai sur cet objet dans un moment plus favorable : je vais me borner ici à quelques réflexions qui me paraissent nécessaires, pour m'occuper ensuite de mon sujet principal. XLIV. Ces réflexions, les voici : si cette harmonie sagement tempérée est la meilleure, comme je l'ai déjà dit; si Démosthène l'a portée à un plus haut point de perfection que tous les écrivains, en lui donnant, d'après la nature des sujets, une allure plus pressée ou plus lâche ; tantôt de la noblesse et tantôt de la simplicité, pourquoi ne suit-il pas toujours la même marche? D'après quelle règle fait-il dominer de préférence telle ou telle espèce d'arrangement? Sans doute, la nature et l'expérience avaient appris à ce grand orateur que la même harmonie saurait plaire à des hommes accourus à une fête publique ou rassemblés dans une école, et à ceux qui jugent au barreau ou délibèrent dans les assemblées publiques. Les premiers cherchent ce qui peut charmer ou faire une illusion agréable; les seconds, ce qui est instructif et utile. Il sentit aussi que l'éloquence du barreau n'a pas besoin d'ornements captieux et séduisants ; et que le genre démonstratif n'admet rien d'inculte, rien de négligé. Je ne peux citer aucun de ses panégyriques, parce que ceux qu'on lui attribue me paraissent sortis d'une autre plume. Je n'y trouve point la moindre trace du caractère de Démosthène, soit dans les pensées soit dans l'arrangement des mots : tout y est inférieur à sa manière. Cette remarque s'applique surtout au discours qui a pour titre : Éloge funèbre. Il est affecté, frivole, puéril. Il en est de même du panégyrique de Pausanias, qui roule sur des divagations sophistiques. Mais ce n'est pas le moment de développer cette assertion. XLV. Dans les harangues qu'il prononça au barreau ou dans les assemblées publiques, Démosthène suit les mêmes principes. Si le sujet demande des tours gracieux, il donne à sa diction la douceur et l'élégance du panégyrique. On le voit dans son discours contre Aristocrate ; surtout, lorsqu'il passe en revue toutes les lois; et en particulier, les lois contre le meurtre, et qu'il fait voir à quel usage chacune est destinée. De même, dans plusieurs passages de la harangue contre Leptine, au sujet des immunités; notamment, quand il fait l'éloge de Chabrias, de Conon, et, d'autres citoyens, qui avaient bien mérité de la patrie. On peut en dire autant du discours sur la couronne et de plusieurs autres. A mon avis, la première considération qui l'a déterminé à procéder de cette manière, c'est la nécessité d'assortir l'arrangement des mots aux sujets qu'il avait à traiter : la seconde, c'est qu'il savait que torts les sujets ne comportent ni le même style, ni les mêmes ornements, ni la même harmonie ; que celle-ci doit être quelquefois douce, et quelquefois austère. Guidé par cette vérité incontestable, c'est le plus souvent dans l'exorde et dans la narration qu'il met de le pompe et de la grâce. Dans la confirmation et dans la péroraison, il s'attache moins à l'élégance : il leur donne presque toujours un ton austère, une sorte de négligence antique; et c'est avec raison. En effet, lorsqu'il faut gagner l'auditeur et fixer son attention, quoiqu'il ait quelquefois à écouter le récit aride et fastidieux des crimes d'autrui; si l'arrangement des mots ne charme point l'oreille, s'il n'offre aucun adoucissement à une langue contention d'esprit, les preuves ne feront point une impression profonde. Mais lorsque tout doit tendre au vrai et à l'utile, la plupart des auditeurs exigent une diction simple, naturelle, et qui unisse la noblesse à la gravité. Ainsi, les finesses de l'art, les grâces séduisantes du style ne sauraient trouver place dans les débats judiciaires. Un orateur, qui n'ignorait pas que chaque sujet est d'une nature différente, ne pouvait point supposer que les mêmes ornements convinssent à toutes les madères : il dut sentir que l'éloquence politique exige de la noblesse et de la majesté; que celle du barreau, où le juge prononce sur les crimes de ses semblables et sur leur conduite, en un mot, sur tout ce qu'il y a de plus sacré parmi les hommes, comporte la grâce, l'élégance et tous les artifices de l'éloquence. Aussi, dans ses harangues politiques, surtout dans ses Philippiques, fait-il usage de l'harmonie où ces deux qualités dominent; il en est même prodigue jusqu'à la satiété. Dans ses harangues judiciaires, lorsqu'elles roulent sur des questions qui intéressent l'honneur national, il s'attache à la noblesse avant tout : dans les causes privées, il en fait moins usage. XLVI. Pour tout dire en peu de mots, ce n'est pas seulement dans les différents genres de discours ou en traitant des sujets si divers, qu'il se crut obligé de varier l'arrangement des mots ; mais encore dans les arguments, et jusque dans les parties dont ils se composent. Persuadé que leurs éléments ont tous des qualités qui leur sont propres, il adopta un arrangement de mots différent pour chacun : ainsi, les sentences, les enthymèmes, les exemples ont chez lui une harmonie particulière. Il serait trop long d'en faire connaître les nuances, de montrer avec quel art il sait donner à tout la couleur convenable et employer un arrangement de mots tantôt serré et tantôt lâche, dans les divines harangues qu'il nous a laissées. Je ne crois pas avoir besoin de nouveaux exemples, pour persuader à mes lecteurs que tel est le caractère de son éloquence ; surtout, après que nous avons examiné si elle a véritablement les qualités que je lui attribue. Cette dissertation deviendrait trop longue, et je craindrais que de simples mémoires ne prissent la forme d'un traité destiné aux écoles. Les exemples que j'ai rapportés, quoique peu nombreux, suffiront aux hommes instruits pour juger du tout : or, ce n'est point pour ceux qui n'ont aucune idée de Démosthène que j'ai rassemblé ces observations. Ainsi, je me borne à des remarques générales, et je me hâte de reprendre la suite du sujet que j'avais d'abord entamé. XLVII. Mon second objet était de montrer par quels principes et par quels exercices Démosthène est arrivé à l'arrangement des mots préférable à tout autre. Je ferai connaître sans détour mon opinion sur ce point. En tout, deux choses contribuent à la perfection : la beauté et la grâce, qui sont tout à la fois l'ouvrage de la nature et de l'art. Démosthène savait qu'elles doivent se trouver réunies, jusqu'à un certain point, dans les vers et dans la prose. Séparées, elles restent toujours imparfaites et sont d'un effet moins sensible. D'après ce principe, et sentant que la perfection de l'harmonie austère consiste dans la noblesse, et celle de l'harmonie tempérée dans la grâce, il rechercha tout ce qui peut produire ces deux qualités : il en trouva la source commune dans la mélodie, les nombres, les inversions et l'à-propos, qui doit toujours en être inséparable ; mais il vit aussi qu'il ne faut point donner partout le même tour à ces divers ornements. Je vais apprendre de quelle manière on doit en faire usage. XLVIII. Les parties du discours, auxquelles certains grammairiens donnent le nom d'éléments sont au nombre de trois, suivant Théodecte et Aristote : le nom, le verbe et la conjonction. D'autres en reconnaissent un plus grand nombre. Quelque division qu'on adopte, on trouvera toujours dans chacune de ces parties la modulation et le temps. La modulation consiste dans l'accent, qui est aigu ou grave : le temps dans la longueur ou la brièveté des syllabes. Du temps naissent les pieds ; celui de deux syllabes brèves que plusieurs appellent Hégémon, et dont let deux temps, le levé et le frappé, sont égaux : le pied de trois syllabes brèves, qui, suivant Aristoxène, a le levé double du frappé. La modulation donné de la pompe aux divers éléments du discours ; le pied et le nombre fixent la mesure. Lorsqu'ils sont près de franchir les justes limites, le changement vient, par un sage tempérament, faire sortir de l'un et de l'autre toute l'utilité qu'ils renferment; et en les ramenant dans les bornes convenables, l'à-propos les embellit de toute la grâce dont ils sont susceptibles. On peut se faire une idée de ce que j'avance par l'art du musicien. Supposez qu'un homme donne au chant ou aux sons d'un instrument les plus douces modulations, sans s'inquiéter du rythme ; qui pourra l'approuver? Qu'arrivera-t-il, si, d'ailleurs habile à employer à propos la mélodie et le nombre, il s'en tient aux mêmes nombres, à la même mélodie, sans jamais y répandre la plus légère variété? Ne détruira-t-il pas tous les charmes de sa composition ? Et saurait-il la varier, s'il ne garde point les convenances prescrites par chaque sujet, la peine qu'il prend pour tout le reste ne sera-t-elle pas une peine inutile ? Pour moi, je le pense. Démosthène, qui avait senti cette vérité, étudia avec le plus grand soin la mélodie des mots et des membres de chaque période, ainsi que leurs nombres, et s'efforça de les adapter les uns aux autres, de manière qu'ils fussent tout à la fois harmonieux et bien cadencés. Il chercha en même temps à y jeter une grande variété, par mille figures de pensées et de mots, et respecta les convenances mieux que tout autre orateur. Convaincu, comme je l'ai déjà dit, qu'on parvient par les mêmes moyens à donner de la grâce et de la beauté au discours, il se demanda pourquoi les mêmes moyens ne produisent pas toujours les mêmes effets, et il en trouva la cause dans les diverses nuances des sons, qui ont, les uns de la noblesse; les autres de l'élégance, et exercent sur la diction la même influence que le chromatique sur l'harmonie musicale. Parmi les nombres aussi, plusieurs ont de la noblesse et de la majesté; d'autres, de la douceur et de la grâce. De même, parmi les inversions, il en est qui ont de la gravité, un vernis antique et austère; tandis que d'autres se distinguent par la grâce et la nouveauté; mais c'est surtout de l'à-propos que ces qualités tirent leur véritable valeur. D'après ces considérations, lorsque le style exige de l'éclat, Démosthène se sert de modulations nobles, de nombres pleins de dignité, d'inversions pompeuses; lorsqu'il demande un arrangement d'une espèce différente, il cherche, avant tout, à lui donner l'harmonie de la musique. Et qu'on ne s'étonne point de m'entendre dire que la prose doit avoir de la mélodie et du nombre, comme les odes ou les compositions musicales, tandis qu'on n'en sent pas la moindre trace à la lecture, dans les discours de Démosthène. Qu'on ne s'imagine pas que je veux tromper et m'appuyer sur des ornements qui ne conviennent qu'au style tempéré : ils se retrouvent dans le style le plus élevé, et principalement dans cet écrivain; mais ils y sont employés avec tant d'à-propos et de justesse qu'ils échappent aux sens. Quelquefois ses périodes sont lâches, et quelquefois très serrées. Dans d'autres, il s'écarte tellement des limites de la composition ordinaire, qu'il paraît employer des formes toutes nouvelles, sans recourir aux ressources de l'art. XLIX. Quelqu'un demandera peut-être que je rende compte ici des modulations et des nombres; que je fasse connaître les murs propres aux inversions, les convenances qui doivent régner dans chaque chose, les nombres qui caractérisent l'harmonie antique et austère, et ceux qui sont propres à l'harmonie douce et tempérée. On pourra aussi mettre en avant cette harmonie avec laquelle nous sommes familiarisés dès l'enfance, par les règles de la musique et de la grammaire, et me reprocher de m'arrêter trop long temps sur des choses rebattues et connues de tout le monde; quoique ce traité ne soit déjà que trop long, du moins, à mon avis. Je présume trop bien des lumières de mes lecteurs pour croire de nouveaux détails nécessaires ; et surtout des vôtres, ô mon cher Ammaeus. Si l'on veut des règles plus développées sur cette matière, on peut consulter, si on ne l'a déjà fait, mon ouvrage sur l'arrangement des mots; on y trouvera toutes celles qu'on peut désirer, et que je ne répète pas ici. Dans cet écrit, j'ai traité à fond cette question : je vais donc continuer meσ observations sur Démosthène. L. J'ai promis encore de dire à quels signes on peut reconnaître l'arrangement de mots qu'il a adopté, et le distinguer des autres orateurs. D'abord, on ne trouve chez lui aucune qualité qui lui soit tellement particulière qu'on ne la rencontre jamais dans les autres écrivains; mais la redondance et la superfluité, qui sont ordinairement un défaut, quand il s'agit de faire connaître une chose ou une personne, forment le trait principal de sa composition. Pour plus de clarté, je me servirai d'une comparaison tirée des objets sensibles. Nous avons tous une certaine taille, un teint, une figure, des membres, et dans ces membres mêmes des rapports déterminés, etc. Si l'on voulait , par une de ces choses, juger d'un homme tout entier, on n'arriverait point à une connaissance exacte; car on trouve dans plusieurs ce qu'on aurait regardé comme la marque caractéristique d'un seul. Mais lorsqu'on a saisi toutes les qualités, ou du moins le plus grand nombre et les plus importantes, on reconnaît un homme à l'instant, et on ne se laisse pas tromper par la ressemblance. Je pense que ceux qui veulent se faire une idée parfaite de l'arrangement des mots dans Démosthène doivent choisir entre les qualités qui lui sont propres, les plus belles et les plus remarquables; d'abord, cette mélodie qui ne saurait être bien appréciée que par un sentiment qui échappe à l'analyse et qu'on ne peut acquérir que par un long exercice et beaucoup d'usage. Les sculpteurs et les peintres ne pourraient, sans une grande expérience, fruit d'observations multipliées sur les ouvrages des anciens artistes, facilement reconnaître ou affirmer (puisqu'ils ne l'auraient appris que par la renommée), si telle statue est de Polyclète, de Phidias, ou d'Alcamène; si tel tableau est de Polygnote, de Timanthe, ou de Parrhasius ; et l'on prétendrait, après quelques études rapides et le travail d'un moment, posséder à fond tout ce qui concerne l'harmonie du discours il s'en faut beaucoup. Telle est la première qualité que l'on doit remarquer dans Démosthène, et on ne peut y être sensible que par l'étude et un long exercice : vient ensuite le choix des nombres. Chez lui, il n'y a point de passage qui n'ait ses nombres et ses pieds, tantôt parfaits et tantôt imparfaits; mais toujours mêlés par des combinaisons si habiles qu'on ne peut dire, s'il y règne, véritablement une cadence déterminée. L'éloquence, sous le rapport de l'arrangement des mots, n'offrirait aucune ressemblance avec la poésie, si elle n'avait une mesure et certains nombres placés à divers intervalles, mais qu'on ne découvre pas au premier coup-d'oeil. Toutefois, elle ne doit point avoir une mesure et des nombres parfaits; elle empiéterait sur le domaine de la poésie et perdrait son propre caractère. Il suit qu'elle ait des nombres convenables et une certaine mesure : par là, elle sera poétique, sans qu'on puisse la confondre avec la poésie; elle aura la mesure du vers, sans se changer en vers. La nature de ces diverses nuances n'est pas difficile à saisir. Si la diction a une mesure et des nombres fixes, soit pour chaque vers en particulier, soit pour chaque période que les musiciens appellent strophe; si les mêmes nombres et la même mesure se reproduisent avec des vers semblables, dans les périodes qu'on appelle antistrophes; enfin, si toute la pièce est composée de la même manière depuis le commencement jusqu'à la fin, on dit qu'elle est ἔμμετρος et ἔρρυθμος : les mots qu'elle emploie forment des pieds et des nombres. La diction dont la mesure et le nombre ne sont point assujettis à une règle déterminée, qui ne présente ni suite régulière, ni correspondance parfaite, ni ressemblance déterminée, a bien aussi ses nombres et sa mesure; mais comme ils sont de différentes espèces, elle n'est ni ἔρρυθμος ni ἔμμετρος; car ces nombres et cette mesure varient à chaque instant. Tel est le caractère de l'éloquence, lorsqu'elle a une couleur poétique; et telle est, en effet, celle de Démosthène. J'en ai fourni la preuve dans mon Traité sur l'arrangement des mots : je ne crois donc pas nécessaire de revenir sur cet objet. La troisième et la quatrième qualité de cet orateur consistent dans l'art de varier à l'infini les incises, les périodes, et de les former avec grâce. Jamais on ne trouve chez lui un passage qui ne soit remarquable par la variété et la nouveauté du tour : c'est un fait avéré, et je n'ai pas besoin de le démontrer par de nouvelles preuves. LI. Tels sont les traits caractéristiques du style de Démosthène et les signes auxquels il est facile de le reconnaître. On dira peut-être qu'il faudrait s'étonner qu'un si grand orateur, quand il écrivait ses discours, ait été assez mal inspiré pour tourmenter les mots en tous sens et transporter la coupe, l'harmonie, le nombre et la mesure de la musique et de la poésie, auxquelles appartiennent ces divers ornements, dans l'éloquence, qui ne saurait s'en servir avec avantage. Je répondrai qu'on doit songer d'abord qu'un orateur dont la gloire a éclipsé tous ceux qui l'avaient précédé, écrivant pour la postérité des discours destinés à soutenir l'examen de tous les siècles, ne dut y placer aucun mot au hasard. De même qu'il mit beaucoup de soin dans l'économie des pensées, de même aussi il dut travailler de son mieux l'arrangement des mots. D'ailleurs, il savait que les écrivains les plus célèbres et les meilleurs orateurs, Isocrate et Platon, avaient poli leurs ouvrages avec autant de soin que le graveur et le ciseleur; il n'ignorait pas que l'art d'écrire repose tout à la fois et sur les choses et sur le style ; que chacun de ces objets en embrasse deux autres ; que les choses renferment 1°. l'art de les trouver, que plusieurs critiques appellent l'invention; 2°. la manière de les employer, après les avoir trouvées, qu'on appelle l'économie : que le style comprend 1°. le choix des mots ; 2°. leur arrangement. Parmi ces divers objets, ceux que j'ai désignés les seconds dans chaque subdivision sont les plus importants, c'est-à-dire, l'économie, dans ce qui concerne les choses, et l'arrangement des mots, dans le style; mais ce n'est pas le moment de traiter à fond cette matière. Du reste, la justesse de ces assertions doit frapper l'homme dont l'esprit n'est ni mal fait , ni porté à la dispute. Il ne peut être surpris que Démosthène ait travaillé avec soin les membres des périodes, les nombres et les tours; qu'il se soit attaché à tous les ornements propres à donner à l'arrangement des mots de la beauté et de la grâce. Au contraire, l'homme ami du travail, celui qui n'est point susceptible de se rebuter et qui ne se contente pas d'une demi-science, pensera que ces ornements ne se trouvent chez Démosthène que dans un degré médiocre et presque sans art; qu'il n'attacha aucune importance, ou du moins qu'une importance bien légère à l'harmonie, pour un orateur qui ambitionnait la gloire de léguer à la postérité des ouvrages dignes d'immortaliser son génie. Le sculpteur et le peintre, dans leurs productions périssables, s'efforcent de représenter, avec la plus grande fidélité, une veine, une plume, le duvet, et d'autres choses semblables : ils épuisent, pour y parvenir, toutes les ressources de l'art; et l'orateur qui, par les dans de la nature et un travail opiniâtre, s'éleva au-dessus de tous ses contemporains, aurait négligé ces ornements, quelque légers qu'ils soient, si toutefois on doit les regarder comme tels ? LII. Je voudrais que ceux qui n'ont pu être convaincus par mes observations, songeassent que Démosthène, qui, dès sa plus tendre jeunesse, se livra à l'étude, mit probablement tous ses soins à se familiariser avec ces ressources de l'art et avec beaucoup d'autres. Mais une fois qu'il s'y fut accoutumé par un long exercice, et lorsqu'un travail assidu en eût empreint le type dans son âme, l'habitude sans doute lui en facilita l'emploi. C'est ce qui arrive dans tous les arts et surtout dans l'étude de la grammaire : elle sait pour juger de tout le reste, parce qu'elle est très simple et digne de notre attention. Quand nous l'étudions, nous commençons par le nom des éléments dont les sons se composent, et qu'on appelle lettres. Nous apprenons ensuite leur forme et leur valeur; et lorsque nous les connaissons, nous passons aux syllabes et à leurs diverses combinaisons. Une fois fixés sur ce point, nous nous occupons des diverses parties de l'oraison; telles que le nom, le verbe; la conjonction et des changement qu'elles peuvent subir, c'est-à-dire, des contractions, du prolongement, de l'accentuation aiguë ou grave, des genres, des cas, des nombres, des déclinaisons et d'une infinité de choses semblables. Dès que nous avons ces notions, nous commençons à lire et à écrire, d'abord syllabe par syllabe et lentement; parce que l'habitude n'est pas encore bien affermie. Mais au bout de quelque temps, et lorsqu'une application continuelle a donné plus de force à notre intelligence, nous lisons correctement, et avec une grande vitesse, le premier livre qu'on nous présente, sans songer aux préceptes, et quand nos en avons la pensée. Nous pouvons présumer qu'il en est de même dans l'art oratoire. Lorsque nous sommes passés de ces préceptes minutieux et peu importants à une habitude fortifiée, par un long exercice, elle est pour nous un guide infaillible, toutes les fois que nous voulons les mettre en pratique. Si l'on soutient que les ornements dont j'ai parlé demandent beaucoup de travail et de peine, cette assertion est sur tout vraie, quand il s'agit de Démosthène. D'ailleurs, rien de ce qui est grand ne peut être acquis par de légères fatigue; mais si l'on considère les fruits que l'on doit en recueillir un jour, ou seulement la gloire dont tous les siècles récompensent, pendant leur vie et après leur mort, ceux qui les ont supportées , elle ne paraîtront rien à côté d'un tel prix.
LIII. Il me reste à
parler de l'action qui rehaussa la beauté de son style; car l'action occupe une
place importante dans l'art oratoire, surtout au barreau. Là où elle se trouve,
les autres ornements peuvent paraître avec avantage; mais si l'orateur en est
dépourvu, ils sont tous inutiles. Pour en sentir le prix, il suffit de songer à
la différence qu'il y a entre les acteurs qui représentent une tragédie ou une
comédie. Ils récitent les mêmes vers, mais ils ne plaisent pas tous également.
Bien plus, noua nous fâchons contre ceux qui en altèrent ou qui en détruisent la
force, tout autant que si nous en avions reçu un véritable dommage. L'action me
paraît surtout nécessaire dans les harangues judiciaires, où le naturel et le
mouvement doivent dominer. Démosthène cultiva cette partie de l'art oratoire
avec autant de soin que toutes les autres. L'action embrasse deux choses, et il
ne négligea rien pour les acquérir toutes LIV. D'abord prenons ce passage plein de nombre: « Ὄλυνθον μὲν δὴ καὶ Μεθώνην καὶ Ἀπολλωνίαν, καὶ δύο καὶ τριάκοντα πόλεις ἐπὶ Θρᾴκης ἐῶ, ἃς ἁπάσας οὕτως ὠμῶς ἀνῄρηκεν, ὥστ' εἰ μηδεπώποτε ᾠκίσθησαν, ῥᾴδιον ἦν προσελθόντας εἰπεῖν· καὶ τὸ Φωκέων τοσοῦτον ἔθνος ἀνῃρημένον σιωπῶ. Je ne parle point d'Olynthe, de Méthone, d'Apollonie, de trente-deux villes de Thrace, qu'il avait cruellement détruites, qu'en passant aujourd'hui sur leurs ruines, il n'est pas facile de dire si jamais elles ont existé; je ne parle point des Phocéens, cette nation qu'il a anéantie. » Ici, le style nous apprend de quelle action il doit être accompagné. Tout en énumérant. les villes détruites par Philippe, il dit qu'il ne s'arrêtera pas à les énumérer. Ces paroles n'exigent-elles pas une sorte d'ironie, le ton de l'indignation et une voix élevée ? L'orateur ajoute qu'il ne veut pas tracer un lugubre tableau, parce qu'il serait trop douloureux; et cependant, il gémit sur le nombre de ces villes, il rappelle leur ruine consommée avec tant de promptitude qu'il n'en restait plus de vestige, aux lieu mêmes où elles s'élevaient. Ce passage ne doit-il pas être prononcé avec l'accent de la colère et de la pitié?. Mais quels sont le ton, les gestes, les attitudes du corps et le mouvement des mains que demandent la colère et la pitié? Pour s'en faire une juste idée, il faut les étudier dans l'homme qui éprouve ces sentiments: il y aurait de l'absurdité à chercher pour l'action un autre maître que la nature. Démosthène ajoute : « Ἀλλὰ Θετταλία πῶς ἔχει; οὐχὶ τὰς πολεῖς καὶ τὰς πολιτείας αὐτῶν ἀφῄρηται, καὶ τετραρχίας καθέστακεν, ἵνα μὴ μόνον κατὰ πόλεις, ἀλλὰ καὶ κατὰ ἔθνη δουλεύωσιν; Αἱ δ´ ἐν Εὐβοίᾳ πόλεις οὐκ ἤδη τυραννοῦνται, καὶ ταῦτα ἐν νήσῳ 〈πλησίον〉 Θηβῶν καὶ Ἀθηνῶν; Et la Thessalie, dans quel état est-elle ? Philippe n'a-t-il pas ruiné toutes ses villes et changé la forme de son gouvernement ? N'a-t-il pas établi des tétrarques, afin d'asservir, non pas quelques cantons, mais la nation entière ? Des tyrans ne sont-ils pas les maîtres d'Eubée, de cette île voisine de Thèbes et d'Athènes ? » Ce passage demande une action bien différente. L'orateur interroge, il répond lui-même, il s'indigne, il exagère l'horreur des événements. Or, l'interrogation, la réponse, l'exagération ont chacune un caractère particulier; elles ne peuvent être exprimées par la même in flexion de voix. Puis, il ajoute : « Καὶ οὐ γράφει μὲν ταῦτα, τοῖς δ´ ἔργοις οὐ ποιεῖ, ἀλλ´ ἐφ´ Ἑλλήσποντον οἴχεται, πρότερον ἧκεν ἐπ´ Ἀμβρακίαν, Ἦλιν ἔχει, τηλικαύτην πόλιν ἐν Πελοποννήσῳ· Μεγάροις ἐπεβούλευσεν· οὔθ´ ἡ Ἑλλὰς, οὔθ´ ἡ βάρβαρος χωρεῖ τὴν πλεονεξίαν τοῦ ἀνθρώπου. Il ne se borne pas à écrire en ces termes formels, mais il effectue ses menaces; il marche vers l'Hellespont, il est déjà tombé sur Ambracie, il est maître d'Élis, ville importante du Péloponnèse : tout récemment encore, il cherchait à surprendre Mégare. La Grèce, les pays barbares, rien ne peut assouvir sa cupidité». L'exposition de ces faits peut être aussi calme qu'une parodie ou un récit historique. L'orateur ne nom apprend-il pas de quelle manière chaque objet doit être exposé? Ne le dit-il pas à haute voix, même sans ouvrir la bouche? Ici, il faut de la politesse; là, de la rapidité; ailleurs, de la lenteur. Tantôt renoncez à un récit continu, et tantôt joignez ce qui suit avec ce qui précède. Pleurez avec ceux-ci; méprisez ceux-là. Ici, soyez consterné; là, tonnez; plus loin, exagérez tout. Suivant moi, l'homme qui a une âme insensible et plus dure qu'un rocher; celui que rien ne touche, que rien n'émeut et dont le coeur est fermé à toutes les affections, ne doit point répéter les paroles de Démosthène. Non sans doute, puisqu'il détruit cet esprit de vie qui en est le plus bel ornement, et que son éloquence alors ne diffère plus d'un corps d'une rare beauté, mais immobile et inanimé. On pourrait ajouter beaucoup d'autres réflexions; mais ce traité a déjà une longueur raisonnable, et il est temps de le terminer. A mes observances précédentes, j'ajouterai seulement que Démosthène présente dans son style l'alliance de toutes les beautés, à l'exception d'une seule ; je veux parler de la plaisanterie que d'autres appellent la grâce, parce qu'en effet elle est un des ornements les plus agréables du style : « Jamais un seul mortel n'a tous les dons des dieux. » Toutefois, ses écrits ont de l'urbanité; car le ciel ne lui refusa complètement aucune des qualités qu'on trouve dans les autres orateurs. LV. Eschine lui reproche, comme je l'ai déjà dit, d'employer quelquefois des expressions dures ou recherchées, et d'autres fois des expressions fades ou enflées: il est facile de réfuter ces allégations. En les examinant avec soin, chacune en particulier, on voit que certaines sont plutôt un éloge qu'un reproche, et que les autres manquent de fondement. Si l'orateur donne une sorte d'apprêté à son style, c'est lorsque le sujet le demande; et le sujet le demande souvent; surtout quand il faut faire mouvoir les ressorts du pathétique : mais alors c'est un véritable mérite: Rendre les auditeurs, gardiens sévères des lois, investigateurs infatigables de toutes les injustices, vengeurs inflexibles de la violation des lois, n'est-ce pas le seul, ou du moins l'un des plus beaux privilèges de l'éloquence ? Mais, dira -t-on peut-être, il n'est pas possible qu'un orateur qui recherche les expressions d'une grâce affectée, parvienne à exciter la haine, la pitié, et les autres passions : il doit s'attacher à trouver les pensées, qui vont naître ces passions, et à les revêtir d'expressions propres à remuer l'âme des auditeurs. Si Eschine avait reproché à Démosthène de donner une sorte d'aigreur à s'on style, quand les circonstances ne le demandent pas, d'y recourir trop souvent, ou de s'écarter d'une juste mesure, cette critique ne serait point dépourvue de fondement. Mais rien, dans Eschine, ne laisse entrevoir la trace d'une accusation de cette nature. Il blâme, en général, dans Démosthène l'emploi du pathétique ; et cependant le pathétique convient à l'éloquence civile. Ainsi, comme je l'ai dit, cette critique devient, à son insu, un véritable éloge. LVΙ. Ou peut en dire autant du reproche d'affectation que lui fait le même orateur. Elle n'est autre chose qu'une diction travaillés avec soin et qui s'éloigne du langage ordinaire. Si, de nos jours, on aime à entasser les mots au hasard; si, par une précipitation irréfléchie, nous transportons le même style dans tous les sujets, il est probable que les anciens n'agissaient pas ainsi. Lorsque Eschine avance que Démosthène, en employant mal à propos et outre mesure un style extraordinaire, a commis une double faute, il soutient une erreur manifeste. Démosthène en fait un fréquent usage dans les harangues politiques et dans les harangues judiciaires, pour proportionner son ton à la hauteur et à l'importance du sujet; mais dans les causes privées, qui roulent sur de légers intérêts, il emploie un style simple et usité. Rarement il s'élève; et encore n'est-ce pas ouvertement, mais plutôt tomme à son insu. Si Eschine critiqua ce style extraordinaire, parce qu'il en était l'ennemi, ce reproche doit paraître ridicule, puisqu'il est dirigé contre la véhémence, souvent nécessaire à l'orateur. L'éloquence civile exige qu'on ne présente pas toujours les pensées sous les mêmes formes et qu'on leur donne quelquefois un tour noble et poétique. Cette véhémence, qu'Eschine blâme dans Démosthène, est plutôt un mérite qu'un défaut; son accusation manque donc de fondement. On pourrait même supposer avec assez de vraisemblance qu'Eschine, qui était l'ennemi de Démosthène, n'ayant rien à lui reprocher, l'attaqua sur ce point sans trop de réflexion. LVII. Mais ce `qui me surprend le plus, c'est qu'il l'accuse d'employer certaines expressions fades ou enflées. Je ne vois pas que cet orateur en ait fait usage, comme le prétend son amer censeur. Telles sont, par exemple, les locutions : « Οὐδε τῆς φιλίας ἀπορρῆξαι τὴν συμμαχίαν. Il ne faut point rompre l'alliance de l'amitié.» - « Ἀμπελουργοῦσί τινες τὴν πόλιν. Il est des hommes qui ébourgeonnent la république.» - « Ὑποτέτμηται τὰ νεῦρα τοῦ δήμου. Ils coupent les nerfs du peuple.» - « Φορμορραφούμεθα. Nous sommes pliés comme de l'osier.» - « Ἐπὶ τὰ στενά τινες ὥσπερ τὰς βελόνας διείρουσιν. Les uns nous plient comme de l'osier; les autres nous enfilent comme des aiguilles. » οἷς αὐτὸς ἐπιτίθησι διακωμῳδῶν· Il ajoute d'un ton satirique : « Ταῦτα δέ οὐ κίναδος τί ἐστι ῥήματα, ἢ θαύματα. De qui sont, bête féroce et rusée, ces expressions ou plutôt ces monstres d'expressions ? » Ces expressions sont vraiment singulières et de mauvais goût; mais je n'ai pu en trouver de semblables dans les discours de Démosthène, quoique les écrits qu'il nous a laissés se composent d'environ cinquante ou soixante mille lignes. Peut-être y en a-t-il de fades et d'ambitieuses dans ceux qu'on lui attribue à tort; tels que le second discours contre Aristogiton; son Apologie au sujet des présents qu'il avait reçus ; le discours où il prouve qu'on ne doit point bannir Harpalus ; le discours contre Néaera; le discours sur les traités conclus avec Alexandre; et plusieurs autres qui ne sont pas son ouvrage, comme le prouve ce que j'ai déjà dit de cet orateur dans un autre traité. Cette réponse aux assertions d'Eschine me paraît suffisante.
LVIII. Certains critiques présentent comme un trait caractéristique de
Démosthène, et d'autres comme un
de ses défauts, l'emploi de plusieurs mots qui signifient la même chose ; par
exemple :
«
Φιλίππῳ δ´ ἐξέσται καὶ πράττειν καὶ ποιεῖν, ὅ τι βούλεται.
Philippe pourra donc entreprendre et exécuter tout ce qu'il voudra
»
-
« Τὸν Μειδίαν, τοῦτον οὐκ εἰδώς,
ὅστις ποτ´ ἐστίν, οὐδὲ γιγνώσκων. Ce Midias, qu'est-il ?
Je ne sais pas; je ne le connais pas.
»
-
« Τῆς ἀδελφῆς ἐναντίον, κόρης ἔτι
καὶ παιδὸς οὔσης. En
présence de ma soeur, qui est encore
dans la plus tendre jeunesse.
». Dire
que c'est un de ses traits caractéristiques, c'est la
vérité : il sut se servir mieux que personne d'un style coupé et rapide. Ceux
qui lui en font un reproche n'examinent point pour quelles raisons il met
souvent des mots qui ont la même signification, et l'attaquent injustement à ce
sujet. On croirait qu'ils ne cherchent que la concision dans Démosthène; or,
comme je l'ai observé, aucun orateur n'en fit usage plus à propos. Ils
paraissent perdre de vue que cette qualité n'est pas la seule qui convienne à
l'orateur; qu'il doit viser à la clarté, à l'énergie, à tout ce qui peut
agrandir, relever un sujet, ou produire l'harmonie ; et s'attacher surtout à un
style plein de mouvement et qui peigne fidèlement les passions vives et les émotions douces ; car ce sont les véritables
instruments de la persuasion. Or, il n'y parviendra point par la concision toute
seule, mais par cette surabondance de certaines expressions, qui se trouve dans
Démosthène. Je citerais quelques exemples, si je ne craignais d'être trop long,
surtout quand c'est à vous que je m'adresse. Telles sont, mon cher Ammæus, les
réflexions que j'avais à vous soumettre sur le style de ce grand orateur. Si les
dieux conservent mes jours, je composerai sur le talent supérieur avec lequel
il traite le fond même des choses, un ouvrage plus considérable et bien
autrement important que celui-ci. J'ai l'intention de m'en occuper, et je
m'empresserai de vous le communiquer. |