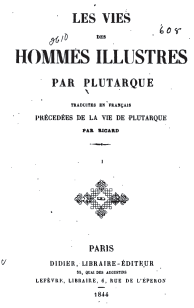
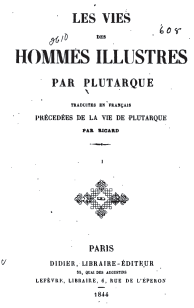
i. NOTICE SUR LA VIE ET LES OUVRAGES DE RICARD.
Dominique Ricard naquit a Toulouse le 25 mars 1741, dans le sein d'une famille qui le fit élever avec soin. Il fit de rapides progrès, et il avait a peine atteint l'âge prescrit par les règlements de l'Université, qu'il fut reçu bachelier en théologie. Il quitta bientôt sa patrie pour se rendre à Auxerre, et y occuper une chaire d'éloquence au collège de cette ville. La pureté et la douceur de ses mœurs lui acquirent l'estime et l'amitié de tous ceux qui le connurent, et l'on s'empressa de le nommer chanoine honoraire de la cathédrale. Il n'était que simple ecclésiastique, n'ayant jamais voulu s'engager dans les ordres. Il n'avait guère plus de vingt-cinq ans lorsqu'il fut choisi, en 1766, pour prononcer, dans la salle du collège, l'Éloge funèbre du Dauphin, fils de Louis XV.
En 1770, il prononça un Discours latin sur le mariage de Louis XVI, alors dauphin, avec Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche. Le style de ce discours montre combien il était versé dans la langue de Cicéron ; les portraits et les maximes qu'on y trouve font honneur a son ii jugement. Le collège d'Auxerre ayant été supprimé, il se vit contraint de venir a Paris pour y chercher des moyens d'existence. Quoique l'éducation fût une carrière pénible et remplie d'écueils, surtout dans un temps de dissolution et de vertige, il s'y engagea néanmoins avec courage, et la parcourut avec succès. Ses instructions et ses exemples furent des semences de vertu qui germèrent dans le cœur de ses élèves.
Le séjour que Ricard fit a Auxerre lui rappela sans doute Amyot, qui avait été évêque de cette ville, et dont la statue existait encore dans la cathédrale, avant la révolution. Cet illustre savant a mérité la reconnaissance de la postérité, par sa traduction complète des Œuvres de Plutarque. Quoiqu'il eut a surmonter beaucoup de difficultés, il fut cependant favorisé dans cette entreprise par le caractère de notre langue, qui avait alors une facilité, une souplesse et une naïveté qu'elle a perdues en se perfectionnant ; aussi l'ouvrage d'Amyot a-t-il conservé des charmes qui en rendront toujours la lecture agréable, malgré tous les défauts qu'on peut lui reprocher, et dont le principal vient de l'état où se trouvait de son temps le texte de Plutarque. Dacier crut devoir profiter du changement que les grande écrivains du siècle de Louis XIV avaient opéré dans la langue, pour traduire de nouveau Plutarque : mais, avec beaucoup de savoir, il n'avait pas le talent d'écrire, et la traduction qu'il publia des Vies de cet auteur ne fit point oublier celle qu'Amyot avait donnée. Le succès de Dacier ne peut donc iii être attribué qu'au grand intérêt qu'ont les faits, et à la manière dont Plutarque les rapporte. Les Œuvres morales de cet écrivain sont d'un autre genre. Outre la difficulté des choses, le texte en était très corrompu ; et ce n'est qu'après les travaux de plusieurs savants, que M. Wyttenbach, aidé encore de sa propre sagacité, vient d'en donner une bonne édition, fruit de longues veilles. Ainsi il n'est point étonnant que la traduction de ces œuvres par Amyot soit si peu supportable, et souvent même inintelligible. Des gens de lettres ont tenté de nous faire mieux entendre quelques traités ; mais, nous osons le dire, aucun, a l'exception de MM. Burette et du Theil, n'y a réussi. Il y avait donc autant de courage que de nécessité a donner une nouvelle traduction des quatre-vingts traités sur différents sujets de morale, de physique, de politique, de philosophie, d'histoire même, qui sont aujourd'hui ce qui nous reste des œuvres de Plutarque ; car il en avait composé un plus grand nombre.
Ricard, versé dans l'étude longue et difficile de la langue grecque, eut ce courage; et l'on ne saurait trop l'en louer. Il a fait lire avec plaisir des écrite utiles pour la plupart aux progrès de la vertu, et qui honoreront éternellement leur auteur. Ricard ne se fit point illusion, et sentit combien sa tache était pénible ; et peut-être s'en serait-il dégoûté, s'il n'eût pas été encouragé par une femme d'esprit, pleine de connaissances, attachée surtout aux vrais principes, qu'elle voyait sans cesse attaqués ou plutôt outragés, dans une société où elle était forcée de vivre : je veux parler de ma iv dame de La Ferté-Imbault (1), qui, se plaisant a faire des extraits de Plutarque, excitait sans cesse Ricard a continuer son ouvrage. Il employa plus de dix ans à l'achever ; et certes il fallait encore une grande application pour y mettre si peu de temps. Son style est clair et facile. Il s'efforce partout d'être fidèle : on peut assurer qu'il y réussit le mieux dans les matières abstraites, et que, quel que soit le sujet, il se fait lire avec plaisir. Les notes dont est accompagnée sa traduction sont instructives, judicieuses, et dignes surtout d'un ami de la vertu. Le succès couronna les efforts de Ricard, et cet ouvrage fit sa réputation littéraire.. L'académie de Toulouse le reçut au nombre de ses membres ; et il est très vraisemblable qu'il eût fini par être de l'académie des Inscriptions et Belles-Lettres, si, dans le cours de la révolution, cette savante compagnie n'eût point été supprimée. Elle agréa la dédicace pleine de modestie et de noblesse que Ricard lui adressa.
Les connaissances de Ricard étaient très variées. Ayant fait une étude assez approfondie de l'astronomie, il voulut inspirer le goût de cette scie^e aux jeunes gens : en conséquence il composa un poème en huit chants sur la Sphère. Il ne se contente pas d'en expliquer le mécanisme et de décrire les cercles qui la composent ; il représente encore le tableau général des cieux et de la terre, en parlant des constellations, des climats, des saisons, etc. Peut-être désirerait- v on dans cet ouvrage plus d'invention et moins de vers prosaïques ; mais rien n'est plus difficile qu'un bon poème didactique. On est dédommagé de ce qui manque a celui de Ricard par des notes explicatives qui sont à la suite de chaque chant. L'ouvrage est terminé par une longue notice de poètes grecs, latins et français, qui ont écrit sur l'astronomie. Ce morceau est un des meilleurs qui soient sortis de la plume de l'auteur : écrit avec goût, il offre des recherches curieuses. Il avait conçu et exécuté le projet de son poème a la campagne de M. et de madame de Meslay, auprès desquels il passa vingt ans de sa vie, et qu'il n'abandonna jamais tout occupé d'eux, s'oubliant lui-même dans les crises les plus périlleuses de la révolution, où tant d'hommes ont cherché leur salut dans l'oubli de leurs devoirs, et trop souvent dans la plus coupable ingratitude.
S'étant toujours proposé de traduire les Vies de Plutarque, Ricard ne pensa plus qu'a exécuter ce nouveau dessein. Il publia le premier volume de ces Vies dans l'année 1798, et bientôt après les trois suivants. En 1802, le cinquième et le sixième parurent. Sa tradition était entièrement achevée lorsqu'il mourut. On comprendra sans peine que cette traduction l'emporte de beaucoup sur celle de Dacier, soit du côté du style, soit du côté de la fidélité; les notes en sont plus étendues, et renferment des éclaircissements nécessaires, qu'on chercherait en vain dans cette dernière. Une critique sage dirige toujours la plume de l'auteur, et se fait apercevoir dans les remarques qui concernent les Vies des Hom vi mes illustres de Rome, sur lesquels Plutarque avait commis un plus grand nombre d'erreurs*.La vie de cet immortel écrivain se trouve au commencement du premier volume ; et ce n'est pas l'écrit qui fait le moins d'honneur à Ricard. Il s'y peint lui-même, sans le vouloir, dans le portrait de l'homme de lettrée ; " Livré tout entier au soin précieux d'éclairer ses semblables, moins occupé du désir de la gloire que du besoin d'être utile, le véritable homme de lettres ne songe, en cultivant sa raison, qu'a leur tracer des règles de conduite qui soient pour eux comme ces signaux qu'on élève dans des chemins difficiles, pour indiquer au voyageur la route qu'il doit suivre. »
La Politique d'Aristote offre de plus grandes difficultés encore a vaincre que les Œuvres de Plutarque ; Ricard en était tellement persuadé, qu'après avoir gardé vingt ans dans son portefeuille la traduction de cet ouvrage, il ne l'a point publiée. D'après la lecture que nous en avons faite, nous croyons que s'il eût. eu le temps de la revoir avec soin, et de mettre surtout plus de concision dans le style, elle aurait été supérieure aux traductions qu'on a imprimées de nos jours.
On a remarqué que la carrière des lettres avait été sans épines pour Ricard. En effet, il n'eut pour ennemi aucun homme de lettres, et ne fut point décrié par les philosophes, qui ne pouvaient pardonner qu'on pensât autrement qu'eux en matière de religion. Les remarques qu'on se permit de faire sur sa traduction des Œuvres morales de Plutarque vii furent moins des critiques que des conseils : aussi se fit-il un devoir de revenir sur ses pas, comme il l'avouait sans peine, lorsqu'elles lui parurent fondées. Une pareille conduite lui concilia l'estime et la bienveillance des savants et des littérateurs. Plusieurs furent ses amis, entre autres M. l'abbé Pluquet.
Cet écrivain estimable avait laissé manuscrit un Traité sur la Superstition et l'Enthousiasme ; Ricard se chargea de publier ce traité posthume ; il en revit le texte, et y ajouta une notice judicieuse et intéressante sur la vie et les travaux de M. Pluquet, dont tous les ouvrages sont recommandables parla sagesse des vues, et par un raisonnement juste et solide.
La mort vint surprendre Ricard au milieu de ses travaux, et il expira le 28 janvier 1803, dans les bras des personnes qui l'avaient toujours chéri. Quand on le connaissait, il était presque impossible de ne pas sentir pour lui un attrait que l'estime rendait bientôt aussi fort que durable. Et que de droits n'avait-il pas a cette estime ! Une piété tendre et éclairée, une charité délicate et sans réserve, une conduite irréprochable dans tous les temps, même les plus orageux ; les mœurs pures, une aménité naturelle, et une modestie rare, formaient le caractère de cet homme vertueux, sur le tombeau duquel ses amis ont versé d'abondantes larmes.
L'histoire, dit Cicéron, est le témoin des temps, la lumière de la vérité, l'école de la vie (2) La raison de l'homme, trop lente dans ses progrès, a besoin d'un guide sûr et éclairé qui hâte sa marche tardive. L'histoire remplit auprès de lui cette fonction importante : c'est elle qui le prend, pour ainsi dire, par la main, dès sa première enfance, qui assure tous ses pas, et prévient par ses conseils les écarts de la faiblesse et de l'inexpérience; c'est elle qui recueille et transmet d'âge en âge cette nuée de témoins dont l'accord entraîne la conviction. L'esprit se rend sans peine à une autorité qui ne le soumet qu'en l'éclairant. Le succès de la prudence et de la sagesse, les revers de l'imprévoyance et de la folie, forment une double leçon qu'il est forcé d'entendre ; elle détruit les illusions et les chimères dont se sont bercés, dans tous les temps, des politiques ignorants ou perfides, à qui le dégoût de leur état présent, l'idée d'une perfection imaginaire, le désir funeste de la célébrité, inspirèrent l'amour des nouveautés.
De là est née cette opinion, inconnue à la sagesse de nos pères, que les empires et les états sont nécessairement soumis aux mêmes périodes d'accroissement et de destruction que les corps naturels; que, comme ceux-ci, après être parvenus à la maturité de leur puissance, ils vieillissent, ils s'altèrent, et tombent enfin dans une entière dissolution, à moins qu'en leur donnant une constitution différente on ne les rappelle, en quelque sorte, à la vie, pour recommencer une nouvelle carrière de gloire et de bonheur. Cette opinion n'a d'autre base qu'une prétendue analogie dont rien ne prouve les rapports. Les corps naturels portent en eux-mêmes un principe nécessaire de dépérissement, qui, les attaquant dès leur naissance, les mine sourdement chaque jour, et les conduit plus ou moins lentement a la mort ; c'est la loi 2 de leur création : les corps politiques, au contraire, ouvrage des institutions humaines, sont fondés sur des rapports moraux dans lesquels rien n'atteste l'existence de cette prétendue cause de leur dissolution.
L'expérience, dira-t-on, vient cependant à l'appui de cette opinion ; on a vu tous les empires, lorsqu'ils brillaient au plus haut point de leur grandeur et de leur gloire, tendre rapidement vers leur chute. Il est vrai que les fondements sur lesquels posent leur puissance et leur prospérité sont souvent ébranlés par les passions des hommes ; les richesses énervent les esprits, le luxe corrompt les mœurs, et la ruine des moeurs entraîne celle des empires. Reconnaissons néanmoins que ces causes de dépérissement ne tiennent pas nécessairement à la constitution des états : que la main d'un législateur habile pourrait facilement en arrêter les effets, et prévenir la chute des corps politiques. Ce rat au sein de la corruption que Lycurgue opéra cette réforme qui régénéra Lacédémone, qui lui imprima, pour une suite de siècles, une force et une stabilité qu'elle n'avait pas eues encore, et qui lui conserva si longtemps la supériorité sur le reste de la Grèce. le sais que le peu d'étendue de sa république rendait cette régénération bien plus facile que celle d'un grand empire corrompu par les jouissances d'une longue prospérité, et affaibli par les erreurs de ses chefs ; mais, outre qu'une réforme si entière n'est pas toujours nécessaire, alors même ses maux ne sont pas irréparables ; et s'il est impossible de lui rendre son ancien éclat, on peut du moins le rasseoir sur ses bases, réparer ses brèches, et lui assurer encore une longue existence. Serait-ce par un changement total de principes, et, s'il est permis de parler ainsi, par la transfusion d'un sang étranger, qu'on redonnerait à ces êtres moraux une nouvelle vigueur ? Non; des remèdes analogues à leur constitution primitive, et dispensés avec une sage réserve, pourront seuls leur procurer la guérison de leurs maux.
C'est de l'ignorance des peuples qu'est venue presque toujours leur facilité à se laisser séduire. La connaissance de l'histoire les eût raie en garde contre des novateurs qui affectent de décrier tous les monuments historiques, ces témoins fidèles des temps; et de jeter, sur l'éclat de leurs dépositions, le soupçon de l'erreur et du mensonge. Ils s'indignent quand on oppose à leurs nouveautés l'autorité des faits. L'homme, disent-ils, n'a pas besoin de puiser dans les exemples de ceux qui l'ont précédé des conseils pour ce qu'il doit faire ; sa raison 3 lui suffit: loin de se traîner sur les pas d'autrui, il doit s'abandonner à son propre essor, et, par une heureuse audace, ouvrir à la politique des routes nouvelles qui soient pour les peuples des sources de gloire et de bonheur. A les en croire, ce n'est que de leur temps que le flambeau de la vérité a fait briller sa lumière ; la science de conduire les hommes n'a été jusqu'à eux qu'une misérable routine que les législateurs ont suivie en aveugles, ils ont tenu les nations dans une sorte d'enfance, et leur ont caché leurs droits, afin de les asservir.
Sans doute la raison fut donnée à l'homme pour l'éclairer et le conduire ; mais à combien d'erreurs ne le livre pas trop souvent ce guide infidèle 1 combien de fois, séduite par les passions, ne trouve-t-elle pas mille prétextes pour méconnaître la vérité ou pour la combattre ! C'est surtout dans les hommes d'état que cette insuffisance de la raison est plus communes plus funeste. La flatterie, cette ennemie si assidue et si dangereuse, en corrompant le cœur élève sur l'esprit des nuages épais gui lui dérobent la vue des pièges qu'on lui tend. Le goût de la domination, l'habitude de voir tout ce qui les entoure céder à leurs moindres volontés, rendent les hommes en place incapables de cette sage réflexion, de cette méditation profonde de leurs devoirs, qui leur apprendrait à connaître les hommes, A juger les événements, à discerner les bonnes et les mauvaises vues qu'on leur suggère. L'homme 4e génie lui-même a besoin du fil de l'histoire peur se guider dans le dédale obscur de la politique t accoutumé A embrasser les objets de ce haut point d'élévation où son esprit le place, pour saisir d'un coup d'oeil le but où il doit tendue, il est plus exposé qu'un autre à s'égarer sur les moyens de détail qui assurent souvent le succès des entreprises. L'histoire, en lui rendant présente l'expérience des siècles passés, lui donne des conseils, aussi sûrs que désintéressés, qui lui montrent les routes qu'il doit suivre, les écueils qu'il doit éviter, et le port assuré où une sage manœuvre peut faire arriver heureusement le vaisseau de la fortune publique.
C'est par là qu'on peut apprécier les reproches qu'on fait aux anciens législateurs, en les accusant de s'être traînés sur les pas de ceux qui les ont précédés, d'avoir laissé languir les nations dans une longue enfance, pour les condamner au plus honteux esclavage. Peut-on sans injustice méconnaître le bien qu'ont fait ces hommes si éclairée, en imposant aux passions humaines le joug salutaire des lois, et en ren- 4 fermant dans de justes bornes l'usage de leur liberté, afin de lent eu garantir la durée ?
L'histoire est un champ si vaste, que peu de personnes peuvent en parcourir toute l'étendue. Les histoires générales, qui, remontant à l'origine du monde, en embrassent toute la durée, celles même qui se bornent à décrire la naissance, les progrès et les actions d'un grand peuple, exigent, pour être lues avec fruit, une étendue d'esprit, une application, une constance dont la plupart des lecteurs ne sont pas capables. On peut les comparer à des tableaux d'une composition savante, où la multitude et la variété des objets, où les grands effets d'une riche ordonnance, où l'accord parfait de toutes les parties qui le composent, ne peuvent être sentis et appréciés que par d'habiles connaisseurs. Le genre adopté par Plutarque, et dont il peut à bien des égards passer pour l'inventeur (3), plus facile à saisir et .à suivre, excite par cela seul un intérêt plus général. C'est une galerie de portraits dont les originaux sont assez connus du commun des lecteurs, pour qu'ils puissent vérifier dans les copies cette ressemblance qui en a fait un des plus grands mérites. Plutarque y a mis un intérêt de plus par le parallèle qu'il établit entre les grands hommes dont il écrit la vie : cette opposition fait ressortir davantage leurs bonnes et leurs mauvaises qualités, elle nous les fait mieux connaître et mieux juger.
C'est sans doute cette manière si intéressante d'écrire l'histoire qui est la source du plaisir que cause la lecture des Vies des grands hommes ; c'est à elle aussi qu'on doit attribuer la réputation dont leur auteur a joui même auprès de ses contemporains. Honoré et chéri dans sa patrie, il ne fut pas moins estimé dans le reste de la Grèce. Athènes, l'école des sciences et des arts, l'admit au nombre de ses citoyens, et il y fut recherché de tous le savants. Il n'obtint pas moins de considération à Rome , où les plus illustres sénateurs s'empressaient d'aller l'entendre et de recevoir ses leçons. La postérité a confirmé pour lui le jugement de son siècle; sa réputation s'est accrue d'âge en âge; et encore aujourd'hui le suffrage des hommes 5 éclairés le place au rang du petit nombre des bons historiens dont s'honorent les plus beaux siècles de la Grèce et de Rome. Les Vies des grands hommes sont la lecture de tous les âges et de tous les états. Si les personnes instruites les lisent avec plus de fruit, le commun des lecteurs y trouve tout ce qu'il faut pour attacher. Les hommes d'un âge fait y voient confirmer les leçons qu'ils doivent à leur expérience, et y en puisent de nouvelles. Les jeunes gens y lisent avec avidité ces récits intéressants , ces peintures de mœurs antiques, qui font de ces Vies comme autant de drames dont le sujet, les événements et les acteurs remplissent la scène avec tant d'intérêt.
Rien ne dépose plus en faveur du caractère de Plutarque que les choix qu'il a faits pour les sujets de ses Vies. Il a pris , en général, des hommes que leurs qualités, leurs talents et leurs vertus rendent recommandables. Ce sont presque toujours dès guerriers célèbres qui excitent notre admiration par leur courage, et qui méritent notre estime par l'emploi qu'ils en ont fait ; qui, modestes et généreux dans la victoire, loin d'abuser de leur pouvoir pour perdre leurs ennemis, ont préféré, à la force qui ravage et qui détruit, la bonté qui protège et qui conserve : ce sont de sages législateurs qui, par de bonnes lois, par un gouvernement bien réglé, ont rendu les citoyens heureux : ce sont des hommes d'état dont la prudence et les conseils ont contribué à augmenter la gloire de leur nation : ce sont des orateurs à jamais célèbres par le double mérite de l'éloquence et de la science politique, qui, défenseurs ardents de la liberté publique, portèrent à la tribune, contre les factieux, le même courage et la même intrépidité que les guerriers déployaient sur le champ de bataille contre les ennemis de l'état. Son histoire est donc une leçon continuelle de morale mise en action, qui présente aux lecteurs des modèles de sagesse, de modération, de justice, de tempérance, de toutes les vertus, enfin, qui contribuent également au bonheur des particuliers et à la félicité des sociétés publiques. Si, à côté de ces hommes vertueux, il en a placé quelques-uns dont le caractère et les mœurs contrastent avec ceux des premiers, c'est, comme il le dit lui-même, afin d'inspirer, par cette opposition, plus d'horreur pour le vice, plus d'estime pour la vertu. En effet, suivant la pensée du plus grand esprit du siècle dernier, l'exemple du mal étant beaucoup plus commun 6 que celui du bien, il faut en tirer aussi des sujets d'instruction (4).
Un des mérites de Plutarque dans ses Vies des grands hommes, c'est de s'être moins attaché à raconter les faits éclatants qui, se trouvant dans tous les historiens, sont connus de tout le monde, que ces actions de leur vie privée qu'ont négligées la plupart des autres écrivains, et qui cependant sont plus propres à faire connaître les caractères et les mœurs, que ces exploits brillants qui le plus souvent sont des efforts des passions, et n'occupent que quelques instants dans la vie, au lieu que les autres sont la suite du naturel et forment nos habitudes. On connaît souvent mieux un homme par un trait, par un mot qui lui échappe, que par un grand nombre de faits de sa vie publique, jte tyran qui, à la représentation d'une tragédie touchante, se surprenant dans une émotion involontaire, se lève brusquement et sort du théâtre, en s'écriant avec une sorte d'indignation : « Je serais sensible à la pitié ! » met plus à découvert, par cette seule parole, l'atrocité de son âme, que par les cruautés qu'il avait commises (5). Après l'approbation générale donnée dans tous les temps à cette manière d'écrire l'histoire, on peut être surpris qu'elle n'ait été imitée par aucun historien des âges suivants.
Je ne dois pas cependant dissimuler qu'elle n'a pas été à l'abri de toute critique. Le nombre des censeurs, il est vrai, n'est pas considérable ; et je ne sache qu'un savant académicien des Inscriptions et Belles-Lettres, M. l'abbé Sallier, qui, dans l'examen qu'il a fait de trois discours de Plutarque, l'un sur la fortune des Romains, les deux autres sur la fortune et la vertu d'Alexandre, ait blâmé ouvertement la forme que Plutarque a suivie en écrivant l'histoire. D'abord il l'accuse d'avoir porté jusqu'à l'excès la prévention qui l'aveuglait en faveur des Grecs, et d'avoir tout donné à la partialité. C'est, à l'en croire, par le même zèle, que Plutarque avait conçu le dessein bizarre de comparer des hommes aussi distants les uns des autres par l'éloignement des temps et des lieux, que par le genre de vie qu'ils ont mené, par la nature des passions qui les gouvernaient, et par la différence des actions qui distinguèrent leur vie. Plutarque, au lieu d'attendre le jugement de la postérité sur ces héros, le prévient par ses comparaisons. Les Grecs gagnaient du moins, par son ouvrage, 7 d'être mis à coté des plut grands hommes de la république romaine. D'ailleurs, ajoute M. l'abbé Sallier, en opposant ainsi un Grec à un Romain, il met dans le plus grand jour les plus petites actions des Grecs, et cherche à les faire paraître très souvent supérieurs, et presque toujours égaux (6).
Mais le savant académicien paraît être tombé lui-même dans le défaut qu'il reproche à Plutarque, et n'avoir suivi dans sa censure que la prévention qu'il montre, dans tous ses Mémoires, en faveur des Romains contre les Grecs. Je ne puis croire avec lui que la jalousie et le préjugé national aient seuls fait concevoir à Plutarque le dessein de comparer les grands hommes de la Grèce avec ceux de Rome. On ne pourrait lui supposer ce motif qu'autant qu'il serait réellement vrai, comme le prétend M, l'abbé Sallier, qu'en les opposant les une aux autres, il aurait rabaissé les Romaine pour faire paraître les Grecs supérieurs à leurs rivaux; et la lecture de ses Vies doit convaincre du contraire tout esprit impartial. Plutarque ne flatte pas ordinairement ses héros. S'il leur arrive de perdre la modération dans la victoire, de faire servir leur puissance à des vues ambitieuses, de chercher à asservir le peuple en ne paraissant que le gouverner, de ne pas porter dans l'administration des affaires est esprit de désintéressement qui fait le bien pour le bien même, et qui ne veut aller à la gloire que par la vertu : alors il les condamne sans ménagement, et place à côté des éloges qu'il a donnés à leurs vertus la juste censure de leurs défauts. Entre ces personnages célèbres, je n'en vois qu'un seul qu'il ait jugé trop favorablement : c'est Périclès, dont les grands talents, dont les succès et la réputation semblent avoir ébloui Plutarque sur des fautes essentielles que ce grand homme commit dans son administration. Quelquefois aussi il s'est laissé tromper sur l'idée qu'il nous donne de ses héros, par les guides qu'il a suivis ; j'aurai occasion de le remarquer dans la Vie de Cléomène, roi de Sparte : mais alors, au lieu de lui reprocher de la partialité, c'est un manque de discernement dans le choix des historiens à qui il donne sa confiance, dont on doit l'accuser ; ces fautes même sont rares dans cet écrivain sage et judicieux. Loin de prendre le zèle outré d'un panégyriste, il conserve, en général, le caractère d'un témoin vrai et incorruptible.
8 Il ne se montre pas moins impartial dans les parallèles des grands hommes qu'il compare ensemble. Ils sont à peu près d'un mérite égal ; et si les Grecs semblent souvent l'emporter, plusieurs fois aussi les Romains ont une supériorité marquée. On le voit en particulier dans les comparaisons de Solon et de Publicola, de Pélopidas et de Marcellus, de Philopémen et de Flaminius,de Démétrius et d'Antoine, et dans plusieurs autres. Quelle preuve plus sensible de sa modération et de son équité que les Vies de Démosthène et de Cicéron ! En les comparant du côté de l'éloquence, quel beau champ n'avait-il pas pour donner la préférence à l'orateur grec, sans craindre le reproche d'être partial ! Il s'abstient de les comparer sous ce rapport, par le motif que le parallèle est trop difficile ; et par là il donne lieu de juger qu'il croit Cicéron égal à Démosthène pour le talent delà parole.
L'éloignement des temps et des lieux où vécurent les hommes qu'il compare, loin de rendre son ouvrage bizarre, comme le prétend M. l'abbé Sallier, ne lui donne-t-il pas, au contraire, un mérite de plus, en ce qu'il a su choisir, dans des temps ou dans des lieux si éloignés, des personnages qui ont entre eux des rapports frappants ; en ce qu'il saisit avec justesse les traits de caractère et les actions par lesquels ils diffèrent où se ressemblent? Faire un crime à Plutarque de ce qu'il prévient par ses comparaisons le jugement de la postérité, c'est faire aussi le procès à presque tous les historiens, à ceux même qui ont le plus de réputation, et qui, dans le cours de leur histoire, jugent les hommes qui ont eu une grande influence sur les événements qu'ils décrivent. Ces parallèles, si fort blâmés par M. l'abbé Sallier, sont, de l'aveu de tout le monde, une des plus intéressantes parties de l'ouvrage de Plutarque. On y reconnaît toujours le bon sens et la sagacité de cet écrivain, son équité à comparer, à peser dans la plus juste balance les actions de ses héros. Il nous manque les comparaisons de Thémistocle et de Camille, de Pyrrhus et de Marius, de Phocion et de Caton d'Utique, d'Alexandre et de César ; et ce ne sont pas, comme on voit, celles qu'on désirerait le moins d'avoir de la main de Plutarque. Duhaillan les avait suppléées du temps d'Amyot ; M. Dacier les a faites aussi ; et, à leur exemple, j'ai essayé de remplir cette lacune. Mais j'ai senti quel désavantage il y avait à lutter avec un écrivain tel que Plutarque, dans la partie de son ouvrage la plus généralement estimée.
9 Ce n'est pas la seule perte que nous ayons faite dans les ouvrages de cet historien. Plusieurs de ses Vies ont été aussi la proie du temps; et, dans ce nombre, il y en a deux qu'on ne peut trop regretter : celle d'Aristomène, général des Messéniens contre les Spartiates, et celle d'Épaminondas, cet homme extraordinaire, si grand par ses exploits, plus grand encore par ses vertus, qui, au jugement de Cicéron (7), fut le premier des Grecs qui, suivant le témoignage de Spintharus son maître, était l'homme qui savait le plus et qui parlait le moins ; plus philosophe encore par sa conduite que par ses principes ; qui, ami de la pauvreté par choix, se refusa à tous les moyens qui lui furent offerts de sortir d'un état dont il faisait sa gloire. Quel beau champ pour Plutarque, que la Vie d'un tel homme ! Combien, dans un sujet si grand, l'amour de la patrie avait dû l'élever au-dessus de lui-même ! Si, comme on le verra dans sa Vie, cet amour de son pays l'a fait sortir une fois des bornes de la modération ; s'il l'a rendu injuste envers l'historien le plus estimable, combien ce sentiment dut-il exalter son âme, lorsqu'il n'eut qu'à louer dans l'homme dont sa patrie s'honorait le plus !
Après la réputation dont les ouvrages de Plutarque ont joui, même à Rome, dès son vivant, après le long séjour qu'il a fait dans cette capitale du monde, on a droit d'être surpris qu'aucun des écrivains qui y fleurissaient alors, tels que Perse, Juvénal, Quintilien, Sénèque, Lucain, Martial, Pline le Jeune, et d'autres, n'aient jamais parlé de lui. Auraient-ils été jaloux de son mérite et de sa célébrité ? auraient-ils vu avec chagrin qu'un étranger, né dans une ville obscure et à peine connue, leur eût enlevé la gloire de traiter leur propre histoire sous une forme nouvelle et piquante, dont personne avant lui n'avait eu l'idée? Cependant on avait déjà vu plusieurs écrivains grecs accueillis à Rome avec empressement, et traités de la manière la plus honorable. Polybe avait joui de la confiance de Scipion l'Africain, qu'il accompagnait dans toutes ses expéditions ; Caton avait fait exprès le voyage de Cypre, pour aller chercher le philosophe Athénodore et l'attacher à sa personne ; Cicéron avait défendu la cause du poète Archias avec tout le zèle, toute la chaleur de l'estime et de l'amitié. Au reste, si le silence des auteurs romains à l'égard de Plu- 10 tarque a été reflet de l'envie, il faut avouer que les écrivains grecs n'ont pas été plus justes envers les auteurs romains ; ils parlent d'eux bien rarement, et lorsqu'ils le font, c'est avec une réserve qui décèle leur jalousie. La vanité grecque se serait crue humiliée en avouant même une égalité de mérite dans les hommes qu'ils ne regardaient que comme leurs disciples, et des disciples trop nouveaux pour avoir pu s'élever à ta perfection de leurs maîtres. Mais Plutarque fut dédommagé de ce silence par l'estime que lui témoignèrent les empereurs Trajan et Adrien, ces princes dont les lumières et les vertus donnaient tant de poids à leur suffrage.
Si, au mérite du fond, qui distingue en général les ouvrages historiques de Plutarque, il eût joint toutes les qualités du style, il n'est pas d'historien dont la réputation eût surpassé la sienne. Mais cette partie de ses écrits n'est pas la plus soignée ; on y désirerait plus d'agrément, de douceur et de grâce. La longueur de ses phrases jette souvent de l'obscurité dans ses récite, et rend sa diction traînante : on n'y trouve pas cette pureté, cette finesse du langage attique, qui font le charme des écrits de Démosthène, de Platon, d'Eschine, de Xénophon, et de tous les écrivains de ce beau siècle de la Grèce, dont le temps de Plutarque était, il est vrai, bien éloigné, mais dont le goût se conservait encore, à cette époque, dans quelques écrivains. Ce n'est pas qu'il ne se fût nourri de la lecture des meilleurs modèles ; ses ouvrages en font foi, par le nombre prodigieux de citations dont ils sont remplis. Mais il n'était pas né à Athènes ; et lorsqu'il alla s'y établir pour y perfectionner ses études, il avait respiré longtemps l'air de la Béotie, qui avait influé sur sa manière d'écrire, et qui l'empêcha d'acquérir ce goût fin et délicat, cette sensibilité exquise, ces grâces naturelles, cette simplicité charmante que nous admirons dans les écrivains attiques. Mais si son style manque de ces formes agréables, il n'est pas pour cela, à beaucoup près, sans mérite. Il est partout vif et énergique, plein d'images et de comparaisons riches et abondantes qui servent à éclaircir et à relever ses pensées. Il emprunte ordinairement ses comparaisons des objets physiques, des effets de la nature, des affections du corps humain. Par là elles ont l'avantage de pouvoir être saisies par tous les esprits, et de jeter de la lumière sur les sujets qu'il traite.
Comme il était rempli de la lecture des poètes, il emploie fréquem- 11 ment des tours et des expressions poétiques qui donnent de la force el de l'éclat à sa diction ; quelquefois même il fond dans son discours des passages entiers de ces poêtes , sans y conserver l'ordre el la mesure du vers : ce qui donne alors à son style un caractère de hardiesse qui lient plus de la poésie que de la prose.
il n'est guère d'écrivains dont les ouvrages aient été aussi souvent imprimés que ceux de Plutarque. Dès la renaissance des lettres en Europe , il s'en fit plusieurs traductions latines ; et, vers le milieu du seizième siècle , un Italien , nommé Sansoveno , publia une traduction des Vies des grands hommes , la première qui ait été faite de cet ouvrage en langue moderne. Celle d'Amyot la suivit de près ; et, depuis , les autres nations savantes se sont empressées d'enrichir leur littérature des ouvrages historiques de cet écrivain célèbre. La traduction d'Amyot , la seule complète que la France ait encore eue , a joui constamment de la plus grande réputation , et elle la méritait. Il s'en est fait en divers temps un grand nombre d'éditions ; et depuis peu d'années on en a publié deux presque en même temps , dont l'une , dirigée par des hommes célèbres dans la république des lettres (8) , et supérieurement exécutée dans sa partie typographique (10) donne un nouveau prix au travail de cet estimable traducteur. Les Vies de Plutarque furent traduites dans le siècle dernier par l'abbé Tallemant , que Boileau appelle le sec traducteur du français d'Amyot. M. Dacier en a donné, au commencement de ce siècle, une traduction nouvelle qui a été réimprimée plusieurs fois, et dont les éditions sont presque épuisées. Lorsqu'il en fit l'entreprise, il s'objecta, dans sa préface, les succès de la traduction d'Amyot, et l'empressement avec lequel elle était recherchée ; ce qui semblait dispenser de traduire de nouveau les ouvrages de Plutarque. Il réfuta cette objection d'une manière solide : j'y ai répondu aussi dans la préface de ma traduction des Œuvres Morales, pour laquelle, je l'avoue, il m'était encore plus facile qu'à M. Dacier d'avoir raison et de justifier mon entreprise.
En effet, les Œuvres Morales de Plutarque n'étaient guère lues, dans la traduction d'Amyot, que d'un petit nombre de savants. Les gens du monde les connaissaient peu ; et plusieurs m'ont avoué, après 12 avoir lu ma traduction, qu'ils étaient loin de soupçonner que cette collection contînt des richesses si précieuses. Je ne répéterai pas ici les raisons que j'ai données alors pour montrer non seulement l'utilité, mais même la nécessité d'une nouvelle traduction de ces Œuvres Morales, quoique d'ailleurs je me sois fait un devoir et un plaisir de rendre à celle d'Amyot toute la justice qu'elle mérite. Ces raisons, si l'on n'a égard qu'à cette dernière version, sont à peu près les mêmes pour la traduction des Vies que je donne aujourd'hui. Le langage d'Amyot, à la vérité, conserve encore du naturel et des grâces ; mais il n'est plus à la portée du très grand nombre des lecteurs. Il serait d'ailleurs humiliant pour notre siècle, qu'il fallût s'en tenir à une traduction faite vers le milieu du seizième. Il y a dans cet écrivain une foule de tournures et d'expressions qui ont tellement vieilli, qu'elles ne sont plus entendues de tous ceux qui n'en ont pas fait une étude particulière. Sa traduction devient donc inutile pour cette classe si nombreuse de lecteurs ; et elle est dangereuse pour les jeunes gens, entre les mains desquels il ne faut mettre que des livres purement écrits ; et celui-ci pourrait corrompre leur langage.
Mais ces raisons ne subsistent plus pour la traduction de M. Dacier. Lorsqu'il la publia, notre langue avait fait depuis longtemps de grands pas vers la perfection. Les excellents écrivains qu'avait produits en tous genres le siècle à jamais mémorable de Louis XIV lui avaient assuré une destinée immortelle, et l'avaient naturalisée chez toutes les nations de l'Europe. M. Dacier la parlait purement; et l'on ne trouve point, dans sa traduction, des expressions ni des tours surannés. Les éditions multipliées qu'elle a eues attestent son mérite. Cet auteur savait très bien le grec ; il a évité les fautes assez nombreuses dans lesquelles Amyot est tombé, quoiqu'il sût bien la langue grecque ; mais il manquait des secours qu'on a eus depuis. Les inexactitudes qu'on pourrait relever dans M. Dacier sont extrêmement rares, et ne doivent pas étonner dans une si grande entreprise, où elles peuvent facilement échapper à l'homme le plus versé dans la langue qu'il traduit. Mais, en convenant du mérite de sa version pour l'exactitude et la fidélité, je me permettrai de dire, avec tous les égards dus à un écrivain de cette réputation, qu'en général elle n'est pas agréable à lire. Elle n'a pas cette variété que Plutarque a su mettre dans ses récits, suivant la nature des événements et le carac- 13 tère des héros qu'il avait à peindre ; il y règne une monotonie qui a fait dire à une femme d'esprit que sa traduction avait l'air triste. Il semble craindre de se livrer à ces heureuses hardiesses, à ces images vives et brillantes qui se trouvent fréquemment dans Plutarque. Un autre défaut de sa traduction, c'est qu'eue manque de précision. Le style de l'original est déjà si diffus ! si dans les endroits où il est concis on ne lui conserve pas ce caractère, il deviendra dans notre langue d'une prolixité rebutante. Il arrive souvent au traducteur d'employer trois ou quatre lignes pour rendre une pensée qui dans le grec est exprimée en trois ou quatre mots. Il convient lui-même qu'il s'est permis plusieurs fois d'ajouter au texte, pour donner à sa traduction de la clarté, de la grâce ou de la force. Un traducteur a sans doute cette liberté ; mais il doit en user sobrement. Ce n'est pas l'envie de critiquer qui me fait relever ces défauts dans un écrivain si estimable ; j'ai moi-même trop besoin d'indulgence pour vouloir me montrer sévère dans le jugement que je porte de lui.
Au lieu de m'arrêter à en faire la censure, j'aime mieux parler des obligations que je lui ai. Dans les endroits du texte qui offrent des difficultés, et où les interprètes sont partagés sur la manière dont il faut les entendre, il m'a souvent servi à fixer mon opinion pour le sens que je devais suivre. La fidélité qui caractérise en général sa traduction commandait cette confiance. J'ai tiré surtout une grande utilité de ses notes, qui sont nombreuses ; il s'est attaché à expliquer tout ce qui demandait quelque éclaircissement. Il n'omet rien de ce qui a rapport aux antiquités, aux usages, aux mœurs et aux lois des peuples dont Plutarque parcourt alternativement l'histoire. Ces objets reviennent à la vérité moins souvent dans les Vies que dans les Œuvres Morales ; mais il est une autre sorte de remarques beaucoup plus fréquentes, et qui forment la partie la plus intéressante de ce genre de travail : c'est le rapprochement qu'on a souvent à faire des récits des autres historiens grecs et romaine avec la narration de Plutarque, lorsque celle-ci en diffère, soit dans le fond, soit dans les circonstances. Il faut alors peser de partit d'autre les autorités, pour juger quelle est celle qui est appuyée sur des preuves plus solides ; ou, quand on n'a pas dans les divers témoignages des auteurs des motifs suffisants de décision, examiner quel est le récit le plus vraisemblable. M. Dacier a eu soin de faire ce rapprochement; et j'ai cru 14 pouvoir m'approprier cette portion de son travail, sans négliger cependant de consulter les originaux. La bonté avec laquelle le public a accueilli ma traduction des Œuvres Morales, et le désir qu'il paraît témoigner d'avoir de la même main celle des Vies des grande nommes, me donnant lieu d'espérer que cette traduction entière des ouvrages de Plutarque sera généralement adoptée, j'ai cru devoir l'enrichir des travaux de ceux qui m'ont précédé dans la même carrière ; ainsi mes lecteurs n'auront rien à désirer de ce qui peut contribuer a en rendre la lecture plus intéressante et plus utile. J'ai, par le même motif, fait usage des observations que MM. Brottier et Vauvilliers ont jointes à leur nouvelle édition de la traduction d'Amyot.
La chronologie est une source de difficultés dans les ouvrages historiques des anciens; Plutarque se plaint lui-même de la négligence avec laquelle les tables chronologiques étaient dressées. Les dates sont cependant d'une nécessité indispensable, eu moins pour les principaux événements. Sans leur secours, l'histoire serait pleine de confusion, et livrerait l'esprit aux plus grandes incertitudes. Mais à cet égard les opinions sont tellement partagées, et souvent même si contraires, qu'on ne doit pas espérer de tirer jamais la vérité d'un tel chaos de sentiments contradictoires. Je ne me suis donc pas livré à un travail aussi long que difficile, et qui, au fond, serait d'un médiocre avantage pour le grand nombre des lecteurs : les savants peuvent y suppléer eux-mêmes ; et les autres, contents de trouver les principales dates, s'embarrassent peu des discussions épineuses d'une chronologie incertaine. Les modernes, malgré leurs travaux opiniâtres sur cette partie de l'histoire, y ont laissé des obscurités qui vraisemblablement resteront toujours impénétrables.
Une des causes de cette difficulté, c'est la différence des mois grecs avec ceux des Romains, et des uns et des autres avec les nôtres, qui ne commencent pas aux mêmes jours que ceux des anciens, surtout chez les Grecs, Plutarque a observé, dans la Vie de Romulus, que le peu de rapport que les mois grecs ont avec ceux des Romains met beaucoup d'incertitude sur l'époque précise de la fondation de Rome. Les savants sont peu d'accord entre eux sur l'ordre même de ces mois. Les uns, par exemple, placent celui de mai au rang où d'autres mettent celui d'avril ; et ils changent ainsi tous les mois de l'année. Ce qui fait cette diversité d'opinions, c'est que chez les Grecs 15 les dix premiers jours d'un mois étaient les dix derniers du mois français, et les vingt derniers répondaient aux vingt premiers du nôtre. Les Grecs partageaient les leurs en trois décades ; et dans la dernière, ils comptaient les jours de cette manière ι le premier, qui dans l'ordre naturel était le vingt et unième, s'appelait le dixième du mois finissant ; le second, qui était le vingt-deuxième, était nommé le neuvième du mois finissant; et ainsi de suite jusqu'au trentième, qui s'appelait vieux et nouveau, parce que c'était le Jour où finissait un mois lunaire, et où un autre recommençait
Les Romains, après les ides, qui tantôt étaient le treize et tantôt le quinze, comptaient tous les autres jours par les calendes du mois suivant. Ainsi le lendemain des ides, lorsque le mois était de trente et un jours, on comptait le dix-huit ou le seize avant les calendes; et si le mois n'avait que trente jours, le lendemain des ides était le dix-sept ou le quinze avant les calendes, suivant que les ides étaient tombées le treize ou le quinze ; le dernier jour s'appelait la veille des calendes. Heureusement ces dates particulières ne sont pas les plus essentielles. Pour les plus importantes, celles, par exemple, du temps où ont vécu les personnages dont Plutarque a écrit les Vies, j'ai rapporté les tables chronologiques qu'ont dressées, d'une part, M. Dacier, et de l'autre, les nouveaux éditeurs d'Amyot. Elles diffèrent do quelque chose pour le calcul des olympiades ; mais elles sont assez d'accord pour les années de la fondation de Rome. Celles de H. Dacier ne comprennent pas ordinairement tout le temps de la vie du personnage, mais seulement les dates de ses principales actions, et quelquefois d'une seule époque de sa vie, Je les place à la fin du sommaire de chaque vie, comme dans Amyot et je les mettrai aussi, comme M. Dacier, à la fin de tout l'ouvrage, en suivant avec lui, non l'ordre des Vies tel qu'il est dans Plutarque, mais celui des temps, afin que le lecteur puisse voir d'un coup d'oeil à quelle époque a vécu chacun de ces .grands hommes dont il aura lu l'histoire.
M. Dacier, en traduisant les noms des mois grecs, les a toujours rendus par les noms des mois français correspondante. Il en donne pour raison que ces dates étrangères, qui ne sont, dit-il, remarquables que par leur bizarrerie, font un mauvais effet dans une traduction française. Il est bien sur, ajoute-t-il, que si les Grecs avaient induit quelque auteur latin, ils n'auraient pas mis les mois romains, 16 mais les Grecs. Enfin il établit en principe qu'un écrivain ne doit employer que les mots de sa langue, à moins qu'il n'en manque, et qu'il ne soit forcé de recourir aux mots étrangers. Ce principe peut être vrai dans sa généralité ; mais je crois qu'il souffre des exceptions, et qu'elles sont applicables en particulier aux noms des mois grecs, qui sont une sorte de noms propres qu'il est plus conforme à la fidélité d'une traduction de conserver tels qu'ils sont. Cicéron, dans ses ouvrages philosophiques, ne fait pas de difficulté d'employer des mots grecs, quoiqu'il en ait de latins pour les exprimer. M. Dacier lui-même a conservé dans sa traduction bien des termes grecs et latins auxquels il a donné seulement la terminaison française, quoiqu'il pût leur en substituer de français. La plupart de ces noms de mois ne sont pas, je l'avoue, bien agréables à l'oreille ; mais ceux de villes ne le sont guère davantage : d'ailleurs ils ne se rencontrent pas assez fréquemment pour que l'oreille en soit fort offensée. Les éditeurs d'Amyot témoignent que ce traducteur aurait dû leur conserver les noms originaux. En les employant, j'ai toujours eu soin de mettre au bas des pages les noms français, afin que le lecteur n'eût pas la peine de les chercher.
Les langues anciennes emploient toujours le singulier en parlant à une seule personne ; dans la nôtre, on ne s'en sert qu'en poésie ou dans le style soutenu. M. Dacier avait voulu d'abord l'employer toujours, par le conseil de quelques personnes qui trouvaient que ce singulier avait plus de grâce dans la bouche des anciens ; mais l'expérience lui fit voir que dans bien des endroits l'emploi de ce mot était très choquant. L'exemple d'Amyot en est une preuve sensible : il s'en est servi partout, et dans une foule de circonstances cette expression est singulièrement déplacée. Qui ne serait blessé, par exemple, dans notre langue, d'entendre Minucius, lorsqu'il va se jeter aux pieds de Fabius qui l'avait sauvé du péril où sa folle présomption l'avait précipité, employer cette manière de parler envers le dictateur, comme le dictateur lui-même s'en sert quand il parle à son licteur ou à un simple soldat? H est vrai que, du temps d'Amyot, notre langue n'avait pas encore pris ce ton d'honnêteté et de décence qui la distingue de toutes les autres langues de l'Europe, si l'on en excepte l'italienne, qui peut-être a porté trop loin ses formules de politesse. D'ailleurs, dans le vieux langage, cette forme choque moins, et semble même con- 17 venir à l'air antique et suranné qui lui est propre. M. Dacier prit donc un milieu : dans toutes les occasions où il fallait faire sentir de l'audace, du mépris, de la colère, ou un caractère étranger, il employa le singulier ; partout ailleurs il se servit du mot vous. J'ai été plus loin que lui ; car aujourd'hui rien ne serait plus contraire au ton de notre langue, à sa délicatesse, à ce sentiment des bienséances dont elle se pique, que d'user de cette manière de parler dans un ouvrage sérieux, même avec ses égaux. Nous venons de faire une honteuse expérience de l'avilissement auquel on a réduit notre langue, en employant ce terme à l'égard même des femmes les plus respectables par leur âge et par leurs qualités personnelles ; et c'est une raison pour en resserrer l'usage le plus qu'il est possible, afin de réparer par là en quelque sorte l'abus indécent qu'on en a fait. Je l'ai donc employé très rarement, et dans les seules occasions où le mot vous aurait paru déplacé ; comme lorsqu'un père parle à son fils, un maître à son esclave, un magistrat à son licteur. Partout ailleurs j'ai usé du terme vous, comme le seul qui convint au caractère grave et décent de la langue française.
Une difficulté assez embarrassante dans la traduction des anciens auteurs, c'est l'évaluation des monnaies. Tous les savants conviennent que la mine grecque valait cent drachmes, et quelle talent attique, celui qu'emploient ordinairement les anciens, était de soixante mines : mais ils ne s'accordent pas sur la valeur de la drachme, qui était la monnaie la plus commune chez les Grecs ; car le talent et la mine étaient des poids, comme chez nous la livre, et non pas des monnaies. Plutarque, dans les Vies des Romains, réduit toujours leurs monnaies à la drachme grecque : ainsi, pour les évaluer, il ne faut fixer que le prix de la drachme, le denier romain étant du même poids et de la même valeur. M. Dacier estime la drachme dix sous ; estimation juste pour son temps, où le marc d'argent valait environ vingt-sept livres. Mais depuis cette époque l'argent a presque doublé de valeur, il est monté à cinquante-trois livres ; ce qui est à peu près le taux actuel. J'ai donc estimé la drachme dix-huit sous, près du double de la valeur qu'elle avait du temps de M. Dacier. C'est l'estimation à laquelle l'a portée M. Dupuy dans un savant Mémoire sur les Monnaies anciennes, inséré dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions. Cette évaluation est un peu au-dessus de celle qu'ont 18 adoptée les nouveaux éditeurs d'Amyot, qui no mettent la drachme qu'à près de seize sous , car ils estiment les cent drachmes soixante-dix-sept livres, au lieu que je les porte à quatre-vingt-dix livres. J'ai conservé, dans ma traduction, les noms grecs des monnaies; et j'ai mis au bas des pages les rapports des sommes avec notre monnaie actuelle.
La valeur des mesures donne lieu encore à des calculs différents. Les Grecs se servent pour la mesure des graine du mot médimne, qu'Amyot traduit par celui de minot, et M. Dacier par celui de boisseau. Les éditeurs d'Amyot trouvent ces deux évaluations trop faibles ; ils portent la médimne à quatre boisseaux, mesure de Paris, et le minot de Paris n'est que de trois boisseaux, pesant chacun de vingt-une à vingt-deux livres. J'ai suivi leur estimation, qui me paraît plus exacte que celle de M. Dacier. Pour mesurer les liquides, les anciens avaient plusieurs grandeurs : celle qu'on trouve le plus ordinairement employée par Plutarque, c'est le choüs, qu'Amyot et M. Dacier traduisent par le mot générique de mesure, et qui, selon les éditeurs d'Amyot, faisait un peu plus de trois pintes et demie, mesure de Paris.
La différence dans la longueur des stades chez les divers peuples de la Grèce met aussi des inégalités dans l'évaluation des distances. Ces stades variaient depuis cinquante-une toises jusqu'à cent quatorze. Ce qui augmente la difficulté dans Plutarque, c'est que, suivant l'observation de M. Fréret, il n'a pas suivi une pratique constante dans l'évaluation du mille en stades : tantôt il compte huit stades au mille, et tantôt sept stades et demi. (Académie des Inscriptions, tom. XXIV, pag. 556.) Dans la plus petite valeur du stade, il en faut cinquante pour faire une de nos lieues de deux mille cinq cents toises ; dans la plus grande valeur, les vingt stades feraient la lieue. La mesure adoptée par M Dacier suppose un stade de cent toises ; il en met vingt-cinq pour une lieue. Je me suis fixé à l'évaluation de huit stades au mille, ce qui fait vingt stades pour une lieue s c'est la mesure qui me parait la plus généralement adoptée.
Je mets a la suite de cette préface une Vie de Plutarque. Le savant Ruauld, dans son édition grecque et latine de toutes les œuvres de cet écrivain ; Corsini, dans celle qu'il a donnée, en grec et en latin, du Traité sur les Opinions des Philosophes ; M. Dacier et les 19 traducteurs anglais des Vies des grands nommes, m'en ont donné l'exemple : je l'ai suivi d'autant plus volontiers que je me suis fait un plaisir d'écrire la vie d'un auteur si intéressant dans ses ouvrages historiques, d'un philosophe si estimable dans ses Traités de morale, et dont le caractère, les mœurs et les vertus offrent un si beau développement, et ne laissent presque que des éloges à donner. J'ai cru aussi que le public aimerait à connaître les particularités de la vie d'un auteur qui a lui-même écrit celles de tant de grands hommes. La vie d'un philosophe n'est pas moins instructive que ses ouvrages, lorsque sa conduite est, comme celle de Plutarque, toujours d'accord avec ses principes.
Je crois que le lecteur ne sera pas fâché d'avoir sous les yeux le tableau correspondant des mois attiques et des nôtres. C'est celui qu'ont donné les éditeurs d'Amyot ; et je le fais précéder de la note que ces savants académiciens y ont jointe, parce qu'elle donne une connaissance exacte de l'année attique, et des changements qu'elle éprouva.
« Anciennement l'année attique était composée de doute mois lunaires, alternativement de 29 et 30 jours, pour la commodité de l'usage, parce que le mois lunaire est de 29 jours et demi. On appelait pleins les mois de 30 jours ; creux, les mois de 29 : ce qui se faisait en supprimant le 29e jour, et en passant du 28 au 30, sans compter ni nommer le 29, qui s'appelait par cette raison jour exemptile ou supprimé. Ainsi l'année attique était censée de 360 jours, et les mois de 30 jours chacun. Mais il y en avait effectivement 6 de 29 jours seulement, et l'année n'était en réalité que de 354. Cela dura jusqu'à la première année de la 87e olympiade, avec laquelle commença la réforme introduite par Méton dans le calendrier. Depuis cette époque, le jour exemptile fut pris de soixante-trois en soixante-trois, pendant toute la durée de la période de dix-neuf ans qu'il avait imaginée pour faire cadrer l'année lunaire avec l'année solaire, au moyen des mois intercalaires.
» Dix-neuf années solaires supposées de 365 jours font 6,935 jours, et dix-neuf années lunaires supposées de 354 n'en font que 6,726 : la différence est 209. Sept mois intercalés dans les 3, 5, 8, 11, 13, 16 et 19e années compensaient cette différence. Telle est l'idée sommaire du calendrier de Méton... La correction que Calippe y fit cent deux 20 ans après ne changea point sa forme. Elle n'eut pour objet que la suppression d'un jour, qui, dans le calcul de Méton, se trouvait redondant tous les soixante-seize ans.
« Indépendamment des jours régulièrement exemptiles dans cette forme d'année, le 2 du mois Boédromion était toujours exemptile, parce que c'était ce jour-là, suivant la fable, que Neptune et Minerve s'étaient disputé l'Attique. C'est pour cela qu'on voit dans Plutarque la date de la bataille de Platée rapportée, tantôt au trois, tantôt au quatre de ce mois, suivant qu'il a égard ou non au jour exemptile.
V Hécatombéon commençant à la nouvelle
lune la plus voisine du solstice d'été, répondait, pour la plus
grande partie, à Juillet,
« Métagitnion... Août.
« Boédromion, le 5 exemptile... Septembre.
« Mémactérion........ Octobre.
« Pyanepsion, le 6 exemptile.... Novembre.
« Poséidon... Décembre.
« Gamélion, le 9 exemptile... Janvier.
« Anthestérion..... Février.
« Élaphébolion, le 12 exemptile.... Mars.
« Munycbion ...Avril.
« Thargélion, le 15 exemptile.... Mai.
« Scirrophorion.... . Juin.
« La période de Médon commença la première année de la 87e olympiade, 432 ans avant J.-C. Avant la troisième année de cette même olympiade on intercala un treizième mois. Il s'appelait le second Poséidon, et s'intercalait après le premier ; ensuite la première année de la 88e olympiade ; puis la quatrième, et ainsi de suite dans l'ordre que nous avons marqué ci-dessus. »
(1) Marie-Thérèse Geoffrin, marquise de La Ferté-Imbault. Celte dame avait extrait de Plutarque un recueil de maximes,
(2) De Orat. liv. Il, chap. IX.
(3) Cornélius Nepos avait écrit avant lui les Vies de quelques Capitaines grecs et de deux Romains; mais, outre qu'elles ont peu d'étendue, il n'a pas comparé entre eux les personnages dont il écrit l'histoire, c'est surtout par ces parallèles ai judicieusement faits que se distinguent les ouvrages historiques de Plutarque ; et cette manière de traiter l'histoire n'était pas encore connue.
(4) Pascal, Pensée 28.
(5) Alexandre, tyran de Phères.
(6) Acad. des Inscript., t. VI, p. 485.
(7) Tusc., liv. I, chap. II.
(8) MM. Brottier et Vauvilliers.
(10) Par
de Pierres, chez Cussac.