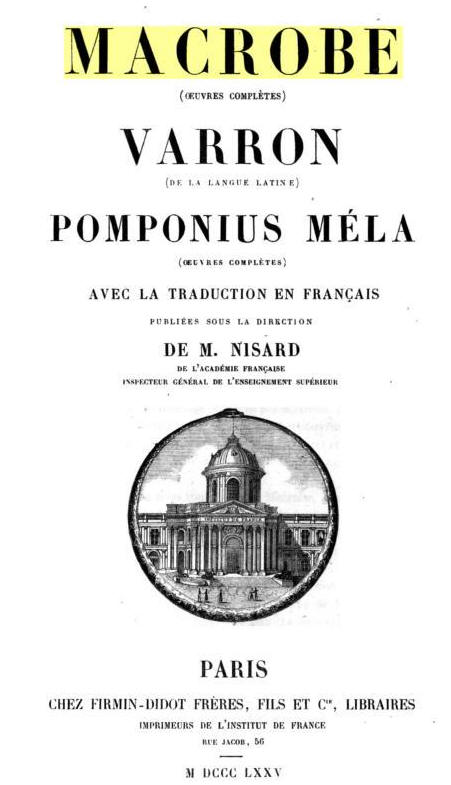|
ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE MACROBE
MACROBE
SATURNALES
LIVRE SEPT
LIVRE SEPTIÈME.
CHAPITRE I. A quelle époque du repas il convient de philosopher et, sur quelles matières.
Après l'enlèvement du premier service, et au moment ou les petites coupes viennent suspendre l'activité du repas, Praetextatus parla en ces termes : νηπενθές τ' ἄχολόν τε, κακῶν ἐπίληθον ἁπάντων. (Odyssée, IV, 221) « --- Qui apaise la colère et le chagrin, et qui verse l'oubli de tous les maux », l'on verra que ce n'est ni une herbe, ni un suc de l'Inde, mais la douceur de la narration, qui rappelle au bonheur l'étranger plongé dans le chagrin; car c'étaient les hauts faits d'Ulysse que Hélène racontait devant son fils, οἷον καὶ τόδ' ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ (Odyssée, IV, 270) « Et tout ce que fit et tout ce qu'eut à supporter cet homme courageux ».
Parce qu'en lui parlant de la gloire et de chacun des hauts faits de son père, Hélène rappela le bonheur dans l'âme de Télémaque, on a cru qu'elle aurait mêlé, au vin qu'elle lui versait, un remède contre le chagrin. Que fait cela, direz-vous, à la philosophie? C'est que rien n'a plus de connexité avec la sagesse que d'approprier ses discours aux lieux, et au caractère des personnes qui doivent les entendre. L'émulation des uns est excitée par des exemples de courage; d'autres le sont par des exemples de modestie ; d'autres par le tableau des bienfaits : de pareils discours font souvent s'amender ceux qui les entendent, et qui jusque-là agissaient tout différemment. νῦν δ' ἔρχεσθ' ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν ῎Αρηα. (Iliade, XIX, 275) « Maintenant allez souper, afin que nous marchions au combat ». Si donc l'occasion se présente d'une répréhension indispensable, le philosophe la fera de manière qu'elle soit juste et efficace. Qu'on ne s'étonne pas si j'ai dit qu'il doit frapper en dissimulant son coup, puisque souvent il reprend, à la satisfaction de celui-là même auquel il s'adresse. Il doit aussi faire briller l'ascendant de la philosophie, non seulement dans ses discours, mais même dans ses questions, en faisant voir qu'elle ne dit jamais rien de puéril. Ainsi donc n'excluons la philosophie d'aucun lieu, d'aucune réunion, d'aucun acte honnête; puisque, partout où elle parait, elle se montre si nécessaire, que son absence paraîtrait impie. CHAPITRE II. Des sujets sur lesquels chacun aime à être interrogé.
Aviénus. ὡς ἡδύ τοι σώθεντα μέμνησθαι πόνων « Combien est doux le souvenir des dangers auxquels on est échappé » ! Le poète dit : « auxquels on est échappé », a pour faire sentir que ce n'est qu'après qu'ils ne sont plus, que commence la douceur de raconter ses maux. Votre poète lui-même n'a-t-il pas employé le mot « olim », pour exprimer que ce n'est que lorsque l'infortune est effacée, qu'il vient un temps où l'on se plait à rappeler la mémoire des fatigues passées? — Forsan et haec olim meminisse iuvabit? « Un jour peut-être vous aimerez à rappeler ces choses ». J'avouerai cependant qu'il est certains genres de malheurs que celui qui les a éprouvés aime à oublier, alors même qu'ils sont entièrement écoulés. Ainsi, celui qui a éprouvé dans ses membres les tortures des bourreaux, celui qui a subi des pertes déplorables, celui qui a été autrefois noté par les censeurs, ne souffre guère moins lorsqu'on l'interroge sur ses infortunes, qu'alors même qu'il les éprouvait. Gardez-vous de pareilles interrogations, qui ressembleraient trop à des récriminations. Au contraire, provoquez souvent, si l'occasion s'en présente, à vous raconter sa bonne fortune, celui que le public écouta favorablement; celui qui s'acquitta heureusement et libéralement de sa mission; celui que l'empereur a accueilli avec faveur et bonté; celui qui, d'une flotte tombée presque tout entière dans les mains des pirates, à échappé seul, par son adresse ou par son courage. Dans ces cas, la plus longue narration doit suffire à peine au plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi à celui que vous inviterez à raconter la fortune qui vient de combler subitement son ami, et qu'il n'osait ni taire, ni annoncer spontanément, dans la crainte de se voir accuser ou de jactance ou d'envie. Interrogez le chasseur sur les détours de la forêt, sur les circuits de la bête fauve, sur les succès de sa chasse. A l'homme religieux, fournissez l'occasion de décrire par quelles pieuses pratiques il a su mériter la protection des dieux, et les fruits qu'il en a recueillis; car il croit faire un nouvel acte de religion, en publiant les bienfaits de la Divinité; ajoutons qu'il aime qu'on le considère comme un ami des dieux. Si un vieillard est présent, vous avez trouvé l'occasion de lui rendre un grand service, quand même vous l'interrogeriez sur des matières qui ne sont nullement de son ressort, car la loquacité est un défaut ordinaire à cet âge. C'est parce que Homère le savait, qu'il adresse à Nestor des interrogations accumulées:
ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, σὺ δ' ἀληθὲς ἐνίσπες· « O Nestor, ô fils de Nélée, dis-moi comment est mort le fils d'Atrée, le puissant Agamemnon? Où était Ménélas? --- N'était-il pas à Argos, dans l'Achaïe? » Le poète accumule dans ces interrogations tant de motifs de parler, pour satisfaire à la démangeaison qu'éprouve la vieillesse. Dans Virgile, Énée, désirant se rendre agréable à Évandre en toute manière, lui fournit diverses occasions de raconter; il ne se contente pas de l'interroger sur ce sujet ou sur cet autre;
— singula laetus « Mais il s'enquiert de tout avec bonheur, et écoute les narrations des premiers hommes (de la contrée.) » Captivé par ces questions, vous savez tout ce qu'Evandre raconta.
CHAPITRE III. Des divers genres du sarcasme, et avec quel ménagement il faut l'employer entre convives. Ces discours d'Eusthate furent accueillis par une approbation universelle, et tout aussitôt Aviénus dit : Je vous prierai, vous tous qui êtes ici présents, vous les doctes entre tous les doctes, d'engager Eustathe à nous développer ce qu'il disait naguère du sarcasme; et Eustathe, déférant à leur vœu unanime, parla en ces termes : Outre le mot ψόγος (inculpation) et διαβολή (accusation), les Grecs ont encore deux autres expressions, λοιδορία et σκῶμμα pour lesquelles je ne trouve point de synonymes latins. Par la première, il faut entendre un blâme avec affront direct : je dirai volontiers du second, que c'est une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme se couvre souvent de dissimulation ou même d'urbanité, en sorte qu'il dit autre chose qu'il ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas toujours à l'amertume; et certaines fois même il renferme quelque chose d'agréable pour celui contre lequel il est lancé. C'est ce dernier genre qu'emploiera l'homme sage et poli, surtout à table et au milieu des coupes, qui rendent plus facile la provocation à la colère. Car, de même qu'une légère impulsion suffit pour précipiter celui qui est au bord d'un escarpement, de même la plus légère blessure suffit pour faire entrer en fureur celui qui est plongé dans le vin. On doit donc s'abstenir soigneusement de lancer à table le sarcasme qui cache une injure; car des traits de cette espèce restent plus profondément fixés qu'un outrage direct, comme un hameçon crochu reste enfoncé avec plus de ténacité qu'une lame droite. D'ailleurs, ces sarcasmes excitent le rire des personnes qui les entendent, lesquelles paraissent ainsi confirmer l'insulte, en lui donnant leur assentiment. Voici un exemple du sarcasme injurieux: Oblitusne es quia salsamenta vendebas? - « As-tu donc oublié que tu vendais des apprêts de cuisine? » Voici un exemple de cette espèce de sarcasme, que nous avons dit être souvent une injure déguisée: Meminimus quando brachio te emungebas - « Nous nous souvenons du temps où tu te mouchais au bras ». La même pensée a été exprimée par les deux interlocuteurs; mais le premier a proféré une insulte, parce que ce qu'il reproche est entièrement nu et à découvert; le second a lancé un sarcasme, parce qu'il a déguisé l'outrage. Octave, qui passait pour être d'origine noble, dit un jour à Cicéron, qui lisait en sa présence: Non audio quae dicis « Je n'entends pas ce que tu dis ».
- « Cependant, lui répondit celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes » : ce qui fait allusion à l'opinion d'après laquelle Octave aurait été originaire de Libye, où c'est l'usage de percer les oreilles. Le même Cicéron repoussa Labérius, qui venait s'asseoir auprès de lui, en lui disant: Reciperem te, nisi anguste sederemus « Je te recevrais bien, si je n'étais assis à l'étroit ». - A quoi Labérius fit cette réponse tout aussi mordante :
Atqui solebas duabus sellis sedere
voulant par là reprocher à ce grand homme la mobilité de sa foi politique. Solent esse flamines diales: modo consules diales habemus « Jadis nous avions, disait-il, des flamines diales; maintenant nous avons des consuls diales ». Et cet autre sarcasme, lancé contre le même personnage: vigilantissimus est consul noster, qui in consulatu suo somnum non vidit « Nous avons un consul très vigilant, puisqu'il n'a point goûté le sommeil pendant toute la durée de son consulat ». - Comme ce même consul reprochait à Cicéron qu'il n'était point venu lui rendre visite, celui-ci lui répondit : Veniebam sed nox me conprehendit - « J'étais en route, lorsque la nuit m'a surpris ».
Des sarcasmes de ce genre emportent plus d'agrément que d'amertume. Ergo inpossibilem mihi dicitis spem salutis. « C'est donc me dire, répliqua-t-il, que tout espoir de salut m'est interdit ».
Or Antigone était borgne. Ce bon mot hors de saison coûta la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne dissimulerai point que l'indignation a quelquefois poussé des philosophes à employer ce genre de sarcasme. Tu nobis, inquit, absolve, cur et de albis et de nigris loris similes maculae gignantur- Et toi, lui répondit avec indignation le philosophe Aridice, tu nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir noir et celles de cuir blanc laissent des cicatrices semblables? » Il est des sarcasmes qui ont l'apparence de l'insulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux à qui ils sont adressés; tandis qu'ils déchireraient cruellement, s'ils étaient lancés contre quelqu'un qui les eût mérités. Il en est d'autres, au contraire, qui ont l'apparence de la louange, et qui cependant outragent gravement celui à qui ils sont adressés. Je donnerai d'abord un exemple du premier : L. Quintius venait de retourner d'une province où il avait exercé la préture avec la plus grande intégrité; ce que vous admirerez, puisque c'était sous l'empire de Domitien. Se trouvant malade, il disait à un ami qui était auprès de lui, qu'il avait les mains froides. Atqui eas de provincia calidas paulo ante revocasti « Cependant, lui répondit celui-ci en plaisantant, tu viens naguère de les rapporter bien chaudes de ta province ».
Quintius sourit et fut même flatté de ce propos, tant le soupçon de toute malversation était loin de planer sur lui. Si, au contraire, ce propos eût été tenu à un homme mal avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir de ses rapines, celui-ci en eût été fortement irrité. Tibi excito creditores tuos « Je vais donner l'éveil à vos créanciers »; ou à un homme très chaste : Gratae sunt tibi meretrices, quia continua eas largitate ditast « Vous aimez les courtisanes, vous les enrichissez par vos largesses; »
ils en souriront tous deux, sachant bien que leur conscience est tranquille à cet égard. Achilli vel Herculi conparandus es « Vous êtes comparable à Achille ou à Hercule »; à un homme fameux par ses iniquités : Ego te Aristidi in aequitate praepono « Je mets votre équité au-dessus de celle d'Aristide; »
assurément ils ne manqueront pas de prendre pour des outrages ces propos louangeurs. Sed et nos de isdem seminibus sumus « Au reste, nous venons tous deux de la même graine »;
propos qui ne fit qu'égayer chacun d'eux. Ipse me, aiebat, mendicum fecit ex divite et pro ampla domo in dolio fecit habitare. « Il m'a rendu, disait-il, mendiant, de riche que j'étais auparavant; et au lieu d'une vaste maison, il m'a donné un tonneau pour habitation ».
C'était le louer mieux, de parler de la sorte, que s'il eût dit :
CHAPITRE IV. Qu'une nourriture simple est préférable à une nourriture composée, comme étant de plus facile digestion.
Praetextatus.
CHAPITRE V. Qu'au contraire une nourriture composée nous est plus appropriée qu'une nourriture simple.
Praetextatus et les autres convives s'empressaient d'applaudir à ces discours, lorsqu'Evangelus s'écria :
CHAPITRE VI. Que le vin, de sa nature, est plutôt froid que chaud ; et pourquoi les femmes s'enivrent rarement, et les vieillards fréquemment.
Flavien: ἤριπε δ' ἐν κονίῃ, ψυχρὸν δ' ἕλε χαλκὸν ὀδοῦσιν. (Iliade, V, 75) « Il saisit avec les dents le fer glacé »
(a dit Homère ) cependant il s'échauffe étant exposé au soleil; et la chaleur qui lui est étrangère détruit le froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonnement ne nous conduira pas à dire la même chose du vin. Le vin, ou est absorbé dans notre intérieur par voie de boisson, ou est employé extérieurement par voie de friction curative. Dans ce dernier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa froideur; mais ils disent qu'il est échauffant pris à l'intérieur, non point par sa nature, mais par son mélange avec des substances chaudes. Qu'ils me disent donc pourquoi ils l'administrent à l'estomac malade et affaibli, afin d'en réparer les forces par ses propriétés astringentes, si ce n'est parce que sa froideur donne de l'énergie aux parties relâchées, et rétablit celles qui se désorganisent. Qu'ils me disent encore pourquoi, tandis qu'ils ne laissent prendre rien d'échauffant aux estomacs fatigués, pour ne pas augmenter leur lassitude, sachant tirer par ce traitement un principe de force d'une privation, le vin n'est point au nombre des choses dont ils interdisent l'usage? CHAPITRE VII. Si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chaud que celui de l'homme; et pourquoi le moût n'enivre pas.
Le raisonnement de Disaire fut approuvé de tout le monde; et Symmaque ajouta : CHAPITRE VIII. De la facilité ou de la difficulté de la digestion de certains aliments; et de quelques autres petites questions extrêmement subtiles.
Furius Albin.
CHAPITRE IX. Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mêmes éprouvent un tournement de tête? comment le cerveau, qui est privé de sentiment, en est cependant le régulateur dans tous les autres membres; l'on indique en même temps quelles sont les parties du corps humain privées de sensibilité. Évangelus continuant la série des interrogations : A mon tour, dit-il, je donnerai de l'exercice à notre ami Disaire, si toutefois ses courtes et légères réponses peuvent satisfaire à mes interrogations. Dis-moi, Disaire, pourquoi ceux qui roulent en tournant circulairement sur eux-mêmes éprouvent-ils un tournement de tête et un obscurcissement de la vue, tels que, s'ils continuent, ils finissent par tomber, sans que leur chute soit déterminée par aucun autre mouvement de leur corps ? Disaire répondit : Il est sept mouvements que peut faire le corps: ou il se porte en avant, ou il recule en arrière, ou il se détourne à droite ou à gauche, ou il est poussé en haut ou en bas, ou il tourne circulairement. De ces sept mouvements un seul, le mouvement sphérique, dont le ciel, les astres et les autres éléments éprouvent aussi l'impulsion, se rencontre dans les corps divins, tandis que les six premiers sont spécialement familiers aux êtres vivants de la terre. Cependant ceux-ci font quelquefois le septième mouvement. Les six autres mouvements, à raison de leur nature directe, sont incapables de produire d'effet nuisible ; mais le septième, c'est-à-dire le mouvement sphérique, par suite de ses fréquentes conversions, trouble et submerge dans les humeurs de la tête l'esprit, qui communique la vie au cerveau, comme au régulateur de toutes les sensations du corps. C'est cet esprit qui, enveloppant le cerveau, communique à chacun des sens son action; c'est lui qui donne la force aux nerfs et aux muscles. Lors donc qu'il est troublé par le mouvement circulaire, et que les humeurs agitées le compriment, il souffre, et cesse ses fonctions; et de là vient que, chez celui qui tourne circulairement, l'ouïe s'émousse et la vue s'obscurcit. Enfin, les nerfs et les muscles ne recevant plus aucune énergie de l'esprit qui doit la leur communiquer, et dont l'action se trouve annulée, le corps entier qu'ils soutiennent, et qui leur doit sa force, croule, privé de son appui. Néanmoins, l'habitude, qu'on appelle ordinairement une seconde nature, fait triompher de tous ces obstacles ceux qui s'exercent fréquemment au mouvement circulaire. Car cet esprit cérébral, dont nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé à un mouvement qui n'est plus nouveau pour lui;continue ses fonctions sans être troublé; en sorte que ce mouvement-là même ne produit aucun effet nuisible sur ceux qui s'y sont habitués.
Évangélus : - Je te tiens,
Disaire, dans mes filets; et, si je ne me trompe, cette fois tu ne
m'échapperas pas. J'ai entendu souvent tes collègues dans ton art, et
toi-même, dire qu'il n'y avait point de sensibilité dans le cerveau,
mais que, comme les os, les dents, les cheveux, il était privé de
sentiment. Est-il vrai que vous le soutenez ainsi, ou bien le nies-tu?
Disaire répondit en souriant : - Les filets dans lesquels tu me tiens enveloppé, Évangélus, sont trop lâches, et leurs mailles trop écartées; car tu m'en verras échapper sans efforts. La nature a voulu que les parties qui sont très sèches on très humides ne fussent pas susceptibles de sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les cheveux, sont tellement condensés par une grande siccité, qu'ils ne sont point accessibles aux impressions de cet esprit qui communique la sensibilité. La graisse, la moelle et le cerveau sont tellement amollis et plongés dans l'humidité, que cette même impression, que la siccité repousse, ne peut être retenue au sein de cet amollissement. C'est ce qui fait que la sensibilité n'a pu exister dans la graisse, dans la moelle et dans le cerveau, tout comme dans les dents, les ongles, les os et les cheveux; et de même que l'amputation des cheveux n'occasionne aucune douleur, de même il n'en éprouverait pas la sensation celui à qui l'on trancherait une dent, un os, une portion de graisse, de moelle, ou de cerveau. Cependant nous voyons, diras-tu, ceux à qui l'on coupe des os éprouver des tourments; et les hommes sont souvent torturés par des douleurs aux dents. Personne ne nie cela. Mais, pour couper un os, il faut couper la membrane qui l'enveloppe; et c'est cette section qui fait éprouver de la douleur. Quand la main du médecin a franchi cette partie, l'os et la moelle que celui-ci contient subissent l'amputation avec la même insensibilité que les cheveux. Lorsqu'on souffre des maux de dents, le sentiment de la douleur n'est point dans l'os de la dent, mais dans la chair où elle est emboîtée. Toute la partie de l'ongle excroissante hors de la chair peut être coupée sans aucune sensation; mais celle qui est adhérente à la chair occasionne de la douleur, si elle est tranchée, non en elle-même, mais dans la partie où elle est fixée. De même aussi le cheveu dont on coupe la partie extérieure, est insensible à la douleur; mais, si on l'arrache il communique une sensation à la chair dont il est séparé. De même enfin, l'attouchement du cerveau fait éprouver à l'homme de la souffrance, et souvent lui donne la mort, non par sa propre sensation, mais par celle de la membrane qui l'enveloppe, laquelle donne lieu à la douleur. J'ai dit quelles sont les parties du corps humain qui sont privées de sentiment, et j'en ai indiqué les causes. Le reste de ma tâche consiste à expliquer comment le cerveau, qui est privé de sentiment, est cependant le régulateur des sensations. Les sens, dont nous avons à parler, sont au nombre de cinq : la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux corps, et ils ne sont propres qu'aux seuls corps périssables : car les corps divins n'ont aucune espèce de sens, tandis que tous les corps, même les divins, ont une âme plus divine encore. Si donc l'excellence des corps divins rend les sens indignes d'eux, comme n'étant convenables qu'à des corps périssables, combien plus l'âme se trouvera-t-elle trop élevée pour avoir besoin des sens? Or, pour constituer un homme et en faire un être vivant, il faut une âme qui illumine un corps. Elle l'illumine en habitant en lui; et sa résidence est dans le cerveau. Sphérique de sa nature et nous venant d'en haut, l'âme occupe aussi la partie sphérique et la plus élevée du corps humain, laquelle est en même temps privée de sensibilité, dont l'âme n'a pas besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire à la partie animale, un esprit est placé dans les cavités du cerveau, esprit au moyen duquel l'âme communique ses effets, et dont les fonctions sont de produire et de gouverner les sensations. De ces cavités, que les anciens médecins ont appelées ventricules du cerveau, naissent sept paires de nerfs, auxquelles vous donnerez en latin le nom qu'il vous plaira. Pour nous, nous appelons en grec syzygie l'assemblage de deux nerfs qui partent ensemble du même lieu, et viennent aboutir au même point. Les sept paires de nerfs partant donc de la cavité du cerveau remplissent les fonctions de canaux, qui vont distribuer, chacun en son lieu, d'après les lois de la nature, le souffle et la sensation, et communiquent ainsi cette propriété aux membres les plus rapprochés, comme à ceux qui s'écartent le plus de l'esprit animal. La première paire de ces nerfs se dirige vers les yeux, et leur donne la faculté de distinguer les divers objets et de discerner les couleurs; la seconde se dirige en se partageant vers les deux oreilles, dans lesquelles elle produit la notion des sons ; la troisième entre dans le nez, et lui communique la vertu de l'odorat ; la quatrième va occuper le palais, par où nous apprécions le goût des choses; la cinquième communique son action à tout le corps, car toutes les parties du corps discernent les objets mous d'avec les objets durs, ceux qui sont froids d'avec ceux qui sont chauds. La sixième paire de nerfs partant du cerveau vient aboutir à l'estomac, auquel la sensibilité est essentiellement nécessaire pour invoquer ce dont il a besoin, repousser le superflu, et pour être enfin à lui-même, dans l'homme sobre, son propre modérateur. La septième paire de nerfs répand le sentiment dans la moelle épinière, qui est chez l'animal ce qu'est la quille dans le navire, et qui joue un rôle si utile et si important, que les médecins l'on appelée le long cerveau. De là aussi, comme du cerveau, partent divers canaux qui concourent aux trois actes que se propose l'âme. Car il est trois choses que l'âme a pour but de procurer au corps animal: qu'il vive; que sa vie soit bien organisée ; et que, par la succession, l'immortalité lui soit assurée. L'action de l'âme pour ces trois objets est communiquée, comme je l'ai dit, par la moelle épinière, qui fournit la force, suivant les moyens dont j'ai parlé, au cœur, au foie, et aux organes de la respiration ; trois objets qui appartiennent à l'essence de la vie. C'est aussi par ces canaux que reçoivent des forces les nerfs des mains et des pieds, et des autres parties du corps qui constituent l'organisation régulière de la vie; et c'est enfin pour assurer au corps une succession, que, de cette même moelle épinière, d'autres nerfs se dirigent vers les parties naturelles ou vers la matrice, afin de les rendre capables de remplir leur fonction. C'est ainsi qu'aucune partie du corps humain n'est privée de l'influence de la moelle épinière, ou de celle de l'esprit qui est placée dans la cavité du cerveau ; et voilà comment on explique que le cerveau, qui est privé de sentiment, soit néanmoins le point d'où il se répand dans tout le corps. - C'est très-bien, dit Évangélus; notre petit Grec nous a expliqué si clairement les choses que la nature avait couvertes de ses voiles, que nous croyons voir de nos yeux ce que ses discours n'ont fait que nous décrire. Mais je cède la parole à Eusthate, auquel j'ai usurpé son tour d'interroger. - Eusthate : qu'Eusèbe, le plus disert des hommes, ou que tout autre qui le désirera, s'empare maintenant de l'interrogation; pour moi, j'y vaquerai par la suite, dans un moment plus loisible.
CHAPITRE X. Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commencent toujours par envahir la partie antérieure de la tête; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix plus grêle que les hommes. Disaire, nous disserterons donc ensemble, dit Eusèbe, sur cet âge à la porte duquel nous sommes près de frapper tous deux. Lorsque Homère dit des vieillards qu'ils ont les tempes blanches, je demande si, à la manière des poètes, il prend cette partie pour la tête entière, ou bien s'il a eu quelque motif d'attribuer la blancheur à cette partie spécialement. - Disaire : En cela, comme dans tout le reste, éclate l'exactitude du poète divin; car la partie antérieure de la tête est plus humide que l'occiput, et c'est à cause de cela que la blancheur commence par cet endroit à se manifester. - Si la partie antérieure, répliqua Eusèbe, est la plus humide, pourquoi est-elle si exposée à la calvitie, qui n'est produite que par la siccité? - L'objection, dit Disaire, est faite à propos; mais la solution n'en est pas moins claire. La nature a fait les parties antérieures de la tête les moins compactes, afin que les émanations fumeuses ou superflues du cerveau pussent s'évaporer par un plus grand nombre de voies. De là vient qu'on remarque sur les crânes desséchés des hommes une espèce de suture, par laquelle, si j'ose m'exprimer ainsi, sont liés ensemble les deux hémisphères dont est formée la tête. Or, l'humidité fait place à la siccité dans les individus chez lesquels ces voies sont les plus ouvertes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard, ils n'échappent point à la calvitie. - Eusèbe: Si c'est la siccité qui produit la calvitie, et que les parties postérieures de la tête soient, comme tu l'as dit, les plus sèches, pourquoi ne voyons-nous jamais l'occiput devenir chauve? - Disaire répondit : La siccité de l'occiput n'est point un vice, c'est une chose naturelle; car il est tel chez tous les individus. Or la calvitie n'est produite que par la siccité qui résulte de cette mauvaise complexion, que les Grecs appellent δυσκρασίαν (dyscratie). Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui est un effet de la sécheresse de leur tête, blanchissent tardivement, mais deviennent bientôt chauves; au contraire, ceux dont les cheveux sont rares ne les perdent pas facilement, parce qu'ils sont nourris par le fluide appelé flegme; mais ils blanchissent bientôt, et cela parce qu'ils se teignent de la couleur du fluide qui les nourrit. - Eusèbe : Si c'est à cause de l'abondance des humeurs que blanchissent les cheveux des vieillards, pourquoi attribue-t-on à la vieillesse une si grande siccité? - Parce que pendant la vieillesse, répondit Disaire, la chaleur naturelle se trouvant éteinte par le temps, le tempérament devient froid, ce qui donne naissance à des humeurs froides et superflues. D'ailleurs, le fluide vital se dessèche par la longévité. Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse, en ce sens qu'elle manque de ce fluide naturel, et que son humidité ne consiste qu'en une abondance d'humeurs vicieuses, procréées par la froidure du tempérament. C'est aussi la raison pour laquelle l'âge avancé est sujet aux insomnies, parce que le sommeil, qui est produit principalement par l'humidité du corps, ne saurait l'être par l'humidité qui n'est point naturelle. La constitution de l'enfance est humide, parce qu'il y a abondance de fluide naturel, mais non superfluité. C'est à cause de cette grande humidité que les cheveux des enfants ne blanchissent jamais, parce que leur flegme n'est point alimenté par la froidure, mais par le fluide vital et naturel. Car tout fluide qui résulte du froid de l'âge, ou qui est produit par quelque autre vice, est superflu, et par conséquent nuisible. Nous voyons les dangers extrêmes auxquels une pareille humidité expose les femmes, si elle n'est pas fréquemment évacuée. C'est elle qui affaiblit les jambes des eunuques, dont les os nageant toujours, pour ainsi dire, dans une humidité surabondante, sont privés de la vigueur naturelle, et plient facilement, parce qu'ils ne peuvent supporter le poids du corps dont ils sont chargés, comme le jonc se courbe sous le faix qu'on lui impose. Èusèbe : - Puisque la discussion sur la superfluité des humeurs nous a conduits des vieillards aux eunuques, je veux que tu me dises pourquoi la voix de ces derniers est si aiguë, que, lorsqu'on ne les voit pas, on peut la confondre avec celle des femmes? - C'est encore, répondit Disaire; l'abondance superflue de l'humidité qui produit cet effet. Car cette humidité, épaississant l'artère par laquelle monte le son de la voix, en rétrécit le passage; et voilà pourquoi la voix des femmes et celle des eunuques est aiguë, tandis que celle des hommes est grave, parce qu'elle trouve une ouverture libre et béante dans toute la capacité de l'artère. Une semblable froidure de tempérament produit dans les femmes et dans les eunuques une pareille abondance d'humeurs superflues; c'est ce que prouve l'embonpoint qu'ils acquièrent également, et le développement presque égal qu'atteignent les mamelles chez les uns comme chez les autres.
CHAPITRE XI. Pourquoi la honte et la joie font rougir, et pourquoi la crainte fait pâlir. Quand Disaire eut cessé de parler, c'était au tour de Servius d'interroger, lorsque sa timidité naturelle alla jusqu'au point de le faire rougir et Disaire lui dit: - Courage, Servius, rassérène ton front ! Puisque tu surpasses en science, non seulement tous les jeunes gens de ton âge, mais même tous les vieillards, bannis cette pudeur qu'atteste la rougeur de ton visage, et disserte librement avec nous sur ce qui te viendra dans l'esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes interrogations, que si tu répondais toi-même à celles d'autrui. - Comme il garda le silence encore quelque temps, Disaire l'excita à le rompre par de pressantes invitations. - Eh bien! dit Servius, je t'interroge sur ce que tu dis qui vient de m'arriver : pourquoi la pudeur que l'âme éprouve produit la rougeur de la surface du corps? - Disaire : Lorsque quelque chose excite en nous une honnête pudeur, la nature, en se portant vers les extrémités, pénètre dans notre sang qui se trouble, et l'agite de manière à ce que la peau en est colorée; et voilà ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent encore que la nature, lorsqu'elle éprouve le sentiment de la pudeur, se couvre du sang, comme d'un voile; et c'est pourquoi nous voyons souvent celui qui rougit mettre sa main devant son visage. Tu ne douteras point de cette raison, lorsque tu sauras que la rougeur n'est autre chose que la couleur du sang. Servius répliqua: - Et ceux qui éprouvent un sentiment de joie, pourquoi rougissent-ils? - Disaire : La joie vient du dehors de nous; la nature se porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit, comme partageant le sentiment de son bonheur, et colore la peau. C'est ce qui produit, ainsi que dans le cas précédent, la rougeur du teint. Servius. - Pourquoi, au contraire, ceux qui éprouvent le sentiment de la crainte pâlissent-ils? - Ceci n'est point obscur, répondit Disaire; car lorsqu'elle craint quelque chose de l'extérieur, la nature se retire dans son intérieur. C'est ainsi que nous-mêmes, lorsque nous appréhendons quelque chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux qui peuvent nous cacher. Ainsi donc, la nature, tendant à descendre pour trouver à se cacher, entraîne avec soi le sang, qui lui sert comme de char pour la transporter : sa retraite laisse sur la peau un fluide plus clair, et c'est ce qui fait que celle-ci pâlit. C'est par une raison analogue que ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se concentrant dans l'intérieur, abandonne les nerfs qui la communiquaient aux membres; et ceux-ci sont agités par les secousses de la crainte. C'est encore ainsi que le relâchement du ventre accompagne la frayeur, parce que les muscles, qui tenaient fermés les conduits des excréments, abandonnés par la force vitale qui se concentre intérieurement, lâchent les liens qui devaient retenir les excréments jusqu'à l'opportunité de la digestion. Servius donna son assentiment à ces réponses par un respectueux silence.
CHAPITRE XII. De quinze questions proposées par Aviénus à Disaire. Aviénus : - Puisque mon tour est venu de faire, comme les autres, des interrogations, je veux ramener sur des sujets relatifs aux festins la conversation, qui s'était beaucoup écartée de la table pour passer à d'autres questions. En voyant servir de la viande salée, que nous appelons lard laridum, mot composé, je pense, de large aridum (très sec), je me suis proposé souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel avec la viande la conserve pendant si longtemps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-même la cause, j'aime mieux en acquérir la certitude de celui qui s'occupe de l'étude de la nature du corps. Disaire : - Tout corps tend par sa propre nature à se flétrir et à se dissoudre; et, à moins qu'il ne soit retenu par quelque lien, il se désorganise facilement. Ce lien existe tant que dure la vie, au moyen du renouvellement de l'air, par lequel les poumons qui engendrent le souffle s'alimentent continuellement, en en aspirant sans cesse de nouveau. L'absence de la vie ayant fait cesser cet acte, les membres se flétrissent, le corps s'affaisse, cédant à son propre poids. Alors aussi le sang, qui, tant qu'il a été doué de chaleur donnait de la vigueur aux membres, se putréfie par l'absence de cette chaleur. Ne se contenant plus dans les veines, il s'écoule au dehors; et, de leurs canaux ainsi relâchés, dégoutte un pus fétide. Ce sont ces effets que prévient le mélange du sel dans les corps. En effet, le sel est de sa nature sec et chaud; sa chaleur empêche la dissolution du corps; sa siccité comprime ou absorbe l'humidité. Ce dernier point est facile à démontrer par l'exemple suivant : Faites deux pains d'une pareille grandeur, l'un salé et l'autre sans sel, vous trouverez le second plus pesant que le premier; ce qui est l'effet de l'humidité, que la privation du sel y laisse séjourner. Aviénus. Je veux demander à mon ami Disaire « pourquoi, tandis que le vin clarifié est plus vigoureux, il a cependant moins de force pour se conserver; et en même temps pourquoi il trouble si promptement celui qui le boit, tandis qu'il tourne facilement, si on le conserve »? - Ce vin trouble promptement, répondit Disaire, celui qui le boit, parce qu'il pénètre plus facilement dans ses veines, à proportion qu'il a été liquéfié par l'épuration de la lie; d'un autre côté, il se tourne facilement, parce que, ne trouvant à s'appuyer sur aucun soutien, il est exposé de toutes parts à ce qui peut lui nuire; car la lie est comme la racine du vin, qu'elle maintient, alimente, et auquel elle fournit des forces. Je te demande maintenant, dit Aviénus, « pourquoi en toutes choses, excepté dans le miel, la lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul décharge sa lie par en haut »? - Disaire répondit: La lie, étant une substance épaisse et terreuse, est plus pesante que tous les liquides, le miel excepté. Aussi, chez les premiers, sa pesanteur la fait couler à fond, tandis que, se trouvant plus légère que ce dernier, elle est chassée du lieu où elle se trouve vers la surface. Aviénus. - De ce qui vient d'être dit naissent des questions du même genre. « Pourquoi, Disaire, le vin et le miel sont-ils réputés meilleurs à des époques différentes? le miel, lorsqu'il est plus récent; le vin, lorsqu'il est plus vieux »? De là est venu ce proverbe des gourmets : Pour bien faire le mulsum (vin doux), il faut mêler de l'Hymette nouveau avec du vieux Falerne. - La raison de ceci, répondit Disaire, c'est la nature différente des deux liquides. Le vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de mon assertion, considère leur emploi en médecine. On prépare avec du vin les remèdes destinés à humecter le corps; et l'on épure avec du miel ceux qui sont destinés à le dessécher. Ainsi donc, le temps absorbant incessamment quelque chose de ces deux substances, le vin devient plus pur et le miel plus aride, l'un se déchargeant de l'eau, l'autre perdant son suc. Aviénus : - Tu ne trouveras pas non plus la demande suivante étrangère à notre sujet : « Pourquoi, si l'on conserve du vin ou de l'huile dans des vases à demi remplis, le vin dégénère-t-il en tournant vers l'aigreur, tandis que l'huile, au contraire, acquiert une saveur plus douce »? - Ces deux observations sont justes; dit Disaire. La partie supérieure du vase de vin qui se trouve vide est remplie par un air qui lui est étranger, et qui pompe et absorbe jusqu'aux moindres portions d'humidité. Par l'effet de cette dessiccation, le vin, pour ainsi dire dépouillé de ses forces, ou s'aigrit, ou perd tout son agrément, selon qu'il est d'une qualité faible ou spiritueuse. L'huile, au contraire, par suite de l'épuisement du fluide muqueux qu'elle renferme, et qui est produit par la dessiccation du superflu de son humidité, acquiert un goût d'une nouvelle suavité. Aviénus, insistant sur le même sujet, reprit : - Hésiode dit que, lorsqu'on est arrivé à moitié du tonneau, il faut ménager le vin; mais qu'on peut abuser jusqu'à la satiété des autres parties. Infailliblement, il veut dire par là que le meilleur vin est celui qui se trouve vers le milieu du tonneau. D'un autre côté, il est constaté par l'expérience que la meilleure portion de l'huile est celle qui surnage; et la meilleure portion du miel, celle qui se trouve au fond. Je demande donc « pourquoi on répute comme la meilleure, la portion qui se trouve à la surface dans l'huile; au milieu, dans le vin ; au fond, dans le miel »? - Disaire répondit sans hésiter : Ce qu'il y a de meilleur dans le miel est plus pesant que le reste. Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond est certainement la plus pesante; elle est donc meilleure que celle qui surnage. Dans un vase de vin, au contraire, la partie inférieure, à cause du mélange de la lie, est non seulement trouble, mais même d'une mauvaise saveur; la partie supérieure s'altère par la contiguïté de l'air, dont le mélange l'affaiblit. C'est pourquoi les agriculteurs, non contents d'avoir abrité les tonneaux sous leurs toits, les enfouissent et les couvrent par des enduits extérieurs, éloignant ainsi de leur vin, autant qu'il est possible, le contact de l'air, qui lui est si manifestement nuisible, que le vin a de la peine à se conserver même dans un vase plein, par conséquent moins accessible à l'air. Ainsi donc, si l'on vient à y puiser, et qu'on ouvre par là une voie au mélange de l'air, tout ce qui reste s'altérera. Donc le milieu du tonneau, parce qu'il est également distant de ses deux extrémités, est préservé de toute détérioration, n'étant ni troublé, ni affaibli. Aviénus ajouta : - « Pourquoi la même boisson parait-elle plus pure à celui qui est à jeun qu'à celui qui a mangé »? - Disaire : L'abstinence épuise les veines, la saturation les obstrue; ainsi donc, lorsque la boisson coule dans un vide complet, ne trouvant point les veines obstruées par de la nourriture, elle n'est affaiblie par aucun mélange, et parait plus forte au goût, à cause de la vacuité des lieux qu'elle traverse. Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, « pourquoi celui qui boit lorsqu'il a faim apaise un peu la faim; tandis que celui qui prend de la nourriture lorsqu'il a soif, non seulement n'apaise pas la soif, mais au contraire l'augmente de plus en plus »? - La cause en est connue, répondit Disaire : lorsqu'on a consommé quelque liquide, rien ne l'arrête en aucun endroit, et ne l'empêche de se distribuer vers toutes les parties du corps et d'aller remplir les veines. Aussi, lorsqu'on remédie par la boisson à la vacuité produite par l'abstinence, cette vacuité ne se reproduit pas entièrement; tandis que la nourriture, dont le volume est plus considérable et plus dense, ne parvient dans les veines qu'après avoir été dissoute peu à peu. Ainsi, elle n'apporte aucun soulagement à la soif actuelle. Loin de là, elle absorbe toute l'humidité extérieure qu'elle rencontre, et par là elle augmente l'ardeur de la soif. - Je ne veux pas non plus, dit Aviénus, rester dans l'ignorance de ceci : « Pourquoi on éprouve plus de plaisir à se désaltérer qu'à se rassasier »? - Disaire : Ceci s'explique par ce que j'ai déjà dit. La boisson pénètre tout d'un trait dans l'ensemble du corps, et le sentiment qu'éprouvent toutes ses parties produit une volupté unique, sensible et très grande; tandis que la nourriture, n'étant prise qu'à petites portions, n'apaise la faim que peu à peu; et la volupté qu'elle occasionne, étant plusieurs fois répétée, doit par cela même être moindre. (Aviénus). - Si tu le trouves bon, j'ajouterai encore ceci à mes autres demandes: « Pourquoi la satiété a-t-elle plutôt atteint celui qui dévore avec avidité, que celui qui mangerait lentement la même quantité »? - La réponse est courte, dit Disaire. Lorsqu'on dévore avidement, beaucoup d'air s'introduit avec les aliments, en ouvrant la bouche et par les fréquentes aspirations; cet air remplit les veines, et contribue, comme la nourriture, à procurer la satiété. (Aviénus). - Si je ne dois pas te fatiguer, Disaire, souffre l'excès de paroles que m'inspirel'ardeur de m'instruire; et dis-moi, je te prie, « pourquoi nous serrons dans la bouche des aliments très chauds, plus facilement que nous ne pourrions les supporter sur la main; et s'ils sont encore trop chauds pour que nous puissions les mâcher plus longtemps, pourquoi les avalons-nous sur-le-champ, sans que le ventre en éprouve une brûlure pernicieuse »? - Disaire : La chaleur intérieure qui se trouve dans le ventre, beaucoup plus forte et plus véhémente que celle des objets qu'il peut recevoir, enveloppe celle-ci, et la détruit par sa puissance. Aussi, si tu as mis dans la bouche quelque chose de brûlant, il ne faut point ouvrir les lèvres, comme font certaines personnes; car l'air renouvelé ne fait que prêter de nouvelles forces à la chaleur; mais il faut fermer un peu la bouche, afin que la chaleur plus forte, que le ventre communique jusqu'à la bouche, comprime la chaleur moindre de la nourriture. Quant à la main, il n'est aucune chaleur qui lui soit propre, qui l'aide à supporter un objet brûlant. - Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire de savoir « pourquoi l'eau qu'on a amenée à la température de la neige, en y recueillant des grêlons, est moins nuisible à boire que celle qui provient de la neige fondue »? - Disaire : J'ajouterai quelque chose à ce que tu me demandes. L'eau qui provient de la neige fondue, quand même on la mettrait devant le feu pour la boire chaude, est aussi nuisible que si on la buvait froide. Ce n'est donc pas le froid de la neige qui lui communique cette qualité pernicieuse; mais il en existe une autre cause, que je ne craindrai pas de rechercher sur les traces d'Aristote. Il l'établit ainsi dans ses Questions physiques, et la résout, si je ne me trompe, de la manière suivante : Toute eau renferme en soi une portion d'un air extrêmement léger, qui la rend salutaire; elle renferme aussi une lie terreuse, qui la rend, après la terre, l'élément le plus matériel. Lors donc que, condensée par le froid de l'air et par la gelée, elle se prend, il faut bien que cet air extrêmement léger qu'elle renferme soit expulsé par l'évaporation, qui lui permet de se coaguler, en ne conservant en elle que sa partie terreuse. Ce qui le prouve, c'est que si ce même volume d'eau vient à être dissous par la chaleur du soleil, sa quantité se trouvera moindre qu'avant qu'elle se fût coagulée : c'est parce qu'il manque la partie salubre, que l'évaporation a consommée. Or la neige, qui n'est autre chose que l'eau condensée dans l'air, a perdu, en se condensant, sa légèreté; et, par conséquent, la boisson qu'on en peut tirer, en la faisant dissoudre, porte dans les intestins le germe de diverses sortes de maladies. Aviénus. - En parlant de la congélation, tu m'as fait souvenir d'une question qui m'a souvent préoccupé : « Pourquoi les vins ne se gèlent-ils point, ou très rarement, tandis que la rigueur du froid fait prendre la plus grande partie des autres liquides? n'est-ce pas parce que le vin a en lui certains principes de chaleur, à cause desquels Homère lui donne l'épithète d'ardent; et non, comme le pensent quelques personnes, à cause de sa chaleur? ou bien existe-t-il quelque autre raison de cela »? C'est ce que j'ignore, et ce que je désire savoir. - Disaire répondit: Je veux que le vin possède une chaleur qui lui soit naturelle; mais l'huile ne la possède-t-elle pas aussi, et a-t-elle moins de force pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la fige. Certainement, si tu penses que les substances les plus chaudes sont celles qui doivent se congeler le plus difficilement, il s'ensuivrait que l'huile ne devrait point se geler; et si tu penses aussi que les substances les plus froides sont celles qui se congèlent le plus facilement, comment le vinaigre, qui est la plus frigorifique de toutes, n'est-il jamais pris par la gelée? La cause qui rend l'huile si prompte à se prendre ne serait-elle pas plutôt son épaisseur et sa densité? car le vin est beaucoup plus sec et beaucoup plus liquide que l'huile; le vinaigre est le plus liquide de tous les fluides, comme il en est le plus acerbe par son aigreur désagréable. A l'exemple de l'eau de mer, que son amertume ne rend pas moins désagréable, il n'est jamais coagulé par l'effet de la gelée. Car ce qu'a écrit l'historien Hérodote, contre l'opinion presque universelle, que le Bosphore qu'il appelle Cimmérien, ainsi que toutes les plages qu'on nomme la mer Scythique, sont sujets à se geler et à prendre de la consistance, est autre chose que ce qu'il croit. En effet, ce n'est point l'eau de mer qui se congèle; mais comme, dans ces régions, il est beaucoup de fleuves et de marais qui affluent dans ces mers, la superficie de la mer, au-dessus de laquelle surnagent les eaux douces, se congèle; et l'on distingue l'eau marine qui reste intacte, au milieu de cette congélation d'eaux qui lui sont étrangères. C'est ce que nous voyons arriver aussi dans le Pont, où des quartiers de glaces provenant des fleuves, et de la grande quantité d'eaux marécageuses qui s'y rendent, flottent, quoique fortement coagulés, à la surface des eaux marines, qui sont plus pesantes qu'eux. C'est à raison de cette grande quantité d'eaux qui affluent dans le Pont et qui inondent d'eau douce sa surface, que Salluste a dit que cette mer est moins amère que les autres. Ce qui prouve encore ce fait, c'est que, si l'on jette dans la mer de Pont des morceaux de bois, des brins de paille, ou tout autre corps flottant, il est entraîné hors de cette mer vers la Propontide, et par conséquent sur les côtes de l'Asie; tandis qu'il est certain que l'eau ne coule point hors du Pont, mais au contraire qu'elle y afflue, de l'autre mer. Car le seul courant qui déverse dans nos mers les eaux de l'Océan; est le détroit de Gadès, situé entre l'Afrique et l'Espagne, dont le courant se prolonge incontestablement jusqu'à la mer Tyrrhénienne, en suivant les côtes de l'Espagne et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriatique; puis à droite, la mer de Parthénium; à gauche, la mer Ionienne; et en face, la mer Égée, d'où il entre dans le Pont. Or donc, quelle est la cause par laquelle les courants d'eau sortent du Pont, tandis que cette mer reçoit ses eaux du dehors? Chacun de ces effets a son explication. La surface de la mer du Pont coule en dehors, à cause de la grande quantité d'eaux douces qu'elle reçoit de la terre; tandis que, dans le fond, l'écoulement des eaux a lieu en dedans. C'est pour cela que, comme je l'ai dit, les objets flottants que l'on jette dans cette mer sont portés à l'extérieur; tandis que si une colonne est jetée au fond, elle est roulée vers l'intérieur. Et en effet, il a été souvent expérimenté que des objets pesants, jetés au fond de la mer de Propontide, avaient été entraînés dans l'intérieur de la mer du Pont. Aviénus. Encore une seule question, et je me tais. « Pourquoi toute substance douce le paraît-elle davantage lorsqu'elle est froide que lorsqu'elle est chaude »? - Disaire répondit: La chaleur absorbe la sensation, et son ardeur émousse le goût sur la langue. Le sentiment pénible qu'elle commence par produire dans la bouche en bannit la volupté. Que si, au contraire, la bouche n'est point affectée par le sentiment de la chaleur, la langue peut alors apprécier sans obstacle la douceur d'un aliment agréable. En outre, les sucs rendus doux par le moyen de la chaleur ne pénètrent point dans nos veines impunément, et cette qualité nuisible en diminue la volupté.
CHAPITRE XIII. De trois questions proposées à Disaire par Horus. Horus, succédant à Aviénus, dit : En faisant plusieurs questions relatives à la boisson et à la nourriture, Aviénus a négligé la plus essentielle; j'ignore si c'est par oubli ou volontairement. « Pourquoi ceux qui sont à jeun ont-ils plus de « soif que de faim »? Disaire, résous, s'il te plaît, pour nous tous cette question. - Disaire : Tu m'interroges, Horus, sur un sujet qui mérite bien d'être traité, mais dont l'explication est évidente. L'animal est un composé de divers éléments; mais entre les éléments qui constituent le corps, il en est un qui exige seul, ou du moins beaucoup plus que les autres, l'aliment qui lui est exclusivement propre; je veux parler de la chaleur, qui réclame sans cesse qu'on lui fournisse du liquide. Hors de nous, nous ne voyons, parmi les quatre éléments, ni l'eau, ni l'air, ni la terre, porter aucune atteinte aux objets placés dans leur voisinage ou dans leur contact, pour les consommer ou pour s'en nourrir. Le feu lui seul, par un effet de sa tendance perpétuelle à s'alimenter, dévore tout ce qu'il rencontre. Considère le premier âge de l'enfance, et vois quelle quantité de nourriture il consomme, par l'effet de l'abondance du calorique. Vois, au contraire, les vieillards supporter facilement l'abstinence, parce que la chaleur, que la nourriture sert à alimenter, est chez eux presque éteinte; tandis que l'âge intermédiaire, s'il excite par beaucoup d'exercice sa chaleur naturelle, désire la nourriture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que les animaux privés de sang ne prennent aucune nourriture, à cause de l'absence de la chaleur. Si donc l'appétit contient toujours un principe de chaleur, et que le liquide soit l'aliment propre à la chaleur, il en résulte que, lorsque notre corps se trouve privé par le jeûne des objets de sa nutrition, la chaleur réclame spécialement le sien, lequel une fois obtenu restaure le corps entier, et lui permet d'attendre plus patiemment une nourriture solide. Comme Disaire eut achevé de parler, Aviénus ramassa sur la table son anneau, qui venait de tomber du petit doigt de sa main droite; et les assistants lui ayant demandé pourquoi il le mettait à une autre main et à un autre doigt qu'à celui qui est consacré à le porter, il leur montra sa main gauche enflée par suite d'une blessure. Cette circonstance fournit à Horus le sujet d'une question. - « Pourquoi, dit-il, Disaire (car la connaissance de la disposition des parties du corps appartient à la médecine : et d'ailleurs, tu possèdes cette connaissance au delà de ce qu'on exige d'un médecin), dis-moi pourquoi l'on s'est généralement accordé à porter les anneaux principalement à la main gauche, et au doigt qui est à côté du plus petit, et qu'on appelle médicinal »? - Disaire. L'explication de cette question m'était venue de chez les Égyptiens, et je doutais encore si elle était fabuleuse ou réelle, lorsque ayant consulté depuis des ouvrages anatomiques, j'ai découvert qu'effectivement un nerf parti du coeur se prolonge jusqu'au doigt de la main gauche qui est à côté du plus petit, et qu'il s'y termine en s'enlaçant dans les autres nerfs du même doigt. Voilà pourquoi les anciens voulurent que ce doigt fût entouré d'un anneau, comme d'une couronne. - Horus. Ce que tu dis de l'opinion des Égyptiens, Disaire, est si vrai, qu'ayant vu dans leurs temples leurs prêtres, qu'ils appellent prophètes, parcourir les simulacres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt d'essences odoriférantes, et leur en ayant demandé le motif, j'appris de leur premier pontife que c'était à cause du nerf dont tu viens de parler, et de plus, à cause du nombre qui est signifié par ce doigt; car étant plié, il désigne le nombre six, nombre entièrement plein, parfait et divin. Le pontife me démontra par plusieurs arguments les causes qui constituent la perfection de ce nombre. Je les passe sous silence, comme étant peu appropriés à notre conversation actuelle ; mais voilà ce que j'ai appris dans cette Égypte, dépositaire de toutes les connaissances sacrées, sur le motif qui a fait affecter l'anneau à un doigt plutôt qu'à un autre. Alors Cècina Albin, prenant la parole, dit : Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter ce que je me souviens d'avoir lu sur ce même sujet dans Atéius Capito, l'un des hommes les plus instruits du droit pontifical. Capito, après avoir établi que la religion défend de sculpter les statues des dieux avec des anneaux aux doigts, passe à l'explication du motif pour lequel on porte l'anneau à ce doigt et à cette main. « Les anciens, dit-il, portaient l'anneau autour de leur doigt, comme sceau et non comme ornement; c'est pourquoi il n'était permis d'en porter qu'un seul; et encore ce droit n'appartenait qu'aux hommes libres, à qui seuls pouvait être accordée cette confiance qu'on attache à un sceau. Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit de porter l'anneau. Soit qu'il fût de fer, soit qu'il fût d'or, l'anneau était orné de ciselures, et chacun le portait à son gré, à quelque main ou à quelque doigt que ce fût. Dans la suite, ajoute-t-il, un siècle de luxe amena l'usage d'inciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet usage devint bientôt universel; en sorte qu'il s'établit une émulation de vanité, pour élever de plus en plus le prix des pierres destinées à être ciselées. De là, il arriva que la main droite, qui agit beaucoup, fut affranchie de l'usage de porter des anneaux, usage qui fut transporté à la main gauche, laquelle reste plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence de l'usage et du mouvement de la main droite n'exposât les pierres précieuses à être brisées. De plus, ajoute encore Capito, on choisit parmi les doigts de la main gauche celui qui est à côté du petit, parce qu'il fut trouvé plus apte que les autres à recevoir la garde précieuse de l'anneau. En effet, le pouce (pollex), ainsi nommé à cause de l'influence qu'il exerce, (qui pollet), ne reste pas oisif, même à la main gauche. Il est toujours en activité de service, autant que la main tout entière; aussi est-il appelé par les Grecs ἀντίχειρ, (avant-main), comme s'il était une seconde main. Le doigt qui est placé à côté du pouce fut trouvé trop nu, puisqu'il n'est point défendu par la juxtaposition d'un autre doigt; car le pouce est placé tellement au-dessous, que c'est tout au plus s'il dépasse sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encore Capito, et le plus petit furent négligés, comme peu convenables, l'un, à cause de sa longueur, l'autre, à cause de sa courte taille, et l'on choisit celui qui est enclavé entre ces deux, et qui fait peu de service, comme étant, à cause de cela, le plus convenablement disposé pour la garde de l'anneau ». Telle est la version du droit pontifical; que chacun suive à son gré l'opinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens. Ici Horus reprenant le cours de ses interrogations : - Tu sais, Disaire, dit-il, que je ne possède rien autre chose que cet habit qui me couvre; ainsi je n'ai ni ne désire d'avoir d'esclave, mais je me rends à moi-même tous les services qui sont nécessaires à un homme vivant. Dernièrement donc, séjournant dans la ville d'Ostie, je lavai quelque peu dans la mer mon manteau sali, et je le mis sécher au soleil sur le rivage; et néanmoins, après cette ablution, les taches de ses saletés reparurent. Comme cela m'étonnait, un marin qui se trouvait là me dit : Que ne vas-tu laver ton manteau dans le fleuve, si tu veux le rendre propre? Je le fis pour éprouver la vérité de son assertion; et en effet, après l'avoir lavé dans l'eau douce et fait sécher, je vis mon manteau rendu à sa propreté naturelle. Je demande donc l'explication de ce fait, et pourquoi l'eau douce est plus propre que l'eau salée à laver les souillures? - Depuis longtemps, dit Disaire, cette question a été posée et résolue par Aristote. Il dit que l'eau marine est beaucoup plus épaisse que l'eau douce; bien plus, que l'une est féculente, tandis que l'autre est pure et légère. De là vient que l'eau de la mer soutient facilement ceux même qui ne savent pas nager, tandis que l'eau des fleuves offre peu de résistance, parce qu'elle n'est renforcée par aucun mélange étranger; elle cède tout de suite, et laisse aller à fond les fardeaux qu'elle reçoit. C'est pourquoi il conclut que l'eau douce, étant d'une nature plus légère, pénètre plus promptement dans les objets qu'elle lave, et emporte avec soi, en séchant, les taches et les saletés, tandis que l'eau de mer, étant plus épaisse, trouve dans sa densité un obstacle qui l'empêche de pénétrer facilement les objets qu'elle doit laver; et comme elle ne sèche qu'avec difficulté, elle n'entraîne avec soi que peu de saletés. - Horus paraissait satisfait de cette explication, lorsque Eusthate dit: - N'abuse point, Disaire, de la confiance de celui qui a soumis ses doutes à ta décision. Aristote, en cela comme en plusieurs autres choses, raisonne avec plus de subtilité que de justesse. La densité de l'eau nuit si peu à l'opération du lavage, que souvent, pour laver certains objets que l'eau douce pure elle-même nettoierait trop tardivement, on y mêle de la cendre, ou, à son défaut, de la terre, afin que, devenue plus crasse, elle opère plus promptement l'ablution. Ce n'est donc point son épaisseur qui rend l'eau de la mer moins propre au lavage; ce n'est pas non plus sa salure; car le propre du sel étant de séparer et d'ouvrir les pores, elledevrait au contraire nettoyer mieux ce qu'on veut laver : mais la seule cause qui rend l'eau de la mer moins propre au lavage, c'est sa qualité graisseuse, qu'Aristote lui-même a souvent reconnue, et qui est attestée d'ailleurs par la présence du sel, dans lequel personne n'ignore qu'il existe une substance grasse. Un autre indice de la qualité graisseuse de l'eau de mer, c'est que lorsqu'on en jette sur la flamme, elle l'attise au lieu de l'éteindre, parce que sa graisse fournit de l'aliment au feu. Enfin, croyons-en Homère, que la nature admit seul dans ses secrets. Quoique Nausicaa, fille d'Alcinoüs, se trouvât au bord de la mer, le poète lui fait laver ses vêtements, non dans la mer, mais dans un fleuve. Dans ce même passage, Homère nous apprend qu'il existe dans l'eau de la mer une partie graisseuse. Ulysse, parvenu à s'échapper des flots et à se sécher le corps, dit aux servantes de Nausicaa:
ἀμφίπολοι,
στῆθ᾽ οὕτω ἀπόπροθεν, ὄφρ᾽ ἐγὼ αὐτὸς « Restez à l'écart, afin que je purifie mes épaules de la salure des eaux ». Après cela, il descend dans le fleuve, et Ἐκ κεφαλῆς ἔσμηχεν ἁλὸς χνόον. « --- s'y purifie de la tète aux pieds de la souillure de la mer ». Le divin poète, qui en toute chose suit la nature, peint ici ce qui arrive à ceux qui, au sortir de la mer, s'exposent au soleil. La chaleur a bientôt desséché l'eau; mais il reste sur la surface du corps comme une espèce de fleur, dont on reconnaît la présence en se frottant : et cet effet est produit par la graisse qui se trouve dans l'eau marine, et qui seule la rend impropre au lavage.
CHAPITRE XIV. Pourquoi les objets paraissent plus grands sous l'eau, qu'ils ne le sont en effet; et en général comment s'opère la vision : est-ce par la susception d'atomes qui émanent des objets vers nos yeux, ou est-ce plutôt par une émission de rayons hors de nos yeux? Puisque tu as terminé avec les autres personnes de la société, continua Eusthate, consacre-moi donc un instant. Nous parlions tout à l'heure de l'eau. Je demande : « Pourquoi les objets paraissent plus grands dans l'eau qu'ils ne le sont effectivement »? Ainsi, chez les traiteurs, certains mets délicats nous sont présentés, qui nous semblent d'un volume plus considérable qu'ils ne sont en effet. Nous voyons, par exemple, dans des vaisseaux de verre en forme de petits tonneaux, remplis d'eau, des oeufs dont le volume paraît considérablement augmenté; des foies dont les fibres paraissent très gonflées, et des oignons dont les zones orbiculaires sont très agrandies. Enfin, les objets nous semblent alors tout différents de ce qu'ils sont réellement; c'est pourquoi certaines personnes ont là-dessus des idées fausses et hors de vraisemblance.
- Disaire : L'eau est plus
épaisse que l'air, c'est pourquoi la vue la pénètre plus lentement. Sa
résistance repousse le trait visuel, qui est brisé et se replie sur
lui-même. Ce retour ne s'effectue point en ligne directe; mais le trait
visuel rompu se replie en débordant en tout sens les contours de
l'objet; et c'est ainsi que l'image de celui-ci se représente plus
grande que son archétype. Ainsi, le disque du soleil nous apparaît le
matin plus grand qu'à l'ordinaire, parce qu'entre lui et nous se trouve
placé l'air, encore surchargé de l'humidité de la nuit, qui agrandit
l'image du soleil, comme si on la voyait dans le miroir des eaux.
- A cela Eusthate répondit en souriant : Il est facile d'apercevoir ce qui a trompé Épicure. En effet, il s'est écarté de la vérité, en se réglant sur l'analogie des quatre autres sens. Car, dans l'ouïe, dans le goût, dans l'odorat, dans le toucher, rien n'émane de nous; mais nous recevons du dehors ce qui provoque l'exercice de chacun de ces sens. Ainsi, la voix entre dans les oreilles; l'air coule dans les narines; c'est ce que nous faisons entrer dans le palais, qui engendre les saveurs; et c'est en appliquant les objets contre notre corps qu'ils deviennent sensibles au tact. C'est par analogie qu'Épicure a pensé qu'il ne s'échappe rien de nos yeux, mais que l'image des objets vient s'y placer spontanément. Cette opinion est contredite par l'expérience du miroir, qui représente à celui qui s'y regarde son image tournée vers lui, tandis qu'elle devrait, si elle émanait de nous en ligne directe, nous montrer en s'échappant sa partie postérieure; en sorte que la gauche et la droite de l'image se trouvassent placées dans le même sens que la gauche et la droite du corps réel. C'est ainsi que l'histrion qui s'ôte le masque le voit du côté qui lui couvrait le visage; c'est-à-dire, par le creux du revers et non par la face. D'ailleurs, je voudrais demander à Épicure si les images ne se détachent des objets que lorsque quelqu'un a la volonté de voir, ou si, lorsque personne ne les considère, les atomes continuent d'en émaner en tout sens. S'il soutient le premier système, je demande quel pouvoir commande aux atomes de se tenir prêts à obéir à celui qui regarde, et de se déplacer autant de fois qu'il voudra mouvoir son visage. S'il s'en tient au second, et qu'il dise qu'il émane de tous les objets un flux perpétuel d'atomes, je demanderai combien de temps ils demeurent adhérents à nos yeux, auxquels rien ne les retient liés? Ou si j'accorde leur adhérence, comment transmettront-ils les couleurs, lesquelles, bien qu'incorporelles de leur nature, ne peuvent néanmoins jamais exister sans corps. D'ailleurs, qui peut concevoir qu'aussitôt que vous tournez vos yeux, accourent les images du ciel, de la mer, de son rivage, des prés, des vaisseaux, des troupeaux, et de ces innombrables objets que nous apercevons d'un coup d'oeil, surtout lorsque c'est dans le très petit espace de notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et de quelle manière s'effectue la vision d'une armée? Est-ce que les atomes, sortis de chaque soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par milliers, pénètrent dans l'œil de celui qui regarde? Mais pourquoi prendre la peine de discourir, afin de détruire une opinion qui se réfute elle-même par sa propre futilité? Or, il est certain que c'est par le mécanisme suivant que s'opère en nous la vision. Un trait de lumière s'échappe en ligne directe de nos deux prunelles, de quelque côté qu'on les tourne. Si cette émanation naturelle de l'oeil rencontre la lumière dans l'air qui est autour de nous, elle lui sert de conduit direct, jusqu'à ce qu'elle ait rencontré un corps ; quoique l'on tourne le visage pour regarder autour de soi, le rayon visuel s'échappe toujours directement. Ce trait, que nous avons dit parti de nos yeux, après avoir été délié à sa racine, s'élargit vers son extrémité, en la manière que les peintres représentent les rayons. C'est pour cela qu'un oeil qui regarde par un très petit trou embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc, trois choses nous sont nécessaires pour opérer la vision : qu'un trait de lumière émane de nous, que l'air qu'il trouve sur son passage soit éclairé, et que le rayon rencontre un corps dont le choc arrête son cours; car s'il le prolonge trop longtemps, ce cours cesse d'être direct, le trait se fatigue, il se déchire et se déverse à droite et à gauche. De là vient qu'en quelque endroit de la terre qu'on se trouve, on croit apercevoir les bornes du ciel, et c'est là ce que les anciens nommèrent horizon. Leurs observations ont constaté avec exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas horizontalement au delà de cent quatre-vingts stades, et qu'à cette distance il commence à se diviser en lignes courbes. J'ai dit horizontalement, car notre vue atteint très loin en hauteur, puisque nous voyons le ciel. Celui qui regarde est toujours placé au centre du cercle que forme son horizon; et, d'après la mesure que nous avons donnée de la longueur du rayon visuel, depuis le centre jusqu'à la circonférence du cercle, il résulte évidemment que le diamètre du cercle horizontal est de trois cent soixante stades; et, soit qu'il avance, soit qu'il recule, l'oeil découvrira toujours autour de soi un cercle de cette même grandeur. Ainsi donc, comme nous l'avons dit, lorsque le rayon qui émane de nous traverse un air éclairé et vient frapper un corps, le phénomène de la vision est opéré; et afin que l'objet vu soit connu de nous, le sens de la vue instruit notre intelligence de sa forme extérieure, et l'intelligence le reconnaît à l'aide de la mémoire; par conséquent les yeux voient, l'intelligence juge, la mémoire se souvient. Trois agents sont nécessaires pour compléter par la vue la connaissance de la forme d'un objet ; le sens, l'intelligence, la mémoire : le sens transmet à l'intelligence l'objet vu, et celle-ci reconnaît par le souvenir quel il est. La coopération du raisonnement est tellement nécessaire dans l'acte de la vision, que souvent, par ce sens seul, l'intelligence nous fait reconnaître une autre sensation que la mémoire nous suggère. Car si j'aperçois du feu, ma raison sait, avant que je l'aie touché, qu'il est chaud. Si c'est de la neige que j'aperçois, ma raison sait aussitôt que son contact est froid. En l'absence de la raison, la vue est inefficace; tellement que si l'on néglige de la consulter, une rame vue dans l'eau paraît rompue, ou une tour anguleuse paraît ronde, étant vue de loin. Mais si la raison veut s'y appliquer, elle reconnaît les angles de la tour et l'intégrité de la rame. En un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui ont fourni à la secte des académiciens des prétextes pour condamner le témoignage des sens. Le témoignage d'un seul sens, accompagné du raisonnement, peut être compté parmi les choses les plus certaines; mais le témoignage d'un seul sens ne suffit pas toujours à la raison, pour reconnaître la nature des objets. Car si j'aperçois de loin la figure de ce fruit qu'on appelle pomme, il n'est pas certain, sous tous les rapports, que ce soit là une pomme; car on aura pu en former la figure avec quelque matière. Il faut donc invoquer un autre sens, pour décider l'odeur de l'objet; mais cet objet, placé au sein d'un tas de pommes, aura pu en retenir leur exhalaison; il faudra donc consulter le tact, qui peut juger de son poids : mais on peut craindre que le poids ne nous trompe à son tour, si l'ouvrier a eu l'artifice de choisir une matière dont le poids fût pareil à celui du fruit ; il faut donc recourir au goût; et s'il est d'accord avec la forme, il n'y a plus de doute que l'objet ne soit une pomme. C'est ainsi qu'il est démontré que l'efficacité des sens dépend du raisonnement; et c'est pourquoi le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens dans la tête, c'est-à-dire, autour du siège de la raison.
CHAPITRE XV. Si Platon est exact lorsqu'il écrit que la nourriture se rend dans l'estomac, et que la boisson coule dans les vaisseaux du poumon par l'artère appelée trachée. Quand Disaire eut ainsi, parlé, il s'éleva touchant la solidité de ses raisonnements, un murmure universel d'approbation qu'Évangélus lui-même ne rougit point de partager; après quoi, Disaire reprit en ces termes : - Ce sont des applaudissements semblables qui ont provoqué la philosophie à usurper la discussion d'un art qui lui est étranger, ce qui a donné lieu plus d'une fois à de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s'est livré à la risée de la postérité, en voulant toucher à l'anatomie, qui est une branche de la médecine. Il dit en effet que la nourriture et la boisson que nous consommons rencontrent deux voies; que la nourriture se rend dans l'estomac, et que la boisson coule dans les vaisseaux des poumons, par l'artère appelée trachée. Il faut s'étonner, ou plutôt s'affliger, qu'un si grand homme ait pu penser et rapporter dans ses ouvrages de pareilles choses. Aussi Erasistrate, médecin très distingué de l'antiquité, l'attaque avec justice, en disant qu'il avance là des faits très différents de ceux que l'observation nous enseigne. En effet, il existe deux tuyaux, pareils à des canaux, qui partent du fond de la bouche et descendent en bas. Par l'un, sont transmises et précipitées dans l'estomac toutes les matières qui composent, tant la nourriture que la boisson : elles sont portées de là dans un ventricule que les Grecs appellent le ventre inférieur, où elles sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la plus aride du résidu de ces matières se rend dans l'intestin appelé en grec κόλον (colon), tandis que la partie humide coule à travers les reins dans la vessie. Par le second des deux premiers tuyaux dont nous avons parlé, appelé par les Grecs τραχεῖα ἀρτηρία (trachée-artère), l'air descend de la bouche dans le poumon, et retourne de là dans la bouche et dans les narines. C'est par ce même canal que passe la voix. Afin d'empêcher que la boisson et la nourriture non liquide, qui doit aller dans l'estomac, ne vienne tomber de la bouche dans ce tuyau où l'air est respiré, et que sa présence n'aille encombrer le canal de la respiration, la nature a eu soin de placer ingénieusement, entre les deux canaux disposés l'un à côté de l'autre, l'épiglotte, qui leur sert réciproquement de cloison. Pendant qu'on mange et qu'on boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachée-artère, et empêche qu'aucune portion de la nourriture ou de la boisson ne tombe dans le canal, toujours en activité, de la respiration. Il résulte de là qu'aucune partie liquide ne coule dans le poumon, qui est protégé par la disposition de l'orifice de l'artère. Tel est le système d'Érasistrate, conforme, je pense, à la vérité. En effet, la nourriture ne doit point parvenir dans le ventre sous forme de parties sèches et indigestes, mais amollie et réduite sous forme liquide. Il faut donc que la même voie soit ouverte à la nourriture et à la boisson, afin que la première, modifiée par l'autre, puisse en cet état être transmise au ventre par l'estomac. Sans cette condition, la nature ne saurait produire ce qui est nécessaire à la conservation de la vie animale. D'ailleurs, le poumon offrant une forme solide et polie, si un corps dense était entraîné vers lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être transmis au lieu où s'opère la digestion; tandis que nous voyons que, si par hasard quelque chose, tant soit peu dense, tombe dans le poumon, entraîné par la force de la respiration, il s'ensuit aussitôt une toux violente et des secousses qui peuvent aller jusqu'à altérer la santé. Or, si une voie naturelle conduisait la boisson au poumon, il ne devrait pas redouter les liquides épaissis par des farines, par des graines, ou par toute autre matière dense. Pour quelle fonction la nature a-t-elle disposé l'épiglotte, qui bouche l'artère lorsque nous avalons la nourriture, si ce n'est pour empêcher que par le canal de celle-ci il ne tombât quelque portion de cette dernière dans le poumon, par l'effet de l'attraction irrégulière de l'aspiration? Lorsque nous voulons émettre la parole, l'épiglotte s'incline d'un autre côté pour fermer la route de l'estomac, et laisser à la voix un libre passage dans l'artère. Un résultat constaté par l'expérience, c'est que ceux qui avalent peu à peu la boisson en ont les intestins plus humectés, parce que le liquide, ainsi bu lentement, y fait un plus long séjour; tandis que, si l'on boit avec avidité, le liquide passe dans la vessie avec la même précipitation qu'il a été avalé; et la nourriture restant dans un état très sec, il en résulte une digestion plus tardive. Or cette différence n'existerait point, si, dès le principe, la nourriture et la boisson avaient suivi des routes différentes. Quant à ce qu'a dit le poète Alcée, et qu'on répète vulgairement: Οἴνῳ πνεύμονα τέγγε, τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται, « Arrose ton poumon de vin, car la canicule opère sa révolution »; cela doit s'entendre du bien-être que l'humectation occasionne au poumon, mais en tant qu'il n'attire du liquide qu'à proportion de son besoin. Tu vois maintenant que le prince des philosophes eût fait sagement de s'abstenir de parler de choses qui lui étaient étrangères, plutôt que de traiter des sujets qui lui étaient trop peu connus. Eusthate un peu ému répliqua en ces termes: - Disaire, je te comptais autant parmi les philosophes que parmi les médecins; cependant, tu m'as paru tout à l'heure oublier une chose généralement crue et proclamée par le consentement universel de tous les hommes: c'est que la philosophie est l'art des arts et la science des sciences; et voilà que, par une audace parricide, la médecine se déchaîne contre elle. Toutefois, la partie rationnelle, c'est-à-dire celle qui traite des objets incorporels, n'est que la portion la plus étroite du domaine de la philosophie; tandis qu'elle s'étend principalement vers la physique, laquelle traite des corps divins, soit du ciel soit des astres. Quant à la médecine, elle n'est que la partie la plus grossière de la physique; elle ne raisonne que sur des corps terrestres et pétris de limon. Mais que parlé-je de raisonnement, dans un art où les conjectures dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science qui consiste à former des conjectures sur une chair de boue ose s'égaler à la philosophie, qui, d'après des raisonnements certains, traite d'objets incorporels et véritablement divins. Mais pour que cette défense générale ne paraisse point un subterfuge, afin d'éluder ce qui concerne le poumon, écoute les motifs qui ont déterminé l'opinion du sublime Platon. L'épiglotte, dont tu as parlé, a été disposée par la nature pour ouvrir et fermer, par une alternative régulière, les deux conduits de la nourriture et de la boisson; de manière que la première soit transmise à l'estomac, et que le poumon reçoive ta seconde par les nombreux canaux qui traversent le poumon. Les ouvertures qui s'y rencontrent ne sont pas destinées à permettre la sortie du souffle, pour lequel une exhalation occulte eût été suffisante, mais à laisser, dans le cas où quelque portion de la nourriture viendrait à tomber dans le poumon, un passage au suc qui en résulte, afin qu'il puisse se rendre au siège de la digestion. Si, par quelque accident, l'artère vient à être coupée, nous n'avalons plus la boisson; car son canal se trouvant percé, elle s'échappe au dehors, sans arriver à l'estomac : ce qui n'aurait pas lieu, si l'artère n'était le canal des liquides. Voici encore qui prouve évidemment ce fait c'est que ceux qui ont le poumon malade éprouvent une ardente soif, ce qui n'arriverait pas non plus, si le poumon n'était le réceptacle de la boisson. Remarquez aussi que les animaux qui n'ont point de poumon ne connaissent pas la soif; et en effet, il n'y a rien de superflu dans la nature, mais elle a prédestiné chaque membre à quelqu'une des fonctions de la vie. Lors donc que l'un d'eux manque, c'est que ses fonctions seraient superflues. Réfléchis encore que, si l'estomac recevait la boisson et la nourriture, les fonctions de la vessie deviendraient inutiles; car l'estomac aurait pu livrer aux intestins le résidu de chacune d'elles, taudis qu'il se borne à livrer celui de la nourriture; et il ne serait pas besoin de divers conduits pour donner passage à chacune de ces deux substances, mais un seul suffirait à toutes deux, pour les évacuer du même lieu. Au lieu de cela, la vessie et les intestins coopèrent, chacun séparément, à l'entretien de notre organisation : la première, en évacuant le poumon; la seconde, en évacuant l'estomac. Il ne faut pas non plus négliger de remarquer qu'on ne trouve dans l'urine, qui est le résidu de la boisson, aucun vestige de la nourriture, et même qu'elle n'est nullement empreinte de la couleur ou de l'odeur de cette dernière. Si cependant celle-ci eût été mêlée dans le ventre avec la boisson, l'urine conserverait quelque impression de la substance de leur commun excrément. Enfin, les pierres que la boisson produit dans la vessie, et que la boisson seule a la propriété de former, pourquoi ne se forment-elles jamais dans le ventre? ce qui devrait être cependant, s'il était le réceptacle de la boisson. Le fait de l'écoulement de la boisson dans le poumon n'a pas été ignoré de plusieurs poètes distingués. Eupolis, dans la pièce intitulée les Parasites, dit:
— Πίνειν « Protagoras prescrivait de boire à l'époque de la canicule, afin de se tenir le poumon humecté ». Nous trouvons dans Ératosthène un témoignage semblable : Καὶ βαθὺν ἀκρήτῳ πνεύμονα τεγγόμενος. « Inondant son poumon de vin ». Euripide vient encore manifestement à l'appui de ce même fait: Οὶνος περάσας πλευμόνων διαῤῥοάς. « Le vin parcourant les canaux du poumon ».
Puis donc que le système de
l'organisation de notre corps et l'autorité des plus illustres témoins
viennent appuyer celle de Platon y n'est-il pas absurde de penser le
contraire? CHAPITRE XVI. Si l'œuf a été avant la poule, ou la poule avant l'oeuf. Sur ces entrefaites, Évangélus, qui voyait avec envie la gloire qu'obtenaient les deux Grecs, leur dit en se moquant : Quittez ces questions, que vous n'agitez entre vous que pour faire parade de votre loquacité. J'aimerais mieux encore, si votre science y peut quelque chose, que vous voulussiez m'apprendre « si l'oeuf a été avant la poule, ou la poule avant l'oeuf »? - Tu crois te moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la question que tu viens de toucher est très digne d'être approfondie et résolue. Car pourquoi m'as-tu demandé, en critiquant l'utilité de cette discussion, si l'oeuf a été avant la poule, ou la poule avant l'oeuf? Mais sache que cette question doit être rangée parmi les plus sérieuses, et discutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui me paraîtra susceptible d'être allégué en faveur de chacune des deux opinions, te laissant le choix de celle qui te paraîtra la plus vraie. Si nous accordons que tout ce qui existe a eu un commencement, il est juste de décider que la nature a commencé par produire l'oeuf. Car tout ce qui commence est d'abord informe, imparfait, et ne marche vers son perfectionnement qu'à l'aide du temps et de l'art. Ainsi donc, pour faire l'oiseau, la nature a commencé par un rudiment informe; elle a produit l'oeuf, dans lequel n'existe pas encore la forme extérieure de l'animal, mais dont est provenu un oiseau complètement organisé, par l'effet de l'accomplissement de son développement progressif. D'ailleurs, tout ce que la nature a décoré d'ornements divers a commencé indubitablement par être simple, et est devenu postérieurement compliqué, par l'accession de choses qui y ont été réunies. Ainsi l'oeuf a été créé d'une forme simple, et qui est la même dans tous les sens. Il est le germe d'où se sont développés les ornements divers qui complètent le corps de l'oiseau. De même que les éléments ont d'abord préexisté, et que de leur mélange ont été formés les autres corps, de même, si l'on peut permettre la comparaison, les principes séminaux qui se, trouvent dans l'oeuf peuvent être considérés, en quelque sorte, comme étant les éléments de la poule. Non, elle n'est pas inopportune la comparaison de l'oeuf avec les éléments dont toutes les choses sont composées ; car, dans toutes les classes d'animaux qui se reproduisent par le coït, vous en trouverez quelques-uns dont l'oeuf est le principe et comme l'élément. En effet, tous les animaux ou marchent, ou rampent, ou nagent, ou volent. Parmi ceux qui marchent, les lézards et tous les animaux de cette famille sont reproduits par des oeufs. Il en est de même des reptiles. Tous les animaux qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont la condition est incertaine : car la chauve-souris vole, il est vrai, au moyen d'ailes formées de pellicules, mais ne doit pas être comptée parmi les oiseaux, puisqu'elle marche sur quatre pieds, qu'elle met au monde ses petits entièrement conformés, et qu'elle les allaite. Tous les animaux nageants sortent d'un oeuf particulier à leur espèce, excepté le crocodile, qui, comme les oiseaux, provient d'un oeuf à écaille. Et pour que je ne te paraisse pas avoir trop relevé la condition de l'oeuf, en le nommant un, élément, consulte les initiés aux mystères de Liber Pater, dans lesquels l'oeuf n'est honoré avec tant de vénération qu'en raison de sa forme ovale et presque sphérique, qui ne présente d'ouverture en aucun sens et parce qu'il renferme en soi la vie, on l'appelle le symbole du monde. Or, d'après l'opinion unanime, le monde est le principe de toutes choses. Maintenant, produisons l'opinion qui soutient la préexistence de la poule; et voici comment nous tâcherons de la défendre. L'oeuf n'est ni le commencement ni la fin de l'animal; car son commencement est la semence, sa fin est l'oiseau développé. L'oeuf n'est donc que la digestion de la semence. Or, puisque la semence contient l'animal et que l'oeuf contient la semence, l'oeuf n'a pu être avant l'animal; de même que la digestion de la nourriture ne peut avoir lieu sans que quelqu'un ait mangé. Dire que l'oeuf a été fait avant la poule, c'est comme si l'on disait que la matrice a été faite avant la femme; et celui qui demande comment la poule a pu venir sans oeuf est semblable à celui qui demanderait comment l'homme a pu être créé avant les parties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi comme il ne serait pas exact de dire que l'homme est le produit de la semence, puisque la semence émane de l'homme; de même on ne peut pas dire que la poule est le produit de l'oeuf, puisque l'oeuf émane de la poule. Maintenant, si l'on accorde ce qui a été dit en faveur de la thèse opposée, que tout ce qui existe a commencé à quelque époque, nous répondrons que la nature a commencé d'abord par former chacun des animaux dans toute sa perfection, et qu'ensuite elle a soumis à des lois perpétuelles la succession continue de leur procréation. Un grand nombre d'animaux que la terre et la pluie produisent encore, tout conformés, sont une preuve que la nature a bien pu en agir ainsi dès le commencement. Tels sont les rats en Égypte, et en d'autres lieux les grenouilles, les serpents, et autres animaux de cette espèce. Car la terre ne produit jamais des oeufs, qui sont des êtres absolument imparfaits, parce que la nature ne forme que des êtres parfaits, et qui procèdent de principes parfaits, d'un tout, dont ils sont les parties. Accordons maintenant que l'oeuf est la semence de l'oiseau, et voyons ce que nous apprend la définition que les philosophes ont donnée de la semence. Cette définition établit que la semence est une production d'une substance pareille à la substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut pas exister de similitude avec une chose qui n'est pas encore; de même qu'il n'émane pas de semence de celui qui n'existe pas. Concluons de là que, dès la première origine des choses, et à l'exemple des autres animaux qui sont reproduits seulement par la semence, et dont on n'a pas mis en question la préexistence à leur semence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis complètement formés des mains de la nature. Chaque animal ayant été doté de la puissance de se reproduire, tous les animaux sont descendus des premiers, suivant les divers modes de naissance, que la nature a diversifiés selon la variété des espèces. Voilà, Évangelus, ce qu'on peut alléguer des deux côtés. Contiens un peu tes dérisions, et considère en toi-même lequel tu dois embrasser. Évangélus. - Puisque la force de la conversation nous entraîne de la plaisanterie au sérieux, je veux que vous m'expliquiez ceci, dont la solution exacte m'a longtemps exercé. Dernièrement des chasseurs ont relancé des sangliers de la forêt de mon domaine de Tibur ; et comme la chasse se prolongea assez longtemps, les uns me furent apportés durant le jour, et les autres pendant la nuit. La chair de ceux qu'on apporta de jour se conserva parfaitement saine; tandis que ceux qu'on apporta de nuit, la lune étant dans son plein, se putréfièrent : ce qui ayant été observé, les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit suivante enfoncèrent des pointes d'airain dans chacune des parties de leur corps, et surent par ce moyen nous conserver leur chair parfaitement saine. Je demande donc pourquoi la lumière de la lune a produit sur les corps de ces animaux un effet pernicieux, que n'ont pas produit les rayons du soleil. - La réponse est simple et facile, dit Disaire. Rien ne se corrompt que par le concours simultané de l'humidité et de la chaleur. La putréfaction des corps des animaux n'est autre chose qu'un écoulement latent qui convertit en liquide les chairs solides. Si la chaleur est médiocre et tempérée, elle entretient l'humidité; si au contraire elle est forte, elle dessèche et réduit le volume des chairs. Ainsi, le soleil, par sa grande chaleur, épuise l'humidité des corps morts, tandis que la lumière de la lune, dont la chaleur est insensible, mais qui renferme une tiédeur cachée, accroît la liquéfaction des parties humides, et produit ainsi la putréfaction, en injectant la tiédeur et en augmentant l'humidité. - Après ce discours, Évangélus, s'adressant à Eustathe, lui dit : Si tu accèdes à cette explication, tu dois le témoigner; ou si elle te répugne en quelque chose, tu ne dois pas négliger de nous en faire part, car vos discours ont eu la puissance de vous faire écouter volontiers par moi. - Tout ce qu'a dit Disaire, répondit Eustathe, est lumineux et vrai : mais il faut examiner brièvement si le degré de la chaleur est réellement la cause de la putréfaction; en sorte qu'on puisse dire qu'une grande chaleur ne la produit point, mais qu'elle est produite par une chaleur légère et modérée. Or, la chaleur du soleil, qui n'est jamais plus ardente durant l'année qu'à l'époque de l'été, et qui s'attiédit pendant l'hiver, putréfie cependant les chairs pendant l'été et non pendant l'hiver. Ce n'est donc pas à cause de la douce température de sa chaleur, que la lune augmente la liquéfaction des substances humides; mais il est dans la nature de la lumière qui émane de cet astre, je ne sais quelle propriété que les Grecs appellent idiotique, laquelle humecte les corps, et les baigne, pour ainsi dire, d'une imperceptible rosée, et qui, jointe à la chaleur propre à la lune, putréfie les chairs qu'elle a pénétrées un instant. En effet, toute chaleur n'est pas d'une quantité uniforme, en sorte qu'elle ne varie que du plus au moins; mais il est démontré, par des expériences évidentes, qu'il est des qualités de feu très diverses qui n'ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfèvres n'emploient, pour travailler l'or, que du feu de paille, parce que tout autre serait impropre à fondre ce métal. Les médecins emploient le feu du sarment, préférablement à celui de tout autre bois, pour faire cuire les remèdes. Ceux qui fondent ou coulent le verre alimentent leur fourneau avec l'arbre appelé bruyère. La chaleur produite par le bois de l'olivier est salutaire aux corps, mais elle est nuisible dans les bains, et d'ailleurs elle a beaucoup d'efficacité pour séparer les jointures du marbre. Il n'est donc pas étrange qu'en raison des propriétés particulières à chaque sorte de chaleur, celle du soleil dessèche, tandis que celle de la lune humecte. Voilà pourquoi les nourrices couvrent soigneusement leurs nourrissons lorsqu'elles passent sous les rayons de la lune, de crainte que sa lumière n'augmente l'humidité naturelle qui abonde à cet âge, et qu'à l'exemple du bois vert, que la chaleur fait contourner parce qu'il contient encore des sucs humides, cet accroissement d'humidité ne fasse contourner les membres des enfants. L'on sait aussi que celui qui s'endort pendant longtemps au clair de la lune s'éveille péniblement et comme hébété, oppressé sous le poids de la substance humide que la lumière de la lune a la propriété de disperser et de répandre dans le corps, dont elle ouvre et relâche tous les conduits, en pénétrant dans son intérieur. De là vient que Diane, qui est la même que la lune, est appelée Artémis, mot formé d'ἀερότεμις,, c'est-à-dire qui fend l'air. Elle est invoquée sous le nom de Lucine par les femmes en travail d'enfant, parce qu'elle a la propriété spéciale de distendre les ouvertures du corps et d'ouvrir les voies aux écoulements, ce qui est favorable à accélérer les accouchements. C'est ce que le poète Timothée a élégamment exprimé en ces termes:
Διὰ
λαμπρὸν πόλον ἄστρων « Par le ciel où brillent les astres, par la lune qui facilite les accouchements ». L'action de la lune ne se fait pas moins sentir à l'égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres coupés pendant la lune pleine ou même croissante sont impropres aux constructions, comme ayant été ramollis par l'influence de l'humidité. Les agriculteurs ont soin de ne ramasser le froment sur l'aire que pendant la lune décroissante, afin qu'il se conserve sec. Faites au contraire, pendant la lune croissante, les choses pour lesquelles vous désirez de l'humidité. C'est alors qu'il conviendra de planter les arbres, surtout pendant que la lune éclaire la terre; parce que l'humidité est un aliment nécessaire à la croissance des racines. L'air éprouve aussi et manifeste les effets de l'humidité lunaire; car lorsque la lune est dans son plein, lorsqu'elle est naissante (et dans ce dernier cas elle est pleine dans sa partie supérieure), l'air, ou se résout en pluie, ou, s'il reste serein, produit beaucoup de rosée. C'est pourquoi le poète lyrique Alcman dit « que la rosée est fille de l'air et de la lune ». Ainsi il est prouvé de toute manière que la lumière de la lune possède la propriété d'humecter et de dissoudre les chairs, ce que l'expérience démontre encore mieux que le raisonnement. Quant à ce que tu as dit, Évangélus, concernant l'aiguille d'airain, voici ma conjecture, qui, si je ne me trompe, ne s'écarte point de la vérité. Il y a dans le cuivre une vertu âcre, que les médecins appellent stiptique : c'est pourquoi ils usent de ses écaillures dans des remèdes qu'ils emploient contre les ravages de la pourriture: En second lieu; ceux qui vivent dans des mines de cuivre ont toujours les yeux dans un excellent état de santé; et leurs paupières s'y regarnissent de poils, s'ils les avaient perdus auparavant. C'est que l'exhalaison qui émane du cuivre, entrant dans les yeux, épuise et dessèche les humeurs pernicieuses. Homère, en se rapportant à ces effets, donne au cuivre les épithètes de fortifiant et éclatant. C'est Aristote qui a découvert que les blessures faites avec une pointe de cuivre sont moins dangereuses que celles qui sont faites avec une pointe de fer, et se guérissent plus facilement; parce qu'il y a, dit-il, dans le cuivre une vertu médicinale et desséchante, qu'il dépose dans la blessure. C'est par la même raison qu'une pointe d'airain, enfoncée dans le corps d'un animal, le préserve de l'humidité lunaire.
|