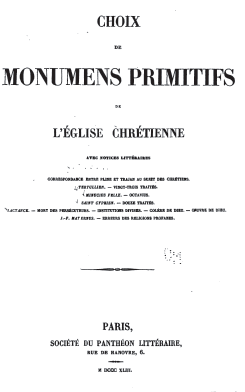
LACTANCE - LUCIUS CAECILIUS FIRMIANUS LACTANTIUS
INSTITUTIONS DIVINES - DIVINAE INSTITUTIONES
LIVRE II
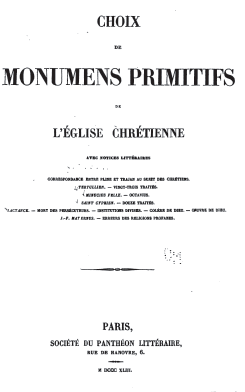
LIVRE II
LUCIUS CAECILIUS FIRMIANUS LACTANTIUS
DIVINAE INSTITUTIONES
|
LIBER SECUNDUS. DE ORIGINE ERRORIS. CAPUT PRIMUM. Quod rationis oblivio faciat homines ignorantes veri Dei, qui colitur in adversis, et in prosperis contemnitur. Quamquam primo libro religiones deorum falsas esse monstraverim; quod ii, quorum varios dissimilesque cultus per universam terram consensus hominum stulta persuasione suscepit, mortales fuerint, functique vita, divinae necessitati morte concesserint; tamen ne qua dubitatio relinquatur, hic secundus liber fontem ipsum patefaciet errorum, causasque omnes explicabit, quibus decepti homines, et primitus deos esse crediderint, et postmodum inveterata persuasione in susceptis pravissime Religionibus perseveraverint. Gestio enim, Constantine Imperator, convictis inanibus, et hominum impia vanitate detecta, singularis Dei asserere majestatem, suscipiens utilius et majus officium revocandi homines a pravis itineribus, et in gratiam secum ipsos reducendi, ne se (ut quidam philosophi faciunt) tantopere despiciant, neve se infirmos, et supervacuos, et nihil, et frustra omnino natos putent. Quae opinio plerosque ad vitia compellit. Nam dum existimant, nulli Deo nos esse curae, aut post mortem nihil futuros, totos se libidinibus addicunt, et dum licere sibi putant, hauriendis voluptatibus sitienter incumbunt, per quas imprudentes in laqueos mortis incurrunt; ignorant enim quae sit hominis ratio. Quam si tenere vellent, in primis Dominum suum agnoscerent, virtutem justitiamque sequerentur, terrenis figmentis animas suas non substernerent, mortiferas libidinum suavitates non appeterent: denique seipsos magni aestimarent, atque intelligerent plus esse in homine, quam videtur, cujus vim conditionemque non aliter possent retinere, nisi cultum veri parentis sui, deposita pravitate, susceperint. Equidem, sicut oportet, de summa rerum saepenumero cogitans, admirari soleo majestatem Dei singularis, quae continet regitque omnia, in tantam venisse oblivionem, ut quae sola coli debeat, sola potissimum negligatur; homines autem ipsos ad tantam caecitatem esse deductos ut vero ac vivo Deo mortuos praeferant, terrenos autem sepultosque in terra ei qui fundator ipsius terrae fuit.
Et tamen huic impietati hominum posset
venia concedi, si omnino ab ignorantia divini nominis veniret hic
error. Cum vero ipsos deorum cultores saepe videamus Deum summum et
confiteri et praedicare, quam sibi veniam sperare possunt impietatis
suae? qui non agnoscunt cultum ejus, quem prorsus ignorari ab homine
fas non est. Nam et cum jurant, et cum optant, et cum gratias agunt,
non Jovem aut deos multos, sed Deum nominant: adeo ipsa veritas,
cogente natura, etiam ab invitis pectoribus erumpit; quod quidem non
faciunt in prosperis rebus. Nam tum maxime Deus ex memoria hominum
elabitur, cum beneficiis ejus fruentes, honorem dare divinae
indulgentiae debent. At vero si qua necessitas gravis presserit,
tunc Deum recordantur. Si belli terror infremuerit, si morborum
pestifera vis incubuerit, si alimenta frugibus longa siccitas
denegaverit, si saeva tempestas, si grando ingruerit, ad Deum
confugitur, a Deo petitur auxilium, Deus, ut subveniat, oratur. Si
quis in mari, vento saeviente, jactatur, hunc invocat. Si quis
aliqua vi afflictatur, hunc potius implorat. Si quis ad extremam
mendicandi necessitatem deductus, victum precibus exposcit, Deum
solum obtestatur, et per ejus divinum atque unicum nomen hominum
sibi misericordiam quaerit. Numquam igitur Dei meminerunt, nisi dum
in malis sunt. Postquam metus deseruit et pericula recesserunt, tum
vero alacres ad deorum templa concurrunt; his libant, his
sacrificant, hos coronant. Deo autem, quem in ipsa necessitate
imploraverant, ne verbo quidem gratias agunt: adeo ex rerum
prosperitate luxuria, ex luxuria vero, ut vitia omnia, sic impietas
adversus Deum nascitur.
Pronaque cum spectent animalia caetera
terram; Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus. Hinc utique ἀνθρώπον Graeci appellarunt, quod sursum spectet. Ipsi ergo sibi renuntiant, seque hominum nomine abdicant, qui non sursum aspiciunt, sed deorsum: nisi forte id ipsum, quod recti sumus, sine causa homini attributum putant. Spectare nos coelum Deus voluit, utique non frustra. Nam et aves, et ex mutis pene omnia coelum vident; sed nobis proprie datum est, coelum rigidis ac stantibus intueri, ut religionem ibi quaeramus, ut Deum, cujus sedes illa, quoniam oculis non possumus, animo contemplemur: quod profecto non facit, qui aes, aut lapidem, quae sunt terrena, veneratur. Est autem pravissimum, cum ratio corporis recta sit, quod est temporale, ipsum vero animum, qui sit aeternus, humilem fieri; cum figura et status nihil aliud significent, nisi mentem hominis eo spectare oportere, quo vultum et animum tam rectum esse debere, quam corpus, ut id, cui dominari debet, imitetur. Verum homines, et nominis sui, et rationis obliti, oculos suos ab alto dejiciunt, soloque defigunt, atque timent opera digitorum suorum, quasi vero quidquam esse possit artifice suo majus. CAPUT II. Quae fuerit prima causa fingendi simulacra; de vera Dei imagine, et ejus vero cultu. Quae igitur amentia est, aut ea fingere quae ipsi postmodum timeant, aut timere quae finxerint? Non ipsa, inquiunt, timemus, sed eos, ad quorum imaginem ficta, et quorum nominibus consecrata sunt. Nempe ideo timetis, quod eos esse in coelo arbitramini: neque enim, si dii sunt, aliter fieri potest. Cur igitur oculos in coelum non tollitis; et advocatis eorum nominibus, in aperto sacrificia celebratis? Cur ad parietes, et ligna, et lapides potissimum, quam illo spectatis, ubi eos esse creditis? Quid sibi templa? quid arae volunt? quid denique ipsa simulacra, quae aut mortuorum aut absentium monimenta sunt? Nam omnino fingendarum similitudinum ratio idcirco ab hominibus inventa est, ut posset eorum memoria retineri, qui vel morte subtracti, vel absentia fuerant separati. Deos igitur in quorum numero reponemus? Si in mortuorum, quis tam stultus ut colat? Si in absentium, colendi ergo non sunt, si nec vident quae facimus, nec audiunt quae precamur. Si autem dii absentes esse non possunt, qui quoniam divini sunt, in quacumque mundi parte fuerint, vident et audiunt universa; supervacua ergo sunt simulacra, illis ubique praesentibus, cum satis sit audientium nomina precibus advocare. At enim praesentes non nisi ad imagines suas adsunt. Ita plane; quemadmodum vulgus existimat, mortuorum animas circa tumulos et corporum suorum reliquias oberrare. Sed tamen postquam deus ille praesto esse coepit, jam simulacro ejus opus non est. Quaero enim, si quis imaginem hominis peraegre constituti contempletur saepius, ut ex ea solatium capiat absentis, num idem sanus esse videatur, si, eo reverso atque praesente, in contemplanda imagine perseveret, eaque potius, quam ipsius hominis aspectu frui velit? Minime profecto. Etenim hominis imago necessaria tum videtur, cum procul abest; supervacua futura, cum praesto est: Dei autem, cujus spiritus ac numen ubique diffusum, abesse numquam potest, semper utique imago supervacua est. Sed verentur, ne omnis eorum religio inanis sit et vana, si nihil in praesenti videant quod adorent, et ideo simulacra constituunt, quae quia mortuorum sunt imagines, similia mortuis sunt; omni enim sensu carent. Dei autem in aeternum viventis vivum et sensibile debet esse simulacrum. Quod si a similitudine in nomen accepit, quomodo possunt ista simulacra Deo similia judicari, quae nec sentiunt, nec moventur? Itaque simulacrum Dei non illud est, quod digitis hominis ex lapide, aut aere, aliave materia fabricatur; sed ipse homo, quoniam et sentit, et movetur, et multas magnasque actiones habet. Nec intelligunt homines ineptissimi, quod, si sentire simulacra et moveri possent, ultro adoratura hominem fuissent, a quo sunt expolita, quae essent aut incultus et horridus lapis, aut materia informis ac rudis, nisi fuissent ab homine formata.
Homo igitur illorum quasi parens
putandus est, per cujus manus nata sunt, per quem speciem, figuram,
pulchritudinem habere coeperunt. Et ideo melior est qui fecit, quam
illa quae facta sunt. Et tamen factorem ipsum nemo suspicit, aut
veretur: quae fecit, timet, tamquam plus possit esse in opere, quam
in opifice. Recte igitur Seneca in libris moralibus: Simulacra,
inquit, deorum venerantur, illis supplicant genu posito, illa
adorant, illis per totum assident diem, aut astant, illis stipem
jaciunt, victimas caedunt; et cum haec tantopere suspiciant, fabros,
qui illa fecere, contemnunt. Quid inter se tam contrarium, quam
statuarium despicere, statuam adorare, et eum ne in convictum quidem
admittere, qui tibi deos faciat? Quam ergo vim, quam potestatem
habere possunt, cum ipse, qui fecit illa, non habeat? Sed ne haec
quidem dare his potuit, quae habebat, videre, audire, loqui, moveri.
Quisquamne igitur tam ineptus est, ut putet aliquid esse in
simulacro dei, in quo ne hominis quidem quidquam est praeter umbram?
Sed haec nemo considerat; infecti sunt enim persuasione, ac mentes
eorum penitus fucum stultitiae perbiberunt. Adorant ergo
insensibilia, qui sentiunt; irrationabilia, qui sapiunt; exanima,
qui vivunt; terrena, qui oriuntur e coelo. Juvat ergo, velut in
aliqua sublimi specula constitutum, unde universi exaudire possint,
Persianum illud proclamare, |
LIVRE II.De L'origine De L'erreur.I. Quoique j'aie parfaitement, dans mon premier livre, fait voir que la religion des dieux est fausse, et que ceux auxquels le consentement des hommes, fondé sur une persuasion ridicule, a attiré par toute la terre des cultes si variés et si dissemblables, n'étaient que des mortels qui, à la fin de leur vie, ont été contraints de subir la loi générale de la mort ; cependant, afin qu'il ne reste aucun doute sur cette matière, je tâcherai de découvrir dans ce second livre la propre source de cette erreur, et d'expliquer les causes qui, ayant d'abord trompé les hommes, les ont portés à croire A la pluralité des dieux, et ensuite, par des préjugés invétérés, les ont affermis dans les religions auxquelles ils s'étaient d'abord soumis, car j'en ai un extrême désir, Constantin, après avoir démontré jusqu'à l'évidence le néant de ces croyances et dévoilé la vanité impie des hommes, de manifester la majesté du seul vrai Dieu. Quelle mission plus utile et plus noble à remplir que celle de les retirer du mauvais chemin où ils sont engagés, de les faire rentrer en grâce avec eux-mêmes, et d'empêcher qu'à l'imitation de certains philosophes, ils ne conçoivent du mépris pour eux-mêmes et ne se considèrent comme des êtres faibles, inutiles, nuls en un mot, et créés sans le moindre but ? Car sitôt qu'ils sont persuadés que Dieu s'embarrasse fort peu de nous, et qu'ils ne seront que néant après leur mort, ils s'abandonnent entièrement à leurs passions; et comme ils croient que tout leur doit être permis, ils s'efforcent d'assouvir leur soif ardente des voluptés, ce qui est le plus grand chemin de la perdition; car ils ignorent réellement et ne connaissent point la raison qui est attribuée aux hommes ; et s'ils voulaient s'en servir, ils commenceraient à reconnaître l'existence du vrai Dieu, et n'auraient pour but dans toutes leurs actions que la justice et la vertu : rien ne les attacherait plus à tout ce qui est terrestre ; ils n'auraient plus aucune passion déréglée ; ils s'estimeraient même beaucoup plus qu'ils ne font, et reconnaîtraient toutes les prérogatives de leur être, qui ne peut subsister qu'en renonçant à l'erreur et en adorant le vrai Dieu. Effectivement, quand je pense à l'immensité de toutes choses, je ne puis m'empêcher d'admirer la grandeur et la puissance du vrai Dieu, qui contient tout et qui gouverne tout; mais en même temps je ne puis assez m'étonner que ce même Dieu, que l'homme devait perpétuellement connaître et adorer, soit la première chose qu'il ait commencé à négliger et à oublier; et qu'il ait été aveuglé au point de préférer des hommes morts à un Dieu vivant, des hommes qui sont terrestres et ensevelis dans la terre à celui qui est le créateur de cette même terre. Cependant les hommes ne doivent pas désespérer que Dieu ne leur pardonne cette impiété, si elle ne vient que par l'ignorance où ils étaient du vrai Dieu et faute de le connaître ; mais comme nous voyons bien des hommes, qui font profession d'adorer les faux dieux, et qui néanmoins conviennent et publient même qu'il n'y en a qu'un seul, quel pardon et quel grâce peuvent-ils espérer que Dieu fasse à leur impiété, ceux qui, ayant connaissance du vrai Dieu, ne connaissent point le culte qu'ils lui devraient rendre, ce qu'il n'est presque pas permis à un homme d'ignorer ? Car quand ils jurent, quand ils implorent la bonté divine, ou qu'ils lui rendent grâce de quelque chose, ce n'est point Jupiter ni les autres dieux à qui ils s'adressent, mais ils nomment Dieu. Effet singulier de la nature, qui leur arrache, pour ainsi dire, la vérité, et même malgré eux, quand ils sont dans l'accablement et le malheur, ce qu'ils ne font jamais néanmoins quand ils sont dans la prospérité. Et en effet, Dieu n'est jamais tant oublié des hommes que lorsque l'homme jouit tranquillement des grâces et des biens qu'il lui envoie, ce qui néanmoins devrait lui en rappeler la mémoire et l'engager à une reconnaissance proportionnée. Mais quand au contraire l'homme se trouve dans l'adversité, c'est pour lors qu'il a recours à Dieu. Si les horreurs de la guerre le menacent et le font trembler, si une maladie contagieuse désole son pays, si une grande sécheresse a desséché tous les fruits de la terre, si une tempête survient, ou un orage ou une grêle, pour lors il a recours à Dieu ; il lui demande du secours; il l'invoque pour qu'il le soulage dans ses peines. Si quelqu'un est surpris en mer par une tempête, et qu'il court risque de périr, il invoque aussitôt Dieu ; s'il se trouve dans quelque danger pressant, il a aussitôt recours à Dieu ; si un homme se voit très affaibli par la longueur d'une maladie et la violence des remèdes, il demande avec instance, en attestant le nom de Dieu, qu'on lui donne à manger, et il espère par cette supplication toucher les hommes de compassion. Ainsi donc, les hommes ne songent jamais à Dieu et n'ont recours à lui que lorsqu'ils sont dans l'adversité ; et sitôt que le péril est passé, et qu'ils n'appréhendent plus rien, on les voit recourir avec joie aux temples des faux dieux. Ils leur font des libations, ils leur offrent des sacrifices, ils vont jusqu'à les couronner, et ne songent pas seulement à rendre les moindres actions de grâces au vrai Dieu qu'ils ont pourtant imploré dans leurs afflictions. Et de même que la luxure n'est produite que par la trop grande aisance et la jouissance des commodités de la vie, de même cette luxure et tous les autres vices ne produisent que l'oubli et l'impiété envers Dieu. Mais d'où cela peut-il provenir, si ce n'est qu'il y a quelque puissance perverse et mauvaise qui est ennemie déclarée de la vérité, qui s'applaudit des erreurs des hommes, qui n'est uniquement occupée qu'à répandre les ténèbres et à aveugler les nommes, de peur qu'ils ne voient la lumière et de peur qu'ils n'élèvent les yeux au ciel, et ne fassent attention à leur nature et à leur origine, dont nous parlerons en son lieu ? Mais pour le présent, nous nous attacherons seulement à combattre les erreurs des hommes. Comme tous les animaux ont le corps et le regard tournés vers la terre, parce qu'ils n'ont pas été doués de la raison et de la sagesse, et les hommes au contraire portent le corps droit et la tête élevée toujours vers le ciel, on peut induire de là que la religion des faux dieux n'est pas un effet de la raison des hommes, puisque l'homme, qui doit être tout divin, est obligé de s'abaisser pour adorer des choses terrestres. Car Dieu, qui est notre seul et unique père, quand il forma l'homme et qu'il le rendit capable d'intelligence et de raison, il s'éleva, pour ainsi dire, hors de terre pour pouvoir contempler plus facilement son créateur. C'est ce qu'a dit fort ingénieusement un poète[1] : « Et quand le reste des animaux porte le corps et le regard sur la terre, il (Dieu) a donné à l'homme un visage élevé, voulant qu'il contemplât le ciel et fixât directement ses regards vers les astres. » C'est ce qui a fait que les Grecs ont donné à l'homme le nom d'anthrôpos, parce qu'il regarde en haut. Ainsi on peut dire que ceux qui n'ont point les yeux élevés vers le ciel, et qui ne pensent uniquement qu'aux choses terrestres, renoncent pour ainsi dire à la qualité d'homme et abdiquent leur état, à moins qu'ils ne se figurent que la structure droite et élevée de l'homme ne soit pas un attribut particulier que Dieu lui ait donné. Ce n'est pas en vain que Dieu a voulu que nous eussions toujours la tête élevée vers le ciel. De tous les animaux et de tous les oiseaux, il n'y en a presque point qui puisse voir le ciel ; mais cette faculté a été accordée à l'homme, afin qu'il puisse y chercher son Créateur et son maître qui y fait son séjour; et, ne pouvant pas le voir face à face, le contempler au moins en esprit et l'adorer avec ardeur, c'est certainement ce que ne peut pas faire celui qui s'amuse à adorer de l'airain ou de la pierre, toutes choses terrestres ; il est même déraisonnable de penser que la structure du corps de l'homme étant droite et élevée, bien qu'il ne soit que terrestre et temporel, son âme, qui est éternelle, soit humble et s'abaisse aux choses terrestres ; car la figure et la structure de l'homme signifient tout simplement que l'homme doit avoir toutes les pensées tournées du même côté et au même endroit que le visage, et que son esprit doit être aussi droit que son corps, de peur qu'il ne ressemble à tous les autres animaux sur lesquels il doit dominer. Mais nous voyons au contraire que les hommes, oubliant et leur prééminence et leur raison, détournent les yeux du ciel et ne les ont attachés qu'à la terre ; ils craignent même des dieux qui ne sont l'ouvrage que de leurs mains, comme si quelqu'un pouvait être plus grand que son créateur. II. N'y a-t-il pas bien de la folie, et n'est-ce pas une erreur bien grande à l'homme, de former de ses mains des dieux qu'il doit craindre quand ils sont faits, ou de craindre lui-même ces mêmes dieux quand il les a formés ? Mais ce ne sont pas, me dira-t-on, ces mêmes dieux qui ont été formés par l'homme que nous craignons, ce sont ceux à l'image et a la représentation desquels ils ont été faits et auxquels ils ont été consacrés. Ainsi donc, vous craignez ceux que nous croyons être dans le ciel ; et cela ne peut être autrement s'ils sont véritablement dieux. Pourquoi, dans cette pensée, n'élevez-vous pas toujours les yeux vers le ciel et faites-vous en secret des sacrifices à vos dieux quand vous voulez les invoquer? Pourquoi vous adressez-vous à des murailles, à du bois, et surtout à des pierres, seuls objets que vous voyez dans vos temples, où vous croyez que vos dieux résident? Ces temples, ces autels, et enfin ces simulacres de vos dieux, sont-ce autre chose que des représentations de personnes mortes ou absentes? L'idée que les hommes ont eue, en imaginant de faire et de fabriquer de pareils simulacres, n'a été que de perpétuer la mémoire de ceux qui sont morts ou de ceux dont ils ont été obligés de se séparer et qui sont absents. Dans laquelle de ces deux classes mettrons-nous donc vos dieux? Si nous les mettons dans celle des morts, quelqu'un peut-il être assez insensé pour les adorer? Si nous les mettons dans celle des absents, on ne doit point non plus les adorer, puisqu'ils ne voient point ce que vous faites et n'entendent point les vœux et les prières que vous leur adressez. Si, au contraire, ces dieux ne peuvent être absents d'aucun endroit, parce qu'étant dieux ils sont répandus dans toutes les parties du monde, qu'ils voient tout et qu'ils entendent tout, les simulacres que les hommes font pour les représenter sont fort inutiles puisqu'ils sont présents partout, et qu'il suffit de se pouvoir faire entendre par ceux qu'on invoque. Mais ils ne sont là présents que par rapport à leurs figures qui y sont, et comme autrefois les peuples croyaient que les âmes des morts erraient autour de leurs tombeaux et des restes de leurs corps. Cependant, après que leur dieu a exaucé leurs vœux et leurs prières, leur simulacre est inutile ; car je demande si quelqu'un contemplait souvent le portrait d'un homme qui serait dans un pays fort éloigné, dans l'idée de se consoler de son absence, cet homme serait-il bien sensé si son ami, étant revenu de ces pays lointains, et étant avec lui, il continuait de contempler toujours son portrait, et avait plus de plaisir à le regarder qu'à regarder son ami ? Sans doute cela serait ridicule, car le portrait d'une personne ne peut faire plaisir à voir que quand elle est absente; mais sitôt qu'elle est présente, il semble qu'il devient inutile. Or Dieu, dont l'esprit est toujours répandu partout ne peut être absent d'aucun endroit ; par conséquent, il est inutile d'en avoir le simulacre ou la figure. « Mais il est à craindre, me dira-t-on, que toute leur religion ne devienne vaine et inutile s'ils n'ont point un objet présent qui leur rappelle l'idée de celui qu'ils adorent; et c'est ce qui les a engagés à faire des simulacres et des représentations qui ressemblent à des morts, parce qu'elles sont véritablement la représentation de gens qui sont morts, n'ayant plus aucune sensation, au lieu que le simulacre d'un Dieu vivant et éternel doit être vivant et sensible. Si c'est la propre ressemblance qui leur a fait donner leurs noms, comment peut-on se figurer et croire que ces idoles ou simulacres ressemblent au dieu qu'ils représentent, puisqu'ils sont insensibles et ne sont capables d'aucun mouvement ? Ainsi donc le simulacre du vrai Dieu n'est point celui qui est fait par main d'homme avec une pierre, de l'airain ou quelque autre matière ; mais ce doit être l'homme lui-même, parce qu'il a le don de sentir et de se mouvoir lui-même, et qu'il est capable de toute sorte d'actions. Mais ces adorateurs des faux dieux ne font pas attention que, quand même ces idoles qu'ils adorent auraient du sentiment et pourraient avoir quelque mouvement, on devrait bien plutôt adorer ceux qui les auraient faits et y auraient mis la dernière main, puisque, sans leur travail, ce ne serait encore qu'une masse informe, une pierre brute, ou quelque autre matière qui n'aurait aucune figure. Ainsi l'homme doit être regardé comme leur créateur, car ils n'ont pris leur naissance, leur forme, leur figure, leur beauté et leur perfection que du travail et de l'adresse de leurs mains. Ainsi il faut convenir que celui qui a fait cette idole qui devient si vénérable, doit être plus considéré que l'idole même qui ne serait rien sans lui. Cependant personne ne considère ni ne craint cet habile ouvrier, et il craint et vénère lui-même son ouvrage, comme si la statue qui sort de la main de l'ouvrier avait plus de pouvoir et de crédit que l'ouvrier lui-même. C'est ce qui a si bien fait dire à Sénèque dans ses livres de morale : « Les simulacres des dieux sont révérés; on fléchit le genou devant eux, on les adore, on est en prières et en méditations des jours entiers devant ces figures, on leur offre et présente de l'argent, on leur immole des victimes ; mais pour peu que ceux qui leur rendent un pareil culte y veuillent faire attention, ils méprisent les ouvriers qui les ont faits. » Y a-t-il rien, je vous prie, de si opposé et de si contradictoire que d'adorer la statue et de mépriser l'ouvrier qui l'a faite, et de ne vouloir pas seulement admettre a la table celui qui a fait les dieux que nous adorons ? Quelle force et quelle puissance peuvent avoir ces dieux, puisque celui qui les a faits n'en a aucune, n'ayant pas pu lui-même leur communiquer seulement les facultés qu'il avait, qui étaient de voir, d'entendre, de parler, de se mouvoir. Peut-il donc y avoir quelqu'un d'assez insensé pour croire qu'il peut y avoir quelque chose de respectable dans le simulacre d'un dieu, dans lequel on ne trouve tout au plus que l'ombre et la ressemblance d'un homme? Cependant personne ne fait ces réflexions, et tout le monde demeure dans son erreur et dans sa prévention, étant comme enivré de son erreur et de sa folie. Ainsi nous voyons que des hommes qui ont du sentiment adorent des dieux insensibles; que des hommes qui sont raisonnables en adorent qui n'ont aucune raison; que des hommes qui vivent et qui respirent adorent des dieux sans vie, sans force et sans puissance ; et que des hommes qui tirent leur origine du ciel adorent des choses terrestres. Oh ! qu'avec raison nous devrions nous écrier avec Perse, de manière que tout le monde puisse nous entendre : Pourquoi les hommes rampent-ils toujours sur la terre, et pourquoi s'éloignent-ils si fort du ciel. Mais élevons plutôt nos yeux vers le ciel, ce grand ouvrier et auteur de toute chose, doit nous y exciter et nous y porter. Il nous a donné un visage et un regard élevé, et vous le fixez seulement sur la terre; il vous a donné un esprit supérieur et capable de s'élever jusqu'aux choses divines, et vous ne pensez qu'à des choses abjectes et terrestres, comme si vous étiez fâché de n'être pas nés comme les bêtes brutes. Un homme, qui est né pour le ciel, ne devrait point s'égaler et se comparer à tout ce qui est terrestre et abject: et pourquoi, vous privant vous-mêmes de tous les biens et de tous les avantages célestes, vous attachez-vous volontairement aux biens terrestres ? L'homme vit malheureux sur la terre quand il cherche ici-bas ce qu'il ne peut trouver que dans le ciel; car tous les dieux que les hommes font, de quelque manière qu'ils soient composés, sont-ils autre chose que de la terre? Ainsi, pourquoi vous soumettez-vous à des choses purement terrestres ? Pourquoi élevez-vous des choses terrestres au-dessus de vous? Car, quand vous vous soumettez à des choses terrestres, et que vous vous humiliez à ce point, vous vous condamnez vous-mêmes à la mort, et vous courez le grand chemin des enfers, parce qu'il n'y a rien au-dessous et plus abject que la terre, excepté la mort et les enfers; et si vous voulez les éviter, il faut mépriser tout ce qui est terrestre, et n'y point laisser assujettir votre corps, afin que vous soyez toujours en état d'élever vos yeux et votre esprit vers celui dont vous tenez l'être. Quand je dis qu'il faut mépriser tout ce qui est. terrestre, je n'entends dire autre chose que de ne point adorer les faux dieux, parce qu'ils ne sont faits que de terre, tout comme de ne point s'attacher aux richesses, de mépriser toutes les voluptés du corps, parce que les richesses et notre corps même, qui sert de prison à notre âme, ne sont que des choses terrestres. Adorez le vrai Dieu si vous voulez vivre : car il faut nécessairement que celui qui se consacre lui-même aussi bien que son âme à des morts, meure lui-même. |
|
CAPUT III. Quod Cicero aliique doctiores peccaverunt, non avertendo populos ab errore. Sed quid prodest ad vulgus et ad homines imperitos hoc modo concionari? cum videamus etiam doctos et prudentes viros, cum religionum intelligant vanitatem, nihilominus tamen in iis ipsis, quae damnant, colendis nescio qua pravitate perstare. Intelligebat Cicero falsa esse, quae homines adorarent. Nam cum multa dixisset quae ad eversionem religionum valerent, ait tamen non esse illa vulgo disputanda, ne susceptas publice religiones disputatio talis extinguat. Quid de eo facias, qui, cum errare se sentiat, ultro ipse in lapides impingat, ut populus omnis offendat? ipse sibi oculos eruat, ut omnes caeci sint? qui nec de aliis bene mereatur, quos patitur errare; nec de se ipso, qui alienis accedit erroribus, nec utitur tandem sapientiae suae bono, ut factis impleat, quod mente percepit, sed prudens et sciens pedem laqueo inserit, ut simul cum caeteris, quos liberare ut prudentior debuit, et ipse capiatur? Quin potius, si quid tibi, Cicero, virtutis est, experire populum facere sapientem: digna res est, ubi omnes eloquentiae tuae vires exerceas. Non enim verendum est ne te in tam bona causa deficiat oratio, qui saepe etiam malas copiose ac fortiter defendisti. Sed nimirum Socratis carcerem times, ideoque patrocinium veritatis suscipere non audes. At mortem ut sapiens contemnere debuisti. Et erat quidem multo pulchrius, ut ob bene dicta potius, quam ob maledicta morereris. Nec plus tibi laudes Philippicae afferre potuerunt, quam discussus error humani generis, et mentes hominum ad sanitatem tua disputatione revocatae. Sed concedamus timiditati, quae in sapiente esse non debet. Quid ergo ipse in eodem versaris errore? Video te terrena et manufacta venerari: vana esse intelligis, et tamen eadem facis quae faciunt ipsi, quos ipse stultissimos confiteris. Quid igitur profuit vidisse te veritatem, quam nec defensurus esses, nec secuturus? Si libenter errant etiam ii qui errare se sentiunt, quanto magis vulgus indoctum, quod pompis inanibus gaudet, animisque puerilibus spectat omnia? oblectatur frivolis, et specie simulacrorum capitur, nec ponderare secum unamquamque rem potest, ut intelligat nihil colendum esse quod oculis mortalibus cernitur, quia mortale sit necesse est. Nec mirandum est, si Deum non videant, cum ipsi ne hominem quidem videant, quem videre se credunt. Hoc enim quod oculis subjectum est, non homo, sed hominis receptaculum est; cujus qualitas et figura, non ex lineamentis vasculi quo continetur, sed ex factis et moribus pervidetur. Qui ergo colunt simulacra, corpora sunt hominibus carentia, quia se corporalibus dediderunt, nec vident plus aliquid mente quam corpore; cum sit animi officium ea subtilius cernere, quae acies corporalis non potest intueri. Quos homines idem ille philosophus ac poeta graviter accusat, tamquam humiles et abjectos, qui contra naturae suae rationem ad veneranda terrena se prosternant: ait enim:
Et faciunt animos humiles formidine
divum, Aliud quidem ille, cum haec diceret, sentiebat; nihil utique esse colendum, quia dii humana non curent. Denique alio loco religiones deorum et cultus inane esse officium confitetur:
Nec pietas ulla est, velatum saepe
videri Quae profecto si cassa sunt, non oportet sublimes et excelsos animos avocari, atque in terram premi, sed nihil aliud quam coelestia cogitare. Impugnatae sunt ergo a prudentioribus falsae religiones, quia sentiebant esse falsas: sed non est inducta vera, quia qualis, aut ubi esset, ignorabant. Itaque sic habuerunt, tanquam nulla esset omnino, quia veram non poterant invenire. Et eo modo inciderunt in errorem multo majorem quam illi qui falsam tenebant. Nam isti fragilium cultores, quamvis sint inepti, quia coelestia constituunt in rebus corruptibilibus atque terrenis, aliquid tamen sapientiae retinent, et habere veniam possunt, quia summum hominis officium, etsi non reipsa, tamen proposito tenent: siquidem hominum atque mutorum, vel solum, vel certe maximum in religione discrimen est. Hi vero quanto fuerunt sapientiores, quod intellexerunt falsae religionis errorem, tanto facti sunt stultiores, quod esse aliquam veram non putaverunt. Itaque quoniam facilius est de alienis judicare, quam de suis; dum aliorum praecipitium vident, non prospexerunt quid ante suos pedes esset. In utraque igitur parte, et summa stultitia invenitur, et odor quidam sapientiae: ut possis dubitare, quos dicas potissimum stultiores, illosne qui falsam religionem suscipiunt, an eos qui nullam. Sed (ut dixi) venia concedi potest imperitis, et qui se sapientes non esse fateantur: his vero non potest qui, sapientiam professi, stultitiam potius exhibent. Non sum equidem tam iniquus, ut eos putem divinare potuisse, ut veritatem per seipsos invenirent; quod fieri ego non posse confiteor. Sed hoc ab his exigo, quod ratione ipsa praestare potuerunt. Facerent enim prudentius, si et intelligerent esse aliquam veram religionem, et falsis impugnatis, aperte pronuntiarent, eam, quae vera esset, ab hominibus non teneri. Sed moverit eos fortasse illud, quod si qua vera esset religio, exereret se ac vindicaret, nec pateretur esse aliud quidquam. Videre enim nullo modo poterant, quare, aut a quo, et quemadmodum Religio vera opprimeretur; quod est divini sacramenti, et coelestis arcani. Id vero, nisi doceatur, aliquis scire nullo pacto potest. Summa rei haec est: imperiti et insipientes falsas religiones pro veris habent, quia neque veram sciunt, neque falsam intelligunt. Prudentiores vero, quia veram nesciunt, aut in iis, quas falsas esse intelligunt, perseverant, ut aliquid tenere videantur, aut omnino nihil colunt, ne incidant in errorem, cum id ipsum maximi sit erroris vitam pecudum sub figura hominis imitari. Falsum vero intelligere, est quidem sapientiae, sed humanae. Ultra hunc gradum procedi ab homine non potest; itaque multi philosophorum religiones (ut docui) sustulerunt: verum autem scire divinae est sapientiae. Homo autem per seipsum pervenire ad hanc scientiam non potest, nisi doceatur a Deo. Ita philosophi quod summum fuit humanae sapientiae assecuti sunt, ut intelligerent quid non sit: illud assequi nequiverunt, ut dicerent quid sit. Nota Ciceronis vox est : « Utinam tam facile vera invenire possem, quam falsa convincere. » Quod quia vires humanae conditionis excedit, ejus officii facultas nobis est attributa, quibus tradidit Deus scientiam veritatis; cui explicandae quatuor posteriores libri servient. Nunc interim falsa, ut coepimus, detegamus. |
III. Mais que sert au peuple et à des gens ignorants de les prêcher ainsi, puisque nous voyons des gens très sages et très savants qui, quoiqu'ils connaissent à merveille la fausseté de ces religions, néanmoins ne laissent pas de persister dans leur erreur et de continuer d'adorer des dieux qu'ils méprisent. Cicéron sentait fort bien que tous les dieux que les Romains adoraient dans leurs temples étaient de faux dieux ; car après avoir dit plusieurs choses qui tendaient à faire voir l'illusion de leur religion et à la détruire, il dit ensuite : « Il ne faut cependant pas disputer sur cette matière devant le peuple, de peur que de pareilles disputes ne ruinent totalement une religion qui deviendrait suspecte. » Que peut-on faire à un homme qui s'égare volontairement, et qui s'arrache les yeux pour que les autres deviennent aveugles? qui ne rend service ni aux autres, qu'il laisse dans l'erreur, ni à lui-même, qui suit les erreurs des autres, qui ne se sert point de ses lumières et ne fait pas le bien qu'il connaît, et qui s'embarrasse lui-même dans le filet d'où il devait retirer le peuple ? Employez, ô Cicéron, les talents que vous avez reçus du ciel pour inspirer quelque sentiment de sagesse à vos concitoyens, c'est un sujet qui mérite que vous déployiez toute la force de votre éloquence. Il ne faut pas appréhender que les paroles vous manquent quand vous défendrez ainsi une si bonne cause, puisque vous en avez souvent trouvé une merveilleuse abondance pour défendre les plus mauvaises. Mais vous faites difficulté d'entreprendre la défense de la vérité, parce que vous appréhendez d'être mis en prison comme Socrate ; l'amour de la sagesse devait vous donner du mépris de la mort, et il valait mieux la souffrir pour avoir fait des discours utiles à tout le monde que pour avoir fait de violentes invectives. Quelque gloire que vos Philippiques vous aient acquise, ce vous en aurait été une incomparablement plus grande d'avoir détrompé les esprits. Mais quand nous pardonnerions à la crainte qui vous empêche de déclarer la vérité, et qui est pourtant indigne d'un homme qui fait profession de l'étude de la sagesse, pourquoi demeurez-vous attaché à la même superstition que le vulgaire? Pourquoi adorez-vous des idoles que les mains des hommes ont faites avec de l'argile ? Vous savez qu'il n'y a que de la vanité et de l'impiété dans le culte qu'on leur rend, et vous le leur rendez comme les plus ignorants et les plus insensés. De quoi vous sert d'avoir connu la vérité, puisque vous n'avez le courage ni de la suivre ni de la défendre? Que si des hommes savants, et qui ont eu assez de lumières pour découvrir l'erreur, se plaisent néanmoins à la suivre, faut-il s'étonner que les ignorants s'y plaisent encore davantage? Ils aiment naturellement les spectacles, la pompe et la magnificence, les figures et les ornements, mais ils ne sauraient pénétrer dans la nature des choses, ni reconnaître qu'il ne faut rien adorer de ce que l'on peut voir par les yeux du corps, parce que l'on ne peut rien voir de la sorte qui ne soit corruptible et périssable. Il ne faut pas s'étonner qu'ils ne voient pas Dieu, puisqu'ils ne voient pas même l'homme qu'ils croient voir. Ce que l'on voit de l'homme n'est qu'un vase qui le renferme; il faut juger de lui, non par la figure de ce vase, mais par ses actions et ses mœurs. Ceux qui adorent les idoles ne sont que des corps et non pas des hommes, parce qu'ils ne voient rien par les yeux de l'esprit, qui sont les véritables yeux de l'homme, et qui sont beaucoup plus subtils et plus perçants que ceux du corps. Un poète, qui était aussi excellent philosophe, reprend fortement la lâcheté avec laquelle les hommes s'abaissent jusqu'à adorer des natures terrestres : Il n'y a rien, dit-il, qui abaisse si fort le courage ni qui le rende si rampant, s'il est permis de parler ainsi, que la superstition et une trop forte appréhension de la puissance des dieux.[2] Quand il parlait de la sorte, il avait une autre pensée que celle que ses paroles expriment, savoir, qu'il ne faut rendre aucun culte aux dieux parce qu'ils ne prennent aucun soin de nos affaires. Il avoue franchement en un autre endroit que tous les devoirs de la religion sont entièrement inutiles, quand il déclare ouvertement : Que la piété ne consiste pas à tourner plusieurs fois autour d'une pierre, à se prosterner contre terre, à s'approcher des autels, à lever les mains au ciel, à faire de longues prières et à immoler des victimes.[3] Que si ces devoirs ne servent de rien, faut-il qu'un esprit aussi élevé que celui de l'homme s'abaisse à les rendre et qu'il rampe sur la terre, au lieu d'être toujours par la pensée dans le ciel? Les plus éclairés ont combattu la religion des païens parce qu'ils en avaient examiné la fausseté, mais ils n'ont pas établi la vérité de la nôtre, parce qu'ils ne les connaissaient pas. L'impuissance où ils ont été de découvrir la véritable religion, a été cause qu'ils n'en ont point du tout, et qu'ils ont été plus criminels que ceux qui en ont une fausse; car, bien que ceux qui avaient des idoles se trompent, parce qu'ils prennent des choses terrestres et corruptibles pour les choses célestes et éternelles, ils sont pourtant excusables et même louables, en ce qu'ils ont dessein de s'acquitter du principal devoir de l'homme, bien qu'ils ne s'en acquittent pas de la manière qu'ils le doivent. La religion met la seule, ou au moins la principale différence qu'il y ait entre les hommes et les animaux. Plus ceux dont je parle ont été sages et éclairés, quand ils ont reconnu que la religion des païens est fausse, plus ils ont été insensés et aveugles quand ils se sont persuadés qu'il n'y en a point de véritable. Comme il est plus aisé de juger de ce qui regarde les autres que de ce qui nous regarde nous-mêmes, ils ont vu le précipice où les païens sont tombés et n'en ont pas vu un autre qui était à leurs pieds. Il y a de côté et d'autre une extrême folie, bien qu'il y ait aussi quelques traces de sagesse. Il est difficile de dire quels sont les plus insensés, ou ceux qui admettent la fausse religion, ou ceux qui n'en admettent aucune. On peut pourtant pardonner, comme je l'ai déjà dit, à ceux qui ne sont pas éclairés, et qui font un aveu sincère de leur peu de science, mais on ne saurait pardonner à ceux qui, faisant profession d'être sages et habiles, tombent dans la dernière de toutes les extravagances. Je n'ai pas si peu d'équité que de prétendre qu'ils devaient deviner et trouver la vérité d'eux-mêmes. J'avoue que cela ne leur était pas possible. Mais il leur était possible de découvrir par la lumière de la raison qu'il y a une religion, de réfuter les fausses, et j'avoue franchement que la véritable ne leur était pas connue. Il y a une objection qui fait une forte impression sur l'esprit de quelques-uns, c'est que s'il y avait une véritable religion, elle ne manquerait pas de paraître, et de dissiper par son éclat toutes les autres. Que ceux dont je parle n'aient pu comprendre comment la véritable religion demeurait opprimée, c'est en effet un mystère impénétrable à l'esprit humain. C'est ici le principal point de notre sujet. Les ignorants prennent une fausse religion pour la véritable, parce qu'ils ne connaissent ni l'une ni l'autre. D'autres plus éclairés demeurent dans une fausse religion, parce qu'ils ne connaissent pas la véritable, et qu'ils ont peur de n'en avoir aucune, ou bien ils n'en ont aucune de peur d'en avoir une fausse; ce qui est la plus grande de toutes les erreurs, et qui fait mener à l'homme une vie semblable à celle des bêtes. Pour reconnaître la fausseté d'une religion, il ne faut qu'une sagesse humaine et ordinaire. L'homme ne saurait pourtant aller plus avant, et c'est pour cela que plusieurs philosophes ont nié absolument toutes les religions; mais pour découvrir la véritable; il faut être éclairé d'une sagesse divine, que l'homme ne saurait avoir si Dieu ne la lui donne. Voilà comment les philosophes ont découvert, par la lumière de la raison, la fausseté des religions païennes et n'ont pu découvrir la vérité de la nôtre. Cette parole de Cicéron est connue de tout le monde[4] : « Plût à Dieu qu'il me fût aussi aisé de connaître la vérité que de réfuter l’erreur ! » Cette connaissance est au-dessus de la nature ; mais Dieu nous l'accorde par sa grâce. Nous tâcherons de la communiquer aux autres dans les quatre derniers livres de cet ouvrage. Mais cependant continuons de réfuter la fausseté du paganisme.
|
|
CAPUT. IV. De Simulacris,
ornamentisque templorum, et eorum contemptu, etiam ab ipsis
Gentilibus. Quid igitur majestatis possunt habere simulacra, quae fuerunt in homunculi potestate, vel ut aliud fierent, vel ut omnino non fierent? Idcirco apud Horatium Priapus ita loquitur:
Olim truncus eram ficulnus, inutile
lignum; Quis non sit tanto hoc custode securus? Fures enim tam stulti sunt, ut Priapi tentiginem timeant; cum aves ipsae, quas terrore falcis aut inguinis abigi existimant, simulacris fabrefactis, id est, hominum plane similibus, insidant, nidificent, inquinent. Sed Flaccus, ut satyrici carminis scriptor, derisit hominum vani-tatem. Verum ii qui faciunt, seriam se facere rem opinantur. Denique poeta maximus, homo in caeteris prudens, in hoc solo non poetice, sed aniliter desipuit; cum in illis emendatissimis libris etiam fieri hoc jubet:
Et custos furum atque avium, cum falce
saligna,
Adorant ergo mortalia, ut a mortalibus
facta. Frangi enim, cremari, perire possunt. Nam et tectis vetustate
labentibus saepe comminui solent, et consumpta incendio dilabuntur
in cinerem, et plerumque (nisi sua illis magnitudo subvenerit, aut
custodia diligens sepserit) in praedam furibus cedunt. Quae igitur
insania est, ea timere, pro quibus aut ruinae, aut ignes, aut furta
timeantur? Quae vanitas, aliquam ab his sperare tutelam, quae tueri
semetipsa non possunt? Quae perversitas, ad eorum praesidia
decurrere, quae ipsa, cum violantur, inulta sunt, nisi a colentibus
vindicentur? Ubi ergo veritas est? ubi nulla vis adhiberi potest
Religioni; ubi nihil, quod violari possit, apparet; ubi sacrilegium
fieri non potest.
Compositum jus, fasque animi,
sanctosque recessus Egregie, sapienterque sensit. Verum illud ridicule subdidit: hoc esse aurum in templis, quod sint, Veneri donatae a virgine pupae: quas ille ob minutiem fortasse contempserit. Non videbat enim, simulacra ipsa et effigies deorum, Polycleti, et Euphranoris, et Phidiae manu ex auro atque ebore perfectas, nihil aliud esse quam grandes pupas, non a virginibus, quarum lusibus venia dari potest, sed a barbatis hominibus consecratas. Merito igitur etiam senum stultitiam Seneca deridet. Non, inquit, bis pueri sumus (ut vulgo dicitur); sed semper. Verum hoc interest, quod majora nos ludimus. Ergo his ludicris, et ornatis, et grandibus pupis et unguenta, et thura, et odores inferunt: his opimas et pingues hostias immolant, quibus est quidem os, sed carens officio dentium: his peplos et indumenta pretiosa, quibus usus velaminis nullus est: his aurum et argentum consecrant, quae tam non habent qui accipiunt, quam qui illa donarunt. Nec immerito Dionysius, Siciliae tyrannus, post victoriam Graecia potitus, deos tales contempsit, spolia-vit, illusit: siquidem sacrilegia sua jocularibus etiam dictis prosequebatur. Nam cum Jovi Olympio aureum amiculum detraxisset, laneum jussit imponi, dicens, aestate grave esse aureum, hyeme frigidum, laneum vero utrique tempori aptum. Idem auream barbam detrahens Aesculapio, incongruens et iniquum esse ait, cum Apollo pater ejus imberbis esset adhuc, ac laevis, priorem filium quam patrem barbatum videri. Item pateras, et exuvias, et parva quaedam sigilla, quae simulacrorum protentis manibus tenebantur, detrahebat: et accipere se illa, non auferre dicebat; perquam enim stultum esse et ingratum, nolle accipere ab his ultro porrigentibus, a quibus bona sibi homines precarentur. Haec ille fecit impune, quia rex et victor fuit. Quin etiam secuta est eum solita felicitas: vixit enim usque ad senectutem, regnumque per manus filio tradidit. In eo igitur, quia homines sacrilegia vindicare non poterant, oportuit deos ipsos sui vindices esse. At si humilis quispiam tale quid commiserit, huic praesto sunt flagella, ignes, equulei, cruces, et quidquid excogitare iratis et furentibus licet. Sed cum puniunt deprehensos in sacrilegio, ipsi de deorum suorum potestate diffidunt. Cur enim illis potissimum non relinquant ulciscendi sui locum, si eos posse aliquid arbitrantur? Quin etiam putant illorum numine accidisse, ut praedones rerum sacrarum deprehensi tenerentur; et saeviunt non tam ira, quam metu, ne si deorum injuriam non vindicaverint, ipsos expetant poenae; incredibili scilicet vanitate, qui nocituros sibi deos putent ob aliena scelera, qui ipsis, a quibus violati spoliatique sunt, per seipsos nihil nocere potuerunt. At enim saepe ipsi quoque in sacrilegos vindicaverunt: potest id vel casu accidisse, quod aliquando, non semper. Sed tamen paulo post, quomodo id acciderit, ostendam. Nunc interim quaero, cur illi tot et tanta sacrilegia in Dionysio non vindicaverunt, qui non furtim, sed palam deos ludibrio habuit? Cur hunc tam potentem sacrilegum a templis, a ceremoniis, ab imaginibus suis non arcuerunt? Cur etiam sacris rebus ablatis, prospere navigavit? quod joco ipse testatus est (ut solebat). Videtisne (inquit comitibus suis naufragium timentibus) quam prospera sacrilegis navigatio ab ipsis diis immortalibus tribuatur? Sed hic fortasse a Platone didicerat, deos nihil esse. Quid Caius Verres? quem Tullius, accusator ejus, eidem Dionysio, et Phalaridi, et tyrannis, omnibus comparat. Nonne omnem Siciliam compilavit, sublatis deorum simulacris, ornamentisque fanorum? Otiosum est persequi singula. Unum libet commemorare in quo accusator omnibus eloquentiae viribus, omni denique conatu vocis et corporis deploravit, de Cerere Catinensi, vel Ennensi; quarum alterius tanta fuit religio, ut adire templi ejus secreta penetralia viris nefas esset; alterius antiquitas tanta, ut omnes historiae loquantur ipsam deam fruges in Ennae solo primum reperisse, filiamque ejus virginem ex eodem loco raptam. Denique Gracchanis temporibus, turbata republica et seditionibus et ostentis, cum repertum esset in carminibus Sibyllinis antiquissimam Cererem debere placari, legati sunt Ennam missi. Haec igitur Ceres vel religiosissima, quam videre maribus ne adorandi quidem gratia licebat, vel antiquissima, quam Senatus Populusque Romanus sacrificiis donisque placaverat, ex arcanis et vetustis penetralibus, a Caio Verre, immissis latronibus servis, impune sublata est. Idem vero cum affirmaret se a Siculis, ut causam provinciae susciperet, oratum, his verbis usus est: « Sese jam ne deos quidem in suis urbibus, ad quos confugerent, habere; quod eorum simulacra sanctissima C. Verres ex delubris religiosissimis sustulisset: » quasi vero si Verres ex urbibus delubrisque sustulerat, de coelo quoque sustulerat. Unde apparet istos deos nihil habere in se amplius quam materiam de qua sunt fabricati. Nec immerito ad te, Marce Tulli, hoc est, ad hominem, Siculi confugerunt; quoniam triennio sunt experti deos illos nihil valere. Essent enim stultissimi, si ad eos ob defendendas injurias hominum confugissent, qui Caio Verri nec pro seipsis irati esse potuerunt. At enim Verres ob haec facinora damnatus est. Non ergo dii vindicaverunt, sed Ciceronis industria, qua vel defensores ejus oppressit, vel gratiae restitit. Quid, quod apud ipsum Verrem non fuit illa damnatio, sed vacatio? ut quemadmodum Dionysio deorum spolia gestanti dii immortales bonam dederant navigationem, sic etiam Verri bonam quietem tribuisse videantur, in qua sacrilegiis suis tranquille frui posset. Nam frementibus postea civilibus bellis, sub obtentu damnationis ab omni periculo et metu remotus, aliorum graves casus et miserabiles exitus audiebat, et qui cecidisse solus universis stantibus videbatur, is vero universis cadentibus solus stetit, donec illum et opibus sacrilegio partis et vita satiatum, ac senectute confectum, proscriptio triumviralis auferret, eadem scilicet quae Tullium violatae deorum majestatis ultorem. Quin etiam felix in eo ipso fuit, quod ante suam mortem crudelissimum exitum sui accusatoris audivit; diis videlicet providentibus, ut sacrilegus ac praedo ille religionum suarum, non ante moreretur quam solatium de ultione cepisset. |
IV. Que peuvent avoir de divin des images qui ont été faites par un homme de qui il dépendait, ou de ne les point faire du tout, ou de les faire autrement qu'elles ne sont ? Voilà pourquoi Priape parle ainsi dans Horace : Je n'étais autrefois qu'un tronc de figuier, bois mutilé, lorsqu'un ouvrier, incertain s'il ferait de moi une escabelle ou un Priape, aima mieux que je devinsse un dieu. Je suis donc un dieu par cette raison, l'effroi des voleurs et des oiseaux. Qui ne sera pas en sûreté ayant un gardien si vigilant et si redoutable ? Les voleurs seront peut-être assez timides pour appréhender la présence de Priape, bien que les oiseaux que l'on croit mis en fuite par sa faux, s'arrêtent souvent sur les images des dieux, font leur nid dans l'intérieur, et les souillent de leurs ordures. Horace s'est moqué comme un poète satirique de la vanité des hommes. Mais cependant ceux qui adorent les images agissent sérieusement. Un poète fort célèbre, et d'ailleurs fort sensé, Virgile s'est trompé comme le plus faible de tous les nommes, quand dans ces livres qu'il a corrigés avec tant de soin il a ordonné ce qui suit : Priez Priape, afin qu'avec sa faux il chasse les oiseaux qui pourraient manger vos grains, et épouvante les voleurs qui pourraient vous faire tort. Les hommes adorent donc des ouvrages périssables de la main des hommes, des ouvrages que l'on peut rompre et brûler. Ils sont souvent brisés par la chute de la couverture des temples qui tombent en ruines; ils sont réduits en cendres par le feu, ou ils sont quelquefois enlevés par les voleurs, si ce n'est que la pesanteur de leur masse ou la vigilance des gardes les garantisse de cet outrage. Quelle folie de craindre des images pour lesquelles ou craint, ou qu'elles ne soient brisées par la chute d'un bâtiment, ou consumées par le feu, ou enlevées par les voleurs ! Quelle extravagance d'attendre protection de ces images qui ne se sauraient sauver elles-mêmes ! Quel désordre d'avoir recours à des figures que l'on outrage impunément, si ceux qui les adorent ne prennent le soin de les venger ! Où se trouve donc la vérité de la religion? Elle se trouve où la religion ne peut souffrir de violence, où l'impiété ne saurait commettre de sacrilège. Tout ce qui peut être ou vu ou touché est fragile, et partant ne saurait être l'objet de notre culte. C'est donc en vain que l'on fait des dieux d'ivoire, et qu'on les enrichit avec de l'or et des perles, comme s'ils pouvaient prendre quelque plaisir à ces ornements. De quoi ces parures peuvent-elles servir à des images qui n'ont point de sentiment? Les honneurs que l’on rend aux dieux sont semblables aux devoirs que l'on rend aux morts. On embaume les corps et on leur met de riches habits, avant de les enfermer dans les tombeaux. On pare de même les dieux qui n'ont aucun sentiment de ce que l'on prétend figuré pour les honorer. Perse ne trouvait pas bon que l'on mît des vases d'or dans les temples, et il fait voir qu'il est inutile d'employer, dans l'exercice de la religion, un métal qui est plus propre à exciter l'avarice qu'à entretenir la piété. Les présents qu'il veut que l'on offre à Dieu sont: Un esprit rempli des sentiments de l'équité et de la justice, et un cœur brûlant de l'amour de l'honnêteté et de la vertu. Il n'y a rien de plus raisonnable que ce sentiment; mais ce qu'il ajoute est ridicule, quand il dit que l'or tient le même rang, dans les temples Que les poupées que les filles donnent à Vénus, et que cette déesse méprise à cause de leur petitesse. Il ne songeait pas que les figures et les images des dieux faites d'or et d'ivoire par la main des Praxitèle, d'Euphranor ou de Phidias, ne sont autre chose que de grandes poupées consacrées, non en jouant par de jeunes filles à qui ce divertissement serait pardonnable, mais sérieusement par des hommes avancés en âge. Sénèque a raison de se moquer de la folie des vieillards, quand il dit : « Nous ne sommes pas deux fois enfants, comme on le dit communément, mais nous le sommes toujours. Toute la différence qu'il y a entre eux et nous, c'est que nous jouons plus grand jeu. » Quand les hommes ont paré les images, qui ne sont que de grandes poupées, ils leur offrent de l'encens, des parfums et des odeurs, et ils leur sacrifient de grasses victimes. Ces images ont une bouche, mais elles ne s'en peuvent servir pour manger. On leur présente des voiles et des habits dont elles n'ont aucun besoin. On leur donne de l'or et de l'argent, qu'elles ne possèdent non plus que ceux qui ne l'ont plus quand ils le leur ont donné. Quand Denys, tyran de Sicile, eut remporté une victoire qui le rendait maître de la Grèce, il eut raison de mépriser et de dépouiller les dieux, et d'ajouter la raillerie au sacrilège. Il fit enlever à Jupiter Olympien un manteau d'or, et lui en fit donner un de laine, en disant que le manteau d'or était trop pesant en été, et trop froid en hiver, au lieu que celui de laine était plus propre en l'une et en l'autre des saisons. Il ôta la barbe d'or à Esculape, et dit qu'il était contre la bienséance qu'il eût une grande barbe, puisque Apollon son père n'en avait point. Il prit aussi des coupes et d'autres petits présents qui étaient aux mains des images, et dit que c'était les recevoir d'elles et non pas les leur ôter, ajoutant qu'il y avait de la folie ou même de l'ingratitude à ne pas recevoir des mains des dieux ce qu'ils nous offrent, puisque nous leur demandons tous les jours des grâces. Il en usa de la sorte, parce qu'il avait entre les mains la souveraine puissance, et que la victoire secondait ses entreprises. Le bonheur ne cessa point pour cela de le suivre. Il vécut jusqu'à une extrême vieillesse, et laissa son royaume à son fils. Puisque les hommes n'étaient pas assez forts pour punir ces sacrilèges, les dieux ne devaient-ils pas entreprendre de le faire ? Si un homme de basse condition les avait commis, ou aurait eu tout prêts, les fouets, le feu, les chevalets, les potences, et les autres instruments de la colère et de la vengeance. Mais ceux qui punissent de la sorte les sacrilèges se défient du pouvoir de leurs dieux. Car s'ils sont persuadés qu'ils ont quelque pouvoir, ils leur doivent laisser le soin de venger leurs propres injures. Ils croient que c'est par leur permission ou par leur ordre, que les coupables sont découverts et arrêtés ; quand ils les ont entre les mains, ils les châtient moins par colère, que par crainte d'être châtiés en leur place. N'est-ce pas une extravagance insupportable, d'appréhender que les dieux, qui n'ont pu faire de mal à ceux qui les ont dépouillés, ne fassent souffrir à des innocents la peine de ces sacrilèges? On dira peut-être qu'ils ont quelquefois puni les coupables; s'ils les ont quelquefois punis, ce n'a été que par hasard, puisqu'ils ne les ont pas toujours punis. Je ferai voir dans la suite de quelle manière cela est arrivé. Je demande cependant pourquoi les dieux n'ont pas réprimé une insolence aussi manifeste et aussi publique que celle avec laquelle Denys le Tyran les avait joués? Pourquoi ne chassaient-ils pas de leurs temples ce fameux sacrilège, et pourquoi ne lui défendaient-ils pas de regarder leurs images et d'assister à leurs cérémonies? Pourquoi permettaient-ils qu'il eut une navigation heureuse, et qu'il dit, en raillant, selon sa coutume, ceux de sa suite qui appréhendaient le naufrage : « Vous voyez combien les dieux sont propices à eux-mêmes qui violent la sainteté de leurs temples. » C'est qu'il avait peut-être appris de Pluton que les dieux ne sont rien. Que dirons-nous de Verrès que Cicéron compare à Denys, à Phalaris et aux autres tyrans? Quand il pilla la Sicile, n'enleva-t-il pas tous les ornements des temples et toutes les images des dieux? Je n'ai pas assez de loisir pour m'arrêter à toutes les circonstances ; je n'en marquerai qu'une seule sur laquelle ce fameux accusateur déploya toute son éloquence, je parle de la profanation des mystères de Cérès de Catane ou d'Enna : l'une était honorée avec un si profond respect qu'il n'était pas permis aux hommes d'entrer dans son temple; le culte de l'autre était si ancien que toutes les histoires font foi qu'elle inventa la première, dans le territoire d'Enna, où sa fille fut enlevée, l'art de semer les grains. Enfin, lorsque la tranquillité publique fut troublée par les séditions des Gracques, on trouva dans les livres des sibylles et on reconnut même par les prodiges qui parurent, qu'il fallait apaiser l'ancienne Cérès, et on envoya à cet effet des ambassadeurs à Enna. Cérès, soit que ce fût la plus mystérieuse, qu'il n'était pas permis aux hommes de voir, non pas même à dessein de lui rendre leurs respects, ou bien que ce fût la plus ancienne, que le sénat et le peuple apaisèrent par des sacrifices, cette Cérès, dis-je, fut enlevée impunément de l'endroit le plus secret et le plus saint de son temple, par des voleurs auxquels Verrès avait donné cet ordre. Quand le même orateur exprime la manière dont les habitants de Sicile l'avaient prié d'entreprendre leur défense, il témoigne « qu'ils n'avaient plus de dieux dont ils pussent implorer la protection, comme si Verrès eût chassé les dieux du ciel, en ôtant leurs images des temples. » Il paraît par là que les dieux ne sont autre chose que la matière dont leurs images sont formées. Les Siciliens eurent raison d'avoir recours à vous, Cicéron, après avoir reconnu pendant trois ans combien leurs dieux avaient peu de pouvoir. Ils auraient eu fort peu de sens s'ils les eussent priés de les défendre contre Verrès, eux qui n'avaient pu lui témoigner aucun ressentiment des outrages qu'il leur avait faits. Mais Verrès fut condamné pour ces sacrilèges. Ce ne furent donc pas les dieux qui le châtièrent ; ce fut Cicéron qui eut l'adresse de ruiner ou le pouvoir ou la faveur de ceux qui le protégeaient. On peut dire de plus que l'arrêt qui fut prononcé contre lui, fut moins une condamnation qu'une décharge. Les dieux lui accordèrent une aussi agréable tranquillité qu'ils avaient accordée à Denys le Tyran une navigation heureuse. Sa condamnation même, qui l’éloigna des emplois, le garantit des dangers qui en enlevèrent beaucoup d'autres durant la fureur des guerres civiles. Il demeura seul debout pendant que d'autres tombaient de tous côtés, lui qui semblait être tombé seul pendant que les autres étaient demeurés debout. Enfin il jouit longtemps des richesses immenses qui étaient le fruit de ses sacrilèges, et les posséda jusqu'à une extrême vieillesse, et jusqu'à ce qu'il fut enlevé du monde par la proscription du même triumvirat, par laquelle Cicéron, ce fameux défenseur de la puissance outragée des dieux, fut aussi enlevé. Il eut le plaisir même d'apprendre, avant d'expirer, le genre cruel de mort qu'on avait fait souffrir à son accusateur, comme si les dieux eussent pris soin que ce profanateur de la sainteté de leurs temples, eût en mourant la consolation de se voir vengé des déclamations de Cicéron.
|
|
CAPUT V. Quod solus omnium creator Deus est colendus, non vero elementa, nec corpora coelestia: Refelliturque Stoicorum sententia, qui stellas et astra deos putant. Quanto igitur rectius est, omissis insensibilibus et vanis, oculos eo tendere, ubi sedes, ubi habitatio est Dei veri; qui terram stabili firmitate suspendit; qui coelum distinxit astris fulgentibus; qui solem rebus humanis clarissimum, ac singulare lumen, in argumentum suae unicae majestatis accendit: terris autem maria circumfudit, flumina sempiterno lapsu fluere praecepit.
Jussit et extendi campos, subsidere
valles, ·uae utique omnia non Jupiter fecit, qui ante annos mille septingentos natus; sed idem: Ille opifex rerum, mundi melioris origo, qui vocatur Deus, cujus principium, quoniam non potest comprehendi, ne quaeri quidem debet. Satis est homini ad plenam perfectamque prudentiam, si Deum esse intelligat: cujus intelligentiae vis et summa haec est, ut suspiciat et honorificet communem parentem generis humani, et rerum mirabilium fabricatorem. Unde quidam hebetis obtusique cordis, elementa, quae et facta sunt et carent sensu, tamquam deos adorant. Qui cum Dei opera mirarentur, id est coelum cum variis luminibus, terram cum campis et montibus, maria cum fluminibus et stagnis et fontibus, earum rerum admiratione obstupefacti, et ipsius artificis obliti, quem videre non poterant, ejus opera venerari et colere coeperunt; nec umquam intelligere quiverunt, quanto major quantoque mirabilior sit, qui illa fecit ex nihilo. Quae cum videant divinis legibus obsequentia commodis atque usibus hominis perpetua necessitate famulari, tamen illa deos existimant esse; ingrati adversus beneficia divina, qui Deo et patri indulgentissimo sua sibi opera praetulerunt. Sed quid mirum, si aut barbari, aut imperiti homines errant? cum etiam philosophi Stoicae disciplinae in eadem sint opinione, ut omnia coelestia, quae moventur, in deorum numero habenda esse censeant; siquidem Lucilius Stoicus apud Ciceronem sic loquitur: « Hanc igitur in stellis constantiam, hanc tantam in tam variis cursibus in omni aeternitate convenientiam temporum, non possum intelligere sine mente, ratione, consilio; quae cum in sideribus esse videamus, non possumus ea ipsa non in deorum numero reponere. » Item paulo superius: « Restat, inquit, ut motus astrorum sit voluntarius; quae qui videat, non indocte solum, verum etiam impie faciat, si deos esse neget. » Nos vero et quidem constanter negamus, ac vos, o philosophi, non solum indoctos et impios, verum etiam caecos, ineptos delirosque probamus, qui ignorantiam imperitorum vanitate vicistis. Illi enim solem et lunam, vos etiam sidera deos putatis. Tradite igitur nobis stellarum mysteria, ut aras et templa singulis erigamus; ut sciamus quo quamque ritu, quo die colamus, quibus nominibus, quibus precibus advocemus; nisi forte nullo discrimine tam innumerabiles, tam minutos deos acervatim colere debemus. Quid quod argumentum illud, quo colligunt universa coelestia deos esse, in contrarium valet. Nam si deos esse idcirco opinantur, quia certos et rationabiles cursus habent, errant. Ex hoc enim apparet deos non esse, quod exorbitare illis a praestitutis itineribus non licet. Caeterum si dii essent, huc atque illuc passim sine ulla necessitate ferrentur, sicut animantes in terra, quarum quia liberae sunt voluntates, huc atque illuc vagantur, ut libuit, et quo quamque mens duxerit, eo fertur. Non est igitur astrorum motus voluntarius, sed necessarius, quia praestitutis legibus officiisque deserviunt. Sed cum disputaret de cursibus siderum, quos ex ipsa rerum ac temporum congruentia intelligebat non esse fortuitos, existimavit voluntarios esse, tamquam non possent tam disposite, tam ordinate moveri, nisi sensus illis inesset officii sui sciens. O quam difficilis est ignorantibus veritas, et quam facilis scientibus! Si motus, inquit, astrorum fortuiti non sunt, nihil aliud restat, nisi ut voluntarii sint; immo vero, ut non esse fortuitos manifestum est, ita nec voluntarios. Quomodo igitur in conficiendis itineribus constantiam suam servant? Nimirum Deus, universi artifex, sic illa disposuit, sic machinatus est, ut per spatia coeli divina et admirabili ratione decurrerent, ad efficiendas succedentium sibi temporum varietates. An Archimedes Siculus concavo aere similitudinem mundi ac figuram potuit machinari, in quo ita solem ac lunam composuit, ut inaequales motus, et coelestibus similes conversionibus, singulis quasi diebus efficerent, et non modo accessus solis et recessus, vel incrementa diminutionesque lunae, verum etiam stellarum, vel inerrantium, vel vagarum, dispares cursus orbis ille, dum vertitur, exhiberet? Deus ergo illa vera non potuit machinari et efficere quae potuit solertia hominis imitatione simulare? Utrumne igitur stoïcus, si astrorum figuras in illo aere pictas effictasque vidisset, suo illa consilio moveri diceret, ac non potius artificis ingenio? Inest ergo sideribus ratio ad peragendos meatus suos apta: sed Dei est illa ratio, qui et fecit, et regit omnia, non ipsorum siderum, quae moventur. Nam si solem stare voluisset, perpetuus utique dies esset. Item, si motus astra non haberent, quis dubitet sempiternam noctem fuisse futuram? Sed ut diei ac noctis vices essent, moveri ea voluit: et tam varie moveri, ut non modo lucis ac tenebrarum mutuae vicissitudines fierent, quibus laboris et quietis alterna spatia constarent; sed etiam frigoris et caloris, ut diversorum temporum vis ac potestas, vel generandis, vel maturandis frugibus conveniret. Quam solertiam divinae potestatis in machinandis itineribus astrorum, quia philosophi non videbant, animalia esse sidera putaverunt; tamquam pedibus, et sponte, non divina ratione procederent. Cur autem illa excogitaverit Deus, quis non intelligit? Scilicet ne solis lumine decedente, nimium caeca nox tetris atque horrentibus tenebris ingravesceret, noceretque viventibus. Itaque et coelum simul mira varietate distinxit, et tenebras ipsas multis minutisque luminibus temperavit. Quanto igitur Naso prudentius, quam illi, qui sapientiae studere se putant, qui sentit a Deo lumina illa, ut honorem tenebrarum depellerent, instituta! Is eum librum, quo Φαινόμενα breviter comprehendit, his tribus versibus terminavit:
Tot numero, talique Deus simulacra
figura Quod si fieri non potest, ut stellae dii sint; ergo nec sol quidem, nec luna dii esse possunt, quoniam luminibus astrorum, non ratione differunt, sed magnitudine. Quod si hi dii non sunt; ergo nec coelum quidem, in quo illa omnia continentur. CAPUT VI. Quod nec mundus totus, nec elementa sint Deus, nec animata. Simili modo si terra, quam calcamus, quam subigimus et colimus ad victum, deus non est, nec campi quidem ac montes dii erunt: sed si hi non sunt, ergo ne tellus quidem universa Deus videri potest. Item si aqua, quae servit animantibus ad usum bibendi aut lavandi, deus non est, nec fontes quidem, ex quibus aqua profluit. Si fontes non sunt, nec flumina quidem, quae de fontibus colliguntur. Si flumina quoque dii non sunt, ergo et mare, quod ex fluminibus constat, Deus haberi non potest. Quod si neque coelum, neque terra, neque mare, quae mundi partes sunt, dii esse possunt; ergo ne mundus quidem totus Deus est, quem iidem ipsi stoïci, et animantem, et sapientem esse contendunt, et propterea Deum: in quo tam inconstantes fuerunt, ut nihil dictum sit ab his quod non ab iisdem fuerit eversum. Sic enim argumentantur: Fieri non posse, ut sensu careat, quod sensibilia ex se generat. Mundus autem generat hominem, qui est sensu praeditus; ergo et ipsum sensibilem esse. Item: Sine sensu esse non posse, cujus pars habeat sensum; igitur quia homo sensibilis est, etiam mundo, cujus pars homo est, inesse sensum. Propositiones quidem verae sunt, et sensibile esse, quod sensu praeditum gignat, et habere sensum, cujus pars sensu aucta sit: sed assumptiones falsae, quibus argumenta concludunt, quia neque mundus generat hominem, neque homo mundi pars est. Nam hominem a principio idem Deus fecit, qui et mundum: et non est mundi pars homo, sicut corporis membrum; potest enim mundus esse sine homine, sicut urbs, et domus. Atqui ut domus unius hominis habitaculum est, et urbs unius populi; sic et mundus domicilium totius generis humani. Et aliud est, quod incolitur, aliud quod incolit. Sed illi, dum student id, quod falso susceperant, confirmare, et sensibilem esse mundum, et Deum, argumentorum suorum consequentia non viderunt. Nam si mundi pars est homo, et sensibilis est mundus, quia homo sentit: ergo quia mortalis est homo, mortalis sit et mundus necesse est; nec tantum mortalis, sed et omnibus morbis et passionibus subjectus. Et e contrario: Si Deus est mundus, et partes ejus utique immortales sunt; ergo et homo Deus est, quia pars est (ut dicitis) mundi. Si homo; ergo et jumenta, et pecudes, et caetera genera bestiarum, et avium, et piscium; quoniam et illa eodem modo sentiunt, et mundi partes sunt. At hoc tolerabile est: nam et haec colunt Aegyptii. Sed res eo pervenit, ut et ranae, et culices, et formicae dii esse videantur, quia et ipsis inest sensus, et partes mundi sunt. Ita semper argumenta ex falso petita ineptos et absurdos exitus habent. Quid, quod iidem ipsi aiunt, deorum et hominum causa mundum esse constructum, quasi communem domum: ergo nec mundus Deus est, nec animans, si constructus est; animans enim non construitur, sed nascitur. Et si est aedificatus sic utique tamquam domus, tamquam navis; est ergo aliquis artifex mundi Deus; et seorsum erit mundus, qui factus est, seorsum ille, qui fecit. Jam illud quam repugnans et absurdum, quod cum coelestes ignes caeteraque mundi elementa deos affirment, item ipsum deum mundum dicunt. Quomodo potest ex deorum multorum acervo unus Deus confici? Si astra dii sunt, mundus ergo non Deus, sed domicilium deorum est. Si vero Deus mundus est; ergo omnia illa quae sunt in eo dii non sunt, sed Dei membra, quae utique sola Dei nomen accipere non possunt. Nec enim recte quis dixerit, membra hominis unius multos homines esse: sed tamen non est similis comparatio animalis et mundi. Animal enim, quia sensu praeditum est, etiam membra ejus habent sensum, nec, nisi a corpore divulsa, brutescunt. Cujus igitur rei similitudinem gerit mundus? Nimirum ipsi docent, cum factum esse non diffitentur, ut esset diis et hominibus quasi communis domus. Si ergo est constructus, ut domus, nec ipse Deus est, nec elementa, quae sunt partes ejus; quia neque domus habere dominium sui potest, neque illa de quibus domus constat. Non tantum igitur veritate, sed etiam verbis suis revincuntur. Sicut enim domus, in usum habitandi facta, per se nihil sentit, dominoque subjecta est, qui eam fecit, aut incolit: ita mundus, per se nihil sentiens, factori Deo subjacet, qui eum in usum sui fecit. CAPUT VII. De Deo, et religionibus insipientium; de avaritia et majorum auctoritate. Duplici ergo ratione peccatur ab insipientibus: primum, quod elementa, id est Dei opera Deo praeferunt; deinde, quod elementorum ipsorum figuras humana specie comprehensas colunt. Nam solis lunaeque simulacra humanum in modum formant; item ignis, et terrae, et maris, quae illi Vulcanum, Vestam, Neptunum vocant; nec elementis ipsis in aperto litant. Tanta homines imaginum cupiditas tenet, ut jam viliora ducantur illa quae vera sunt: auro scilicet, gemmis, et ebore delectantur. Horum pulchritudo ac nitor praestringit oculos: nec ullam religionem putant ubicumque illa non fulserint. Itaque sub obtentu deorum avaritia et cupiditas colitur. Credunt enim deos amare quidquid ipsi concupiscunt; quiquid est, propter quod furta, et latrocinia, et homicidia quotidie saeviunt; propter quod bella per totum orbem populos urbesque subvertunt. Consecrant ergo diis manubias et rapinas suas, quos certe necesse est imbecilles esse, ac summae virtutis expertes, si subjecti sunt cupiditatibus. Cur enim coelestes eos putemus, si desiderant aliquid de terra? vel beatos, si aliqua re indigent? vel incorruptos, si voluptati habent ea in quibus appetendis cupiditas hominum non immerito damnatur? Veniunt igitur ad deos, non tam religionis gratia, quae nulla potest esse in rebus male partis et corruptibilibus, quam ut aurum oculis hauriant, nitorem levigati marmoris, aut eboris aspiciant; ut insignes lapillis et coloribus vestes, vel distincta gemmis fulgentibus pocula insatiabili contemplatione contrectent. Et quanto fuerint ornatiora templa, et pulchriora simulacra, tanto plus majestatis habere creduntur: adeo religio eorum nihil aliud est, quam quod cupiditas humana miratur.
Hae sunt religiones, quas sibi a
majoribus suis traditas pertinacissime tueri ac defendere
perseverant: nec considerant quales sint; sed ex hoc probatas atque
veras esse confidunt, quod eas veteres tradiderunt, tantaque est
auctoritas vetustatis, ut inquirere in eam scelus esse dicatur.
Itaque creditur ei passim, tamquam cognitae veritati. Denique apud
Ciceronem sic dicit Cotta Lucilio: « Habes, Balbe, quid Cotta, quid
pontifex sentiat. Fac nunc ego intelligam, quid tu sentias; a te
enim philosopho rationem religionis accipere debeo, majoribus autem
nostris, etiam nulla ratione reddita, rationis est credere. » Si
credis, cur ergo rationem requiris, quae potest efficere ne credas?
Si vero rationem requiris, et quaerendam putas, ergo non credis.
Ideo enim quaeris, ut eam sequaris, cum inveneris. Docet ecce te
ratio non esse veras religiones deorum. Quid facies? majoresne
potius, an rationem sequeris? quae quidem tibi non ab alio
insinuata, sed a te ipso inventa et electa est, cum omnes religiones
radicitus eruisti. Si rationem mavis, discedere te necesse est ab
institutis et auctoritate majorum; quoniam id solum rectum est quod
ratio praescribit. Sin autem pietas majores sequi suadet, fatere
igitur, et stultos illos fuisse, qui excogitatis contra rationem
religionibus servierunt, et te ineptum qui id colas, quod falsum
esse convinceris. Sed tamen quoniam nobis tantopere majorum nomen
opponitur, videamus tandem qui fuerint majores illi, a quorum
auctoritate discedi nefas ducitur.
Buccina cogebat priscos ad verba
Quirites: Hi sunt Patres, quorum decretis eruditi ac prudentes viri devotissime serviunt, idque verum ac immutabile omnis posteritas judicet, quod centum pelliti senes statutum esse voluerunt, quos tamen, ut in primo libro dictum est, Pompilius illexit, ut vera crederent esse sacra quae ipse tradebat. Est vero, cur illorum auctoritas tanti habeatur a posteris, quos nemo, cum viverent, neque summus, neque infimus affinitate dignos judicavit? |
V. Combien est-il plus juste et plus raisonnable de renoncer au culte de toutes les choses insensibles, et de tourner les yeux du côté où est le palais et le trône du véritable Dieu, qui a affermi la terre sur des fondements inébranlables, qui a attaché les astres au firmament, qui a donné la lumière au soleil, afin qu'elle fût une image de la majesté invisible, qui a répandu la mer autour de la terre, qui a donné aux fleuves un mouvement perpétuel : Qui a étendu les campagnes, qui a élevé les montagnes qui a abaissé les vallées, et qui a revêtu d'arbres les forêts. C'est un principe dont il ne faut point chercher le commencement, parce qu'il n'en a point et qu'on ne le saurait trouver. L'homme se doit contenter de savoir qu'il y a un Dieu, de l'honorer comme le père du genre humain et comme l’auteur des merveilles de l'univers. Quelques-uns ont été assez grossiers et assez stupides pour adorer les éléments, bien qu'ils aient été créés et qu'ils soient privés de sentiment. Quand ils ont considéré le ciel avec les astres, la terre avec les plaines et les montagnes, la mer avec les rivières et les étangs, ils ont été surpris d'une si grande admiration, qu'ils ont oublié l'ouvrier pour ne révérer que les ouvrages. Ils n'ont pu comprendre combien il est élevé au-dessus des choses qu'il a tirées du néant, qu'il tient soumises à ses ordres, et qu'il fait servir aux besoins et aux commodités de l'homme. Ils se rendent sans doute coupables de la plus criminelle de toutes les ingratitudes, quand, au lieu de conserver la mémoire des bienfaits qu'ils ont reçus de la bonté de Dieu, ils prennent les créatures pour des dieux, et les préfèrent à lui. Mais faut-il s'étonner que des ignorants soient tombés dans cette erreur, puisque les stoïciens sont persuadés que les astres doivent être mis au rang des dieux ? Lucilius, philosophe stoïcien, en parle dans Cicéron en ces termes: « Je ne saurais concevoir que les étoiles aient un mouvement si juste et si égal, ni qu'elles règlent comme elles le font par leur cours la diversité des saisons dans la suite de tous les siècles, si elles n'avaient une âme, une intelligence et une raison. Que si elles en ont une, nous ne saurions refuser de les mettre au rang des dieux. » Il avait dit un peu auparavant: « Le mouvement des astres doit être volontaire ; ce qui étant, on ne saurait nier non seulement sans ignorance, mais encore sans impiété, qu'ils ne soient des dieux. » Nous le nions cependant très fortement, et nous faisons voir très clairement que vous autres, qui prétendez être philosophes, n'êtes non seulement que des ignorants et des impies, mais encore que des aveugles et des insensés, et que vous allez au delà de la stupidité des peuples : car vous communiquez indifféremment les honneurs divins à tous les astres, au lieu que le peuple ne les a déférés qu'à la lune et au soleil. Découvrez-nous donc le secret de la religion des étoiles, et nous enseignez la manière dont nous devons bâtir des temples et élever des autels à chacune; en quel jour nous les devons révérer, sous quel nom, avec quelles cérémonies, par quelle prière nous les devons célébrer, ou s'il est plus à propos de les prier toutes en commun ou en général. L'argument dont ils se servent pour prouver que les étoiles sont des dieux, peut servir à prouver tout le contraire. C'est une erreur de prendre l'égalité de leur mouvement et de leur cours, pour une preuve de leur divinité. Au contraire si elles étaient des dieux, leur mouvement dépendrait de leur volonté, et elles paraîtraient où il leur plairait dans le ciel, comme les animaux vont où il leur plaît sur la terre. Le mouvement des astres n'est donc pas volontaire, mais nécessaire, parce qu'ils suivent la loi qui leur est imposée. Mais ce philosophe ayant reconnu, par l'ordre si réglé des saisons, que le cours des astres ne peut être un effet du hasard, il a cru qu'il dépendait d'une volonté libre, comme si les astres ne pouvaient avoir un cours si juste et si réglé, sans avoir la connaissance de l'utilité des secours et des avantages qu'en tirent les créatures inférieures. Que la vérité est difficile et obscure à ceux qui l'ignorent, mais qu'elle est aisée et claire à ceux qui la connaissent! « Si le mouvement des astres, disent ces philosophes, ne dépend pas du hasard, il dépend du libre arbitre. » Au contraire, il est aussi clair qu'il ne dépend pas du libre arbitre, qu'il est clair qu'il ne dépend pas du hasard. Comment donc se peut-il faire que leur cours soit si réglé? C'est que Dieu qui a créé l'univers, les a disposés de telle sorte, qu'en faisant le tour du ciel ils mesurent le temps et règlent les saisons. Archimède a pu inventer une sphère de cuivre où il a mis un soleil et une lune, qui imitent la marche des astres eux-mêmes et qui représentent des jours ; il a pu marquer dans ce globe artificiel les changements de la lune, l'inégalité du cours des planètes ou des étoiles fixes, et Dieu n'aura pu faire le véritable modèle de ce globe ! Un stoïcien, voyant la sphère d'Archimède, aurait-il dit que ces figures du soleil, de la lune et des étoiles se remuaient par un effet de leur volonté ou par celui des machines qu'un mathématicien avait inventées? Il y a une raison et une intelligence qui règle le cours des astres, mais c'est la raison et l'intelligence de Dieu qui a créé toutes choses et qui les gouverne, et non pas ces astres mêmes. Si Dieu avait voulu que le soleil fût demeuré immobile, il y aurait eu un jour perpétuel dans les lieux qui avaient été éclaires de sa lumière; si les autres astres étaient immobiles, il est certain aussi qu'ils n'auraient point reçu d'autre clarté que celle qu'ils répandent. Mais Dieu leur a imprimé un mouvement accompagné d'une si merveilleuse diversité, que non seulement il fait succéder tour à tour le jour à la nuit, dont l'un est destiné au travail et l'autre au repos, mais qu'il partage aussi le froid et le chaud entre les saisons, avec la justesse qui est nécessaire pour produire les fruits et les grains et pour leur donner une juste maturité. L'ignorance où les philosophes ont été de la sagesse admirable avec laquelle la puissance divine a réglé le cours des astres, les a portés à croire que ces astres étaient comme les animaux qui ont eux-mêmes le mouvement. Il n'y a cependant personne qui ne reconnaisse que Dieu a placé les astres dans le ciel, et leur a assigné la route qu'ils tiennent, de peur que quand le soleil disparait, la terre ne soit couverte d'une très grande obscurité. Voilà pourquoi il a attaché au firmament une multitude si prodigieuse d'étoiles, dont la lumière dissipe une partie des ténèbres de la nuit. Ovide en a jugé plus sagement que ces hommes qui font profession de l'étude de la sagesse, quand, dans un petit livre où il décrit les phénomènes, il assure que, quelque merveilleuse que soit ou la multitude ou la diversité des astres, il n'y en a aucun que Dieu n'ait placé dans le ciel, et qu'il n'ait destiné à répandre quelque lumière sur la terre et à diriger une partie de l'obscurité de la nuit. Que s'il n'est pas possible que les étoiles soient des dieux, il n'y a pas plus de raison d'y mettre le soleil ou la lune, puisqu'ils diffèrent des autres astres, non par l'intelligence, mais par la grandeur; et si ce ne sont pas des dieux, encore moins le ciel qui ne fait que les renfermer tous. VI. On peut dire de la même sorte que si la terre que nous foulons aux pieds, que nous remuons et que nous cultivons pour en tirer de quoi nous nourrir, n'est pas un Dieu, les plaines ni les montagnes ne sont pas des dieux : si l'eau dont les animaux se servent pour boire et pour se laver n'est pas un dieu, les sources d'où elle coule, les fontaines, les rivières, les fleuves et la mer même qui se grossit de ces fleuves ne doit pas passer pour un dieu. Que si ni le ciel, ni la terre, ni la mer, qui sont les principales parties du monde, ne sont pas des dieux, le monde entier n'est pas un dieu, bien que les stoïciens lui aient attribué la vie, la sagesse et la divinité. Ils s'accordent néanmoins si peu en cela avec eux-mêmes, qu'ils renversent ce qu'ils avaient dessein d'élever. Voici comment ils raisonnent : Il n'est pas possible que ce qui produit des êtres qui ont du sentiment, soit privé du sentiment ; le monde produit l'homme qui a du sentiment; le monde en a donc aussi bien que l'homme. De plus, le tout dont une partie a du sentiment, a aussi du sentiment; le monde est un tout dont l'homme qui en est une partie, a du sentiment ; le monde en a donc. Les deux premières propositions de chaque syllogisme sont véritables; savoir, que ce qui produit un être qui a du sentiment doit avoir du sentiment, et qu'un tout dont une partie a du sentiment en a aussi. Mais les deux suivants ne le sont pas ; car le monde ne produit point l'homme, et l'homme n'est point une partie du monde. L'homme a été créé par le même Dieu que le monde, et il n'est point une partie du monde, comme un membre est une partie du corps. Le monde peut être sans l'homme, comme une maison ou une ville peut exister sans l'homme. Une maison est le lieu et la demeure d'un homme. Une ville est le lieu et la demeure d'un peuple, et le monde est le lieu et la demeure du genre humain. Autre chose est le lieu où demeure une personne, et autre chose la personne qui demeure dans ce lieu. Mais pendant que ces philosophes s'efforcent de prouver la fausse opinion dont ils se sont laissé prévenir : « que le monde a du sentiment et quelque chose de divin, » ils ne prévoient pas les conséquences que l'on peut tirer contre eux de leurs principes. Si l'homme est une partie du monde, et si le monde a du sentiment parce que l'homme en a, il sera donc sujet à la mort parce que l'homme y est sujet, et ne sera pas seulement sujet à la mort, mais encore aux maladies et aux autres infirmités humaines. On peut encore tirer cette conséquence contre eux : Si le monde est dieu, les parties qui le composent seront immortelles : l'homme sera immortel et partant Dieu, puisqu'il est une partie du monde, selon l'opinion de ces philosophes. Si l'homme est dieu parce qu'il est une partie du monde, les animaux, les oiseaux et les poissons seront aussi des dieux, parce qu'ils sont des parties du même monde et qu'ils ont du sentiment. Cela est peut-être supportable, parce que les Egyptiens adorent ces animaux. Mais ou pourra dire par la même raison que les souris, les puces et les fourmis sont des dieux, parce qu'elles ont du sentiment et qu'elles sont des parties du monde. Voilà comment les faux principes produisent toujours d'impertinentes conséquences. Quel jugement ferons-nous de ce que les mêmes philosophes avancent : que le monde a été bâti comme un palais pour loger les dieux et les hommes? Si le monde a été bâti de la sorte, ce n'est pas un dieu, et non pas même un animal; car les animaux sont nés et n'ont pas été bâtis. Que s'il a été bâti comme une maison ou comme un vaisseau, il y a eu un dieu qui l'a bâti, et ce dieu est autre que le monde même. Ce qu'ils disent : que les astres et les éléments sont des dieux, s'accorde-t-il avec ce qu'ils disent que le monde est un dieu? Comment peut-on faire un seul dieu de l'assemblage de plusieurs dieux ? Si les astres sont des dieux, le monde sera leur palais et ne sera pas un dieu. Si le monde au contraire est un dieu, les astres et les éléments ne seront pas des dieux, mais seulement les membres et les parties de dieu ; et on ne pourra pas les appeler proprement des dieux, comme on n'appelle pas proprement homme la partie du corps d'un homme. De plus, quand on compare le monde à un animal, la comparaison n'est pas juste ; car l'animal a le sentiment répandu dans tous ses membres. A quoi donc peut-on comparer le monde pour faire la comparaison plus juste? Les philosophes le disent eux-mêmes quand ils avouent qu'il a été bâti comme un palais pour loger les dieux et les hommes. Puisqu'il a été bâti comme un palais, il n'est pas dieu, ni les éléments qui les composent ne sont pas des dieux. Un palais, ni ce qui entre dans la construction d'un palais, ne peut avoir aucun droit de disposer de soi. L'opinion de ces philosophes est donc détruite par leurs propres paroles aussi bien que par la vérité. Car le monde qui n'a point de sentiment dépend de Dieu qui l'a fait pour son usage, comme une maison dépend de l'homme qui l'a bâtie ou qui l'habite. VII. Les païens tombent dans deux extravagances : l'une est qu'ils préfèrent à Dieu les éléments, qui ne sont que les ouvrages de Dieu ; l'autre qu'ils donnent à ces éléments une forme humaine. Car, au lieu d'adorer simplement le soleil et la lune, ou bien le feu, la terre et la mer qu'ils appellent Vulcain, Vesta, Neptune, ils leur donnent une figure d'hommes. Ils prennent un si grand plaisir à regarder les images et les portraits, qu'ils semblent mépriser la vérité et les originaux. Ils ne veulent voir que de l'ivoire, de l'or et des perles. Ils sont tellement éblouis de l'éclat de ces riches matières, qu'ils croient que sans elles il n'y a point de piété. Ainsi, ils adorent la cupidité et l'avarice sous prétexte d'adorer les dieux. Ils se persuadent que les dieux aiment ce qu'ils aiment eux-mêmes, ce pourquoi ils commettent des vols, des brigandages et des homicides, et se font des guerres cruelles qui troublent la tranquillité publique; voilà pourquoi ils consacrent à leurs dieux une partie du butin et des dépouilles qu'ils ont remportés. Il faut que ces dieux-là soient bien faibles, s'ils désirent des choses si misérables. Croyons-nous qu'ils soient dans le ciel s'ils souhaitent les biens de la terre, qu'ils soient heureux s'ils ont besoin de nos présents, et qu'ils soient incorruptibles s'ils jouissent des plaisirs que nous ne saurions rechercher que par une cupidité blâmable? Les païens vont donc dans les temples non par piété, parce qu'il n'y en peut avoir dans des biens ou acquis par de mauvais moyens, ou sujets à la corruption, mais par la curiosité de voir de l'ivoire et du marbre bien travaillés, enrichis d'ornements magnifiques, des vases d'or et des perles précieuses. Ils s'imaginent que plus les temples et les images sont bien parés, plus ils méritent de respect. Ainsi, toute leur religion se borne à adorer ce que leur cupidité admire. Voilà les religions qu'ils prétendent avoir reçues de leurs ancêtres, et qu'ils soutiennent avec une opiniâtreté invincible. Ils n'en examinent point la vérité. Ils se contentent de savoir qu'elles sont anciennes, et l'antiquité a une autorité si absolue sur leurs esprits, qu'ils croiraient que ce serait un crime de douter de ce qu'elle a une fois approuvé. Ils reçoivent comme une vérité généralement reconnue tout ce que le temps autorise. C'est pour cela que Cicéron fait parler Cotta à Lucilius en ces termes : « Vous voyez, mon cher Balbus, quel est le sentiment du pontife Cotta. Je vous supplie de me déclarer maintenant le vôtre : car un philosophe comme vous doit rendre raison de la religion, au lieu que la raison même nous oblige de croire ce que les anciens nous enseignent, bien qu'ils n'en rendent aucune raison. » Si vous croyez ce que les anciens enseignent, pourquoi demandez-vous à un philosophe une raison qui détruira peut-être votre croyance ? Si vous demandez une raison et que vous souhaitiez de la connaître pour la suivre, c'est que vous ne croyez pas ce que les anciens vous enseignent. Supposons que la raison vous fasse voir que la religion des dieux est fausse ; que ferez-vous en ce cas-là ? Suivrez-vous les anciens ou la raison? Si vous préférez la raison, et que vous teniez qu'il n'y a de bon chemin que celui qu'elle montre, vous renoncerez à l'autorité de vos ancêtres. Que si la piété vous porte au contraire à écouter leur voix, il faut que vous reconnaissiez qu'ils avaient perdu le sens, quand ils ont suivi des religions contraires à la raison, et que vous n'êtes pas vous-même raisonnable quand vous aurez des dieux de la fausseté desquels vous êtes convaincus. Néanmoins, comme on nous oppose perpétuellement les anciens, examinons un peu quels sont ces anciens à l'autorité desquels il n'est pas permis de se soustraire. Quand Romulus eut résolu de fonder une ville, il assembla une troupe de pasteurs parmi lesquels il avait été élevé; mais parce qu'ils n'étaient pas en assez grand nombre pour la remplir, il en fit un lieu d'asile, où tout ce qu'il y avait de scélérats à l'entour se rendirent en foule. Ce furent là les premiers habitants de la ville, parmi lesquels il en choisit cent des plus âgés qu'il appela pères et sénateurs, et sans l'avis desquels il ne voulait rien entreprendre. Properce parle de cette assemblée en ces termes: Le sénat qui possède maintenant une autorité si absolue et si redoutable, ne fut composé au commencement que d'une troupe de paysans vêtus de peaux. Ils s'assemblaient ordinairement au son d'un cor, et n'avaient point d'autre lieu de réunion qu'une prairie émaillée de fleurs. Voilà les vénérables vieillards au jugement desquels les plus éclairés et les plus sages se doivent soumettre, et dont toute la postérité doit recevoir les arrêts comme des oracles infaillibles. Ce sont pourtant les mêmes auxquels Numa imposa des lois et auxquels il fit accroire que les mystères qu'il enseignait étaient véritables et qu'il les avait appris d'une déesse. Leur autorité doit être sans doute fort grande après leur mort, puisque leur mérite a été si considérable durant leur vie, qu'il ne s'en trouve personne qui n'ait refusé leur alliance.
|
|
CAPUT VIII. De rationis usu in religione; deque somniis, auguriis, oraculis, talibusque portentis. Quare oportet, in ea re maxime in qua vitae ratio versatur, sibi quemque confidere, suoque judicio ac propriis sensibus magis niti ad investigandam et perpendendam veritatem; quam credentem alienis erroribus decipi tamquam ipsum rationis expertem. Dedit omnibus Deus pro virili portione sapientiam, ut et inaudita investigare possent, et audita perpendere. Nec quia nos illi temporibus antecesserunt, sapientia quoque antecesserunt; quae si omnibus aequaliter datur, occupari ab antecedentibus non potest. Illibabilis est tamquam lux et claritas solis, quia ut sol oculorum, sic sapientia lumen est cordis humani. Quare cum sapere, id est, veritatem quaerere, omnibus sit innatum, sapientiam sibi adimunt, qui sine ullo judicio inventa majorum probant, et ab aliis pecudum more ducuntur. Sed hoc eos fallit, quod majorum nomine posito, non putant fieri posse, ut aut ipsi plus sapiant, quia minores vocantur, aut illi desipuerint, quia majores nominantur. Quid ergo impedit, quin ab ipsis sumamus exemplum; ut quomodo illi, quae falsa invenerant, posteris tradiderunt, sic nos, qui verum invenimus, posteris meliora tradamus? Superest ingens quaestio, cujus disputatio non ab ingenio, sed a scientia venit, quae pluribus explicanda erit, ne quid omnino dubium relinquatur. Nam fortasse aliquis ad illa confugiat, quae a multis et non dubiis traduntur auctoribus; eos ipsos, quos docuimus deos non esse, majestatem suam persaepe ostendisse, et prodigiis, et somniis, et auguriis, et oraculis. Et sane multa enumerari possunt digna miraculo: in primis illud, quod Accius Navius summus Augur, cum Tarquinium Priscum commoneret, ut nihil novi facere inciperet, nisi prius esset inauguratus, eique rex artis ejus elevans fidem diceret, ut consultis avibus renuntiaret sibi, utrumne fieri posset id quod ipse animo concepisset, affirmaretque Navius posse: Cape igitur hanc, inquit, cotem, eamque novacula dissice. At ille incunctanter accepit ac secuit. Deinde illud, quod Castor et Pollux, bello latino, apud Lacum Juturnae visi sunt equorum sudorem abluentes, cum aedes eorum, quae juncta fonti erat, sua sponte patuisset: iidem bello macedonico equis albis insidentes, Publio Vatieno Romam nocte venienti se obtulisse dicuntur, nuntiantes eo die regem Persen victum atque captum, quod paucis post diebus litterae Pauli verum fuisse docuerunt. Illud etiam mirabile, quod simulacrum Fortunae muliebre non semel locutum esse traditur; item Junonis Monetae, cum, captis Veiis, unus ex militibus ad eam transferendam missus, jocabundus ac ludens interrogavit, utrumne Romam migrare vellet, respondit velle. Claudia quoque proponitur in exemplum miraculi. Nam cum ex libris Sibyllinis Idaea mater esset accita, et in vado Tiberini fluminis navis qua vehebatur haesisset, nec ulla vi commoveretur, Claudiam ferunt, quae semper impudica esset habita ob nimios corporis cultus, deam submissis genibus orasse, ut, si se castam judiearet, suum cingulum sequeretur, ita navim, quae ab omni juventute non valuit commoveri, ab una muliere esse commotam. Illud aeque mirum, quod lue saeviente, Aesculapius, Epidauro accitus, urbem Romam diuturna pestilentia liberasse perhibetur. Sacrilegi quoque numerari possunt, quorum praesentibus poenis injuriam suam dii vindicasse creduntur. Appius Claudius Censor, cum adversus responsum ad servos publicos sacra Herculis transtulisset, luminibus orbatus est, et Potitiorum gens, quae prodidit, intra unius anni tempus extincta est. Item Censor Fulvius, cum ex Junonis Laciniae templo marmoreas tegulas abstulisset, quibus aedem Fortunae equestris, quam Romae fecerat, tegeret, et mente captus est, et amissis duobus filiis in Illyrico militantibus, summo animi moerore consumptus est. Praefectus etiam M. Antonii Turullius, cum apud Coos everso Aesculapii luco classem fecisset, eodem postea loco a militibus Caesaris est interfectus. His exemplis adjungitur Pyrrhus, qui sublata ex thesauro Proserpinae Locrensis pecunia, naufragium fecit, ac vicinis deae littoribus illisus est, ut nihil, praeter eam pecuniam, incolume reperiretur. Ceres quoque Milesia multum sibi apud homines venerationis adjecit. Nam cum ab Alexandro capta civitas esset, ac milites ad eam spoliandam irrupissent, omnium oculos repente objectus fulgor ignis extinxit. Reperiuntur etiam somnia, quae vim deorum videantur ostendere. Tiberio Namque Attinio, homini plebeio, per quietem obversatus esse Jupiter dicitur, et praecepisse, ut Consulibus et Senatui nuntiaret, ludis Circensibus proximis praesultorem sibi displicuisse, quod Antonius Maximus quidam diverberatum servum sub furca medio circo ad supplicium duxerat, ideoque ludos instaurari oportere; quod cum ille neglexisset, eodem die filium perdidisse, ipse autem gravi morbo esse correptus: et cum rursus eamdem imaginem cerneret quaerentem, satisne poenarum pro neglecto imperio pependisset, lectica delatus ad Consules, et omni re in Senatu exposita, recepisse corporis firmitatem, suisque pedibus domum rediisse. Illud quoque somnium non minoris fuit admirationis, quo Caesar Augustus dicitur esse servatus. Nam cum bello civili Brutiano, implicitus gravi morbo, abstinere praelio statuisset, medico ejus Artorio Minervae species obversata est, monens ne propter corporis imbecillitatem castris se contineret Caesar. Itaque in aciem lectica perlatus est, et eodem die a Bruto castra capta sunt. Multa praeterea exempla similia possunt proferri: sed vereor ne, si fuero in propositione rerum contrariarum diutius immoratus, aut oblitus esse propositi videar, aut crimen loquacitatis incurram. CAPUT IX. De Diabolo, Mundo, Deo, Providentia, Homine et ejus sapientia.
Exponam igitur omnium istorum
rationem, quo facilius res difficiles et obscurae intelligantur, et
has omnes simulati numinis praestigias revelabo, quibus inducti
homines, a veritatis via longius recesserunt. Sed repetam longe
altius; ut si quis ad legendum veri expers et ignarus accesserit,
instruatur, atque intelligat, quod tandem sit Nec audiendi sunt poetae, qui aiunt chaos in principio fuisse, id est, confusionem rerum, atque elementorum; postea vero Deum diremisse omnem illam congeriem, singulisque rebus ex confuso acervo separatis, in ordinemque descriptis, instruxisse mundum pariter et ornasse. Quibus facile est respondere potestatem Dei non intelligentibus, quem credant nihil efficere posse, nisi ex materia subjacente ac parata; in quo errore etiam philosophi fuerunt. Nam Cicero de Natura deorum disputans, sic ait: « Primum igitur non est probabile, eam materiam rerum, unde orta sunt omnia, esse divina providentia effectam; sed habere, et habuisse vim et naturam suam. Ut igitur faber, cum quid aedificaturus est, non ipse facit materiam, sed ea utitur quae sit parata, fictorque item cera: sic isti providentiae divinae materiam praesto esse oportuit, non quam ipse faceret, sed quam haberet paratam. Quod si non est a Deo materia facta, ne terra quidem, et aqua, et aer, et ignis a Deo factus est. » O quam multa sunt vitia in his decem versibus! Primum, quod is, qui in aliis disputationibus, et libris fere omnibus providentiae fuerit assertor, et qui acerrimis argumentis impugnaverit eos, qui providentiam non esse dixerunt, idem nunc quasi proditor aliquis, aut transfuga, providentiam conatus est tollere: in quo si contradicere velis, nec cogitatione opus est, nec labore; sua illi dicta recitanda sunt. Nec enim ab ullo poterit Cicero, quam a Cicerone vehementius refutari. Sed concedamus hoc mori et instituto Academicorum; ut liceat hominibus valde liberis dicere, ac sentire quae velint. Sententias ipsas consideremus. Non est, inquit, probabile, materiam rerum a Deo factam. Quibus hoc argumentis doces? Nihil enim dixisti, quare hoc non sit probabile. Itaque mihi e contrario vel maxime probabile videtur: nec tamen temere videtur, cogitanti plus esse aliquid in Deo, quem profecto ad imbecillitatem hominis redigis; cui nihil aliud, quam opificium concedis. Quo igitur ab homine divina illa vis differet, si ut homo, sic etiam Deus ope indiget aliena? Indiget autem, si nihil moliri potest, nisi ab altero illi materia ministretur. Quod si fit, imperfectae utique virtutis est, et erit jam potentior judicandus materiae institutor. Quo igitur nomine appellabitur, qui potentia Deum vincit? Siquidem majus est, propria facere, quam aliena disponere. Si autem fieri non potest, ut sit potentius Deo quidquam, quem necesse est perfectae esse virtutis, potestatis, rationis: idem igitur materiae fictor est, qui et rerum ex materia constantium. Neque enim Deo non faciente, et invito, esse aliquid aut potuit, aut debuit. Sed probabile est, inquit, materiam rerum habere, et habuisse semper vim et naturam suam. Quam vim potuit habere, nullo dante? quam naturam, nullo generante? Si habuit vim, ab aliquo eam sumpsit. A quo autem sumere, nisi a Deo potuit? Porro si habuit naturam, quae utique a nascendo dicitur, nata est. A quo autem, nisi a Deo potuit procreari? Natura enim, qua dicitis orta esse omnia, si consilium non habet, efficere nihil potest. Si autem generandi et faciendi potens est, habet ergo consilium et propterea Deus sit necesse est. Nec alio nomine appellari potest ea vis, in qua inest, et providentia excogitandi, et solertia potestasque faciendi. Melius igitur Seneca omnium stoicorum acutissimus, qui vidit « nil aliud esse naturam, quam Deum. Ergo, inquit, Deum non laudabimus, cui naturalis est virtus? » nec enim illam didicit ex ullo. Immo laudabimus: quamvis enim naturalis illi sit, illa sibi illam dedit; quoniam Deus ipse natura est. Cum igitur ortum rerum tribuis naturae, ac detrahis Deo, in eodem luto haesitas; versuram solvis, Geta. A quo enim fieri negas, ab eodem plane fieri mutato nomine confiteris. Sequitur ineptissima comparatio. « Ut faber, inquit, cum quid aedificaturus est, non ipse facit materiam, sed utitur ea quae sit parata, fictorque item cera: sic isti providentiae divinae materiam esse praesto oportuit, non quam ipse faceret, sed quam haberet paratam. » Immo vero non oportuit; erit enim Deus minoris potestatis, si ex parato facit, quod est hominis. Faber sine ligno nihil aedificabit, quia lignum ipsum facere non potest; non posse autem, imbecillitatis est humanae: Deus vero facit sibi ipse materiam, quia potest. Posse enim, Dei est: nam si non potest, Deus non est. Homo facit ex eo, quod est; quia per mortalitatem imbecillis est, per imbecillitatem, definitae ac modicae potestatis: Deus autem facit ex eo, quod non est; quia per aeternitatem fortis est, per fortitudinem, potestatis immensae, quae fine ac modo caret, sicut vita factoris. Quid ergo mirum, si facturus mundum Deus, prius materiam de qua faceret praeparavit, et praeparavit ex eo quod non erat? quia nefas est Deum aliunde aliquid mutuari, cum in ipso vel ex ipso sint omnia. Nam si est aliquid ante illum, et si factum est quidquam non ab ipso, jam et potestatem Dei, et nomen amittet. At enim materia nunquam facta est, sicut Deus, qui ex materia fecit hunc mundum. Duo igitur constituuntur aeterna, et quidem inter se contraria; quod fieri sine discordia et pernicie non potest. Collidant enim necesse est ea quorum vis et ratio diversa est: sic utraque aeterna esse non poterunt, si repugnant, quia superare alterum necesse est. Ergo fieri non potest, quin aeterni natura sit simplex, ut inde omnia, velut ex fonte, descenderint. Itaque aut Deus ex materia ortus est, aut materia ex Deo. Quid horum sit verius, facile est intelligi. Ex his enim duobus alterum sensibile est, alterum caret sensu. Potestas faciendi aliquid non potest esse, nisi in eo quod sentit, quod sapit, quod cogitat, quod movetur. Nec incipi, aut fieri, aut consummari quidquam potest, nisi fuerit ratione provisum; et quemadmodum fiat, antequam est, et quemadmodum constet, postquam fuerit effectum. Denique is facit aliquid, qui habet voluntatem ad faciendum et manus ad id quod voluit implendum. Quod autem insensibile est, iners et torpidum semper jacet, et nihil inde oriri potest, ubi nullus est motus voluntarius. Nam si omne animal ratione constat, certe nasci ex eo non potest, quod ratione praeditum non est; nec aliunde accipi potest id, quod ibi, unde petitur, non est. Nec tamen commoveat aliquem, quod animalia quaedam de terra nasci videntur. Haec enim non terra per se gignit, sed spiritus Dei, sine quo nihil gignitur. Non ergo Deus ex materia, quia sensu praeditum ex insensibili, sapiens ex bruto, impatibile de patibili, expers corporis de corporali numquam potest oriri: sed materia potius ex Deo est. Quidquid enim est solido et contrectabili corpore, accipit externam vim. Quod accipit vim, dissolubile est. Quod dissolvitur, interit. Quod interit, ortum sit necesse est. Quod ortum est, habuit fontem unde oriretur, id est factorem aliquem sentientem, providum, peritumque faciendi. Is est profecto, nec ullus alius quam Deus. Qui quoniam sensu, ratione, providentia, potestate, virtute praeditus est, et animantia, et inanima creare et efficere potest, quia tenet quomodo quidque sit faciendum. Materia vero semper fuisse non potest, quia mutationem non caperet, si fuisset. Quod enim semper fuit, semper esse non desinit; et unde abfuit principium, abesse hinc etiam finem necesse est. Quin etiam facilius est, ut id quod habuit initium, fine careat, quam ut habeat finem, quod initio caruit. Materia ergo si facta non est, ne fieri ex ea quidquam potest. Si fieri ex ea non potest, nec materia quidem erit. Materia enim est, ex qua fit aliquid. Omne autem ex quo fit, quia recepit opificis manum, destruitur, et aliud esse incipit. Ergo quoniam finem habuit materia, tum cum factus est ex ea mundus, et initium quoque habuit. Nam quod destruitur, aedificatum est; quod solvitur, alligatum; quod finitur, incoeptum est. Si ergo ex commutatione ac fine materia colligitur habuisse principium, a quo alio fieri nisi a Deo potuit? Solus igitur Deus, qui factus non est, et idcirco destruere alia potest, ipse destrui non potest. Permanebit semper in eo quod fuit, quia non est aliunde generatus, nec ortus, nec nativitas ejus ex aliqua alia re pendet, quae illum mutata dissolvat. Ex seipso est, ut in primo diximus libro; et ideo talis est, qualem se esse voluit, impassibilis, immutabilis, incorruptus, beatus, aeternus. Jam vero illa conclusio, qua sententiam terminavit Tullius, multo absurdior. « Quod si materia, inquit, a Deo non est facta, nec terra quidem, et aqua, et aer, et ignis a Deo factus est. » Quam callide periculum praetervolavit. Sic enim superius illud assumpsit, tanquam probatione non indigeret; cum id multo esset incertius quam illud propter quod assumptum est. Si non est, inquit, a Deo facta materia, nec mundus a Deo factus est. Ex falso maluit colligere, quod falsum est, quam ex vero, quod verum. Et cum debeant incerta de certis probari, hic probationem sumpsit ex incerto, ad evertendum quod erat certum. Nam divina Providentia effectum esse mundum (ut taceam de Trismegisto, qui hoc praedicat, taceam de carminibus Sibyllarum, quae idem nuntiant; taceam de prophetis, qui opus mundi, ac opificium Dei uno spiritu ac pari voce testantur) etiam inter philosophos pene universos convenit; id enim Pythagoraei, Stoici, Peripatetici, qui sunt principes omnis disciplinae. Denique a primis illis septem sapientibus ad Socratem usque ac Platonem pro confesso et indubitato habitum est, donec unus multis post saeculis extitit delirus Epicurus, qui auderet negare id quod est evidentissimum, studio scilicet inveniendi nova, ut nomine suo constitueret disciplinam. Et quia nihil novi potuit reperire: ut tamen dissentire a caeteris videretur, vetera voluit evertere. In quo illum circumlatrantes philosophi omnes coarguerunt. Certius est igitur mundum providentia instructum, quam materia providentiam conglobatam. Quare non oportuit putare, idcirco mundum non esse divina providentia factum, quia materia ejus divina providentia facta non sit: sed quia mundus divina providentia sit effectus, et materiam esse factam divinitus. Credibilius est enim materiam potius a Deo factam, quia Deus omnia potest, quam mundum a Deo non esse factum, quia sine mente, ratione, consilio nihil fieri potest. Verum haec non Ciceronis est culpa, sed sectae. Cum enim suscepisset disputationem, qua deorum naturam tolleret, de qua philosophi garriebant, omnem divinitatem ignorantia veri putavit esse tollendam. Itaque deos potuit tollere, quia non erant. Cum autem providentiam divinam, quae est in uno Deo, conaretur evertere, quia contra veritatem niti coeperat, deficientibus argumentis, in hanc foveam necessario decidit, unde se extricare non posset. Hic ergo illum teneo haerentem, teneo defixum, quo Lucilius, qui contra disserebat, obmutuit. Hic est ergo cardo rerum; hic vertuntur omnia. Explicet se Cotta, si potest, ex hac voragine; proferat argumenta, quibus doceat semper fuisse materiam, quam nulla providentia effecerit. Ostendat, quomodo quidquam ponderosum et grave, aut esse potuerit sine auctore, aut immutari valuerit, ac desierit esse, quod semper fuit, ut inciperet esse, quod numquam fuit. Quae si docuerit, tum demum assentiar, ne mundum quidem divina providentia constitutum; et tamen sic assentiar, ut aliis illum laqueis teneam. Eodem enim, quo nolet revolvetur, ut dicat, et materiam de qua mundus est, et mundum qui de materia est, natura extitisse: cum ego ipsam naturam Deum esse contendam. Nec enim potest facere mirabilia, id est maxima ratione constantia, nisi qui habet mentem, providentiam, potestatem. Ita fiet, ut Deus fecerit omnia, nec quidquam esse possit omnino, quod non originem a Deo traxerit. At idem quoties Epicureus est, et non vult a Deo factum esse mundum, quaerere solet quibus manibus, quibus machinis, quibus vectibus, qua molitione hoc tantum opus fecerit. Videret fortasse, si eo tempore potuisset esse, quo fecit. Sed ne perspiceret homo Dei opera, noluit eum inducere in hunc mundum, nisi perfectis omnibus. Sed ne induci quidem poterat: quomodo enim subsisteret, cum fabricaretur desuper coelum, terraque subter fundaretur; cum fortasse humida, vel nimiis rigoribus torporata concrescerent, vel igneis caloribus incocta et solidata durescerent? Aut quomodo viveret, sole nondum instituto, nec frugibus, nec animalibus natis? Itaque necesse fuit hominem postremo fieri, cum jam mundo caeterisque rebus manus summa esset imposita. Denique sanctae litterae docent hominem fuisse ultimum Dei opus, et sic inductum fuisse in hunc mundum, quasi in domum jam paratam et instructam: illius enim causa facta sunt omnia. Idem etiam poetae fatentur. Ovidius perfecto jam mundo, et universis animalibus figuratis, hoc addidit:
Sanctius his animal, mentisque
capacius altae Natus homo est. Adeo nefas existimandum est ea scrutari, quae Deus voluit esse celata! Verum ille non audiendi aut discendi studio requirebat, sed refellendi; quia confidebat neminem id posse dicere. Quasi vero ex hoc putandum sit, non esse haec divinitus facta, quia quomodo facta sint, non potest pervideri. An tu, si educatus in domo fabrefacta et ornata, nullam umquam fabricam vidisses, domum illam putasses non ab homine esse aedificatam; quia, quomodo aedificetur, ignorares? Idem profecto de domo quaereres, quod nunc de mundo requiris; quibus manibus, quibus ferramentis homo tanta esset opera molitus; maxime si saxa ingentia, immensa caementa, vastas columnas, opus totum sublime et excelsum videres, nonne haec tibi humanarum virium modum viderentur excedere, quia illa non tam viribus quam ratione atque artificio facta esse nescires? Quod si homo, in quo nihil perfectum est, tamen plus efficit ratione, quam vires ejus exiguae patiantur, quid est cur incredibile tibi esse videatur, cum mundus dicitur factus a Deo, in quo, quia perfectus est, nec sapientia potest habere terminum, nec fortitudo mensuram? Opera ipsius videntur oculis. Quomodo autem illa fecerit, ne mente quidem videtur: quia, ut Hermes ait, mortale immortali, temporale perpetuo, corruptibile incorrupto propinquare non potest, id est propius accedere et intelligentia subsequi. Et ideo terrenum adhuc animal rerum coelestium perspectionem non capit, quia corpore quasi custodia septum tenetur, quominus soluto ac libero sensu cernat omnia. Sciat igitur quam inepte faciat, qui res inenarrabiles quaerit. Hoc est enim modum conditionis suae transgredi, nec intelligere, quousque homini liceat accedere. Denique cum aperiret homini veritatem Deus, ea sola scire nos voluit, quae interfuit hominem scire ad vitam consequendam: quae vero ad curiosam et profanam cupiditatem pertinebant, reticuit, ut arcana essent. Quid ergo quaeris, quae nec potes scire, nec si scias, beatior fias? Perfecta est in homine sapientia, si et Deum esse unum, et ab ipso esse facta universa cognoscat. |
VIII. Chacun doit se fier à soi-même dans la plus importante affaire de sa vie, et se servir de ses sens et de son esprit pour chercher la vérité, plutôt que de se laisser tromper en suivant les erreurs des autres. Dieu a donné à chaque homme une portion de lumière et de sagesse par laquelle il peut apprendre ce qu'il ignore et examiner ce qu'on lui propose. Ceux qui nous ont précédés dans l'ordre du temps, ne nous ont pas pour cela surpassés en prudence. Les hommes de tous les temps en ont leur part, et les anciens n'en ont pas été si avantageusement partagés qu'il n'en soit point resté pour ceux qui le sont suivis. Elle est incorruptible et inaltérable, comme la lumière. Elle éclaire l'esprit, comme le soleil éclaire le corps. Tous les hommes cherchent naturellement la vérité. Ceux qui approuvent le sentiment des anciens sans l'examiner, se privent eux-mêmes de l'avantage de leur raison et se laissent conduire comme des bêtes. C'est le nom d'antiquité, d'anciens qui leur impose, et qui leur persuade que les pères ont été plus habiles que leurs descendants. Mais qui empêche que, suivant leur exemple, nous ne découvrions la vérité à ceux qui viendront après nous, comme ils ont enseigné l'erreur à ceux qui sont venus après eux ? Il nous reste une question fort importante, et dont la décision dépend plutôt de la connaissance de l'histoire que de la sublimité de l'esprit. Je la proposerai un peu au long pour ne laisser aucun doute sur le sujet que je traite. Plusieurs ont recours à des histoires écrites par de célèbres auteurs, et par lesquelles il semble être justifié que ceux que nous prétendons n'avoir point été des dieux, ont fait voir par des prodiges, par des songes, par des présages et par des oracles, qu'ils étaient véritablement des dieux. On raconte en effet divers miracles, et entre autres celui-ci : Anius Navius, grand augure, ayant averti Tarquin l'ancien de ne rien entreprendre sans avoir auparavant consulté le vol des oiseaux, ce prince se moquant de la superstition de cette cérémonie, lui ordonna de les consulter, pour savoir si ce qu'il avait dans l'esprit pouvait être exécuté. Navius lui ayant répondu qu'il le pouvait, Tarquin repartit : Prenez donc un rasoir et coupez cette roche. A l'heure même, Navius la coupa. Durant la guerre contre les Latins, on vit Castor et Pollux proche du lac de Suturne qui essuyaient la sueur de leurs chevaux, la porte de leur maison qui était près d'une fontaine hélant ouverte d'elle-même. On dit que pendant la guerre de Macédoine ils parurent sur des chevaux blancs à Vatienus qui allait à Rome, et lui dirent que le roi Persée avait été vaincu et pris ce jour-là ; ce que bientôt après on apprit par les lettres de Paul Emile, être véritable. Ce que l'on dit de l'image de la Fortune des Femmes est fort merveilleux : qu'elle a très souvent parlé. Après la prise de Véies, un soldat qui avait été chargé de faire porter à Rome l'image de Junon Moneta, lui ayant demandé en riant si elle consentait à ce transport, elle répondit qu'elle y consentait. On rapporte encore une action mémorable de Claudia pour preuve d un miracle extraordinaire. Quand pour obéir aux oracles contenus dans les livres des sibylles on eut fait venir l'image de la mère des dieux, comme le vaisseau où elle était demeurait tellement immobile sur le Tibre, que, quelque machine dont on se servît, il était impossible de le remuer, Claudia, dont la vertu avait toujours été un peu suspecte à cause du trop grand soin qu'elle prenait de sa parure, se mit à genoux et pria la déesse qu'elle se laissât attirer avec sa ceinture, si elle avait conservé la pudicité; et ainsi elle tira à bord le vaisseau qui n'avait pu être ébranlé par tous les jeunes gens de la ville. Ce que l'on publie d'Esculape n'est pas moins merveilleux : qu'ayant été amené d'Epidaure à Rome, il la délivra de la maladie contagieuse dont elle avait été longtemps tourmentée. On peut aussi rapporter un grand nombre de sacrilèges dont les dieux ont puni l'impiété par des châtiments exemplaires. Appius Claudius, censeur, ayant communiqué les mystères d'Hercule aux esclaves publics contre l'ordre qu'il en avait reçu perdit l'usage de la vue, et la nation des Politiens qui avait trahi ce secret fut éteinte en un an. Fulvius, censeur, ayant ôté le marbre dont le temple de Junon Lacinia était orné, pour en parer le temple qu'il avait élevé dans Rome en l'honneur de la Fortune Equestre, il perdit d'abord la raison, et ensuite ses deux fils qui servaient dans les troupes d'Illyrie, et mourut enfin consumé de chagrin et d'angoisses. Turullius, lieutenant d'Antoine, ayant fait couper dans l’île de Cos un bois consacré à Esculape pour en faire des vaisseaux, fut vaincu en ce lieu même par l'armée de Jules César. On ajoute à ces exemples celui de Pyrrhus qui fit un triste naufrage après avoir pillé le trésor de Proserpine de Locres, et perdit toute sa flotte, à la réserve de l'argent qu'il avait enlevé à cette déesse. Cérès de Milet rendit autrefois sa puissance fort redoutable par l'exemple de la sévérité dont elle usa contre des profanateurs sacrilèges. Alexandre, s'étant rendu maître de la ville, et quelques soldats ayant fait irruption dans son temple à dessein de le piller, ils furent consumés par son feu qui s'alluma à l'instant même. On rapporte aussi quantité de songes qui sont autant de preuves du pouvoir des dieux. On dit que Jupiter apparut à Tibérius Attinius, homme du peuple, et qu'il lui commanda d'avertir les consuls et les sénateurs qu'un certain Antonius Maximus, qui avait mené la danse aux derniers jeux publics, lui avait déplu pour avoir fait punir un esclave dans le cirque, et qu'ils eussent à recommencer les jeux. Ayant négligé d'obéir à ce commandement, il perdit le jour même son fils, et fut frappé d'une dangereuse maladie. Jupiter, lui ayant apparu une seconde fois et lui ayant demandé si sa désobéissance n'avait pas été assez rigoureusement châtiée, il se fit porter dans une chaire au sénat, où il n'eut pas plutôt exposé son ordre, qu'il fut si parfaitement guéri qu'il s'en retourna à pied chez lui. Le songe par le moyen duquel on dit qu'Auguste évita la mort n'est pas moins merveilleux. Ayant été attaqué d'une fâcheuse maladie, il résolut de ne se point trouver à la bataille; mais Minerve apparut à Artorius, son médecin, et l'avertit que sa maladie ne devait pas l'obliger à demeurer dans son camp. Brutus entra le même jour dans le camp et le pilla. Mais Auguste s'était fait porter à son armée. Je pourrais rapporter quantité d'autres exemples semblables, si je n'appréhendais de m'éloigner trop de mon sujet et d'être encore d'une longueur ennuyeuse. IX. Pour ne rien laisser d'obscur sans l'éclaircir, je ferai voir que les prodiges et les songes dont j'ai parlé n'étaient que des illusions dont le démon s'est servi pour tromper les hommes, et pour les éloigner de la vérité. Mais je reprendrai les choses de plus haut, afin que ceux qui ne sont pas instruits de cette matière puissent apprendre d'où procède le désordre, et reconnaître le principe de leur erreur et la cause de l'égarement général des hommes. Dieu ayant une sagesse infinie pour former ses desseins et une puissance égale à sa sagesse pour les exécuter, avant de commencer le grand ouvrage de l'univers, fit le bien et le mal. J'expliquerai ceci le plus clairement qu'il me sera possible, de peur qu'on ne s'imagine que je veuille imiter les poètes qui revêtent de figures sensibles les choses les plus spirituelles. Comme il n'y avait rien que lui, et qu'il était, comme il l'est encore, l'unique principe de tous les biens, il produisit un esprit semblable à lui, un fils qui avait une puissance égale à la sienne. Je tâcherai d'expliquer dans le quatrième livre de cet ouvrage ce qui le porta à vouloir produire cet esprit. Il en produisit ensuite un autre qui ne conserva pas la sainteté de la nature divine et qui, ayant été corrompu par l'envie comme par un poison, passa du bien au mal, et prit, par un effet de sa liberté, un nom contraire A celui qu'il avait reçu. Cela montre que l'envie est la source de tous les péchés. Il porta envie à celui qui avait été produit avant lui, et qui étant demeuré uni à son père, est toujours chéri de lui. Cet esprit, qui de bon qu'il avait été créé est devenu méchant, est appelé diable par les Grecs et délateur par les Romains, parce qu'il défère à Dieu les crimes où il fait tomber les hommes. J'expliquerai, autant que mon peu de talent le pourra permettre, les raisons pour lesquelles Dieu, qui n'agit jamais qu'avec une parfaite justice, a voulu qu'il ait été tel qu'il est. Dieu ayant résolu de faire le monde, il commença à produire ce fils unique pareil à lui-même. Il lui commit le soin de tout ce grand ouvrage, et il l'établit comme conciliateur, et en même temps et conjointement avec lui comme principal inventeur de ce grand ouvrage qu'il projetait, afin qu'il pût l'orner et le perfectionner entièrement, parce qu'il est lui-même la perfection en tout ce qui est conception, raison et puissance. Nous en parlerons très peu à présent, parce que nous rapporterons dans un autre endroit et sa vertu, et son nom, et ses autres attributs. Qu'on ne nous demande donc point de quelle manière il s'est servi pour faire un ouvrage si grand et si merveilleux, car il a fait tout de rien. Il ne faut point ajouter foi à ce que les poètes avancent, qu'il y avait au commencement un chaos et une confusion étrange des éléments, et que quand Dieu fit le monde, il ne fit rien autre chose que d'en ôter la confusion et d'en mettre les parties en ordre. Mais il est aisé de leur répondre : qu'ils connaissent fort peu l'étendue de la puissance divine, quand ils se persuadent qu'elle a besoin d'une matière pour agir. Les philosophes ont soutenu la même erreur, et Cicéron l'a expliquée dans les livres de la Nature des Dieux, quand il dit : « Il n'est pas probable que la matière d'où toutes les choses ont été tirées soit un ouvrage de la Providence. Il y a plus d'apparence de croire qu'elle a toujours conservé et qu'elle conserve encore sa nature et sa force. La providence divine n'a point fait la matière. Elle s'est servie de celle qu'elle a trouvée, comme un artisan se sert du bois ou de la cire qu'il ne saurait faire. Que si Dieu n'a pas créé la matière, il n'a pas créé non plus la terre, l'eau, l'air ni le feu. » Quel prodigieux amas d'erreurs en si peu de lignes ! C'est premièrement une chose étrange de voir que Cicéron, qui avait toujours soutenu la Providence dans ses autres ouvrages, et qui s'était fortement opposé à ceux qui avaient entrepris de la combattre, l'ait tout d'un coup trahie et abandonnée. Si quelqu'un voulait contester la vérité de ce fait, il ne serait pas nécessaire d'employer beaucoup de raisons pour le convaincre. Il n'y aurait qu'à lire les propres paroles de Cicéron ; car on ne saurait jamais mieux le réfuter que par lui-même. Mais quand on lui laisserait la liberté que les académiciens prétendent avoir de soutenir et de dire tout ce qui leur plaît, cela n'empêche pas que nous n'examinions ses sentiments et ses paroles. ! Il n'est pas probable, dit-il, que Dieu ait fait la matière. « Comment le prouvez-vous ? car vous n'avez rien allégué qui fasse voir que cela n'est pas probable. Je dis au contraire que cela est probable, et je le dis avec raison, attendu que Dieu ne doit pas être réduit à la condition d'un artisan, qui n'a rien dans son ouvrage que la façon. Quel avantage aurait la puissance de Dieu sur la faiblesse de l'homme s'il avait besoin de quelque chose ? il en aurait besoin, s'il ne pouvait rien faire sans qu'on lui eût fourni une matière. S'il attendait qu'on lui fournît cette matière, son pouvoir serait limité, et celui qui la lui fournirait serait en ce point plus puissant que lui. Quel nom donnerions-nous à celui qui serait plus puissant que Dieu et qui pourrait faire quelque chose de lui-même, au lieu que Dieu ne pourrait que travailler sur le sujet qu'il aurait reçu d'un autre? Que s'il est impossible qu'il y ait aucun être plus puissant que Dieu, puisqu'il est infiniment parfait, il faut avouer que la matière n'est pas moins son ouvrage que les autres choses qui sont composées de matière. Rien n'a pu recevoir l'être sans l'agrément de Dieu. Rien n'a pu être fait qu'il ne l'ait ; bien voulu faire. « Mais il est probable, dites-vous, que la matière dont toutes choses ont été tirées a toujours conservé sa force et sa nature, et qu'elle la conserve encore. » Quelle force et quelle nature peut-elle avoir si elle ne l'a reçue, et de qui peut-elle l'avoir reçue que de Dieu ? Si elle a reçu la nature, elle est née ; car c'est de là même que vient le mot nature. Comment a-t-elle pu naître, si ce n'est que Dieu l'ait produite? cette nature, d'où vous prétendez que toutes choses ont été tirées, ne les a pu produire, à moins qu'elle n'ait l'intelligence et la raison. Que si elle a l'intelligence et la raison, c'est-à-dire la sagesse pour former le dessein de ses ouvrages et le pouvoir de les achever, elle est Dieu. C'est pour cela que Sénèque, le plus subtil des stoïciens, a fort bien jugé que la nature n'est rien autre chose que Dieu même. « Pourquoi, dit-il, ne louerions-nous pas Dieu à qui la puissance est naturelle, puisqu'il ne l'a reçue d'aucun autre ? Nous le louerons sans doute, parce qu'il tient de soi cette puissance qui lui est naturelle, et qu'il est lui-même la nature. » Quand vous attribuez à la nature le pouvoir de produire que vous ôtez à Dieu, vous vous engagez dans l'erreur plus avant que vous n'y étiez, et vous ressemblez à ceux qui, pour payer de vieilles dettes, en font de nouvelles. Dans le temps même que vous niez que Dieu ait fait le monde, vous confessez qu'il l'a fait. Sénèque fait après cela une comparaison fort ridicule. « Dieu, dit-il, a besoin d'un sujet sur lequel il travaille, comme un artisan a besoin de bois ou de cire, et Dieu ne crée non plus ce sujet que l'artisan ne crée la cire ni le bois. » Au contraire, il n'en a pas besoin; et s'il en avait besoin son pouvoir en serait moindre. Un artisan ne fera jamais rien s'il n'a une matière comme du bois, et il ne saurait créer ce bois parce qu'il est faible. Dieu, au contraire, crée la matière sur laquelle il travaille, parce que sa puissance est infinie. L'homme ne saurait travailler s'il n'a un sujet sur lequel il travaille, parce que la condition mortelle le rend faible, et que sa faiblesse met des bornes fort étroites à son pouvoir. Mais Dieu fait ce qu'il lui plait sans avoir besoin de sujet, parce que son éternité fait sa force, et que sa force lui donne un pouvoir aussi infini que sa vie. Faut-il donc s'étonner que Dieu, ayant dessein de faire le monde, en ait premièrement préparé la matière, et qu'il l'ait tirée du néant. Il fallait nécessairement qu'il en usât de la sorte, puisqu'il ne peut rien emprunter, et qu'il est le principe qui renferme et qui produit tous les biens. S'il y avait quelque chose avant lui, ou qui eût l'être indépendamment de lui, il n'aurait plus le pouvoir, ni même le nom de Dieu. « Mais la matière, dit-on, n'a jamais été faite, et elle a cet avantage particulier, qui ne lui est commun qu'avec Dieu, qui, de cette matière, a fait le monde. Il faudrait pour cela admettre deux êtres qui, étant également éternels, seraient tellement contraires entre eux, que leur combat et leur guerre ne pourrait être terminée que par la défaite et par la ruine de l'un ou de l'autre. S'ils sont contraires, il faut qu'ils se combattent l'un l'autre. S'ils se combattent, l'un des deux remportera la victoire. Ainsi il est clair qu'il n'y a qu'un être éternel, et qui est comme la source d'où sont sortis les autres. Il faut donc ou que Dieu soit sorti de la matière, ou que la matière soit sortie de Dieu. Il est aisé de reconnaître lequel des deux est sorti de l'autre : l'un a du sentiment, au lieu que l'autre n'en a point. Le pouvoir d'agir ne se trouve qu'où se trouve le sentiment, le mouvement, la pensée et l'intelligence. On ne saurait rien entreprendre, rien commencer, rien achever que l'on n'en ait formé le dessein par la raison, que l'on n'en ait résolu l'exécution par sa volonté, et qu'enfin on n'ait mis la main à l'œuvre. Or, ce qui n'a point de sentiment ne met point la main à l'œuvre, et ce qui n'a point de mouvement ne produit aucune chose. Bien qu'il n'y ait point d'animal qui n'ait la raison, il n'y en a point qui puisse procurer aucune des choses qui n'ont point la raison. Enfin on ne saurait rien trouver, ni rien prendre dans un lieu qu'il n'y soit auparavant. Personne ne doit douter de la vérité de ce que je dis, sous prétexte que l'on voit des animaux qui naissent de la terre. Ce n'est pas la terre qui les produit, c'est l'esprit de Dieu, sans lequel rien ne se produit dans le monde. Dieu n'est donc pas sorti de la matière, parce que ce qui a du sentiment ne saurait sortir de ce qui n'a point de sentiment. Ce qui a de la raison, ne saurait sortir de ce qui n'a point de raison. Ce qui est impossible ne saurait sortir de ce qui est possible. Ce qui est spirituel ne saurait sortir de ce qui est corporel. La matière est plutôt sortie de Dieu, car ce qui est solide, dur, et peu maniable, reçoit sa force du dehors. Ce qui reçoit sa force du dehors se peut dissoudre. Ce qui se peut dissoudre, finit. Ce qui finit a eu un commencement et un principe, c'est-à-dire un auteur qui a du sentiment, de la prévoyance, de la sagesse, et cet auteur-là est Dieu. Comme il a le sentiment, la raison, la prévoyance, la puissance et la sagesse, il peut faire des créatures animées et inanimées, et il sait de quelle manière il faut les faire. La matière ne peut avoir toujours été, parce que si elle avait toujours été, elle ne serait pas sujette au changement. Ce qui a toujours été ne cesse jamais d'être ; et comme il n'a point eu de commencement, il n'a point aussi de fin. Il arrive même plus aisément que ce qui a eu un commencement n'ait point de fin, qu'il n'arrive que ce qui n'a point eu de commencement en ait une. Rien n'aurait pu être fait de la matière, si elle n'avait pas été faite elle-même, et si rien n'en avait pu être fait, elle ne serait pas matière; car la matière n'est que ce dont on fait quelque chose. Ce dont on fait quelque chose est changé et détruit par la main de l'ouvrier, et cesse d'être ce qu'il était pour commencer d'être ce qu'il n'était pas. Si la matière a cessé d'être ce qu'elle était auparavant, lorsque le monde a été fait d'elle, et si elle a eu une fin, elle avait donc eu un commencement. Ce qui est détruit a été autrefois élevé. Ce qui est délié a été autrefois lié. Ce qui finit a commencé. Si de ce que la matière est sujette au changement et de ce qu'elle cesse d'être ce qu'elle était auparavant, on conclut bien qu'elle a eu un commencement et un principe, quel peut être ce principe-la, si ce n'est Dieu même? Il n'y a que lui seul qui n'ait pas été fait. Il peut tout anéantir, et ne peut être anéanti. Il sera toujours ce qu'il a toujours été. Il n'a point été engendré. Il n'a point reçu la naissance d'un autre. Son être étant indépendant, il est aussi immuable. Il subsiste par lui-même, et ainsi il est tel qu'il a voulu être, impassible, immuable, incorruptible, heureux, éternel. La conclusion par laquelle Cicéron a terminé son discours est encore plus absurde. « Si Dieu, dit-il, n'a pas fait la matière, il n'a pas fait non plus la terre, l'eau, l'air ni le feu. » Qu'il évite adroitement la difficulté ! Il suppose la première proposition, comme si elle n'avait point besoin d'être prouvée, bien qu'elle soit moins certaine que celle qu'il prétend prouver par elle. « Si Dieu, dit-il, n'a pas fait la matière, il n'a pas non plus fait le monde. » Il a mieux aimé tirer une fausse conclusion d'un faux principe, que d'en tirer une véritable d'un véritable. Au lieu de prouver ce qui est incertain par ce qui est certain, il a choisi ce qui est incertain pour combattre ce qui est certain. Car pour ne parler ni de Trismégiste, qui déclare que l'univers est l'ouvrage de la divine providence, ni des sibylles dont les vers contiennent le même oracle, ni des prophètes que l'esprit de Dieu a animés pour publier la même vérité, presque tous les philosophes, les chefs des principales sectes, les pythagoriciens, les stoïciens et les péripatéticiens en conviennent. Enfin on n'en avait jamais douté, ni dans les premiers temps, ni au siècle de Socrate et de Platon, jusqu'avec qu'Épicure, qui n'est venu qu'après une longue suite d'années, ait eu la témérité, par un désir déréglé d'avancer des nouveautés et de se faire chef de secte, de révoquer en doute ce qui avait presque jusque alors été évident et manifeste. N'ayant pu rien découvrir de nouveau, et n'ayant pas voulu paraître du même sentiment que les autres, il a entrepris d'ébranler ce qui était le plus solidement établi sur le témoignage de toute l'antiquité, en quoi il a excité l'indignation de toutes les sectes. Il est donc certain que le monde est l'ouvrage de Dieu et non de la matière. Au lieu de se persuader que Dieu n'a pas fait le monde parce qu'il n'a pas fait la matière, il faut croire qu'il a fait la matière, parce qu'il a fait le monde. Il est plus croyable que Dieu a fait la matière parce qu'il peut tout, qu'il n'est croyable qu'il n'a pas fait le monde, sous prétexte que rien ne se peut faire sans conseil, sans raison et sans esprit. Mais cette faute est moins particulière à Cicéron qu'à sa secte; car comme il avait entrepris de discourir sur la nature des dieux, l'ignorance de la vérité l'a engagé à soutenir qu'il n'y en avait aucun. Il pouvait nier l'existence des dieux, parce qu'en effet il n'y a point de dieux. Mais quand il a entrepris de combattre la providence d'un seul dieu, il s'est trouvé sans forces et sans preuves, et il est tombé dans un abîme d'où il ne saurait se retirer. Il s'y tient attaché. Lucilius qu'il a introduit perd la parole. C'est ici la plus importante question ; c'est le point d'où dépend le reste. Que Cotta se tire comme il pourra des embarras, et qu'il fasse voir qu'il y a toujours eu une matière indépendante de la divine providence ; qu'il montre comment un corps solide et pesant a pu être sans avoir été créé, et comment il a pu être changé de telle sorte qu'il ait cessé d'être ce qu'il était, pour devenir ce qu'il n'était pas : quand il aura prouvé tout cela, je demeurerai d'accord que le monde n'est pas l'ouvrage de la divine providence, et ne laisserai pas de le tenir enveloppé dans un filet, d'où il ne pourra s'échapper ; car il sera obligé d’avouer, malgré tous ses efforts, que le monde et la matière d'où il a été tiré existent par la force de la nature. Or je prétends que la nature n'est autre chose que Dieu même; car rien ne peut produire des ouvrages tout à fait admirables, s'il n'a la sagesse, la prévoyance et la puissance. Ainsi il est clair que Dieu a fait toutes choses, et qu'il n'y a rien qui ne tire de lui son origine. Quand Cicéron veut suivre les sentiments d'Épicure et soutenir que Dieu n'a pas fait le monde, il demande s'il a des mains, et de quelle machine il s'est servi pour construire un si précieux édifice. Il aurait peut-être vu de quelles machines Dieu s'est servi pour achever son ouvrage, s'il eût vécu en ce temps-là. Mais Dieu n'a pas jugé à propos de mettre l'homme dans le monde avant que le monde fût achevé, de peur qu'il ne le vît travailler à son ouvrage. Il ne pouvait même être mis dans le monde avant qu'il fût achevé: car comment y aurait-il subsisté pendant que Dieu étendait le ciel, qu'il affermissait les fondements de la terre, pendant que l'une était peut-être glacée par la rigueur du froid ou bouillante par l'excès de la chaleur, avant que le soleil eût répandu sa lumière, que la terre eût produit des fruits et que les animaux fussent nés? Dieu ne devait donc créer l'homme qu'après avoir mis la dernière main au reste de ses ouvrages. Enfin, l'Ecriture témoigne qu'il fut créé le dernier, et qu'il fut placé dans le monde comme dans un palais qui avait été bâti et préparé exprès pour le recevoir. Les poètes en demeurent d'accord; et après qu'Ovide a décrit la construction de l'univers et la production des animaux, il ajoute: « Comme il manquait encore à l'univers une créature pourvue d'un esprit éclairé et pénétrant, qui eût en elle-même quelque chose de saint et de sacré, et qui fût capable de commander à celles qui avaient déjà été faites, l'homme fut produit. » Il n'est pas permis de pénétrer ce que Dieu a voulu nous tenir secret. Cicéron n'entreprenait pas aussi de le pénétrer à dessein de s'instruire, mais à dessein de réfuter l'opinion contraire à la sienne, et sous ce seul prétexte que personne ne s'est trouvé au commencement des choses. Est-ce une preuve que Dieu n'a pas fait le monde, de dire qu'il n'y a point d'homme qui l'ait vu travailler à cet ouvrage? Si vous aviez été élevé dans une maison bien bâtie et bien parée, sans avoir vu travailler à la bâtir et à la parer, vous croiriez sans doute qu'elle n'aurait pas été bâtie par des hommes, et vous demanderiez de quels instruments ils se seraient servis pour faire un si grand ouvrage, pour tailler et pour placer de si grosses pierres, pour élever de si hautes colonnes; vous jugeriez sans doute que la construction d'un si superbe édifice serait au-dessus de la force des hommes, parce que vous ne sauriez pas que la force y contribue moins que l'adresse. Que si l’homme, bien qu'il n'ait aucun avantage qui soit tellement parfait qu'il n'y manque quelque chose, ne laisse pas de faire par son industrie des ouvrages qui semblent être au-dessus de sa nature, quelle raison y a-t-il de douter que Dieu, qui est souverainement parfait et qui a une sagesse et une puissance infinies, ait pu produire le monde? Ses ouvrages sont exposés à la vue. Mais la manière dont il les a faits est incompréhensible. Ce qui est mortel ne peut, comme dit Trismégiste, s'approcher de ce qui est immortel, c'est-à-dire il ne le peut comprendre. Ce qui est périssable ne peut s'approcher de ce qui est éternel. Ce qui est corruptible ne peut s'approcher de ce qui est incorruptible. Une créature aussi terrestre que l'homme ne saurait pénétrer parfaitement les choses célestes. Son corps est comme une prison qui le relient, et qui l'empêche d'user de ses forces et de son esprit. Que ceux qui recherchent ce que l'on ne saurait trouver, reconnaissent combien leur occupation est vaine. C'est passer les bornes de notre nature ! ignorer jusqu'où se peuvent étendre nos connaissances. Quand Dieu a révélé la vérité à l'homme, il lui a découvert tout ce qu'il avait intérêt de savoir pour son salut, et lui a caché ce qui n'aurait servi qu'à entretenir une curiosité profane. Pourquoi donc cherchez-vous ce que vous ne sauriez trouver, et pourquoi voulez-vous savoir ce dont la connaissance ne contribuerait en rien à vous rendre heureux? L'homme sera assez savant, quand il saura qu'il y a un Dieu, et que ce Dieu a fait toutes choses.
|
|
CAPUT X. De mundo ejusque partibus, elementis et tempestatibus.
Nunc quoniam refutavimus eos qui de
mundo et de factore ejus Deo aliter sentiunt quam veritas habet, ad
divinam mundi fabricam revertamur, de qua in arcanis sanctae
religionis litteris traditur. Fecit igitur Deus primum omnium
coelum, et in sublime suspendit, quod esset sedes ipsius Dei
conditoris. Deinde terram fundavit, ac coelo subdidit, quam homo cum
caeteris animalium generibus incoleret. Eam voluit humore
circumflui, et contineri. Suum vero habitaculum distinxit claris
luminibus, et implevit, sole scilicet, lunaeque orbe fulgenti, et
astrorum micantium splendentibus signis adornavit; tenebras autem,
quod est his contrarium, constituit in terra: nihil enim per se
continet luminis, nisi accipiat a coelo, in quo posuit lucem
perennem, et superos, et vitam perpetuam, et contra in terra
tenebras, et inferos, et mortem. Tanto enim haec ab illis
superioribus distant, quantum mala a bonis, et vitia a virtutibus.
Ipsius quoque terrae binas partes contrarias inter se, diversasque
constituit, scilicet orientem, occidentemque: ex quibus oriens Deo
accensetur; quia ipse luminis fons, et illustrator est rerum, et
quod oriri nos faciat ad vitam sempiternam. Occidens autem
conturbatae illi pravaeque menti adscribitur, quod lumen abscondat,
quod tenebras semper inducat, et quod homines faciat occidere atque
interire peccatis. Nam sicut lux orientis est, in luce autem vitae
ratio versatur; sic occidentis tenebrae sunt: in tenebris autem, et
mors, et interitus continetur. Deinde alteras partes eadem ratione
dimensus est, meridiem ac septentrionem; quae partes illis duabus
societate junguntur. Ea enim, quae est solis calore flagrantior,
proxima est, et cohaeret orienti. At illa, quae frigoribus et
perpetuo gelu torpet, ejusdem est cujus extremus occasus. Nam sicut
contrariae sunt lumini tenebrae, ita frigus calori. Ut igitur calor
lumini est proximus, sic meridies orienti: ut frigus tenebris, ita
plaga est septentrionalis occasui. Quibus singulis partibus suum
tempus attribuit, ver scilicet orienti, aestatem meridianae plagae;
occidentis autumnus est, septentrionis hyems. In his quoque duabus
partibus, meridiana et septentrionali, figura vitae et mortis
continetur: quia vita in calore est, mors in frigore. Sicut autem
calor ex igne est, ita frigus ex aqua. Secundum harum partium
dimensionem, diem quoque fecit ac noctem, quae spatia, et orbes
temporum perpetuos ac volubiles, quos vocamus annos, alterna per
vices successione conficiant. Dies, quem primus oriens subministrat,
Dei sit necesse est, ut omnia quaecumque meliora sunt. Nox autem,
quam occidens extremus inducit, ejus scilicet, quem Dei esse aemulum
diximus.
Quippe ubi temperiem sumpsere humorque
calorque, Alterum enim quasi masculinum elementum est, alterum quasi foemininum; alterum activum, alterum patibile. Ideoque a veteribus institutum est, ut sacramento ignis et aquae nuptiarum foedera sanciantur, quod foetus animantium calore et humore corporentur, atque animentur ad vitam. Cum enim constet omne animal ex anima et corpore, materia corporis in humore est, animae in calore: quod ex avium foetibus datur scire, quos crassi humoris plenos nisi opifex calor foverit, nec humor potest corporari, nec corpus animari. Exulibus quoque ignis et aqua interdici solebat: adhuc enim videbatur nefas, quamvis malos, tamen homines supplicio capitis afficere. Interdicto igitur usu earum rerum, quibus vita constat hominum, perinde habebatur, ac si esset, qui eam sententiam exceperat, morte mulctatus. Adeo ista duo elementa prima sunt habita, ut nec ortum hominis, nec sine his vitam crediderint posse constare. Horum alterum nobis commune est cum caeteris animantibus, alterum soli homini datum. Nos enim quoniam coeleste atque immortale animal sumus, igne utimur, qui nobis in argumentum immortalitatis datus est, quoniam ignis e coelo est: cujus natura, quia mobilis est, et sursum nititur, vitae continet rationem. Caetera vero animalia, quoniam tota sunt mortalia, tantummodo aqua utuntur, quod est elementum corporale atque terrenum. Cujus natura, quia mobilis est, ac deorsum vergens, figuram mortis ostendit. Ideo pecudes, neque in coelum suspiciunt, neque religiones sentiunt, quoniam ab his usus ignis alienus est. Unde autem, vel quomodo Deus haec duo principalia, ignem et aquam, vel accenderit, vel eliquaverit, solus scire potest qui fecit. |
X. A présent que nous avons réfuté ceux qui ont du monde et de Dieu son auteur une opinion contraire à la vérité, retournons à cette œuvre divine de l'univers dont parlent les livres mystérieux de notre sainte religion. Dieu créa le ciel avant toutes choses, et il le suspendit dans la partie la plus élevée de l'univers pour y établir le trône de sa gloire. Il a ensuite affermi la terre qui devait servir de demeure aux hommes et aux animaux. Il a répandu sur sa surface la mer et les fleuves. Il a rempli le lieu de sa demeure de lumière, en y attachant le soleil, la lune et une infinité d'autres globes éclatants. Il a placé les ténèbres sur la terre, car cette masse grossière et opaque n'a pas d'autre jour que celui qu'elle reçoit du ciel ; elle est le lieu de la nuit, de la mort et du tombeau, comme la partie qui lui est opposée est le lieu de la lumière et de la vie. La terre est autant éloignée du ciel que le mal est éloigné du bien, que le vice est éloigné de la vertu. Il a divisé la terre en deux parties qui semblent contraires, l'orientale et l'occidentale. L'orient a un rapport particulier avec Dieu, qui est le véritable principe de la lumière, le soleil spirituel et invisible qui nous éclaire et qui nous conduit à une vie immortelle. L'occident, au contraire, ressemble à cet esprit ténébreux qui nous dérobe la lumière et qui nous jette dans la mort du péché. Il a encore distingué sur la terre deux autres parties : le midi, qui approche plus de l'orient et qui est exposé aux ardeurs du soleil, et le septentrion qui approche de l'occident, et qui est couvert de neige et de glace. Le froid est contraire au chaud, comme les ténèbres sont contraires à la lumière. Le midi approche de l'orient, comme la chaleur approche de la lumière, et le septentrion approche de l'occident, comme le froid approche des ténèbres. Il a assigné à chaque partie une saison qui lui est propre, savoir : le printemps à l'orient, l'été au midi, l'automne à l'occident, et l'hiver au septentrion. Le midi et le septentrion sont aussi des images de la vie et de la mort, parce que la vie consiste dans la chaleur qui procède du feu, comme la mort consiste dans le froid qui procède de l'eau. Ces saisons apportent une grande variété dans la longueur des jours et des nuits, dont la révolution continuelle suit les années et les autres mesures du temps. Le jour que l'orient répand appartient à Dieu, comme tout ce qu'il y a de bon et d'excellent lui appartient; la nuit, au contraire, que l'occident répand, appartient à l'esprit qui, comme nous l'avons dit, est contraire à Dieu. Ce souverain seigneur de l'univers a trouvé bon de tracer dans le jour et dans la nuit des figures de la religion et des superstitions; car comme le soleil, bien qu'il soit seul, ainsi que son nom le porte, est le père du jour et remplit toutes les parties du monde de sa lumière et de sa chaleur. Dieu de la même manière, bien qu'il soit unique, a une majesté, une grandeur et une puissance infinies. La nuit, dont nous avons dit que l'intendance est donnée à l'esprit ennemi de Dieu, représente en quelque sorte par sa noirceur l'aveuglement et l'erreur des superstitions païennes; car quelque grand que soit le nombre des astres qui brillent au milieu des ténèbres, ils n'en sauraient jamais dissiper l'obscurité, et ayant fort peu d'éclat ils n'ont point du tout de chaleur. La chaleur et l'humidité sont deux principes que Dieu a établis pour la production et pour la conservation de tous les êtres. Comme la force de Dieu consiste dans la chaleur et dans le feu, si l'excès de cette ardeur n'avait été en quelque sorte tempéré par l'humidité et par la fraîcheur de la matière, elle aurait entièrement consumé tout ce qui lui aurait été exposé, de sorte que rien n'aurait reçu la vie qu'il ne l'eût aussitôt perdue. C'est pour cela que quelques philosophes et quelques poètes ont dit que le monde subsiste par l'accord et par la discorde qui se rencontrent entre les parties qui le composent. Héraclite a dit que toutes choses étaient nées du feu. Thalès de Milet a dit qu'elles étaient nées de l'eau. Ils ont tous les deux découvert quelque chose de la vérité, et se sont pourtant trompés tous les deux ; car s'il n'y avait point eu d'autre principe que le feu, jamais l'eau n'en serait sortie; et s'il n'y avait eu d'autre principe que l'eau, jamais le feu n'aurait été produit. La vérité est que le mélange de ces deux éléments est la cause de toutes les productions. Ce n'est pas que le feu puisse être mêlé avec l'eau, parce que ce sont deux contraires dont l'un détruirait l'autre; mais la chaleur qui procède du feu et l'humidité qui procède de l'eau peuvent être mêlées, et Ovide a eu raison d'en parler de cette sorte. Quelle que soit la contrariété apparente entre la chaleur et l'humidité, et quelque combat qu'il y ait sans cesse entre l'eau et le feu, il est vrai pourtant qu'il n'y a rien dans l'univers qui ne soit composé du mélange de ces qualités contraires. L'un de ces deux éléments est comme le mâle et l'autre comme la femelle; l'un agit et l'autre souffre. Les anciens se servaient du symbole du feu et de l'eau dans la célébration de leurs mariages, parce que la chaleur de l'un et l'humidité de l'autre servent à former et à animer les corps des animaux. Tout animal étant composé de corps et d'âme, l'humidité sert de matière à l'un et la chaleur à l'autre. Cela paraît principalement dans la formation des oiseaux; car bien que les œufs d'où ils sortent soient remplis d'une humeur épaisse, jamais cette humeur n'est animée qu'elle n'ait été auparavant rendue féconde par la chaleur. C'était autrefois une coutume de défendre l'usage de l'eau et du feu aux coupables; car on était encore persuadé en ces premiers temps que, quelque crime qu'un homme eût commis, il ne fallait pas le punir de mort ; mais en le privant de l'eau et du feu sans lesquels on ne saurait presque conserver la vie, on faisait presque la même chose que si on la lui eût ôtée. Voilà comment ces deux éléments ont toujours paru si nécessaires, que l'on a cru que sans eux l'homme ne pouvait ni recevoir l'être ni le conserver; l'usage de l'un de ces éléments nous est commun avec les bêtes, et l'autre nous est propre. Nous nous servons seuls du feu, qui étant descendu du ciel, et tendant vers le ciel par un mouvement perpétuel, nous avertit en quelque sorte de l'immortalité de notre Ame. Les autres animaux, qui sont entièrement sujets à la mort, ne se servent que de l'eau, qui est un élément grossier et terrestre, dont la pesanteur tend toujours vers le bas, et marque le lieu du tombeau; les animaux qui sont privés de l'usage du feu ne regardent jamais le ciel et n'ont aucun sentiment de religion. Il n'y a que Dieu, qui est l'auteur de ces deux éléments, qui sache de quelle manière il en a allumé un, et de quelle manière il a répandu l'autre sur la terre.
|
|
CAPUT XI. De animantibus, homine, Prometheo, Deucalione, Parcis. Consummato igitur mundo, animalia varii generis, dissimilibus formis, et magna et minora ut fierent, imperavit. Et facta sunt bina; id est diversi sexus singula: ex quorum foetibus, et aer, et terra, et maria completa sunt. Deditque his omnibus generatim Deus alimenta de terra, ut usui hominibus esse possent; alia nimirum ad cibos, alia vero ad vestitum: quae autem magnarum sunt virium, ut in excolenda terra juvarent; unde dicta sunt jumenta. Ita rebus omnibus mirabili descriptione compositis, regnum sibi aeternum parare constituit, et innumerabiles animas procreare, quibus immortalitatem daret. Tum fecit ipsi sibi simulacrum sensibile, atque intelligens, id est ad imaginis suae formam, qua nihil potest esse perfectius: hominem figuravit ex limo terrae; unde homo nuncupatus est, quod sit factus ex humo. Denique Plato humanam formam esse ait; et Sibylla, quae dicit: Εἰκών ἐστ' ἄνθρωπος ἐμὴ λόγον ὀρθὸν ἔχουσα De hac hominis fictione poetae quoque, quamvis corrupte, tamen non aliter tradiderunt: namque hominem de luto a Prometheo factum esse dixerunt. Res eos non fefellit, sed nomen artificis. Nullas enim litteras veritatis attigerant: sed quae prophetarum vaticinio tradita, in sacrario Dei continebantur, ea de fabulis et obscura opinione collecta et depravata, ut veritas a vulgo solet variis sermonibus dissipata corrumpi, nullo non addente aliquid ad quod audierat, carminibus suis comprehenderunt; et hoc quidem inepte, quod tam mirabile tamque divinum opificium homini dederunt. Quid enim opus fuit hominem de luto fingi, cum posset eadem ratione generari qua ipse Prometheus ex Japeto natus est? qui si fuit homo, generare hominem potuit, facere non potuit. De diis autem illum non fuisse, poena ejus in Caucaso monte declarat. Sed neque patrem ipsius Japetum, patruumque Titana quisquam deos nuncupavit, quia regni sublimitas penes Saturnum solum fuit, per quam divinos honores cum omnibus suis posteris consecutus est. Multis argumentis hoc figmentum poetarum coargui potest. Factum esse diluvium ad perdendam tollendamque ex orbe terrae malitiam, constat inter omnes. Idem enim et philosophi, poetae, scriptoresque rerum antiquarum loquuntur; in eoque maxime cum prophetarum sermone consentiunt. Si ergo cataclysmus ideo factus est, ut malitia, quae per nimiam multitudinem increverat, perderetur, quomodo fictor hominis Prometheus fuit? cujus filium Deucalionem iidem ipsi ob justitiam solum esse dicunt servatum. Quomodo unus gradus, et una progenies, orbem terrae tam celeriter potuit hominibus implere? Sed videlicet hoc quoque sic corruperunt, ut illud superius; cum ignorarent, in quo tempore cataclysmus sit factus in terra, et quis ob justitiam meruerit, genere humano pereunte, salvari, et quomodo, aut cum quibus servatus sit: quae omnia propheticae litterae docent. Apparet ergo falsum esse quod de opificio Promethei narrant. Verum quia poetas dixeram non omnino mentiri solere, sed figuris involvere, et obscurare quae dicant, non dico esse mentitos, sed primum omnium Promethea simulacrum hominis formasse de pingui et molli luto, ab eoque primo natam esse artem, et statuas, et simulacra fingendi; siquidem Jovis temporibus fuit, quibus primum templa constitui, et novi deorum cultus esse coeperunt. Sic veritas fucata mendacio est; et illud, quod a Deo factum ferebatur, homini, qui opus divinum imitatus est, etiam coepit adscribi. Caeterum fictio veri ac vivi hominis e limo Dei est. Quod Hermes quoque tradidit: qui non tantum hominem ad imaginem Dei factum esse dixit a Deo; sed etiam illud explanare tentavit, quam subtili ratione singula quaeque in corpore hominis membra formaverit, cum eorum nihil sit quod non tantumdem ad usus necessitatem, quantum ad pulchritudinem valeat. Id vero etiam stoici, cum de providentia disserunt, facere conantur; et secutus eos Tullius pluribus quidem locis. Sed tamen materiam tam copiosam et uberem strictim contingit; quam ego nunc idcirco praetereo, quia nuper proprium de ea re librum ad Demetrianum auditorem meum scripsi. Illud hoc loco praeterire non possum, quod errantes philosophi quidam aiunt, homines, caeteraque animalia sine ullo artifice orta esse de terra; unde illud Virgilianum est:
Virumque Et ii maxime fuerunt in ea sententia qui esse providentiam negant. Nam stoici animantium fabricam divinae solertiae tribuunt. Aristoteles autem labore se ac molestia liberavit, dicens semper mundum fuisse; itaque et humanum genus, et caetera quae in eo sunt, initium non habere, sed fuisse semper, ac semper fore. Sed cum videamus singula quaeque animalia, quae ante non fuerant, incipere esse, et esse desinere, necesse est totum genus aliquando esse coepisse, et aliquando desiturum esse, quia coeperit. Omnia enim tribus temporibus contineri necesse est, praeterito, praesenti, futuro. Praeteriti est origo, praesentis substantia, futuri dissolutio. Quae omnia in singulis hominibus apparent, et incipimus enim, cum nascimur; et sumus, cum vivimus; et desinimus, cum interimus. Unde etiam tres Parcas esse voluerunt; unam, quae vitam hominibus ordiatur; alteram, quae contexat; tertiam, quae rumpat ac finiat. In toto autem genere hominum, quia solum praesens tempus apparet, ex eo tamen et praeteritum, id est, origo colligitur; et futurum, id est, dissolutio. Nam quoniam est, apparet aliquando coepisse (esse enim nulla res sine exordio potest); et quia coepit, apparet quandoque desiturum. Nec enim potest id totum esse immortale, quod ex mortalibus constat. Nam sicut universi per singulos interimus, fieri potest, ut aliquo casu omnes simul; vel sterilitate terrarum, quae accidere particulatim solet; vel pestilentia ubique diffusa, quae singulas urbes atque regiones plerumque populatur; vel incendio in orbem misso, quale jam fuisse sub Phaetonte dicitur; vel diluvio aquarum, quale sub Deucalione traditur, cum praeter unum hominem genus omne deletum est. Quod diluvium si casu accidit, profecto potuit accidere, ut et unus ille, qui superfuit, interiret. Si autem divinae providentiae nutu, quod negari non potest, ad reparandos homines reservatus est, apparet in Dei potestate esse, vel vitam, vel interitum generis humani. Quod si potest occidere in totum, quia per partes occidit, apparet aliquando esse ortum; et ut fragilitas initium, sic declarat et terminum. Quae si vera sunt, non poterit defendere Aristoteles, quominus habuerit et mundus ipse principium. Quod si Aristoteli Plato et Epicurus extorquent, et Platoni et Aristoteli, qui semper fore mundum putaverunt, licet sint eloquentes, ingratis tamen idem Epicurus eripiet, quia sequitur, ut habeat et finem. Sed haec in ultimo libro pluribus. Nunc ad hominis originem recurramus. |
XI. Lorsque Dieu eut achevé le monde, il commanda que les animaux de diverses formes et de diverses espèces, grands et petits, fussent faits. Ils furent faits deux de chaque espèce et de différent sexe, et ils se sont tellement multipliés depuis qu'ils ont rempli la vaste étendue de l'air, de la mer et de la terre. Dieu leur permit de se nourrir des aliments qui croissent sur la terre, afin qu'ils puissent servir les uns à la nourriture de l'homme, les autres à son vêtement, les autres au travail et au labourage. Lorsqu'il eut ainsi rangé les parties de l'univers dans cet ordre admirable qui en fait la principale beauté, il se fit à lui-même un royaume éternel, en créant un nombre infini d'âmes auxquelles il donna le privilège de l'immortalité. Il fit ensuite un portrait sensible et intelligent de lui-même, et le plus excellent que l'on puisse voir. Il forma le corps de l'homme du limon, et c'est ce que le nom d'homme marque dans la langue latine. Platon a dit que la forme de l'homme ressemble à celle de Dieu, et cette pensée a assez de rapport à celle que la sibylle présente à l'esprit, quand elle dit que l'homme est une image de Dieu, mais une image animée et raisonnable. Bien que les poètes n'aient parlé que fort imparfaitement de la formation de l'homme, ils n'ont pas laissé de dire qu'il a été fait de limon par Prométhée. Ils ne se sont pas trompés dans le fond, ils ne se sont trompés que dans le nom de l'ouvrier : car ils n'avaient eu aucune connaissance des livres sacrés qui expliquent clairement la vérité ; ils n'avaient rien lu des prophètes dont les prédictions étaient cachées dans le secret de Dieu. Ils n'ont rois dans leurs poèmes que ce qu'ils avaient appris de la fable, et l'ont mis corrompu par le mélange des erreurs populaires sur lesquelles chacun avait enchéri à l'envi, comme il arrive ordinairement quand on rapporte les faux bruits qui ont été une fois répandus. C'est sans doute une impertinence d'attribuer à l'homme, comme ils ont fait, un ouvrage si excellent et si divin. Qu'était-il besoin que Prométhée prit du limon pour faire l'homme, puisqu'il le pouvait engendrer de la même façon qu'il avait été engendré par Japhet son père ? Le supplice qu'il subit sur le mont Caucase ne fait que trop voir qu'il n'était pas du nombre des dieux. Japhet son père, ni Titan son oncle, n'ont jamais été honorés par personne de ce titre, il n'a été attribué qu'à Saturne et à ses descendants, en considération de la dignité royale dont il avait joui. Il n'y a rien si aisé que de détruire cette vaine imagination des poètes touchant la formation de l'homme; tout le monde demeure d'accord que le déluge n'a été répandu sur la terre que pour la laver des crimes dont elle était toute salie; les philosophes, les poètes et les historiens conviennent de cette vérité avec les prophètes. Si l'unique fin du déluge a été d'arrêter le cours des crimes que le grand nombre des hommes avait rendus trop publics et trop communs, comment Prométhée a-t-il formé l'homme, puisque les poètes assurent que Deucalion, qui était son fils, fut seul préservé à cause de sa justice? la terre a-t-elle pu être si fort peuplée dans l'espace d'une seule génération ? Les poètes ont changé ces circonstances aussi bien que d'autres dont nous avons déjà parlé, parce qu'ils n'ont rien su de ce que les livres saints enseignent touchant le temps auquel le déluge inonda la terre, touchant la personne dont la vertu mérita d'être préservée de l'inondation, et touchant la manière dont elle fut préservée et le nombre de ceux qui furent aussi sauvés avec lui. Il est donc clair que ce qu'ils avancent, de la manière dont Prométhée forma l'homme, est contraire à la vérité ; ce n'est pas qu'ils l'aient tout à fait abolie, ils n'ont fait que l'obscurcir et l'envelopper. Prométhée inventa en effet le premier l'art de faire des figures et des images avec de la terre et du limon, et il vécut au temps de Jupiter, où on commença à élever des temples et où on inventa le culte des dieux. Voilà comment la vérité a été altérée par le mensonge, et comment on a attribué l'ouvrage de Dieu à un homme qui n'en avait fait que la figure; au reste il n'y a que Dieu qui ait formé de limon un homme vivant et véritable. Trismégiste reconnaît cette vérité, et non seulement avoue que Dieu a fait l'homme à son image, mais tâche même d'expliquer le soin qu'il a pris de travailler à chaque partie, dont il n'y en a aucune qui ne soit aussi admirable pour son usage que pour sa beauté. Les stoïciens remarquent à peu près les mêmes choses lorsqu'ils parlent de la Providence, et Cicéron les a imités en plusieurs endroits de ses ouvrages; il n'a pourtant touché que légèrement cette matière, quoiqu'elle soit fort abondante. Je ne la traiterai pas en ce lieu-ci, parce que je l'ai traitée fort au long dans un livre que j'ai adressé à Démétrianus, mon disciple. Je ne puis néanmoins admettre l'erreur où sont tombés quelques philosophes, qui ont soutenu que les hommes et les autres animaux étaient nés de la terre, sans qu'aucun ouvrier eût travaillé à les former ; c'est ce qu'il semble que Virgile ait voulu faire entendre, quand il a dit que la race des hommes est sortie de dessous les sillons de la terre. Ce sont principalement ceux qui nient la Providence qui ont été dans ce sentiment; car les stoïciens qui la reconnaissent, tiennent que Dieu a pris le soin de produire les animaux. Aristote a évité cette difficulté en soutenant que le monde est éternel, et que la nature humaine n'a point eu de commencement et n'aura point de fin; mais puisque nous voyons que chaque animal naît en un temps et meurt en un autre, il faut nécessairement que l'espèce entière soit sujette à la même loi, qu'elle ait autrefois commencé et qu'elle doive un jour finir. Il n'y a rien au monde qui ne soit renfermé dans l'espace du passé, du présent et de l'avenir; le passé est le temps de la naissance, le présent celui de la consistance, et l'avenir celui de la dissolution. Ces trois degrés se font remarquer dans le cours de la vie de tous les hommes. Nous commençons quand nous naissons, nous demeurons en un état de consistance durant toute notre vie, et nous finissons par la mort. C'est pour cela que les poètes ont inventé trois Parques, dont l'une commence la vie de l'homme, l'autre la continue, et la dernière la termine. Bien que l'on ne voie que le présent dans le cours de la vie humaine, on ne laisse pas de reconnaître par là même, et le passé qui est le temps de l'origine, et l'avenir qui est celui de la mort. Car tout ce qui est a autrefois commencé, et parce qu'il a commencé, il finira. La nature ne peut être immortelle, puisqu'elle ne subsiste que dans les individus qui sont mortels. Comme chaque individu meurt séparément, il peut arriver que tous les individus ou au moins un grand nombre d'entre eux soient enlevés, soit par la stérilité de la terre et par la disette des grains, ou par la corruption de l'air et par une maladie contagieuse, ou par un embrasement général semblable à celui qui consuma l'univers au temps de Phaéton, ou par une pluie telle que celle dont Deucalion eut seul le bonheur d'être préservé. Si ce fut par hasard que le déluge inonda la terre, il pouvait par un hasard semblable enlever l'homme qui en échappa seul, mais cet homme fut sauvé seul par l'ordre de la divine providence. Il est clair que la conservation et la ruine du genre humain dépendent uniquement de Dieu ; si la nature entière peut finir parce que les individus qui la composent finissent, il est clair qu'elle a commencé, et ce commencement est une marque aussi naturelle et aussi nécessaire de sa fragilité que sa fin. Si tout ceci est véritable, Aristote n'a pu soutenir comme il l'a fait que le monde a toujours été. Si Platon et Epicure convainquent Aristote sur ce point, Epicure convaincra Aristote et Platon, malgré toute leur éloquence sur ce qu'ils ont cru que le monde n'avait point de fin, car il faut nécessairement qu'il en ait une puisqu'il a eu un commencement. Je traiterai plus amplement ce sujet dans le dernier livre, mais maintenant je continuerai à traiter ce qui reste touchant la formation de l'homme.
|
|
CAPUT XII. Quod animalia non sponte nata sint, sed dispositione divina, cujus fecisset nos conscios Deus, si scire expediret. Aiunt certis conversionibus coeli, et astrorum motibus maturitatem quamdam extitisse animalium serendorum; itaque terram novam, semen genitale retinentem, folliculos ex se quosdam in uterorum similitudinem protulisse, de quibus Lucretius: Crescebant uteri terrae radicibus apti; eosque, cum maturassent, natura cogente ruptos, animalia tenera profudisse. Deinde terram ipsam humore quodam, qui esset lacti similis, exuberasse, eoque alimento animantes esse nutritas. Quomodo igitur vim frigoris aut caloris ferre aut vitare potuerunt, aut omnino nasci, cum sol exureret, frigus astringeret? Non erant, inquiunt, in principio mundi hyems nec aestas, sed perpetua temperies, et ver aequabile. Cur ergo nihil horum fieri etiamnunc videmus? Quia semel, aiunt, fieri necessarium fuit, ut animalia nascerentur; postquam vero esse coeperunt, concessa his facultate generandi, et terra parere desiit, et temporis conditio mutata est. O quam facile est mendacia redarguere! Primum, quod nihil potest esse in hoc mundo, quod non sic permaneat, ut coepit. Nec enim sol, et luna, et astra tunc non erant, aut cum essent, meatus non habebant, ac non divina moderatio, quae cursus eorum temperat et gubernat, cum ipsis simul coeperit. Deinde quod si ita sit, ut dicunt, providentiam esse necesse est; et in idipsum incidunt, quod maxime fugiunt. Nondum enim natis animalibus, aliquis utique providit, ut nascerentur, ne orbis terrae desertus, atque incultus horreret. Ut autem de terra sine officio parentum nasci possent, necesse est magna ratione esse provisum; deinde ut humor ille concretus de terra in varias imagines corporum fingeretur; item ut e folliculis, quibus tegebantur, accepta vivendi, sentiendique ratione, tamquam ex alvo matrum profunderentur, mira inextricabilisque provisio est. Sed putemus id quoque casu accidisse: illa certe quae sequuntur, fortuita esse non possunt; ut terra continuo lacte manaret, ut aeris temperies esset aequalis. Quae si constat idcirco esse facta, ut animalia recens edita, vel haberent alimentum, vel non haberent periculum, necesse est, ut aliquis divina nescio qua ratione providerit. Quis autem potest providere, nisi Deus? Videamus tamen an id ipsum, quod dictitant, fieri potuerit: ut homines nascerentur e terra. Si consideret aliquis quandiu, et quibus modis educetur infans, intelliget profecto non potuisse terrigenas illos pueros sine ullo educatore nutriri. Fuit enim necesse quampluribus mensibus jacere projectos, donec confirmatis nervis movere se, locumque mutare possent: quod vix intra unius anni spatium fieri potest. Jam vide utrumne infans eodem modo, et eodem loco quo est effusus, jacere per multos menses valuerit, ac non et humore illo terrae, quem alimenti gratia ministrabat, et sui corporis purgamentis in unum mixtis obrutus corruptusque moreretur. Itaque nullo modo fieri potest, quin ab aliquo fuerit educatus; nisi forte animalia omnia non tenera nata sunt, sed excreta: quod ut dicerent, numquam venit illis in mentem. Omnis ergo illa ratio impossibilis, et vana est: si tamen ratio dici potest, qua id agitur ut nulla sit ratio. Qui enim dicit omnia sua sponte esse nata, nihilque divinae providentiae tribuit, hic profecto rationem non asserit, sed evertit. Quod si neque quidquam fieri sine ratione, neque nasci potest, apparet divinam esse providentiam, cujus est proprium quod dicitur ratio. Deus igitur rerum omnium machinator fecit hominem. Quod Cicero, quamvis expers coelestium litterarum, vidit tamen; qui libro de Legibus primo hoc idem tradidit, quod prophetae, cujus verba subjeci: « Hoc animal providum, sagax, multiplex, acutum, memor, plenum rationis et consilii, quem vocamus hominem, praeclara quadam conditione generatum esse a supremo Deo; solum est enim ex tot animantium generibus atque naturis, particeps rationis et cogitationis, cum caetera sint omnia expertia. » Videsne hominem, quamvis longe a veritatis notitia remotum, tamen, quoniam imaginem sapientiae tuebatur, intellexisse non nisi a Deo hominem potuisse generari? Sed tamen divinis opus est testimoniis, ne minus humana sufficiant. Sibylla hominem Dei opus esse testatur:
Ὃς μόνος ἐστὶ Θεὸς κτίστης ἀκράτητος
ὑπάρχων, Eadem sanctae litterae continent. Deus ergo veri patris officio functus est. Ipse corpus effinxit; ipse animam qua spiramus infudit. Illius est totum, quidquid sumus. Quomodo id fecerit, si nos oporteret scire, docuisset, sicut docuit caetera quae cognitionem nobis, et pristini erroris et veri luminis attulerunt. CAPUT XIII. Quare duo sexus in homine: quid sit mors ejus prima, quid secunda; et de primorum parentum culpa et poena. Cum ergo marem ad similitudinem suam primum finxisset, tum etiam foeminam configuravit ad ipsius hominis effigiem, ut duo inter se permisti sexus propagare sobolem possent, et omnem terram multitudine opplere. In ipsius autem hominis fictione illarum duarum materiarum, quas inter se diximus esse contrarias, ignis et aquae, conclusit perfecitque rationem. Ficto enim corpore, spiravit ei animam de vitali fonte spiritus sui, qui est perennis, ut ipsius mundi ex contrariis constantis elementis similitudinem gereret. Constat enim ex anima et corpore, id est, quasi e coelo et terra: quandoquidem anima, qua vivimus, velut e coelo, oritur a Deo, corpus e terra, cujus e limo diximus esse formatum. Empedocles, quem nescias utrumne inter poetas, an inter philosophos numeres, quia de rerum natura versibus scripsit, ut apud Romanos Lucretius et Varro, quatuor elementa constituit, id est, ignem, aerem, aquam, et terram; fortasse Trismegistum secutus, qui nostra corpora ex his quatuor elementis constituta esse dixit a Deo: habere namque in se aliquid ignis, aliquid aeris, aliquid aquae, aliquid terrae; et neque ignem esse, neque aerem, neque aquam, neque terram: quae quidem falsa non sunt. Nam terrae ratio in carne est; humoris, in sanguine; aeris, in spiritu; ignis, in calore vitali. Sed neque sanguis a corpore secerni potest, sicut humor a terra; neque calor vitalis a spiritu, sicut ignis ab aere: adeo rerum omnium duo sola reperiuntur elementa, quorum omnis ratio in nostri corporis fictione conclusa est. Ex rebus igitur diversis ac repugnantibus homo factus est, sicut ipse mundus ex luce ac tenebris, ex vita et morte: quae duo inter se pugnare in homine praecepit, ut si anima superaverit, quae ex Deo oritur, sit immortalis, et in perpetua luce versetur; si autem corpus vicerit animam, ditionique subjecerit, sit in tenebris sempiternis, et in morte. Cujus non ea vis est, ut injustas animas extinguat omnino, sed ut puniat in aeternum. Eam poenam secundam mortem nominamus, quae est et ipsa perpetua, sicut et immortalitas. Primam sic definimus: Mors est naturae animantium dissolutio; vel ita: Mors est corporis animaeque seductio. Secun-dam vero sic: Mors est aeterni doloris perpessio; vel ita: Mors est animarum pro meritis ad aeterna supplicia damnatio. Haec mutas pecudes non attingit, quarum animae non ex Deo constantes, sed ex communi aere, morte solvuntur. In hac igitur societate coeli atque terrae, quorum effigies in homine expressa est, superiorem partem tenent ea quae sunt Dei, anima scilicet, quae dominium corporis habet; inferiorem autem ea quae sunt diaboli, corpus utique: quod quia terrenum est, animae debet esse subjectum, sicut terra coelo. Est enim quasi vasculum, quo tamquam domicilio temporali spiritus hic coelestis utatur. Utriusque officia sunt, ut hoc, quod est ex coelo et Deo, imperet, illud vero, quod ex terra est et diabolo, serviat. Quod quidem non fugit hominem nequam Sallustium, qui ait: Sed omnis nostra vis in animo et corpore sita est; animi imperio, corporis servitio magis utimur. Recte, si ita vixisset, ut locutus est. Servivit enim foedissimis voluptatibus, suamque ipse sententiam vitae pravitate dissolvit. Quod si anima ignis est, ut ostendimus, in coelum debet eniti, sicuti ignis, ne extinguatur, hoc est ad immortalitatem, quae in coelo est. Et sicut ardere, ac vivere non potest ignis, nisi aliqua pingui materia teneatur, in qua habeat alimentum: sic animae materia et cibus est sola justitia, qua tenetur ad vitam. Post haec Deus hominem, qua exposuri ratione generatum, posuit in paradiso, id est, in horto foecundissimo, et amoenissimo: quem in partibus Orientis omni genere ligni arborumque consevit, ut ex earum variis fructibus aleretur, expersque omnium laborum, Deo patri summa devotione serviret. Tum dedit ei certa mandata: quae si observasset, immortalis maneret, si transcendisset, morte afficeretur. Id autem praeceptum fuit, ut ex arbore una, quae erat in medio paradisi, non gustaret, in qua posuerat intelligentiam boni et mali. Tum criminator ille invidens operibus Dei, omnes fallacias et calliditates suas ad decipiendum hominem intendit, ut ei adimeret immortalitatem. Et primo mulierem dolo illexit, ut vetitum cibum sumeret; et per eam ipsi quoque homini persuasit, ut transcenderet Dei legem. Percepta igitur scientia boni et mali, pudere eum nuditatis suae coepit, absconditque se a facie Dei, quod antea non solebat. Tum Deus ejecit hominem de paradiso, sententia in peccatorem lata, ut victum sibi labore conquireret, ipsumque paradisum igni circumvallavit, ne homo posset accedere, donec summum judicium faciat in terra, et justos viros cultores suos in eumdem locum revocet, morte sublata; sicut sacrae voces docent, et Sibylla Erythraea, cum dicit:
Οἵ δὲ Θεὸν τιμῶντες ἀλητινὸν ἄεναὸν γε Verum quoniam haec extrema sunt, in extrema operis hujus parte tractabimus. Nunc ea, quae prima sunt, explicemus. Mors itaque secuta est hominem secundum Dei sententiam; quod etiam Sibylla in carmine suo docet, dicens:
Ἄνθρωπον πλασθέντα Θεοῦ παλάμαις ἐνὶ
αὐταῖς Sic facta hominis vita est temporaria: sed tamen longa, quae in mille annos propagaretur. Quod divinis litteris proditum, et per omnium scientiam publicatum cum Varro non ignoraret, argumentari nisus est cur putarentur antiqui mille annos victitasse. Ait enim, apud Aegyptios pro annis menses haberi, ut non solis per XII signa circuitus faciat annum, sed luna, quae orbem illum signiferum 30 dierum spatio lustrat: quod argumentum perspicue falsum est. Nemo enim tunc millesimum annum transgressus est. Nunc vero qui ad centesimum perveniunt, quod fit saepissime, mille certe ac ducentis mensibus vivunt. Et auctores idonei tradunt, ad centum et viginti annos perveniri solere. Sed quia ignorabat Varro, cur aut quando vita hominis esset diminuta, ipse diminuit; cum sciret mille et quadringentis mensibus posse vivere hominem. |
XII. Quelques-uns assurent que la révolution du ciel et des astres a amené une saison propre à jeter la semence de toutes sortes d'animaux, que la terre, l'ayant reçue et l'ayant conservée, a produit comme certains petits étuis dont Lucrèce a dessein de parler, quand il a dit que le sein de la terre semblait s'enfler et s'ajuster aux racines des plantes et des arbres. Lorsque ces étuis sont venus à une juste maturité et qu'ils se sont rompus, il en est sorti quantité de petits animaux. La terre a été trempée en même temps d'une humeur semblable au lait, et qui leur a servi de nourriture. Comment ont-ils pu éviter ou supporter le froid et le chaud? Comment ont-ils pu naître pendant qu'ils étaient ou gelés par la glace ou brûlés par les ardeurs du soleil ? C'est, dit-on, qu'au commencement du monde, il n'y avait ni hiver ni été. C'était un printemps perpétuel et une température d'air toujours égale. Pourquoi ne jouissons-nous plus de cette agréable température? C'est qu'elle n'était nécessaire, explique-t-on, qu'au commencement du monde pour favoriser la naissance des animaux, mais depuis qu’ils sont venus à une juste grandeur et qu'ils ont eu la puissance d'engendrer leurs semblables, la terre a cessé d'en produire, et les saisons ont été réglées comme nous les voyons. Qu'il est aisé de détruire le mensonge! Premièrement, il n'y a rien dans le monde qui ne se conserve en l'état où il a été créé. Le soleil la lune et les astres avaient été créés avant ce temps-là. Ils avaient déjà un mouvement et un cours réglé par l'ordre de la divine providence. De plus, quand ce que prétendent ceux dont je parle serait vrai, ils retomberaient dans le mal qu'ils veulent éviter, et seraient contraints de reconnaître une providence. Il fallait en effet qu'il y eût une puissance intelligente qui, pour empêcher que la terre ne demeurât déserte, présidât à la naissance des animaux; qui préparât la terre pour la rendre propre à les produire d'elle-même, et à leur donner cette variété si merveilleuse de formes et de figures qui les distinguent. Il fallait sans doute un soin tout particulier pour faire en sorte que les animaux sortissent des étuis où ils étaient enfermés, et qu'à ce moment-là même ils reçussent la vie et le sentiment. Que s'ils ne l'ont reçu que par hasard, n'est-ce aussi que par hasard que la terre a fait couler comme une espèce de lait pour les nourrir, et que l'air est devenu doux et tempéré de peur de leur nuire ? Il est certain que cela n'est pas arrivé sans un soin particulier, et qu'il n'y a que Dieu qui l'ait pu prendre. Mais examinons s'il est probable que l'homme ait pu naître de la terre, comme l'on dit. Quiconque considérera avec attention la peine qu'il faut prendre, et le temps qu'il faut mettre à élever des enfants, reconnaîtra certainement qu'il aurait été impossible que des enfants nés de la terre eussent pu vivre sans que quelqu'un eût soin de les nourrir. Il aurait fallu qu'ils eussent été étendus sur la terre l'espace de plusieurs mois durant lesquels leurs nerfs étaient trop faibles pour les soutenir. Ils n'auraient eu presque point, de mouvement. Il n'y a personne qui ne juge fort bien qu'il est impossible qu'un enfant demeure plusieurs mois dans la même posture où il aurait été jeté au moment de sa naissance. Mais s'il était demeuré en cet état, les déjections ne se seraient-elles pas mêlées avec l'humeur que la terre aurait fait couler pour le nourrir, et si elles s'y étaient mêlées, ne l'auraient-elles pas étouffé? Il a donc fallu qu'il y ait eu quelqu'un qui ait eu le soin d'élever l'homme ; car personne ne s'est encore avisé de dire que les animaux ne sont pas nés faibles, mais qu’ils sont nés capables de se nourrir. Cette manière dont on explique la naissance des animaux est donc ridicule, vaine, dépourvue d'apparence et de raison. En effet, dire que les animaux sont nés d'eux-mêmes, sans que la Providence ait pris aucun soin de les produire, c'est combattre ouvertement la raison ; ainsi nier la Providence et combattre la raison sont la même chose. Il faut donc avouer que Dieu a fait l'homme comme il a fait toutes les autres créatures. Bien que Cicéron n'eut aucune connaissance des saintes Écritures, il n'a pas laissé de découvrir cette vérité et d'en parler de la même manière que les prophètes avaient fait avant lui. Je rapporterai ici ses paroles. « Cet animal, dit-il, si subtil, si pénétrant, si éclairé, qui se souvient du passé, qui connaît le présent, qui prévoit l'avenir, qui agit par raison et par conseil, et à qui l'on a donné le nom d'homme, a été produit d'une manière toute particulière par le souverain Seigneur de l'univers. Il n'y a que lui parmi tous les animaux qui ait l'avantage de penser et de discourir. » Voilà comment Cicéron, tout éloigné qu'il était de la vérité, a eu pourtant assez de lumières pour reconnaître que l'homme n'a pu être placé dans le monde que par un effet de la divine toute-puissance. Si ces témoignages ne suffisent pas, produisons-en de plus forts. La sibylle déclare que l'homme est l'ouvrage de Dieu quand elle dit : Dieu, qui a seul tiré le monde du néant pur un effet de sa puissance infinie, a pris aussi le soin de former le corps du premier homme et de lui inspirer l'âme et la vie. Les livres saints nous enseignent la même vérité. Dieu nous a donc rendu les véritables devoirs d'un père. Il a formé nos corps et répandu en eux la vie qui les anime. Ainsi, nous tenons de lui tout ce que nous sommes. S'il avait été à propos que nous connaissions de quelle manière il a achevé cet ouvrage, il nous l'aurait enseigné comme il nous a enseigné ce qui nous était nécessaire pour nous retirer de l'erreur et pour nous conduire à la vérité. XIII. Dieu ayant fait l'homme à son image fit ensuite la femme à l'image de l'homme, afin qu'ils pussent mettre des enfants au monde et avoir une postérité qui se multipliât de telle sorte qu'elle remplît toute la terre. Pour faire l'homme, il se servit du feu et de l'eau, de ces deux matières que nous avons dit être si contraires. Dès que le corps fut achevé, il l'anima par le souffle de son esprit et par la communication de sa vie éternelle. Ainsi l'homme est un petit monde formé par le mélange d'aliments contraires et composé d'âme et de corps, dont l'une ressemble au ciel et l'autre à la terre. L'âme qui nous fait vivre est descendue du ciel et nous est communiquée par l’effusion de l'esprit de Dieu, et le corps a été tiré de la terre et formé de limon. Empédocle, que l'on ne sait en quel rang on doit mettre, ou en celui des poètes, ou en celui des philosophes, parce qu'il a écrit sur les choses naturelles en vers grecs, comme Varron et Lucrèce en ont écrit en vers latins, a admis quatre éléments, savoir : le feu, l'air, l'eau et la terre ; en quoi il a suivi Trismégiste qui avait dit avant lui que nos corps ne sont ni feu, ni air, ni terre, ni eau, mais un composé de toutes ces choses. Ce qui certainement est très vrai ; car la chair a quelque chose de la terre, le sang a quelque chose de l'eau, les esprits ont quelque chose de l'air, et la chaleur a quelque chose du feu. Le sang ne saurait pourtant être tout à fait séparé de notre corps comme l'eau peut l'être de la terre, ni la chaleur ne saurait être séparé des esprits vitaux comme le feu peut l'être de l'air. Ainsi il ne se trouve proprement que deux éléments qui aient contribué à la formation de nos corps. L'homme est donc composé aussi bien que le monde de contraires, de la lumière et des ténèbres, de la vie et de la mort. Dieu a voulu qu'il y eût entre ces contraires un combat perpétuel dans l'homme, afin que si l'âme qui est descendue du ciel remporte la victoire, elle soit immortelle et demeure toujours dans la région de la lumière, et que si au contraire elle est vaincue, elle demeure dans les ténèbres et dans la mort. L'effet de cette mort n'est pas de détruire l'essence de l'âme et de la réduire au néant ; ce n'est que de la châtier d'un châtiment qui n'aura point de fin. Nous appelons ce châtiment la seconde mort, qui est d'une éternelle durée aussi bien que l'âme. On définit la première mort de cette manière : la mort est la destruction de la nature des animaux, ou bien la mort est la séparation du corps et de l'âme. Voici comment on définit la seconde : la mort est la souffrance d'une douleur éternelle, ou bien la mort est la condamnation de l'âme à un supplice éternel et égal à ses crimes. Les bêtes ne sont pas sujettes à la seconde mort, parce que leurs âmes n'ont point été créées de Dieu, mais formées d'air et qu'elles finissent avec leurs corps. L'âme qui vient de Dieu et qui doit commander au corps tient la première place dans l'homme, qui est une image et un abrégé du monde ; et le corps qui vient du démon tient la dernière place, et parce qu'il est terrestre il doit être soumis à l'âme, comme la terre l'est au ciel : c'est en quelque sorte un vase où l'âme est renfermée comme une essence fort précieuse. Le devoir réciproque de ces deux parties, est que celle qui vient de Dieu et du ciel commande, et que celle qui vient du démon et de la terre obéisse. Cette vérité a été reconnue par Salluste lui-même, tout vicieux qu'il était. Voici ce qu'il en dit : « Toute notre force consiste dans l'esprit et dans le corps, l'esprit doit commander et le corps obéir. » Cela est fort bien dit, mais il devait vivre comme il a parlé. Cependant il s'est rendu l'esclave des plus sales voluptés et a démenti ses sentiments par le dérèglement de sa vie. Que si l'âme est un feu comme nous l'avons dit, elle doit tendre comme le feu vers le ciel et s'élever à l'immortalité. Mais comme le feu a besoin pour brûler et pour vivre d'une matière épaisse qui l'entretienne, ainsi l'âme pour vivre a besoin d'une nourriture qui est la justice. Quand Dieu eut fait l'homme de la manière que je l'ai décrit, il le plaça dans le paradis, c'est-à-dire dans un jardin très agréable et très fertile, assis en Orient et planté de toute espèce d'arbres dont les fruits devaient le nourrir et lui fournir une vie facile et sans autre soin que de servir Dieu. Dieu lui fit certains commandements, à condition que s'il les gardait il obtiendrait l'immortalité, et que s'il les violait il deviendrait sujet à la mort. Le principal commandement qu'il lui fit, fut de ne point manger du fruit d'un arbre qu'il avait planté au milieu du paradis, et auquel il avait attaché la connaissance du bien et du mal. Alors le calomniateur, animé par la jalousie qui lui donnait l'excellence de l'ouvrage de Dieu, employa tout ce qu'il avait de ruses et d'artifices pour tromper l'homme, et pour le priver de l'immortalité. Il persuada premièrement à la femme de goûter du fruit défendu, et se servit ensuite de la femme pour porter l'homme à violer le commandement. Dès que l'homme sut le bien et le mal, il eut honte de sa nudité, et tâcha de se cacher et de se dérober à la vue de Dieu, ce qu'il n'avait jamais fait jusque alors. Dieu le condamna à vivre de son travail, le chassa du paradis, entoura le paradis de feu de peur qu'il n'en approchât jusqu'à ce que Dieu juge la terre et jusqu'à ce qu'après avoir détruit la mort il rétablisse ses serviteurs dans ce lieu des saintes délices, comme l'Ecriture et la sibylle même le témoigne quand elle assure que ceux qui auront rendu à Dieu les honneurs et le culte qui lut sont dus, jouiront en récompense d'une vie éternelle dans un lieu délicieux. Mais comme cela n'arrivera qu'à la fin du monde, je n'en dois parler aussi qu'à la fin de mon ouvrage. Parlons maintenant de ce qui a précédé. L'homme est mort comme Dieu l'avait ordonné, et comme la sibylle le déclare quand elle rapporte la manière dont, après que l'homme eut été formé des mains de Dieu, il fut trompé par les ruses du serpent, et tomba dans la mort, au lieu d'arriver à la connaissance du bien et du mal. Ainsi la vie de l'homme devint limitée par le temps, quoique ce temps fût d'assez longue durée, et qu'il s'étendit jusqu'à mille ans. Ce fait dont l'Écriture fait mention est devenu si public que Varron, en ayant entendu parler, voulut rechercher la raison pour laquelle on a étendu jusqu'à mille ans la vie des premiers hommes, et dit que parmi les Égyptiens les mois tiennent lieu d'années. Mais son argument est évidemment faux ; car jamais personne n'a vécu plus de mille ans. Or ceux qui en vivent seulement cent, ce qui n'est pas rare, vivent douze cents mois. Mais parce que Varron ne savait ni le sujet pour lequel la vie des hommes fut accourcie, ni le temps auquel cela arriva, il l'a accourcie lui-même de la manière qui lui a paru la plus probable, sur ce qu'il savait que l'on peut vivre jusqu'à cent vingt ans qui valent quatorze cents mois.
|
|
CAPUT XIV. De Noe vini inventore: qui primi scientiam astrorum habuerint, ac de ortu falsarum religionum. Deus autem postea, cum videret orbem terrae malitia et sceleribus oppletum, statuit humanum genus diluvio perdere: set tamen ad multitudinem reparandam delegit unum, quod, corruptis omnibus, singulare justitiae supererat exemplum. Hic cum sexcentorum esset annorum, fabricavit arcam, sicut praeceperat ei Deus, in qua ipse, cum conjuge, ac tribus filiis totidemque nuribus servatus est, cum aqua universos montes altissimos operuisset. Deinde orbe siccato, execratus injustitiam prioris saeculi Deus, ne rursus longitudo vitae causa esset excogitandorum malorum, paulatim per singulas progenies diminuit hominis aetatem, atque in centum et viginti annis metam collocavit, quam transgredi non liceret. Ille vero, cum egressus esset ex arca, ut sanctae litterae docent, terram studiose coluit, atque vineam sua manu sevit. Unde arguuntur qui auctorem vini Liberum putant. Ille enim non modo Liberum, sed etiam Saturnum, atque Uranum multis antecessit aetatibus. Qua ex vinea cum primum fructum cepisset, laetus factus, bibit usque ad ebrietatem, jacuitque nudus. Quod cum vidisset unus ex filiis, cui nomen fuit Cham, non texit patris nuditatem: sed egressus, etiam fratribus indicavit. At illi sumpto pallio, intraverunt aversis vultibus, patremque texerunt. Quae cum facta recognovisset pater, abdicavit atque expulit filium. At ille, profugus, in ejus terrae parte consedit, quae nunc Arabia nominatur; eaque terra de nomine ejus Chanaan dicta est, et posteri ejus Chananaei. Haec fuit prima gens, quae Deum ignoravit; quoniam princeps ejus et conditor cultum Dei a patre non accepit, maledictus ab eo: itaque ignorantiam divinitatis minoribus suis reliquit. Ab hac gente, proximi quique populi, multitudine increscente, fluxerunt. Ipsius autem patris posteri, Hebraei dicti, penes quos religio Dei resedit. Sed et ab his postea, multiplicato in immensum numero, cum eos angustiae locorum suorum capere non possent, tum adolescentes vel missi a parentibus, vel sua sponte, cum rerum penuria cogeret, profugi, ad quaerendas sibi novas sedes, huc atque illuc dispersi, omnes insulas, et orbem totum replerunt; et a stirpe sanctae radicis avulsi, novos sibi mores, ac instituta pro arbitrio condiderunt. Sed omnium primi, qui Aegyptum occupaverunt, coelestia suspicere atque adorare coeperunt. Et quia neque domiciliis tegebantur propter aeris qualitatem, nec ullis in ea regione nubibus subtexitur coelum, cursus siderum, et defectus notaverunt, dum ea saepe venerantes, curiosius atque liberius intuerentur. Postea deinde potentificas animalium figuras, quas colerent, commenti sunt, quibusdam prodigiis inducti: quorum mox auctores aperiemus. Caeteri autem, qui per terram dispersi fuerunt, admirantes elementa mundi, coelum, solem, terram, male, sine ullis imaginibus ac templis venerabantur, et his sacrificia in aperto celebrabant; donec processu temporum, potentissimis regibus templa et simulacra fecerunt; eaque victimis et odoribus colere instituerunt; sic aberrantes a notitia dei gentes esse coeperunt. Errant igitur, qui deorum cultus ab exordio rerum fuisse contendunt, et priorem esse gentilitatem, quam Dei religionem: quam putant posterius inventam, quia fontem atque originem veritatis ignorant. Nunc ad principium mundi revertamur. CAPUT XV. De inquinatione angelorum, et duobus generibus daemonum. Cum ergo numerus hominum coepisset increscere, providens Deus ne fraudibus suis diabolus, cui ab initio terrae dederat potestatem, vel corrumperet homines, vel disperderet, quod in exordio fecerat, misit angelos ad tutelam cultumque generis humani: quibus quia liberum arbitrium erat datum, praecepit, ante omnia, ne, terrae contagione maculati, substantiae coelestis amitterent dignitatem. Scilicet id eos facere prohibuit, quod sciebat esse facturos, ut veniam sperare non possent. Itaque illos cum hominibus commo-rantes dominator ille terrae fallacissimus consuetudine ipsa paulatim ad vitia pellexit, et mulierum congressibus inquinavit. Tum in coelum ob peccata, quibus se immerserant, non recepti, ceciderunt in terram. Sic eos diabolus ex angelis Dei suos fecit satellites, ac ministros. Qui autem sunt ex his procreati, quia neque angeli, neque homines fuerunt, sed mediam quamdam naturam gerentes, non sunt ad inferos recepti, sicut in coelum parentes eorum. Ita duo genera daemonum facta sunt, unum coeleste, alterum terrenum. Hi sunt immundi spiritus, malorum, quae geruntur, auctores, quorum idem diabolus est princeps. Unde Trismegistus illum δαιμονιάρχεν vocat. Daemonas autem grammatici dictos aiunt, quasi δαήμονας, id est, peritos, ac rerum scios, hos enim putant deos esse. Sciunt illi quidem futura multa, sed non omnia, quippe quibus penitus consilium Dei scire non liceat: et ideo solent responsa in ambiguos exitus temperare. Eos poetae et sciunt esse daemonas, et loquuntur. Hesiodus ita tradit:
Οἱ μὴν δαἰμονές εἰς Διὸς μεγάλου διὰ
βουλὰς, Quod idcirco dictum est, quoniam custodes eos humano generi Deus miserat: sed ipsi, cum sint perditores hominum, custodes tamen se videri volunt, ut ipsi colantur, et Deus non colatur. Philosophi quoque de his disserunt. Nam Plato etiam naturas eorum in Symposio exprimere conatus est. Et Socrates esse circa se assiduum daemona loquebatur, qui sibi puero adhaesisset, cujus arbitrio et nutu sua vita regeretur. Magorum quoque ars omnis ac potentia horum aspirationibus constat, a quibus invocati, visus hominum praestigiis obcaecantibus fallunt; ut non videant ea quae sunt, et videre se putent illa quae non sunt. Hi, ut dico, spiritus contaminati ac perditi per omnem terram vagantur, et solatium perditionis suae perdendis hominibus operantur. Itaque omnia insidiis, fraudibus, dolis, erroribus complent; adhaerent enim singulis hominibus, et omnes ostiatim domos occupant, ad sibi geniorum nomen assumunt: sic enim latino sermone daemonas interpretantur. Hos in suis penetralibus consecrant: his quotidie merum profundunt; et scientes, daemonas venerantur, quasi terrestre deos, et quasi depulsores malorum, quae ipsi faciunt et irrogant. Qui quoniam sunt spiritus tenues, et incomprehensibiles, insinuant se corporibus hominum, et occulte in visceribus operati, valetudinem vitiant, morbos citant, somniis animos terrent, mentes furoribus quatiunt, ut homines his malis cogant ad eorum auxilia decurrere. CAPUT XVI. Daemones nihil posse in eos qui in fide solidati sunt. Quarum omnium fallaciarum ratio expertibus veritatis obscura est. Prodesse enim eos putant, cum nocere desinunt, qui nihil aliud possunt quam nocere. Dicat fortasse aliquis, colendos esse ergo, ne noceant, siquidem possunt nocere. Nocent illi quidem, sed iis, a quibus timentur, quos manus Dei potens et excelsa non protegit, qui profani sunt a sacramento veritatis. Justos autem, id est cultores Dei, metuunt, cujus nomine adjurati de corporibus excedunt: quorum verbis, tanquam flagris verberati, non modo daemonas se esse confitentur, sed etiam nomina sua edunt, illa, quae in templis adorantur, et quod plerumque coram cultoribus suis faciunt; non utique in opprobrium religionis et honoris sui, quia nec Deo per quem adjurantur, nec justis, quorum voce torquentur, mentiri possunt. Itaque maximis, saepe ululatibus editis, verberari se et ardere, et jam jamque exire proclamant: tantum habet Dei cognitio ac justitia potestatis! Cui ergo nocere possunt, nisi iis, quos habent in sua potestate? Denique affirmat eos Hermes, qui cognoverint Deum, non tantum ab incursibus daemonum tutos esse, verum etiam ne fato quidem teneri. Miva inquit, φυλακὴ εὐσέβεια εὐσέβοῦς γὰρ ἀνθρώπον οὐ δαίμων κάκος, οὔτε εἰμαρμένη κρατεῖ. Θεὸς γὰρ ρύεται τὸν εὐσεβῆ ἐκ παντὸς κακοῦ τὸ γὰρ ἐν καὶ μόνον ἐν ἀνθρώποις ἐστὶν ἀγαθὸς εὐσέβεια. Quid sit autem εὐσέβεια, alio loco his verbis testatur, dicens: ἡ γὰρ εὐσέβεια γνῶσίς ἐστι τοῦ Θεοῦ. Asclepius quoque auditor ejus, eamdem sententiam latius explicavit in illo sermone perfecto, quem scripsit ad regem. Uterque vero daemonas esse affirmat inimicos et vexatores hominum; quos ideo Trismegistus ἀγγέλους πονηροὺς appellat: adeo non ignoravit ex coelestibus depravatos, terrenos esse coepisse. |
XIV. Lorsque Dieu vit que la terre était toute couverte de crimes, il se résolut d'exterminer le genre humain par le déluge; et néanmoins, pour le réparer, il choisit un homme qui dans la corruption générale avait conservé son innocence. Il s'appelait Noé. A l'âge de six cents ans il construisit sur le commandement de Dieu une arche où il fut préservé avec sa femme, ses trois fils et ses trois belles-filles de l'eau du déluge qui avait couvert le sommet des plus hautes montagnes. Lorsque cette eau fut dissipée et que la surface de la terre eut commencé à paraître et à se sécher, Dieu, en haine des crimes qui avaient attiré cet épouvantable châtiment, et de peur que la trop longue durée de la vie humaine ne servît qu'à en accroître la corruption, la raccourcit peu à peu, et la borna à l'espace de cent vingt ans. Lorsque Noé fut sorti de l'arche, il cultiva la terre et planta la vigne. Cela fait voir clairement la fausseté de l'opinion de ceux qui attribuent à Bacchus l'invention et la manière de faire le vin; car Noé a précédé de plusieurs siècles non seulement Bacchus, mais Saturne et Uranus. Aux premières vendanges qu'il fit, il but jusqu'à perdre l'usage de la raison, et s'endormit sans se couvrir. Un de ses fils nommé Cham l'ayant vu en cet état, au lieu de couvrir sa nudité, alla en avertir ses frères. Ils prirent un manteau, entrèrent au lieu où leur père dormait, et le couvrirent en tenant toujours le visage et les yeux tournés d'un autre côté. Quand Noé sut ce qui lui était arrivé, il maudit Cham et le chassa. Cham s'enfuit au pays que l'on appelle aujourd'hui Arabie et que l'on appelait autrefois de son nom terre de Canaan, comme on appelait ses descendants Cananéens. Ce furent les premiers peuples qui ne connurent point Dieu, parce que leur chef n'avait pas appris à le connaître et n'avait point été instruit par Noé son père, qui l'avait maudit et chassé. C'est d'eux que les peuples voisins sont descendus. Les descendants de Noé son père furent depuis appelés Hébreux. Ils furent dépositaires de la véritable religion. Lorsqu'ils se furent si fort multipliés que le pays où ils demeuraient ne pouvait plus les contenir, quantité de jeunes gens en allèrent chercher un autre, soit qu'ils eussent été envoyés par leurs parents ou qu'ils y eussent été contraints par la disette, et, s'étant répandus de côté et d'autre, ils peuplèrent les îles. Alors étant comme séparés de la racine d'où ils avaient tiré le sentiment de la véritable piété, ils se firent d'autres mœurs chacun selon son caprice. Les Égyptiens commencèrent les premiers à regarder le ciel et les astres, et à les adorer. Mais parce qu'ils n'avaient point encore de maisons et qu'ils jouissaient d'un air fort pur, et qui n'était couvert d'aucun nuage, ils considérèrent attentivement les astres et en observèrent le cours et les défaillances. Ils furent quelque temps après excités par des prodiges à adorer des animaux d'une figure monstrueuse. Ceux qui se dispersèrent en d'autres pays, admirèrent le ciel, le soleil et les éléments, les adorèrent et leur offrirent des sacrifices, bien qu'ils n'eussent fait encore ni temples ni images et qu'ils ne les aient inventés que dans la suite des temps, en l'honneur des plus puissants princes auxquels ils présentèrent de l'encens et immolèrent des victimes. Voilà comment ils s'éloignèrent de la connaissance du vrai Dieu et tombèrent dans l'aveuglement du paganisme. Ainsi ceux qui croient que l'idolâtrie est aussi ancienne que le monde et que notre religion est nouvelle sont dans une erreur manifeste. XV. Dieu, ne voulant pas permettre que le démon, à qui dès le commencement il avait donné un grand pouvoir sur toute l'étendue de la terre, corrompît ou dissipât les hommes qui commençaient à se multiplier, envoya ses anges pour les garder, et leur recommanda sur toutes choses de ne rien perdre de la pureté de leur nature par le commerce qu'ils entretiendraient ici-bas. Il leur défendit de faire ce qu'il savait bien qu'ils feraient, et il le leur défendit afin que quand ils l'auraient fait, il ne leur restât aucune excuse. Le prince du monde qui a quantité de moyens de tromper, les engagea peu à peu dans le crime et les souilla par l'habitude criminelle qu'il leur fit contracter avec des femmes Ces péchés leur ayant fermé l'entrée du ciel, ils tombèrent sur la terre, et au lieu d'anges et d'envoyés de Dieu qu'ils avaient été, ils devinrent les ministres et les esclaves du démon ; les enfants qui descendirent d'eux ne furent ni de la nature des anges ni de celle des hommes, mais d'une nature qui tient le milieu entre ces deux là. Aussi furent-ils exclus de l'enfer comme leurs pères l'avaient été du ciel. Ainsi il y eut deux espèces de démons : savoir, les démons du ciel et ceux de la terre. Ces derniers sont des esprits impurs qui sont cause de tout le mal qui se commet et qui obéissent au diable comme à leur prince. C'est pour cela que Trismégiste l'appelle Démoniarque c'est-à-dire prince des démons. Les grammairiens enseignent que le nom de démon vient de daïmôn, qui signifie savant, et ils croient que les démons sont des dieux, lis savent quelque chose de l'avenir, mais ils ne savent pas tout, car ils n'entrent pas au conseil de Dieu. C'est pour cela qu'ils ne font que des réponses ambiguës. Les poètes les ont connus et ont parlé d'eux. Voici ce qu'en dit Hésiode : « Les démons ont été créés par la volonté de Jupiter pour être les gardiens des hommes. » Hésiode a parlé de la sorte parce que les démons avaient été chargés de garder les hommes, et parce qu'ils veulent que l'on croie qu'ils les gardent, bien qu'au lieu de les garder ils les corrompent et se fassent adorer par eux. Les philosophes ont parlé d'eux fort au long. Platon a lâché d'expliquer leur nature. Socrate disait que dès sa jeunesse il avait toujours eu auprès de lui un démon par le conseil duquel il s'était conduit dans les actions les plus importantes de sa vie. La puissance et les effets de la magie dépendent d'eux. Quand ils sont évoqués par les cérémonies de cet art, ils enchantent de telle sorte les hommes par leurs illusions, qu'ils ne voient plus ce qui est devant eux et qu'ils s'imaginent voir ce qui n'y est pas. Ces esprits impurs sont errants et vagabonds sur toute la terre, et n'ont rien qui les console de leur chute, que la malheureuse satisfaction de faire tomber les hommes dans le même précipice. C'est pour cela qu'ils usent de tant d'artifices et de tant de ruses ; qu'ils dressent tant de pièges et tant d'embûches. Il n'y a personne à qui ils ne s'attachent pour cet effet, ni de maison dont ils ne s'emparent sous le nom de génie, qui signifie en latin la même chose que démon. On les consacre dans les maisons, on répand chaque jour du vin devant eux, on les révère comme des esprits remplis de science, comme des dieux terrestres, comme des génies qui détournent et éloignent k mal de nous, bien qu'en effet ils l'attirent et le procurent. Comme ce sont des êtres subtils et impalpables, ils s'insinuent dans les entrailles, y altèrent la santé, y excitent des maladies, troublent le repos par des songes affreux, ébranlent l'esprit par de furieux mouvements, et épouvantent si fort les plus hardis qu'ils les contraignent d'implorer leur protection. XVI. Ceux qui ne connaissent point la vérité ont peine à éviter ces tromperies; car ils croient qu'ils servent quand ils cessent de nuire, bien qu'ils n'aient aucun pouvoir, si ce n'est de nuire. Quelqu'un dira peut-être que, puisqu'ils ont le pouvoir de nuire, il faut les révérer de peur qu'ils ne nuisent ; mais ils ne nuisent qu'à ceux qui les craignent, qu'à ceux qui ne sont pas défendus par la main toute-puissante de Dieu, et qui n'ont point de part au secret de la vérité. Mais ils craignent si fort les gens de bien et les serviteurs de Dieu, qu'aussitôt qu'ils entendent prononcer leur nom, ils sortent du corps qu'ils possédaient, étant quelquefois pressés et comme battus, non à coups de bâton, mais par la voix de ces fidèles adorateurs du souverain maître de l'univers. Ils confessent qu'ils sont des démons, et déclarent les noms sous lesquels ils sont adorés dans les temples, et le déclarent à leur honte en présence de leurs adorateurs, parce qu'ils ne peuvent en imposer ni à Dieu, au nom duquel ils sont conjurés, ni aux personnes saintes qui les pressent et qui les tourmentent par la force de leur parole. Ils protestent quelquefois avec d'horribles hurlements qu'ils sentent qu'on les bat et qu'on les brûle, et qu'ils sont prêts à sortir des corps qu'ils possèdent. Voilà le pouvoir que la foi et la sainteté exercent sur ces esprits. A qui peuvent-ils donc nuire, si ce n'est à ceux qu'ils tiennent sous leur puissance? Trismégiste assure que ceux qui connaissent Dieu sont exempts des insultes des démons, et que de plus ils ne dépendent point de la destinée. « Toute la force. dit-il, et toute l'assurance de l'homme consistent dans la piété. Le démon ni la destinée ne peuvent rien sur les hommes pieux. Dieu les délivre de toute sorte de mal, et la piété est l'unique bien. » Expliquant en un autre lieu en quoi consiste la piété, il dit qu'elle consiste en la connaissance de Dieu. Asclépius, son disciple, a enseigné plus au long la même doctrine dans un discours dédié à un roi. Ils conviennent tous deux que les démons sont les ennemis qui tourmentent l'homme, et Trismégiste dit que c'est pour cela qu'ils ont été appelés les mauvais anges. Il paraît par là qu'il n'a pas ignoré qu'ils tiraient du ciel leur origine, et qu'ils ne sont devenus terrestres que par leurs crimes.
|
|
De CAPUT XVII. Astrologiam, aruspicinam et similes artes esse daemonum inventa. Eorum inventa sunt astrologia, et aruspicina, et auguratio, et ipsa quae dicuntur oracula, et necromantia, et ars magica, et quiquid praeterea malorum exercent homines, vel palam, vel occulte. Quae omnia per se falsa sunt, ut Sibylla Erythraea testatur: Επεὶ πλάνα πάντα τάδ' ἐστίν. Ἅπερ ἄφρονες ἀνδρες ἐρευνῶσι κατ' ἧμαρ. Sed iidem ipsi auctores praesentia sua faciunt, ut vera esse credantur. Ita hominum credulitatem mentita divinitate deludunt, quod illis verum aperire non expedit. Hi sunt qui imagines, et simulacra fingere docuerunt; qui, ut hominum mentes a cultu veri Dei averterent, et fictos mortuorum regum vultus, et ornatos exquisita pulchritudine statui consecrarique fecerunt, et illorum sibi nomina, quasi personas aliquas, induerunt. Sed eos magi, et ii quos vere maleficos vulgus appellat, cum artes suas execrabiles exercent, veris suis nominibus cient, illis coelestibus, quae in litteris sanctis leguntur. Hi porro incesti ac vagi spiritus, ut turbent omnia, et errores humanis pectoribus offundant, serunt ac miscent falsa cum veris. Ipsi enim coelestes multos esse finxerunt, unumque omnium regem Jovem; eo quod multi sunt spiritus angelorum in coelo, et unus parens ac dominus omnium Deus: sed veritatem mentitis nominibus involutam ex oculis abstulerunt. Nam Deus, ut principio docui, neque nomine, cum solus sit, eget; neque angeli, cum sint immortales, dici se deos aut patiuntur, aut volunt: quorum unum solumque officium est, servire nutibus Dei, nec omnino quidquam nisi jussu facere. Sic enim mundum regi a Deo dicimus, ut a rectore provinciam: cujus apparitores nemo socios esse in regenda provincia dixerit, quamvis illorum ministerio res geratur. Et hi tamen possunt aliquid praeter jussa rectoris, per ipsius ignorantiam, quae est conditionis humanae. Ille autem praeses mundi, et rector universi, qui scit omnia, cujus divinis oculis nihil septum est, solus habet rerum omnium cum filio potestatem; nec est in angelis quidquam, nisi parendi necessitas. Itaque nullum sibi honorem tribui volunt, quorum omnis honor in Deo est. Illi autem, qui desciverunt a Dei ministerio, quia sunt veritatis inimici, et praevaricatores Dei, nomen sibi et cultum deorum vindicare conantur; non quo ullum honorem desiderent (quis enim perditis honor est?), nec ut Deo noceant, cui noceri non potest: sed ut hominibus, quos nituntur a cultu et notitia verae majestatis avertere, ne immortalitatem adipisci possint, quam ipsi sua nequitia perdiderunt. Offundunt itaque tenebras, et veritatem caligine obducunt, ne dominum, ne patrem suum norint; et ut illiciant facile, in templis se occulunt, et sacrificiis omnibus praesto adsunt, eduntque saepe prodigia, quibus obstupefacti homines, fidem commodent simulacris divinitatis ac numinis. Inde est, quod ab augure lapis novacula incisus est; quod Juno Veiensis migrare se Romam velle respondit; quod Fortuna muliebris periculum denuntiavit; quod Claudiae manum navis secuta est; quod in sacrilegos et Juno nudata, et Locrensis Proserpina, et Ceres Milesia vindicavit; et Hercules de Appio, et Jupiter de Atinio, et Minerva de Caesare. Hinc, quod serpens urbem Romam pestilentia liberavit Epidauro accersitus. Nam illuc δαιμονιάρχης ipse in figura sua sine ulla dissimulatione perlatus est; siquidem legati ad eam rem missi, draconem secum mirae magnitudinis advexerunt. In oraculis autem vel maxime fallunt, quorum praestigias profani a veritate intelligere non possunt: ideoque ab illis attribui putant, et imperia, et victorias, et opes, et eventus prosperos rerum; denique ipsorum nutu saepe rempublicam periculis imminentibus liberatam: quae pericula, et responsis denuntiaverunt, et sacrificiis placati averterunt. Sed omnia ista fallaciae sunt. Nam cum dispositiones Dei praesentiant, quippe qui ministri ejus fuerunt, interponunt se in his rebus, ut quaecumque a Deo vel facta sunt, vel fiunt, ipsi potissimum facere, aut fecisse videantur. Et quoties alicui populo vel urbi, secundum Dei statutum boni quid impendet, illi se id facturos vel prodigiis, vel somniis, vol oraculis pollicentur, si sibi templa, si honores, si sacrificia tribuantur: quibus datis, cum illud acciderit, quod necesse est, summam sibi pariunt venerationem. Hinc templa devoventur, et novae imagines consecrantur, mactantur greges hostiarum. Sed cum haec facta sunt, nihilominus tamen et vita, et salus eorum qui haec fecerint, immolantur. Quoties autem pericula impendent, ob aliquam ineptam et levem causam se profitentur iratos: sicut Juno Varroni, quod formosum puerum intensa Jovis ad excuvias tenendas collocarat; et ob hanc causam Romanum nomen apud Cannas pene deletum est. Quod si Juno alterum Ganymedem verebatur, cur juventus Romana luit poenas? Vel si dii tantummodo duces curant, caeteram multitudinem negligunt, cur Varro solus evasit, qui hoc fecit, et Paulus, qui nihil meruit, occisus est? Videlicet nil tunc Romanis accidit . . . . . Fatis Junonis iniquae, cum Annibal duos exercitus populi Romani, et astu, et virtute confecit. Nam Juno audere non poterat, aut Carthaginem defendere, ubi arma ejus et currus fuit, aut Romanis nocere, quia
. . . . . Progeniem Trojano a sanguine
duci Sed illorum sunt isti lusus, qui sub nominibus mortuorum delitescentes, viventibus plagas tendunt. Itaque sive illud periculum, quod imminet vitari potest, videri volunt id placati avertisse; sive non potest, id agunt, ut propter illorum contemptum accidisse videatur. Ita sibi apud homines, qui eos nesciunt, auctoritatem, ac timorem pariunt. Hac versutia, et his artibus, notitiam veri ac singularis Dei apud omnes gentes inveteraverunt. Suis enim vitiis perditi, saeviunt, et grassantur, ut perdant. Idcirco etiam humanas hostias excogitaverunt ipsi hostes humani generis, ut quam multas devorarent animas. CAPUT XVIII. De Dei patientia et ultione, daemonum cultu, et falsis religionibus. Dicet aliquis: Cur Ergo Deus haec fieri patitur, nec tam malis succurrit erroribus? Ut mala cum bonis pugnent; ut vitia sint adversa virtutibus; ut habeat alios, quos puniat; alios, quos honoret. Ultimis enim temporibus statuit de vivis ac mortuis judicare: de quo judicio mihi erit in ultimo libro disputatio. Differt ergo, donec veniat temporum finis, quo effundat iram suam in potestate ac virtute coelesti, sicut . . . . . . Vatum praedicta piorum Terribili monitu horrificant. Nunc autem patitur homines errare, et adversum se quoque impios esse, ipse justus, et mitis, et patiens. Nec enim fieri potest, ut non is, in quo perfecta sit virtus, sit etiam perfecta patientia. Unde quidam putant, ne irasci quidem Deum omnino, quod affectibus, qui sunt perturbationes animi, subjectus non sit; quia fragile est omne animal quod afficitur et commovetur. Quae persuasio veritatem, atque religionem funditus tollit. Sed seponatur interim locus hic nobis de ira Dei disserendi, quod et uberior est materia, et opere proprio latius exequenda. Illos ergo nequissimos spiritus quisquis veneratus fuerit, et secutus, neque coelo, neque luce potietur, quae sunt Dei: sed in illa decidet, quae in distributione rerum attributa esse ipsi malorum principii disputavimus; in tenebras scilicet, et inferos, et suplicium sempiternum. Docui religiones deorum triplici modo vanas esse: uno, quod simulacra ista, quae coluntur, effigies sint hominum mortuorum; esse autem perversum et incongruens, ut simulacrum hominis a simulacro Dei colatur: colit enim quod est deterius et imbecillius; tum inexpiabile facinus esse, deserere viventem, ut defunctorum monimentis servias, qui nec vitam, nec lucem dare cuiquam possunt, qua ipsi carent; nec esse alium quemquam Deum, praeter unum, cujus judicio ac potestati omnis anima subjecta sit. Altero, quod ipsae imagines sacrae, quibus inanissimi homines serviunt, omni sensu carent, quoniam terra sint. Quis autem non intelligat, nefas esse rectum animal curvari, ut adoret terram? quae idcirco pedibus nostris subjecta est, ut calcanda nobis, non adoranda sit, qui sumus ideo excitati ex ea, statumque sublimem praeter caeteras animantes accepimus, ut non revolvamur deorsum, nec hunc coelestem vultum projiciamus ad terram; sed oculos eo dirigamus, quo illos naturae suae conditio dixerit, nihilque aliud adoremus, nihil colamus, nisi solius artificis parentisque nostri unicum numen: qui propterea hominem rigidum figuravit, ut sciamus, nos ad superna et coelestia provocari. Tertio, quod spiritus, qui praesunt ipsis religionibus, condemnati et abjecti a Deo, per terram volutentur: qui non tantum nihil praestare cultoribus suis possint, quoniam rerum potestas penes unum est, verum etiam mortiferis eos illecebris et erroribus perdant; quoniam hoc illis quotidianum sit opus, tenebras hominibus obducere, ne quaeratur ab illis verus Deus. Non igitur colendi sunt, quia sententiae Dei subjacent. Est enim piaculum maximum, addicere se potestati eorum, quibus, si justitiam sequare, potentior esse possis, et eos adjuratione divini nominis expellere, ac fugare. Quod si apparet, religiones istas tot modis esse vanas, quibus docui, manifestum est eos qui vel mortuis supplicant, vel terram venerantur, vel spiritibus impuris animas suas mancipant, rationem hominum non tenere, eosque impietatis ac sceleris sui supplicia pensuros, qui rebelles adversus parentem generis humani Deum, susceptis inexpiabilibus sacris fas omne violaverint. CAPUT XIX. De simulacrum et terrenarum rerum cultu. Quicumque igitur sacramentum hominis tueri, rationemque naturae suae nititur obtinere, ipse se ab humo suscitet, et erecta mente oculos suos tendat in coelum: non sub pedibus quaerat Deum, nec a vestigiis suis eruat quod adoret (quia quidquid homini subjacet, infra hominem sit necesse est); sed quaerat in sublimi, quaerat in summo; quia nihil potest homine majus esse, nisi quod fuerit supra hominem; Deus autem major est homine; supra ergo, non infra est, nec in ima potius, sed in summa regione quaerendus est. Quare non est dubium quin religio nulla sit, ubicumque simulacrum est. Nam si religio ex divinis rebus est, divini autem nihil est, nisi in coelestibus rebus; carent ergo religione simulacra, quia nihil potest esse coeleste in ea re, quae fit ex terra. Quod quidem de nomine ipso apparere sapienti potest. Quidquid enim simulatur, id falsum sit necesse est; nec potest unquam veri nomen accipere, quod veritatem fuco et imitatione mentitur. Si autem omnis imitatio, non res potissimum seria, sed quasi ludus ac jocus est, non religio in simulacris, sed mimus religionis est. Praeferendum est igitur verum omnibus falsis: calcanda terrena, ut coelestia consequamur. Ita enim res se habet, ut quisquis animam suam, cujus origo de coelo est, ad inferna et ima prostraverit, eo cadat quo se ipse dejecerit. Ideoque oportet rationis, ac status sui memorem, non nisi ad superna niti semper, ac tendere. Quod qui fecerit, hic plane sapiens, hic justus, hic homo, hic denique coelo dignus judicabitur; quem suns parens non humilem, nec ad terram more quadrupedum abjectum, sed stantem potius, ac rectum, sicut eum fecit, agnoverit. CAPUT XX. De philosophis, deque veritate. Peracta est igitur (ni fallor) magna et difficilis suscepti operis portio; et majestate coelesti suggerente nobis dicendi facultatem, inveteratos depulimus errores. Nunc vero major nobis, ac difficilior cum philosophis proposita luctatio est: quorum summa doctrina et eloquentia, quasi moles aliqua mihi opponitur. Nam ut illic (id est, in secundo libro) multitudine, ac prope consensu omnium gentium premebamur; ita hic auctoritate praestantium omni genere laudis virorum. Quis autem nesciat, plus esse momenti in paucioribus doctis, quam in pluribus imperitis? Sed non est desperandum, istos quoque de sententia, Deo ac veritate ducibus, posse depelli: nec tam pertinaces fore arbitror, ut clarissimum solem sanis ac patentibus oculis videre se negent. Modo illud verum sit, quod ipsi solent profiteri, studio investigandae veritatis se teneri, efficiam profecto, ut quaesitam veritatem diu, et aliquando inventam esse credant, et humanis ingeniis inveniri non potuisse fateantur. |
XVII. L'astrologie judiciaire, les auspices, les augures, les oracles, la nécromancie, la magie, et tous les mauvais arts que les hommes exercent, soit en particulier, soit en public, sont des inventions des démons, et ces arts-là sont faux, comme la sibylle Erythrée le témoigne quand elle dit : que tout ce que les hommes dépourvus de sagesse cherchent par l'explication des songes, n'est qu'illusion et tromperie. Mais bien que ces moyens de parvenir à la connaissance de la vérité soient faux, les démons qui les ont inventés abusent tellement de la crédulité des hommes, qu'ils les leur font recevoir comme véritables. Pour les détourner du culte du vrai Dieu, ils leur ont appris à faire des images et des idoles, à embellir les portraits des princes défunts, et à les consacrer dans les temples, et ils ont pris eux-mêmes les noms de ces princes comme des marques pour attirer les adorations des peuples. Mais quand les magiciens font les cérémonies exécrables de leur art, ils appellent les démons par leurs propres noms et non par les noms sous lesquels ils se font rendre un culte de religion. Ces esprits impurs et vagabonds mêlent la vérité avec le mensonge, pour tout confondre et pour répandre des erreurs. C'est dans ce dessein qu'ils ont feint un grand nombre de dieux, dont Jupiter est le roi. Cette fiction obscurcit la vérité : savoir que dans le ciel il y a un grand nombre d'anges et un seul Dieu qui est leur Seigneur, et elle la dérobe à la vue des hommes ! Dieu étant seul n'a pas besoin de nom pour se distinguer, comme je l'ai dit au commencement de cet ouvrage. Les anges, bien qu'ils soient immortels, ne veulent pas pourtant qu'on les appelle dieux. Ils mettent toute leur gloire dans leur devoir, et leur devoir consiste uniquement à obéir au souverain maître de l'univers. Nous disons que Dieu gouverne le monde à peu près comme un gouverneur administre sa province. Bien que le gouverneur fasse beaucoup de choses par le ministère de ses officiers, il n'y a pourtant personne qui dise que ces derniers partagent avec lui l'honneur du gouvernement. Cependant ils agissent très souvent contre ses ordres, sans qu'il le sache, et cette ignorance on il est, est une misérable dépendance de notre condition. Mais le souverain maître de l'univers, qui sait tout et qui voit tout, possède seul avec son Fils la puissance du commandement, et les anges n'ont que l'obéissance en partage. Ils ne s'attribuent aucun honneur, et toute leur grandeur consiste à être soumis à Dieu. Mais ceux qui ont renoncé à son service et déclaré la guerre à la vérité tâchent d'usurper des honneurs divins, non par aucun désir qu'ils en aient, car quel désir en pourraient avoir des esprits qui se sont perdus par leurs crimes ? ni à dessein de nuire à Dieu à qui nul ne peut nuire, mais à dessein de nuire aux hommes, en les détournant du culte de la majesté éternelle, et en les privant de l'immortalité dont il se sont privés eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils mettent des voiles sur la vérité, et qu'ils charment les hommes de peur qu'ils ne reconnaissent leur père et leur Seigneur. Pour tromper plus aisément ils se cachent dans les temples aux heures auxquelles on offre des sacrifices ; ils y font de faux miracles, par lesquels ils épouvantent les simples et leur font prendre des idoles pour des dieux. C'est ce qui a fait croire qu'un augure avait coupé une roche avec un rasoir, que Junon avait déclaré qu'elle voulait être transportée de Véies à Rome, que la Fortune des Femmes a averti du péril dont la ville était menacée, que Claudia a attiré à bord un vaisseau que toute la jeunesse n'avait pu ébranler, que Junon, Proserpine, Cérès, se sont vengées des sacrilèges qui avaient été commis contre elles, qu'Hercule, se vengea aussi d'Appius comme Jupiter d'Attinius, et Minerve de César. C'est aussi ce qui a fait croire que le dragon amené d'Épidaure avait délivré Rome de la maladie contagieuse. On peut dire qu'alors le Démoniarque, c'est-à-dire le prince des démons, fut amené par les ambassadeurs sans aucun déguisement et sous sa propre et naturelle figure de serpent. Mais jamais ces démons ne trompent tant que quand ils rendent des oracles, dont ceux qui sont privés des lumières de notre religion ne découvrent pas les illusions et les impostures. Ils s'imaginent que ces oracles promettent les dignités et les royaumes, la victoire, les richesses, l'heureux succès des entreprises; ils se persuadent que ces oracles ont souvent averti des dangers dont les Etats étaient menacés, et déclaré le moyen de les éviter en apaisant la colère des dieux par des sacrifices ; mais ce n'est que tromperie et illusion. Comme les démons connaissent l’ordre que Dieu, dont ils ont été les ministres, a établi dans le monde, ils se mêlent à ses ouvrages pour lui ravir la gloire qui lui est due et pour se l'attribuer à eux-mêmes. Quand ils savent que, selon la disposition de l'éternelle providence, il doit arriver quelque avantage ou à une ville ou à un peuple, ils promettent ou en songe, ou par des prodiges, ou par des oracles, de le procurer, au cas qu'on leur élève des temples, qu'on leur offre des sacrifices, qu'on leur rende des honneurs. Quand ces honneurs leur ont été rendus, et que l'avantage qu'ils avaient promis est réalisé, le peuple conçoit pour eux une admiration et une révération qu'on ne saurait exprimer. On leur élève ensuite des temples, on consacre leurs images et on égorge en leur honneur une prodigieuse quantité de victimes. Mais ceux qui s'acquittent de ces devoirs sont eux-mêmes des victimes qui sacrifient la vie non de leurs corps, mais de leurs âmes. Quand les démons prévoient un danger extraordinaire qui est proche, ils protestent qu'ils sont en colère, bien qu'ils n'en donnent le plus souvent que de fort légères raisons, comme quand Junon protesta qu'elle était en colère contre Varron parce qu'il avait placé un jeune garçon dans le temple de Jupiter pour y veiller et pour y servir de sentinelle. Ce fut pour cela que les Romains perdirent la bataille de Cannes qui enleva la fleur de leur armée et qui éteignit presque le nom de leur république. Si Junon était jalouse du jeune garçon dont j'ai parlé, fallait-il que la fleur de l'armée romaine en portât la peine? Si les dieux n'ont soin que des chefs, et s'ils négligent les soldats, pourquoi Varron, qui était coupable, échappa-t-il, et pourquoi Paulus, qui était innocent, fut il tué? Lorsque Annibal tailla en pièces deux armées romaines par son habileté et par sa valeur, la haine que Junon avait conçue contre les Romains ne fut point cause de cette défaite ; autrement elle aurait entrepris de défendre Carthage, où elle avait son char et ses armes, et de repousser les Romains, puisqu'elle avait ouï dire qu'il sortirait de Troie une nation qui abattrait un jour les forteresses de Carthage. Ce ne sont que des illusions par lesquelles les démons, cachés sous le nom de quelques personnes qui ne sont plus, tâchent de surprendre ceux qui sont encore. Quand le péril qui est proche peut être détourné, ils font croire qu'ils l'ont détourné après avoir été apaisés par des sacrifices. Quand il ne peut-être détourné, ils disent qu'ils ne l'ont pas voulu, en haine du mépris qu'on a fait de leur puissance. Voilà comment ils se font respecter et craindre par des hommes qui ne les connaissent point. Voilà quels sont les artifices dont ils se sont servis pour ôter à presque tous les peuples la connaissance d'un seul Dieu. Depuis qu'ils se sont perdus par leurs crimes, ils ne travaillent plus qu'à perdre les autres. C'est pour cela qu'ils ont été assez cruels pour vouloir qu'on leur sacrifiât des victimes humaines, et qu'ils se sont repus avec tant de plaisir de leur sang et de leurs âmes. XVIII. Quelqu'un demandera peut-être pourquoi Dieu souffre ces désordres et pourquoi il permet que les hommes tombent en des erreurs si déplorables et si dangereuses ? C'est afin qu'il y ait un combat entre le bien et le mal, entre la vertu et le vice, et qu'il y ait des gens de bien qu'il récompense et des coupables qu'il châtie. Je parlerai dans le dernier livre du jugement qu'il établira à la fin des siècles, et où il jugera les vivants et les morts. Il diffère cependant jusqu'à ce que le temps arrive auquel il répandra sa colère avec une force dont on ne saurait voir l'image dans les livres des prophètes sans être saisi d'horreur et d'effroi. Mais jusque-là il permet aux hommes de s'égarer et de se montrer impies à son égard, et il ne fait rien en cela de contraire à sa justice, à sa douceur, et à sa patience. Car quiconque a une vertu parfaite a aussi une patience parfaite. Quelques-uns croient que Dieu n'entre jamais en colère, parce qu'il est exempt des passions auxquelles l'homme est sujet ; mais ce sentiment est contraire à la vérité et ruine entièrement la religion. Je l'examinerai dans un ouvrage exprès ou je traiterai fort au long de la colère de Dieu. Quiconque aura suivi ces esprits impurs, et les aura révérés, ne jouira jamais du ciel ni de la lumière de Dieu, mais tombera dans les ténèbres et dans les supplices qui sont préparés au prince et à l'auteur du péché. J'ai fait voir, si je ne me trompe, par trois raisons invincibles qu'il n'y a rien que de vain et de ridicule dans le culte qu'on rend aux dieux. La première est que les images que l'on adore représentent des hommes qui ont vécu autrefois sur la terre. Or c'est une chose contraire à la bienséance et à la raison que l'image de Dieu adore l'image d'un homme, puisque celui qui rend l'adoration est plus élevé et plus puissant que celui à qui il la rend. D'ailleurs c'est un crime énorme d'abandonner le culte de Dieu vivant, pour se soumettre à celui d'un cadavre et d'un tombeau qui ne sauraient donner la vie dont ils sont privés. Enfin il ne peut y avoir qu'un seul Dieu, de la souveraine puissance du quel toutes les créatures relèvent. La seconde raison est que les images, que les païens adorent par le dernier et par le plus déplorable de tous les aveuglements, n'ont aucun sentiment puisqu'elles ne sont que de terre. Or il n'y a personne qui ait assez peu de lumière pour ne pas reconnaître que l'homme, à qui Dieu a donné une taille droite et élevée afin qu'il regarde le ciel d'où il est descendu et où il doit retourner, ne doit pas s'abaisser et se courber vers la terre qu'il foule aux pieds. La troisième raison est: que les esprits qui président aux religions païennes, ayant été condamnés par la bouche de Dieu et chassés de sa présence, sont errants et vagabonds sur la terre où, bien loin de procurer aucun avantage à ceux qui les adorent, ce qui n'appartient qu'à Dieu seul, ils les empoisonnent par des erreurs pernicieuses et les détournent de la fin à laquelle ils doivent tendre. Il ne faut donc pas adorer ces esprits qui sont condamnés par la bouche de Dieu, et ce serait un crime de s'abaisser au-dessous d'eux, puisqu'il est aisé de s'élever au-dessus en suivant la justice, et de les chasser par la force du nom de Dieu. Si ces raisons font voir la vanité des religions païennes, il est clair que ceux qui prient les morts, qui se courbent vers la terre, qui adorent des esprits impurs, s'éloignent de la raison, et qu'ils subiront le supplice dû à l'impiété par laquelle ils se sont soulevés contre le père commun du genre humain et se sont souillés par d'exécrables sacrifices. XIX. Quiconque veut tâcher de se rendre digne du nom qu'il porte, et conserver l'excellence de sa nature, doit s'élever au-dessus de la terre, regarder fixement le ciel, et bien loin de chercher sous les pieds un Dieu pour l'adorer, le chercher en haut, tout ce qui est au-dessous de l'homme étant sans doute moindre que l'homme. Or comme Dieu est plus grand que l'homme, il est aussi au-dessus de lui dans la plus haute et non pas dans la plus basse région du monde. C'est pourquoi il est certain qu'il n'y a point de religion là où il y a des images et des idoles. La religion consiste dans les choses de Dieu : les choses de Dieu sont célestes. Les images ni les idoles n'ont rien de céleste, parce qu'elles ne sont que de terre, et par conséquent il n'y a point de religion dans les images. Tout homme qui aura un peu de pénétration reconnaîtra par le nom même d'image la vérité de ce que je dis ; car une image est quelque chose d'opposé à la vérité. Ce qui la représente et ce qui l'imite n'est pas elle. L'imitation et la représentation ne sont pas une chose sérieuse : ce n'est qu'un divertissement et un jeu. Ainsi il n'y a point de religion dans les images, mais seulement une imitation, ou, s'il est permis de parler ainsi, une comédie de religion. Il faut donc préférer la vérité à toutes sortes de faussetés. Il faut fouler la terre aux pieds pour s'élever au ciel, car quiconque abaissera vers la terre son âme, qui est descendue du ciel, tombera lui-même au lieu où il l'aura abaissée. C'est pourquoi il faut toujours se souvenir de sa dignité et toujours tendre vers le lieu de son origine. Quiconque s'acquittera fidèlement de ce devoir aura la justice et la sagesse, et méritera le titre d'homme. Quand Dieu le verra non couché sur la terre comme les animaux, mais droit et élevé vers le ciel, tel qu'il l'a fait, il le reconnaîtra pour son enfant. XX. J'ai achevé, je crois, une grande et difficile partie de l'œuvre que j'ai entreprise; et Dieu ayant daigné me suggérer mes paroles, j'ai réfuté assez fortement les erreurs invétérées. Mais maintenant ce qui me reste à faire sera sans doute encore fort difficile ; car j'ai à combattre la philosophie dont on m'oppose la doctrine et l'éloquence. Au lieu que l'on n'avait employé jusqu'ici que le suffrage de la multitude et le consentement des nations pour opprimer la vérité, on emploie maintenant l'autorité des plus excellents hommes en toute sorte de sciences. Or il est certain que le jugement d'un petit nombre de savants doit être préféré à celui d'un grand nombre de personnes qui n'ont que l'ignorance en partage. Je ne désespère pas pourtant de convaincre, avec l'aide de Dieu, les philosophes, et je ne puis m'imaginer qu'ils aient une opiniâtreté assez déraisonnable pour nier qu'ils voient la lumière lorsque je la leur aurai mise devant les yeux. S'ils cherchent sincèrement la vérité, comme ils en font profession, je leur ferai voir clairement qu'elle est trouvée et qu'elle ne pourrait l'être par la seule pénétration de leur esprit, ni par la seule force de la nature.
|
|
[1] Ovide, Métamorphoses, livre I. [2] Lucrèce, De la nature des choses, livre VI, v. 51. [3] Lucrèce, De la nature des choses, livre V, v. 1197. [4] Cicéron, De la nature des Dieux, livre I. |
|