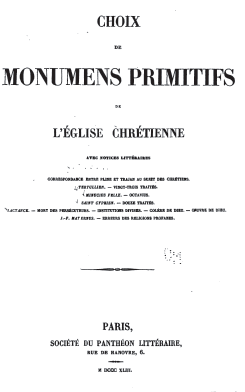
LACTANCE - LUCIUS CAECILIUS FIRMIANUS LACTANTIUS
INSTITUTIONS DIVINES - DIVINAE INSTITUTIONES
LIVRE I
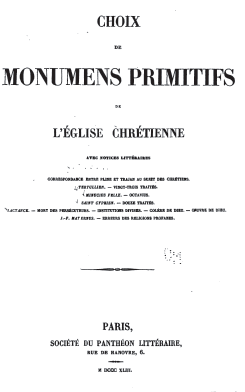
LIVRE I
LUCIUS CAECILIUS FIRMIANUS LACTANTIUS
DIVINAE INSTITUTIONES
|
PRAEFATIO. QUANTI SIT ET FUERIT SEMPER COGNITIO VERITATIS. Magno et excellenti ingenio viri, cum se doctrinae penitus dedissent, quidquid laboris poterat impendi, contemptis omnibus et privatis et publicis actionibus, ad inquirendae veritatis studium contulerunt; existimantes multo esse praeclarius humanarum divinarumque rerum investigare ac scire rationem, quam aut struendis opibus, aut cumulandis honoribus inhaerere. Quibus rebus, quoniam fragiles terrenaeque sunt et ad solius corporis pertinent cultum, nemo melior, nemo justior effici potest. Erant illi quidem veritatis cognitione dignissimi, quam scire tantopere cupiverunt; atque ita, ut eam rebus omnibus arteponerent. Nam et abjecisse quosdam res familiares suas, et renuntiasse universis voluptatibus constat, ut solam nudamque veritatem nudi expeditique sequerentur: tantumque apud eos veritatis nomen et auctoritas valuit, ut in ipsa esse summi boni praemium praedicarent. Sed neque adepti sunt id quod volebant: et operam simul atque industriam perdiderunt; quia veritas, id est arcanum summi Dei, qui fecit omnia, ingenio ac propriis non potest sensibus comprehendi: alioqui nihil inter Deum hominemque distaret, si consilia et dispositiones illius majestatis aeternae cogitatio assequeretur humana. Quod quia fieri non potuit, ut homini per seipsum ratio divina innotesceret, non est passus hominem Deus lumen sapientiae requirentem diutius errare, ac sine ullo laboris effectu vagari per tenebras inextricabiles; aperuit oculos ejus aliquando, et notionem veritatis munus suum fecit: ut et humanam sapientiam nullam esse monstraret, et erranti ac vago viam consequendae immortalitatis ostenderet. Verum quoniam pauci utuntur hoc coelesti beneficio ac munere; quod obvoluta in obscuro veritas latet; eaque vel contemptui doctis est, quia idoneis assertoribus eget, vel odio indoctis, ob insitam sibi austeritatem, quam natura hominum proclivis in vitia pati non potest (nam quia virtutibus amaritudo permixta est, vitia vero voluptate condita sunt; illa offensi, hac deliniti feruntur in praeceps, et bonorum specie falsi, mala pro bonis amplectuntur) succurrendum esse his erroribus credidi: ut et docti ad veram sapientiam dirigantur et indocti ad veram religionem. Quae professio multo melior, utilior, gloriosior putanda est, quam illa oratoria, in qua diu versati, non ad virtutem, sed plane ad argutam malitiam juvenes erudiebamus. Multo quippe nunc rectius de praeceptis coelestibus disseremus, quibus ad cultum verae majestatis mentes hominum instruere possimus: nec tam de rebus humanis bene meretur, qui scientiam bene dicendi affert, quam qui pie atque innocenter docet vivere: idcirco apud Graecos majore in gloria philosophi, quam oratores fuerunt. Illi enim recte vivendi doctores sunt existimati: quod est longe praestabilius: quoniam bene dicere, ad paucos pertinet, bene autem vivere ad omnes. Multum tamen nobis exercitatio illa fictarum litium contulit, ut nunc majore copia et facultate dicendi causam veritatis peroremus: quae licet possit sine eloquentia defendi, ut est a multis saepe defensa; tamen claritate ac nitore sermonis illustranda, et quodammodo disserenda est, ut potentius in animos influat et vi sua instructa, et luce orationis ornata.
|
PRÉFACE.Il y a eu dans tous les siècles des hommes d'un génie supérieur qui, s'étant donnés tout entiers à l'étude de la sagesse, et ayant pour cela renoncé à tous les engagements de la vie civile, ont employé tout ce qu'ils avaient de lumières et de forces pour parvenir à la connaissance de la vérité. Ils estimaient qu'il leur était plus utile, et tout ensemble plus glorieux, de s'appliquer à connaître les causes des événements, et à considérer la conduite admirable de Dieu dans la nature, que de s'occuper à amasser des richesses, et à acquérir de vains honneurs, qui, n'étant que des biens terrestres et fragiles, ne peuvent rendre l'homme ni meilleur ni plus heureux. Certes, ces grands hommes méritaient de rencontrer ce qu'ils cherchaient avec tant d'ardeur et si peu de succès, puisqu'ils en préféraient l'acquisition à tout ce que le monde a de plus engageant ; car on sait qu'il y en a eu parmi eux qui ont tout abandonné, et se sont privés volontairement des plaisirs les plus innocents, pour suivre, sans embarras et sans aucun autre attachement, la vertu toute nue. Ils étaient touchés pour elle d'un respect si religieux, qu'ils révéraient jusqu'à son nom d'un culte particulier, et qu'ils ne reconnaissaient sur la terre d'autre puissance légitime que la sienne. Mais comme la suprême vérité, qui n'est autre chose que Dieu, ne peut être l'objet des sens, ni être comprise par l'esprit humain éclairé des seules lumières de la raison, une recherche si assidue et si laborieuse leur a été inutile. Il y a une trop grande distance entre Dieu et l'homme, pour que l'homme puisse atteindre par ses propres forces à la connaissance de la vérité. Aussi cet être souverainement bon, ne pouvant souffrir que l'homme demeurât plus longtemps dans l'aveuglement, et que cette recherche sincère de la sagesse ne le conduisit que par des routes couvertes de ténèbres et environnées de précipices, lui a ouvert enfin les yeux ; la vérité a été un présent de sa main libérale. En faisant connaître à l'homme que toute la sagesse humaine n'est que vanité, il lui a montré en même temps le chemin qui le pouvait conduire à une immortalité bienheureuse. Mais ce bienfait du ciel devint inutile à plusieurs, et la vérité demeure toujours inconnue. Les savants la méprisent, ne la trouvant pas soutenue par des preuves aussi évidentes qu'ils le souhaiteraient. Le peuple la fuit à cause de son air trop austère, car la vertu a toujours quelque amertume qui rebute; au lieu que le vice, accompagné des douceurs de la volupté, attire, plaît, engage. Ainsi les hommes trompés par l'apparence courent après un faux bien, et ne trouvent en effet qu'un mal véritable. Nous avons cru devoir travailler à bannir du monde cette double erreur, en faisant connaître aux savants la sagesse qu'ils doivent suivre, et en montrant au peuple la religion qu'il doit embrasser. Au reste, ce travail nous paraît plus honorable et plus utile que celui qui a occupé toute notre jeunesse, que ces exercices de déclamateur et de sophiste qui contribuent bien moins à former l'esprit à la vertu qu'à le subtiliser et à le rendre capable d'exercer une malice plus fine et moins grossière. Nous ne laisserons pas toutefois de tirer cet avantage de ces connaissances profanes, qu'elles nous donneront plus de facilité à discourir des choses divines, et à disposer les esprits à recevoir les instructions que nous avons résolu de leur donner touchant le culte qui est dû à sa souveraine majesté. Sans doute celui-là mérite beaucoup plus de louanges qui apprend aux hommes à bien vivre, que n'en mérite celui qui leur apprend à bien parler. Et c'est ce qui a, parmi les Grecs, acquis tant de gloire aux philosophes, et leur a donné un si grand avantage sur les orateurs; l'art de la parole n'étant que pour un petit nombre de personnes, mais la science des mœurs étant propre à tous. Nous emploierons donc pour défendre la vérité ce que nous avons autrefois mis en usage pour soutenir le mensonge ; et quoi qu'elle n'ait pas besoin pour vaincre du secours de l'éloquence, et que plusieurs l'aient souvent défendue sans en avoir la moindre teinture ; cependant, lorsqu'elle est ornée de la beauté majestueuse des pensées solides, et qu'elle brille des couleurs vives d'une élocution fleurie, il faut avouer qu'elle en est reçue bien plus agréablement dans les esprits, qu'elle y fait de plus profondes impressions, et que, se rendant d'ailleurs vénérable par la sainteté de la religion qu'elle annonce, elle est conservée dans les cœurs sans que rien l'en puisse effacer.
|
|
LIBER PRIMUS. DE FALSA RELIGIONE DEORUM. CAPUT PRIMUM. De religione et sapientia.
De religione itaque nobis rebusque
divinis instituitur disputatio. Nam si quidam maximi oratores
professionis suae quasi veterani, decursis operibus actionum suarum,
postremo se philosophiae tradiderunt, eamque sibi requiem laborum
justissimam putaverunt; si animos suos in earum rerum, quae inveniri
non poterant, inquisitione torquerent, ut non tam otium sibi, quam
negotium quaesisse videantur, et quidem multo molestius, quam in quo
fuerant ante versati: quanto justius ego me ad illam piam, veram,
divinamque sapientiam, quasi ad portum aliquem tutissimum conferam,
in qua omnia dictu prona sunt, auditu suavia, facilia intellectu,
honesta susceptu? Et si quidam prudentes, et arbitri aequitatis,
Institutiones civilis juris compositas ediderunt, quibus civium
dissidentium lites contentionesque sopirent: quanto melius nos et
rectius divinas Institutiones litteris persequemur; in quibus non de
stillicidiis, aut aquis arcendis, aut de manu conserenda, sed de
spe, de vita, de salute, de immortalitate, de Deo loquemur, ut
superstitiones mortiferas, erroresque turpissimos sopiamus? Quod opus nunc nominis tui auspicio inchoamus, Constantine, Imperator Maxime, qui primus Romanorum principum, repudiatis erroribus, majestatem Dei singularis ac veri et cognovisti et honorasti. Nam cum ille dies felicissimus orbi terrarum illuxisset, quo te Deus summus ad beatum imperii culmen evexit, salutarem universis et optabilem principatum praeclaro initio auspicatus es, cum eversam sublatamque justitiam reducens, teterrimum aliorum facinus expiasti: pro quo facto dabit tibi Deus felicitatem, virtutem, diuturnitatem: ut eadem justitia, qua juvenis exorsus es, gubernaculum reipublicae etiam senex teneas, tuisque liberis, ut ipse a patre accepisti, tutelam Romani nominis tradas. Nam malis, qui adhuc adversus justos in aliis terrarum partibus saeviunt, quanto serius, tanto vehementius idem omnipotens mercedem sceleris exsolvet: quia ut est erga pios indulgentissimus pater, sic adversus impios rectissimus judex. Cujus religionem cultumque divinum cupiens defendere, quem potius appellem, quem alloquar, nisi eum per quem rebus humanis justitia et sapientia restituta est? Omissis ergo hujusce terrenae philosophiae auctoribus nihil certi afferentibus, aggrediamur viam rectam: quos equidem, si putarem satis idoneos ad bene vivendum duces esse, et ipse sequerer, et alios, ut sequerentur, hortarer. Sed cum inter se magna concertatione dissideant, secumque ipsi plerumque discordent, apparet eorum iter nequaquam esse directum: siquidem sibi quique, ut est libitum, proprias vias impresserunt, confusionemque magnam inquirentibus veritatem reliquerunt. Nobis autem, qui sacramentum verae religionis accepimus, cum sit veritas revelata divinitus, cum doctorem sapientiae ducemque veritatis Deum sequamur, universos sine ullo discrimine vel sexus vel aetatis ad coeleste pabulum convocamus. Nullus enim suavior animo cibus est, quam cognitio veritatis, cui asserendae atque illustrandae septem volumina destinavimus, quamvis ea res infiniti pene sit operis et immensi: ut si quis haec dilatare atque exequi plenissime velit, tanta illi rerum copia exuberet, ut nec libri modum nec finem reperiat oratio. Sed nos idcirco breviter omnia colligemus; quod ea quae allaturi sumus, tam clara sunt et lucida, ut magis mirum esse videatur tam obscuram videri hominibus veritatem, et iis praecipue, qui sapientes vulgo putantur, vel quod tantummodo instituendi nobis homines erunt, hoc est, ab errore quo sunt implicati, ad rectiorem viam revocandi. Quod si fuerimus, ut spero, assecuti, mittemus eos ad ipsum doctrinae uberrimum ac plenissimum fontem, cujus haustu atque potu conceptam visceribus sitim sedent, ardoremque restinguant. Eruntque illis omnia facilia, prona, manifesta: modo ne pigeat ad percipiendam sapientiae disciplinam, legendi, vel audiendi patientiam commodare. Multi enim superstitionibus vanis pertinaciter inhaerentes, obdurant se contra manifestam veritatem, non tam de suis religionibus, quas prave asserunt, bene meriti, quam de se male: qui cum habeant iter rectum, devios sequuntur anfractus; planum deserunt, ut per praecipitium labantur; lucem relinquunt, ut in tenebris caeci ac debiles jaceant. His consulendum est ne contra se pugnent, velintque se tandem ab inveteratis erroribus liberari: quod utique facient, si, quare sint nati, aliquando perviderint. Haec enim pravitatis est causa, ignoratio sui; quam si quis, cognita veritate, discusserit, sciet quo referenda, et quemadmodum sibi vita degenda sit. Cujus scientiae summam breviter circumscribo: ut neque religio ulla sine sapientia suscipienda sit, nec ulla sine religione probanda sapientia. CAPUT II. Quod providentia sit in rebus humanis. Suscepto igitur illustrandae veritatis officio, non putavi adeo necessarium ab illa quaestione principium sumere, quae videtur prima esse natura: sitne providentia, quae rebus omnibus consulat; an fortuitu vel facta sint omnia vel regantur. Cujus sententiae auctor est Democritus, confirmator Epicurus. Sed et antea Protagoras, qui deos in dubium vocavit; et postea Diagoras, qui exclusit; et alii nonnulli qui non putaverunt deos esse; quid aliud effecerunt, nisi ut nulla esse providentia putaretur? quos tamen et caeteri philosophi, ac maxime Stoici acerrime retuderunt, docentes, nec fieri mundum sine divina ratione potuisse, nec constare, nisi summa ratione regeretur. Sed et M. Tullius, quamvis Academicae disciplinae defensor esset, de providentia gubernatrice rerum et multa et saepe disseruit, Stoicorum argumenta confirmans, et nova ipse afferens plurima: quod facit tum in omnibus philosophiae suae libris, tum maxime in iis qui sunt de Natura deorum. Nec difficile sane fuit paucorum hominum prave sentientium redarguere mendacia testimonio populorum atque gentium in hac una re non dissidentium. Nemo est enim tam rudis, tam feris moribus, qui oculos suos in coelum tollens, tametsi nesciat cujus Dei providentia regatur hoc omne quod cernitur, non aliquam tamen esse intelligat ex ipsa rerum magnitudine, motu, dispositione, constantia, utilitate, pulchritudine, temperatione: nec posse fieri quin id, quod mirabili ratione constat, consilio majori aliquo sit instructum. Et nobis utique facillimum est exequi hanc partem quamlibet copiose. Sed quia multum inter philosophos agitata res est, et providentiam tollentibus satis responsum videtur ab hominibus argutis et eloquentibus, et de solertia divinae providentiae per totum hoc opus, quod suscepimus, sparsim dicere necesse est; omittamus in praesenti hanc quaestionem, quae cum caeteris sic cohaeret, ut nihil a nobis disseri posse videatur, ut non simul de providentia disseratur. CAPUT III. Uniusne potestate Dei mundus regatur, an multorum? Sit ergo nostri operis exordium quaestio illa consequens ac secunda: utrum potestate unius Dei mundus regatur, anne multorum? Nemo est qui quidem sapiat, rationemque secum putet, non unum esse intelligat, qui et condiderit omnia, et eadem, qua condidit, virtute moderetur. Quid enim multis opus est ad mundi regimen sustinendum? nisi forte arbitremur, si plures sint, minus habere singulos nervorum atque virium. Quod quidem faciunt ii, qui multos esse volunt; quia necesse est imbecilles esse: siquidem singuli, sine auxilio reliquorum, tantae molis gubernaculum sustinere non possent. Deus autem, qui est aeterna mens, ex omni utique parte perfectae consummataeque virtutis est. Quod si verum est, unus sit necesse est. Potestas enim, vel virtus absoluta, relinet suam propriam firmitatem. Id autem solidum existimandum est, cui nihil decedere; id perfectum, cui nihil possit accedere. Quis dubitet potentissimum esse regem, qui totius orbis habeat imperium? neque immerito: cum illius sint, quae ubique sunt omnia; cum ad eum solum omnes undique copiae congerantur. At si plures partiantur orbem, minus certe opum, minus virium singuli habebunt, cum intra praescriptam portionem se quisque contineat. Eodem etiam modo dii, si plures sint, minus valebunt, aliis tantumdem in se habentibus. Virtutis autem perfectior natura potest esse in eo, in quo totum est, quam in eo, in quo pars exigua de toto est. Deus vero, si perfectus est (quia perfectus est) ut esse debet, non potest esse nisi unus, ut in eo sint omnia. Deorum igitur virtutes ac potestates infirmiores sint necesse est: quia tantum singulis deerit quantum in caeteris fuerit; ita quanto plures, tanto minores erunt. Quid, quod summa illa rerum potestas ac divina vis ne semel quidem dividi potest? Quidquid enim capit divisionem, et interitum capiat necesse est. Si autem interitus procul est a Deo, quia incorruptibilis est et aeternus, consequens est ut dividi potestas divina non possit. Deus ergo unus est, si nihil esse aliud potest, quod tantumdem capiat potestatis; et ii tamen, qui multos esse arbitrantur, officia inter se dicunt esse partitos: de quibus omnibus suo loco disputabimus. Illud interim, quod ad praesentem locum pertinet, teneo. Si partiti sunt inter se officia, eodem revolvitur res, ut ex iis quilibet sufficere, omnibus nequeat. Perfectus igitur jam non erit, qui, cessantibus caeteris, non potest omnia gubernare. Ita fit ut ad regendum mundum unius perfecta virtute magis opus sit, quam imbecillitate multorum. Qui autem putat hanc tantam magnitudinem non posse ab uno regi, fallitur. Nec enim quanta sit vis potestasque divinae majestatis intelligit, si existimat singularem Deum, qui facere mundum potuit, eumdem regere non posse quem fecit. At si concipiat animo, quanta sit divini hujus operis immensitas cum antea nihil esset, tamen virtute atque consilio Dei ex nihilo esse conflatam; quod opus nisi ab uno inchoari perficique non potuit: jam intelliget, multo facilius esse ab uno regi, quod est ab uno constitutum.
Dicat fortasse aliquis, ne fabricari
quidem tam immensum opus mundi, nisi a pluribus potuisse: quamlibet
multos, quamlibet magnos faciat, quidquid in multis magnitudinis,
potestatis, virtutis, majestatisque posuerit, id totum in unum
confero, et in uno esse dico; ut tantum in eo sit istarum rerum,
quantum nec cogitari nec dici potest. Qua in re quoniam et sensu
deficimus et verbis; quia neque tantae intelligentiae lucem pectus
humanum, neque explanationem tantarum rerum capit lingua mortalis:
idipsum intelligere nos oportet ac dicere. Video rursus quid e
contrario dici possit: tales esse illos plures, qualem nos volumus
unum. At hoc fieri nullo pacto potest, quod singulorum potestas
progredi longius non valebit, occurrentibus sibi postestatibus
caeterorum. Necesse est enim ut suos quisque limites aut transgredi
nequeat, aut si transgressus fuerit, suis alterum finibus pellat.
Non vident, qui deos multos esse credunt, fieri posse ut aliqui
diversum velint; ex qua re disceptatio inter eos et certamen
oriatur: sicut Homerus bellantes inter se deos finxit; cum alii
Trojam capi vellent, alii repugnarent. Unius igitur arbitrio mundum
regi necesse est. Nisi enim singularum partium potestas ad unam
providentiam referatur, non poterit summa ipsa constare; unoquoque
nihil curante amplius, quam quod ad eum proprie pertinet: sicut ne
res quidem militaris, nisi unum habeat ducem atque rectorem. Quod si
in uno exercitu tot fuerint imperatores, quot legiones, quot
cohortes, quot cunei, quot alae, primum nec instrui poterit acies,
unoquoque periculum recusante; nec regi facile, aut temperari, quod
suis propriis consiliis utantur omnes, quorum diversitate plus
noceant, quam prosint: sic in hoc rerum naturae imperio, nisi unus
fuerit, ad quem totius summae cura referatur, universa solventur et
corruent. CAPUT IV. Quod unus vere sit Deus a prophetis etiam praenuntiatus.
Prophetae, qui fuerunt admodum multi,
unum Deum praedicant, unum loquuntur: quippe qui unius Dei spiritu
pleni, quae futura essent, pari et consona voce praedixerunt. At
enim veritatis expertes non putant his esse credendum. Illas enim
non divinas, sed humanas voces fuisse aiunt. Videlicet quia de uno
Deo praeconium faciunt, aut insani, aut fallaces fuerunt. At quin
impleta esse implerique quotidie illorum vaticinia videmus; et in
unam sententiam congruens divinatio docet non fuisse furiosos. Quis
enim mentis emotae, non modo futura praecinere, sed etiam
cohaerentia loqui possit? Num ergo fallaces erant, qui talia
loquebantur? quid ab his tam longe alienum quam ratio fallendi, cum
caeteros ab omni fraude cohiberent? Idcirco enim a Deo mittebantur,
ut et praecones essent majestatis ejus, et correctores pravitatis
humanae. CAPUT V. De testimoniis poetarum et philosophorum. Sed omittamus sane testimonia prophetarum, ne minus idonea probatio videatur esse de his, quibus omnino non creditur. Veniamus ad auctores; et eos ipsos ad veri probationem testes citemus, quibus contra nos uti solent, poetas dico ac philosophus. Ex his unum Deum probemus necesse est: non quod illi habuerint cognitam veritatem; sed quod veritatis ipsius tanta vis est, ut nemo possit esse tam caecus, qui non videat ingerentem se oculis divinam claritatem. Poetae igitur, quamvis deos carminibus ornaverint, et eorum res gestas amplificaverint summis laudibus, saepissime tamen confitentur spiritu vel mente una contineri regique omnia. Orpheus, qui est vetustissimus poetarum, et aequalis ipsorum deorum (siquidem traditur inter Argonautas cum Tyndaridis et Hercule navigasse), Deum verum et magnum, πρωτόγονον, id est primogenitum, appellat; quod ante ipsum nihil sit genitum, sed ab ipso sint cuncta generata: eumdem etiam φάνητα nominat; quod cum adhuc nihil esset, primus ex infinito apparuerit et extiterit. Cujus originem atque naturam quia concipere animo non poterat, ex aere immenso natum esse dixit: Πρωτόγονος φαέθων περὶ μήκεος ἠέρος υἱός. Aliud enim amplius quod diceret non habebat. Hunc ait esse omnium deorum parentem, quorum causa coelum condiderit, liberisque prospexerit ut haberent habitaculum, sedemque communem: ἔκτισεν ἀθανάτοις δόμον ἄφθιτον. Natura igitur et ratione ducente, intellexit esse praestantissimam potestatem coeli ac terrae conditricem. Non poterat enim dicere Jovem esse principem rerum, qui erat Saturno genitus; neque Saturnum ipsum, qui coelo natus ferebatur: coelum autem tamquam Deum primum constituere non audebat, quod videbat elementum esse mundi, quod ipsum eguerit auctore. Haec eum ratio perduxit ad illum Deum primogenitum, cui assignat et tribuit principatum. Homerus nihil nobis dare potuit, quod pertineat ad veritatem, qui humana potius quam divina conscripsit. Potuit Hesiodus, qui deorum generationem unius libri opere complexus est. Sed tamen nihil dedit, non a Deo conditore sumens exordium, sed a chao, quod est rudis inordinataeque materiae confusa congeries: cum explanare ante debuerit, chaos ipsum unde, quando, quomodo esse, aut constare coepisset. Nimirum sicut ab aliquo artifice disposita, ordinata, effecta sunt omnia: sic ipsam materiam fictam esse ab aliquo necesse est. Quis igitur hanc, nisi Deus, fecit, cujus potestati subjacent omnia? sed refugit hoc ille dum horret incognitam, veritatem. Non enim Musarum instinctu, sicut videri volebat, in Helicone carmen illud effudit; sed meditatus venerat et paratus. Nostrorum primus Maro non longe fuit a veritate; cujus de summo Deo, quem mentem ac spiritum nominavit, haec verba sunt:
Principio coelum, ac terras, camposque
liquentes, Ac ne quis forte ignoret quisnam esset ille spiritus, qui tantum haberet potestatis, declaravit alio loco, dicens:
Deum namque ire per omnes Ovidius quoque in principio praeclari operis, sine ulla nominis dissimulatione, a Deo, quem fabricatorem mundi, quem rerum opificem vocat, mundum fatetur instructum. Quod si vel Orpheus, vel hi nostri, quae natura ducente senserunt, in perpetuum defendissent, eamdem quam nos sequimur, doctrinam comprehensa veritate tenuissent. Sed hactenus de poetis. Ad philosophos veniamus, quorum gravior est auctoritas, certiusque judicium; quia non rebus commentitiis, sed investigandae veritati studuisse creduntur. Thales Milesius, qui unus e septem sapientium numero fuit, quique primus omnium quaesisse de causis naturalibus traditur, aquam esse dixit, ex qua nata sint omnia; Deum autem esse mentem, quae ex aqua cuncta formaverit. Ita materiam rerum posuit in humore; principium causamque nascendi constituit in Deo. Pythagoras ita definivit quid esset Deus: « Animus, qui per universas mundi partes, omnemque naturam commeans atque diffusus; ex quo omnia, quae nascuntur animalia, vitam capiunt. » Anaxagoras Deum esse dixit infinitam mentem, quae per seipsam moveatur, Antisthenes multos quidem esse populares deos, unum tamen naturalem, summae totius artificem. Cleanthes et Anaximenes aethera dicunt esse summum Deum; cui opinioni poeta noster assensit:
Tum pater omnipotens foecundis
imbribus aether Chrysippus naturalem vim divina ratione praeditam, interdum divinam necessitatem Deum nuncupat. Item Zeno divinam naturalemque legem. Horum omnium sententia, quamvis sit incerta, eodem tamen spectat, ut providentiam unam esse consentiant. Sive enim natura, sive aether, sive ratio, sive mens, sive fatalis necessitas, sive divina lex, sive quid aliud dixeris; idem est, quod a nobis dicitur Deus. Nec obstat appellationum diversitas, cum ipsa significatione ad unum omnia revolvantur. Aristoteles, quamvis secum ipse dissideat, ac repugnantia sibi et dicat et sentiat, in summum tamen unam mentem mundo praeesse testatur. Plato, qui omnium sapientissimus judicatur, monarchiam plane aperteque defendit; nec aethera, aut rationem, aut naturam, sed, ut est, Deum nominat; ab eo mundum hunc perfectum atque mirabilem esse fabricatum. Quem Cicero secutus atque imitatus in plurimis, Deum frequenter confitetur, ac supremum vocat in iis libris, quos de Legibus scripsit; ab eoque regi mundum argumentatur, cum disputat de Natura deorum, hoc modo: « Nihil est praestantius Deo; ab eo igitur mundum regi necesse est. Nulli igitur est naturae obediens aut subjectus Deus; omnem ergo regit ipse naturam. » Quid autem sit Deus, in Consolatione definit: « Nec vero Deus ipse, qui intelligitur a nobis, alio modo intelligi potest, nisi mens soluta quaedam et libera, segregata ab omni concretione mortali, omnia sentiens ac movens. » Annaeus quoque Seneca, qui ex Romanis vel acerrimus Stoicus fuit, quam saepe summum Deum merita laude prosequitur! Nam cum de immatura morte dissereret: « Non intelligis, inquit, auctoritatem ac majestatem judicis tui, rectorem orbis terrarum, coelique et deorum omnium Deum, a quo ista numina, quae singula adoramus, et colimus, suspensa sunt. » Item in Exhortationibus: « Hic, cum prima fundamenta molis pulcherrimae jaceret, et hoc ordiretur, quo neque majus quidquam novit natura, nec melius; ut omnia sub ducibus suis irent, quamvis ipse per totum se corpus intenderat, tamen ministros regni sui deos genuit. » Et quam multa alia de Deo nostris similia locutus est: quae nunc differo, quod aliis locis opportuniora sunt. Nunc satis est demonstrare, summo ingenio viros attigisse veritatem, ac pene tenuisse; nisi eos retrorsum infatuata pravis opinionibus consuetudo rapuisset, qua et deos alios esse opinabantur, et ea, quae in usum hominis Deus fecit, tamquam sensu praedita essent, pro diis habenda, et colenda credebant.
|
LIVRE PREMIER.DE LA FAUSSE RELIGION.I. Nous avons donc entrepris de traiter dans cet ouvrage de la religion et de toutes les choses qui concernent le culte divin; car si nous voyons tous les jours de fameux orateurs, les lumières du barreau, s'éclipser, pour ainsi dire, à la fin de leurs cours, et se soustraire aux affaires publiques, pour s'appliquer uniquement à l'élude de la philosophie, et y chercher le repos que leurs glorieux travaux leur ont si justement mérité : si ces grands personnages, bien loin d'y goûter la douceur de ce repos si longtemps désiré, et acheté par tant de sueurs et de fatigues, n'y trouvent au contraire que de nouvelles tortures pour leur esprit, parce qu'ils cherchent ce qu'ils ne sauraient rencontrer : avec combien plus de raison et de confiance devons-nous nous jeter entre les bras de la divine sagesse comme dans un port assuré, puisque tout ce qu'elle enseigne est naturel à penser, agréable à écouter, facile à dire et honorable à entreprendre. Si enfin des hommes nés pour être les arbitres des peuples et les interprètes de la justice, ont cru bien mériter du public en lui donnant les Institutions du Droit Civil, pour tâcher par là d'assoupir les différends qui naissent à tous moments parmi leurs citoyens : que ne devons-nous point espérer de la grandeur et de la sainteté de notre sujet, puisqu'il ne s'agit pas ici de quelques lois locales, ou de quelques coutumes établies, mais de la vie éternelle, de l'immortalité, de Dieu même ! J'entreprends cet ouvrage sous vos auspices, ô invincible empereur, et j'ose mettre à la tête de ces Institutions le nom sacré du grand Constantin, de ce prince religieux qui, renonçant à l'erreur a, le premier de tous ceux qui ont régné avant lui, reconnu le véritable Dieu, et lui a rendu le culte qui n'est dû qu'à lui seul. Car cet heureux jour que la Providence avait choisi pour vous donner l'empire du monde, ayant enfin paru, vous commençâtes un règne qui devait faire tout le bonheur des peuples, comme il en faisait déjà tous les souhaits; vous commençâtes, dis-je, ce beau règne par rappeler la justice du triste exil où vos prédécesseurs l'avaient toujours reléguée. Un commencement si digne d'un empereur chrétien, n'en doutez point, attirera sur vous toutes les bénédictions de Dieu. Ce Dieu reconnaissant vous comblera d'une félicité durable ; il vous donnera les grandes et solides vertus; il prolongera vos jours jusqu'à une heureuse vieillesse, afin que les hommes aient le plaisir de voir la justice et la voir régner longtemps sur eux, et qu'après une longue suite d'années et d'heureux succès, vous puissiez mettre entre les mains des Césars vos fils[1] le pouvoir souverain que vous avez reçu de celles de votre auguste père.[2] Mais si Dieu a couronné la piété en votre personne sacrée, il saura bien punir l'impiété de ceux[3] qui persécutent encore les adorateurs de son nom et les disciples de son fils ; et plus il semble différer leur châtiment, plus ils en doivent craindre la rigueur. Car si la vertu trouve en lui un père plein de bonté, le crime doit s'attendre à y trouver toute la juste colère et la sévère équité d'un juge inexorable. Entrons donc dans la voie qui conduit à la vérité, et prenons garde à ne nous pas engager dans des routes écartées sous la conduite de ces faux sages, de ces célèbres fondateurs de la philosophie humaine. Je serais sans doute le premier à les suivre, et à porter les autres à embrasser leurs dogmes, si je croyais qu'ils pussent nous faire arriver sûrement à la possession de la vertu. Mais ce sont des guides aveugles, qui ne s'accordant pas même entre eux sur le chemin qu'on doit tenir, et marchant chacun par des sentiers différents qu'ils ont tracés, n'ont laissé après eux que des vestiges confus, sur lesquels il est dangereux de régler les siens, et qui, bien loin de mener à la connaissance de la vérité, conduisent infailliblement à l'erreur et au mensonge. Pour nous, qui avons le bonheur d être initiés par le baptême aux mystères sacrés de la véritable religion, qui avons reçu d'en haut par l'organe de la foi la lumière de la vérité, et qui avons Dieu même pour garant des grands principes que nous établissons, nous invitons toutes sortes de personnes au banquet que nous avons préparé, où nous ne servirons que des viandes célestes, et qui ont la vertu de rendre immortels ceux qui en font leur nourriture ordinaire. Nous avons partagé cet ouvrage en sept livres, dans lesquels nous exposerons la vérité dans tout son jour, et nous la ferons voir avec toute la beauté et tous les agréments qui l'accompagnent. Au reste, le sujet que nous traitons est si riche et si abondant, que si nous voulions étaler toutes les richesses qu'il renferme et ne rien omettre de tout ce qui pourrait contribuer à sa perfection, nous serions obligés de lui donner une trop grande étendue. Mais si nous resserrons notre discours dans de justes bornes, on ne doit pas craindre qu'il en soit plus obscur; car les choses que nous avons à dire sont d'elles-mêmes si claires et si faciles à comprendre qu'on ne saurait assez s'étonner de voir les hommes, et surtout ceux qui font une profession particulière de sagesse, de les voir, dis-je, chercher la vérité, sans la pouvoir trouver, puisqu'elle se montre à eux environnée de tant de lumières. Que si nous sommes assez heureux, ce que nous espérons de la bonté du ciel, pour faire rentrer les hommes dans le chemin de la vérité, dont ils se sont écartés pour suivre celui de l'erreur, nous les conduirons à la source d'une doctrine salutaire, où ils pourront étancher avec plaisir et sans crainte la soif ardente qui les brûle. Il ne sera pas même nécessaire qu'ils fassent un grand effort d'esprit pour pénétrer dans ce que nous leur proposerons : nous le ferons avec tant de netteté qu'on le concevra sans peine, pourvu qu'on ait la patience d'écouter ou de lire; car il se trouve des personnes si fort attachées à leurs préventions qu'elles se mettent volontairement un voile sur les yeux pour ne pas voir la vérité ; et leur aveuglement est d'autant plus déplorable, qu'en voulant défendre leur religion, ils ne font rien pour elle et font beaucoup contre eux. C'est pour ces malheureux esclaves de la prévention et de l'erreur que nous entreprenons d'écrire ceci. Il faut, s'il se peut, les faire sortir de cette obscurité où ils sont comme ensevelis, il faut leur aider à rompre les liens qui les retiennent captifs du mensonge. Qu'ils considèrent seulement ce qu'ils sont, et pourquoi ils se trouvent sur la terre; qu'ils apprennent à se connaître, et ils apprendront en même temps à connaître quelle est leur fin, et quels sont les moyens qu'ils doivent prendre pour y arriver; qu'ils soient enfin bien persuadés que toute religion sans la pratique de la vertu est fausse, et que la vertu sans l'exercice de la véritable religion n'est qu'imaginaire. II. Nous avons donc entrepris de tirer la vérité des ténèbres dont l'erreur l'a couverte jusqu'ici, et de la faire paraître dans tout l'éclat qui lui est naturel : mais nous n'avons pas cru devoir commencer par cette question célèbre, qui semble d'abord se présenter d'elle-même; savoir : s'il y a une providence qui veille sur toute la nature, ou si toutes choses ayant été formées par le hasard lui doivent aussi leur conservation. Démocrite a été l'auteur de cette opinion, et son disciple Épicure l'a pareillement enseignée. Mais ces deux philosophes n'ont fait que renouveler l'impiété de deux fameux athées,[4] dont le premier doutant de la divinité, et le second la niant absolument, s'accordaient en cela, qu'ils ôtaient à la Providence le gouvernement de l'univers. Les stoïciens au contraire ont toujours soutenu que le monde n'avait pu être formé que par cette souveraine puissance, et ne pouvait se conserver que par ses soins. Cicéron même, quoiqu'il fût académicien déclaré, abandonna sur ce point l'incertitude de sa secte, pour confirmer par plusieurs arguments affirmatifs le sentiment des stoïciens, et le fortifier par de nouveaux raisonnements: ce qu'il fait dans plus d'un ouvrage, mais principalement dans celui qu'il a composé sur la Nature des Dieux. Et certes, pour convaincre de fausseté l'opinion de trois ou quatre philosophes, il n'y a qu'à leur opposer le témoignage unanime des peuples et des nations entières, qui n'ont là-dessus qu'une même voix et un même langage. Car quel est l'homme assez grossier, et dont l'esprit et les mœurs soient si sauvages et si brutes, qui, levant les yeux au ciel, ne soit convaincu de la nécessité d'une providence, quoiqu'il puisse ignorer quel est le Dieu qui la fait agir, lorsqu'il vient à contempler la disposition des corps célestes, leur mouvement, leur étendue, leur durée, leur utilité, leur éclat, leurs effets. Et il ne se peut qu'il ne conçoive en même temps, que ce qui se maintient dans un ordre si admirable, et se meut par des ressorts si justes, ne soit l'effet d'une cause encore plus excellente, et d'une sagesse qui ne peut être que celle d'un Dieu? Il n'est donc rien de plus aisé que de produire des preuves de cette première vérité; mais parce que cette matière a été beaucoup agitée de part et d'autre, et que les ennemis de la Providence ont été plus d'une fois vaincus et désarmés par ses défenseurs, nous ne nous y arrêterons pas davantage, d'autant plus que nous serons obligés dans le cours de cet ouvrage de toucher souvent le même sujet, qui se trouve si naturellement lié aux autres que nous devons traiter, que nous ne saurions en entamer aucun qui n'ait quelque rapport avec la divine providence. III. Ne différons donc plus d'entrer en matière, et commençons par cette question qui, dans l'ordre, ne devrait être que la seconde ; savoir, si le monde est gouverné par une seule divinité ou par plusieurs. Nous n'estimons pas qu'il puisse y avoir un seul homme, s'il se sert de son esprit pour penser et de sa raison pour former un raisonnement, qui ne comprenne par cet unique secours qu'il tire de la nature, qu'il n'y a qu'un Dieu qui soit l’auteur de toutes choses, et qui les conserve par la même puissance qui les a créées. Car quel besoin y a-t-il d'en admettre plusieurs? Est-ce qu'un seul n'a ni assez de tête ni assez de force pour un emploi si vaste et si pénible? Peut-être que les forces de plusieurs unies ensemble pourront suppléer à la faiblesse d'un seul. C'est sans doute ce que s'imaginent ceux qui veulent établir la pluralité des dieux : ils les croient faibles et incapables de soutenir un si pesant fardeau, sans le secours mutuel et charitable qu'ils reçoivent l'un de l'autre. Mais comment cette puissance peut-elle s'accorder avec la nature de Dieu qui renferme en soi une puissance infinie? Il n'y a donc qu'un Dieu dont la puissance est sans bornes et la force sans faiblesse. Car cela seul peut-être appelé infiniment solide, qui ne peut rien perdre, et infiniment parfait, qui ne peut rien acquérir. Qui doute qu'un roi à qui toute la terre serait soumise n'eût un pouvoir d'une plus grande étendue que si cet empire était partagé entre plusieurs rois? Il en sera de même de l'empire de l'univers, si on le partage entre plusieurs divinités. Or comme il est certain qu'un pouvoir infini ne peut résider que dans un être qui est en toutes choses et en qui toutes choses sont, si la divinité n'est unique, en qui trouvera-t-on ce pouvoir? Sera-ce dans des divinités subalternes, qui le divisant entre elles, détruisent entièrement sa nature? Ces petits dieux qu'on se figure n'auront en particulier qu'un pouvoir fort limité, parce qu'il manquera à chacun ce qui sera dans tous les autres; et plus leur nombre sera grand, moins ils auront de pouvoir. Bien plus, cette souveraine puissance ne peut souffrir la moindre division; car tout ce qui peut être divisé, peut être altéré. Or Dieu étant incorruptible ne peut souffrir aucune altération : concluons donc que la puissance de Dieu, qui n'est point distincte de Dieu même, ne saurait être divisée. Et certes celui-là est dans une erreur grossière, qui ne peut s'imaginer qu'un corps d'une si grande étendue que le monde, puisse être régi par un seul : il ignore l'immensité de la puissance divine, s'il croit que celui qui l'a créé sans aide en ait besoin pour le gouverner. Mais peut-être voudra-t-on encore nous contester ce point. Un seul n'a pu construire une machine composée de tant de ressorts si justes, et qui ne se dérangent jamais; assembler tant de différents corps pour n'en former qu'un ; les maintenir tous dans une concorde admirable, y mettre tant d'ornements qui surprennent par leur variété, et par la merveilleuse proportion qui se trouve entre eux; il faut nécessairement, dira-t-on, que plusieurs aient mis la main à un si bel ouvrage. Et moi je soutiens qu'un seul en est l'auteur. Imaginez dans vos dieux telle grandeur qu'il vous plaira; multipliez-en le nombre à proportion du besoin que vous croyez en avoir pour un édifice si considérable; mettez dans chacun d'eux tant de puissance, de vertu, de sagesse, de majesté, que vous voudrez: je réunirai tout cela dans un seul, et je vous soutiendrai, de plus, qu'il y en a une infinité de fois davantage qu'il n'est possible de le dire ni de le penser. L'esprit humain n'a point d'idée, quelque élévation qu'il lui veuille donner, qui puisse représenter l'ombre seule de cette divine intelligence: comment en pourrait-il soutenir l'éclat? La langue n'a point de parole, quelque énergique qu'elle soit, qui puisse expliquer le moindre des effets qui partent de cette divine puissance : comment en pourrait-elle exprimer l'étendue? Je sais qu'on peut encore nous opposer que tous ces dieux, considérés chacun en particulier, sont aussi grands que le seul Dieu que nous reconnaissons: mais il n'est rien de moins juste que cette pensée; car il faut de nécessité que le pouvoir de ces dieux soit borné : si l'un d'eux veut tant soit peu étendre le sien, il ne le peut qu'il ne rencontre un de ses collègues et qu'il ne le chasse du poste qu'il occupait. Peut-on appeler divin un pouvoir qui se trouve enfermé dans de certaines limites? Quel dieu! à qui l'on prescrit, pour ainsi dire, une sphère d'activité, hors laquelle il ne lui est plus permis d'agir! Mais ils ne prévoient pas, ces partisans de la pluralité des dieux, qu'il peut arriver qu'ils se trouvent de sentiments opposés, comme il arriva en effet durant la guerre de Troie (du moins si nous en croyons Homère); car les uns voulant la ruine de cette ville, et les autres au contraire la voulant sauver, ils en vinrent aux mains, et ce différend pensa avoir de fâcheuses suites pour la céleste république. Les conséquences en seraient incomparablement plus dangereuses dans le gouvernement du monde. Et voyez à quoi il serait réduit, et quel désordre ce serait dans la nature, si, par exemple, l'un de ces dieux ayant destiné une certaine quantité de pluie douce pour arroser la terre et la rendre féconde au printemps, il prenait fantaisie à un autre dieu d'envoyer de la neige? Il est donc constant que le monde ne peut être gouverné que selon la suprême volonté d'un seul, comme une armée ne saurait subsister que sous les ordres d'un seul général ; vouloir enfin admettre plusieurs dieux dans le gouvernement de l'univers, n'est pas moins contraire au bon sens et à la raison, que d'introduire dans le corps humain plusieurs âmes pour conduire et régler les mouvements de ce petit monde, dont la structure n'est peut-être pas moins admirable que celle du grand : en sorte qu'une âme régirait les passions, une autre âme ferait agir les membres, chacun suivant les fonctions auxquelles il est destiné: celle-ci appliquerait les sens à leurs objets, celle-là fournirait les esprits et les enverrait aux endroits où ils sont nécessaires; une autre enfin ferait jouer tous les ressorts qui entretiennent la vie, et qui font subsister la machine. Si donc une âme peut seule gouverner le corps qu'elle anime, pourquoi ne veut-on pas qu'un Dieu puisse seul gouverner le monde qu'il a créé ? D'ailleurs, si l'on prétend que tous ces dieux, dans l'exercice de leurs emplois, reçoivent les ordres de l'un d'entre eux, qui soit comme leur chef, ce ne seront plus des dieux, mais les officiers et les ministres de celui qui leur commande, qui prescrit à chacun ce que chacun doit exécuter, qui distribue les charges, en un mot qui est celui à qui les autres obéissent. Si l'égalité ne se rencontre point entre eux, ni la divinité non plus, le commandement absolu exclut toute obéissance ; or le nom de Dieu est un nom de puissance absolue. IV. Les prophètes, dont le nombre n'est pas peu considérable, ont tous annoncé un Dieu. Et ce qui doit donner à leur témoignage un caractère d'infaillibilité, c'est que par l'inspiration de ce même Dieu, ils ont tous prédit ce qui devait arriver dans la suite des siècles, avec une uniformité capable de convaincre les moins crédules. Ceux qui font gloire de ne point déférer à la vérité, soutiennent que ces hommes divins ne méritent aucune créance, et que dans les oracles qu'ils ont rendus, ils ont moins été les organes de leur Dieu que les interprètes de leurs propres pensées. Peut-être parce qu'ils n'ont parlé que d'une divinité, les veut-on faire passer pour des fanatiques ou pour des imposteurs? Cependant, nous voyons que leurs prophéties s'accomplissent tous les jours; et ce rapport merveilleux entre les prédictions et les événements, et entre les paroles d'un prophète et celles d'un autre prophète, nous fait assez connaître que ce n'est l'ouvrage ni de la fureur, ni de l'imposture. Et quelle plus grande témérité que d'oser accuser ces hommes admirables d'avoir voulu imposer aux peuples, eux que Dieu n'avait pas seulement envoyés pour publier son nom par toute la terre, mais aussi pour en chasser l'injustice qui y régnait! Mais, après tout, quel est le motif le plus ordinaire qui inspire le mensonge et qui fait les fourbes, sinon le désir qu'on a de s'élever dans le monde aux dépens de la crédulité des simples? Et qui fut jamais moins attaché aux richesses et moins susceptible d'ambition que ces hommes de Dieu? Ils se sont acquittés de leur ministère avec un si grand désintéressement, qu'ayant abandonné ce qu'une prévoyance raisonnable pouvait leur conseiller de se réserver pour le soutien de leur vie, ils l'ont attendu chaque jour de la main de Dieu, et, bien loin d'avoir acquis dans l'exercice de leurs fonctions des biens et des honneurs, ils n'y ont trouvé que des supplices et la mort. C'est le prix ordinaire dont les médians paient la charité sincère des gens de bien, qui les reprennent de leurs désordres et qui leur veulent inspirer l'amour de la vertu: ils conçoivent en même temps de l'aversion pour elle, et de la haine pour ceux qui leur annoncent ces maximes. Ajoutons à cela que, parmi ces prophètes, il s'est trouvé des princes et des rois, sur qui sans doute le soupçon d'une basse avarice ne tombera jamais, et qui cependant, aussi bien que les autres d'un rang inférieur, ont enseigné l'unité de Dieu. V. Mais n'insistons pas davantage sur cette preuve, quelque certitude qu'elle ait, puisqu'elle n'en a pas pour ceux qui se font un honneur de ne rien croire, et venons à leurs propres auteurs. Nous consentons même à les prendre pour juges, et nous ne les récuserons point, quoiqu'on veuille qu'ils ne nous soient pas favorables. Ces juges sont les poètes et les philosophes. Nous prétendons trouver dans leurs écrits des preuves de l'unité de Dieu; et il faut avouer que l'éclat de cette vérité est si perçant qu'il n'y a point d'yeux, quelque fermés qu'ils soient par l'ignorance ou par la passion, qui ne soient forcés de s'ouvrir lorsqu'ils en sont frappés. Orphée, le plus ancien des poètes et contemporain des dieux (puisqu'on dit qu'il se trouva dans le vaisseau des Argonautes avec Hercule, elles deux frères Castor et Pollux), Orphée, dis-je, appelle Dieu « le premier né, » comme étant le principe de toutes choses. Il le nomme encore « celui qui a apparu, » parce qu'il est le premier qui soit sorti du néant; et comme ce poète ne peut concevoir ni la véritable origine, ni la véritable nature de Dieu, et ne voit rien de plus grand que l'air, ni qui ait plus de rapport avec l'immensité de Dieu, il le fait naître de cette vaste étendue. Il ajoute que ce Dieu est le père de plusieurs autres ; qu'il a bâti le ciel pour leur servir de demeure, et pour rassembler autour de lui dans le même palais cette nombreuse et divine famille. Ainsi ce poète théologien, conduit par le seul instinct de la nature et éclairé de ses seules lumières, comprit sans peine qu'il y avait un être suprême auteur des autres êtres : car il ne pouvait attribuer cette qualité à Jupiter, puisqu'il était fils de Saturne; ni à Saturne, puisque le ciel passait pour son père; ni au Ciel même, qui ne faisant qu'une partie du monde et n'en étant qu'un élément, reconnaît nécessairement lui-même un principe. Cette suite de raisonnements conduisit enfin Orphée à l'existence de ce Dieu premier né, entre les mains du quel il mit un pouvoir universel sur toutes les créatures. Pour Homère, il ne nous a rien laissé qui pût éclaircir cette question, ayant écrit les aventures des dieux d'une manière qui n'a nul rapport à la grandeur qu'on doit supposer dans des substances si excellentes, et qui sans doute convient mieux à la faiblesse des hommes qu'à la majesté de Dieu. Il semblerait qu'Hésiode, qui a composé un livre exprès sur cette matière, pourrait nous être utile dans la recherche que nous faisons ; il faut cependant demeurer d'accord que son ouvrage ne nous peut fournir que de faibles preuves. Il le commence par la description du chaos, de cette masse informe, de cet amas confus de matière, sans nous apprendre en quel temps et de quelle sorte les parties de cette matière première se sont trouvées unies ensemble. Car, comme toutes choses doivent avoir reçu leur disposition et leur arrangement de la main de quelque excellent ouvrier, il faut nécessairement que la matière ait reçu son existence de quelque être supérieur; et quel autre que Dieu peut lui avoir donné cette existence? Mais Hésiode n'entre point dans cette pensée; il ne saurait goûter une vérité qui lui est inconnue; et il paraît bien que lorsqu'il monta sur le Parnasse pour y composer son poème, il l'avait médité à loisir, et que les Muses (comme il voudrait nous le faire croire) ne le lui inspirèrent jamais. Virgile, le premier de nos poètes latins, s'est beaucoup moins éloigné de la vérité, lorsqu'il parle ainsi de Dieu : Au commencement le ciel, la mer, et les globes célestes furent comme animés d'un souffle de vie ; tout reçut le mouvement de l'Esprit, qui se répandit et se mêla dans toutes les parties de l'univers Et, pour ne laisser aucun doute touchant la nature de cet Esprit auquel il attribue une puissance si universelle, il dit nettement en un autre endroit : Que Dieu remplit la terre, la mer, et l'immense étendue de l'air, et que tous les animaux qui vivent au milieu de ces éléments, tiennent de lui l'être et la vie. Ovide, dès l'entrée de son excellent livre des Métamorphoses, avoue que le monde est l'ouvrage de Dieu, qu'il appelle en plus d'un endroit Le Créateur du monde, et l'auteur de toutes choses. Mais laissons-la les poètes, et consultons les philosophes, dont l'autorité doit avoir plus de poids, et le témoignage plus de certitude, puisqu'on est persuadé qu'ils ne s'occupent pas, comme les poètes, à embellir le mensonge, mais que leur unique étude est la recherche de la vérité. Thalès de Milet, qui fut un des sept sages de la Grèce, et qu'on croit avoir été le premier qui ait traité des causes naturelles, fait naître toutes choses de l'eau ; il soutient que Dieu s'est servi de cet élément pour les former. Ainsi, suivant cette opinion, l'eau est la matière, et Dieu est l'agent qui l'a mise en œuvre. Dieu, selon Pythagore, est une âme qui anime toutes les parties de ce grand univers, qui est répandue partout, et qui donne la vie aux animaux et l'être à tout ce qui existe. Anaxagore veut que Dieu soit une intelligence infinie, qui a en soi le principe de tout mouvement. Antisthène laisse aux peuples ses dieux; mais il n'en reconnaît qu'un, qui est l'auteur de la nature. Cléante et Anaximène croient que cette partie de l'air, la plus pure et la plus voisine du ciel, est Dieu même. A quoi Virgile notre poète semble faire allusion, lorsqu'il dit que : L'air, qui est le Père tout-puissant, descend dans le sein de la Terre son épouse, par des pluies qui la rendent féconde ; et que s'insinuant par tout cet élément, il y forme les germes, les fait croître, et les nourrit. Chrysippe veut que Dieu soit une vertu naturelle, excitée et comme animée par un esprit divin. Quelquefois il nomme Dieu une nécessité divine. Zénon l'appelle une « loi divine et naturelle. » Tous enfin, dans une diversité apparente de sentiments, conviennent qu'il y a une Providence. Car que ce soit ou la nature, ou un air subtil, ou une souveraine raison, ou une intelligence, ou une nécessité fatale, ou une loi divine, ou telle autre chose qu'il leur plaira d'imaginer, c'est ce que nous appelons Dieu. Et qu'importe que tous ces noms soient différents, s'ils rappellent les esprits à une même notion, et s'ils y forment la même idée? Quoique Aristote ne soit pas toujours d'accord avec lui-même, et que ses opinions se combattent quelquefois, il marque en ceci une conformité toujours égale, et sans jamais varier il confesse qu'il n'y a qu'une seule et unique intelligence qui gouverne le monde. Platon, qui est estimé le plus sage et le plus éclairé des philosophes, établit clairement un seul gouvernement monarchique dans l'univers; et sans se servir des noms d'air, de raison ou de nature, il appelle Dieu ce souverain monarque, et il le fait l'auteur de ce grand et admirable ouvrage. Cicéron, qui le suit et l'imite en plusieurs choses, rend souvent témoignage à l'unité de Dieu : et dans son Traité des lois il ne fait point de difficulté de le nommer l'Être suprême. Il se sert même de cet argument, pour prouver que le monde est gouverné par ce premier de tous les êtres : c'est dans le livre de la Nature des Dieux: « Il n'y a rien, dit-il, de plus grand, rien de plus excellent, que la nature divine ; par conséquent il n'y a que cette divine essence qui ait droit de posséder l'empire souverain sur toutes les créatures: elle seule est indépendante; donc tout doit dépendre d'elle. » C'est ce qu'il confirme par la définition qu'il donne de la divinité. « Le Dieu, dit-il, que nous concevons, est un esprit libre, dégagé de toute matière, immortel, qui connaît tout, et qui donne le mouvement à tout. » Enfin Sénèque, stoïcien déterminé s'il en fût jamais, et dévoué entièrement aux opinions du Portique, ne rend-il pas à Dieu en mille rencontres la gloire qui lui est due. Venant à parler de la mort qui arrive dans un âge peu avancé: « Vous ignorez, dit-il a un de ses amis, quelle est la grandeur et la majesté de votre juge; sachez qu'il a un pouvoir absolu sur les hommes, et qu'il est le maître des dieux. » Et ailleurs : « Lorsque Dieu voulut jeter les premiers fondements de cet édifice merveilleux, qui surprend encore tous les jours nos yeux et nos esprits, il créa des dieux, qu'il fit ses ministres dans la conduite de ce vaste empire ; et quoiqu'il fût présent partout, il trouva bon de faire divers départements, et d'assigner à chacun une portion de l'univers, qu'il confia à son administration et à ses soins. » Ce philosophe parle le même langage que nous en plusieurs endroits de ses ouvrages. Mais nous l'écouterons encore autre part ; qu'il suffise maintenant d'avoir montré que les plus grands hommes, et les génies les plus sublimes de la savante Grèce et de la sage Italie ont approché de la vérité; et ils l'eussent sans doute vue dans toute son évidence, si le malheur de leur naissance ne les eût engagés dans des opinions fausses, quoique établies par la coutume, par une longue suite d'années, et par le consentement des peuples. C'est sur la foi de ces opinions trompeuses qu'ils ont cru qu'il y avait d'autres dieux que celui qu'ils reconnaissaient pour le premier et le plus ancien de tous ; et qu'attribuant des qualités divines à diverses choses qui servent à l'entretien de la vie des hommes, ils en ont fait des divinités, et leur ont offert avec de l'encens leurs vœux et leurs hommages.
|
|
CAPUT VI. De divinis testimoniis et de Sibyllis et earum carminibus. Nunc ad divina testimonia transeamus: sed prius unum proferam, quod est simile divino, et ob nimiam vetustatem, et quod is, quem nominabo, ex hominibus in deos relatus est. Apud Ciceronem C. Cotta pontifex disputans contra Stoicos de religionibus, et de varietate opinionum, quae solent esse de diis, ut more academicorum omnia faceret incerta, quinque fuisse Mercurios ait; et enumeratis per ordinem quatuor, quintum fuisse eum, a quo occisus sit Argus, ob eamque causam in Aegyptum profugisse, atque Aegyptiis leges ac litteras tradidisse. Hunc Aegyptii Thoyth appellant, a quo apud eos primus anni sui mensis, id est september, nomen accepit. Idem oppidum condidit, quod etiam nunc Graece vocatur Ἐρμόπολις et Phenatae colunt eum religiose. Qui tametsi homo, fuit tamen antiquissimus, et instructissimus omni genere doctrinae: adeo ut ei multarum rerum et artium scientia Trismegisto cognomen imponeret. Hic scripsit libros, et quidem multos, ad cognitionem divinarum rerum pertinentes, in quibus majestatem summi ac singularis Dei asserit, iisdemque nominibus appellat, quibus nos, Deum et patrem. Ac ne quis nomen ejus requireret, ἀνώνυμον esse dixit; eo quod nominis proprietate non egeat, ob ipsam scilicet unitatem. Ipsius haec verba sunt: Ὁ δὲ Θεὸς εἷς, ὁ δὲ εἷς ὀνόματος οὐ προσδέεται ἔστι γὰρ ὁ ὢν ἀνώνυμος. Deo igitur nomen non est, quia solus est; nec opus est proprio vocabulo, nisi cum discrimen exigit multitudo, ut unamquamque personam sua nota et appellatione designes. Deo autem, quia semper unus est, proprium nomen est Deus. Superest de responsis carminibusque sacris testimonia, quae sunt multo certiora, proferre. Nam fortasse ii, contra quos agimus, nec poëtis putent esse credendum, tamquam vana fingentibus; nec philosophis, quod errare potuerint, quia et ipsi homines fuerint. M. Varro, quo nemo umquam doctior, ne apud graecos quidem nedum apud latinos vixit, in libris rerum divinarum, quos ad C. Caesarem pontificem maximum scripsit, cum de quindecim viris loqueretur, Sibyllinos libros ait non fuisse unius Sibyllae; sed appellari uno nomine Sibyllinos quod omnes foeminae vates Sibyllae, sint a veteribus nuncupatae, vel ab unius Delphidis nomine, vel a consiliis deorum enuntiandis. σιοὺς enim deos, non θεοὺς, et consilium non βουλὴν, sed βυλὴν appellabant Aeolico genere sermonis: itaque Sibyllam dictam esse quasi σιοβολὴν caeterum Sibyllas decem numero fuisse; easque omnes enumeravit sub auctoribus, qui de singulis scriptitaverint: primam fuisse de Persis, cujus mentionem fecerit Nicanor, qui res gestas Alexandri Macedonis scripsit: secundam Lybissam, cujus meminit Euripides in Lamiae prologo: tertiam Delphida, de qua Chrysippus loquitur in eo libro, quem de divinatione composuit: quartam Cimmeriam in Italia, quam Naevius in libris belli Punici, Piso in annalibus nominat: quintam Erythraeam, quam Apollodorus Erythraeus affirmat suam fuisse civem, eamque Graiis Ilium petentibus vaticinatam, et perituram esse Trojam, et Homerum mendacia scripturum: sextam Samiam de qua scribit Eratosthenes in antiquis annalibus Samiorum repeisse se scriptum: septimam Cumanam nomine Amaltheam, quae ab aliis Demophile vel Herophile nominatur; eamque novem libros attulisse ad regem Tarquinium Priscum, ac pro eis trecentos Philippeos postulasse; regemque aspernatum pretii magnitudinem, derisisse mulieris insaniam: illam in conspectu Regis tres combussisse, ac pro reliquis idem pretium postulasse: Tarquinium multo magis mulierem insanire putasse. Quae denuo tribus aliis exustis, cum in eodem pretio perseveraret, motum esse regem, ac residuos trecentis aureis emisse: quorum postea numerus sit auctus, Capitolio refecto, quod ex omnibus civitatibus et Italicis, et Graecis, et praecipue Erythraeis coacti, allatique sunt Romam, cujuscumque Sibyllae nomine fuerint: octavam Hellespontiam in agro Trojano natam; vico Marpesso, circa oppidum Gergithium; quam scribit Heraclides Ponticus Solonis et Cyri fuisse temporibus: nonam Phrygiam, quae vaticinata sit Ancyrae: decimam Tiburtem, nomine Albuneam, quae Tiburi colitur ut dea, juxta ripas amnis Anienis, cujus in gurgite simulacrum ejus inventum esse dicitur, tenens in manu librum: cujus sortes Senatus in Capitolium transtulerit. Harum omnium Sibyllarum carmina et feruntur et habentur, praeterquam Cumaeae, cujus libri a Romanis occuluntur, nec eos ab ullo, nisi a quindecim viris inspici fas habent. Et sunt singularum singuli libri: qui quia Sibyllae nomine inscribuntur, unius esse creduntur; suntque confusi, nec discerni ac suum cuique assignari potest: nisi Eruthraeae, quae et nomen suum verum carmini inseruit, et Erythraeam se nominatum iri praelocuta est, cum esset orta Babylone: sed et nos confuse Sibyllam dicemus, sicubi testimoniis earum fuerit abutendum. Omnes igitur hae Sibyllae unum Deum praedicant; maxime tamen Erythraea, quae celebrior inter caeteras ac nobilior habetur: siquidem Fenestella, diligentissimus Scriptor de quindecim viris dicens, ait, restituto Capitolio, retulisse ad Senatum C. Curionem Cos. ut legati Erythras mitterentur, qui carmina Sibyllae conquisita Romam deportarent; itaque missos esse P. Gabinium, M. Otacilium, L. Valerium, qui descriptos a privatis versus circa mille Romam deportarunt. Idem supra ostendimus dixisse Varronem. In iis ergo versibus, quos legati Romam attulerunt, de uno Deo haec sunt testimonia: Εἷς θεὸς ὃς μόνος ἐστὶν ὑπερμεγεθὴς ἀγένητος. Hunc esse solum Deum summum, qui coelum fecerit, luminibusque distinxerit.
Ἀλλὰ θεὸς μόνος εἷς, πανυπέρτατος ὃς πεποίηκεν; Qui quoniam solus sit aedificator mundi, et artifex rerum, vel quibus constat, vel quae in eo sunt, solum coli oportere testatur:
Αὐτὸν τὸν μόνον ὄντα σέβεσθ' ἡγήτορα κόσμον Item alia Sibylla, quaecumque est, cum perferre se ad homines Dei vocem diceret, sic ait: Εἷς μόνος εἰμὶ θεὸς, καὶ οὐκ ἔστι θεὸς ἄλλος Exequerer nunc testimonia caeterarum, nisi et haec sufficerent, et illa opportunioribus locis reservarem. Sed cum defendamus causam veritatis apud eos, qui aberrantes a veritate falsis religionibus serviunt, quod genus probationis adversus eos magis adhibere debemus, quam ut eos deorum suorum testimoniis revincamus?
CAPUT VII. De testimoniis Apollinis et deorum.
Αὐτοφυὴς ἀδιδάκτος ἀμήτωρ ἀστυφέλικτος, Num quis potest suspicari de Jove esse dictum, qui et matrem habuit, et nomen? Quid quod, Mercurius ille ter maximus, cujus supra mentionem feci, non modo ἀμήτορα, ut Apollo, sed ἀπάτορα quoque appellat Deum; quod origo illi non sit aliunde? Nec enim potest ab ullo esse generatus, qui ipse universa generavit. Satis (ut opinor) et argumentis docui, et testibus confirmavi, quod per se satis clarum est Unum esse regem mundi, unum patrem, unum Deum. Sed fortasse quaerat aliquis a nobis idem illud, quod apud Ciceronem quaerit Hortensius: Si Deus unus est, quae esse beata solitudo queat? Tamquam nos, qui unum esse dicimus, desertum ac solitarium esse dicamus; habet enim ministros, quos vocamus nuntios. Et est illud verum, quod dixisse in Exhortationibus Senecam supra retuli, ministros genuisse regni sui Deum. Verum hi neque dii sunt, neque deos se vocari, aut coli volunt: quippe qui nihil praeter jussum ac voluntatem Dei faciant. Nec tamen illi sunt, qui vulgo coluntur, quorum et exiguus et certus est numerus. Quod si cultores deorum eos ipsos se colere putant, quos summi Dei ministros appellamus, nihil est quod nobis faciant invidiam, qui unum Deum dicamus, multos negemus. Si eos multitudo delectat, non duodecim dicimus, aut trecentos sexaginta quinque (ut Orpheus), sed innumerabiles esse arguimus errores eorum in diversum, qui tam paucos putant. Sciant tamen, quo nomine appellari debeant: ne Deum verum violent, cujus nomen exponunt, dum pluribus tribuunt. Credant Apollini suo, qui eodem illo responso, ut Jovi principatum, sic etiam caeteris diis abstulit nomen. Tertius enim versus ostendit, Dei ministros, non deos, verum angelos appellari oportere. De se quidem ille mentitus est, qui cum sit e numero daemonum, angelis se Dei aggregavit: denique in aliis responsis daemonem se esse confessus est. Nam cum interrogaretur, quomodo sibi supplicari vellet, ita respondit: Πάνσοφε, παντοδίδακτ' αἰολόστροφε, κέκλυτι δαῖμον. Item rursus cum precem in Apollinem Smynthium rogatus expromeret, ab hoc versu exorsus est: Αρμονίη κόσμοιο φαεσφόρε καὶ σοφὲ δαῖμον. Quid ergo superest, nisi ut sua confessione verberibus veri Dei ac poenae subjaceat sempiternae? Nam et in alio responso ita dixit: Δαίμονες οἰ φοιτῶσι περὶ χθόνα καὶ περὶ τότον Ἀκάματοι δάμανται ὑπαὶ μάστιγι θεοῖο. De utrisque generibus in secundo libro disserimus. Interim nobis sat est, quod, dum honorare se vult, et in coelo collocare, confessus est, id quod res habet, quomodo sint appellandi qui Deo semper assistunt. Retrahant ergo se homines ab erroribus et abjectis religionibus pravis, parentem suum dominumque cognoscant: cujus nec virtus aestimari potest, nec magnitudo perspici, nec principium comprehendi. Cum ad illum mentis humanae intentio et acumen et memoria pervenerit, quasi subductis et consummatis omnibus viis, subsistit, haeret, deficit; nec est aliquid ulterius quo progredi possit. Verum quia fieri non potest, quin id quod sit, aliquando esse coeperit, consequens est, ut quando nihil ante illum fuit, ipse ante omnia ex se ipso sit procreatus. Ideoque ab Apolline αὐτοφυὴς, a Sibylla αὐτογενὴς, et ἀγγένητος, et ἀποίητος nominatur. Quod Seneca, homo acutus, in Exhortationibus vidit: « Nos, inquit, aliunde pendemus. Itaque ad aliquem respicimus, cui, quod est optimum in nobis debeamus. Alius nos edidit; alius instruxit: Deus ipse se fecit. » CAPUT VIII. Quod Deus sine corpori sit, nec sexu ad procreandum egeat. His igitur tot et tantis testibus comprobatur unius Dei potestate ac providentia mundum gubernari; cujus vim majestatemque tantam esse dicit in Timaeo Plato, ut eam neque mente concipere, neque verbis enarrare quisquam possit, ob nimiam ejus et inaestimabilem potestatem. Dubitet vero aliquis, an quidquam difficile aut impossibile sit Deo, qui tanta tamque mirifica opera providentia excogitavit, virtute constituit, ratione perfecit; nunc autem spiritu sustentet, potestate moderetur, inexcogitabilis, ineffabilis, et nulli alii satis notus quam sibi? Unde mihi de tanta majestate saepius cogitanti, qui deos colunt, interdum videri solent tam caeci, tam incogitabiles, tam excordes, tam non multum a mutis animalibus differentes, qui credant eos, qui geniti sunt maris ac foeminae coïtu, aliquid majestatis divinaeque virtutis habere potuisse; cum Sibylla Erythraea dicat:
. . . . . . . . . . . . Οὐ δύνατ' ἀνδρὸς Quod si est verum, sicuti est, apparet Herculem, Apollinem, Liberum, Mercurium, Jovemque ipsum cum caeteris homines fuisse; quando sunt ex duobus sexibus nati. Quid est autem tam remotum a Deo, quam id opus quod ipse ad propagandam sobolem mortalibus tribuit, et quod sine substantia corporali nullum potest esse? Dii ergo si sunt immortales et aeterni, quid opus est altero sexu; cum successione non egeant, qui semper sunt futuri? Nam profecto in hominibus caeterisque animantibus diversitas sexus, et coïtio, et generatio nullam habet aliam rationem, nisi ut omnia genera viventium, quando sunt conditione mortalitatis obitura, mutua possint successione servari. Deo autem, qui est sempiternus, neque alter sexus, neque successio necessaria est. Dicet aliquis, ut habeat vel ministros, vel in quos ipse possit dominari. Quid igitur opus est sexu foemineo, cum Deus, qui est ommipotens, sine usu et opera foeminae possit filios procreare? Nam si quibusdam minutis animalibus id praestitit, ut sibi E foliis natos et suavibus herbis Ore legant: cur existimet aliquis ipsum Deum, nisi ex permixtione sexus alterius non posse generare? Illos igitur, quos imperiti et insipientes tanquam deos et nuncupant et adorant, nemo est tam inconsideratus, qui non intelligat fuisse mortales. Quomodo ergo, inquiet aliquis, dii crediti sunt? Nimirum quia reges maximi ac potentissimi fuerint: ob merita virtutum suarum, aut munerum, aut artium repertarum, cum cari fuissent iis quibus imperitaverant, in memoriam sunt consecrati. Quod is quis dubitet, res eorum gestas, et facta consideret, quae universa tam poetae quam historici veteres prodiderunt. CAPUT IX. De Hercule et ejus vita et morte. Hercules, qui ob virtutem clarissimus, et quasi Africanus inter deos habetur, nonne orbem terrae, quem peragrasse ac expurgasse narratur, stupris, libidinibus, adulteriis inquinavit? nec mirum, cum esset adulterio genitus Alcmenae. Quid tandem potuit in eo esse divini, quis suis ipse vitiis mancipatus, et mares et foeminas contra omnes leges infamia, dedecore, flagitio affecit? Sed ne illa quidem, quae magna et mirabilia gessit, talia judicanda sunt; ut virtutibus divinis tribuenda videantur. Quid enim tam magnificum, si leonem aprumque superavit, si aves sagittis dejecit, si regium stabulum egessit, si viraginem vicit, cingulumque detraxit, si equos feroces cum domino interemit? Opera sunt ista fortis viri, hominis tamen. Illa enim, quae vicit, fragilia et mortalia fuerunt. Nulla enim est (quod ait Orator) tanta vis, quae non ferro ac viribus debilitari frangique possit. At animum vincere, iracundiam cohibere, fortissimi est: quae ille nec fecit unquam, nec potuit. Haec qui faciat, non ego eum cum summis viris comparo; sed simillimum Deo judico. Vellem adjecisset de libidine, luxuria, cupiditate, insolentia; ut virtutem ejus impleret, quem similem Deo judicabat. Non enim fortior putandus est, qui leonem, quam qui violentam in seipso inclusam feram superat, iracundiam; aut qui rapacissimas volucres dejecit, quam qui cupiditates avidissimas coercet; aut qui Amazonem bellatricem, quam qui libidinem vincit, pudoris ac famae debellatricem; aut qui fimum de stabulo, quam qui vitia de corde suo egerit, quae magis sunt perniciosa, quia domestica et propria mala sunt, quam illa, quae et vitari poterant et caveri. Ex quo fit, ut ille solus vir fortis debeat judicari, qui temperans, moderatus et justus est. Quod si cogitet aliquis, quae sint Dei opera: jam haec omnia, quae mirantur homines ineptissimi, ridicula judicabit. Illa enim non divinis virtutibus, quas ignorant, sed infirmitate suarum virium metiuntur. Nam illud quidem nemo negabit, Herculem non Eurystheo tantum servisse regi, quod aliquatenus honestum videri potest; sed etiam impudicae mulieri Omphalae, quae illum vestibus suis indutum sedere ad pedes suos jubebat pensa facientem: detestabilis turpitudo! sed tanti erat voluptas. Quid tu, inquiet aliquis, poetisne credendum putas? Quidni putem? Non enim ista Lucilius narrat, aut Lucianus, qui diis et hominibus non pepercit; sed hi potissimum, qui deorum laudes canebant. Quibus igitur credemus, si fidem laudantibus non habemus? Qui hos mentiri putat, proferat alios quibus credamus auctores, qui nos doceant, qui sint isti dii, quomodo, unde orti; quae sit vis eorum, qui numerus, quae potestas, quid in his admirabile, quid cultu dignum, quod denique certius veriusque mysterium: nullos dabit. Credamus igitur istis, qui non ut reprehenderent sunt locuti; sed ut praedicarent. Navigavit ergo cum Argonautis, expugnavitque Trojam, iratus Laomedonti ob negatam sibi pro filiae salute mercedem: unde, quo tempore fuerit, apparet. Idem furore atque insania percitus, uxorem suam cum liberis interemit. Hunc homines deum putant? sed Philocteta ejus haeres non putavit, qui facem supposuit arsuro, qui artus ejus et nervos cremari ac diffluere vidit, qui ossa ejus ac cineres in Oeteo monte sepelivit, pro quo munere sagittas ejus accepit. CAPUT X. De Aesculapii, Apollinis, Neptuni, Martis, Castoris et Pollucis, Mercurii atque Liberi vita et gestis. Aesculapius et ipse non sine flagitio Apollinis natus, quid fecit aliud divinis honoribus dignum, nisi quod sanavit Hippolytum? mortem sane habuit clariorem, quod a Deo meruit fulminari. Hunc Tarquitius de illustribus viris disserens, ait incertis parentibus natum, expositum, et a venatoribus inventum, canino lacte nutritum, Chironi traditum, didicisse medicinam: fuisse autem Messenium, sed Epidauri moratum. Tullius etiam Cynosuris ait sepultum. Quid Apollo pater ejus? Nonne ob amorem, quo flagrabat, turpissime gregem pavit alienum, et muros Laomedonti exstruxit, cum Neptuno mercede conductus, quae illi negari potuit impune, ab eoque primo Rex perfidus, quidquid cum diis pepigisset, didicit abnegare. Idem formosum puerum et dum amat, violavit; et dum ludit, occidit. Homicida Mars, et per gratiam caedis crimine ab Atheniensibus liberatus, ne videretur nimis ferus et immanis, adulterium cum Venere commisit. Castor et Pollux, dum alienas sponsas rapiunt, esse gemini desierunt. Nam livore injuriae concitatus Idas, alterum gladio transverberavit; et eosdem poetae alternis vivere alternis mori narrant: ut jam sint non deorum tantum, sed omnium mortalium miserrimi, quibus semmel mori non licet. Hos tamen Homerus ambos simpliciter (non ut poetae solent) mortuos esse testatur. Nam cum faceret in muris assidentem Priamo Helenam, cunctos Graeciae principes recognoscere, solos autem se fratres suos requirere, subjeccit orationi ejus hujusmodi versum: Ὡς φάτο, τοὺς δ' ἤδη κάτεχεν φυνίζοος αἶα. Fur ac nebulo Mercurius, quid ad famam sui reliquit nisi memoriam fraudum suarum? Coelo scilicet dignus, quia palaestram docuit, et lyram primus invenit. Liberum patrem in senatu deorum summae auctoritatis primaeque esse sententiae necesse est; quia praeter Jovem solus omnium triumphavit, exercitum duxit, Indos deballavit. Sed invictus ille Imperator Indicus, maximus ab amore ac libidine turpissime victus est. Delatus enim Cretam cum semiviro comitatu, nactus est impudicam mulierem in littore ac fiducia victoriae Indicae vir esse, voluit, ne nimium mollis videretur atque illam patris proditricem, fratris inte remptricem, ab alio relictam et repudiatam, in conjugium sibi vendicavit, et Liberam fecit, et cum ea pariter ascendit in coelum. Quid horum omnium pater Jupiter, qui in solemni precatione Optimus, Maximus nominatur? nonne a prima sua pueritia impius ac pene parricida deprehenditur? cum patrem regno expulit ac fugavit, nec expectavit mortem decrepiti senis, cupiditate regnandi: et cum paternum solium per vim, per arma cepisset, bello est a Titanibus lacessitus; quod humano generi principium fuit malorum: quibus victis, et pace in perpetuum comparata, reliquam suam vitam in stupris adulteriisque consumpsit. Omitto virgines, quas imminuit. Id enim tolerabile judicari solet. Amphitryonem ac Tyndarum praeterire non possum, quorum domos dedecore atque infamia plenissimas reddidit. Illud vero summae impietatis ac sceleris, quod regium puerum rapuit ad stuprum. Parum enim videbatur, si in expugnanda foeminarum pudicitia maculosus esset ac turpis, nisi etiam sexui suo injuriam faceret: hoc est verum adulterium, quod fit contra naturam. Haec qui fecit viderimus, an maximus; certe optimus non est: quod nomen a corruptoribus, ab adulteris, ab incestis abest; nisi forte nos erramus homines, qui talia facientes sceleratos vocamus, ac perditos, omnibusque poenis dignissimos judicamus. Stultus autem Marcus Tullius, qui C. Verri adulteria objecit: eadem enim Jupiter, quem colebat, admisit; qui P. Clodio sororis incestum: at illi Optimo Maximo eadem fuit et soror et conjux. |
VI. Venons maintenant aux preuves divines : mais avant que d'en faire voir la certitude et l'évidence, examinons-en une qui n'est pas à mépriser, soit à cause de son ancienneté qui l'a en quelque sorte consacrée, soit parce que celui qui nous la doit fournir a été mis lui-même au rang des dieux. Nous lisons donc dans Cicéron, que le souverain pontife Cotta, disputant de la religion contre les stoïciens et expliquant les divers sentiments qui partagent les philosophes touchant le nombre et la nature des dieux, dit, que l'antiquité avait reconnu cinq différents Mercures: et après avoir raconté l'histoire des quatre premiers, il vient aux aventures du cinquième. Ce fut celui qui, ayant tué Argus, chercha dans l'Egypte un asile contre le ressentiment de Junon. Pendant le séjour qu'il y fit, il donna aux Égyptiens la connaissance des lettres, et leur dicta des lois; et ces peuples par reconnaissance donnèrent son nom[5] au premier mois,[6] bâtirent en sa mémoire une ville que les Grecs appellent encore aujourd'hui Hermopolis,[7] et lui rendirent tous les honneurs qu'on ne rend qu'à la divinité. Quoique ce prétendu dieu des Saïtes[8] ne fût en effet qu'un homme, ce fut un homme extraordinaire : il rassembla en lui tout ce que la nature et l'art peuvent produire de lumières, et il posséda dans un degré si éminent les connaissances acquises et infuses, qu'elles lui méritèrent le glorieux nom de Trismégiste.[9] Il écrivit plusieurs livres des choses qui concernent la religion. Il y établit la grandeur, la souveraine puissance et l'unité de Dieu, et il lui donne, comme nous, le nom de Dieu et de Père. Mais afin de réprimer la curiosité peu religieuse de ceux qui voudraient savoir son véritable nom, il soutient qu'il n'en doit point avoir à cause de son unité. Car voici ses propres termes : « Dieu est un; or ce qui est un n'a pas besoin de nom : Dieu est celui qui est, voilà son nom. Dieu est donc sans nom parce qu'il est seul, et que les noms ne sont nécessaires que lorsqu'il y a nombre ; ils ne servent enfin qu'à empêcher la confusion qui se rencontrerait dans la pluralité, si l'un n'était distingué de l'autre par un nom particulier. » Il faut maintenant parler des livres que les sibylles ont laissés; nous y trouverons, sur la vérité que nous voulons établir, des preuves plus certaines et qui ne seront pas sujettes aux défauts de celles que nous avons produites jusqu'ici ; car nos adversaires refuseront peut-être d'ajouter foi aux poètes, parce que la perfection de leur art consiste à feindre et à rendre le mensonge vraisemblable, et ils ne croiront pas non plus devoir déférer à l'autorité des philosophes, parce qu'étant des hommes, ils peuvent se laisser surprendre à l'erreur ou à l'apparence. Varron, qui pour sa profonde érudition ne vit aucun parmi les Grecs qui ne lui cédât, ni aucun des Romains qui osât l'égaler, ce savant homme, dis-je, dans son Traité des Choses Divines qu'il adresse à Caïus César, souverain sacrificateur, venant à parler des fonctions des quindécemvirs, qui sont préposés à la garde des livres sibyllins, prétend que ce nom ne fut pas donné à ces livres sacrés pour avoir été l'ouvrage d'une seule sibylle ; mais que les anciens ayant ainsi nommé toutes les femmes qui paraissaient remplies de l'esprit de prophétie ou agitées de la fureur poétique, tout ce que ces femmes inspirées prononçaient reçut le nom d'oracles sibyllins, et elles celui de sibylles, ou du nom de celle qui prophétisait à Delphes, ou plutôt parce qu'elles passaient pour être les interprètes des volontés divines, le nom de sibylle étant composé de deux mots qui signifient, en langue éolienne, les desseins des dieux. Au reste, on en compte dix, et Varron rapporte leurs noms sur la foi des auteurs qui en ont parlé : la première parut dans la Perse : Nicanor, qui a écrit l'histoire d'Alexandre, en fait mention ; la seconde, selon Euripide, dans son prologue de Lamia, était originaire de la Libye; la sibylle de Delphes, au rapport de Chrysippe, dans son Traité sur la Divination, était la troisième ; celle de Cumes était la quatrième : le poète Nævius et l'historien Pison en parlent, l'un dans son poème de la guerre de Carthage et l'autre dans ses Annales. L'Érythréenne fut la cinquième; Apollodore d'Erythrée la fait citoyenne de la même ville que lui. Ce fut elle qui, voyant partir les Grecs pour Troie, leur prédit la ruine de cette ville, et dit qu'Homère ferait un poème qu'il remplirait de fictions et de mensonges. Samos donna le nom et la naissance à la sixième ; les Annales de cette île par Ératosthène en conservent la mémoire. La Cumane, nommée Amalthée par Damophile et par Hérophile, est la septième ; cette sibylle, si célèbre dans l'histoire romaine, vivait sous le règne du premier des Tarquins; elle lui apporta un jour neuf volumes, elle lui en demanda trois cents pièces d'or. Le roi, indigné de la hardiesse de cette femme, ou étonné de sa folie, ou plutôt effrayé de la grandeur du prix qu'elle mettait à ses livres, la rebuta; mais elle, sans s'émouvoir, en brûla trois, et demanda la même somme pour les six qui restaient; Tarquin, surpris et irrité tout ensemble d'un procédé si nouveau, la traita encore plus rudement, ce qui l'obligea à en brûler trois autres. Le roi, ému de crainte, et peut-être touché de curiosité, voyant qu'elle persistait toujours à demander les trois cents pièces d'or, les lui fit compter sur l'heure, et fit mettre dans le Capitole les trois livres qui s'étaient sauvés du feu et de l'avarice de la sibylle. Leur nombre fut dans la suite beaucoup augmenté de ceux que plusieurs villes de Grèce et d'Italie envoyèrent à Rome; et on rassemblait avec soin tout ce qui portait le nom de sibyllin, ou qui paraissait en avoir le caractère. La huitième fut nommée l'Hellespontique ; elle était née dans les champs de Troie, au bourg de Marpesse, près de la ville de Gergithium; elle prophétisa sous le règne de Cyrus, et du temps de Solon, si nous en croyons Héraclide. La neuvième était de Phrygie, et publia ses prophéties à Ancyre. La dixième et dernière fut la Tiburtine; elle se nommait Albunée, et on lui avait dressé un autel sur le bord de l'Anio. On dit même que son image tenant un livre à la main fut trouvée au fond de ce fleuve, et que le sénat ordonna qu'elle fût transférée au Capitole pour y recevoir les honneurs divins. Les livres des sibylles sont entre les mains de tout le monde, hors ceux de la sibylle de Cumes, dont les Romains font un grand mystère, n'étant permis qu'aux quindécemvirs, dont nous avons parlé, de les voir et de les lire. Chacun de ces livres est appelé le Livre de la sibylle, sans que l'on puisse bien discerner de laquelle des dix chaque livre est en particulier ; la seule sibylle d'Erythrée se nomme au commencement du sien ; elle déclare que, quoiqu'elle soit née à Babylone, elle prend toutefois le nom d'Érythréenne. Elle rendit ce nom célèbre dans la suite par la noblesse de ses expressions et par la sublimité des choses qu'elle prédit ; car quoique ses autres compagnes aient publié d'une commune voix l'unité de Dieu, celle-ci le fait d'une manière plus relevée et plus digne de la majesté de celui qu'elle annonce. Voici ce qu'un auteur très exact, Fenestella, rapporte d'elle au sujet des quindécemvirs : il dit que le Capitole ayant été rebâti sous le consulat de Curion, après un incendie qui n'en avait fait que des ruines, ce premier magistrat de la république proposa au sénat d'envoyer à Erythrée quelques personnes de considération pour faire une recherche des livres de la sibylle et les faire transporter à Rome. Le sénat députa pour cet effet trois personnes de probité,[10] qui retournèrent chargés de mille vers qu'ils avaient eu soin de tirer de l'original avec beaucoup de fidélité et d'exactitude. Varron raconte la chose dans les mêmes termes. Voici donc de quelle manière cette sibylle parle de Dieu dans ses vers : Il n'y a qu'un Dieu, dont la grandeur est infinie, et l'essence incréée. Dieu est seul, infiniment élevé au-dessus des autres êtres : il a créé le ciel et les astres, la terre et les arbres qu'elle porte; la mer et les eaux qui s'y précipitent. Peuples, adorez ce Dieu, qui est un seul, rendez-lui l'honneur qui lui est dû comme au maître du monde ; il est seul de toute éternité, et il sera seul dans toute l'éternité. Une autre sibylle fait parler Dieu de cette sorte. Je suis le Dieu unique, et il n'y en a point d'autre que moi. Ces témoignages doivent suffire pour notre dessein ; mais l'occasion se présentera peut-être d'en parler encore ; et nous achèverons alors de rapporter les témoignages des autres sibylles. Au reste, puisque nous avons entrepris de défendre la vérité contre ceux qui la combattent sans la connaître, et qui fuyant la lumière de la véritable religion aiment à demeurer dans les ténèbres de celle où ils sont nés, de quelles plus fortes preuves pourrions-nous nous servir pour les détromper, que de celles que leurs propres dieux nous fourniront ? VII. Apollon, celui de leurs dieux qu'ils croient le plus éclairé et le plus savant dans la connaissance des mystères, ayant quitté Delphes pour venir demeurer à Colophon dont l'agréable séjour l'avait charmé, un jour que quelqu'un l'interrogeait touchant la véritable essence de Dieu, lui répondit ainsi: Il est né de lui-même ; il ne doit point à une mère la vie dont il jouit, ni à un maître la science qu'il possède ; nulle langue ne peut exprimer son nom : le feu est sa demeure : voilà quel est Dieu. Pour nous autres anges, nous ne sommes qu'une portion de la Divinité. Ces paroles peuvent-elles s'entendre de Jupiter ? Est-il sans mère et sans nom, et l'un et l'autre ne sont-ils pas connus ? Mercure Trismégiste, dont nous avons ci-devant rapporté le témoignage, donne encore plus d'étendue à cette réponse d'Apollon ; il ne se contente pas, comme lui, de ne point donner de mère a Dieu, il ne lui donne pas même de père, parce qu'il est lui-même son principe. Et en effet celui qui donne la vie à toutes choses, la peut-il recevoir d'un autre? C'est donc une proposition d'une éternelle vérité qu'il n'y a qu'un Dieu, qu'un Père, et qu'un Maître. Et nous croyons l'avoir jusqu'ici suffisamment prouvé, soit en y employant la force du raisonnement, soit en produisant, pour l'appuyer, une foule de témoins qui ne doivent pas être suspects à nos adversaires, puisqu'ils sont d'un même parti. Mais peut-être quelqu'un nous fera la même question que Cicéron fait faire à Hortensius. « Si Dieu est seul, de quelle félicité peut-il jouir dans une si triste solitude? » Il est vrai que Dieu est seul, mais il n'est pas vrai qu'il soit solitaire comme on se l'imagine, ni relégué, pour ainsi dire, dans le fond d'un désert. Il a sa cour, il a ses ministres que nous appelons ses anges ; et c'est la pensée d'un philosophe,[11] que nous avons allégué en un autre endroit : « Dieu, dit-il, a créé de purs esprits pour être ses ministres dans le gouvernement du monde. Mais ces ministres ne sont pas des dieux, et ne veulent passer pour tels. Ils n'ont garde d'accepter des autels, ni de demander des sacrifices. Toute leur gloire consiste dans la prompte obéissance qu'ils rendent aux ordres du Tout-Puissant. » Qu'on ne présume donc pas que ces esprits soient ces fausses divinités que le peuple adore : quoique, après tout, il nous soit fort indifférent qu'on ait cette pensée, elle ne peut avoir aucune force contre nous, puisque l'unité que nous reconnaissons en Dieu exclut toute pluralité. Qu'ils s'informent du moins, ces adorateurs des faux dieux, quel nom ils peuvent leur donner sans crime. Qu'ils sachent qu'on viole le respect qu'on doit à Dieu, lorsqu'on donne à plusieurs un nom qui ne peut être qu'à un seul ; et que ce grand Dieu ne communique à personne ni son nom ni sa puissance. Qu'ils apprennent de leur Apollon ce qu'ils doivent croire de Jupiter et des dieux qui sont moindres que lui. Il leur enseignera par son oracle, que Jupiter n'a pas plus de part à la puissance souveraine que les autres dieux à la nature divine, et que de simples esprits ne sont pas des dieux, mais les hérauts ou tout au plus les ministre du vrai Dieu. Ce n'est pas que dans cet oracle votre Apollon ne soit un imposteur lorsqu'il parle de lui-même ; car n'étant qu'un mauvais démon, il a bien l'audace de se mettre au nombre de ces bienheureuses intelligences que Dieu appelle ses anges. Il est vrai qu'il se rend quelquefois justice, ou plutôt la force de la vérité l'oblige à confesser malgré lui qu'il est un esprit impur. C'est ce qu'il fit dans cette autre réponse, qu'il rendit à ceux qui lui demandaient la manière dont il voulait être invoqué, et dans la formule de prières qu'il leur prescrivit : O vous qui savez tout, qui connaissez tout, vous qui êtes présent partout, exaucez nos vœux, ô démon. En donnant le modèle d'une autre prière qu'il veut qu'on lui adresse, il la commence par ces mots : Lucifer, qui avez formé cette belle harmonie qui unit ensemble toutes les parties de l’univers, sage démon, etc. Il se condamne donc lui-même par sa propre bouche, et demeurant d'accord qu'il est ce fameux rebelle,[12] qui dès le commencement du monde se révolta contre son créateur, il est en même temps contraint d'avouer qu'il mérite la peine qui est due à son crime. C'est ce qu'il confesse nettement dans un autre de ses oracles. Les démons qui habitent sur la terre, et ceux qui parcourent les campagnes liquides, gémissent sous la pesanteur des coups que le bras de Dieu fait tomber sur eux sans relâche. Nous traiterons dans le second livre de ces deux espèces de démons. Il nous suffit pour le moment d'indiquer que lorsqu’Apollon se veut honorer lui-même et se placer dans le ciel de sa propre autorité, il nous apprend quel nom nous devons donner à ces substances spirituelles[13] qui environnent le trône de Dieu. Que les hommes ouvrent donc enfin les yeux, qu'ils renoncent à leurs anciennes erreurs, et que sortant des ténèbres d'un culte faux et profane, ils se laissent conduire, à la faveur d'une lumière plus pure, à la connaissance de leur Dieu, de leur Père. Mais qu'ils sachent que quelque efforts que fasse l'esprit humain, quelque élévation naturelle qu'il ait, de quelque pénétration qu'il se glorifie, il se trouvera toujours accablé de la puissance de Dieu lorsqu'il en voudra mesurer l'étendue, ébloui de sa majesté s'il la veut regarder trop fixement, et arrêté tout court s'il prétend s'élever jusqu'à la connaissance de son origine. VIII. On ne peut sans doute résister à la force et à la multitude des preuves que nous venons d'alléguer, ni douter un seul moment que le monde ne soit régi par un pouvoir absolu, et par une providence infiniment éclairée, qui n'est autre chose que Dieu même. Platon, frappé de l'éclat de cette majesté, et considérant qu'elle doit être la force et la vertu qui donne le mouvement et la vie à tous les êtres, avoue, dans son Timée, que l'esprit ne saurait comprendre ni la parole exprimer tant de grandeur et de puissance. Après cela qui osera seulement penser qu'il y ait rien, je ne dis pas de difficile, mais d'impossible à Dieu, à ce Dieu qui ayant formé dans son entendement le dessein et le plan de tant d'ouvrages merveilleux, les a produits au dehors par sa puissance, et les a perfectionnés par sa parole. Sa sagesse les gouverne, son esprit y maintient l'ordre, sa bonté les conserve; et quoique nos yeux soient témoins de ces miracles, ils demeurent toujours incompréhensibles, toujours ineffables. Il ne peut être parfaitement connu que de lui même. C'est ce qui m'a souvent fait déplorer en moi-même l'aveuglement de ceux qui adorent les fausses divinités ; car enfin peut-il y avoir des hommes qui aient le cœur si étroit et l'esprit si obscurci, des hommes qui aient dégénéré de telle sorte de la noblesse de leur origine et de l'excellence de leur nature, pour se pouvoir persuader que ce qui est sorti de l'union purement naturelle d'un homme et d'une femme renferme en soi des qualités divines qui méritent leur culte et leur adoration. Qu'ils écoutent ce que la sibylle[14] chante dans ses vers, et qu'ils défèrent du moins à un oracle pour lequel ils ont tant de vénération. La divinité ne peut être formée dans le sein d'une femme, et l'homme ne saurait produire un dieu. Si cela est, comme on n'en peut douter, que deviendra la divinité d'Hercule, d'Apollon, de Bacchus, de Minerve et celle du grand Jupiter, puis qu'il est certain que tous ces dieux doivent leur naissance à l'un et à l'autre sexe? Mais qu'ya-t-il de plus éloigné de l'extrême pureté qui doit être en Dieu, que le moyen qu'il a donné aux hommes pour conserver leur espèce ? Si donc les dieux sont immortels, si l'éternité est leur partage, quel besoin ont-ils d'un autre sexe ? Est-ce pour leur donner des successeurs? Ils ne doivent jamais finir, et quand leur postérité pourra-t-elle leur succéder? C'est ce qui a introduit parmi les hommes et les animaux la nécessité de l'union entre les sexes différents ; parce que tout ce qui reçoit la vie étant sujet à la mort, chaque espèce finirait bientôt sans cette union qui la conserve, et lui procure en quelque sorte l'immortalité. « Je conviens, dira quelqu'un, que Dieu n'a pas besoin d'un autre sexe pour avoir des fils qui lui succèdent ; mais qu'il s'en serve du moins pour se faire des sujets, ou pour augmenter le nombre de ses ministres; » comme si Dieu, dont la puissance ne peut être bornée, ne pouvait sans ce secours produire autant de créatures qu'il le jugera nécessaire pour sa gloire et pour son service. Car s'il a bien voulu accorder à des insectes le privilège de pouvoir se former une postérité du suc de quelques herbes odoriférantes et du plus pur sang des fleurs, qui osera nier qu'il ait le pouvoir de peupler le monde de nouvelles créatures, sans avoir recours à un moyen si peu digne de la simplicité de sa nature? Que les hommes ne soient donc plus si insensés que de rendre à leurs semblables un culte qui n'est dû qu'à Dieu. Mais on voudra peut-être savoir ce qui a rempli le monde de tant de divinités, ce qui a obligé les peuples à élever des autels en tant de lieux : c'est l'amour qu'ils ont eu pour leurs princes ; c'est cet amour qui leur a mis l'encensoir à la main. Ils ont cru ne pouvoir rendre à la mémoire de leurs rois ce qu'ils croyaient leur devoir, soit à cause de leurs vertus, soit pour la découverte de quelques arts utiles à la vie civile ou naturelle, soit enfin pour reconnaître les bienfaits qu'ils en avaient reçus, qu'en leur rendant après leur mort les honneurs divins. Il ne faut qu'ouvrir les historiens et les poètes pour être d'abord convaincu de cette vérité. IX. Mais entrons dans les détails, et examinons les mœurs, la conduite et la vie de ces hommes dont la superstition a fait des dieux. Commençons par Hercule ; l'innocence opprimée et la vertu malheureuse n'eurent jamais un protecteur plus zélé. Il passe lui-même pour un modèle achevé des vertus héroïques, et il est parmi les dieux ce que fut autrefois parmi les Romains l'illustre Africain.[15] Cependant lorsqu'il parcourait la terre pour la purger des monstres qui l'infestaient, il la remplissait de monstruosités plus horribles, et on le suivait moins à la trace de ses victoires qu'à la suite de ses adultères et de ses incestes. Mais doit-on s'en étonner; il était lui-même le fruit d'un double adultère.[16] Que pouvait-il y avoir de divin dans ce fils d'Alcmène, qui, devenu l'esclave des passions les plus honteuses, n'épargnait ni condition ni sexe, et qui allumant partout un feu impur, violait de toutes les manières les lois de la nature les plus inviolables. Et, à bien considérer ces fameux travaux qui l'ont rendu si célèbre, on ne voit pas que pour en venir à bout il ait eu besoin de la divinité. Combattre un lion, faire perdre la vie à un sanglier, percer des oiseaux à coups de flèches, nettoyer une étable, surmonter la résistance d'une fille et lui enlever sa ceinture, mettre en pièces des chevaux accoutumés au sang et au carnage avec leur barbare conducteur; qu'y a-t-il après tout en cela de si grand, de si digne d'admiration? Ce sont, à la vérité, des exploits signalés, mais ce sont des exploits d'un homme. Et s'il a remporté plus d'une victoire, c'a été sur des ennemis qui n'étaient ni immortels ni invincibles. Car, comme dit l'orateur romain : « quelle est la valeur qui puisse résistera la violence du fer et aux forces d'un athlète? Mais de réprimer la fougue de la colère, et d'apaiser les saillies d'un esprit emporté, ce sont là les hauts faits d'un véritable héros ; » et c'est cette bravoure qui a été inconnue à Hercule. Qu'on me donne un héros de ce caractère; je ne le mettrai pas seulement au-dessus des hommes, je le placerai sur un même trône avec Dieu. Et qui doute qu'il n'y ait beaucoup moins de gloire à terrasser un lion ou un sanglier, qu'à surmonter sa colère, qui est une bête incomparablement plus difficile à apprivoiser ; que les harpies, ces oiseaux insatiables, ne soient plus faciles à chasser que l'avarice et l'ambition, passions toujours avides d'honneurs et de richesses ; qu'il ne soit plus aisé de désarmer une Amazone, que d'ôter à l'impureté les armes dont elle se sert pour triompher de la pudeur; et que ce ne soit enfin un travail moins pénible de vider une étable où l'on renferme tous les jours dix mille bœufs, que de nettoyer une âme que les vices remplissent d'ordure. Il n'y a donc que celui qui aime la justice, et qui sait vaincre par sa modération les passions les moins soumises à la raison, qui mérite le nom de héros, et qui ait droit de prétendre à la gloire, l'unique récompense de la vertu. Si l'on comprenait bien quelles doivent être les actions d'un Dieu, de quel caractère de grandeur elles doivent être marquées, combien elles doivent être épurées; avec quel mépris, ou plutôt avec quelle horreur, ne regarderait-on pas celles que l'on publie de ces prétendues divinités, et qui font le sujet de l'admiration des petits esprits ? Elles leur paraissent grandes et relevées, non qu'ils les mesurent par la force et la vertu qui est en Dieu, mais par la faiblesse de l'impuissance qui est en eux. Mais peuvent-ils nier que ce fils du grand Jupiter n'ait été réduit à la plus honteuse de toutes les servitudes. Je ne parle point des services qu'il rendit à Eurysthée, il pouvait en cela avoir quelque motif honnête ; mais comment ceux qui l'adorent ne rougissent-ils point, lorsqu'ils le voient aux pieds d'Omphale, revêtu d'une robe de femme au lieu de sa peau de lion, et portant une quenouille à la place de cette massue formidable, l'instrument de ses victoires et la compagne de ses travaux? O turpitude ! ô infamie ! mais la gloire ne lui est plus rien, quand la volupté se présente. Et ce n'est ni un Lucilius ni un Lucien, gens qui ne pardonnent ni à hommes ni à dieux, ce n'est, dis-je, ni ce poète satyrique, ni ce piquant sophiste qui ont ainsi parlé du grand Alcide;[17] ce sont ceux-là mêmes qui chantent les hymnes à son honneur, ce sont ses plus dévots adorateurs. Et à qui ajouterons-nous créance, si nous la leur refusons ? Que si contre toute apparence on les soupçonne de ne pas dire la vérité, qu'on nous produise des auteurs qu'on croie irréprochables, qui nous informent de l'origine de ces dieux, de leur naissance, de leur nombre, de leur pouvoir ; qui nous apprennent quelles vertus nous devons révérer en eux, quelles actions éclatantes nous y devons admirer, quels mystères la religion nous y propose à adorer; mais ces auteurs ne se trouveront point. Croyons-en donc ceux qui, bien loin d'avoir eu la pensée de ternir la mémoire de leurs dieux par l'histoire qu'ils nous en ont laissée, n'ont eu au contraire intention que de leur attirer par là le culte et le respect des hommes. Ce sont donc des faits constants qu'Hercule s'embarqua avec les Argonautes, et qu'il alla mettre le siège devant Troie, irrité de ce que le roi Laomédon avait refusé de lui payer son salaire pour avoir rendu la santé à la princesse sa fille : ce qui nous apprend que ce dieu était ou un habile médecin qui guérissait par des remèdes naturels, ou plutôt un savant magicien qui employait pour guérir des secrets inconnus à la nature. Et ce siège de Troie nous peut encore servir d'une époque certaine pour savoir le temps auquel il a vécu. Enfin, pour achever le récit d'une si belle vie, étant saisi de fureur, il déchira de ses propres mains sa femme et ses enfants. Les peuples en firent un dieu : mais son ami Philoctète, qui fut aussi son unique héritier, en jugea sans doute autrement. Car ce fut lui qui mit le feu au bûcher où Hercule se jeta ; il vit brûler son corps, et il recueillit ses cendres, qu'il renferma dans un tombeau sur le mont Œta. Et pour se récompenser lui-même de cet office de piété, il emporta son carquois et ses flèches. X. Le dieu Esculape doit la vie à un crime d'Apollon son père, et sa divinité à la guérison d'Hippolyte. Mais sa mort lui fut véritablement glorieuse, puisqu'il la reçut de la main de Dieu même qui le tua d'un coup de foudre. Tarquitius, qui a écrit la vie des hommes illustres, dit de lui qu'il a eu une naissance incertaine, et qu'ayant été trouvé dans un bois par des chasseurs, une chienne le nourrit de son lait ; qu'il fut ensuite donné à Chiron, qui lui apprit la médecine ; qu'au reste on le croit originaire de Misène, quoiqu'il ait passé la plus grande partie de sa vie à Épidaure, et que son tombeau se voie à Cynosure.[18] Et que dirons-nous d'Apollon son père, sinon que, poussé par un désir amoureux, il se loua au roi Admète pour garder ses troupeaux, et ensuite à Laomédon pour bâtir les murs de sa ville capitale;[19] mais ce prince lui retint son salaire, et commença par lui à se moquer des traités qu'il faisait avec les dieux. La passion qu'Apollon eut pour Hyacinthe ne fut pas moins funeste à lui-même et à ce beau garçon qu'elle était criminelle: il l'aime, et il en abuse: il joue avec lui, et il lui donne la mort.[20] Mars, fameux par ses homicides, fut absous par le peuple d'Athènes, et arraché au supplice qu'il avait mérité. Mais pour ne pas paraître aimer toujours le sang, et pour adoucir sa férocité naturelle, il se mit à faire l'amour avec Vénus. Castor, et son frère Pollux, sans aucun égard pour les droits sacrés de l'hospitalité, enlevèrent les femmes de leurs hôtes. Mais Idas, outré de l'injure qu'il avait reçue de l'un de ces deux gémeaux, la vengea dans son sang. Les poètes nous disent que celui qui restait voulut partager avec son frère sa triste destinée, et que l'un et l'autre vit et meurt tour à tour; en cela les plus infortunés non seulement des dieux, mais aussi des hommes, de ne pouvoir ni vivre ni mourir.[21] Cependant Homère reconnaît de bonne foi (ce qui n'est pas ordinaire aux gens de son métier) que tous deux sont morts. Car introduisant Hélène assise auprès de Priam sur les murs de Troie durant une trêve, et repassant tous les princes grecs qui étaient venus au siège de cette ville, comme elle cherche des yeux ses deux frères,[22] le poète l'avertit que sa recherche est vaine, et que la terre tient leurs corps enfermés dans son sein. Quelle réputation Mercure a-t-il laissée après lui, sinon d'avoir su parfaitement l'art de tromper? Et tout ce qu'il pouvait espérer de l'équité publique, c'était de recevoir d'elle le titre de dieu des larrons. Cependant on lui a donné une place dans le ciel, pour avoir enseigné aux hommes le jeu de l'escrime et celui de la lutte. Pour le père Liber[23] tous les dieux lui doivent déférer la place la plus honorable dans leurs assemblées ; car si l'on en excepte Jupiter, il a eu seul l'honneur de commander une armée, et de la ramener victorieuse après avoir conquis plusieurs royaumes.[24] Mais par malheur ce vainqueur des Indiens se laissa honteusement vaincre par la volupté ; car ayant abordé à l'île de Naxos, accompagné d'une troupe infâme d'eunuques, il trouva sur le rivage la détestable Ariane; et la crainte qu'il eut qu'elle ne le prit pour un de ces demi-hommes qui le suivaient, le fit résoudre à l'épouser, quoiqu'elle eût encore les mains souillées du sang de son frère, et de la trahison qu'elle venait de commettre contre son père : il la fit monter ensuite dans le ciel, et il ne rougit point de placer parmi les étoiles[25] les restes impurs de l'amour de Thésée. Enfin, pour remonter jusqu'au maître de tous les dieux, le très bon, le très grand, le très puissant Jupiter, ainsi qu'il est nommé dans une prière solennelle, ne donna-t-il pas dès ses premières années des marques d'une impiété consommée ? Il ébaucha même, si l'on ose se servir de ce terme, un parricide, et sans vouloir attendre que la mort le mit en possession du trône de son père, il l'en fit descendre par force, et le contraignit de sortir de son propre royaume, et de chercher dans une extrême vieillesse un asile contre l'ambition sacrilège de son fils: c'est ce qui lui attira sur les bras les armes des Titans, et sur la terre un déluge de maux. Enfin, ayant obtenu la victoire sur ces fiers ennemis, et donné la paix au monde, il passa le reste de sa vie dans les désordres les plus honteux. Car sans parler d'un très grand nombre de filles, dont il corrompit l'innocence, peut-on voir, sans indignation, le lit d'Amphitryon violé, et la maison de Tindare couverte d'un opprobre éternel par l'incontinence de ce souverain des dieux. Mais ce qui fit rougir la nature, et ce qui devait intéresser tous les rois dans un même ressentiment, fut lorsqu'on vit sa passion furieuse et brutale monter sur le trône, et arracher un enfant royal[26] d'entre les bras de son père, pour le faire servir à ses infâmes plaisirs. C'était peu pour lui d'avoir déshonoré tout un sexe, s'il n'achevait de déshonorer toute la nature, en rendant son propre sexe complice de ses horribles excès. Si celui qui a commis tant de crimes est très grand, du moins il faut avouer qu'il n'est pas très bon : on ne mérita jamais ce nom par l'inceste et l'adultère. Mais peut-être que les dieux ont là-dessus des lumières que nous n'avons pas ? peut-être que nous sommes dans l'erreur nous autres hommes, et que nos lois ont tort de punir des crimes que les dieux justifient? Le sage Cicéron était sans doute aussi dans l'erreur, lorsqu'il reprochait à Verrès un adultère qu'il adorait dans son Jupiter. Et comment osait-il accuser Claudius d'inceste, à la vue de ce dieu très bon et très grand, dont la femme est la même que la sœur[27] ?
|
|
CAPUT XI. De Jovis ortu, vita, regno, nomine et morte, et de Saturno et Urano. Quis est igitur tam excors, qui hunc in coelo regnare putet, qui ne in terra quidem debuit? Non insulse quidam poeta triumphum Cupidinis scripsit: quo in libro non modo potentissimum deorum Cupidinem, sed etiam victorem facit. Enumeratis enim amoribus singulorum, quibus in potestatem Cupidinis ditionemque venissent, instruit pompam, in qua Jupiter cum caeteris diis ante currum triumphantis ducitur catenatus. Eleganter id quidem a poeta figuratum: sed tamen non multum distat a vero. Qui enim virtutis est expers, qui a cupiditate ac libidinibus malis vincitur, non Cupidini (ut ille finxit), sed morti subjectus est sempiternae. Sed omittamus de moribus dicere: rem confideremus; ut intelligant homines, in quibus miseri versentur erroribus. Regnare in coelo Jovem vulgus existimat: id et doctis pariter et indoctis persuasum est. Quod et Religio ipsa, et precationes, et hymni, et delubra, et simulacra demonstrant. Eumdem tamen Saturno et Rhea genitum confitentur. Quomodo potest Deus videri, aut credi (ut ait poeta): . . . . . . . Hominum rerumque repertor, ante cujus ortum infinita hominum millia fuerunt? eorum scilicet, qui Saturno regnante vixerunt; ac priores luce, quam Jupiter, sunt potiti. Video alium Deum regem fuisse primis temporibus, alium consequentibus. Potest ergo fieri, ut alius sit postea futurus. Si enim regnum prius mutatum est: cur desperemus etiam posterius posse mutari? nisi forte Saturnus generare potuit fortiorem: Jupiter non potest. Atqui divinum imperium aut semper immutabile est: aut, si est mutabile, quod fieri non potest, semper utique mutabile est. Potest ergo Jupiter regnum amittere, sicut pater ejus amisit? Ita plane. Nam cum idem neque virginibus, neque maritatis unquam pepercisset, abstinuit se tamen una Thetide, quod responsum fuit, majorem patre suo futurum, quisquis ex illa natus esset. Et primum imprudentia in eo non Dei, cui nisi Themis futura dixisset, ipse nesciret. Si autem divinus non sit, ne Deus quidem sit; unde ipsa divinitas nominatur, ut ab homine humanitas. Deinde conscientia imbecillitatis, qui timuit utique majorem: quod qui facit, scit profecto non esse se maximum: quondoquidem potest aliquid majus existere. Idem per Stygiam paludem sanctissime jurat. Vana superstitio, superis quae reddita divis. Quae est ista superstitio? aut a quo reddita? Est ergo aliqua potestas maxima, quae pejerantes deos puniat? quae tanta formido est paludis infernae, si sunt immortales? quid metuunt eam, quam visuri non sunt, nisi quos mori necesse est? Quid igitur homines oculos suos in coelum tollunt? quid per superos dejerant, cum ipsi superi ad inferos revolvantur, ibique habeant quod venerentur et adorent? Illud vero quale est? esse fata, quibus dii omnes, et ipse Jupiter pareat. Si Parcarum tanta vis est, ut plus possint quam coelestes universi, quamque ipse rector ac dominus, cur non illae potius regnare dicantur, quarum legibus ac statutis parere omnes deos necessitas cogit? Nunc cui dubium est, quin is, qui alicui rei obsequitur, maximus non sit? nam si sit, non accipiat fata, sed faciat. Nunc ad aliud, quod omiseram, redeo. In una itaque sola fuit continentior, cum eam deperiret; non virtute aliqua, sed metu successoris. Quae formido utique ejus est, qui sit et mortalis, et imbecillus, et nihili: quippe qui potuit et tunc, cum nasceretur, extingui, sicut frater ejus ante genitus, extinctus est: qui si vivere potuisset, nunquam minori concessisset imperium. Ipse autem furto servatus, furtimque nutritus, ζεὺς sive ζῆν appellatus est; non, ut isti putant, a fervore coelestis ignis, vel quod vitae sit dator, vel quod animantibus inspiret animas, quae virtus solius Dei est (quam enim possit inspirare animam, qui ipse accepit aliunde?), sed quod primus ex liberis Saturni maribus vixerit. Potuerunt igitur homines alium deum habere rectorem, si Saturnus non fuisset ab uxore delusus. At enim poetae ista finxerunt. Errat quisquis hoc putat. Illi enim de hominibus loquebantur; sed ut eos ornarent, quorum memoriam laudibus celebrabant, deos esse dixerunt. Itaque illa potius ficta sunt, quae tamquam de diis, non illa quae tamquam de hominibus locuti sunt: quod clarum fiet exemplo, quod inferemus. Danaen violaturus, aureos nummos largiter in sinum ejus infudit. Haec stupri merces fuit. At poetae, qui quasi de Deo loquebantur, ne auctoritatem creditae majestatis infringerent, finxerunt ipsum in aureo imbre delapsum, eadem figura, qua imbres ferreos dicunt, cum multitudinem telorum sagittarumque describunt. Rapuisse dicitur in aquila Catamitum: poeticus color est. Sed aut per legionem rapuit, cujus insigne aquila est; aut navis, in qua est impositus, tutelam habuit in aquila figuratam, sicut taurum, cum rapuit et transvexit Europam. Eodem modo convertisse in bovem traditur Io Inachi filiam, quae, ut iram Junonis effugeret, ut erat jam setis obsita, jam bos tranasse dicitur mare, in Aegyptumque venisse, atque ibi, recepta pristina specie, dea facta quae nunc Isis vocatur. Quo igitur argumento probari potest, nec Europam in Tauro sedisse, nec Io factam bovem? Quod certus dies habetur in Fastis, quo Isidis navigium celebratur: quae res docet non tranasse illam, sed navigasse. Igitur qui sapere sibi videntur, quia intelligunt vivum terrenumque corpus in coelo esse non posse, totam Ganymedeam fabulam pro falso repudiant; ac sentiunt in terra id esse factum, quia res ac libido ipsa terrena est. Non ergo ipsas res gestas finxerunt poetae; quod si facerent, essent vanissimi: sed rebus gestis addiderunt quemdam colorem. Non enim obtrectantes illa dicebant, sed ornare cupientes. Hinc homines decipiuntur: maxime quod, dum haec omnia ficta esse arbitrantur a poetis, colunt quod ignorant. Nesciunt enim, qui sit poeticae licentiae modus; quousque progredi fingendo liceat: cum officium poetae sit in eo, ut ea, quae gesta sunt vere, in alias species obliquis figurationibus cum decore aliquo conversa traducat. Totum autem, quod referas, fingere, id est ineptum esse, et mendacem potius quam poetam. Sed finxerint ista, quae fabulosa creduntur; num etiam illa, quae de diis foeminis, deorumque connubiis dicta sunt? Cur igitur sic figurantur, sic coluntur? nisi forte non tantum poetae, sed pictores etiam fictoresque imaginum mentiuntur. Si enim hic est Jupiter, qui a vobis dicitur deus, si non is est, qui ex Saturno et Ope natus est, non oportuit nisi solius simulacrum in templis omnibus collocari. Quid sibi mulierum effigies volunt? quid sexus infirmus? in quem si cecidit hic Jupiter, eum vero ipsi lapides hominem fatebuntur. Mentitos aiunt esse poetas, et his tamen credunt; immo vero non esse mentitos, re ipsa probant, ita enim deorum simulacra confingunt, ut ex ipsa diversitate sexus appareat, vera esse quae dicunt poetae. Nam quod aliud argumentum habet imago Catamiti, et effigies aquilae, cum ante pedes Jovis ponuntur in templis, et cum ipso pariter adorantur: nisi ut nefandi sceleris ac stupri memoria maneat in aeternum? Nihil igitur a poetis in totum fictum est: aliquid fortasse traductum, et obliqua figuratione obscuratum, quo veritas involuta tegeretur; sicut illud de sortitione regnorum. Aiunt enim Jovi coelum obtigisse, Neptuno mare, inferna Plutoni. Cur non terra potius in sortem tertiam venit; nisi quod in terra gesta res est. Ergo illud in vero est, quod regnum orbis ita partiti sortitique sunt, ut Orientis imperium Jovi cederet; Plutoni, cui cognomen Agesilao fuit, pars Occidentis obtingeret: eo quod plaga Orientis, ex qua lux mortalibus datur, superior; Occidentis autem inferior esse videatur. Sic veritatem mendacio velaverunt, ut veritas ipsa persuasioni publicae nihil derogaret. De Neptunii sorte manifestum est, cujus regnum tale fuisse dicimus, quale Marci Antonii fuit infinitum illud imperium; cui totius orae maritimae potestatem Senatus decreverat, ut praedones persequeretur, ac mare omne pacaret. Sic Neptuno maritima omnia cum insulis obvenerunt. Quomodo id probari potest? Nimirum veteres historiae docent. Antiquus auctor Euhemerus, qui fuit ex civitate Messene, res gestas Jovis, et caeterorum qui dii putantur, collegit, historiamque contexuit ex titulis, et inscriptionibus sacris, quae in antiquissimis templis habebantur, maximeque in fano Jovis Triphylii; ubi auream columnam positam esse ab ipso Jove titulus indicabat, in qua columna gesta sua perscripsit, ut monumentum esset posteris rerum suarum. Hanc historiam et intepretatus est Ennius, et secutus; cujus haec verba sunt: « Ubi Jupiter Neptuno imperium dat maris, ut in insulis omnibus et quae secundum mare loca essent, omnibus regnaret. » Vera sunt ergo quae loquuntur poetae, sed obtentu aliquo specieque velata. Potest et mons Olympus figuram poetis dedisse, ut Jovem dicerent coeli regnum esse sortitum; quod Olympus ambiguum nomen est et montis, et coeli. In Olympo autem Jovem habitasse docet historia eadem, quae dicit: « Ea tempestate Jupiter in monte Olympo maximam partem vitae colebat, et eo ad eum in jus veniebant, si quae res in controversia erant. Item, si quis quid novi invenerat, quod ad vitam humanam utile esset, eo veniebat, atque Jovi ostendebat. » Multa in hunc modum poetae transferunt, non ut in eos mentiantur quos colunt, sed ut figuris versicoloribus venustatem ac leporem carminibus suis addant. Qui autem non intelligunt, quomodo aut quare quidque figuretur, poetas velut mendaces et sacrilegos insequuntur. Hoc errore decepti etiam philosophi, quod ea, quae de Jove feruntur, minime in Deum convenire videbantur, duos Joves fecerunt, unum naturalem, alterum fabulosum. Viderunt ex parte, quod erat verum, eum scilicet, de quo poetae loquuntur hominem fuisse: in illo autem naturali Jove, vulgari consuetudine religionis inducti, erraverunt, quod in Deum nomen hominis transtulerunt; qui (ut supra diximus) quia solus est, non indiget nomine. Jovem autem illum esse, qui sit ex Ope Saturnoque natus, negari non potest. Vana igitur persuasio est eorum, qui nomen Jovis summo Deo tribuunt. Solent enim quidam errores suos hac excusatione defendere; qui convicti de uno Deo, cum id negare non possunt, ipsum se colere affirmant, verum hoc sibi placere, ut Jupiter nominetur: quo quid absurdius? Jupiter enim sine contubernio conjugis filiaeque coli non solet. Unde quid sit, apparet: nec fas est id nomen eo transferri, ubi nec Minerva est ulla, nec Juno. Quid? quod hujus nominis proprietas non divinam vim exprimit, sed humanam? Jovem enim, Junonemque a juvando esse dictos, Cicero interpretatur. Et Jupiter, quasi Juvans pater dicitur; quod nomen in Deum minime congruit; quia juvare hominis est, opis aliquid conferentis in eum, qui sit alienus, et exigui beneficii. Nemo sic Deum precatur, ut se adjuvet; sed ut servet, ut vitam salutemque tribuat: quod multo plus ac majus est quam juvare. Et quoniam de patre loquimur, nullus pater dicitur filios juvare, cum eos generat, aut educat. Illud enim levius est, quam ut eo verbo magnitudo paterni beneficii exprimatur. Quanto id magis inconveniens est Deo, qui verus est pater; per quem sumus, et cujus toti sumus, a quo fingimur, animamur, illuminamur; qui nobis vitam impertit, salutem tribuit, victum multiplicem subministrat. Non intelligit beneficia divina, qui se juvari tantummodo a Deo putat. Ergo non imperitus modo, sed etiam impius est, qui nomine Jovis virtutem summae potestatis imminuit. Quare si Jovem et ex rebus gestis et ex moribus hominem fuisse, in terraque regnasse deprehendimus, superest ut mortem quoque ejus investigemus. Ennius in sacra Historia, descriptis omnibus quae in vita sua gessit, ad ultimum sic ait: Deinde Jupiter, postquam quinquies terras circuivit, omnibusque amicis atque cognatis suis imperia divisit, reliquitque hominibus leges, mores frumentaque paravit, multaque alia bona fecit, immortali gloria, memoriaque affectus, sempiterna monimenta suis reliquit: aetate pessum acta, in Creta vitam commutavit, et ad deos abiit, eumque Curetes filii sui curaverunt, decoraveruntque eum; et sepulcrum ejus est in Creta et in oppido Cnosso, et dicitur Vesta hanc urbem creavisse; inque sepulcro ejus est inscriptum antiquis litteris graecis, id est latine, Jupiter Saturni. Hoc certe non poetae tradunt, sed antiquarum rerum scriptores: quae adeo vera sunt, ut ea sybillinis versibus confirmentur; qui sunt tales:
Δαίμονας ἀψύχους νεκύων εἴδωλα καμόντων, Cicero de Natura deorum, cum tres Joves a theologis enumerari diceret, ait tertium fuisse Cretensem, Saturni filium, cujus in illa insula sepulcrum ostenditur. Quomodo igitur potest deus alibi esse vivus alibi mortuus, alibi habere templum, alibi sepulcrum? Sciant ergo Romani, Capitolium suum, id est summum caput religionum publicarum, nihil esse aliud quam inane monimentum. Veniamus nunc ad ejus patrem, qui ante regnavit, et qui fortasse plus habebat in se, quod ex coitu tantorum elementorum genitus esse dicatur. Videamus quid in eo fuerit deo dignum: in primis illud, quod aureum saeculum narratur habuisse; quod justitia sub eo fuerit in terra. Teneo aliquid in hoc, quod in ejus filio non fuit. Quid enim tam conveniens deo, quam justum regimen, ac pium saeculum? Sed cum eadem ratione natum esse cogito, non possum putare Deum summum, quo videam esse aliquid antiquius, coelum scilicet atque terram. At ego Deum quaero, ultra quem nihil sit omnino, qui fons, et origo sit rerum. Hic sit necesse est, qui coelum ipsum condidit, terramque fundavit. Saturnus autem si ex his natus est (ut putatur) quemadmodum potest Deus esse principalis, qui aliis ortum suum debet? aut quis praefuit mundo, priusquam Saturnus gigneretur? Sed hoc poeticum est (ut dicebam paulo ante) figmentum. Nec enim fieri poterat, ut elementa insensibilia, tantoque intervallo separata, in unum coirent ac filium procrearent: aut is, qui natus esset, non potissimum genitoribus similis existeret; sed eam formam gereret, quam parentes sui non habebant. Quaeramus ergo quid veritatis sub hac figura lateat. Minucius Felix in eo libro, qui Octavius inscribitur, sic argumentatus est: « Saturnum, cum fugatus esset a filio in Italiamque venisset, Coeli filium dictum, quod soleamus eos quorum virtutem miremur, aut qui repentino advenerint, de coelo cecidisse dicere; terrae autem, quod ignotis parentibus natos, terrae filios nominemus. » Sunt haec quidem similia veri, non tamen vera: quia constat etiam tunc cum regnaret ita esse habitum. Potuit et sic argumentari: Saturnum, cum potentissimus rex esset, ad retinendam parentum suorum memoriam, nomina eorum coelo terraeque indidisse, cum haec prius aliis vocabulis appellarentur; qua ratione et montibus et fluminibus nomina scimus imposita. Neque enim cum dicunt poetae de progenie Atlantis, aut Inachi fluminis, id potissimum dicunt, homines ex rebus sensu carentibus potuisse generari; sed eos utique significant, qui nati sunt ex his hominibus, qui vel vivi, vel mortui, nomina montibus aut fluminibus indiderunt. Nam id apud veteres, maximeque Graecos, fuit usitatum. Sic maria eorum traxisse nomina accepimus, qui deciderant in ea, ut Aegeum, Icarium, Hellesponticum: et in Latio Aventinus, vocabulum monti dedit, in quo sepultus est; Tiberinus vel Tiberis, amni in quo mersus est. Non ergo mirandum, si nomina eorum coelo terraeque attributa essent, qui reges genuerant potentissimos. Apparet ergo non ex coelo natum esse; quod fieri non potest: sed ex eo homine, cui nomen Urano fuit. Quod esse verum Trismegistus auctor est: qui cum diceret admodum paucos extitisse in quibus esset perfecta doctrina, in his Uranum, Saturnum, Mercurium cognatos suos nominavit. Haec ille quia ignoravit, alio traduxit historiam; qui quomodo potuerit argumentari, ostendi: nunc dicam, quomodo, ubi, a quo sit hoc factum; non enim Saturnus hoc, sed Jupiter fecit. In sacra Historia sic Ennius tradit: « Deinde Pan eum deducit in montem, qui vocatur coeli stela. Postquam eo ascendit, contemplatus est late terras, ibique eo in monte aram creat coelo; primusque in ea ara Jupiter sacrificavit: in eo loco suspexit in coelum quod nunc nos nominamus, idque quod supra mundum erat, quod aether vocabatur, de sui avi nomine coelo nomen indidit: idque Jupiter, quod aether vocatur, precans, primum coelum nominavit; eamque hostiam, quam ibi sacravit, totam adolevit. » Nec hic tantum sacrificasse Jupiter invenitur. Caesar quoque in Arato refert Aglaosthenem dicere, Jovem cum ex insula Naxo adversus Titanas proficisceretur, et sacrificium faceret in littore, aquilam ei in auspicium advolasse; quam victor bono omine acceptam tutelae suae subjugarit. Sacra vero Historia ( scilicet Ennii ) etiam ante consedisse illi aquilam in capite, atque illi regnum portendisse, testatur. Cui ergo sacrificare Jupiter potuit, nisi coelo avo? quem dicit Euhemerus in Oceania mortuum, et in oppido Aulacia sepultum. |
XI. Et l'on pourra croire que celui-là règne dans le ciel, qui ne mérite pas même de régner sur la terre. Un poète grec nous a laissé une fable ingénieuse, où il décrit d'une manière fort agréable le triomphe de l'amour.[28] Car après avoir fait le détail de toutes les victoires qu'il a remportées sur tous les dieux et Jupiter en particulier, il le représente sur un char, enchaîné, qui marche devant le vainqueur, suivi de tous les dieux chargés de fers comme lui. Ce n'est qu'une fiction, mais on peut dire qu'elle approche fort de la vérité ; car tout homme qui renonce à la vertu, et qui se laisse vaincre par une passion criminelle, devient l'esclave infortuné, non de Cupidon, comme feint notre poète, mais de la mort éternelle. Mais laissons là la moralité, et développons ce mystère d'iniquité et d'horreur; ôtons enfin le voile à la superstition, et que les hommes frémissent à la vue de l'état déplorable, où une malheureuse prévention les a retenus jusqu'ici. C'est une créance commune et universellement répandue parmi les hommes, que Jupiter règne dans le ciel, et les sages semblent être en cela d'accord avec le peuple. Tout contribue à former ce préjugé dans les esprits : les temples, les images, les hymnes, les prières, enfin tout le culte extérieur de la religion. Cependant on convient qu'il est fils de Saturne et de Rhéa. Comment concilier une chose si opposée? Et comment peut-il avoir créé les hommes, s'il y a eu des milliers d'hommes avant lui. Du moins ne peut-on nier que ceux qui vivaient sous le règne de son père ne l'aient précédé dans le monde. On voit un dieu qui règne dans les premiers siècles; on en voit un autre qui dans les siècles suivants lui succède : il se peut donc faire qu'un troisième vienne encore après celui-ci; et si le monde a pu changer de maître, on peut raisonnablement présumer qu'il en peut encore changer. Dira-t-on que Saturne a bien pu avoir un fils plus grand que lui, mais que la même chose ne saurait arriver à Jupiter: pourquoi? Si ce beau royaume a bien pu passer du père au fils, quel inconvénient trouve-t-on à croire qu'il ne puisse passer du fils à son successeur ? Si Saturne a vu tomber sa couronne sur la tête de Jupiter, quel privilège aura celui-ci de conserver toujours la sienne ? Que dis-je, il l'aurait déjà perdue, si le désir de régner n'eût été plus fort en lui que n'était l'amour. On sait à quel excès cette passion l'a si souvent porté, qu'il n'a respecté ni l'état de la virginité, ni celui du mariage: déesses ou mortelles; libres ou esclaves ; sur le trône ou dans une cabane : tout a eu le don de lui plaire, tout a ressenti les effets de cette furieuse passion. La seule Thétis[29] fut assez heureuse pour s'en garantir; un oracle rendu à propos la mit à couvert de cet horrible débordement. Cet oracle portait que le fils qui naîtrait de l'un et de l'autre détrônerait son père. La menace était forte; elle ralentit l'amour du dieu et sauva l'honneur de la déesse. Si Thémis ne l'eût charitablement averti par cet oracle de ce qui lui arriverait, s'il contentait sa passion, il allait sottement s'ôter lui-même le sceptre de la main ; il se donnait un successeur à l'empire de l'univers, et il vengeait, sans y penser, son père Saturne. Mais quel besoin avait-il qu'un autre lui révélât l'avenir, qu'était devenue sa prescience ; quel dieu ! qui ne saurait prévoir sa destinée! outre qu'il parut en cette rencontre se défier de lui-même. S'il eût cru être le plus grand et le plus puissant des dieux, aurait-il appréhendé d'en mettre au monde un plus puissant que lui? C'est une chose encore assez plaisante de l'entendre jurer par le Styx. Les dieux, dit un poète, observent en cela une superstition vaine et ridicule, qu'ils ont reçue par une espèce de tradition. Mais de qui l’ont-ils reçue? Il y a donc une puissance supérieure, qui punit le parjure dans les dieux. Mais s'ils sont immortels, qu'ont-ils à craindre? Il n'y a que de pauvres mortels qui doivent appréhender la vue de ces eaux infernales. O hommes ! pourquoi levez-vous les yeux au ciel, pour prendre les dieux à témoin de vos serments ? Ne voyez-vous pas ces mêmes dieux, qui, pour confirmer les leurs, s'abaissent jusqu'aux enfers, et y trouvent un objet de vénération et de crainte. Ce sont les Destinées auxquelles tous les dieux obéissent, et Jupiter lui-même. Si donc les Parques[30] sont plus puissantes que tous les dieux ensemble, pourquoi reconnaissons-nous un pouvoir limité, et que ne nous soumettons-nous plutôt a une puissance souveraine et absolue que les dieux sont forcés de reconnaître? Car qui doute que qui se soumet à la loi ne soit inférieur à celui qui donne la loi? Celui-là seul est tout-puissant qui fait la destinée, et ne lui obéit pas. Revenons maintenant à ce que nous n'avons fait que toucher en passant. Il est certain que Jupiter aimait passionnément Thétis; mais il fallut se contraindre, il fallut se priver d'un plaisir qui devait lui coûter si cher, et la crainte le rendit chaste, ce que jusque alors la vertu n'avait pu faire. Mais avouons que cette crainte est moins d'un dieu que d'un homme mortel, d'un homme faible, d'un homme qui a toujours présent le souvenir du péril qu'il a couru autrefois de perdre la vie au moment où il la recevait, et d'être enveloppé dans la même infortune que son frère,[31] qui sans doute ne lui aurait pas cédé l'empire s'il eût vécu. Pour lui, on sait qu'il se sauva heureusement des dents meurtrières de son père, encore toutes teintes du sang de ses frères; on sait qu'il fut élevé en secret par de certains solitaires du mont Ida,[32] qui lui donnèrent un nom qui exprime également le feu et la vie : non qu'il soit animé d'un feu céleste et divin, ni encore moins que ce soit lui qui donne la vie à tout ce qui respire, ce qui n'appartient qu'à Dieu seul, mais à cause qu'il fut le premier des fils de Saturne à qui le destin conserva la vie. Les hommes auraient donc pu avoir un autre maître, si la tromperie que Rhéa fit à son mari Saturne[33] ne leur eût donné Jupiter. Mais enfin tout cela n'est que pure fiction; ce sont d'agréables imaginations et des ornements empruntés, dont les poètes se sont servis pour parer les éloges des hommes illustres qu'ils avaient entrepris de louer, et ils n'ont pas cru le pouvoir faire d'une manière plus obligeante, ni qui fût plus digne de leurs héros, qu'en les faisant passer pour des dieux. Ainsi, l'on peut dire que tout ce qui est rapporté de leurs actions est vrai, si on ne les considère que comme des hommes; mais que tout est feint et supposé, dès qu'on les regarde comme des dieux. C'est ce qu'il est facile de faire voir par plusieurs faits que nous allons rapporter. Jupiter, prêt à remporter sur Danaé une indigne victoire, fait briller à ses yeux un grand nombre de pièces d'or. Danaé, éblouie de leur éclat, se rend, et reçoit en même temps le prix honteux de sa prostitution. Cela est simple, mais historique, et voici ce que les poètes y ont mis du leur. Voulant conserver à leur héros le rang qu'ils lui avaient procuré parmi les dieux, ils ont emprunté de leur art des couleurs pour donner à cette action, fort commune d'elle-même, un air de mystère et de prodige. Ils ont donc feint que Jupiter était descendu dans le sein de Danaé en pluie d'or, qui ne leur a pas plus coûté que la pluie de fer qu'ils font tomber sur une armée, pour exprimer une grande quantité de dards et de flèches. C'est à la faveur de cette même figure poétique que Jupiter se change en aigle pour ravir Ganymède, ou en taureau pour enlever Europe. Une troupe de soldats qui avaient un aigle sur leur drapeau, un navire qu'on nommait le Taureau, ou qui en portait un sur sa poupe: voilà la figure dévoilée et réduite à sa signification naturelle. On peut dire la même chose d'Io, la fille d'Inachus, qui fut changée en génisse, disent les poètes, pour éviter, sous cette forme empruntée, la colère de Junon, et qui, ayant traversé un grand espace de mer, se sauva en Egypte, où, après avoir repris sa première figure et sa première beauté, elle reçut de la libéralité des Égyptiens le titre de déesse, et le nom d'Isis.[34] Mais quelle preuve, nous dira-t-on, avez-vous de ce que vous avancez? Celle que nous tirons des fastes et des archives publiques, où il est ordonné aux peuples de célébrer tous les ans une fête en mémoire de l'heureuse navigation d'Isis ; ce qui marque qu'elle n'a pas traversé la mer à la nage, mais dans un vaisseau. Qu'on ne s'imagine pas au reste que les poètes aient inventé le corps de l'histoire et les principales circonstances des événements qu'ils racontent : ils ne font souvent que changer le lieu de la scène, et faire arriver dans le ciel ce qui s'est passé fort simplement sur la terre; ou bien ils ajoutent quelque épisode; ou enfin, ils ornent leur sujet de couleurs qui le déguisent, le fardent et le rendent méconnaissable. Et qu'on ne les accuse pas pour cela d'avoir eu un dessein formel d'imposer aux peuples; tout ce qu'ils prétendaient n'était que de rendre la mémoire de ceux dont ils décrivaient les aventures plus respectable aux hommes, en la revêtant, pour ainsi dire, des dehors et des apparences de la divinité. Et c'est ce qui a surpris la créance des peuples; ils ont reçu comme des vérités ce qui n'était que d'ingénieux mensonges ; et ignorant les lois de cet art imposteur, et jusqu'où la licence poétique peut légitimement pousser la fiction, ils ont adoré comme des dieux ce qui ne l'était en effet que dans l'imagination du poète. Ils se sont laissé abuser avec d'autant plus de facilité, que tout ce qui était l'objet de leur foi n'était pas fabuleux : la vérité, comme nous l'avons déjà remarqué, était mêlée avec la figure ; car le devoir du poète n'est pas d'inventer tout son sujet, cela serait trop grossier, il consiste à embellir celui qui lui est offert. Mais rendra-t-on les poètes seuls coupables de la superstitieuse crédulité des hommes? Les peintres et les statuaires y ont sans doute aussi beaucoup contribué, et leur art n'est pas moins sujet à imposer. C'est cet art qui a placé dans les temples ces figures si peu propres à inspirer la piété, ces représentations indécentes. Car si ce Jupiter que vous adorez est véritablement un dieu, pourquoi offrez-vous à notre culte d'autres images avec la sienne? Que font là autour de lui toutes ces femmes, qui ne servent qu'à nous donner un souvenir plus présent et plus vif de ses honteuses dissolutions. Pourquoi tant de vérité dans la preuve de son sexe ? Ne voyez-vous pas que les pierres mêmes publient que votre dieu n'est qu'un homme. Les poètes, disent-ils, font profession ouverte de mentir. D'où vient donc qu'ils leur ajoutent foi ; mais plutôt ils font voir eux-mêmes que les poètes n'ont pas imposé; car quand il est question de représenter les dieux, la diversité des sexes est parfaitement marquée dans leurs œuvres, d'où il résulterait que les poètes n'ont rien dit que de vrai. Que signifient, de grâce, ce jeune enfant et cet aigle, aux pieds de votre dieu? Sont-ce des monuments de sa gloire? Et n'accuserez-vous point aussi les poètes de les y avoir placés? Cependant tout cela devient l'objet de votre dévotion. Nous l'avons déjà dit, et nous le répétons, les poètes n'ont pas tout inventé. Ils se sont seulement servi de voiles pour cacher la vérité, soit qu'ils aient prétendu par là augmenter dans les esprits le désir de la connaître, soit qu'ils aient voulu en dérober la connaissance au peuple. C'est ce qu'on peut remarquer dans ce célèbre partage du monde entre les trois fils de Saturne, où le sort adjugea le ciel à Jupiter, la mer à Neptune et les enfers à Pluton. Pourquoi n'est-il point parlé là de la terre? c'est que ce partage se passa sur la terre. Ce qui est vrai, c'est que ces trois frères partagèrent la terre entre eux: que Jupiter eut pour lui l'Orient, que les poètes nommèrent le Ciel, parce que le jour et la lumière nous viennent de ce côté là ; que Pluton eut l'Occident, appelé les enfers par les mêmes poètes, à cause que la nuit et les ténèbres s'y forment après le coucher du soleil ; et que la mer échut à Neptune, à peu près de la même manière qu'elle échut à Pompée, lorsque le sénat, par un décret, lui en donna le commandement, et lui enjoignit d'arrêter les courses des pirates et d'en nettoyer les côtes. On nous demandera sans doute sur quoi nous fondons cette interprétation: nous répondrons que c'est sur d'anciens mémoires. Evhémère nous les fournira; c'est un auteur digne de foi, et qui vivait il y a plusieurs siècles. Il a écrit l'histoire de Jupiter et des autres dieux, et il l'a composée des inscriptions et des autres monuments sacrés, qui se voyaient de son temps dans de vieux temples, et particulièrement dans celui de Jupiter Triphyllien, où on lisait sur une colonne les exploits glorieux de ce roi du ciel. Il paraissait même par l'inscription qu'il se l'était lui-même dressée pour conserver la mémoire de ses belles actions, et les faire passer jusqu'à la postérité la plus éloignée. Ennius nous a donné cette histoire en latin : voici ce qu'il en dit. « Jupiter, dit-il, laissa à Neptune l'empire de la mer, c'est-à-dire qu'il lui confia le gouvernement des îles et des côtes. » Ce qui peut encore avoir donné lieu d'appeler Jupiter roi du ciel est la signification équivoque de l’Olympe, qui tantôt est pris pour une montagne, et tantôt pour le ciel; car il paraît, par l'histoire que je viens de citer, que Jupiter demeurait sur le mont Olympe. « En ce temps-là (continue l'historien) Jupiter passait une partie de l'année sur l'Olympe, et il y rendait la justice à ses sujets. Il avait pareillement ordonné que ceux qui auraient fait quelque nouvelle découverte, soit dans la nature, soit dans les arts, qui fût utile au public, eussent à lui en venir rendre compte en ce lieu. » C'est donc ainsi, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, que les poètes se servent de figures pour exprimer leurs pensées d'une manière plus noble et plus agréable. Ceux qui ignorent ces secrets de l'art regardent les poètes comme des imposteurs et des sacrilèges. Et c'est aussi ce qui a trompé plusieurs philosophes, qui, considérant que ce qui se publiait de l'homme ne pouvait convenir au dieu, se sont imaginé qu'il y avait eu deux Jupiter, l'un réel et l'autre fabuleux. Ils voyaient clairement que celui dont parlent les poètes n'avait jamais été qu'un homme; et cependant entraînés par la multitude et par les préjugés, que l'esprit ne reçoit que trop facilement en matière de religion, ils donnèrent à un homme le nom de dieu, et le fils de Saturne et de Rhéa devint, du consentement de ces grands génies, le maître du ciel et de la terre. Il y en a qui tâchent de défendre l'erreur où ils sont engagés par une seconde erreur. « Nous sommes, disent-ils, convaincus qu'il n'y a qu'un Dieu; nous l'adorons de tout notre cœur, et nous n'adorons que lui ; mais ce Dieu, nous l'appelons Jupiter. » Qu'y a-t-il de moins juste que ce raisonnement ? Et ne sait-on pas que le culte de Jupiter enferme aussi celui de sa femme et de sa fille ; que ce dieu a un ménage complet, et une famille à laquelle il fait rendre les honneurs qu'on rend à lui-même? Croit-on que Junon et Minerve veulent renoncer à un si beau privilège ? D'ailleurs ce nom n'a rien de divin, il ne donne que l'idée d'un pouvoir purement humain ; car voici comme Cicéron explique ces noms de Jupiter et de Junon : il les fait venir du mot latin juvare qui signifie aider, secourir; ce qui ne convient nullement à un dieu; aider, étant proprement ce que l'homme, avec des forces aussi bornées que les siennes, peut faire à l'égard d'un autre homme. Et ce serait faire injure à la puissance de Dieu, et témoigner qu'on n'en est pas assez persuadé, de lui dire simplement : « Seigneur, secourez-nous; » mais plutôt « conservez-nous, Seigneur ; que votre bonté conserve en nous la vie que nous tenons de votre puissance. » Que si l'on veut que ce nom de Jupiter soit composé de deux mots signifiant père secourable, nous n'y trouverons pas un sens moins contraire à l'usage et à la raison. Peut-on dire qu'un père donne à ses enfants quelque secours, lorsqu'il leur donne la naissance et la vie? L'expression ne répond pas à la grandeur du don; et un pareil bienfait demande un terme qui y ait du rapport. En aurait-il avec ce que nous devons à Dieu ? lui qui est notre véritable père, à qui nous devons l'être, la vie, tout ce que nous sommes; lui qui nous forme à son image, qui nous anime de son esprit, qui nous éclaire de sa lumière, qui nous soutient, qui nous conserve, qui nous nourrit, qui nous comble de biens avec profusion, qui durant tout le cours de notre vie nous donne mille marques de sa puissance et de son amour. Celui-là sans doute ne connaît pas le prix des bienfaits, qui ne les reçoit de sa main que comme un secours. Ce n'est pas seulement le défaut de connaissance, mais une impiété formelle, qui ôte à Dieu le nom de Tout-Puissant, pour lui laisser le nom de Secourable.[35] Si la vie de Jupiter, si ses mœurs, si toute sa conduite marque évidemment que ce n'était qu'un homme, sa mort ne nous fera pas moins connaître que ce n'était pas un dieu. Ennius dans son histoire sacrée la rapporte en ces termes : « Jupiter, prêt à finir une aussi belle vie que la sienne, voulut partager ses Etats entre ses amis et les personnes de son sang. Puis, tout couvert d'une gloire immortelle, il quitta la terre pour s'aller réunir aux dieux. Il donna des marques d'un courage infatigable, en faisant cinq fois le tour de la terre; il fit paraître une sagesse éclairée dans les lois qu'il établit ; il montra une prudence consommée, en disposant les hommes à régler leurs mœurs; il fit ressentir à ses peuples les effets d'une bonté toute royale, en leur faisant distribuer une quantité de blé considérable ; en un mot il laissa au monde d'illustres monuments de toutes sortes de vertus. Les Curètes prirent soin de ses funérailles; ils lui élevèrent un tombeau dans l'île de Crète, où ils mirent cette inscription grecque : Zan Kponoy, c'est-à-dire Jupiter, fils de Saturne. » Ce récit, comme l'on voit, n'est pas tiré des poètes, mais d'auteurs graves, et dont l'histoire est en quelque sorte consacrée par l'antiquité, et par le témoignage des sibylles. Démons inanimés, vains simulacres de corps privés de vie, dont la Crète se vante de conserver les misérables restes, etc. Cicéron, dans les livres de la Nature des Dieux, dit que les théologiens admettent trois Jupiter ; qu'il y en a un qui est fils de Saturne, et qu'on montre son tombeau dans l'île de Crète. Comment se peut-il faire qu'un dieu soit en même temps vivant et mort? Mort en Crète, vivant à Rome? Qu'il ait ici un temple, et là un tombeau? Que les Romains apprennent enfin que leur Capitole, ce sanctuaire de la divinité, ce chef-lieu de la religion, n'est autre chose qu'un vain monument consacré à l'erreur publique. Mais il est juste de dire quelque chose du père du grand Jupiter, et d'examiner ses preuves de divinité. On dit premièrement que ce fut durant son règne qu'on eut le siècle d'or, et que la justice fit l'honneur aux hommes de demeurer parmi eux. Voilà déjà du moins un bel endroit dans sa vie, qu'on ne trouve pas dans celle de son fils; car qu'y a-t-il de plus digne d'un dieu, que de faire régner la justice et la félicité parmi les peuples? Mais quand je pense que le Ciel[36] a éclairé les premiers jours de sa vie, et que la Terre[37] l'a gardé neuf mois dans son sein, je ne puis me résoudre à le reconnaître pour dieu. Je cherche un dieu avant lequel je ne puisse rien trouver, et qui soit lui-même le principe et l'origine de toutes choses ; et il faut nécessairement que ce dieu que j'imagine ait jeté les premiers fondements de la terre et construit le ciel, bien loin de devoir sa naissance à l'un et à l'autre, comme on dit que Saturne doit la sienne à ces deux éléments. Avouons donc qu'il y a encore ici de la fiction poétique, et qui manque même de ce qui pourrait la rendre vraisemblable; car comment deux corps insensibles, inanimés, séparés par un espace si considérable, auraient-ils pu produire un fils qui n'a aucune ressemblance avec ceux de qui il tient la vie, mais une figure et des qualités toutes différentes ? Otons donc encore une fois le voile qui nous cache la vérité. Minucius Félix[38] croit que l'on nomma Saturne fils du Ciel et de la Terre, parce que s'étant réfugié en Italie, après avoir été chassé de ses états, il parut tout d'un coup, ainsi qu'un homme tombé du ciel ; et que, comme d'ailleurs on ignorait quelle était sa naissance et d'où il tirait son origine, on l'appela enfant de la Terre. L'une et l'autre de ces manières de parler qui ont cours parmi le peuple, peuvent bien avoir donné lieu à cette fable. Cependant, quelque ingénieuse que soit cette pensée, je ne pense pas qu'elle soit fondée en vérité; il y a plus d'apparence de croire que Saturne étant un prince puissant ait voulu conserver, et comme consacrer la mémoire de ceux auxquels il devait la vie, en leur donnant, après leur mort, les noms de Ciel et de Terre, quoiqu'ils aient été connus sous d'autres noms. Et c'est ainsi que nous voyons des montagnes et des fleuves changer de nom, et recevoir celui de quelques personnes illustres : car il ne faut pas s'imaginer que lorsque les poètes ont donné une postérité à Inachus et à Atlas, ils aient eu dessein de nous faire croire qu'un fleuve et une montagne aient pu mettre des enfants au monde. Ils ont seulement voulu nous faire entendre qu'un prince grec et qu'un roi d'Afrique ont donné leur nom à un fleuve et à une montagne. Cela était fort en usage parmi les anciens, et surtout parmi les Grecs. Les différents noms que porte la mer qui mouille les côtes de la Grèce, elle les a reçus des différentes personnes qui y ont péri. Egée, Icare et Hellé, ont donné les leurs à la mer Egée, à la mer Icarienne, et à l'Hellespont. C'est ainsi que le mont Aventin reçut le sien d'Aventinus, qui a son tombeau sur cette montagne de Rome, et le fameux fleuve du Tibre de Tibérinus qui s'y noya. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner qu'on ait donné au Ciel et à la Terre le nom de ceux qui avaient mis au monde de puissants princes. Il est donc claire que Saturne n'était pas fils du Ciel, mais d'un homme qui s'appelait Uranus, c'est-à-dire Ciel; cette vérité est confirmée par le témoignage de Trismégiste, qui, après avoir dit qu'il y a eu fort peu d'hommes solidement savants, compte Uranus, Saturne et Mercure, ses parents parmi ceux qui l'ont été. Voilà de quelle manière cet écrivain a traduit cette histoire, parce qu'il n'en savait pas la vérité. Il a raisonné de la manière qui lui a convenu. Je dirai comment, et par qui le ciel fut nommé de la sorte, car ce ne fut pas par Saturne, mais par Jupiter qu'il le fut. Voici ce qu'en dit Ennius dans son Histoire sacrée. « Jupiter, dit-il, alla sur une montagne extrêmement élevée, d'où ayant jeté la vue de tous côtés, et s'étant mis à considérer le pays d'alentour, il y érigea un autel qu'il consacra par un sacrifice solennel. Puis, levant les yeux vers cette vaste étendue qui est au-dessus de l'air, et que jusque alors on avait nommé l'Éther,[39] il lui donna le nom de Ciel[40] de celui de son aïeul, et il acheva ensuite le sacrifice en laissant consumer toute la victime ; mais ce n'est pas le seul sacrifice que Jupiter ait offert. Nous lisons dans César que ce fils de Saturne, marchant contre les Titans, et étant sur le point de quitter l'île de Naxos où il avait mouillé l'ancre, il sacrifia sur le rivage; qu'un aigle vint fondre à ses pieds, et qu'en ayant tiré un heureux présage pour la victoire, après qu'il l'eut remportée, il prit par reconnaissance une aigle pour symbole. L'histoire sacrée que nous avons alléguée plus d'une fois, témoigne aussi qu'un aigle se posa sur sa tête, et sembla par cette action lui promettre l'empire. »
|
|
CAPUT XII. Quod stoici figmenta poetarum ad philosophicam tranferunt rationem. Quoniam revelavimus mysteria poetarum, et Saturni parentes invenimus, ad virtutes ejus et facta redea-mus. Justus in regno fuit. Primum ex hoc ipso jam Deus non est, quod fuit: Deinde quod ne justus quidem fuit; sed impius, non modo in filios quos necavit, verum etiam in patrem, cujus dicitur abscidisse genitalia; quod forsitan vere acciderit. Sed homines respectu elementi, quod dicitur coelum, totam fabulam explodunt tamquam ineptissime fictam: quam tamen stoici (ut solent) ad rationem physicam conantur traducere; quorum sententiam Cicero, de Natura deorum disserens, posuit: « Coelestem, inquit, altissimam aetheriamque naturam, id est igneam, quae per sese omnia gigneret, vacare voluerunt ea parte corporis, quae conjunctione alterius egeret ad procreandum: quae ratio in Vestam potuit convenire, si mas diceretur. Idcirco enim virginem putant Vestam, quia ignis inviolabile sit elementum, nihilque nasci possit ex eo, quippe qui omnia quae arripuerit absumat. » Ovidius in Fastis:
Nec tu aliud Vestam, quam vivam intellige flammam;
Vulcano quoque id potuit adscribi, qui quidem putatur ignis; et tamen eum poetae non absciderunt. Potuit et Soli, in quo est natura et causa gignentium; nam sine Solis igneo calore neque nasci quidquam, neque augeri potest: ut nulli alii elemento magis opus sit genitalibus, quam calori, cujus fotu concipiuntur, nascuntur, sustentantur omnia. Postremo etiamsi ita sit (ut volunt) qui magis abscissum esse Coelum putemus, quam omnino sine genitalibus natum? Nam si per se gignit, non indigebat utique genitalibus, cum Saturnum ipsum procrearet. Si vero habuit, et a filio abscissa sunt, ortus rerum, et natura omnis interisset. Quid, quod ipsi Saturno non divinum modo sensum, sed humanum quoque adimunt, cum affirmant eum esse Saturnum, qui cursum et conversionem spatiorum et temporum continet; eumque graece id ipsum nomen habere. Κρόνος enim dicitur, quod est idem, quod χρόνος, id est spatium temporis. Saturnus autem est appellatus, quod saturetur annis. Haec Ciceronis verba sunt exponentis sententiam stoicorum (Lib. II de Nat. deor, c. 64) : « Quae quam vana sit, cuivis intelligere promptissimum est. Si enim Saturnus Coeli est filius, quomodo potuit aut tempus a Coelo gigni, aut Coelum a tempore abscidi, aut postea tempus imperio spoliari a filio Jove? Aut quomodo Jupiter natus est ex tempore? Aut quibus annis saturari possit aeternitas, cui nullus est finis? » CAPUT XIII. Quam vanae sint et inanes stoicorum interpretationes de diis; et ibi de Jovis ortu, Saturno et Ope. Si ergo vanae sunt istae rationes philosophorum, quid superest, nisi ut vere factum esse credamus, id est hominem ab homine abscissum? nisi forte aliquis existimet deum fuisse, qui timuit cohaeredem: cum, si quid divinitatis habuisset, non patris genitalia debuerit amputare, sed propria, ne Jupiter nasceretur, qui eum regni possessione privavit. Idem sororem suam Rheam, quam latine Opem dicimus, cum haberet uxorem, responso vetitus esse dicitur, mares liberos educare; quod futurum esset, ut a filio pelleretur: quam rem metuens, natos sibi filios non utique devorabat (ut ferunt fabulae) sed necabat; quamquam scriptum sit in Historia sacra ( scilicet Ennii) Saturnum, et Opem, caeterosque tunc homines humanam carnem solitos esitare: verum primum Jovem, leges hominibus moresque condentem, edicto prohibuisse ne liceret eo cibo vesci. Quod si verum est, quae potest in eo fuisse justitia? Sed fictum sane putemus, Saturnum filios devorasse, modo quum aliqua ratione: num idcirco, quod ait vulgus comedisse filios suos eum qui extulerit, sepulturaeque mandaverit? Ops autem cum Jovem peperisset, subtraxit infantem, eumque nutriendum furtim misit in Cretam. Rursum imprudentiam reprehendam necesse est. Cur enim responsum ab alio potius accepit? Cur in coelo constitutus, quae gerebantur in terra, non videbat? Cur eum Corybantes cymbalis fefellerunt? Postremo cur extitit aliqua vis major, quae illius vinceret potestatem? Nimirum senex a juvene facile victus est, ac spoliatus imperio. Fugit igitur, et in Italiam navigio venit, cum errasset diu; sicut expulsus Ovidius in Fastorum libris refert:
Causa ratis superest. Thuscum rate venit ad amnem
Hunc errantem atque inopem Janus excepit. Cujus rei argumenta sunt nummi veteres, in quibus est cum duplici fronte Janus, et in altera parte navis; sicut idem poeta (ibidem) subjecit:
At bona posteritas puppim formavit in aere, Omnes ergo non tantum poetae, sed historiarum quoque ac rerum antiquarum scriptores, hominem fuisse consentiunt, qui res ejus in Italia gestas memoriae prodiderunt: Graeci, Diodorus et Thallus; Latini, Nepos et Cassius et Varro. Nam cum agresti quodam more in Italia viveretur,
Is genus indocile, ac dispersum montibus altis Maluit, his quoniam latuisset tutus in oris. Censet ne aliquis deum esse, qui pulsus est, qui fugit, qui latuit? Nemo tam stultus est. Qui enim fugit aut latet, et vim et mortem timeat necesse est. Orpheus, qui temporibus ejus recentior fuit, aperte Saturnum in terra et apud homines regnasse commemorat:
Πρώτιστος μὲν ἄνασσεν ἐπιχθονίων Κρόνος ἀνδρῶς,
Item Maro noster: Aureus hanc vitam in terris Saturnus agebat; Et alio loco:
Aureaque (ut perhibent) illo sub rege fuere Neque superius dixit in coelo egisse vitam, neque inferius superos in pace rexisse: unde apparet illum regem fuisse terrenum; quod alibi apertius declarat: Aurea condet Saecula; qui rursus Latio, regnata per arva Saturno quondam. Ennius quidem in Euhemero non primum dicit regnasse Saturnum, sed Uranum patrem. Initio, inquit, primus in terris imperium summum Coelus habuit; is id regnum una cum fratribus suis instituit atque paravit. Non magna dissensio, siquidem maximorum auctorum de filio ac patre dubitatio est. Sed tamen utrumque fieri potest: ut et primus Uranus eminere inter caeteros potentia coeperit, et principatum habere, non regnum; postea Saturnus majores sibi opes comparaverit, ac regium nomen asciverit. CAPUT XIV. Quid de diis Euhemeri et Ennii doceat sacra historia. Nunc quoniam ab iis, quae retulimus, aliquantulum sacra Historia dissentit, aperiamus ea quae veris litteris continentur, ne poetarum ineptias in accusandis religionibus sequi ac probare videamur. Haec Ennii verba sunt: « Exin Saturnus uxorem duxit Opem. Titan, qui major natu erat, postulat ut ipse regnaret. Ibi Vesta mater eorum, et sorores Ceres atque Ops, suadent Saturno, ut de regno non concedat fratri. Ibi Titan, qui facie deterior esset, quam Saturnus, idcirco et quod videbat matrem atque sorores suas operam dare ut Saturnus regnaret, concessit ei ut is regnaret. Itaque pactus est cum Saturno, uti si quid liberum virilis sexus ei natum esset, ne educaret. Id ejus rei causa fecit, uti ad suos gnatos regnum rediret. Tum Saturno filius qui primus natus est, eum necaverunt. Deinde posterius nati sunt gemini, Jupiter atque Juno. Tum Junonem Saturno in conspectum dedere, atque Jovem clam abscondunt, dantque eum Vestae educandum, celantes Saturnum. Item Neptunum clam Saturno Ops parit, eumque clanculum abscondit. Ad eumdem modum tertio partu Ops parit geminos, Plutonem et Glaucam. Pluto Latine est Dispater: alii Orcum vocant. Ibi Glaucam filiam Saturno ostendunt, ac filium Plutonem celant atque abscondunt. Deinde Glauca parva emoritur. » Haec (ut scripta sunt) Jovis fratrumque ejus stirps, atque cognatio in hunc modum nobis ex sacra scriptione tradita est. Item paulo post haec infert: « Deinde Titan, postquam rescivit Saturno filios procreatos, atque educatos esse clam, seducit secum filios suos qui Titani vocantur, fratremque suum Saturnum, atque Opem comprehendit, eosque muro circumegit, et custodiam his apponit. » Haec historia quam vera sit, docet Sibylla Erythraea, eadem fere dicens; nisi quod in paucis, quae ad rem non pertinent, discrepat. Jupiter ergo liberatur summi sceleris crimine, quod patrem vinxisse compedibus perhibetur: id enim Titan patruus fecit quod ille contra pactionem jusque jurandum mares liberos sustulisset. Reliqua historia sic contexitur: Jovem adultum, cum audisset patrem atque matrem custodiis circumseptos, atque in vincula conjectos, venisse cum magna Cretensium multitudine, Titanumque ac filios ejus pugnando vicisse, parentes vinculis exemisse, patri regnum reddidisse, atque ita in Cretam remeasse: Post haec deinde Saturno datam sortem, ut caveret ne filius eum regno expelleret: illum elevandae sortis atque effugiendi periculi gratia, insidiatum Jovi, ut eum necaret: Jovem, cognitis insidiis, regnum sibi denuo vindicasse, ac fugasse Saturnum, qui, cum jactatus esset per omnes terras, persequentibus armatis, quos ad eum comprehendendum vel necandum Jupiter miserat, vix in Italia locum, in quo lateret, invenit. |
XII. Les secrets des poètes ne nous sont plus cachés ; nous avons pénétré dans leurs plus sacrés mystères, la véritable naissance de Saturne nous est enfin connue. Examinons maintenant si ses vertus méritent que nous lui donnions rang parmi les dieux. On commence son éloge par la justice. Il fut juste, dit-on, en voilà d'abord assez pour lui faire perdre sa divinité; et ce mot, il fut, l'en dégrade entièrement. Mais il ne fut pas même juste, comme on le publie si hautement, et il commit la plus horrible de toutes les injustices, soit envers ses enfants qu'il fit mourir, soit envers son père qu'il mit hors d'état de lui donner des frères. J'avoue que les stoïciens lui ont rendu un bon office, et qu'ils ont donné à cette action barbare et impie un sens qui lui fait perdre une partie de l'horreur que nous en avions conçue.[41] Ils veulent donc, selon la remarque de Cicéron dans ses livres de la Nature des Dieux,[42] que le père de Saturne, cet eunuque infortuné, ne soit autre chose que la sphère du feu, qui, ne produisant rien, n'a pas besoin des mêmes organes que la nature a donné au sexe le plus noble pour multiplier son espèce. Cela se pourrait peut-être dire de Vesta,[43] si son sexe pouvait souffrir cette application ; car on dit que cette déesse est toujours demeurée vierge, parce qu’étant la déesse du feu, elle représente un élément dont la stérilité est la marque de l'extrême pureté.[44] XIII. Si donc cette explication est trop recherchée, si elle n'a rien de naturel ni de solide, que reste-t-il? sinon de croire sans façon qu'un homme a bien pu commettre ce crime envers un autre homme; à moins qu'on ne dise que Saturne, tout dieu qu'il était, ne laissait pas de craindre que son père ne lui donnât un frère qui vînt mal à propos partager avec lui une succession qu'il regardait comme devant lui appartenir un jour tout entière. Mais il devait bien plutôt faire cette opération sur lui-même, et avoir la prévoyance de ne pas donner la vie à un fils[45] qui devait lui ôter la couronne. Il est vrai qu'ayant appris d'un oracle que ce fils le chasserait de ses États, il prit la précaution de dévorer (comme disent les fables), ou plutôt de faire mourir (comme raconte l'histoire), tous les mâles, que sa femme Rhéa, qui était aussi sa sœur, lui donnait tous les ans. A la vérité Ennius nous apprend, dans son Histoire sacrée, que dans ces premiers temps, les hommes, dont les mœurs étaient encore rudes et sauvages, se nourrissaient de chair humaine : mais que les premières lois que donne Jupiter, lorsqu'il fut le maître, et qu'il s'appliqua à polir et à civiliser les peuples, que ces premières lois, dis-je, défendirent sous de rigoureuses peines ces horribles repas. Quoi qu'il en soit, que Saturne ait tué ses enfants, ou qu'il les ait mangés, on ne voit pas par quel endroit il a pu mériter le nom de juste. Mais enfin Rhéa, ayant mis Jupiter au monde, elle eut assez d'adresse ou de bonheur pour le soustraire à la cruauté de son mari, et pour l'envoyer en Crète, où elle le fit nourrir secrètement. Mais je ne puis m'empêcher d'accuser ici Saturne d'imprudence et de sottise : en fut-il jamais une pareille à celle qu'il fit paraître en cette rencontre. Il est dans le ciel, et il ne voit pas ce qui se passe sur la terre : il est Dieu, et il se laisse vilainement tromper par les Corybantes.[46] Enfin, ce sage vieillard, ce puissant prince, ce politique raffiné, se voit en un instant dépouillé de tout par un jeune homme sans force et sans expérience : le voilà réduit à fuir et à chercher chez tous les peuples de la terre, un asile qu'il ne peut rencontrer qu'en Italie, où il trouva en Janus, comme le raconte Ovide dans ses Fastes,[47] un ami généreux, qui, pour honorer un tel hôte, fit frapper exprès des monnaies, où l'on voit d'un côté Janus avec deux visages, et de l'autre un navire qui représente celui sur lequel Saturne avait abordé en Italie. Ainsi poètes et historiens, anciens et modernes, Grecs et Latins,[48] tous sont d'accord en ce point, que le fils d'Uranus et le père de Jupiter ne furent jamais qu'un homme. Et qui serait assez crédule pour croire que celui-là est un dieu, qui, se voyant chassé de chez lui, cherche sa sûreté dans la fuite, et se dérobe comme il peut à la violence et à la cruauté d'un usurpateur. Orphée, qui vivait peu de temps après Saturne, dit nettement que ce fut lui qui fonda le premier royaume de la terre et qui fut père du grand roi.[49] Virgile le fait aussi régner sur la terre et lui donne un règne tout d'or. Ennius, à la vérité, fait régner Uranus son père avant lui, mais il est facile d'accorder ces auteurs en disant qu’Uranus a jeté les premiers fondements dans la puissance souveraine, et que Saturne, ayant amassé de grands trésors, s'en servit pour l'établir plus solidement, et qu'il prit le nom de roi que son père n'avait osé prendre. XIV. Mais afin que l’on ne nous accuse pas de n'employer, pour combattre la fausse religion, que le témoignage des poètes, qui peut-être n'ont pas un caractère assez grave pour servir de témoins dans un procès de cette importance, nous voulons bien ne rien avancer qui ne soit pris d'auteurs irréprochables. Voici donc comme Ennius, qui peut passer pour tel, parle de Saturne et de sa famille d'après Evhémère, dont il a traduit l'histoire : « Après cela (disent ces deux historiens) Saturne épousa Rhéa ou Ops sa sœur; il avait un frère aîné nommé Titan, qui aspirait à la royauté; mais la mère de ces deux princes, et Cérès leur sœur, avaient beaucoup plus de penchant pour Saturne, et lui conseillaient de ne point partager le royaume avec son frère : cela vint à la connaissance de Titan ; mais il le dissimula, et consentit en apparence que Saturne régnât seul. Cependant, comme il avait l'esprit plus subtil que le nouveau monarque, il l'engagea à signer un traité par lequel Saturne s'obligeait à lui livrer de bonne foi tous les mâles qui lui naîtraient. L'intention de Titan était de faire passer le royaume dans sa maison après la mort de Saturne. On commença donc à exécuter le traité par la mort du premier fils de ce roi. Mais la reine sa femme ayant mis au monde un fils et une fille, ou montra la fille qui fut nommée Junon, et pour le fils, qui fut le fameux Jupiter, on l'enleva secrètement, et on alla le cacher dans la solitude du mont Ida.[50] La même chose arriva à la naissance de Neptune et à celle de Pluton et de Glauca; Glauca fut apportée a Saturne; mais Neptune et Pluton furent sauvés par la même adresse que l'avait été Jupiter. » C'est ainsi que les Annales sacrées[51] rapportent sa naissance et celle de ses frères ; et elles continuent de cette sorte à nous instruire de ce qui s'est passé de plus considérable dans cette famille. « Titan s'étant aperçu qu'on s'était joué de lui, et ayant appris que Saturne avait trois fils, malgré la précaution qu'il avait prise de ne lui en point laisser, obligea ses enfants, qu'on nommait Titans comme leur père, à se joindre a lui, et avec leur secours il enferma Saturne et sa femme dans une tour, et les y fit soigneusement garder. » La vérité de cet événement nous est confirmée par la sibylle Erythréenne, et peut en même temps justifier Jupiter d'avoir, par une horrible impiété, mis lui-même son père dans les fers. Ce fut son oncle Titan qui commit ce crime, pour se venger de ce que Saturne avait contre sa parole laissé la vie à ses enfants. Jupiter, ayant appris que ce perfide retenait prisonnier le roi son père, leva aussitôt une armée dans l'île de Crète, vint fondre sur Titan et sur ses fils, les défit, et délivra son père. Mais Saturne ayant trop facilement ajouté loi à un oracle qui l'assurait que son fils avait dessein de le renverser du trône, où sa main venait de le rétablir, il chercha l'occasion de le faire mourir ; ce qui étant venu à la connaissance de Jupiter, il prévint son père, s'empara du royaume, et en chassa celui qui le voulait perdre. Saturne, ayant longtemps combattu contre la mauvaise fortune, fut enfin contraint de lui céder, et fuyant de ville en ville et de contrée en contrée, il aborda enfin en Italie, comme nous l'avons déjà dit, où à peine put-il trouver un endroit pour se mettre à couvert de l'orage, et pour ne pas tomber entre les mains des meurtriers que son fils envoyait de tous côtés pour lui ôter la vie.
|
|
CAPUT XV. Quomodo, cum fuerint illi homines, dii fuerint nominati Quibus ex rebus, cum constet illos homines fuisse, non est obscurum qua ratione dii coeperint nominari. Si enim nulli reges ante Saturnum vel Uranum fuerunt propter hominum raritatem, qui agrestem vitam sine ullo rectore vivebant: non est dubium quin illis temporibus homines regem ipsum totamque gentem summis laudibus ac novis honoribus jactare coeperint, ut etiam deos appellarent, sive ob miraculum virtutis (hoc vere putabant rudes adhuc et simplices), sive (ut fieri solet) in adulationem praesentis potentiae, sive ob beneficia quibus erant ad humanitatem compositi. Deinde ipsi reges, cum chari fuissent iis, quorum vitam composuerant, magnum sui desiderium mortui reliquerunt. Itaque homines eorum simulacra finxerunt, ut haberent aliquod ex imaginum contemplatione solatium; progressique longius per amorem meriti, memoriam defunctorum colere coeperunt; ut et gratiam referre bene meritis viderentur, et successores eorum allicerent ad bene imperandi cupiditatem. Quod Cicero de Natura deorum (l. II, c. 14) docet, dicens: « Suscepit autem vita hominum consuetudoque communis, ut beneficiis excellentes viros in coelum fama ac voluntate tollerent. Hinc Hercules, hinc Castor, hinc Pollux, hinc Aesculapius, hinc Liber. » Et alio loco: « Atque in plerisque civitatibus intelligi potest, acuendae virtutis gratia, aut quo libentius reipublicae causa periculum adiret optimus quisque virorum fortium, memoriam honore deorum immortalium consecratam. » Hac scilicet ratione Romani Caesares suos consecraverunt, et Mauri reges suos. Sic paulatim religiones esse coeperunt, dum illi primi, qui eos noverant, eo ritu suos liberos ac nepotes, deinde omnes posteros imbuerunt. Et hi tamen summi reges ob celebritatem nominis in provinciis omnibus colebantur. Privatim vero singuli populi gentis aut urbis suae conditores, seu viri fortitudine insignes erant, seu foeminae castitate mirabiles, summa veneratione coluerunt; ut Aegyptii Isidem, Mauri Jubam, Macedones Cabirum, Poeni Uranum, Latini Faunum, Sabini Sancum, Romani Quirinum. Eodem utique modo Athenae Minervam, Samos Junonem, Paphos Venerem, Lemnos Vulcanum, Naxos Liberum, Apollinem Delphi. Sic per populos atque regiones varia sacra suscepta sunt, dum grati homines esse in suos principes cupiunt, et quod alios honores, quos vita carentibus deferant, invenire non possunt. Praeterea pietas eorum, qui successerant, plurimum contulit ad errorem; qui (ut divina stirpe nati viderentur) divinos honores parentibus detulerunt, deferrique jusserunt. An potest aliquis dubitare, quomodo religiones deorum sint institutae, cum apud Maronem legat Aeneae verba sociis imperantis: Nunc pateras libate Jovi, precibusque vocate Anchisem genitorem. Cui non tantum immortalitatem, verum etiam ventorum tribuit potestatem:
Poscamus ventos, atque haec me sacra quotannis Idem scilicet de Jove Liber, et Pan, et Mercurius, et Apollo fecerunt; ac postea de his ipsis successores eorum. Accesserunt etiam poetae, et compositis ad voluptatem carminibus, in coelum eos sustulerunt: sicut faciunt qui apud reges, etiam malos, panegyricis mendacibus adulantur. Quod malum a Graecis ortum est: quorum levitas, instructa dicendi facultate et copia, incredibile est quantas mendaciorum nebulas excitaverit. Itaque admirati eos, et susceperunt primi sacra illorum, et universis gentibus tradiderunt. Ob hanc vanitatem Sibylla sic eos increpat:
Ἕλλὰς δὴ τί πέποιτας ἐπ' ἀνδράσιν ἡγημόνεσσι; M. Tullius, qui non tantum perfectus orator, sed etiam philosophus fuit; siquidem solus extitit Platonis imitator, in eo libro, quo se ipse de morte filiae consolatus est, non dubitavit dicere, deos, qui publice colerentur, homines fuisse. Quod ipsius testimonium eo debet gravissimum judicari, quod et augurale habuit sacerdotium, et eosdem se colere venerarique testatur. Itaque intra paucos versiculos duas res nobis dedit. Nam dum imaginem filiae eodem modo se consecraturum esse profiteretur, quo illi a veteribus sunt consecrati, et illos mortuos esse docuit, et originem vanae superstitionis ostendit. « Cum vero, inquit, et mares et foeminas complures ex hominibus in deorum numero esse videamus, et eorum in urbibus atque agris augustissima delubra veneremur, assentiamur eorum sapientiae, quorum ingeniis et inventis omnem vitam legibus et institutis excultam constitutamque habemus. Quod si ullum unquam animal consecrandum fuit, illud profecto fuit. Si Cadmi progenies, aut Amphytrionis, aut Tyndari in coelum tollenda fama fuit, huic idem honos certe dicandus est. Quod quidem faciam, teque omnium optimam doctissimamque, approbantibus diis immortalibus ipsis, in eorum coetu locatam, ad opinionem omnium mortalium consecrabo. » Fortasse dicat aliquis, prae nimio luctu delirasse Ciceronem. Atqui omnis illa oratio, et doctrina, et exemplis, et ipso loquendi genere perfecta, non aegri, sed constantis animi ac judicii fuit; et haec ipsa sententia nullum praefert indicium doloris. Neque enim puto illum tam varie, tam copiose, tam ornate scribere potuisse, nisi luctum ejus et ratio ipsa, et consolatio amicorum, et temporis longitudo mitigasset. Quid, quod idem dicit in libris de Republica? idem de Gloria? Nam de Legibus, quo in opere Platonem secutus, leges voluit ponere, quibus putaret usuram esse justam et sapienetm civitatem, de Religione ita sanxit: « Divos, et eos qui coelestes semper habiti sunt, colunto; et illos, quos in coelo merita locaverunt, Herculem, Liberum, Aesculapium, Pollucem, Castorem, Quirinum. » Item in Tusculanis, cum diceret totum pene coelum humano genere completum: « Si vero, inquit, scrutari vetera, et ex illis ea quae scriptores Graeciae prodiderunt, eruere coner, ipsi illi majorum gentium dii qui habentur, hinc a nobis profecti in coelum reperientur. Quaere, quorum demonstrantur sepulcra in Graecia; reminiscere, quoniam es initiatus, quae traduntur mysteriis: tum denique quam hoc late pateat intelliges. » Testatus est videlicet Attici conscientiam, ex ipsis mysteriis intelligi posse, quod omnes illi homines fuerunt, qui coluntur: et cum de Hercule, Libero, Aesculapio, Castore, Polluce incunctanter fateretur; de Apolline ac Jove, patribus eorum, item de Neptuno, Vulcano, Marte, Mercurio, quos majorum gentium deos appellavit, timuit aperte confiteri. Et idcirco ait late hoc patere, ut idem de Jove caeterisque antiquioribus diis intelligamus, quorum memoriam si eadem ratione veteres consecraverunt, qua se imaginem nomenque filiae consecraturum esse dicit, ignosci moerentibus potest, credentibus non potest. Quis enim tam demens, qui consensu et placito innumerabilium stultorum aperiri coelum mortuis arbitretur? aut aliquem, quod ipse non habeat, dare alteri posse? Apud Romanos deus Julius, quia hoc scelerato homini placuit Antonio; deus Quirinus, quia hoc pastoribus visum est: cum alter gemini fratris extiterit, alter patriae parricida. Quod si consul non fuisset Antonius, C. Caesar pro suis in rempublicam meritis etiam defuncti hominis honore caruisset, et quidem consilio Pisonis soceri, et L. Caesaris propinqui, qui vetabant funus fieri, et Dolabellae consulis, qui columnam in foro, id est, tumulum ejus evertit, ac forum expiavit. Nam Romulum desiderio suis fuisse declarat Ennius, apud quem populus amissum regem dolens, haec loquitur:
O Romule, Romule dic, o, Ob hoc desiderium facilius creditum est Julio Proculo mentienti, qui subornatus a patribus est, ut nuntiaret plebi vidisse se regem humano habitu augustiorem, eumque mandasse ad populum, ut sibi delubrum fieret, se deum esse, et Quirinum vocari. Quo facto, et ipsi populo persuasit Romulum ad deos abiisse, et senatum suspicione caedis regiae liberavit. |
XV. Si l'on demande présentement comment Saturne et ses enfants n'étant que des hommes ont été honorés comme des dieux, il est facile de répondre à cela : que s'il est vrai, comme on le suppose, qu'avant Uranus et Saturne la royauté était inconnue aux hommes, qui n'étant encore qu'en petit nombre, vivaient à l'aventure et ne reconnaissaient d'autres lois que celles de l'instinct, qui seul gouvernait alors, il ne faut pas douter que les premiers qui reçurent de ces peuples grossiers le nom et le pouvoir de souverain, n'en reçussent en même temps des honneurs extraordinaires, jusqu'à être appelés dieux par leurs nouveaux sujets : soit pour quelque vertu apparente qui était en eux (n'étant pas difficile d'en imposer à des esprits si peu éclairés), soit que la flatterie commençât dès lors à corrompre les puissances par des louanges outrées, soit enfin que les sujets se fussent laissé corrompre eux-mêmes par les bienfaits de leurs souverains. D'ailleurs, considérant combien ils étaient redevables aux soins que leurs premiers rois avaient pris de les rassembler dans des villes, de les avoir civilisés, d'avoir changé leur vie toute brute et agreste en des mœurs polies et honnêtes, et ne les trouvant plus sur la terre, ils s'avisèrent, pour soulager leur douleur et réparer en quelque sorte leur perte, de les faire revivre dans leurs portraits; et poussant encore plus loin leur amour et leur reconnaissance, il se mirent à honorer leur mémoire d'un culte religieux ; peut-être aussi dans le dessein d'exciter par là leurs successeurs dans leurs États à devenir aussi les héritiers de leurs vertus. C'est ce que Cicéron exprime à peu près dans les mêmes termes: « C'a été, dit-il, en quelque façon un usage reçu de tout temps parmi les hommes, de mettre au nombre des dieux, du moins par les mouvements d'une volonté reconnaissante, ou à l'aide d'une réputation vertueuse, les grands personnages qui par leurs bienfaits ont su gagner le cœur des peuples. » C'est à ce charme des bienfaits qu'un Hercule, qu'un Castor, qu'un Pollux son frère, qu'un Esculape, que tant d'autres, doivent leur divinité. C'est ce qui a fait chez les Romains tant d'apothéoses, et tant de consécrations chez les peuples d'Afrique. Ainsi s'établirent peu à peu les diverses religions. Le culte passa des fils aux neveux, et des neveux à la postérité la plus éloignée. Il y en avait qui par la grandeur de leurs exploits avaient rendu leur nom si célèbre, qu'ils étaient adorés comme dieux du premier ordre par toutes les nations du monde. Mais ceux dont les vertus moins éclatantes n'avaient eu pour témoins que leurs citoyens, et avaient été renfermées dans l'enceinte d'une ville, ou tout au plus dans les limites d'une province, étaient reconnus pour les dieux d'une province ou d'une ville, et quelquefois d'une nation tout entière. Telle fut Isis parmi les Égyptiens, le dieu Faune chez les Latins, et Quirinus dans Rome. C'est encore ce qui mit Athènes sous la protection de Minerve, Samos sous celle de Junon, et Paphos sous celle de Vénus; c'est ce qui établit le culte particulier de Vulcain à Lemnos, de Bacchus à Naxos et d'Apollon à Delphes. Ainsi, à mesure que cet esprit de reconnaissance se répandait avec la politesse sur la terre, le nombre des dieux augmentait dans le ciel. Mais ce qui contribua beaucoup à l'établissement de cette erreur fut la piété ou superstitieuse ou intéressée des successeurs de ces nouvelles divinités. Car s'imaginant qu'il leur serait glorieux d'avoir un dieu pour père ou pour aïeul, ils furent les premiers à mettre de ces dieux dans leur famille, et ils ordonnèrent ensuite aux peuples qui dépendaient d'eux d'adorer ces idoles de leur vanité. Virgile sera notre garant de ce que nous venons d'avancer. Lorsque après la mort d'Anchise, Énée son fils le mit au nombre des dieux, ce prince troyen dit à ceux qui l'accompagnaient : Faite les effusions ordinaires devant Jupiter, et invoquez Anchise notre très honoré seigneur et père. Mais il ne lui donne pas seulement l'immortalité, et il n'en fait pas un dieu oisif, et qui ne soit bon à rien ; pour lui attirer de la considération, il lui donne un pouvoir absolu sur les vents.[52] Jupiter reçut les mêmes honneurs divins de quatre dieux subalternes,[53] qui à leur tour se les firent rendre avec usure par les pauvres mortels. Les poètes vinrent ensuite, qui, parmi les égarements de la poésie, mêlèrent des louanges excessives qui mettaient de plain-pied leurs héros dans le ciel. En cela, semblables à ces infâmes flatteurs qui ne rougissent point de donner un encens impur aux crimes des princes. Le mal vint d'abord du côté de la Grèce. Cette nation naturellement légère, et qui sait joindre à cette légèreté une grande facilité à parler et à écrire, fit élever, si j'ose m'exprimer ainsi, une infinité de nuages remplis de fictions et de mensonges qui obscurcirent la vérité. Ce fut donc les Grecs qui les premiers instituèrent des fêtes et des sacrifices à ces dieux de leur façon, et firent ensuite passer chez les autres peuples ce culte sacrilège. C'est cette institution vaine et ridicule qui anime contre eux le zèle de la sibylle et qui lui fait adresser à la Grèce ces paroles : O aveugle Grèce, pourquoi mets-tu ta confiance dans tes princes ? Que te sert d'offrir à des morts insensibles et sourds tes présents et les vœux ? Apprends que les dieux auxquels tu sacrifies, ne sont que de vaines idoles. Qui t'a fait tomber dans une erreur si déplorable, que d'abandonner le vrai Dieu pour courir après des dieux imaginaires ? Cicéron, qui n'est pas seulement un orateur parfait, mais encore un excellent philosophe, puisqu'il est le seul qui s'est conformé en toutes choses aux sentiments de Platon, Cicéron, dis-je, dans le discours qu'il a composé pour se consoler lui-même de la mort de sa fille, ne fait point de difficulté d'avouer que les dieux que Rome adorait n'avaient été que des hommes. Et ce témoignage est d'autant plus important, qu'il est rendu par un homme revêtu de la dignité d'augure, et qui confesse ingénument qu'il les adore avec le peuple. Et certes, en nous apprenant que, pour donner quelque soulagement à sa douleur, il a résolu de consacrer l’image de sa fille de la même manière que celles des premiers dieux furent consacrées, il nous apprend la mort de ces dieux, le motif de leur consécration, et l'origine du culte qu'on leur rend. « Lors donc, ajoute-t-il, que nous voyons cette multitude de dieux de l'un et de l'autre sexe, et que nous rencontrons à chaque pas, soit dans les villes, soit à la campagne, les temples que la religion leur a élevés, reconnaissons du moins que nous devons à leurs soins officieux, à leur prudence consommée, et à l'excellence de leur esprit, les sages lois qui nous gouvernent, et l'extrême politesse qui nous distingue des peuples barbares. Que s'il fut jamais quelque créature digne des honneurs divins, sans doute c'est l'admirable personne dont je pleure la perte; et si on les a accordés à la postérité de Cadmus, ou à celle d'Amphion et de Tindare, qui peut te les refuser, ô ma fille! Reçois-les donc de moi, et attends-les de toute la terre, après qu'avec la permission des dieux immortels, j'aurai consacré ta mémoire, et que je t'aurai donné parmi eux une place, que la bonté de ton cœur et les lumières divines de ton esprit t'ont si bien méritée. » Quelqu'un dira peut-être que l'excès de la douleur faisait écrire à Cicéron tant d'extravagances; mais si l'on considère que tout ce discours[54] est rempli d'une doctrine sublime, d'exemples choisis, et de toutes les sortes d'ornements que fournit l'éloquence, on changera de sentiment, et on demeurera d'accord que ce n'est point l'ouvrage d'un esprit accablé de tristesse et que le chagrin affaiblit, mais d'un homme qui parle de sens rassis, et qui fait paraître partout une fermeté et une constance digne d'un grand philosophe. Et je ne saurais m'imaginer qu'il y ait pu mettre tant de variété, une abondance si fleurie, et des ornements si recherchés, si la raison, ses amis et le temps n'eussent adouci sa douleur, et n'eussent rendu son affliction moins vive et moins sensible. Mais ce qui doit nous convaincre qu'il parle ici de sang-froid et avec réflexion, c'est que partout ailleurs il tient le même langage, dans ses livres de la République, dans celui de la Gloire, et particulièrement dans celui des Lois. Car après avoir, à l'imitation de Platon, établi des lois pour une république bien policée, lorsqu'il vient à parler de la religion, voici ce qu'il en dit : « Qu'on honore les dieux, soit qu'ils soient originaires du ciel, soit qu'ils y aient été reçus pour leur vertu; tels que sont Hercule, Esculape, Quirinus, etc. » Et dans ses Tusculanes il avance hardiment que le genre humain remplit le ciel de toutes parts. « Si je voulais, dit-il, fouiller dans l'antiquité, et surtout dans les monuments que nous ont laissés les Grecs, il ne me serait pas difficile de montrer que les dieux des nations les plus anciennes ont eu même origine que nous, et ne sont montés au ciel qu'après avoir longtemps demeuré sur la terre. Combien la Grèce montre-t-elle de tombeaux qui ont été dressés à ces hommes divins? Ouvrez les livres sacrés, vous qui êtes initiés aux mystères, et vous connaîtrez que le ciel est redevable à la terre de presque tous ses dieux. » Il confirme encore la même chose par la bouche d'Atticus, avec cette différence que lorsqu'il parle d'Hercule, d'Esculape, de Castor, de Pollux, il soutient sans hésiter qu'ils ont été des hommes. Mais quand il vient à parler de Jupiter, d'Apollon, de Neptune, et des autres dieux qu'il appelle les dieux des nations, il ne propose son sentiment qu'en tremblant, et on voit bien qu'il craint de se commettre ou avec le peuple, ou avec les ministres de la religion. Mais enfin il nous fait assez entendre que Jupiter même et les dieux anciens doivent être compris dans cette notion générale qu'il nous donne de la manière dont s'est faite la consécration des autres. Et il est aisé de conclure de ce qu'il nous dit, que si les peuples ont fait leurs dieux par le même motif qu'il a eu de faire sa fille déesse, cette impiété trouverait peut-être quelque excuse dans la douleur, mais qu'il n'y en peut avoir pour la fausse prévention. Et certainement il faut avoir perdu la raison pour croire que le ciel s'ouvre selon le bizarre caprice d'une multitude insensée afin de recevoir ceux qu'il lui plaît d'y faire monter, ou qu'un homme puisse conférer à un autre homme la divinité qu'il n'a pas. A qui, par exemple le dieu Jules[55] est il redevable de la sienne, sinon au plus scélérat de tous les hommes, à un Antoine ? et le dieu Quirinus ne serait encore aujourd'hui que Romulus, si des bergers[56] ne s'étaient avisés d'en faire un dieu Cependant l'un[57] est le meurtrier de son frère et l'autre[58] de sa patrie. Et si le hasard n'avait donné cette année-là le consulat à Marc Antoine, César, tout dieu qu'il est maintenant, aurait été privé des honneurs funèbres qu'on rend aux hommes,[59] bien loin d'avoir reçu ceux qu'on ne défère qu'aux dieux. Pour Romulus, ce fut la douleur que le peuple romain ressentit de sa perte qui lui fit ajouter foi à Julius Proculus, qui, gagné par les sénateurs, protesta avec serment que ce roi lui était apparu tout brillant de gloire, et qu'il lui avait ordonné de dire de sa part à ses chers Romains de lui bâtir un temple sous le nom de Quirinus. Ce rapport de Proculus mit Romulus dans le ciel, et déchargea le sénat du soupçon de sa mort.
|
|
CAPUT XVI. Qua ratione dii esse non possint, quos sexus differentia discernit; et quod in naturam Dei non cadit officium generandi. Poteram iis, quae retuli, esse contentus; sed supersunt adhuc multa suscepto operi necessaria. Nam quam vis ipso religionum capite destructo, universa sustulerim, libet tamen prosequi caetera, et redarguere plenius inveteratam persuasionem, ut tandem homines suorum pudeat ac poeniteat errorum. Magnum hoc opus, et homine dignum. Relligionum animos nodis exsolvere pergo, ut ait Lucretius, qui quidem hoc efficere non poterat, quia nihil veri afferebat. Nostrum est hoc officium, qui et verum Deum asserimus, et falsos refutamus. Illi ergo, qui poetas finxisse de diis fabulas opinantur, et deas feminas et esse credunt et colunt, revolvuntur imprudentes ad id quod negaverant, coire illos, ac parere. Nec enim fieri potest, quin duo sexus generandi causa sint instituti. Recepta vero sexuum diversitate, non intelligunt consequens esse, ut concipiant: quod in Deum cadere non potest. Sed sit ut isti putant; nam et Jovis esse filios dicunt, et caeterorum deorum. Nascuntur ergo et quotidie quidem dii novi, nec enim vincuntur ab hominibus fecunditate. Igitur deorum innumerabilium plena sunt omnia, nullo scilicet moriente. Nam cum hominum vis incredibilis, numerus sit inaestimabilis, quos tamen, sicuti nascuntur, mori necesse est; quid deorum esse tandem putemus, qui tot saeculis nati sunt, immortalesque manserunt? Cur ergo tam pauci coluntur? nisi forte arbitramur, non generandi causa, sed tantummodo capiendae voluptatis duos esse sexus deorum; et ea exercere, quae homunculos et facere et pati pudet. Cum vero dicantur aliqui ex aliquibus nati, consequens est, ut semper nascantur; siquidem aliquando sunt nati: vel, si aliquando nasci desierunt, scire nos convenit, cur aut quando desierint. Non illepide Seneca in libris moralis Philosophiae: « Quid ergo est, inquit, quare apud poetas salacissimus Jupiter desierit liberos tollere? Utrum sexagenarius factus est, et illi lex Papia fibulam imposuit? an impetravit jus trium liberorum? an tandem illi venit in mentem: Ab alio expectes, alteri quod feceris, et timet, ne quis sibi faciat, quod ipse Saturno? » At isti, qui deos asserunt, videant quomodo respondeant huic argumento quod inferemus: Si duo sunt sexus deorum, sequitur concubitus; et si coeunt, et domos habeant necesse est, nec enim carent virtute ac pudore, ut hoc promiscue aut in propatulo faciant, sicut muta videmus facere animalia. Si domos habent, consequens est ut et urbes habeant, et quidem auctore Nasone qui ait:
Plebs habitat diversa locis; hac fronte potentes
Si habent urbes, et agros igitur habebunt. Jam, quis non videat quae sequantur? arare illos, et colere: quod quidem victus causa fit. Ergo mortales sunt. Quod argumentum retroversum idem valet. Si enim agros non habent, ne urbes quidem: si urbes non habent, ne domos quidem. Si domibus carent, ergo et concubitu. Si concubitus ab his abest, et sexus igitur femineus: in diis autem videmus et feminas esse; ergo dii non sunt. Dissolvat hoc argumentum, si quis potest. Ita enim res rem sequitur, ut haec ultima necesse sit confiteri. Sed ne illud quidem dissolvet aliquis. Ex duobus sexibus alter fortior, alter infirmior est. Robustiores enim mares sunt, feminae imbecilliores. Imbecillitas autem non cadit in deum; ergo nec femineus sexus. Huic additur superioris argumenti extrema illa conclusio, ut dii non sint, quoniam in diis et feminae sunt. CAPUT XVII. De Stoicorum eadem sententia; et ibi de deorum aerumnis et turpitudinibus. Ob has rationes Stoici alioversus deos interpretantur; et quia non pervident, quid sit in vero, conantur eos cum rerum naturalium ratione conjungere. Quos Cicero secutus, de diis, ac religionibus eorum hanc sententiam tulit: Videtisne igitur, ut a physicis rebus bene atque utiliter inventis tracta ratio sit ad commentitios ac fictos deos? quae res genuit falsas opiniones, erroresque turbulentos, et superstitiones pene aniles. Et formae enim deorum nobis, et aetates, et vestitus, ornatusque noti sunt: genera praeterea, conjugia, cognationes omnes, omniaque traducta ad similitudinem imbecillitatis humanae. Quid planius, quid verius dici potest? Romanae philosophiae princeps, et amplissimo sacerdotio praeditus, commentitios ac fictos deos arguit; quorum cultus superstitiones pene aniles esse testatur: falsis opinionibus, erroribusque turbulentis implicatos esse homines queritur. Nam totus liber tertius de Natura deorum omnes funditus religiones evertit ac delet. Quid ergo a nobis expectatur amplius? Num eloquentia superare possumus Ciceronem? minime id quidem; sed fiducia illi defuit ignoranti veritatem, quod ipse simpliciter in eodem opere confitetur. Ait enim facilius se posse dicere, quid non sit, quam quid sit; hoc est, falsa se intelligere, vera nescire. Clarum est igitur homines fuisse illos, qui dii putantur, et eorum memoriam post mortem consecratam esse. Ideo etiam aetates diversae sunt, et certae imagines singulorum, quod in eo habitu, et aetate simulacra eorum configurata sunt, in qua quemque mors deprehendit. Consideremus, si placet, aerumnas infelicium deorum. Isis filium perdidit; Ceres filiam; expulsa et per orbem terrae jactata, Latona vix insulam parvam (Delon), in qua pareret, invenit. Deum mater et amavit formosum adolescentem, et eumdem cum pellice deprehensum exsectis virilibus semivirum reddidit; et ideo nunc sacra ejus a Gallis sacerdotibus celebrantur. Juno pellices acerrime persecuta est, quia parere ipsa non potuit ex fratre. Insulam Samum scribit Varro prius Partheniam nominatam, quod ibi Juno adoleverit, ibique etiam Jovi nupserit. Itaque nobilissimum et antiquissimum templum ejus est Sami, et simulacrum in habitu nubentis figuratum, et sacra ejus anniversaria nuptiarum ritu celebrantur. Si ergo adolevit, si virgo fuit primo, postea mulier, hominem fuisse, qui non intelligit, pecudem se fatetur. Quid loquar obscoenitatem Veneris omnium libidinibus prostitutae, non deorum tantum, sed et hominum? Haec enim ex famoso Martis stupro genuit Harmoniam; ex Mercurio Hermaphroditum, qui est natus Androgynus; ex Jove Cupidinem; ex Anchise Aeneam; ex Bute Erycen; ex Adonio quidem nullum potuit, quod etiamtum puer ab apro ictus occisus est: quae prima, ut in Historia Sacra continetur, artem meretriciam instituit, auctorque mulieribus in Cypro fuit, uti vulgato corpore quaestum facerent: quod idcirco imperavit, ne sola praeter alias mulieres impudica, et virorum appetens videretur. Etiamne habet haec aliquid numinis? cujus plura numerantur adulteria, quam partus. Sed ne illae quidem virgines illibatam castitatem servare potuerunt. Unde enim putemus Erichthonium esse natum? an ex terra, ut poetae videri volunt? At res ipsa clamat. Nam cum Vulcanus diis arma fecisset, eique Jupiter optionem dedisset praemii quod vellet postulandi, jurassetque, ut solebat, per infernam paludem se nihil negaturum, tum faber claudus Minervae nuptias postulavit. Hic Jupiter Opt. Max. tanta religione constrictus abnuere non potuit: Minervam tamen monuit repugnare, pudicitiamque defendere. Tum in illa colluctatione Vulcanum in terram profudisse aiunt semen, unde sit Erichthonius natus; idque illi nomen impositum ἀπὸ τῆς ἔριδος, καὶ χθονὸς, id est, ex certamine atque humo. Cur igitur virgo eum puerum cum dracone conclusum et obsignatum tribus virginibus Cecropidis commendavit? evidens, ut opinor, incestum, quod nullo modo possit colorari. Altera cum pene amatorem suum perdidisset, qui erat Turbatis distractus equis praestantissimum medicum Asclepium curando juveni advocavit; eumque sanatum: Secretis alma recondit Sedibus, et nymphae Egeriae, nemorique relegat: Solus ubi in silvis Italis ignobilis aevum Exigeret, versoque ubi nomine Virbius esset. Quid sibi vult haec tam diligens, tam sollicita curatio? quid secretae sedes? quid relegatio vel tam longe, vel ad mulierem, vel in solitudinem? quid deinde nominis commutatio? Postremo, quid equorum tam pertinax abominatio? quid significant haec omnia, nisi conscientiam stupri, et amorem minime virginalem? Erat plane cur tantum laborem pro tam fideli juvene susciperet, qui amanti novercae obsequium pernegarat. CAPUT XVIII. De deorum consecratione propter collata in homines beneficia. Hoc loco refellendi sunt etiam ii, qui deos ex hominibus esse factos, non tantum fatentur, sed ut eos laudent etiam gloriantur, aut virtutis gratia, ut Herculem; aut munerum, ut Cererem ac Liberum; aut artium repertarum, ut Aesculapium ac Minervam. Haec vero quam inepta sint, quamque non digna propter quae homines inexpiabili se scelere contaminent, hostesque Deo vero fiant, quo contempto, mortuorum sacra suscipiunt, ex singulis rebus ostendam. Virtutem esse dicunt, quae hominem tollat in coelum: non illam, de qua philosophi disserunt, quae posita est in bonis animi; sed hanc corporalem, quae dicitur fortitudo: quae quoniam praecipua in Hercule fuit, immortalitatem meruisse creditur. Quis tam stulte ineptus est, ut corporis vires divinum vel etiam humanum bonum judicet; cum sint et majores pecudibus attributae, et uno morbo saepe frangantur, vel ipsa senectute minuantur et corruant? Itaque idem ille, cum deformari ulceribus toros suos cerneret, nec sanari se voluit, nec senem fieri, ne quando seipso minor aut deformior videretur. Hunc e rogo quo vivum se ipse combusserat, ascendisse in coelum putaverunt: eaque ipsa, quae stultissime admirati sunt, simulacris et imaginibus expressa et consecrata posuerunt, ut in perpetuum vanitatis eorum monimenta perstarent, qui ob necem bestiarum deos fieri credidissent. Sed haec Graecorum fortasse culpa sit, qui res levissimas pro maximis semper habuerunt. Quid nostri, num sapientiores? qui athleticam quidem virtutem contemnunt, quia nihil obest: sed regiam, quia late solet nocere, sic admirantur, ut fortes et bellicosos duces in deorum coetu locari arbitrentur; nec esse ullam aliam ad immortalitatem viam, quam exercitus ducere, aliena vastare, urbes delere, oppida excidere, liberos populos aut trucidare, aut subjicere servituti: videlicet quo plures homines afflixerint, spoliaverint, occiderint, eo se nobiliores, et clariores putant, et inanis gloriae specie capti, sceleribus suis nomen virtutis imponunt. Jam mallem, ut a ferarum caedibus deos sibi fingerent, quam immortalitatem tam cruentam probarent. Si quis unum hominem jugulaverit, pro contaminato ac nefario habetur, nec ad terrenum hoc domicilium deorum admitti eum fas putant. Ille autem, qui infinita hominum millia trucidaverit, cruore campos inundaverit, flumina infecerit, non modo in templum, sed etiam in coelum admittitur. Apud Ennium sic loquitur Africanus; Si fas endo plagas coelestum ascendere cuiquam est, Mi soli coeli maxima porta patet. Scilicet quia magnam partem generis humani extinxit ac perdidit. O quantis in tenebris, Africane, versatus es! vel potius, o poeta, qui per caedes et sanguinem patere hominibus in coelum ascensum putaveris! Cui vanitati et Cicero assensit: Est vero, inquit, Africane: nam et Herculi eadem ista porta patuit. Tamquam ipse plane, cum id fieret, janitor fuerit in coelo. Equidem statuere non possum, dolendumne potius, an ridendum putem; cum videam graves et doctos, et, ut sibi videntur, sapientes viros, in tam miserandis errorum fluctibus volutari. Si haec est virtus, quae nos immortales facit, mori quidem malim, quam exitio esse quamplurimis. Si aliter immortalitas parari non potest, nisi per sanguinent, quid fiet, si omnes in concordiam consenserint? Quod certe fieri poterit, si pernicioso et impio furore projecto, innocentes esse ac justi velint. Num igitur nemo erit coelo dignus? num peribit virtus, quia hominibus in homines saevire non dabitur? Sed isti, qui eversiones urbium populorumque summam gloriam computant, otium publicum non ferent; rapient, saevient, et injuriis insolenter illatis, humanae societatis foedus irrumpent, ut habere hostem possint, quem sceleratius deleant, quam lacessierint. Nunc ad reliqua pergamus. Nomen deorum Cereri ac Libero traditio munerum fecit. Possum divinis docere litteris, vinum atque fruges ante progeniem Coeli atque Saturni fuisse in usu hominum: sed ab his sane inventa esse fingamus. Num potest plus aut majus videri, collegisse fruges, hisque fractis, panem facere docuisse, aut uvas de vitibus lectas expressisse, vinumque fecisse, quam fruges ipsas, aut vites generasse, ac protulisse de terra? Reliquerit haec sane Deus humanis ingeniis eruenda: tamen fieri non potest, quin ipsius sint omnia, qui et sapientiam tribuit homini, ut inveniret, et illa ipsa, quae possent inveniri. Artes quoque suis inventoribus immortalitatem peperisse dicuntur, ut Aesculapio medicina, Vulcano fabrica. Colamus igitur et illos, qui fullonicam sutrinamque docuerunt. Cur autem figulinae repertori honos non habetur? an quia isti divites vas Samia contemnunt? Sunt et aliae artes, quarum repertores humanae vitae plurimum profuerunt. Cur non et illis attributa sunt templa? sed nimirum Minerva est, quae omnes reperit: ideoque illi opifices supplicant. Ergo ab his sordibus Minerva ascendit in coelum. Est vero cur quisquam derelinquat eum, qui terram cum animantibus, coelum cum astris et luminibus exorsus est, ut eam veneretur, quae telam docuit ordiri? Quid ille, qui vulnera in corporibus sanare docuit? num potest esse praestantior, quam qui corpora ipsa formavit, sentiendi ac vivendi rationem dedit? herbas denique ipsas, et caetera quibus medendi ars constat, excogitavit ac protulit? |
XVI. Ce que nous avons rapporté jusqu'ici pourrait peut-être suffire pour ébranler le culte des faux dieux; mais il nous reste encore beaucoup de choses à dire qui nous paraissent nécessaires au dessein que nous avons entrepris de le renverser entièrement. Car quoiqu'il semble que la tête de ce monstre étant abattue, le corps ait dû tomber par terre, nous estimons toutefois lui devoir encore porter quelques coups, et achever d'arracher de l'esprit des hommes cette fatale prévention où ils sont depuis si longtemps : heureux si nous pouvons leur inspirer une confusion salutaire, et un sincère repentir de leurs erreurs! l'entreprise est grande, mais elle est digne d'un homme, et elle n'est pas au-dessus de ses forces. Nous continuerons donc à dénouer ces nœuds, dont l'erreur tient les esprits embarrassés. C'est ce qu'un poète philosophe[60] avait entrepris de faire; mais en vain, puisque ne connaissant pas la vérité, il n'avait garde de détruire le mensonge; il n'appartient qu'à ceux qui adorent le vrai Dieu d'attaquer les faux dieux. Ceux qui accusent les poètes d'avoir mêlé des fables aux mystères de leur religion, en introduisant parmi les dieux une naissance semblable à la nôtre, et qui cependant croient que les sexes s'y rencontrent, tombent sans y penser dans l'impiété qu'ils condamnent. Car dès lors qu'ils admettent plusieurs sexes, ils ne peuvent se dispenser d'admettre la fin que la nature a eue lorsqu'elle a mis cette diversité entre l'un et l'autre; c'est-à-dire la naissance des enfants, ce qui ne saurait convenir à la divinité. Ils donnent des fils à Jupiter et aux autres dieux : ainsi chaque jour en voit naître de nouveaux, car ils auraient honte de céder aux hommes en fécondité. Cependant, comme il n'en meurt point, car les dieux sont immortels, le monde s'en remplira de telle sorte, qu'il ne sera pas assez grand pour les contenir tous. Que si le nombre des hommes qui sont sur la terre, et que la mort en retire après quelques années, est en quelque manière infini, puisqu'on ne le peut compter, quel doit être celui des dieux qui ne meurent point, et qui se multiplient depuis tant de siècles? Car dès qu'on suppose la naissance de quelques-uns, on doit supposer en même temps que cette divine race se perpétue toujours par de nouvelles naissances, et qu'il n'y a plus d'interruption, à moins qu'on ne nous apprenne ce qui la pourrait causer. Sénèque à ce sujet demande agréablement d'où vient que Jupiter, qui n'a jamais passé pour un dieu fort chaste, a sitôt cessé d'être père. Est-ce qu'il est sexagénaire, et ne lui est-il plus permis d'user du mariage? La loi Papia le lui défend-elle? Ou peut-être a-t-il allégué le privilège des trois enfants.[61] Ne serait-ce point aussi qu'il craint de mettre au monde un fils qui le traite comme il a traité le pauvre Saturne? Mais enfin si les deux sexes se trouvent parmi les dieux, il s'y doit faire des mariages : on sait les suites de ces engagements. Ils ont trop de pudeur et de retenue, pour exposer à la vue de tout le monde ce qui se doit passer en secret ; et il n'appartient qu'à un cynique effronté,[62] à des animaux sans raison et sans honte, de faire en public une action que la nature d'elle-même inspire de cacher. Il leur faut donc des maisons ou plutôt des palais; car comment des gens, accoutumés à loger dans des temples magnifiques, pourraient-ils se résoudre à vivre dans des cabanes ? Ovide, leur bon ami, y a pourvu ; il a eu soin de leur bâtir d'assez belles maisons dans le ciel, et même de les garnir de Pénates[63] : ces maisons forment des villes : ces villes sont environnées de campagnes propres au labourage ; il faut vivre; il faut semer de l'ambroisie, il faut cultiver du nectar : que conclurons-nous de cette induction, sinon que les dieux sont mortels? Que si l'on renverse l'argument, il n'aura pas moins de force ; car s'il paraît ridicule d'imaginer dans le ciel des plaines et des coteaux, il n'y a donc ni villes, ni maisons, ni ménages, ni sexes différents. D'où vient donc qu'on trouve des femmes parmi les dieux? C'est qu'en effet il est faux qu'il y ait des dieux. Que celui qui pourra dénouer ce nœud gordien le dénoue, aussi bien que celui-ci. Des deux sexes, l'un se distingue par la force, l'autre par la faiblesse. Qui osera dire que la divinité est susceptible de faiblesse? Qu'on ne dise donc plus que le sexe qui l'a reçue en partage se trouve parmi les dieux; mais s'il s'y trouve, c'est qu'il est faux qu'il y ait des dieux. XVII. Les stoïciens ne pouvant nier la justesse de ce raisonnement, se sont efforcés, comme nous en avons déjà touché quelque chose, de rapporter à des raisons naturelles tout ce qui regarde les dieux et le culte qu'on leur rend. Cicéron, qui les a suivis en ce point, nous explique ainsi leur sentiment : « Voyez-vous, dit-il, comme la nature, et les divers effets qu'elle produit pour le bien et l'utilité de l'homme, ont donné lieu aux faiseurs de fables d'inventer diverses espèces de dieux? C'est ce qui a causé ce déluge de fausses opinions, d'erreurs grossières, de contes ridicules dont toute la terre a été inondée. On est entré à l'égard de ces prétendues divinités dans des détails qui ne nous ont rien laissé ignorer de tout ce qui les concerne. Nous savons quelle est leur figure, leur âge, leurs habillements, leurs différentes parures. On a pris soin de nous informer de leur généalogie, de leurs mariages, de leurs alliances; le tout ajusté à l'infirmité humaine. » Peut-on rien dire de plus fort contre les faux dieux, que de les appeler des dieux faits à plaisir, de vaines productions de l'imagination. Cependant, celui qui les appelle ainsi est le prince de la philosophie romaine, un augure, un homme initié dans tous les mystères les plus saints et les plus augustes de sa religion. Il emploie même tout son troisième livre de la Nature des Dieux, à renverser les fondements de tous ces cultes impies et sacrilèges. Que peut-on attendre de nous après cela? Nous croit-on plus éloquent que Cicéron? Non sans doute; mais toute son éloquence ne l'a pu garantir des surprises de l'erreur, et il confesse lui-même avec une ingénuité digne d'un esprit aussi droit que le sien, qu'il n'entrevoit la vérité qu'au travers d'un nuage, et qu'il lui est bien plus facile de dire ce que Dieu n'est pas, que de dire ce qu'il est. Cela s'appelle connaître le faux et ignorer le vrai. Il faut donc encore le redire : il est plus clair que le jour que tous ces dieux n'ont été que des hommes, dont la mémoire a été consacrée par d'autres hommes ; et la différence qui se rencontre dans leur âge, leur habillement et leur figure, vient de ce que leurs images les représentent tels qu'ils étaient lorsqu'ils sont morts. Considérons maintenant les infortunes de ces misérables divinités. Isis perd son fils[64] ; Cérès perd sa fille[65] ; Latone trouve à peine un rocher pour faire ses couches. Personne n'osait la recevoir, de crainte de s'attirer l'indignation de Junon. La seule île de Délos fut assez charitable pour lui donner un asile contre la cruelle persécution de cette furieuse déesse, et elle y mit au monde Apollon et Diane. La mère des dieux, la bonne femme Cybèle, s'avise à son âge d'épouser un jeune homme.[66] Mais l'ayant surpris en commettant une infidélité, elle lui ôte le pouvoir de lui en faire jamais d'autre. Les prêtres gaulois, touchés de son malheur, et pour l'en consoler, instituèrent une fête en son honneur. La grande Junon, au désespoir de n'avoir point d'enfants de son frère,[67] se met à persécuter toutes ses maîtresses. Le docte Varron, au sujet de cette déesse, nous a laissé par écrit que l'île de Samos, qui lui est consacrée, portait autrefois le nom de Parthénie,[68] à cause qu'elle y avait passé sa première jeunesse; qu'elle y épousa ensuite Jupiter, et qu'en mémoire de ce mariage on y bâtit un temple qui subsiste encore, où l'on voit l'image de Junon vêtue en nouvelle Marie. Si donc elle a été jeune, si elle a été vierge, si elle a été mariée, quiconque après cela voudra la mettre au rang des dieux, ne mérite pas lui-même d'être mis au rang des hommes. Ne salissons point notre plume et la blancheur de ce papier par le récit des prostitutions de l'infâme Vénus, et par les désordres honteux mentionnés par les poètes.[69] XVIII. Il faut maintenant réfuter l'opinion impie tout ensemble et bizarre de ceux qui ne disconviennent pas, à la vérité, qu'il n'y ait plusieurs hommes dont on ait fait des dieux, mais qui soutiennent que c'est avec justice qu'on leur a donné un rang si fort au-dessus de leur condition de mortels ; et que c'est une récompense qui était due à leur mérite, soit pour avoir donné des marques d'une valeur extraordinaire, comme Hercule ; soit pour avoir enrichi la terre de nouvelles productions,[70] comme Cérès et Bacchus; soit enfin pour avoir inventé des arts en faveur de l'utilité publique, comme Esculape[71] et Minerve.[72] Examinons tous ces différents motifs de consécration, et montrons qu'il n'y en a aucun qui mérite que les hommes deviennent les ennemis de Dieu, et se rendent criminels envers lui de la plus horrible impiété, en lui ôtant l'honneur qui n'est dû qu'à lui seul pour le transférer à ses créatures. Commençons par ce qu'ils appellent vertu, non celle que les philosophes mettent au nombre des véritables biens de l'âme, mais celle qui consiste toute dans la force du corps et que l'on nomme valeur. C'est parce que cette valeur parut dans Hercule avec plus d'éclat, qu'elle lui acquit l'immortalité. Mais la force du corps, qui ne peut rendre l'homme ni meilleur, ni plus heureux, peut-elle contribuer à faire un dieu? Qu'y a-t-il de moins divin que cette force, puisqu'une maladie la détruit, et que la vieillesse la fait entièrement perdre. C'est ce qui faisait dire à ce fameux athlète qui voyait ses bras s'affaiblir insensiblement par des blessures qu'il y avait reçues, qu'il ne voulait ni de la santé qu'on lui promettait, ni de la vieillesse qu'on lui faisait espérer, de crainte de se voir un jour inférieur à lui-même, et de n'en être plus qu'une partie. Pour Hercule, on croit que du bûcher où il se brûla tout vif, il monta tout droit au ciel ; et on a légué aux siècles à venir cette imagination ridicule, en la gravant sur le bronze et la pierre, dont on s'est servi pour représenter les images d'un dieu à qui la divinité ne coûte que quelques coups de massue donnés à propos sur quelques bêtes sauvages. Peut-être rejettera-t-on une impiété si monstrueuse sur les Grecs, cette nation crédule, qui aime à faire passer des actions fort communes pour des prodiges éclatants? mais croit-on que nos Romains aient été en cela plus sages et plus circonspects? Ils font peu de cas à la vérité de cette force d'athlète, et ils ne regardent que comme des personnes viles et méprisables ceux qui l'ont reçue de la nature, quoique après tout cette vertu de gladiateur ne soit nuisible qu'à celui qui la possède. Mais ils n'ont que des louanges et de l'admiration pour celle qui fait les conquérants, parce qu'elle porte partout le fer et le feu. Ils ne croient pas qu'il y ait une voie plus glorieuse pour arriver à cette bienheureuse immortalité qui donne rang parmi les dieux, que de conduire des armées, désoler des provinces, ruiner des villes, renverser des trônes, assujettir des nations entières, et faire couler sur la terre des torrents de sang humain. Éblouis par l'état trompeur d'une gloire fausse, ils donnent à de grands crimes le nom et la récompense de la vertu. J'aime encore mieux les dieux des Grecs, puisque pour devenir dieu chez eux, il n'en coûte la vie qu'à des lions ou à des sangliers ; mais pour être dieu chez les Romains, il faut détruire les images vivantes et animées de Dieu même. Quoi ! pour avoir malheureusement ôté la vie à un homme, on est réputé immonde, l'entrée des temples est interdite, on est chassé de la présence des dieux! et on couvre de gloire, on place dans les temples, on associe aux dieux celui qui remplit tout d'horreur et de carnage, qui fait rougir les fleuves du sang de plusieurs milliers d'hommes! C'est dans cet esprit qu'Ennius fait parler ainsi le grand Scipion:[73] Si le ciel est ouvert à celui qui a répandu beaucoup de sang, nul conquérant n'eut jamais de droit que moi d'y entrer. O aveuglement déplorable du conquérant et du poète, de croire que, pour monter au ciel, des monceaux de corps qu'on aura privés de vie, puissent servir de degrés! Et Cicéron même ne rougit point d'applaudir à une vanité si peu humaine ; car répondant en quelque sorte à cette brutale saillie de Scipion: « Oui, grand africain, lui dit-il, vous avez droit d'y entrer, et le vaillant Hercule n'y entra jamais par une autre porte. » Comme si ce philosophe avait été de garde à la porte du ciel quand Hercule y fit son entrée. Et certes je ne sais si l'on doit rire ou verser des larmes, lorsqu'on voit de graves personnages si savants et si éclairés, et comme ils se le persuadent, si sages et si habiles, se laisser emporter à ces opinions populaires, et flotter toute leur vie entre l'erreur et la vérité, sans pouvoir se défendre de l'une ni embrasser l'autre. Si l'on doit l'immortalité à cette vertu meurtrière, je renonce à une vie qu'on ne peut obtenir que par la mort d'un million d'hommes. Mais de quel usage serait cette inhumaine vertu, que deviendraient tous ces prétendants à la divinité, si tous les hommes s'étaient donné le mot de vivre bien ensemble, si l'innocence et l'équité retournant parmi eux en chassaient l'envie, l'intérêt et l'injustice. Le ciel ne s'ouvrirait-il plus alors? N'y aurait-il plus d'hommes vertueux, s'il n'y avait plus de ces illustres homicides? Venons maintenant aux autres motifs qui ont obligé les hommes à faire des dieux. Nous trouvons que Cérès et Bacchus furent reconnus pour tels, pour avoir trouvé le blé et le raisin : mais c'est à tort qu'on croit leur devoir deux dons si précieux. Nous montrerons par les divines Écritures que le pain et le vin étaient en usage parmi les hommes, bien avant qu'on parlât dans le monde de Saturne et de sa race.[74] Supposons toutefois qu'une découverte si utile soit due à leurs soins : quoi, couper du blé, le moudre et en faire du pain ; cueillir des raisins, les fouler et en tirer du vin, qu'y a-t-il en tout cela qui mérite les honneurs du ciel ? S'ils sont dus à quelqu'un, c'est à celui qui a produit et qui a fait naître l'épi; c'est lui qui, après avoir créé toutes choses, a bien voulu laisser à l'homme la gloire d'en trouver quelques-unes? Mais il est toujours l'auteur des choses que l'homme découvre et de l'esprit dont l'homme se sert pour les découvrir. On veut encore que les arts aient acquis à leurs inventeurs ce beau droit de se faire adorer ; Esculape et Vulcain en jouissent paisiblement du consentement des peuples: l'un pour avoir inventé la médecine, et l'autre pour avoir exercé le premier le métier de forgeron. Je suis d'avis que nous fassions des dieux cordonniers et foulons. Et pourquoi l'art de la poterie, si ancien et si utile, n'obtiendra-t-il pas le même honneur à celui qui l'a trouvé ? Est-ce parce que les grands de la terre font peu d'état de ces ouvrages de Samos[75] ? Il y a tant d'autres arts qui contribuent à rendre la vie de l'homme ou commode ou agréable, qui travaillent ou pour la nécessité ou pour l'ornement ; pourquoi seront-ils sans autels et sans temples? Enfin, Minerve, comme les ayant inventés tous, est invoquée par tous les artisans : chose étrange ! On néglige le culte de celui qui a créé la terre et les animaux qui l'habitent, qui a formé le ciel et les astres qui l'éclairent, pour adorer le fuseau et l'aiguille de Minerve. Un Esculape se vante d'avoir trouvé quelques secrets pour rendre la santé au corps, et le voilà aussitôt dieu, pendant qu'on se met peu en peine de connaître celui qui a formé le corps, qui l'anime, qui le conserve, qui produit les simples dont se sert Esculape dans l'exercice de son art.
|
|
CAPUT XIX. Quod Deum verum simul cum diis vanis nemo possit colere. At enim dicet aliquis, et huic summo qui fecit omnia, et illis partim profuerunt, suam venerationem esse tribuendam. Primum nec factum est unquam, ut qui hos coluit, etiam Deum coluerit: neque fieri potest; quoniam si honos idem tribuitur aliis, ipse omnino non colitur, cujus religio est, illum esse unum ac solum Deum credere. Clamat summus poeta, eos omnes, Qui inventas vitam excoluere per artes, apud inferos esse, ipsumque illum repertorem medicinae talis et artis ad Stygias undas fulmine esse detrusum: ut intelligamus, quantum valeat pater omnipotens, qui et deos fulminibus extinguat. Sed homines ingeniosi hanc secum habebant fortasse rationem: quia Deus fulminari non potest, apparet non esse factum; immo vero, quia factum est, apparet hominem fuisse, non deum. Mendacium enim poetarum non in facto est, sed in nomine. Metuebant enim malum, si contra publicam persuasionem faterentur, quod erat verum. Quod si hoc constat inter ipsos, ex hominibus deos factos, cur ergo non credunt poetis, si quando illorum fugas, et vulnera, et mortes, et bella, et adulteria describunt? Quibus de rebus intelligi datur, non potuisse ullo pacto fieri deos: quia ne homines quidem probi fuerunt, eaque in vita sua gesserunt, quae mortem pariunt sempiternam. CAPUT XX. De diis Romanorum propriis et eorum sacris. Venio nunc ad proprias Romanorum religiones, quoniam de communibus dixi. Romuli nutrix lupa honoribus est affecta divinis. Et ferrem si animal ipsum fuisset, cujus figuram gerit. Auctor est Livius, Larentinae esse simulacrum, et quidem non corporis, sed mentis ac morum. Fuit enim Faustuli uxor, et propter vulgati corporis vilitatem, lupa inter pastores, id est, meretrix nuncupata est; unde etiam lupanar dicitur. Exemplum scilicet Atheniensium in ea figuranda Romani secuti sunt; apud quos meretrix quaedam nomine Leaena, cum tyrannum occidisset, quia nefas erat simulacrum constitui meretricis in templo, animalis effigiem posuerunt, cujus nomen gerebat. Itaque ut illi monimentum ex nomine, sic isti ex professione fecerunt. Hujus nomini etiam dies festus dicatus est, et Larentinalia constituta. Nec hanc solam Romani meretricem colunt, sed Faulam quoque, quam Herculis scortum fuisse Verrius scribit. Jam quanta ista immortalitas putanda est quam etiam meretrices assequuntur? Flora, cum magnas opes ex arte meretricia quaesivisset, populum scripsit haeredem, certamque pecuniam reliquit, cujus ex annuo foenore suus natalis dies celebraretur editione ludorum, quos appelant Floralia. Quod quia senatui flagitiosum videbatur, ab ipso nomine argumentum sumi placuit, ut pudendae rei quaedam dignitas adderetur. Deam finxerunt esse, quae floribus praesit, eamque oportere placari, ut fruges cum arboribus aut vitibus bene prospereque florescerent. Eum colorem secutus in Fastis poeta, non ignobilem nympham fuisse narravit, quae sit Chloris vocitata, eamque Zephyro nuptam, quasi dotis loco id accepisse muneris a marito, ut haberet omnium florum potestatem. Honeste quidem ista dicuntur; sed inhoneste turpiterque creduntur. Nec debent (cum veritas quaeritur) hujusmodi nos velamenta decipere. Celebrantur ergo illi ludi cum omni lascivia, convenienter memoriae meretricis. Nam praeter verborum licentiam, quibus obscoenitas omnis effunditur, exuuntur etiam vestibus populo flagitante meretrices, quae tunc mimarum funguntur officio, et in conspectu populi usque ad satietatem impudicorum luminum cum pudendis motibus detinentur. Cloacinae simulacrum in cloaca maxima repertum Tatius consecravit, et quia cujus esset effigies ignorabat, ex loco illi nomen imposuit. Pavorem, Palloremque Tullus Hostilius figuravit et coluit. Quid de hoc dicam, nisi dignum fuisse, qui semper deos suos (sicut optari solet) praesentes haberet? Ab hoc illud M. Marcelli de consecratione Honoris atque Virtutis, honestate nominum differt, re congruit. Eadem vanitate Mentem quoque inter deos collocavit senatus: quam profecto si habuisset, ejusmodi sacra nunquam suscepisset. Magnum Cicero audaxque consilium suscepisse Graeciam dicit, quod Cupidinum et Amorum simulacra in gymnasiis consecrasset; adulatus est videlicet Attico, et irrisit hominem familiarem. Non enim illud magnum, aut omnino consilium dicendum fuit, sed impudicorum hominum perdita et deplorata nequitia, qui liberos suos, quos erudire ad honesta deberent, prostituerunt libidini juventutis; a quibus flagitiorum deos, et in illis potissimum locis ubi nuda corpora corruptorum luminibus patent, et in illa coli aetate voluerunt, quae simplex et improvida prius irretiri, et in laqueos potest cadere, quam cavere. Quid mirum si ab hac gente universa flagitia manarunt? apud quam ipsa vitia religiosa sunt, eaque non modo non vitantur, verum etiam coluntur. Et ideo huic sententiae, tanquam Graecos prudentia vinceret, adjecit: « Virtutes enim oportere, non vitia consecrari. Quod si recipis, o Marce Tulli, non vides fore ut irrumpant vitia cum virtutibus, quia mala bonis adhaerent, et in animis hominum potentiora sunt; quae si vetas consecrari, respondebit tibi illa eadem Graecia, se alios deos colere, ut prosint, alios, ne noceant. » Haec enim semper excusatio est eorum, qui mala sua pro diis habent, ut Romani Rubiginem ac Febrem. Si ergo vitia consecranda non sunt, in quo tibi assentior, ne virtutes quidem. Non enim per se sapiunt, aut sentiunt, neque intra parietes, aut aediculas luto factas, sed intra pectus collocandae sunt, et interius comprehendendae, ne sint falsae, si extra hominem fuerint collocatae. Itaque praeclaram illam legem tuam derideo, quam ponis his verbis: « Ast illa, propter quae datur homini ascensus in coelum, mentem, virtutem, pietatem, fidem, earumque laudum delubra sunto. » Atqui haec separari ab homine non possunt. Si enim colenda sunt, in homine ipso sint necesse est. Si autem sunt extra hominem, quid opus est ea colere quibus careas? Virtus enim colenda est, non imago virtutis: et colenda est non sacrificio aliquo, aut thure, aut precatione solemni, sed voluntate sola atque proposito. Nam quid est aliud colere virtutem, nisi eam comprehendere animo, et tenere? quod unusquisque simul ac coepit velle, consequitur. Hic solus virtutis est cultus; nam religio et veneratio nulla alia, nisi unius Dei tenenda est. Quid igitur opus est, o vir sapientissime, supervacuis extructionibus loca occupare, quae possint humanis usibus cedere? quid sacerdotes constituere vana et insensibilia culturos? quid immolare victimas? quid tantos sumptus vel fingendis, vel colendis imaginibus impendere? Firmius et incorruptius templum est pectus humanum: hoc potius ornetur, hoc veris illis nominibus impleatur. Has ergo falsas consecrationes sequitur, quod necesse est. Qui enim virtutes sic colunt, id est qui umbras atque imagines virtutum consectantur, ea ipsa, quae vera sunt, tenere non possunt. Itaque nulla in quoquam virtus est, vitiis ubique dominantibus; nulla fides, omnia pro se unoquoque rapiente; nulla pietas, nec consanguineis nec parentibus parcente avaritia, et cupiditate in venena et in ferrum ruente; nulla pax, nulla concordia, publice bellis saevientibus, privatim vero inimicitiis usque ad sanguinem furentibus; nulla pudicitia, libidinibus effrenatis omnem sexum et omnes corporis partes contaminantibus: nec tamen desinunt ea colere, quae fugiunt et oderunt. Colunt enim thure ac summis digitis, quae sensibus intimis horrere debuerunt: qui error omnis ex illius principalis ac summi boni ignoratione descendit. Urbe a Gallis occupata, obsessi in Capitolio Romani, cum ex mulierum capillis tormenta fecissent, aedem Veneri Calvae consecrarunt. Non igitur intelligunt, quam vanae sint religiones, vel ex eo ipso, quod eas his ineptiis cavillantur. A Lacedaemoniis fortasse didicerant, deos sibi ex eventis fingere, qui cum Messenios obsiderent, et illi furtim deceptis obsessoribus egressi, ad diripiendam Lacedaemonem cucurrissent, a Spartanis mulieribus fusi fugatique sunt. Cognitis autem dolis hostium, Lacedaemonii sequebantur. His armatae mulieres obviam longius exierunt; quae cum viros suos cernerent parare se ad pugnam, quod putarent Messenios esse, corpora sua nudaverunt. At illi uxoribus cognitis, et aspectu in libidinem concitati, sicuti erant armati, permisti sunt utique promiscue; nec enim vacabat discernere. Sic juvenes ab iisdem antea missi, misti cum virginibus, ex quibus sunt Partheniae nati, propter hujus facti memoriam aedem Veneri armatae, simulacrumque posuerunt: quod tametsi ex causa turpi venit, tamen honestius videtur armatam Venerem consecrasse, quam calvam. Eodem tempore Jovi quoque Pistori ara posita est, quod eos in quiete monuisset, ut ex omni frumento, quod habebant, panem facerent, et in hostium castra jactarent; eoque facto soluta esset obsidio, desperantibus Gallis inopia subigi posse Romanos. Quae ista religionum derisio est? Si earum defensor essem, quid tam graviter queri possem, quam deorum nomen in tantum venisse contemptum, ut turpissimis nominibus ludibrio habeatur? Quis non rideat Fornacem deam, vel potius doctos viros celebrandis Fornacalibus operari? Quis, cum audiat deam Mutam, tenere risum queat? Hanc esse dicunt, ex qua sint nati Lares, et ipsam Laram nominant, vel Larundam. Quid praestare colenti potest, quae loqui non potest? Colitur et Caca, quae Herculi fecit indicium de furto boum, divinitatem consecuta, quia prodidit fratrem; et Cunina, quae infantes in cunis tuetur, ac fascinum submovet; et Stercutus, qui stercorandi agri rationem primus induxit; et Tutinus, in cujus sinu pudendo nubentes praesident, ut illarum pudicitiam prior deus delibasse videatur: et mille alia portenta, ut jam vaniores qui haec colenda susceperint, quam Aegyptios esse dicamus, qui monstruosa et ridicula quaedam simulacra venerantur. Et haec tamen habent aliquam imaginem. Quid? qui lapidem colunt informem atque rudem, cui nomen est Terminus? Hic est, quem pro Jove Saturnus dicitur devorasse; nec immerito illi honos tribuitur. Nam cum Tarquinius Capitolium facere vellet, atque in eo loco multorum deorum sacella essent, consuluit eos per auguria, utrum Jovi cederent; et cedentibus caeteris, solus Terminus mansit. Unde illum poeta Capitoli immobile saxum vocat. Jam ex hoc ipso quam magnus Jupiter invenitur, cui non cessit lapis, ea fortasse fiducia, quod illum de paternis faucibus liberaverat. Facto itaque Capitolio, supra ipsum Terminum foramen est in tecto relictum: ut quia non cesserat, libero coelo frueretur; quo ne ipsi quidem fruebantur, qui lapidem frui putaverunt. Et huic ergo publice supplicacatur, quasi custodi finium deo: qui non tantum lapis, sed etiam stipes interdum est. Quid de iis dicam, qui colunt talia? nisi ipsos potissimum lapides ac stipites esse? |
XIX. On me dira peut-être qu'il n'y a rien à la vérité de plus juste que d'honorer le Dieu qui a créé l'univers; mais que cela n'empêche pas que ceux qui ont rendu quelque service au public ne reçoivent leur part de cet honneur. Je réponds à cela : que le culte des créatures est incompatible avec celui du Créateur;[76] c'est ne lui en rendre aucun que de partager celui qu'on lui rend, parce que Dieu étant un et seul, la religion consiste dans une adoration indivisible. Écoutez le prince de vos poètes qui vous crie que tous ces inventeurs d'arts sont dans les enfers; qu'Esculape, le fameux Esculape, malgré les importants services qu'il a rendus à l'homme, a senti la main d'un Dieu plus puissant que lui, qui l'a renversé d'un coup de foudre et l'a envoyé herboriser sur les bords du Styx, pour vous apprendre quel doit être ce Dieu qui réduit les vôtres en poudre. On voudra peut-être me soutenir que la chose n'est pas, parce qu'il est impossible qu'un dieu soit foudroyé; et moi je dis que c'est parce qu'il a été foudroyé que ce n'était pas un dieu, mais un homme. La fiction du poète ne consiste pas dans le fait qui est véritable, mais dans le nom qui est faux.[77] Le poète craignait le peuple. Et qui aurait osé s'opposer à une erreur si universellement répandue? Concluons donc : que de l'aveu même de vos poètes, qui sont aussi vos théologiens, vos dieux souffrent pour leurs crimes dans les enfers, et ne sont pas des dieux; car qui peut faire un dieu d'un méchant homme? XX. Nous voici enfin arrivés à la religion des Romains. La louve qui nourrit Romulus se trouve la première dans le catalogue de leurs dieux. Je le souffrirais plus volontiers, si c'était en effet une de ces bêtes carnassières. Mais si nous en croyons Tite-Live, ce n'en est que la figure sous laquelle les Romains adorent une prostituée, une Larentine, à qui les bergers des environs d'Albe donnèrent le nom infâme de louve, pour marquer le honteux commerce dont elle se mêlait. Rome suivit en cela l'exemple d'Athènes, qui, ayant été délivrée de l'oppression où elle gémissait sous la tyrannie de Pisistrate par le moyen d'une courtisane, voulut témoigner sa reconnaissance à sa libératrice en la faisant déesse. Mais comme la loi ne permettait pas d'accorder cet honneur à une femme débauchée, les Athéniens trouvèrent le secret de l'éluder, en donnant à cette chaste divinité la figure d'une lionne, dont elle avait le nom et la générosité. Ainsi ce fut le nom qui dans Athènes mit une lionne parmi les dieux, et ce fut un métier honteux qui dans Rome y mit une louve. On institua même une fête solennelle qui fut nommée les Larentinales. Mais les Romains, les hommes du monde les plus compatissants à la faiblesse humaine, ne se contentèrent pas d'avoir élevé un autel à l'impudique Larentine, ils lui associèrent à cet honneur une nommée Faula de la même profession, qui avait, dit-on, mérité autrefois les bonnes grâces du grand Alcide.[78] De quel prix ne doit-elle pas être cette immortalité que des courtisanes obtiennent? Certes on peut dire qu'on récompensait en celles-ci les services qu'elles avaient rendus au public. La belle Flore ne vit-elle pas le jour de sa naissance célébré à Rome par des courses de chariots, de combats de gladiateurs, et par d'autres spectacles qui donnèrent à cette fête le nom de jeux Floraux. Et ce ne fut qu'à cette condition qu'elle légua au peuple romain les richesses immenses provenues de ses débauches et de l'incontinence de ses concitoyens. Mais parce que l'origine de cette fête ne paraissait pas fort honorable à la république, le sénat supprimant le nom de courtisane lui substitua celui de déesse qui préside aux fleurs, et déclara que les jeux floraux avaient été institués pour rendre cette déesse favorable au peuple romain, et pour l'engager par là à prendre soin des arbres fruitiers, de la vigne et des blés, lorsqu'ils sont en fleurs. Et ainsi les Romains couvrirent de fleurs les ordures de leur religion. Le poète,[79] dans ses Fastes, s'est conformé au décret du sénat, car il prétend que cette Flore était une nymphe de bonne maison qui fut donnée en mariage à Zéphire, et reçut de lui pour présent de noces le pouvoir sur toutes les fleurs. Cela est fort honnête à dire, mais cela est fort honteux à croire. Et pour nous qui cherchons la vérité, nous déchirons tous ces voiles, et nous ne nous laissons pas éblouir par le fard dont la poésie sait couvrir les objets qu'elle nous présente pour nous les faire trouver agréables sous cette beauté empruntée. Au reste ces jeux floraux se célèbrent d'une manière digne de celle dont ils portent le nom. Car on expose ce jour-là, à la vue de toute la ville de Rome, des courtisanes toutes nues qui, par des paroles déshonnêtes et des postures lascives qu'elles savent diversifier selon l'art des pantomimes,[80] corrompent les mœurs des spectateurs, et rassasient d'impureté, si l'on ose se servir de ce terme, les yeux et les oreilles du peuple. La déesse Cloacine viendra fort à propos après ces honnêtes déesses dont nous venons de parler. Tatius fit tirer sa statue de la grande Cloaque, et ne sachant de qui elle était, il lui donna le nom du lieu où il l'avait trouvée. Le roi Hostilius bâtit un temple à la Fièvre et à la Peur. Sa piété méritait bien que ces dieux ne l'abandonnassent jamais. Quoique Marcellus en consacrant un autel à l'Honneur et à la Vertu eût fait deux divinités dont le nom sans doute était moins odieux, leur existence n'en était pas pour cela moins chimérique. Le sénat, prévenu de la haute idée de son pouvoir, crut qu'il pouvait retendre jusqu'à faire des dieux; c'est ce qui lui fit rendre un arrêt par lequel il donnait à l'Entendement (Mens) le nom, la qualité et tout l'attirail des divinités de cette espèce, c'est-à-dire un temple et des prêtres. Mais cet auguste corps marque bien par une conduite si peu raisonnable qu'il n'était guère rempli du dieu dont il venait d'enrichir sa patrie. Cicéron estime que la Grèce fit un coup d'une haute sagesse, lorsqu'elle fit placer dans les écoles publiques et les académies où la jeunesse faisait ses exercices les images de l'Amour et de ses frères. Ce philosophe a voulu sans doute s'accommoder en cela aux sentiments de son ami Atticus, ou peut-être s'en railler. Car bien loin que la sagesse eût présidé à ce conseil, ce ne pouvait être au contraire que l'esprit de corruption qui l'eût inspiré aux Grecs, qui, au lieu de procurer à leurs enfants une éducation honnête et vertueuse, les prostituaient en quelque sorte aux désirs d'une jeunesse emportée, en leur proposant pour modèle de leurs actions, et pour objet de leur culte, des dieux qui ne sont connus que par leurs crimes, et surtout dans les lieux où la nudité des corps,[81] exposée aux yeux des corrupteurs, ne fait encore qu'augmenter le feu impur qui les brûle. Et ce qui est le plus déplorable, c'est que leurs propres pères les abandonnaient à ces périls dans un âge tendre, susceptibles de toute sorte d'impressions, dénués d'expérience et de force qui pût leur faire éviter les pièges tendus de toutes parts à leur innocence. Doit-on après cela être surpris si une nation qui, bien loin d'avoir de l'horreur pour les vices, les consacre par un culte religieux, les ait fait passer chez les autres peuples comme autant de divinités domestiques à la gloire desquelles elle s'intéresse? Cicéron, ne pouvant s'empêcher de reconnaître ce fait, et voulant en même temps insinuer qu'il avait des vues plus nettes et plus claires que les Grecs (quoiqu'il les eût d'abord loués de leur prudence), ajoute, comme par réflexion, que ce sont les vertus et non les vices qu'on doit consacrer. Mais les Grecs auraient pu lui répondre qu'ils adressaient leurs vœux à deux sortes de divinités : à celles qui sont bienfaisantes comme les vertus, pour en recevoir du secours, et à celles qui sont nuisibles, comme les vices, pour être préservés du mal qu'elles peuvent faire. C'est l'excuse ordinaire de ceux qui font des dieux de tout, des maux comme des biens. Mais s'il est vrai que les vices ne doivent pas s'attendre à notre encens et à nos vœux, en quoi nous sommes du sentiment de Cicéron, nous disons que les vertus ne doivent pas non plus y prétendre, qu'elles n'ont ni sentiment ni intelligence, et que ce n'est pas dans des temples de pierre et de marbre qu'on doit leur dresser des autels, mais au milieu du cœur de l'homme. C'est donc une loi ridicule que ce nouveau législateur[82] veut établir dans sa République en idée. « Qu'on élève, dit-il, des temples à l'Esprit, à la Piété, à la Valeur, à la Fidélité et à toutes les autres vertus qui donnent à l'homme l'entrée dans le ciel. » Ces divinités de Cicéron ne peuvent être sans l'homme seul, et l'homme seul leur peut servir de temple. C'est la vertu qui mérite notre vénération et non son image, et le culte qu'on lui rend ne consiste pas à brûler de l'encens devant elle, ni à égorger des bêtes sur son autel ; mais il consiste dans une volonté sincère et une ferme résolution qu'on prend de l'acquérir, ou de la conserver si elle est déjà acquise. Car qu'est-ce que révérer en soi la vertu, sinon la posséder et en exercer les actes ? C'est donc en vain que notre philosophe veut embarrasser les villes de nouveaux édifices, et occuper inutilement un terrain[83] qu'on peut faire servir à un meilleur usage. Nous voulons lui épargner les frais qu'il serait obligé de faire, soit pour l'entretien des prêtres, soit pour fondre des statues, soit pour acheter des victimes. Le cœur de l'homme est un temple bien plus digne de ces divinités morales ; il n'est point sujet à tomber en ruine, ou à être renversé d'un coup de tonnerre. Qu'on l'orne tant qu'on voudra, qu'on le remplisse de ces aimables déesses, qu'on en fasse un Panthéon, nous y consentons; plus il sera plein, plus il sera auguste. Il est à craindre que ceux qui placent dans les temples l'image de la vertu, n'en aient en effet que l'image. Ils l'adorent en figure, et ils la déshonorent en elle-même. On rend à la déesse Piété un culte extérieur et apparent, et l'on en rend un intérieur et véritable à l'Avarice qui n'épargne ni parents, ni citoyens, ni alliés. On donne de l'encens à la Paix et à la Concorde d'une main encore fumante du sang qu'on vient de répandre, ou dans une guerre publique, ou dans une querelle particulière. On sacrifie à la Pudicité des taureaux et des béliers, pendant que l'on immole son propre corps à la déesse de l'impureté. On fait des effusions, et l'on répand le lait et le vin devant l'autel de la Foi et l'Amitié, prêt à verser le poison à celui qui ne meurt pas assez tôt au gré d'un avide héritier. On fait semblant d'adorer la Vertu, et on la fuit; on feint d'avoir le Vice en horreur, et on l'adore. Mais achevons de démasquer la fausse religion, et d'en faire voir tout le ridicule. Quelle imagination aux Romains d'édifier un temple à Vénus la Chauve, parce qu'étant assiégés par les Gaulois, et les cordages dont ils remuaient leurs machines étant rompus par l'effort continuel qu'elles faisaient, ils en firent des cheveux de leurs femmes. Y eut-il jamais rien qui ait pu mieux faire connaître le faible d'une religion que ces sortes de monuments, plus propres à exciter la pitié ou la moquerie, que la dévotion ou la surprise? Sans doute que les Romains avaient appris des Lacédémoniens à se faire des dieux selon les événements, et à les recevoir des mains de la Fortune ; car ces habitants de Sparte[84] ayant mis le siège devant Messène, et les Messéniens les amusant par de fausses sorties, ils allèrent à leur tour assiéger Lacédémone; mais les femmes qui étaient restées dans la ville les repoussèrent vigoureusement, et, non contentes de les avoir chassés de devant leurs murailles, elles les poursuivirent bien avant dans la campagne. Cependant les Lacédémoniens s'étant aperçus du stratagème de leurs ennemis, et ayant appris qu'ils leur avaient donné le change, abandonnèrent leur siège, et coururent défendre leurs propres maisons ; ils n'en étaient pas fort éloignés lorsqu'ils rencontrèrent ces braves amazones qui retournaient de la poursuite des Messéniens, et, les prenant pour les Messéniens mêmes, ils se préparaient à les combattre ; mais ces vaillantes femmes se désarmèrent, et parurent si belles en cet état à leurs maris, qu'ils ne furent plus les maîtres de leur passion, qui devint si furieuse et si brutale, que tout se mêla, sans choix et sans discernement ; et, pour conserver la mémoire d'une aventure si mémorable et si digne de la curiosité des siècles suivants', on bâtit, au lieu où elle était arrivée, un temple magnifique à Vénus Armée. Mais, dans le même temps que les Romains élevaient un temple à Vénus la Chauve, ils en gratifièrent pareillement Jupiter le Boulanger, pour un service signalé qu'il venait de leur rendre dans ce fameux siège ; car il les avertit par des songes qu'ils fissent du pain de tout ce qu'il leur restait de blé, et qu'ils en jetassent dans le camp des ennemis : ce qui obligea les Gaulois d'abandonner la place, désespérant de la pouvoir forcer la voyant si bien munie. Quelle religion, grand Dieu ! où les sujets de plaisanterie naissent à chaque moment. Pour moi, si j'avais à la défendre, rien ne me ferait plus de peine que de voir ces pauvres divinités devenues à un tel point méprisables, qu'on ne peut même prononcer leurs noms sans rire. Quel est l'homme assez saturnien qui puisse garder son sérieux au nom de Fornace, déesse des forgerons, et en voyant de doctes personnages frapper gravement sur une enclume pour célébrer plus dévotement les Fornacales ? Et la déesse Muta, n'est-elle pas bien propre à secourir ceux qui l'invoquent, elle qui, étant privée dès sa naissance de l'usage de la parole, l'est aussi de celui de l'ouïe? Pour la déesse Caca, c'est une franche scélérate, car elle trahit son frère Hercule sur la promesse qu'on lui fit de la recevoir à la table des dieux. : La déesse des Berceaux (Cunina) est une assez bonne déesse ; elle est d'un grand secours pour les nourrices : c'est elle qui berce les enfants et qui les endort. Les laboureurs sont aussi fort redevables au dieu Sterculus, de leur avoir appris à fumer la terre. Je n'aurais jamais fini si je voulais rapporter ici le nom et les divers emplois de ces monstrueuses divinités,[85] qui ne cèdent en rien à celle des Égyptiens; encore celles-ci avaient-elles quelques figures déterminées. Mais que peut-on dire de ceux qui adorent une pierre brute et mal polie, qu'ils appellent le dieu Terme? c'est, dit-on, cette pierre que Saturne avala, croyant avaler son fils Jupiter. Lorsque Tarquin consacra le Capitole à ce maître des dieux, comme il se trouve là plusieurs petits dieux qui y avaient leurs chapelles, il leur fit demander honnêtement par les augures s'ils ne voulaient pas bien se retirer, et laisser la place à leur souverain; ils ne se le firent pas dire deux fois, et ils cédèrent de fort bonne grâce un logement destiné pour un dieu d'un tout autre relief qu'eux. Il n'y eut que le dieu Terme qui ne voulut jamais désemparer; peut-être crut-il devoir être traité avec distinction pour avoir sauvé la vie à Jupiter.[86] C'est ce dieu informe qui est le gardien des limites de l'empire; il les conserve, et il empêche que les barbares ne les franchissent. Au reste, ce dieu n'est pas toujours une pierre, c'est aussi quelquefois une souche. Tels dieux, tels adorateurs. Il faut être une vraie souche pour adorer une telle divinité.
|
|
CAPUT XXI. De diis Barbarorum quibusdam propriis, et eorum sacris, ac itidem de Romanis. Diximus de diis ipsis, qui coluntur: nunc de sacris ac mysteriis eorum pauca dicenda sunt. Apud Cyprios humanam hostiam Jovi Teucrus immolavit; idque sacrificium posteris tradidit, quod est nuper Hadriano imperante sublatum. Erat lex apud Tauros, inhumanam et feram gentem, uti Dianae hospites immolarentur; et id sacrificium multis temporibus celebratum est. Galli Hesum atque Teutatem humano cruore placabant. Nec Latini quidem hujus immanitatis expertes fuerunt, siquidem Latialis Jupiter etiamnunc sanguine colitur humano. Quid a diis boni precantur, qui sic sacrificant? Aut quid tales dii hominibus praestare possunt, quorum poenis propitiantur? Sed de Barbaris non est adeo mirandum, quorum religio cum moribus congruit. Nostri vero, qui semper mansuetudinis et humanitatis gloriam sibi vindicarunt, nonne sacrilegis his sacris immaniores reperiuntur? Hi enim potius scelerati sunt habendi, qui, cum sint liberalium disciplinarum studiis expoliti, ab humanitate desciscunt, quam qui rudes et imperiti ad mala facinora bonorum ignoratione labuntur. Apparet tamen antiquum esse hunc immolandorum hominum ritum: siquidem Saturnus in Latio eodem genere sacrificii cultus est, non quidem ut homo ad aram immolaretur, sed uti in Tiberim de ponte Milvio mitteretur. Quod ex responso quodam factitatum Varro auctor est; cujus responsi ultimus versus est talis: Καὶ κεφαλὰς Αἲδηι καὶ τῶι πατρὶ πέμπετε ψώτα. Quod quia videtur ambiguum et fax illi, et homo jaci solet. Verum id genus sacrificii ab Hercule, cum ex Hispania rediret, dicitur esse sublatum, ritu tamen permanente, ut pro veris hominibus imagines jacerentur ex scirpo; ut Ovidius in Fastis docet:
Donec in haec venit Tirynthius arva, quotannis Nam de infantibus, qui eidem Saturno immolabantur propter odium Jovis quid dicam, non invenio; tam barbaros, tam immanes fuisse homines, ut parricidium suum, id est tetrum atque execrabile humano generi facinus, sacrificium vocarent: cum teneras atque innocentes animas, quae maxime est aetas parentibus dulcior, sine ullo respectu pietatis extinguerent, immanitatemque omnium bestiarum, quae tamen foetus suos amant, feritate superarent! O dementiam insanabilem! Quid illis isti dii amplius facere possent, si essent iratissimi, quam faciunt propitii? cum suos cultores parricidiis inquinant, orbitatibus mactant, humanis sensibus spoliant? Quid potest esse his hominibus sancti? Aut quid in profanis locis facient, qui inter aras deorum summa scelera committunt? Pescennius Festus in libris Historiarum per Satyram refert, Carthaginenses Saturno humanas hostias solitos immolare: et cum victi essent ab Agathocle, rege Siculorum, iratum sibi Deum putavisse; itaque ut diligentius piaculum solverent, ducentos nobilium filios immolasse.
Tantum relligio potuit suadere malorum, Cui ergo dementissimi homines illo sacrificio consulebant? cum tantam partem civitatis occiderent, quantam fortasse ne Agathocles quidem victor occiderat. Ab isto genere sacrorum non minoris insaniae judicanda sunt publica illa sacra: quorum alia sunt matris deum, in quibus homines suis ipsi virilibus litant; amputato enim sexu, nec viros se, nec foeminas faciunt: alia Virtutis, quam eamdem Bellonam vocant, in quibus ipsi sacerdotes non alieno, sed suo cruore sacrificant. Sectis namque humeris, et utraque manu districtos gladios exerentes, currunt, efferuntur, insaniunt. Optime igitur Quintilianus in Fanatico; « Istud, inquit, si Deus cogit, iratus est. » Etiamne haec sacra sunt? Nonne satius est pecudum more vivere, quam deos tam impios, tam profanos, tam sanguinarios colere? Sed unde isti errores et haec tanta flagitia manaverint, suo loco disseremus: interim videamus et caetera, quae carent scelere, ne studio insectandi videamur eligere pejora. Isidis Aegyptia sacra sunt, quatenus filium parvulum vel perdiderit, vel invenerit. Nam primo sacerdotes ejus, deglabrato corpore, pectora sua tundunt; lamentantur, sicut ipsa, cum perdidit, fecerat. Deinde puer producitur quasi inventus, et in laetitiam luctus ille mutatur: ideo Lucanus: . . . . Nunquamque satis quaesitus Osiris. Semper enim perdunt, et semper inveniunt. Refertur ergo in sacris imago rei, quae vere gesta est, quae profecto, si quid sapimus, declarat mortalem mulierem fuisse, ac pene orbam, nisi unicum reperisset. Quod illum ipsum poetam minime fugit, apud quem Pompeius adolescens, morte patris audita, haec loquitur:
Evolvam busto jam numen gentibus Isim; Hic est Osiris, quem Serapim vel Serapidem vulgus appellat. Solent enim mortuis consecratis nomina immutari; credo, ne quis putet eos homines fuisse. Nam et Romulus post mortem Quirinus factus est; et Leda, Nemesis; et Circe, Marica; et Ino, postquam se praecipitavit, Leucothea, materque Matuta; et Melicertes filius ejus, Palaemon, atque Portumnus. Sacra vero Cereris Eleusinae non sunt his dissimilia. Nam sicut ibi Osiris puer planctu matris inquiritur; ita hic ad incestum patrui matrimonium rapta Proserpina: quam quia facibus ex Aetnae vertice accensis quaesisse in Sicilia Ceres dicitur, idcirco sacra ejus ardentium taedarum jactatione celebrantur. Apud Lampsacum Priapo litabilis victima est asellus: cujus sacrificii ratio in Fastis haec redditur: Cum dii omnes ad festum matris magnae convenissent, epulisque satiati noctem lusibus ducerent, quievisse humi Vestam, somnumque cepisse: ibi Priapum somno ejus ac pudicitiae insidiatum; sed illam intempestivo clamore aselli, quo Silenus vehebatur excitatam, libidinem vero insidiatoris esse deceptam; hac de causa Lampsacenos asellum Priapo, quasi in ultionem, mactare consuevisse; apud Romanos vero eumdem Vestalibus sacris in honorem pudicitiae conservatae panibus coronari. Quid turpius? quid flagitiosius? quam si Vesta beneficio asini virgo est? At poeta fabulam finxit. Num ergo illud est verius, quod referunt ii, qui Φαινόμενα conscripserunt, cum de duabus Cancri stellis loquuntur, quas Graeci ὄνους vocant? asellos fuisse, qui Liberum patrem transvexerint, cum amnem transire non posset; quorum alteri hoc praemium dederit, ut humana voce loqueretur: itaque inter eum, Priapumque ortum esse certamen de obscoeni magnitudine; Priapum victum et iratum, interemisse victorem. Hoc vero multo magis ineptum est; sed poetis licet quidquid velint: non excutio tam deforme mysterium, nec Priapum denudo, ne quid appareat risu dignum. Finxerunt haec sane poetae; sed necesse est alicujus majoris turpitudinis tegendae gratia ficta sint. Quae sit ergo quaeramus. At ea profecto manifesta est. Nam sicut Lunae taurus mactatur, quia similiter habet cornua, et Placat equo Persis radiis Hyperiona cinctum, Ne detur celeri victima tarda Deo. Ita in hoc quia magnitudo membri virilis enormis est, non potuit ei monstro aptior victima reperiri, quam quae ipsum, cui mactatur, posset imitari. Apud Lindum, quod est oppidum Rhodi, Herculis sacra sunt, quorum a caeteris longe diversus est ritus: siquidem non εὐφημίαι (ut Graeci appellant), sed maledictis, et execratione celebrantur; eaque pro violatis habent, si quando inter solemnes ritus vel imprudenti alicui exciderit bonum verbum. Cujus rei haec ratio redditur, si tamen ulla esse in rebus vanissimis potest: Hercules, cum eo delatus esset, famemque pateretur, aratorem quemdam aspexit operantem, ab eoque petere coepit, ut sibi unum bovem venderet. Enimvero ille negavit fieri posse, quia spes sua omnis colendae terrae duobus illis juvencis niteretur. Hercules, solita violentia usus, quia unum accipere non potuit, utrumque sustulit. At ille infelix, cum boves suos mactari videret, injuriam suam maledictis ultus est. Quod homini eleganti et urbano gratissimum fuit. Nam dum comitibus suis epulas apparat, dumque alienos boves devorat, illum sibi amarissime conviciantem, cum risu et cachinnis audiebat. Sed postquam Herculi divinos honores ob admirationem virtutis deferri placuit, a civibus ei ara posita est, quam de facto βούζυγον nominavit, ad quam duo juncti boves immolarentur, sicut illi quos abstulerat aratori; eumque ipsum sibi constituit sacerdotem, ac praecepit, ut iisdem maledictis semper in celebrandis sacrificiis uteretur, quod negaret se unquam epulatum esse jucundius. Haec jam non sacra sunt, sed sacrilegia, in quibus id sanctum dicitur, quod in aliis, si fiat, etiam severissime vindicatur. Ipsius autem Cretici Jovis sacra quid aliud quam quomodo sit aut subtractus patri, aut nutritus ostendunt? Capella est Amaltheae nymphae, quae uberibus suis aluit infantem; de qua Germanicus Caesar in Arataeo carmine sic ait:
. . . . . Illa putatur ujus capellae corio usum esse pro scuto Jovem contra Titanas dimicantem Musaeus auctor est: unde a poetis ἀιγίοχος nominatur. Ita quidquid est gestum in abscondendo puero, id ipsum per imaginem geritur in sacris. Sed et matris ejus mysterium idem continet, quod Ovidius exponit in Fastis:
Ardua jamdudum resonat tinnitibus Ide; Hanc totam opinionem, quasi a poetis fictam, Salustius respuit, voluitque ingeniose interpretari, cur altores Jovis dicantur Curetes fuisse; et sic ait: Quia principes intelligendi divini fuerunt, vetustatem ut caetera in majus componentem, altores Jovis celebravisse. Quantum erraverit homo eruditus, jam res ipsa declarat. Si enim princeps est Jupiter, et deorum et religionum; si ante illum dii nulli colebantur vulgo, quia nondum nati fuerant, qui coluntur; apparet Curetes ex diverso principes fuisse divini non intelligendi, per quos error omnis inductus est, et Dei veri memoria sublata. Ex ipsis itaque mysteriis et ceremoniis intelligere debuerunt, hominibus se mortuis supplicare. Non igitur exigo, ut aliquis poetarum fictionibus credat. Qui hos mentiri putat, Pontificum ipsorum scripta consideret, et quidquid est litterarum ad sacra pertinentium revolvat: plura fortasse, quam nos afferimus, inveniet, ex quibus intelligat, inania inepta, commentitia esse omnia, quae pro sanctis habentur. Si quis autem, percepta sapientia, deposuerit errorem, profecto ridebit ineptias hominum pene dementium; illos dico, qui vel inhonesto saltatu tripudiant, vel qui nudi, uncti, coronati, personati, aut luto obliti currunt. Quid de scutis jam vetustate putridis dicam? quae cum portant, deos ipsos se gestare humeris suis arbitrantur. Nam Furius Bibaculus inter praecipua pietatis exempla numeratur, qui cum praetor esset, tamen lictoribus praeeuntibus, ancile portavit, cum haberet, magistratus beneficio, muneris ejus vacationem. Non ergo ille Furius, sed plane furiosus fuit, qui praeturam hoc ministerio se putavit ornare. Merito igitur, cum haec a viris non imperitis ac rudibus fiant, Lucretius exclamat: O stultas hominum mentes, o pectora caeca! Qualibus in tenebris vitae, quantisque periclis Degitur hoc aevi, quodcumque est! Quis haec ludibria non rideat, qui habeat aliquid sanitatis? cum videat homines velut mente captos ea serio facere, quae si quis faciat in lusu, nimis lascivus et ineptus esse videatur. CAPUT XXII. Quid auctor praedictarum vanitatum in Italia apud Romanos fuerit, et quis apud alias gentes. Harum vanitatum apud Romanos auctor et constitutor Sabinus ille rex fuit, qui maxime animos hominum rudes atque imperitos novis superstitionibus implicavit: quod ut faceret aliqua cum auctoritate, simulavit cum dea Egeria nocturnos se habere congressus. Erat quaedam spelunca peropaca in nemore Aricino, unde rivus perenni fonte manabat; huc, remotis arbitris, se inferre consueverat, ut mentiri posset, monitu deae conjugis ea sacra populo se tradere quae acceptissima diis essent: videlicet astutiam Minois voluit imitari: qui se in antrum Jovis recondebat, et ibi diu moratus, leges tamquam sibi a Jove traditas afferebat, ut homines ad parendum non modo imperio, sed etiam religione constringeret. Nec difficile sane fuit persuadere pastoribus. Itaque pontifices, flamines, salios, augures creavit, deos per familias descripsit. Sic novi populi feroces animos mitigavit, et ad studia pacis a rebus bellicis avocavit. Sed cum alios falleret, seipsum tamen non fefellit; nam post annos plurimos, Cornelio et Bebio coss., in agro scribae Petilii sub janiculo arcae duae lapideae sunt repertae a fossoribus, quarum in altera corpus Numae fuit, in altera septem latini libri de jure pontificio, item graeci totidem de disciplina sapientiae scripti, quibus religiones, non eas modo, quas ipse instituerat, sed omnes praeterea dissolvit. Qua re ad senatum delata, decretum est, ut hi libri abolerentur: ita eos Q. Petilius Praetor urbanus in concione populi concremavit, insipienter id quidem. Quid enim profuit, libros esse combustos? cum hoc ipsum, quod sunt ideo combusti, quia religionibus derogabant, memoriae sit traditum? Nemo ergo tunc in senatu non stultissimus. Potuerunt enim et libri aboleri, et res tamen in memoriam non exire. Ita dum volunt etiam posteris approbare quanta pietate defenderint religiones, auctoritatem religionum ipsarum testando minuerunt. Sed ut Pompilius apud Romanos institutor ineptarum religionum fuit: sic ante Pompilium Faunus in Latio, quin et Saturno avo nefaria sacra constituit, et Picum patrem inter deos honoravit, et sororem suam Fatuam Faunam, eamdemque conjugem consecravit; quam Gabius Bassus Fatuam nominatam tradit, quod mulieribus fata canere consuevisset, ut Faunus viris. Eamdem Varro scribit tantae pudicitiae fuisse, ut nemo eam, quoad vixerit, praeter virum suum mas viderit, nec nomen ejus audierit. Idcirco illi mulieres in operto sacrificant, et bonam deam nominant. Et Sextus Clodius in eo libro, quem graece scripsit, refert Fauni hanc uxorem fuisse, quae quia contra morem decusque regium clam vini ollam ebiberat, et ebria facta erat, virgis myrteis a viro usque ad mortem caesa. Postea vero cum eum facti sui poeniteret, et desiderium ejus ferre non posset, divinum illi honorem detulisse; idcirco in sacris ejus obvolutam vini amphoram poni. Reliquit ergo posteris Faunus quoque non parum erroris, quem tamen prudentes quique perspiciunt. Nam Lucilius eorum stultitiam, qui simulacra deos putant esse, deridet his versibus:
Terricolas Lamias Fauni, quas Pompiliique
Poeta quidem stultos homines infantibus
comparavit. At ego multo imprudentiores esse dico. Illi enim simulacra homines
putant esse, hi deos. Illos aetas facit putare quod non est, hos stultitia. Illi
utique brevi desinunt falli, horum vanitas et durat, et semper crescit. Sacra
Liberi Patris primus Orpheus induxit in Graeciam, primusque celebravit in monte
Boeotiae Thebis, ubi Liber natus est, proximo, qui cum frequenter citharae cantu
personaret, Citeron appellatus est. Ea sacra etiamnunc Orphica nominantur, in
quibus ipse postea dilaceratus, et carptus est, et fuit per eadem fere tempora,
quibus Faunus. Sed quis aetate praecesserit, dubitari potest: siquidem per
eosdem annos Latinus Priamusque regnaverunt; item patres eorum Faunus et
Laomedon, quo regnante, Orpheus cum Argonautis ad Iliensium littus accessit. |
XXI. Après avoir parlé des dieux, de leur origine, de leurs emplois et de leurs diverses aventures, il nous reste encore quelque chose à dire des sacrifices qu'on leur offre, et des mystères qui sont enfermés dans le culte qu'on leur rend. A Salamine, ville de Cypre, on immolait un homme à Jupiter ; ce fut Teucer qui institua cet horrible sacrifice, et qui en prescrivit la forme à ses descendants. L'empereur Adrien le fit cesser. Les peuples de la Tauride, nation féroce, avaient une loi qu'ils observèrent fort longtemps, qui leur ordonnait de sacrifier à Diane tous les étrangers que leur mauvaise fortune jetait sur leurs côtes; et les anciens Gaulois apaisaient avec du sang leurs dieux Hésus, Teutatès et Taramis. Les Latins ne furent pas plus innocents ni moins barbares dans leurs sacrifices ; et le Jupiter du Latium[87] n'aimait pas moins le sang des hommes que le Jupiter de Salamine. Quelle vertu peut-on demander à ces dieux par un sacrifice qui est un crime? et quel bien ces dieux peuvent-ils faire, si on ne peut l'obtenir que par un homicide? Mais il n'est pas étonnant que des barbares aient une religion conforme à leurs mœurs, et des dieux qui leur ressemblent. Ce qui doit surprendre, c'est de voir l'Italie, qui a toujours fait gloire d'élever ses peuples dans l'humanité, de voir, dis-je, l'Italie surpasser les barbares en cruauté, en répandant avec fureur le sang humain dans ces cérémonies impies et sacrilèges. Ceux qui, joignant la politesse des mœurs aux lumières de l'esprit, éteignent en quelque sorte ces lumières, et renoncent à cette politesse pour devenir barbares par un motif de religion, sont sans doute bien plus coupables que ceux qui, nés dans l'ignorance des lois et parmi les ténèbres d'une nature corrompue, font le mal souvent parce qu'ils ne connaissent pas le bien. Il y avait même longtemps que cette coutume d'immoler des hommes avait cours en Italie (avant que l'empereur Adrien ne l'abrogeât) ; et Saturne se plaisait à un culte si digne d'un dieu qui avait plus d'une fois bu le sang de ses enfants. Mais pour diversifier les mets qu'on lui présentait, on n'égorgeait pas la victime comme on faisait ailleurs, mais on la précipitait du pont Milvius[88] dans le Tibre. On dit qu'Hercule, à son retour d'Espagne, abolit ce sacrifice, et en laissa seulement une vaine représentation, qui consistait à faire sauter du pont en bas des hommes de bois ou de carton. Mais où prendre des couleurs assez sombres pour peindre ces horribles hécatombes d'enfants immolés au même Saturne, pour le consoler de ce qu'un seul[89] lui avait échappé? A quel excès d'horreur les hommes ne sont-ils point capables de se porter par un excès de religion On appelle sacrifice le crime le plus opposé à la nature; on étouffe dans le berceau des créatures qui ne commencent qu'à vivre, et qui, par toute l'innocence de leur âge, ne peuvent exciter le moindre mouvement de compassion dans le cœur de leurs impitoyables pères, et obtenir d'eux qu'ils ne leur ôtent pas ce qu'ils ne viennent que de leur donner. Les animaux les plus farouches le sont beaucoup moins que ces hommes dénaturés. O pères infortunés ! quelle aveugle fureur vous agite ? et que pourraient faire de pis vos dieux, si vous aviez mérité leur indignation ? Leur colère, dites-moi, pourrait-elle vous être plus funeste? Pour prix de vos hommages ils vous rendent parricides, ils vous privent de vos enfants, ils vous ôtent la raison : est-ce ainsi que s'exprime leur reconnaissance? comment, hélas! s'exprimerait leur haine? Mais que peut-il y avoir d'inviolable et de sacré pour des hommes qui ont dépouillé tous les sentiments de la nature? On doit tout craindre de celui qui fait un acte de religion du plus grand de tous les crimes. Les Carthaginois qui, au rapport du satirique Festus, suivaient aussi cette barbare coutume, ayant été vaincus dans un combat par Agathocle, roi de Sicile, et attribuant leur défaite à la colère de leur dieu, coururent l'apaiser en lui immolant deux cents jeunes gens, qu'ils choisirent parmi leur plus illustre noblesse. Misérables ! quel avantage vous revient-il de ce massacre? Celui qui vous a vaincus vous a moins tué de citoyens que celui qui vous protège. Mais Saturne n'est pas le seul des dieux qui aime à voir répandre le sang des hommes. Cybèle inspire une autre sorte de fureur à ceux qui sont initiés à ses détestables mystères. Elle les oblige à lui sacrifier de leurs propres mains ce que sa jalousie arracha au malheureux Athis; et ces infâmes victimes d'une plus infâme divinité deviennent, par un culte aussi bizarre qu'il est cruel, des monstres que la nature abhorre. Pour Bellone, déesse de la guerre, on ne doit pas s'étonner si elle aime le sang. Ses prêtres, tenant à chaque main un poignard, se font des incisions aux bras et aux épaules; et, s'abandonnant à l'esprit de vertige qui les pousse, ils courent, ils se roulent, ils s'agitent ; leur sang coule de toutes parts, et leur raison se perd avec lui. Sont-ce là des sacrifices, s'écrie Quintilien, et ne vaudrait-il pas bien mieux être comme les bêtes, qui ne connaissent point d'autres dieux que la sage nature, que de rendre un culte impie et profane à des scélérats, à des dieux barbares, qui s'engraissent du sang des trop crédules mortels. Nous découvrirons une autre fois la source de tant d'erreurs grossières et de crimes énormes. Et de peur qu'on ne nous soupçonne d'affectation, dans le récit que nous venons de faire des horribles excès qui se commettent dans les sacrifices, nous allons examiner quelques cérémonies qui sont, à la vérité, exemptes de crimes, mais que nous aurons de la peine à sauver du ridicule. Toute l'Egypte célèbre avec beaucoup de solennité la fête d'Isis, et cette fête se diversifie suivant les divers événements de la vie de la déesse ; car d'abord les prêtres qui lui sont consacrés se découvrant l'estomac, se le frappent rudement, poussent des cris lamentables, et donnent toutes les marques d'une violente affliction, pour honorer celle que ressentit Isis lorsqu'elle perdit son fils.[90] Mais, dès que l'enfant vient à paraître, tout ce grand deuil cesse, et la joie de l'avoir retrouvé succède à la douleur de l'avoir perdu. Ainsi, ce fils si cher à sa mère, sans cesse se perd, et sans cesse se retrouve. On voit clairement, par la représentation d'une aventure autrefois arrivée, que cette Isis, si révérée des Égyptiens, n'était qu'une femme qui se serait trouvée sans enfants, si son fils unique ne lui eût été rendu. Lucain ne s'éloigne pas de cette pensée, lorsqu'il fait dire au jeune Pompée, qui vient d'apprendre la mort du grand Pompée son père:[91] « J'irai, et l'Egypte me verra mettre le feu au bûcher qui consumera ses dieux[92] ; je donnerai aux vents les cendres d'Isis et d'Osiris. » Cet Osiris est aussi quelquefois nommé par le peuple Sérapis ; car ils ont coutume de changer le nom de ceux qu'ils consacrent après leur mort, de crainte peut-être que leur premier nom ne les fasse reconnaître pour des hommes. Romulus fut ainsi changé en Quirinus ; Léda reçut le nom de Némésis; Circé celui de Marica; Ino et son frère Mélicerte ceux de Leucothoé et de Palémon. On observe presque les mêmes cérémonies à la fête de Cérès Eleusine qu'à celle d'Isis; car si l'on pleure à celle-ci la perte d'Osiris, on se lamente fort à celle-là pour la perte de Proserpine, que son oncle Pluton a enlevée, sans se mettre beaucoup en peine de ce que le monde pourrait dire de voir un dieu commettre un rapt et un inceste. Et, parce que la tradition poétique porte que ce fut avec des branches de pin allumées que Cérès se mit à chercher sa fille par toute la Sicile, on allume quantité de torches durant cette fête. A Lampsaque,[93] on sacrifie un âne à Priape: et l'on en rapporte cette raison. Les dieux s'étant trouvés à un festin solennel que Cybèle leur donnait, ils se mirent, après souper, à jouer à de petits jeux ; mais Vesta, accablée de sommeil (peut-être pour avoir trop bu), s'endormit profondément, sans chercher d'autre lit que le plancher de la salle. Ce qu'apercevant Priape, il s'approcha d'elle, et était sur le point de la déshonorer, si l'âne de Silène ne se fût mis à braire fort à propos pour la pauvre déesse, qui s'éveilla au cri, et sauva ainsi son honneur qui courait grand risque: or, les habitants de Lampsaque, fort dévoués à Priape, lui sacrifient tous les ans un âne, pour le venger du mauvais tour que cet animal lui joua dans une si nombreuse et si sainte assemblée. Quels dieux ! quelle religion! Mais si l'âne reçoit à Lampsaque un traitement si rude pour avoir empêché une mauvaise action, il en reçoit en récompense un fort honorable à Rome, où les vestales, pour reconnaître le service important qu'il rendit à leur déesse,[94] choisissent un des plus beaux ânes de la ville, lui font une guirlande de pains fort délicats et fort blancs, qui servent ensuite à lui faire un bon repas. Quelle honte à une déesse de devoir à un âne la conservation de sa virginité ! On me dira que ce n'est qu'une fable: je le veux; mais cette fable est reçue des peuples comme une vérité et comme un point capital de leur religion. Je sais que les poètes ne prétendent pas assujettir notre créance à leurs folles imaginations; mais elles ne trouvent que trop d'ouvertures pour s'insinuer dans l'esprit des hommes, qui sont ravis de trouver dans leurs dieux ce qui peut autoriser et pour ainsi dire consacrer leurs vices. Que dirons-nous des astronomes qui placent sérieusement deux ânes parmi les étoiles[95] ? Ont-ils aussi prétendu nous laisser la liberté de n'en rien croire ? Cependant on nous assure que ce beau privilège leur a été accordé à la sollicitation de Bacchus, qui, en leur procurant un logement si magnifique, a voulu les payer du service qu'ils lui rendirent au passage d'un fleuve. Peut-on rien écrire de plus extravagant? Mais voici une espèce de sacrifice bien différent des autres, car on y dit des injures au dieu à qui on l'offre: on l'accable de paroles outrageuses et de malédictions, au lieu des bénédictions et des louanges dont on a coutume d'honorer les dieux. C'est cependant le grand Hercule qu'on traite ainsi à Linde,[96] dans l'île de Rhodes ; et voici la raison qu'on apporte d'une chose si peu commune. On dit qu'Hercule ayant abordé à cette plage, et se sentant pressé de la faim, demanda à un villageois qui labourait là auprès, l'un des deux bœufs qu'il avait à sa charrue, offrant de le lui payer ce qu'il vaudrait. Le laboureur refusa de le lui vendre, s'excusant sur ce qu'il ne se pouvait passer de ses bœufs, qu'il n'avait pour tout bien que ce morceau de terre, dont la récolte lui servait à nourrir sa famille. Hercule, sans vouloir écouter les raisons du bonhomme, et usant de sa modération ordinaire, n'ayant pu avoir de gré un de ces bœufs, les enleva tous deux de force, les fit assommer sur-le-champ, et apprêter pour son dîner et pour celui de ses compagnons ; ce que voyant le malheureux villageois, il se mit à vomir mille injures contre Hercule ; mais ce héros, prenant la chose en galant homme, les écouta sans s'émouvoir, et ne fit que rire avec ses compagnons de la colère du pauvre laboureur. Toutefois, après que l'admiration où on était de sa valeur lui eut fait déférer les honneurs divins, les habitants de cette contrée lui élevèrent un autel au même lieu où la chose s'était passée, qu'il nomma lui-même l’Autel des deux Bœufs, et il ordonna qu'à l'avenir on lui immolerait deux bœufs joints ensemble par un même joug. Il se consacra aussi un prêtre auquel il enjoignit expressément d'employer dans les sacrifices qui lui seraient offerts les mêmes injures que le villageois lui avait dites, avouant que de sa vie il n'avait fait un repas si agréable. A quelle autre fin a-t-on institué la fête de Jupiter Crétois, sinon pour renouveler la mémoire de sa naissance, de son enlèvement dans l'île de Crète, et de la nourriture qu'il y reçut ? La nymphe Amalthée n'est autre que la chèvre qui l'allaita; c'est la pensée du poète Aratus qui fait parler Germanicus en ces termes : Cette nymphe fut la nourrice de Jupiter, s'il est vrai, comme on le dit, qu'une chèvre de l’île de Crète l'ait nourri de son lait, et que ce divin nourrisson, pour marquer sa reconnaissance, lui ait donné une place honorable parmi les astres de la nuit. Mais, ayant résolu de faire de cette chèvre une étoile brillante, il lui ôta sa peau mortelle pour la revêtir d'immortalité ; et de cette peau de chèvre il s'en fit un bouclier, qui lui servit bien contre les Titans, ce qui a donné lieu aux poètes de l'appeler l’Égide de Jupiter. On fait encore dans cette même fête de Jupiter Crétois diverses représentations de ce que sa mère fit pour le dérober à la cruauté de Saturne; ce qu'Ovide exprime ainsi:[97] Le bruit des clairons et des trompettes fit autrefois retentir les rochers du mont Ida, de peur que les cris du céleste enfant, que sa mère leur avait confié, ne trahissent la sûreté de son asile. Ici les Curètes frappaient sur des boucliers d'airain ; là les Corybantes faisaient entrechoquer des casques d'acier. Enfin, l'enfant fut sauvé, et le secret fut gardé. Chaque année renouvelle la mémoire de ce grand événement ; mais les flûtes et les hautbois ont pris la place des trompettes et des clairons. Salluste rejette ce récit et le traite de pure fiction; mais il faut avouer que le tour qu'il y donne est ingénieux. Il dit « que les Curètes représentent ceux qui, les premiers, ont pénétré dans les choses divines et en ont acquis la science; et que, comme nous attachons à tout ce qui est éloigné de nous une certaine idée qui en inspire la vénération, on s'est avisé de nommer ces premiers sages les nourriciers de Jupiter, » pour exprimer que les secrets de la divinité leur ont été confiés dès son enfance, si l'on peut se servir de ce terme, c'est-à-dire dès le commencement et avant que les autres hommes en eussent connaissance. Mais n'en déplaise à ce savant historien, il a suivi une fausse lumière dans l'explication de cette fable ; car si Jupiter est, selon les Curètes, le premier des dieux et le principe de toute religion, sans doute ils n'ont pas eu l'intelligence des choses divines, ils ne sont pas les interprètes de la vérité, mais les maîtres de l'erreur, et ils l'ont répandue dans le monde en donnant à leur Jupiter la divinité, dont il n'y a que le vrai Dieu qui soit propriétaire. Qu'on se donne la peine de consulter les livres sacrés, les registres des pontifes, ces monuments de la religion, qui en doivent être les titres les plus authentiques, et je suis sûr qu'on y trouvera de quoi se convaincre que tout ce qu'on estime saint et digne de vénération, ne mérite que le mépris et la risée des gens raisonnables, n'est que vanité, qu'extravagance ; en un mot, qu'impiété et que profanation. S'il se trouve enfin quelqu'un qui, ayant honte de son erreur, vienne à considérer les choses avec des yeux purifiés par la sagesse, quel ridicule ne découvrira-t-il point dans la plupart des cérémonies qui font partie du culte religieux? Pourra-t-il s'empêcher de rire, ou plutôt de verser des larmes, pour peu que la charité le presse, lorsqu'il verra les sacrés ministres des dieux, les véritables interprètes de leurs volontés, les sages dépositaires des mystères, lors, dis-je, qu'il les verra danser en public, et mêler à des sauts de bouffon des postures de courtisanes ; qu'il les verra courir dans les places, tantôt nus et frottés d'huile comme des athlètes, tantôt couronnés de fleurs comme des victimes, tantôt masqués, déguisés, barbouillés comme d'infâmes comédiens? Que dirai-je des boucliers sacrés que le temps a presque réduits en poussière?[98] Cependant ceux qui les portent sur leurs épaules, dans des processions solennelles, croient porter des dieux. Et l'on raconte d'un certain préteur,[99] qu'il voulut par un sentiment de dévotion porter un de ces boucliers,[100] devant lequel il fit par honneur marcher tous ses huissiers, quoique sa charge l'exemptât de cette fonction. Ce bonhomme n'était-il pas bien fou de s'imaginer qu'un pareil ministère donnerait du lustre à sa dignité? Peut-on enfin voir sans indignation pratiquer sérieusement, et par un esprit de religion, ce qu'on jugerait digne de censure dans les jeux et les divertissements du peuple ? XXII. Celui qui commença à introduire dans Rome de vaines superstitions fut Numa Pompilius, son second roi, qui trouvant des esprits grossiers et susceptibles de toutes sortes d'impressions, se servit de cette disposition pour leur inspirer ce qu'il voulut touchant le culte des dieux. Pour le faire avec plus d'autorité et de succès, il feignit qu'une certaine nymphe Egérie lui révélait de hauts mystères dans les entretiens qu'il avait avec elle durant la nuit. Assez proche de Rome, dans un bois épais, se voit un antre obscur et profond d'où sort une eau claire et pure qui va arroser le pied des arbres voisins; c'est là que Numa passait les nuits sans témoins, et, sortant le matin de sa retraite, il annonçait au peuple ce qu'il avait appris de son épouse immortelle, sur la manière dont les dieux voulaient être servis. Il imitait en cela l'adresse de Minos qui, voulant rendre ses lois plus vénérables, feignait que Jupiter les lui avait dictées dans l'antre sacré de ce dieu, où il passait plusieurs heures en conférence avec lui ; afin que les hommes apprissent à obéir non seulement par un motif de crainte, mais aussi par un principe de religion. Mais, après tout, il n'était pas difficile à Numa d'abuser de la crédulité de simples bergers, qui faisaient alors la plus grande partie de ses sujets. Il institua donc un souverain pontife, des prêtres de Jupiter, des saliens, des augures ; il composa la généalogie des dieux ; il en forma diverses branches et diverses familles, et fournissant à ce peuple farouche divers amusements, il adoucit peu à peu sa férocité naturelle, et le fit insensiblement passer de l'ardeur qu'il avait pour la guerre à l'amour du repos et de la paix. Mais, s'il abusa de sa trop grande facilité à croire ce qu'il voulut lui inspirer, il n'eut garde de se laisser surprendre lui-même aux faux préjugés d'une religion dont il était l'auteur ; car il composa en latin un traité du droit des pontifes, et un autre en grec, qui contenait les règles et les principaux axiomes de la sagesse ; et dans ces deux ouvrages il s'applique non seulement à détruire les principes de la religion qu'il avait lui-même imaginée, mais aussi à ruiner les fondements des autres religions. Or, il arriva longtemps après la mort de ce roi, sous le consulat de Cornélius et de Bébius, que des ouvriers travaillant à remuer la terre dans un champ qui est au pied du Janicule et qui appartenait au secrétaire d'Etat Pétilius, vinrent à découvrir deux coffres de pierre, dans l'un desquels était le corps de Numa, et dans l'autre les deux traités dont nous venons de parler; ce qui ayant été rapporté au sénat, il ordonna qu'on les supprimerait. Q. Pétilius les fit brûler dans une assemblée du peuple. Mais cette ordonnance me semble peu digne de la sage prévoyance d'une compagnie aussi éclairée et aussi politique que celle-là ; car son dessein en supprimant ces livres était de faire perdre le souvenir de ce qu'ils contenaient de contraire à la religion du peuple romain, et c'est ce qui l'a conservé. Ainsi ces dévots sénateurs, en voulant apprendre à la postérité avec quel zèle et quelle piété ils avaient soutenu l'honneur de leurs dieux, lui ont appris en même temps qu'on pouvait impunément se dispenser de les honorer, en lui découvrant les endroits faibles de leur culte. Mais si Numa, chez les Romains, fut l'inventeur d'une religion ridicule et vaine, les peuples du Latium[101] en la personne de Faune reconnaissent le fondateur de la leur. Ce Faune était petit-fils de Saturne, et il fit une étrange profusion des honneurs divins à tous ceux de sa famille; car premièrement il mit son père[102] au nombre des dieux, et de sa sœur[103] ayant fait sa femme, il en fit ensuite une déesse: outre le nom de Fauna qu'elle avait, on lui donna encore celui de Destinée, parce qu'elle disait la bonne aventure aux femmes, comme Faune, son frère et son mari, la disait aux hommes. Varron écrit de cette Fauna qu'elle vécut si retirée et qu'elle fut d'une chasteté si exemplaire, que nul homme, hors son mari, ne put se vanter d'avoir vu son visage, ni lui avoir seulement ouï prononcer une seule parole. C'est elle que les femmes appellent la Bonne Déesse, et c'est pour honorer une vie si cachée et si éloignée de tout bruit, qu'elles font soigneusement fermer les portes de son temple lorsqu'elles lui sacrifient, et que l'entrée en est entièrement fermée aux hommes.[104] Mais cette bonne déesse, avec toute sa chasteté, se laissait quelquefois surprendre au plaisir de la bouteille: ce fut après avoir vidé une bouteille de vin de Falerne que son mari la trouva ivre; et étant outre de voir sa dignité royale si fort avilie par l'intempérance de sa femme, il la prit et la fouetta si cruellement avec des branches de myrte, qu'elle expira sous les coups ; ce qui fut dans la suite si sensible à cet époux, qu'après que sa colère fut un peu ralentie, pour soulager son extrême déplaisir, il la plaça parmi les déesses. Il lui en donna l'appareil; il lui assigna des sacrifices. Mais parmi les offrandes qu'on met sur son autel, on n'oublie pas des flacons d'excellent vin, comme une des plus agréables oblations qu'on lui puisse faire. Ce Faune, aussi bien que les autres faiseurs de divinités, a laissé à la postérité de quoi la faire tomber dans l'erreur; mais les sages s'en préservent par le secours de leurs lumières. Lucrèce, l'un de ces sages, parle ainsi de celui qui, par une superstition outrée, croit que toutes les statues qu'il voit sont autant de dieux. « Cet homme, dit-il, a une superstitieuse vénération pour toutes ces petites divinités de la façon de Faune et de Numa; il tremble à leur aspect : il n'y en a pas une à laquelle il aille porter ses vœux et son offrande. Semblable aux enfants qui s'imaginent que toutes les figures qu'ils voient sont des hommes véritables, il prend pour des vérités ce qui n'est que pure fiction ; il croit qu'il y a un esprit qui meut, instruit et anime ces statues de bronze et de marbre. O homme crédule! ne voyez-vous pas que ce ne sont la que des ouvrages de l'art, et que les dieux que vous adorez et devant qui vous tremblez ne doivent leur être qu'a quelque habile statuaire ? » Le poète compare à des enfants ces gens qui donnent dans toutes les superstitions, quelque monstrueuses qu'elles soient, et moi je trouve que les enfants sont bien plus raisonnables : les enfants, il est vrai, croient que des statues inanimées sont des hommes vivants, et ceux-là jurent que ce sont des dieux immortels. Un âge sans expérience rend les enfants susceptibles de ces fausses impressions, et les superstitieux reçoivent toutes celles que leur folie leur fait prendre; l'innocente erreur où sont les enfants diminue à mesure que la lumière de la raison croit en eux, au lieu que la fausse persuasion où sont ces malheureux esclaves de la superstition augmente, se fortifie et dure autant que leur vie. Ce fut Orphée qui institua la fête de Bacchus,[105] et il fut le premier qui lui sacrifia sur une montagne de la Béotie, assez proche du lieu où ce dieu était né. Il fut aussi nommé Cithéron,[106] parce qu'il jouait souvent de la cithare. On donna encore à cette fête le nom d'Orphée, depuis qu'il y fut déchiré et mis en pièces par les Bacchantes. Ce nouveau culte s'introduisit dans la Grèce à peu près dans le même temps que Faune établissait le sien en Italie. Il y a cependant quelque apparence que Faune était venu après Orphée, puisque cet excellent musicien se trouva avec les Argonautes au premier siège de Troie, où régnait Laomédon, pendant que Picus, père de Faune, régnait en Italie. Remontons donc encore plus haut, et cherchons si bien que nous puissions enfin trouver celui qui a commencé à honorer les faux dieux. Didyme, auteur grec, croit que ce fut Mélissée qui le premier leur offrit des sacrifices; que ce roi de Crète régla les cérémonies qui accompagnent le culte divin, qu'il y mit de l'ordre, et qu'il y ajouta la magnificence et l'éclat extérieur pour les rendre plus vénérables aux peuples. Ce prince eut deux filles, Mélisse et Amalthée, qui nourrirent Jupiter de lait et de miel ; ce qui a donné lieu aux poètes de feindre que des abeilles volaient chaque jour sur la bouche de cet enfant pour lui apporter le miel qu'elles faisaient. Mélisse reçut de la main de son père la dignité de grande prêtresse de la mère des dieux, ce qui a fait donner à toutes celles qui lui ont succédé dans cette charge le nom de Mélisses. Pour Jupiter, l'Histoire Sacrée d'Evhémère nous apprend qu'étant monté sur le trône, il vint à un tel excès d'insolence et d'orgueil qu'il s'érigeait partout à lui-même des temples et autels ; car, s'étant mis à voyager, il savait avec tant d'adresse s'insinuer dans l'esprit des rois et des princes chez qui il passait, et il savait si bien le secret de se les attacher par les démonstrations d'une amitié teinte et sous le spécieux prétexte des devoirs sacrés de l'hospitalité, qu'en les quittant il leur faisait promettre de lui bâtir un temple, comme pour servir de monument éternel de l'alliance qu'ils venaient de contracter ensemble. De là sont venus les noms d'Atabirien, de Labranden, de Laprien, de Molion, de Casien, et tant d'autres sous lesquels Jupiter est adoré en divers lieux, et qui sont les noms de ces princes crédules et de ces officieux hôtes, qui pensant éterniser leurs noms par de superbes édifices, ont bien plus travaillé pour la gloire du roi de Crète[107] que pour la leur : on remarquait même en ces rois une certaine estime religieuse qui faisait qu’ils se soumettaient avec joie à son empire, et qu'ils ordonnaient à leurs sujets de célébrer tous les ans des fêtes et des sacrifices en son honneur ; c'est de cette manière que le culte de Jupiter s'est répandu par toute la terre, et l'exemple d'un dieu qui s'est en quelque sorte consacré lui-même a été suivi par tant d'autres qu'enfin tout l'univers s'est rempli de divinités. Nous savons donc maintenant l'époque de la fausse religion ; car, ou que ce soit Mélissée qui en ait jeté les premiers fondements, ou que ce soit Jupiter, la différence du temps n'est pas fort considérable, et l'erreur pour se faire recevoir ne saurait se prévaloir de son antiquité.
|
|
CAPUT. XXIII. De vanarum superstitionum aetatibus, et quibus coeperint temporibus. Nunc quoniam vanarum superstitionum originem deprehendimus, superest ut etiam tempora colligamus, per quae fuerint illi quorum memoria colitur. Theophilus in libro de Temporibus ad Autolicum scripto ait, in historia sua Thallum dicere, quod Belus, quem Babylonii et Assyrii colunt, antiquior trojano bello fuisse invenitur trecentis viginti duobus annis: Belum autem Saturno aequalem fuisse, et utrumque uno tempore adolevisse. Quod adeo verum est, ut ratione ipsa colligi possit. Nam et Agamemnon, qui gessit bellum Troicum, Jovis abnepos fuit, et Achilles Ajaxque pronepotes, et Ulysses eodem gradu proximus fuit; Priamus quidem longa serie. Sed auctores quidam tradunt, Dardanum et Jasium Coriti filios fuisse, non Jovis. Nec enim, si ita fuisset, ad usus impudicos Ganymedem pronepotem suum habere potuisset. Itaque parentibus illorum, quos supra nominavi, si congruentes annos dividas, numerus consentiet. Ab excidio autem Trojanae urbis colliguntur anni MCCCCLXX. Ex hac temporum ratione manifestum est, ante annos non amplius quam MDCCC natum esse Saturnum, qui et sator omnium deorum fuit. Non ergo isti glorientur sacrorum vetustate, quorum et origo, et ratio, et tempora deprehensa sunt. Restant adhuc aliqua, quae ad arguendas religiones falsas plurimum valent. Sed jam finem facere libro decrevi, ne modum excedat. Ea enim plenius sunt exequenda, ut omnibus refutatis, quae veritati videntur obstare, homines, qui bonorum ignorantia vagantur incerti, ad religionem veram possimus imbuere. Primus autem sapientiae gradus est, falsa intelligere; secundus, vera cognoscere. Ergo apud quem haec prima institutio nostra profecerit, qua falsa deteximus, excitabitur ad veri cognitionem, qua nulla est homini jucundior voluptas; et erit jam sapientia coelestis disciplinae dignus, qui ad cognoscenda caetera libens ac paratus accesserit. |
XXIII. Après avoir fait connaître la véritable origine des vaines superstitions, ce qui nous reste à faire est de marquer précisément le temps où elles ont été introduites dans le monde, et comme le moment de leur naissance. Nous en avons déjà touché quelque chose dans le chapitre précédent ; mais nous en parlerons un peu plus amplement dans celui-ci. Théophile, dans sa chronologie, rapportant le sentiment de Thallus, ancien historien, dit que Belus, dieu des Assyriens et de Babylone, a vécu 322 ans avant la guerre de Troie. Or Belus et Saturne étaient contemporains, ce qu'il est facile de faire voir en supposant comme un fait certain qu'Agamemnon, qui commandait les Grecs au siège de cette ville, était arrière-petit-fils de Jupiter, comme Achille et Ajax l'avaient pour trisaïeul. Ulysse était au même degré; pour Priam, il en était plus éloigné, et même il y a des auteurs qui assurent que Dardanus et Jasius, ancêtres de Priam, n'étaient pas fils de Jupiter, mais de Coritus; et ce qui rend cette conjecture vraisemblable, c'est que si ce prince[108] eût été du sang de Jupiter, il y a de l'apparence que le roi de Crète[109] n'aurait pas voulu en souiller la pureté, en faisant servir Ganymède,[110] son parent, à l'usage infâme auquel il le consacra. Depuis la prise de Troie jusqu'aujourd'hui, l'on compte MCCCCLXX (1470)[111] ainsi il n'y a pas plus de MDCCC (1800) ans que Saturne vivait. Or, de l'aveu même de tous ceux qui ont écrit des choses divines, il est le père de tous les autres dieux et comme la souche d'où ils sont sortis. Qu'on juge maintenant quelle est l'antiquité d'une religion dont on connaît l'établissement, l'origine de ses dieux, leur naissance et leur consécration. Il y aurait encore quelque chose à dire pour achever d'abattre entièrement le culte des faux dieux; mais il est temps de finir, et ce livre n'a déjà que trop d'étendue. Nous allons maintenant travailler à écarter tous les nuages qui empêchent les hommes de voir la vérité et d'embrasser la véritable religion. Le premier pas qui conduit les hommes à la sagesse, c'est de démêler le faux d'avec le vrai, et la seconde démarche c'est de s'attacher au vrai : ainsi, celui qui dans le livre des Institutions aura appris à se défendre des atteintes de l'erreur, se trouvera disposé à recevoir dans les autres livres qui suivent les impressions de la vérité.
|
|
[1] Constantin, Constance et Constant. [2] Constance Chlore. [3] Il veut marquer par là Licinius. [4] Protagoras et Diagoras. [5] Thoth. [6] Septembre. [7] La ville de Mercure. [8] Les peuples d'Egypte. [9] Trois fois grand. [10] P. Gabinius, M. Octacilius, et L. Valérius. [11] Sénèque. [12] Lucifer. [13] Le nom d'anges. [14] Erythréenne. [15] Scipion. [16] De Jupiter et d'Alcmène, femme d'Amphitryon. [17] Hercule. [18] Capo di Sidro dans l'Achaïe. [19] Troie. [20] Il jouait avec lui au palet, et Zéphire, qui était spectateur du jeu et jaloux d'Hyacinthe, poussa le palet d'Apollon contre la tête de ce beau jeune homme, et la lui cassa. Apollon, pour se consoler, le changea en une fleur qui porte son nom. [21] Ces deux frères partagent l'année entre eux, et pendant les six mois que l'un est sur la terre, l'autre demeure aux enfers; mais, retournant à son tour à la vie durant les autres mois, son frère va prendre sa place parmi les morts. [22] Castor, Pollux, Hélène et Clytemnestre, étaient tous quatre enfants de Jupiter et de Léda. [23] Bacchus. [24] Les Indes. [25] Cela est fondé sur ce que les astronomes nomment une certaine constellation la couronne d'Ariane. [26] Ganymède. [27] Junon. [28] Cupidon. [29] La déesse de la mer. [30] Les Parques sont les Destinées elles-mêmes. [31] Qui fut dévoré par son père Saturne. [32] Dans l'île de Crète. [33] En lui offrant une pierre à la place de son fils. [34] C'est qu'elle s'y sauva dans un vaisseau nommé la Vache. [35] Ou de Jupiter. [36] Le Ciel, père de Saturne. [37] La Terre, mère de Saturne. [38] Dans son apologie pour la religion chrétienne, intitulée Octavius. [39] C'est la plus haute région de l'air. [40] Ou d'Uranus. [41] Les stoïciens réduisaient toutes les fables à un sens ou moral ou en rapport avec les phénomènes naturels. [42] Livre II, ch. 24. [43] La déesse du feu. [44] Jupiter. [45] Ici vient une espèce de dissertation sur l'opération faite à Saturne. [46] Ceux qui avaient soin d'élever Jupiter. [47] Livre VI, v. 291 sqq. [48] Diodore, Népos, Cassius, Varron. [49] Jupiter. [50] Dans l'île de Crète ou Candie. [51] De l'historien Evhémère. [52] Poscamus ventos. (Virgile.) [53] Pan, Bacchus, Apollon et Mercure. [54] La pièce entière de la Consolation sur la mort de sa fille. [55] Jules César. [56] Il appelle ainsi les premiers Romains, qui en effet n'étaient qu'une troupe de bergers rassemblés par Romulus aux environs d'Albe, et dont il fit les premiers citoyens de cette superbe république. [57] Romulus tua Rémus son frère. [58] Jules César. [59] Lucius César voulut empêcher qu'on ne fît ses funérailles, et le consul Dolabella renversa une colonne sur laquelle on avait gravé son épitaphe. [60] Lucrèce. [61] Jus trium liberorum. [62] Diogène. [63] Une espèce de dieux qui gardaient les logis. [64] Osiris. [65] Proserpine. [66] Athis. [67] Jupiter. [68] L'île de la Vierge. [69] Cet alinéa n'est que l'abrégé de deux alinéas dans lesquels Lactance raconte avec détails une suite de désordres qui ne peuvent trouver place ici : Le latin dans les mots brave l'honnêteté, Mais le lecteur français veut être respecté. [70] Le blé et la vigne. [71] Inventeur de la médecine. [72] Qui inventa les instruments du labourage. [73] L’Africain. [74] Cérès, sœur de Saturne. [75] L’île de Samos, renommée pour la belle poterie qui s'y faisait. [76] Il ne s'agit ici que du culte suprême. [77] Le nom de dieu qu'il lui donne. [78] Hercule. [79] Ovide. [80] Espèce de bouffons qui exprimaient par les seuls gestes tout ce qu'ils voulaient faire entendre. [81] Aux exercices de la lutte. [82] Cicéron. [83] A bâtir des temples aux Vertus. [84] Lacédémone. [85] On peut voir ce qu'en écrit saint Augustin dans son œuvre de la Cité de Dieu. [86] On a remarqué que c'était la pierre que Saturne avala pour Jupiter. [87] Campagna di Roma. [88] Ponte mole. [89] Jupiter. [90] Osiris. [91] Ptolémée, roi d'Egypte, le fit assassiner. [92] Isis et Osiris. [93] Lampsico, ville de Mysie. [94] Vesta. [95] Dans l'Écrevisse. [96] Lindo. [97] Fastes, livre IV, v. 207. [98] Ils étaient en bois. [99] Furius Bibaculus. [100] On croyait que le salut de la république était attaché à la conservation de ces boucliers. [101] Campagne de Rome. [102] Picus. [103] Fauna. [104] Un des chefs d'accusation que Cicéron proposa contre Claudius, fut qu'il était entré déguisé en femme dans le lieu où on sacrifiait à la bonne déesse. Oraison pour Milon. [105] Autrement, Liber. [106] En latin Cithara. [107] Jupiter. [108] Priam. [109] Jupiter. [110] Ganymède était du sang de Priam. [111] Lactance écrivait en l'année 320. |
|