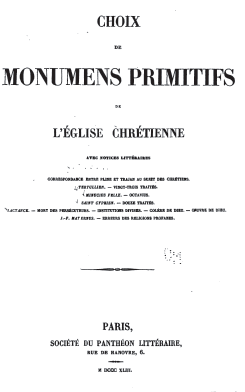
LACTANCE - LUCIUS CAECILIUS FIRMIANUS LACTANTIUS
INSTITUTIONS DIVINES - DIVINAE INSTITUTIONES
LIVRE III
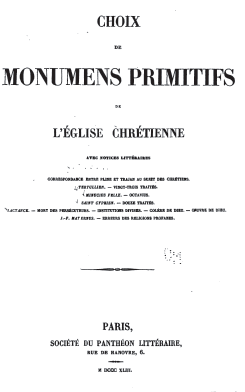
LIVRE III
LUCIUS CAECILIUS FIRMIANUS LACTANTIUS
DIVINAE INSTITUTIONES
|
LIBER TERTIUS. DE FALSA SAPIENTIA PHILOSOPHORUM. CAPUT PRIMUM. Veritatis collatio cum eloquentia; cur eam non sunt assecuti philosophi: de stylo simplici Scripturarum.
Vellem mihi, quando veritas in obscuro
latere adhuc existimatur, vel errore atque imperitia vulgi, variis
et ineptis superstitionibus servientis, vel philosophis pravitate
ingeniorum turbantibus eam potius quam illustrantibus, etsi non
qualis in Marco Tullio fuit, quia praecipua et admirabilis fuit,
aliquam tamen proximam eloquentiae contingere facultatem; ut quantum
veritas vi sua propria valet, tantum ingenii quoque viribus nixa,
exereret se aliquando, et discussis convictisque tam publicis, quam
eorum, qui sapientes putantur erroribus, humano generi clarissimum
lumen inferret. Quod quidem duabus ex causis fieri vellem: vel quod
magis possent credere homines ornatae veritati, qui etiam mendacio
credunt, capti orationis ornatu, lenocinioque verborum; vel certe,
ut ipsi philosophi suis armis potissimum, quibus placere sibi et
confidere solent, opprimerentur a nobis. Nam cum error omnis, aut ex religione falsa oriatur, aut ex sapientia, in eo convincendo necesse est utrumque subvertere. Cum enim sit nobis divinis litteris traditum, cogitationes philosophorum stultas esse, id ipsum re et argumentis docendum est: ne quis honesto sapientiae nomine inductus, aut inanis eloquentiae splendore deceptus, humanis malit quam divinis credere; quae quidem tradita sunt breviter ac nude. Nec enim decebat aliter, ut cum Deus ad hominem loqueretur, argumentis assereret suas voces, tanquam fides ei non haberetur: sed, ut oportuit, est locutus, quasi rerum omnium maximus judex, cujus est non argumentari, sed pronuntiare. Verum ipse, ut Deus. Nos autem, cum ad res singulas testimonia divinae vocis habeamus, profecto monstrabimus, quanto certioribus argumentis possint vera defendi, cum etiam falso sic defendantur, ut vera soleant videri. Quare non est, quod philosophis tantum honoris habeamus, aut eorum eloquentiam pertimescamus. Loqui enim bene potuerunt, ut homines eruditi, vere autem loqui, nullo modo, quia veritatem non didicerant ab eo, qui ejus potens esset. Nec sane magnum aliquid efficiemus, quod illos ignorantiae redarguemus, quam ipsi saepissime confitentur in eo solo, quoniam his non creditur, in quo solo credi debuit; conabor ostendere, nunquam illos tam veridicos fuisse, quam cum sententiam de sua ignoratione dixerunt. CAPUT II. De philosophia, et quam inanis fuerit ejus in exponenda veritate occupatio. Nunc quoniam duobus prioribus libris religionum falsitas demonstrata est, nec non origo ipsa totius erroris exposita: hujus libri munus est philosophiam quoque ostendere, quam inanis et falsa sit; ut, omni errore sublato, veritas patefacta clarescat. Ordiamur itaque a communi philosophiae nomine, ut ipso capite destructo, facilior nobis aditus pateat ad excidendum omne corpus: si tamen potest corpus vocari, cujus partes ac membra discordent, nec ulla compage inter se cohaereant, sed quasi disjecta et dissipata, palpitare potius, quam vivere videantur. Philosophia est (ut nomen indicat, ipsique definiunt) studium sapientiae. Unde igitur probem magis philosophiam non esse sapientiam, quam ex ipsius nominis significatione? Qui enim sapientiae studet, utique nondum sapit, sed ut sapere possit studet. In caeteris artibus, studium quid efficiat, et quo tendat, apparet. Quas cum discendo aliquis assecutus est, jam non studiosus artificii, sed artifex nominatur. At enim verecundiae causa studiosos se sapientiae, non sapientes vocaverunt. Immo vero Pythagoras, qui hoc primus nomen invenit, cum paulo plus saperet, quam illi priores, qui se sapientes putaverunt, intellexit nullo humano studio posse ad sapientiam perveniri, et ideo non oportere, incomprehensae atque imperfectae rei perfectum nomen imponi. Itaque cum ab eo quaereretur, quemnam se profiteretur, respondit: philosophum, id est, quaesitorem sapientiae. Si ergo philosophia sapientiam quaerit, nec ipsa sapientia est; quia necesse est aliud esse, quod quaerit; aliud, quod quaeritur: nec quaesitio ipsa recta est, quia nihil potest invenire. Ego vero ne studiosos quidem sapientiae philosophos esse concesserim, quia illo studio ad sapientiam non pervenitur. Nam si facultas inveniendae veritatis huic studio subjaceret, et si esset id studium tamquam iter ad sapientiam, aliquando esset inventa. Cum vero tot temporibus, tot ingeniis in ejus inquisitione contritis non sit comprehensa, apparet nullam esse ibi sapientiam. Non ergo sapientiae student, qui philosophantur: sed ipsi studere se putant; quia illud quod quaerunt, ubi, aut quale sit nesciunt. Sive ergo sapientiae student, sive non student, sapientes non sunt; quia nunquam reperiri potest, quod aut non recte quaeritur, aut omnino non quaeritur. Videamus tamen id ipsum, possit ne hoc studio reperiri aliquid, an nihil. |
LIVRE III.DE LA FAUSSE SAGESSE DES PHILOSOPHES.I. Comme la vérité paraît encore enveloppée de quelque nuage, ce qui arrive tant par l'ignorance du peuple qui est engagé en de vaines et ridicules superstitions, que par la faute des philosophes dont le travail ne sert souvent qu'à confondre les matières qu'ils traitent au lieu de les débrouiller, je souhaiterais avoir une éloquence non égale à celle de Cicéron, parce qu'elle était tout à fait extraordinaire et admirable, mais au moins approchant de la sienne, afin de pouvoir apporter à la vérité un secours d'une puissance égale à la sienne, et de répandre sa lumière, afin qu'elle dissipe entièrement les ténèbres et les erreurs que les peuples et les philosophes ont semées parmi les hommes. J'ai deux raisons qui me portent à faire ce souhait. L'une est que la vérité sera peut-être plus capable de plaire aux hommes, quand elle sera parée des ornements par lesquels le mensonge a coutume de les surprendre; l'autre que je serai bien aise de vaincre les philosophes avec les armes dans lesquelles ils mettent leur principale confiance. Mais parce que Dieu a voulu que la vérité fût plus agréable avec sa seule beauté naturelle qu'avec ces ornements étrangers qui ne serviraient qu'à la défigurer, au lieu que le mensonge serait horrible si on lui avait ôté le masque dont il est couvert, je me contente de la médiocrité démon esprit. Ce n'a pas été aussi dans mon éloquence, mais dans la vérité que j'ai mis ma confiance quand j'ai entrepris cet ouvrage. Il est peut-être au-dessus de mes forces, mais quand je succomberais sous le poids, j'espère que Dieu ne laisserait pas de faire triompher la vérité. Si les plus fameux orateurs perdent quelquefois des causes contre des avocats médiocres, parce qu'alors la vérité a la force de se maintenir toute seule par l'évidence qui l'environne, quel sujet aurais-je de craindre qu’en cette occasion, qui est une des plus importantes qui se puisse présenter, elle soit opprimée par des hommes qui ont beaucoup d'éloquence et beaucoup d'esprit, mais qui n'avancent que des faussetés manifestes. La vérité paraîtra fort claire, non de la clarté qu'elle tirera d'un discours aussi faible que le mien, mais de celle qu'elle a de son propre fonds. Quelque connaissance que les philosophes aient eue des sciences profanes, ils n'en ont eu aucune de la vérité, parce qu'elle ne s'acquiert ni par la voie de méditation, ni par celle de la discussion. Je ne les blâme pas d'avoir désiré de la connaître, parce que Dieu a mis ce désir dans le cœur de l'homme, mais je les condamne d'avoir travaillé inutilement, parce qu'ils ne savaient ni où était la vérité, ni de quelle manière ou par quel esprit il fallait se conduire en sa recherche. Ainsi ils se sont engagés dans l'erreur au temps même qu'ils prétendaient en délivrer les autres. La suite naturelle de mon sujet m'oblige à entreprendre dans ce livre-ci de les réfuter. Il n'y a point d'erreur qui ne procède ou d'une fausse religion, ou d'une fausse philosophie. Ainsi, pour renverser toutes les erreurs, il faut ruiner ces deux principes. L'Ecriture nous ayant appris qu'il n'y a que de la vanité dans les pensées des philosophes, il faut encore le faire voir par de solides raisons, de peur que quelqu'un surpris par le beau nom de la sagesse, ou ébloui par le faux éclat de l'éloquence, n'écoute plutôt la voix des hommes que celle de Dieu. Quand Dieu parle, il le fait simplement et en peu de paroles. Et certes, il n'était pas à propos qu'il en usât autrement, ni qu'il apportât des preuves, comme s'il ne méritait pas d'être cru sans en apporter. Il a parlé, non comme un philosophe qui raisonne et qui dispute, mais comme un juge souverain qui prononce des arrêts. Pour nous, qui avons des passages formels de l'Ecriture par lesquels nous prouvons tous les points de notre religion, nous ferons voir qu'il est facile d'établir la vérité puisque l'on parle quelquefois si avantageusement du mensonge qu'on le rend presque aussi croyable que la vérité. Nous ne devons donc pas redouter si fort l'éloquence des philosophes. Ils ont pu passer pour des hommes savants, mais ils n'ont pu passer pour des hommes véritables en leurs paroles, parce qu'ils n'ont pas appris la vérité de celui qui peut seul l'enseigner. Ce ne nous sera pas un notable avantage de les convaincre d'ignorance en un point où ils la reconnaissent eux-mêmes, parce qu'ils ne peuvent trouver de créance sur un sujet où ils en devaient pourtant plutôt trouver que sur un autre. Je tâcherai seulement de prouver qu'ils n'ont jamais rien avancé de si véritable, que quand ils ont avoué franchement qu'ils ne savaient rien. II. Après avoir fait voir dans les deux livres précédents la fausseté de la religion païenne et la source d'où cette fausseté procède, je tâcherai de découvrir en celui-ci la fausseté de la philosophie, afin que les nuages de toutes les erreurs soient dissipés et qu'il n'y ait plus rien qui empêche la vérité de paraître avec l'éclat qui lui est propre. Je commencerai par le nom de philosophie, afin qu'ayant coupé la tête, il soit plus aisé d'abattre le corps, si néanmoins on peut appeler corps ce qui n'a que des parties séparées et éparses, qui, étant privées du principe de la vie, ne manifestent qu'un mouvement de palpitation. Le nom de philosophie et l'explication que l'on en donne d'ordinaire marquent assez qu'elle ne signifie autre chose que l'étude de la sagesse. Quelle meilleure preuve pourrais-je jamais avoir pour montrer que la philosophie n'est pas la sagesse, que celle qui se tire du nom même de philosophie? Celui qui s'adonne à la sagesse ne la possède pas encore, mais il l'étudie pour la posséder. Personne n'ignore le rapport que l'étude a avec les autres arts que l'on étudie; de ce que l'on apprend un art on ne le sait pas encore. C'est par retenue et par une honnête pudeur que les philosophes, au lieu de s'appeler sages, ont seulement fait profession de rechercher la sagesse. Pythagore inventa le premier ce nom; car, étant un peu plus sage que ceux qui croyaient l'être beaucoup, il jugea fort bien que l'homme ne saurait parvenir par son étude à la sagesse et ne crut pas devoir prendre le nom d'une chose à laquelle il n'osait aspirer. Quand on lui demandait de quoi il faisait profession, il répondait qu'il faisait profession de chercher la sagesse. Si la philosophie est la recherche de la sagesse, elle n'est donc pas la sagesse ; car il y a différence entre la recherche et la chose recherchée. La recherche n'est pas raisonnable quand elle a pour but ce qui ne peut se trouver. C'est pourquoi je prétends que les philosophes ne cherchent pas la sagesse puisqu'ils ne l'ont jamais trouvée. S'ils avaient pu la trouver, ils l'auraient trouvée depuis le temps qu'ils la cherchent. Ainsi le temps qu'ils ont perdu et la peine qu'ils ont prise inutilement ne font que trop voir que la possession de la sagesse n'est ni la fin ni le fruit de leur travail. Les philosophes ne s'adonnent donc pas à l'étude de la sagesse, bien qu'ils croient s'y adonner. Ils se tourmentent inutilement à chercher sans savoir ni ce qu'ils cherchent ni le lieu où il se trouve. Enfin les philosophes ne possèdent pas la sagesse, soit qu'ils la cherchent ou qu'ils ne la cherchent pas ; car il est certain que l'on ne trouve une chose que si on ne la cherche point, ou si on la cherche d'une autre manière qu'il faut la chercher. Examinons pourtant si par cette étude on ne peut rien trouver ou si l’on peut trouver quelque chose.
|
|
CAPUT III. Philosophia quibus rebus constet; et quis fuerit Academicae sectae auctor primarius. Duabus rebus videtur philosophia constare, scientia et opinatione, nec ulla alia re. Scientia ab ingenio venire non potest, ne cogitatione comprehendi; quia in seipso habere propriam scientiam, non hominis, sed Dei est. Mortalis autem natura non capit scientiam, nisi quae veniat extrinsecus. Idcirco enim oculos, et aures, et caeteros sensus patefecit in corpore divina solertia, ut per eos aditus scientia permanaret ad mentem. Nam causas naturalium rerum disquirere, aut scire velle: sol utrumne tantus, quantus videtur, an multis partibus major sit, quam omnis haec terra; item, luna globosa sit, an concava; et stellae utrumne adhaereant coelo, an per aerem libero cursu ferantur; coelum ipsum qua magnitudine, qua materia constet, utrum quietum sit et immobile, an incredibili celeritate volvatur; quanta sit terrae crassitudo, aut quibus fundamentis librata et suspensa sit. Haec, inquam, disputando, et conjecturis velle comprehendere, tale est profecto, quale si disserere velimus, qualem esse arbitremur cujuspiam remotissimae gentis urbem, quam nunquam vidimus, cujusque nihil aliud quam nomen audivimus. Si nobis in ea re scientiam vindicemus, quae non potest sciri, nonne insanire videamur, qui id affirmare audeamus, in quo revinci possimus? Quanto magis, qui naturalia, quae sciri ab homine non possunt, scire se putant, furiosi dementesque sunt judicandi. Recte ergo Socrates, et eum secuti Academici scientiam sustulerunt, quae non disputantis, sed divinantis est. Superest, ut opinatio in philosophia sola sit. Nam unde abest scientia, id totum possidet opinatio. Id enim opinatur quisque, quod nescit. Illi autem, qui de rebus naturalibus disputant, opinantur ita esse, ut disputant. Nesciunt igitur veritatem; quoniam scientia, certi est, opinatio, incerti. Redeamus ad illud superius exemplum. Age, opinemur de statu et qualitate urbis illius, quae nobis rebus omnibus praeter nomen ignota est. Verisimile est, in plano sitam, lapideis moenibus, aedificiis sublimibus, viis pluribus, magnificis ornatisque delubris. Describamus, si placet, mores habitumque civium. Sed cum haec dixerimus, alius contraria disputabit; et cum hic quoque peroraverit, surget et tertius, et alii deinceps, et opiniabuntur multo disparia, quam nos sumus opinati. Quid ergo erit ex omnibus verius? fortasse nihil. At omnia sunt dicta, quae in rerum naturam cadunt; ut necesse sit aliquid eorum esse verum. At nescietur, quis verum dixerit. Potest fieri, ut omnes ex parte aliqua erraverint, ex parte attigerint veritatem. Stulti ergo sumus, si hoc disputatione quaeramus; potest enim supervenire aliquis, qui opiniones nostras derideat, nosque pro insanis habeat, qui velimus id, quod nescimus, quale sit, opinari. Verum non opus est longe posita conquirere, unde nemo fortasse veniat, qui nos redarguat. Age, opinemur, quid nunc in foro geratur, quid in curia; longum est id quoque: dicamus, interposito uno pariete quid fiat; nemo potest id scire, nisi qui audiverit, aut viderit. Nullus igitur audet id dicere, quia statim non verbis, sed re ipsa praesenti refutabitur. Atqui hoc idem faciunt philosophi, qui disputant in coelo quid agatur: sed eo se id impune facere arbitrantur, quia nullus existit, qui errores eorum coarguat. Quod si existimarent descensurum esse aliquem, qui eos delirare ac mentiri doceret, nunquam quidquam de iis rebus. quas scire non possunt, disputarent. Nec tamen ideo felicior putanda est eorum impudentia et audacia, quia non redarguuntur: redarguit enim Deus, cui soli veritas nota est, licet connivere videatur, eamque hominum sapientiam pro summa stultitia computat. CAPUT IV. Scientiam a Socrate, opinationem a Zenone esse sublatam. Recte igitur Zeno ac Stoici opinationem repudiarunt. Opinari enim te scire, quod nescias, non est sapientis, sed temerarii potius, ac stulti. Ergo si neque sciri quidquam potest, ut Socrates docuit, nec opinari oportet ut Zeno, tota philosophia sublata est. Quid, quod non tantum ab his duobus evertitur, qui philosophiae principes fuerunt, sed ab omnibus; ut jam videatur, jampridem suis armis esse confecta. In multas sectas philosophia divisa est; et omnes varia sentiunt. In qua ponimus veritatem? in omnibus certe non potest. Designemus quamlibet: nempe in caeteris omnibus sapientia non erit. Transeamus ad singulas: eodem modo, quidquid uni dabimus, caeteris auferemus. Unaquaeque enim secta omnes alias evertit, ut se suaque confirmet; nec ulli alteri sapere concedit, ne se desipere fateatur: sed sicut alias tollit, sic ipsa quoque ab aliis tollitur omnibus. Nihilominus enim philosophi sunt, qui eam stultitiae accusant. Quamcumque laudaveris, veramque dixeris, a philosophis vituperatur, ut falsa. Credemusne igitur uni sese suamque doctrinam laudanti, an multis unius alterius ignorantiam culpantibus? Rectius sit necesse est, quod plurimi sentiunt, quam quod unus. Nemo enim potest de se recte judicare, quod nobilis poeta testatur. Ita enim comparatam esse hominum naturam omnium, aliena ut melius videant, et dijudicent quam sua. Cum igitur omnia incerta sint, aut omnibus credendum est, aut nemini: si nemini, sapientes ergo non sunt, quia singuli diversa affirmantes, sapientes esse se putant: si omnibus, aeque non sunt sapientes, quia singuli ab omnibus esse negantur sapientes. Pereunt igitur universi hoc modo, et tanquam sparti illi poetarum, sic se invicem jugulant, ut nemo ex omnibus restet: quod eo fit, quia gladium habent, scutum non habent. Si ergo singulae sectae multarum sectarum judicio stultitiae convincuntur, omnes igitur vanae, atque inanes reperiuntur: ita seipsam philosophia consumit, et conficit. Quod cum intelligeret Arcesilas Academiae conditor, reprehensiones omnium inter se collegit, confessionemque ignorantiae clarorum philosophorum, armavitque se adversus omnes. Ita constituit novam non philosophandi philosophiam. Eo igitur auctore, duo philosophiae genera esse coeperunt: unum, illud vetus, quod scientiam sibi vendicat; alterum, novum repugnans, quod eam detrahit. In his duobus generibus video dissidium, et quasi civile bellum. Sapientiam, quae detrahi non potest, in qua parte ponemus? Si natura rerum sciri potest, haec tironum caterva interibit; si non potest, veterani conficientur: si pares fuerint, nihilominus peribit dux omnium philosophia, quia detracta est; nihil enim potest sine interitu sibi esse contrarium. Si autem, ut docui, nulla potest esse in homine interna et propria scientia, ob fragilitatem conditionis humanae, Arcesilae manus vincit. Sed ne ipsa quidem stabit, quia non potest omnino nihil sciri. |
III. La philosophie semble ne comprendre que deux choses : la science et la conjecture. La science ne procède pas de l'esprit et ne peut s'acquérir par le seul effet de la méditation et de la pensée. Il n'y a que Dieu qui ait dans lui-même la science de cette sorte. Les hommes n'en ont aucune qui ne leur vienne du dehors. La divine providence nous a donné des yeux, des oreilles et d'autres organes par où ce que nous savons entre dans l'âme. Car prétendre découvrir par conjecture ou par raisonnement les causes des choses naturelles, et savoir, par exemple, si le soleil n'est qu'aussi grand qu'il paraît, ou s'il est beaucoup plus grand que la terre, si la lune est un globe ou si elle n'est qu'un demi-globe, si les étoiles sont attachées au firmament ou si elles ont un mouvement libre au travers de l'air, quelle est l'épaisseur de la terre, et sur quel fondement elle est affermie, ce serait une témérité pareille à celle de ceux qui entreprendraient de décrire une ville assise dans un pays éloigné, qu'ils n'auraient jamais vue et de laquelle ils n'auraient jamais entendu que prononcer le nom; ce serait sans doute une folie de vouloir parler de la sorte sur un sujet sur lequel il serait aisé de nous convaincre de fausseté. L'extravagance de ceux qui se vantent de savoir des choses naturelles qu'il n'est pas possible de savoir, est beaucoup plus extraordinaire et plus étrange. C'est pourquoi Socrate et les académiciens qui l'ont suivi ont eu raison de nier qu'il y eût aucune science, parce que, quand on prétend parvenir à la science par le raisonnement, on ne fait que deviner. Il n'y a donc plus que des conjectures dans la philosophie, car dès que l'on a ôté la science, il ne reste plus que les conjectures. On a des conjectures touchant les choses dont on ne sait rien de certain. Ceux qui disputent sur la physique conjecturent que les choses sont telles qu'ils se les feignent : ils ne le savent donc pas ; quand on sait, on a de la certitude ; quand on n'a pas de certitude, on ne sait pas et on n'a qu'une conjecture. Servons-nous encore une fois de l'exemple que je viens d'apporter. Raisonnons chacun selon notre opinion de l'état d'une ville dont nous ne connaissons que le nom. Il y a apparence, dira quelqu'un, qu'elle est assise dans une plaine, que ses murailles sont de pierres, que les maisons sont fort hautes, que les rues sont larges et qu'il y a quantité de temples et d'ornements. Entreprenons encore de décrire les mœurs et la manière de vivre des habitants. Quand nous en aurons dit ce qui nous sera venu dans l'esprit, un autre en parlera tout autrement, et après lui un troisième, et d'autres après celui-là. Lequel de tous aura dit la vérité? Aucun peut-être ne l'aura dite; mais on a dit tout ce qui se rencontre dans les villes, selon le cours commun des choses et selon l'usage le plus ordinaire. Ainsi il faut nécessairement que l'on ait dit au moins une partie de la vérité. S'il arrive que par hasard quelqu'un ait dit une partie de la vérité, on ne le pourra savoir. Peut-être que tous se seront trompés en quelque chose et qu'en quelque chose ils auront approché de la vérité. C'est donc une extravagance de prétendre apprendre par raisonnement comment une ville que nous n'avons jamais vue est faite. S'il survenait quelqu'un qui y eût été, il se moquerait de notre folie de parler par conjecture d'une chose dont nous n'avons point de connaissance. Mais sans parler d'un pays si éloigné d'où personne ne viendra pour réfuter ce que nous en aurons avancé, disons maintenant par supposition et par conjecture ce que l'on fait ou dans le marché ou dans le palais. Si ces lieux-là sont encore trop éloignés de nous, disons ce qui se fait dans une maison ou dans un appartement qui n'est séparé que par une cloison du lieu où nous sommes. Personne ne le peut savoir, s'il ne l'a vu ou entendu. Personne aussi n'est assez hardi pour le dire, parce que, s'il le disait, on le convaincrait de fausseté, non par un grand nombre de paroles, mais par la seule évidence du fait. Les philosophes qui disputent touchant ce qui se passe dans le ciel commettent la même faute. Mais ils s'imaginent que personne ne les peut reprendre, parce que personne n'a été au lieu dont ils parlent. Si quelqu'un en pouvait descendre, et faire voir leurs impostures et leurs rêveries, ils se garderaient bien de raisonner sur un sujet dont ils ne peuvent jamais avoir de connaissance certaine. Que s'il n'y a point d'homme qui les reprenne, leur témérité n'en est pas pour cela plus heureuse, parce que Dieu, qui sait seul la vérité, les reprend, bien qu'il semble garder le silence et regarder leur prétendue sagesse comme une véritable folie. IV. Zénon et les stoïciens ont eu raison de rejeter les conjectures ; car ce n'est pas en effet le propre d'un homme sage, mais d'un extravagant et d'un téméraire de former des conjectures sur des sujets dont on ne peut rien savoir. Que si l'on ne peut avoir aucune science, comme Socrate l'a cru, et que l'on ne doive former aucune conjecture, comme Zénon le prétend, voilà toute la philosophie renversée. Mais elle ne l'est pas seulement par ces deux célèbres philosophes, elle l'est par tous les autres, et elle voit se lever contre elle les armes de tous ceux qui sembleraient la devoir défendre. Elle est divisée en plusieurs sectes qui sont différentes de sentiments. En laquelle se trouvera la vérité ? Il est clair qu'elle ne se peut trouver en toutes. Fixons-en une où elle se trouve. Elle n'est donc en nulle des autres. Si nous les parcourons toutes, nous dirons toujours la même chose et nous ne donnerons rien à l'une d'entre elles que nous ne l'ayons ôté à ses rivales. Une secte ne s'établit que par la ruine des autres sectes. Nulle ne veut accorder aux autres la sagesse, parce que nulle ne veut avouer qu'elle soit tombée dans la folie. Mais comme chacune renverse les autres, chacune aussi est renversée de la même sorte. Cependant ce sont des philosophes qui accusent de folie les autres sectes de philosophes. Vous n'en sauriez louer une qui ne soit blâmée par d'autres. Vous ne sauriez lui accorder la vérité, que les philosophes ne la lui envient. Ajouterons-nous foi à une seule qui vantera sa doctrine, ou ajouterons-nous foi à plusieurs qui l'accusent d'ignorance? Le sentiment de plusieurs doit sans doute être préféré à celui d'un seul. Personne ne juge sainement de soi, et, comme a dit un poète célèbre, les hommes sont faits de telle façon qu'ils voient beaucoup mieux les affaires d'autrui que les leurs propres. Tout étant incertain de la sorte, ou il faut croire tout le monde, ou il ne faut croire personne. S'il ne faut croire personne, il n'y a personne qui soit sage, bien que chacun prétende l'être. S'il faut croire tout le monde, on peut dire de la même sorte que tout le monde n'est pas sage, parce qu'il n'y a personne à qui tous les autres ne disputent l'avantage de la sagesse. Ainsi ils périssent tous, comme les hommes de Cadmus qui se tuent les uns les autres, ainsi que le raconte la fable, parce qu'ils ont des épées et n'ont point de boucliers. S'il n'y a point de secte qui ne soit vaine et absurde au jugement des autres, il faut nécessairement qu'elles le soient toutes. Ainsi la philosophie se ruine et se détruit elle-même. Arcésilas, chef des académiciens, ayant fort bien prévu cette conséquence, amassa ce que chaque secte reprenait dans les autres, et les confessions que les plus fameux philosophes avaient faites de leur ignorance, se déclara contre tous et institua une nouvelle philosophie qui consistait à n'en admettre aucune. On a commencé à avoir depuis lui deux sortes de philosophie, l'ancienne qui prétend à la gloire de la science, et la nouvelle qui y renonce. Je vois comme une guerre civile entre ces deux sortes de philosophie. À laquelle des deux accorderons-nous la sagesse que l'on ne saurait partager? S'il est possible de pénétrer dans les secrets de la nature, ces nouveaux philosophes sont perdus; si cela n'est pas possible, les anciens sont confondus. Si les deux partis se maintiennent dans une force égale, la philosophie qui est comme leur reine ne laissera pas d'être ruinée, puisqu'elle sera divisée, et qu'elle trouvera sa ruine dans sa division. Si la faiblesse de notre nature nous rend incapables d'aucune science véritable, le parti d'Arcésilas a l'avantage. Mais ce parti-là même ne saurait entièrement subsister, parce qu'il est impossible qu'on ignore tout. |
|
CAPUT V. Multarum rerum scientiam esse necessariam. Sunt enim multa, quae natura ipsa nos scire, et usus frequens, et vitae necessitas cogit. Itaque pereundum est, nisi scias, quae ad vitam sunt utilia, ut appetas, quae periculosa, ut fugias et vites. Praeterea multa sunt, quae usus invenit. Nam solis ac lunae varii cursus, et meatus siderum, et ratio temporum deprehensa est, et natura corporum a medicis, herbarumque vires, et ab agricolis natura terrarum, nec non imbrium futurorum, ac tempestatum signa collecta sunt. Nulla denique ars est, quae non scientia constet. Debuit ergo Arcesilas, si quid saperet, distinguere, quae sciri possent, quaeve nesciri. Sed si id fecisset, ipse se in populum redegisset. Nam vulgus interdum plus sapit; quia tantum, quantum opus est sapit. A quo si quaeras, utrum sciat aliquid, an nihil, dicet se scire, quae sciat, fatebitur se nescire, quae nesciat. Recte ergo aliorum sustulit disciplinas, sed non recte fundavit suam. Ignoratio enim rerum omnium non potest esse sapientia, cujus est scire proprium. Ita cum philosophos expugnaverit, ac docuerit eos nihil scire, ipse quoque nomen philosophi perdidit; quia doctrina ejus est nihil scire. Nam qui alios reprehendit, quod nesciant, ipse debet sciens esse. Cum autem nihil sciat, quae perversitas, quaeve insolentia est, ob id ipsum se philosophum constituere, propter quod caeteros tollat? Possunt enim sic respondere: Si nihil nos scire convincis, et ideo non esse sapientes, quia nihil sciamus; ergone tu quidem es sapiens, quia te quoque confiteris nihil scire? Quid ergo promovit Arcesilas, nisi quod confectis omnibus philosophis, seipsum quoque eodem mucrone transfixit? CAPUT VI. De sapientia, et Academicis et Physicis. Nusquam ne igitur sapientia est? Immo vero inter ipsos fuit: sed nemo vidit. Alii putaverunt, sciri posse omnia; hi sapientes utique non fuerunt; alii nihil, ne hi quidem sapientes fuerunt; illi, quia plus homini dederunt; hi, quia minus: utrisque in utramque partem modus defuit. Ubi ergo sapientia est? Ut neque te omnia scire putes, quod Dei est, neque omnia nescire, quod pecudis. Est enim aliquod medium, quod sit hominis, id est scientia cum ignoratione conjuncta et temperata. Scientia in nobis ab animo est, qui oritur e coelo; ignoratio a corpore, quod est e terra: unde nobis et cum Deo, et cum animalibus est aliqua communitas. Ita quoniam ex his duobos constamus elementis, quorum alterum luce praeditum est, alterum tenebris; pars nobis data est scientiae, pars ignorantiae. Per hunc quasi pontem transire sine cadendi periculo licet; nam illi omnes, qui se in alteram partem inclinaverunt, aut dextro, aut sinistro versus ceciderunt. Utraque autem pars quomodo erraverit, dicam. Academici contra Physicos ex rebus obscuris argumentati sunt, nullam esse scientiam, et exemplis paucarum rerum incomprehensibilium contenti, amplexi sunt ignorantiam; tanquam scientiam totam sustulissent, quia in parte sustulerant. Physici contra ex iis, quae aperta sunt, argumentum trahebant, omnia sciri posse, contentique perspicuis, retinebant scientiam; tanquam totam defendissent, quia ex parte defenderant. Itaque neque hi clara, neque illi obscura viderunt: sed utrique, dum solam scientiam consertis manibus vel retinent, vel eripiunt, non viderunt, in medio constitutam fore, quae illos ad sapientiam transmitteret. Verum Arcesilas ignorantiae magister, cum Zenoni obtrectaret principi Stoicorum, ut totam philosophiam everteret, auctore Socrate, suscepit hanc sententiam, ut affirmaret nihil sciri posse. Itaque coarguit existimationem philosophorum, qui putassent ingeniis suis erutam esse, atque inventam veritatem: videlicet, quia mortalis fuerat illa sapientia, paucisque ante temporibus instituta, ad summum jam incrementum pervenerat, ut jam necessario consenesceret, ac periret, repente extitit Academia, tanquam senectus philosophiae, quae illam conficeret jam deflorescentem. Recteque vidit Arcesilas, arrogantes, vel potius stultos esse, qui putent, scientiam veritatis conjectura posse comprehendi. Sed tamen falsa dicentem redarguere non potest, nisi qui scierit ante, quid sit verum: quod Arcesilas veritate non cognita facere conatus, introduxit genus philosophiae ἀσύστατον quod latine instabile, sive inconstans possumus dicere. Ut enim nihil sciendum sit, aliquid sciri necesse est. Nam si omnino nihil scias, id ipsum, nihil sciri posse, tolletur. Itaque qui velut sententiae loco pronuntiat, nihil sciri, tanquam praeceptum profitetur et cognitum, ergo aliquid sciri potest. Huic simile est illud, quod in scholis proponi solet in asystati generis exemplum; somniasse quemdam, ne somniis crederet. Si enim crediderit, tum sequitur ut credendum non sit. Si autem non crediderit, tunc sequitur ut credendum sit. Ita si nihil sciri potest, necesse est, id ipsum sciri, quod nihil sciatur. Si autem scitur, posse nihil sciri, falsum est ergo, quod dicitur, nihil posse sciri. Sic inducitur dogma sibi ipsi repugnans, seque dissolvens. Sed homo versutus, caeteris philosophis voluit scientiam eripere, ut eam domi absconderet. Nam sibi illam profecto non adimit, qui aliquid affirmat, ut caeteris adimat: sed nihil agit; apparet enim, ac furem suum prodit. Quanto faceret sapientius ac verius, si exceptione facta, diceret, causas rationesque duntaxat rerum coelestium, seu naturalium, quia sunt abditae, nec sciri posse, quia nullus doceat, nec quaeri oportere, quia inveniri quaerendo non possunt. Qua exceptione interposita, et physicos admonuisset, ne quaererent ea quae modum excederent cogitationis humanae; et seipsum calumniae invidia liberasset; et nobis certe dedisset aliquid, quod sequeremur. Nunc autem cum ab illis sequendis nos retraxerit, ne velimus plus scire, quam possumus, non minus a se quoque ipso retraxit. Quis enim velit laborare, ne quidquam sciat? aut ejusmodi suscipere doctrinam, ut etiam communem scientiam perdat? Quae si doctrina est, scientia constet necesse est; si non est, quis tam stultus est, ut discendum id putet, in quo aut nihil discitur aut etiam dediscitur? Quare si neque omnia sciri possunt, quod physici putaverunt, neque nihil, quod Academici, philosophia omnis extincta est. |
V. Il y a plusieurs choses que la condition de notre nature et la nécessité des affaires nous obligent de savoir. On pourrait mourir pour ne pas savoir ce qui est utile à la conservation de la vie, ou ce qui lui est contraire. Il y a d'ailleurs quantité de vérités qui ont été découvertes par un long usage. Les astronomes ont remarqué le mouvement du soleil, de la lune et des astres, et la disposition des saisons. Les médecins ont appris à connaître les diversités des tempéraments, de la force des herbes et des remèdes. Les laboureurs connaissent la qualité des terroirs, les signes des pluies et des changements qui arrivent dans l'air. Enfin il n'y a point d'art où il n'y ait quelque chose de certain. C'est pourquoi Arcésilas devait faire distinction entre ce qu'on peut savoir et ce qu'on ne peut savoir. Mais en faisant cette distinction il serait descendu au rang du vulgaire. Cependant ce vulgaire en sait quelquefois plus que les philosophes, parce qu'il ne sait que ce qu'il est obligé de savoir. Si on lui demande s'il ne sait rien ou s'il sait quelque chose, il déclare franchement ce qu'il sait et avoue de même ce qu'il ne sait pas. Arcésilas a donc bien ruiné les opinions des autres, mais il a mal établi la sienne; car on ne saurait dire que la sagesse consiste à tout ignorer. Au contraire, pour être sage, il faut nécessairement savoir quelque chose. Ainsi en combattant les philosophes et en faisant voir qu'ils ne savaient rien, il a perdu lui-même cette qualité, puisqu'il fait profession de ne rien savoir. Celui qui accuse les autres d'ignorance doit être savant. Que s'il ne l'est pas, c'est un dérèglement et une insolence de s'attribuer le titre de philosophe, pour le même sujet qui le fait le refuser aux autres. Les anciens qu'il attaque lui peuvent répondre de cette sorte: « Si vous nous avez convaincu de ne rien savoir, et que vous prétendiez que, puisque nous ne savons rien, nous ne sommes pas philosophes, vous ne l'êtes pas plus que nous, puisque vous avouez que vous ne savez rien. » Quel avantage a donc remporté Arcésilas, si ce n'est de s'être percé de la même épée dont il avait percé les autres. VI. La sagesse ne se trouve-t-elle donc nulle part? Elle se trouve parmi les philosophes, mais aucun ne la reconnaît. Les uns croient que l'on peut tout savoir, et ceux-là n'ont pas la sagesse; les autres croient que l'on ne peut rien savoir, et ceux-là ne l'ont pas non plus. Les premiers donnent plus à l'homme que ce qui lui appartient ; les derniers lui donnent moins. Les uns et les autres se portent à des extrémités ridicules. En quoi consiste donc la sagesse ? Elle consiste à croire que l'homme ne sait pas tout, parce que cela n'appartient qu'à Dieu, ni qu'il n'ignore pas tout, parce que cela n'est propre qu'aux bêtes. Il y a comme un milieu entre ces deux extrémités, qui est de savoir et d'ignorer quelque chose, et c'est le partage de l'homme. Il a une science mêlée d'ignorance. La science vient de son esprit qui a été tiré du ciel, l'ignorance, de son corps qui a été fait de terre. Une de ces parties qui le composent lui est commune avec Dieu, et l'autre avec les bêtes. L'une a la lumière en partage, et l'autre n'a que les ténèbres. Nous avons une partie de science et une partie d'ignorance. C'est là comme le pont où il faut passer pour éviter les précipices. Ceux qui ont pris un autre chemin sont tombés de côté ou d'autre. Je dirai ici ce qui a donné lieu à la chute de l'un ou de l'autre des partis. Quand les académiciens ont vu qu'il y avait des choses obscures dans la nature, ils en ont tiré cette conséquence contre les physiciens : qu'il n'y en a aucune qu'on puisse savoir. Les physiciens, ayant au contraire apporté un petit nombre de vérités claires et manifestes, en ont conclu qu'on n'ignore rien. Les premiers n'ont pas tenu compte de ce qui est clair, et les seconds n'ont pas tenu compte de ce qui est obscur. Ils se sont tous efforcés les uns de chasser la science et les autres de la retenir, et n'ont vu ni les uns ni les autres le chemin par où ils eussent pu arrivera la sagesse. Arcésilas, le défenseur de l'ignorance, qui parlait fort désavantageusement de Zénon, chef des stoïciens, entreprit, par l'avis de Socrate, de soutenir que l'on ne pourrait rien savoir ; ce qui tendait sans doute à la ruine de toute la philosophie. Il réfuta l'opinion dont les philosophes se flattaient d'avoir découvert la vérité par la subtilité de leur esprit. Comme il y avait quelque temps que cette sagesse était née et qu'elle avait déjà fait de notables progrès, elle ne pouvait pas être éloignée de sa décadence et de sa fin. L'Académie survint tout à propos comme pour avoir soin de ses funérailles. Arcésilas reconnut fort bien qu'il y a de la témérité ou plutôt de l'extravagance à prétendre arriver par de simples conjectures à la connaissance de la vérité. Cependant on ne saurait réfuter la fausseté sans avoir quelque idée de la vérité. Arcésilas l'ayant néanmoins entrepris, a introduit une sorte de philosophie où il n'y a rien de stable ni d'assuré. Car c'est savoir quelque chose que de savoir qu'on ne peut rien savoir. Si l'on ne savait rien du tout, on ne saurait pas que l'on ne peut rien savoir. Quiconque prononce comme un axiome que l'on ne sait rien, prononce que l'on sait quelque chose. Ce que je dis est semblable à ce que l'on propose d'ordinaire dans les écoles, comme un exemple de proposition douteuse et ambiguë: que quelqu'un a songé qu'il ne faut pas ajouter foi aux songes. Car s'il ajoute foi à ce songe-là, il s'ensuit qu'il n'y en faut point ajouter; et s'il n'y en ajoute point, il s'ensuit qu'il en faut ajouter. Ainsi s'il est vrai qu'on ne puisse rien savoir, il s'ensuit qu'on sait qu'on ne peut rien savoir, et si l'on sait qu'on ne peut rien savoir, il est faux qu'on ne puisse rien savoir. Voilà comment on avance une doctrine contraire à elle-même et qui se détruit. Mais cet homme fin et adroit a lâché de ravir la science aux autres philosophes, à dessein de la tenir comme cachée chez lui. Car il est clair qu'en l’ôtant aux autres, il ne se l'ôte pas à lui-même. Mais il ne réussit pas mieux dans ce dessein, parce qu'il est aisé de découvrir son artifice et son vol. Il aurait agi beaucoup plus judicieusement s'il s'était contenté de dire : que l'on ne saurait savoir les causes de ce qui arrive dans la nature et dans le ciel, qu'on ne les peut apprendre, parce qu'il n'y a personne qui les puisse enseigner, et qu'on ne les doit pas chercher, parce qu'il est impossible de les trouver. En usant de cette réserve, il aurait donné un sage conseil aux physiciens de ne se point tourmenter inutilement dans la recherche de ce qui est au-dessus de leur esprit ; il aurait évité le blâme où il est tombé d'avoir voulu discréditer toutes les sectes, et nous aurait laissé des règles que nous aurions pu suivre en sûreté. Mais en nous détournant de suivre les autres, et de désirer savoir ce qui peut être su, il nous a détourné de le suivre lui-même. Car qui voudrait se donner de la peine pour ne rien apprendre, ou qui voudrait faire profession d'une doctrine qui l'obligerait de renoncer aux lumières les plus communes? Si c'est une doctrine, en l’étudiant on doit apprendre quelque chose ; car qui aurait assez peu d'esprit pour s'adonner à une étude où il n'y aurait rien à apprendre et où il faudrait oublier ce que l'on aurait appris auparavant? La conclusion de ce discours est : que, soit que l'on ne puisse pas tout savoir comme les physiciens l'ont reconnu, soit que l'on ne puisse rien savoir comme l'ont prétendu les académiciens, il n'y a plus de philosophie. VII. Parlons maintenant de la morale qui est sans doute la partie la plus importante de la philosophie, et qui apporte la plus grande utilité, au lieu que la physique ne donne que du plaisir. Comme il n'y a point de fautes aussi dangereuses que celles qui regardent les mœurs, nous ne devons jamais avoir plus d'application que quand il s'agit de les bien régler. Il y a d'autres matières auxquelles on ne prend pas si fort garde, parce que, quand on y réussit, on n'en tire pas grand profit, et quand on se trompe, on n'en souffre pas grand dommage. En matière de morale, il n'est pas permis de suivre son caprice ni de se tromper. Tout le monde doit être uni dans le même sentiment, parce que le moindre égarement est d'une grande conséquence pour la suite de la vie. Il y a moins de danger dans la recherche des secrets de la nature, mais il y a aussi plus d'obscurité, et plus de liberté de soutenir ce qui paraît le plus probable. Au contraire, dans le règlement des mœurs, comme il y a plus de danger il y a moins de difficulté, parce que l'usage et l'expérience nous enseignent ce qu'il y a de plus véritable ou de meilleur. Voyons donc s'il y a quelque uniformité de sentiments parmi les philosophes touchant la morale et touchant les préceptes qu'ils nous donnent pour la conduite de notre vie. Il n'est pas nécessaire de parcourir toutes les questions. Il n'y a qu'à choisir la principale et celle d'où les autres dépendent. Epicure met le souverain bien dans le plaisir de l'esprit, et Aristippe dans le plaisir du corps. Calliphon et Dinomaque, Cyrénéens, joignent l'honnêteté au plaisir. Diodore fait consister le souverain bien à être exempt de douleur. Hiéronymus à n'en pas sentir. Les péripatéticiens l'établissent dans les biens de l'esprit, du corps et de la fortune. Hérille maintient que le souverain bien est de savoir; Zénon, que c'est de vivre conformément à la nature; quelques stoïciens, que c'est de suivre la vertu. Aristobée n'en reconnaît que dans l'honnêteté et dans la vertu. Voila les sentiments des philosophes. Lequel suivrons-nous dans une si grande diversité ? Leur autorité est égale. Si nous sommes capables de prendre de nous-mêmes le bon parti, nous n'aurons pas besoin de nous adonner s l'étude de la philosophie, parce que nous sommes montés au comble de la sagesse, et que nous sommes les juges de ceux qui font profession de la chercher. Mais si nous sommes encore au rang de ceux qui ont besoin de s'instruire, comment jugerons-nous de ce que nous n'avons pas appris, surtout quand un académicien nous retiendra comme il fait par le manteau, et nous empêchera d'ajouter foi à personne, bien que de son côté il n'avance rien que nous puissions croire. |
|
CAPUT VII. De philosophia ethica et summo bono. Transeamus nunc ad alteram philosophiae partem, quam ipsi moralem vocant, in qua totius philosophiae ratio continetur; si quidem in illa physica sola oblectatio est, in hac etiam utilitas. Et quoniam in disponendo vitae statu, formandisque moribus, periculo majori peccatur, majorem diligentiam necesse est adhiberi, ut sciamus quomodo nos oporteat vivere. Illic enim potest venia concedi; quia sive aliquid dicunt, nihil prosunt, sive delirant, nihil nocent. Hic vero nullus dissidio, nullus errori est locus. Unum sentire omnes oportet, ipsamque philosophiam uno quasi ore praecipere; quia si quid fuerit erratum, vita omnis evertitur. In illa priori parte ut periculi minus, ita plus difficultatis est; quod obscura rerum ratio cogit diversa et varia sentire. Hic ut periculi plus, ita minus dificultatis; quod ipse usus rerum et quotidiana experimenta possunt docere, quid sit verius, et melius. Videamus ergo, utrumne consentiant, aut quid nobis afferant, quo rectius vita degatur. Non necesse est omnia circuire. unum eligamus, ac potissimum, quod est summum ac principale, in quo totius sapentiae cardo versatur. Epicurus summum bonum in voluptate animi esse censet; Aristippus in voluptate corporis; Callipho et Dinomachus honestatem cum voluptate junxerunt; Diodorus cum privatione doloris. Summum bonum posuit Hieronymus in non dolendo; peripatetici autem in bonis animi, et corporis, et fortunae. Herilli summum bonum est scientia; Zenonis, cum natura congruenter vivere: quorumdam stoicorum, virtutem sequi; Aristoteles in honestate ac virtute summum bonum collocavit. Hae sunt fere omnium sententiae. In tanta diversitate, quem sequimur? cui credimus? Par est in omnibus auctoritas. Si eligere possumus quod est melius, jam non est philosophia nobis necessaria, quia sapientes jam sumus, qui de sapientium sententiis judicemus. Cum vero discendae sapientiae causa veniamus, qui possumus judicare, qui nondum sapere coeperimus? maxime cum praesto adsit academicus, qui nos pallio retrahat, ac vetet cuiquam credere, nec tamen afferat ipse quod sequamur. CAPUT VIII. De summo bono, et animi corporisque voluptatibus et virtute. Quid ergo superest, nisi ut, omissis litigatoribus furiosis ac pertinacibus, veniamus ad judicem illum, scilicet datorem simplicis et quietae sapientiae? Quae non tantum formare nos, ac inducere in viam possit, verum etiam de controversiis istorum ferre sententiam. Haec nos docet, quid sit hominis verum ac summum bonum: de quo priusquam dicere incipio, illae omnes sententiae sunt refellendae, ut appareat neminem illorum fuisse sapientem. Cum de officio hominis agatur, oportet summum summi animalis bonum in eo constitui, quod commune cum caeteris animalibus esse non possit. Sed ut feris dentes, armentis cornua, volucribus pennae, propria sunt: sic homini aliquid suum debet adscribi, sine quo rationem suae conditionis amittat. Nam quod vivendi aut generandi causa datum est omnibus, est quidem bonum naturale; summum tamen non est, nisi quod est unicuique generi proprium. Sapiens ergo non fuit qui summum bonum credidit animi voluptatem, quoniam illa sive securitas, sive gaudium est, communis est omnibus. Aristippo ne respondendum quidem duco, quem semper in corporis voluptates ruentem, nihilque aliud quam ventri et Veneri servientem, nemini dubium est hominem non fuisse; sic enim vixit, ut nihil inter eum pecudemque distaret, nisi unum, quod loquebatur. Quod si asino, aut cani, aut sui facultas loquendi tribuatur, quaerasque ab his, quid sibi velint, cum feminas tam rabide consectantur, ut vix divelli queant, cibos etiam, potumque negligant? cur aut alios mares violenter abigant, aut ne victi quidem absistant, sed a fortioribus saepe contriti, eo magis insectentur? cur nec imbres, nec frigora pertimescant, laborem suscipiant, periculum non recusent? Quid aliud respondebunt, nisi summum bonum esse corporis voluptatem? eam se appetere, ut afficiantur suavissimis sensibus; eosque esse tanti, ut assequendorum causa, nec laborem sibi ullum, nec vulnera, nec mortem ipsam recusandam putent. Ab hisne igitur praecepta vivendi petemus, qui hoc idem sentiunt, quod animae rationis expertes? Aiunt Cyrenaici virtutem ipsam ex eo esse laudandam, quod sit efficiens voluptatis. Verum, inquit obscoenus canis, aut sus ille lutulentus. Nam ideo cum adversario summa virium contentione depugno, ut virtus mea pariat mihi voluptatem, cujus expers sim necesse est, si victus abcessero. Ab his ergo sapere discemus, quos a pecudibus ac belluis, non sententia, sed lingua discernit? Privationem doloris summum bonum putare, non plane peripateticorum ac stoicorum, sed clinicorum philosophorum est. Quis enim non intelligat ab aegrotis et in aliquo dolore positis esse hoc disputatum? Quid tam ridiculum, quam id habere pro summo bono, quod medicus possit dare? Dolendum est ergo, ut fruamur bono, et quidem graviter ac saepe, ut sit postea, non dolere, jucundius. Miserrimus est igitur, qui nunquam doluit; quia bono caret: quem nos felicissimum putabamus, quia malo caruit. Ab hac vanitate non longe abfuit, qui, omnino nihil dolere, summum bonum dixit. Nam praeter quod omne animal doloris est fugiens, quis potest sibi hoc bonum praestare, quod nobis ut eveniat, nihil aliud possumus quam optare? Summum autem bonum non potest efficere quemquam beatum, nisi semper fuerit in ipsius potestate: hoc autem non virtus homini, non doctrina, non labor, sed natura ipsa cunctis animantibus praestat. Qui voluptatem cum honestate junxerunt, communionem hanc effugere voluerunt, sed effecerunt repugnans bonum; quoniam qui voluptati deditus est, honestate careat necesse est, qui honestati studet, voluptate. Peripateticorum bonum nimium multiplex, et exceptis animi bonis, quae ipsa quae sint, magna contentio est, commune cum belluis potest videri. Nam corporis bona, id est, incolumitas, indolentia, valetudo, non minus sunt mutis, quam homini necessaria; ac nescio an etiam magis, quia homo et medelis, et ministeriis sublevari potest, muta non possunt. Item, quae appellant fortunae bona; nam sicut homini opibus ad vitam tuendam, ita illis praeda et pabulis opus est. Ita inducendo bonum, quod non sit in hominis potestate, totum hominem alienae ditioni subjugarunt. Audianeus etiam Zenonem; nam is interdum virtutem somniat. Summum, inquit, est bonum, cum natura consentanee vivere. Belluarum igitur nobis more vivendum est. Nam quae abesse debent ab homine, in iis omnia deprehenduntur: voluptates appetunt, metuunt, fallunt, insidiantur, occidunt; et, quod ad rem maxime attinet, Deum nesciunt. Quid ergo me docet, ut vivam secundum naturam, quae ipsa in deterius prona est, et quibusdam blandimentis lenioribus in vitia praecipitat? Vel si aliam mutorum, aliam hominis dicit esse naturam, quod homo ad virtutem sit genitus, nonnihil dicit: sed tamen non erit definitio summi boni; quia nullum est animal, quod non secundum naturam suam vivat. Qui scientiam summum bonum fecit, aliquid homini proprium dedit: sed scientiam alterius rei gratia homines appetunt, non propter ipsam. Quis enim scire contentus est, non expetens aliquem fructum scientiae? Artes ideo discuntur, ut exerceantur: exercentur autem, vel ad subsidia vitae, vel ad voluptatem, vel ad gloriam. Non est igitur summum bonum, quod non propter se expetitur. Quid ergo interest utrum scientiam summum bonum putemus, an illa ipsa, quae scientia ex se parit, id est, victum, gloriam, voluptatem? quae non sunt homini propria, et ideo ne summa quidem bona. Nam voluptatis et victus appetentia non homini solum, sed etiam mutis inest. Quid cupiditas gloriae? nonne in equis deprehenditur, cum victores exultant, victi dolent? Tantus amor laudum, tantae est victoria curae. Nec immerito summus poeta experiendum esse ait, Et quis cuique dolor victo, quae gloria palmae. Quod si ea, quae parit scientia, communia sunt cum aliis animalibus, non est ergo summum bonum scientia. Praeterea non mediocre hujus definitionis est vitium quod scientia nuda ponitur. Incipient enim beati omnes videri, qui artem aliquam scierint, immo vero qui et res malas scierint; ut tam beatus sit, qui venena didicerit temperare, quam qui mederi. Quaero igitur, ad quam rem scientia referenda sit? Si ad causas rerum naturalium, quae beatitudo erit mihi proposita, si sciero unde Nilus oriatur, vel quidquid de coelo physici delirant? Quid, quod earum rerum non est scientia, sed opinatio, quae pro ingeniis varia est. Restat ut scientia bonorum ac malorum summum bonum sit. Cur ergo scientiam maluit, quam ipsam sapientiam summum bonum dicere, cum sit utriusque significatio et vis eadem? Nemo tamen usque adhuc summum bonum dixit esse sapientiam, quod melius dici potuit. Nam scientia parum est ad bonum suscipiendum, malumque fugiendum nisi accedat et virtus. Multi enim philosophorum, cum de bonis, malisque dissererent, aliter tamen, quam loquebantur, natura cogente, vixerunt, quia virtute caruerunt. Virtus autem cum scientia conjucta est sapientia. Superest ut eos etiam refellamus qui virtutem ipsam summum bonum putaverunt, in qua opinione etiam M. Tullius fuit; in quo multum inconsiderati fuerunt. Non enim virtus ipsa est summum bonum, sed effectrix et mater est summi boni; quoniam perveniri ad illud sine virtute non potest. Utrumque intellectu est facile. Quaero enim, utrumne ad praeclarum illud bonum facile perveniri putent, an cum difficultate ac labore? Expediant acumen suum, erroremque defendant. Si facile ad illud, ac sine labore perveniri potest, summum bonum non est. Quid enim nos cruciemus, quid conficiamus, enitendo diebus et noctibus? quandoquidem tam in promptu id quod quaerimus jacet, ut illud quilibet sine ulla contentione animi comprehendat. Sed si commune quoque ac mediocre quodlibet bonum non nisi labore assequimur quoniam bonorum natura in arduo posita est, malorum in praecipiti, summo igitur labore summum bonum assequi necesse est. Quod si verissimum est, ergo altera virtute opus est, ut perveniamus ad eam virtutem quae dicitur summum bonum; quod est incongruens, et absurdum, ut virtus per seipsam perveniat ad seipsam. Si non potest ad ullum bonum nisi per laborem perveniri, apparet virtutem esse, per quam perveniatur; quoniam in suscipiendis perferendisque laboribus, vis officiumque virtutis est. Ergo summum bonum non potest esse id, per quod necesse est ad aliud perveniri. Sed illi, cum ignorarent quid efficeret virtus, aut quo tenderet, honestius autem nihil reperirent, substiterunt in ipsius virtutis nomine, quam nullo proposito emolumento, appetendam esse dixerunt, et bonum sibi constituerunt, quod bono indigeret. Aristoteles ab iis non longe recessit, qui virtutem cum honestate summum bonum putavit: quasi possit ulla esse virtus nisi honesta, ac non, si quid habuerit turpitudinis, virtus esse desinat. Sed vidit fieri posse, ut de virtute pravo judicio male sentiatur; et ideo existimatione hominum serviendum putavit, quod qui facit, a recto bonoque discedit, quia non est in nostra potestate ut virtus pro suis meritis honestetur. Nam quid est honestas, nisi honor perpetuus ad aliquem secundo populi rumore delatus? Quid ergo fiet, si errore ac pravitate hominum, mala existimatio subsequatur? abjiciemusne virtutem, quia flagitiosa et turpis ab insipientibus judicetur? Quae quoniam invidia premi, ac vexari potest, ut sit ipsa proprium ac perpetuum bonum, nullo extrinsecus adjumento indigere debet, quin suis per se viribus nitatur, et constet. Itaque nec ullum ei ab homine bonum sperandum est, nec ullum malum recusandum. |
VIII. Que nous reste-t-il à faire, si ce n'est de renoncer à des disputes pleines d'opiniâtreté et de fureur, et de nous soumettre à l'équité d'un juge qui décidera nos questions, qui nous donnera de salutaires préceptes, et nous inspirera une sagesse pure et tranquille. Ce sera de lui que nous apprendrons quel est le véritable bien de l'homme. Mais avant de faire voir en quoi il consiste, il est à propos de réfuter les opinions que les philosophes ont eues sur ce sujet, et de montrer qu'aucun d'entre eux n'a approché de la sagesse. Puisqu'il s'agit ici du principal devoir de l'homme, il faut nécessairement que son souverain bien consiste en une chose qui ne lui puisse être commune avec les autres animaux. L'homme doit avoir quelque chose qui lui soit propre et qu'il ne puisse perdre sans perdre sa propre nature, comme les loups ont les dents, les taureaux les cornes, et les oiseaux les ailes. La faculté de vivre ou de produire son semblable est un bien naturel, mais il n'y a de bien souverain que celui qui est commun à tous. Celui-là n'était donc pas un véritable sage qui a vu que le souverain bien consistait dans le plaisir de l'esprit, parce que, soit que ce plaisir soit une joie ou un repos et une sécurité, c'est un bien qui est commun. Quant à Aristippe, je n'estime pas qu'il mérite qu'on lui réponde. La brutalité avec laquelle il s'est plongé en toute sorte de sales voluptés et la bassesse avec laquelle il s'est rendu esclave des plaisirs des sens ne font que trop voir que ce n'était pas un homme et qu'il n'y avait aucune différence entre lui et les bêtes, si ce n'est qu'il avait l'usage de la parole. Si les ânes, les chiens et les porcs pouvaient parler et qu'on leur demandât pourquoi ils suivent leurs femelles avec une ardeur si furieuse qu'ils ne peuvent s'en séparer, qu'ils négligent pour cela les aliments, qu'ils se battent contre les autres mâles, qu'ils ne se rendent pas lors même qu'ils sont abattus, qu'ils méprisent la pluie, le froid, le travail et le danger, que répondraient-ils, si ce n'est que le plaisir du corps est le souverain bien, et que pour en jouir ils n'appréhendent aucun mal et ne refusent ni de recevoir des blessures, ni de souffrir la mort. Recevons-nous des préceptes pour la conduite de notre vie de ceux qui n'ont point d'autres sentiments que ceux des créatures privées de raison ? Les deux Cyrénéens disent que la vertu mérite d'être louée, quand ce ne serait que pour le plaisir qu'elle donne. « Nous combattons, disent-ils, non comme des chiens ou des porcs pour le plaisir du corps, mais pour le plaisir de l'esprit qui ne vient que de la vertu, et si nous sommes vaincus nous serons privés de ce plaisir. » Recevons-nous des règles de sagesse de ceux qui ne sont différents des bêtes qu'en la manière de parler plutôt qu'en celle de penser et de concevoir. Il appartient aux cyniques plutôt qu'aux péripatéticiens de faire consister le souverain bien dans l'exemption de la douleur. Chacun sait que cette question a été fort agitée par les malades et ceux qui sentent du mal. Qu'y a-t-il de si ridicule que de prendre pour le souverain bien, un bien qu'un médecin nous peut procurer ? Pour jouir de ce souverain bien il faut avoir souffert du mal, et afin que cette jouissance soit plus agréable, il faut avoir senti les douleurs les plus aiguës et les plus fâcheuses. Celui qui n'en a jamais senti est très misérable parce qu'il est privé du bien, qui consiste à ne plus sentir de douleur, au lieu qu'il semblait heureux de n'avoir jamais eu de mal. Celui qui a cru que le souverain bien consiste à n'avoir jamais eu de douleur n'est pas fort éloigné de l'extravagance de l'opinion dont je viens de parler. Car outre qu'il n'y a point d'animal qui n'évite autant qu'il peut la douleur, qui peut se promettre la possession d'un bien qu'il n'est permis tout au plus que de souhaiter? Or, il est certain que pour être heureux, il faut avoir le souverain bien en sa puissance, ce que ne peuvent procurer ni la vertu ni la science, ni le travail, mais seulement la nature. Ceux qui ont joint l'honnêteté au plaisir pour trouver le souverain bien de l'homme, ont voulu éviter les inconvénients des autres opinions, mais ils ont établi un bien contraire à lui-même. Car qui conque recherche le plaisir n'a pas d'honnêteté, et quiconque a de l'honnêteté est privé du plaisir. Les péripatéticiens font consister le souverain bien dans un trop grand nombre de sujets et qui semblent communs aux hommes et aux bêtes, à la réserve des seuls avantages de l'esprit, touchant lesquels il y a de grandes contestations. Les avantages du corps, comme l'intégrité des parties, l'indolence, la santé ne sont pas moins nécessaires aux bêtes qu'à l'homme. Car quand l'homme en est privé, il trouve dans les remèdes et dans la société des soulagements que les bêtes ne trouvent point. D'ailleurs quels sont les biens que l'on appelle les biens de la fortune ? ce sont des biens qui ne viennent que du vol et du brigandage, comme les commodités de la vie ne procèdent que des richesses. Ainsi, en introduisant un bien qui ne dépend point de l'homme, ils ont fait dépendre l'homme des choses extérieures. Écoulons maintenant ce qu'a dit Zénon, car il semble qu'il ait quelquefois quelque idée de la vertu. « Le souverain bien, dit-il, consiste à vivre conformément à la nature. » Il faut donc vivre de la même manière que les bêtes. Mais elles vivent d'une manière dont nous devons être fort éloignés. Elles cherchent le plaisir, elles craignent, elles espèrent, elles usent de ruses, tendent des pièges, tâchent de tromper, de surprendre et de tuer, et ce qui est plus important, elles ne connaissent pas Dieu. Qui est-ce donc qui m'enseigne à vivre conformément à une nature qui ne porte qu'au péché et qui n'a de charmes que pour engager dans le crime ? Que si Zénon répond que la nature des hommes est différente de celle des bêtes, en ce que l'homme est capable de la vertu, j'avoue que la réponse sera digne de notre considération. Mais la définition qu'il porte du souverain bien n'en sera pas meilleure, parce qu'il n'y a point d'animal qui ne vive conformément à la nature. Ceux qui mettent le souverain bien dans la science semblent accorder quelque chose de particulier à l'homme. Cependant les hommes ne recherchent pas la science pour elle-même. Car qui est-ce qui se contenir de l'acquérir, sans en attendre quelque fruit ? On apprend les arts pour les exercer. On les exerce pour le plaisir, pour le profit ou pour la gloire. La science n'est donc pas le souverain bien puisqu'on ne la recherche pas sur elle-même, mais pour autre chose. Quelle différence y a-t-il entre mettre le souverain bien dans la science ou le mettre dans le plaisir, dans le profit ou dans la gloire que la science peut apporter, c'est-à-dire dans des biens qui, n'étant pas propres à l'homme, ne peuvent jamais être souverains ? Le plaisir et le soin d'amasser des vivres se rencontrent dans les bêtes. Le désir de la gloire ne s'y rencontre-t-il pas? ne se remarque-t-il pas dans les chevaux, et ne voit-on pas qu'ils triomphent de joie quand ils ont remporté la victoire, et qu'ils sont abattus de tristesse quand ils ont été vaincus? Ils semblent qu'ils soient sensibles à la gloire et qu'ils aiment les louanges. Aussi un poète a-t-il dit avec raison combien chacun sent avec douleur sa défaite, avec joie son triomphe. Si les biens qui procèdent de la science sont communs à l'homme et aux animaux, la science n'est pas le souverain bien. De plus, on peut remarquer un autre défaut fort grave dans cette opinion, qui est que la science y est nommée d'une manière trop vague et trop indéfinie ; car si le bonheur consistait dans la science, tous ceux qui sauraient un métier seraient heureux. Ceux mêmes qui en sauraient un mauvais, et ceux qui sauraient détremper des poisons ne seraient pas moins heureux que ceux qui sauraient préparer des remèdes. Je demande donc de quelle science on entend parler. Si c'est de la science naturelle, j'en serai donc plus heureux quand je connaîtrai la source du Nil, ou que j'aurai appris tout ce que les physiciens disent de ridicule et d'extravagant touchant le ciel et les astres. De plus, on n'a presque aucune science de ces matières; on n'a que des conjectures qui sont aussi différentes que les esprits. Il reste donc que ce soit de la science du bien et du mal en laquelle consiste le souverain bien. Que ne disait-on plutôt qu'il consiste en la sagesse? On aurait sans doute mieux dit, et cependant personne ne s'est avisé de le dire. Si la science n'est accompagnée de la vertu, elle sert de peu, soit pour faire le bien ou pour éviter le mal. Plusieurs philosophes ont fait d'excellents discours touchant le bien et le mal, et ont tenu une conduite fort contraire à leurs sentiments, parce qu'ils n'ont pas eu assez de vertu pour réprimer les mouvements déréglés de leurs passions. L'union de la vertu à la science est ce qui fait la sagesse. Il ne nous reste plus qu'à réfuter l'opinion de ceux qui ont cru que la vertu est le souverain bien. Cicéron a été dans ce sentiment, bien que plusieurs se soient trompés en le voulant soutenir. La vertu est plutôt un moyen pour arriver au souverain bien, qu'elle n'est le souverain bien. Ce que je dis est aisé à entendre ; car je demande s'il est nécessaire de prendre beaucoup de peine pour arriver à la possession d'un bien si excellent, ou si l'on y arrive sans peine. Que ces philosophes fassent paraître ici la subtilité de leur esprit et qu'ils soutiennent leurs erreurs. Si l'on parvient aisément à la possession de ce bien, ce n'est pas le bien souverain. Ce serait fort inutilement que nous nous tourmenterions jour et nuit pour le posséder, s'il était à la portée de tout le monde, et s'il était permis d'en jouir sans aucun travail. On n'a aucun bien sans peine, pas même le plus médiocre et le plus commun. Le bien est comme au sommet d'une montagne, et le mal dans la pente. Il faut donc nécessairement faire des efforts pour parvenir à la jouissance du souverain bien. S'il faut faire des efforts, il faut de la vertu pour les faire, et cette vertu-là par laquelle on arrivera au souverain bien, sera autre chose que le souverain bien même; ce qui semble renfermer une contradiction, en ce que l'on arriverait à la vertu par la vertu même. Si l'on ne saurait arriver à la possession du souverain bien sans peine ni sans travail, c'est par la vertu que l'on y arrive, parce que son devoir est de prendre la peine et de supporter le travail. La vertu n'est donc pas le souverain bien, puisqu'elle sert à y arriver. Ces philosophes ayant ignoré quel est le propre devoir et la véritable fin de la vertu, et ne trouvant rien de plus honnête qu'elles s'y sont arrêtés, ont assuré qu'il la fallait rechercher sans intérêt, et l'ont prise pour le souverain bien, quoique elle-même tendit au souverain bien. Aristobée ne s'est pas fort éloigné de ce sentiment, quand il a soutenu que le souverain bien [consistait dans la vertu jointe à l'honnêteté. La vertu peut-elle être séparée de l'honnêteté, et si elle avait quelque chose de déshonnête ne cesserait-elle pas d'être vertu ? Ce philosophe a considéré que les hommes jugent quelquefois peu favorablement de la vertu, et il s'est accommodé à l'opinion du peuple, bien que cela ne puisse se faire sans blesser la raison et la justice, parce que l'honneur de la vertu ne dépend pas de notre suffrage. Cet honneur est-il rien autre chose que la louange que donne la multitude ? Si cette multitude conçoit par légèreté ou par méprise une fausse opinion sur quelqu'un, la vertu deviendra-t-elle tout d'un coup ou criminelle ou infâme? Elle peut être persécutée par la haine et par la jalousie des médians. Mais pour être un bien solide et durable, il faut qu'elle soit absolument indépendante, et qu'elle n'ait rien ni à espérer ni à craindre. |
|
CAPUT IX. De summo bono, et de cultu veri Dei; atque Anaxagorae refutatio. Venio nunc ad verae sapientiae summum bonum, cujus natura hoc modo determinanda est. Primum, ut solius hominis sit, nec cadat in ullum aliud animal; deinde, ut solius animi, nec communicari possit cum corpore; postremo, ut non possit cuiquam sine scientia et virtute contingere. Quae circumscriptio illas omnes sententias excludit, ac solvit; eorum enim quae dixerunt, nihil tale est. Dicam nunc, quid sit; ut doceam (quod institui) philosophos omnes caecos atque insipientes fuisse qui, quod esset homini summum bonum constitutum, nec videre, nec intelligere, nec suspicari aliquando potuerunt. Anaxagoras, cum ab eo quaereretur cujus rei causa natus esset, respondit, coeli ac solis videndi. Hanc vocem admirantur omnes ac philosopho dignam judicant. At ego hunc puto non invenientem quid responderet, effudisse hoc passim, ne taceret. Quod quidem secum, si sapiens fuisset, commentatum et meditatum habere debuit: quia si quis rationem sui nesciat, nec homo sit quidem. Sed putemus non ex tempore dictum illud effusum. Videamus, in tribus verbis quot et quanta peccaverit. Primum, quod omne hominis officium in solis oculis posuit, nihil ad mentem referens, sed ad corpus omnia. Quid si caecus fuerit, officiumne hominis amittet, quod fieri sine occasu animae non potest? Quid caeterae corporis partes? num carebunt suis quaeque muneribus? Quid, quod plus est in auribus, quam in oculis situm; quoniam et doctrina, et sapientia percipi auribus solis potest, oculis solis non potest. Coeli ac solis videndi causa natus es? Quis te in hoc spectaculum induxit? aut quid coelo rerumque naturae visio tua confert? Nimirum, ut hoc immensum et admirabile opus laudes. Confitere ergo rerum omnium esse constitutorem Deum, qui te in hunc mundum, quasi testem laudatoremque tanti sui operis induxit. Magnum esse credis videre coelum ac solem: cur ergo gratias non agis ei, qui hujus beneficii auctor est? cur non ipsius virtutem, providentiam, potestatem metiris animo, cujus opera miraris? Etenim necesse est, ut multo mirabilior sit qui mirabilia perfecit. Si te quispiam vocasset ad coenam, in eaque optime acceptus esses, num sanus viderere si pluris faceres ipsam voluptatem, quam voluptatis auctorem? Adeo philosophi ad corpus omnia referunt, nihil prorsus ad mentem; nec vident amplius quam quod sub oculos venit. Atqui, remotis omnibus officiis corporis, in sola mente ponenda est hominis ratio. Non ergo ideo nascimur, ut ea, quae sunt facta, videamus, sed ut ipsum factorem rerum omnium contemplemur, id est, mente cernamus. Quare si quis hominem, qui vere sapiat, interroget, cujus rei gratia natus sit, respondebit intrepidus ac paratus, colendi se Dei gratia natum, qui nos ideo generavit, ut ei serviamus. Servire autem Deo, nihil aliud est, quam bonis operibus tueri et conservare justitiam. Sed ille, ut homo divinarum rerum imperitus, rem maximam redegit ad minimum, duo sola deligendo, quae sibi diceret intuenda. Quod si natum se esse dixisset, ut mundum intueretur, quanquam omnia comprehenderet, ac majori uteretur sono, tamen non implesset hominis officium: quia quanto pluris est anima quam corpus, tanto pluris est Deus, quam mundus, quia mundum Deus fecit et regit. Non ergo mundus oculis, quia utrumque est corpus, sed Deus animo contemplandus est: quia Deus, ut est ipse immortalis, sic animum voluit esse sempiternum. Dei autem contemplatio est, venerari et colere communem parentem generis humani. Quod si a philosophis abfuit, projectique in terram fuerunt divina ignorando, existimandus est Anaxagoras, ad quae videnda natum se esse dixit, nec coelum vidisse, nec solem. Expedita est igitur hominis ratio, si sapiat: cujus propria est humanitas. Nam ipsa humanitas quid est, nisi justitia? quid est justitia, nisi pietas? pietas autem nihil aliud est, quam Dei parentis agnitio. CAPUT X. Proprium hominis est Deum cognoscere et colere. Summum igitur hominis bonum in sola religione est; nam caetera, etiam quae putantur esse homini propria, in caeteris quoque animalibus reperiuntur. Cum enim suas voces propriis inter se notis discernunt atque dignoscunt, colloqui videntur; ridendi quoque ratio apparet in his aliqua, cum demulsis auribus, contractoque rictu, et oculis in lasciviam resolutis, aut homini alludunt, aut suis quisque conjugibus ac foetibus propriis. Nonne aliquid amori mutuo et indulgentiae simile impartiunt? Jam illa quae sibi prospiciunt in futurum, et cibos reponunt, habent utique providentiam. Rationis quoque signa in multis deprehenduntur. Nam quando utilia sibi appetunt, mala cavent, pericula vitant, latibula sibi parant in plures exitus dispatentia, profecto aliquid intelligunt. Potest aliquis negare illis inesse rationem, cum hominem ipsum saepe deludant? Nam quibus generandi mellis officium est, cum assignatas incolunt sedes, castra muniunt, domicilia inenarrabili arte componunt, regi suo serviunt; nescio an non in his perfecta sit prudentia. Incertum est igitur, utrumne illa, quae homini tribuuntur, communia sint cum aliis viventibus: religionis certe sunt expertia. Equidem sic arbitror, universis animalibus datam esse rationem, sed mutis tantummodo ad vitam tuendam, homini etiam ad propagandam. Et quia in homine ipsa ratio perfecta est, sapientia nominatur: quae in hoc eximium facit hominem, quod soli datum est intelligere divina. Qua de re Ciceronis vera est sententia. « Ex tot, inquit, generibus nullum est animal praeter hominem, quod habeat notitiam aliquam Dei; ipsisque in hominibus nulla gens est, neque tam immansueta, neque tam fera, quae non, etiamsi ignoret qualem Deum haberi deceat, tamen habendum sciat. » Ex quo efficitur, ut is agnoscat Deum, qui, unde ortus sit, quasi recordetur. Qui ergo philosophi volunt animos omni metu liberare, tollunt etiam religionem, et orbant hominem suo proprio ac singulari bono, quod est a recte vivendo, atque ab omni humanitate disjunctum: quia Deus, ut cuncta viventia subjecit homini, sic ipsum hominem sibi. Nam quid est, cur iidem ipsi disputent, eo dirigendam esse mentem, quo vultus erectus est? Si enim nobis in coelum spectandum est, ad nihil aliud utique quam ob religionem. Si religio tollitur, nulla nobis ratio cum coelo est. Itaque aut eo est spectandum, aut in terram procumbendum. In terram procumbere ne si velimus quidem possumus, quorum status rectus est. In coelum igitur spectandum est, quo natura corporis provocat. Quod si constat esse faciendum, aut ideo est faciendum, ut religioni serviamus, aut ideo, ut rationem rerum coelestium cognoscamus. Sed rationem rerum coelestium cognoscere nullo modo possumus: quia nihil ejusmodi potest cogitando inveniri, sicut supra docui. Religioni ergo serviendum est quam qui non suscipit, ipse se prosternit in terram, et vitam pecudum secutus, humanitate se abdicat. Sapientiores ergo imperiti, qui etiam si errant in religione deligenda, tamen naturae suae conditionisque meminerunt. |
IX. Je commencerai maintenant à examiner la nature du souverain bien. Il faut convenir d'abord qu'il doit être propre à l'homme, et que les bêtes n'y sauraient avoir part. En second lieu, il réside dans l'esprit et non dans le corps. Enfin nul ne peut le posséder, qu'il ne possède aussi la science et la vertu. Ces trois conditions renversent toutes les idées des philosophes; car ils n'avaient jamais rien conçu de pareil. Je dirai maintenant en quoi consiste le souverain bien, et je ferai voir, comme je l'ai entrepris, que les philosophes n'ont été que des ignorants et des aveugles, qui, bien loin de le connaître ou de le comprendre, n'ont pu seulement former une conjecture raisonnable sur ce sujet. Comme l'on demandait un jour à Anaxagore pour quelle fin il était né, il répondit que c'était pour considérer le soleil et le ciel. Tout le monde a admiré cette parole et l'a trouvée digne d'un véritable philosophe. Je crois au contraire qu'il ne l'a dite que par hasard, ne sachant que répondre et ne voulant pas se taire. Pour peu qu'il eût eu de sagesse, il devait avoir souvent pensé que quiconque ne sait pas pourquoi il est né, ne mérite pas de vivre. Mais supposons qu'il ne fit pas cette réponse sur-le-champ et sans l'avoir préméditée, et examinons combien il fit de fautes en ces trois paroles. La première consiste en ce qu'il a mis la principale ou plutôt l'unique fonction de l'homme dans les yeux, et en ce qu'il a rapporté tout au corps sans rien laisser à l'esprit. S'il avait été aveugle, aurait-il perdu pour cela la fonction que l'homme ne saurait perdre sans perdre son être ? Mais si tout dépend du ministère des yeux, les autres sens demeureront-ils inutiles ? Les oreilles servent plus en cela que les yeux. On peut acquérir les sciences et la sagesse par l’ouïe seule, au lieu qu'on ne les peut acquérir par la vue. Vous êtes né, dites-vous, pour regarder le ciel et le soleil ! Qui vous a commandé de les regarder, et quel intérêt avez-vous à le faire ? Est-ce pour louer la grandeur et la beauté de cet ouvrage? Confessez donc qu'il y a un Dieu qui en est l'auteur, et qui vous a créés vous-même, afin que vous fussiez le témoin et l'admirateur des beautés du monde. Vous êtes persuadé que c'est un extrême avantage de regarder le ciel et le soleil : que ne rendez-vous donc de profondes actions de grâces à celui de qui vous tenez ce bienfait ? Que ne faites-vous réflexion sur la providence, sur la sagesse, sur la puissance de celui de qui vous ne pouvez voir les ouvrages sans être surpris d'étonnement ? Si quelqu'un vous avait invité à souper, et qu'il vous eût offert un magnifique festin, ne faudrait-il pas que vous eussiez perdu l'esprit, pour estimer plus le plaisir que vous y auriez pris que la personne qui vous l'aurait procuré ? Voilà comment les philosophes rapportent tout au corps et rien à l'esprit, et comment ils ne voient que ce qu'on peut voir par les yeux. Cependant il faut faire cesser les actions des sens, pour écouter ce que dicte la raison qui réside dans l'âme. Nous sommes nés non pour regarder les créatures, mais pour considérer le créateur. Il n'y a personne, pour peu qu'il ait de sagesse, qui, si on lui demandait pour quel sujet il est né, ne fût prêt à répondre hardiment qu'il est né pour rendre au Dieu de qui il tient la naissance le service qu'il lui doit, service qui ne consiste qu'à conserver, par la pureté de ses actions, l'innocence qu'il a reçue de sa grâce. Mais ce philosophe qui n'était point instruit des choses de Dieu a réduit presque à rien le plus important de tous les devoirs, quand il a dit qu'il n'était né que pour regarder deux créatures. S'il avait dit qu'il était né pour regarder l'univers, il aurait embrassé un plus vaste sujet, et n'aurait pas encore rempli tous ses devoirs. Dieu étant plus élevé au-dessus de l'univers qu'il a créé et qu'il gouverne, que l'âme ne l'est au-dessus du corps, il ne faut donc pas s'arrêter à regarder l'univers qui est corporel avec les yeux qui sont aussi corporels; il faut élever l'âme qui est immortelle jusqu'à la contemplation de Dieu qui est éternel, et joindre à cette contemplation un respect sincère qui lui est dû, comme au père commun de tous les hommes. Comme les philosophes, bien loin de s'élever de la sorte, sont demeurés attachés par leur ignorance à la terre, il y a apparence qu'Anaxagore ne regardait jamais le ciel ni le soleil, bien qu'il ait dit qu'il était né pour les regarder. J'ai expliqué en quoi consiste le principal devoir de l'homme, et il n'y a personne qui, pour peu qu'il ait de sagesse, ne le puisse aisément comprendre. Ce devoir n'est rien autre chose que l'humanité ; l'humanité n'est autre chose que la justice; la justice n'est autre chose que la piété ; la piété n'est autre chose que la connaissance de Dieu, qui est notre père. X. Le souverain bien de l'homme consiste dans la religion, et les autres biens qui lui semblent propres lui sont communs avec les animaux. N'ont-ils pas des voix et des sons par lesquels ils semblent parler et s'entretenir ensemble? Ne semble-t-il pas qu'ils rient quand ils caressent ou les hommes ou leurs petits, avec divers mouvements des oreilles, du nez, et des yeux ? N'ont-ils pas de l'amour les uns pour les autres, et ne font-ils pas beaucoup de choses par le mouvement de cet amour ? N'ont-ils pas le soin de faire des provisions et de serrer de quoi vivre à l'avenir ? On voit en plusieurs des signes de raison, comme quand ils poursuivent ce qui leur est propre ; qu'ils s'éloignent de ce qui leur est contraire ; qu'ils évitent les dangers, et qu'ils se font des tanières à différentes issues. Peut-on nier qu'ils n'aient quelque sorte de raison, puisqu'ils trompent souvent les hommes? Les abeilles font comme une petite république dans leurs ruches; elles y bâtissent des cellules avec un art merveilleux ; elles s'y fortifient ; elles y obéissent à leur roi ; et l'on peut même douter si elles n'ont pas une prudence achevée. Il est donc probable que la plupart des biens que l'on attribue à l'homme appartiennent aussi aux autres animaux. Mais il est certain qu'ils n'ont point de religion. Pour moi, je me persuade que la raison a été donnée à tous les animaux; mais qu'au lieu qu'elle n'a été donnée aux autres que pour défendre leur vie, elle a été donnée aux hommes pour la communiquer. Comme cette raison est parfaite et consommée dans l'homme, on l'appelle sagesse, et c'est par elle qu'il connaît Dieu. Le sentiment de Cicéron sur ce sujet est très véritable. « Il n'y a, dit-il, que l'homme qui, parmi un grand nombre d'animaux de différentes espèces, ait quelque connaissance de la divinité. Mais parmi les hommes il n'y a point de nation si barbare, ni si farouche, qui ne sache pas qu'il est celui qu'il faut adorer. » Il suit de là que quiconque se souvient de son origine, reconnaît qu'il y a un Dieu. Les philosophes, qui ont voulu délivrer les esprits de toute sorte de crainte, ont ôté toute sorte de religion. Il est certain qu'ils ne pourraient rien faire de plus contraire à l'humanité, ni à la raison ; car comme Dieu a assujetti les animaux à l'homme, il a assujetti l'homme à lui-même. D'où vient que ces philosophes disent que nous devons élever notre esprit au lieu même où nous levons les yeux, si ce n'est pour nous avertir de nous acquitter des devoirs de la religion? S'il n'y a point de religion, quel rapport avons-nous avec le ciel? Il faut nous élever vers le ciel ou nous abaisser vers la terre. Nous ne saurions nous abaisser vers la terre quand nous le voudrions, parce que notre taille est naturellement droite et élevée. Il faut donc regarder le ciel. Mais on ne le peut regarder qu'à dessein ou de s'acquitter des devoirs de la religion, ou d'apprendre le mouvement et le cours des astres. J'ai déjà fait voir que nous ne saurions découvrir, par nos pensées et par nos raisonnements, quel est ce mouvement et ce cours. Ce n'est donc que pour s'acquitter des devoirs de la religion qu'il faut regarder le ciel ; et si on ne le regarde, on rampe sur la terre comme des bêtes, et on renonce à la dignité de la nature humaine. Le peuple avec toute son ignorance est plus sage que les philosophes, parce que bien qu'il se trompe dans le choix de la religion, il n'oublie pas entièrement l'excellence de sa nature et de sa condition. |
|
CAPUT XI. De religione, sapientia, ac summo bono. Constat igitur, totius humani generis consensu, religionem suscipi oportere: sed quomodo in ea erretur explicandum est. Naturam hominis hanc Deus esse voluit, ut duarum rerum cupidus et appetens esset, religionis et sapientiae. Sed homines ideo falluntur, quod aut religionem suscipiunt, omissa sapientia, aut sapientiae soli student, omissa religione, cum alterum sine altero esse non possit verum. Cadunt ergo ad multiplices religiones, sed ideo falsas, quia sapientiam reliquerunt, quae illos docere poterat deos multos esse non posse: aut student sapientiae, sed ideo falsae, quia religionem summi Dei omiserunt, qui eos ad veri scientiam potuit erudire. Sic homines, qui alterutrum suscipiunt, viam deviam, maximisque erroribus plenam sequuntur, quoniam in his duobus inseparabiliter connexis, et officium hominis, et veritas omnis inclusa est. Miror itaque nullum omnino philosophorum extitisse, qui sedem, ac domicilium summi boni reperiret. Potuerunt enim sic quaerere. Quodcumque est summum bonum, necesse est omnibus esse propositum. Voluptas est, quae appetitur a cunctis: sed haec et communis est cum belluis, et honesti vim non habet, et satietatem affert, et nimia nocet, et processu minuitur aetatis, et multis non contingit; nam qui opibus carent, quorum major est numerus, etiam voluptate careant necesse est. Non est igitur summum bonum, sed ne bonum quidem voluptas. Quid divitiae? Multo magis. Nam et paucioribus, et plerumque casu, et inertibus saepe, et nonnumquam scelere contingunt, et optantur ab iis qui eas jam tenent. Quid regnum ipsum? Ne id quidem. Non enim cuncti homines regnare possunt; et necesse est universos summi boni capaces esse. Quaeramus igitur aliquid, quod propositum sit omnibus. Num virtus? Negari non potest, quin et bonum sit, et omnium certe bonum. Sed si beata esse non potest, quia vis et natura ejus in malorum perferentia posita est, non est profecto summum bonum. Quaeramus aliud. At nihil virtute pulchrius, nihil sapiente dignius inveniri potest. Si enim vitia ob turpitudinem fugienda sunt, virtus igitur appetenda est ob decorem. Quid ergo? Potestne fieri, ut quod bonum, quod honestum esse constat, mercede ac praemio careat, sitque tam sterile, ut nihil ex se commodi pariat? Labor ille magnus, et difficultas, et eluctatio adversus mala, quibus haec vita plena est, aliquid magni boni pariat necesse est. Id vero quid esse dicemus? Num voluptatem? at nihil turpe ex honesto nasci potest. Num divitias? num potestates? at ea quidem fragilia sunt, et caduca. Num gloriam? num honorem? num memoriam nominis? at haec omnia non sunt in ipsa virtute, sed in aliorum existimatione atque arbitrio posita. Nam saepe virtus et invisa est, et malo afficitur. Debet autem id bonum, quod ex ea nascitur, ita cohaerere, ut divelli atque abstrahi nequeat; nec aliter summum bonum videri potest, quam si et proprium sit virtutis, et tale, ut neque adjici quidquam, nec detrahi possit. Quid, quod in his omnibus contemnendis virtutis officia consistunt. Nam voluptates, opes, potentias, honores, eaque omnia, quae pro bonis habentur, non concupiscere, non appetere, non amare, quod caeteri faciunt victi cupiditate, id est profecto virtutis. Aliud ergo sublimius atque praeclarius efficit; nec frustra his praesentibus bonis reluctatur, nisi quod majora, et veriora desiderat: non desperemus inveniri posse, modo verset se cogitatio in omnia. Neque enim levia aut ludicra petuntur praemia. CAPUT XII. De duplici pugna corporis et animae; atque de appetenda virtute propter vitam aeternam. Sed quaeritur quid sit, propter quod nascimur; quid efficiat virtus, possumus sic investigare. Duo sunt, ex quibus homo constat, animus et corpus. Multa sunt propria animi, multa propria corporis, multa utrique communia, sicut est ipsa virtus: quae quoties ad corpus refertur, discernendi gratia fortitudo nominatur. Quoniam igitur utrique subjacet fortitudo, utrique proposita dimicatio est, et utrique ex dimicatione victoria: corpus, quia solidum est et comprehensibile, cum solidis et comprehensibilibus confligat necesse est; animus autem, quia tenuis, et invisibilis est, cum iis congreditur hostibus, qui videri tangique non possunt. Qui sunt autem hostes animi, nisi cupiditates, vitia, peccata? quae si vicerit virtus, ac fugaverit, immaculatus erit animus, ac purus. Unde ergo colligi potest, quid efficiat animi fortitudo? Nimirum ex conjuncto, et pari, hoc est ex corporis fortitudine, quod cum in aliquam congressionem certamenque venerit, quid aliud ex victoria quam vitam petit? Sive enim cum homine, sive cum bestia dimices, pro salute certatur. Ergo ut corpus vincendo id assequitur, ut non intereat: sic etiam animus, ut permaneat; et sicut corpus ab hostibus suis victum, morte mulctatur: ita superatus a vitiis animus moriatur necesse est. Quid ergo intererit inter animi corporisque dimicationem, nisi quod corpus temporalem vitam expetit, animus sempiternam? Si ergo virtus per seipsam beata non est, quoniam in perferendis (ut dixi) malis tota vis ejus est; si omnia, quae pro bonis concupiscuntur, negligit; si summus ejus gradus ad mortem patet, quandoquidem vitam, quae optatur a caeteris, saepe respuit, mortemque, quam caeteri timent, fortiter suscipit; si necesse est ut aliquid ex se magni boni pariat, quia sustentati et superati usque ad mortem labores sine praemio esse non possunt; si nullum praemium, quod ea dignum sit, in terra reperitur, quandoquidem cuncta, quae fragilia sunt et caduca, spernit, quid aliud restat, nisi ut coeleste aliquid efficiat, quia terrena universa contemnit, et ad altiora nitatur, quia humilia despicit? Id vero nihil aliud potest esse, quam immortalitas. Merito ergo philosophorum non obscurus Euclides, qui fuit conditor Megaricorum disciplinae, dissentiens a caeteris, id esse summum bonum dixit, quod simile sit, et idem semper. Intellexit profecto quae sit natura summi boni, licet id non explicaverit quid sit: id est autem immortalitas, nec aliud omnino quidquam; quia sola nec imminui, nec augeri, nec immutari potest. Seneca quoque imprudens incidit, ut fateretur, nullum esse aliud virtutis praemium, quam immortalitatem. Laudans enim virtutem in eo libro quem de immatura morte conscripsit: « Una, inquit, res est virtus, quae nos immortalitate donare possit, et pares diis facere. » Sed et stoici, quos secutus est, negant sine virtute effici quemquam beatum posse. Ergo virtutis praemium beata vita est, si virtus (ut recte dictum est) beatam vitam facit. Non est igitur, ut aiunt, propter seipsam virtus expetenda, sed propter vitam beatam, quae virtutem necessario sequitur. Quod argumentum docere eos potuit, quod esset summum bonum. Haec autem vita praesens et corporalis beata esse non potest, quia malis est subjecta per corpus. Epicurus Deum beatum et incorruptum vocat, quia sempiternus est. Beatitudo enim perfecta esse debet, ut nihil sit, quod eam vexare, ac imminuere, aut immutare possit. Nec aliter quidquam existimari beatum potest, nisi fuerit incorruptum. Incorruptum autem nihil est, nisi quod est immortale. Sola ergo immortalitas beata est, quia corrumpi ac dissolvi non potest. Quod si cadit in hominem virtus, quod negare nullus potest, cadit et beatitudo. Non potest enim fieri, ut sit miser, qui virtute est praeditus. Si cadit beatitudo, ergo et immortalitas cadit in hominem, quae beata est. Summum igitur bonum sola immortalitas invenitur, quae nec aliud animal, nec corpus attingit, nec potest cuiquam sine scientiae virtute, id est, sine Dei cognitione ac justitia provenire. Cujus appetitio quam vera, quam recta sit, ipsa vitae hujusce cupiditas indicat: quae licet sit temporalis, et labore plenissima, expetitur tamen ab omnibus, et optatur; hanc enim tam senes quam pueri, tam reges quam infimi, tam denique sapientes quam stulti cupiunt. Tanti est (ut Anaxagorae visum est) contemplatio coeli ac lucis ipsius, ut quascumque miserias libeat sustinere. Cum igitur laboriosa haec et brevis vita, non tantum hominum, sed etiam caeterorum animantium consensu, magnum bonum esse ducatur: manifestum est eamdem summum ac perfectum fieri bonum, si et fine careat et omni malo. Denique nemo umquam extitisset, qui hanc ipsam brevem contemneret, aut subiret mortem, nisi spe vitae longioris. Nam illi, qui pro salute civium voluntariae se neci obtulerunt, sicut Thebis Menoeceus, Athenis Codrus, Romae Curtius et Mures duo, numquam mortem vitae commodis praetulissent, nisi se immortalitatem opinione civium consequi putavissent: qui tametsi nescierunt immortalitatis vitam, res tamen eos non fefellit. Si enim virtus divitias et opes ideo contemnit, quia fragiles sunt, voluptates ideo, quia breves; ergo et vitam fragilem brevemque ideo contemnit, ut solidam et perpetuam consequatur. Ipsa ergo cogitatio per ordinem gradiens, et universa considerans, perducit nos ad eximium illud et singulare, cujus causa nascimur bonum. Quod si fecissent philosophi; si non, quod semel apprehenderant, tueri pertinaciter maluissent: profecto pervenissent ad verum hoc, ut ostendi modo. Quod si non fuit eorum, qui coelestes animas una cum corporibus extinguunt, illi tamen, qui de immortalitate disputant animi, intelligere debuerunt; ideo propositam nobis esse virtutem, ut, perdomitis libidinibus, rerumque terrestrium cupiditate superata, purae ac victrices animae ad Deum, id est ad originem suam revertantur. Idcirco enim soli animantium ad aspectum coeli erecti sumus ut summum bonum nostrum in summo esse credamus. Ideo religionem soli capimus, ut ex hoc sciamus, humanum spiritum non esse mortalem, quod Deum, qui est immortalis, et desiderat, et agnoscit.
Igitur ex omnibus philosophis, qui aut
pro summo bono scientiam, aut virtutem sunt amplexi, tenuerunt
quidem viam veritatis, sed non pervenerunt ad summum. Haec enim duo
sunt, quae simul efficiant illud, quod quaeritur. Scientia id
praestat, ut quomodo, et quo perveniendum sit, noverimus; virtus, ut
perveniamus. Alterum sine altero nihil valet, ex scientia enim
virtus, ex virtute summum bonum nascitur. Beata igitur vita, quam
philosophi quaesierunt semper, et quaerunt, sive in cultu deorum,
sive in philosophia nulla est; et ideo ab his non potuit reperiri,
quia summum bonum non in summo quaesierunt, sed in imo. Summum autem
quid est, nisi coelum, et Deus, unde animus oritur? Imum quid est,
nisi terra, unde corpus est? Itaque licet quidam philosophi summum
bonum non corpori, sed animo dederint, tamen, quoniam illud ad hanc
vitam retulerunt, quae cum corpore terminatur, ad corpus revoluti
sunt, cujus est hoc omne tempus, quod transigitur in terra. Quare
non immerito summum bonum non comprehenderunt; quia quidquid ad
corpus spectat, et immortalitatis est expers, imum sit necesse est.
Non cadit ergo in hominem beatitudo illo modo, quo philosophi
putaverunt: sed ita cadit, non ut tunc beatus sit cum vivit in
corpore, quod utique, ut dissolvatur, necesse est corrumpi; sed
tunc, cum anima societate corporis liberata, in solo spiritu vivit.
Hoc uno beati esse in hac vita possumus, si minime beati esse
videamur; si fugientes illecebras voluptatum, solique virtuti
servientes, in omnibus laboribus miseriisque vivamus, quae sunt
exercitia, et corroboramenta virtutis; si denique asperam illam viam
difficilemque teneamus, quae nobis ad beatitudinem patefacta est.
Summum igitur bonum, quod beatos facit, non potest esse, nisi in ea
religione, atque doctrina, cui spes immortalitatis adjuncta est. |
XI. C'est une maxime reçue par le consentement unanime de tous les peuples qu'il faut avoir une religion. D'où vient donc qu'ils s'accordent si peu dans le choix? Je tâcherai de faire voir d'où procède un égarement si général et si déplorable. Dieu a formé l'homme de telle sorte, qu'il lui a donné le désir de connaître la religion et la sagesse; mais la plupart se trompent, ou en ce qu'ils embrassent une religion sans s'adonner à l'étude de la sagesse, ou en ce qu'ils s'adonnent à l'étude de la sagesse sans prendre aucun soin de s'instruire de la religion. Il fallait cependant joindre ces deux choses ensemble, parce qu'il est impossible que l'une subsiste sans l'autre ; ou ils s'engagent en diverses religions, qui sont toutes fausses, parce qu'ils ont quitté la sagesse qui leur avait appris qu'il est impossible qu'il y ait plusieurs dieux ; ou ils s'adonnent à l'étude d'une sagesse qui est fausse, parce qu'ils n'ont pas embrassé la religion du vrai Dieu, qui les aurait conduits à la vérité : ainsi ils tombent dans quantité d'erreurs en séparant la recherche de la religion de l'étude de la sagesse; au lieu qu'en les joignant, ils pourraient parvenir à la connaissance de la vérité, et s'acquitter du plus important de tous les devoirs. Pour moi, je m'étonne qu'aucun philosophe n'ait jamais pu découvrir en quoi consiste le souverain bien ; car il leur était aisé de raisonner de cette sorte. Le souverain bien doit être proposé et comme offert à tout le monde. La volupté est peut-être proposée à tout le monde, car il n'y a personne qui ne souhaite d'en jouir; mais elle ne convient qu'aux bêtes ; elle n'a rien d'honnête ; elle cause du dégoût ; elle nuit par son excès ; elle diminue à mesure que l'âge avance, et elle ne se fait pas sentir A tout le monde, car ceux qui ne sont pas riches, et ceux-là sont en grand nombre, sont privés pour l'ordinaire des plus douces et des plus agréables voluptés. La volupté n'est donc pas le souverain bien, ou ce n'est pas même un bien. Que dirons-nous des richesses ? elles le sont encore moins que la volupté. Elles sont possédées par un plus petit nombre de personnes, et quelquefois par des lâches qui ne les méritent pas. Elles arrivent souvent par hasard; souvent elles ne sont amassées que par des crimes, et quand on en a, on en désire encore davantage. Le souverain bien consistera-t-il dans la possession des royaumes ou des empires? Il est impossible qu'il consiste en cela; car tout le monde ne peut pas régner, et tout le monde doit aspirer à la jouissance du souverain bien. Cherchons donc quelque autre chose où tout le monde puisse prétendre, ne sera-ce point la vertu ? Mais si elle ne peut nous rendre heureux, parce qu'elle consiste à supporter le mal, elle ne peut non plus être le souverain bien. Cherchons donc quelque autre chose. Il n'y a rien de si excellent que la vertu ; il n'y a rien qui doive être préféré à la sagesse. La vertu doit être recherchée pour sa beauté, comme on doit fuir les vices pour leur laideur. Est-il possible que la vertu, qui est un bien si honnête, demeure sans récompense, et qu'elle n'apporte aucun avantage? Les peines et les fatigues qui partagent toute notre vie, les combats qu'il faut livrer sans cesse pour vaincre le mal, méritent sans doute une récompense très considérable; mais quelle sera-t-elle? Sera-ce la volupté ? Un si vil effet ne saurait procéder d'une si belle cause. Seront-ce les richesses ou la puissance ? Ce sont des choses passagères et périssables. Sera-ce l'honneur, la gloire, la réputation? Ces avantages-là ne se rencontrent pas dans la vertu même ; ils dépendent du jugement et de l'opinion des hommes. La vertu n'est que trop souvent le sujet de la haine la plus envenimée et de la persécution la plus cruelle. Or le bien, qui est attaché à la vertu comme sa récompense, doit ne pouvoir pas en être séparé ; et il faut qu'il lui soit tellement propre, que l'on n'y puisse rien ajouter, ni rien en retrancher. De plus, le principal devoir de la vertu est non seulement de ne pas souhaiter, mais de ne pas rechercher et de ne pas aimer les plaisirs, les richesses, les honneurs, les dignités, le pouvoir de commander, et tout ce que les hommes prennent pour des biens. Le mépris qu'elle fait de toutes ces choses ne procède que de l'espérance qu'elle a d'en posséder de plus excellentes. Ne perdons pas courage, et faisons tous les efforts dont nous sommes capables pour trouver ce que nous cherchons. Le prix qui nous est proposé vaut bien la peine que nous prendrons ; il ne s'agit de rien moins que de savoir pour quel sujet nous avons été mis au monde. XII. Voici la méthode par laquelle on peut reconnaître quel est l'effet de la vertu. L'homme est composé de corps et d'âme : il y a des biens qui sont propres à l'âme ; il y en a qui sont propres au corps; et il y en a qui sont communs à l'un et à l'autre. La vertu est donc de cette dernière sorte, et quand elle convient au corps, on l'appelle force, pour la distinguer de celle qui convient à l'âme. Si la vertu convient à ces deux parties de notre être, elles sont toutes deux obligées à combattre, et peuvent toutes deux remporter la victoire. Le corps, étant solide et palpable, combat contre des ennemis de même nature ; mais l'esprit, étant délié et invisible, combat contre des ennemis que l'on ne peut ni voir ni toucher. Quel sont ces ennemis, sinon les mauvais désirs, les vices et les crimes? Quand l'âme les surmonte, elle conserve sa pureté. Par où peut-on connaître quel est le prix de la victoire que remporte l'âme? On peut le connaître par la comparaison du prix de la victoire que remporte le corps. Quand le corps combat, la fin et la récompense qu'il reçoit, c'est la conservation de la vie; car, soit qu'il combatte contre des hommes ou contre des bêtes, il ne combat le plus souvent que pour la défendre. L'âme combat de la même sorte pour sa vie et pour son salut. Et comme le corps est pour l'ordinaire privé de la vie quand il a été vaincu par ses ennemis, l'âme perd la sienne quand elle se laisse vaincre par ses vices; la seule différence qu'il y ait entre les combats de l'âme et ceux du corps, c'est que les combats du corps ne tendent qu'à la conservation d'une vie temporelle, au lieu que ceux de l'âme tendent à la conservation d'une vie éternelle. Si la vertu n'est pas heureuse par elle-même, parce que sa principale occupation est de supporter la fatigue et le travail, si elle méprise tout ce que le monde recherche avec la plus grande ardeur, si elle refuse souvent la vie, et si elle affronte la mort, qui est si généralement redoutée, si de généreux exploits ne peuvent manquer de récompense ni en trouver sur la terre, parce que, sur la terre, il n'y a rien qui les égale, il faut nécessairement que la vertu trouve sa récompense dans le ciel, et cette récompense n'est autre chose que l'immortalité. Euclide, philosophe célèbre, qui a fondé une secte particulière à Mégare, a eu raison de dire que le souverain bien est ce qui est toujours égal et toujours semblable à soi-même. Il avait sans doute pénétré la nature du souverain bien, quoiqu'il ne l'ait pas expliqué, et c'est l'immortalité qui ne peut recevoir de changement, d'accroissement ni de diminution. Sénèque a avoué, comme par mégarde et sans y penser, que l'immortalité est l'unique récompense de la vertu. « Il n'y a, dit-il, que la vertu qui nous puisse rendre immortels et égaux aux dieux. » Les stoïciens, dont il a suivi les sentiments, soutiennent que l'on ne peut arriver à la béatitude que par la vertu. On ne recherche donc pas la vertu pour elle-même, mais on la recherche pour la béatitude qui en est la récompense. Les stoïciens ont dû reconnaître par ce raisonnement en quoi consiste le souverain bien. Le temps de cette vie n'est pas le temps de la béatitude, parce que le corps est sujet à trop de misères. Épicure dit que Dieu est heureux, parce qu'il est incorruptible et éternel. Il faut que la béatitude soit parfaite, et qu'il n'y ait rien qui puisse l'altérer ni la changer; pour la posséder il faut être incorruptible et immortel. Que si l'homme est capable d'acquérir la vertu, comme tout le monde est obligé d'en demeurer d'accord, il est aussi capable de parvenir à la béatitude, car il est impossible d'être tout ensemble et vertueux et misérable. S'il est capable de parvenir à la béatitude, il est capable de parvenir à l'immortalité. Il faut avouer que cette immortalité est le souverain bien, qu'elle ne convient à aucun autre animal qu'à l'homme, qu'elle ne convient pas même à son corps, qu'elle ne peut être séparée de la science et de la vertu, de la connaissance de Dieu et de la justice. Il est aisé de reconnaître, par le désir que nous avons de conserver la vie présente, combien celui de parvenir à l'immortalité est tout ensemble et violent et raisonnable. De quelque misère que la vie présente soit remplie, il n'y a personne qui ne souhaite avec passion de la posséder. Les vieillards ne le souhaitent pas moins que les enfants, les princes pas moins que les sujets, les sages pas moins que les insensés. La vue du ciel et de la lumière est si chère, selon l'avis d'Anaxagore, qu'il n'y a point de fatigue que l'on n'essuie volontiers pour la conserver. Si tout le monde demeure d'accord que cette vie, si courte et si misérable, est un grand bien, elle deviendra le souverain de tous les biens, dès qu'il n'y aura plus rien qui borne sa durée ni qui trouble son repos. Enfin personne n'a jamais méprisé la vie présente que par l'espérance d'en posséder une plus longue. Ceux qui se sont exposés volontairement à la mort pour le salut de leurs concitoyens, comme Ménecée à Thèbes, Codrus à Athènes, Curtius et les deux Décius à Rome, n'auraient jamais renoncé à la vie présente s'ils n'avaient espéré d'en acquérir une immortelle dans l'esprit des peuples. Bien qu'ils ne sussent pas le chemin par où l'on va à l'immortalité, ils n'ont pas laissé déjuger fort bien qu'il y avait une immortalité et qu'il y a un chemin qui y conduit. Si la vertu méprise les richesses parce qu'elles peuvent se perdre; si elle méprise les plaisirs parce qu'ils s'échappent promptement de nos mains; si elle méprise la vie parce qu'elle est de peu de durée, c'est sans doute qu'elle en veut posséder une qui ne finisse jamais. Voilà comment l'esprit, montant comme par degrés, parvient enfin à la connaissance du souverain bien pour lequel nous avons été créés. Si les philosophes avaient suivi cette méthode, au lieu de soutenir opiniâtrement les sentiments dont ils ont été une fois prévenus, ils auraient pu acquérir la connaissance de la vérité. Que si ceux qui croient que l'âme périt avec le corps n'ont pu reconnaître que la vertu lui est commandée, afin qu'après avoir dompté les passions et vaincu l'amour des biens de la terre, elle rentre comme en triomphe dans le sein de Dieu, qui est son principe, ceux au moins qui la reconnaissent immortelle auraient pu le faire. L'homme a reçu seul, entre tous les animaux, une taille droite et élevée vers le ciel, afin qu'il regardât Dieu en la possession duquel consiste son souverain bien. Il est seul capable des devoirs de la religion, et reconnaît seul, par le désir qu'il a de l'immortalité, que son âme est exempte de la mort. Les philosophes qui ont regardé la science et la vertu comme le souverain bien ont approché de la vérité, mais ils ne sont pas arrivés jusqu'à elle. La science nous découvre le lieu où nous devons tendre, la vertu nous y conduit; l'une ne sert de rien sans l'autre La science nous éclaire pour pratiquer la vertu, et la pratique de la vertu mérite la possession du souverain bien. Le bonheur que les philosophes ont cherché, et qu'ils cherchent encore, soit dans le culte des dieux, soit dans l'étude, est un bonheur imaginaire, et ils n'avaient garde de trouver le véritable, parce qu'au lieu de le chercher au ciel, où il est, ils le cherchent sur la terre. Où peut être le souverain bien ailleurs que dans le ciel et dans le sein de Dieu d'où l'âme est sortie? Qu'y a-t-il, au contraire, de plus bas que la terre, dont le corps a été formé ? Quoique quelques philosophes aient cru que le souverain bien était propre à l'âme, et que le corps n'y pouvait avoir aucune part, ils le lui ont néanmoins attribué sans y penser, quand ils en ont terminé la jouissance avec la durée de la vie mortelle que nous menons dans notre union avec le corps. Ainsi ils n'ont pas trouvé le souverain bien, parce qu'ils l'ont cherché dans le corps où il n'y a rien que de vain, que de faible et de périssable. La béatitude ne convient donc pas à l'homme de la manière que les philosophes l'ont cru. Elle ce lui convient pas durant la vie qu'il mené dans un corps corruptible et mortel, mais durant une autre, toute spirituelle et éternelle, qu'il mènera quand il sera délivré de la servitude du corps. L'unique moyen d'être heureux en cette vie, c'est de paraître malheureux, de se priver des plaisirs, de s'adonner à la vertu, de s'accoutumer aux exercices laborieux qui la fortifient, et de n'être jamais exempt de peine ni de misère. Le souverain bien qui nous rend heureux ne peut se trouver que dans la religion, à laquelle l'espérance de l'immortalité est attachée. |
|
CAPUT. XIII. De animae immortalitate, deque sapientia, philosophia et eloquentia. Res exigere videtur hoc loco, ut quoniam docuimus immortalitatem esse summum bonum, id ipsum immortalem esse animam comprobemus. Qua de re ingens inter philosophos disceptatio est, nec quidquam tamen explicare, aut probare potuerunt ii, qui verum de anima sentiebant; expertes enim hujus divinae eruditionis, nec argumenta vera, quibus vincerent, attulerunt, nec testimonia, quibus probarent. Sed oportunius hanc quaestionem tractabimus in ultimo libro, cum de vita beata nobis erit disserendum. Superest pars illa philosophiae tertia, quam vocant λογικὴν, in qua tota dialectica, et omnis loquendi ratio continetur. Hanc divina eruditio non desiderat: quia non in lingua, sed in corde sapientia est; nec interest, quali utare sermone: res enim, non verba quaeruntur. Et nos non de grammatico, aut oratore, quorum scientia est, quomodo loqui deceat, sed de sapiente disserimus, cujus doctrina est, quomodo vivere oporteat. Quod si neque physica illa ratio necessaria est, neque haec logica, quia beatum facere non possunt: restat ut in sola ethica totius philosophiae vis contineatur, ad quam se, abjectis omnibus, Socrates contulisse dicitur. In qua etiam parte quoniam philosophos errasse docui, qui summum bonum, cujus capiendi gratia generati sumus, non comprehenderunt; apparet falsam et inanem esse omnem philosophiam, quia nec instruit ad justitiae munera, nec officium hominis rationemque confirmat. Sciant igitur errare se, qui philosophiam putant esse sapientiam: non trahantur auctoritate cujusquam; sed veritati potius faveant, et accedant. Nullus hic temeritati locus est: in aeternum stultitiae poena subeunda est, si aut persona inanis, aut opinio falsa deceperit. Homo autem, qualiscumque est, si sibi credit, hoc est si homini credit (ut non dicam stultus, qui suum non videat errorem) certe arrogans est, qui sibi audeat vendicare, quod humana conditio non recipit. Ille ipse romanae linguae summus auctor quantum fallatur, licet ex illa sententia pervidere: qui cum in libris officiorum philosophiam nihil aliud esse dixisset, quam studium sapientiae, ipsam autem sapientiam, rerum divinarum et humanarum scientiam, tum adjecit: « Cujus studium qui vituperat, haud sane intelligo quidnam sit, quod laudandum putet. Nam si oblectatio quaeritur animi, requiesque curarum, quae conferri cum eorum studiis potest, qui semper aliquid inquirunt, quod spectet, et valeat ad bene beateque vivendum? Sive ratio constantiae virtutisque ducitur, aut haec ars est, aut nulla omnino, per quam eas assequamur. Nullam dicere maximarum rerum artem esse, cum minimarum sine arte nulla sit, hominum est parum considerate loquentium, atque in maximis rebus errantium. Si autem est aliqua disciplina virtutis, ubi ea quaeretur, cum ab isto genere discendi discesseris. » Equidem tametsi operam dederim, ut quantulamcumque discendi assequerer facultatem propter studium docendi, tamen eloquens nunquam fui; quippe qui forum ne attigerim quidem: sed necesse est, ipsa me faciat causae bonitas eloquentem; ad quam diserte copioseque defendendam scientia divinitatis, et ipsa veritas sufficit. Vellem igitur Ciceronem paulisper ab inferis surgere, ut vir eloquentissimus ab homunculo non diserto doceretur, primum, quidnam sit, quod laudandum putet, qui vituperat id studium, quod vocatur philosophia; deinde, neque illam esse artem, qua virtus et justitia discatur, nec aliam ullam, sicut putavit; postremo, quoniam est virtutis disciplina, ubi quaerenda sit, cum ab illo discendi genere discesseris: quod ille non audiendi discendique gratia quaerebat. A quo enim posset audire, cum sciret id nemo? Sed ut in causis facere solebat, interrogatione voluit urgere, ad confessionemque perducere; tanquam confideret responderi prorsus nihil posse, quominus philosophia esset magistra virtutis. Quod quidem in Tusculanis disputationibus aperte professus est, ad eam ipsam conversa oratione, tamquam se declamatorio dicendi genere jactaret. « O vitae philosophia dux, inquit, o virtutis indagatrix expultrixque vitiorum: quid non modo nos, sed omnino vita hominum sine te esse potuisset? Tu inventrix legum, tu magistra morum ac disciplinae fuisti. » Quasi vero aliquid per se ipsa sentiret, ac non potius ille laudandus esset, qui eam tribuit. Potuit eodem modo gratias agere cibo et potui, quia sine his rebus vita constare non possit; in quibus ut sensus, ita beneficii nihil est. Atqui ut illa corporis alimenta sunt, sic animae, sapientia. CAPUT XIV. Quod Lucretius et alii erraverunt, ac ipse Cicero, in statuenda sapientiae origine. Rectius itaque Lucretius, cum eum laudat, qui sapientiam primus invenit: sed hoc inepte, quod ab homine inventam putavit. Quasi vero illam alicubi jacentem homo ille, quem laudabat, invenerit, tanquam tibias ad fontem, ut poetae aiunt. Quod si repertorem sapientiae, ut deum, laudavit; ita enim dicit:
Nemo (ut opinor) erit mortali corpore
cretus. Dicendum est, Deus ille fuit, Deus, inclyte Memmi: tamen non erat sic laudandus Deus, quod sapientiam invenerit, sed quod hominem fecerit, qui posset capere sapientiam. Minuit enim laudem, qui partem laudat ex toto. Sed ille, ut hominem, laudavit, qui tamen ob id ipsum deberet pro Deo haberi, quod sapere invenerit. Nam sic ait: Nonne decebit, Hunc hominem numero divum dignarier esse? Unde apparet, aut Pythagoram voluisse laudare, qui se primus, ut dixi, philosophum nominavit; aut Milesium Thalem, qui de rerum natura primus traditur disputasse. Ita dum hominem quaerit extollere, rem ipsam depressit. Non est enim magna, si ab homine potuit inveniri. Verum potest, ut poetae, dari venia. At ille idem perfectus orator, idem summus philosophus, et Graecos reprehendit, quorum levitatem semper accusat, et tamen sequitur; ipsam sapientiam, quam alias donum, alias inventum deorum vocat, poetice figuratam laudat in faciem. Graviter etiam queritur extitisse aliquos, qui eam vituperarent. « Quisquamne, inquit, vituperare vitae » parentem, et hoc parricidio se inquinare audeat, » et tam impie ingratus esse? » Nos ergo, Marce Tulli, parricidae sumus, et insuendi te judice in culeum, qui philosophiam negamus parentem esse vitae? An tu, qui adversus Deum tam impie ingratus es (non hunc cujus effigiem veneraris in Capitolio sedentem, sed illum qui mundum fecit, hominemque generavit, qui sapientiam quoque ipsam inter coelestia sua beneficia largitus est) magistram tu virtutis, aut parentem vitae vocas, ad quam si quis accesserit, multo sit incertior necesse est, quam prius fuerit? Cujus enim virtutis? quae ipsa, ubi sita sit, adhuc philosophi non expediunt. Cujus vitae? cum ipsi doctores ante fuerint senectute ac morte confecti, quam constituerint quomodo vivi deceat. Cujus veritatis indagatricem profiteri potes? qui saepe testaris, cum tanta multitudo fueri philosophorum, sapientem tamen extitisse adhuc neminem. Quid ergo te magistra illa vitae docuit? An ut potentissimum consulem maledictis incesseres, eumque hostem patriae venenatis orationibus faceres? Sed omittamus illa, quae possunt excusari fortunae nomine. Studuisti nempe philosophiae, et quidem sic, ut nullus umquam diligentius; quippe qui omnes cognoveris disciplinas, sicut ipse gloriari soles, eamque ipsam latinis litteris illustraveris, imitatoremque te Platonis ostenderis. Cedo igitur quid didiceris, aut in qua secta veritatem deprehenderis. In academia scilicet, quam secutus es, quam probasti. At haec nihil docet, nisi ut scias te nihil scire. Tui ergo te libri arguunt, quam nihil a philosophia disci possit ad vitam. Haec tua verba sunt: « Mihi autem non modo ad sapientiam caeci videmur, sed ad ea ipsa, quae aliqua ex parte cerni videantur, hebetes et obtusi. » Si ergo philosophia est magistra vitae, cur tibi ipse caecus, et hebes, et obtusus videbare, quem oportuit, illa docente, et sentire, et sapere, et in clarissima luce versari? At quam confessus fueris philosophiae veritatem, docent ad filium composita praecepta, quibus mones philosophiae quidem praecepta noscenda, vivendum autem esse civiliter. Quid tam repugnans dici potest? Si noscenda sunt praecepta philosophiae, ideo utique noscenda sunt ut recte sapienterque vivamus. Vel, si civiliter vivendum est, non est igitur philosophia sapientia; siquidem melius est civiliter, quam philosophice vivere. Nam si sapientia est, quae dicitur philosophia, stulte profecto vivit, qui non secundum philosophiam vivit. Si autem non stulte vivit, qui civiliter vivit, sequitur ut stulte vivat, qui philosophice vivit. Tuo itaque judicio philosophia stultitiae, inanitatisque damnata est. Idem in Consolatione, id est, in opere non joculari, hanc de philosophia sententiam tulisti: « Sed nescio quis nos teneat error, aut miserabilis ignoratio veri. » Ubi est ergo philosophiae magisterium? aut quid te docuit illa vitae parens, si verum miserabiliter ignoras? Quod si haec erroris ignorationisque confessio pene invito tibi ab intimo pectore expressa est, cur non tibi verum fateris aliquando, philosophiam, quam tu nihil docentem in coelum laudibus extulisti, magistram virtutis esse non posse? |
XIII. Après avoir fait voir que le souverain bien consiste dans la possession de l'immortalité, l'ordre du sujet que je traite semblerait m'obliger à faire voir que l'âme est immortelle. Il y a eu de grandes contestations entre les philosophes sur cette matière. Mais ceux qui ont été dans les véritables sentiments, n'en ont apporté aucune preuve, et n'ont proposé ni raison ni autorités pour convaincre leurs ennemis. Le dernier livre de cet ouvrage où je parlerai de la vie heureuse, sera plus propre que celui-ci à l'examen de cette question. Il ne reste plus que la troisième partie de la philosophie, que l'on appelle logique et qui enseigne l'art de penser et d'exprimer ses pensées. La religion n'a pas besoin de cet art, parce que la sagesse réside non sur la langue, mais dans le cœur, et que les choses parlant d'elles-mêmes, elle peut négliger le choix des paroles. Nous ne cherchons ni un grammairien ni un orateur qui ne fasse profession que de bien parler; nous cherchons un sage qui sache bien vivre. Si la physique ni la logique ne servent de rien pour nous rendre plus heureux, on ne peut plus avoir recours qu'à la morale, à laquelle on dit que Socrate s'appliqua uniquement. Mais, comme j'ai fait voir que les philosophes se sont trompés dans cette partie aussi bien que dans les autres, et qu'ils n'ont pu comprendre en quoi consiste le souverain bien pour lequel ils ont été mis au monde, il est clair que la philosophie ne contient rien que de vain et d'inutile, et qu'elle ne nous enseigne ni les règles de la justice ni aucun de nos véritables devoirs. Que ceux-là sachent qu'ils se trompent, qui s'imaginent que la philosophie est la sagesse. Qu'ils ne défèrent en cela à l'autorité de qui que ce soit, mais qu'ils se rendent plutôt à la vérité. C'est une matière où l'on ne se trompe pas impunément. Quand on a la témérité d'embrasser une fausse opinion, ou l'imprudence de suivre une personne peu éclairée, on ne s'engage à rien moins qu'à subir un supplice qui n'a pas de fin. Si un homme, quel qu'il puisse être, se fie à sa propre conduite, ou il n'a pas l'esprit de s'apercevoir de son égarement, ou au moins il a beaucoup d'orgueil en s'attribuant un avantage qui est au-dessus de sa nature. Le plus éloquent des Romains tombe lui-même en des erreurs fort grossières, et on ne saurait mieux les reconnaître que par la lecture de ses Offices, où, après avoir dit que la philosophie n'est autre chose que l'étude de la sagesse, et que la sagesse est la science des choses divines et humaines, il ajoute ce qui suit : « Je ne sais ce que peut louer celui qui blâme l'étude de la philosophie ; car si c'est le divertissement ou le repos que l'on cherche, qu'y a-t-il que l'on puisse comparer avec les études de ceux qui n'ont point d'autre occupation que de méditer sur les moyens de parvenir à une vie honnête et heureuse? Que si l'on désire de s'établir dans la solidité de la vertu, il n'y a point d'autre art qui nous promette ce glorieux avantage. » Dire qu'il n'y a point d'art qui nous mette en cet état, et qu'il n'en faut point espérer pour cet effet, au lieu qu'il y en a pour les moindres choses, c'est n'avoir aucune attention à ce que l'on dit, et se tromper dans une matière fort importante. Que s'il y a quelque art pour apprendre la vertu, où le peut-on trouver hors des limites de la philosophie? Bien que la profession que j'ai faite d'enseigner les belles-lettres m'ait donné quelque facilité de parler, j'avoue pourtant que je ne suis point éloquent, et que jamais je n'ai fréquenté le barreau. Mais la bonté de ma cause peut me donner de l'éloquence, et la connaissance que j'ai du vrai Dieu, suffisent pour me faire plaider avec autant d'ornements que de force. Je voudrais que Cicéron pût sortir maintenant du tombeau, afin que le plus célèbre orateur de l'antiquité fût instruit par un homme qui n'a qu'une connaissance médiocre des préceptes de la rhétorique. Je lui ferais voir premièrement ce que pourrait louer un homme qui blâmerait l'étude de la philosophie. Je lui ferais voir, en second lieu, que la philosophie n'est pas un art par lequel on apprenne la vertu, et où il faut chercher cet art et hors de la philosophie. Il faut aussi demeurer d'accord que Cicéron ne faisait point ces questions là à dessein d'apprendre, et qu'il n'y avait personne en son temps de qui il put attendre la résolution de ses doutes. Il ne les faisait que par manière de déclamation, dans l'assurance qu'on ne lui pourrait jamais rien répondre pour faire voir que l'étude de la philosophie n'est pas une école de vertu. Il plaidait du même style et du même air, quand il voulait presser ceux à qui il avait affaire et les faire tomber dans quelque contradiction. Il en a usé de la sorte dans les questions Tusculanes où il fait à la philosophie cette apostrophe. « O philosophie! qui nous conduisez dans le cours de vie, qui exterminez les vices, et qui autorisez la vertu, qu'auraient pu faire sans vous tous les hommes ? Vous avez inventé les lois ; vous avez formé nos mœurs. Vous avez établi une discipline. » Il lui adresse la parole comme si elle eût pu l'entendre, et il lui donne des louanges qu'il aurait mieux méritées qu'elle. Il aurait pu remercier de la même manière les aliments que nous prenons, parce que sans eux nous ne saurions conserver notre vie. Comme il n'ont point de sentiment, ils n'ont point aussi de dessein de nous obliger. La sagesse est à l'égard de l'esprit, ce qu'ils sont à l'égard du corps. XIV. Lucrèce a mieux fait quand il a loué celui par qui la sagesse avait été inventée, bien qu'il se soit trompé en croyant qu'elle a été inventée par un homme. Est-ce qu'un homme, que ce poète loue comme un dieu, a trouvé la sagesse de la même sorte que des flûtes à une fontaine, selon le proverbe qui est dans la bouche des poètes. « Celui, dit Lucrèce, qui a inventé la sagesse n'était pas un homme qui eût un corps grossier et matériel comme les nôtres. L'excellence du sujet désire que nous disions librement, mon cher Memmius, qu'il était un Dieu. » Il ne faut pas même louer Dieu d'avoir inventé la sagesse, car ce serait lui ôter une partie de la louange qui lui est due. Il faut le louer d'avoir créé l'homme capable de recevoir la sagesse. Lucrèce loue cependant l'inventeur de la sagesse comme un homme, et l'élève en même temps jusqu'au ciel, en disant que, bien qu'il soit homme, il mérite d'être mis au nombre des dieux. Il y a apparence qu'il avait dessein de louer ou Pythagore, qui avait pris le premier le nom de philosophe, ou Thalès de Milet, qui avait recherché le premier les secrets de la nature. Mais en voulant relever la gloire de l'homme, il rabaisse le mérite de la sagesse, étant certain que son origine est moins illustre si elle n'a été inventée que par un homme. On peut néanmoins pardonner cette faute à Lucrèce comme à un poète ; on ne la peut excuser dans Cicéron, le premier orateur de son siècle et le plus excellent philosophe de la république romaine ; car pour ne point parler des Grecs, qu'il accuse souvent de légèreté et qu'il suit cependant comme ses maîtres, ne loue-t-il pas avec des expressions aussi figurées que celles de la poésie la sagesse qu’il appelle un don et un présent des dieux ? Non content de cela, il fait de grandes plaintes de ce qu'il s'est trouvé des personnes qui l'ont blâmée. « Y a-t-il quelqu'un, dit-il, qui ose tomber dans une méconnaissance si pleine d'impiété, et commettre un parricide si détestable, que de blâmer la mère de la vie civile? » Nous sommes ces parricides qui nions que la philosophie est la mère de la vie, et qui méritons, à votre jugement, d'être enfermés dans un sac. Et vous ne l'êtes point, vous qui commettez la plus odieuse de toutes les ingratitudes et la plus exécrable de toutes les impiétés, non contre le dieu dont vous adorez l'image dans le Capitole, mais contre celui qui a fait le monde, qui a créé l'homme, et qui, parmi un grand nombre d'autres faveurs, lui a donné la sagesse. Vous appelez la philosophie la maîtresse de la vertu et la mère de la vie ; cependant personne n'entre dans son école qu'il n'en sorte plus rempli d'incertitude et de doute qu'il n'était auparavant. De quelle vertu la philosophie est-elle la maîtresse? de quelle vie est-elle la mère? Les philosophes disputent encore pour savoir en quoi consiste la vertu. Ils vieillissent et meurent tous les jours sans avoir pu convenir de la manière dont il faut vivre. Quelle vérité pouvez-vous montrer que la philosophie ait découverte, vous qui témoignez en plusieurs endroits de vos ouvrages que, parmi une si prodigieuse multitude de personnes qui ont fait profession de l'étude de la sagesse, il ne s'en est jamais trouvé aucune qui l'ait possédée? Qu'avez-vous appris vous-même de cette maîtresse de la vie? Avez-vous appris d'elle à faire de sanglantes invectives contre un consul qui avait acquis une grande autorité, et à l'irriter si fort par vos outrageuses exclamations, qu'il a été comme contraint de prendre les armes contre sa patrie? Mais supposons que cette conduite puisse être excusée par l'état où se trouvaient alors les affaires de la république, vous vous êtes adonné à l'étude de la philosophie, et vous vous y êtes attaché avec une plus grande application que nul autre. Vous vous vantez de savoir les opinions de toutes les sectes, et vous avez écrit en latin à l'imitation de Platon. Déclarez-nous donc ce que vous en avez appris, et nous dites en quelle secte vous avez trouvé la vérité? Est-ce dans celle des académiciens, que vous avez préférée aux autres et que vous avez suivie comme la meilleure? Elle n'enseigne rien, si ce n'est que l'on ne peut rien savoir. Il est aisé de vous convaincre par vos propres écrits que la philosophie ne nous peut rien enseigner qui contribue à la conduite de la vie civile. Voici vos paroles: « non seulement nous n'avons point d'yeux pour voir la sagesse, mais nous n'en avons que de faibles pour voir les objets les plus visibles. » Si la philosophie est la maîtresse de la vie et qu'elle vous éclaire dans votre conduite, d'où vient que vous êtes aveugle? Vous déclarez franchement quelles vérités vous croyez que l'on puisse apprendre de la philosophie, lorsque entre les règles que vous donnez à votre fils, vous lui dites qu'il faut savoir les préceptes de la philosophie, mais que dans la pratique il faut suivre les lois civiles. Peut-on jamais avancer une contradiction plus manifeste? S'il est nécessaire de savoir les préceptes de la philosophie, c'est sans doute pour vivre selon les lois civiles; la philosophie n'enseigne pas la sagesse, puisqu'il faut préférer l'autorité des législateurs ou les coutumes reçues parmi les peuples, aux avis des philosophes. Si la philosophie et la sagesse ne sont qu'une même chose, c'est vivre en homme qui n'a point de sagesse que de ne pas vivre selon la philosophie. Si ce n'est pas vivre en insensé que de vivre selon les lois civiles, c'est vivre en insensé que de vivre selon la philosophie ; ainsi voilà la philosophie condamnée de folie par vous-même. Dans le livre de la Consolation, qui est un livre fort sérieux, vous avez parlé de la philosophie en ces termes : « Nous sommes dans l'erreur et dans une misérable ignorance de la vérité ! » Où sont donc les préceptes de la philosophie ? Où est ce que vous a enseigné cette mère et cette maîtresse de la vie ? Que si cet aveu si sincère de votre ignorance et de vos erreurs vous est échappé de la bouche, que ne reconnaissez-vous aussi que la philosophie, que vous avez élevée par des louanges si extraordinaires, ne peut enseigner la pratique de la vertu ? |
|
CAPUT XV. Senecae error in philosophia: et quomodo philosophorum oratio cum eorum vita pugnet. Eodem ductus errore Seneca (quis enim veram viam teneret, errante Cicerone? « Philosophia, inquit, nihil aliud est quam recta ratio vivendi, vel honeste vivendi scientia, vel ars rectae vitae agendae. Non errabimus, si dixerimus philosophiam esse legem bene honesteque vivendi. Et qui dixerit illam regulam vitae, suum illi reddidit. » Hic plane non respexit ad commune philosophiae nomen, quae cum sit in plures sectas disciplinasque diffusa, nihilque habeat certi, nihil denique, de quo universi una mente ac voce consentiant, quid potest esse tam falsum, quam regulam vitae philosophiam nominari, in qua diversitas praeceptorum rectum iter impediat, et turbet? aut legem bene vivendi, cujus capita longe dissonant? aut scientiam vitae agendae, in qua nihil aliud efficitur, contraria saepe dicendo, quam ut nemo quidquam sciat? Quaero enim, utrumne academiam philosophiam putet esse, an non? Negaturum non arbitror: quod si est, nihil ergo illorum cadit in philosophiam, quae omnia reddit incerta, legem abrogat, artem nullam putat, rationem subvertit, regulam depravat, scientiam funditus tollit. Falsa igitur illa omnia, quia in rem semper incertam et adhuc nihil explicantem cadere non possunt. Nulla itaque ratio, vel scientia, vel lex bene vivendi, nisi in hac unica, et vera, et coelesti sapientia constituta est, quae philosophis fuerat ignota. Nam illa terrena, quoniam falsa est, fit varia, et multiplex, sibique tota contraria est. Et sicut unus est hujus mundi constitutor et rector Deus, una veritas: ita unam esse ac simplicem sapientiam necesse est, quia quidquid est verum, ac bonum, id perfectum esse non potest, nisi fuerit sin gulare. Quod si philosophia vitam posset instruere, nulli alii nisi philosophi essent boni, et qui eam non didicissent, essent omnes semper mali. Cum vero innumerabiles existant, et semper exstiterint, qui sint, aut fuerint sine ulla doctrina boni, ex philosophis autem perraro fuerit, qui aliquid in vita fecerit laude dignum, quis est tandem, qui non videat, eos homines virtutis, qua ipsi egent, non esse doctores? Nam si quis in mores eorum diligenter inquirat, inveniet iracundos, cupidos, libidinosos, arrogantes, protervos, et sub obtentu sapientiae sua vitia celantes, domi facientes ea quae in scholis arguissent. Fortasse mentior accusandi gratia. Nonne id ipsum Tullius et fatetur, et queritur? « Quotus quisque, inquit, philosophorum invenitur, qui sit ita moratus, ita animo et vita constitutus, ut ratio postulat? qui disciplinam veram, non ostentationem scientiae, sed legem vitae putet? qui obtemperet ipse sibi, et decretis pareat suis? Videre licet alios tanta levitate et jactatione, ut his fuerit non didicisse melius: alios pecuniae cupidos, alios gloriae; multos libidinum servos, ut cum eorum vita mirabiliter pugnet oratio. » Nepos quoque Cornelius ad eumdem Ciceronem ita scribit: « Tantum abest, ut ego magistram esse putem vitae philosophiam, beataeque vitae perfectricem, ut nullis magis existimem opus esse magistris vivendi, quam plerisque, qui in ea disputanda versantur. Video enim magnam partem eorum, qui in schola de pudore et continentia praecipiant argutissime, eosdem in omnium libidinum cupiditatibus vivere. Item Seneca in Exhortationibus: « Plerique, inquit, philosophorum tales sunt, diserti in convitium suum, quos si audias in avaritiam, in libidinem, in ambitionem perorantes, indicium sui professos putes, adeo redundant ad ipsos maledicta in publicum missa; quos non aliter intueri decet, quam medicos, quorum tituli remedia habent, pyxides venena. Quosdam vero nec pudor vitiorum tenet: sed patrocinia turpitudini suae fingunt, ut etiam honeste peccare videantur. Faciet sapiens, inquit idem Seneca, etiam quae non probabit, ut etiam ad majora transitum inveniat: nec relinquet bonos mores, sed tempori aptabit; et quibus alii utuntur in gloriam, aut voluptatem, utetur agendae rei causa. » Deinde paulo post: « Omnia quae luxuriosi faciunt, quaeque imperiti, faciet et sapiens, sed non eodem modo, eodemque proposito. Atqui nihil interest quo animo facias, quod fecisse vitiosum est: quia facta cernuntur, animus non videtur. »
Aristippo Cyrenaicorum magistro cum
Laide nobili scorto fuit consuetudo, quod flagitium gravis ille
philosophiae doctor sic defendebat, ut diceret, multum inter se et
caeteros Laidis amatores interesse, quod ipse haberet Laidem, alii
vero a Laide haberentur. O praeclara et imitanda bonis sapientia!
Huic vero liberos in disciplinam dares, ut discerent habere
meretricem? Aliquid inter se ac perditos interesse dicebat; scilicet
quod illi bona sua perderent, ipse gratis luxuriaretur. In quo plane
sapientior meretrix fuit, quae philosophum habuit pro lenone, ut ad
se omnis juventus, doctoris exemplo et auctoritate corrupta, sine
ullo pudore concurreret. Quid ergo interfuit, quo animo philosophus
ad meretricem famosissimam commearet, cum eum populus et rivales sui
viderent omnibus perditis nequiorem? Nec satis fuit ita vivere: sed
docere etiam libidines coepit, ac mores suos de lupanari ad scholam
transtulit, disserens voluptatem corporis esse summum bonum. Quae
doctrina execrabilis et pudenda, non in corde philosophi, sed in
sinu meretricis est nata. CAPUT XVI. Quod recte docentes philosophi male vivant, teste Cicerone; unde non tam philosophiae, quam sapientiae studendum est. Verum cum se perpetuae desidiae tradant, nullamque virtutem capessant, et omnem suam vitam nihil aliud quam in eloquendo peragant, quid aliud quam inertes putari debent? Sapientia enim, nisi in aliquo actu fuerit quo vim suam exerceat, inanis et falsa est; recteque Tullius civiles viros, qui rempublicam gubernent, qui urbes aut novas constituant, aut constitutas aequitate tueantur, qui salutem libertatemque civium vel bonis legibus, vel salubribus consiliis, vel judiciis gravibus conservent, philosophiae doctoribus praefert. Bonos enim facere oportet potius quam inclusos in angulis facienda praecipere, quae ne ipsi quidem faciunt, qui loquuntur; et quoniam se a veris actibus removerunt, apparet eos exercendae linguae causa, vel advocandi gratia artem ipsam philosophiae reperisse. Qui autem docent tantum, nec faciunt, ipsi praeceptis suis detrahunt pondus; quis enim obtemperet, cum ipsi praeceptores doceant non obtemperare? Bonum est autem recta et honesta praecipere: sed nisi et facias, mendacium est; et est incongruens atque ineptum, non in pectore, sed in labris habere bonitatem. Non ergo utilitatem ex philosophia, sed oblectationem petunt. Quod quidem Cicero testatus est: « Profecto, inquit, omnis istorum disputatio, quanquam uberrimos fontes virtutis et scientiae contineat, tamen collata cum horum actis perfectisque rebus, vereor ne non tantum videatur attulisse negotiis hominum utilitatis, quantam oblectationem otiis. » Vereri quidem non debuit, cum verum diceret: sed quasi timeret, ne proditi mysterii reus a philosophis citaretur, non est ausus confidenter pronuntiare, quod fuit verum, illos non ideo disputare, ut doceant, sed ut se oblectent in otio: qui quoniam auctores sunt rerum gerendarum, nec ipsi quidquam gerunt, pro loquacibus sunt habendi. Sed profecto, quia nihil boni ad vitam afferebant, nec ipsi decretis suis obtemperaverunt; nec quisquam per tot saecula inventus est, qui eorum legibus viveret. Abjicienda est igitur omnis philosophia, quia non studendum est sapientiae, quod fine ac modo caret: sed sapiendum est, et quidem mature. Non enim nobis altera via conceditur, ut, cum in hac sapientiam quaeramus, in illa sapere possimus: in hac utrumque fieri necesse est. Cito inveniri debet, ut cito suscipi possit, ne quid pereat ex vita cujus finis incertus est. Ciceronis Hortensius contra philosophiam disserens, circumvenitur arguta conclusione; quod cum diceret philosophandum non esse, nihilominus philosophari videbatur, quoniam philosophi est, quid in vita faciendum, vel non faciendum sit, disputare. Nos ab hac calumnia immunes ac liberi sumus, qui philosophiam tollimus, quia humanae cogitationis inventio est; sophiam defendimus, quia divina traditio est, eamque ab omnibus suscipi oportere testamur. Ille, cum philosophiam tolleret, nec melius aliquid afferret, sapientiam tollere putabatur, eoque facilius de sententia pulsus est: quia constat hominem non ad stultitiam, sed ad sapientiam nasci. Praeterea illud quoque argumentum contra philosophiam valet plurimum, quo idem est usus Hortensius; ex eo posse intelligi, philosophiam non esse sapientiam, quod principium et origo ejus appareat. Quando, inquit, philosophi esse coeperunt? Thales (ut opinor) primus, recens haec quidem aetas; ubi ergo apud antiquiores latuit amor iste investigandae veritatis? Item Lucretius ait:
Denique natura haec rerum, ratioque
reperta est Et Seneca: « Nondum sunt, inquit, mille anni, ex quo initia sapientiae mota sunt. » Multis ergo saeculis humanum genus sine ratione vixit. Quod irridens Persius: Postquam (inquit) sapere urbi Cum pipere et palmis venit; tanquam sapientia cum saporis mercibus fuerit invecta: quae si secundum hominis naturam est, cum homine ipso coeperit necesse est; si vero non est, nec capere quidem illam posset humana natura. Sed quia recepit, igitur a principio fuisse sapientiam necesse est; ergo philosophia, quia non a principio fuit, non est eadem vera sapientia. Sed videlicet Graeci, quia sacras veritatis litteras non attigerant, quemadmodum depravata esset sapientia, nesciverunt. Et ideo cum vacare sapientia humanam vitam putarent, philosophiam commenti sunt; id est, latentem atque ignotam sibi veritatem disserendo eruere voluerunt, quod studium, per ignorantiam veri, sapientiam putaverunt. |
XV. Sénèque a été dans la même erreur ; car qui pourrait demeurer dans le bon chemin pendant que Cicéron s'égare? « La philosophie, dit-il, n'est autre chose que la manière de bien vivre, que la science de vivre honnêtement, que l'art de bien régler ses actions. Nous ne nous tromperions point, ajoute-t-il, si nous disions que la philosophie est une loi qui nous oblige à vivre selon l'honnêteté et la vertu; et celui qui l'a appelée la règle de la vie humaine, lui a donné un nom qui lui est fort propre. » Quand Sénèque parlait de la sorte, il ne conservait pas sans doute l'idée de la philosophie prise en général, qui contient plusieurs sectes, qui n'enseigne aucune maxime dont tout le monde ne convienne, et qui renferme une multitude prodigieuse de préceptes qui ne peuvent apporter que du trouble et de la confusion. Comment une philosophie, si peu stable et si peu constante pourrait-elle, donner des règles certaines et invariables pour bien vivre? Je demanderais volontiers à Sénèque s'il tient que la secte des académiciens fasse profession d'une véritable philosophie. Je me persuade qu'il n'en disconviendra pas. S'il est vrai que l'académie ne s'éloigne pas de la vérité de la philosophie, celle-ci ne saurait être la règle de la vie; car, selon l'académie même, elle n'a rien de certain ni d'assuré, elle abolit toute sorte de règles, de lois et de science. Il n'y a donc point d'art ni de science qui nous enseigne à bien vivre, hors cette sagesse sublime qui a été inconnue aux philosophes. Celle de la terre ne saurait être que fausse, puisqu'elle est incertaine, changeante et contraire à elle-même. Il faut nécessairement qu'il n'y ait qu'une sagesse, comme il n'y a qu'une vérité, comme il n'y a qu'un Dieu qui a tiré l'univers du néant et qui le gouverne. Tout ce qui possède la vérité et la bonté dans un haut degré, ne saurait être qu'unique. Si la philosophie nous donnait de bonnes règles pour la conduite de notre vie, il n'y aurait que les philosophes qui vécussent en gens de bien. Ceux qui n'auraient pas étudié, ne seraient que des scélérats. Cependant il y a toujours en quantité de personnes qui, sans les secours des préceptes dont nous parlons, ont pratiqué la vertu, au lieu que nul de ceux qui ont fait profession d'expliquer ces préceptes n'a rien fait de digne de louange. Il est donc clair que les philosophes n'enseignent pas les vertus, puisqu'ils ne les ont pas eux-mêmes. Si l'on examine leurs mœurs, on trouvera qu'ils sont sujets à la colère, à l'avarice, à la volupté, qu'ils sont superbes et insolents, qu'ils cachent leurs défauts sous une fausse apparence de sagesse, et qu'ils font dans leurs maisons ce qu'ils condamnent dans leurs écoles. On dira peut-être que le désir de les reprendre me fait passer les bornes de la vérité. Cicéron se plaint de ces désordres, et prouve qu'ils ne sont que trop véritables. « Combien, dit-il, se trouve-t-il de philosophes dont l'esprit et la vie soient réglés de la manière que la raison le désire? Combien y en a-t-il qui ne fassent de leur profession un sujet de vanité, au lieu d'en faire la règle de leur conduite ? Combien y en a-t-il qui s'accordent avec eux-mêmes et qui pratiquent les préceptes qu'ils donnent? Il y en a de si extravagants et de si emportés, qu'il serait à souhaiter qu'ils n'eussent jamais rien appris. D'autres brûlent d'un désir incroyable d'amasser des richesses; d'autres ont une ambition excessive et démentent leur doctrine par leurs actions. » Cornélius Népos écrit à Cicéron sur le même sujet en ces termes : « Bien loin de croire que la philosophie enseigne à bien vivre et contribue à nous rendre heureux, je suis persuadé que plusieurs de ceux qui en font profession ont plus grand besoin que les autres d'avoir des gouverneurs et des précepteurs qui veillent sur leur conduite. J'en vois parmi eux qui, dans les écoles, donnent d'excellents préceptes de retenue, de modération et de pudeur, et qui dans leurs maisons s'abandonnent aux plus infâmes voluptés. » Sénèque écrit quelque chose de fort important dans ses exhortations. « La plupart des philosophes, dit-il, semblent n'avoir de l'éloquence que pour déclamer contre eux-mêmes. On ne saurait les entendre parler contre l'avarice, contre l'ambition et contre la débauche, sans s'imaginer qu'ils prononcent leur propre arrêt; car toutes les invectives qu'ils font en public retombent sur eux, et on ne les saurait regarder qu'à peu près comme on ferait des médecins qui n'auraient que des poisons dans leurs boites, bien que les inscriptions promissent des remèdes. Quelques-uns n'ont aucune honte de leurs crimes, et ne cherchent aucun prétexte pour les couvrir. — Le sage fera quelquefois, dit le même Sénèque, pour venir à bout d'une entreprise importante, des choses qu'il n'approuve pas. Il ne renonce pas pour cela aux bonnes mœurs, mais il s'accommodera au temps. Enfin il emploiera pour faire ses affaires les mêmes moyens que les autres emploient pour jouir de leurs plaisirs ou pour acquérir de la gloire. » Il ajoute un peu après ce qui suit: « Le sage fera les mêmes choses que font les ignorants et les débauchés, mais il ne les fera pas de la même manière ni avec la même intention. » Il importe peu à quelle intention on fasse ce qu'il n'eût pas permis de faire. On voit les actions, mais on ne voit pas l'intention. Aristippe, chef des Cyrénéens, tâchait de justifier l'habitude criminelle qu'il avait avec la fameuse Laïs, en disant qu'il y avait grande différence entre lui et les autres amans de Laïs, parce qu'il la possédait, au lieu que les autres étaient possédés par elle. Oh! l'excellente sagesse et digne d'être imitée! Il faut lui mettre vos enfants entre les mains, si vous désirez qu'ils soient bien élevés. Ce philosophe disait qu'il y avait cette différence entre lui et les autres débauchés, qu'au lieu que les autres dissipaient leur bien, il se divertissait sans faire aucune dépense. Laïs était sans doute fort habile en son métier, de se servir ainsi d'un philosophe, dont l'autorité et l'exemple attiraient chez elle une foule incroyable de jeunes gens. Qu'importé donc à quel dessein il fréquentât cette célèbre courtisane, puisque le peuple et « es rivaux voyaient qu'il était plus corrompu que nul autre. Il ne se contenta pas de vivre dans cet horrible débordement ; il en fit des leçons publiques et enseigna cette doctrine infâme et détestable qui était sortie non du cœur d'un philosophe, mais du sein d'une femme perdue : que le souverain bien consiste dans la jouissance des plaisirs. Que dirai-je des cyniques, qui avaient accoutumé de caresser leurs femmes devant tout le monde? Ils ont justement mérité qu'on leur donnât, comme on fait, le nom des animaux dont ils imitent l'impudence. Tout ce que je viens de dire fait voir clairement, si je ne me trompe, qu'il n'y a point de vertu à apprendre dans l'école des philosophes, puisque ceux qui donnent les plus excellents préceptes ne les observent pas eux-mêmes, ou s'ils les observent, ce qui est fort rare, c'est moins en eux un effet de l'étude que du bon naturel, qui porte souvent à des entreprises fort louables des personnes qui ne sont point lettrées. XVI. Ces philosophes doivent passer pour des hommes fort inutiles, puisqu'au lieu de pratiquer la vertu, ils consument toute leur vie dans des conférences et dans des disputes. La sagesse qui demeure oisive ne peut être qu'une sagesse vaine ou fausse. Cicéron a eu raison de préférer ceux qui gouvernent les États, qui fondent de nouvelles villes, qui font de bonnes lois pour la police de celles qui sont déjà toutes fondées, et qui y rendent la justice, aux professeurs de philosophie; car un homme de bien doit être dans une pratique continuelle des bonnes actions, bien loin de demeurer enfermé pour donner des préceptes, qui sont pour l'ordinaire plus mal observés par ceux qui les donnent que par les autres. Ces philosophes s'étant éloignés des véritables devoirs, il est clair qu'ils ne sont engagés dans leur profession qu'a dessein d'y acquérir de la facilité de parler et de suivre le barreau. Or ceux qui se contentent de parler sans faire ce qu'ils disent, ôtent le poids à leurs paroles. Qui voudrait observer les préceptes les plus salutaires, lorsque ceux qui les font enseignent eux-mêmes, par leur exemple, à ne les pas observer? C'est une chose fort louable que de donner de bons préceptes ; mais ceux qui les donnent sans les observer sont des imposteurs. Il n'y a rien de si extravagant ni de si injuste que d'avoir la vertu sur les lèvres, et de ne l'avoir pas dans le cœur. Tout ceci fait voir clairement que la plupart de ceux qui se sont adonnés à l'étude de la philosophie, au lieu de chercher à s'y instruire solidement, n'ont point eu d'autre dessein que d'y prendre du plaisir. Cicéron le témoigne par ces paroles. « Bien que leurs discours et leurs conférences renferment des semences très abondantes de science et de vertu, j'appréhende pourtant que quand on les comparera avec leurs actions et avec leurs mœurs, on ne juge qu'elles n'ont été qu'un agréable divertissement. » Il ne le devait point avancer avec crainte ni avec réserve; mais il n'a osé publier la vérité de peur que les philosophes ne se plaignissent de ce qu'il aurait révélé leurs mystères, et de ce qu'il aurait appris à tout le peuple qu'ils ne disputent point à dessein d'enseigner la vérité, mais à dessein de se divertir durant leur loisir, et que ne pratiquant aucune vertu, bien qu'ils conseillent aux autres de les pratiquer toutes, ils ne doivent être considérés que comme de vains parleurs. Le peu d'utilité que leurs raisonnements ont eu pour la conduite de la vie humaine, a été cause que personne n'a suivi leurs conseils durant plusieurs siècles et que dans la pratique ils s'en sont éloignés d'eux-mêmes. Il faut donc renoncer à une philosophie dont l'étude n'a ni règle ni fin, et s'adonner de bonne heure à la sagesse. On ne nous a point promis une autre vie où nous puissions jouir de la sagesse que nous aurons acquise en cette vie. C'est en celle-ci qu'il faut et acquérir la sagesse et jouir d'elle. Il faut la trouver et l'embrasser de bonne heure, pour ne perdre aucune partie d'une vie qui peut finir à chaque moment. Hortensius discourant contre la philosophie dans un dialogue de Cicéron, se trouve embarrassé d'une subtile objection qui lui était faite sur ce qu'il s'appliquait à l'étude de la philosophie, bien qu'il soutint qu'il ne s'y faut point appliquer. Cette objection ne nous touche point, nous qui rejetons la philosophie comme une invention de l'esprit humain, et qui ne maintenons que la sagesse, qui est un présent de Dieu. Quand Hortensius rejetait la philosophie sans apporter rien de meilleur, on l'accusait, avec quelque fondement, de rejeter la sagesse, et il était d'autant plus aisé de le convaincre, qu'il est constant que l'homme a été créé non pour être insensé, mais pour être sage. Hortensius s'est encore servi d'un autre argument extrêmement fort, pour prouver qu'il y a une grande différence entre la philosophie et la sagesse, qui est de faire voir l'origine et le principe de la philosophie. « Quand est-ce, dit-il, que les philosophes ont commencé à paraître ? Je pense que Thalès a été le premier. Il n'y a pas fort longtemps qu'il vivait : auparavant où était caché l'amour de la vérité dont les anciens brûlaient? » Lucrèce dit : que les secrets de la nature ont été découverts depuis peu, et qu'il est le premier qui se soit rendu capable de les expliquer en latin. Sénèque a employé depuis la même preuve. « Il n'y a pas mille ans, dit-il, que l'on connaît la source d'où la sagesse est venue. » Les hommes ont donc vécu durant plusieurs siècles sans aucun usage de la raison. Perse semble faire allusion à cette pensée, quand il dit en raillant : que la sagesse a été apportée à Rome avec le poivre et les palmes. Si cette sagesse est conforme à la nature, elle est aussi ancienne que lui ; si elle n'y est pas conforme, il ne la saurait recevoir. Or il est certain qu'il l'a reçue ; elle était donc dès le temps où il a été créé, et dès le commencement, auquel il n'y avait point de philosophie, ce qui fait voir que la philosophie et la sagesse ne sont pas une même chose. Les païens, qui n'avaient rien lu des saintes Écritures, et qui ne savaient rien de la manière dont la sagesse s'est obscurcie, ont cru qu'il n'y en avait jamais eu parmi les hommes, et ont eu recours à la philosophie pour lever les voiles dont la vérité leur paraissait couverte ; et c'est à cette occupation qu'ils ont donné le nom de sagesse. |
|
CAPUT XVII. A Philosophia ad philosophos transit, initio ab Epicuro sumpto; et quomodo Leucippum et Democritum habuerit auctores erroris. Dixi de philosophia ipsa quam breviter potui: nunc ad philosophos veniamus; non ut cum his decertemus, qui stare non possunt, sed ut eos fugientes atque dejectos nostro campo insequamur. Epicuri disciplina multo celebrior semper fuit, quam caeterorum; non quia veri aliquid afferat, sed quia multos populare nomen voluptatis invitat. Nemo enim non in vitia pronus est. Praeterea, ut ad se multitudinem contrahat, apposita singulis quibusque moribus loquitur. Desidiosum vetat litteras discere, avarum populari largitione liberat, ignavum prohibet accedere ad rempublicam, pigrum exerceri, timidum militare. Irreligiosus audit deos nihil curare; inhumanus, et suis commodis serviens jubetur nihil cuiquam tribuere; omnia enim sua causa facere sapientem. Fugienti turbam solitudo laudatur. Qui nimium parcus est, discit aqua et polenta vitam posse tolerari. Qui odit uxorem, huic enumerantur coelibatus bona: habenti malos liberos orbitas praedicatur; adversus impios parentes nullum esse vinculum naturae. Impatienti ac delicato dolorem esse omnium malorum maximum dicitur: forti, etiam in tormentis beatum esse sapientem. Qui claritati ac potentiae studet, huic praecipitur reges colere: qui molestiam ferre non potest, huic regiam fugere. Ita homo astutus ex variis diversisque moribus circulum cogit, et dum studet placere omnibus, majore discordia secum ipse pugnavit, quam inter se universi. Unde autem disciplina ejus tota descendat, quam originem habeat, explicandum est. Videbat Epicurus bonis adversa semper accidere, paupertatem, labores, exilia, charorum amissiones; malos contra beatos esse, augeri potentia, honoribus affici: videbat innocentiam minus tutam, scelera impune committi: videbat, sine delectu morum, sine ordine ac discrimine annorum saevire mortem: sed alios ad senectutem pervenire, alios infantes rapi, alios jam robustos interire, alios in primo adolescentiae flore immaturis funeribus extingui, in bellis potius meliores, et vinci, et perire. Maxime autem commovebat, homines in primis religiosos gravioribus malis affici: iis autem, qui aut deos omnino negligerent, aut non pie colerent, vel minora incommoda evenire vel nulla: ipsa etiam saepe templa fulminibus conflagrare. Quod Lucretius queritur, cum dicit de Deo:
Tum fulmina mittat, et aedes Quod si vel exiguam veritatis auram colligere potuisset, numquam diceret, aedes illum suas disturbare; cum ideo disturbet, quod non sunt suae. Capitolium, quod est Romanae urbis et religionis caput summum, non semel, sed saepius fulmine ictum conflagravit. Homines autem ingeniosi quid de hoc existimaverint, ex dicto Ciceronis apparet, qui ait, divinitus extitisse illam flammam, non quae terrestre illud domicilium Jovis deleret, sed quae sublimius magnificentiusque deposceret. Qua de re etiam in libris Consulatus sui eadem dixit quae Lucretius:
Nam pater altitonans stellanti nixus
Olympo, Pertinaci ergo stultitia non modo vim majestatemque veri Dei non intellexerunt: sed etiam impietatem sui erroris auxerunt, qui templum coelesti judicio saepe damnatum restituere contra fas omne contenderint.
Cum haec igitur cogitaret Epicurus,
earum rerum velut iniquitate inductus (sic enim causam rationemque
ignoranti videbatur) existimavit nullam esse providentiam. Quod cum
sibi persuasisset, suscepit etiam defendendum: sic in errores
inextricabiles se ipse conclusit. Si enim providentia nulla est,
quomodo tam ordinate, tam disposite mundus effectus est? Nulla,
inquit, dispositio est; multa enim facta sunt aliter, quam fieri
debuerunt. Et invenit homo divinus, quae reprehenderet. Quae singula
si vacaret refellere, facile ostenderem, nec sapientem hunc fuisse,
nec sanum. Item si nulla providentia est, quomodo animalium corpora
tam providenter ordinata sunt, ut singula quaeque membra mirabili
ratione disposita sua officia conservent? Nihil, inquit, in
procreandis animalibus providentiae ratio molita est; nam neque
oculi facti sunt ad videndum, neque aures ad audiendum, neque lingua
ad loquendum, neque pedes sd ambulandum: quoniam prius haec nata
sunt quam esset loqui, audire, videre, ambulare. Itaque non haec ad
usum nata sunt: sed usus ex illis natus est. Si nulla providentia
est, cur imbres cadunt, fruges oriuntur, arbusta frondescunt? Non,
inquit, semper causa animantium ista fiunt, quoniam providentiae
nihil prosunt: sed omnia sua sponte fieri necesse est. Unde ergo
nascuntur aut quomodo fiunt omnia quae geruntur? Non est, inquit,
providentiae opus; sunt enim semina per inane volitantia, quibus
inter se temere conglobatis, universa gignuntur atque concrescunt.
Cur igitur illa non sentimus aut cernimus? Quia nec colorem habent,
inquit, nec calorem ullum, nec odorem; saporis quoque et humoris
expertia sunt, et tam minuta, ut secari ac dividi nequeant.
Qui genus humanum ingenio superavit,
et omnes Quos equidem versus numquam sine risu legere possum. Non enim de Socrate, aut Platone hoc saltem dicebat, qui velut reges habentur philosophorum: sed de homine, quo sano et vigente, nullus aeger ineptius deliravit. Itaque poeta inanissimus leonis laudibus murem non ornavit, sed obruit et obtrivit. At idem nos metu liberat mortis, de qua haec ipsius verba sunt expressa: « Quando nos sumus, mors non est: quando mors est, nos non sumus; mors ergo nihil ad nos. » Quam argute nos fefellit! quasi vero transacta mors timeatur, qua jam sensus ereptus est, ac non ipsum mori, quo sensus eripitur. Est enim tempus aliquod, quo nos etiamnum sumus, et mors tamen nondum est; idque ipsum videtur miserum esse, cum et mors esse incipit, et nos esse desinimus. Nec frustra dictum est: Mors misera non est. Aditus ad mortem est miser: hoc est, morbo tabescere, ictum perpeti, ferrum corpore excipere, ardere igni, dentibus bestiarum laniari. Haec sunt quae timentur, non quia mortem afferunt, sed quia dolorem magnum. Quin potius effice ne dolor malum sit. Omnium, inquit, malorum maximum est. Qui ergo non possum non timere, si id, quod mortem antecedit, aut efficit, malum est? Quid, quod totum illud argumentum falsum est? quia non intereunt animae. Animae vero, inquit, intereunt. Nam quod cum corpore nascitur, cum corpore intereat necesse est. Jam superius dixi, differre me hunc locum melius, et operi ultimo reservare. ut hanc Epicuri persuasionem, sive illa Democriti, sive Dicaearchi fuit, et argumentis, et divinis testimoniis redarguam. Verum ille fortasse impunitatem vitiis suis spopondit; fuit enim turpissimae voluptatis assertor, cujus capiendae causa, nasci hominem putavit. Quis, cum hoc affirmari audiat, vitiis et sceleribus abstineat? Nam si periturae sunt animae, appetamus divitias, ut omnes suavitates capere possimus: quae si nobis desunt, ab iis qui habent, auferamus clam, dolo, vi; eo magis, si humanas res Deus nullus curat, quandocumque spes impunitatis arriserit, rapiamus, necemus. Sapientis est enim malefacere, si et utile sit, et tutum; quoniam si quis in coelo Deus est, non irascitur cuiquam. Aeque stulti est et benefacere; quia sicut ira non commovetur, ita nec gratia tangitur. Voluptatibus igitur, quoquo modo possumus, serviamus. Brevi enim tempore nulli erimus omnino. Ergo nullum diem, nullum denique temporis punctum fluere nobis sine voluptate patiamur; ne, quia ipsi quandoque perituri sumus, id ipsum quod viximus pereat. Hoc ille tametsi non dicit verbo, re tamen ipsa docet. Nam cum disputat, omnia sapientem sua causa facere, ad utilitatem suam refert omnia quae agit. Ita qui audit haec flagitia, nec boni quidquam faciendum putabit, quoniam benefacere ad utilitatem spectat alienam, nec a scelere abstinendum, quia maleficio praeda conjuncta est. Archipyrata quisquam, vel latronum ductor, si suos ad grassandum cohortetur; quo alio sermone uti potest, quam ut eadem dicat, quae dicit Epicurus? Deos nihil curare; non ira, non gratia tangi; inferorum poenas non esse metuendas, quod animae post mortem occidant, nec ulli omnino sint inferi; voluptatem esse maximum bonum; nullam esse humanam societatem; sibi quemque consulere; neminem esse qui alterum diligat, nisi sua causa; mortem non esse metuendam forti viro, nec ullum dolorem, qui etiamsi torqueatur, si uratur, nihil curare se dicat. Est plane, cur quisquam putet, hanc vocem viri esse sapientis, quae potest latronibus aptissime commodari? CAPUT XVIII. Pythagorici et Stoici, animarum immortalitatem statuentes, voluntariam mortem inaniter persuadent.
Alii autem contraria his disserunt,
superesse animas post mortem; et hi sunt maxime Pythagorici ac
Stoici: quibus etsi ignoscendum est, quia verum sentiunt, non possum
tamen non reprehendere eos, quia non sententia, sed casu inciderunt
in veritatem. Itaque in eo ipso quod recte sentiebant aliquid
errarunt. Nam cum timerent argumentum illud, quo colligitur necesse
esse, ut occidant animae cum corporibus, quia cum corporibus
nascuntur, dixerunt non nasci animas, sed insinuari potius in
corpora, et de aliis in alia migrare. Non putaverunt aliter fieri
posse, ut supersint animae post corpora, nisi videantur fuisse ante
corpora. Par igitur, ac prope similis error est partis utriusque.
Sed haec in praeterito falsa est, illa in futuro. Nemo enim vidit,
quod est verissimum, et nasci animas, et non occidere; quia, cur id
fieret, aut quae ratio esset hominis, nescierunt. Multi ergo ex iis,
quia aeternas esse animas suspicabantur, tamquam in coelum migraturi
essent, sibi ipsis manus intulerunt: ut Cleanthes, ut Chrysippus; ut
Zeno, ut Empedocles, qui se in ardentis Aetnae specum intempesta
nocte dejecit, ut, cum repente non apparuisset, abiisse ad deos
crederetur; et ex Romanis Cato, qui fuit in omni sua vita Socraticae
vanitatis imitator. Nam Democritus in alia fuit persuasione. Sed
tamen Sponte sua letho caput obvius obtulit ipse, quo nihil
sceleratius fieri potest. Nam si homicida nefarius est, quia hominis
extinctor est, eidem sceleri obstrictus est, qui se necat, quia
hominem necat. Imo vero majus esse id facinus existimandum est,
cujus ultio Deo soli subjacet. Nam sicut in hanc vitam non nostra
sponte venimus, ita rursus ex hoc domicilio corporis, quod tuendum
nobis assignatum est, ejusdem jussu recedendum est, qui nos in hoc
corpus induxit, tamdiu habituros, donec jubeat emitti; et si vis
aliqua inferatur, aequa mente id patiendum est, cum extincta
innocentis anima inulta esse non possit, habeamusque judicem magnum,
cui soli vindicta in integro semper est.
Prius disce, quid sit vivere; Indigaris te malis esse subjectum: quasi quidquam merearis boni, qui patrem, qui dominum, qui regem tuum nescis; qui quamvis clarissimam lucem intuearis oculis, mente tamen caecus es, et in profundis ignorantiae tenebris jaces. Quae ignorantia effecit, ut quosdam dicere non puderet, idcirco nos esse natos, ut scelerum poenas lueremus: quo quid delirius dici possit, non video. Ubi enim, vel quae scelera potuimus admittere, qui omnino non fuimus? Nisi forte credemus inepto illi seni, qui se in priori vita Euphorbum fuisse mentitus est. Hic, credo, quod erat ignobili genere natus, familiam sibi ex Homeri carminibus adoptavit. O miram et singularem Pythagorae memoriam! O miseram oblivionem nostrum omnium, qui nesciamus, qui ante fuerimus! Sed fortasse, vel errore aliquo, vel gratia sit effectum, ut ille solus lethaeum gurgitem non attigerit, nec oblivionis aquam gustaverit: videlicet senex vanus (sicut otiosae aniculae solent) fabulas tamquam infantibus credulis finxit. Quod si bene sensisset de iis, quibus haec locutus est, si homines eos existimasset, nunquam sibi tam petulanter mentiendi licentiam vindicasset. Sed deridenda est hominis levissimi vanitas. Quid Ciceroni faciemus? qui cum in principio Consolationis suae dixisset, luendorum scelerum causa nasci homines, iteravit id ipsum postea, quasi objurgans eum, qui vitam non esse poenam putet. Recte ergo praefatus est, errore, ac miserabili veritatis ignorantia se teneri. |
XVII. Après avoir parlé de la philosophie avec toute la brièveté qu'il m'a été possible, je me tourne maintenant du côté des philosophes, à dessein, non de les vaincre, parce qu'ils sont déjà vaincus et hors de combat, mais de les poursuivre après leur défaite. La secte d'Epicure a toujours été plus célèbre que les autres; ce n'est pas qu'elle approche de plus près de la vérité, mais c'est qu'elle attire plus de monde par le nom de la volupté. Comme elle sait qu'il n'y a personne qui ne se porte naturellement au mal, il n'y a aussi personne dont elle n'étudie et ne flatte la mauvaise inclination. Elle exempte les paresseux de l'étude, les avares des libéralités qui se font au peuple, les timides des fonctions publiques, les lâches de l'exercice des armes : elle assure aux impies que les dieux ne se mettent en peine de rien ; elle permet à ceux qui sont attachés à leur intérêt de ne donner jamais rien à personne, et leur enseigne que le sage ne fait rien que pour soi-même ; elle loue la solitude en présence de ceux qui fuient la compagnie. Si elle trouve un auditeur qui soit d'humeur à épargner, elle lui enseigne à ne vivre que de pain et d'eau. Elle raconte les avantages du célibat à ceux qui ont aversion de leurs femmes; elle représente les avantages de l'orbite à ceux qui ont de méchants enfants, et elle dit à ceux qui ont de méchants pères que le lien de la parenté n'est pas un lien dont il faille faire grand état; elle prêche aux impatients et aux délicats, que la douleur est le souverain de tous les maux ; aux fermes et aux généreux, que le sage peut être heureux au milieu des tourments; elle conseille à ceux qui ont de l'ambition et qui aspirent aux dignités de faire leur cour aux princes, et permet à ceux qui sont trop fins pour en souffrir les rebuts, de s'éloigner de la cour. Voilà comment cet homme rusé s'est tourné de tous côtés pour contenter tout le monde, et s'est aussi peu accordé avec lui-même que ceux au goût desquels il tâchait de s'accommoder s'accordaient entre eux. Examinons un peu de plus près l'origine de sa secte et de ses opinions. Il avait remarqué que les gens de bien sont pour l'ordinaire les plus malheureux en ce monde; qu'ils y souffrent la honte et l'incommodité de la pauvreté, l'exil, la perte des personnes qui leur étaient les plus chères ; que les médians au contraire y croissent de jour en jour en crédit et en pouvoir; que l'innocence n'y trouve point de sûreté, au lieu que les crimes y règnent avec insolence; que la mort enlève toute sorte de personnes sans distinction de condition, d'âge ni de mœurs ; qu'elle prend les uns dans le berceau, et qu'elle laisse parvenir les autres jusqu'à une extrême vieillesse; qu'elle arrête les uns dans la fleur et les autres dans la force de leur âge ; que les plus considérables par leur vertu sont le plus souvent vaincus et tués dans les combats. Mais rien ne le touchait si fort que de voir que les personnes de la plus grande piété étaient toujours plus mal traitées que les autres, et que ceux qui négligeaient le culte des dieux ne souffraient aucun dommage, ou n'en souffraient que de fort légers; que les temples mêmes ne sont pas respectés par la foudre : c'est le sujet de la plainte que Lucrèce fait par ces paroles[1] : « Que Jupiter lance le tonnerre sur les temples, et qu'il les réduise en cendres ; c'est où il doit jeter ses traits, qui épargnent souvent les coupables et percent les innocents. » Pour peu qu'il eût entrevu la vérité, il n'aurait jamais dit que Dieu renverse son palais; car il ne le renverse que parce que ce n'est pas le sien. Le Capitole, qui est le principal siège de la religion romaine, a été plusieurs fois brûlé par le feu du ciel. Cicéron a marqué le jugement que les hommes d'esprit portaient sur ces accidents, quand il a dit : que le feu du ciel n'avait réduit en cendres ces temples que pour faire voir que les dieux en demandaient de plus magnifiques et de plus superbes. Dans les livres de son consulat, il a parlé de ce sujet à peu près dans le même sens que Lucrèce, quand il a dit: que Jupiter avait jeté du haut du ciel le feu sur le Capitole. Ceux qui ont entrepris de relever ce temple qui avait été tant de fois abattu par l'ordre du ciel, ont été non seulement assez aveugles pour ne pas reconnaître la grandeur de Dieu, mais encore assez impies pour s'opposer opiniâtrement à ses volontés. Les réflexions que faisait Epicure sur l'injustice qui lui paraissait dans cette conduite (car l'aveuglement où il était l'empêchait d'en juger autrement), lui persuadèrent qu'il n'y avait point de providence. Quand il en fut persuadé, il commença à le publier et à s'engager en des erreurs qu'il est très difficile de démêler; car s'il n'y a point de providence, comment le monde a-t-il été fait dans un si bel ordre et dans une si juste harmonie? « Il n'y a point d'ordre, répond-il, dans le monde: les pièces qui le composent sont hors de leur place, et il y a beaucoup de choses à réduire. » Si j'avais le loisir de réfuter cette réponse, je ferais voir que, bien loin d'être la réponse d'un homme sage, elle ne saurait être que d'un homme qui avait perdu l'usage de la raison. De plus s'il n'y a point de providence, d'où vient la structure si merveilleuse des animaux et les usages si différents de leurs parties? » La providence, réplique Épicure, n'a pris aucun soin de former ces corps, et les membres ne sont estimés à aucun usage; les yeux n'ont point été faits pour voir, ni les oreilles pour ouïr, ni la langue pour parler, ni les pieds pour marcher: tous ces organes étaient faits avant qu'ils fussent propres à aucun de ces usages. » S'il n'y a point de providence, d'où vient que les pluies arrosent la terre, et qu'elles loi font produire une si merveilleuse abondance de toute sorte de fruits? « Ces fruits-là naissent d'eux-mêmes, répond Epicure, ils ne sont point faits en faveur des animaux, et la Providence ne prend aucune part à leur production. » Comment donc est-ce que naissent toutes les choses qui paraissent dans le monde? » Elles ne naissent point, dit Epicure, par l'ordre de la Providence; elles sont produites par le concours fortuit des atomes qui volent dans l'air. » D'où vient que nous ne voyons et nous ne sentons rien de ces atomes ? » C'est qu'ils sont imperceptibles, qu'ils n'ont ni couleur, ni chaleur, ni odeur, ni saveur, et que leur petitesse est si extrême qu'ils ne sont susceptibles d'aucune division. » Voilà les extravagances et les rêveries où le réduit la nécessité de parler conséquemment à un faux principe ; car enfin d'où viennent ces atomes et où sont-ils? Comment personne n'y a-t-il jamais pensé que Leucippe ? de qui les avait reçus Démocrite, qui les a laissés à Epicure comme une succession d'erreur et d'égarement ? Si ce sont des corps solides, comme on nous en assure, ils doivent tomber sous les sens et être visibles? S'ils sont tous de même nature, comment produisent-ils des choses si différentes? C'est, dit-on, qu'ils se mêlent de différentes manières, et forment par ce mélange tous les corps de la nature, de la même sorte que les lettres, qui ne sont pas en grand nombre, fout par leur assemblage un nombre innombrable de mots. Les lettres ont différentes figures; les atomes ont aussi des figures fort différentes, disent les épicuriens; il y en a qui sont rudes, et d'autres qui sont polis; j il y en a qui sont en forme de petits crochets. Ils peuvent donc être coupés et divisés: s'ils sont polis, ils coulent et ne sauraient se joindre les uns aux autres; il faut qu'ils soient faits en forme de crochets, qu'ils s'attachent ensemble comme les chaînons d'une chaîne. Mais s'ils sont si petits qu'ils ne puissent être coupés ni divisés, ils n'ont ni crochets ni angles. S'ils en ont, ils peuvent être coupés et divisés. Je demande encore par quel mouvement ils s'unissent pour former un corps naturel? S'ils n'ont point de sentiment, ils ne peuvent se joindre avec la justesse qui est nécessaire pour composer ces sortes d'ouvrages. Il n'y a que la raison qui puisse rien faire d'aussi raisonnable que cela, et je pourrais apporter un grand nombre d'autres arguments pour réfuter cette extravagance, si je n'avais bâte d'achever cette matière. Voilà cependant quel était cet Epicure qui, au jugement de Lucrèce, N'a pas moins surpassé les autres hommes en esprit, que le soleil surpasse les moindres astres en lumières. J'avoue que je ne saurais m'empêcher de rire quand je lis ces paroles de ce poète, car il ne les a pas dites de Socrate ni de Platon, qui sont respectés comme les princes des philosophes, mais d'un homme qui a eu en pleine santé des rêveries plus extravagantes que n'en ait jamais eu aucun malade. Ce poète ridicule a écrasé un rat en le voulant parer comme un lion. Le même Epicure tâche de nous délivrer de la crainte de la mort par ce raisonnement. Tandis que nous sommes, la mort n'est point, elle n'est que quand nous ne sommes plus ; elle ne nous regarde donc en aucune manière : il y a un moment auquel nous ne sommes plus et auquel la mort n'est pas encore, le moment auquel nous cessons et auquel la mort commence, et c'est ce moment-là qui nous rend misérables! Ce n'est pas sans sujet que l'on a dit que la mort n'est pas un mal, mais que le passage qui mène à la mort en est un. On craint de languir de maladie, d'être consumé par la fièvre, d'être percé par le fer, d'être déchiré par les dents des bêtes, d'être réduit en cendres, non parce que ces choses causent la mort, mais parce qu'elles causent une grande douleur. Il ne suivrait pas de là que ce serait un mal de mourir, il s'ensuivrait que ce serait un mal de sentir de la douleur : « C'est aussi le plus grand de tous les maux, dit Epicure. » Comment donc ne craindrais-je pas la mort, puisque la douleur qui la précède et qui la cause est un mal ? Mais il n'y a rien que de faux dans le raisonnement de ce philosophe, parce que les âmes sont immortelles. » Au contraire, elles sont mortelles, répond Epicure, et tout ce qui commence avec le corps, finit aussi avec lui. » J'ai déjà promis de traiter amplement ce sujet dans le dernier livre de cet ouvrage où je réfuterai, par autorité et par raison, l'erreur de Démocrite et de Dicéarque. Peut-être que ces philosophes se promettaient par cette opinion l'impunité dans leurs crimes ; car ils permettaient les plus infâmes voluptés, et soutenaient que l'homme n'était né que pour en jouir. Peut-on s'abstenir des crimes, quand on est une fois persuadé de ce sentiment? « Si l'âme doit périr, dit-on, recherchons les richesses pour goûter ensuite les plaisirs les plus doux et les plus agréables. Si nous ne pouvons acquérir du bien par des moyens légitimes, volons-en par adresse ou par violence. S'il n'y a point de Dieu qui veille sur nos actions, nous pouvons piller et tuer avec une plus grande licence, et nous assurer de l'impunité. Le sage ne doit point faire de difficulté de se porter au crime, quand il y trouve du profit et de la sûreté. Quand il y aurait un Dieu dans le ciel, il n'entrerait jamais en colère contre personne. Il ne se mettrait en peine ni de punir le vice ni de récompenser la vertu. Ainsi ce serait une aussi grande folie de faire le bien que de s'abstenir du mal. Goûtons les plaisirs, puisque dans peu de temps nous ne serons plus. Ne laissons échapper aucun jour ni aucun moment sans nous divertir, de peur de perdre le temps de la vie, comme nous perdrons bientôt la vie elle-même. » Bien qu'Epicure ne dise pas ceci en propres termes, il le dit dans le fond, quand il assure que le sage n'agit que pour soi et qu'il rapporte tout a son intérêt. Quiconque sera infecté de ces abominables sentiments, ne fera jamais aucun bien, parce que le bien que l'on fait tourne au profit des autres, et ne s'abstiendra d'aucun mal, parce que le mal est suivi de quelque avantage. Un corsaire ou un chef de voleurs qui voudrait les exhorter à piller, leur pourrait-il dire autre chose que ce que dit Epicure : que les dieux ne se soucient de rien; qu'ils sont insensibles à la colère ; qu'ils ne font grâce à personne; que l'âme meurt avec le corps; qu'il n'y a point de peines après cette vie ; que la volupté est le souverain bien; que chacun doit veiller à ses intérêts sans procurer le bien public; que l'on ne doit aimer les autres que par rapport à soi-même; qu'un homme de cœur ne doit craindre ni la douleur ni la mort, et que si on le brûlait tout vif et qu'on lui fit souffrir les plus cruels tourments, il devrait dire qu'il ne s'en soucie point ? Il y a, sans doute, grand sujet de croire que ces sentiments, qui conviennent parfaitement à des voleurs et à des brigands, sont des sentiments d'un homme sage ! XVIII. D'autres philosophes, et principalement les pythagoriciens et les stoïciens, soutiennent au contraire que l'âme survit au corps. Bien qu'il n'y ait rien à reprendre dans leur sentiment, ils ne sont pas néanmoins fort louables d'avoir trouvé la vérité par hasard plutôt que par science ; ils ne sont pas même tout à fait exempts d'erreur. Car, pour éviter la force de l'argument par lequel on conclut de ce que les âmes naissent avec les corps, qu'elles meurent aussi avec eux, ils ont assuré qu'elles ne naissent point avec les corps, mais qu'elles passent de l'un dans l'autre. Ils se sont persuadés qu'il n'était pas possible qu'elles survécussent au corps si elles n'avaient été auparavant. Ils se trompent donc aussi bien que les épicuriens. Mais il y a cette différence que l'erreur des uns regarde le passé, au lieu que celle des autres regarde l'avenir. Aucun d'entre eux n'a vu qu'encore que les âmes naissent, néanmoins elles ne meurent point, et aucun n'a découvert la raison et la différence. Plusieurs de ceux qui ont cru l'âme immortelle, se sont tués eux-mêmes comme s'ils eussent été assurés d'entrer dans le ciel. Cléante, Chrysippe, Zénon et plusieurs autres, en usaient de la sorte. Empédocle se jeta durant la nuit au fond d'une caverne enflammée du mont Etna; et parce qu'il ne parut plus depuis, on a cru qu'il avait été élevé au rang des dieux. Caton, qui avait affecté durant toute sa vie d'imiter la vanité des stoïciens, se tua lui-même. Bien que Démocrite fût dans un autre sentiment, il ne laissa pas de se procurer la mort; ce qui était sans doute la plus méchante action qu'il pût jamais faire. Car si l'homicide est un crime, c'est un homicide de se tuer soi-même, et il est d'autant plus énorme que Dieu s'en réserve le châtiment. Nous ne devons point sortir de nous-mêmes, de cette vie, non plus que nous n'y sommes point entrés de nous-mêmes. Il faut attendre que celui qui nous y a mis nous en retire. Que si l'on nous en chasse par violence, il le faut souffrir avec modération, dans l'assurance que notre mort ne sera pas impunie, et que nous aurons un protecteur qui saura bien la venger. Ainsi ces philosophes, et Caton même, le plus sage des Romains, ont été des homicides. On dit que ce dernier, avant de se plonger le poignard dans le sein, lut le livre de l'Immortalité de l'âme de Platon, et fut excité à ce crime atroce par l'autorité de ce philosophe. Il faut pourtant avouer que la crainte de la servitude semblait lui pouvoir faire souhaiter la mort avec raison. Mais quelle excuse peut-on apporter en faveur de Cléombrote qui, après avoir lu le même livre de Platon, se précipita dans la mer, sans aucun autre dessein que celui d'ajouter pleine et entière créance aux paroles de Platon. Détestable doctrine qui prive les hommes de la vie ! Que si Platon avait su qui est celui qui donne l'immortalité, à qui il la donne, de quelle manière, et en récompense de quelles actions, et qu'il l'eût enseigné aux autres, bien loin de porter ni Cléombrote ni Caton à se procurer volontairement la mort, il leur aurait appris à conserver leur vie et à garder la justice. Il me semble que le motif qui poussa Caton à se tuer, ne fut pas tant d'éviter de tomber entre les mains de César, que de réduire en pratique les maximes des stoïciens, et de rendre son nom célèbre par une action extraordinaire. Quand il serait demeuré en vie, je ne vois pas quel mal il lui en serait arrivé. César était clément de son naturel, et durant la plus grande chaleur de la guerre civile, il ne souhaitait rien avec tant de passion que de faire croire, en conservant Cicéron et Caton, les deux meilleurs citoyens de la république, qu'il l'aimait sincèrement et qu'il ne cherchait que l'occasion de la servir. Mais retournons à ceux qui louent la mort comme un grand bien. Vous vous plaignez de la vie, comme si vous n’en aviez jamais joui et comme si vous n’aviez jamais su la raison pour laquelle vous avez été mis au monde. Le véritable et le père commun de tous les hommes ne peut-il pas vous répondre avec raison en ces termes qui se lisent dans Térence[2] : Si la vie vous déplaît, apprenez premièrement ce que c'est que la vie, et vous ferez ensuite ce qui vous plaira. Vous vous fâchez de ce que vous y souffrez beaucoup de mal, comme si vous ne méritiez aucun bien, vous qui ne connaissez pas votre père, votre maître et votre roi, vous qui ne voyez rien en plein jour, et qui êtes enveloppé des ténèbres épaisses de l'ignorance ; ce qui a fait dire à quelques-uns: que les hommes n'ont été mis sur la terre que pour y souffrir les supplices dus à leurs crimes. Je ne vois rien que l'on puisse jamais avancer de plus extravagant que cela. Quel crime avons-nous pu commettre avant que d'être ? Si ce n'est que nous voulions ajouter foi à l'imprudence avec laquelle cet impertinent vieillard a osé dire qu'il avait vécu dans un autre corps, et qu'il avait été Euphorbe. Je me persuade qu'étant de basse naissance, il a voulu se glisser dans une famille qui avait été rendue illustre par les vers d'Homère. Que Pythagore a été heureux d'avoir si bonne mémoire, et que nous sommes malheureux de l'avoir si mauvaise, que nous ne nous souvenons point de ce que nous avons été ! C'est peut-être par mégarde ou par faveur qu'il s'est seul exempté de boire de l'eau du fleuve de Lethé. Ce vieux fou a inventé des fables semblables à celles que les vieilles content aux enfants. Que s'il avait eu bonne opinion de ceux à qui il parlait, et qu'il les eût pris pour des hommes fort raisonnables, il n'aurait jamais osé leur imposer avec une si horrible impudence. Mais enfin la vanité mérite d'être raillée. Que dirons-nous de Cicéron, qui, après avoir écrit au commencement de la Consolation : que les hommes ont été mis au monde pour y porter la peine due à leurs crimes, l'a encore répété, comme pour reprendre ceux qui ne croiraient pas que la vie de l'homme est toute remplie de misères? il avait eu raison d'avouer dès le commencement qu'il était plongé dans l'erreur et dans une misérable ignorance de la vérité. |
|
CAPUT XIX. Cicero et alii sapientissimi animarum immortalitatem, sed infideliter docent; et quod bona vel mala mors ex ante acta vita sit ponderanda. At illi, qui de mortis bono disputant quia nihil veri sciunt, sic argumentantur: Si nihil est post mortem, non est malum mors; aufert enim sensum mali. Si autem supersunt animae, est etiam bonum, quia immortalitas sequitur. Quam sententiam Cicero de Legibus sic explicavit: « Gratulemurque nobis, quoniam mors aut meliorem, quam qui est in vita, aut certe non deteriorem allatura est statum. Nam sine corpore animo vigente, divina vita est; sensu carente, nihil profecto est mali. » Argute, ut sibi videbatur, quasi nihil esse aliud possit. Atqui utrumque hoc falsum est. Docent enim divinae Litterae, non extingui animas: sed aut pro justitia praemio affici, aut poena pro sceleribus sempiterna. Nec enim fas aut eum qui sceleratus in vita feliciter fuerit, effugere quod meretur; aut eum, qui ob justitiam miserrimus fuerit, sua mercede fraudari. Quod adeo verum est, ut idem Tullius in Consolatione non easdem sedes incolere justos atque impios praedicaverit. Nec enim omnibus, inquit, iidem illi sapientes arbitrati sunt, eumdem cursum in coelum patere: nam vitiis et sceleribus contaminatos deprimi in tenebras, atque in coeno jacere docuerunt; castos autem animos, puros, integros, incorruptos, bonis etiam studiis atque artibus expolitos, levi quodam et facili lapsu ad deos, id est, ad naturam sui similem pervolare. Quae sententia superiori illi argumento repugnat. Illud enim sic assumptum est, tamquam necesse sit, omnem hominem natum immortalitate donari. Quod igitur erit discrimen virtutis, ac sceleris, si nihil interest, utrumne Aristides sit aliquis, an Phalaris? utrum Cato, an Catilina? Sed hanc repugnantiam rerum sententiarumque non cernit, nisi qui tenet veritatem. Si quis igitur nos roget, utrumne bonum sit mors, an malum? respondebimus, qualitatem ejus ex vitae ratione pendere. Nam sicut vita ipsa bonum est, si cum virtute vivatur, malum, si cum scelere: sic et mors ex praeteritis vitae actibus ponderanda est. Ita fit, ut si vita in Dei religione transacta sit, mors malum non sit; quia translatio est ad immortalitatem. Sin autem, malum sit necesse est; quoniam ad aeterna (ut dixi) supplicia transmittit. Quid ergo dicemus, nisi errare illos, qui aut mortem appetunt, tamquam bonum, aut vitam fugiunt, tamquam malum? nisi quod sunt iniquissimi, qui pauciora mala non pensant bonis pluribus. Nam cum omnem vitam per exquisitas et varias traducant voluptates, mori cupiunt, si quid forte his amaritudinis supervenit; et sic habent, tamquam illis nunquam fuerit bene, si aliquando fuerit male. Damnant igitur vitam omnem, plenamque nihil aliud, quam malis opinantur. Hinc nata est inepta illa sententia, hanc esse mortem, quam nos vitam putemus; illam vitam, quam nos pro morte timeamus: ita primum bonum esse, non nasci, secundum citius mori. Quae, ut majoris sit auctoritatis, Sileno attribuitur. Cicero, in Consolatione: « Non nasci, inquit, longe optimum, nec in hos scopulos incidere vitae; Proximum autem, si natus sis, quamprimum mori, tanquam ex incendio effugere violentiam fortunae. » Credidisse illum vanissimo dicto exinde apparet, quod adjecit aliquid de suo, ut ornaret. Quaero igitur, cui esse optimum putet non nasci, cum sit nullus omnino, qui sentiat: nam ut bonum sit aliquid, aut malum, sensus efficit. Deinde, cur omnem vitam nihil aliud esse, quam scopulos, et incendium putaverit; quasi aut in nostra fuerit potestate, ne nasceremur, aut vitam nobis fortuna tribuat, non Deus, aut vivendi ratio quidquam simile incendio habere videatur. Non dissimile Platonis illud est. quod aiebat, se gratias agere naturae: primum, quod homo natus esset potius, quam mutum animal; deinde, quod mas potius, quam foemina; quod Graecus, quam Barbarus; postremo, quod Atheniensis, et quod temporibus Socratis. Dici non potest, quantam mentibus caecitatem, quantosque pariat errores ignoratio veritatis. Ego plane contenderim, numquam quidquam dictum esse in rebus humanis delirius. Quasi vero si aut Barbarus, aut mulier, aut asinus denique natus esset, idem ipse Plato esset, ac non ipsum illud, quod natum fuisset. Sed videlicet Pyhagorae credidit, qui ut vetaret homines animalibus vesci, dixit, animas de corporibus in aliorum animalium corpora commeare: quod et vanum et impossibile est. Vanum, quia necesse non fuit veteres animas in nova corpora inducere, cum idem artifex, qui primas aliquando fecerat, potuerit semper novas facere. Impossibile, quia rectae rationis anima tam immutare naturam status sui non potest, quam ignis aut deorsum niti, aut in transversum, fluminis modo, flammam suam fundere. Existimavit igitur homo sapiens, potuisse fieri, ut anima, quae tunc erat in Platone, in aliquod mutum animal includeretur, essetque humano sensu praedita, ut intelligeret ac doleret incongruenti se corpore oneratam. Quanto sanius faceret, si gratias agere se diceret, quod ingeniosus, quod docilis natus esset, quod in iis opibus, ut liberaliter erudiretur. Nam quod Athenis natus est, quid in eo beneficii fuit? An non plurimi extiterunt in aliis civitatibus excellenti ingenio atque doctrina viri, qui meliores singuli, quam omnes Athenienses fuerunt? Quanta hominum millia fuisse credamus, qui et Athenis nati, et temporibus Socratis, indocti tamen, ac stulti fuerunt? Non enim aut parietes, aut locus in quo quisque est effusus ex utero conciliat homini sapientiam. Quid vero attinuit Socratis se temporibus natum gratulari? Num Socrates ingenia discentibus potuit commodare? Non venit in mentem Platoni Alcibiadem quoque et Critiam ejusdem Socratis assiduos auditores fuisse; quorum alter hostis patriae acerrimus fuit, alter crudelissimus omnium tyrannorum. CAPUT XX. Socrates aliis prudentior fuit in philosophia, quamvis in multis desipuerit. Videamus nunc, quid in Socrate ipso tam magnum fuerit, ut homo sapiens merito gratias ageret, illius se temporibus esse natum. Non inficior fuisse illum paulo cordatiorem, quam caeteros, qui naturam rerum putaverunt ingenio posse comprehendi. In quo illos non excordes tantum fuisse arbitror, sed etiam impios; quod in secreta coelestis illius providentiae curiosos oculos voluerint immittere. Romae, et in plerisque urbibus scimus esse quaedam sacra, quae aspici a viris nefas habeatur. Abstinent igitur aspectu, quibus contaminare illa non licet: et si forte, vel errore, vel casu quopiam vir aspexerit, primo poena ejus, deinde instauratione sacrificii, scelus expiatur. Quid his facias, qui inconcessa scrutari volunt? Nimirum multo sceleratiores, qui arcana mundi, et hoc coeleste templum profanare impiis disputationibus quaerunt, quam qui aedem Vestae, aut Bonae Deae, aut Cereris intraverint. Quae penetralia quamvis adire viris non liceat, tamen a viris fabricata sunt. Hi vero non tantum impietatis crimen effugiunt: sed, quod est multo indignius, eloquentiae famam, et ingenii gloriam consequuntur. Quid, si aliquid investigare possent? Sunt enim tam stulti in asseverando. quam improbi in quaerendo; cum neque invenire quidquam possint, nec defendere, etiamsi invenerint. Nam si verum vel fortuito viderint, quod saepius contingit, committunt, ut ab aliis id pro falso refellatur. Non enim descendit aliquis de coelo, qui sententiam de singulorum opinionibus ferat: quapropter nemo dubitaverit, eos, qui ista conquirant, stultos, ineptos, insanos esse. Aliquid ergo Socrates habuit cordis humani, qui cum intelligeret haec non posse inveniri, ab ejusmodi quaestionibus se removit; vereorque ne in eo solo. Multa enim sunt ejus non modo laude indigna, sed etiam reprehensione dignissima, in quibus fuit suorum simillimus. Ex his unum eligam, quod ab omnibus sit probatum. Celebre hoc proverbium Socrates habuit: « Quod supra nos, nihil ad nos. » Procumbamus igitur in terram, et manus nobis ad praeclara opera datas convertamus in pedes. Nihil ad nos coelum, ad cujus contemplationem sumus excitati; nihil denique lux ipsa pertineat: certe victus nostri causa de coelo est. Quod si hoc sensit, non esse de rebus coelestibus disputandum, ne illorum quidem rationem poterat comprehendere, quae sub pedibus habebat. Quid ergo? num erravit in verbis? Verisimile non est: sed nimirum id sensit, quod locutus est, religioni minime serviendum: quod si aperte diceret, nemo pateretur. Quis enim non sentiat, hunc mundum tam mirabili ratione perfectum, aliqua providentia gubernari? quandoquidem nihil est, quod possit sine ullo moderatore consistere. Sic domus ab habitatore deserta dilabitur; navis sine gubernatore abit pessum; et corpus, relictum ab anima, diffluit: nedum putemus, tantam illam molem aut construi sine artifice, aut stare tamdiu sine rectore potuisse. Quod si publicas illas reli-giones voluit evertere, non improbo, quin etiam laudabo, si ipse quod est melius invenerit. Verum idem per canem et anserem dejerabat. O hominem scurram (ut ait Zeno epicureus) ineptum, perditum, desperatum, si cavillari voluit religionem; dementem, si hoc serio fecit, ut animal turpissimum pro Deo haberet! Quis jam superstitiones Aegyptiorum audeat reprehendere, quas Socrates Athenis auctoritate confirmavit sua? Illud vero nonne summae vanitatis, quod ante mortem familiares suos rogavit, ut Aesculapio gallum, quem voverat, pro se sacrarent? Timuit videlicet, ne apud Rhadamanthum reciperatorem voti reus fieret ab Aesculapio. Dementissimum hominem putarem, si morbo affectus periisset. Cum vero hoc sanus fecerit, est ipse insanus, qui eum putat fuisse sapientem. En, cujus temporibus natum esse se homo sapiens gratulatur. |
XIX. Ceux qui disputent sur le sujet de la mort ne sachant rien de la vérité, raisonnent de cette sorte : s'il n'y a rien après la mort, et pas même de sentiment, la mort n'est point un mal ; que si l'âme vit après la mort du corps, la mort est un bien, et elle est suivie de l'immortalité. Cicéron a expliqué ce sentiment en ces termes : « Nous devons nous réjouir de ce que l'état où nous met la mort est plus heureux, ou au moins aussi heureux que celui de la vie présente. Car si l'âme conserve le sentiment après la perte du corps, elle mène une vie semblable à celle des dieux : si au contraire elle n'a point de sentiment, elle est exempte de mal. » Il a cru raisonner fort subtilement, et que le dilemme qu'il proposait était fort juste. Cependant il ne contient rien que de faux ; car l'Écriture sainte nous enseigne que l'âme est immortelle, et qu'elle reçoit une récompense ou une punition éternelle, n'étant pas juste que les crimes qui ont été heureux sur la terre demeurent impunis, ni que les vertus qui ont été persécutées soient privées de la couronne qu'elles méritent. Cette vérité est si constante, que Cicéron a reconnu dans le livre de la Consolation que les bons et les médians n'habiteront pas le même lieu en l'autre monde. « Ces hommes, si éminents en sagesse, dit-il, n'ont pas été persuadés que le chemin du ciel fût ouvert à tout le monde. Ils ont enseigné au contraire que ceux qui seraient souillés de crimes seraient plongés dans un bourbeux limon et couverts d'épaisses ténèbres; au lieu que ceux qui auraient conservé leur pureté, qui auraient évité la corruption, et qui se seraient adonnés aux sciences et aux arts, s'élèveraient par un vol léger jusqu'au sein des dieux. Il est certain que ce dernier sentiment ne se peut accorder avec le dilemme qu'il avait proposé auparavant; car il supposait que toutes les âmes sont immortelles de la même manière, et il ne mettait aucune différence entre Aristide et Phalaris, entre Caton et Catilina. Nul ne peut s'apercevoir de la contradiction de ces sentiments, s'il n'est pleinement instruit de la vérité. S'il se trouvait donc quelqu'un qui nous demandât si la mort est un bien ou un mal, nous lui répondrions : que la qualité de la mort dépend de celle de la vie. Comme la vie est un bien quand elle se conforme à la vertu, et un mal quand elle est pleine de crimes, on doit faire le même jugement de la mort qui suit l'une et l'autre. La mort qui termine une vie qui a été employée au service de Dieu est un bien, parce que ce n'est qu'un passage à l'immortalité; celle qui termine une vie criminelle est un mal, parce qu'elle commence un supplice qui n'a point de fin. Il est donc clair que ceux-là se trompent, qui souhaitent la mort comme un bien, ou qui évitent la vie comme un mal ; et qu'ils n'ont pas assez d'équité pour peser dans une juste balance les biens et les maux qui leur arrivent. Après avoir joui de toute sorte de plaisirs, ils souhaitent la mort dès qu'il leur survient la moindre disgrâce, et la moindre adversité leur fait oublier toute leur prospérité passée. Ils soutiennent qu'il n'y a que du mal à souffrir dans le monde; et c'est de là qu'est venue l'extravagante opinion de ceux qui prétendent que ce que nous prenons pour la vie est une mort, et que ce que nous prenons pour la mort est une vie; et que le premier et le plus grand avantage que nous aurions pu avoir aurait été de n'être jamais venus au monde, et le second d'en être sortis aussitôt que nous y sommes venus. On l'attribue à Silène pour lui donner quelque poids. Voici comment en parle Cicéron, dans le livre de la Consolation. « Le plus grand avantage, dit-il, qui nous pût arriver était de ne point naître et de ne point tomber dans les écueils de cette vie. Le second était de mourir promptement, et d'échapper à la violence de la fortune comme à un funeste embrasement. » Les ornements qu'il a recherchés pour embellir cette pensée font voir qu'elle lui a paru véritable. Je lui demanderai volontiers: à qui c'est un avantage que de ne point naître, puisque avant que de naître, il n'y a aucun sentiment? C'est le sentiment qui fait trouver ou de l'avantage ou du désavantage en quoi que ce soit, le lui demanderai encore : pourquoi il compare la vie à un embrasement et à un écueil? Dépendait-il de nous de la recevoir? Est-ce de la fortune et non de Dieu que nous l'avons reçue? Enfin, quel rapport peut-elle avoir avec un embrasement ? Platon disait quelque chose de semblable, quand il rendait grâce à la nature de ce qu'elle l'avait fait naître raisonnable plutôt que bête, homme plutôt que femme, Grec plutôt que barbare, et enfin de ce qu'elle l'avait rendu citoyen d'Athènes et contemporain de Socrate. On ne saurait dire jusqu'où va l'égarement d'un esprit qui s'est une fois éloigné de la vérité. Pour moi je soutiens qu'il n'y eut jamais rien de si extravagant que cette parole de Platon. S'il était né ou barbare ou femme ou âne, il n'aurait pas été Platon. Il ajoutait peut-être foi aux rêveries de Pythagore, qui défendait de manger de la chair des animaux, et qui enseignait que les âmes pussent dans des corps de diverses espèces, ce qui n'est ni nécessaire ni possible. Cela n'est point nécessaire, parce que celui qui a créé les âmes peut en créer de nouvelles à mesure que de nouveaux corps se forment. Cela n'est pas non plus possible, et une âme raisonnable ne saurait changer de nature, et tendre en bas comme l'eau. Ce célèbre philosophe s'est imaginé que l'âme qui animait son corps pouvait passer dans celui d'une bête, et qu'y conservant l'intelligence et la raison, elle s'y pourrait plaindre d'être si indignement loger. N'aurait-il pas mieux fait de dire qu'il remerciait la nature de ce qu'il avait de l'esprit, de la docilité pour apprendre, ou bien pour se faire instruire ? Car quel avantage était-ce d'être né dans Athènes plutôt que dans une autre ville? N'y a-t-il pas eu dans d'autres villes des hommes qui ont excellé en esprit et en science, et dont un seul a surpassé tous les Athéniens en mérite? Combien y a-t-il eu d'Athéniens au temps de Socrate qui n'ont été que des ignorants et des insensés ! Le lieu de la naissance ne contribue en rien à la sagesse. Le temps n'y contribue pas davantage, et il n'y avait pas sujet de se vanter d'être venu dans celui de Socrate. Ce philosophe donnait-il de l'esprit à ceux qui n'en avaient point? Platon avait-il oublié qu'Alcibiade et Critias ont été des plus fidèles disciples de Socrate, et que cependant l'un a déclaré la guerre à sa patrie, et l'autre a opprimé la liberté de ses concitoyens ? XX. Voyons maintenant ce qu'il y avait dans Socrate de si rare et de si extraordinaire, qu'un homme sage eût sujet de se tenir fort obligé à la nature de ce qu'elle l'avait fait naître en son temps. J'avoue qu'il a été plus sage que ceux qui ont entrepris de pénétrer par la lumière de leur esprit les secrets de la nature. Il n'y avait pas moins d'impiété que d'imprudence dans la curiosité avec laquelle ils avaient sonde l'abime impénétrable de la Providence. On sait qu'à Rome ou ailleurs il y a des mystères où il est défendu aux hommes d'assister. Ils s'en abstiennent très religieusement ; et si quelqu'un y jette les yeux par imprudence ou par hasard, on le punit, et on recommence la célébration du mystère. Que faut-il faire de ceux qui veulent apprendre ce qu'il ne leur est pas permis de savoir? Ceux qui entreprennent de découvrir les secrets de la nature et qui profanent le temple de l'univers par l'impiété de leurs disputes, sont sans doute plus coupables que ceux qui entrent dans les temples de Vesta de la Bonne Déesse ou de Cérès. Ces temples-là, qui sont fermés aux hommes, ont été bâtis par des hommes. Cependant ces philosophes, bien loin d'être condamnés comme des impies quand ils cherchent, par une présomptueuse curiosité, ce qu'il y a de plus caché dans les ouvrages de Dieu se mettent en crédit, et font admirer leur esprit et leur éloquence. Ils seraient peut-être excusables si leur travail leur apportait quelque fruit. Mais ils sont aussi malheureux dans le succès, qu'ils ont été téméraires dans l'entreprise. Ils ne trouvent point la vérité ; et quand ils l'auraient trouvée, ils ne la pourraient défendre. Quand, par hasard, ils la découvrent, ils souffrent qu'elle soit combattue par les autres. Car personne ne descend du ciel pour terminer leurs différends et pour juger quelle est la plus véritable de leurs opinions. C'est pourquoi personne ne saurait nier que leur occupation ne soit vaine, ridicule et inepte. Socrate a été fort prudent de s'abstenir de ces questions inutiles; mais j'ai peur qu'il ne l'ait été qu'en ce point-là seulement. En d'autres, il a ressemblé aux autres philosophes, et bien loin de mériter des louanges, il n'a mérité que du blâme. Parmi ce qu'il a jamais dit de plus remarquable, je choisirai un mot qui a eu une approbation générale. « Ce qui est au-dessus de nous, a-t-il dit, ne nous regarde point. » Couchons-nous donc sur la terre, et marchons sur les mains qui nous ont été données pour faire de si merveilleux ouvrages. Ne songeons ni au ciel que nous devrions toujours regarder, ni à la lumière qui nous éclaire. S'il a cru ne devoir agiter aucune question touchant la nature du ciel, il n'a pas mieux connu ce qui était sous ses pieds. Est-ce qu'il s'est mal expliqué? Il n'y a point d'apparence. Il est probable qu'il a cru qu'il ne faut pas suivre la religion du peuple. Mais il n'a osé le publier, de peur de soulever tout le monde. Car qui ne sait que l'univers, qui a été créé par une sagesse si merveilleuse, est gouverné par une providence? On voit que rien ne peut subsister que par les soins d'une intelligence; une maison qui n'est ni habitée ni entretenue, tombe en ruines; un vaisseau qui n'est pas conduit par un bon pilote, flotte au gré des vents ; un corps qui n'a plus d'âme, se corrompt et se réduit en cendres: pourrait-on s'imaginer qu'une si vaste machine pût avoir été faite et se conserver d'elle-même? Si Socrate s'était contenté de combattre la religion reçue par le peuple, bien loin d'y trouver à redire, je me louerais d'avoir trouvé quelque chose de meilleur. Mais il jurait par un chien et par une oie. Oh! l'impertinent, l'insensé et le désespéré, comme dit Zénon l'épicurien, s'il a eu intention de se railler de la religion! mais l'extravagant et l'insensé, s'il a pris sérieusement un vilain animal pour un dieu! Pourra-t-on reprendre les superstitions des Égyptiens depuis que Socrate les a autorisées dans Athènes par son approbation et par son suffrage? Peut-on s'imaginer une prière plus ridicule que celle qu'il fit à ses amis avant de mourir, de sacrifier à Esculape un coq qu'il lui aurait promis? Il appréhendait sans doute d'être accusé par Esculape devant Rhadamanthe d'avoir manqué d'accomplir son vœu. S'il était mort de maladie j'aurais cru qu'il en aurait eu l'esprit affaibli. Mais puisqu'il a fait, et qu'il a dit en pleine santé ce que je rapporte, ce serait une folie de se persuader qu'il ait jamais été fort sage. Voilà cependant ce personnage, au temps duquel Platon se tenait fort heureux d'être venu au monde. |
|
CAPUT XXI. De Platonis doctrina, quae respublicas destrueret. Videamus tamen, quid illum Socrates docuerit, qui cum totam Physicam repudiasset, eo se contulit, ut de virtute atque officio quaereret. Itaque non dubito, quin auditores suos justitiae praeceptis erudierit. Docente igitur Socrate, non fugit Platonem, justitiae vim in aequitate consistere; siquidem omnes pari conditione nascuntur. Ergo nihil (inquit) privati ac proprii habeant: sed ut pares esse possint, quod justitiae ratio desiderat, omnia in commune possideant. Ferri hoc potest, quamdiu de pecunia dici videtur. Quod ipsum quam impossibile sit, et quam injustum, poteram multis rebus ostendere. Concedamus tamen, ut possit fieri. Omnes enim sapientes erunt, et pecuniam contemnent. Quo ergo illum communitas ista perduxit? Matrimonia quoque inquit, communia esse debebunt: scilicet ut ad eamdem mulierem multi viri, tamquam canes confluant; et is utique obtineat, qui viribus vicerit: aut si patientes sunt, ut philosophi, expectent, ut vicibus, tamquam lupanar obeant. O miram Platonis aequitatem! Ubi est igitur virtus castitatis? ubi fides conjugalis? quae si tollas, omnis justitia sublata est. At idem dixit, beatas civitates futuras fuisse, si aut philosophi regnarent, aut reges philosopharentur. Huic vero tam justo, tam aequo viro regnum dares, qui aliis abstulisset sua, aliis condonasset aliena; prostituisset pudicitiam foeminarum: quae nullus unquam non modo rex, sed ne tyrannus quidem fecit. Quam vero intulit rationem turpissimi hujus consilii? Sic inquit: Civitas concors erit, et amoris mutui constricta vinculis, si omnes omnium fuerint et mariti, et patres, et uxores, et liberi. Quae ista confusio generis humani est! Quomodo servari potest caritas, ubi nihil est certum quod ametur? Quis aut vir mulierem, aut mulier virum diliget, nisi hahitaverint semper una, nisi devota mens, et servata invicem fides individuam fecerit charitatem? quae virtus in illa promiscua voluptate locum non habet. Item si omnes omnium liberi sint, quis amare liberos tamquam suos poterit, cum suos esse aut ignoret, aut dubitet? quis honorem tamquam patri deferet, cum unde natus sit nesciat? Ex quo fit, ut non tantum alienum pro patre habeat, sed etiam patrem pro alieno. Quid, quod uxor potest esse communis, filius non potest, quem concipi non nisi ex uno necesse est. Perit ergo illi uni communitas, ipsa reclamante natura. Superest, ut tantummodo concordiae causa uxores velit esse communes. At nulla vehementior discordiarum causa est, quam unius foeminae a multis maribus appetitio. In quo Plato, si ratione non potuit, exemplis certe potuit admoneri, et mutorum animalium, quae ob hoc vel acerrime pugnant, et hominum, qui semper ob eam rem gravissima inter se bella gesserunt. CAPUT XXII De Platonis praeceptis, iisdemque reprehensis. Restat ut communio ista nihil aliud habeat, praeter adulteria, et libidines; propter quas funditus eruendas, virtus est vel maxime necessaria. Itaque non invenit concordiam, quam quaerebat; quia non videbat, unde oriatur. Nam justitia in extrapositis nihil momenti habet, ne in corpore quidem: sed tota in hominis mente versatur. Qui ergo vult homines adaequare, non matrimonia, non opes subtrahere debet; sed arrogantiam, superbiam, tumorem, ut illi potentes et elati pares esse se etiam mendicissimis sciant. Detracta enim divitibus insolentia et iniquitate, nihil intererit utrumne alii divites, alii pauperes sint, cum animi pares fuerint; quod efficere nulla res alia praeter religionem Dei potest. Putavit igitur se invenisse justitiam, cum eam prorsus everterit; quia non rerum fragilium, sed mentium debet esset communitas. Nam si justitia virtutum omnium mater est, cum illae singulae tolluntur, ipsa subvertitur. Tulit autem Plato ante omnia frugalitatem: quae utique nulla est, ubi proprii nihil habeatur. Tulit abstinentiam: siquidem nihil fuerit, quod abstineatur, alienum. Tulit temperantiam, tulit castitatem; quae virtutes in utroque sexu maximae sunt. Tulit verecundiam, pudorem, modestiam, si honesta et legitima esse incipiunt, quae solent flagitiosa et turpia judicari. Sic virtutem dum vult omnibus dare, omnibus adimit. Nam rerum proprietas, et vitiorum, et virtutum materiam continet: communitas autem nihil aliud, quam vitiorum licentiam. Nam viri, qui multas mulieres habent, nihil aliud dici possunt, quam luxuriosi ac nepotes. Item mulieres, quae a multis habentur, non utique adulterae, quia certum matrimonium nullum est, sed prostitutae ac meretrices sint necesse est. Redegit ergo humanam vitam ad similitudinem, non dicam mutorum, sed pecudum ac belluarum. Nam volucres pene omnes faciunt matrimonia, et paria junguntur, et nidos suos tamquam geniales toros concordi mente defendunt; et foetus suos, quia certi sunt, amant; et si alienos objeceris, abigunt. At homo sapiens contra morem hominum, contraque naturam, stultiora sibi, quae imitaretur, elegit. Et quoniam videbat in caeteris animalibus officia marium foeminarumque non esse divisa, existimavit oportere etiam mulieres militare, et consiliis publicis interesse, et magistratus gerere, et imperia suscipere. Itaque his arma et equos assignavit: consequens est, ut lanam et telam viris, et infantium gestationes. Nec vidit impossibilia esse, quae diceret; ex eo quod adhuc in orbe terrae, neque tam stulta, neque tam vana ulla gens extiterit; quae hoc modo viveret. |
XXI. Voyons ce que Platon a appris de Socrate, qui avait renoncé à la physique pour s'adonner tout entier à la morale. Je ne doute point qu'il n'ait fort bien traité des devoirs de la vie, et qu'il n'ait donné à ses disciples de fort bons préceptes de vertu et de justice; Platon lui aura sans doute oui dire que la justice consiste dans l'égalité, et qu'il n'y a aucune différence entre les hommes par le droit de leur naissance. « Pour être parfaitement égaux, dit-il, comme la justice le désire, ils ne possèdent rien en particulier. » S'il ne parle en cet endroit que de l'argent, cela se peut en quelque sorte tolérer. Il me serait pourtant aisé de faire voir que cela n'est ni juste ni faisable; mais supposant que cela est faisable, et que tous les hommes auront assez de sagesse pour mépriser l'argent et pour se mettre au-dessus de l'intérêt, suivons, pour voir jusqu'où sera la communauté qu'il veut introduire. Elle ira jusqu'au mariage. Plusieurs hommes s'assembleront comme des chiens autour d'une femme. Le plus fort en jouira, ou s'ils sont sages, et modérés comme des philosophes, ils attendront leur rang selon la police des lieux de débauche. Oh! la merveilleuse justice de Platon ! où est donc la continence? où est la fidélité des mariages? Sans elle il n'y a plus d'équité ni de justice. Le même Platon a dit que les États seraient heureux lorsqu'ils seraient gouvernés par des philosophes, et lorsque ceux qui les gouverneraient s'adonneraient à l'étude de la philosophie. Il fallait donner un royaume à un homme si juste et si équitable, qui avait ôté le bien à quelques-uns pour le donner à d'autres, et qui avait entrepris de prostituer toutes les femmes, ce que jamais aucun roi ni aucun tyran n'avait fait. Quelle raison a-t-il apportée pour faire recevoir un si infâme projet ? « Les citoyens, a-t-il dit, vivront dans une plus parfaite intelligence, et seront unis ensemble par le lien d'une plus étroite amitié, quand les hommes seront maris de toutes les femmes et pères de tous les enfants. » Quelle étrange confusion ! Une amitié qui n'a point d'objet certain peut-elle être fort grande? Comment un homme et une femme s'aimeront-ils s'ils n'ont point été longtemps ensemble et s'ils ne se sont point gardés une fidélité réciproque? Quelle vertu se peut trouver avec la licence effrénée de se divertir indifféremment comme l'on veut ? Si les enfants sont communs, qui les pourra aimer, ne sachant pas s'il en est le père, ou ayant au moins sujet d'en douter? Comment un enfant honorera-t-il son père qu'il ne connaît pas? Il prendra un étranger pour son père, et son père pour un étranger. De plus, les femmes peuvent être communes, mais les enfants ne le sauraient être. La nature s'oppose à l'établissement de cette extravagante communauté. Il ne reste plus aucun prétexte de la maintenir, si ce n'est celui d'une parfaite intelligence. Il est certain qu'il n'y a point de plus grand sujet de différends et de querelles, que l'inclination que plusieurs hommes ont pour une femme. Si Platon n'a pu écouter la raison, il a pu voir les exemples, et des bêtes qui se battent, et des hommes qui livrent souvent de sanglantes guerres pour ce sujet. XXII. Cette communauté n'était autre chose qu'une confusion monstrueuse de débauches et d'adultères, qui ne pouvait être réparée que par la vertu. Platon n'avait garde de trouver la bonne intelligence qu'il cherchait, parce qu'il ne s'apercevait pas qu'elle ne procède que de la justice, qui réside non dans les choses extérieures, ni même dans le corps, mais dans le cœur. Quiconque veut établir une parfaite égalité entre les hommes, doit leur ôter non leurs femmes ni leurs richesses, mais leur orgueil et leur arrogance. Quand les riches seront dépouillés de l'injustice et de l'insolence, il n'y aura plus aucune différence entre eux et les pauvres, et ils seront tous égaux par une disposition d'esprit, que la seule religion peut donner. Platon a ruiné la justice, dans le temps même qu'il se flattait de l'avoir trouvée, parce qu'il n'a pas reconnu que la véritable communauté consiste non à posséder en commun des choses périssables, mais à n'avoir qu'un esprit et qu'un cœur. La justice est la mère des autres vertus; elle ne saurait subsister quand on les a ôtées toutes. Or, Platon les a toutes ôtées. Il a ôté la frugalité, parce qu'il n'y a point de frugalité lorsque personne n'a rien qui lui soit propre. Il a ôté l'abstinence, parce que l'on ne s'abstient que du bien d'autrui, et qu'il n'y a plus de bien d'autrui quand tout est commun. Il a ôté la continence et la chasteté, vertus qui sont de très grand usage et qui font le principal ornement des deux sexes. Il a ôté la pudeur et la modestie, en permettant comme honnêtes et légitimes des actions qui avaient toujours paru infâmes et criminelles ; ainsi en voulant donner la vertu à tout le monde, il l'a ôtée à tout le monde. La propriété et le domaine renferment la matière des vices et des vertus, au lieu que la communauté de biens donne la licence de s'abandonner à toutes sortes de crimes. Les hommes qui ont plusieurs femmes ne peuvent passer que pour des débauchés et pour des perdus. Les femmes qui ont plusieurs maris ne sont pas des adultères parce qu'elles n'ont jamais contracté de mariage, mais ce sont des prostituées. Il a donc réduit la vie des hommes à la condition de celle des bêtes les plus basses elles plus méprisables ; car les oiseaux s'accouplent avec quelque sorte de fidélité. Le mâle et la femelle ont leur nid qu'ils gardent en commun, où ils élèvent leurs petits ; ils les aiment parce qu'ils sont assurés qu'ils sont à eux, et ils enchâssent les autres. Cet homme sage a choisi pour modèle ce qu'il y avait de plus extravagant, de plus contraire à la nature et à la coutume. Ayant vu que les mâles et les femelles n'ont point de fonctions séparées parmi les bêtes, il a jugé que les hommes et les femmes n'en devaient point avoir, et que les femmes devaient manier les armes, entrer dans les conseils, exercer les charges, posséder la souveraine puissance. Il fallait qu'il mît entre les mains des hommes le fil et la laine, et qu'il les obligeât à porter les enfants entre leurs bras. Je m'étonne qu'il ne se soit pas aperçu que ces projets-là ne pouvaient être réduits en pratique, et qu'il n'y a jamais eu de nation qui se soit avisé de se conduire par une police si extravagante. |
|
CAPUT XXIII. De erroribus quorumdam philosophorum, deque sole et luna. Cum igitur in tanta vanitate ipsi philosophorum principes deprehendantur, quid illos minores putabimus, qui numquam sibi tam sapientes videri solent, quam cum pecuniae contemptu gloriantur? Fortis animus. Sed expecto quid faciant, et quo ille contemptus evadat. Tradita sibi a parentibus patrimonia tamquam malum fugiunt, ac deserunt. Et ne in tempestate naufragium faciant, in tranquillo se ultro praecipitant, non virtute, sed perverso metu fortes; sicut illi, qui, cum timent ne ab hoste jugulentur, ipsi se jugulant, ut mortem morte devitent. Sic isti, unde possent gloriam liberalitatis acquirere, sine honore, sine gratia perdunt. Laudatur Democritus, quod agros suos reliquerit, eosque pascua publica fieri passus sit. Probarem, si donasset. Nihil autem sapienter fit, quod si ab omnibus fiat, inutile est ac malum. Sed haec negligentia tolerabilis. Quid ille, qui patrimonium in nummos redactum effudit in mare? Ego dubito utrumne sanus, an demens fuerit. Abite, inquit, in profundum, malae cupiditates; ego vos mergam, ne ipse mergar a vobis. Si tantus pecuniae contemptus est, fac illam beneficium, fac humanitatem, largire pauperibus: potest hoc, quod perditurus es, multis succurrere, ne fame, aut siti, aut nuditate moriantur. Imitare insaniam saltem furoremque Tuditani; sparge populo diripienda. Potes et pecuniam effugere, et tamen bene collocare; quia salvum est quidquid pluribus profuit. Zenonis autem paria peccata quis probat? Sed omittamus id, quod est ab omnibus semper irrisum. Illud satis est ad coarguendum furiosi hominis errorem, quod inter vitia et morbos misericordiam ponit. Adimit nobis affectum, quo ratio humanae vitae pene omnis continetur. Cum enim natura hominis imbecillior sit quam caeterorum animalium, quae vel ad perferendam vim temporum, vel ad incursiones a suis corporibus arcendas, naturalibus munimentis providentia coelestis armavit: homini autem quia nihil istorum datum est, accepit pro istis omnibus miserationis affectum, qui plane vocatur humanitas, qua nosmet invicem tueremur. Nam si homo ad conspectum alterius hominis efferaretur, quod facere videmus animantes quarum natura solivaga est, nulla esset hominum societas, nulla urbium condendarum vel cura, vel ratio. Sic neque vita quidem satis tuta, cum et caeteris animalibus exposita esset imbecillitas hominum, et ipsi inter semetipsos belluarum more saevirent. Non minor in aliis dementia. Quid enim dici potest de illo, qui nigram dixit esse nivem? quam consequens erat, ut etiam picem albam esse diceret! Hic est ille, qui se idcirco natum esse dicebat, ut coelum ac solem videret, qui in terra nihil videbat sole lucente. Xenophanes dicentibus Mathematicis orbem lunae duodeviginti partibus majorem esse, quam terram, stultissime credidit; et quod huic levitati fuit consentaneum, dixit, intra concavum lunae sinum esse aliam terram, et ibi aliud genus hominum simili modo vivere, quo nos in hac terra vivimus. Habent igitur illi lunatici homines alteram lunam, quae illis nocturnum lumen exhibeat, sicut haec exhibet nobis. Et fortasse noster hic orbis alterius inferioris terrae luna sit. Fuisse Seneca inter Stoicos ait, qui deliberaret utrumne Soli quoque suos populos daret: inepte scilicet, qui dubitaverit. Quid enim perderet, si dedisset? Sed, credo, calor deterrebat, ne tantam multitudinem periculo committeret; ne si aestu nimio periissent, ipsius culpa evenisse tanta calamitas diceretur. CAPUT XXIV. De antipodibus, de coelo ac sideribus. Quid illi, qui esse contrarios vestigiis nostris Antipodas putant, num aliquid loquuntur? aut est quisquam tam ineptus, qui credat esse homines, quorum vestigia sint superiora, quam capita? aut ibi, quae apud nos jacent, inversa pendere? fruges et arbores deorsum versus crescere? pluvias, et nives, et grandinem sursum versus cadere in terram? Et miratur aliquis, hortos pensiles inter septem mira narrari, cum philosophi et agros, et maria, et urbes, et montes pensiles faciant? Hujus quoque erroris aperienda nobis origo est. Nam semper eodem modo falluntur. Cum enim falsum aliquid in principio sumpserint, veri similitudine inducti, necesse est eos in ea, quae consequuntur, incurrere. Sic incidunt in multa ridicula; quia necesse est falsa esse, quae rebus falsis congruunt. Cum autem primis habuerint fidem, qualia sint ea, quae sequuntur, non circumspiciunt, sed defendunt omni modo; cum debeant prima illa, utrumne vera sint, an falsa, ex consequentibus judicare.
Quae igitur illos ad Antipodas ratio
perduxit? Videbant siderum cursus in occasum meantium; solem atque
lunam in eamdem partem semper occidere, atque oriri semper ab eadem.
Cum autem non perspicerent, quae machinatio cursus eorum temperaret,
nec quomodo ab occasu ad orientem remearent, coelum autem ipsum in
omnes partes putarent esse devexum, quod sic videri, propter
immensam latitudinem necesse est: existimaverunt, rotundum esse
mundum sicut pilam, et ex motu siderum opinati sunt coelum volvi,
sic astra solemque, cum occiderint, volubilitate ipsa mundi ad ortum
referri. Itaque et aereos orbes fabricati sunt, quasi ad figuram
mundi, eosque caelarunt portentosis quibusdam simulacris, quae astra
esse dicerent. Hanc igitur coeli rotunditatem illud sequebatur, ut
terra in medio sinu ejus esset inclusa. Quod si ita esset, etiam
ipsam terram globo similem; neque enim fieri posset, ut non esset
rotundum, quod rotundo conclusum teneretur. Si autem rotunda etiam
terra esset, necesse esse, ut in omnes coeli partes eamdem faciem
gerat, id est montes erigat, campos tendat, maria consternat. Quod
si esset, etiam sequebatur illud extremum, ut nulla sit pars terrae,
quae non ab hominibus caeterisque animalibus incolatur. Sic pendulos
istos Antipodas coeli rotunditas adinvenit. |
XXIII. Après que les plus célèbres philosophes ont été convaincus de soutenir des opinions vaines et ridicules, que doit-on attendre des autres qui sont beaucoup au-dessous d'eux, et qui ne s'imaginent jamais être arrivés à un si haut point de sagesse, que quand ils se vantent de mépriser les richesses? C'est sans doute une grande force d'esprit. Mais voyons où elle se termine. Ils renoncent à la succession de leurs pères, comme si c'était un mal de la posséder. Ils se précipitent dans la mer durant le calme, de peur de faire naufrage pendant la tempête. Leur force ne vient que de la crainte, au lieu de venir du courage. Ils ressemblent à ceux qui se tuent, pour n'être pas tués par l'ennemi, et qui ne trouvent point d'autre moyen d'éviter la mort que de se la procurer. En pensant faire estimer leur libéralité, ils perdent leur bien sans honneur et sans mérite. On loue Démocrite d'avoir abandonné ses terres: je le louerais plutôt s'il les avait données. Il n'y a point de sagesse à faire une action, qui deviendrait inutile ou même mauvaise si elle était faite par tout le monde. Supposons néanmoins que cette négligence puisse être excusée, que dirons-nous de celui qui, ayant vendu son bien, en jeta le prix dans la mer? Je doute qu'il fût sage. « Allez, dit-il, au fond de la mer, malheureuse cupidité; je vous perdrai de peur que vous ne me perdiez moi-même. » Si vous méprisez si fort votre bien, faites-en un bon usage et l'employez au soulagement des pauvres. Ce que vous voulez perdre peut servir à empêcher que plusieurs ne meurent de faim, de soif ou de nudité. Imitez au moins l'extravagance et la fureur de Tuditanus. Jetez votre argent au peuple, c'est un moyen de vous en délivrer et de ne le pas perdre. Qui pourrait approuver l'égalité que Zénon a prétendu mettre entre les péchés? Ne disons rien de cette ineptie dont tout le monde s'est toujours moqué. Pour le convaincre d'erreur et de folie, c'est assez de dire qu'il a mis la compassion au nombre des vices et des maladies. Il nous ôte de la sorte une affection d'où dépendent les principaux devoirs de la vie. L'homme étant né plus faible que les animaux, que la Providence a munis et armés contre les injures de l'air et des saisons et contre les violences qui leur peuvent venir de dehors, il n'a pour toute défense que la tendresse et l'humanité avec laquelle nous nous secourons les uns les autres. Si l'homme entrait en fureur à la vue d'un autre homme, comme font les bêtes farouches, il n'y aurait plus de société, plus de villes, plus de sûreté; nous serions exposés à la rage des bêtes, et nous n'exercerions pas moins de cruautés les uns contre les autres que les bêtes mêmes. Les autres philosophes n'ont point été moins extravagants. Quel jugement peut-on faire de celui qui a dit que la neige était noire? Il fallait qu'il dît ensuite que la poix était blanche. C'est celui-là même qui disait qu'il était né pour regarder le ciel et le soleil, et qui ne voyait rien sur la terre en plein midi. Xénophane fut assez simple pour croire ce que les mathématiciens lui disaient : que la lune était vingt et une fois plus grande que la terre. Il ajouta que dans le creux de la lune il y a une terre habitée comme la nôtre. Les hommes de cette terre-la ont donc aussi une autre lune qui les éclaire durant la nuit ; et peut-être que le globe que nous habitons est la lune d'une autre terre. Sénèque témoigne que, parmi les stoïciens, il s'est trouvé un philosophe qui doutait s'il donnerait des hommes au soleil. Quelle raison avait-il de douter, puisqu'il ne pouvait rien perdre en les donnant? Mais il appréhendait peut-être de les exposer au péril d'être brûlés, et il ne voulait pas être la cause d'un si funeste incendie. XXIV. Ceux qui tiennent qu'il y a des antipodes, tiennent-ils un sentiment raisonnable? Y a-t-il quelqu'un assez extravagant pour se persuader qu'il y ait des hommes qui aient les pieds en haut et la tête en bas; que tout ce qui est couché en ce pays-ci, soit suspendu en celui-là ; que les herbes et les arbres y croissent en descendant, et que la pluie et la grêle y tombent en montant? Faut-il s'étonner que l'on ait mis les jardins suspendus de Babylone au nombre des merveilles de la nature, puisque les philosophes suspendent aussi des mers, des villes et des montagnes? Cherchons la source de cette erreur, et nous trouverons sans doute qu'elle procède de la même cause que les autres. Quand les philosophes, trompés par l'ombre de la vraisemblance, ont une fois admis un faux principe, il faut qu'ils admettent aussi les conséquences qui s'en tirent. Ils tombent de fausseté en fausseté; ils embrassent indiscrètement la première, et au lieu d'examiner la seconde qui se présente, ils la soutiennent par toute sorte de moyens, au lieu de juger de la première par la seconde. Comment donc se sont-ils engagés à soutenir qu'il y a des antipodes? En observant le mouvement et le cours des astres, ils ont remarqué que le soleil et la lune se couchent toujours du même côté et se lèvent toujours de même. Mais ne pouvant découvrir l'ordre de leur marche, ni deviner comment ils passaient de l’Occident à l'Orient, ils se sont imaginé que le ciel était rond, tel que sa vaste étendue le fait paraître; que le monde même était rond comme une boule, que le ciel tournai t continuellement, et qu'en tournant il ramenait le soleil et les astres de l'Occident à l'Orient. C'est ce qui les a portés à faire des globes d'airain, sur lesquels ils ont gravé des figures monstrueuses auxquelles ils ont donné le nom d'astres. Le ciel étant rond, il fallait que la terre, qui est renfermée dans son étendue, fût aussi ronde. Que si elle est ronde, elle regarde le ciel de tous côtés de la même manière, et lui oppose de tous côtés des mers, des plaines et des montagnes. Il suit encore de là qu'il n'y a aucune partie qui ne soit habitée. Voilà comment la rondeur que l'on a attribuée au ciel a donné occasion d'inventer les antipodes. Quand l'on demande à ceux qui défendent ces opinions monstrueuses, comment il se peut faire, que ce qui est sur la terre ne tombe pas vers le ciel, ils répondent : que c'est parce que les corps pesants tendent toujours vers le milieu comme les rayons d'une roue, et que les corps légers, comme les nuées, la fumée, le feu, s'élèvent en l'air. J'avoue que je ne sais ce que je dois dire de ces personnes qui demeurent opiniâtres dans leurs erreurs, et qui soutiennent leurs extravagances, si ce n'est que quand ils disputent, ils n'ont point d'autre dessein que de se divertir ou de faire paraître leur esprit. Il me serait aisé de prouver, par des arguments invincibles, qu'il est impossible que le ciel soit au-dessous de la terre. Mais je suis obligé de finir ce livre-ci, ce que je ne saurais faire pourtant sans y ajouter auparavant quelques matières de grande importance. Comme on ne peut réfuter les erreurs de tous les philosophes, je me contenterai d'en avoir représenté quelques-unes par lesquelles on jugera des autres. |
|
CAPUT XXV. De addiscenda philosophia; et quanta ad ejus studium sint necessaria. Nunc pauca nobis de philosophia in commune dicenda sunt, ut confirmata causa peroremus. Summus ille noster Platonis imitator existimavit philosophiam non esse vulgarem, quod eam non nisi docti homines assequi possint. « Est, inquit Cicero, philosophia paucis contenta judicibus, multitudinem consulto ipsa fugiens. » Non est ergo sapientia, si ab hominum coetu abhorret: quoniam si sapientia homini data est, sine ullo discrimine omnibus data est, ut nemo sit prorsus, qui eam capere non possit. At illi virtutem humano generi datam sic amplexantur, ut soli omnium publico bono frui velle videantur, tam invidi, quam si velint deligare oculos aut effodere caeteris, ne solem videant. Nam quid est aliud hominibus negare sapientiam, quam mentibus eorum verum ac divinum lumen auferre? Quod si natura hominis sapientiae capax est, oportuit et opifices, et rusticos, et mulieres, et omnes denique, qui humanam formam gerunt, doceri, ut sapiant; populumque ex omni lingua, et conditione, et sexu, et aetate conflari. Maximum itaque argumentum est, philosophiam neque ad sapientiam tendere, neque ipsam esse sapientiam, quod mysterium ejus barba tantum celebratur et pallio. Senserunt hoc adeo Stoici, qui et servis, et mulieribus philosophandum esse dixerunt; Epicurus quoque, qui rudes omnium litterarum ad philosophiam invitat; item Plato, qui civitatem de sapientibus voluit componere. Conati quidem illi sunt facere, quod veritas exigebat: sed non potuit ultra verba procedi. Primum, quia multis artibus opus est, ut ad philosophiam possit accedi. Discendae istae communes litterae propter usum legendi, quia in tanta rerum varietate, nec disci audiendo possunt omnia, nec memoria contineri. Grammaticis quoque non parum operae dandum est, ut rectam loquendi rationem scias. Id multos annos auferat necesse est. Nec oratoria quidem ignoranda est; ut ea, quae didiceris, proferre atque eloqui possis. Geometria quoque, ac musica, et astrologia necessaria est, quod hae artes cum philosophia habent aliquam societatem: quae universa perdiscere neque foeminae possunt, quibus intra puberes annos officia mox usibus domesticis profutura discenda sunt neque servi, quibus per eos annos vel maxime serviendum est, quibus possunt discere; neque pauperes, aut opifices, aut rustici, quibus in diem victus labore est quaerendus. Ob eam causam Tullius ait abhorrere a multitudine philosophiam. At enim rudes Epicurus accipiet. Quomodo ergo illa, quae de principiis rerum dicuntur, intelligunt, quae perplexa et involuta vix etiam politi homines assequuntur? In rebus igitur obscuritate implicitis, et ingeniorum varietate confusis, et eloquentium virorum exquisito sermone fucatis, quis imperito ac rudi locus est? Denique nullas unquam mulieres philosophari docuerunt, praeter unam ex omni memoria Themisten; neque servos, praeter unum Phaedonem, quem male servientem redemisse ac docuisse Cebetem tradunt. Enumerant etiam Platonem, ac Diogenem; qui tamen servi non fuerunt: sed his servitus evenerat; sunt enim capti. Platonem quidem redemisse Anniceris quidam traditur sestertiis octo. Itaque insectatus est conviciis hunc ipsum redemptorem Seneca, quod parvo Platonem aestimaverit. Furiosus, ut mihi videtur, qui homini fuerit iratus, quod non multam pecuniam perdidit: scilicet aurum appendere debuit, tamquam pro mortuo Hectore, aut tantum ingerere nummorum, quantum venditor non poposcit. Ex Barbaris vero nullum, praeter unum Anacharsim Scytham, qui philosophiam ne somniasset quidem, nisi et linguam, et litteras ante didicisset. CAPUT XXVI. Sapientiam sola doctrina coelestis largitur; et quam sit efficax lex Dei. Quod ergo illi poscente natura faciendum esse senserunt, sed tamen neque ipsi facere potuerunt, neque a philosophis fieri posse viderunt, sola haec efficit doctrina coelestis; quia sola sapientia est. Illi scilicet persuadere cuiquam poterunt, qui nihil persuadent etiam sibi? aut cujusquam cupiditates oppriment, iram temperabunt, libidinem coercebunt, cum ipsi et cedant vitiis, et fateantur, plus valere naturam? Dei autem praecepta, quia et simplicia, et vera sunt, quantum valeant in animis hominum, quotidiana experimenta demonstrant. Da mihi virum, qui sit iracundus, maledicus, effraenatus: paucissimis Dei verbis: Tam placidum, quam ovem, reddam. Da cupidum, avarum, tenacem: jam tibi eum liberalem dabo, et pecuniam suam plenis manibus largientem. Da timidum doloris ac mortis: jam cruces, et ignes, et taurum contemnet. Da libidinosum, adulterum, ganeonem: jam sobrium, castum, continentem videbis. Da crudelem et sanguinis appetentem: jam in veram clementiam furor ille mutabitur. Da injustum, insipientem, peccatorem: continuo et aequus, et prudens, et innocens erit. Uno enim lavacro malitia omnis abolebitur. Tanta divinae sapientiae vis est, ut in hominis pectus infusa, matrem delictorum stultitiam uno semel impetu expellat: ad quod efficiendum, non mercede, non libris, non lucubrationibus opus est. Gratis ista fiunt, facile, cito; modo pateant aures, et pectus sapientiam sitiat. Nemo vereatur: nos aquam non vendimus, nec solem mercede praestamus. Dei fons uberrimus atque plenissimus patet cunctis: et hoc coeleste lumen universis oritur, quicumque oculos habent. Num quis haec philosophorum aut unquam praestitit, aut praestare, si velit, potest? Qui cum aetates suas in studio philosophiae conterant, neque alium quemquam, neque seipsos (si natura paululum obstitit) possunt facere meliores. Itaque sapientia eorum, ut plurimum efficiat, non excidit vitia, sed abscondit. Pauca vero Dei praecepta sic totum hominem immutant, et exposito vetere novum reddunt, ut non cognoscas eumdem esse. |
XXV. Il ne me reste plus qu'à dire quelque chose de la philosophie en général avant de finir ce livre. Le grand imitateur de Platon a écrit : que la philosophie n'était pas commune et qu'il n'y avait que les savants qui pussent y aspirer. La philosophie est donc distinguée de la sagesse, qui doit être commune à tous les hommes. Ces philosophes se rendent propre un bien qui est donné indifféremment à tout le monde, et ils sont animés d'une si maligne jalousie, qu'ils voudraient pouvoir bander ou arracher les yeux aux autres, de peur qu'ils ne voient le soleil. Les priver de la sagesse n'est rien moins qu'éteindre en eux une lumière divine. La nature humaine étant capable de sagesse, toutes sortes de personnes, les paysans, les artisans, les femmes, les enfants et les vieillards, enfin tous les peuples, de quelque langue et de quelque pays que ce soit, la devraient apprendre. Le mystère que l'on fait de la philosophie, bien qu'il ne consiste le plus souvent qu'à porter une longue barbe et un manteau, est une preuve convaincante que la philosophie n'est ni la sagesse ni le moyen de l'acquérir. Cette vérité a été reconnue par les stoïciens qui ordonnaient aux femmes et aux esclaves de s'adonner à la philosophie, par Epicure qui exhortait les plus ignorants à l'étude, par Platon qui avait jeté dans son esprit le plan d'une ville qui n'aurait été composée que de sages. Leur projet était fort louable; mais il est demeuré sans exécution. Il est aussi fort difficile de parvenir à la connaissance de la philosophie. Il faut premièrement apprendre à lire pour pouvoir voir les livres, parce qu'on ne saurait recevoir de vive voix une si prodigieuse variété de préceptes, ni en conserver la mémoire. Il faut donner ensuite beaucoup de temps à la grammaire pour apprendre à parler. Il n'est pas permis d'ignorer la rhétorique, parce que sans elle on ne saurait exprimer ses pensées avec élégance. La géométrie, la musique et l'astrologie sont nécessaires à cause de l'étroite liaison qu'elles ont avec la philosophie. Or tous ces arts ne peuvent être appris ni par les filles, qui sont obligées d'apprendre durant leur jeunesse quantité de choses nécessaires pour l'usage de la maison, ni par les esclaves, qui sont employés à servir dans le temps qu'il faudrait donner à l'étude, ni par les pauvres, par les artisans et les gens de la campagne qui travaillent tout le jour pour gagner leur vie. Voilà pourquoi Cicéron a dit : que la philosophie fuit la multitude. Si Epicure reçoit les plus ignorants dans son école, comment leur fera-t-il entendre ce qu'il enseigne touchant les principes, et qui est si difficile et si obscur, qu'à peine peut-il être compris par les plus habiles ? Que peut faire un esprit qui n'a aucune teinture des lettres dans une matière épineuse d'elle-même, et qui a été encore embrouillée par la malice des philosophes qui l'ont traitée et déguisée par l'artifice des orateurs qui en ont parlé? Enfin les philosophes n'ont jamais enseigné la philosophie qu'à une seule femme, savoir à Thémiste, et à un seul esclave, savoir à Phédon, qui, comme il servait mal son maître, fut acheté et instruit par Cébès. On met aussi de ce nombre-là Platon et Diogène, bien, qu'ils fussent nés libres et qu'ils eussent été pris. On dit que Platon fut racheté de huit sesterces par Anicéris. Sénèque lui dit des injures d'avoir mis à si bas prix un si excellent philosophe. Mais il me semble qu'il y a de la fureur à se fâcher contre un homme de ce qu'il n'a pas prodigué son bien mal à propos. Il devait donner une aussi grande quantité d'or que celle que Priam donna pour le corps d'Hector, ou compter plus de pièces d'argent qu'il n'en demandait. Entre tous les étrangers ils n'ont enseigné la philosophie qu'à Anacharsis, Scythe de nature, qui ne l'aurait jamais pu apprendre s'il n'avait su auparavant la langue grecque et la grammaire. XXVI. La doctrine du ciel qui contient la véritable sagesse fait toute seule ce que les philosophes ont jugé qu'il fallait faire, bien qu'ils ne le pussent faire, et qu'ils crussent qu'il ne pouvait être fait par les autres. Comment ceux qui ne sont persuadés de rien pourraient-ils persuader quelque chose ? Comment ceux qui obéissent à leurs passions, qui confessent qu'elles ont plus de force que leur raison, pourraient-ils réprimer celles des autres, modérer l'ardeur de leurs désirs et apaiser les mouvements de leur colère ? L'expérience fait voir au contraire la grandeur du pouvoir que les commandements de Dieu, qui sont simples et véritables, exercent sur l'esprit des hommes. Donnez-m'en un qui soit sujet à la colère et accoutumé à de grands emportements, je le rendrai aussi doux qu'un mouton dès que je lui aurai dit quelques paroles du Sauveur. Donnez-m'en un qui soit avare et insatiable, je le rendrai libéral, et je lui ferai donner son argent à pleines mains. Donnez-m'en un qui soit délicat, et qui n'appréhende rien tant que la douleur et la mort, je lui ferai mépriser les tourments, les feux, et le taureau de Phalaris. Donnez-m'en un qui soit débauché, je le rendrai sobre et tempérant. Donnez-m'en un qui soit cruel et qui aime à répandre le sang, je changerai toute sa fureur en humanité. Enfin donnez-m'en un qui soit injuste, déréglé et criminel, je le ferai devenir tout d'un coup équitable, réglé et innocent. Il ne faut qu'un peu d'eau pour effacer tous les crimes. La sagesse de Dieu agit avec une puissance si efficace, que dès qu'elle entre dans un cœur elle en chasse toute la folie. On ne demande rien en récompense : cela se fait gratuitement et en un instant. Que personne n'appréhende d'approcher de nous. Nous ne vendons ni l'eau ni le soleil. La fontaine de Dieu est ouverte, et sa lumière éclaire tous ceux qui ont des yeux. Y a-t-il jamais eu, ou y a-t-il maintenant un philosophe qui en puisse faire autant ? Ils consument toute leur vie à l'étude, et ne rendent pas leurs disciples meilleurs, ni ne le deviennent pas eux-mêmes, pour peu que l'inclination que les uns et les autres ont au mal résiste aux préceptes. Tout l'effet que l'on peut attendre de leur sagesse, c'est qu’elle cache les vices au lieu de les arracher. Les commandements de Dieu apportent au contraire un changement si surprenant qu'ils détruisent le vieil homme pour former le nouveau. |
|
CAPUT XXVII. Quam parum philosophorum praecepta conferant ad veram sapientiam, quam in sola religione invenies.
Quid ergo? nihilne illi simile
praecipiunt? Imo permulta; et ad verum frequenter accedunt. Sed
nihil ponderis habent illa praecepta, quia sunt humana, et
auctoritate majori, id est divina illa, carent. Nemo igitur credit;
quia tam se hominem putat esse, qui audit, quam est ille, qui
praecipit. Praeterea nihil apud eos certi est, nihil quod a scientia
veniat. Sed cum omnia conjecturis agantur, multa etiam diversa et
varia proferantur, stultissimi est hominis, praeceptis eorum velle
parere, quae utrum vera sint, an falsa, dubitatur; et ideo nemo
paret, quia nemo vult ad incertum laborare. Virtutem esse Stoici
aiunt, quae sola efficiat vitam beatam. Nihil potest verius dici.
Sed quid, si cruciabitur aut dolore afficietur? Poteritne quisquam
inter carnifices beatus esse? Imo vero illatus corpori dolor materia
virtutis est: itaque ne in tormentis quidem miser est. Epicurus
multo fortius. Sapiens, inquit, semper beatus est; et vel inclusus
in Phalaridis tauro hanc vocem emittet: « Suave est, et nihil curo.
» Quis eum non irriserit? Maxime, quod homo voluptarius personam
sibi viri fortis imposuit, et quidem supra modum, non enim fieri
potest, ut quisquam cruciatus corporis pro voluptatibus ducat, cum
satis sit, ad officium virtutis implendum, perferre ac sustinere.
Quid dicitis Stoici? Quid tu Epicure? Beatus est sapiens, etiam cum
torquetur. Si propter gloriam patientiae; non fruetur; in tormentis
enim fortasse morietur. Si propter memoriam; aut non sentiet, si
occidunt animae, aut si sentiet, nihil ex ea consequetur. Quae sese a coeli regionibus ostentabat. Haec causa est, cur praeceptis eorum nullus obtemperet: quoniam aut ad vitia erudiunt, si voluptatem defendunt; aut si virtutem asserunt, neque peccato poenam minantur, nisi solius turpitudinis, neque virtuti ullum praemium pollicentur, nisi solius honestatis et laudis, cum dicant, non propter seipsam expetendam esse virtutem. Beatus est igitur sapiens in tormentis: sed cum torquetur pro fide, pro justitia, pro Deo, illa patientia doloris beatissimum faciet. Est enim Deus, qui solus potest honorare virtutem; cujus merces immortalitas sola est: quam qui non appetunt, nec religionem tenent, cui aeterna subjacet vita, profecto neque virtutis vim sciunt, cujus praemium ignorant; neque in coelum spectant, quod ipsi se facere putant, cum res non vestigabiles quaerunt, quia ratio in coelum spectandi nulla alia est, nisi aut religionem suscipere, aut animam suam immortalem esse credere. Quisquis enim aut Deum colendum esse intelligit, aut immortalitatis spem sibi propositam habet, mens ejus in coelo est; et licet id non aspiciat oculis, animae tamen lumine aspicit. Qui autem religionem non suscipiunt, terreni sunt; qui religio de coelo est, et qui animam putant cum corpore interire, aeque in terram spectant, quia ultra corpus quod est terra, nihil amplius vident, quod sit immortale. Nihil igitur prodest hominem ita esse fictum, ut recto corpore spectet in coelum; nisi erecta mente Deum cernat, et cogitatio ejus in spe vitae perpetuae tota versetur. CAPUT XXVIII. De vera religione, deque natura; fortuna num sit dea; et de philosophia. Quapropter nihil aliud est in vita, quo ratio, quo conditio nostra nitatur, nisi Dei, qui nos genuit, agnitio et religiosus ac pius cultus: unde quoniam philosophi aberraverunt, sapientes utique non fuerunt. Quaesierunt illi quidem sapientiam: sed quia non rite quaerebant, prolapsi sunt longius; et in tantos errores inciderunt, ut etiam communem sapientiam non tenerent. Non enim tantum religionem asserere noluerunt: verum etiam sustulerunt; dum specie falsae virtutis inducti, conantur animos omni metu liberare: quae religionis eversio naturae nomen invenit. Illi enim, cum aut ignorarent, a quo esset effectus mundus, aut persuadere vellent, nihil esse divina mente perfectum, naturam esse dixerunt rerum omnium matrem, quasi dicerent, omnia sua sponte esse nata: quo verbo plane imprudentiam suam confitentur. Natura enim, remota providentia et potestate divina, prorsus nihil est. Quod si Deum naturam vocent, quae perversitas est, naturam potius quam Deum nominare? Si autem natura ratio est, vel necessitas, vel conditio nascendi, non est per seipsam sensibilis: sed necesse est mentem esse divinam, quae sua providentia nascendi principium rebus omnibus praebeat. Aut si natura est coelum atque terra, et omne, quod natum est, non est Deus natura, sed Dei opus.
Non dissimili errore credunt esse
fortunam, quasi deam quamdam res humanas variis casibus illudentem;
quia nesciunt, unde sibi bona, et mala eveniant. Cum hac se
compositos ad praeliandum putant; nec ullam tamen rationem reddunt,
a quo et quam ob causam: sed tantum cum fortuna se digladiari
momentis omnibus gloriantur. Jam quicumque aliquos consolati sunt ob
interitum amissionemque charorum, fortunae nomen acerrimis
accusationibus prosciderunt; nec omnino ulla eorum disputatio de
virtute est, in qua non fortuna vexetur. M. Tullius in sua
Consolatione pugnasse se semper contra fortunam loquitur, eamque a
se esse superatam, cum fortiter inimicorum impetus retudisset; ne
tum quidem se ab ea fractum, cum domo pulsus patria caruit: tum
autem, cum amiserit charissimam filiam, victum se a fortuna turpiter
confitetur. Cedo, inquit, et manum tollo. Quid hoc homine miserius,
qui sic jaceat? Insipienter, inquit: sed qui profitetur se esse
sapientem. Quid ergo sibi vult assumptio nominis? Quid contemptus
ille rerum, qui magnificis verbis praetenditur? Quid dispar caeteris
habitus? Aut cur omnino praecepta sapientiae datis, si nemo, qui
sapiat, adhuc inventus est? Et quisquam nobis invidiam facit, quia
philosophos negamus esse sapientes? cum ipsi nec scire se quidquam,
nec sapere fateantur. Nam si quando ita defecerint, ut ne affingere
quidem quidquam possint, quod faciunt in rebus caeteris: tum vero
ignorantiae admonentur, et quasi furibundi exiliunt, et exclamant se
caecos esse et excordes. Anaxagoras pronuntiat circumfusa esse
tenebris omnia. Empedocles angustas esse sensuum semitas queritur,
tamquam illi ad cogitandum rheda et quadrigis opus esset. Democritus
quasi in puteo quodam sic alto, ut fundus sit nullus, veritatem
jacere demersam; nimirum stulte, ut caetera. Non enim tamquam in
puteo demersa veritas est, quo vel descendere, vel etiam cadere illi
licebat, sed tamquam in summo montis excelsi vertice, vel potius in
coelo, quod est verissimum. Quid enim est, cur eam potius in imum
depressam diceret, quam in summum levatam? nisi forte mentem quoque
in pedibus, aut in imis calcibus constituere malebat potius, quam in
pectore, aut in capite. |
XXVII. Les philosophes ne donnent-ils point de semblables préceptes ? Ils en donnent en grand nombre, et ils approchent souvent de la vérité. Mais ces préceptes-là n'ont aucun poids, parce qu'ils ne procèdent que d'une autorité humaine. Personne ne les reçoit avec respect parce que ceux qui les écoutent sont de même nature et de même condition que ceux qui les font. De plus, il n'y a rien de certain ni de constant dans ce que disent les philosophes. Ils n'ont souvent que des conjectures, et on trouve une merveilleuse diversité dans ce qu'ils avancent. Ce serait donc une folie de suivre des préceptes, de la vérité et de la justice desquels on a sujet de douter. Personne n'y défère, parce que personne ne veut travailler en vain. Les stoïciens assurent qu'il n'y a que la vertu qui rende la vie heureuse. Il n'y a rien de si vrai. Mais si un homme avec sa vertu souffre de la douleur, sera-t-il heureux au milieu des tourments et entre les mains des bourreaux ? La douleur ne servira qu'à éprouver sa constance ; et quoi qu'il souffre, il sera toujours fort heureux! Epicure va plus loin. « Le sage, dit-il, est toujours heureux, et si on l'avait enfoncé dans le taureau de Phalaris, il dirait : je m'y trouve bien et j'y suis content. » Qui pourrait voir sans rire qu'un homme adonné à ses plaisirs contrefasse de la sorte l'homme de cœur, et qu'il porte la générosité plus loin qu'elle ne peut aller? Personne ne trouve de plaisir dans la douleur, c'est assez de la supporter avec constance. Que prétendez-vous, stoïciens et Epicure, quand vous dites que le sage est heureux dans les tourments? Si c'est la réputation d'avoir méprisé les tourments qui le rende heureux, peut-être qu'il mourra par l'excès de la douleur, et qu'il ne jouira pas du fruit de sa patience. Si c'est la mémoire que la postérité en conservera, il n'en saura rien s'il n'y a aucun sentiment après la mort, ou s'il y en a quelqu'un, il ne lui servira de rien de le savoir. Quelle sera donc la récompense de la vertu, et quel bonheur possédera-t-il ? Il en mourra plus content. Voilà une belle récompense qui ne dure qu'une heure, ou peut-être qu'un moment, et pour laquelle il faudrait nous rendre misérables durant toute notre vie? La mort n'emporte pas beaucoup de temps. Quand son heure est venue, il importe peu que l’on soit content de la recevoir, ou que l'on ne le soit pas. Ainsi on ne peut attendre aucune autre récompense de la vertu, que la gloire de l'avoir pratiquée. Mais cette gloire est souvent fort inutile. Souvent elle se dissipe et s'évanouit en un instant, et elle dépend quelquefois du mauvais jugement des hommes, auquel il ne faut avoir aucun égard. Il n'y a donc aucun fruit à recueillir d'une vie très faible et périssable, et ceux qui ont été dans ce sentiment, au lieu de voir la vertu, n'ont vu que son ombre. Ils sont demeurés attachés à la terre, au lieu de lever les yeux au ciel où la vertu paraît comme sur un trône. C'est pour cela qu'il s'est trouvé si peu de monde qui ait déféré à leurs préceptes. Car quand ils soutiennent la volupté, ils excitent au vice, et quand ils entreprennent la défense de la vertu, ils ne s'en acquittent que très faiblement, parce qu'ils ne proposent point d'autre châtiment au vice que le déshonneur, d'autre récompense à la vertu que la louange, en disant qu'elle ne doit être recherchée que pour elle-même. Le sage est donc heureux au milieu des tourments, mais c'est quand il souffre pour le service de Dieu, pour la défense de la foi et de la justice. Il n'y a que Dieu qui puisse honorer la vertu, parce qu'il n'y a que lui qui lui puisse donner l'immortalité, qui est la seule récompense qui soit digne d'elle. Ceux qui ne désirent pas cette immortalité ne sont pas dans la véritable religion, qui tend à la vie éternelle comme à sa fin. Ils ne connaissent ni la valeur de la vertu ni la récompense qu'elle mérite. Ils ne regardent pas le ciel quoiqu'ils croient le regarder quand ils y cherchent ce qu'ils n'y sauraient trouver, parce qu'il n'y a point d'autre raison de regarder le ciel que pour embrasser la religion qui en est venue, ou pour espérer l'immortalité qui nous est promise. Quiconque songe sérieusement au service qu'il doit à Dieu, et à l'immortalité qu'il espère, regarde le ciel par les yeux de l'esprit, bien qu'il ne le regarde peut-être pas par les yeux du corps. Ceux qui n'embrassent pas la religion qui est, comme je l'ai dit, descendue du ciel, demeurent attachés à la terre. Ceux qui croient que l'âme meurt avec le corps, rampent sur la terre de la même sorte, et ne voient rien au delà du corps qui n'est lui-même qu'un amas de terre. Il ne sert de rien à l'homme d'avoir la taille droite et de regarder le ciel, s'il ne songe à Dieu et s'il n'a une ferme espérance de posséder la vie éternelle. XXVIII. L'unique devoir auquel toute notre vie se doit rapporter, est de connaître le Dieu qui nous a mis au monde et de le servir. Les philosophes ne sont jamais parvenus à la sagesse, parce qu'ils se sont éloignés de cette fin pour laquelle ils avaient été créés. Il est vrai qu'ils ont cherché la sagesse ; mais loin de la trouver, ils sont tombés en des erreurs très grossières. Ils ont aboli toute sorte de religion, lorsque, trompés par une fausse image de vertu, ils ont tâché de délivrer les esprits de crainte. Ils ont couvert ce renversement de religion du spécieux nom de Nature. Car comme ils ne savaient pas que Dieu a fait le monde ni aucun autre ouvrage, ils en ont attribué la production à la Nature, ce qui est la même chose que s'ils avaient dit que toutes choses sont nées d'elles-mêmes ; en quoi il est certain qu'ils ont fait voir une extrême imprudence; car la Nature n'est rien d'elle-même, si on la sépare de la providence et de la puissance divine. Que si par le nom de Nature ils n'entendent que Dieu, quel étrange renversement de langage? que si par le mot de Nature ils entendent ou la manière et la nécessité de la naissance, ou les conditions auxquelles nous venons au monde, ils n'entendent rien de sensible ni de palpable, et il n'y a en effet que la providence de Dieu qui préside à la naissance de toutes choses. Que s'ils donnent le nom de Nature au ciel et à la terre, la Nature sera l'ouvrage de Dieu, et non pas Dieu même. Ils sont tombés dans une erreur semblable touchant la Fortune ; car ne sachant d'où leur venaient ni les biens ni les maux, ils ont inventé une déesse qui se joue du sort des hommes. Ils se vantent d'être tous les jours aux mains avec elle, bien qu'ils ne sachent qui les a engagés dans ce combat, ni quel est le sujet de leur différend. Tous ceux qui ont entrepris de consoler ceux qui étaient affligés de la perte de leurs proches ont fait de sanglantes invectives contre la Fortune, et jamais ils n'ont relevé le mérite de la vertu, qu'ils ne la lui aient opposé comme la plus irréconciliable ennemie. Cicéron publie qu'il a toujours combattu la Fortune, qu'il l'a vaincue lorsqu'il a ruiné les entreprises des ennemis, et qu'il n'a pas été vaincu lorsqu'il a été chassé de sa maison et de son pays. Mais il avoue lâchement qu'il en a été vaincu, lorsqu'il a perdu sa chère fille. « Je me rends, dit-il, et je pose les armes. » Y a-t-il rien de si misérable qu'un homme qui se soumet de la sorte : il avoue que c'est une folie, mais il soutient en même temps que tout le monde n'est pas sage. Pourquoi donc en prend-on le nom? Pourquoi cherche-t-on des termes si magnifiques pour exprimer le mépris des grandeurs du monde? Pourquoi affecte-t-on un habit différent de celui des autres? Enfin pourquoi donne-t-on ces préceptes de sagesse, si jamais personne n'a été sage? On ne doit pas tâcher de nous rendre odieux, sous prétexte que nous nions que les philosophes soient parvenus à la sagesse puisqu'ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne savent rien. Quand ils se trouvent embarrassés, et qu'ils ne peuvent rendre raison des matières qu'ils traitent, ils s'écrient comme des furieux, qu'ils sont des ignorants et des aveugles. Anaxagore déclare que toute la nature est couverte de ténèbres. Empédocle se plaint que la voie du sens est étroite, comme si pour penser il avait besoin d'un chemin fort large, d'un char superbe, et d'un équipage magnifique. Démocrite dit que la vérité est cachée au fond d'un puits ; mais il le dit avec la même impertinence avec laquelle il dit tout le reste. Elle n'est pas au fond d'un puits où il avait pu descendre ou se jeter; mais elle est sur le sommet d'une montagne, ou plutôt elle est dans le ciel. Pourquoi ne disait-il pas qu'elle était en haut au lieu de dire qu'elle était en bas, si ce n'est qu'il avait l'esprit aux pieds au lieu de l'avoir au cœur ou à la tête ? Les philosophes ont été si éloignés de trouver la vérité, qu'ils n'ont pu reconnaître par la structure et par la disposition de leur corps le lieu où il fallait l'aller chercher. Le désespoir et la tyrannie ont arraché cette confession de la bouche de Socrate : qu'il ne savait qu'une chose, qui est qu'il ne savait rien. C'est de là qu'est venue la secte et la discipline des académiciens, si toutefois on peut donner le nom de discipline à une secte où l'on fait profession de ne rien enseigner et de ne rien apprendre. Ceux mêmes qui ont prétendu savoir quelque chose n'ont pu soutenir ce qu'ils croyaient savoir. L'ignorance où ils ont été de tout ce qui regarde Dieu, les a engagés dans une si merveilleuse diversité d'opinions, et dans une si étrange incertitude, qu'il est difficile de discerner ce qu'ils admettent et ce qu'ils approuvent. Qu'est-il donc besoin d'attaquer ces hommes qui se détruisent d'eux-mêmes. « Aristote, dit Cicéron,[3] a accusé les anciens philosophes de folie et de présomption, pour avoir cru que par leur esprit ils avaient porté la philosophie à sa perfection; » et il a ajouté: « qu'il reconnaissait pourtant qu'elle avait fait depuis de grands progrès en peu de temps, et qu'il prévoyait qu'elle serait bientôt à un point où il n'y aurait rien à désirer. » Quand ce temps-la est-il arrivé, et comment est-ce que la philosophie a été portée à sa perfection? Aristote a eu raison de se moquer de l'extravagance avec laquelle les anciens s'étaient imaginé avoir découvert par leur esprit le plus haut point de la sagesse ; mais il n'a pas eu beaucoup de prudence quand il a cru, ou que les anciens avaient commencé une si importante entreprise, ou que leurs successeurs l'avaient heureusement continuée, ou qu'enfin ceux qui viendraient auraient la gloire de l'achever. Or il est certain que jamais on ne trouve ce que l'on ne cherche pas comme il faut. |
|
CAPUT XXIX. De fortuna iterum et virtute. Sed repetamus id quod omisimus. Fortuna ergo per se nihil est; nec sic habendum est, tamquam sit in aliquo sensu. Siquidem fortuna est accidentium rerum subitus atque inopinatus eventus. Verum philosophi, ne aliquando non errent, in re stulta volunt esse sapientes; qui fortunae sexum mutant, eamque non deam, sicut vulgus, sed deum esse dicunt. Eumdem tamen interdum naturam, interdum fortunam vocant; « quod multa, inquit idem Cicero, efficiat inopinata nobis, propter obscuritatem ignorationemque causarum. » Cum igitur causas ignorent, propter quas fiat aliquid, et ipsum qui faciat ignorent, necesse est. Idem in opere valde serio, in quo praecepta vitae deprompta ex philosophia filio dabat: « Magnam, inquit, esse fortunae vim in utramque partem, quis nesciat? Nam et, cum prospero flatu ejus utimur, ad exitus pervenimus optatos; et, cum reflaverit, affligimur. » Primum, qui negat sciri posse quidquam, sic hoc dixit, tamquam et ipse, et omnes sciant. Deinde, qui, etiam quae clara sunt, dubia conatur efficere, hoc putavit esse clarum, quod illi esse debuit vel maxime dubium; nam sapienti omnino falsum est. Quis, inquit, nescit? Ego vero nescio. Doceat me, si potest, quae sit illa vis, qui flatus iste, et qui reflatus. Turpe igitur est, hominem ingeniosum dicere id, quod, si neges, probare non possit. Postremo, quod is, qui dicit assensus esse retinendos, quod stulti sit hominis, rebus incognitis temere assentiri, is plane vulgi et imperitorum opinionibus credidit, qui fortunam putant esse, quae hominibus tribuat bona et mala. Nam simulacrum ejus cum copia et gubernaculo fingunt, tamquam haec et opes tribuat, et humanarum rerum regimen obtineat. Cui opinioni et Virgilius assentit, qui fortunam omnipotentem vocat; et historicus, qui ait: Sed profecto fortuna in omni re dominatur. Quid ergo caeteris diis loci superest? Cur non aut ipsa regnare dicitur, si plus potest; aut sola colitur, si omnia? Vel, si tantum mala immittit, aliquid causae proferant, cur, si dea sit, hominibus invideat, eosque perditos cupiat, cum ab his religiose colatur: cur aequior sit malis, iniquior autem bonis: cur insidietur, affligat, decipiat et exterminet: quis illam generi hominum vexatricem perpetuam constituerit: cur denique tam malam sortita sit potestatem, ut res cunctas ex libidine magis, quam ex vero celebret, obscuretque? Haec, inquam, philosophos inquirere oportuit potius, quam temere innocentem accusare fortunam: quae etiamsi sit aliqua, nihil tamen afferri ab his potest, cur hominibus tam inimica sit, quam putatur. Itaque illae omnes orationes, quibus iniquitatem fortunae lacerant, se suasque virtutes contra fortunam superbissime jactant, nihil aliud sunt, quam deliramenta inconsideratae levitatis. Quare non invideant nobis quibus aperuit veritatem Deus: qui sicut scimus, nihil esse fortunam; ita scimus esse pravum ac subdolum spiritum, qui sit inimicus bonis, hostisque justitiae; qui contraria faciat, quam Deus, cujus invidiae causam in secundo libro explicavimus. Hic ergo insidiatur universis; sed eos, qui nesciunt Deum, errore impedit, stultitia obruit, tenebris circumfundit, ne quis possit ad divini nominis pervenire notitiam, in quo uno et sapientia continetur, et vita perpetua. Eos autem, qui Deum sciunt, dolis et astu aggreditur, ut cupiditate ac libidine irretiat, ac peccatis blandientibus depravatos impellat ad mortem; vel, si dolo nihil profecerit, vi et violentia dejicere conatur. Idcirco enim in primordiis transgressionis non statim ad poenam detrusus a Deo est, ut hominem malitia sua exerceat ad virtutem: quae nisi agitetur, ni assidua vexatione roboretur, non potest esse perfecta; siquidem virtus est perferendorum malorum fortis ac invicta patientia. Ex quo fit, ut virtus nulla sit, si adversarius desit. Hujus itaque perversae potestatis cum vim sentirent virtuti repugnantem, nomenque ignorarent, fortunae vocabulum sibi inane finxerunt. Quod quam longe a sapientia sit remotum, declarat Juvenalis his versibus:
Nullum numen abest, si sit prudentia:
sed nos Stultitia igitur, et error, et caecitas, et, ut Cicero ait, ignoratio rerum atque causarum, Naturae ac Fortunae nomina induxit. Sed ut adversarium suum nesciunt: sic nec virtutem quidem sciunt, cujus scientia ab adversarii notione descendit. Quae si conjuncta est cum sapientia, vel, ut ipsi dicunt, eadem ipsa sapientia est, ignorent necesse est in quibus rebus sita sit. Nemo enim potest veris armis instrui, si hostem contra quem fuerit armandus, ignorat; nec adversarium vincere, qui in dimicando non hostem verum, sed umbram petit. Prosternetur enim, qui alio intentus, venientem vitalibus suis ictum nec praeviderit ante, nec caverit. CAPUT XXX. Epilogus ante dictorum; et qua ratione sit transeundum a vanitate philosophorum ad sapientiam veram et veri Dei cognitionem, in quo solo virtus est et beatitudo. Docui, quantum mea mediocritas tulit, longe devium philosophos iter a veritate tenuisse. Sentio tamen, quam multa praeterierim, quia non erat mihi propria contra philosophos disputatio. Sed huc necessario divertendum fuit, ut ostenderem, tot et tanta ingenia in rebus falsis esse consumpta; ne quis forte a pravis religionibus exclusus, ad eos se conferre vellet, tamquam certi aliquid reperturus. Una igitur spes homini, una salus in hac doctrina, quam defendimus, posita est. Omnis sapientia hominis in hoc uno est, ut Deum cognoscat et colat: hoc nostrum dogma, haec sententia est. Quanta itaque voce possum, testificor, proclamo, denuntio. Hic, hic est illud, quod philosophi omnes in tota sua vita quaesierunt, nec unquam tamen investigare, comprehendere, tenere valuerunt, qui religionem aut pravam retinuerunt, aut totam penitus sustulerunt. Facessant igitur illi omnes, qui humanam vitam non instruunt, sed turbant. Quid enim docent? aut quem instruunt qui se ipsos nondum instruxerunt? Quem sanare aegroti, quem regere caeci possunt? Huc ergo nos omnes, quibus est cura sapientiae, conferamus. An expectabimus donec Socrates aliquid sciat? aut Anaxagoras in tenebris lumen inveniat? aut Democritus veritatem de puteo extrahat? aut Empedocles dilatet animi sui semitas? aut Arcesilas et Carneades videant, sentiant, percipiant? Ecce vox de coelo veritatem docens, et nobis sole ipso clarius lumen ostendens. Quid nobis iniqui sumus? et sapientiam suscipere cunctamur, quam docti homines, contritis in quaerendo aetatibus suis, nunquam reperire potuerunt? Qui vult sapiens ac beatus esse, audiat Dei vocem, discat justitiam, sacramentum nativitatis suae norit; humana contemnat, divina suscipiat, ut summum illud bonum, ad quod natus est, possit adipisci. Dissolutis religionibus universis, et omnibus, quaecumque in earum defensionem dici vel solebant, vel poterant, refutatis, deinde convictis philosophiae disciplinis, ad veram nobis religionem sapientiamque veniendum est, quoniam est, ut docebo, utrumque conjunctum; ut eam vel argumentis, vel exemplis, vel idoneis testibus asseramus, et stultitiam, quam nobis isti deorum cultores objectare non desinunt, ut nullam penes nos, sic totam penes ipsos esse doceamus. Et quamquam prioribus libris, cum falsas arguerem religiones, et hoc, cum falsam sapientiam tollerem, ubi veritas sit, ostenderim; planius tamen, quae religio, et quae sapientia vera sit, liber proximus indicabit. |
XXIX. Achevons ce que nous avons commencé. La fortune n'est rien, et il ne faut pas s'imaginer qu'elle ait aucun sentiment. Ce n'est qu'un accident soudain et qu'un événement imprévu ; mais les philosophes, de peur de manquer une seule fois de se tromper, ont affecté de faire paraître de la sagesse en un sujet où il n'y a que de la folie, en changeant le sexe de la Fortune et disant qu'elle était un dieu, au lieu que le peuple la prend pour une déesse. Ils appellent quelquefois dieu la Nature, et quelquefois ils l'appellent Fortune, « à cause, dit Cicéron, qu'il fait contre notre opinion beaucoup de choses dont nous ignorons les causes. » Si les philosophes ignorent les causes pour lesquelles une chose est faite, ils ignorent aussi celui qui l'a faite. Le même Cicéron, parlant de la Fortune dans un ouvrage fort sérieux où il donne des préceptes à son fils pour la conduite de la vie, dit : « Que la Fortune a un grand pouvoir; que quand elle nous est favorable, nous venons heureusement à bout de nos desseins, et que quand elle nous est contraire, nous avons le déplaisir de voir que rien ne nous réussit. » La première réflexion que je fais sur ces paroles, est que Cicéron, qui tient que l'on ne peut rien savoir, les a avancées de la même sorte que s'il en eût été assuré et que tout le monde l'eût été avec lui. Je remarque ensuite que lui, qui tâche pour l'ordinaire d'observer les vérités les plus claires, prend, pour une vérité claire, une proposition qui lui devait sembler fort obscure, et qui paraîtra absolument fausse à tout homme sage. « Qui est-ce, dit-il, qui ne sait pas? » C'est moi qui ne sais pas. Qu'il m'enseigne, s'il peut, quel est ce pouvoir de la Fortune, quel est ce vent qui seconde ou qui renverse nos desseins? C'est une chose honteuse à un homme d'esprit d'avancer ce qu'il ne saurait prouver en cas que quelqu'un le nie. Enfin, ce que j'apprends dans Cicéron, est qu'après avoir écrit en tant d'endroits qu'il faut suspendre son jugement, et que c'est une folie de le porter sur des choses dont on n'est pas parfaitement informé, il ajoute légèrement créance aux opinions du peuple, et reconnaît avec les ignorants une Fortune qui distribue le bien et le mal aux hommes. On a mis une corne d'abondance et un gouvernail proche de son image, pour marquer qu'elle répand les richesses et qu'elle dispose des affaires. Cette opinion est favorisée par Virgile, quand il appelle la Fortune « toute puissante, » et par un célèbre historien, quand il écrit, « qu'elle exerce une domination absolue sur toutes choses. » Quel pouvoir reste-t-il donc aux autres dieux, et pourquoi ne règne-t-elle pas et ne reçoit-elle pas nos hommages toute seule? Si elle n'envoie que du mal, pourquoi la vénère-t-on comme une déesse? Pourquoi envie-t-elle la prospérité à ceux qui lui offrent des sacrifices? Pourquoi est-elle plus favorable aux médians qu'aux gens de bien? Pourquoi prend-elle plaisir à tendre des pièges, à tromper, à ruiner les hommes, et il les jeter dans des tristesses mortelles? Qui lui a donné l'ordre et le pouvoir de faire une guerre si cruelle aux hommes, et de disposer de toutes choses par son caprice et sans aucune justice? Les philosophes devaient chercher l'éclaircissement de ces questions, plutôt que d'accuser légèrement la Fortune, tout innocente qu'elle est; car, quand il y aurait en effet une Fortune, ils ne sauraient rendre aucune raison de la haine si implacable qu'ils lui attribuent contre les hommes. Ainsi les plaintes continuelles qu'ils font de son injustice, elles vains éloges dont ils relèvent leur propre vertu, ne sont que d'extravagantes rêveries, qui font voir la faiblesse et la légèreté de leur esprit. Qu'ils n'aient donc point de jalousie de ce que Dieu a eu la bonté de nous révéler la vérité. Comme nous savons qu'il n'y a point de Fortune, nous savons aussi qu'il y a un méchant esprit qui est l'ennemi déclaré de la justice, qui persécute les gens de bien, qui s'oppose à tous les desseins de Dieu par le motif d'une jalousie dont j'ai rapporté le sujet dans le second livre de cet ouvrage. Il dresse des pièges à tous les hommes; il embarrasse aisément dans les filets de l'erreur ceux qui ne connaissent point Dieu ; il les enveloppe de ténèbres; il les accable du poids de leur propre extravagance, afin qu'ils ne parviennent jamais a la connaissance qui renferme la sagesse et la vie éternelle; il use de ruse et d'adresse pour surprendre ceux qui connaissent Dieu, et pour les porter au péché par le plaisir; et quand ce moyen ne réussit pas, il a recours à la violence. Dieu a différé à dessein le châtiment que mérite son péché, afin qu'il exerce notre vertu, qui ne saurait devenir parfaite que par l'épreuve; car la vertu est la patience qui a supporté le mal sans être vaincue. Ainsi nous n'aurions point de vertu si nous n'avions point d'ennemi. Comme les philosophes ont senti la violence de cette puissance contraire et qu'ils en ont ignoré le nom, ils ont inventé celui de Fortune, ce qui est fort extravagant, comme Juvénal a eu dessein de le marquer par ces paroles : Il n'y a point de divinité sans la prudence ; mais à l'égard de la Fortune, nous la reconnaissons pour une déesse, et comme telle nous la plaçons dans le ciel. Ce sont donc, comme Cicéron l'avoue, la folie, l'erreur, l'ignorance et l'aveuglement qui ont inventé les noms de Nature et de Fortune : les philosophes n'avaient garde de connaître la vertu, puisqu'ils ne connaissaient pas l'ennemi contre lequel ils la devaient faire paraître. Si cette vertu est jointe à la sagesse, ou si c'est la sagesse même, comme ils le prétendent, ils ne savent en quoi elle consiste. Quiconque ne connaît pas son ennemi, ne saurait se préparer comme il faut à le combattre; il ne choisira pas des armes propres à remporter la victoire. Au lieu de poursuivre son ennemi, il ne poursuivra que son ombre. Il sera infailliblement vaincu, parce qu'il ne prévoit pas le coup qui le menace et qui le percera de part en part. XXX. J'ai fait voir, autant que mon peu de suffisance me l'a pu permettre, combien les philosophes se sont éloignés de la vérité. Je sais que j'ai omis beaucoup de choses ; mais aussi je n'avais pas entrepris de combattre toutes leurs erreurs : j'avais seulement été obligé de montrer, comme en passant, qu'un si grand nombre d'excellents esprits s'étaient misérablement consumés à la poursuite du mensonge, pour empêcher que ceux qui avaient reconnu qu'il n'y avait pas d'espérance de trouver la vérité dans les religions païennes, ne l'allassent chercher parmi des sectes si différentes de ces sages de l'antiquité. Il ne reste donc aucune espérance ni aucun salut que dans la doctrine que nous soutenons. Toute la sagesse consiste à connaître Dieu et à le servir. J'élève ma voix, autant qu'il m'est possible, pour déclarer et pour publier : que nous avons dans notre religion la vérité que les philosophes ont cherchée durant toute leur vie, et qu'ils n'ont jamais pu trouver parce qu'ils n'ont aucune religion, ou qu'ils n'en ont eu qu'une mauvaise. Eloignons-nous de ces maîtres qui ne font que nous troubler au lieu de nous instruire. Que pourraient-ils nous enseigner, eux qui n'ont rien appris? Qui ces malades pourraient-ils guérir? Qui ces aveugles pourraient-ils instruire? Que ceux qui désirent connaître la sagesse se rendent en foule à notre religion. Attendrons-nous que Socrate commence à savoir quelque chose, qu'Anaxagore trouve la lumière au milieu des ténèbres, que Démocrite tire la vérité du fond du puits où elle est cachée, qu'Empédocle élargisse les chemins des sens par où les objets entrent dans l'âme, enfin qu'Arcésilas et Carnéade voient et comprennent? Une voix du ciel nous déclare la vérité ; une lumière plus éclatante que le soleil nous la montre. Pourquoi sommes-nous assez injustes envers nous-mêmes, pour refuser la sagesse que les philosophes les plus célèbres de l'antiquité ont cherchée inutilement durant tout le temps de leur vie ? Quiconque veut devenir sage et heureux n'a qu'à écouter la voix de Dieu, à apprendre la justice, à méditer le sujet pour lequel il a été mis au monde, à mépriser tout ce qu'il y a sur la terre, à faire profession du culte de Dieu, pour parvenir un jour au souverain bien, dont la jouissance doit faire tout son bonheur. Il faut pour cela renoncer à toutes les autres religions, rejeter tout ce que l'on dit pour leur défense, réfuter les erreurs de toutes les sectes des philosophes. La vérité s'élèvera sur les ruines du mensonge. Après avoir détruit les fausses religions, il est aisé d'établir la nôtre par des exemples, par des arguments et par des témoignages convaincants, et de faire voir que l'extravagance que les philosophes nous attribuent ne se rencontre que parmi eux. Bien qu'en réfutant leurs erreurs et en faisant voir qu'ils ne possèdent point la véritable sagesse, j'aie marqué assez clairement le lieu où elle réside, je me suis proposé de le prouver encore plus solidement dans tout le livre suivant.
|
|
[1] De la nature des choses, livre II. [2] Térence, Héautontimoruménos, acte V. [3] Tusculanes, III. |
|