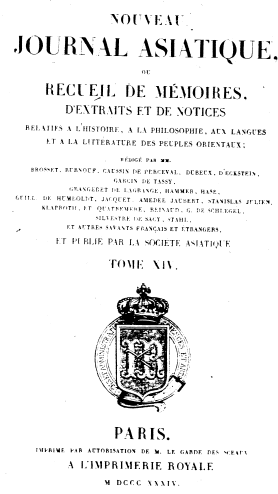
HARIRI
séances
Traduction française : Mr. S. MUNK
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
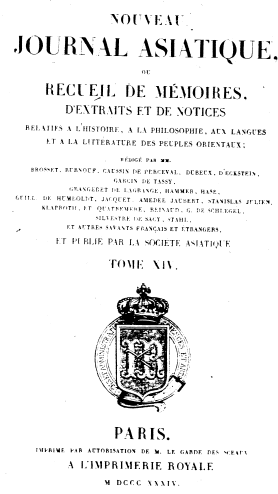
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
Séance de Hariri, traduite de l'arabe par M. Garcin de Tassy.
Journal Asiatique, 1824
Exempt de soucis, et fier de l'abondance du lait de mes richesses, je quittai un jour l'Irak dans le dessein de visiter Goutha de Damas.[1] Arrivé dans ce beau lieu, je trouvai qu'il justifiait l'éloge qu'en font les voyageurs. En effet on y voit tout ce que le cœur désire et tout ce qui peut charmer les yeux. Je bénis alors la main de l'éloignement,[2] et, m'abandonnant à la volupté, je me mis à briser le sceau des souhaits, et à cueillir les grappes des plaisirs. Néanmoins je ne tardai pas à sortir de mon ivresse et de ma léthargie, et bientôt le départ d'une caravane pour l'Irak vint me rappeler ma patrie, et fit naître dans mon cœur le désir d'y retourner. Je ployai donc la tente de l'absence, et je sellai le coursier du retour.
Lorsque nous eûmes fait tous les préparatifs, ne voulant pas nous mettre en route sans escorte, nous prîmes de concert toutes sortes de moyens pour nous en procurer une ; mais nos soins furent inutiles. Nous nous assemblâmes alors irrésolus à la porte de Damas, nommée Giroun, pour délibérer sur le parti que nous avions à prendre, et nous nous mîmes à lier et à délier les nœuds des difficultés, à tordre et à détordre la corde de la résolution. Auprès de nous se trouvait un homme vêtu d'une robe de derviche; dans sa main était le chapelet des femmes,[3] et dans ses yeux l'interprète de l'ivresse.
Lorsqu'il vit que nous étions sur le point d'abandonner notre projet, dont son indiscrétion l'avait instruit, il nous aborda, et nous parla en ces termes : « Voyageurs, rassurez-vous, je consens à vous servir d'escorte. J'ai un moyen immanquable pour dissiper vos craintes. » Cette proposition nous fit questionner l'étranger sur son expédient, et nous lui promîmes pour un tel service une somme considérable. Il nous dit alors qu'il nous apprendrait des paroles qui lui avaient été révélées en songe, pour mettre à l'abri de la méchanceté des hommes. A ces mots, de nous regarder les uns les autres, et de nous faire des signes qui marquaient notre défiance. Il s'en aperçut, et comprit le peu de cas que nous faisions de ses offres obligeantes. « Quoi! reprit-il, vous prenez pour un jeu ce que je dis sérieusement, et mon or ne vous semble que de viles scories? Je vous assure néanmoins que, depuis longtemps, toutes les fois que j'ai traversé des pays où il y avait quelque danger à courir, toutes les fois que je me suis exposé à des périls imminents, ces paroles m'ont tenu lieu d'escorte. D'ailleurs, pour éloigner de votre esprit tout soupçon, je serai avec vous dans le désert, et je vous accompagnerai dans les lieux dangereux. Si je remplis ma promesse, soyez généreux envers moi ; mais si ma bouche profère le mensonge, libre à vous de déchirer ma peau, de répandre mon sang ». Ces paroles nous portante croire ce que disait l'étranger, nous brisâmes les liens des obstacles, et, sans nulle méfiance, nous tirâmes vite au sort pour savoir qui de nous le prendrait sur sa monture. Lorsque les chameaux furent chargés, et que le moment du départ fut venu, nous le priâmes de nous réciter les paroles magiques dont il nous avait parlé : « Que chacun de vous, nous répondit-il alors, lise matin et soir la première surate du Coran, et qu'il dise ensuite avec humilité et à demi-voix la prière suivante : O Dieu, qui rends la vie aux os réduits en poussière, toi qui repousses les malheurs, qui préserves des accidents, rémunérateur généreux, refuge de ceux qui t'implorent, toi qui pardonnes, toi qui conserves sain et sauf, daigne répandre tes bénédictions sur Mahomet, le sceau de tes prophètes, celui qui nous a annoncé ta parole, et sur les lampes de sa famille et les clefs de ses victoires.[4] O Dieu, délivre- moi des suggestions des démons, des violences des sultans, des vexations des méchants, de l'inimitié des ennemis ; préserve-moi de la défaite, du pillage, des machinations, des attaques imprévues ! O Dieu, défends-moi de l'injustice de mes voisins et du voisinage des hommes injustes ; repousse loin de moi les mains des oppresseurs. Retire-moi des ténèbres de la méchanceté, et place-moi, par ta miséricorde, parmi tes bons serviteurs! O Dieu, daigne être mon soutien, soit que je vive dans ma patrie ou en pays étranger, et dans mon absence et dans mon retour, et dans cette vie et dans l'autre ! Conserve-moi, conserve mon honneur, mes biens, ma famille, ma santé ! Préserve-moi des vicissitudes de la fortune, donne-moi la force d'éviter le mal, et de faire le bien ! O Dieu, veille sur moi, aide-moi de ta protection et de ta grâce, rends-moi possesseur de ton élection, et comble-moi de tes faveurs. Accorde-moi une nourriture non-interrompue, éloigne de moi la détresse, soutiens-moi de tes abondants bienfaits. Exauce ma prière, ô toi qui l'entends ! » Cet étranger baissa ensuite les yeux vers la terre, sans dire une parole; mais, bientôt après, il leva la tête, et il s'écria : « Oui, j'en jure par le ciel, qu'embellissent les constellations ; par la terre que décorent les vallées, par le brûlant flambeau du soleil, par l'onde mugissante, par l'air et par la poussière, cette prière est l'amulette le plus sûr possible ; il remplacera pour vous les soldats couverts de casques. Celui qui la récitera au sourire de l'aurore, n'aura rien à craindre de fâcheux jusqu'au crépuscule du soir, et celui qui la dira avant les ténèbres de la nuit ne sera point volé durant son cours. »
Nous apprîmes donc cette prière, et nous partîmes ensuite, défendant nos bagages avec des mots et non avec des gens armés.
Notre derviche nous suivait fidèlement sans nous rien demander; mais, lorsque nous eûmes découvert les hauteurs d'Anah,[5] il nous pria de le récompenser de ses soins. Nous lui dîmes alors de prendre parmi nos marchandises et notre argent tout ce qui pourrait lui faire plaisir. Il ne se fit point répéter cette invitation, il s'empara hardiment de ce que nous avions de plus précieux, et surtout il n'épargna pas l'or, moyen expéditif pour se tirer de la misère, après quoi il disparut avec la promptitude d'un filou. Affligés et étonnés tout à la fois de ce qu'il nous eût ainsi quittés, nous demandions de ses nouvelles à tous ceux que nous voyions. Enfin nous apprîmes que, depuis son arrivée à Anah, il n'avait pas quitté le cabaret.[6]
Surpris de ce discours, je voulus m'assurer de la vérité, et je me décidai à entrer dans un lieu où l'on ne me vit jamais mettre les pieds. Je me travestis, et j'allai, lorsqu'il fut nuit, dans la taverne indiquée. Voilà que je vis en effet notre faux derviche entouré de vases de vin et de jeunes échansons. Ici étaient des bougies allumées, là du myrte, et d'autres fleurs qui répandaient une odeur voluptueuse;[7] divers instruments de musique, à vent et à cordes, ajoutaient encore un nouveau charme à ce lieu ; tantôt le vieillard débouchait les vases, tantôt il faisait jouer des instruments, tantôt il respirait l'odeur balsamique des fleurs, puis il badinait avec les jeunes échansons.
En comparant la conduite actuelle de cet homme à sa conduite antérieure, je découvris facilement qu'il n'était qu'un hypocrite : « Maudit, lui dis-je, as-tu oublié le jour de Giroun ? » Mais il se mit à rire aux éclats, et me chanta ces vers :
« C'est pour cueillir la fleur de la joie, que, dédaignant la gloire, j'ai entrepris des voyages, traversé des déserts ; c'est pour traîner la robe de l'étourderie et de la pétulance, que j'ai franchi des torrents et dompté des chevaux, et que, pour boire du vin, laissant là le décorum, j'ai vendu mes immeubles. Sans ce désir, ma bouche n’aurait jamais dit de bons mots, et tantôt la finesse de mon esprit ne se serait pas déployée, et je ne vous aurait point conduit en Irak en me munissant d'un chapelet. Ne te mets pas en colère, et ne me fais point de reproche, car je suis bien excusable. Cesse de t'étonner de voir dans un lieu agréable un cheikh entouré de vases de vin ; le vin donne de la force, délivre des maladies, et chasse la mélancolie. Guéris les blessures de ton cœur, et bannis ton chagrin avec la fille des vignes. Reçois le vin du soir de la main d'un bel échanson, dont la seule vue puisse dissiper ta tristesse, et qu'un chanteur, doit la voix saurait rendre sensibles les montagnes de fer, vienne ajouter par ses accents au charme de ta boisson. Ferme l'oreille aux discours sévères de celui qui défend les plaisirs de l'amour que ne sanctionne point la loi. Pour parvenir à tes fins, ne crains pas de parcourir l'hippodrome de la ruse et du mensonge. Laisse dire ce que l'on veut, et livre-toi à tes goûts. Dresse tes rets, et prends ceux qui y tomberont. Hélas! pourquoi faut-il que l'idée d'une autre vie vienne troubler de si douces jouissances ? Pourquoi faut-il, à l'heure du trépas, verser des larmes sur une vie si douce et si agréable? »
« J'avoue que tu es éloquent, lui dis-je, après avoir entendu ces vers, mais n'as-tu pas honte de donner les leçons d'une si étrange morale? Au nom de Dieu ? dis-moi qui tu es. » — « Je n'aime pas à déclarer mon nom, me répondit-il, mais je vais me faire connaître par des métaphores :
« Fils du besoin et poursuivi par le sort, je suis la merveille du siècle et des nations : l'Arabie et la Perse sont tour-à-tour le théâtre de mes artifices.... Quand le frère de la pauvreté, chargé d'une nombreuse famille, use d'adresse, il peut être excusable. »
Je compris alors que cet homme était Abou-Zeïd dont les vices noircissaient les cheveux blancs. Ne pouvant retenir mon indignation sur ce qu'il venait de faire, je lui dis d'un ton de reproche, que me permettaient nos liaisons antérieures : « Quand cesseras- tu de mener cette vie infâme? » A ces mots, il entra dans une violente colère ; mais, après un moment de réflexion, il m'adressa ces paroles : « Cette nuit est consacrée à la joie, je veux l'employer à boire du vin, et non à me quereller ; laisse-moi donc : au revoir : à demain. » Alors je me retirai, et je passai la nuit revêtu de la robe de deuil du repentir, pour avoir porté mes pas dans un pareil lieu, et je promis au Très-Haut (que sa louange soit toujours sur ma bouche) de ne plus mettre de ma vie les pieds chez un marchand de vin, quand-même j'aurais le royaume de Bagdad, et que l'âge de la jeunesse reviendrait pour moi. Puis, à la pointe du jour, nous chargeâmes nos chameaux, et nous partîmes, abandonnant cet incorrigible vieillard.
Revue des traditions populaires, 1904.
On pose en vers une question :
« Donne-nous ton avis sur une affaire d'où s'écartent tous les kadis et qui stupéfie tous les jurisconsultes.
» Un homme est mort, laissant un frère de père et de mère, musulman, libre, vertueux.
» Et une femme qui avait un frère authentique, légitime.
» Elle a retiré sa part d'héritage, et son frère à obtenu tout le reste, à l'exclusion du frère du défunt.
» Satisfais par ta réponse à notre demande, car c'est un texte où l'on peut trouver à répondre. »
Le héros des séances, Abou Zeïd, donne également sa réponse en vers :
« Dis à celui qui pose des questions énigmatiques que je vais découvrir le secret qu'il cache.
» Ce mort au frère duquel la loi préfère le frère de sa femme.
» C'est un homme dont le fils, avec son consentement, a épousé la belle-mère : il n'y a rien de surprenant à cela.
» Puis ce fils est mort, laissant sa femme enceinte et elle a mis au monde un fils semblable à lui.
» C'est donc, sans plus de réflexions, le fils de son fils et le frère de sa femme indubitablement.
» Le petit-fils direct est plus rapproché de son aïeul et plus apte à hériter que le frère de celui-ci.
» Aussi quand celui-ci est mort, sa veuve avait droit au huitième de l'héritage, ce qu'elle a pris intégralement.
» Et le petit-fils, qui est par origine, le frère de la veuve, par sa mère, reçoit le reste.
» Le frère intérieur est privé de l'héritage et nous lui dirons : Il ne te reste qu'à le pleurer.
Revue Orientale et Algérienne, tome II, 1852.[8]
Extrait d’une traduction inédite des Mékâmat de Hariri.
Garcin de Tassy, membre de l’Institut.
Le mot arabe mékâmat qui signifie littéralement séance, s'applique aussi aux conversations et morceaux d'éloquence ou discours académiques qui se récitent dans les compagnies de gens de lettres. On connaît plusieurs recueils de pièces de ce genre. Hamadani, surnommé Badî el-Zemân, c'est-à-dire la Merveille du temps, est le premier qui ait fait un ouvrage intitulé : Mékâmat, c'est-à-dire Séances. El-Kamas a composé sous le titre de Mékâmat el-Kamas, un recueil intitulé aussi Riad el-Azhâr ou les Parterres de fleurs, et qui contient dix discours dont le dernier portait le nom de Sandjar, sultan des Seldjoukides. El-Soyouti a aussi composé vingt-neuf discours de ce genre qui portent les noms de fleuris, dorés, azurés, musqués, etc.
De tous les ouvrages connus sous le nom de Mékâmat, aucun n'a acquis autant de célébrité que celui de Hariri, dont le recueil composé de cinquante discours en prose mêlée de vers, est considéré comme le chef-d'œuvre de ce genre, et mérite, dit le plus docte des grammairiens arabes, d'être écrit en or sur de la soie.
Abou Mohammed el-Kâcim Ibn Ali, surnommé Hariri parce qu'il faisait le commerce de la soie (harir), naquit près de Basrah, l'an de l'hégire 446, et mourut l'an 515, sous le règne de Mostarched, 29e kalife de la race des Abassides. Il composa son ouvrage sur les instances d'Abou Chirwan Kaled, vizir du sultan Mahmoud de la dynastie des Seldjoukides. Ce chef-d'œuvre d'éloquence contient cinquante discours ou déclamations sur différents sujets de morale, et chacun de ces discours porte le nom du lieu où il a été récité. La premier a pour titre le nom de Sanaa, capitale du Yémen, et le dernier celui de Basrah.
Il est nécessaire d'ajouter, pour les personnes qui ne connaissent pas l'ouvrage de Hariri, que dans ce livre, l'auteur suppose qu'un homme nommé Abou Zeïd gagne sa vie à improviser des vers, et parcourt à cet effet diverses villes d'Asie et d'Afrique, prenant tous les langages et revêtant toutes les formes; ce qui donne lieu à cinquante différentes aventures formant autant de chapitres dont le héros vient souvent incognito débiter des vers et finit par être reconnu. Plusieurs écrivains arabes ont écrit des commentaires sur les mots difficiles qui se rencontrent tant dans la prose que dans les vers de cet ouvrage devenu classique en Orient. Parmi ces commentaires, on distingue ceux d'Okberi el-Bagdadi et d'el-Motarezi el-Chirazi; enfin, celui de S. de Sacy qui, au dire des savants arabes, est un chef-d'œuvre.
Les notes qui accompagnent la traduction suivante sont empruntées en grande partie au travail de S. de Sacy. Le traducteur espère que le lecteur sérieux ne s'offensera pas de la légèreté de quelques passages et de la liberté de certaines expressions. Il a dû conserver les uns et reproduire les autres dans l'intérêt de l'ethnologie des Peuples musulmans.
Je revenais un jour de la Syrie à Bagdad. La caravane était bien composée : nous avions avec nous Abou Zeïd fait pour arrêter un homme pressé et la merveille du siècle par son éloquence. Comme nous descendîmes à Sindjar,[9] un négociant de la ville fit un repas de noces auquel il invita en masse tous ceux qui voudraient y venir[10] et même les gens de la caravane. Nous nous rendîmes à cette invitation. On servit mille mets délicieux; enfin on apporta un vase aussi transparent que si c'eût été de l'air des champs concret. Ce vase était rempli de confitures excellentes : il n'eut pas plutôt paru que chacun jeta sur lui un regard avide; mais à peine Abou Zeïd l'aperçut-il qu'il se leva comme un insensé, et s'éloigna avec précipitation. Nous fîmes tout notre possible pour l'engager à revenir; mais il dit : « J'en jure par celui qui rend la vie aux morts, je ne m'avancerai que lorsqu'on aura retiré ce vase » Ne voyant pas d'autre moyen de le faire revenir, nous fîmes donc enlever ce cristal, ce qui excita une sensation pénible dans l'assemblée. Lorsque Abou Zeïd fut revenu à sa place, nous lui demandâmes aussitôt pourquoi il s'était ainsi levé et avait fait emporter le vase. C'est, dit-il, parce que le verre est un délateur.[11] Or, depuis plusieurs années, j'ai juré de ne me trouver jamais en un même lieu avec un délateur, et voici quelle est la cause de mon serment. J'avais un voisin qui, à l'extérieur, était la douceur même; mais qui, au fond, était un vrai scorpion, dont les paroles étaient du miel le plus doux et les pensées cachées le poison le plus subtil. Notre voisinage m'engagea à faire connaissance avec lui, et, séduit par ses manières, je le fréquentai. Je croyais trouver en lui un bon voisin, un ami affectionné, et je ne trouvai qu'un vautour destructeur et un serpent perfide. Je mangeai avec lui le sel de l'amitié, je bus le vin de la concorde sans présumer qu'un jour je serais charmé de ne plus le voir. Je possédais une esclave qui n'avait pas sa pareille tant sa beauté était parfaite; sa vue enflammait les cœurs, son sourire laissait voir à découvert des dents plus blanches que les perles, qui faisaient un agréable contraste avec l'incarnat purpurin de ses lèvres dont l'éclat l'emportait sur le corail. Un seul de ses regards excitait dans le cœur un trouble voluptueux. Parlait-elle, le philosophe le plus froid ne pouvait rester sans émotion; lisait-elle, elle guérissait le cœur affligé et rendait la vie au mourant. Ses accents rappelaient ceux de David, effaçaient ceux de Mabad[12] et d'Ishac,[13] et faisaient oublier la flûte de Zunâm.[14] Sa danse enfin était aussi agréable que celle des bulles de vin dans les coupes. Je vivais content en sa compagnie ; je la tenais soigneusement cachée aux regards et n'en parlais jamais. Je craignais même que le zéphyr, en répandant ses parfums, ne découvrît sa retraite ou qu'un nouveau Sâlih[15] ne devinât son habitation. Le malheur de ma destinée voulut que dans la chaleur du vin je parlasse de cette jeune esclave à mon voisin. Je n'eus pas plutôt ouvert la bouche à ce sujet, que je m'en repentis ; mais la flèche était partie : je me contentai de faire promettre à ce faux ami de garder un secret inviolable sur ce que je venais de lui apprendre, quand même il aurait lieu de se plaindre de moi. Il me dit alors qu'il tenait les secrets avec autant de soin que l'avare garde les pièces d'or. A peine y avait-il deux ou trois jours que nous avions eu cet entretien que le gouverneur de la ville trouva bon d'aller se présenter chez le roi pour faire passer les chevaux en revue et pour solliciter des faveurs. Toutefois il voulut de son côté lui porter un présent qui pût lui être agréable et le lui offrir avant l'audience. Dans cette intention, il fit des largesses à ses émissaires, et donna à espérer une forte récompense à celui qui le mettrait en possession de ce qui pourrait le contenter. Mon perfide voisin, dans l'espoir de la récompense, ferma l'oreille aux reproches de sa conscience, et alla trouver le gouverneur à qui il dit ce que je lui avais confié sous le secret le plus absolu. Je n'appris que j'avais été ainsi desservi que lorsque les gens du gouverneur vinrent chez moi, m'engager à lui céder cette perle solitaire, me disant d'y mettre le prix que je voudrais. Je rejetai toutes les propositions que l'on me fit; mais rien ne put faire désister le gouverneur de son désir; ni prières, ni supplications, ni difficultés. Toutefois je ne pouvais me résoudre à me séparer de ma jeune esclave ; c'était m'arracher le cœur de la poitrine. Le gouverneur finit par me menacer, par me frapper même... La crainte de la mort me fit alors acquiescer à ses désirs. C'est à cette occasion que je promis à Dieu de ne me trouver jamais avec un délateur : or, le verre a ce caractère pervers, en sorte qu'il a passé en proverbe pour exprimer la délation, donc mon serment s'étend jusqu'au verre, et c'est pourquoi je n'ai pas voulu m'en approcher.
« Après l'explication que vous venez d'entendre, ne me blâmez point de ce que je suis cause que vous n'avez pas mangé des confitures contenues dans ce vase. Je réparerai, autant que possible, le dommage que j'ai occasionné. D'ailleurs tout ce que je vous ai dit est, pour les hommes instruits, plus agréable que ce dont je vous ai privés. »
Nous reçûmes parfaitement bien ses excuses, et nous lui dîmes même, pour le consoler, que le meilleur des hommes a été lui-même victime de la délation.[16] Nous lui demandâmes ensuite ce qu'était devenu, après cette action perfide, ce voisin délateur. « Il s'humilia, nous dit-il, il me fit intercéder par des personnages puissants ; mais j'étais décidé à ne plus lui rendre mon amitié. Il eut beau insister, je fus inflexible : toutefois, ce furent des vers que je fis, poussé par la haine, qui me délivrèrent tout à fait de ses importunités ; il désespéra alors de voir revivre mon amitié, comme les incrédules désespèrent de voir ressusciter les morts. » Nous priâmes Abou Zeïd de nous réciter ces vers, ce qu'il fit sans se faire prier, ni sans être intimidé en aucune manière.
« J'avais un ami qui posséda toute ma tendresse, tant que je le crus sincère. Je croyais trouver en lui un compagnon fidèle, un aide, un disciple ; mais je connus bientôt sa méchanceté,[17] et je le laissai avec haine. J'avais cru voir dans sa physionomie les traits de la douceur, pouvais-je m'attendre qu'il ferait à mon cœur une blessure que le magicien le plus habile ne saurait guérir. Bien loin de m'être ni utile ni agréable, il s'est déclaré mon ennemi..., il a divulgué mes secrets. Ah ! que j'eusse désiré ne l'avoir jamais eu pour ami. Il m'a fait même détester l'aurore ; car sa clarté dévoile ce que les ténèbres cachaient aux regards,[18] et il m'a fait, au contraire, aimer la nuit. Oui, il suffit qu'on rapporte pour être digne de reproche et d'animadversion. »
Lorsque le maître de la maison eut entendu ces vers, il fit asseoir Abou Zeïd à la place d'honneur, et fit servir nombre de vases d'argent remplis de confitures et de friandises. «Ne confonds point ces vases, dit-il alors à Abou Zeïd, avec les autres car ceux-ci représentent celui qui garde fidèlement les secrets. » Abou Zeïd dit alors à la société : « Eh bien! messieurs, avez-vous perdu au change, et n'est-ce pas le cas de vous dire avec le Coran : Il peut se faire que vous n'aimiez pas quelque chose qui vous soit cependant avantageux.[19] » Bientôt Abou Zeïd, voulant se retirer, s'avisa de demander la permission d'emporter ces vases ; le maître, enchanté de lui, y consentit, et lui donna même un esclave pour les porter. Après avoir fait ses remercîments, il nous invita d'aller dans sa demeure et nous distribua toutes les friandises que ces -vases contenaient. Il dit ensuite : « Je ne sais actuellement, si je dois me plaindre de ce délateur ou si je dois lui rendre grâce ; car, enfin, il est cause que j'ai reçu tous ces présents. Il faut actuellement que je retourne auprès de mes enfants ; je vous laisse donc : adieu. » Alors il monta sur son chameau et nous quitta. Sa disparition fut pour nous comme lorsque se retire celui qui, dans une assemblée, occupe la première place, ou lorsque durant une belle nuit la lune vient à se coucher.
J'étais un jour dans la ville de Reï, lorsque je vis une foule aussi épaisse qu'une nuée de sauterelles. Les gens qui la formaient marchaient avec hâte et parlaient entre eux d'un prédicateur qu'ils allaient entendre et qu'ils préféraient à Ibn Samoun.[20] Désireux de connaître le talent du wâez, je ne balançai pas, malgré les cris et la presse qu'il me fallait souffrir, de m'unir à cette foule. Nous ne tardâmes pas d'arriver à un cercle nombreux où se trouvaient assemblés le prince et le sujet, l'homme illustre et l'homme sans considération. Au milieu de l'assemblée se trouvait un vieillard qui pérorait avec onction, et que chacun paraissait écouter avec le plus vif intérêt. Voici ce que je lui entendis dire : « Fils d'Adam, pourquoi te laisses-tu si facilement séduire par le plaisir? pourquoi es-tu porté à faire ce qui t'est nuisible? Tu n'aspires qu'aux louanges, tu te livres à mille soins inutiles, et tu oublies tes intérêts les plus chers. Tu tends l'arc du crime, et tu te revêts du manteau de l'avidité, oubliant qu'il ne faut à l'homme que quelques bouchées pour vivre. Tu n'obtempères pas aux avis qu'on te donne, et les menaces qu'on te fait ne te touchent point. Tu t'abandonnes complètement à tes désirs ; comme l'aveugle, tu erres à l'aventure. Tu ne penses qu'à acquérir des richesses périssables, sans songer qu'elles seront bientôt la proie de tes héritiers. Crois-tu être abandonné au hasard? crois-tu que demain (au jour du jugement), Dieu ne te demandera pas compte de tes actions ? Crois-tu que la mort se laisse séduire par des présents, et qu'elle fasse quelque différence entre le lion superbe et te faible faon de la gazelle? Rien n'est utile pour l'autre vie que les bonnes œuvres. Heureux qui sait fermer son cœur à la volupté et qui l'ouvre aux purs sentiments de la religion. »
« A quoi te serviront ces palais somptueux, ces immenses richesses, lorsque quelques poignées de terre couvriront ton corps privé de vie ! Emploie tes richesses à faire du bien, avant que l'inconstante Fortune te les ait arrachées : personne n'est à l’abri de sa perfidie. Résiste à tes passions ; nul ne les a suivies sans être tombé du faîte de l'honneur dans l'avilissement. Sois pieux, crains Dieu, verse sur tes fautes des larmes abondantes, pense au breuvage de coloquinte que te prépare la mort. N'oublie jamais que ta dernière habitation sera une fosse dans la terre. Heureux celui qui répare le mal qu'il a pu faire, alors qu'il le peut encore ! »
Tandis que l'orateur parlait, les assistants sanglotaient et laissaient voir des signes de conversion. Quand il eut fini et que le silence fut rétabli, quelqu'un implora le secours de l'émir qui était présent contre l'injustice de son lieutenant Comme le plaignant vit que l'émir n'accédait pas à sa prière, il s'adressa à l'orateur, qui reprit aussitôt la parole, faisant allusion à l'émir.
« On doit s'étonner qu'il y ait des personnes qui ambitionnent un gouvernement et qui, lorsqu'elles le possèdent, sont injustes. Si elles savaient qu'il n'est aucune situation qui ne change, non, elles ne tyranniseraient pas le peuple qui leur est confié, et elles fermeraient leurs oreilles aux mensonges du délateur. Il faut que le peuple se laisse gouverner par ceux entre les mains de qui sont les rênes du pouvoir : il faut qu'il paisse l'herbe amère si on le conduit pour la paître ; qu'il boive l'eau salée si on ne lui en donne pas de douce. Il faut qu'il supporte avec patience tous les maux que ses supérieurs lui font éprouver, et qu'il se contente de répandre des larmes ; mais un jour, il rira à son tour, lorsque la fortune abandonnera tout d'un coup ce superbe, et excitera contre lui l'incendie de la sédition. La joie de ses ennemis viendra encore insulter à son malheur. Dépouillé de tous ses emplois, il sera un objet de pitié au jour où son visage sera couvert de la poussière du mépris. Tout cela n'est rien encore : il sera bientôt forcé de comparaître à ce tribunal où l'homme le plus, éloquent balbutiera. Là, plus vil que le champignon du désert, il sera forcé de rendre un compte terrible et minutieux. En ce jour redoutable, il voudrait bien n'avoir jamais été au pouvoir. »
« O toi, continua le prédicateur, en s'adressant directement à l'émir, ô toi qui occupes le rang élevé de gouverneur, dépose un vain orgueil... Le bonheur est un vent variable et le pouvoir un éclair trompeur, que ne suit point la pluie. Le meilleur prince est celui-qui rend ses peuples heureux. Celui qui les rend malheureux est détesté dans ce monde et puni dans l'autre. Non, tu ne seras point de ceux qui tyrannisent leurs administrés Les actions ne sont point indifférentes; la balance pèsera, et tu seras jugé comme tu auras jugé. »
Le gouverneur fut interdit à ces paroles ; il changea de couleur et se mit à gémir et à soupirer. Il alla ensuite consoler celui qui s'était plaint, et réprimanda celui dont il s'était plaint : puis il fit toutes sortes d'honnêtetés au prédicateur, et le combla de présents. Celui-ci se retira alors au milieu de ses compagnons, content de l'heureux succès de ses paroles. Je le suivis, il s'en aperçut et me dit :
« Mon cher Hareth, je suis Abou Zeïd que tu connais. Je me plais toujours à changer de costume et de langage. Tantôt je réjouis par mes plaisanteries celui que le luth le plus harmonieux ne saurait émouvoir. Tantôt je dis au contraire des choses sérieuses. Depuis la dernière fois que je t'ai vu, je n'ai éprouvé aucun accident fâcheux. Je continue toujours à m'emparer des proies que je puis saisir. Comme un loup dévorant, je viens fondre sur les troupeaux.[21] »
J'avoue que je n'ai jamais aimé à rester fixé dans ma patrie ; mais au contraire à affronter le péril et à surmonter la crainte. Combien de fois dans mes courses ne parcourus-je pas des lieux que jamais les pieds de l'homme n'avaient foulé et où le katâ[23] n'avait pas dirigé son vol. Mes voyages m'ayant dirigé à Bagdad, siège du khalifat, j'y demeurai quelque temps à repaître mes yeux des objets les plus agréables et à cueillir les fleurs du plaisir. Un jour que je me promenais au harîm, je vis une foule immense environner un vieillard qui avait une longue barbe, et qui tenait un jeune homme par ses vêtements. Je me joignis à la foule et, à sa suite, j'arrivai chez l'émir. Là le vieillard expose qu'il a élevé, dès son plus jeune âge, ce jeune homme qui est orphelin ; qu'il n'a rien épargné pour lui donner de l'instruction ; mais qu'aussitôt qu'il a été suffisamment formé, il s'est comporté envers lui en ennemi ; qu'il s'est emparé de ses vers et se les est appropriés, ce qui est regardé par les poètes comme quelque chose de plus criminel que de voler de l'or et de l'argent. Ils ont en effet autant de soin pour garder les pensées vierges que la mère vigilante en a pour conserver l'innocence de sa fille ingénue. « Mais, interrompt le juge, de quelle manière ce jeune homme a-t-il été plagiaire ; car il y a diverses sortes de vols littéraires : on peut prendre les idées seulement ou prendre des morceaux entiers sans y faire de changements. Voici ce qu'il a fait, répond le vieillard, il a coupé la queue à mes vers et s'est emparé des deux tiers. — « Récite tes vers entiers, dit le wali, afin que je puisse voir ce qu'il a pris sur leur totalité. —Volontiers, répond le vieillard, les voici. »
« O toi ! dont l'ambition se borne à ce monde vil et périssable, tandis qu'il tend sous tes pas le filet des malheurs et de la mort ! Comment peux-tu aimer un monde qui, lorsque tu es au milieu des ris, te prépare des pleurs amers? Ses nuages trompeurs n'étanchent point la soif. Ah ! ne perds pas dans l'inaction cette vie précieuse : emploie-la à te munir du viatique des bonnes œuvres pour ce voyage qu'il te faudra bientôt faire[24] ».
« Eh bien, dit le wali, qu'a donc fait le jeune homme ? — Je te le répète, dit le vieillard, il s'est contenté de retrancher une portion de ces vers et en a formé ceux que je vais te réciter. »
Ici se trouvent les deux tiers de chacun des vers précédents ; c'est-à- dire le vieillard s'arrête à la première rime. Je ne donne pas la traduction de ces vers, attendu qu'ils ne sont que la répétition des autres, sauf quelques épithètes et quelques phrases incidentes de moins, ce qui ne change le sens en aucune manière.
Le wali se tourna alors vers le jeune homme, et lui dit : « Ce n'est pas beau, pour un élève, de piller ainsi son maître. — Je suis prêt, répond l'élève, à renoncer à jamais à la science et aux érudits, et à m'unir aux ennemis de l'instruction qui détruisent l'édifice des connaissances, si j'ai connu les vers de mon maître, avant d'avoir fait les miens. C'est simplement par un effet du hasard que nous nous sommes rencontrés. »
Le juge parut croire à ce que dit l'élève : toutefois, il chercha dans son esprit le moyen de découvrir la vérité et de connaître lequel des deux était en état de faire de pareils vers. Après avoir un peu réfléchi, il leur dit : « Pour que je puisse juger entre vous, voulez- vous improviser alternativement dix vers, en suivant un parallélisme constant d'expressions. Vous prendrez pour sujet les plaintes d'un amant sur les dédains d'une maîtresse. — Nous acceptons de bon cœur, répondirent-ils à l'envi, l'épreuve à laquelle tu veux nous soumettre. »
Ici suivent dix vers qu'ils récitent alternativement, et qui ne sont guère intéressants que par le parallélisme d'expressions, qu'ils renferment, parallélisme qu'il est impossible de faire passer dans une autre langue.[25]
Après avoir entendu ces vers, le wali, étonné, exprima aux deux poètes son admiration, et dit ensuite au vieillard: « Je vois clairement que ce jeune homme n'a pas besoin du secours d'autrui ; mais qu'il se sert du talent que Dieu lui a donné. Cesse donc de le soupçonner d'un plagiât dont il est incapable, et rends-lui ton amitié. — A Dieu ne plaise! répond le vieillard, je persiste à le croire coupable, et, après ce qu'il m'a fait, je ne veux pas me réconcilier avec lui. —Prendre des soupçons pour la vérité, dit alors le jeune homme, c'est un crime, et tourmenter un innocent c'est une méchanceté. Je suppose que j'aie réellement commis une faute ; mais ne te souviens-tu plus de ces vers que tu lis un jour durant le temps de notre union ? »
« Sois toujours bon envers ton frère ; quand même tu aurais à t'en plaindre. Fais-lui du bien; qu'il soit reconnaissant ou non. Demander un homme parfait, c'est demander l'impossible. Quel est celui qui n'a rien à se reprocher? Quel est celui qui n'a que de bonnes qualités? Ne voit-on pas l'épine à côté de la rose, l'aiguillon sur le rameau qui porte le fruit? »
Le vieillard dit alors, d'un air étonné : « Je ne suis pas éloigné de me réconcilier avec ce jeune homme ; mais voici ce qui m'empêche de le faire : j'ai l'habitude de l'entretenir, or ma position actuelle ne me permet plus de fournir à ses besoins ; car je suis si malheureux que le vêtement que je porte est emprunté, et qu'un rat ne pourrait trouver à vivre dans ma maison.[26] »
Le gouverneur touché de compassion, fit retirer les spectateurs dans l'intention de donner quelque chose aux deux poètes. Pour moi, qui voulais voir si je ne connaissais point ce vieillard, et qui étais empêché par la foule d'apercevoir ses traits, je la laissais s'écouler. Je le considérai ensuite attentivement et je ne tardai pas à reconnaître Abou Zeïd et son fils et à comprendre le but de tout ce jeu. J'allais aborder Abou Zeïd; mais il me jeta un coup d'œil pour m'en empêcher. Je demeurai donc à l'attendre. « Que désires-tu ?» me dit le wali. « C'est l'ami, dit Abou Zeïd, sans me laisser répondre, qui m'a prêté le vêtement qui me couvre. » Alors le wali me permit de rester et de m'asseoir. Il donna ensuite à chacun des deux poètes une pelisse, de l'argent, et leur fit promettre de vivre désormais en bonne intelligence. Ils sortirent bientôt en le remerciant de ses bienfaits, et je suivis leurs pas ; mais à peine étions-nous hors de la maison du gouverneur, qu'un de ses gens vint, de sa part, me prier de revenir auprès de lui. Je me doutai du pourquoi et dis à Abou Zeïd : « Le wali ne me rappelle sans doute que pour me demander de tes nouvelles. Que dois-je donc lui dire ? » — « Avoue-lui franchement, me dit-il, que je me suis joué de lui ; peu m'importe qu'il se mette en colère. Je quitte ce pays et je ne crains, pas que l'on puisse m'atteindre. » Je retournai, donc chez le wali, que je trouvai enthousiasme d'Abou Zeïd et qui regrettait que la fortune l'eût traité si cruellement. Il me dit ensuite : « Est-il bien vrai que tu lui aies prêté son vêtement? » — « Non, répondis-je, cet homme t'a joué un tour. » A ces mots le visage du wali s'enflamma de colère. « Je n'ai jamais manqué, de découvrir la fraude, dit-il, mais comment pouvais-je croire qu'un vieillard, ayant l'air respectable, voulût m'en imposer. Comment se nomme cet homme et qu'est-il devenu ? » reprit-il. « Il se nomme Abou Zeïd, lui dis-je, et il est parti tout de suite pour Bagdad, de crainte que tu ne découvrisses sa fourberie. » — « Le tour qu'il m'a joué est affreux, reprit le wali, et si ce n'était le respect que j'ai pour son mérite littéraire, je le ferais poursuivre jusqu'à ce qu'on l'eût atteint, et je le punirais sévèrement. S'il raconte cette aventure à Bagdad, je serai l'objet de mille plaisanteries qui me feront rougir et m'aviliront aux yeux des hommes. De ton côté, du moins, n'en parle pas, je t'en prie, tant que tu seras dans ce pays. Je le lui jurai et lui promis de garder mon serment avec la fidélité de Samwal.[27]
Je passai un hiver à Karadj[28] pour toucher le montant d'une dette. L'hiver y fut si rigoureux cette année, que je ne sortais de chez moi que par nécessité et le vendredi, pour la prière publique.[29] Un jour qu'une affaire m'avait obligé de quitter le coin de mon feu, et qu'un temps gris ajoutait encore à l'intensité du froid, quel fut mon étonnement de rencontrer un vieillard qui n'avait pour tout vêtement qu'un turban et une serviette autour des reins. Une foule de gens l'entouraient, et il leur récitait ces vers :
« Rien ne vous prouve mieux ma pauvreté que l'état où vous me voyez dans un temps si froid. Faites, en me voyant, de sages réflexions sur l'inconstance de la fortune. Je n'ai pas toujours été malheureux ; je me suis vu dans l'abondance : alors je faisais du bien aux indigents. Pour régaler mes hôtes, je n'épargnais pas mes chameaux. Tout à coup la fortune a tiré du fourreau le glaive de la perfidie : mes richesses ont bientôt disparu. Dénué de tout, je n'ai pour me garantir du froid que le soleil. N'y aura-t-il point parmi vous un homme généreux qui, dans la vue de plaire à Dieu, me couvre d'un vêtement?
» Messieurs, ajouta-t-il ensuite, vous voyez mon état misérable : Mon bras me sert d'oreiller, ma peau de vêtement, le creux de ma main d'écuelle. Quel sujet de réflexions pour le sage qui de tout sait tirer d'utiles instructions ! »
« Eh bien? lui dîmes-nous, nous voyons que tu n'es pas un sot; mais à quelle famille appartiens-tu? » Il répondit :
« L'homme ne doit point s'enorgueillir de ses aïeux ; il doit ne s'enorgueillir que de ce qu'il est lui-même. Qu'il parle de ses bonnes actions et non de celles de ses ancêtres. Qu'il n'établisse pas sa gloire sur des os cariés; ce n'est que le mérite personnel qui la donne.[30] »
Je crus entendre un autre Asmaï[31] et je me mis à examiner cet homme que je reconnus bientôt pour Être Abou Zeïd. Je compris alors qu'il n'avait eu d'autre chose en vue, en se présentant ainsi tout nu, que de tendre de nouveaux filets à la compassion publique.
Abou Zeïd s'apercevant que je le reconnaissais, et craignant que je ne disse son secret, m'invita à me taire par des expressions détournées, qu'il adressa à tous les assistants, et dont je compris seul le vrai sens. Je lui donnai ensuite ma pelisse. Abou Zeïd satisfait récita des vers pour me remercier. Alors l'assemblée enchantée de lui, lui donna à l'envi des vêtements plus qu'il n'en pouvait porter. Abou Zeïd se retira tout joyeux. Je le suivis et lui dis : « Ah ça ! tu as senti le froid, j'espère que tu ne te présenteras pas tout nu une autre fois. — Ne te hâte pas de me blâmer sans m'avoir entendu me dit-il ; je te jure que si je ne me fusse pas présenté ainsi, je m'en serais retourné les mains vides. — Avoue du moins, lui dis-je, que si j'eusse parlé je t'aurais fait manquer un beau coup, et que tu ne serais pas actuellement plus vêtu qu'un ognon. Rends-moi, par reconnaissance, ma pelisse, ou du moins récite-moi ces fameux vers que l'on nomme les kâfs de l'hiver.[32] —Pour ce qui est de ta pelisse, me dit-il, n'y compte pas, quant aux vers d'Ibn Sukkarah dont tu me parles, comment ne pas t'en souvenir? Je te les ai chantés à Daskarah.[33]
« L'hiver est venu; mais j'ai les sept choses qui sont nécessaire dans ce temps, lorsque la pluie empêche de sortir pour aller chercher ce dont on a besoin. Ces choses sont une maison bien abritée, une bourse bien garnie, un réchaud bien fourni, du vin vieux, de la viande rôtie, une femme douce et jolie et un vêtement chaud.[34] »
La réputation méritée qu'ont les Arabes bédouins de parler l'arabe dans toute sa pureté m'engagea d'aller rester quelque temps au milieu d'eux. Je me munis d'une troupe de chameaux, d'un troupeau de brebis et j'allai chez ces Arabes d'une noble et ancienne origine, et on qui l'éloquence est naturelle. Ils me reçurent avec la franche cordialité qui les caractérise, et je passai chez eux d'heureux moments. Mais une nuit je vins à perdre une femelle de chameau au lait abondant; impatient de la retrouver, je montai sur un cheval, à la course rapide, je pris ma pique et je me mis à parcourir le désert, cherchant de tous côtés ma chamelle, sans pouvoir la trouver. A l'aurore j'entendis de loin le muezzin annoncer la prière. Je descendis de mon coursier et rendis mes hommages au créateur de l'univers. Je remontai ensuite à cheval et je continuai mes recherches. Je suivais toutes les traces que j'apercevais, je m'informais de ma chamelle à tous ceux que je rencontrais. Toutefois mes efforts furent vains et inutiles. Bientôt l'heure de midi arriva, et ce jour-là la chaleur était insupportable. Je pensai qu'il me serait impossible de rester sans danger exposé aux rayons du soleil et de continuer ma course sans me reposer quelque temps. J'allai donc me mettre à couvert sous l'ombre d'un arbre dont les rameaux touffus étaient couverts d'un épais feuillage, afin de me reposer jusqu'à ce que le soleil baissât. Toutefois je n'avais pas encore respiré, lorsque je vis un homme, en équipage de voyageur, qui, comme moi, cherchait un arbre pour se garantir des rayons de l'astre du jour. Ayant aperçu mon abri, il vint s'y réfugier. Je vis d'abord avec peine s'approcher cet inconnu ; mais ensuite je pensai qu'il pourrait, peut-être, me donner des nouvelles de ma chamelle. Quand cet homme fut tout près de moi, je fus bien surpris de reconnaître en lui Abou Zeïd. Je lui demandai aussitôt d'où il venait et comment allaient ses affaires, il me répondit :
« Je passe ma vie à voyager au loin : tantôt je suis dans un pays tantôt dans un autre. Ici, je traverse un lieu sûr, là un lieu périlleux. La proie que je saisis, voilà ma provision ; des sandales usées sont ma chaussure ; ma besace et mon bâton voilà tout ce que je porte avec moi. Sans chagrin, quelque privation que j'éprouve, je dors profondément tant que dure la nuit Je ne veux point des faveurs dues à la bassesse, ni voir accomplir mes vœux en me couvrant du manteau de l'opprobre. Plutôt la mort que la honte et l'infamie. »
Abou Zeïd me demanda ensuite, à son tour, ce qui m'avait amené dans ce lieu. Je lui racontai alors comment une de mes chamelles avait disparu et les fatigues que j'avais supportées à la chercher, ce jour-là et la veille. « Je te conseille, me dit-il, de n'y plus songer, et de t’en consoler; car je crois que tes peines seraient perdues. Pensons à dormir, cela vaudra mieux ; nous sommes las, et il fait bien chaud ; or, rien n'est plus favorable dans l'un et dans l'autre cas que de faire la sieste. — Comme tu voudras, » lui dis-je. Il se coucha alors par terre et parut s'endormir. Bientôt le sommeil me prit aussi, et je ne me réveillai que lorsque la nuit avait déjà commencé et que les étoiles brillaient. Hélas ! plus d'Abou Zeïd et plus de cheval. Je passai cette nuit bien tristement, en proie à des chagrins aussi vifs que ceux de Jacob. Je ne pus dormir : tantôt j'avais envie de continuer mes recherches, tantôt de m'en retourner. Au matin, je vis au loin un homme monté sur un chameau. Je lui fis signe de venir de mon côté; mais il parut lie pas y faire attention. Alors je me hâtai d'aller vers lui pour le prier de vouloir bien me prendre en croupe. Je l'atteignis bientôt ; mais quoi ! je reconnus qu'il était monté sur la chamelle que je cherchais. Je le tirai tout de suite en bas du dos de sa monture, et lui dis : « C'est à moi que cette chamelle appartient; rends-la et ne sois pas aussi avide qu'Achab.[36] » Il paraissait disposé à faire quelque résistance lorsqu’Abou Zeïd survint avec l'audace du léopard et l'impétuosité du torrent. Je craignis aussitôt qu'il ne me prit ma chamelle, comme la veille il avait pris mon cheval. Pour prévenir ses mauvaises intentions, je lui rappelai alors ce qu'il avait fait le jour précédent, lui demandant s'il prenait aujourd'hui à tâche de me poursuivre et de me tourmenter. « A Dieu ne plaise, me dit-il, que j'achève de tuer celui que j'ai blessé ; je viens au contraire te soutenir et te défendre. » A ces mots ma crainte cessa, et je lui montrai ma chamelle en lui parlant de l'impudence de cet homme. Abou Zeïd lança alors sur cet Arabe le regard du lion qui fixe sa proie, et lui présentant sa pique, il jura par celui qui fait naître l'aurore que s'il ne cédait sur-le-champ et s'il ne se retirait, il allait lui ôter la vie et jeter ainsi l'affliction dans le cœur de ses enfants et de ses amis. Alors l'Arabe lâcha les rênes de la chamelle et s'enfuit promptement. « Prends ta chamelle, me dit en cet instant Abou Zeïd, et monte sur son dos. Un seul malheur est préférable à deux. » Je fus tout stupéfait, et je ne savais si je devais faire des reproches à Abou Zeïd ou le remercier. Il devina le secret de mon cœur, et il me dit, en m'embrassant avec un visage ouvert :
« O mon frère, toi qui supportes mon injustice plus que mes autres frères et que ma propre tribu, si hier je t'ai fait du mal, aujourd'hui je t’ai réjoui. Pardonne-moi ce que je fis hier pour ce que j'ai fait aujourd'hui, et laisse là ta reconnaissance et tes reproches ! »
[1] Le lieu nomme Goutha de Damas est, selon les Orientaux, l'un des quatre plus beaux jardins de la terre.
[2] C'est-à-dire Je fus charmé de m'être éloigné de mon pays.
[3] Voyez sur le chapelet des Musulmans une note des Oiseaux et les Fleurs, p. 157, 158.
[4] C'est-à-dire sur sa famille et sur ses compagnons, qui l'aidèrent dans ses victoires. Selon le commentaire, la première de ces deux expressions indiquerait les Mecquois, et la seconde les Médinois.
[5] Petite ville sur l’Euphrate, célèbre par ses vins.
[6] Le mot que je rends par cabaret ou taverne, est dérivé d'une racine qui signifie perte, mort, parce que, dit le commentateur, le cabaret est un lieu où l'on perd l'argent et l'honneur.
[7] Chez les anciens Romains, comme chez les Orientaux, le myrte était consacré à l'amour et à la volupté. Horace, comme Abou-Zeïd, avait du myrte dans le lieu où il buvait.
[8] Les séances 18, 21, 23 25 et 27 sont extraites de cette Revue.
[9] Ville du Diarbekr, près de Mossoul, sur la route de Damas à Bagdad.
[10] Les Arabes invitent quelquefois de cette manière, sans prier personne en particulier.
[11] Horace a dit de même: Arcanique fides prodiga, pellucidior vitro. (Odes. I. 17.)
[12] Nom d'un célèbre chanteur.
[13] Cet Ishac est Ishac ben Ibrahim de Mossoul, qui était un des courtisans de Haroun al-Rachid, et le plus célèbre de son siècle dans le chant. Il a aussi travaillé avec beaucoup de succès à la théorie de la musique arabe.
[14] Excellent joueur de flûte, qui était aussi des familiers de Rachid.
Baktari a dit au sujet de ce musicien et de Banân, célèbre joueur de luth :
« Une vie douce et paisible peut se comparer au jus clair et limpide de la grappe mûrie par la nue bienfaisante, à ce jus vermeil lorsque tu le verses doucement dans ta coupe ; ou au luth de Banân lorsque la flûte de Zunâm accompagne le frémissement voluptueux de ses cordes. »
Cherichi dit que Zonam a inventé l’instrument à vent nommé naï (flûte), et qu'en Barbarie on nomme cet instrument zulâmi, mot évidemment formé de Zonam, le n étant changé en l.
[15] Célèbre devin. Ibn Kelbi dit qu'il vécut trois cents ans.
[16] L'auteur veut parler ici d'une femme dont il est question dans le Coran, sur. CXI. Cette femme était espion des Koraïchides auprès de Mahomet.
[17] On trouve dans bien des poètes arabes des plaintes sur la perfidie des amis. Un de ces poètes a dit :
« Je suis devenu misanthrope à force de connaître les hommes et d'avoir eu des amis les uns après les autres. Je n'ai pas eu un seul ami qui n'ait fini par m'abreuver de chagrins après avoir fait mon bonheur au commencement de notre amitié. Quand je suis venu lui demander son assistance contre un désastre de la fortune, j'ai été forcé de compter cet ami au nombre de mes malheurs. »
[18] Un poète arabe a dit : — « Ne vas trouver que dans la nuit ta bien-aimée; car le soleil est un délateur; mais la nuit cache avec soin les mystères de l'amour; que dis-je? il les conduit, il les couronne. Combien d'amants qui doivent à son voile impénétrable le bonheur de voir leur maîtresse, tandis que l'importun délateur est plongé dans un profond sommeil ! »
[19] Coran. Sur. II., vers. 213.
[20] Ibn Samoun est un prédicateur célèbre. On lui dit un jour : « Tu prêches l'austérité, tu dis qu'il faut renoncer aux vanités du monde, et cependant tu te revêts des plus beaux habits et tu te nourris on ne peut plus délicatement. Comment cela serait-il? — Toutes les fois, répondit-il, qu'il sera utile à ton avancement dans la vie spirituelle de te vêtir d'habits fins et de te nourrir de mets délicats, fais-le sans scrupule. »
[21] Les dernières phrases, que je me dispense de traduire à cause de leur peu d'intérêt, sont accompagnées de cette glose sur Amrou Ben Obaïd. C'était un homme pieux et excellent conseiller. Le kalife Al-Mansour le rencontra un jour et le pria de lui dire quelques paroles d'édification. Si le gouvernement qui est actuellement dans tes mains, lui dit aussitôt Amrou, fût resté dans les mains de ceux qui t'ont précédé, il ne te serait point parvenu. Prends garde à cette nuit qui engendrera un jour qu'une nouvelle nuit ne suivra pas. Ensuite Amrou chanta des vers dont voici la traduction.
« O toi que l'espoir séduit et qui ne penses pas à l'infortune et au chagrin qui peuvent remplir ta vie, ni à la mort qui peut bientôt finir tes jours. Le monde n'est qu'une hôtellerie où les gens de la caravane descendent et se retirent bientôt après. »
A ces mots, Al-Mansour ne put retenir ses larmes.
Lorsque ce kalife apprit la mort d'Amrou, il dit : Il ne reste plus actuellement personne sur la terre dont il faille se cacher. Il alla visiter son tombeau à Murran, et y récita ces vers :
« Que Dieu soit propice à l'âme d'Amrou, dont le corps est déposé dans le tombeau auprès duquel je passe à Murran. Tombeau précieux, tu renfermes les restes sensibles d'un vrai croyant, d'un homme timoré qui a eu la foi la plus vive en Dieu et qui a respecté le Coran. Si le siècle eût laissé subsister un homme de bien, il nous aurait conservé cet homme recommandable. »
[22] Lieu spacieux, autour du palais du roi, où s'assemblent les troupes. D'autres disent que ce sont les boulevards extérieurs d'une ville.
[23] Le katâ est un oiseau qui, dit-on, va à une très grande distance chercher l'eau pour abreuver ses petits, et qui ne manque jamais leur nid. Aussi dit-on en proverbe : Il est mieux dirigé que le katâ. Un poète a dit :
« La tribu de Tamim est mieux dirigée que le katâ dans tout ce qui est digne de blâme ; mais elle s'égare si elle vent essayer de marcher dans la voie des actions généreuses. Si les Bènou-Tamim voyaient, au jour où l'armée ennemie s'avance, une puce montée sur le dos d'un pou, certes ils tourneraient le dos. »
[24] Dans ces vers, l'auteur suit un genre particulier de-versification, dans lequel les vers sont sur deux rimes et sur deux mètres différents, de manière que lorsqu'on s'arrête à la première rime, les vers sont complets, et en s'arrêtant cor b seconde, ils sont également complets.
On a fait autrefois des vers français de cette sorte. On les nommait vers à rime couronnées. En voici quelques-uns de Marot :
La blanche colombelle belle
Souvent le voy priant, criant;
Mais dessus la cordelle d'elle
Me jette un œil friant riant,
En me consommant et sommant
A douleur que ma face efface
Dont suis le réclamant amant
Qui pour l'outrepasse trépasse.
[25] Le dernier vers de cette tirade roule sur l'ingratitude. On lit à ce propos dans le commentaire: « Parmi les exemples d'ingratitude, on peut citer celui-ci que donne Meïdani. Deux jeunes gens, dit-il, allèrent à une partie de chasse. Ils poursuivirent une hyène qui alla se réfugier dans la tente d'un homme, lequel sortit contre eux l'épée à la main. Ils lui dirent : Serviteur de Dieu, pourquoi nous empêches-tu de chasser? Cet homme répondit: Cette hyène s'est mise sous ma protection; je me fais un devoir de la défendre. Ils la laissèrent donc avec cet homme qui, la voyant maigre et souffrante, lui donna du lait matin et soir, en sorte qu'elle devint bientôt grasse et qu'elle reprit toute sa force ; mais tandis qu'un jour il était dépouillé de ses armes et de ses vêtements, elle se précipita sur lui le déchira et but son sang. Un des cousins de ce malheureux fit à ce sujet les vers dont voici la traduction :
« Quiconque prodigue ses bienfaits à celui qui n'en est pas digne éprouve ce qu'à éprouvé le voisin de la hyène. Lorsqu'elle vint se réfugier auprès de lui, il la reçut avec bonté et l'abreuva du lait de ses chameaux. Il en prit le plus grand soin, et lorsqu'elle eut acquis de la force, elle le déchira de ses dents et de ses griffes. Quelle leçon pour ceux qui prodiguent leurs bienfaits à un ingrat! »
[26] C'est une expression proverbiale dont les Arabes se servent pour exprimer le manque de provisions dans une maison. Ils disent aussi : Les rats de cette habitation ont disparu; et, dans un sens contraire: Que Dieu multiplie les rats de cette maison !
[27] C'est Samwal le Juif, fils d'Adin. On raconte de loi qu'Amrou Elkaïs voulant se retirer chez l'empereur grec, laissa en dépôt chez Samwal des cuirasses. Lorsqu’Amrou Elkaïs fut mort, un des rois de Syrie fit la guerre à Samwal. Celui-ci se mit en défense contre lui. Ce roi prit un fils de Samwal qui était avec sa nourrice hors de la forteresse ; il appela ensuite Samwal. Celui-ci vint lui parler. Le roi lui dit: Voilà que j'ai ton fils entre mes mains ; tu sais qu'Amrou Elkaïs est mon cousin et de ma tribu, personne ne mérite donc mieux que moi d'être son héritier. Si tu me livre les cuirasses, c'est bien ; sinon j'égorgerai ton fils. Donne-moi quelque temps pour faire mes réflexions, lui dit Samwal. J'y consens, répondit le roi. Samwal assembla alors ses femmes et toutes les personnes de sa maison, et leur demanda conseil. Chacun fut d'avis qu'il devait donner les cuirasses et délivrer son fils. Un matin, Samwal parut sur les remparts, et dit au roi : Il m'est impossible de te livrer les cuirasses. Je ne suis pas un homme à trahir la foi d'un dépôt. Ainsi, fais ce que tu voudras. La perfidie est un collier qui demeure éternellement: je ne veux pas le prendre. Mon fils a des frères, je tâcherai de me consoler de sa perte. Le roi tua le fils en présence de Samwal, et s'en retourna sans avoir pu, contre son espoir, obtenir les cuirasses. Lorsque le temps de la foire arriva, Samwal ; vint avec les cuirasses et les remit aux héritiers d'Amrou Elkaïs.
[28] Ville entre l'Aderbidjan et Hamadan.
[29] Ibn Gara a dit, en parlant du froid qu'il éprouva à Grenade :
« Tourmenté par le froid, j'ai, sans péché, abandonné le devoir de la prière. J'ai bu du vin, ce qui est défendu ; que dis-je ! je me serais réfugié en enfer, persuadé que la chaleur brûlante qu'on y éprouve est encore plus légère et moins désagréable que ce froid rigoureux. »
[30] Cette tirade déclamatoire me rappelle ce qu'a dit bien plus justement, sur le même sujet, un gentilhomme de vieille et bonne maison :
« Un nom illustré par le mérite ou les services de ceux qui l'ont porté, doit être une lettre de change tirée sur leurs héritiers, bien plus qu'une lettre de crédit en leur faveur. Honorer un homme nul, en considération du mérite de tes ancêtres, c'est prendre la dette pour la quittance. »
(Pensées du lieutenant général marquis de Bouillé.)
[31] Parmi les facéties d'Asmaï, qu'on trouve dans le commentaire arabe, je citerai la suivante :
Asmaï alla un jour voir Jafar Ben Yahia, qui lui dit : « Es-tu marié ? — Non, répondit Asmaï. — Mais tu as du moins une esclave avec laquelle tu vis? — Non, lui répondit encore Asmaï. — Voudrais-tu que je t'en donne une jeune et jolie? — Ah! dit Asmaï, j'avoue que j'en serais charmé. Jafar fit alors sortir une fille extrêmement belle, et lui dit : Je t'ai donnée à cet homme. Il dit en même temps à Asmaï : Allons, prends-la. Asmaï remercia Jafar ; mais la jeune esclave se mit à pleurer et à trembler de tous ses membres. Puis elle dit à Jafar : O mon maître tu me donnes à ce vieillard, si sale et si laid ? Eh bien, dit alors Jafar à Asmaï: Veux-tu que je te donnes en échange mille dinars? Asmaï y consentit. Jafar les lui fit compter, et la jeune fille rentra dans le harem. J'étais mécontent de cette es clave, dit alors Jafar à Asmaï, et j'ai voulu la punir en te la donnant ; mais j'en ai eu ensuite pitié. Il fallait me faire savoir, répliqua Asmaï, ce que tu voulais faire, je serais venu tel que je suis chez moi, car en venant te voir, je m'arrange toujours un peu la barbe et le turban; mais si j'étais venu sans avoir pris ces précautions, je t'assure que cette esclave n'aurait de sa vie rien fait qui t'eût déplu.
[32] Attendu que les noms des sept choses qui y sont mentionnées commencent par un kâf (k).
[33] Lieu entra Hulwân et Bagdad.
[34] Un poète a dit, en opposition à ces vers d'Ibn Sukkarah :
« On désigne plusieurs choses commençant par un kaf comme nécessaires dans l'hiver; mais je crois qu'il n'y a qu'une seule de ces choses qui soit véritablement nécessaire; c'est la bourse (en arabe, kîs), avec quoi on peut se procurer toutes les autres. »
[35] Il y a dans cette séance un grand nombre d'expressions proverbiales disséminées ça et là, expressions qui seraient inintelligibles, si Hariri n'eût pris la précaution de les expliquer lui-même. Je n'ai donné que le sens de ces expressions.
[36] Homme de Médine extrêmement avide. On raconte entre autres choses de lui que des jeunes gens étaient un jour rassemblés en sa maison et plaisantaient avec lui, attendu qu'il riait volontiers et qu'il était aimable; mais ils finirent par l'insulter. Alors pour les attraper, il leur dit : Dans une telle maison, il y a une noce et tout le monde est invité. Ils y allèrent donc. Lorsqu'ils furent partis, il dit en lui-même : Peut-être ce que j'ai dit est vrai. Il les suivit ; mais il ne trouva rien, et les jeunes gens l'ayant entouré, le taquinèrent de nouveau.
On dit qu'il ne voyait jamais deux personnes se parler en secret auprès d'une bière, sans penser que le défunt lui avait peut-être fait quelque legs. Personne ne tirait sa bourse sans qu'il s'imaginât qu'on allait lui donner quelque chose. Il n'y avait pas de mariage dans la ville, qu'il ne nettoyât sa maison, dans l'espoir qu'on vint à se tromper, et qu'on lui amenât la jeune mariée, etc.