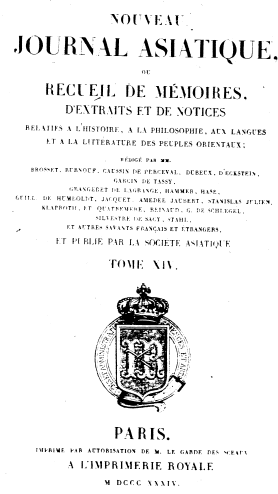
HARIRI
séances
Traduction française : Mr. A. CHERBONNEAU
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
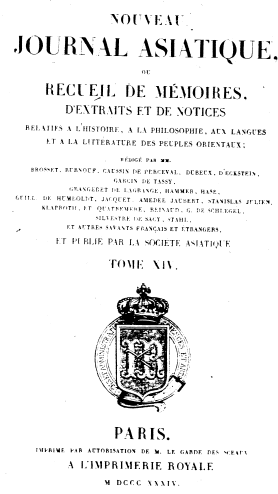
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
Traduite en français, commentée et annotée par M. A. Cherbonneau.
Journal Asiatique, juil.-déc. 1845.
L'ouvrage qui a rendu immortel en Orient le nom de Hariri est le recueil intitulé Mékamat ou Séances, longue suite d'anecdotes dont le héros est un personnage réel, comme l'a ingénieusement prouvé le savant M. Reinaud par une courte notice imprimée dans le tome II, p. 495, du Dictionnaire biographique d'Ibn-Khallican, traduction de M. Mac Guckin de Slane. Fidèle historien d'un aventurier, que son esprit et ses connaissances devaient placer au rang des hommes supérieurs, l'auteur paraît avoir composé, de concert avec lui, ce livre instructif et amusant, que les ouléma de l'Egypte et de la Syrie regardent comme un spécimen complet du génie et de la langue arabes.
Comme composition littéraire, l'œuvre de Hariri manque d'unité. On n'y trouve pas cette liaison, cette suite, cet ensemble visible dont ne sauraient se passer les livres, même les plus capricieux, de notre Occident: tout au contraire, c'est une variété sans limites, avec toute la liberté, ou, si l'on veut, toute la licence orientale; c'est une longue série de scènes sans ressemblance, sans lien nécessaire et seulement juxtaposées. Il n'y faut pas chercher un tissu dramatique, une intrigue un dénouement, à moins que l’on n'accepte comme une intrigue les ébahissements périodiques du touriste Hareth, fils de Hammam, et comme un dénouement suffisant, la fin comique d'Abou Zeïd, qui, des vicissitudes de ce monde, retourne dans sa patrie, dont la paix lui a rouvert le chemin, pour se faire saintement imam de sa paroisse. Quel que soit l'ordre qu'on veuille assigner à ces tableaux, il est à peu près aussi arbitraire que celui qu'Othman imposa aux sourates du Coran en les classant par ordre de longueur. L'intérêt repose sur Abou Zeïd, qui remplit le théâtre tout entier de ses rapides évolutions et de ses singulières métamorphoses.
Du lit de justice d'un kadi débonnaire, vous êtes transporté sur la place publique ; d'un caravansérail, vous passez à une réunion de beaux esprits; vous quittez la mosquée, et vous errez au milieu du désert, où vous vous abritez sous la tente du Bédouin. Le cheikh de Saroudje est aux lieux où vous êtes, il sera encore aux lieux où vous allez. Protée insaisissable, il possède le talent de tromper l'œil qui le connaît. Tour à tour imam ou pèlerin, muphti ambulant ou beau diseur mendiant ou débauché, aveugle ou pied-bot, taille souple ou corps disloqué, rigide censeur ou voleur avide, il sait grimer sa figure et contrefaire sa voix, contourner ses membres et larder son esprit, changer de profession et varier sa morale selon la circonstance. Aujourd'hui vertueux et dévot, il édifie par son humilité ceux que la veille il scandalisait par son cynisme effronté. Tantôt revêtu de haillons, il vante la vie frugale et prêche la charité; tantôt paré des habits de l'opulence, il chante la bonne chère et les joyeux plaisirs. Vivant d'artifices et de bons mots, il raille les sots, dupe les âmes crédules et parvient toujours à mettre les rieurs de son côté.
C'est qu'Abou-Zeïd est un philosophe pratique qui a vu le fond des choses ; il a compris que les mortels ne sont ici-bas que les tristes jouets du destin, que des ombres passagères :
Ὁρω γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ὄντα ἄλλο, πλὴν
Εἴδωλ', ὄσοι πὲρ ζῶμεν ἢ κούφην σκιάν
(Sophocle, Ajax, v. 125.)
Elevé à l'école du malheur, il s'est habitué à regarder la vie comme une lutte permanente où le succès couronne et justifie le plus adroit. De là cette morale tant soit peu relâchée et ces maximes débitées sans vergogne, dont la plus piquante se retrouve dans la bouche du héros de Hamadani. « Je vois que la fortune ne demeure jamais dans un même état et je m'efforce de l'imiter. Un jour elle me fait subir l'effet de sa malignité, et le lendemain c'est elle-même qui éprouve ma malice. » De pareils principes pourraient donner à penser que le vagabond rabelaisien porte un cœur insensible et cuirassé contre les douces émotions; mais un chagrin cuisant s'attache à ses pas errants sur la terre étrangère; c'est le souvenir de la patrie absente.
Lorsqu'il voit, au déclin du jour, s'élever, du creux d'un vallon, la fumée de quelque tente, tout pensif, il se dit: « Heureux celui qui retrouve le soir le foyer domestique et s'y assied au milieu des siens! » Il aime à contempler les palmiers élancés qui se balancent sur la route, il aime à respirer le parfum des fleurs; mais ce ne sont point les fleurs ni les palmiers de son pays, ils ne disent rien à son âme épuisée par la douleur Il rencontre des jeunes filles qui sourient à leur père, mais pas une ne lui sourit. Richesses, patrie, famille, tout lui manque. La barbarie des infidèles lui a ravi les douceurs du climat qui l'a vu naître.
En vain essaierait-on de blâmer les fourberies où l'entraîne la misère, le ressentiment se fond sous le souffle élégiaque qui inspire ses chants, lorsqu'il se prend à déplorer son sort. Entendez-le s'écrier à la fin de la XIVe séance : « Saroudje est mon pays; mais comment y retourner? L'ennemi campe sous ses murs et s'attache à sa ruine. Ma fille, devenue captive, reste au pouvoir des vainqueurs. » Dans la XXXVIe séance, il manifeste avec une éloquence à la fois simple et vraie l'amour du sol natal et la peine qui torture le malheureux proscrit, en récitant cette touchante poésie que nous avons essayé de reproduire mot pour mot en vers français :
Le village où je suis heureux
Pour moi devient une patrie;
Mais la terre absente et chérie
Que j'appelle de tous mes vœux,
La terre où je vis la lumière,
Où coulèrent mes premiers ans,
C'est Saroudj, si justement fière
De ses jardins verts et riants.
Loin d'elle je hais la verdure,
Je hais les ruisseaux, les jardins.
Le sourire de la nature
Semble encore aigrir mes chagrins!....
Dans la XXXIVe séance, il croit toucher au terme de l'exil. Plein d'ardeur, il s'élance sur sa monture et cadence sur un rythme rapide cette gracieuse chansonnette qui trahit l'émotion de son cœur :
A Saroudje, ma brave chamelle; marche la nuit, marche le jour, marche sans cesse!
Là tu fouleras en paix et librement d'abondants pâturages.
Parcours le Téhama, parcours d'un saut le Nadj !
Toi pour qui je donnerais toutes les chamelles de l'Arabie,
Fends l'écorce du sol, galope de désert en désert. Qu'un peu d'eau suffise à ta soif.
Ne t'agenouille pas avant le but, car, je jure sur ma foi,
Je jure par le temple saint aux majestueuses colonnes, que, si tu me ramènes dans ma patrie,
Je te traiterai comme mon enfant.
Enfin, que l'on suive pas à pas le mélancolique Mésopotamien dans les sauvages solitudes du désert comme à travers les campagnes fertiles, sur une mer orageuse comme au milieu d'une île paisible, sur le dos d'un chameau ou sur le pont d'une felouque ; qu'on l'admire à loisir, lorsque, emporté par sa verve drolatique, il déclame, sans pauses ni digressions, les longs récits d'autrefois, ou bien lorsque, pénétré de sa supériorité, il propose aux beaux esprits de l'époque des énigmes, des charades et des gryphes avec art concertes; qu'on s'extasie à le voir jongler en maître avec l'alphabet arabe, et pousser ce talent de gentillesses littéraires jusqu'à composer des tirades de mots dénuées de points diacritiques, ou donner à une épître l'apparence d'une peau de tigre en alternant les lettres mouchetées, c'est-à-dire ornées de points, avec les lettres de trait pur, c'est-à-dire sans points, on lira toujours, dans ses yeux animés par un sourire à peine achevé, ces paroles du poète, paroles désespérantes:
Plus je vis l'étranger, plus j'aimai ma patrie!
(De Belloy, le Siège de Calais.)
Ce qui ne doit pas échapper à un examen sérieux, c'est que le caractère d'Abou Zeïd, quoique varié à l'infini, ne se dément pas un seul instant. Hariri le montre jusqu'à la fin, tel qu'il l'a montré à la première scène. Fidèle, au moins en cela, aux principes vrais et éternels du goût, il lui souffle, pour ainsi dire, les mêmes principes, les mêmes appétits, le même enjouement dans toutes les situations. Il en fait un personnage intrigant par instinct, moraliste à ses heures ; rhéteur par amour-propre, grammairien dans l'occasion ; fripon par nécessité, bigot selon la circonstance ; intolérant par boutades, libertin en secret; parasite effronté, amoureux de la dive bouteille ; quelquefois pathétique, souvent goguenard, toujours bouffon ; frondant les gens en place, humiliant les avares; en un mot, se mettant à l'aise partout où il se trouve, comme s'il lui suffisait, pour payer son écot, de vider, séance tenante, l'écrin merveilleux de son érudition.
Dans la plupart des productions littéraires, le fond est tout, et la forme n'a de prix qu'à la condition d'en être l'expression exacte et complète. Ici, c'est tout différent ; le sujet, ce n'est presque rien, c'est une occasion, c'est un canevas sur lequel viennent s'entrelacer des broderies de tout genre et d'une richesse inconcevable.
............................................... servetur ad imum
Qualis ab incepto processerit, et sibi constet.
(Horace, Art poétique.)
De même que chez nous l'on a composé des pièces à tiroir afin d'exhiber, sans frais d'esprit, certains mimes d'un talent extraordinaire ou spécial, de même Hariri a imaginé une longue série de surprises et de travestissements pour déployer d'une manière moins monotone les trésors de sa science universelle. On pourrait lui reprocher d'avoir poussé le luxe jusqu'à n'employer d'un bout à l'autre de son livre, qu'un style purement artificiel, d'où il résulte que l'attention la plus forte ne saurait, sans fatigue, en soutenir la lecture au delà de vingt pages. Mais si l'on veut bien se reporter à l'époque où Hariri écrivait, et se rappeler que le Recueil de Hamadani, son modèle, faisait alors les délices des ouléma arabes, on verra d'un autre œil ces parades scientifiques, ces escamotages littéraires, cette prestidigitation lexicographique.
Toutefois, des qualités plus importantes que l'agrément de composer des vers avec des mots fiancés (c'est l'expression arabe) ou de les border aux deux extrémités d'une frange pareille, recommandent Hariri à l'estime des littérateurs. Il ne se borne pas exclusivement à versifier des mosaïques de voyelles et de consonnes pour le plaisir des yeux ; de temps à autre, il cède au démon qui l'inspire. Alors s'échappe de ses mains le calam, frivole instrument de ces jeux de patience. Le linguiste minutieux devient poète. Il improvise une ode; il chante, sur un ton sentencieux, la médiocrité, véritable source du bonheur; il trace un tableau touchant de la générosité, symbole de la divinité sur cette terre ; il fait vibrer la lyre plaintive de l'élégie ; il arme son bras du fouet de la satire. Trop souvent peut-être a-t-il abordé Je même sujet ; mais il y a tant de grâce dans le tour, tant de richesse et de variété dans l'expression qu'on trouve encore de la nouveauté dans les pensées qu'il a dix fois reproduites. Son style, quoique empreint du sceau de l'originalité, offre des images puisées dans la nature, des maximes pleines de vérité, des aphorismes d'un sens et d'une application pratique éternels.
Ce jugement préliminaire porté sur l'ensemble de la composition nous conduit naturellement à parler de la nouvelle qui fait l'objet de cette publication. Elle se distingue entre toutes autant par la mise en scène que par la netteté de la diction. Hariri s'y est abstenu d'énigmes, d'anagrammes, de tautogrammes, de logogriphes, d'expressions à double entente, de tours de force sur les points diacritiques, de lectures rétrogrades, de curiosités grammaticales, en un mot, de ces jeux d'esprit que le plus grand talent d'imitation ne saurait faire passer dans une autre langue. Déposant cette fois le faste souvent éblouissant de son érudition, il s'est contenté du rôle de conteur.
Dans la première partie, il expose simplement le sujet, cachant sous l'écorce des mots les plus sérieux une intention bouffonne, et prêtant des manières de gentilshommes à des personnages de la plus infime condition. A la suite du prologue obligatoire, c'est-à-dire des pérégrinations bien et dûment motivées du naïf touriste Hareth, fils de Hammam, vient la cavalcade rencontrée au bord du chemin, puis la description du vieux manoir abandonné probablement par quelque riche seigneur, puis le sermon composé entièrement de mots et même de versets du Coran, que l'ingénieux Abou Zeïd a su approprier à la circonstance. Mais surtout, rien n'est beau comme l'élégie du proscrit. C'est là que le poète de Basra se surpasse lui-même. Ovide, Tibulle, Properce ne sont pas plus touchants. Vers la fin, le prédicateur improvisé laisse tomber sa gravité de comédie et redevient homme; ses pleurs le fout reconnaître par un ami, non moins enthousiaste du vrai talent qu'admirateur éclairé de la fine littérature : dénouement invariable de tous les actes de ce drame, unique en son genre.
Il nous reste à parler de la traduction. Les personnes qui connaissent le livre des Mékamat autrement que par des fragments choisis, n'ignorent pas que les Orientaux les plus instruits ont besoin d'un commentaire pour n'être pas fréquemment arrêtés dans la lecture de
Hariri; ce qui vient, soit des expressions peu usitées, ou figurées, ou énigmatiques que cet écrivain affecte d'employer, soit de la multitude des allusions et des proverbes dont il enrichit ses compositions. A cette difficulté première, se joint celle du style et de certaines associations d'idées qu'il est impossible d'apprécier sans avoir acquis une connaissance profonde de l'arabe. Si donc nous avons entrepris de donner une version de la trentième séance, et d'en commenter les passages qui semblent s'éloigner du monde de nos idées, ce n'est pas que nous ayons prétendu lever toutes les difficultés; il y aurait eu de la présomption de notre part: mais nous avons voulu payer un tribut d'admiration à l'auteur qui fait le charme de nos études.Quelques citations empruntées aux écrivains de l'Occident sont venues se ranger parmi les remarques que nous suggérait l'analyse du contexte. Nous avions à cœur de confirmer par nos recherches, ici comme précédemment1, une vérité reconnue avant nous par les plus illustres savants : que, chez tous les peuples et dans toutes les langues, le génie est le même, quoique soumis à des transformations diverses, et inauguré sous des aspects divers.
Qu'il nous soit permis, en terminant, d'exprimer hautement la reconnaissance dont nous sommes pénétré pour les deux illustres professeurs MM. Reinaud et Caussin de Perceval, dont les doctes leçons nous ont guidé dans l'étude, aussi attrayante que difficile, de la littérature arabe.
Voici ce que racontait Hâreth fils de Hammam :
Je quittai la ville d'Almansour (1) pour me rendre à Sour (2). Lorsque j'y eus acquis de l'aisance et de la considération, et que je fus en position d'élever mes amis comme d'abaisser mes ennemis par l'influence de mon crédit, j'éprouvai pour la cité de Misr (3) le même désir que le malade pour la santé, et l'homme généreux pour assister son prochain.
Dès ce moment, je rompis les liens du séjour (4), et je terminai au plus tôt les affaires qui me retenaient; puis je me mis en route (5), et je partis pour Misr avec la vitesse de l'autruche (6). Enfin, j'y arrivai épuisé et presque mort de lassitude. Au premier coup d'œil, je me passionnai pour cette capitale de l'Egypte, comme le buveur pour le coup du matin, comme le voyageur égaré pour le souffle de l'aurore.
Un jour que j'errais à l'aventure, monté sur un bidet trotte-menu (7), je vis caracoler sur des coursiers de race (8) une société aussi brillante que les flambeaux de la nuit (9). Poussé par l'envie de me divertir, je demandai quelle était cette compagnie, et vers quel endroit elle se dirigeait (10). « Ces gens-là, me répondit-on, ce sont des témoins. Le but de leur voyage, c'est une noce où il y aura foule (11). »
Tel fut alors l'élan de ma joie que, stimulant ma monture paresseuse, je rejoignis le premier groupe des cavaliers, dans l'espoir de prendre part aux largesses nuptiales (12), et de trouver place au gala.
Au bout d'un chemin fatigant, nous arrivâmes devant un édifice de haute structure, dont la cour d'honneur annonçait un maître opulent et noble. On était descendu de cheval, et l'on se disposait à entrer, lorsque j'aperçus la façade (13) tapissée de haillons et couronnée (14) de paniers suspendus(15). A côté de la porte se tenait un personnage assis sur une petite estrade (16) recouverte d'une étoffe de peluche (17). Le frontispice du livre (18), non moins que l'aspect de cette singularité (19), m'intrigua vivement. Alors, voulant tirer augure de ces indices de misère, je m'arrêtai auprès du gardien, si gravement accroupi, et je l'adjurai, par le régulateur des destins, de me nommer le propriétaire de ce bâtiment. Voici quelle fut sa réponse :
« La maison que vous voyez n'a point de possesseur désigné, ni de maître reconnu. C'est le logement (20) des bateleurs (21), des chanteurs de complaintes (22), des mendiants et de toute la gent déguenillée (23). » — Aussitôt je murmurai la formule sacramentelle de l'oraison : « Certes nous appartenons à Dieu. » Ma démarche n'aboutit à rien, et j'ai trouvé un pâturage sans herbe. Puis je songeai à retourner sur mes pas; mais il me parut messéant de repartir tout de suite, et d'être le seul de la cavalcade qui s'avisât de rebrousser chemin. C'est pourquoi je me glissai dans la maison avec autant de répugnance qu'un moineau entrerait dans une cage.
Quelle ne fut pas ma surprise! L'intérieur de l'édifice était décoré de coussins bariolés, de sofas disposés avec art, et de tentures richement drapées. En ce moment s'avança le prétendu : il se pavanait dans son manteau et se prélassait en tête de son cortège. Dès qu'il se fut assis et installé, comme s'il eût été le fils de Mâ-essémâ (24), un maître des cérémonies fit, au nom de la famille du fiancé, la proclamation suivante : « Par les égards dus à Sassân (25), roi des rois et patriarche des chauffeurs de bourse (26), nul n'est plus digne, en ce jour de pompe et d'allégresse (27), de consacrer une pareille alliance, que celui qui a rôdé et vagabondé, grandi et vieilli dans la mendicité. » L'objet de la proclamation obtint l'agrément des parents de la fiancée ; ils permirent qu'on introduisît dans la salle le héros en question.
Aussitôt s'avança un vieillard dont la taille se courbait sous le poids des ans, et que l'hiver de la vie avait blanchi de ses frimas (28). Son entrée produisit sur l'assemblée une sensation si agréable, que chacun se leva et fit un mouvement pour se porter à sa rencontre. A peine eut-il pris place sur le tapis qui lui était réservé, à peine les murmures flatteurs des assistants se furent-ils apaisés par respect pour sa majesté, qu'il s'adossa contre un coussin et passa gravement la main sur sa barbe, puis il dit :
« Louange à Dieu, source première de tout bien (qui prend l'initiative pour faire le bien), qui est merveilleux dans ses faveurs, dont on peut s'approcher quand on a une demande à faire, en qui on met ses espérances lorsqu'on veut les voir réalisées! Louange à Dieu, qui a fixé la dîme sur les biens et défendu de repousser la demande, qui a invité les humains à soulager le nécessiteux, et ordonné de nourrir le pauvre honteux aussi bien que le prochain qui tend la main humblement (29)! Louange à Dieu, qui a désigné dans son livre manifeste ceux de ses serviteurs auxquels est réservée la faveur de s'approcher de son trône (30), et qui a dit (certes sa parole est la plus véridique) (31) : « Et ceux dans la fortune desquels est une part reconnue pour le mendiant et pour l'infortuné (32). » Je le glorifie à cause de la nourriture (33) qu'il nous prodigue avec tant de munificence, et je le supplie de me préserver des vœux faits sans bonne intention (34). J'atteste qu'il n'y a de dieu que Dieu lui seul, et qu'il n'a point d'associé. C'est un Dieu qui rémunère ceux et celles qui exercent la charité (35), qui réprouve l'usure et récompense l'aumône avec usure (36). Je confesse que Mahomet, l'objet de sa miséricorde, est son serviteur et son prophète généreux. Il l'a envoyé ici-bas pour effacer les ténèbres par la lumière, et faire justice aux pauvres contre les riches.
« Sachez donc, ô mes frères ! que le Très-Haut a institué le mariage, afin que vous observiez la continence, et qu'il a prescrit l'union des sexes afin que vous vous multipliiez. Au nombre de ses préceptes se trouve celui-ci : « Fils d'Adam! nous vous avons créés d'un homme et d'une femme, et nous vous avons partagés en familles et en tribus, afin que vous vous connaissiez entre vous (37). » Et Mahomet, que Dieu lui accorde salut et bénédiction ! s'est montré bon pour l'indigent (38); il a abaissé son aile sur l'humble; il a prescrit les parts dues sur le bien des opulents, et il a taxé la dette de ceux qui possèdent envers ceux qui sont dénués de ressources. Que Dieu lui donne une bénédiction qui l'élève au-dessus des autres prophètes et de ses élus les compagnons du banc (39)!
« Or, je vous présente maître Abou Darrâdj Wellâdj, fils de Kairâdj (40), à l'air effronté, au mensonge impudent. Sa voix opiniâtre semble un aboiement fait pour importuner les passants. Il demande en mariage la criarde par excellence, la virago digne d'un tel époux, Qanbas, fille d'Abou'l-Ambas (41), parce qu'il a entendu vanter son insistance à mendier (42), sa bassesse à toute épreuve, son talent à conquérir sa subsistance, et son ardeur à remuer ciel et terre pour obtenir la charité. Il lui offre, à titre de don nuptial, une besace, un bâton ferré, une cruche (43) et une cape (44).
« Agréez, ô mes frères! un prétendant d'illustre renom; qu'il devienne membre de votre famille; et
si jamais vous craignez la misère, Dieu vous rendra riches par les trésors de sa grâce (45). Voilà ce que j'avais à déclarer. Puisse l'Eternel nous accorder à tous un généreux pardon ! Puisse-t-il multiplier vos descendants sur le banc des mosquées, et préserver de l'infortune votre bienheureuse confrérie ! »Ainsi parla le vieillard. A peine eut-il achevé sa khotba et noué les liens (46) de l'hyménée entre les hautes parties contractantes, que toutes les bourses firent pleuvoir à l'envi les pièces de monnaie. Les avares même se laissèrent gagner par l'exemple d'une générosité si spontanée. Un instant après, l'orateur leva la séance et sortit à la tête de sa bande, laissant, d'un air superbe, traîner les larges pans de sa robe (47).
Toutefois, continue Hâreth fils de Hammam, je le suivis autant par esprit de curiosité que pour compléter l'agrément de ma journée; je le vis se diriger, lui et son monde, vers une table longue, que d'habiles cuisiniers avaient servie avec une symétrie irréprochable. Déjà chaque convive avait pris place au festin; déjà chacun pâturait dans son pré, lorsque je saisis l'occasion pour m'esquiver de la foule et me sauver de la mêlée.
Tout à coup le vieillard, se tournant vers moi, me lança un regard en disant: « Où vas-tu donc, vilain? Pourquoi ne pas te joindre en bon vivant à notre aimable société? » Ma réponse ne fut pas moins vive que son apostrophe. « Par celui qui a formé les sept cieux superposés les uns au-dessus des autres, lui dis-je, et qui inonde la terre de la lumière du firmament (48), je ne prendrai pas une bouchée (49), je ne mettrai pas la dent sur une tartelette, que tu ne m'aies nommé le pays où rampait ton enfance (50), et d'où partit le souffle de ta jeunesse (51). »
A ces mots, de gros soupirs s'échappèrent un à un de sa poitrine oppressée, et il se prit à pleurer amèrement. Puis, quand il eut satisfait sa douleur, il invita l'assemblée à garder le silence, et me dit : « Ecoute ! »
Vers. — Saroudje (52) est le pays de ma naissance; c'est à Saroudje que mon enfance prit ses premiers ébats.
Pays fertile, et dont les marchés regorgent de toutes les denrées de prix !
Ses fontaines versent de l'eau de Selsebil (53) ; ses campagnes sont de riants jardins.
Les habitants de Saroudje sont autant d'astres brillants; leurs demeures autant de constellations (54).
Quel zéphir embaumé souffle à travers ses collines! Quel splendide spectacle offrent ses alentours!
Qu'il est enivrant, le parfum de ses fleurs, quand la neige s'est fondue sur la verdure de ses prairies !
A la vue de ma patrie, qui pourrait ne pas s'écrier : C'est ici la place du paradis terrestre!
Les regrets, les soupirs sont l'apanage du proscrit qui s'en éloigne.
Et moi, mon supplice a commencé depuis que les infidèles (55) m'ont banni de Saroudje (56).
Les pleurs brûlent mes paupières ; et, si parfois ma douleur s'apaise, ce n'est que pour se réveiller plus poignante.
Chaque instant me suscite de nouveaux chagrins et des soucis nouveaux.
En vain je m'élance dans la carrière de l'espérance. Fatalité! mes pas s'égarent ou s'arrêtent en chemin!....
Plût à Dieu que le jour de mon exil eût été le jour de mon trépas (57) !
Lorsqu'il m'eut fait connaître son pays natal et qu'il eut récité sa touchante élégie (58), je ne doutai plus que ce ne fût Abou Zeïd, le phénix des docteurs, quoique la vieillesse eût affaissé son corps. Je lui serrai la main cordialement (59), et j'acceptai comme une bonne fortune l'avantage de m'asseoir à sa table.
Tant que dura mon séjour dans la ville de Misr, j'allumai mon falot à la flamme de son génie, et je remplis la conque de mes oreilles des perles de sa conversation (60) jusqu'à l'heure où croassa au-dessus de nos têtes le corbeau de la séparation (61). Alors je le quittai avec autant de regret que la paupière quitterait l'œil.
(1) La ville d'Almansour, c'est-à-dire Bagdad. Le nom par lequel elle est désignée ici est emprunté au prince des croyants, Abou Djafar Abd-Allah al-Mansour, le second des khalifes abbassides, qui en jeta les fondements l'an de l'hégire 145 (de J. C. 762).
(2) La cité de Sour ou Tsour. Nous avons peine à reconnaître dans ce nom celui de Tyr, que nous tenons des Latins; mais si l’on se rappelle que l'y fut jadis ou, si l'on observe que les Latins ont substitué le t au q des Grecs, et que le q avait le son sifflant du th anglais dans think, l'on sera moins étonné de l'altération.
(3) Misr ou mesr, au pluriel amsâr, signifie, dans son acception générale, une province, une grande ville. Cependant, ce mot a été consacré par l'usage pour désigner particulièrement l'Egypte, et plus spécialement encore sa capitale, qui a été nommée successivement Memphis, Babylone et le Caire. C'est ainsi que les Grecs appelaient Athènes, « la ville par excellence. »
(4)
« Les liens du séjour,»  . On
entend par liens du séjour ce qui tient à
l'homme, par exemple la fortune, une femme, des enfants, ou bien
encore une affection de cœur, une profession ou tout autre motif. Un
de nos poètes du siècle dernier s'est servi de la même figure
lorsqu'il disait :
. On
entend par liens du séjour ce qui tient à
l'homme, par exemple la fortune, une femme, des enfants, ou bien
encore une affection de cœur, une profession ou tout autre motif. Un
de nos poètes du siècle dernier s'est servi de la même figure
lorsqu'il disait :
Mon amant est le nœud qui m'attachait au monde.
(Œuvres de Gilbert, p. 78, v. 26.)
(5)
Littéralement: « Je montai à nu (à cru) sur le dos du fils de
l'autruche,  .
Cette image, qui nous paraît à bon droit si bizarre, est employée
fréquemment par les écrivains arabes, soit poètes, soit prosateurs.
Pour se faire une idée bien nette de ce que
Hariri
a
voulu dire, il faut d'abord savoir que la locution
.
Cette image, qui nous paraît à bon droit si bizarre, est employée
fréquemment par les écrivains arabes, soit poètes, soit prosateurs.
Pour se faire une idée bien nette de ce que
Hariri
a
voulu dire, il faut d'abord savoir que la locution
 est
usitée en arabe pour signifier, tantôt chemin, tantôt
cheval. En second lieu, le verbe
est
usitée en arabe pour signifier, tantôt chemin, tantôt
cheval. En second lieu, le verbe
 douzième forme de
douzième forme de
 , a le sens de monter un cheval à
nu.
, a le sens de monter un cheval à
nu.
(6)
L'expression  , vitesse,
rapidité, précipitation, qui a la valeur de
, vitesse,
rapidité, précipitation, qui a la valeur de
 , est le nom d'action de la
quatrième forme du verbe
, est le nom d'action de la
quatrième forme du verbe  djafala,
qui, à la première forme, ainsi qu'à la quatrième, à la cinquième et
à la septième, signifie, d'après le commentaire, « courir vite en
fuyant, »
djafala,
qui, à la première forme, ainsi qu'à la quatrième, à la cinquième et
à la septième, signifie, d'après le commentaire, « courir vite en
fuyant, » 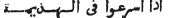
 .
On dit d'un homme craintif qu'il est idjfyl
.
On dit d'un homme craintif qu'il est idjfyl
 , c'est- à-dire,
, c'est- à-dire,
 . Un chameau idjfyl est
celui que le moindre objet effraye et fait fuir à toutes jambes. Par
extension on a désigné « un
. Un chameau idjfyl est
celui que le moindre objet effraye et fait fuir à toutes jambes. Par
extension on a désigné « un
 et
et
 , parce que, dit le scholiaste,
les convives y arrivent en hâte et avec empressement :
, parce que, dit le scholiaste,
les convives y arrivent en hâte et avec empressement :
 . L'analogie aidant, le
mot
. L'analogie aidant, le
mot  djafl a été appliqué
au nuage qui a versé une partie de l'eau dont il était chargé, parce
que, après la pluie, il devient plus léger et plus rapide.
Quant à l'objet de la comparaison, si
Hariri
a
choisi de préférence l'autruche, c'est que la vitesse de cet oiseau
est passée en proverbe. On dit en Orient, et principalement en
Arabie :
djafl a été appliqué
au nuage qui a versé une partie de l'eau dont il était chargé, parce
que, après la pluie, il devient plus léger et plus rapide.
Quant à l'objet de la comparaison, si
Hariri
a
choisi de préférence l'autruche, c'est que la vitesse de cet oiseau
est passée en proverbe. On dit en Orient, et principalement en
Arabie :  , «
celerius currens
quam struthio camelus mas.»
(Voyez Freytag,
Arabum
proverbia,
tom. II, p. 151.)
, «
celerius currens
quam struthio camelus mas.»
(Voyez Freytag,
Arabum
proverbia,
tom. II, p. 151.)
(7) Un bidet trotte-menu. Je crois avoir traduit exactement le texte, parce que je me suis autorisé de l'interprétation du commentateur, qui a dit : « On entend par cheval qatouf celui qui est court d'allure, ou bien celui qui va lentement. »
(8)
Il y a dans le texte : 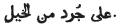 .
L'adjectif adjrad
.
L'adjectif adjrad  dont
le pluriel est djourd
dont
le pluriel est djourd  ,
s'emploie pour qualifier un cheval au poil fin et ras. On sait que
cet état du pelage passe aux yeux des Arabes pour caractériser
l'ancienneté et la noblesse de race chez ces animaux. Le sens que
l'auteur a en vue est: « un cheval arabe pur sang. »
,
s'emploie pour qualifier un cheval au poil fin et ras. On sait que
cet état du pelage passe aux yeux des Arabes pour caractériser
l'ancienneté et la noblesse de race chez ces animaux. Le sens que
l'auteur a en vue est: « un cheval arabe pur sang. »
(9)
Hariri
reproduit cette comparaison dans la
XXXVIe
séance (p. 394, l. 3). Il dit, en parlant d'une société de
beaux esprits :  , « en sorte
qu'ils resplendissaient comme la constellation des Gémeaux. »
, « en sorte
qu'ils resplendissaient comme la constellation des Gémeaux. »
(10)
Littéralement : « Quelle était sa direction. » Le mot
 synonyme
de
synonyme
de  , veut dire un endroit vers
lequel on tourne son visage,
, veut dire un endroit vers
lequel on tourne son visage,  ,
par conséquent vers lequel on dirige ses pas. Régulièrement, il
devrait s'écrire sans waw, comme
,
par conséquent vers lequel on dirige ses pas. Régulièrement, il
devrait s'écrire sans waw, comme
 et
et
 , mais l'usage contraire a
prévalu. Ou lit, par exemple, dans le Koran (sourate
ii, vers. 143), …….
, mais l'usage contraire a
prévalu. Ou lit, par exemple, dans le Koran (sourate
ii, vers. 143), ……. ,
« chaque peuple a une plage vers laquelle il se tourne en priant. »
,
« chaque peuple a une plage vers laquelle il se tourne en priant. »
(11)
 . L'expression imlâh a le
même sens que
. L'expression imlâh a le
même sens que  et
et
 , ainsi on dit: « nous étions à
la noce d'un tel, »
, ainsi on dit: « nous étions à
la noce d'un tel, »  . Suivant le
commentateur, le mot
. Suivant le
commentateur, le mot  , avec un
fatha sur le mim, employé souvent comme synonyme de
, avec un
fatha sur le mim, employé souvent comme synonyme de
 , est un terme particulier à la
tribu de Kelab. M. Freytag, dans son lexique, substitue un kcsra
au fatha, et écrit:
, est un terme particulier à la
tribu de Kelab. M. Freytag, dans son lexique, substitue un kcsra
au fatha, et écrit:  , «
pro quo
melius
, «
pro quo
melius  dicitur.
» Il serait superflu de s'arrêter à l'explication du participe
mechoud
dicitur.
» Il serait superflu de s'arrêter à l'explication du participe
mechoud  , qui a été rendu
avec exactitude par M. Reinbart Dozy dans l'Histoire des Bènou-Ziyan
de Tlemcen (Journ. asiat. juin 1844, p. 406). Avant
lui, M. Et. Quatremère, dont il cite l'autorité, avait mis en
lumière cette expression, qui manque dans nos dictionnaires (Histoire
des sultans mamlouks, tom. I, 1ère
part. p. 149). Quoi qu'il en soit, Peiper, auteur de la traduction
latine des Séances de Hariri, a jeté de l'obscurité sur ce passage,
en se servant d'une périphrase que son latin rend peu intelligible.
, qui a été rendu
avec exactitude par M. Reinbart Dozy dans l'Histoire des Bènou-Ziyan
de Tlemcen (Journ. asiat. juin 1844, p. 406). Avant
lui, M. Et. Quatremère, dont il cite l'autorité, avait mis en
lumière cette expression, qui manque dans nos dictionnaires (Histoire
des sultans mamlouks, tom. I, 1ère
part. p. 149). Quoi qu'il en soit, Peiper, auteur de la traduction
latine des Séances de Hariri, a jeté de l'obscurité sur ce passage,
en se servant d'une périphrase que son latin rend peu intelligible.
(12)
Pendant la cérémonie des noces, et même dans toutes les fêtes de
réjouissance, les Arabes avaient coutume de jeter aux assistants,
comme on le fait encore dans plusieurs contrées de l'Europe, des
gâteaux, des fruits et des pièces de monnaie : ces distributions
s'appelaient louqâth  , de
la racine laqatha
, de
la racine laqatha  ,
qui
signifie « ramasser une chose jetée à terre, ramasser ça et là. » On
les désignait aussi par le mot nouçar
,
qui
signifie « ramasser une chose jetée à terre, ramasser ça et là. » On
les désignait aussi par le mot nouçar
 , de la racine naçara
, de la racine naçara
 , « jeter à terre un à un, jeter
ça et là. » Nous lisons, par exemple, dans l'Extrait du roman
d'Antar, publié par le savant professeur M. Caussin de Perceval, à
la page 180: « Quiconque sortira aujourd'hui
sans emporter de quoi faire largesse, je lui infligerai un châtiment
qui lui sera pénible (qu'il ne choisira pas). » Ailleurs, « Le
roi Zoheir ne. se contente pas du retour d'Antar, il faut encore
qu'il nous ordonne d'aller au-devant de lui et de faire largesse de
drachmes et de dinars. » Plus loin, on rencontre un détail relatif à
la manière de distribuer les largesses : «Alors il jeta sur Schâs et
Antar toutes les pièces d'or que renfermait son mouchoir; mais
Chéiboub, leste comme une panthère effrayée, les attrapa à la volée.
»
, « jeter à terre un à un, jeter
ça et là. » Nous lisons, par exemple, dans l'Extrait du roman
d'Antar, publié par le savant professeur M. Caussin de Perceval, à
la page 180: « Quiconque sortira aujourd'hui
sans emporter de quoi faire largesse, je lui infligerai un châtiment
qui lui sera pénible (qu'il ne choisira pas). » Ailleurs, « Le
roi Zoheir ne. se contente pas du retour d'Antar, il faut encore
qu'il nous ordonne d'aller au-devant de lui et de faire largesse de
drachmes et de dinars. » Plus loin, on rencontre un détail relatif à
la manière de distribuer les largesses : «Alors il jeta sur Schâs et
Antar toutes les pièces d'or que renfermait son mouchoir; mais
Chéiboub, leste comme une panthère effrayée, les attrapa à la volée.
»
(13)
Dehliz  ; on lit dans
quelques exemplaires dehlizan. Ce mot, emprunté par les
Arabes à la langue persane, a été expliqué par M. Et. Quatremère
dans son Histoire des sultans mamlouks.tom. I, 1ère part.
p. 190.
; on lit dans
quelques exemplaires dehlizan. Ce mot, emprunté par les
Arabes à la langue persane, a été expliqué par M. Et. Quatremère
dans son Histoire des sultans mamlouks.tom. I, 1ère part.
p. 190.
(14)
,
 « couronné. » A la seconde
forme, le verbe
« couronné. » A la seconde
forme, le verbe  signifie «
ceindre la tête de quelqu'un d'une îklil
signifie «
ceindre la tête de quelqu'un d'une îklil
 , » et selon Jac. Schultens, «
d'une akilla
, » et selon Jac. Schultens, «
d'une akilla  , »
c'est-à-dire d'un bandeau orné de pierreries ou d'une guirlande de
roses. L'étymologie la plus probable serait alors le mot persan
, »
c'est-à-dire d'un bandeau orné de pierreries ou d'une guirlande de
roses. L'étymologie la plus probable serait alors le mot persan
 goul « rose. »
goul « rose. »
(15)
 , qui fait au pluriel
, qui fait au pluriel
 , a la même valeur que
, a la même valeur que
 , et sert à désigner les paniers
où les mendiants mettent les provisions qu'ils reçoivent dans leurs
tournées. Cette signification ne se trouve pas dans le Lexique de M.
Freytag. Les Arabes, dont la langue est si riche, emploient dans la
même acception le mot
, et sert à désigner les paniers
où les mendiants mettent les provisions qu'ils reçoivent dans leurs
tournées. Cette signification ne se trouve pas dans le Lexique de M.
Freytag. Les Arabes, dont la langue est si riche, emploient dans la
même acception le mot  , qui veut
dire proprement un morceau de cuir taillé en rond, auquel on donne
la forme de sac à l'aide d'un cordon faufilé dans le contour, et qui
sert de récipient au miel qu'on recueille.
, qui veut
dire proprement un morceau de cuir taillé en rond, auquel on donne
la forme de sac à l'aide d'un cordon faufilé dans le contour, et qui
sert de récipient au miel qu'on recueille.
(16)
L'espèce de siège appelé en arabe dekka
 , « estrade, » me paraît ne pas
être autre chose que le tégeos des Grecs.
, « estrade, » me paraît ne pas
être autre chose que le tégeos des Grecs.
(17)
Le mot  qui,
dans la langue moderne, veut dire « velours de soie » (Lettres
sur l'histoire des Arabes avant
l'islamisme, par M. F. Fresnel, p. 18), exprimait autrefois
une couverture de peluche dont on s'enveloppe pour dormir. Les
Espagnols l'ont conservé sans en altérer l'orthographe ni la
signification. Par extension on a appelé
qui,
dans la langue moderne, veut dire « velours de soie » (Lettres
sur l'histoire des Arabes avant
l'islamisme, par M. F. Fresnel, p. 18), exprimait autrefois
une couverture de peluche dont on s'enveloppe pour dormir. Les
Espagnols l'ont conservé sans en altérer l'orthographe ni la
signification. Par extension on a appelé
 qathâif, pl. de
qathâif, pl. de
 qathyfe, une certaine
espèce de gâteaux et de bonbons faits avec de la fleur de farine, du
miel et de l'huile de sésame, parce qu'ils ont l'air d'être couverts
de peluche et ornés de franges.
qathyfe, une certaine
espèce de gâteaux et de bonbons faits avec de la fleur de farine, du
miel et de l'huile de sésame, parce qu'ils ont l'air d'être couverts
de peluche et ornés de franges.
(18) Allusion au frontispice enluminé des manuscrits orientaux, dont la magnificence est ordinairement proportionnée à l'importance et au mérite de l'ouvrage.
(19) Il y a des exemplaires où on lit cette variante : « et la vue de cette nouveauté piquante. »
(20)
Elmasthaba  : c'est
l'hôtellerie où descendent les étrangers et les voyageurs. On lit
dans le Moudjmel : « Les meçâthib sont les boutiques
rangées autour de la mosquée. » Suivant Motarrezy, le singulier du
mot pris dans cette acception est
: c'est
l'hôtellerie où descendent les étrangers et les voyageurs. On lit
dans le Moudjmel : « Les meçâthib sont les boutiques
rangées autour de la mosquée. » Suivant Motarrezy, le singulier du
mot pris dans cette acception est
 . D'autres écrivains veulent que
masthâba, par un ssâd, soit le lieu où se rassemblent
les pauvres et les mendiants :
. D'autres écrivains veulent que
masthâba, par un ssâd, soit le lieu où se rassemblent
les pauvres et les mendiants : 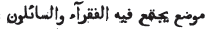
(21)
J'ai cru pouvoir traduire elmouc haqchiqina
 par « bateleurs, farceurs de
tréteaux, saltimbanques, » vu que la définition présentée par le
scholiaste donne à penser que c'est précisément de cette espèce de
gens qu'il s'agit. Voici ce qu'il dit : « La profession des
mouchaqchiqin en Orient, consiste à monter sur un tréteau, et à
dialoguer en vers sur des sujets burlesques. »
par « bateleurs, farceurs de
tréteaux, saltimbanques, » vu que la définition présentée par le
scholiaste donne à penser que c'est précisément de cette espèce de
gens qu'il s'agit. Voici ce qu'il dit : « La profession des
mouchaqchiqin en Orient, consiste à monter sur un tréteau, et à
dialoguer en vers sur des sujets burlesques. »
(22)
Les mouqayifoun  sont les
gens qui vous abordent et qui, pour obtenir la charité, vous
débitent leur généalogie en ces termes: « Je suis un tel, fils d'un
tel, de tel pays. » Plusieurs auteurs ont regardé elmouqayifoun
comme synonyme de elmoutatabbi oun
sont les
gens qui vous abordent et qui, pour obtenir la charité, vous
débitent leur généalogie en ces termes: « Je suis un tel, fils d'un
tel, de tel pays. » Plusieurs auteurs ont regardé elmouqayifoun
comme synonyme de elmoutatabbi oun
 , par la raison que cette
locution usuelle,
, par la raison que cette
locution usuelle,  répond
exactement à cette autre,
répond
exactement à cette autre,  , « il
a parcouru la terre. » Une autre leçon admet qu'il faut entendre par
ce terme les gens qui s'acharnent à vous suivre pas à pas, et qui
mendient en récitant des vœux pour votre bonheur.
, « il
a parcouru la terre. » Une autre leçon admet qu'il faut entendre par
ce terme les gens qui s'acharnent à vous suivre pas à pas, et qui
mendient en récitant des vœux pour votre bonheur.
(23)
D'après la glose, le mot elmoudarouizoun
 , du persan, a passé en arabe,
s'emploie ordinairement pour qualifier les gens de la basse classe
qui exercent les petits métiers,
, du persan, a passé en arabe,
s'emploie ordinairement pour qualifier les gens de la basse classe
qui exercent les petits métiers, 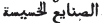 ,
tels que la fabrication des éventails et des amulettes. En remontant
au sens primitif de la racine
,
tels que la fabrication des éventails et des amulettes. En remontant
au sens primitif de la racine  ,
« couture d'habit, » la traduction littérale serait « les rapiécés,
» parce que cette partie de la population porte ordinairement des
vêtements recousus et rapiécés de tout côté. L'opinion d'Ibn el-Araby
confirme cette définition. Il dit qu'on applique aux gens du commun
la dénomination d’« enfants de la couture d'habit, » ou plutôt « des
guenilles cousues. » Mais il y a des commentateurs qui ont prétendu
que mondarouiiz veut dire un homme qui tantôt demeure assis,
tantôt circule sur la place publique, eldarwaze
,
« couture d'habit, » la traduction littérale serait « les rapiécés,
» parce que cette partie de la population porte ordinairement des
vêtements recousus et rapiécés de tout côté. L'opinion d'Ibn el-Araby
confirme cette définition. Il dit qu'on applique aux gens du commun
la dénomination d’« enfants de la couture d'habit, » ou plutôt « des
guenilles cousues. » Mais il y a des commentateurs qui ont prétendu
que mondarouiiz veut dire un homme qui tantôt demeure assis,
tantôt circule sur la place publique, eldarwaze
 , en demandant l'aumône, et que
le verbe quadrilatère
, en demandant l'aumône, et que
le verbe quadrilatère  « mendier
dans la rue, » ou simplement « mendier, » en est une pure
dérivation. Ce qui pourrait me faire croire que cette assertion
n'est pas dépourvue de fondement, c'est l'explication donnée par
Castell au mot dervaze : «
platea urbis;
forum venale in quo semper commercium magnum et ubi pauperes
mendicando versantur.
»
« mendier
dans la rue, » ou simplement « mendier, » en est une pure
dérivation. Ce qui pourrait me faire croire que cette assertion
n'est pas dépourvue de fondement, c'est l'explication donnée par
Castell au mot dervaze : «
platea urbis;
forum venale in quo semper commercium magnum et ubi pauperes
mendicando versantur.
»
(24)
Le fils de Mâ-Essemâ était Mounzir, fils d'Amrou'l-Qaîs, fils de
Nou'mân, fils d'Amrou'l-Qaïs, fils d'Amrou, fils d'A'dy, fils de
Nassar, fils de Rebyia, fils d'El-Hareth, fils d'Amrou, fils de
Nemâra, fils de Lahkm, roi des Arabes. Ce prince descendait des
souverains qui gouvernaient Tekhoum, province de l'Arabie, en
qualité de lieutenants des Khosroès, roi de la Perse, et faisaient
leur résidence tantôt à Khauranek, tantôt à Hira. La glose ajoute
que Mâ-essemâ, mère de Mounzir, dut son surnom de
 , « eau du ciel, » à sa beauté
et à ses grâces merveilleuses ; mais il y eut dans l'antiquité arabe
un autre personnage nommé Aamer, fils de Harithet-Elazedy-Mozeyqya,
qui reçut, à cause de sa libéralité, le même titre pompeux : d'où il
résulte que le lecteur, instruit à la fois et embarrassé par ces
récits différents, ne sait auquel des deux notre auteur fait
allusion.
, « eau du ciel, » à sa beauté
et à ses grâces merveilleuses ; mais il y eut dans l'antiquité arabe
un autre personnage nommé Aamer, fils de Harithet-Elazedy-Mozeyqya,
qui reçut, à cause de sa libéralité, le même titre pompeux : d'où il
résulte que le lecteur, instruit à la fois et embarrassé par ces
récits différents, ne sait auquel des deux notre auteur fait
allusion.
(25)
Sassân est le prince et le souverain de la confrérie des mendiants,
 .
C'est à lui qu'appartient le droit de tailler à chacun de la
besogne, comme aussi de tracer à chacun la route où il doit
opérer :
.
C'est à lui qu'appartient le droit de tailler à chacun de la
besogne, comme aussi de tracer à chacun la route où il doit
opérer : 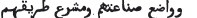 .
.
(26)
J'ai rendu en français echchahhâzin
 , par « les chauffeurs de
bourses, » faute d'équivalent. Ce mot signifie originairement « les
aiguiseurs, » c'est-à-dire ceux qui aiguisent en quelque sorte la
patience des passants en sollicitant leur générosité avec une
insistance de plus en plus importune. On est arrivé à cette
acception au moyen d'une métaphore empruntée au couteau que l'on
repasse : «
, par « les chauffeurs de
bourses, » faute d'équivalent. Ce mot signifie originairement « les
aiguiseurs, » c'est-à-dire ceux qui aiguisent en quelque sorte la
patience des passants en sollicitant leur générosité avec une
insistance de plus en plus importune. On est arrivé à cette
acception au moyen d'une métaphore empruntée au couteau que l'on
repasse : « . Cette explication
pourrait suffire: mais quelques commentateurs ont imaginé que le
mendiant est appelé chekhâz, parce qu'il aiguise et affile
pour ainsi dire son regard sur les passants et sur l'objet qu'ils
tiennent dans leurs mains:
. Cette explication
pourrait suffire: mais quelques commentateurs ont imaginé que le
mendiant est appelé chekhâz, parce qu'il aiguise et affile
pour ainsi dire son regard sur les passants et sur l'objet qu'ils
tiennent dans leurs mains:  . Il
existe en effet une locution qui semblerait confirmer la seconde
hypothèse : chakhasako biaïneïh
. Il
existe en effet une locution qui semblerait confirmer la seconde
hypothèse : chakhasako biaïneïh
 , «
petivit eum
oculo,
il lui a lancé un regard perçant. » Quoi qu'il en soit, la glose se
termine par une remarque dont le but est de critiquer
Hariri
sur
l'emploi d'une expression sans nous en apprendre la signification
propre, « chakhâz en arabe n'a point le sens de mendiant.
, «
petivit eum
oculo,
il lui a lancé un regard perçant. » Quoi qu'il en soit, la glose se
termine par une remarque dont le but est de critiquer
Hariri
sur
l'emploi d'une expression sans nous en apprendre la signification
propre, « chakhâz en arabe n'a point le sens de mendiant.
(27)
 , littéralement: « dans cette
journée marquée de blanc au front et au jarret. » L'intention de
Hariri,
développée par la glose correspondante, trouve une meilleure
sanction dans la remarque que fait Erpénius (Grammaire
arabe,
p.
473) au sujet des mots
, littéralement: « dans cette
journée marquée de blanc au front et au jarret. » L'intention de
Hariri,
développée par la glose correspondante, trouve une meilleure
sanction dans la remarque que fait Erpénius (Grammaire
arabe,
p.
473) au sujet des mots  et
et
 :
«
Haec jam
biga ab equis
talibus,
quibus nihil nobilius illustriusque censetur, permissa ad omnia quae
illustri modo eminent ac praefulgent. »
:
«
Haec jam
biga ab equis
talibus,
quibus nihil nobilius illustriusque censetur, permissa ad omnia quae
illustri modo eminent ac praefulgent. »
(28)
A la lettre : « Dont le jour et la nuit ( )
avaient fait pencher la taille, et dont les deux garçons avaient
fait fleurir l'arbre (
)
avaient fait pencher la taille, et dont les deux garçons avaient
fait fleurir l'arbre ( ).» Le mot
melouân, expliqué dans le commentaire de la XIIe
séance, sert à désigner le jour et la nuit. Quant à l'expression
).» Le mot
melouân, expliqué dans le commentaire de la XIIe
séance, sert à désigner le jour et la nuit. Quant à l'expression
 , « les deux garçons, » s'il
faut s'en rapporter à Hamza el-Isbahany, elle renferme un sens
analogue à
, « les deux garçons, » s'il
faut s'en rapporter à Hamza el-Isbahany, elle renferme un sens
analogue à 
 ,
qui sont autant de synonymes du jour et de la nuit.
,
qui sont autant de synonymes du jour et de la nuit.
(29) C'est un passage du Coran, sourate XXII, verset 87.
(30) Coran, sour. III, vers. 40; sour. XXVI, vers. 41.
(31) Ibid. sour. IV, vers. 89, 121.
(32) Ibid. sour. LI, vers. 19; sour. LXX, vers, 24.
(33) Ibid. sour. XXII, vers. 35.
(34)
Ici Hariri
fait allusion à une réponse en usage chez les Arabes, lorsqu'on veut
se débarrasser des importunités d'un mendiant. Elle consiste en ces
mots :  ,
Dieu te bénisse ! Cette locution est devenue si banale qu'on en a
fait, un substantif. En voici un exemple emprunté au poète Cherichy
:
,
Dieu te bénisse ! Cette locution est devenue si banale qu'on en a
fait, un substantif. En voici un exemple emprunté au poète Cherichy
:

Souvent une vieille femme rouée, hargneuse et prompte à repousser le pauvre,
Pense que je vais me contenter d'un Dieu te bénisse ! lorsque je suis sorti la main droite tendue (pour récolter quelque bonne aubaine).
La langue française offre plus d'un exemple de locutions du même genre employées substantivement, témoin ce passage de Gresset, p. sa de ses œuvres :
Ici Vert-Vert, en vrai gibier de Grève,
L'apostropha d'un la peste te crève !
(35) Voyez le Coran, sour. xii, vers. 88.
(36) Ibid. sour. II, vers. 277.
(37) Ibid. sour. XLIX, vers. 13.
(38) II est à remarquer que le prédicateur improvisé place la confrérie des moines mendiants sous l'invocation de Mahomet, en mémoire de sa générosité exemplaire et de la protection qu'il accordait aux pauvres. On lit à ce sujet dans le savant ouvrage de M. Reinaud (Description des monuments musulmans du cabinet du duc de Blacas. tom. I, p. 374) : « La plus grande partie de l'orge et des dattes que Mahomet récoltait, il l'abandonnait aux pauvres. Il entretenait constamment quarante personnes à ses frais. Quelque chose qu'on lui demandât, il ne disait jamais non. Aussi lui arriva-t-il plus d'une fois de manquer du nécessaire. » On lit aussi dans l'Histoire des Sarrasins, par El-Makin (liv. I, p. 10) : « Il consolait les hommes souffrants, traitait avec charité les pauvres gens. Tout ce qu'on lui demandait, il le donnait. Il était d'une affabilité sans exemple »; et dans le Borda (traduction de Joh. Uri), vers 55 :
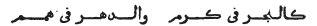
Tanquam mare in liberalitate, et tempos in rebus intentis.
(39) Au rapport de Zamakhschary, ceux qu'on appelait Ashkab essoffah étaient au nombre de quatre cents hommes et faisaient partie des Kouraïschs mouhadjirs (émigrants). Ils occupaient dans la mosquée l'estrade couverte d'un toit et passaient la nuit à étudier le Coran, et le jour à broyer des noyaux de dattes. Aboulféda (Vie de Mahomet, trad. de M. Noël des Vergers, p. 120) leur attribue le privilège d'être considérés comme les hôtes de l'islamisme.
(40)
C'est-à-dire: « le père du rôdeur, »
 ; « celui qui fait métier de se
faufiler partout,
; « celui qui fait métier de se
faufiler partout,  ; « fils de
l'individu que l'on voit sortir à tout instant »,
; « fils de
l'individu que l'on voit sortir à tout instant »,
 .
Dans ces dénominations comiques, dont le poète a fait autant
d'assonances emphatiques, nous aimons à reconnaître les qualités
essentielles d'un mendiant de la
bonne roche. On trouve ailleurs que dans
Hariri de
pareilles bouffonneries. Térence, par exemple, appelle ses
personnages Heautontimôroumenos, Thesaurochrysonicochrisidès, etc.
Lafontaine célèbre les exploits des Rodilard et des Ronge-maille; et
l'auteur du Lutrin n'a pas dédaigné de se faire l'historien du
chantre Brontin et du puissant porte-croix Boirude.
.
Dans ces dénominations comiques, dont le poète a fait autant
d'assonances emphatiques, nous aimons à reconnaître les qualités
essentielles d'un mendiant de la
bonne roche. On trouve ailleurs que dans
Hariri de
pareilles bouffonneries. Térence, par exemple, appelle ses
personnages Heautontimôroumenos, Thesaurochrysonicochrisidès, etc.
Lafontaine célèbre les exploits des Rodilard et des Ronge-maille; et
l'auteur du Lutrin n'a pas dédaigné de se faire l'historien du
chantre Brontin et du puissant porte-croix Boirude.
(41)
Ce qui signifie, dans le langage des mendiants : « Chauffeuse
on Allumeuse, sœur de Grognon. » Suivant la glose,
 a
été formé de
a
été formé de  ,
synonyme de
,
synonyme de  , « flamme. »
L'auteur paraît avoir choisi ce sobriquet, pour qualifier l'héroïne
de la mendicité, parce que sa malignité lui donne l'air d'une flamme
ardente qui brûle tout ce qu'elle touche,
, « flamme. »
L'auteur paraît avoir choisi ce sobriquet, pour qualifier l'héroïne
de la mendicité, parce que sa malignité lui donne l'air d'une flamme
ardente qui brûle tout ce qu'elle touche,
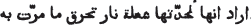 . — Ambas,
. — Ambas,
 , dérivé de
, dérivé de
 ,
« être maussade, renfrogné, » a subi
une transformation analogue, par l'addition d'un noun après
la première radicale.
,
« être maussade, renfrogné, » a subi
une transformation analogue, par l'addition d'un noun après
la première radicale.
(42) Sur l'importunité des moines mendiants, consultez l'ouvrage de M. Reinaud, Description des monuments musulmans, etc. tom. II, p. 277, 278, et l'Essai sur l'histoire de la Perse, par Jourdain.
(43)
 karraz,
et en préposant l'article, alkarraz.
Sous cette forme, le mot a passé dans la langue espagnole :
Alcarraza, cantarilla de barro blanco.
Khalil et Ibn Doreïd en donnent chacun une définition différente. Le
premier pense que, dans le dialecte de l'Irak, un karraz est
un vase à goulot étroit, tandis que l'autre en fait le synonyme de
qarouré, « flacon, » et lui assigne le pluriel
karraz,
et en préposant l'article, alkarraz.
Sous cette forme, le mot a passé dans la langue espagnole :
Alcarraza, cantarilla de barro blanco.
Khalil et Ibn Doreïd en donnent chacun une définition différente. Le
premier pense que, dans le dialecte de l'Irak, un karraz est
un vase à goulot étroit, tandis que l'autre en fait le synonyme de
qarouré, « flacon, » et lui assigne le pluriel
 ;
mais il ajoute qu'il ne sait pas si c'est un terme arabe d'origine
ou arabisé.
;
mais il ajoute qu'il ne sait pas si c'est un terme arabe d'origine
ou arabisé.
(44)
 siqâ, sorte de capuchon dont se couvraient
les moines mendiants (D'Herbelot, Biblioth. orient, p.
298). Abou Delef l'a écrit par un sin, dans son poème sur
Sassân :
siqâ, sorte de capuchon dont se couvraient
les moines mendiants (D'Herbelot, Biblioth. orient, p.
298). Abou Delef l'a écrit par un sin, dans son poème sur
Sassân :

Voyez les poux ! Il y en a deux cents nids dans chaque capuchon.
(45) C'est un passage du Coran, sour. IX, v. 18.
(46) Littéralement : « Quand il eut consolidé pour le gendre le nœud de sa fiancée. » Virgile avait déjà employé cette métaphore dans son Enéide, liv. iv, v. 16 :
Nec cui me vellem vinclo sociare jugali.
Plus tard, Clément Marot disait, en s'adressant à une jeune dame (p. 21 de ses Œuvres choisies) :
Doncq si vous voulez vostre blonde jeunesse
Joindre et lyer à sa grise vieillesse ! —
(47)
En arabe,  , pluriel de
, pluriel de
 ou
ou
 . Le sens propre est : « la
partie inférieure d'un vêtement quelconque, et surtout d'une
chemise. » La racine est
. Le sens propre est : « la
partie inférieure d'un vêtement quelconque, et surtout d'une
chemise. » La racine est  , «
être bas, être en bas. » On entend par zalzil la partie d'un
vêtement qui traîne à terre. Quoi qu'il en soit, Peiper a traduit
zalâzil par tritas manicas.
, «
être bas, être en bas. » On entend par zalzil la partie d'un
vêtement qui traîne à terre. Quoi qu'il en soit, Peiper a traduit
zalâzil par tritas manicas.
(48) C'est encore un passage du Coran, sour. LXV, v. 13. Comparez la Description des monuments musulmans, etc. par M. Reinaud, t. II, p. 876; et le Commentaire de Beïdawy, édit. de M. Fleischer, p. 46, l. 22.
(49)
 limâqan
tient ici la place de
limâqan
tient ici la place de  . D'après
Alsirafi, limâq s'emploie indifféremment lorsqu'il s'agit de
manger ou de boire. Voici un vers de ce poète où l'on, doit le
traduire par gorgée, goutte d'eau :
. D'après
Alsirafi, limâq s'emploie indifféremment lorsqu'il s'agit de
manger ou de boire. Voici un vers de ce poète où l'on, doit le
traduire par gorgée, goutte d'eau :

On dirait un éclair dont la lueur propice réjouit l'œil sans donner aux hommes dévorés par la soif une seule goutte d'eau (à boire).
(50) Les images puisées dans la nature sont du domaine de toutes les langues. Le poète Prudence a peint avec le même trait les premiers pas de l'enfance :
Sic variat natura vices, infantia repit.
(51) C'est-à-dire : « où ta jeunesse prit son premier essor. » Il y a dans cette métaphore quelque chose d'insolite qui fait que l'on ne saisit pas tout d'abord l'intention du poète. Les commentateurs ont pris soin de l'expliquer à propos d'un passage de la XXXVIe séance, où elle a été reproduite par l'auteur :
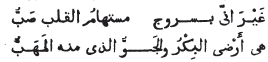
Mon cœur n'a d'amour que pour Saroudje, objet de mes regrets ; car Saroudje est ma terre vierge (ma patrie) et l'atmosphère d'où est parti mon souffle.
En d'autres termes : « d'où je suis sorti, ou bien où j'ai commencé à respirer. »
Hariri prête au mot mahabb la signification de heboub, qui n'est autre chose que l'action de sortir et de faire son apparition loin de sa terre natale. La métaphore est tirée de cette locution : heboub er-ryhh, « le souffle du vent, » son action de se précipiter.
(52) La ville de Saroudje, mentionnée au tome II de la Géographie d'Edrisi (trad. de M. Amédée Jaubert, p. 129, 136, 142, 1 55), est située aux environs de Harran. On la vante pour la beauté de ses eaux et de ses jardins (voir Abulf. Descript. Mesopotam. Specimen, édit. de Frid. Tuch, note 232). Aboulfaradj cite plusieurs événements relatifs à son histoire (Hist. des dynasties, p. 245, 271, 280). Le savant Kœhler en parle aussi dans son ouvrage qui a pour titre : Abulf. Tabula; Syriae, p. 38 et 126, et fait remarquer que son ancien nom était Bathnas. Il s'appuie toutefois sur l'autorité d'Assemani, qui a traité la question dans sa Bibl. orient, t. I, p. 285; et t. II, in diss. de Menophysltis, à l'article Sarudj.
(53) Fontaine du Paradis, dont il est question dans le coran, sour. LXXVI, vers. 18.
(54) En traduisant les mots d'après l'ordre qu'ils occupent dans le texte, j'obtiens pour résultat une construction qui ressemble moins à une phrase qu'à une proportion géométrique dont les conséquents correspondent réciproquement à leurs antécédents, comme on le voit ci-dessous :
Et ses Enfants et leurs Demeures sont des Astres et des Constellations.
Les
Arabes ont appelé cet arrangement de mots
 tertib, et plus
spécialement encore
tertib, et plus
spécialement encore  leff
oua nachar. Or cet artifice de la rhétorique arabe
consiste à rassembler deux objets dans le premier membre d'une
proposition, puis à énoncer la somme de leurs attributs dans le
second membre, de façon que l'auditeur ait à restituer à chaque
objet la qualité qui lui convient :
leff
oua nachar. Or cet artifice de la rhétorique arabe
consiste à rassembler deux objets dans le premier membre d'une
proposition, puis à énoncer la somme de leurs attributs dans le
second membre, de façon que l'auditeur ait à restituer à chaque
objet la qualité qui lui convient :

Le Coran offre un exemple du leff oua nachar, sour. XXVIII, v. 73 :
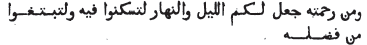
Mais Dieu, par l'effet de sa miséricorde, vous a donné la nuit et le jour, tantôt pour vous reposer, tantôt pour demander à sa bonté des richesses, par le travail.
Notre langue ne manque pas de tournures de ce genre. Je dois à l'obligeante érudition de M. Grangeret de la Grange la citation suivante, empruntée au poète Lebrun. (Veillées du Parnasse.) Il est question de Protée :
Rappelant de son art les merveilles en foule,
Tigre, flamme, torrent, gronde, embrase, s'écoule.
Le
commentateur de Hariri
ajoute (p. 332, fig. 5 et 7) deux exemples à l'appui de la
démonstration que je viens d'exposer. Ici devrait s'arrêter mon
observation, déjà un peu étendue ; mais comme je tiens à fixer d'une
manière décisive le sens du vers qui attire notre attention, je
signalerai l'erreur commise par G. Jones au sujet du mot
 , qu'il a écrit avec un hamza
après le waw. L'illustre auteur du Commentaire sur la poésie
asiatique
cite, au chapitre des Descriptions, les sept premiers vers du
chant d'Abou Zeïd, comme un modèle de grâce, sous le rapport du
style et des images, et nous en donne une traduction latine assez
exacte ; mais il a rendu benou par aedificia, et
, qu'il a écrit avec un hamza
après le waw. L'illustre auteur du Commentaire sur la poésie
asiatique
cite, au chapitre des Descriptions, les sept premiers vers du
chant d'Abou Zeïd, comme un modèle de grâce, sous le rapport du
style et des images, et nous en donne une traduction latine assez
exacte ; mais il a rendu benou par aedificia, et
 par mansiones, sans
s'occuper du pronom pluriel qui vient après le second mot, ce qui
constitue, d'un côté, un pléonasme insignifiant que
Hariri
ne
peut pas même avoir eu dans l'esprit, et de l'autre un contresens
dont G. Jones reste seul responsable.
par mansiones, sans
s'occuper du pronom pluriel qui vient après le second mot, ce qui
constitue, d'un côté, un pléonasme insignifiant que
Hariri
ne
peut pas même avoir eu dans l'esprit, et de l'autre un contresens
dont G. Jones reste seul responsable.
(55) Ouloudj, pluriel de ildj, par un aïn, est le nom que les musulmans assignent aux infidèles de l'Orient ou de l'Occident. Comparez les Invasions des Sarrasins en France, par M. Reinaud, p. 282.
(56) Saroudj était tombé entre les mains des Francs en 494 de l'hégire (de J. C. 1101), à la suite d'une victoire qu'ils avaient remportée sur Socman, fils d'Ortoc, prince de cette ville. (Ibn Kkalduni Narratio de expedit. Francorum, p. 14.)
(57) Ibn Khallican (texte arabe, édit. de M. Mac Guckin de Slane, t. I, p. 47) cite un vers du poète cordouan Abou 'Omar Ahhmed ben Abd Rabbihi ben Hhabyb ben Hhodayr ben Salim, affranchi de Hechâm ben Abd-Er-Rahman ben Moawyah ben Hecham ben Abd el-Melik ben Merouân ben el-Hhakem l'omeyyade, que l'on aimera à rapprocher du vers de Hariri :

« Le jour de la séparation est le plus déchirant de la vie.
« Plût au ciel que je fusse mort avant le jour de la séparation !
(58) Les accents déchirants du pauvre Abou Zeïd nous rappellent les plaintes aussi harmonieuses que naïves d'un de nos poètes que les devoirs de sa position retenaient à Rome, loin de l'Anjou, sa chère patrie :
Je me pourmène seul sur la riue latine,
La France regrettant, et regrettant encor
Mes antiques amis, mon plus riche thrésor,
Et le plaisant séiour de ma terre angeuine.
Je regrette les bois et les champs blondissans,
Les uignes, les jardins et les prez verdissans
Que mon fleuve traverse.
(Les regrets de Joachim du Bellay, t. II de ses œuvres. p. 387.)
(59) A la lettre : « Je m'avançai pour échanger avec lui une poignée de main, » et non pas pour l'embrasser, in amplexum, comme l'a traduit Peiper. « En se prenant la main, dit Burckhardt (Voyage en Arabie, tom. I, p. 474), les habitants du Hedjaz s'empoignent mutuellement le pouce, le pressent et recouvrent la main trois ou quatre fois. C'est ce qu'on appelle mesafehha. » Tel était, au rapport des historiens, l'usage de Mahomet.
(60) Lisez le Borda, vers 67.
(61) Voyez la XXVIe séance, p. 267, comment. l. 9; et la XLVIe, p. 530, l. 5.
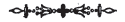
EXTRAIT DE LA
Histoire et Mémoires de l’Institut Royal, Académie des inscriptions & belles-lettres, tome IV, 1818.
Je n'ai pas trouvé de gain plus facile, de subsistance plus agréable, de profession plus lucrative, de ruisseau dont l'eau soit plus pure, que le métier institué par Sasan, et dont il a imaginé diverses modifications ............... C'est un commerce qui ne languit jamais, un réservoir dont l'eau ne s'épuise point, un flambeau à la lueur duquel se rassemblent un grand nombre d'hommes, et qui éclaire les aveugles et les borgnes. Ceux qui exercent cette profession, sont le peuple le plus heureux, la race la plus fortunée ....... Ils n'ont point de demeure fixe, ils ne craignent aucune autorité : il n'y a nulle différence entre eux et les oiseaux qui se lèvent le ventre creux et se trouvent au soir la panse pleine ............. Mais la première condition pour exercer cette profession, c'est de se donner beaucoup de mouvement ; la première qualité requise, c'est une grande activité. Un esprit fécond en ressources doit être le flambeau de celui qui l'embrasse ; l'impudence, l’armure dont il faut qu'il soit muni .......
Ne vous lassez donc point de chercher, ne vous rebutez pas de faire toute sorte de diligence ; car il était écrit sur le bâton de notre chef Sasan : Quiconque cherchera, trouvera ; quiconque ira et viendra, obtiendra.
EXTRAIT DE LA
Revue orientale et algérienne, 1858.
A l'époque où Hariri fit ses études, la ville de Bassora conservait encore quelques restes de son ancienne splendeur. Il a tracé dans sa dernière Mékâma un aperçu de l'aspect que présentait alors cette ville célèbre, exclusivement occupée de commerce et d'études littéraires.
[2] Ses lumières jamais n'étaient d'ombre offusquées.
Les flambeaux de l'esprit brillaient dans ses mosquées ;
Ses fontaines étaient des sources de savoir ;
Et comme les troupeaux courent à l'abreuvoir,
Des gens de tous pays et de toutes naissances
Y venaient étancher leur soif de connaissances.
Les voûtes résonnaient du doux bruit des Sélams ;
Les parchemins criaient sous le bec des calams !
Tous ceux qui de talent pouvaient donner un gage,
Cueillaient dans ses jardins les fleurs du beau langage;
Moissonnaient dans ses champs des gerbes d'heureux tours,
Et péchaient dans ses eaux les perles du discours.
« Jamais le culte impur du feu — n'y vint arborer ses symboles. — Les habitants de ce beau lieu, — ennemis jurés des idoles, — n'adoraient d'autre dieu que Dieu. — Bassora fourmillait d'écoles, —de palmiers aux verts éventails, —de vastes caravansérails, — de glorieuses métropoles. — On y rencontrait par milliers — les chameaux et les chameliers, — les chevaux et les cavaliers, — les bateaux et les bateliers, — les bergers avec leur houlette, — les archers avec l'arbalète, — les seigneurs avec leurs valets, — tes pêcheurs avec leurs filets, — les marchands avec leurs balances —et les lanciers avec leurs lances. — Le Tigre y monte avec le flux — et s'abaisse avec le reflux. »
[1] Motarrézi, commentateur de Hariri, explique ainsi le mot Sasan :
Sasan, dit-il, est le chef des mendiants et leur patron. Le Sasan dont il s'agit est Sasan l’ancien, fils de Bahman, fils d'Esfendiar, fils du roi Ghischtasf. Voici comment son histoire est racontée par Ibn Almokanna (lisez Al-Mokaffa, auteur d’une trad. arabe des Fables de Bidpaï, connue sous le nom de Calila et Dimna). Quand Bahman fut près de mourir, il fit venir sa fille Homaï, qui était enceinte. Elle surpassait tous les mortels en beauté, et personne, parmi les Perses de ce temps-là, ne l'égalait en sagesse. Ensuite le roi se fit apporter la couronne, la mit sur la tête de sa fille, et la déclara reine après lui, ordonnant que, si elle mettait au monde un enfant mâle, elle conserverait l'administration du royaume, jusqu'à ce que son fils eût atteint l'âge de trente ans, époque à laquelle elle lui remettrait le gouvernement. Sasan, fils de Bahman, était un homme d'une belle figure, bien élevé, et plein de sagesse et de toute sorte de perfections ; personne ne doutait qu'il ne dût hériter du trône. Bahman ayant donc disposé de son royaume en faveur de Homaï, sœur de Sasan, celui-ci en ressentit un dépit violent, s'en alla, acheta des brebis, les conduisit lui-même vers les montagnes, et s'occupa à les faire paître, habitant au milieu des Kurdes, le tout par un effet de la colère qu'il avait conçue, à cause du mépris que son père avait témoigné pour lui en lui ôtant la couronne pour la donner à sa sœur. Depuis ce temps jusqu'à ce jour, le nom de Sasan a été pris métaphoriquement pour indiquer un homme qui conduit un troupeau de brebis, et l'on dit Sasan le Kurde, ou Sasan le berger. On dénomme de là Sasani tout homme qui mendie, ou qui fait un métier vil, comme les aveugles, les borgnes, les joueurs de gobelets, ceux qui dressent et montrent des chiens ou des singes, et les autres gens de cette espèce, quoiqu'ils ne descendent pas de ce Sasan. Le nombre de ces hommes est très grand, et il y en a beaucoup de classes et d'espèces différentes. Abou Dolaf Khazradji en parle dans le poème où il décrit, en les faisant parler eux-mêmes, tous leurs métiers, leurs jongleries, leurs contes, et l'argot dont ils se servent entre eux. Ce poème, connu sous le nom de Sasaniyyeh, a été commenté par Saheb ben Abbad ; en le lisant, on y trouvera dans le plus grand détail ce que j'ai dit en raccourci.
[2] Hariri est un auteur intraduisible en prose comme en vers ; mais de ces deux formes la prose courante était peut-être encore la plus perfide. Nous nous sommes permis de le translater en vers ou en prose rimée. Une imitation infidèle est souvent plus propre qu'une copie fidèle à refléter la manière d'un écrivain chez qui ta ferme est tout et la pensée presque rien.