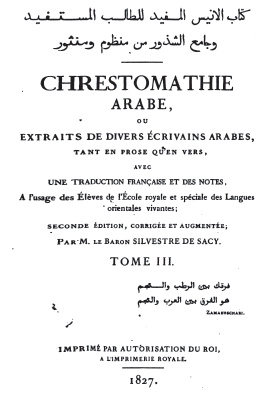
HARIRI
séances
Traduction française : Mr. Silvestre de SACY, S. MUNK,....
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
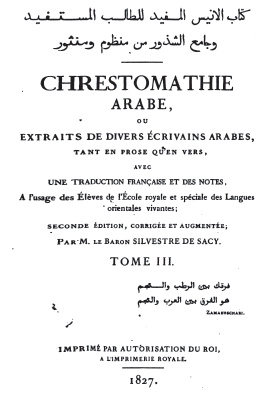
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
Silvestre de Sacy, Chrestomathie arabe, tome III, 1827
Voici ce que racontait Hareth, fils de Hammam: J'étais dans l'intention de partir de Barkaïd (2) ; mais comme je voyais approcher et luire déjà les premiers instants de la grande solennité (3), je ne jugeai pas à propos de quitter cette ville, sans y avoir passé le jour de la fête. Lorsque ce grand jour fut venu, avec les rites et les cérémonies religieuses prescrites par la loi ou inspirées par la dévotion (4), et qu'il fut arrivé accompagné de toute sa pompe et de tout son éclat (5), je pris, me conformant à la sainte tradition, des vêtements neufs, et je me joignis à tous ceux qui sortaient de leurs maisons, pour prendre part à la solennité. Quand tout le monde fut assemblé sur le Mosalla (6), et rangé convenablement, au moment où la foule interceptait la respiration (7), un homme parut vêtu d'un double manteau, et dont les deux yeux fermés ne laissaient point apercevoir la prunelle. Il portait au bras une espèce de gibecière (8), et se faisait conduire par une vieille femme qu'on eût prise pour un ogre (9). Cet homme s'arrêta, comme s'il eût été prêt à rendre l'âme ; il salua l'assemblée d'une voix basse; et quand il eut fini ses compliments et ses vœux, il mit (10) la main dans son sac, et en tira divers papiers (11) écrits en toutes sortes de couleurs et à loisir : il les remit à la vieille, courbée sous le poids des années, et lui ordonna de chercher dans l'assemblée ceux qu'elle croirait susceptibles d'être dupés (12), et de présenter un de ces papiers à chacun de ceux dont la main lui semblerait familiarisée avec les actes de bienfaisance. Or le destin, qui est si souvent l'objet des reproches des mortels (13), permit qu'il m'échût un de ces papiers, où étaient écrits les vers que voici :
« Accablé que je suis sous les coups réitérés des maux et des alarmes (14) victime tour-à-tour des superbes, des perfides et des méchants,
» Et de l'infidélité d'un faux frère, qui sous l'apparence de l'amitié me hait parce que je suis indigent, et des efforts malins que font les gens en place pour défigurer et envenimer toutes mes actions (15);
» Combien de fois, la haine, la misère et la fatigue des voyages ne me font-elles pas endurer des peines cuisantes ! combien de fois je marche couvert de haillons, sans qu'il se trouve un cœur sensible à ma misère (16)!
» Ah ! plût au ciel que la fortune cruelle, quand elle m'a choisi pour le but de ses traits, m'eût enlevé mes enfants ! S'ils n'étaient pas mes chaînes, s'ils n'étaient pas mes douleurs,
» Certes je n'aurais jamais colporté mes espérances chez les grands et les puissants, ni traîné ma robe dans le sentier du déshonneur (17).
» J'eusse choisi mille fois le séjour de ma retraite obscure (18), et mes haillons m'eussent semblé mille fois préférables (19).
» Est-il donc un homme généreux qui veuille soulager ma peine par le don d'une pièce de monnaie, et éteindre les flammes dévorantes de mes soucis, en m'accordant quelques hardes pour couvrir ma nudité! »
Lors donc, continuait Hareth fils de Hammam, que j'eus examiné en entier le riche tissu de cette pièce de vers, je conçus un vif désir de connaître celui qui l'avait ourdi et qui en avait brodé les bordures. Je pensai en moi-même que cette vieille pouvait seule me servir d'introductrice auprès de lui, et je me dis que si la loi proscrit le salaire des devins, elle ne défend pas de payer celui qui nous instruit de ce que nous ignorons (20). Je la guettai donc, tandis qu'elle parcourait l'un après l'autre tous les rangs de l'assemblée, et qu'elle s'efforçait de faire couler une pluie abondante d'aumônes des mains des assistants : ses peines n'avaient cependant pas un grand succès, et les bourses ne s'ouvraient pas pour elle (21). Quand elle vit que ses prières et ses sollicitations étaient infructueuses (22), et qu'elle fut lasse de parcourir ainsi tous les rangs, elle invoqua, par la formule accoutumée, la protection divine (23), et commença à retirer les papiers des mains de ceux qui les avoient reçus; mais le Diable lui "fit oublier le mien: elle ne vint pas à la place où j'étais, et retourna trouver le vieillard, pleurant amèrement sur le mauvais succès de ses peines, et donnant une libre carrière à ses plaintes contre la rigueur de la fortune. Le vieillard se contenta de dire (24) : Nous sommes à Dieu ; je remets tous mes intérêts entre ses mains: en lui seul est la force et le pouvoir.
« Il ne reste plus en ce jour ni âme sincère, ni ami loyal, ni ruisseau dont les eaux soient pures (25) ni protecteur secourable.
» Les vices mettent aujourd'hui tous les hommes de niveau ; il n'est plus ni confident fidèle, ni homme auquel ses vertus donnent du prix (26). »
Puis s'adressant à la vieille: Laisse ton âme, lui dit-il, concevoir une meilleure espérance, et se promettre un plus heureux avenir; rassemble tous mes papiers et compte-les. Ah ! dit-elle, je les ai comptés après les avoir repris, et j'ai trouvé un mécompte; il nous en manque un. Malheureuse, s'écria le vieillard, que tous les maux tombent sur toi! Misérable, qu'as-tu fait ! faut-il donc que nous perdions en même temps le gibier et les rets, la mèche avec le charbon qui devait servir à l'allumer ! Hélas! plaie sur plaie, misère sur misère (27) ! A ces soupirs, la malheureuse retourna sur ses pas pour chercher le papier. Lorsqu'elle fut près de moi, je joignis au papier une pièce d'argent et une menue monnaie. Si tu veux, lui dis-je en lui montrant la pièce d'argent, cette pièce qui brille et qui porte une empreinte (28), révèle-moi le secret qui m'est caché ; si tu ne veux pas satisfaire ma curiosité, contente-toi de cette monnaie informe, et va-t-en. La grosse pièce pleine et blanche comme l'astre des nuits, excitant ses désirs, elle ne demandait pas mieux que de la recevoir. Point de contestation, me dit-elle, demande ce que bon te semblera. Je lui fis alors des questions sur ce vieillard (29), lui demandant de quel pays il était, et je voulus aussi savoir quel était celui qui avait tissu la riche étoffe des vers que j'avais lus. Le vieillard, me dit-elle, est de Saroudj, et cette broderie est son ouvrage ; puis elle saisit la pièce d'argent, comme l'épervier saisit sa proie, et disparut avec la rapidité de la flèche que l'arc a lancée.
Sur le champ il me vint en pensée que ce vieillard n'était autre qu'Abou-Zeïd, et je sentis un vif chagrin du malheur qu'il avait eu de perdre la vue. J'aurais bien voulu pouvoir l'aborder aussitôt et lui parler, afin de vérifier ma conjecture (30) mais je n'aurais pu arriver jusqu'à lui, qu'en passant sur le corps des assistants (31) ; ce que la loi ne permet pas. Craignant donc de blesser quelqu'un et de m'attirer quelque juste reproche, je demeurai à ma place, les yeux invariablement fixés sur lui, jusqu'à ce que la khotba fût achevée, et qu'il fût permis de s'en aller: je courus alors vers lui; et l'ayant reconnu quoique ses yeux fussent cachés par ses paupières, je m'assurai que j'avais rencontré aussi juste que le fils d'Abbas, et deviné avec autant de sagacité qu'Iyyas (32). Je me fis donc connaître à lui, je lui offris un de mes vêtements, et l'invitai à venir partager mon repas. Il fut charmé de se voir reconnu de moi, et de mon offre obligeante, et accepta avec empressement mon invitation. Nous partîmes sur le-champ: ma main lui servait de guide et mon ombre de précurseur. Avec nous était la vieille, tiers assez importun, et telle qu'un compagnon inséparable auquel on ne peut rien cacher (33). Quand il se fut établi dans ma demeure (34) et que je lui eus servi à la hâte un repas proportionné à mes facultés : Hareth, me dit-il, n'y a-t-il point ici de tiers avec nous! Non, répondis-je, si ce n'est la vieille. Pour elle, me dit-il, il n'y a point de secret; et à l'instant même, ouvrant les yeux, il fit jouer ses prunelles : les deux flambeaux de son visage brillaient comme deux astres (35). Charmé de voir qu'il n'avait point perdu, comme je l’avais cru, l'usage de la vue, mais extrêmement surpris de sa conduite, je ne pus me retenir, et cédant à mon impatience: Quel motif, lui demandai-je, t'a donc engagé à contrefaire l'aveugle, tandis que tu cours dans les lieux déserts, que tu traverses les solitudes et que tu t'enfonces dans des routes périlleuses (36) ! Cependant il faisait comme s'il n'eût pas pu parler (37), et ne s'occupait qu'à manger les mets que je lui avais offerts. Son besoin étant apaisé, il tourna ses regards vers moi et me chanta ces vers :
« Puisque le sort, père de tous les humains, a pris à tache, dans ses démarches et sa conduite, de s'aveugler pour ne pas voir le droit chemin,
» Je l'ai imité en contrefaisant l'aveugle, en sorte qu'on jugerait que je le suis véritablement. Qu'un enfant agisse comme son père, cela n'a rien de surprenant (38). »
Puis il ajouta : Va, je te prie, dans ton office, et apporte-moi des cendres de kali (39), qui réjouissent la vue, nettoient les mains, adoucissent la peau, embaument, parfument et rafraîchissent l'haleine, affermissent et fortifient les gencives, corroborent l'estomac ; qu'elles soient dans un vase propre, qu'elles répandent une bonne odeur, qu'elles soient fraîchement broyées et réduites, en poudre très fine; qu'on puisse croire, en les touchant, que c'est une poudre destinée à former un collyre, et les prendre, en les flairant, pour du camphre: joins-y un cure-dent (40), pur dans son origine, agréable dans l'usage, d'une jolie figure, qui excite à manger, mince comme l'homme que l'amour consume, poli comme une épée et comme l'instrument des combats (41) flexible comme un vert rameau. Je me levai promptement, et j'allai chercher ce qu'il demandait, pour purifier sa bouche de l'odeur désagréable des aliments. J'étais loin de soupçonner qu'en me faisant passer dans l'office, il voulait me jouer un tour, et je n'imaginais pas qu'il se moquait de moi, en m'envoyant quérir un cure-dent et des cendres de kali : mais quand je rentrai, en moins de temps qu'il n'en faut pour respirer, avec ce qu'il m'avait demandé, je trouvai la place vide; le vieillard et sa vieille compagne avoient disparu. Son artifice me mit en colère ; je suivis longtemps ses traces : mais je ne le trouvai pas plus que s'il eût été submergé dans les eaux ou enlevé subitement dans les nues (42).
N.B. : Les notes ne sont reproduites que partiellement..
(1) Lors de la première édition de ce recueil, on connaissait déjà Hariri et son ouvrage intitulé Mékamat ou Séances, par ce qu'en avaient dit plusieurs savants, entre autres d'Herbelot, dans sa Bibliothèque orientale, au mot Hariri ; Golius, dans son édition de la Grammaire arabe d'Erpénius, Leyde, 1656, p. 211 et suiv.; et A. Schultens, dans ses préfaces aux portions de cet ouvrage qu'il a publiées en 1731 et 1740. Je crus néanmoins devoir donner en entier la traduction de la Vie de Hariri, telle qu'elle se trouve dans les Vies des hommes illustres d'Ibn Khallican, Schultens n'en ayant fait connaître qu'un extrait dans la préface qu'il a mise à la tête de son édition des IVe, Ve et VIe séances de notre auteur. Depuis ce temps, ayant publié le recueil entier des Séances en arabe avec un commentaire dans la même langue, j'y ai joint le texte de cette Vie de Hariri. Il serait tout-à-fait inutile de répéter ici ce texte ; je me borne donc à en donner la traduction.
« Abou-Mohammed Kasem Hariri Basri Harami, fils d'Ali, fils de Mohammed, fils d'Othman, auteur des Mékamas ou Séances. Il fut un des premiers docteurs de son siècle, et il avait reçu un talent particulier pour la composition de ce genre d'écrits. Ses Séances renferment une grande partie des richesses de la langue arabe, de ses dialectes, de ses proverbes, de ses expressions figurées et énigmatiques. Quiconque les connaît à fond et comme elles méritent de l'être, peut se faire une idée du talent de cet écrivain, de l'abondance de ses lectures, et des richesses de son érudition. Voici, au rapport de son fils Abou'lkasem Abd-Allah, quelle fut l'occasion qui lui fit entreprendre la composition de ses Séances. Mon père, disait-il, étant assis dans sa mosquée, au quartier dit Bènou-Haram: il survint un vieillard vêtu de deux méchants haillons, qui avait l'équipage d'un voyageur et l'extérieur très pauvre, mais qui parlait avec beaucoup de facilité, et s'exprimait avec une grande élégance. L'assemblée lui demanda d'où il était; il répondit qu'il était de Séroudj: interrogé sur son prénom, il dit qu'il se nommait Abou-Zeïd. » A cette occasion, mon père composa la séance intitulée Haramiyya, qui est la 48e de son recueil, et il la mit sous le nom de cet Abou Zeïd. Cette Séance s’étant répandue, vint à la connaissance du vizir Schéref-eddin Abou Nasr Anouschiréwan, fils de Khaled, fils de Mohammed, vizir du khalife Mostarched-billah. Il la lut, et elle lui plut tant, qu’il engagea mon père à en composer d’autres dans le même genre; en conséquence, il en composa jusqu’au nombre de cinquante. C’est à ce vizir que Hariri fait allusion dans la préface de ses Séances, quand il dit: Une personne dont les conseils sont des ordres, et à laquelle obéir est un bonheur inattendu, m’a engagé à composer des Séances, en me proposant pour modèles celles de Bédi, quoique je n’ignore pas qu’un boiteux ne puisse suivre les pas de celui qui est grand et robuste. J’ai trouvé le fait ainsi raconté dans un grand nombre d’ouvrages historiques; mais, était au Caire, en l’année 686, j’y vis un exemplaire des Séances écrit en entier de la main de Hariri, et sur le dos de l’exemplaire était écrit, aussi d la main de cet auteur, qu’il les avait composées pour le vizir Djélal-eddin Omaïd-eddaula Abou’lhasan Ali, fils d’Abou’lozz Ail, fils de Sadaka, qui fut aussi vizir de Mostarched, et on ne peut douter que ce récit ne mérite la préférence sur le précédent. Au surplus, Dieu connaît parfaitement la vérité. Ce vizir mourut au mois de redjeb 522. Voilà donc ce qui donna lieu à notre auteur de mettre ses Séances sous le nom d’Abou-Zeïd Séroudji. Le kadi Kémal-eddin Abou’lhassan Ail Schéïbani Kofti, fils, de Yousouf, gouverneur d’Alep, dans son livre intitulé les Relations des historiens au sujet des fils des grammairiens, dit que le vrai nom de cet Abou Zeïd était Motahher ben Salar, qu’il était de Basra, et faisait son étude de la grammaire et de la lexicographie, qu’il vécut en la compagnie de Hariri, étudia à Basra, se forma à son école, et le citait comme ayant appris de lui ce qu’il enseignait.
Le
kadi Abou’lfath Mohammed Waséti, fils d’Ahmed, fils de Mendaï, a
récité, comme le tenant de ce personnage, un ouvrage de Hariri,
intitulé  , Molhat alirab
(Récréations grammaticales), et il a dit: Motahher
vint à Waset, où nous habitions, en l’année 538, et je l’y entendis
réciter ce poème qu’il tenait de Hariri; de Waset il monta à Bagdad;
et y étant arrivé, il y séjourna quelque temps et y mourut. C’est ce
que dit Samani dans son ouvrage intitulé le Supplément,
et Omad-eddin, dans Le livre qui a pour titre la Perle.
(Voy. dans Hadji-Khalfa, le titre
, Molhat alirab
(Récréations grammaticales), et il a dit: Motahher
vint à Waset, où nous habitions, en l’année 538, et je l’y entendis
réciter ce poème qu’il tenait de Hariri; de Waset il monta à Bagdad;
et y étant arrivé, il y séjourna quelque temps et y mourut. C’est ce
que dit Samani dans son ouvrage intitulé le Supplément,
et Omad-eddin, dans Le livre qui a pour titre la Perle.
(Voy. dans Hadji-Khalfa, le titre 
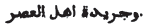 .
Le dernier ajoute, que Motaher avait le surnom honorifique de
Fakhr-eddin, qu’il exerça la charge de sadr-alislam (chef
du clergé musulman) à Méschan, où il mourut après l’an 540.
.
Le dernier ajoute, que Motaher avait le surnom honorifique de
Fakhr-eddin, qu’il exerça la charge de sadr-alislam (chef
du clergé musulman) à Méschan, où il mourut après l’an 540.
Nous allons dire maintenant pourquoi Hariri donne le nom de Hareth, fils de Hammam, à celui par qui il fait raconter les aventures d’Abou-Zeïd. Il se désigne lui-même sous ce nom emprunté; du moins c’est ce que j’ai lu dans plusieurs commentaires sur les Séances. Lorigine de cette dénomination est une parole de Mahomet, qui a dit: Vous êtes tous HARETH, et chacun de vous est HAMMAM; car hareth signifie celui qui gagne, et hammam, celui qui a beaucoup de sollicitude, il n’y a personne en ce sens qui ne soit hareth et hammam, parce que chacun s’occupe à gagner, et se donne des soins pour ses affaires. Beaucoup de personnes ont entrepris de commenter les Séances; les unes fort au long, les autres d’une manière abrégée.
J’ai lu dans un certain recueil, que Hariri n’avait composé d’abord que quarante Séances: étant venu de Basra à Bagdad, il les apporta avec lui, et s’en attribuait la composition; mais beaucoup de gens de lettres de Bagdad ne voulurent pas croire qu’il en fût l’auteur; ils disaient qu’elles n’étaient point son ouvrage, mais celui d’un homme très éloquent du Maghreb, qui était mort à Basra, et dont les papiers étaient tombés entre les mains de Hariri, qui s’en faisait honneur. Le vizir l’ayant donc mandé au diwan, lui demanda quel était son état. Il répondit qu’il émit monschi (c’est-à-dire, écrivain rédacteur). Alors le vizir lui ordonna de composer un écrit sur un sujet qu’il lui indiqua. Hariri se retira dans un coin du diwan, prit de l’encre et du papier, et demeura longtemps sans que Dieu lui fit la grâce de rien trouver. Il se leva donc tout confus. Au nombre de ceux qui l’avaient accusé de plagiat, était le poète Abou’lkasem Ah, fils d’Aflah, dont nous avons parlé plus haut.
Hariri n’ayant pas pu composer la lettre que lui avait donnée à faire le vizir, ce poète récita les deux vers suivants, que d’autres attribuent à Abou-Mohammed Harimi Bagdadi, fils d’Ahmed, poète célèbre, connu sous le nom d’Ibn Djakina.
Nous avons un docteur issu de Rébiat-alfarès, qui, dans son imbécile fureur, s’arrache les poils de la barbe. Plaise à Dieu de l’envoyer parler à Aléschan, comme il l'a frappé d'un silence absolu en plein diwan.
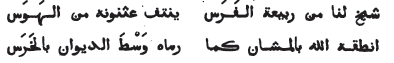
Ces
vers sont du mètre nommé  , dont
chaque hémistiche se compose de trois pieds, savoir, de deux
, dont
chaque hémistiche se compose de trois pieds, savoir, de deux
 ou des
variations de ce pied, et d'un
ou des
variations de ce pied, et d'un
 ou
ou
 placé
entre les deux
placé
entre les deux  . La
mesure est donc, sauf les licences :
. La
mesure est donc, sauf les licences :

Ici le
dernier pied de chaque vers, qui renferme la rime, est réduit à
trois syllabes  .
.
Le second vers est rapporté un peu différemment par Aboulféda (Annal. Moslem. tom. III, p. 414), mais Reiske a eu tort de traduire, in Maschano qu'idem ipsi loquax os dederat Deus ; car soit qu'on lise comme dans Aboulféda,

ou comme je lis dans Ibn Khallican,

le mot
 doit
être traduit par l'optatif.
doit
être traduit par l'optatif.
» Il faut savoir que Hariri prétendait descendre de Rébiat-alfartf, et que, quand il était occupé à réfléchir, il avait l'habitude de s'arracher les poils de la barbe. Hariri demeurait à Méschan [dépendance de Basra] : quand il y fut revenu, il composa dix nouvelles Séances, et les envoya à Bagdad, s'excusant de l'espèce de stupidité et d'incapacité à laquelle il s'était trouvé réduit dans le diwan, sur la crainte respectueuse dont il étroit saisi.
» Il y
a plusieurs ouvrages excellents de Hariri, tels que celui qui est
intitulé,
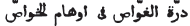 Dortet
algawwasfi awham elkhawass, (La Perle
du plongeur, où il est traité
des fautes de langage des gens
bien nés); un poème sur la Grammaire, sous le titre de
Dortet
algawwasfi awham elkhawass, (La Perle
du plongeur, où il est traité
des fautes de langage des gens
bien nés); un poème sur la Grammaire, sous le titre de
 Molhat
alirab (Récréations grammaticales), qu'il a
commenté lui-même, un diwan ou recueil de poésies, de petits
traités, et beaucoup de pièces de vers outre
celles qui sont insérées dans les Séances. Voici quelques-uns de ses
vers, dont les pensées sont pleines de grâce:
Molhat
alirab (Récréations grammaticales), qu'il a
commenté lui-même, un diwan ou recueil de poésies, de petits
traités, et beaucoup de pièces de vers outre
celles qui sont insérées dans les Séances. Voici quelques-uns de ses
vers, dont les pensées sont pleines de grâce:
» Mes censeurs ont dit : Quel est donc cet amour dont tu brûles pour lui! Ne vois-tu pas que ses joues sont déjà couvertes de poil! Je leur ai répondu: Par Dieu, si celui qui me traite d'insensé consultait la droite raison, les reproches qu'il me fait ne lui paraîtraient pas bien fondés ; celui qui demeure sur une terre, quand elle est nue et stérile, la quittera-t-il au moment où le printemps la couvre de verdure! »
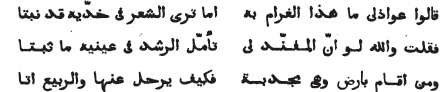
Ces
vers sont du mètre  , dont
chaque hémistiche se compose de quatre pieds qui sont
alternativement des
, dont
chaque hémistiche se compose de quatre pieds qui sont
alternativement des  et
des
et
des  ou des
variations de ces pieds. La mesure est donc :
ou des
variations de ces pieds. La mesure est donc :
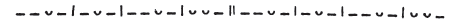
« Omad-eddin Isfahani, dans le livre intitulé la Perle, rapporte ce passage de Hariri:
» Combien de gazelles dans un désert pierreux, n'ont-elles pas fait de blessures par leurs yeux ! Combien d'âmes précieuses ne sont-elles pas tombées dans la langueur, par l'amour que leur ont inspiré de jeunes beautés, élevées loin des regards ! Combien de fois une démarche affectée et des mouvements étudiés n'ont-ils point fait naître dans un cœur une passion amoureuse! Combien de fois les charmes d'une joue n'ont-ils pas changé mon rigide censeur en un complaisant apologiste de mes faiblesses ! Quelle foule de soucis cuisants n'ont pas fait naître de beaux cheveux, en se montrant à découvert! »

Ces
vers sont remarquables par l'emploi constant de la figure nommée
 ou
jeu de mots. Dans mon édition de Hariri, j'ai
imprimé
ou
jeu de mots. Dans mon édition de Hariri, j'ai
imprimé  ,
conformément à mon manuscrit; mais la prosodie fait voir qu'il faut
supprimer
,
conformément à mon manuscrit; mais la prosodie fait voir qu'il faut
supprimer  ........................
........................
Ces
vers sont du mètre nommé  : chaque
hémistiche est composé d'un
: chaque
hémistiche est composé d'un  et d'un
et d'un
 ou de
leurs variations. La mesure du vers est :
ou de
leurs variations. La mesure du vers est :
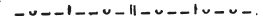 .
.
« Hariri a composé des élégies où il y a beaucoup de jeux de mots. » On dit qu'il était très laid et d'une figure ignoble. Un étranger étant venu pour lui rendre visite et s'instruire auprès de lui, conçut du mépris pour lui en voyant sa figure. Hariri s'en aperçut ; et quand cet étranger le pria de lui dicter quelque chose, il lui dicta ces vers :
» Tu n'es pas le premier voyageur de nuit que l'éclat de la lune a déçu, ni le premier explorateur d'un campement d'Arabes qu'a séduit une verdure trompeuse, qui n'est due qu'à un vil fumier. Cherche un homme qui te convienne mieux que moi : car, pour moi, je ressemble à Modidi; il faut m'entendre et non me voir.
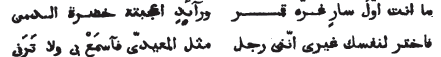
Ces
vers sont du mètre  ,
ci-devant.
,
ci-devant.
» Cet homme rougit et se retira tout confus.
» Hariri était né en l'année 446 et mourut en 515 ou 516, à Basra, dans la rue Bènou-Haram. Il laissa deux fils. Abou-Mansour Djawaliki dit : Nedjm-eddin fils d'Abd-Allah, et le kadi'l-kodhât de Basra, Dhiâ-eddin Obeïd-Allah, m'ont permis d'enseigner les Séances composées par leur pire. Hariri est surnommé Harami, du nom de la rue où il demeurait à Basra: ce nom se prononce Harâm, Les Bènou-Haram sont une tribu d'Arabes qui étaient établis dans cette rue, et cette rue a pris le nom de ces Arabes. Quant au surnom de Hariri, il vient de harir (qui signifie de la soie), et on le nommait ainsi parce qu'il travaillait la soie ou qu'il en vendait. Méschan, ainsi prononcé, est le nom d'un petit bourg au-dessus de Basra, où il y a beaucoup de palmiers, et qui a la réputation d'être très malsain ; la famille de Hariri était de ce lieu : on dit qu'il y possédait 18.000 palmiers, et qu'il jouissait d'une grande aisance.
» Le
vizir Anouschiréwan, dont nous avons parlé, était un homme instruit
et de beaucoup de talents; il est auteur d'une chronique intitulée
 Sodour
zéman alfotour (Les grands hommes
du siècle de langueur), dont Omad-eddin
Isfahani a transporté une partie «dans l'histoire qu'il a composée
de la dynastie des Seldjoukides, sous »ce titre:
Sodour
zéman alfotour (Les grands hommes
du siècle de langueur), dont Omad-eddin
Isfahani a transporté une partie «dans l'histoire qu'il a composée
de la dynastie des Seldjoukides, sous »ce titre:
 Mosrat
alfitra weosrat alfitra » (Le secours
de la langueur, et le refuge
des créatures). Ce vizir mourut en l'année 532.
Mosrat
alfitra weosrat alfitra » (Le secours
de la langueur, et le refuge
des créatures). Ce vizir mourut en l'année 532.
» Ibn Mendaï dont il a été aussi question, est Abou'lfath Mohammed Waséti, fils de Bakhtiar, fils d'Ali, fils de Mohammed, fils d'Ibrahim, fils de Djafar: il est connu sous le nom d'Ibn Mendâï. Beaucoup d'hommes célèbres ont été ses disciples, comme le hafedh Abou-Bekr Hazémi, dont nous avons parlé, et autres. Il était né à Waset, au mois de rébi second 517, et y mourut le 8 de chaban 605. Prononcez son nom Mendâï.
« Quant à Moaïdi, on dit en proverbe, Écoutez Moaïdi, mais gardez-vous de le voir; on dit aussi, Il vaut mieux entendre Moaïdi que de le voir. Suivant Mofaddhal Dhobbi, ce proverbe tire son origine de Mondhar, fils de Ma-alséma, qui tint ce propos à l'occasion de Schakka Témimi Darémi, fils de Dhomra; il avait entendu parler Schakka; mais quand il le vit, il lui trouva si mauvaise mine, qu'il dit ce mot, qui depuis a passé en proverbe. Schakka lui répondit: Prince, que le ciel préserve de malédiction! les hommes ne sont pas des animaux destinés à la boucherie, dont on n'estime que le corps ; le mérite de l'homme s'apprécie par les deux plus petites parties de lui-même, son cœur et sa langue. Mondhar admira sa réponse et son bon sens. On dit ce proverbe d'un homme qui n'a ni renommée ni extérieur. Moaïdi est un mot dérivé du nom de Maadd, fils d'Adnan »on a fait de ce nom un adjectif patronymique, après en avoir formé d'abord un diminutif, et avoir supprimé le doublement du dal. »
J'ajoute, pour l'intelligence d'un vers de Hariri, cité par Ibn Khallican, que les Arabes appellent la verdure d'un fumier, ce qui a une belle apparence et peu de mérite ; parce que les plantes potagères qui viennent sur un fumier, ont une belle apparence et une végétation vigoureuse, mais sont ordinairement peu succulentes. Voyez Schultens, Consessus Haririi quartus, quintus, sextus, &c, p. 6l, et mon Commentaire sur Hariri, séance iv, p. 41.
L'auteur du dictionnaire géographique intitulé
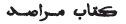
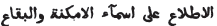 , que
j'ai déjà cité bien des fois, dit au sujet de Méschan :
, que
j'ai déjà cité bien des fois, dit au sujet de Méschan :

« Méschan. C'est une petite ville voisine de Basra, abondante en dattes et en fruits. Peut-être devrait-on prononcer son nom Moschan, du nom d'une espèce de dattes excellentes qui s'appellent ainsi. Ce lieu est très malsain ; quand les khalifes de Bagdad étaient en colère contre quelqu'un, ils le bannissaient en cet endroit. Il peut se faire que ce soit à cause de cela qu'on ait prononcé par un fatha, Méschan, comme qui dirait le lieu du déshonneur. Hariri, l'auteur des Séances, était de cet endroit. »
Bédif
que
Hariri dit avoir pris pour son modèle, est Abou'lfadhl Ahmed
Hamadani, fils de Hosaïn, surnommé la Merveille de
son siècle,  mort,
suivant Ibn Khallican, à Hérat dans le Khorasan, en 398. On trouvera
dans ce volume quelques-unes des Séances de Bédi-alzéman
Hamadani.
mort,
suivant Ibn Khallican, à Hérat dans le Khorasan, en 398. On trouvera
dans ce volume quelques-unes des Séances de Bédi-alzéman
Hamadani.
Si
Hariri a imité Hamadani, il a eu lui-même des imitateurs. La
bibliothèque du Vatican possède un manuscrit qui porte le n° 372, et
qui contient un recueil de cinquante Séances, composées à
l'imitation de celles de Hariri, par Abou'ltaher Mohammed Témimi
Sarakosti Andalousi, fils de Yousouf, dans la ville de Cordoue.
Elles portent le titre de  , et ce
nom leur est donné sans doute à cause de la gêne que leur auteur
s'est volontairement imposée dans cette composition, et qu'on
appelle
, et ce
nom leur est donné sans doute à cause de la gêne que leur auteur
s'est volontairement imposée dans cette composition, et qu'on
appelle  ,
comme on le voit par ces mots qui servent de préface à ce
recueil….
,
comme on le voit par ces mots qui servent de préface à ce
recueil….
On trouve exposé dans mon Commentaire sur Hariri, séance XXXVII, ce qu'on entend par cette expression technique, s'assujettir à ce qui n'est pas d'obligation.
Le héros des Séances d'Abou'ltaher se nomme Abou- Habib et cet auteur met ses récits dans la bouche de Mondhar fils de Homam, qui raconte ce qu'il a entendu dire à Saïb, fils de Témam. Hadji-Khalfa fait mention de cet ouvrage. Ce manuscrit a appartenu à Pietro della Valle. Voyez Biblioth. Or. Clément. Vatic. tom. I, p. 588, n° 18. Recensio manuscriptorum codicum qui ex universa blbliotheca Vaticana selecti ...... procuratonbus Gallorum jure belli ......... traditi fuere, Lipsiae, 1803, p. 33.
Je reviens maintenant au recueil des Séances de Hariri. Si l'on veut connaître les portions de ce recueil qui ont été publiées, on en trouvera le détail dans le second Specimen Bibliothecœ arabicae de M. Schnurrer, imprimé à Tübingen en 1800; mais il faut observer que, depuis cette époque, la VIIe et la XIe séance ont été données en arabe, avec de courtes gloses, par M. Jahn, dans sa Chrestomathie arabe (Arabische Chrestomathie, Vienne, 1802); la XIVe, par M. Rink, dans la Chrestomathie chaldaïque, syriaque et arabe, qu'il adonnée conjointement avec M. Vater, à Leipzig, en la même année, sous ce titre, Arabisches, Syrisches und Chald. Lesebuch ; et enfin la XLIXe, du moins en partie, avec des gloses arabes et une traduction allemande, par M. Rosenmuller, à Leipzig, en 1801, dans l'ouvrage intitulé, Ueber einen Arab. Roman des Hariri.
On trouve aussi plusieurs séances en arabe et en français dans les Mines de l'Orient à savoir, la VIIIe dans le tome Ier, la XIIe dans le tome II, la XXXIVe, dans le tome V, et la XLIXe dans le tome IV. M. le capitaine J. Baillie a fait imprimer la XXIVe dans le IIIe tome de l'ouvrage intitulé, The five Books on Arabic Grammar, à Calcutta, en 1805; enfin le recueil entier des Séances de Hariri a été publié à Calcutta, de 1809 à 1814, en trois volumes in 4°, dont le dernier est un vocabulaire arabe-persan pour l'intelligence de cet ouvrage; à Paris, en 1818, par M. Caussin de Perceval (Journal des savants, année 1819, cahier de mai, p. 283 et suiv.), en un volume in 4°; puis, par moi-même, avec un commentaire arabe (Journal des savants, 1823, cahier de décembre, p. 737 et suiv.), Paris, 1822, fol. Quelques séances ont été traduites en français et en anglais, et publiées, mais sans être accompagnées du texte, dans divers recueils. La XXe a été traduite en français par M. Venture, et cette traduction a été imprimée dans le palais de France, à Constantinople. M. Fr. Rückert a entrepris de traduire en allemand les Séances de Hariri, à l'exception d'un très petit nombre, en imitant le style, les figures et les rimes de l'original. Le Ier volume de cette traduction a paru en 1826, sous ce titre: Die Verwandlungen des Ebn-Saïd von Serug, oder die Makamen des Hariri, in freier Nachbildung.
Mon intention avait été originairement de donner deux séances inédites de Hariri. J'ignorais que M. Jahn se proposât de publier la VIIe; et le texte arabe de cette Chrestomathie était déjà imprimé pour la première fois, lorsque l'ouvrage de M. Jahn a paru (Magasin encyclopédique, année VIII, tome IV, p. 305 et suivantes).
Je dois faire connaître maintenant les manuscrits que j'ai employés pour donner, dans la première édition de ce recueil, ces extraits des Séances de Hariri. Ce sont, 1° Le manuscrit arabe n° 1588 de la bibliothèque du Roi, qui ne contient rien autre chose que le texte ;
2° Le manuscrit n° 207 de Saint-Germain-des-Prés, manuscrit excellent, et qui contient, outre le texte, quelques gloses interlinéaires et marginales en petit nombre, mais importantes;
3° Le
manuscrit arabe n° 1589 de la bibliothèque du Roi, qui contient, non
le texte de Hariri, mais un ample commentaire intitulé
 , et dont l'auteur est Borhan-eddin
Nastr Motarrézi, fils d'Abou'lmécarim;
4° Le manuscrit arabe n° 1626 de la même bibliothèque, dont j'ai
déjà parlé à l'occasion du poème de Nabéga (tom. II, p. 423). Ce
volume est un recueil de plusieurs ouvrages. Le premier est un
lexique pour les Séances de Hariri; il n'est pas disposé par forme
de dictionnaire, mais les mots expliqués y sont rangés dans l'ordre
ou ils se trouvent dans le texte de Hariri. Il… a pour auteur
Mohibb-eddin Abou'lbaka Abd-Allah Ocbari
Bagdadi, fis de Hosaïn. Ocbari est
un adjectif relatif, dérivé d’Ocbara… comme
l'observe l’auteur du Kamous. Je cite ce manuscrit sous le
nom d'Ocbari, et le précédent sous celui de Motarrézi.
, et dont l'auteur est Borhan-eddin
Nastr Motarrézi, fils d'Abou'lmécarim;
4° Le manuscrit arabe n° 1626 de la même bibliothèque, dont j'ai
déjà parlé à l'occasion du poème de Nabéga (tom. II, p. 423). Ce
volume est un recueil de plusieurs ouvrages. Le premier est un
lexique pour les Séances de Hariri; il n'est pas disposé par forme
de dictionnaire, mais les mots expliqués y sont rangés dans l'ordre
ou ils se trouvent dans le texte de Hariri. Il… a pour auteur
Mohibb-eddin Abou'lbaka Abd-Allah Ocbari
Bagdadi, fis de Hosaïn. Ocbari est
un adjectif relatif, dérivé d’Ocbara… comme
l'observe l’auteur du Kamous. Je cite ce manuscrit sous le
nom d'Ocbari, et le précédent sous celui de Motarrézi.
5° Enfin j'ai aussi consulté un manuscrit apporté d'Egypte, il y a quelques années, par M. Delaporte, et acquis par la bibliothèque du Roi. Ce manuscrit a de petites gloses interlinéaires, qui forment comme un commentaire perpétuel. Ces gloses sont pareilles à celles qu'on voit dans la Chrestomathie de M. Jahn, et dans l'ouvrage de M. Rosenmuller, que j'ai déjà indiqué: elles sont souvent insuffisantes pour entrer dans la pensée de Hariri.
Pour cette seconde édition, outre le manuscrit de Motarrézi, qui appartient à la bibliothèque du Roi, j'en ai eu un qui a fait partie de ma collection particulière. J'ai aussi consulté un plus grand nombre de manuscrits, et de commentaires plus ou moins étendus; mais je renvoie, à cet égard, le lecteur à la préface que j'ai mise à la tête de mon édition complète du texte de Hariri. Cette édition étant aujourd'hui entre les mains de tout le monde, j'ai cru devoir ajouter peu de chose aux notes qui accompagnaient ma traduction dans la première édition de cette Chrestomathie.
(2) Barkaïd est, suivant le Kamous, le nom d'une ville proche de Mosul ; Aboulféda en parle d'après Mohallébi, dans sa Description de la Mésopotamie, et dit que c'est une ville considérable, éloignée de onze parasanges de Béled, et de dix-sept de Mosul. Voyez aussi ce qu'en dit Bakouï, Notices et Extraits des manuscrits, tom. II, p. 473.
Suivant
l'auteur du Dictionnaire géographique que j'ai déjà cité en plus
d'un endroit, Barkaïd est une petite ville, à
l'extrémité du canton nommé Bakâ, qui est situé entre Nisibe
et Mosul, du côté de Nisibe, en face de Bascha. Barkaïd
appartient au canton nommé Bakâ : ses habitants sont mal
famés, car on dit en proverbe:  un
voleur de Barkaïd.
un
voleur de Barkaïd.
(3) Il
y a ici un jeu de mots entre le nom propre Barkaïd et les
mots arabes qui signifient les éclairs de la
fête ; ce que j'ai rendu par les premiers
instants de la grande solennité. Il
s'agit de la fête de la fin du jeûne, fête que les Turcs nomment
 Beiram.
Beiram.
(4) A la lettre : avec ses rites d'obligation et de dévotion. Le scholiaste Motarrézi dit : « Par les rites d’obligation, il entend l'aumône qu'on doit acquitter à la fin du jeûne; et par les pratiques de dévotion, les prières particulières de cette fête. » Voyez M. de Mouradjea, Tableau général de l'empire Othoman, tom. Ier, p. 211 et 276.
(5) A la lettre : et qu'il fut arrivé avec sa cavalerie et son infanterie. C'est une expression empruntée de l’Alcoran, sur. 17, vers. 66, édition de Hinckelmann. Dieu adressant la parole à satan, lui dit:
 et
invehere super illos equitibus tuis
et peditibus tuis.
et
invehere super illos equitibus tuis
et peditibus tuis.
(6) Voyez sur le mot mosalla, la première partie de ce recueil, p. 191, note (78).
(9) Dans les gloses du man. 207 de Saint-Germain-des-Prés, on lit : « Ce qu'on appelle saalat est la même chose que le goul : cela appartient aux fables des Arabes. »
Voyez, à ce sujet, Lette, Caab ben-Zoheir Carmen Panegyr. &c. p. 8 et 113 ; et M. Freytag, Caabi ben Sohair Carmen in laudem Muhammedis dictum, p. 6.
(13) Le destin, dit l'auteur des gloses du manuscrit 207 de la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés, ne satisfait les vues d'aucun homme, et chacun s'en prend à lui; voilà pourquoi Hariri lui donne l'épithète de « accablé de reproches. »
(17) C'est-à-dire : Je ne me fusse pas avili jusqu'à mendier la protection des grands et les bienfaits des riches.
(18) Ce vers d'Ibn Doréïd est le 41e de l'édition de Scheïdius. Voici comment l'auteur du Kamous décrit le château de Gomdan :
« Gomdan, château dans le Yémen, bâti par Yaschrah, avec quatre faces, une rouge, une blanche, une jaune et une verte. En dedans il construisit un autre château, qui avait sept toits séparés chacun l'un de l'autre par une hauteur de quarante coudées. » L'auteur veut dire apparemment une sorte de pyramide à sept étages avec des toits saillants en dehors.
L'auteur du dictionnaire géographique précédemment cité dit que le château de Gomdan était dans la ville de Sanaa, et ne fut détruit que par le khalife Othman.
(20) « Hariri, dit ici Motarrézi, veut dire que la loi qui interdit de «donner un salaire aux devins, ne s'étend pas au salaire de celui qui procure quelque connaissance : cela est dit, parce que le prophète a défendu de donner au devin un salaire. »
(25) Motarrézi observe que l'auteur entend un camarade dont l'amitié soit pure comme un ruisseau limpide qui court sur lu surface de la terre : ou bien, ajoute-t-il, Hariri peut avoir désigné sous cette figure, des biens dont l'acquisition ne coûte pas beaucoup de " pane à quelqu'un, et qui viennent comme d'eux-mêmes remplir ses désirs.
(26) « On se sert du mot mouthmïn pour dire une chose d'un grand prix ; mais c'est une erreur, car, en suivant l'analogie du langage des Arabes, mouthmïn signifie une chose qui a acquis une valeur, fût-ce même une petite valeur. C'est ainsi qu'on dit mourik d'une branche, quand elle commence à avoir des feuilles, et d'un arbre mouthmir, quand son fruit commence à paraître. Le sens de mouthmïn n'est »donc pas celui que ces gens-là lui donnent. Dans ce sens, il faut dire thémin, comme on dit lahim d'un homme charnu, et schahim d'un bélier gras. On lit dans quelqu'un des écrivains éloquents : Le mérite d'un homme fidèle est d'un grand prix (thémin). Les lexicologues font une distinction entre les mots kimeh et thémen: ils disent que le premier signifie le prix, quand il est égal à la valeur réelle de la chose et au pair avec elle ; et que le second s'emploie, »soit que le prix soit d'accord avec la valeur réelle, ou lui soit supérieur ou inférieur. Quant au mot thémin dans ce vers d'un poète : Je leur ai abandonné ma part quand ils se sont trouvés dans l'indigence, et je n'ai eu que le Huitième (thémin) de la portion qui m'appartenait, il a pris thémin dans le sens de thoumoun, comme on dit pour la moitié nasif, et pour le dixième aschir. »
(28) Les mots peuvent également désigner une pièce d'or et une pièce d'argent : Antara s'en est servi pour dire une pièce d'or, dans la Moallaka qui porte son nom. Il a dit:
« Quand la violence de la chaleur commence à tomber, je bois d'un vin vieux, acheté au prix d'une pièce d'or) polie et marquée d'une empreinte. » Dans ce vers, quelques commentateurs entendent un verre d'un métal brillant et ciselé ; dans notre auteur, il signifie une pièce d'argent, ce que prouve le mot suivant qui contient une comparaison de cette pièce de monnaie avec la pleine lune.
Rien n'est plus ordinaire aux écrivains arabes que de désigner les pièces d'argent par le mot blanche, et celles d'or par le mot jaunes. On en trouve un exemple dans la troisième séance de Hariri, donnée par Schultens, p. 150 et 164. Ibn Arabschah a dit aussi en joignant ces épithètes aux noms mêmes des pièces : « Je n'ai amassé des dinars jaunes et des dirhems blancs que pour m'en servir dans les jours noirs, » c'est-à-dire, dans le temps de l'adversité. Voyez Ahmedis Arabsiadae Vita et res gestae Timuri, de l'édition de M. Manger, tom. II, p. 102.
A cette occasion, j'expliquerai un passage de cet écrivain qui n'a été entendu ni par le traducteur latin ni par Vattier.
Ibn Arabschah raconte que, lors de l'irruption de Timour en Syrie, le gouverneur de Safad s'étant rendu à Alep, laissa, en son absence, le commandement de Safad à son hadjeb ou chambellan, riche négociant qui se nommait Ala-eddin, et était surnommé Déwadari. Ala-eddin ayant appris que son maître Altoun-boga Othmani était tombé entre les mains de Timour, et voulant le sauver et préserver Safad de la fureur du conquérant tartare, avisa aux moyens de faire réussir ce projet. Ala-eddin, dit Ebn-Arabschah, était un homme bien né et il avoit un esprit fin et subtil. Il prit donc conseil sur cela de la sagesse de son jugement, et la consulta pour savoir ce qu'il avait à faire. Sa sagesse lui répondit : Emploie, pour gagner l'esprit de Timour, les richesses que tu possèdes, et garde-toi de recourir à la fuite et à une retraite précipitée. Elle ne lui mentit point ; au contraire, elle lui parla conformément à la vérité, en lui disant : Quand il s'agit de sauver son honneur, tous les moyens de flatterie sont bons pour le mettre à l'abri, et sont une bonne œuvre. Comme Ala-eddin possédait de grandes richesses, il dit : Je n'ai amassé des pièces d'or et d'argent que pour les employer aux jours de l'adversité. Il chercha donc à amadouer Timour, et voulut d'abord sonder le gué, en le prévenant par de bonnes manières: il traita cette affaire comme un médecin habile traite un malade; et, par des démarches pacifiques, il prévint le moment où les hoquets de la mort ne permettent plus de réciter des vers (c'est-à-dire, où les remèdes ne sont plus d'aucune utilité). »
(30) A la lettre, pour mordre le bois de ma conjecture. « On mord un morceau de bois, pour s'assurer s'il est dur ou tendre. »
(31) Cette expression est employée aussi par Ahmed, fils d'Arabschah, dans la Vie de Timour. Voy. l'édition de M. Manger tom. II, p. 72, et la note de cet éditeur, p. 73.
Mahomet a dit que quiconque marchera sur le cou des hommes, servira de pont aux damnés pour se rendre en enfer. Voyez mon Commentaire sur Hariri, séance VII.
(32) Le fils d'Abbas, dont il est ici question, est Abd-Allah, fils d'Ab- bas, très-célèbre par la justesse de son esprit, sa sagacité et sa prévoyance. On attribuait ces qualités distinguées à une prière que Mahomet avoit faite pour lui, lorsqu'il était encore enfant. Motarrézi, qui rapporte quelques particularités de sa vie, finit en disant: « Les traditions qui font connaître la sagacité et la vivacité d'esprit d'Abd-Allah, fils d'Abbas, sont trop connues pour les rapporter, et trop nombreuses pour qu'on puisse les compter. Comment en serait-il autrement, puisque le prophète avait adressé à Dieu cette «prière en sa faveur: Mon Dieu, enseigne-lui la sagesse, et donne-lui un surcroit d'intelligence et de science. L'étendue de ses connaissances et la pénétration de son esprit lui valurent les surnoms le docteur, et la mer. » Voyez d'Herbelot, aux mots Abbas et Rabboni ; Aboulféda, Annal. Moslem. tom. I, p. 287 et suiv., et p. 417.
Iyyas Mozéni, fils de Moawia, fils de Korra, avait une sagacité si singulière, qu'elle a passé en proverbe. Reiske, dans ses notes sur Aboulféda (Annal. Moslem. tom. I, p. 455 et Adnot. histor. p. 125), en a rapporté plusieurs traits tirés de Méïdani. Suivant Motarrézi, Méïdani a composé un recueil particulier des traits d'esprit d'Iyyas.
Abou'lwalid, fils de Zéïdoun, dans cette lettre pleine de grâces et d'érudition que Reiske a publiée, et après lui Hirt, a dit aussi : et Iyyas, fils de Moawia, n’a brillé que de l'éclat de ta sagacité; et son commentateur, Ibn Nobata, rapporte à cette occasion beaucoup de traits de la sagacité de ce kadi de Basra. (Voyez Reiske, Abi'lwalidi Ibn-Zeiduni Risalet, p. 1 et 2 ; Hirt, Institut, arab. ling. p. 516, et mon Commentaire sur Hariri, séance VII.) Ibn Arabschah, dans l'Histoire de Timour (édition de M. Manger, tom. I, p. 1 16), fait dire à ce conquérant : mes conjectures sont comme celles d'Iyyas. Ibn-Khallican donne à Iyyas le surnom de Abou-Waritha.
(33) Je vais transcrire d'abord ce que l'on trouve dans Firouzabadi à la racine
 :
:
« Othfiyya et ithfiyya, c'est-à-dire, la pierre sur laquelle on pose la » marmite ; pluriel athafiyy ou athaft, sans teschdid: il signifie aussi 35 grand nombre et plusieurs hommes réunis. Par [le troisième des supports de la marmite], on entend une portion saillante d'une montagne, près de laquelle saillie on place deux de ces supports ; et quant à cette saillie (qui forme le troisième support), elle tient à la montagne. Cette expression, Qu'il le frappe du troisième des supports de la marmite, signifie, de toutes les espèces de maux ; c'est comme si l'on disait : Qu'il fasse du malheur un support de marmite, puis un autre ; en sorte que, quand il aura jeté contre quelqu'un le troisième, il ne reste plus rien au-delà dont il puisse se servir pour le frapper. »
A la
racine  , on lit
:
, on lit
:
« Othfiyâ et ithfiyyâ, c'est-à-dire, la pierre sur laquelle on met la marmite; pluriel athafiyy et athqfin. Que Dieu le frappe du troisième des supports de la marmite, c'est-à-dire, de la montagne, ce qui signifie, d'une grande calamité. Cette expression vient de ce que, quand les Arabes ne trouvent point une troisième pierre pour compléter le nombre des supports de leur marmite, ils l'appuient d'un côté sur le plan incliné d'une montagne. »
On voit maintenant le sens de cette expression proverbiale. Athafi signifie trois pierres que les Arabes Bédouins placent triangulairement sous leur marmite, pour la tenir élevée et pouvoir allumer du feu par-dessous. M. Hornemann, parlant de la manière dont les Arabes qui voyagent en caravane apprêtent leurs repas, dit : « Les esclaves creusent un petit trou dans le sable pour y allumer du feu ; ils vont ensuite chercher du bois, et trois pierres destinées à être placées dans le trou, afin de retenir les cendres et de supporter le chaudron. » (Voyage de F. Hornemann, traduction française, tom. I) Quand les Arabes ne pouvaient trouver que deux pierres propres à cet usage, ils les plaçaient sous la marmite à deux sommets du triangle, et l'appuyaient, du côté où aurait dû être placée la troisième pierre, contre le plan incliné d'un tertre ou d'une montagne, qui remplaçait la troisième pierre, et devenait comme l'un des pieds du trépied : de là on a appelé le troisième des supports d'une marmite, ou le troisième pied d'un trépied, tout ce qui sert à compléter le nombre de trois. C'est en ce sens qu'Abd-allatif, parlant de la plus petite des pyramides de Djizèh, dit que le sultan Mélik-alaziz Othman, fils de Yousouf, ayant formé le dessein de détruire ces pyramides, commença par la plus petite, qui est de couleur rouge, et qui, ajoute-t-il, est le troisième pied du trépied », c'est-à-dire que, quoique inférieure aux deux autres par sa grandeur et sa construction, elle complète avec elles le nombre de trois (Abdollat. Hist. Aeg. comp. édition de M. White, 1800, in-4°). Pococke le fils avait traduit littéralement, est que hœc tripodis pes tertius. (Ibid. p. 5 de l'Appendix. Voyez aussi Relation de l'Egypte, par Abdallatif, p. 177.) Dans l'expression proverbiale, Que Dieu le frappe du troisième support de la marmite, ce mot indique le comble des malheurs, non-seulement, je crois, parce que cela suppose le dernier des malheurs, tous les autres représentés par le premier et le second support de la marmite ayant déjà été épuisés sur le malheureux dont il s'agit, mais aussi parce que, dans la signification naturelle de ces mots, le troisième support de la marmite étant une montagne, surpasse, sans aucune proportion, en volume et en poids, les deux autres qui sont des pierres détachées. Je ne relèverai pas toutes les fautes commises par Giggeïus et Castell, aux deux racines; j'ai voulu seulement faire sentir l'imperfection de nos dictionnaires, et combien une bonne édition des textes de Djewhari et Firouzabadi serait utile aux progrès de la littérature arabe. Une partie du vœu que je formais lors de la première édition de ce recueil, a été remplie par l'édition du Kamous donnée à Calcutta, et par celle de la traduction turque du même dictionnaire, imprimée en trois volumes in-folio à Scutari : il est à souhaiter que le Sihah de Djewhari obtienne aussi les honneurs de l'impression.
Puisque
j'ai eu occasion de citer le Voyage de M. Hornemann, au sujet de la
cuisine des Arabes, je remarquerai que, suivant ce voyageur, à
l'endroit déjà cité, le mets le plus ordinaire des Arabes, dans les
caravanes, est formé de hassidé, épaisse bouillie de farine.
M. Langlès a cru que le hassidé de M. Hornemann était le même
que le hasou de M. Hoest (Nachrichten von
Marolikos, p. 107); mais quoiqu'il puisse y avoir du rapport
entre la manière de préparer ces deux mets, leurs noms sont fort
différents : le premier est  , et le
second
, et le
second  ; ils se
trouvent l'un et l'autre dans nos dictionnaires, et leur
signification donne lieu de croire que le hasou est plus
liquide que le hassidé ou plutôt asidèh.
; ils se
trouvent l'un et l'autre dans nos dictionnaires, et leur
signification donne lieu de croire que le hasou est plus
liquide que le hassidé ou plutôt asidèh.
Ahmed, fils d'Arabschah, dans la vie de Timour (édition de M. Manger, tom. I, p. 470), dit: et il leur prépara, parle bouillon d'une marmite qu'il fit chauffer, un potage plus épais que du asidèh.
Voyez, sur ce genre de potage, Burkhardt, Travels in Africa.
Il y a eu un roi de Tunis de la famille des Hafsites ou descendants d’Abou-Hafs, qui portait le surnom d'Abou-asidèh, parce que cette sorte de mets était fort en vogue de son temps. Voyez Casiri, Bibl. ar. Hisp. Escur. tome II, p. 227.
Pour revenir à notre passage de Hariri, il pourrait être traduit ainsi : Avec nous était la vieille qui complétait notre trio, et en outre l'observateur à qui rien n'est caché, c'est-à-dire, Dieu ; et ce sens a été adopté par feu M. Aryda (Instit. grammat. arab. Vienne, 1813, p. 162). La grammaire de ce savant maronite ayant été l'objet d'une critique un peu sévère dans la Gazette universelle de littérature de Vienne (18 novembre 1814, p. 1466), un des auditeurs de M. Aryda a répondu à cette critique, par un petit écrit intitulé Apologia contra Censuram in grammat. arab. Rev. D. Antonii Aryda, &c. Dans cette réponse, l'auteur a soutenu que la traduction que j'avais donnée de ce passage, était inadmissible et réprouvée par les antécédents et les conséquents. Il aurait dû faire attention que je n'avais fait qu'adopter l'opinion de Motarrézi, critique d'une grande autorité, qui désapprouve le sens donné par M. Aryda à ce passage.
Voici
sa glose : « II peut se faire qu'en disant,
 , »
Hariri ait simplement voulu dire que la vieille
faisait la troisième ; mais on peut aussi supposer
qu'il a employé cette expression pour faire entendre que cette femme
était un tourment ou un fléau insupportable, et qu'il a en en vue ce
proverbe, Que Dieu le frappe avec
le troisième support de la
marmite, où ces mots signifient une grande
calamité. J'ai lu dans les proverbes d'Abou-Obéïd, qu'on
interrogea Abou-Obéïda sur le sens de cette expression, et qu'il
répondit qu'elle signifiait la dernière extrémité
de tout malheur, de toute
chose désagréable et
récita
ce
vers: Leur chef a été lapidé
avec les nippons du trépied de
l'infortune. Ce qui justifie que c'est là le sens que lui a
donné Hariri, c'est qu'il ajoute en parlant
de cette femme, et l'observateur pour qui
aucun secret n'est caché: car cette
assiduité importune est regardée comme un grand fléau. Le sentiment
de ceux qui croient que par l'observateur, il faut entendre
Dieu, est faux. En y regardant attentivement, on en découvre
la fausseté. »
, »
Hariri ait simplement voulu dire que la vieille
faisait la troisième ; mais on peut aussi supposer
qu'il a employé cette expression pour faire entendre que cette femme
était un tourment ou un fléau insupportable, et qu'il a en en vue ce
proverbe, Que Dieu le frappe avec
le troisième support de la
marmite, où ces mots signifient une grande
calamité. J'ai lu dans les proverbes d'Abou-Obéïd, qu'on
interrogea Abou-Obéïda sur le sens de cette expression, et qu'il
répondit qu'elle signifiait la dernière extrémité
de tout malheur, de toute
chose désagréable et
récita
ce
vers: Leur chef a été lapidé
avec les nippons du trépied de
l'infortune. Ce qui justifie que c'est là le sens que lui a
donné Hariri, c'est qu'il ajoute en parlant
de cette femme, et l'observateur pour qui
aucun secret n'est caché: car cette
assiduité importune est regardée comme un grand fléau. Le sentiment
de ceux qui croient que par l'observateur, il faut entendre
Dieu, est faux. En y regardant attentivement, on en découvre
la fausseté. »
On peut voir le texte de Motarrézi dans mon Commentaire sur Hariri, séance VII.
(35). A la lettre, comme les deux étoiles de la petite ourse, nommées les deux veaux. Voyez Ulugh Begh, Tab. stell. fix. dans le tome I du Syntagma dissert, de Th. Hyde, pag. 6; M. Ideler, Untersuchungen über den Ursprung und die Bedeutung den Sternnamen, pages 3 et 12.
Bibliothèque britannique, mars 1810.
Traducteur anonyme
« Voici ce que dit Herbelot de cet ouvrage si fameux dans tout l'orient.» Macamat. Assemblées et conversations, lieux communs et pièces d'éloquence ou discours académiques, qui se récitent dans les compagnies de gens de lettre. — Les Arabes ont plusieurs livres, qui contiennent de ces sortes de discours, lesquels passent parmi eux pour des chefs-d'œuvre d'éloquence. Hamadani a été le premier qui en ait publié ; Aboulcassem Al-Hariri l'a imité, et même, selon le sentiment de plusieurs, l'a surpassé, en sorte que Zamakhshari, le plus docte des grammairiens arabes, dit que son ouvrage ne doit être écrit que sur de la soie. Plusieurs auteurs l'ont commenté, entre lesquels Schirazi et Modhaffer tiennent le premier rang.
» Ces assemblées ou conversations savantes, dont cet ouvrage est composé, sont au nombre de cinquante ; elles ont différents surnoms relatifs à leur contenu. Plusieurs savants se sont occupés à en publier quelques-unes, en partie avec le texte, en partie en traduction seulement. L'extrême difficulté d'en saisir parfaitement le sens est sans doute la cause principale qui a empêché jusqu'ici la publication de l'ouvrage entier. Les assemblées qui ont été publiées jusqu'à présent séparément sont : les six premières par Schultens en latin, traduites par Chappelow, en anglais ; la VII & IX par de Sacy ; la XI par Jahn ; la XXVI par Reiske ; la XLV par Venture ; et la L par Uri. (Voyez Schnurrer Bibliothèque arabe et de Sacy Chrestomathie arabe). On donne ici l'original[1] et la traduction de la huitième. »
» Des manuscrits de cet ouvrage se trouvent à la bibliothèque impériale de Paris, à celle du grand duc de Toscane, à celle de l'Escurial, à la bibliothèque impériale de Vienne, et dans la collection du traducteur. La concision extrême de l’arabe, et quelquefois la nécessité de voiler des expressions trop libres pour des lecteurs européens, ont fait préférer une traduction moins exacte, mais qui rend cependant le sens a une traduction littérale, qui eût été souvent obscure, et quelquefois indécente. »
************************************
Hareth, fils de Hammam, raconta son histoire et commença ainsi:
Parmi les choses merveilleuses de ce siècle, j'ai vu se présenter devant un cadi, dans la ville de Maarrat-on-Naamani, deux hommes qui étaient en procès. L'un d'eux avait déjà perdu le goût des repas et des plaisirs ; la grâce et la taille du second rappelaient le myrabolane.[3] Le plus vieux s'adressant au cadi, lui dit: « Que Dieu soutienne le juge, comme il soutient par son secours celui qui plaide ! J'avais une ouvrière, dont la taille et les formes étaient régulières, la tête allongée; elle se laissait occuper à l'ouvrage avec docilité, et l’exécutait avec l’agilité d'un jeune chien ; puis elle se reposait dans un petit lit. Sa fraîcheur n'était point altérée par les chaleurs du mois de juillet ; .... Sa main, quoiqu'elle n'eût qu'un seul doigt, était habile à ourler.... Elle était sage et fourbe en même temps, elle se faisait voir et se cachait tour-à-tour; elle était naturellement utile; elle était soumise, soit qu'elle se trouvât à son aise, soit qu'elle se trouvât à l'étroit. . . . Toutes les fois qu'un l'employait, elle servait avec utilité. Quelquefois elle faisait du mal involontairement ; confuse, elle s'esquivait aussitôt. Ces qualités avaient porté ce jeune homme à me prier de la lui prêter: je le fis, sans rien accepter en gage, mais avec la condition qu'il l'emploierait, sans exiger d'elle des travaux au-dessus de ses forces. Cependant il s'en servit, multiplia par elle ses moyens de subsistance, et me la rendit en très mauvais état. »
Alors le jeune homme prit la parole, et dit : « A l'égard de ce vieillard, il est plus véridique que l'oiseau kata;[4] et quant à l'accident survenu, il est arrivé, je l'avoue, mais involontairement. Aussi ai-je donné à ce vieillard, pour le dédommager de sa perte, mon ouvrier, bien fait sous tous les rapports, et proportionné comme s'il eût été formé par un artiste en acier ; il est exempt de toute malpropreté et de toute souillure. Les prunelles des yeux se rapprochent de l'endroit où il se trouve ; il fait le bien et excite l'admiration ; il nourrit l'homme, et tient sa langue en garde. Si on le noircit, il s’en trouve bien; et si on le teint, il n'en devient que plus aimable. Si on lui donne de la nourriture, il en distribue; et plus il en donne, plus il en répand. Il est reconnaissant des générosités qu'il reçoit ; il est docile aux avertissements de son ami, quoiqu'il soit d'un naturel bien différent du sien, il fait rejaillir sur lui l'éclat de: sa beauté et ne lui ôte rien de sa douceur. »
Le juge alors s'écria : « Finissez donc ! expliquez-vous, ou cessez de m'importuner. »
Le vieillard interdit de la sévérité du juge t resta longtemps la bouche entr'ouverte, les yeux fixés sur la terre. Le jeune homme prît encore la parole, et dit : « Ce vieillard m'a prêté une aiguille, pour raccommoder des haillons que, le temps avait usés. J'eus le malheur de la casser involontairement, en tirant un fil avec trop de force. Le vieillard voyant son aiguille cassée, ne voulut point me pardonner. — Il me dit : Apporte-moi une aiguille semblable à la mienne, ou bien donne m'en un prix raisonnable et suffisant pour mi dédommager. Il prit en gage le pinceau qui sert à teindre mes yeux,[5] et il m'accabla d'injures. Maintenant mes yeux se gâtent, parce qu'ils sont privés du pinceau que j'ai mis en gage, et que ma main ne pourra jamais les racheter. Voyez, ô cadi, d'après ce récit, dans quel abîme de misère je suis plongé, et prenez pitié d'un homme qui n'y est pas accoutumé. »
Le cadi alors se tourna vers le vieillard, et lui commanda de parler sans détour.
« Je jure par le monument sacré de la Kaaba,[6] répondit celui-ci, et par les habitants du vallon de Mina,[7] que si la fortune m'eût été favorable, vous ne m'eussiez pas vu recevoir en gage le pinceau qu'il a déposé chez moi, ni me présenter à vous, pour demander le prix de mon aiguille. Mais, hélas ! de toutes parts le malheur décoche de son arc sur moi des flèches mortelles. Vous exposer ma situation, c'est vous faire connaître la sienne. Nous n'avons pour tout bien que l'indigence, que les revers, et toute notre ressource est le pèlerinage. Le sort nous a tellement assimilés l'un à l'autre, que ma misère est aussi grande que la sienne; car' il ne peut racheter le pinceau engagé entre mes mains ; et moi, vu ma pauvreté, je suis hors d'état de l'acquitter. Voilà notre histoire : jugez maintenant entre nous et pour nous. »
Lorsque le juge eut entendu le récit de leur pauvreté et de leur misère, il tira une pièce d'or de dessous le tapis, et leur dit: « Terminez votre différent par cette pièce d'or. »
Le vieillard s'empara de la pièce, et sans la partager avec le jeune homme, il se l'appropria toute entière, en lui disant d'un ton sérieux: « La moitié de cette pièce m'est due pour ma justification ; et tu me dois l'autre moitié pour avoir cassé mon aiguille. Quant à moi, je ne relâcherai rien de mes justes prétentions ; ainsi, lève-toi, et reprends ton pinceau. »
Ces paroles répandirent le chagrin dans l'âme du jeune homme, et en attristant le juge, lui firent regretter la pièce d'or qu'il avait donnée, Cependant il consola le jeune homme en lui donnant quelques drachmes, et leur dit à tous deux : « Cessez dorénavant de faire de pareils arrangements, gardez-vous de toute dispute, et ne reparaissez plus devant moi pour des procès ; car je n'ai point de bourse destinée à arranger les dettes des parties. » Les plaideurs se levèrent alors, et se retirèrent en se réjouissant de sa libéralité, et lui prodiguant des éloges. Le cadi, de son côté, ne cachait pas son mécontentement, de ce que sa pierre avait été obligée de donner de la rosée;[8] et sa mauvaise humeur ne cessait point de se manifester, depuis qu'il avait cédé à la compassion. Cependant, après s'être un peu remis de cette humeur, il se tourna vers ses archers, et leur dit: « Je comprends maintenant ; ma défiance m'ouvre les yeux ; ce sont deux filous, et ils étaient d'accord. Quel moyen y aurait-il pour les découvrir et pour leur arracher leur secret ? — On ne peut l'avoir, s'écria le plus fin de sa suite, que par leur propre aveu. » Le cadi donna ordre à ce même archer de les faire revenir. Lorsqu'ils furent arrivés devant lui, il leur dit: « Confessez-moi la vérité, et soyez assurés du pardon. » A ces mots le jeune homme demeura sans parler, et balbutia seulement quelques excuses. Le vieillard s'approcha et dit: « Le fruit ne tombe pas loin de l'arbre ; je suis natif de Saroudje ; il est mon fils; le lionceau tient du caractère de son père. Nous n'avons eu rien de commun ni avec l'aiguille, ni avec le pinceau; mais ces temps de calamité nous ont tellement accablés, que nous sommes réduits à demander l'aumône à quelque main généreuse ; et même à solliciter l'avare de toutes manières et par différentes prières ; tantôt sérieusement, si ce moyen nous réussit, tantôt en badinant, si cela est nécessaire ; afin de pouvoir recueillir de quoi améliorer notre déplorable état, et traîner ainsi une vie fastidieuse. La mort nous guette toujours, et si elle nous épargne aujourd’hui, ce n'est que pour nous saisir demain. »
Le cadi prit la parole et s'écria : « Quelle douceur dans tes discours! que tu serais intéressant si tu n'étais pas un fourbe ! Quant à moi je t'avertis, et je te recommande, de ne pas à l'avenir tromper les princes, et de respecter la dignité des magistrats ; car tous ne seront pas disposés à te pardonner, ou à entendre tes excuses. » Le vieillard promît au cadi de suivre le conseil qu'il venait de lui donner, et de cesser désormais d'employer la supercherie. Il se retira ensuite, conservant toutefois sur sa physionomie l'expression de la fausseté.
Hareth, fils de Hammam, finit son récit en disant, que dans ses voyages et ses lectures il n'avait rencontré rien de pareil.
Silvestre de Sacy, Chrestomathie arabe, tome III, 1827
Voici ce que racontait Hareth, fils de Hammam:
Emporté par le feu de la jeunesse et le désir de faire fortune, je parcourus tout l'espace qui est entre Fergana et Gana. (41); je me plongeais dans les gouffres les plus profonds pour cueillir quelques fruits, et j'affrontais tous les dangers pour atteindre l'objet de mes vœux. J'avais recueilli avidement cet avis sorti de la bouche des savants (42), et je m'étais bien pénétré de cette maxime des sages, qu'un homme instruit et adroit, en entrant dans une terre étrangère, doit avant tout se concilier le juge de la contrée, et s'assurer ses bonnes grâces, afin d'avoir en lui un appui dans les contestations qui peuvent survenir, et de se mettre à l'abri, dans les lieux où il est étranger, de l'oppression des gouverneurs. J'avais pris cette sage maxime pour règle de ma conduite, et elle était le guide de toutes mes démarches. Jamais je n'entrais dans une ville, jamais je n'abordais un lieu suspect (43), que je ne contractasse avec celui qui y exerçait l'autorité, une liaison aussi intime qu'est celle de l'eau avec le vin, et que je ne me fisse de sa faveur un renfort aussi puissant que celui que le corps trouve dans son union avec l'âme.
Un jour donc, comme je me trouvais chez le magistrat d'Alexandrie, pendant une soirée très froide, au moment où cet officier se faisait apporter l'argent recueilli des aumônes des fidèles, pour le distribuer aux indigents, on vit entrer un vieux matois (44) que traînait une jeune femme (45).
Seigneur, dit-elle, en adressant la parole au kadi, que Dieu vous assiste de son secours, et qu'il vous emploie toujours à concilier les intérêts respectifs des plaideurs (46) ! Je suis une femme d'une naissance illustre; j'appartiens à une race pure (7), aussi noble du côté paternel que du côté maternel; j'étais distinguée par le soin que mes parents ont pris de ma pudeur; la douceur de mes mœurs faisait mon ornement ; j'avais toutes les qualités propres à être d'un grand secours (48), et il y avait une extrême différence entre moi et mes voisines. Toutes les fois qu'il s'était présenté, pour me rechercher en mariage, des hommes considérables par l'illustration de leurs familles ou par leurs richesses, mon père leur avait imposé silence, et les avait rebutés durement. Il avait toujours rejeté leur alliance et leurs dons, sous prétexte qu'il avait promis à Dieu, avec serment, de ne donner pour époux à sa fille qu'un homme qui sût quelque métier. Pour mon malheur et mon tourment, le destin voulut que le fourbe que voilà vînt se présenter dans l'assemblée de la famille de mon père, et jurât devant tous les parents qu'il remplissait les conditions de l'engagement que mon père avait contracté. Il prétendit que depuis longtemps son métier était d'assembler une perle avec une autre, et qu'il en avait vendu un couple pour une grosse somme d'argent (49). Mon père fut dupe de ses mensonges, et lui accorda ma main sans prendre aucune information sur son compte. Lorsqu'il m'eut tirée du séjour de mon enfance, emmenée loin de ma famille et transportée dans son domicile, et qu'il me tint une fois dans ses fers, je ne trouvai en lui qu'un paresseux, un fainéant, toujours étendu sur son lit, toujours livré au sommeil. En le suivant, j'avais emporté avec moi un riche trousseau, des parures précieuses, des meubles et un équipage brillant (50); mais il ne cessa de vendre peu-à-peu à vil prix (51) tout ce que je lui avais apporté, et d'en consommer l'argent pour satisfaire son appétit (52). II a si bien fait, qu'il a dissipé tout mon bien, et que dans son besoin il a dépensé tout ce qui m'appartenait. Depuis que sa mauvaise conduite m'a fait oublier jusqu'au goût du repos dont je jouissais auparavant, et qu'il a rendu ma demeure aussi nette que la paume de la main (53), je lui ai dit : Il ne faut plus user de réserve, quand on est tombé dans l'indigence, et il n'y a plus de parfums après la perte d'Arous (54) : lève-toi donc, mets tes talents à profit, et fais-moi recueillir le fruit de ton industrie. Que m'a-t-il répondu! que son métier est absolument tombé, depuis les troubles qui ont porté la désolation et le ravage dans ce pays. Cependant j'ai eu de lui un fils aussi maigre qu'un cure-dent (15) ; il laisse mourir de faim la mère et l’enfant, et le besoin nous arrache des larmes qui ne tarissent jamais. Je l'ai amené devant vous, seigneur, et conduit en votre présence, afin que vous examiniez ses excuses prétendues (16), et que vous jugiez entre nous suivant que Dieu vous l'inspirera.
Le kadi s'approchant alors du vieillard, lui dit: « Tu as entendu le récit de ton épouse; justifie-toi de ce qu'elle t'impute, sinon j'exposerai au grand jour ton hypocrisie (17), et je te ferai mettre en prison. » Le vieillard, d'un air confus et embarrassé, baissa les yeux comme fait un reptile (58) ; puis rassemblant ses forces pour un genre de combat qui n'était pas nouveau pour lui (59), il dit :
« Ecoute (20) mon aventure ; elle est vraiment surprenante : on ne saurait l'entendre sans éclater de rire, et sans verser en même temps des larmes amères. . .
» Je suis un homme dont les talents et le mérite ne sont » souillés par aucune tache, dont la gloire n'est sujette à aucun doute.
» Saroudj est ma patrie, le lieu qui m'a vu naître; si je nomme mes ancêtres, je nomme la famille de Gassan.
» Mon occupation est l'étude : pénétrer dans les profondeurs de la science, voilà l'objet de mes travaux; en est-il un plus excellent!
» Mes capitaux et le fonds de mes revenus, c'est la magie de la parole (61), cet art dont les travaux façonnent les beaux vers et les discours éloquents.
» Je plonge dans les gouffres de l'art oratoire ; j'y choisis à loisir les perles les plus belles.
» Je cueille les fruits les plus mûrs qui couvrent l'arbre de l'éloquence, tandis que les autres ne font que ramasser le menu bois qui tombe de ses branches.
» Les mots, quand je les prends pour mon usage, ne sont que de l'argent ; façonnés par mes mains, ils semblent être convertis en or.
» Autrefois les talents que j'avais acquis par mon travail, étaient pour moi une source abondante de richesses et de biens (62) ;
» La plante de mes pieds foulait orgueilleusement les degrés les plus élevés, et je voyais tout ce qu'il y a de plus » grand, au-dessous de moi.
» Pendant longtemps les présents et les dons affluèrent chez moi de toute part (63), et je n'honorais pas toujours d'un accueil favorable ceux qui s'empressaient de me les offrir ;
» Mais aujourd'hui il n'est aucune marchandise moins précieuse que les lettres, aux yeux de ceux sur qui l'on pourrait fonder l'espoir d'un bienfait.
» L'honneur des hommes qui les cultivent, n'est plus à l'abri des outrages ; leurs droits les plus sacrés ne sont point respectés
» Abandonnés dans leurs demeures, on dirait que ce sont des cadavres qu'on repousse loin de soi à cause de leur puanteur, et qu'on évite avec soin.
» Victime des traits du sort, mon esprit en est comme stupéfait ; et certes, les vicissitudes du sort sont bien dignes qu'on s'en étonne !
» L'indigence de mes mains a paralysé mes talents (25), et de toute part les chagrins et les soucis sont tombés en foule sur moi.
» La fortune injuste envers moi m'a contraint à des démarches que l'honneur désavoue.
» J'ai vendu jusqu'au dernier de mes effets : il ne me reste plus ni un morceau de serge, ni un feutre grossier, sur lequel je puisse me jeter.
» Accablé des dettes que j'ai contractées pour fournir à mes besoins, leur poids, sous lequel je courbe la tête, est plus lourd pour moi que le trépas.
« Mes entrailles, repliées sur elles-mêmes, ont souffert la faim pendant cinq jours entiers : tourmenté de ses cruels aiguillons,
» Je n'ai plus vu d'autre marchandise que je pusse exposer en vente, et dont il me fût possible de trafiquer, que le trousseau de cette femme.
» J'en ai donc disposé, en dépit de mon âme, l'œil baigné de larmes, le cœur rongé de chagrin.
» Lorsque je me suis ainsi joué de son bien, je ne l'ai point fait sans son consentement, en sorte que j'aie mérité par là de sa part une juste colère.
» Si son dépit vient de ce qu'elle s'est imaginé que mes doigts fourniraient à ma subsistance, en travaillant à enfiler des perles, ou de ce qu'elle croit que, quand j'ai recherché son alliance, j'ai eu recours au mensonge pour assurer le succès de ma demande ;
» J'en jure par celui dont la Kaaba est le rendez-vous des troupes saintes de pèlerins qui y viennent de tous côtés, » guidés par des chameaux excellents qui accélèrent leur marche,
» Jamais je n'ai usé d'artifices perfides pour séduire les femmes d'honneur (26) ; le mensonge et une odieuse dissimulation (67) sont bien éloignés de mon caractère.
» Depuis que j'ai vu le jour, mes mains n'ont manié que les roseaux taillés pour écrire les livres.
» C'est mon esprit et non mes mains qui enfilent des perles : et les bijoux qui sortent de mon atelier, sont des pièces de poésie et non des colliers de graines aromatiques (68).
» C’est de cet art que j'ai voulu parler ; c'est par ce travail n que je gagnais ma subsistance et que j'amassais des richesses (69).
» Écoute donc mon récit, comme tu as écouté les plaintes de celle-ci, et rends sans partialité le jugement convenable. »
Hareth ajoutait : Quand le vieillard eut établi sa défense et fini de chanter ces vers, le kadi, qui en avait été touché jusqu'au cœur, se tournant vers la femme, lui dit : « C’est une chose connue de tous ceux qui exercent l'autorité et qui rendent la justice, que la race des hommes généreux a cessé, et que notre siècle ne produit plus que des âmes basses et dégradées. Il me semble que votre époux n'a rien dit que de vrai, et qu'il ne mérite aucun reproche. Il vous a tout simplement avoué sa dette ; il a dit franchement la pure vérité; il a fait voir qu'il possédait effectivement le talent de mettre en œuvre, comme il s'en était vanté ; et c'est une chose claire qu'il n'a que la peau sur les os. Tourmenter celui qui fait valoir une excuse légitime, c'est une bassesse ; et mettre en prison un homme réduit par l'indigence à l'impossibilité de payer, c'est une action criminelle. Cacher sa pauvreté, est une œuvre de dévotion, et c'est un acte de religion d'attendre patiemment l'instant du soulagement. Retournez donc chez vous, et ne rejetez pas les excuses du premier objet de votre amour (30) : mettez fin à la violence de vos plaintes, et résignez-vous aux volontés de votre souverain maître. »
Ensuite le kadi leur donna part aux aumônes ; et leur présentant quelques pièces d'argent (71) prises sur ce fonds sacré, il leur dit : « Prenez toujours ceci pour adoucir vos malheurs ; profite de cette goutte d'eau, et supportez avec patience les rigueurs de la fortune : peut-être Dieu vous procurera-t-il bientôt un sort plus heureux ou quelques secours (72). » Ils se levèrent alors pour s'en aller. Le vieillard paraissait aussi joyeux qu'un homme auquel on vient d'ôter ses fers; il tressaillait comme celui qui vient de passer de l'indigence à une opulence inespérée.
J’avais bien reconnu, continuait Hareth, que ce vieillard n'était autre qu'Abou-Zeïd, du moment où sa figure avait frappé mes regards (73) et où sa femme avait commencé à parler contre lui : peu même s'en était fallu que je n'eusse dit ce que je savais de la variété de ses talents et des productions de son savoir; mais je fus retenu par la crainte que le kadi ne découvrît son mensonge et la fausseté de ses discours, et que, quand il le connaîtrait, il ne voulût pas lui donner part à ses libéralités (74). Je retins donc mes paroles comme celui qui n'est pas assuré de la vérité de ses conjectures ; et je gardai le silence sur ce que je savais de lui, comme l'ange qui tient registre des actions des hommes cache les secrets dans les plis de son livre (75): seulement, quand il fut parti et qu'il se fut retiré où bon lui sembla, je dis: « Si nous avions quelqu'un par qui on pût faire suivre ce vieillard, on nous apporterait la fin de son histoire (76), et nous saurions quelles sont les étoffes qu'il déploie (77). » Alors le kadi le fit suivre par un homme de confiance, à qui il recommanda de s'informer de son aventure. Celui-ci ne tarda pas à revenir avec précipitation (78), en riant. « Qu'as-tu appris, Abou-Maryam (79), lui dit le kadi ? Ah, dit-il, j'ai vu une chose bien surprenante; ce que j'ai entendu m'a beaucoup amusé. Eh bien ! reprit le kadi, qu'as-tu donc vu, qu'as-tu donc entendu ? » Cet homme dit alors : « J'ai vu le vieillard qui, dès l'instant qu'il est sorti de devant vous, n'a cessé de battre des mains, de sauter en dansant (80) et de chanter à gorge déployée:
« Peu s'en est fallu qu'une femme impudente et adroite n'attirât sur moi un malheur ;
» Peu s'en est fallu que je n'allasse faire un tour en prison, si ce n'eût été le magistrat d'Alexandrie (41). »
Le kadi se mit à rire avec une telle violence, que son bonnet (82) tomba de dessus sa tête, et que la dignité de sa place en souffrit : quand il eut repris sa gravité, il demanda pardon à Dieu de l'excès auquel il s’était laissé aller ; puis il dit : « Mon Dieu, par les mérites de vos serviteurs les plus chers, ne permettez pas que je condamne à la prison ceux qui cultivent les lettres. » Après quoi il ordonna à ce même homme qu'il avait déjà envoyé après Abou-Zeïd, de lui amener le vieillard. Le messager partit aussitôt en grande hâte pour chercher Abou-Zeïd ; mais au bout d'un temps assez long, il revint annonçant que le vieillard avait disparu. Si on me l'eût amené, dit alors le kadi, il n'aurait couru aucun risque; loin de là, je lui aurais fait des présents dignes de son mérite, et je lui aurais fait voir que la fin eût été meilleure que le commencement (83).
Lorsque je vis, disait Hareth en finissant son récit, que le kadi avait conçu de l'intérêt pour Abou-Zeïd, et que celui-ci avait manqué de recueillir le fruit de l'avis que j’avais donné ace magistrat, j'éprouvai un repentir pareil à celui de Férazdak, quand il eut répudié Néwar, ou aux regrets de Cosaï, quand le jour lui eut fait apercevoir son erreur (85).
N.B. : Les notes ne sont reproduites que partiellement.
(41) C'est, dit l'auteur des gloses du manuscrit de la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés, n° 207, comme si Hariri eût dit : Depuis l'extrémité orientale jusqu'à l'extrémité occidentale la plus reculée des pays où la religion des Musulmans a pénétré : car Fergana est la contrée la plus éloignée à l'orient, et Gana le pays le plus reculé à l'occident.

Fergana est une ville ou plutôt une contrée du Mawaralnahr ou de la Transoxiane, sur laquelle on peut consulter Aboulféda, Chorasmiœ et Mawaralnahrœ Descriptio, p. 60; d’Herbelot, Biblioth. or. au mot Ferganah ; Golius, Not. ad Alfergan. p. 168; M. W. Ouseley, the oriental Geography of Ebn-Haukal Suc. Cette contrée s'appelle aujourd'hui royaume de Kouhan ou de Fergana. Voyez M. Fraser, Narration of a Journey into Khorasan, Append. p. 74.
Gana est le nom d'une ville et d'une contrée en Afrique, sur laquelle on peut voir M. Hartmann, Edrisii Africa, p. 41 et suiv. ; d’Herbelot, Biblioth. or. au mot Ganah &c. M. le ch.r P. Am. Jaubert a fait imprimer, il y a peu, dans le tome II des Mémoires de la Société de géographie, une relation de Ganat (Gana)et de ses habitants, traduite de l'arabe.
Dans le dictionnaire géographique que j'ai souvent cité, on lit que de Gana on entre dans le pays de Tatar; mais il faut lire dans le pays de l'or, c'est-à-dire, la contrée de Wankara. Voyez M. Hartmann, Edrisii Africa, p. 47 et suiv.
(42)Le
mot  , suivant
Motarrézi, signifie proprement recevoir avec
promptitude une chose de la main
d'une personne qui la jette :
, suivant
Motarrézi, signifie proprement recevoir avec
promptitude une chose de la main
d'une personne qui la jette :
(43) A la lettre, n'entrais jamais dans un repaire de lions.
(44) Motarrézi dit que le mot
 signifie
méchant, très pernicieux, qu'il vient de
poussière, et que c'est comme si l'on disait, un homme
qui, à cause de sa force,
renverse ses rivaux dans la
poussière. Suivant Ocbari, il a la même origine; mais il
signifie un homme de couleur de
terre. Le même auteur cependant dit que, suivant d'autres, il
est synonyme de fort, épais. On lit dans Djewhari :
signifie
méchant, très pernicieux, qu'il vient de
poussière, et que c'est comme si l'on disait, un homme
qui, à cause de sa force,
renverse ses rivaux dans la
poussière. Suivant Ocbari, il a la même origine; mais il
signifie un homme de couleur de
terre. Le même auteur cependant dit que, suivant d'autres, il
est synonyme de fort, épais. On lit dans Djewhari :
« Ifr signifie un homme méchant et dangereux : d'une femme on dit ifra. Abou-Obéïda dit que le mot ifr'it, appliqué à toute sorte de choses, signifie, dans chaque espèce, ce qui est porté à un haut degré. On dit: Un tel homme est ifrit nifrit, ou ifrièh nifrièh. On » rapporte de Mahomet cette sentence : Dieu hait l'ifrièh qui n'est éprouvé par aucune infortune, dans sa famille ou dans son bien. nlfriyèh (dans cette expression, ifriyèh nifriyèh) est le mot qui exprime réellement le sens, et nifriyèh n'est là que pour la consonance (sans exprimer aucun sens). Le poète Dhou'lromma a dit:
» On dirait qu'il est une étoile marquée exprès pour cela, qui, au milieu des ténèbres de la nuit, se détache, et quitte sa place pour poursuivre un Ifriyéh [c'est-à-dire, un mauvais génie].
» Ifrit signifie aussi un grand malheur. »
Dans le vers de Dhou'lromma cité par Djewhari, il y a une allusion
aux étoiles ou feux atmosphériques, qui, suivant l'Alcoran,
poursuivaient les mauvais génies, pour les écarter des régions
éthérées dont ils s'étaient approchés afin de dérober les secrets
des esprits célestes (Alcor. sur. 37, v. 8, sur. 67, v. 5, et sur.
72, v. 9, édition de Hinckelmann ; Marracci, Prodr. ad
refut. Alcor. part. I, p. 38). Quant au mot
 , il fait
allusion à la destruction de Sodome, et à ce texte de l'Alcoran :
, il fait
allusion à la destruction de Sodome, et à ce texte de l'Alcoran :
 (Alcor.
sur. 51, v. 33 et 34, et sur. 11, v. 84).
(Alcor.
sur. 51, v. 33 et 34, et sur. 11, v. 84).
Le vrai nom de Dhou'lromma était Gaïlan: on peut voir dans mon Commentaire sur les Séances de Hariri, séance XXVII, p. 280, à quelle occasion on lui donna le surnom de Dhou'lromma.
(45) On
explique le mot
 de
deux manières, selon Ocbari ; il peut signifier une femme
qui a de petits enfants, ou
une femme dont la beauté ravit
tous les cœurs.
de
deux manières, selon Ocbari ; il peut signifier une femme
qui a de petits enfants, ou
une femme dont la beauté ravit
tous les cœurs.
(46)
Voici la glose qu'on lit sur le mot
 dans le
manuscrit de Berlin, dont j'ai déjà parlé, ci-devant, p. 203, note
(32).
dans le
manuscrit de Berlin, dont j'ai déjà parlé, ci-devant, p. 203, note
(32).
« C'est là le meilleur vœu qu'on puisse faire pour un kadi, car il renferme le souhait de la durée de ses fonctions et de son autorité, et en même temps on exprime le désir de voir ses jugements conformes à la justice, au plus haut degré possible. En effet, s'il satisfait longtemps une des deux parties qui plaident devant lui, en conservant toujours son office, que sera-ce s'il continue longtemps à satisfaire les deux parties en litige ! On lit dans l'ouvrage intitulé, Fragment des Mékamas : Est-ce que je puis contenter les deux parties adverses ! Comment et par quel moyen réussir à cela ! »
(48) Le
mot  signifie
proprement aide, secours, assistance ; mais on
appelle aussi de ce nom une femme mariée.
signifie
proprement aide, secours, assistance ; mais on
appelle aussi de ce nom une femme mariée.
(49) Il
y a dans le texte  , ce qui
signifie, suivant l'auteur du Kamous, une bourse qui contient
1.000 ou 10.000 pièces d'argent, ou 7.000 pièces d'or. Djewhari dit
simplement que
, ce qui
signifie, suivant l'auteur du Kamous, une bourse qui contient
1.000 ou 10.000 pièces d'argent, ou 7.000 pièces d'or. Djewhari dit
simplement que  signifie
10.000 pièces d'argent. Abou-Saïd, ou l'auteur des notes qui
accompagnent la version arabe des Livres de Moïse à l'usage des
Samaritains, dit que le poids nommé bedrèh
est
égal à 20 rotls de Damas.
signifie
10.000 pièces d'argent. Abou-Saïd, ou l'auteur des notes qui
accompagnent la version arabe des Livres de Moïse à l'usage des
Samaritains, dit que le poids nommé bedrèh
est
égal à 20 rotls de Damas.
(50) Le mot est expliqué, dans le manuscrit 207 de la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés. Ocbari rend ainsi raison de la signification de ce mot: « ce qui a un bel aspect, comme s'il y avait de l'eau qui coulât dessus. » Ce mot réunit l'idée de la beauté à celle de la parure.
(51) A la lettre, dans le marché de la perte.
(52) Les deux mots sont opposés: le premier signifie manger avec les dents qui sont dans le fond de la bouche, ce qu'on fait quand ce que l'on mange est mou ; et le second, manger avec les dents de devant, ce qui a lieu quand on mange des choses sèches, comme le dit Ocbari.
« Khadhm, c'est manger de toute la touche, et kadhm, manger du bout des dents. Le fils d'Abou-Tarafa dit : Un Arabe du désert vint trouver un de ses cousins à la Mecque, et celui-ci lui dit: Ce pays-ci est un pays où l'on mange du bout des dents, on n'y mange pas de toute la bouche. Le sens du proverbe, On parvient à manger de toute la bouche, en mangeant du bout des dents, est qu'en agissant avec douceur, on parvient à réussir à ce qu'il y a de plus difficile, comme on parvient à se rassasier en mangeant du bout des dents. »
(53) Les Arabes disent en proverbe, plus net que la paume de la main ; que le chaudron d'une nouvelle mariée, que le miroir d'une femme étrangère. Méïdani, expliquant ce dernier proverbe, dit qu'il signifie, plus propre que le miroir d'une femme qui est mariée hors de son pays et de sa nation ; parce qu'une femme qui est dans ce cas, nettoie son miroir sans relâche, de peur qu'il n'y ait quelque endroit de son visage qu'elle n'aperçoive pas [et qu'elle oublie de nettoyer].
(54) C'est un proverbe que Méïdani rapporte de deux manières. Voici comment Méïdani en raconte l'origine, sur l'autorité de Mofaddhal. Ce mot fut dit, pour la première fois, par une femme de la tribu d'Odhra, qui se nommait Asma, fille d'Abd-allah. Elle avait pour mari un de ses cousins paternels, nommé Arous. Celui-ci étant mort, elle épousa en secondes noces un homme de sa propre tribu, qui s'appelait Naufal. Cet homme était pauvre, avait l'haleine puante; il était, en outre, avare, et d'un caractère bas et méprisable. Lorsqu'il voulut partir et emmener sa femme avec lui, elle lui demanda la permission de pleurer sur le tombeau de son cousin Arous, son premier mari, et de chanter encore une fois l'objet de son deuil. Naufal le lui ayant permis, elle commença à dire :
« Je te pleure, ô Arous, l'époux des époux (elle faisait allusion à son nom Arous, qui signifie époux), ô toi qui étais un renard au milieu de ta famille, et un lion au jour du combat, sans parler des autres choses que les hommes ignorent! »
« Quelles sont ces choses ? » demanda Naufal.
« Jamais, répondit-elle, son courage n’était endormi, et il savait manier l'épée aux jours du combat. »
Puis elle reprit :
« O Arous, magnifique, éclatant, doué d'un heureux naturel et d'une figure noble, sans les autres choses dont je ne parle pas! »
Naufal lui demanda encore quelles étaient ces autres choses.
« Arous, lui dit-elle, ne se permettait rien d'obscène ni de malséant ; son haleine était douce, et n'avait point une odeur rebutante ; il était riche, et non pas réduit à l'indigence. »
Alors Naufal vit bien que sa femme avait en vue de lui reprocher ses défauts. Quand il fut parti avec elle, il lui dit : « Ramassez vos parfums, » regardant en même temps la corbeille où elle mettait ses parfums, et qui était tombée par terre. « Après Arous, répondit-elle, il n'y a plus de parfums » ; et ce mot passa en proverbe.
D'autres disent, ajoute Méïdani, qu'un homme ayant épousé une femme, quand elle eut été amenée chez lui, il trouva qu'elle avait l’haleine désagréable. « Où sont les odeurs ! » lui demanda-t-il. Elle lui répondit qu'elle les avait serrées: « Après le mariage [arous], dit-il, il ne faut pas resserrer les odeurs. » Et cette répartie passa en proverbe.
Motarrézi, qui rapporte la plus grande partie de ce récit d'après Méïdani, dit qu'on se sert de ce proverbe pour blâmer quelqu'un qui met une chose en réserve, ait moment où l'on en a besoin :
Ocbari rapporte l'aventure de Naufal, qu'il nomme Taulab, et d'Asma, plus en abrégé, d'une manière différente.
(58) Le
mot  ,
suivant Motarrézi, signifie un serpent mâle, et
selon Ocbari, un gros serpent,
,
suivant Motarrézi, signifie un serpent mâle, et
selon Ocbari, un gros serpent,
Cette expression proverbiale veut dire, suivant le premier de ces commentateurs, baisser les yeux et regarder la terre, comme fait un serpent blessé d'une flèche. « Le proverbe se dit d'un homme qui réfléchit, et qui se conduit avec une grande finesse. Méïdani, à ce sujet, cite le vers suivant de Motélammès :
« Il fixe les regards sur la terre comme le serpent; et si le serpent voyait la possibilité d'enfoncer ses dents, certes il mordrait fermement. »
On trouve la même idée dans des vers de Taabbata-scharran, que j'ai rapportés dans mon Commentaire sur les Séances de Hariri, à l'occasion de ce passage de la séance IX, p. 88.
(59) Le
mot  se dit
proprement d'une femme de moyen âge, qui a déjà eu un enfant, ou
d'un animal qui a déjà mis bas une fois; figurément, étant joint au
mot guerre, il signifie un combat qui a déjà été précédé
d'hostilités antérieures, et qui en est d'autant plus terrible, à
cause de l'expérience et de l'animosité des combattants, comme le
dit Ocbari.
se dit
proprement d'une femme de moyen âge, qui a déjà eu un enfant, ou
d'un animal qui a déjà mis bas une fois; figurément, étant joint au
mot guerre, il signifie un combat qui a déjà été précédé
d'hostilités antérieures, et qui en est d'autant plus terrible, à
cause de l'expérience et de l'animosité des combattants, comme le
dit Ocbari.
Djewhari dit aussi :
« On ne montre pas à une femme qui a déjà quelques années de mariage, à mettre son voile. »
Schultens, dans les Extraits du Hamasa, à la suite de son édition de la Grammaire d'Erpénius, p. 528, a donné la glose de Teblébi sur ce passage de Hariri.
(61)Le
mot  , qui
s'emploie ordinairement en mauvaise part dans le sens de magie,
enchantement, signifie primitivement, suivant Djewhari et
Firouzabadi, toute chose qu'on ne
peut prendre que par un endroit
mince et subtil, c'est-à-dire, qu'il est
difficile de saisir et d'attraper: de là il se dit de toute sorte de
sciences. Les Arabes nomment spécialement la poésie, la
magie permise.
, qui
s'emploie ordinairement en mauvaise part dans le sens de magie,
enchantement, signifie primitivement, suivant Djewhari et
Firouzabadi, toute chose qu'on ne
peut prendre que par un endroit
mince et subtil, c'est-à-dire, qu'il est
difficile de saisir et d'attraper: de là il se dit de toute sorte de
sciences. Les Arabes nomment spécialement la poésie, la
magie permise.
(62) Les deux mots signifient proprement presser le pis d'un animal pour en tirer le lait ; traire.
(63) Le
mot  signifie proprement conduire une fiancée
en pompe à l'époux auquel elle
est accordée: de là vient une espèce de litière
qui sert à porter la jeune épouse sur un chameau.
signifie proprement conduire une fiancée
en pompe à l'époux auquel elle
est accordée: de là vient une espèce de litière
qui sert à porter la jeune épouse sur un chameau.
(67) Le
mot  , dit
l'auteur des gloses du manuscrit 207 de la bibliothèque de
Saint-Germain-des-Prés, signifie primitivement, recouvrir
du fer ou autre chose, d'or
ou d'argent, et il cite ce vers de Dhou'lromma :
, dit
l'auteur des gloses du manuscrit 207 de la bibliothèque de
Saint-Germain-des-Prés, signifie primitivement, recouvrir
du fer ou autre chose, d'or
ou d'argent, et il cite ce vers de Dhou'lromma :
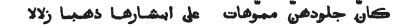
« Comme si leur peau était lustrée par une couverte d'or en liqueur. »
(68)Une note du manuscrit 207 de la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés nous apprend que Hariri a imité ici un vers d'un poète nommé Ibn Harama. Voici ce vers :

« Je ne suis pas un homme dont les mains façonnent les bijoux qu'il fabrique : c'est ma langue qui façonne les mots. »
(69)La construction dans ce vers est extrêmement embarrassée; et l'on peut voir dans mon Commentaire sur Hariri, séance IX, les efforts qu'ont faits les scholiastes pour la ramener à une analyse régulière. Je crois qu'il est impossible de justifier complètement cette construction : toutefois le sens est certain.
(71 Le premier mot signifie une pincée, ce que l'on prend avec le bout des doigts, et le second, une poignée, ce qu'on prend avec toute la main.
(72) C'est un passage de l'Alcoran, sur. 5, v. 57, éd. de Hinckelmann.
(73)A la lettre, dis que son soleil se fut levé.
(74) La
glose de Motarrézi, sur le mot  est trop
importante pour ne pas la transcrire ici en entier.
est trop
importante pour ne pas la transcrire ici en entier.
Motarrézi dit, en finissant, que la composition
même du mot  indique
l'humidité. Ceci tient à un système étymologique dont je n'ai
trouvé nulle part le développement, mais qui me paraît fondé sur la
supposition que beaucoup de racines trilitères sont formées de deux
racines qui, en se réunissant, ont perdu chacune une partie de leurs
éléments. Dans l'exemple présent, l'auteur paraît avoir supposé que
indique
l'humidité. Ceci tient à un système étymologique dont je n'ai
trouvé nulle part le développement, mais qui me paraît fondé sur la
supposition que beaucoup de racines trilitères sont formées de deux
racines qui, en se réunissant, ont perdu chacune une partie de leurs
éléments. Dans l'exemple présent, l'auteur paraît avoir supposé que
 est
formé de
est
formé de  humore
conspuit,
et
de ad
satietatem bibit.
humore
conspuit,
et
de ad
satietatem bibit.
Je ne me rappelle pas avoir trouvé de traces de ce système ailleurs que dans Motarrézi; mais elles y sont fréquentes.
(75)Le mot
 peut
signifier
peut
signifier  un volume; il peut aussi être le nom d'un
homme qui servait de secrétaire à Mahomet, suivant Motarrézi, ou le
nom d'un ange qui tient registre des actions des hommes.
un volume; il peut aussi être le nom d'un
homme qui servait de secrétaire à Mahomet, suivant Motarrézi, ou le
nom d'un ange qui tient registre des actions des hommes.
(76) Les noms d'action de la langue arabe tiennent la place des infinitifs, tant actifs que passifs : ainsi on peut traduire, suivant la première signification, comme est plié le papier dont on se sert pour en faire un livre ou pour écrire; et suivant les deux autres sens du même mot, de même que Siddjill plie le livre ou la lettre. Cette seconde explication me paraît meilleure ; et je crois que Hariri a pris ce nom dans la dernière acception, c'est-à-dire, pour celui d'un ange: c'est ce que j'ai exprimé dans ma traduction.
Il y a dans ce passage une allusion à un texte de l’Alcoran, qui se trouve sur. 21, v. 104.
(77) Le mot veut dire une sorte d'habit d'une étoffe rayée fabriquée dans le Yémen. Cette phrase signifie: Nous saurons la conduite qu'il tient en public, et ce qu'on dit de lui.
(78) A la lettre, en roulant du haut en bas, c'est-à-dire, aussi vite qu'une pierre qui tombe du haut d'une montagne.
(79) Abou-Maryam, dit Motarrézi, est une expression particulière à certains auteurs modernes, qui désignent sous ce nom les officiers ministériels des kadis, c'est-à-dire, les huissiers.
(80) Motarrézi explique les mots par l'action de danser.
(82)« Le mot, dit Motarrézi, signifie un bonnet fort haut que portent les kadis ; ce mot vient de cruche, ce bonnet ayant, par sa hauteur et sa rondeur, quelque ressemblance avec une cruche. »
(83) C'est une allusion à une phrase de l'Alcoran, mais ici le sens de ces paroles est que le kadi aurait fait à Abou-Zeïd un présent encore plus considérable que le premier.
(84) Les aventures de Férazdak et de Cosaï sont rapportées un peu différemment par Ocbari et Motarrézi. Je vais donner le récit de l’un et de l'autre, en commençant par celui de Motarrézi. Ce qu'il dit de Cosaï est conforme, mot pour mot, à Méïdani; et en comparant les deux manuscrits, je crois être venu à bout de rectifier les fautes, qui sont assez nombreuses dans l'un et dans l'autre texte.
Mais avant de passer à ces récits, je dois dire un mot de Férazdak lui-même. Férazdak se nommait Hammam (ou Homam) fils de Caleb. Son surnom, qui n'est qu'un sobriquet, signifie un morceau de pâte.
Férazdak est mort, suivant Abou'lmahasen, en l'année no de l'hégire, qui fut aussi celle où moururent le fameux docteur Hawo Basri, et Mohammed, fils de Sirin, auteur d'un traité célèbre d'onirocritique. Voici ce qu'en dit Abou'lmahasen : « En cette même année (110) mourut Férazdak, le premier entre les poètes de son temps : il avait pour surnom Abou-Férat et pour nom Homam Temimi Basri, fis de Caleb, fils de Saasaa, fils de Nadjia : il rapporte des traditions reçues d'Ali, fils d'Abou-Taleb, et de plusieurs autres, mais ordinairement sans citer ceux de qui il les tenait ; il en rapportait aussi qu'il tenait d'Abou-Horéïra et de beaucoup d'autres compagnons du prophète. On avait coutume de dire: Férazdak est le meilleur poète de tous les hommes en général, et Djérir est le meilleur poète de tous les hommes en particulier. Suivant un récit de Mohammed, fils de Sélam, Férazdak vint trouver un jour Hasan Basri, et lui dit : J'ai fait une satire contre le diable, écoutez-la. Je ne me soucie nullement de ce que tu dis, lui répondit Hasan. Certes, reprit Férazdak, tu m'écouteras ; sinon je vais sortir, et je dirai à tout le monde que Hasan défend de mal parler du diable. Tais-toi, lui dit Hasan ; tu ne parles que par son inspiration. Férazdak eut avec sa femme Néwadir [lisez Néwar] des aventures plaisantes.»
Abou'lmahasen cite ensuite deux vers de Férazdak ; puis il parle d'un autre poète célèbre, mort la même année, dont le nom est Abou-Hazra Djérir Témimi Basri, fils d'Atia, fils de Hodhaifa, fils de Bedr, fils de Salama, et qui est appelé communément Djérir Khatfi, et à cette occasion il rapporte encore quelques vers de Férazdak. (Voyez manuscrit arabe de la bibliothèque du Roi, n° 659, à l'année 110.)
Voyez., sur Férazdak, M. Eichhorn, Monum. vetust. hist. Arab. p. 30; Notices et Extraits des manuscrits, tom IV, p. 228; M. Rasmusen, Additam. ad hist. Ar. p. 66 et 67.
Voici maintenant le récit quêtait Motarrézi, de l'aventure de Férazdak.
« Voici comment on raconte l'aventure de Férazdak, sur l'autorité d'Obéïd, qui nous a transmis les poésies de Férazdak : Néwar, disait Obéïd, vint me trouver, et me dit : Dites à cet homme qu'il me répudie. Que prétendez-vous faire, lui demandai-je! Comme cependant elle insista, j'allai trouver Férazdak, et je lui dis: Néwar demande, Abou-Féras, que tu la répudies. Il me répondit : Je ne serai pas satisfait et tranquille, si je ne prends Hasan à témoin du divorce que je fais avec elle. Il appela donc Hasan et lui dit : Abou-Saïd, sois témoin que je répudie Néwar. J'en suis témoin, répondit Hasan (qui est le même qu'Abou-Saïd). Quelque temps après, comme ils faisaient route ensemble, Férazdak dit à Néwar: Est-ce que je t'ai répudiée! Oui certes, lui répondit-elle. Il n'en est rien, reprit Férazdak. Eh bien, dit Néwar, Dieu va te couvrir de confusion par le témoignage de Hasan. Puis elle prit à témoin avec serment Hasan. Alors Férazdak, ému de regret, dit:
» J'éprouve un repentir pareil à celui de Cotai, à cause du divorce qui a séparé de moi Néwar.
» C'était mon paradis, et je l'ai quitté ; j'ai imité Adam, que le séducteur a fait sortir du jardin de délices.
» Mon malheur est semblable à celui d'un insensé qui s'est arraché les yeux de ses propres mains, et pour qui la lumière du jour ne se lève plus.
» Quant à Cosaï, dont le repentir est passé en proverbe, Hamza dit que c’était un homme de la tribu de Cosaï, qui se nommait Moharib, fils de Kais. D'autres disent qu'il était du nombre des descendants de Cosaï, et de la branche de Moharib, et que son nom était Amer, fils de Hareth. Au surplus, voici son aventure. Il faisait paître des chameaux dans une vallée où il y avait beaucoup d'herbe, lorsqu'il aperçut dans une roche un arbrisseau de l'espèce nommée naba. L'ayant trouvé très beau, il faut, dit-il, que j'en fasse un arc. Depuis ce temps il venoit souvent visiter cet arbrisseau, attendant le moment où il serait en état d'être employé à cet usage ; et quand l'arbrisseau fut assez fort, il le coupa, le fit sécher, et puis il se mit à en faire un arc, et chanta ces vers:
« Mon Dieu, accorde-moi la grâce de réussir à faire cet arc; il sera mon amusement; fais qu'il fournisse aux besoins de ma femme et de mes enfants. Je fais un arc jaune comme le safran, un arc jaune qui n'est pas de ces arcs qui ont quelque partie plus faible que le reste. »
La plante nommée au singulier naba, est un arbrisseau dont on se sert pour faire des arcs, et dont les branches servent à faire des flèches : son bois est sans doute jaune, car un poète cité par Djewharidit: Plus jaune que des flèches de naba. On appelle jaune, suivant le Kamous, tout arc fait de cette plante. Dans le poème d'Ibn Doréïd, il est aussi parlé des flèches faites du bois de naba. Ce poète compare les pèlerins de la Mecque que la fatigue d'un long pèlerinage et la faim ont exténués, à des flèches de bois de naba :

» Après cela, il huila son arc, le garnit d'une corde ; puis, prenant les copeaux, il en fit cinq flèches, et, en les remuant dans sa main, il chantait :
» Ce sont ici, par Dieu, de bonnes flèches ; elles charment les doigts qui les lancent: on dirait qu'elles ont été faites à une balance. Mes enfants, réjouissez-vous d'avance de la bonne chère que vous allez faire, pourvu que le sort malin ne ruine pas mes espérances.
» Ensuite il alla se mettre en embuscade dans une cabane de chasseur, près d'une citerne où venaient s'abreuver les ânes sauvages: un troupeau de ces animaux venant à passer, il tira un jeune faon; la flèche le perça de part en part, et, étant allée frapper la montagne, elle en fit jaillir des étincelles. Cosaï s'imaginant qu'il avait manqué son coup, dit:
» Ne plaise au Dieu puissant et plein de bonté, que je prenne tant de peine sans en retirer aucun fruit! Qu'est ceci ! j'ai vu ma flèche faire sortir du milieu des rochers des étincelles jaunes comme l'or : elle a trompé aujourd'hui l'espoir de mes enfants.
» Bientôt arriva un autre troupeau : une autre flèche est encore tirée sur un faon ; elle le perce d'outre en outre, et fait comme la première.
» Hélas ! dit Cosaï, que Dieu maudisse les coups qui partent des cabanes des chasseurs ! Que Dieu me préserve de la malice du sort ! Est-ce donc que je tire des flèches pour blesser les pierres, ou ma vue me trompe-t-elle par une vaine illusion ou bien n'y a-t-il point de précaution qui puisse servir contre le destin?
» Un troisième troupeau succéda au bout de quelque temps au second. Cosaï tira encore une fois, et la flèche fit comme les deux premières.
» Pourquoi donc, dit le chasseur, mes flèches font-elles ainsi jaillir du feu ! Je croyais que celle-ci serait plus heureuse : au lieu de percer ce faon qu'elle pouvait atteindre, elle s'est détournée de côté, et mon attente a été déçue : un tel malheur me plonge dans un chagrin cuisant.
« Le sort ne lui fut pas plus favorable une quatrième fois, et il témoigna son chagrin par ces vers:
» Il faut que je sois bien malheureux ! toutes mes peines sont en pure perte ; à rien ne sert ni l'attention ni la force. L'attente de ma famille et de mes enfants sera donc vaine! tout ce que j'espérais pour eux, trompe mon espoir !
» Enfin un nouveau troupeau vint à passer ; Cosaï tira sa cinquième flèche, et il en fut comme des autres.
» C'en est trop, dit-il : après cinq épreuves (je n'en ai pas oublié le nombre), porterais-je mon arc ! voudrais-je encore essayer de le tendre! fortement ou faiblement tendu, Dieu l'a toujours couvert de honte. Après cela, Dieu m'est témoin que je ne le conserverai pas entier ; je n'en attends aucun bien de toute la durée de mes jours.
» Aussitôt, prenant son arc, il en frappa contre une pierre et le cassa; mais quand le jour commença à paraître, il aperçut cinq faons couchés par terre tout autour de lui, et ses flèches teintes de sang. De dépit d'avoir brisé son arc, il se mordit le pouce et le coupa.
» Ah! dit-il en gémissant, tel est le repentir dont j'éprouve la violence, que si je suivais ce que me dicte mon dépit, je couperais mes cinq doigts ! Vive ton père! je ne saurais douter de la sottise que j'ai faite en brisant mon arc. »
On peut comparer la colère de Cosaï avec celle de Pandare qui, dans Homère (Iliade, chant V, vers 209-216), consent que sa tête tombe sous le fer d'un ennemi, si, de retour dans ses foyers, il ne brise pas son arc qui ne lui a rendu aucun service, et ne le livre pas aux flammes.
Voici maintenant le récit d'Ocbari :
Néwar était femme de Férazdak. Avant, l’un des proches parents de Férazdak, l'avait chargé d'épouser pour lui, par procuration, Néwar; mais il l'épousa en son propre nom. N'ayant pas plu à femme, elle le cita devant Abd-Allah, fils de Zobéïr, qui l'obligea à la répudier. Comme Férazdak lui avait assuré un douaire de cent femelles de chameaux, il s'en repentit fortement, et dit:
» J'éprouve un repentir pareil à celui de Cosaï à cause de ma séparation d'avec Néwar.
» Quant à Cosaï, c’était un homme qui avait choisi un arbuste de ceux qu'on nomme naba ou schauhat : il en eut grand soin et l'arrosa très assidûment, jusqu'à ce qu'il fût en état d'être employé: alors il en fit un arc et en tailla cinq flèches; puis il se tint en embuscade pendant la nuit pour chasser les bêtes sauvages. Des ânes sauvages ayant passé devant lui, il tira; sa flèche perça d'outre en outre un onagre, et alla frapper une pierre qui fit feu. Cosaï crut qu'il avait manqué son coup : il tira ses cinq flèches, et toutes firent de même. Alors il cassa son arc; mais le lendemain matin, voyant » les bêtes qu'il avait tirées, couchées par terre, il se repentit de ce qu'il avait fait. »
Magasin pittoresque, 1857
Dans l'adversité, ne désespérez jamais de voir un sourire de la fortune dissiper vos chagrins.
Que de fois, en effet, le souffle des vents empoisonnés est tombé devant la douce haleine de la brise !
Que de fois de formidables nuages se sont dispersés avant de décharger les pluies contenues dans leurs flancs !
Que de fois la flamme n'a point jailli de la fumée dont nous craignions le feu !
Soyez donc patients dans l'adversité : le temps est le père des miracles.
Attendez de la miséricorde de Dieu des biens dont vous vous ne sauriez compter le nombre.
Rhétorique et prosodie des langues de l'Orient musulman, Garcin de Tassy, 1873.
O toi qui t'enorgueillis de ton intelligence, jusqu'à quand, ô mon frère, en proie à des idées vaines, accumuleras-tu des fautes et des actions coupables, et commettras-tu de nombreux péchés?
Tu ne pleurerais pas seulement, mais tu répandrais des larmes de sang, si tu pensais qu'an jugement dernier, ni entourage, ni parents, ni amis ne seront d'aucun secours.
Dans ce jour redoutable, combien de guides qui se trouveront égarés; combien de personnes illustres qui seront avilies; combien de savants qui glisseront et reconnaîtront la gravité de la circonstance !
Jeune homme sans expérience, hâte-toi d'adoucir l'amertume de tes mauvaises actions, par le miel (du repentir et des bonnes œuvres). Le mur de ta vie est sur le point de crouler, et tu n'as pas mis fin à ta conduite blâmable.
Garde-toi de la fierté, quand la fortune te favorise. Sache retenir tes paroles : heureux celui qui en est le maître.
A celui qui est dans le besoin, donne beaucoup si tu es riche, donne encore si tu es pauvre. Ne sois pas triste lorsque tu éprouveras des pertes, et ne désire pas amasser (des richesses).
[1] L'original est en effet donné dans le recueil que nous transcrivons. (R)
[2] Cette assemblée est appelée celle de Maarra parce que la scène du conte se passe dans la ville de ce nom en Syrie, située au pied du Mont Naaman vis-à-vis de l'Antiliban. Il est souvent question de cette ville dans l'histoire des croisades.
[3] Une branche de l'arbre Ban, dont le dictionnaire ne donne pas le nom propre, mais que quelques-uns assurent être le Myrobolan. (R.)
[4] Son nom est son cri articulé ; de là le proverbe; être aussi véridique que Kata, qui s'annonçant par son cri sous son véritable nom, ne ment point. (A)
[5] C'est du kohol, ou de l'antimoine pulvérisé, qu'on introduit au moyen d'un pinceau,: entre la paupière et l'œil, pour donner à celui-ci plus de grandeur, de feu et d’éclat. (A)
[6] Ancien temple de la Mecque, sanctifié par Mahomet, qui fit du pèlerinage à la Mecque, un devoir sacré de religion. (A)
[7] Mina est un vallon près de la Mecque. (A)
[8] La rosée est limage de la générosité chez les orientaux. La rosée de la pierre veut dire la libéralité d'un avare, parce que les pierres ne donnent pas de rosée. (A)