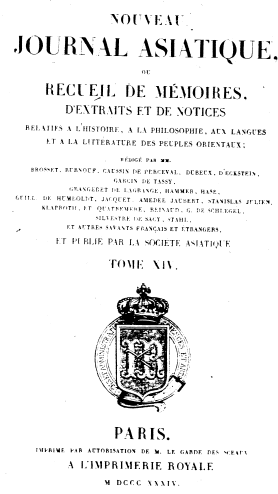
HARIRI
séances
Traduction française : Mr. S. MUNK
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
Essai d’une traduction précédé de quelques observations sur la poésie arabe,
par M. S. Munk.
Journal Asiatique, décembre 1834.
En offrant à des lecteurs français quelques échantillons d'un des plus célèbres écrivains arabes, dont le nom, au moyen âge, retentissait depuis les frontières de la Perse jusqu'aux colonnes d'Hercule, et dont les poésies faisaient les délices des beaux esprits de l'Orient et de l'Occident, je ne me cache pas tout ce qu'un semblable essai a de téméraire et de présomptueux; car les formes dont ce poète a revêtu ses compositions spirituelles, et qui ont tant de charme dans la langue originale, ne sont que trop étrangères aux habitudes de notre goût, et j'ai besoin de réclamer l'indulgence du lecteur pour cette fleur orientale transplantée sur le sol européen.
Parmi les gens du monde, à qui cet essai est particulièrement destiné, il n'y en aura peut-être qu'un petit nombre qui connaissent le nom de Hariri, et, pour leur parler convenablement de cet écrivain, je suis obligé de remonter plus haut dans l'histoire de la poésie arabe.
On se forme ordinairement, dans le monde, une idée peu exacte de l'ancienne poésie arabe ; on croit retrouver là l'Orient avec son imagination ardente, ses images hardies et ses hyperboles. Loin de là, la poésie arabe, avant Mahomet, pèche par le défaut contraire. Elle est souvent d'une simplicité monotone comme les sables du désert; on n'y rencontre presque jamais de ces idées élevées qui exaltent l’âme, de ces sentiments nobles qui touchent le cœur. On est tout d'abord étonné quand on met les chants des Arabes à côté de la Bible; on se demande comment deux peuples issus de la même souche, habitant le même climat, environnés de la même nature, et dont les langues ont tant d'analogie, ont pu être, l'un si éminemment poétique, l'autre totalement abandonné de la muse. Quelles que soient vos croyances, que vous regardiez la Bible comme une révélation divine, ou que vous la lisiez comme un livre profane, si vos préjugés n'ont pas été assez forts pour étouffer dans votre cœur la dernière étincelle de sentiment poétique, vous ne serez pas indifférent aux beautés du chantre de Sion.
Chez aucun peuple, la poésie lyrique ne s'est élevée à la hauteur des psaumes et des prophètes; mais tandis que les prophètes font retentir leur voix éloquente, qu'ils inspirent à ceux qui les entourent une sainte terreur par la sévère vérité avec laquelle ils dépeignent le vice, la plus douce espérance par leurs touchantes consolations, l'Arabie est encore dans un profond sommeil; aucun souffle de poésie ne pénètre dans la tente du Bédouin, ni dans les palais brillants d'or et de pierres précieuses et embaumés des parfums les plus exquis. Plus de dix siècles avaient passé sur les tombeaux des prophètes lorsque l'Arabe fit retentir les premiers sons de ses chants monotones. Mais cette différence entre les Hébreux et les Arabes s'explique facilement : c'est que ces derniers manquaient non seulement de la grande idée qui inspirait le poète hébreu, mais en général de presque tous les éléments de la poésie. La religion des anciens Arabes, le sabéisme, était trop peu polythéiste pour fournir à une riche mythologie; elle était trop païenne pour pouvoir inspirer les sentiments élevés que nous admirons tant dans les psaumes. Les Arabes, avant Mahomet, n'ont jamais joué un grand rôle dans l'histoire; il ne s'est conservé chez eux aucune tradition de héros fabuleux, ou de quelque événement mémorable de l'antiquité. Deux choses s'opposaient à ce que l'amour inspirât à l'Arabe ces sentiments nobles et cette mélancolie qui en forment toute la poésie : la dégradation de la femme, et le manque de sensibilité dont leurs anciens poètes se font gloire. « On pleure sur nous, dit l'un d'entre eux, mais nous ne pleurons sur personne, car nous avons le cœur plus dur que les chameaux.[1] » Et comment avoir une poésie sans religion, sans amour, sans mythologie, sans histoire?
Ce n'est que peu de temps avant Mahomet que les Arabes commencent à sortir de leur léthargie. Un grand événement se prépare pour les peuples arabes; cet événement ne peut être regardé comme un simple hasard ; il doit avoir son fondement dans le besoin de l'époque, dans le besoin qu'éprouvaient ces peuples de tourner enfin leur pensée vers quelque chose de plus noble que les querelles des tribus et les vengeances. Ce besoin se fait sentir vaguement, mais les Arabes ne possèdent pas les moyens de le satisfaire; ii faut attendre que des secours viennent du dehors : ils leur seront offerts par la religion. Le judaïsme et le christianisme viendront enfin leur ouvrir un nouveau monde d'idées et de sensations ; et la voix des prophètes, après tant de siècles, trouvera enfin quelque retentissement parmi les nomades du désert. En attendant, le vague désir d'élever son âme, d'ennoblir ses passions, donne à l'Arabe quelques éclairs d'enthousiasme ; il a quelques élans poétiques, mais qui ne peuvent pourtant l'entraîner hors du cercle étroit de ses idées. Un beau chameau, un noble coursier, une lance droite, une flèche rapide, une épée étincelante, quelquefois une belle femme: voilà à peu près tous les objets qu'il sait décrire. L'hospitalité, voilà toute sa vertu ; la vengeance, voilà toute sa passion; la valeur, voilà sa gloire. Ce sont là les idées que vous voyez se reproduire sans cesse dans les poèmes qui précèdent l'arrivée de Mahomet, et que l'on peut regarder comme les précurseurs du Coran.
La plupart des chants arabes roulent sur la valeur ; mais la valeur, pour être noble, a besoin d'une noble cause. Or ce qui l'ennoblit le plus, le patriotisme, est une vertu entièrement inconnue aux anciens Arabes. La patrie de l'Arabe, c'est sa tente; sa famille, sa tribu : les différentes tribus s'entretuent quelquefois pour la plus petite chose, et la victoire remportée dans une expédition de pillage est le digne sujet de leurs chants de guerre. Peu leur importe que la victoire soit noble par elle-même, ils ne célèbrent point la valeur comme vertu ; elle n'est pour leur insupportable orgueil qu'une occasion de sèche vanterie. Cette observation n'a pu échapper au plus profond penseur des Arabes, l'immortel Abou'l-Walid ibn-Roschd.
Averroès che ’l gran commenta fece,
dans son commentaire sur la poétique d'Aristote, s'exprime ainsi au sujet de la poésie arabe : « Les chants arabes, comme le dit Abou-Nasr,[2] ne traitent, en grande partie, que de choses lascives; car le genre qu'ils appellent érotique n'est qu'une excitation au vice. On devrait donc en écarter les jeunes gens et ne leur laisser lire que ceux où l'on encourage à la valeur et à la gloire ; car les Arabes n'ont célébré dans leurs poèmes que ces deux vertus, quoique au fond ils n'en parlent pas pour encourager les autres, mais seulement par manière de vanterie ». Des sentiments plus élevés animent quelques-uns de ces poètes qui eurent l'honneur de voir leurs poèmes affichés à la porte du temple de la Mecque. Ils ont des accents pour un amour plus noble que celui dont parle Averroès; çà et là ils offrent des traces de vertus bien au-dessus de l’égoïsme de leurs contemporains. Lébid, l'un des plus célèbres parmi eux, vit paraître le prophète, qui, au nom du Dieu unique, annonça aux peuples effrayés le grand jour du jugement.
« Ceux, dit Mahomet, qui ont abandonné la direction, pour prendre en échange l'erreur, n'ont tiré aucun profit de ce commerce et n'ont pas été bien guidés. Ils ressemblent à ceux qui se sont efforcés d'allumer un feu, et lorsqu'il faisait clair autour d'eux, Dieu leur a enlevé la lumière et les a laissés dans les ténèbres, où ils ne distinguaient plus rien ; ils sont sourds, muets et aveugles, et ne trouvent plus de retour. Ou bien ils se sont trouvés comme dans un orage du ciel qui renferme les ténèbres, le tonnerre et la foudre, et au mugissement du tonnerre ils mettaient les doigts dans les oreilles, craignant de mourir; — mais la divinité entoure les incrédules. Souvent la foudre était près de leur enlever la vue ; lorsque brillait l'éclair ils faisaient quelques pas, mais subitement ils s'arrêtaient, enveloppés de ténèbres. Il dépendait de Dieu de leur ravir l'ouïe et la vue; car Allah est grand et tout-puissant. » Lorsque Lébid eut entendu ces paroles de tonnerre, il brisa sa lyre et se résigna;[3] car certes il y avait là quelque chose de plus sublime que les querelles et le talion, ou même les regrets d'un amant trahi par une infidèle.
Malheureusement le Coran, qui ne devait être que le berceau de la poésie arabe, en devint en même temps le tombeau. Mahomet, non content d'être grand prophète et grand roi, ambitionnait aussi la gloire de grand poète. Il défia cent fois ses contemporains de produire quelque chose qui ressemblât à ses versets, et certes il pouvait avec raison leur porter ce défi. Mais on reçut comme article de foi qu'on ne pouvait mieux faire que le Coran, et ce livre, où il y avait de quoi produire un Dante, un Milton, paralysa le génie au moment même où il commença à s'éveiller et à sentir ses forces.
La Perse, il est vrai, a produit de grands poètes malgré le Coran ; mais la différence est très notable entre les Arabes et les Persans. Chez ces derniers il existait une civilisation ancienne que le glaive dévastateur de l'islamisme n'a pu extirper ; la religion de Mahomet a pu modifier le génie poétique des Persans et lui donner une nouvelle direction, mais il n'a pu le tuer. Chez les Arabes, au contraire, le Coran devait éveiller le génie et créer des poètes ; mais avant qu'on eût le temps de se pénétrer de ce qu'il y avait de poétique dans l'Islam, le dogme prévalut, et la lettre tua le génie. Les poètes persans ont souvent allié la poésie du Coran et ses légendes à la riche imagination de la Perse, et ils ont produit des chefs-d'œuvre ; mais aucun des versificateurs arabes ne peut se mesurer avec les Firdousi, les Djami, les Hafiz, et si quelques écrivains ont prodigué le nom de grand poète à l'ampoulé, à l'orgueilleux Moténabbi, celui-ci a trouvé, parmi les Arabes eux-mêmes, des critiques sévères qui refusaient de lui reconnaître même un talent médiocre. En effet il a les défauts des anciens poètes arabes sans avoir leur simplicité.
Sous le khalifat d'Almansour, le besoin matériel, et non pas le goût, porta les Arabes vers les sciences de la Grèce. Les chefs-d'œuvre des poètes classiques leur restaient inconnus ; on fit traduire du grec en syriaque, et du syriaque en arabe, une foule de livres scientifiques, et ce furent surtout les œuvres d'Aristote qui devinrent le foyer d'une nouvelle civilisation parmi les Arabes. On les commentait, on tâchait de les mettre d'accord avec le Coran, et une tendance analogue à celle du scolasticisme se manifesta dès lors dans l'esprit des Arabes. Cette tendance n'était pas propre à donner de l'essor à la poésie, et bientôt la science grammaticale, poussée à un excès de subtilité et de sécheresse dont un Européen peut difficilement se former une idée, acheva de tout prosaïfier et de noyer dans des commentaires prolixes et sans goût les véritables beautés poétiques, déjà si rares chez les anciens Arabes.[4]
Le scalpel des grammairiens se mit aussi à analyser les beautés extérieures des anciennes poésies. Si chez les Grecs tout ce qui a trait à la poésie est un don d'Apollon et des Muses, ii n'en est pas ainsi chez les Arabes. Dans leurs rythmes on ne trouve pas la musique des vers grecs et romains ; excepté deux ou trois au plus, ces rythmes n'ont rien d'harmonieux pour l'oreille. Aussi fallut-il à Khalil ben Ahmed, inventeur de l'art métrique, un singulier hasard pour lui faire découvrir la prosodie des vers anciens. L'anecdote que l'on raconte à ce sujet est trop caractéristique, tant pour la prosodie arabe elle-même que pour l'esprit des grammairiens, pour que l'on ne me permette pas de la citer ici : Khalil se promenait un jour dans la rue des Foulons, à Basra ; les battements des fouloirs frappèrent ses oreilles par leur cadence variée; il entendit dans une maison dak, dans une autre dak dak, dans une troisième dakak dakak. Tout rempli de cette douce harmonie, Khalil rentra chez lui et trouva… la prosodie arabe.[5]
Le goût se corrompait de plus en plus; la rime, que l'on trouve déjà dans les poésies anciennes et dans le Coran, commença à jouer un très-grand rôle dans les compositions des Arabes; elle devint presque indispensable, même pour la prose; tout écrivain qui se piquait d'élégance ne pouvait se dispenser d'écrire au moins la préface de son ouvrage en prose rimée ; mais on alla jusqu'à employer cette manière d'écrire dans des ouvrages d'histoire, qu'on rimait d'un bout à l'autre.
Bientôt on ne se contenta plus de la rime, qui était devenue trop commune et qu'on commençait à trouver monotone. Les écrivains élégants tâchaient donc de donner à leur style un nouveau charme par toutes sortes d'allitérations, d'assonances, de jeux de mots, etc. Ainsi de la corruption du goût naquit chez les Arabes un nouveau genre de poésie, une espèce de prose rythmique, qui, bien exécutée, avait le plus grand charme pour l'oreille. Cette prose se composait de petits membres rimes et consonants; et souvent le parallélisme des différents membres va si loin que chaque mot de l'un trouve sa rime ou sa consonance dans un mot de l'autre, comme par exemple dans la première makama :
Il cadençait avec harmonie ses idées précieuses ;
Il annonçait à la compagnie des pensées sérieuses.
Et dans la troisième :
Et lorsque nous engageâmes d'aimables conversations,
Et que nous nous égayâmes par d'agréables improvisations.
En jouissant des attraits d'une gracieuse éloquence,
Et en bannissant les traits de la hideuse médisance.
Dans une langue aussi riche en mots que la langue arabe, et dont les formes grammaticales offrent assez de facilité pour la rime et la consonance, cette prose rimée est plus facile que dans aucune autre langue, et il n'en est aucune où il soit aussi aisé de faire un long discours sans rien dire, en répétant toujours la même idée par d'autres paroles. Aussi la plupart de ces compositions rythmiques n'ont de mérite que dans la forme ; le contenu est souvent frivole et même absurde. Nous devons donc d'autant plus admirer un poète qui, en donnant à ses compositions les formes les plus gracieuses, a su en même temps ennoblir ces formes par un esprit pétillant, par une imagination vive, et qui, dans un chef-d'œuvre d'éloquence, a tracé le plus grand, le plus riche tableau des mœurs de son siècle et de la sphère intellectuelle de ses contemporains. Ce vaste génie, c'est Abou-Mohammed al-Kasem al-Hariri, qui, par ses makama ou séances, a acquis le plus juste titre à l'immortalité.
Le mouvement intellectuel imprimé aux Arabes par l'étude des sciences et de la philosophie des Grecs, en fit, comme l'on sait, le peuple le plus civilisé du moyen âge. Le besoin de s'instruire alla toujours croissant; on établit des universités, des académies; il se forma des sociétés savantes, et rien, à ce qu'il paraît, ne fut plus fréquent que ces réunions littéraires, où le bel esprit faisait briller son talent par des improvisations spirituelles, par des nouvelles amusantes et par des tours de génie de tout genre. Une semblable réunion s'appelait medjlis ou makama, et ce dernier nom a été donné aux nouvelles mêmes qu'on y racontait. Plusieurs poètes composèrent des nouvelles sous le titre de makama; un des plus célèbres fut Hamadani, surnommé Bedi al-Zémân (le prodige du siècle), qui en composa jusqu'à quatre cents; mais, s'il faut en juger par les extraits publiés par MM. Silvestre de Sacy et Grangeret de Lagrange, les séances de Hamadani sont bien inférieures à celles de Hariri. Il y à dans le style du premier beaucoup moins d'art, et ses personnages manquent tout à fait de ce que Hariri a su donner aux siens de spirituel, de piquant et d'original. C'est donc une trop grande modestie, lorsque ce dernier, dans sa préface, s'appelle lui-même un boiteux, qui ne saurait atteindre le robuste (Hamadani). Aussi l'ouvrage de Hamadani a-t-il été entièrement négligé par les savants arabes, tandis que celui de Hariri a trouvé une foule de commentateurs.
De Basra, où florissait Hariri, à la fin du XIe siècle,[6] son nom s'était répandu jusqu'en Espagne, et il-pénétra dans les écoles des rabbins, qui prenaient alors une part si .active aux études des musulmans: Un rabbin espagnol du XIIIe siècle, Yéhouda al-Harizi, qui, après avoir traduit en hébreu les séances de Hariri, composa un ouvrage du même genre sous le titre de Thahkémoni,[7] fait, dans la préface de ce dernier ouvrage, un éloge pompeux du poète arabe, où il dit entre autres choses, en jouant sur les mots : « Le poète le plus célèbre est Hariri, et tout poète autre que lui est ariri.[8] »
Telle était l'admiration que l'on portait alors à ce poète dans tous les pays musulmans, et ce qui en fait le plus grand éloge parmi nous, c'est que notre premier orientaliste lui a consacré des veilles si précieuses aux lettres, et en a publié une brillante édition, qui, non-seulement par l'excellent commentaire arabe plein de goût qui y accompagne le texte des séances, mais aussi par la beauté de l'exécution, restera toujours un des plus beaux monuments des études orientales en Europe. Pour les détails sur la vie de Hariri, je renvoie le lecteur à l'article extrait du Dictionnaire biographique d'Ibn Khallican, et publié par M. Silvestre de Sacy, en arabe et en français, à la tête de son édition des Séances de Hariri, et en français seulement dans sa Chrestomathie arabe (tom. III, p. 173 et suiv.).
Il me reste à ajouter quelques mots sur les séances. Il faut qu'en les lisant nous nous transportions dans une réunion d'hommes de lettres arabes, où un certain Hareth ben Hammâm, espèce d'aventurier qui a parcouru tous les pays, raconte les aventures qu'il a eues avec Abou-Zeïd, aventurier comme lui, mais beaucoup plus instruit et surtout plus spirituel. Partout Hareth rencontre le jovial Abou-Zeïd de Saroudj, avec lequel il se lie d'une intime amitié, ce qui n'empêche pas qu'il ne soit souvent dupe lui-même de ses ruses inépuisables. Saroudji, le spirituel Protée, embrasse toutes les carrières de la vie, ou plutôt il n'en embrasse aucune, mais il joue à merveille tous les rôles. Partout il excite l'admiration, chacun lui ouvre son cœur, et, qui plus est, sa bourse, car c'est là le but principal d'Abou-Zeïd, qui n'a jamais le sou, et qui pourtant aime la bonne chère. Par ses talents distingués il aurait pu souvent faire fortune et être élevé à de hautes places, mais il ne peut se résoudre à s'arrêter nulle part ; il n'est heureux que dans la vie vagabonde, couvert de haillons et tenant dans sa main le bâton de pèlerinage. Tantôt nous le rencontrons comme prédicateur; ses sermons font verser des larmes, et lui pourtant, dans son intérieur, se rit des préceptes religieux. Tantôt il est plaideur, et il se trouve alors qu'il s'est entendu avec son adversaire pour duper le juge. Ici il est mendiant, boiteux ou aveugle; là maître d'école, improvisateur ou médecin. Partout il rançonne les gens ; l'état de mendiant lui paraît le meilleur que l'on puisse choisir, et c'est cet état que vers la fin de ses jours il recommande vivement à son fils. Enfin, lorsqu'il sent approcher le terme de sa vie aventurière, il se convertit sincèrement, il se retire à Saroudj, sa ville natale, et là, solitaire et adonné aux pratiques religieuses, il attend son heure suprême. Ici Hareth le voit pour la dernière fois, et les deux amis, avec un sincère attendrissement, se disent les derniers adieux. C'est là le canevas sur lequel Hariri a composé ses cinquante séances.
S'il était permis de trouver une allégorie dans le personnage d'Abou-Zeïd, je croirais que c'est le génie arabe personnifié. Abou-Zeïd résume en lui ce génie avec ses tendances variées, avec ses formes multipliées; l'empire du monde lui appartient, il est partout, et ne trouve pas de bornes à l'étendue de sa domination. Ce vaste génie réunit en lui toutes les qualités intellectuelles, il a cultivé tous les arts et toutes les sciences; mais le vrai repos, la vraie consolation, il ne les trouve enfin que dans la résignation de l'Islam.
Plusieurs des séances de Hariri ont été traduites en français: deux par M. Silvestre de Sacy, dans sa Chrestomathie arabe, et quelques autres dans les Mines de l'Orient et le Journal asiatique.
J'ai voulu essayer de donner au lecteur français un échantillon du style de Hariri, en suivant l'exemple donné par le rabbin Hariri, dans sa traduction hébraïque, et par M. Frédéric Ruckert, dans ses Métamorphoses d'Abou-Zeïd.[9]
Le premier essai de ce genre fait en langue française pourra servir au moins à appeler l'attention des littérateurs sur le poète qui fut le plus grand dans le seul genre de poésie où les Arabes aient excellé. J'ai tâché d'imiter fidèlement la forme de l'original arabe. Cette formé consiste en une prose rimée, telle que je l'ai décrite plus haut, et qui est entremêlée de vers, où l'on retrouve en général toutes les particularités des anciens poèmes arabes : ce sont des pièces de vers qui ont d'un bout à l'autre la même rime. Ordinairement ces poèmes, appelés kassida, se divisent par béits, ou distiques, et la rime ne se trouve qu'à la fin de chaque béit; mais quelquefois, et chez Hariri bien souvent, la rime se retrouve à chaque vers; et les grammairiens prétendent que dans ces vers, qu'ils appellent meschtour, il y a suppression d'un hémistiche entier. Les deux morceaux de la troisième makama sont de ce genre. J'ai tâché autant que possible de rendre vers par vers, et ma traduction n'en a ni plus ni moins que l'original. Ces vers sont presque toujours inférieurs à la prose, et en général peu poétiques ; on y remarque plutôt des tours de force et des difficultés vaincues que de l'inspiration.
Le style des Mille et une Nuits a souvent de l’analogie avec celui des Séances; mais en général il est moins recherché, la rime et le parallélisme y sont moins fréquents et d'autant plus agréables lorsqu'ils se présentent. La traduction de Galland, quel que soit son mérite, ne peut donner qu'une idée imparfaite de l'original; et s'il est vrai qu'il s'y trouve des passages qu'il serait impossible de reproduire dans une traduction, des passages qui auraient fait rougir la chaste société du Décaméron, il y a d'un autre côté maint trait caractéristique que Galland a effacé sans nécessité, et on y trouve de très jolis vers dont la traduction française n'offre aucune trace.
Si les morceaux qu'on va lire sont accueillis avec faveur, je me propose de publier un choix des Séances de Hariri et de traduire aussi de l'hébreu quelques séances du Thahkémoni du rabbin al-Harizi.
Hareth ben-Hammâm raconta :
Forcé par la misère — de visiter une terre étrangère, — je préparai le bâton du voyage—et je me séparai des compagnons de mon âge ; — et voilà que le sort me mène — à Sanaa, dans le Yémen. — En y entrant, je vis dépouillée ma valise, — pas de souliers ni de chemise, — pas un sou à cacher dans ma poche, — rien à mâcher dans ma sacoche. — Je parcourus, les rues comme un homme qui flâne, — je volai par les allées comme un oiseau qui plane. — Sur les marchés ennuyeux — je cherchai des yeux — un homme généreux —pour lui ouvrir ma visière — et découvrir ma misère, — ou un homme bien élevé dont le sourire aimable pût délasser mon cœur — et le dire agréable effacer ma douleur. — Enfin, au bout de ma course, — je cherchai une ressource — dans des demandes d'adresses — faites avec politesses. — Avec ce moyen, — je parvins enfin, — par une généreuse indication, — à une nombreuse réunion, — où je vis prendre des alarmes, -—et répandre des larmes. — Je coudoyai de tout côté pour pénétrer dans ce mystère, — pour connaître la chose entière, — la cause des larmes amères ; — et je vis au milieu un personnage — dans l'appareil du pèlerinage. — Il avait la stature chétive et maigre, — la voix plaintive et aigre ; — il cadençait avec harmonie ses idées précieuses; — il annonçait à la compagnie des pensées sérieuses. — Et autour de lui la foule bourdonnait — et l'environnait, — comme le halo entoure l’astre de la nuit — et le calice le fruit. — Et sans bruit — de lui je m'approche — pour écouter ses reproches — et pour ramasser avec attention — une parole de son sermon, — une perle de sa leçon. — Et voici ce qu'il dit avec vigueur et articulation, — avec ardeur et gesticulation, —dans la chaleur de l'improvisation:
— « O toi qui t'oublies — dans les joies et les folies ; — qui flânes, — qui te pavanes —dans l'appareil —de l'orgueil, —qui t'emportes dans ta stupidité, — qui te portes vers des futilités ; jusqu'à quand répéteras-tu tes erreurs — et te repaîtras-tu de tes horreurs? — Jusqu'à quand veux-tu t'adonner à tes forfanteries — et ne pas abandonner tes plaisanteries, — braver par ton allure — le maître de ta chevelure,[10] — irriter par ta conduite indiscrète — celui qui connaît tes voies secrètes, — te dérober à la vue de ton prochain, — tandis que tu es vu de ton gardien, — cacher à l'esclave ton chemin, — et rien n'est caché à ton souverain ? — Crois-tu que ton entourage te servira — quand l'heure du voyage arrivera? — que ta possession te gardera — quand ton action te perdra ? — que ton regret te débrouillera ?—quand ton pied s'embrouillera? — que ta famille te surveillera — quand le cercueil t'accueillera? —As-tu marché dans le chemin de la raison? —as-tu cherché le moyen de ta guérison ? as-tu émoussé l'aiguillon de la rébellion? —as-tu repoussé le tourbillon de ta passion ? — Quand l’heure malheureuse arrivera, — quelle œuvre pieuse te survivra ? —Quand ta tête blanche te l'annoncera, — qu'est-ce que tu avanceras ? — Quand dans la tombe tu reposeras, — qu'est-ce que tu opposeras — aux questions qu'on te posera[11] ? — Quand devant Dieu tu plaideras, — qui est-ce qui t'aidera ? — Depuis longtemps les années t'atteignaient pour t'éveiller, — mais tu feignais de sommeiller;— on avait beau te désabuser et l'avertir, — tu as refusé de te convertir. — Devant les amples exemples tu faisais l'aveugle; — devant la clarté de la vérité tu méconnaissais la règle. — Mainte fois la mort s'est présentée à tes yeux, — mais tu es oublieux; — mainte fois le sort t'a présenté un remède —pour ton aide; — tu le voyais, — mais ne l'employais. — Tu aimes mieux prendre une obole — que d'apprendre une parabole ; — élever un édifice de géant — que de prélever un bénéfice pour l'indigent; — solliciter un subside temporel— que de te féliciter d'un guide spirituel. —Tu préfères les oripeaux et la vaine parure — au repos de la vie future; — tu connais mieux la valeur des pierres — que les heures des prières ; — tu aimes mieux enchérir sur une belle moitié[12] — que de secourir le pauvre avec amitié; — les bons morceaux te sont plus précieux — que les beaux morceaux des livres religieux ; — tu sais mieux dire une gravelure — que de lire l'écriture. —Tu prêches aux autres d'être généreux, — pour toi, tu le trouves onéreux ; — tu te récries contre l'ingratitude, — et tu oublies la gratitude; — tu te défends contre l'injustice, — mais tu n'exerces pas la justice; — tu crains le mortel, — et tu braves l'éternel.
Malheur à toi, mortel frivole
Qui, plein d'erreur et plein 'de songes,
Demeures toujours dans l'ivresse,
Sans revenir de tes mensonges.
Viderais-tu l'amer calice,
Si tu savais où tu te plonges?
Et là il cessa ses clameurs — et sécha ses pleurs, — et il reprit son sac de voyage — et son bâton de pèlerinage. — Lorsque la foule vit ses préparatifs — et son départ hâtif, — chacun mit la main dans la bourse — pour lui faire goûter une goutte de sa source, — en lui disant, c'est pour subvenir à tes besoins — ou pour porter à tes amis de tendres soins. — Il l'accepta en baissant les yeux, —et les remercia en faisant ses adieux. — Il congédia ceux qui tâchaient de le suivre, — pour leur cacher sa manière de vivre, — et il les renvoya de bonne manière, — pour qu'ils ne connussent pas sa tanière. — Hareth ben-Hammâm dit : Je le suivis en cachette, — et sans qu'il me vît, je me mis en vedette. — Arrivé sur son terrain, — il se glissa dans un souterrain ; — je lui laissai le temps de délier ses souliers —et de laver ses pieds souillés. — Ensuite je m'avance rapidement — et je m'y lance brusquement; — et voilà notre homme aux graves préceptes — vis-à-vis d'un brave adepte, — et devant eux des tartines de fleur de farine, — d'un cabri rôti la savoureuse poitrine — de vin pétillant une mousseuse chopine. — « Ah! dis-je, est-ce là ta vie intérieure — et ta conduite supérieure? » — Alors il rougit de chaleur — et rugit de fureur; — et par le regard qu'il me lançait j'étais terrifié, — et je pensai d'être pétrifié. —Mais peu à peu sa fureur expira, — et sa bonne humeur l'inspira; — et, avec un air moins sévère, — il récita ces vers : —
Je me revêts du froc pour faire bonne chère,
Et je tends mes filets à tout bord de rivière,
Je fais de mes sermons mainte espèce de rets,
Pour prendre le gibier, selon toute manière.
Poussé par le destin, j'use de toute ruse ;
Je poursuis le lion jusque dans sa tanière.
Du sort je puis sans peur voir les vicissitudes;
Je ne tremble jamais ni ne marche en arrière
Ce n'est pas un cœur bas, ni la vile avarice
Qui me mène à la source où je me désaltère.
Si le sort était juste, on ne verrait jamais :
Les méchants dominer sur l'entier hémisphère.
Ensuite il me dit : « Viens ici et récrée ton âme, — ou, si tu aimes mieux, reste là et déclame. » — Je clignai les yeux — et je lançai à l'élève un regard curieux. — « Je t'en conjure, lui dis-je, par celui qui détourne le dommage, —que tu me fasses connaître ce personnage. — C'est, répondit-il, Abou-Zeïd le Saroudji, le phare des orateurs, — la tiare des littérateurs. » — Et je m'éloignai, je vous l'assure, — tout émerveillé de cette aventure.
Hareth ben Hammam raconta :
Je me trouvai un jour dans une réunion, — où régnait toujours une tendre union; — où les soucis des amis furent toujours partagés, — où les malheurs des demandeurs furent toujours soulagés. —Et lorsque nous engageâmes d'aimables conversations, — et que nous nous égayâmes par d'agréables improvisations, — en jouissant des attraits d'une gracieuse éloquence — et en bannissant les traits de la hideuse médisance, — il se présenta à nous un boiteux personnage, — en misérable équipage, — et il dit : « O brillants météores de l'humanité, —vaillants matadors de la société, — je vous souhaite un matin heureux, — un déjeuner savoureux. — Jetez un regard de compassion — sur un ancien compagnon — qui fréquentait souvent votre réunion matinale, —qui présentait des présents d'une main libérale, —qui possédait des biens, —.des terrains, — qui régalait ses hôtes —- d'anecdotes. — Hélas ! le destin au visage austère — a changé les festins en ravage et misère;—le sort envieux m'a accablé de lassitudes, — de noires vicissitudes ; — je ne tiens rien — dans ma main ; — plus de liaison — dans ma maison ; — ma bourse est vide, — ma source fétide, —- mes appartements encombrés, —mes vêtements délabrés, —mes tables desservies, — mes étables dégarnies;— il ne me reste — pas un zeste —- pour que j'achète un petit pain, — une miette pour mes bambins. — L'envie elle-même se désespère — de notre misère ; — la haine elle-même s'approche en deuil — de notre seuil ; —notre chaussure est l'enflure, —l'amertume notre nourriture, —notre ivresse —la tristesse; — de nos nuits, l'insomnie[13] — est la compagnie;—une pierre notre chevet, la terre notre duvet. —Heureux si l'heure prédestinée — accomplit notre destinée, — si notre sort s'achève, — si la mort nous enlève. — Trouverai-je parmi vous un cœur généreux, — un remède à ma souffrance, — un aide à ma subsistance ? — J'en jure par celui qui m'a fait sortir d'une noble souche— qu'aujourd'hui je n'ai rien mis dans ma bouche, — que pour ce soir je n'ai pas de couche. — Hareth Ben-Hammam dit : Au récit de son malheur, —- j'eus le cœur —navré de douleur; — et, pour soulager son indigence — et encourager son éloquence, — je tirai de ma bourse un ducat — d'un brillant éclat, — et je lui dis : « Fais une pièce de vers à sa louange, —et tu auras la pièce entière en échange. » Et il n'hésita pas un instant, — et il récita sur-le-champ les vers suivants :
Qu'il est beau ce rond jaune et d'un éclat riant!
Il parcourt l'univers de l'ouest à l'orient;
Et son métal sonore, et son lustre brillant,
Rend le riche joyeux par son air souriant,
Toute affaire prospère à lui se mariant,
Que le mortel chérit son regard sémillant !
On le dirait des cœurs souffle vivifiant,
Si ma bourse l'enferme, alors je suis régnant,
Fût même ma tribu dans un sort défaillant.
Quelle belle lueur, ô quel feu pétillant!
Que sa splendeur ravit le pauvre mendiant !
Tel maître vous prescrit plus d'un ordre effrayant,
Qui sans lui resterait docile et suppliant
Devant lui le chagrin se dissipe en fuyant.
Telle lune s'éteint, pour lui s'humiliant.
Et l'on a vu maint homme, en son courroux bouillant,
Adouci devant lui, prendre un ton bienveillant;
On a vu des captifs qui, sur lui s'appuyant,
Furent sauvés, au jour un chemin se frayant.
Je voudrais l'adorer en le glorifiant;
Mais je crains, grand Allah, ton pouvoir foudroyant.
Et il me tendit la main — et me dit à la fin : — L’homme d'honneur dégage sa promesse, — car le tonnerre présage l'averse.[14] — Je lui donnai le ducat, —qu'il invoqua— en lui disant: « Mon cher, — c'est de bon cœur. — Il mit dans sa bouche ses épices — et dit : « Que Dieu vous soit propice ! » — Et après s'être acquitté de son remerciement, — il voulut nous quitter dans le moment; — mais j'étais si enchanté — de ce qu'il avait chanté, —que je m'entêtai de le retenir; — et je me serais endetté pour le réjouir. — Et pour qu'il chantât, — je tirai un second ducat, — et je lui dis: « De flétrir son ravage — te sens-tu le courage ? » — Il n'y avisa guère — et improvisa de cette manière
Qu'il est laid le trompeur, le traître diabolique!
A deux faces, jaunâtre et jamais véridique.
Si vous l'examinez, à vos yeux il indique,
Et de l’objet aimé la splendeur magnifique,
Et du sombre amoureux la pâleur morbifique.
Les vertueux ont dit: Quiconque s'y applique,
Haï du Créateur, est un vil hérétique.
Sans lui vous ne verriez au monde pacifique,
Ni crimes à punir, ni vol, ni fraude inique.
Pour l’avare la nuit n'aurait point de panique.'
Pour le créancier, pas de délai juridique.
Ni charme préservant d'envieux maléfique.
Si le pervers vous aide en un moment critique,
Ce n'est qu'en s'enfuyant; son chemin est oblique.
Heureux qui sait honnir ce métal magnétique,
Et n'est pas ébloui par son lustre magique;
Qui dit avec dédain à ce bien chimérique :
Loin de moi ! je te hais; ta faveur je l'abdique.
Je lui dis : « Tu réjouis par ta faconde — comme la pluie qui abonde ; » — et il me répondit : « Garde pour toi tes caresses —et garde-moi tes promesses. » — Je lui sacrifiai de nouveau — et je le gratifiai d'un second cadeau, — en lui disant: « Loue la divinité —de sa bonté. » — Il joignit la pièce bien-aimée— à sa sœur aînée — et, se louant de sa matinée, — il quitta la loge— et fit l'éloge — de la société — et de sa générosité. — Alors mon cœur me dit que c'était Abou-Zeïd, notre rusé personnage, — et son pied estropié un pur badinage. — Je le fis revenir et je lui dis : « On reconnaît la monnaie par son empreinte ; —mais va droit sans crainte. — C'est toi, me dit-il, mon cher Ben-Hammam, — je te salue de toute mon âme ; — puisses-tu vivre heureux — parmi les généreux ! — Oui, dis-je, je suis de tes amis fidèles, —donne-moi donc de tes nouvelles. — Mon cher, me dit-il, mon terrestre voyage — se partage entre les soupirs — et les plaisirs; — un jour, dans l'orage —je fais naufrage; — demain, un doux zéphyr me soulage. — Mais pourquoi, dis-je, contrefaire le boiteux? — pour un homme comme toi c'est honteux. —Alors son sourcil se fronça, — et le souci s'annonça ; —et en me tournant son revers, —il murmura ces vers :
Ce n'est pas par plaisir que je fais le boiteux,
C'est afin de frapper au seuil où l'on soulage.
Je suis libre, mon frein est jeté sur mon dos,
Je m'étends à loisir dans un grand pâturage.
Et si vous me blâmez, je vous dis : Excusez,
On ne peut accuser un boiteux personnage.
Séance de Hariri, traduite de l'arabe par M. Garcin de Tassy.
Journal Asiatique, 1823.
Je me trouvais un jour dans une assemblée composée d'hommes aussi spirituels qu'aimables. Parmi eux le briquet du génie ne manquait jamais de donner des étincelles, et le feu de la dispute n'élevait point ses flammes dévorantes. La conversation roulait sur des objets littéraires, lorsque tout à coup un boiteux, portant la livrée de la misère, pénètre dans la salle où nous étions. Il s'avance vers nous, nous fait avec la plus rare éloquence le récit des malheurs auxquels il était en proie, et finit par implorer notre générosité.[15] A ces paroles, touché de compassion pour lui, je voulus soulager sa misère; et, frappé de la manière dont il nous avait tracé le tableau de son infortune, et du choix heureux de ses expressions, il me vint dans l'idée d'essayer s'il serait en état d'improviser des vers. Je tirai donc de ma bourse une pièce d'or, et la faisant briller à ses yeux, tiens, lui dis-je, si tu te sens capable de faire à l'instant même en vers l'éloge de cette pièce, elle est à toi. Je n'avais pas achevé ma proposition, que ces vers, semblables à des perles, découlèrent de sa bouche :
« Quelle agréable couleur ; qu'une pièce d'or est une jolie chose ! L'or traverse tous les pays, il a partout la même valeur ; il donne le contentement, il fait réussir l'homme dans toutes ses entreprises : sa vue seule réjouit, et l'amour violent qu'il inspire ne peut s'exprimer ; aussi celui dont il remplit la bourse est-il fier et superbe, car l'or peut lui tenir lieu de tout. Que de gens, qui par son moyen trouvent partout des esclaves prêts à exécuter leurs ordres, seraient sans lui condamnés à se servir eux-mêmes. Que d'affligés dont il dissipe l'armée des noirs chagrins ; que de beautés il parvient à séduire ; que de colères il apaise ; que de captifs dont il brise les chaînes et dont il sèche les larmes. Oui, si je n'étais retenu par les sentiments religieux, j'oserais attribuer à l'or la puissance de Dieu même. »
Après avoir proféré ces vers, le poète tendit la main demandant la pièce d'or. « Celui qui est bien né, dit-il, tient ce qu'il a promis, de même que le nuage envoie la pluie après avoir fait entendre le tonnerre. » Je m'empressai de lui remettre aussitôt le dinar. Notre étranger se disposait à partir après m'avoir remercié ; mais j'étais si content de la manière dont il avait fait l'éloge que je lui avais demande, que tirant de ma bourse une nouvelle pièce d'or, je lui dis : « Pourrais-tu faire actuellement des vers contre cette pièce, et je te la donnerai. » Il improvisa alors sur le champ ces nouveaux vers :
« Fi de cette pièce trompeuse qui a deux faces comme le fourbe, et présente à la fois et la couleur brillante des belles étoffes qui parent la jeune amante, et celle du visage hâlé de son ami, que l'amour a décoloré. La malheureuse envie de posséder l'or entraîne l'homme à commettre des crimes qui attirent sur sa tête l'indignation de Dieu. Sans l'or la main du voleur ne serait point coupée;[16] sans l'or plus d'oppression, plus d'oppresseur ; l'avare ne froncerait point le sourcil, lorsque, durant la nuit, on vient lui demander l'hospitalité ; le créancier ne se plaindrait point des retards de son débiteur. On n'aurait point à craindre l'envieux qui attaque avec les flèches acérées de la médisance. D'ailleurs j'aperçois dans l'or un défaut palpable et bien propre à le déprécier, c'est qu'il ne peut être utile dans le besoin qu'en sortant des mains de celui qui le possède. Honneur à l'homme qui le méprise ! Honneur à celui qui résiste à ses perfides appâts.[17] » .
Lorsque notre improvisateur eut cessé de parler, je lui exprimai ma vive satisfaction. De son côté, il demanda avec empressement cette seconde pièce. Je la lui donnai, et lui dis : « Récite en actions de grâce la première surate du Coran.[18] » Il s'en retourna alors ne pouvant contenir sa joie, et je m'aperçus que c'était Abou Zeïd, et qu'il ne boitait que par feinte.
Traduite de l'arabe de Hariri ; par M. Garcin de Tassy.
Journal Asiatique, 1822.
On sait que Hariri est le plus célèbre et en même tenu le plus difficile à entendre des écrivains arabes. Depuis longtemps les orientalistes en désiraient une édition soignée, accompagnée de gloses pour l'intelligence du texte. L'édition de Calcutta et celle de M. Caussin de Perceval, offrant simplement le texte, ne pouvaient remplir les vœux des orientalistes. M. le baron de Sacy, à qui la littérature orientale doit tant, s'est chargé de cet important travail. Déjà l'impression en est terminée. Ce grand ouvrage pouvait seul satisfaire les arabisants. Les gloses occupent presque toujours les trois quarts ou les deux tiers de la page : elles renferment souvent des explications curieuses, de très beaux vers, des anecdotes intéressantes, etc. En lisant Hariri dans cette édition, j'ai regretté que les lecteurs, qui ne connaissent pas l'arabe, ou ceux même qui, en ayant acquis quelque connaissance, ne sont point encore entrés dans le sanctuaire de sa littérature, ne pussent en jouir. C'est pour ces deux classes de lecteurs que j'ai osé faire une traduction des séances de Hariri. Dans la préface que je mettrai en tête de ma traduction, j'entrerai dans des détails sur le caractère particulier de mon travail, qui ne tardera pas à paraître.
Il est seulement nécessaire ici de dire, pour les personnes qui ne connaissent pas l'ouvrage de Hariri, que dans ce livre l'auteur suppose qu'un homme, nommé Abou Zeïd, gagne sa vie à improviser des vers, et parcourt à cet effet diverses villes d'Asie et d'Afrique, prenant tous les langages et revêtant toutes les formes : ce qui donne lieu à cinquante différentes aventures, qui forment autant de chapitres dont le héros vient, toujours incognito, débiter des vers, et finit par être reconnu de l'auteur.
*****************************
Me trouvant un jour dans la ville de Maraghah,[19] mes affaires m'appelèrent au bureau d'administration des affaires civiles. Le hasard voulut que, lorsque j'y entrai, la conversation roulât sur l'éloquence. Les cavaliers du calam, et les maîtres dans l'art d'écrire, qui étaient présents, furent tous d'avis qu'il ne restait personne de très habile en matière de chancellerie, personne qui pût, après les anciens, se frayer en ce genre une route brillante, ou cueillir la fleur d'une composition vierge. Ils soutenaient que les meilleurs écrivains du siècle, ceux même qui tenaient les rênes de l'éloquence, n'étaient que les serviteurs des anciens. Dans un coin obscur de la salle se trouvait confondu avec les simples esclaves un vieillard qui, tandis que les assistants, livrés à toute l'exagération dont on se défend rarement dans ces sortes de disputes, répandaient tour à tour de leurs corbeilles des dattes, soit bonnes, soit mauvaises, laissait lire sur son visage qu'il se disposait à entrer dans la lice, et qu'il préparait en silence les flèches du génie. Lorsque les carquois furent épuisés ; que le vent impétueux de la contestation fut apaisé et que le silence eut succédé aux cris aigus ; il s'adressa à l'assemblée et parla en ces termes: « Messieurs, vous vous êtes laissés aller à un enthousiasme ridicule, en célébrant des os réduits en poussière, et en préférant, avec tant d'injustice, les morts aux vivants. Pourquoi ravaler votre siècle et mépriser vos amis et vos concitoyens? Pouvez-vous perdre de vue, ô vous qui connaissez si bien la monnaie de l'esprit, et qui êtes les mobez[20] tout-puissants de l'éloquence, pouvez-vous oublier, dis-je, tout ce que nous devons à nos auteurs modernes? Je n'hésite pas à assurer qu'ils ont surpassé les anciens, tant par la pureté de leur diction, que par leur prose rimée et leurs vers harmonieux. Qu'ont en effet de préférable à nous nos devanciers ? Pour peu qu'on se donne la peine d'examiner sans prévention leurs titres à la gloire, que présentent leurs outrages ? Des pensées rebattues, des métaphores outrées et dont le sens peut à peine être saisi ; et si ces écrits sont cités, n'est-ce pas uniquement parce que leurs auteurs nous ont précédés, et non parce qu'ils sont meilleurs que ceux des écrivains de notre siècle. D'ailleurs j'en parle sciemment, et je connais même un poète de nos jours qui fait des compositions admirables et qui improvise avec une étonnante facilité ». L'inspecteur du bureau lui demanda alors quel était cet homme merveilleux. « C'est moi-même, répondit-il, mets-moi à l'épreuve et tu verras ce que je sais faire. Doucement, reprit celui qui lui avait adressé la parole ; sache que tu n'as pas à faire à des gens qui prennent des milans pour des vautours, et les cailloux pour des pièces d'argent. Vois combien il en est peu parmi ceux qui osent affronter les flèches meurtrières, qui s'en retirent sans de cruelles blessures : combien peu parmi ceux qui soulèvent la poussière de l'épreuve, dont les yeux ne soient pas obscurcis par la paille de l'avilissement. Je t'engage donc à ne pas exposer ta réputation à être couverte d'opprobre. Fie-toi à mon avis. Chacun, répondit-il alors, connaît mieux que personne la couleur de sa flèche.[21] Bientôt tu verras la nuit du doute disparaître devant l'aurore de la certitude ».
L'assemblée se consultait pour savoir comment on s'y prendrait pour sonder ce puits de science, lorsque tout à coup un des assistons prenant la parole dit : « Laissez-moi faire, je m'en charge ; je vais lui proposer une difficulté qui sera la pierre de touche de son mérite ». Puis s'adressant au vieillard, il lui parla en ces termes : « Sache que le wali[22] de ce pays m'honore de son amitié, et que les lettres font le charme de mon existence. Je vivais de mon bien dans ma patrie ; mais ma famille étant devenue plus nombreuse, et mes revenus ayant au contraire diminué, je vins trouver ce wali en le priant de venir à mou secours. J'en reçus le meilleur accueil, et bientôt il me combla de ses faveurs. Toutefois, lorsque je lui demandai la permission de retourner dans ma patrie, porté sur le chameau de la joie. Je ne consentirai à ton départ, m'a-t-il dit, que lorsque tu m'auras fait, sur ta position, un placet où tu feras entrer alternativement, un mot composé de lettres marquées de points diacritiques et un mot composé de lettres sans ces points.[23] Depuis un an j'attends l'inspiration de l'éloquence, et jusqu'ici elle ne m'a pas fourni un seul mot ; depuis un an je m'efforce de réveiller mon génie endormi, et son sommeil devient toujours plus profond. Il y a plus : j'ai eu recours à tous les écrivains, et nul d'entre eux n'a pu me contenter. Si tu es vraiment tel que tu le dis, je t'offre ici l'occasion d'en fournir la preuve en faisant ce travail ».
« Va, va, répond le vieillard, le cheval que tu veux faire marcher, est habitué à la course ; la nuée à laquelle tu demandes une faible rosée, contient dans son sein des eaux abondantes. N’est-ce pas donner l'arc à celui qui l'a fait, n'est-ce pas proposer à l'architecte de parcourir le palais qu'il a construit ».
L'étranger resta alors quelques instants occupé à rassembler les eaux abondantes de son génie; puis il invita son interlocuteur à mettre de la soie écrue dans son écritoire, à prendre son calam et à écrire l'épître qu'il allait dicter : ce qu'il exécuta avec le plus rare bonheur, se soumettant à la condition imposée.[24]
Lorsqu'il eut fini de dicter ce placet, et qu'il eut ainsi montré sa force dans le combat de l'éloquence, les assistants, étonnés de son talent et de sa facilité, lui donnèrent les applaudissements qu'il méritait. On lui demanda ensuite qui il était; il répondit par ces vers :
« Je suis de la noble et illustre famille de Gassan, dont la splendeur rivalise d'éclat avec le soleil. Ma patrie est Séroudj, pays charmant, qui peut se comparer au paradis, pays où j'ai passé des jours heureux dans le plaisir et dans les délices. Enveloppé du vêtement séducteur de la jeunesse et possesseur d'un bien immense, tout cédait à mes vœux. Je ne craignais ni les revers de la fortune, ni les coups du malheur. Mais, hélas! ils sont bientôt tombés sur moi. Ah ! si les chagrins faisaient périr, il y a longtemps que je n'existerais plus ».
Le wali ne tarda pas à apprendre cette aventure ; il combla de dons Abou Zeïd ; il voulut même se l'attacher et lui donner la première place dans le bureau de la chancellerie ; mais notre vieillard ne voulut pas accepter cette offre obligeante, et se contenta des présents qu'il avait reçus.
Pour moi, j'avais d'abord reconnu l'arbre avant d'en avoir goûté le fruit ; j'avais même été sur le point de publier le mérite de ce personnage, avant que, semblable à la pleine lune, il eût jeté le plus vif éclat. Toutefois, par un clin d'œil, Abou Zeïd m'avait fait signe de ne point tirer du fourreau et de ne point faire briller à tous les yeux l'épée de son talent magique. Lorsqu'il sortit, tout joyeux et sa bourse remplie, je le suivis et le blâmai d'avoir rejeté les offres du wali. Il se mit à sourire et me récita ces vers :
« Rester pauvre et courir de pays en pays, est à mes yeux préférable à la servitude qu'impose un emploi. Quelque considérable que soit une place, on a toujours à supporter des hauteurs et des reproches. Aucun wali ne récompense dignement le mérite, aucun ne le protège. Crois-moi, mon ami, ne te laisse point séduire par ce mirage trompeur. Combien de gens endormis ont été réjouis dans leur sommeil par un songe enchanteur, qui, à leur réveil, se sont trouvés en proie à la douleur.[25]
[1] Hamâsa, p. 292. Le commentateur Tebrizi observe que les anciens Arabes se vantaient d'être durs, et que c'était chez eux une' chose honteuse que de verser des larmes.
[2] C'est le philosophe Abou Nasr al-Farabi.
[3] Le verbe arabe aslam (à l'infinitif islam) veut dire soumettre, résigner; de là se résigner à la volonté de Dieu. Au participe on dit moslim. De là viennent les mots musulman (homme résigné), et islamisme (résignation). Lébid, dit-on, n'a fait que ce seul vers après sa conversion : « Grâces soient rendues à Dieu de ce que l’heure de mon trépas n'est point arrivée avant que je me fusse revêtu du manteau de l'islamisme. » Voyez Calila et Dimna, ou Fables de Bidpâi suivies de la moallaka de Lébid, par M. Silvestre de Sacy, p. 132.
[4] Le commentaire de Zouzeni sur les sept Moallakât fait ici une honorable exception, et mérite d'être signalé à cause de sa lucidité et de sa concision.
[5] Voyez le commentaire sur les Séances de Hariri, p. 451. La connaissance de la prosodie est absolument nécessaire pour l'intelligence des vers arabes, et les orientalistes doivent savoir gré à M. Silvestre de Sacy d'avoir traité cette matière dans la nouvelle édition de sa grammaire arabe avec la clarté et la précision qu'on lui connaît. L'écrit du célèbre orientaliste, qui porte le titre modeste de Traité élémentaire de la prosodie et de l'art métrique des Arabes, renferme tout ce qu'il est nécessaire d'en savoir, et tout ce qui est digne d'être su.
[6] Il mourut l'an 516 de l'hégire, vers 1122 de l'ère chrétienne.
[7] Voyez sur cet ouvrage la notice de M. Silvestre de Sacy, insérée dans le Journal asiatique, mois d'octobre 1833.
[8] Ariri en hébreu, veut dire sans enfants, stérile.
[9] Die Verwandlungen des Ebu-Seid von Serug oder die Makamen des Hariri. 1 vol. in-8°. M. Rückert avait sur moi, non seulement l'avantage d'un grand talent, mais aussi celui d'écrire dans une langue plus riche, et qui se prête davantage à cette sorte de compositions. Néanmoins il a dû çà et là se permettre des expressions un peu forcées et des licences dans les rimes. Sous ce rapport, il m'a fallu suivre son exemple; mais je n'ai eu ni l'habileté, ni même le désir d'embellir les vers arabes, comme l'a trop souvent fait l'ingénieux traducteur allemand.
[10] Littéralement le maître ou le roi de ton toupet. C'est une allusion à un verset du Coran (ch. xcvi, v.15), où Dieu dit: « Certes s'il ne s'abstient pas (du péché), nous l'entraînerons par le toupet (dans l'enfer). »
[11] Selon la croyance des musulmans, le défunt, immédiatement après la sépulture et avant de se présenter devant le juge suprême, subit un interrogatoire de la part de deux anges terribles de figure et de voix, et appelés Monkir et Nakir. Après avoir fait rentrer l'âme dans le corps, ils adressent au défunt les questions suivantes: Quel est ton maître? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Si l'homme fait les réponses convenables, il s'endort et ses ossements jouissent d'un doux repos ; si, au contraire, il ne sait pas répondre, des châtiments terribles lui sont réservés.
[12] On sait que chez les Orientaux le mari acquiert sa femme par un cadeau qu'il fait à son père, et qui varie selon les qualités de la femme et de sa famille. Le même usage existait chez les anciens Germains, dont Tacite dit : « Dotem non uxor marito, sed uxori maritus, offert. » Chez les Arabes, ce cadeau s'appelle mahr ou sadouka.
[13] L'original porte : « nous nous fardons d'insomnie. » On sait que les Orientaux se peignent les yeux d'une espèce de fard qu'ils appellent cohol.
[14] L'eau, la pluie, en général l'humidité; est, chez les Arabes, l'image de la générosité.
[15] Je n'ai pas besoin d'avertir que, dans le texte, cet homme tient un long discours, plein de jeux de mots et de métaphores intraduisibles, qui finit par ces mots : « Oui, j'en jure par celui qui m'a fait venir de la tribu de Caïla, je suis le frère de la pauvreté. » De là vient que Hariri a donné à cette séance le titre de Caïla. On lit, dans plusieurs manuscrits, Séance de la pièce d’or.
[16] « Autrefois on coupait (chez les Arabes) la main à un homme qui avait volé quatre pièces de monnaie d'argent ou une somme plus considérable. Pour un second larcin, il devait perdre le pied gauche, ensuite la main gauche, enfin le pied droit. Cette loi n'est guère en usage parmi les Turcs. La bastonnade est la peine ordinaire du vol. Souvent aussi on tranche la tête au voleur. Ce crime est bien rare dans les villes de Turquie ; mais le défaut de police le rend fréquent sur les grands chemins, et surtout dans les déserts. » Savary, traduct. du Coran, t. I. p. 105.
[17] Voici la traduction de quelques vers sur le même sujet, qu'on trouve dans l’Anvari soheili. On s'apercevra, en les lisant, de la différence qui existe entre la littérature arabe et la littérature persane ; différence que j'ai essayé de caractériser dans mon Coup d'œil sur la littérature orientale.
« Acquiers de l'or à quelque prix que ce soit ; car l'or est ce qu'on estime le plus au monde. On prétend que la liberté est préférable ; ne le crois pas ; c'est l'or seul qui renferme la vraie liberté. . . .
» La pièce de monnaie de ce beau métal a les joues riantes comme le soleil, et brillantes de pureté comme la coupe de Gemschid * ; c'est une beauté estampée au visage vermeil, un objet de bon aloi précieux et agréable. Tantôt l'or entraine dans le crime les belles au sein d'argent; tantôt il les arrache à la séduction. Il réjouit les cœurs affligés ; il est la clef de la serrure des événements fâcheux du siècle. »
* L'ancien roi Gemschid, le Salomon des Perses, avait une coupe, disent les auteurs orientaux, par le moyen de laquelle il connaissait toutes les choses naturelles, et quelquefois même les surnaturelles. Herbelot, Biblioth. or. au mol giam.
[18] Ibn Rachik a dit aussi en vers, en parlant d'une jeune fille :
« Sa taille est régulière, l'ensemble de son corps est bien proportionné. Ses joues sont d'une couleur de rose si parfaite, que, si l'on y mettait des feuilles de rose, on ne pourrait pas les distinguer de celles de son teint. Que celui qui est émerveillé de sa beauté, récite la première surate du Coran. »
[19] Ville de l'Aderbijan, (Médie des anciens).
[20] Les mobez sont les prêtres des mages, c'est-à-dire des sectateurs de Zoroastre. Il y a dans le texte : « Vous, mobez, qui avez le pouvoir de lier et de délier ». Les Orientaux se servent souvent de cette expression pour exprimer la toute-puissance.
[21] Ceci fait allusion à une manière particulière de tirer au sort avec des flèches, qui était très usitée chez les Arabes païens, et se pratiquait ainsi : « On achetait un jeune chameau, on le tuait et on le divisait en dix ou vingt-huit parties. Les personnes qui devaient jeter au sort pour avoir ces lots, se rassemblaient au nombre de sept : on prenait onze flèches sans pointe et sans plume ; on en marquait sept ; on faisait une marque à la première, deux à la seconde, et ainsi de suite pour toutes les sept. Les quatre autres flèches n'étaient pas marquées. On mettait ces flèches ensemble pêle-mêle dans un sac, et elles étaient tirées par une personne qui n'avait point de part au jeu. Près d'elle, était une autre personne qui devait recevoir les flèches, et prendre garde que cette première personne ne fit aucune tricherie. Ceux à qui les flèches marquées échéaient recevaient des portions de chameau proportionnées à leur lot ; les autres, auxquelles le sort donnait les flèches sans marque, n'avaient aucune part à la chair du chameau, et étaient obligés de le payer en entier. Cependant ceux qui gagnaient ne mangeaient pas plus de la chair du chameau que ceux qui perdaient ; mais le tout était distribué aux pauvres. Mahomet abolit cet usage ». Sale, Obs. hist. et crit. sur le mahom.
[22] Wali équivaut au mot gouverneur.
[23] Pour l'intelligence de ce passage, je dois avertir les personnes qui ne connaissent pas l'arabe, qu'environ la moitié des lettres arabes ont un ou plusieurs points que l'on nomme diacritiques, et qu'il ne faut pas confondre avec les points-voyelles, et que les autres n'en ont pas.
[24] Dans cette épître se trouvent alternativement un mot avec des points diacritiques, et un mot sans points diacritiques. Outre la gêne qui oblige l'auteur de sacrifier à la clarté et à la précision, ce placet se compose d'antithèses et de jeux de mots continuels, qui le rendent intraduisible. Après avoir fait dans ce placet l’éloge de la libéralité en général, et de celle du wali en particulier, le vieillard expose les besoins du pétitionnaire, et termine par des souhaits et par des vœux pour le wali.
[25] Vers d'un Anonyme: « Dans mon sommeil, au moment que l’izan (Appel à la prière, voyez l'Exposition de la foi musulmane, p. 79.) de l'aurore retentissait dans les airs, j'ai cru voir celle que j'aime venir auprès de moi à l'insu de l'indiscret. Dans l'excès de ma joie, j'ai failli réveiller ceux qui étaient près de moi. Hélas! celui qui est en proie à la violence de sa passion, est bien près de déchirer le voile de l'amour. Je me suis ensuite éveillé.... Fatal réveil! il a détruit toutes mes espérances, il a fait évanouir mon bonheur, et au lieu du contentement que l'espérance donnait à mon cœur, il m'a laissé la tristesse la plus profonde. »