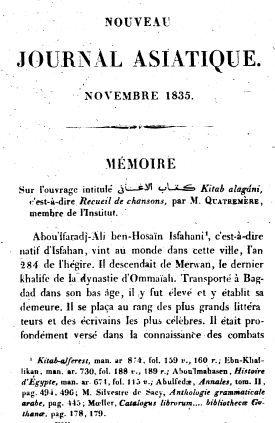
Abū al-Faraǧ al-Is̩fahānī (أبو الفرج الإصفهاني)
EXTRAITS DU Kitab al-agHÂni
Traduction française : P. Quatremère
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
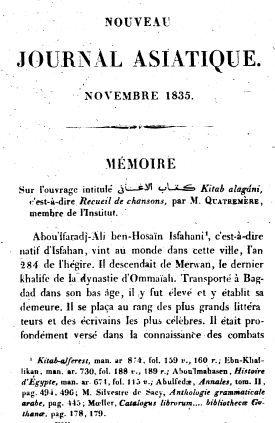
EXTRAITS DU Kitab al-agHÂni
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
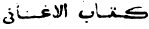
Sur l'ouvrage intitulé Kitab alagâni, c'est-à-dire Recueil de chansons,
par M. Quatremère, membre de l’Institut.
« Abou Katifah avait pour
véritable nom Amrou, fils de Walid, fils d'Okbah, fils d'Abou Moaït.
Le nom de ce dernier était Aban, fils d'Abou Amrou, fils d'Ommaïah,
fils d'Abd-Schems, fils d'Abd-Menaf, fils de Kosaï, fils de Kelab,
fils de Morrah, fils de Kaab, fils de Louwaï, fils de Gâleb. Tous
les généalogistes sont d'accord sur ce point. Si l'on en croit
Haïthem ben Adi, dans l'ouvrage intitulé Mathalïb,
 (les Défauts), Abou Amrou, dont
le nom était Dhakwan, était esclave d'Ommaïah et fut adopté par lui.
Suivant le même auteur, Dagfal[23]
le généalogiste étant un jour entré chez Moawiah, ce prince lui
demanda qui il avait vu parmi les plus illustres Koraïschs. Il
répondit : Abd-almotaleb ben Hâschem et Ommaïah ben Abd-Schems. » Le
khalife l'ayant invité à lui faire le portrait de ces deux hommes,
il répondit : Abd-almotaleb avait le teint blanc, était d'une haute
taille, beau de visage, et portait sur son front la lumière de la
prophétie et la majesté de la royauté. Il était entouré de ses dix
enfants, qui ressemblaient à autant de lions. » Moavviah ayant
désiré connaître le signalement d'Ommai'ah, Dagfal lui dit :
« C'était un vieillard de petite taille, maigre de corps, aveugle,
et qui avait pour conducteur son esclave Dhakwan. —Non, dit Moawiah,
c'était son fils Abou Amrou. — Vous le prétendez, reprit Dagfal, et
c'est vous qui avez mis en vogue cette tradition ; mais quant à moi,
ce que je sais de science certaine, est ce que je vous ai rapporté.
» Maintenant nous allons reprendre la suite de la généalogie. Louwaï
était fils de Gâleb, fils de Fehr, fils de Mâlek, fils de Nadar,
fils de Kenanah. Nadar, suivant la plupart des généalogistes, est la
souche des Koraïschs ; tous ses descendants
sont censés faire partie de cette tribu, et ceux qui ne tirent pas
de lui leur origine sont étrangers à cette grande famille. Si l'on
en croit quelques généalogistes koraïschs, Fehr ben Malek était le
véritable Koraïsch ; et ceux qui ne le reconnaissent point pour leur
père n'ont rien de commun avec les Koraïschs.
(les Défauts), Abou Amrou, dont
le nom était Dhakwan, était esclave d'Ommaïah et fut adopté par lui.
Suivant le même auteur, Dagfal[23]
le généalogiste étant un jour entré chez Moawiah, ce prince lui
demanda qui il avait vu parmi les plus illustres Koraïschs. Il
répondit : Abd-almotaleb ben Hâschem et Ommaïah ben Abd-Schems. » Le
khalife l'ayant invité à lui faire le portrait de ces deux hommes,
il répondit : Abd-almotaleb avait le teint blanc, était d'une haute
taille, beau de visage, et portait sur son front la lumière de la
prophétie et la majesté de la royauté. Il était entouré de ses dix
enfants, qui ressemblaient à autant de lions. » Moavviah ayant
désiré connaître le signalement d'Ommai'ah, Dagfal lui dit :
« C'était un vieillard de petite taille, maigre de corps, aveugle,
et qui avait pour conducteur son esclave Dhakwan. —Non, dit Moawiah,
c'était son fils Abou Amrou. — Vous le prétendez, reprit Dagfal, et
c'est vous qui avez mis en vogue cette tradition ; mais quant à moi,
ce que je sais de science certaine, est ce que je vous ai rapporté.
» Maintenant nous allons reprendre la suite de la généalogie. Louwaï
était fils de Gâleb, fils de Fehr, fils de Mâlek, fils de Nadar,
fils de Kenanah. Nadar, suivant la plupart des généalogistes, est la
souche des Koraïschs ; tous ses descendants
sont censés faire partie de cette tribu, et ceux qui ne tirent pas
de lui leur origine sont étrangers à cette grande famille. Si l'on
en croit quelques généalogistes koraïschs, Fehr ben Malek était le
véritable Koraïsch ; et ceux qui ne le reconnaissent point pour leur
père n'ont rien de commun avec les Koraïschs.
« Revenons à Nadar, fils
de Kenanah, fils de Khozaïmah, fils de Modrekah, fils d'Elias, fils
de Modar, fils de Nezar. Les fils d'Elias prirent le nom de leur
mère Khindif,  ,[24]
qui était surnommée
ainsi, mais dont le véritable nom était Leïla, fille de Halwan, fils
d'Amran, fils d'Alhaf, fils de Kodâah. Efle fut la mère de Modrekah,
de Tabekhah et de Kamah, qu'elle eut d'Elias, fils de Modar, fils de
Nezar, fils de Maadd, fils d'Adnan, fils d'Add, fils d'Odad, fils de
Homaïsa, fils de Iaschheb, ou, suivant d'autres, fils d'Aschheb,
fils de Nabat, fils de Kaïdar, fils d'Ismaël, fils d'Abraham. Telle
est la généalogie qui est admise parmi les Arabes.
,[24]
qui était surnommée
ainsi, mais dont le véritable nom était Leïla, fille de Halwan, fils
d'Amran, fils d'Alhaf, fils de Kodâah. Efle fut la mère de Modrekah,
de Tabekhah et de Kamah, qu'elle eut d'Elias, fils de Modar, fils de
Nezar, fils de Maadd, fils d'Adnan, fils d'Add, fils d'Odad, fils de
Homaïsa, fils de Iaschheb, ou, suivant d'autres, fils d'Aschheb,
fils de Nabat, fils de Kaïdar, fils d'Ismaël, fils d'Abraham. Telle
est la généalogie qui est admise parmi les Arabes.
« Suivant le récit de
Schehab-Azheri, l'un des plus instruits et des plus habiles d'entre
les Koraïschs, et suivant le témoignage de plusieurs généalogistes,
qui prétendent s'appuyer sur l'autorité de Dagfal et autres, Maadd
était fils d'Adnan, fils d'Odad, fils d'Omaïn, fils de Schadjib,
fils de Nabat, fils de Thalebab, fils d'Itr,
 , fils de Iarih, fils de
Mohallem, fils d'Awam, fils de Mohtemil, fils de Raïmah,
fils d'Akban, fils d'Allah, fils de Schahdoud, fils de Darb, fils
d'Akbar, fils d'Ibrahim, fils d'Ismaïl, fils de Rozn, fils d'Awadj,
fils de Motim, fils de Tarnah, fils de Kaswar, fils d'Atoud, fils de
Dada, fils de Mahmoud, fils de Zaïd, fils de Bezwan, fils d'Athamah,
fils de Daous, fils de Khadr, fils de Nazzal, fils de Kamir, fils de
Mahasch, fils de Madar, fils de Saïfi, fils de Nabat, fils de Kaïdar,
fils d'Ismaël, offert en sacrifice à Dieu, fils d'Abraham, l'ami de
Dieu. (Puissent la bénédiction et le salut du très Haut reposer sur
l'un et sur l'autre, ainsi que sur tous les prophètes et les apôtres
!)
, fils de Iarih, fils de
Mohallem, fils d'Awam, fils de Mohtemil, fils de Raïmah,
fils d'Akban, fils d'Allah, fils de Schahdoud, fils de Darb, fils
d'Akbar, fils d'Ibrahim, fils d'Ismaïl, fils de Rozn, fils d'Awadj,
fils de Motim, fils de Tarnah, fils de Kaswar, fils d'Atoud, fils de
Dada, fils de Mahmoud, fils de Zaïd, fils de Bezwan, fils d'Athamah,
fils de Daous, fils de Khadr, fils de Nazzal, fils de Kamir, fils de
Mahasch, fils de Madar, fils de Saïfi, fils de Nabat, fils de Kaïdar,
fils d'Ismaël, offert en sacrifice à Dieu, fils d'Abraham, l'ami de
Dieu. (Puissent la bénédiction et le salut du très Haut reposer sur
l'un et sur l'autre, ainsi que sur tous les prophètes et les apôtres
!)
« Tout le monde est d'accord que le père d'Abraham s'appelait Azer : du moins c'est ainsi que son nom est écrit en arabe, ainsi que l'atteste le livre de Dieu ; car dans le texte hébreu du Pentateuque on lit Tarekh. Celui-ci était fils de Nakhor ou Nahir, fils de Schareg, autrement Scharoug, fils d'Argou, le même que Raïdj, fils de Faleg, qui partagea la terre entre ses enfants, fils d'Abar, fils de Schalekh, fils d'Arfakhschid, autrement Rafed, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamek, dont le nom, en arabe, est écrit Malkan, fils de Motawaschlikh, autrement Mathoub, fils d'Enokh, le même qu'Edris, le prophète de Dieu, fils de Bord, autrement Raïd, fils de Mahlaïl, fils de Kathan (Kaïnan), fils d'Enosch, autrement Taher, fils de Schith (Dieudonné), autrement nommé Schath, fils d'Adam, le père des hommes.
« Voilà la généalogie qui
est généralement reçue, sauf quelques différences. On rapporte que
l'apôtre de Dieu donnait à cet égard un démenti aux généalogistes et
réfutait leurs assertions. Il existe aussi des dissidences d'opinion
relativement aux noms de quelques-uns de ceux qui sont compris dans
cette table; mais j'ai expliqué tout cela dans mon Livre des
généalogies, de manière à dispenser de recourir à aucun autre
ouvrage.[25]
Abou Katifah et sa famille faisaient partie des Anabis,
 , une des branches de la famille
d'Ommaïah. Ommaïah eut onze enfants mâles, dont chacun portait un
prénom dérivé du nom d'un de ses frères, savoir : Alas, Abou Alas,
Alaïs, Abou Alai's, Amrou et Abou Amrou, Harb et Abou Harb, Sofian
et Abou Sofian, et Alawis. Ils ne portaient pas d'autres prénoms.
C'est parmi eux que se trouvaient les Aïas,
, une des branches de la famille
d'Ommaïah. Ommaïah eut onze enfants mâles, dont chacun portait un
prénom dérivé du nom d'un de ses frères, savoir : Alas, Abou Alas,
Alaïs, Abou Alai's, Amrou et Abou Amrou, Harb et Abou Harb, Sofian
et Abou Sofian, et Alawis. Ils ne portaient pas d'autres prénoms.
C'est parmi eux que se trouvaient les Aïas,
 , ainsi que nous l'a rapporté
Haremi ben abi-Lala, dont le véritable nom était Ahmed ben Mohammed
ben Ishak, et Tousi, dont le nom était Ahmed ben Soleïman. Suivant
une tradition qui remonte à Zobaïr ben Bakkar, cette famille se
partageait en deux branches, les Aïas,
, ainsi que nous l'a rapporté
Haremi ben abi-Lala, dont le véritable nom était Ahmed ben Mohammed
ben Ishak, et Tousi, dont le nom était Ahmed ben Soleïman. Suivant
une tradition qui remonte à Zobaïr ben Bakkar, cette famille se
partageait en deux branches, les Aïas,
 , savoir : Alas, Abou Alas,
Alaïs, Abou Alaïs et Awis; et les Anabis,
, savoir : Alas, Abou Alas,
Alaïs, Abou Alaïs et Awis; et les Anabis,
 .[26]
Ce nom comprenait Harb, Abou Harb, Sofian, Abou Sofian, Amrou et
Abou Amrou. Ils avaient reçu ce surnom attendu que, conjointement
avec leur frère Harb, ils avaient tenu ferme au combat d'Okkad,
s'étaient liés eux-mêmes[27]
et avaient combattu avec un courage intrépide,[28]
ce qui les avait fait comparer à des lions; car le mot
.[26]
Ce nom comprenait Harb, Abou Harb, Sofian, Abou Sofian, Amrou et
Abou Amrou. Ils avaient reçu ce surnom attendu que, conjointement
avec leur frère Harb, ils avaient tenu ferme au combat d'Okkad,
s'étaient liés eux-mêmes[27]
et avaient combattu avec un courage intrépide,[28]
ce qui les avait fait comparer à des lions; car le mot
 , au pluriel
, au pluriel
 , est un des noms de cet animal.
Le poète Abd-Allah ben Fadalah, de la tribu d'Asad, dit au sujet de
cette famille :
, est un des noms de cet animal.
Le poète Abd-Allah ben Fadalah, de la tribu d'Asad, dit au sujet de
cette famille :
« C'est parmi les Aïas, ou les enfants de Harb, qu'on trouve un homme qui brille comme l'étoile blanche qui pare le front d'un noble coursier. »
« Voici à quelle occasion fut composé ce vers : Abd-Allah ben Fadalah, de la famille d'Asad ben Khozaïmah, s'étant rendu auprès d'Abd-Allah ben Zobaïr, lui dit : « Mon argent est épuisé et ma monture est harassée de fatigue. » Abd-Allah demanda à voir l'animal, qui lui fut aussitôt amené. Ensuite il dit de le faire avancer, puis reculer; enfin il ajouta : « Recouvre le pied de cette bête avec un cuir, que tu recoudras avec du crin. Gravis un lieu élevé, le sabot se rafraîchira; marche ensuite pendant deux jours, et l'animal aura pleinement recouvré ses forces. » Ibn Fadalah dit avec aigreur : « Je suis venu vers toi pour te demander une monture et non pas des détails pareils. Que Dieu maudisse la femelle de chameau qui m'a porté vers toi ! » Ibn Zobaïr répondit: « Que Dieu maudisse le cavalier! » Ibn Fadalah, s'étant éloigné, composa ces vers :
« Je dirai à mes esclaves qui ont sellé mes montures : Il faut que je passe, durant les ténèbres, la vallée de la Mecque.
« Lorsque je traverserai le lieu nommé Dhat-Irk, je me garderai bien de retourner auprès du fils de Kaheliah.
« Je mettrai entre nous une grande distance, grâce au pas de mes montures, sur le dos desquelles j'aurai suspendu des outres et des provisions ;
« Grâce à un chameau généreux,[29] à qui ses femelles ont souvent laissé voir les marques empreintes sur leur dos,[30] et qui gravit les lieux les plus escarpés.
« Je vois qu'on n'a rien à espérer d'Abou Khobaïb ; et Ommaïah n'est plus dans ce pays.
« C'est parmi les Aïas, ou dans la famille de Harb, que l'on peut trouver un homme qui brille comme l'étoile blanche qui pare le front d'un coursier généreux. »
« Abou Khobaïb est Abd-Allah ben Zobaïr, qui prenait le prénom d'Abou Bekr. Khobaïb était, à la vérité, l’aîné de ses enfants; mais le surnom de père de Khobaïb n'était donné à Abd-Allah que par ceux qui voulaient l'injurier. Ibn Zobaïr, ayant vu ces vers, dit aussitôt : Cet homme a prétendu m'insulter en nommant la moins estimable de mes mères, qui toutefois est la meilleure de ses tantes. »
« Au rapport de Iézidi,
l'adverbe  répond ici à
répond ici à
 , c'est vrai,
oui. Il indique une sorte d'aveu de ce qu'avait dit ce poète. Il
se trouve avec le même sens dans ce vers d'Abou Kaïs-Rokiat :
, c'est vrai,
oui. Il indique une sorte d'aveu de ce qu'avait dit ce poète. Il
se trouve avec le même sens dans ce vers d'Abou Kaïs-Rokiat :
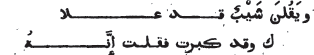
« Ces femmes me disaient : Déjà tes cheveux blanchissent et tu atteins la vieillesse. » Je répondis : C'est vrai. »
« Abou Moaït eut pour mère Aminah, fille d'Aban, fils de Kolaïb, fils de Rebiah, fils d'Amer, fils de Saasaah, fils de Moawiah, fils de Bekr, fils de Hawazin. C'est pour elle que le poète Nabegah ben Djadah a fait ces vers :
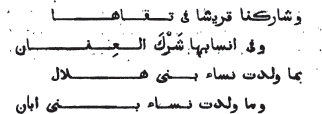
« Nous avons été unis intimement avec les Koraïschs par les liens de la religion et de la parenté ;
« Grâce aux enfants nés des femmes des Bènou Helal, et à ceux qui ont reçu le jour des femmes des Bènou Aban. »
« Aminah était femme d'Ommaïah,
fils d'Abd Schems, dont elle eut plusieurs enfants, savoir: Aïasi,
Abou'Iasi, Aïs, Abou'laïs, Awis, Safiiah, Taubah et Arwa. Après la
mort d'Ommaïah elle épousa Abou Amrou, fils de son mari; car, du
temps du paganisme, un homme se mariait sans scrupule à la femme de
son père. De ce mariage naquit Abou Moaït. Les enfants qu'Aminah
avait eus d'Ommaïah étaient donc tout à la fois frères et oncles
paternels d'Abou Moaït. Tout ce que je viens de dire a été rapporté
par Tousi, d'après le récit de Zobaïr ben Bakkar. Celui-ci ajoutait
: Suivant ce que m'a raconté mon oncle Mosab, on assurait que
c'était Abou'Iasi, fils d'Aminah, qui lui avait fait épouser son
frère Abou Amrou. En effet, des unions de ce genre étaient admises
chez les Arabes païens ; mais Dieu les prohiba formellement par ce
verset de l'Alcoran,[31]
N'épousez point les femmes qu'ont
épousées vos pères, à moins
que le mariage n'ait été
précédemment contracté; car une pareille
union est infâme, odieuse et
coupable. Dès lors ce genre de mariage fut nommé
 , le mariage
haïssable.[32]
»
, le mariage
haïssable.[32]
»
« Okbah, fils d'Abou Moaït, fut fait prisonnier à la bataille de Bedr, et mis à mort de sang-froid par ordre de l’apôtre de Dieu. Toutes les traditions sont d'accord sur ce point.
« Suivant le récit d'Ibn
Schehab-Zehri, Okbah, ayant entendu l'arrêt de mort prononcé contre
lui par le prophète, s'écria : O Mohammed, quoi, seul d'entre les
Koraïschs je vais périr ? — Oui, dit l'apôtre de Dieu. — O ciel!
ajouta Okbah, qui donc recueillera mes enfants après ma mort? — Le
feu, » dit le prophète. Depuis cette époque les enfants d'Okbah
reçurent le surnom d'enfants du feu

 .
On est peu d'accord sur le nom de celui qui exécuta la sentence de
mort prononcée contre Okbah : suivant les uns, ce fut Ali, fils
d'Abou Taleb, qui, après la bataille de Bedr, trancha la tête d'Okhah,
fils d'Abou Moaït, ainsi que de Nadr ben Hareth. Au rapport d'Ibn
Ishak, Okbah périt par les mains d'Asem ben Thabet, et Ali donna la
mort à Nadr ben Hareth ben Keldah.[33]
Suivant une tradition qui remonte à Ibn
Ishak, l'apôtre de Dieu, le jour du combat de Bedr, ayant de
sang-froid prononcé la mort d'Okbah, fils d'Abou Moaït, ce fut Asem
ben Thabet qui reçut Tordre d'exécuter cet arrêt et trancha la tête
du prisonnier. Le prophète, étant parti de Bedr et étant arrivé au
lieu nommé Safrâ,
.
On est peu d'accord sur le nom de celui qui exécuta la sentence de
mort prononcée contre Okbah : suivant les uns, ce fut Ali, fils
d'Abou Taleb, qui, après la bataille de Bedr, trancha la tête d'Okhah,
fils d'Abou Moaït, ainsi que de Nadr ben Hareth. Au rapport d'Ibn
Ishak, Okbah périt par les mains d'Asem ben Thabet, et Ali donna la
mort à Nadr ben Hareth ben Keldah.[33]
Suivant une tradition qui remonte à Ibn
Ishak, l'apôtre de Dieu, le jour du combat de Bedr, ayant de
sang-froid prononcé la mort d'Okbah, fils d'Abou Moaït, ce fut Asem
ben Thabet qui reçut Tordre d'exécuter cet arrêt et trancha la tête
du prisonnier. Le prophète, étant parti de Bedr et étant arrivé au
lieu nommé Safrâ,
 , ordonna le supplice de Nadr
ben Hareth, dont la tête tomba sous les coups d'Ali. Suivant le
récit d'Omar ben Schabbah, le lieu nommé Othaïl,
, ordonna le supplice de Nadr
ben Hareth, dont la tête tomba sous les coups d'Ali. Suivant le
récit d'Omar ben Schabbah, le lieu nommé Othaïl,
 ,[34]
fut le théâtre de cet événement tragique. Kotaïlali, fille de Hareth
et sœur de Nadr, déplora dans les vers suivants le malheur de son
frère:[35]
,[34]
fut le théâtre de cet événement tragique. Kotaïlali, fille de Hareth
et sœur de Nadr, déplora dans les vers suivants le malheur de son
frère:[35]
« O cavalier! Othaïl est un lieu où tu arriveras le matin du cinquième jour, si tu es bien guidé.
« Va trouver un mort qui repose en cet endroit et porte-lui de ma part une salutation, dont le son ne cessera de faire palpiter nos chameaux.
« Annonce-lui mes regrets, qui tantôt font couler de mes yeux des larmes abondantes, et tantôt m'oppressent et me suffoquent.
« Nadr entendrait-il ma voix? peut-on croire qu'un mort, qui ne peut parler, soit capable d'entendre?
« Il a péri par le glaive des enfants de son père. Grand Dieu ! quels liens de parenté ont-ils ainsi brisés[36] !
« Fatigué, chargé de chaînes,[37] captif, il a été conduit lentement au supplice, comme un animal garrotté.
« O Mohammed, fils d'une mère distinguée dans toute la tribu, et du père le plus illustre :
L'indulgence ne t'aurait causé aucun préjudice; souvent l'homme généreux, quoique agité par les transports de la haine et de la colère, pardonne à son ennemi.
« Si tu avais voulu accepter une rançon, nous t'aurions offert les objets qui eussent été pour toi les plus rares et les plus précieux.
« Nadr était, de tous ceux dont tu as puni les fautes, celui qui te touchait de plus près et le plus digne de la liberté, si quelqu'un avait dû l'obtenir.[38] »
« On assure que le prophète, ayant entendu réciter cette élégie, déclara que, s'il l'avait connue plus tôt, il n'aurait point fait mettre à mort son prisonnier.
« On ajoute que ces vers étaient les plus nobles, les plus modérés, les plus calmes, les plus doux que la douleur ait jamais inspirés à une femme livrée aux transports du ressentiment.
« Arwah ben Zobaïr ayant demandé à Abd-Allah, fils d'Omar, quelle était l'action la plus criminelle que les idolâtres eussent tentée contre le prophète, en reçut cette réponse : Tandis que l'apôtre de Dieu se trouvait dans la kabah, au lieu nommé Hidjr, Okbah, fils d'Abou Moaït, s'approcha, jeta son habit autour du cou du prophète et le serra fortement, de manière à l'étrangler. Abou Bekr, accourant, saisit Okbah par l'épaule et le poussa violemment. Hé quoi, lui dit-il, vous voulez égorger un homme uniquement parce qu'il dit Dieu est mon seigneur?
« Walid, fils d'Okbah, était frère utérin du khalife Othman ben Affan. Leur mère, Arwa, fille de Koraïz, avait eu pour mère Omm-Hakim. Baïda, fille d'Abd-almotaleb ben Hâschem, était sœur jumelle d'Abd-Allah, père de l'apôtre de Dieu. Okbah, fils d'Abou Moaït, épousa Arwa après la mort d'Affan, et il en eut plusieurs enfants, savoir : Walid, Kaled, Omârah, Omm-Kelthoum, qui tous se trouvaient frères et sœurs de mère du khalife Othman. Celui-ci, pendant son règne, avait donné à Walid le gouvernement de Koufah; mais il buvait du vin, faisait la prière en public dans un état complet d'ivresse, et se permettait d'ajouter aux formules dont se composait la prière. Le fait ayant été rapporté au khalife et certifié par la déposition de plusieurs témoins, il fit frapper sévèrement Valid.
« Abou Katifah-Amrou, fils de Walid, avait pour prénom Abou Walid ; Abou Katifah était un surnom qui lui avait été donné. Sa mère était fille de Rebi, fils de Dhou'lkhamar, l'un des descendants d'Asad ben Khozaïmah.
« Les vers cités plus haut furent composés par Abou Katifah au moment où il fut expulsé de Médine, avec les autres membres de la famille d'Ommaïah, par ordre d'Abd-Allah ben Zobaïr, et contenaient l'expression de ses regrets. »
L'auteur ajoute ici des détails curieux et circonstanciés sur l'histoire d'Abd-Allah ben Zobaïr et sur la manière dont les membres de la famille d'Ommaïah furent chassés de Médine. Je ne transcrirai point ce récit, que j'ai donné ailleurs avec beaucoup d'étendue.
« Abou Katifah partagea la disgrâce des Omeyades. Retiré en Syrie, et s'ennuyant de la longueur de son exil, il composa ces vers :
« Plût à Dieu que je susse si, depuis notre départ, Kobâ a changé, si Akik et son bourg sont anéantis;
« Si Bathâ a cessé de posséder le tombeau de Mohammed, auquel arrivaient, dès le matin, les plus illustres familles d'entre les Koraïschs.
« Je leur ai voué le plus extrême attachement, l'affection la plus sincère et l'amitié la plus pure, à eux et à tous les hommes en général. »
« Il composa également cette chanson, qui ne fait pas partie des cent chansons choisies :
« Plût à Dieu que je susse (et à quoi me sert ce souhait?) si Ialben et Beram sont encore dans leur état ordinaire ;
« Si Akik est aujourd'hui ce qu'il était pendant mon séjour, ou si, depuis mon départ, il a éprouvé les bouleversements que peuvent amener le temps et les événements !
« Au lieu de mes compatriotes, je trouve ici les tribus d'Akk, de Lakhm, de Djedham. Et quel rapport y a-t-il entre Djedham et moi ?
« J'ai échangé les habitations de ma famille, ces palais vastes et pompeux, pour des châteaux élevés, décorés de peintures, et sur le faîte desquels chantent des colombes.
« Si tu parviens auprès de mes compatriotes, adresse leur mes salutations. J'ai bien rarement occasion de leur donner cette marque de souvenir. »
Le mètre de cette chanson
est celui que l'on appelle  (léger);
l'air est
(léger);
l'air est  (lourd). Ialben et
Beram sont deux noms de lieu.
(lourd). Ialben et
Beram sont deux noms de lieu.
 est le pluriel de
est le pluriel de
 , et signifie des
châteaux, des palais. Au rapport d'Asmaï,
, et signifie des
châteaux, des palais. Au rapport d'Asmaï,
 désigne des maisons couvertes de
toits. Suivant le témoignage d'Ibn Ammar, il faut écrire
désigne des maisons couvertes de
toits. Suivant le témoignage d'Ibn Ammar, il faut écrire
 avec
un schin; ce qui indiquerait que ces palais étaient
avec
un schin; ce qui indiquerait que ces palais étaient
 , c'est-à-dire
, c'est-à-dire
 ,
ornés de peintures. Ishak lit
,
ornés de peintures. Ishak lit
 avec un sin ; c'est le
pluriel de
avec un sin ; c'est le
pluriel de  , qui signifie,
, qui signifie,
 , origine,
état primitif. On dit :
, origine,
état primitif. On dit :
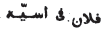 Quelqu'un est dans son état
primitif
Quelqu'un est dans son état
primitif  . » Le mot
. » Le mot
 est
la même chose que
est
la même chose que  (fondement).
(fondement).
 est le pluriel de
est le pluriel de
 , qui signifie le
sommet d'une chose quelconque.
, qui signifie le
sommet d'une chose quelconque.
« Au rapport de Zobaïr ben Bakkar, Abou Katifah ajouta à la chanson qu'on vient de lire, les vers que voici :
« Je passe la nuit dans la douleur, dans les gémissements, et je goûte à peine les douceurs du sommeil,
« En pensant à mes compatriotes, qui habitent si loin de moi, sur une terre où mes songes eux-mêmes n'osent pénétrer.
« Je crains qu'ils ne soient exposés aux insultes du temps et à une de ces guerres qui font blanchir les cheveux des jeunes gens.[39]
« Le moment approche où le temps va être séparé de nous pour toujours. »
« Abd-Allah ben Zobaïr, ayant lu ces vers, s'écria: Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur Abou Katifah! Quiconque le rencontrera peut lui annoncer qu'il n'a rien à craindre pour sa sûreté, et qu'il est libre de revenir dans sa patrie. » A cette nouvelle Abou Katifah partit aussitôt et prit la route de Médine; mais il mourut avant d'être arrivé au terme de son voyage.
« Ibn Ammar, d'après Medaïni, raconte à cette occasion l'anecdote suivante. Une femme de Médine ayant épousé un habitant de la Syrie, son mari l'emmena malgré elle pour la conduire au pays qu'il habitait. Cette femme, en ce moment, ayant entendu un chanteur qui récitait les vers d'Abou Katifah, poussa des soupirs convulsifs et tomba morte. Suivant un autre récit, une femme de la famille de Zehrah étant sortie de chez elle pour réclamer une dette, fut rencontrée par un homme de la famille d'Abd-Schems, qui habitait la Syrie. Ayant pris des informations sur cette femme, et sachant qui elle était, il la demanda en mariage à ses parents, qui la lui accordèrent, malgré la répugnance qu'elle témoignait pour cette alliance. Le mari se mit bientôt en marche pour retourner en Syrie. Au moment de son départ, cette femme entendit réciter cette chanson :
« Plaise à Dieu que je
sache si, depuis notre départ, les côtés du Mosallâ
(l'oratoire) ont changé, ou si le quartier appelé Karaïn,
 , est encore tel qu'il était de
mon temps ;
, est encore tel qu'il était de
mon temps ;
« Ou si les maisons qui
environnent Bêlât  , sont
encore occupées par ma tribu, ou si Médine est encore habitée.
, sont
encore occupées par ma tribu, ou si Médine est encore habitée.
« Lorsqu'un nuage chargé d'éclairs paraît du côté du Hedjaz, mon amour appelle à grands cris ces éclairs qui brillent à la droite.
« Si j'ai quitté mon pays, ce n'a point été par dégoût, mais pour obéir aux ordres suprêmes de Dieu. »
Ces vers appartiennent au
mètre nommé  (le long). On
prétend que la musique a pour auteur Mabed.
(le long). On
prétend que la musique a pour auteur Mabed.
Cette femme, en entendant ces vers, poussa de profonds soupirs, au milieu de ses compagnes, et tomba morte. Elle se nommait, dit-on, Hamidah, fille d'Omar ben Abd-alrahman.
« Abou Katifah-Amrou écrivit un jour à son père Walid, tandis que celui-ci gouvernait Koufah, au nom du khalife Othman :
« Qui se chargera de dire de ma part à l'émir que je suis livré à l'insomnie, sans avoir d'autre maladie qu'une soif ardente du plaisir?
« Si vous ne me secourez pas, je crains votre injustice, j'appréhende qu'on ne me voie bientôt, dans la maison, puni sévèrement, pour venger des belles aux yeux bleus. »
Il entend ici la maison d'Othman, où s'exécutaient les châtiments juridiques. Walid ayant acheté à Koufah une jeune esclave, se hâta de l'envoyer à son fils.
« Quant à ce qui concerne
le palais  ,
dont il a été parlé plus
haut, et à la vente qui en avait été faite à Moawiah, voici ce que
racontait Mosab, petit-fils d'Arwah ben Zobaïr. Saïd, fils d'Alasi,
étant près de mourir, habitait le palais susdit. Son fils Amrou lui
demanda s'il ne voulait pas s'établir à Médine. Mon fils, dit Saïd,
mes compatriotes ne refuseront pas de me porter sur leur cou pendant
une heure. Dès que je ne serai plus, fais-les avertir. Après m'avoir
rendu les devoirs de la sépulture, va trouver Moawiah, annonce-lui
ma mort et parle-lui des dettes que je laisse. Je ne doute pas qu'il
ne te promette de les acquitter; mais garde-toi d'accepter cette
offre. Propose-lui la vente du palais que j'habite, qui est un lieu
de plaisance sans aucun produit.
,
dont il a été parlé plus
haut, et à la vente qui en avait été faite à Moawiah, voici ce que
racontait Mosab, petit-fils d'Arwah ben Zobaïr. Saïd, fils d'Alasi,
étant près de mourir, habitait le palais susdit. Son fils Amrou lui
demanda s'il ne voulait pas s'établir à Médine. Mon fils, dit Saïd,
mes compatriotes ne refuseront pas de me porter sur leur cou pendant
une heure. Dès que je ne serai plus, fais-les avertir. Après m'avoir
rendu les devoirs de la sépulture, va trouver Moawiah, annonce-lui
ma mort et parle-lui des dettes que je laisse. Je ne doute pas qu'il
ne te promette de les acquitter; mais garde-toi d'accepter cette
offre. Propose-lui la vente du palais que j'habite, qui est un lieu
de plaisance sans aucun produit.
« Dès que Saïd eut fermé
les yeux, les habitants de Médine, informés de sa mort,
s'empressèrent de transporter son corps depuis son palais jusqu'au
lieu nommé Baki,  , où il
fut inhumé. Les montures d'Amrou, fils de
Saïd, étaient prêtes à partir. Tout le monde vint devant le tombeau
faire à Amrou ses compliments de condoléance et lui adresser ses
adieux. Il fut le premier qui apprit au khalife Moawiah la mort de
Saïd. A cette nouvelle le prince montra une extrême tristesse, et
appela sur le défunt la miséricorde de Dieu; ensuite il demanda à
Amrou si son père avait laissé des dettes. Oui, répondit-il, il doit
trois cent mille pièces d'argent. » Le khalife déclara qu'il
s'engageait à les acquitter. Mon père a bien prévu, dit Amrou, que
vous me feriez une pareille proposition; mais il m'a recommandé de
ne pas l'accepter, à moins que vous ne veuillez consentir à acheter
une de ses propriétés, dont le prix sera consacré à éteindre ses
dettes. » Moawiah ayant demandé quel terrain il voulait vendre,
Amrou répondit : C'est le palais de mon père, situé au lieu nommé
Ardah,
, où il
fut inhumé. Les montures d'Amrou, fils de
Saïd, étaient prêtes à partir. Tout le monde vint devant le tombeau
faire à Amrou ses compliments de condoléance et lui adresser ses
adieux. Il fut le premier qui apprit au khalife Moawiah la mort de
Saïd. A cette nouvelle le prince montra une extrême tristesse, et
appela sur le défunt la miséricorde de Dieu; ensuite il demanda à
Amrou si son père avait laissé des dettes. Oui, répondit-il, il doit
trois cent mille pièces d'argent. » Le khalife déclara qu'il
s'engageait à les acquitter. Mon père a bien prévu, dit Amrou, que
vous me feriez une pareille proposition; mais il m'a recommandé de
ne pas l'accepter, à moins que vous ne veuillez consentir à acheter
une de ses propriétés, dont le prix sera consacré à éteindre ses
dettes. » Moawiah ayant demandé quel terrain il voulait vendre,
Amrou répondit : C'est le palais de mon père, situé au lieu nommé
Ardah,
 .[40]
» Le khalife déclara qu'il acceptait le marché et paierait les
dettes. Amrou ajouta, pour dernière condition, que le prince
s'engagerait à faire porter l'argent à Médine et à le convertir en
monnaie appelée wafiah,
.[40]
» Le khalife déclara qu'il acceptait le marché et paierait les
dettes. Amrou ajouta, pour dernière condition, que le prince
s'engagerait à faire porter l'argent à Médine et à le convertir en
monnaie appelée wafiah,  ;[41]
ce qui fut accordé sans objection. Les fonds furent en effet
transportés à Médine et distribués entre les créanciers de Saïd, qui
n'avaient, pour la plupart, d'autres titres que des promesses
verbales. Un jeune homme d'entre les Koraïschs se présenta avec un
billet de vingt mille pièces d'argent, souscrit par Saïd et revêtu
de l'attestation d'un affranchi de ce dernier. Amrou ayant fait
venir cet homme et lui ayant présenté cette pièce, il se mit à
pleurer, déclara que c'était bien sa propre déclaration et la
signature de son maître. Amrou ayant demandé comment il pouvait se
faire que son père fût redevable d'une somme si forte à un jeune
homme qui était un des plus pauvres d'entre les Koraïschs,
l'affranchi lui raconta le fait en ces termes : Saïd, après sa
destitution, passant dans les rues de Médine, ce jeune homme, qui se
trouvait sur son passage, l’accompagna jusqu'à sa maison. Saïd,
s'arrêtant, demanda à cet homme s'il désirait quelque chose. Non,
dit-il ; mais j'ai vu que tu marchais seul, et j'ai voulu me placer
sous ton aile. » Saïd m'ayant dit d'apporter une feuille de papier,
je lui présentai celle-ci, sur laquelle il écrivit l'obligation que
je tiens, en disant à ce jeune homme : Je n'ai point d'argent en ce
moment; mais prends ce billet, et viens me trouver lorsque j'aurai
reçu quelques sommes. » Amrou déclara que cette dette serait payée
en monnaie wafiah; et il fit compter au jeune homme vingt
mille dirhems wafis. »
;[41]
ce qui fut accordé sans objection. Les fonds furent en effet
transportés à Médine et distribués entre les créanciers de Saïd, qui
n'avaient, pour la plupart, d'autres titres que des promesses
verbales. Un jeune homme d'entre les Koraïschs se présenta avec un
billet de vingt mille pièces d'argent, souscrit par Saïd et revêtu
de l'attestation d'un affranchi de ce dernier. Amrou ayant fait
venir cet homme et lui ayant présenté cette pièce, il se mit à
pleurer, déclara que c'était bien sa propre déclaration et la
signature de son maître. Amrou ayant demandé comment il pouvait se
faire que son père fût redevable d'une somme si forte à un jeune
homme qui était un des plus pauvres d'entre les Koraïschs,
l'affranchi lui raconta le fait en ces termes : Saïd, après sa
destitution, passant dans les rues de Médine, ce jeune homme, qui se
trouvait sur son passage, l’accompagna jusqu'à sa maison. Saïd,
s'arrêtant, demanda à cet homme s'il désirait quelque chose. Non,
dit-il ; mais j'ai vu que tu marchais seul, et j'ai voulu me placer
sous ton aile. » Saïd m'ayant dit d'apporter une feuille de papier,
je lui présentai celle-ci, sur laquelle il écrivit l'obligation que
je tiens, en disant à ce jeune homme : Je n'ai point d'argent en ce
moment; mais prends ce billet, et viens me trouver lorsque j'aurai
reçu quelques sommes. » Amrou déclara que cette dette serait payée
en monnaie wafiah; et il fit compter au jeune homme vingt
mille dirhems wafis. »
« Au rapport d'Abou Haroun-Medaïni, si un particulier se présentait devant Saïd pour réclamer de lui un bienfait et qu'il n'eût pas d'argent disponible, il lui souscrivait un engagement pour la somme qu'il demandait. Il disait à ses amis : Croyez-vous que j'aie réellement reçu la valeur de ce billet? Non ; mais un homme se présentait devant moi pour implorer ma générosité. Le sang qui enflammait son visage se communiquait au mien, et je ne pouvais me résoudre à renvoyer cet homme les mains vides. »
« Un jour, un affranchi des Koraïschs, accompagné d'un jeune homme, fils de son affranchi, alla trouver Saïd, et lui dit : Cet enfant a perdu son père et je désirerais le marier. » Saïd lui répondit : Pour le moment je n'ai pas d'argent; mais emprunte sous ma responsabilité. Après la mort de Saïd, cet homme se rendit auprès d'Amrou, et lui dit : J'ai autrefois présenté à ton père le fils d'un tel. » Et il lui raconta l'anecdote. Amfou, ayant demandé quel était le montant du billet, apprit qu'il s'agissait d'une somme de dix mille pièces d'argent. Amrou, s'avançant vers l'assemblée de ses compatriotes, leur dit : Qui de vous a vu un être plus désintéressé que cet homme? Saïd l'ayant autorisé à emprunter, sous son cautionnement, la somme qu'il voudrait, il s'est borné à dix mille pièces. A coup sûr, s'il en avait demandé cent mille, j'aurais acquitté la dette sans difficulté. »
« Abou Katifah eut pour
mère Arwâ,  ,
qui fut également mère de
Khaled, fils de Walid et petit-fils d'Okbah, oncle paternel d'Abou
Katifah. Celui-ci fit à cette occasion les vers suivants :
,
qui fut également mère de
Khaled, fils de Walid et petit-fils d'Okbah, oncle paternel d'Abou
Katifah. Celui-ci fit à cette occasion les vers suivants :
« Moi, fils d'Abou Moaït, quand j'expose ma généalogie, j'appartiens à la famille la plus noble, à la race la plus illustre.
« Ma naissance, du côté des femmes, remonte à Kosaï et à Makhzoum ; et je ne suis point un homme du commun.
« Les liens du sang m'attachent à Arwa, de la famille de Koraïz, et Arwa de Khaïr, fille d'Abou Akil.
« Ces deux tribus (j'en jure par la vie de ton père) peuvent se vanter de la noblesse la plus ancienne.
« O Abou Dhobab, passe en revue des femmes aussi illustres, afin que les hommes sensés puissent peser tes paroles.
« Je n'ai point eu Zerka pour mère : je n'ai point à rougir d'une pareille naissance. Aucun lien de parente ne m'attache à la famille d'Azrak. »
« Le surnom d'Abou Dhobab désigne ici le khalife Abd-al-Malik. Zerka, de la tribu de Kendah, était une des ancêtres de ce prince ; et on citait volontiers cette femme pour railler le khalife. Le poète, ayant appris qu'Abd-al-Malik ne cessait de le décrier, fit les vers suivants :
« J'ai appris que le fils de Kalamess se plaît à m'insulter. Quel être, parmi les hommes, est irréprochable et à l'abri des outrages ?
« Qui êtes-vous? vous autres? qui êtes-vous, dites-moi qui vous êtes? Déjà bien des faits paraissent au jour, tandis que d'autres restent cachés. »
« Abd-al-Malik, ayant eu connaissance de ces vers, s'écria : Je n'avais pas cru que nous fussions des êtres ignorés. Certes, si je ne conservais quelques égards pour cet insensé, je le traiterais comme un homme qu'il connaît bien, et je ferais déchirer sa peau à coups de fouet. »
« Abou Katifah ayant répudié sa femme, elle épousa un habitant de l'Irak. A peine le nouveau mariage avait-il été contracté et consommé, que le poète exhala son repentir dans ces vers :
« O tristesse mortelle ! me voilà séparé de la fille d'Amrou; et sa famille a pris la route de l'Irak.
« Il ne m'est plus permis de lui rendre visite ; et nous ne nous réunirons plus jusqu'au jour de la résurrection.
« Peut-être que Dieu nous la ramènera, par la mort de son mari, ou par un divorce.
« Dans ce cas, je recouvrerais la joie et le bonheur. Nous nous rapprocherions après une longue séparation. »
« Saïd, fils d'Othman, avait été nommé, par Moawiah, gouverneur du Khorasan. Après sa destitution, il se rendit à Médine, conduisant avec lui des sommes d'argent considérables, des armes et trente esclaves du pays de Sogd (la Sogdiane), qu'il chargea de lui bâtir une maison. Tandis qu'il était assis dans son habitation, ayant auprès de lui Ibn Saïhan, Ibn Zanbah, Khaled ben Okbah et Abou Katifah, ces esclaves s'étant concertés entre eux, se jetèrent sur lui et l'égorgèrent. Abou Katifah, ou, suivant une autre tradition, Khaled, fils d'Okbah, fit, dans ces vers, l’éloge de Saïd :
« O mon œil, verse des larmes comme une pluie abondante; pleure Saïd, fils d'Othman, fils d'Afian.
« Certes Ibn Zanbah ne lui a pas témoigné une affection sincère; et Ibn Artat ben Saïhan l’a abandonné dans le danger. »
J'interromps ici le récit de l'historien : j'en donnerai la suite dans un autre numéro; et je me hâte de transcrire un morceau rempli de détails curieux, piquants, et qui, si je ne me trompe, présenteront aux lecteurs instruits plus d'un genre d'intérêt.
[42]Adi[43]
était fils de Zeïd, fils de Hammad, fils de Zeïd, fils d'Aïoub, fils
de Madjrouf, fils d'Amer, fils d'Adaïah,
 , fils d'Amrou'lkaïs, fils de
Zeïd-Menât, fils de Temim, fils de Morr, fils d'Add, fils d'Elias,
fds de Modar, fils de Nézar. Au rapport d'Ibn alarabi, Aïoub fut,
parmi les Arabes, le premier qui porta ce nom.[44]
C'était un homme éloquent, un des poètes du temps du paganisme. Il
professait la religion chrétienne, aussi bien que son père et toute
sa famille. On ne le compte pas parmi les poètes du premier rang,
, fils d'Amrou'lkaïs, fils de
Zeïd-Menât, fils de Temim, fils de Morr, fils d'Add, fils d'Elias,
fds de Modar, fils de Nézar. Au rapport d'Ibn alarabi, Aïoub fut,
parmi les Arabes, le premier qui porta ce nom.[44]
C'était un homme éloquent, un des poètes du temps du paganisme. Il
professait la religion chrétienne, aussi bien que son père et toute
sa famille. On ne le compte pas parmi les poètes du premier rang,
 .[45]
C'était un citadin ; et on a pris soin de relever plusieurs défauts
qui lui ont été justement reprochés. Asmaï et Abou Obaïdah ont dit
de lui : « Adi ben Zeïd tient parmi les poètes la même place que
l'étoile de Canope parmi les astres : il voulait rivaliser avec eux
sans pouvoir les égaler. » Il en était de même d'Ommaïah ben Abi 'Isalt.
Tels furent, depuis l'islamisme, Komaït et Tirimmakh. Adjadj
s'exprimait ainsi en parlant de ces deux versificateurs : « Ils me
questionnaient sur des mots peu communs,
.[45]
C'était un citadin ; et on a pris soin de relever plusieurs défauts
qui lui ont été justement reprochés. Asmaï et Abou Obaïdah ont dit
de lui : « Adi ben Zeïd tient parmi les poètes la même place que
l'étoile de Canope parmi les astres : il voulait rivaliser avec eux
sans pouvoir les égaler. » Il en était de même d'Ommaïah ben Abi 'Isalt.
Tels furent, depuis l'islamisme, Komaït et Tirimmakh. Adjadj
s'exprimait ainsi en parlant de ces deux versificateurs : « Ils me
questionnaient sur des mots peu communs,
 , et je leur en donnais
l'explication ; mais ensuite je voyais que dans leurs ouvrages ces
expressions se trouvaient tout à fait déplacées. Comme on lui
demandait à quoi il attribuait ce défaut, il répondait : « Ces deux
poètes habitaient les villes, et par suite, peignant ce qu'ils
n'avaient pas vu, ils en faisaient un portrait infidèle; tandis que
moi qui suis Bédouin, je décris ce que j'ai sous les yeux et je le
retrace avec fidélité. » Ibn alarabi, citant une tradition qui
remonte à Hescham ben Kelbi, expose en ces termes la raison pour
laquelle Adi ben Zeïd passa sa vie dans la ville de Hirah : « Son
aïeul Aïoub, fils de Madjrouf, habitait le Yemamah, parmi les
enfants d'Amrou'lkaïs ben Zeïd-Menat. Ayant commis un meurtre dans
sa tribu, il prit la fuite et alla chercher un asile à Hirah, auprès
d'Aous ben Kallam, l'un des descendants de Hareth
ben Kaab, avec lequel il était parent du côté des femmes. Aous
l'accueillit avec la plus grande distinction et le reçut dans sa
maison. Au bout de quelque temps il dit à Aïoub : « As-tu, mon
cousin, l'intention de te fixer auprès de moi, dans ma maison ? »
Aïoub déclara que tel était son désir. « En effet, ajouta-t-il, je
sais parfaitement que, si je retournais dans ma tribu étant coupable
d'un meurtre, je ne serais nullement en sûreté; et je n'ai plus
désormais d'autre asile que ta maison. » Aous répondit : « Je suis
avancé en âge ; peut-être ma mort n'est-elle point éloignée. Je
crains que mes enfants n'aient pas pour toi tous les égards que je
te témoigne, et qu'il n'arrive entre eux et toi quelque différend
qui leur fasse oublier les devoirs que leur imposent les liens du
sang,
, et je leur en donnais
l'explication ; mais ensuite je voyais que dans leurs ouvrages ces
expressions se trouvaient tout à fait déplacées. Comme on lui
demandait à quoi il attribuait ce défaut, il répondait : « Ces deux
poètes habitaient les villes, et par suite, peignant ce qu'ils
n'avaient pas vu, ils en faisaient un portrait infidèle; tandis que
moi qui suis Bédouin, je décris ce que j'ai sous les yeux et je le
retrace avec fidélité. » Ibn alarabi, citant une tradition qui
remonte à Hescham ben Kelbi, expose en ces termes la raison pour
laquelle Adi ben Zeïd passa sa vie dans la ville de Hirah : « Son
aïeul Aïoub, fils de Madjrouf, habitait le Yemamah, parmi les
enfants d'Amrou'lkaïs ben Zeïd-Menat. Ayant commis un meurtre dans
sa tribu, il prit la fuite et alla chercher un asile à Hirah, auprès
d'Aous ben Kallam, l'un des descendants de Hareth
ben Kaab, avec lequel il était parent du côté des femmes. Aous
l'accueillit avec la plus grande distinction et le reçut dans sa
maison. Au bout de quelque temps il dit à Aïoub : « As-tu, mon
cousin, l'intention de te fixer auprès de moi, dans ma maison ? »
Aïoub déclara que tel était son désir. « En effet, ajouta-t-il, je
sais parfaitement que, si je retournais dans ma tribu étant coupable
d'un meurtre, je ne serais nullement en sûreté; et je n'ai plus
désormais d'autre asile que ta maison. » Aous répondit : « Je suis
avancé en âge ; peut-être ma mort n'est-elle point éloignée. Je
crains que mes enfants n'aient pas pour toi tous les égards que je
te témoigne, et qu'il n'arrive entre eux et toi quelque différend
qui leur fasse oublier les devoirs que leur imposent les liens du
sang,
 . Choisis dans la ville de Hirah
le local qui te conviendra le mieux, et indique-le-moi ; je te le
donnerai ou je l'achèterai pour toi. » Aïoub avait un ami qui
habitait dans le quartier oriental de Hirah, et Aous demeurait dans
la partie occidentale de cette ville. Aïoub ayant témoigné le désir
que la maison qui lui serait donnée fût près du lieu où se trouvait
Osam ben Okdah, l'un des descendants de Hareth ben Kaab, Aous lui
acheta, pour trois cents oukiah d'or, un terrain sur lequel
la maison devait être bâtie. Il dépensa cent oukiah pour les
constructions; ensuite il donna à son ami deux cents chameaux avec
leurs pasteurs, un cheval et une jeune esclave. Aïoub continua de
résider dans la maison d'Aous jusqu'à la mort de celui-ci ; après
quoi il se transporta vers la propriété qu'il possédait dans le
quartier oriental de Hirah, et ce fut là qu'il termina sa carrière.
Il s'était introduit auprès des rois qui gouvernaient successivement
Hirah, et qui le traitèrent, aussi bien que son fils Zeïd, avec une
distinction particulière. Aïoub conserva son crédit, et tous ces
princes, à l'envi l'un de l'autre, le comblèrent, ainsi que son
fils, de présents et de gratifications. »
. Choisis dans la ville de Hirah
le local qui te conviendra le mieux, et indique-le-moi ; je te le
donnerai ou je l'achèterai pour toi. » Aïoub avait un ami qui
habitait dans le quartier oriental de Hirah, et Aous demeurait dans
la partie occidentale de cette ville. Aïoub ayant témoigné le désir
que la maison qui lui serait donnée fût près du lieu où se trouvait
Osam ben Okdah, l'un des descendants de Hareth ben Kaab, Aous lui
acheta, pour trois cents oukiah d'or, un terrain sur lequel
la maison devait être bâtie. Il dépensa cent oukiah pour les
constructions; ensuite il donna à son ami deux cents chameaux avec
leurs pasteurs, un cheval et une jeune esclave. Aïoub continua de
résider dans la maison d'Aous jusqu'à la mort de celui-ci ; après
quoi il se transporta vers la propriété qu'il possédait dans le
quartier oriental de Hirah, et ce fut là qu'il termina sa carrière.
Il s'était introduit auprès des rois qui gouvernaient successivement
Hirah, et qui le traitèrent, aussi bien que son fils Zeïd, avec une
distinction particulière. Aïoub conserva son crédit, et tous ces
princes, à l'envi l'un de l'autre, le comblèrent, ainsi que son
fils, de présents et de gratifications. »
« Cependant Zeïd épousa
une femme qui appartenait à la famille de Kallam, et dont il eut un
fils appelé Hammar. Zeïd sortit un jour de Hirah, avec plusieurs
habitants de la ville, pour prendre le divertissement de la chasse.
Ils étaient campés dans le lieu nommé Djefir,
 ,
dont il est fait mention
dans les poésies d'Adi ben Zeïd. Zeïd, s'étant laissé emporter par
son ardeur à poursuivre le gibier, se trouvait éloigné de ses
compagnons, lorsqu'il fit rencontre d'un Arabe de la famille d'Amrou'lkaïs,
qui avait une vengeance à exercer sur le père de Zeïd. « Cet
inconnu, frappé de la ressemblance des traits de ce jeune homme avec
ceux d'Aïoub, s'approcha, et
lui demanda d'où il était originaire; il répondit: « De la tribu de
Temim. — De quelle famille, demanda l'Arabe. — De celle de Marek,
répondit Zeïd. » L'Arabe s'informa dans quel lieu il habitait, et
apprit qu'il résidait à Hirah. Enfin il lui demanda s'il n'était pas
un fils d'Aïoub. Zeïd répondit affirmativement; puis il ajouta: «
D'où connais-tu la famille d'Aïoub? » « Il commençait à concevoir
des inquiétudes et se rappela le meurtre qui avait causé la fuite de
son père. « L'Arabe répondit qu'il avait entendu parler des enfants
d'Aïoub. Du reste il ne laissa pas entrevoir à Zeïd qu'il l'eût
reconnu. Celui-ci, ayant demandé à l'Arabe de quelle tribu il était,
et ayant appris qu'il appartenait à celle de Taï, sentit dissiper
ses craintes et ne poussa pas plus loin ses questions. L'inconnu,
profitant de sa sécurité, lui décocha une flèche, qui pénétra entre
ses deux épaules et lui perça le cœur. Zeïd ne cessa de tenir le
sabot de sa monture jusqu'à ce qu'il expire.[46]
,
dont il est fait mention
dans les poésies d'Adi ben Zeïd. Zeïd, s'étant laissé emporter par
son ardeur à poursuivre le gibier, se trouvait éloigné de ses
compagnons, lorsqu'il fit rencontre d'un Arabe de la famille d'Amrou'lkaïs,
qui avait une vengeance à exercer sur le père de Zeïd. « Cet
inconnu, frappé de la ressemblance des traits de ce jeune homme avec
ceux d'Aïoub, s'approcha, et
lui demanda d'où il était originaire; il répondit: « De la tribu de
Temim. — De quelle famille, demanda l'Arabe. — De celle de Marek,
répondit Zeïd. » L'Arabe s'informa dans quel lieu il habitait, et
apprit qu'il résidait à Hirah. Enfin il lui demanda s'il n'était pas
un fils d'Aïoub. Zeïd répondit affirmativement; puis il ajouta: «
D'où connais-tu la famille d'Aïoub? » « Il commençait à concevoir
des inquiétudes et se rappela le meurtre qui avait causé la fuite de
son père. « L'Arabe répondit qu'il avait entendu parler des enfants
d'Aïoub. Du reste il ne laissa pas entrevoir à Zeïd qu'il l'eût
reconnu. Celui-ci, ayant demandé à l'Arabe de quelle tribu il était,
et ayant appris qu'il appartenait à celle de Taï, sentit dissiper
ses craintes et ne poussa pas plus loin ses questions. L'inconnu,
profitant de sa sécurité, lui décocha une flèche, qui pénétra entre
ses deux épaules et lui perça le cœur. Zeïd ne cessa de tenir le
sabot de sa monture jusqu'à ce qu'il expire.[46]
« Cependant les compagnons de Zeïd l'attendirent jusqu'au soir; et, ne le voyant pas revenir, ils se persuadèrent qu'il s'était laissé emporter à la poursuite du gibier Ils le cherchèrent toute la nuit et ris perdaient l'espoir de le rencontrer ; enfin, au point du jour, ayant continué leurs perquisitions, ils reconnurent ses traces et celles d'un cavalier qui faisait route à côté de lui. En suivant la direction que ces vestiges indiquaient, ils trouvèrent Zeïd étendu mort, et reconnurent qu'il avait été tué par le cavalier qui l'accompagnait. Ils se mirent à la poursuite de cet homme avec une telle ardeur, qu'ils l'atteignirent le soir du second jour. Averti par leurs cris, l'Arabe, qui était un archer extrêmement habile, se défendit à coups de flèches jusqu'à ce que la nuit fît cesser le combat. Un de ses adversaires avait reçu une flèche qui lui avait percé le bas de l'épaule, et il expira au commencement de la nuit. Le meurtrier parvint à s'échapper. Les chasseurs reprirent le chemin de Hirah, après avoir perdu Zeïd et un individu de la famille de Hareth ben Kaab.
« Hammar, fils de Zeïd,
resta auprès de ses oncles maternels, jusqu'à ce qu'il fût devenu
grand et qu'il fût au nombre des jeunes pages,
 . Un jour qu'il était
allé se promener avec quelques jeunes gens de la famille de Lihian,
un d'entre eux lui ayant donné un coup sur l'œil, Hammar lui fit une
blessure. Le père du Lihiani, sortant de chez lui, frappa violemment
Hammar. Celui-ci, fondant en larmes, alla trouver sa mère, qui lui
demanda le sujet de son chagrin. Il répondit : « Un tel m'a frappé,
parce que j'avais blessé son fils, dont j'avais reçu un soufflet. »
La mère, effrayée de cet accident, se transporta avec son fils à la
maison de Zeïd ben Aïoub. Là elle s'occupa de lui apprendre
l'écriture. Hammar fut, parmi les enfants d'Aïoub, le premier qui
sut écrire;[47]
et il devint extrêmement habile dans cet art. Il fut choisi pour
secrétaire du roi Noman le Grand,
. Un jour qu'il était
allé se promener avec quelques jeunes gens de la famille de Lihian,
un d'entre eux lui ayant donné un coup sur l'œil, Hammar lui fit une
blessure. Le père du Lihiani, sortant de chez lui, frappa violemment
Hammar. Celui-ci, fondant en larmes, alla trouver sa mère, qui lui
demanda le sujet de son chagrin. Il répondit : « Un tel m'a frappé,
parce que j'avais blessé son fils, dont j'avais reçu un soufflet. »
La mère, effrayée de cet accident, se transporta avec son fils à la
maison de Zeïd ben Aïoub. Là elle s'occupa de lui apprendre
l'écriture. Hammar fut, parmi les enfants d'Aïoub, le premier qui
sut écrire;[47]
et il devint extrêmement habile dans cet art. Il fut choisi pour
secrétaire du roi Noman le Grand,
 , et remplit longtemps ces
fonctions. Il épousa une femme de la tribu de Taï, dont il eut un
fils, auquel il donna le nom de Zeïd, qu'avait porté son père.
, et remplit longtemps ces
fonctions. Il épousa une femme de la tribu de Taï, dont il eut un
fils, auquel il donna le nom de Zeïd, qu'avait porté son père.
« Hammar avait pour ami un
des principaux dihkan,[48]
appelé Farruk-mahan,  , qui lui
témoignait une extrême bienveillance. Se voyant près de mourir, il
confia, par son testament, son fils Zeïd à ce dihkan, qui
était en même temps un des satrapes,
, qui lui
témoignait une extrême bienveillance. Se voyant près de mourir, il
confia, par son testament, son fils Zeïd à ce dihkan, qui
était en même temps un des satrapes,
 . Il prit le jeune homme chez
lui et le traita comme son fils. Zeïd était déjà habile dans l'art
de l'écriture et dans la connaissance de l’arabe. Le satrape lui
apprit la langue persane; et, charmé de l'esprit supérieur de ce
jeune homme, il conseilla au roi Kesra de le placer dans
l'administration de la poste. Ces emplois n'étaient jamais donnés
qu'aux fils de satrapes. Il y avait quelque temps que Zeïd
remplissait ces fonctions, lorsque, Noman Nasri Lakhmi étant venu à
mourir, et les habitants de Hirah se trouvant incertains sur celui à
qui ils devaient confier le gouvernement de leur ville en attendant
que Kesra leur donnât un souverain, le satrape leur désigna et leur
fit agréer Zeïd, fils de Hammar, qui prit en main l'administration
jusqu'au moment où le monarque persan éleva au trône de Hirah
Mondhar, fils de Mâ-aïsema.
. Il prit le jeune homme chez
lui et le traita comme son fils. Zeïd était déjà habile dans l'art
de l'écriture et dans la connaissance de l’arabe. Le satrape lui
apprit la langue persane; et, charmé de l'esprit supérieur de ce
jeune homme, il conseilla au roi Kesra de le placer dans
l'administration de la poste. Ces emplois n'étaient jamais donnés
qu'aux fils de satrapes. Il y avait quelque temps que Zeïd
remplissait ces fonctions, lorsque, Noman Nasri Lakhmi étant venu à
mourir, et les habitants de Hirah se trouvant incertains sur celui à
qui ils devaient confier le gouvernement de leur ville en attendant
que Kesra leur donnât un souverain, le satrape leur désigna et leur
fit agréer Zeïd, fils de Hammar, qui prit en main l'administration
jusqu'au moment où le monarque persan éleva au trône de Hirah
Mondhar, fils de Mâ-aïsema.
« Zeïd ben Hammar épousa
Namah, fille de Thalebah,  , de
la famille d'Adi,
, de
la famille d'Adi,  , et en eut un
fils, auquel il donna le nom d'Adi. Mondhar, pendant son règne, se
conduisait en tout point d'après les conseils de Zeïd. Cependant le
satrape eut un fils, qu'il nomma Schahan-mard,
, et en eut un
fils, auquel il donna le nom d'Adi. Mondhar, pendant son règne, se
conduisait en tout point d'après les conseils de Zeïd. Cependant le
satrape eut un fils, qu'il nomma Schahan-mard,
 . Adi, fils de Zeïd, ayant
grandi et étant arrivé à l'adolescence, son père le mit à l'école.
Dès qu'il fut suffisamment instruit, le satrape l'envoya, avec son
fils Schahan-mard, à l'école des Persans ; et il fit de tels progrès
dans la connaissance de l'écriture et de la langue persane, qu'il
devint en ce genre un des hommes les plus habiles. Il parlait
l'arabe avec une extrême élégance, et il s'adonna à la poésie; il
apprit aussi l'art de lancer des flèches, et prit rang parmi les
cavaliers, qui étaient en même temps archers; il s'exerça également
à ce jeu en usage chez les Persans, qui a lieu à cheval, avec des
raquettes; et acquit encore d'autres talents.
. Adi, fils de Zeïd, ayant
grandi et étant arrivé à l'adolescence, son père le mit à l'école.
Dès qu'il fut suffisamment instruit, le satrape l'envoya, avec son
fils Schahan-mard, à l'école des Persans ; et il fit de tels progrès
dans la connaissance de l'écriture et de la langue persane, qu'il
devint en ce genre un des hommes les plus habiles. Il parlait
l'arabe avec une extrême élégance, et il s'adonna à la poésie; il
apprit aussi l'art de lancer des flèches, et prit rang parmi les
cavaliers, qui étaient en même temps archers; il s'exerça également
à ce jeu en usage chez les Persans, qui a lieu à cheval, avec des
raquettes; et acquit encore d'autres talents.
« Bientôt après le satrape se rendit auprès du roi Kesra, emmenant avec lui son fils Schahan-mard. Un jour que tous deux étaient debout en présence du roi, deux oiseaux s'abattirent sur fa muraille et commencèrent à se béqueter, comme font, chez les oiseaux, un mâle et une femelle. A cette vue, le roi, transporté de colère et de jalousie, dit au satrape et à son fils : Que chacun de vous tire une 'flèche sur un de ces oiseaux. Si vous les tuez, je vous ferai conduire dans mon trésor, où on vous remplira la bouche de pierreries; mais, si l'un de vous manque son coup, il sera sévèrement puni. » Le père et le fils, visant chacun un des oiseaux, les percèrent à la fois. Le roi, conformément à sa promesse, donna ordre d'introduire dans le trésor le satrape avec son fils et de leur remplir la bouche de pierreries; de plus, il retint auprès de lui Schahan-mard et les autres enfants du satrape. Farrukh-mahan dit alors au prince : J'ai chez moi un jeune Arabe que son père, en mourant, m'a confié, et que j'ai fait élever : c'est, de tous les hommes que je connais, celui qui parle avec le plus d'élégance et qui écrit le mieux, tant en persan qu'en arabe. Il pourrait être d'une grande utilité au roi ; et si ce prince veut l'attacher à son service, en même temps que mes fils, il n'a qu'à parler. » Le roi lui ayant donné l’ordre de mander ce jeune homme, if lui fit dire de venir de suite. Adi était d'une beauté extraordinaire ; et les Perses s'applaudissaient de posséder cet avantage. Le roi, s'étant entretenu avec Zeïd, et ayant trouvé en lui le plus spirituel des hommes et celui qui avait la répartie la plus prompte, conçut de l'affection pour lui et le retint à son service avec les fils du satrape. Adi fut le premier qui, dans la chancellerie du roi de Perse, écrivit en langue arabe. Les habitants de Hirah, de leur côté, avaient pour lui autant de respect que d'attachement. Il séjournait à Madaïn, attaché à la chancellerie du roi, auprès duquel il avait ses entrées particulières, et qui était de plus en plus satisfait de sa société.
« Zeïd, père d'Adi, était encore vivant à cette époque ; mais la réputation du fils, croissant chaque jour, avait fini par obscurcir celle du père. Toutes les fois qu'Adi se présentait chez le roi Mondhar, toutes les personnes qui se trouvaient auprès du prince se levaient et restaient debout jusqu'au moment où Adi s'asseyait. Ces égards extraordinaires augmentèrent au plus haut point sa renommée. Lorsqu'il voulait passer quelque temps à Hirah, dans sa maison, auprès de son père et de sa famille, il en demandait la permission au roi de Perse; et, muni de cette autorisation, il y séjournait un mois, deux mois, plus ou moins.
« Cependant Kesra envoya Adi comme ambassadeur auprès de l'empereur de Constantinople, et le chargea, pour ce prince, d'un présent composé des objets les plus précieux. Adi étant arrivé à la cour du monarque grec, celui-ci le reçut avec beaucoup de distinction, fit mettre à sa disposition les chevaux de la poste, et l'adressa aux gouverneurs des diverses provinces, afin qu'il pût voir l'étendue et la puissance de l'empire; c'est ainsi qu'on en usait à l'égard des ambassadeurs. Ensuite il séjourna à Damas, et s'y livra à son goût pour la poésie. Les vers que nous allons citer, et qu'il publia en Syrie, furent, dit-on, les premiers qu'il ait composés.
« Combien de maisons situées au bas du ravin de Doumah me sont plus chères que Djiroun !
« Là sont des convives qui ne se réjouissent point de ce qu'ils ont acquis et ne redoutent point les catastrophes de la fortune.
« J'ai bu, dans la maison de Bescher, une liqueur amère mêlée avec de l’eau chaude.[49] »
« Les premiers vers qui suivirent ceux-ci furent les suivants :
« A qui appartenait cette habitation, dont les vestiges sont effacés, qui se composait de tentes, et que la longueur du temps a fait disparaître?
« L'œil n'y voit plus d'autre reste qu'un fossé semblable à une ligne que trace la plume.[50]
« Saleh les a réunies en un seul corps, ainsi qu'un épervier réunit les pigeons sur un arbre épineux.[51] » Tandis qu'Adi séjournait à Damas, des troubles agitèrent la ville de Hirah ; et de fut Zeïd, père d'Adi, qui y rétablit l'ordre. Mondhar, qui régnait dans cette ville, ne suivant pas dans sa conduite les règles de l’équité, et enlevant à son gré les biens de ses sujets, ceux-ci résolurent de le massacrer. Le prince, averti du complot, envoya un message à Zeïd ben Hammar, qui avait eu avant lui le gouvernement de Hirah, et lui fit dire : Tu as été jadis le représentant de mon père; aujourd'hui je sais quel dessein ont tramé contre moi les habitants de la ville. Je n'ai nui besoin de la royauté : reprenez-la, et donnez-vous pour maître qui vous voudrez. » Zeïd répondit : « La chose ne dépend pas de moi ; mais j'aurai soin de prendre des informations exactes, et je ne manquerai pas de donner au roi des conseils dictés par la sincérité. » De grand matin les habitants se présentèrent chez Zeïd, le saluèrent par la formule usitée à regard des rois, et lui dirent: Envoyez des émissaires vers votre serviteur (c'est ainsi qu'ils désignaient Mondhar), et délivrez de lui vos sujets. » Zeïd leur demanda s'il n'y avait pas un parti meilleur à prendre. Ils répondirent qu'il n'avait qu'à ouvrir un avis. Hé bien, dit Zeïd, laissez ce prince dans le rang qu'il occupe ; car il est de race royale. J'irai le trouver et je l'informerai que les habitants de Hirah ont fait choix d'un homme qui administrera les affaires, excepté en cas de guerre et de conquête. De cette manière, ajouterai-je, vous ne conserverez que le nom de roi, et n'aurez aucune part au gouvernement. » Ce conseil ayant été universellement approuvé, Zeïd se rendit auprès de Mondhar, et lui communiqua les propositions susdites, que le prince accueillit avec joie. Zeïd, lui dit-il, tu m'as rendu un service que je n'oublierai jamais tant que je conserverai le respect que je dois à Sabad » (c'était le nom d'une idole adorée à Hirah). Les habitants de cette ville remirent à Zeïd toute l'autorité, à l’exception du titre de roi, qu'ils laissèrent à Mondhar. C'est à cette occasion qu'Adi fit ce vers :
« Vous le savez, nous avons été avant vous les colonnes de la maison, les piliers auxquels étaient attachées les cordes de la tente. »
« Zeïd vint à mourir tandis que son fils Adi résidait encore en Syrie. Il possédait mille femelles de chameaux, destinées à acquitter les compositions fixées pour le rachat des meurtres, et qui lui avaient été données par les habitants de Hirah au moment où ils le choisirent pour leur chef. Dès qu'ils le virent mort, ils voulurent reprendre ces animaux ; mais Mondhar, en étant informé, protesta contre cette résolution en disant : J'en jure par Lat et Ozza, tant que je serai vivant,[52] on n'enlèvera pas le moindre objet[53] de tout ce qui appartient à Zeïd. » C'est à cette occasion qu'Adi a dit, en s'adressant à Noman ben Mondhar :
Votre père, cet homme généreux, ne nous a point donné des témoignages de haine,
Le jour où l'on voulait nous ruiner par des rapines odieuses.
Bientôt après Adi se rendit à Madaïn, auprès du roi Kesra, et lui
remit un présent de la part de l’empereur des Grecs. A cette époque,
son père était mort, ainsi que le satrape qui l'avait élevé. Il
demanda au roi la permission de faire un voyage à Hirah. L'ayant
obtenue, il prit la route de cette ville. Mondhar, informé de son
approche, vint à sa rencontre, à la tête des habitants, jusqu'au
lieu nommé Astenia,  , et
rentra avec lui dans la capitale. Adi possédait au plus haut point
l'estime de la population de Hirah; et, s'il avait aspiré au trône,
rien ne lui était plus facile que d'y parvenir; mais il préférait à
la royauté les plaisirs du jeu et de la chasse. Il passa ainsi deux
années, consacrant deux saisons à ses excursions dans le désert,
séjournant à Djefir, et passant l'hiver à Hirah. Dans l'intervalle
il se rendait à Madaïn pour remplir auprès de Kesra les fonctions de
sa charge. Plusieurs années s'écoulèrent ainsi. Adi préférait à tous
les campements des Arabes le district habité par les Bènou-Iarbou;
et c'était la seule tribu, parmi celles qui descendaient de Temim,
chez laquelle il aimât à séjourner. De tous les Arabes, ceux qu'il
affectionnait le plus étaient les Bènou-Djafar. Ses chameaux
paissaient sur le territoire occupé par les Bènou-Dabbah,
, et
rentra avec lui dans la capitale. Adi possédait au plus haut point
l'estime de la population de Hirah; et, s'il avait aspiré au trône,
rien ne lui était plus facile que d'y parvenir; mais il préférait à
la royauté les plaisirs du jeu et de la chasse. Il passa ainsi deux
années, consacrant deux saisons à ses excursions dans le désert,
séjournant à Djefir, et passant l'hiver à Hirah. Dans l'intervalle
il se rendait à Madaïn pour remplir auprès de Kesra les fonctions de
sa charge. Plusieurs années s'écoulèrent ainsi. Adi préférait à tous
les campements des Arabes le district habité par les Bènou-Iarbou;
et c'était la seule tribu, parmi celles qui descendaient de Temim,
chez laquelle il aimât à séjourner. De tous les Arabes, ceux qu'il
affectionnait le plus étaient les Bènou-Djafar. Ses chameaux
paissaient sur le territoire occupé par les Bènou-Dabbah,
 et
les Bènou-Saad. Il suivait en cela
l'exemple de son père, qui avait toute sa vie confié ses chameaux à
ces deux tribus exclusivement. Cependant Adi épousa Hind, fille de
Noman ben Mondhar, qui était, à cette époque, arrivée, ou peu s'en
faut, à l'âge nubile. Je rapporterai ci-après l’histoire de ce
mariage.
et
les Bènou-Saad. Il suivait en cela
l'exemple de son père, qui avait toute sa vie confié ses chameaux à
ces deux tribus exclusivement. Cependant Adi épousa Hind, fille de
Noman ben Mondhar, qui était, à cette époque, arrivée, ou peu s'en
faut, à l'âge nubile. Je rapporterai ci-après l’histoire de ce
mariage.
« Suivant une tradition, Adi ben Zeïd avait deux frères, dont l'un portait le nom d'Ammar et le surnom d'Obaï; l'autre, le nom d'Amrou et le surnom de Somaï. Ils avaient un frère utérin appelé Adi, fils de Handalah, de la tribu de Taï. Obaï résidait auprès du roi Kesra. Toute cette famille professait la religion chrétienne. Tous ces frères vivaient auprès des monarques persans, qui leur donnaient un traitement fixe, des propriétés territoriales, et les comblaient de riches présents.
« Mondhar, au moment où il
monta sur le trône, avait confié son fils Noman à la tutelle d'Adi
ben Zeïd,[54]
qui, aidé de ses frères, surveilla la nourriture et l'éducation du
jeune prince. Mondhar avait un autre fils nommé Aswad, qui avait eu
pour mère Mariah, fille de Hareth ben Djelhem. Cet enfant fut
nourri, et élevé par les Bènou-Marina, qui formaient une des
familles les plus distinguées de la ville de Hirah,
et qui prétendaient appartenir à la tribu de Lakhm. Outre ces deux
fils, Mondhar en avait dix autres, que l'on désignait par le surnom
d'Aschahib,
 (les blancs),[55]
à cause de leur extrême beauté. C'est en parlant d'eux que le poète
Ascha ben Kaïs a dit : « Les
blancs enfants de Mondhar marchent le matin, dans la ville de Hirah,
droits connue des épées. »
(les blancs),[55]
à cause de leur extrême beauté. C'est en parlant d'eux que le poète
Ascha ben Kaïs a dit : « Les
blancs enfants de Mondhar marchent le matin, dans la ville de Hirah,
droits connue des épées. »
« Noman, au contraire, était rouge de visage, avait la peau couverte de taches de lèpre et était de petite taille. Il avait eu pour mère Selma, fille de Waïl, fils d'Atiah-Salig, de la tribu de Fedek. Mondhar, se voyant près de mourir, laissant dix, ou, suivant d'autres, treize fils, les confia, par son testament, aux soins d'Aïas ben Kabisah, de la tribu de Taï, auquel il remit le gouvernement de Hirah, en attendant la décision de Kesra. Ai'as remplit ces fonctions l'espace de plusieurs mois. Cependant le roi de Perse, Kesra, fils de Hormuz, cherchait un homme capable de régner à Hirah, et ne trouvait personne qui pût fixer son choix. Ennuyé de ces efforts inutiles, il dit un jour : J'enverrai à Hirah douze mille de mes cavaliers, auxquels je donnerai un Persan pour chef. Je les autoriserai à s'établir dans les maisons des Arabes et à disposer de leurs biens et de leurs femmes. »
Adi ben Zeïd se trouvait en ce moment de service auprès du roi ; ce prince, se tournant de son côté, lui demanda s'il restait encore des enfants de la famille de Mondhar, et s'ils possédaient quelques qualités estimables. O monarque heureux! répondit Adi, la famille de Mondhar compte encore plusieurs membres pleins de mérite. » Le roi lui ayant donné l'ordre de mander ces princes, Adi les fit venir et les logea tous dans sa maison. »
Suivant une autre narration, Adi, s'étant rendu à Hirah, s'aboucha avec les fils de Mondhar et leur donna les avis qu'il voulait leur faire adopter; après quoi il les présenta au roi de Perse.
[23] Dagfal ben Haudalah-Sedousi est célèbre chez les Arabes comme ayant possédé au plus haut point la science des généalogies. On peut voir, sur ce personnage, Ibn Kotaïbah (ap. Eichhorn, Monumenta antiquissimœ historiae Arabum, page 44); Meïdani (Proverb. 37, 40, 5479); Abou'lala (Commentaire sur ses poésies, man. de Scheidins 17, page 366); Tebrizi (Commentaire sur le Hamasah, page 124) ; Ibn Khallikan (man. ar. 730, fol. 233 r.).
[24] On peut voir, sur cette femme, Tebrizi, dans son Commentaire sur le Hamasah (p. 193, 194).
[25] Cette généalogie a été exposée avec beaucoup de détails par divers historiens arabes, entre autres par Ibn Kotaïbah, l'auteur du Sirat-alresoul (man. arabe 629, foi. 14 et suiv.); Aboulféda (ap. Specimen historiœ Arabum, éd. White, p. 486 et suiv.), etc. On peut voir aussi les observations savantes que M. Silvestre de Sacy a publiées dans le tome xlviii des Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
[26] Ibn Kotaïbah (Monum. antiq. historien Arabum, page 86.)
[27] Le
texte porte  . Le verbe
. Le verbe
 signifie attacher
les pieds d'un chameau ou
d'un autre animal. C'est ainsi que nous
lisons dans un passage de l'histoire de Nowaïri (man. arabe
645, fol. 23 v.) :
signifie attacher
les pieds d'un chameau ou
d'un autre animal. C'est ainsi que nous
lisons dans un passage de l'histoire de Nowaïri (man. arabe
645, fol. 23 v.) :  .
« Il l'attacha par le pied. » Il est probable que les
enfants d'Ommaïah s'étaient attachés de cette manière afin
de se mettre dans l'impossibilité de fuir. C'est ainsi que,
suivant le témoignage de l'auteur du Kitab-alagâni (tome IV,
fol. 224 v.), le poète Farazdaq se garrotta lui-même et jura
de ne pas se délier jusqu'à ce qu'il eût appris tout
l'Alcoran.
.
« Il l'attacha par le pied. » Il est probable que les
enfants d'Ommaïah s'étaient attachés de cette manière afin
de se mettre dans l'impossibilité de fuir. C'est ainsi que,
suivant le témoignage de l'auteur du Kitab-alagâni (tome IV,
fol. 224 v.), le poète Farazdaq se garrotta lui-même et jura
de ne pas se délier jusqu'à ce qu'il eût appris tout
l'Alcoran.
[28] On peut voir, sur les combats livrés à la foire d'Okad, le récit de Nowaïri (op. Histor. prœcipuorum arabum Regnorum, page 73 et suiv.).
[29] Le
texte porte  . Au rapport
de l'auteur du Kamous (tome I, page 386, éd. de
Calcutta), ce mot signifie, entre autres choses, avili
. Au rapport
de l'auteur du Kamous (tome I, page 386, éd. de
Calcutta), ce mot signifie, entre autres choses, avili
 , anobli,
, anobli,
 , un étalon
en rut,
, un étalon
en rut, 
 ,
et un chameau enduit de poix.
Il est difficile d'admettre qu'un même mot ait eu réellement
des sens aussi opposés. On peut croire que ces
significations si différentes ont dû leur naissance aux
conjectures des grammairiens, qui, rencontrant ce mot dans
des poésies anciennes, auront cherché à l'expliquer, chacun
suivant son opinion particulière.
,
et un chameau enduit de poix.
Il est difficile d'admettre qu'un même mot ait eu réellement
des sens aussi opposés. On peut croire que ces
significations si différentes ont dû leur naissance aux
conjectures des grammairiens, qui, rencontrant ce mot dans
des poésies anciennes, auront cherché à l'expliquer, chacun
suivant son opinion particulière.
[30]
Les deux manuscrits du Kitab-alagâni offrent ici deux leçons
différentes. Dans l'une on lit :
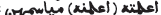 , et c'est celle dont
j'ai exprimé le sens, c'est-à-dire que ces
femelles se sont souvent livrées
à lui. L'autre exemplaire porte
, et c'est celle dont
j'ai exprimé le sens, c'est-à-dire que ces
femelles se sont souvent livrées
à lui. L'autre exemplaire porte
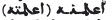
 ,
à qui elles ont fait
connaître le sabot de leur
pied, c'est-à-dire dont elles ont plus d'une fois
repoussé à coups de pied les tentatives amoureuses. Puisque
j'ai parlé du mot
,
à qui elles ont fait
connaître le sabot de leur
pied, c'est-à-dire dont elles ont plus d'une fois
repoussé à coups de pied les tentatives amoureuses. Puisque
j'ai parlé du mot  , on
me permettra de citer un vers bizarre que Soïouti rapporte
en deux endroits de son Commentaire sur le Mogni
(man. ar. 1238, fol. 74 r., 75 r.). Un poète a dit :
, on
me permettra de citer un vers bizarre que Soïouti rapporte
en deux endroits de son Commentaire sur le Mogni
(man. ar. 1238, fol. 74 r., 75 r.). Un poète a dit :

Le scoliaste fait à ce sujet les observations suivantes : Le
mot  , feu,
désigne
, feu,
désigne  , le feu qui
sert à marquer les troupeaux. Suivant la pensée du poète,
lorsque les chameaux des hommes dont il parle vont à
l'abreuvoir, tout le monde, en voyant les marques imprimées
sur ces animaux, reconnaissant à quels maîtres ils
appartiennent, leur abandonne la place et les laisse boire
tranquillement, par respect pour les propriétaires. » Le
même écrivain dit dans un de ces passages (fol. 74 r.) :
, le feu qui
sert à marquer les troupeaux. Suivant la pensée du poète,
lorsque les chameaux des hommes dont il parle vont à
l'abreuvoir, tout le monde, en voyant les marques imprimées
sur ces animaux, reconnaissant à quels maîtres ils
appartiennent, leur abandonne la place et les laisse boire
tranquillement, par respect pour les propriétaires. » Le
même écrivain dit dans un de ces passages (fol. 74 r.) :

 « Ils
connaissent la marque de chacune des tribus et l'excellence
de leurs chameaux. »
« Ils
connaissent la marque de chacune des tribus et l'excellence
de leurs chameaux. »
[31] Sur. iv, 26.
[32] Amrou ben Nafil épousa également Djida, sa belle-mère (Agâni, tome I, fol. 164 r.).
[33] On serait sans doute surpris de cet acte de cruauté froide auquel Mahomet se livra dans cette circonstance, si les historiens n'avaient pris soin de nous faire connaître les motifs qui avaient excité dans le cœur du prétendu prophète une haine implacable contre Nadr ben Hareth. Ce dernier, qui était bien supérieur à ses compatriotes, sous le rapport de l'esprit et des connaissances, avait voyagé hors de son pays, étudié les langues étrangères, lu avec soin les monuments littéraires et historiques des Perses et des Grecs, et apporté ces ouvrages à la Mecque, où il avait introduit le goût de la musique. Se trouvant dans cette ville à l'époque où Mahomet se glorifiait d'avoir reçu la mission divine, Nadr se déclara contre lui, et lui fit, par ses discours bien plus que par son épée, une guerre cruelle. Fier de son érudition, il relevait avec aigreur l'ignorance du prophète, tournait en ridicule les contradictions et les erreurs dont fourmille l'Alcoran, et empêchait ainsi la population arabe, dont il était l'oracle, d'accueillir les lois et les dogmes que Mahomet prétendait imposer à ces hommes simples et crédules. Aussi, dès que le sort des armes eut fait tomber Nadr dans les mains de son rival, celui-ci, abusant de la victoire, saisit avec empressement l'occasion de se délivrer d'un ennemi incommode. On peut voir, sur ce qui concerne Nadr, le Sirat-alresoul (man. ar. 629, fol. 56, etc.); Tebrizi, Commentaire sur le Hamasah, page 437 ; Zamakhschari, Kaschschaf, tome II, fol. 46 r.; Soïouti, Anthologie arabe, man. ar. 1568, fol. 235 r. et v.; Halbat-alkoumaït, man. ar. 1566, fol. 94 r.
[34] On
lit ici Athil,  ;
mais j'ai préféré la leçon
;
mais j'ai préféré la leçon
 , que donnent le
Hamasah et le Marasid-alitla, page 14.
, que donnent le
Hamasah et le Marasid-alitla, page 14.
[35] Quelques écrivains donnent à cette femme le nom de Leïla. Suivant un autre récit, elle était fille de Nadr. Ces vers ont été également transcrits dans le Sirat-alresoul (la Vie de Mahomet), man. ar. 629, fol. 140 v. 141 r.; dans le Hamasah (p. 437, édition Freytag); dans l'Anthologie arabe de Soïouti (man..ar. 1568, fol. 235 r. et ».); et dans le commentaire du même écrivain sur le Mogni (man. ar. 1238, fol. 140 v.).
[36] Le
mot  , au pluriel
, au pluriel
 désigne un lien
de parenté ou d'amitié. (Voy. le
Hamasah, p. 633). On lit dans le Kamel d'Ibn
Athir (tome I, fol. 13 r.):
désigne un lien
de parenté ou d'amitié. (Voy. le
Hamasah, p. 633). On lit dans le Kamel d'Ibn
Athir (tome I, fol. 13 r.):
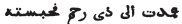 . « Je pris un parent et
le mis en prison.» De là vient l'expression
. « Je pris un parent et
le mis en prison.» De là vient l'expression
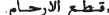 il a
rompu les liens de l'amitié.
On lit dans le Moroudj de Massoudi (tome I, fol. 220
r.) :
il a
rompu les liens de l'amitié.
On lit dans le Moroudj de Massoudi (tome I, fol. 220
r.) : 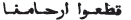
 .
Et le verbe
.
Et le verbe  dont le nom
d'action est
dont le nom
d'action est  ,
signifie former les nœuds de
l'amitié, ou observer les lois
qu'elle prescrit. On lit dans le Sahih
de Bokhari (tome I, man. ar. 242, fol. 176 r.) :
,
signifie former les nœuds de
l'amitié, ou observer les lois
qu'elle prescrit. On lit dans le Sahih
de Bokhari (tome I, man. ar. 242, fol. 176 r.) :
 . « Tu payeras la dîme
et observeras les lois de l'amitié. » Dans le Moroudj
de Massoudi (tome I, fol. 217 r.),
. « Tu payeras la dîme
et observeras les lois de l'amitié. » Dans le Moroudj
de Massoudi (tome I, fol. 217 r.),
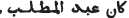
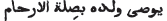 « Abd-almotaleb
recommandait à son fils d'observer les règles de l'amitié. »
Dans les Annales de Tabari (Taberistanensis
Annales, tome I, page 18) :
« Abd-almotaleb
recommandait à son fils d'observer les règles de l'amitié. »
Dans les Annales de Tabari (Taberistanensis
Annales, tome I, page 18) :
 .
.
Dans le roman d'Antar (tome III, fol. 263
D.) :
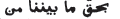
 .
« Au nom des nœuds d'amitié qui existent entre nous. » Dans
une histoire de Médine (de mon manuscrit, fol. 30 c.):
.
« Au nom des nœuds d'amitié qui existent entre nous. » Dans
une histoire de Médine (de mon manuscrit, fol. 30 c.):
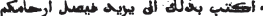 . « J'écrirai sur cet
objet à Iézid, et il vous traitera en amis.» Dans un vers du
poète Aschâ (Soïouti, Commentaire sur le
Mogni, fol. 58 v.):
. « J'écrirai sur cet
objet à Iézid, et il vous traitera en amis.» Dans un vers du
poète Aschâ (Soïouti, Commentaire sur le
Mogni, fol. 58 v.):

« Il ne rompt point les nœuds de l'amitié et ne trompe jamais une famille. »
Dans l'ouvrage persan intitulé
Matla-alsaadeïn (man. persan de l'Arsenal 24, fol. 81
r.) :  . « Afin observer
les lois de l'amitié. » On lit dans le Commentaire
sur le Mogni (man. ar. 1238, fol. 76 v.) :
« Je te conjure au nom de Dieu et de l'amitié. »
. « Afin observer
les lois de l'amitié. » On lit dans le Commentaire
sur le Mogni (man. ar. 1238, fol. 76 v.) :
« Je te conjure au nom de Dieu et de l'amitié. »
[37] Le texte porte :
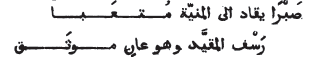
Le verbe  se trouve avec
le même sens dans un vers du recueil des poètes de la tribu
de Hudheïl (man. ar. de Ducaurroy 53, fol. 35):
se trouve avec
le même sens dans un vers du recueil des poètes de la tribu
de Hudheïl (man. ar. de Ducaurroy 53, fol. 35):
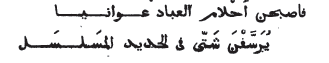
« On a vu les amantes des hommes, captives, dispersées, se traîner péniblement sous le poids des chaînes. »
Et le commentateur Sukkari fait cette remarque :

 .
Le mot
.
Le mot  exprime la
marche d'un homme enchaîné. » Quant au mot
exprime la
marche d'un homme enchaîné. » Quant au mot
 , employé dans le sens
de captif, il se retrouve encore dans d'autres
passages. On lit dans l'ouvrage d'Imad-eddin-Isfahani (man.
ar. 714, fol. 86 r.):
, employé dans le sens
de captif, il se retrouve encore dans d'autres
passages. On lit dans l'ouvrage d'Imad-eddin-Isfahani (man.
ar. 714, fol. 86 r.): 
 .
« Elle se soumit et s'humilia, afin d'obtenir la délivrance
de son prisonnier. » Dans le commentaire de Soïouti sur le
Mogni (man. ar. 1238, fol. 52 r.),
.
« Elle se soumit et s'humilia, afin d'obtenir la délivrance
de son prisonnier. » Dans le commentaire de Soïouti sur le
Mogni (man. ar. 1238, fol. 52 r.),
 ; et dans un vers cité
par le même auteur (fol. 67 r.) :
; et dans un vers cité
par le même auteur (fol. 67 r.) :
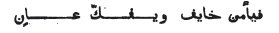
« Un homme alarmé reprendra sa sécurité. Un captif sera délivré. » Dans des vers du poète Amrou'lkaïs, cités par Soïouti (Ib. fol. 89 r.)

« Combien de captifs que j'ai délivrés de leurs chaînes m'ont protesté de leur dévouement pour moi ! »
[38] Ceci rappelle le vers de Virgile : « Ignoscenda quidem, scirent si ignoscere manes. »
[39]
Cette expression se trouve déjà dans l'Alcoran, où on lit
(sur. lxxiii,
v. 17) :  « Un jour qui
blanchira les cheveux des enfants. » Elle se rencontre
fréquemment chez les poètes et les prosateurs arabes. On lit
dans un vers de Motanebbi (de mon manuscrit, page 108) :
« Un jour qui
blanchira les cheveux des enfants. » Elle se rencontre
fréquemment chez les poètes et les prosateurs arabes. On lit
dans un vers de Motanebbi (de mon manuscrit, page 108) :
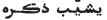
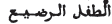 « Son
seul nom fera blanchir l'enfant à la mamelle. » Dans les
poésies d'Omar ben Fared (man. arabe 1479, fol. 12 v.):
« Son
seul nom fera blanchir l'enfant à la mamelle. » Dans les
poésies d'Omar ben Fared (man. arabe 1479, fol. 12 v.):
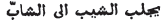 . Il amènera la
blancheur sur la tête du jeune homme.» Dans le Hamasah,
(page 593) :
. Il amènera la
blancheur sur la tête du jeune homme.» Dans le Hamasah,
(page 593) :  . Les jours
de la séparation ont blanchi ma tête.» Un vers cité par
l'auteur du Kitab-alraoudataïn (min. ar, 707 A, fol.
75 v.) est conçu en ces termes :
. Les jours
de la séparation ont blanchi ma tête.» Un vers cité par
l'auteur du Kitab-alraoudataïn (min. ar, 707 A, fol.
75 v.) est conçu en ces termes :
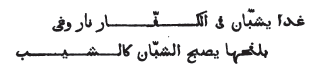
Demain ils allumeront, pour les infidèles, le feu de combat, dont la flamme rendra la tête des jeunes gens aussi blanche que celle des vieillards. »
Dans le Moroudj de Massoudi (tome I, fol. 422 v.) :
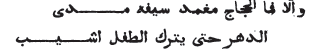
« Sinon Hadjadj ne remettra point son épée dans le fourreau jusqu'à ce qu'il laisse l'enfant aussi blanc qu'un vieillard. »
Un vers cité dans l’Histoire de Kaïrowan (man. arabe n° 752, fol. 105 r.) est ainsi conçu :
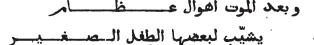
« La mort est suivie de terreurs affreuses, dont une partie suffirait pour blanchir les cheveux d'un enfant en bas âge.»
Dans le Kamel d'Ibn
Alathyr (tome III, fol. 17 v.):

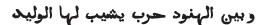
« Il se livra, entre lui et les Indiens, un combat qui ferait blanchir d'effroi un jeune homme. » Ailleurs (tome V, page 232), on lit ce vers :
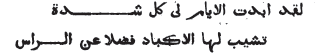
« Les destins ont amené sur moi tous les genres de malheurs qui feraient blanchir le foie, à plus forte raison la tête. »
Dans le roman d'Antar (manuscrit, tome IV, fol. 11 v.), on lit ce vers :
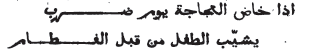
« Lorsqu'il s'enfonce au milieu de nuages de poussière, dans un jour de combat qui ferait blanchir l'enfant avant qu'il soit sevré. »
[40] Taki-eddin-Fâsi (Histoire de la Mecque, manuscrit arabe 721, fol. 9 r.).
[41] Taki-eddin-Fâsi
(Histoire de la Mecque, man. ar.
721, fol. 9 v.) explique ainsi ce mot : C'est-à-dire des
pièces d'argent de Perse, dont chacune pesait un mithkal
d'or. » Plus loin (ib.) il dit : Les dirhems wafis
sont les mêmes que les baglis,
 .
.
[42] Vie d'Adi ben Zeïd, tome I, fol. 84 r. et suiv.
[43] Le nom d'Adi ben Zeïd est célèbre à juste titre parmi ceux des poètes arabes qui ont fleuri antérieurement à la naissance de l'islamisme ; aussi les écrivains orientaux ont souvent parlé de lui et se sont plu à citer ou des vers extraits de ses ouvrages, on des anecdotes relatives à sa vie; mais tous ces historiens, ceux du moins qui ont vécu depuis le ive siècle de l'hégire, n'ont fait que copier textuellement ou abréger le récit de notre auteur. Tel est, entre autres, Nowaïri, qui, dans l'Histoire des rois de Hirah (ms. ar. 700, fol. 7 et suiv.), a reproduit la narration du Kitab-alagâni, sans rien changer aux faits ni aux expressions. On peut voir aussi Massoudi (Moroudj, tome I, fol. 205 v., 206); Ibn Kotaïbah (ap. Eichhorn, Monumenta antiquissimœ historiae Arabum, page 196 et suiv.) ; Zamakhschari (Kaschschaf, tome I, fol. 249 v.); Soïouti (Commentaire sur le Mogni, man. ar. 1238, fol. 107 v.); l'auteur du Commentaire sur le poème d'Ibn Abdoun (man. ar. 1487, fol. 51 et suiv.). Abou'lala, dans un de ses vers, fait allusion a Adi ben Zeïd (voy. man. de E. Scheidius 17, page 424). Le commencement du morceau que je publie a été donné par M. le baron Silvestre de Sacy dans son Mémoire sur les anciens monuments de la littérature parmi les Arabes (Académie des inscriptions et belles-lettres, tome L, pages 437-440).
[44] Puisque le nom d'Aïoub ne fut connu chez les Arabes que dans le VIe siècle de notre ère, on peut supposer, avec quelque vraisemblance, que ce nom dut son origine à l'introduction du christianisme, qui, en s'établissant dans les provinces de l'Arabie, y propagea la réputation des personnages dont l'Ancien et le Nouveau Testament ont consacré les vertus, et parmi lesquels Job devait nécessairement tenir un rang distingué.
[45] Le
mot fahl,  , qui
signifie proprement un étalon, désignait, chez
les Arabes, un poète du talent
le plus distingué. De là viennent les
expressions
, qui
signifie proprement un étalon, désignait, chez
les Arabes, un poète du talent
le plus distingué. De là viennent les
expressions  , c'était
un poète du premier rang
; (Agani, t. II, fol. 32 v.);
, c'était
un poète du premier rang
; (Agani, t. II, fol. 32 v.);
 , il n'était
pas au nombre des plus
grands poètes (ib., tome III, fol. 204 v.
et passim);
, il n'était
pas au nombre des plus
grands poètes (ib., tome III, fol. 204 v.
et passim);  (Aboul
mahasen, Histoire d'Egypte, man. ar. 663, fol.
147 r.). Soïouti (Commentaire sur le
Mogni, man. ar. 1238, fol. 20 v.) dit, en parlant du
poète Nabegah :
(Aboul
mahasen, Histoire d'Egypte, man. ar. 663, fol.
147 r.). Soïouti (Commentaire sur le
Mogni, man. ar. 1238, fol. 20 v.) dit, en parlant du
poète Nabegah :  .
Plus
bas (fol.
30 v), on lit
.
Plus
bas (fol.
30 v), on lit
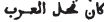 . Au
rapport du même écrivain (ib. fol. 6 r.), chez les Arabes,
les poètes étaient partagés en quatre classes. Au premier
rang était le fahl-khindkidh,
. Au
rapport du même écrivain (ib. fol. 6 r.), chez les Arabes,
les poètes étaient partagés en quatre classes. Au premier
rang était le fahl-khindkidh,
 , c'est-à-dire le poète
le plus parfait; ensuite venait le khindhidh-schaïr-mouftik,
, c'est-à-dire le poète
le plus parfait; ensuite venait le khindhidh-schaïr-mouftik,
 , c'est-à-dire le poète
distingué aussi par un mérite éminent; puis le schaïr,
, c'est-à-dire le poète
distingué aussi par un mérite éminent; puis le schaïr,
 , et enfin le sckaour,
, et enfin le sckaour,
 . Si l'on en croit cet
historien, ou plutôt l’écrivain dont il cite le témoignage (ib.,
fol. 59 r.), les Arabes ne donnaient point à un poète le
titre de fahl,
. Si l'on en croit cet
historien, ou plutôt l’écrivain dont il cite le témoignage (ib.,
fol. 59 r.), les Arabes ne donnaient point à un poète le
titre de fahl,  ,
à moins qu'il n'eût mis dans ses vers quelque sentence
philosophique;
,
à moins qu'il n'eût mis dans ses vers quelque sentence
philosophique; 
 . Plus bas (fol. 64 r.),
on lit :
. Plus bas (fol. 64 r.),
on lit : 
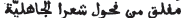 « Un poète excellent,
l'on des plus grands poètes du temps du paganisme. »
« Un poète excellent,
l'on des plus grands poètes du temps du paganisme. »
[46] Le
texte porte 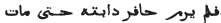 . Je lis
. Je lis
 . Le verbe
. Le verbe
 signifie cesser,
quitter. On lit dans l’Histoire de
la conquête de Jérusalem, écrite
par Imad eddin Isfahani (man. ar. 714, fol. 80 r.) :
signifie cesser,
quitter. On lit dans l’Histoire de
la conquête de Jérusalem, écrite
par Imad eddin Isfahani (man. ar. 714, fol. 80 r.) :
 « Ils ne quittèrent pas
leur champ de bataille. » Et ailleurs (fol. 89 «.) :
« Ils ne quittèrent pas
leur champ de bataille. » Et ailleurs (fol. 89 «.) :
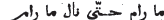 « Il ne quitta pas
jusqu'à ce qu'il eût obtenu ce qu'il désirait. » On serait
tenté de croire que, dans ce passage, il faut lire
« Il ne quitta pas
jusqu'à ce qu'il eût obtenu ce qu'il désirait. » On serait
tenté de croire que, dans ce passage, il faut lire
 , et traduire « Zeïd ne
quitta point le dos de sa monture jusqu'au moment où il
expira. » Si l'on admet la leçon que présente le texte qui
est sous nos yeux, on peut supposer que Zeïd, renversé de sa
monture par suite de la blessure qu'il avait reçue, saisit
le sabot de l'animal et le tint fortement serré jusqu'au
moment où il rendit le dernier soupir.
, et traduire « Zeïd ne
quitta point le dos de sa monture jusqu'au moment où il
expira. » Si l'on admet la leçon que présente le texte qui
est sous nos yeux, on peut supposer que Zeïd, renversé de sa
monture par suite de la blessure qu'il avait reçue, saisit
le sabot de l'animal et le tint fortement serré jusqu'au
moment où il rendit le dernier soupir.
[47] Soïouti atteste le même fait (man. ar. 1238, fol. 107 v.).
[48]
Le mot Dihkan,
 , qui est d'origine
persane, s'écrivait primitivement Dihgan,
, qui est d'origine
persane, s'écrivait primitivement Dihgan,
 . Il tirait son origine
du mot
. Il tirait son origine
du mot  , qui désigne un
bourg. Ce sont les Arabes qui ont changé le
, qui désigne un
bourg. Ce sont les Arabes qui ont changé le
 en
en
 ; et les Persans, en
reprenant ce terme, lui ont conservé la forme que lui
avaient donnée leurs voisins. Cette expression paraît avoir
existé de temps immémorial dans les contrées de la Perse et
de la Chaldée; car nous lisons dans l'histoire de Polybe (Historia,
lib. V, cap. liv,
tome II, page 329) que, dans la ville de Séleucie, il
existait des hommes appelés Adeiganes,
'Αδειγάνες,
ou, comme portent plusieurs éditions, Deiganes,
Δειγάνες,
et qui tenaient dans cette ville un rang distingué. Or ce
mot, comme on peut facilement le supposer, nous représente
le terme persan
; et les Persans, en
reprenant ce terme, lui ont conservé la forme que lui
avaient donnée leurs voisins. Cette expression paraît avoir
existé de temps immémorial dans les contrées de la Perse et
de la Chaldée; car nous lisons dans l'histoire de Polybe (Historia,
lib. V, cap. liv,
tome II, page 329) que, dans la ville de Séleucie, il
existait des hommes appelés Adeiganes,
'Αδειγάνες,
ou, comme portent plusieurs éditions, Deiganes,
Δειγάνες,
et qui tenaient dans cette ville un rang distingué. Or ce
mot, comme on peut facilement le supposer, nous représente
le terme persan  .
Suivant l'auteur du lexique intitulé Borhani-kati
(page 409, éd. de Calcutta), le mot dihgan,
.
Suivant l'auteur du lexique intitulé Borhani-kati
(page 409, éd. de Calcutta), le mot dihgan,
 , ou dihkan,
, ou dihkan,
 , désigne 1° un
agriculteur ; 2° un homme versé
dans la connaissance de
l'histoire, un historien. Le premier sens
se trouve surtout chez des écrivains d'une époque un peu
récente. On lit dans l'Histoire des descendants de Timour (Matla-alsaadeïn,
man. pers. de l'Arsenal 24, fol. 217 v.):
, désigne 1° un
agriculteur ; 2° un homme versé
dans la connaissance de
l'histoire, un historien. Le premier sens
se trouve surtout chez des écrivains d'une époque un peu
récente. On lit dans l'Histoire des descendants de Timour (Matla-alsaadeïn,
man. pers. de l'Arsenal 24, fol. 217 v.):

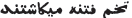 .
« Les agriculteurs semaient dans le champ des combats la
semence des troubles. » Plus loin, on lit le mot
.
« Les agriculteurs semaient dans le champ des combats la
semence des troubles. » Plus loin, on lit le mot agriculture,
qui se trouve dans ce passage (fol. 181 v.) :
agriculture,
qui se trouve dans ce passage (fol. 181 v.) :
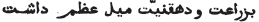 . Il avait beaucoup
d'inclination pour la vie champêtre et l'agriculture. » La
seconde signification, celle d’historien, d'amateur
de l'histoire, est confirmée par l'autorité de
l'auteur du commentaire sur le Sekander-Nameh de Nizami. On
lit dans ce poème (page 145, éd. de Calcutta) :
. Il avait beaucoup
d'inclination pour la vie champêtre et l'agriculture. » La
seconde signification, celle d’historien, d'amateur
de l'histoire, est confirmée par l'autorité de
l'auteur du commentaire sur le Sekander-Nameh de Nizami. On
lit dans ce poème (page 145, éd. de Calcutta) :
 ; et le mot
; et le mot
 est rendu dans la glose
par
est rendu dans la glose
par  . On peut croire que
ce dernier sens n'est dû qu'à une interprétation peut-être
peu exacte des nombreux passages du Schah-Nameh où ce mot se
trouve employé. Quant au premier sens, celui d'agriculteur,
on ne devrait peut-être l'admettre qu'avec une restriction
importante. Il est probable que le mot dihgan ne
désignait pas proprement un simple laboureur,
mais un grand propriétaire, qui, faisant valoir les terres
nombreuses dont il était possesseur, exerçait son patronage,
son autorité, sur un canton plus ou moins considérable.
C'est ce que confirme l'auteur du Moudjmel-altawarikh
(man. pers. 62, fol. 273 r.'), qui s'exprime
en ces termes:
. On peut croire que
ce dernier sens n'est dû qu'à une interprétation peut-être
peu exacte des nombreux passages du Schah-Nameh où ce mot se
trouve employé. Quant au premier sens, celui d'agriculteur,
on ne devrait peut-être l'admettre qu'avec une restriction
importante. Il est probable que le mot dihgan ne
désignait pas proprement un simple laboureur,
mais un grand propriétaire, qui, faisant valoir les terres
nombreuses dont il était possesseur, exerçait son patronage,
son autorité, sur un canton plus ou moins considérable.
C'est ce que confirme l'auteur du Moudjmel-altawarikh
(man. pers. 62, fol. 273 r.'), qui s'exprime
en ces termes:  (lisez
(
(lisez
(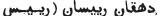
 .
« Le dihkan est un magistrat propriétaire de terres et de
villages. » Et partout où, dans l'histoire orientale, nous
le rencontrons, le mot dihkan,
.
« Le dihkan est un magistrat propriétaire de terres et de
villages. » Et partout où, dans l'histoire orientale, nous
le rencontrons, le mot dihkan,
 , désigne constamment un
magistrat local, un officier qui commandait dans un
territoire plus ou moins étendu. Dans un passage du
Sekander-Nameh (page 254), le terme
, désigne constamment un
magistrat local, un officier qui commandait dans un
territoire plus ou moins étendu. Dans un passage du
Sekander-Nameh (page 254), le terme
 est rendu par
est rendu par
 , la dignité
de général. Massoudi (Moroudj, tome I,
fol. 126 r.) fait mention des dihkan, qui, établis
dans la Chaldée et partagés en cinq classes, tenaient le
second rang parmi les grands dignitaires de cette province,
et passaient pour descendre de Kaioumors, le premier roi de
la Perse. Dans l'ouvrage intitule Akhbar-aldjilad
(man. ar. 638, fol. 98 r.) il est fait mention du dihkan de
Babylone,
, la dignité
de général. Massoudi (Moroudj, tome I,
fol. 126 r.) fait mention des dihkan, qui, établis
dans la Chaldée et partagés en cinq classes, tenaient le
second rang parmi les grands dignitaires de cette province,
et passaient pour descendre de Kaioumors, le premier roi de
la Perse. Dans l'ouvrage intitule Akhbar-aldjilad
(man. ar. 638, fol. 98 r.) il est fait mention du dihkan de
Babylone,  , c'est-à-dire
du gouverneur de cette ville. On lit dans le Kitab-aliktifa,
où se trouve racontée l'expédition des Arabes dans la Perse
(man. ar. 653, fol. 34 r.), que le général Rustem avait
écrit aux dihkan, c'est-à-dire aux gouverneurs
de la Chaldée, de tomber sur les musulmans,
, c'est-à-dire
du gouverneur de cette ville. On lit dans le Kitab-aliktifa,
où se trouve racontée l'expédition des Arabes dans la Perse
(man. ar. 653, fol. 34 r.), que le général Rustem avait
écrit aux dihkan, c'est-à-dire aux gouverneurs
de la Chaldée, de tomber sur les musulmans,

 .
Plus loin l'historien rapporte
(fol. 90 r.) que, le général arabe étant arrivé à Mehroud,
le dihkan de cette ville vint le trouver, et qu'il
lui accorda la paix. Dans des temps beaucoup plus modernes,
ce mot conserva sa signification. Nous apprenons d'Ibn Athir
(Kamel, tome III, fol. 355 r.) que le sultan
Seldjoukide Massoud conféra à Daoud le commandement de la
province de Dehestan, à Thogrul-bek celui de la ville de
Nisa, celui de Farawah à Babgher, et que chacun de ces
officiers reçut le titre de dihkan. Ailleurs, on lit,
en parlant d'un personnage important (tome IV, fol. 140 v.)
: « Il appartenait à une famille de dihkans de la province
de Tous, et son père avait perdu tout ce qu'il possédait
d'autorité et de richesses. » Enfin on lit chez l'historien
Ibn Djouzi (man. arabe 640, fol. 110 r.) que Serouin, roi du
Tabaristan, ayant reçu du khalife Motasem l'ordre de mettre
à mort Abd-Allah, frère du célèbre rebelle Babek, Abd-Allah
demanda à l'exécuteur de la sentence qui il était. Serouin
s'étant fait connaître comme prince souverain, Abd-Allah
s'écria: Louange à Dieu, qui veut bien me faire la grâce de
périr par les mains d'un dihkan,
.
Plus loin l'historien rapporte
(fol. 90 r.) que, le général arabe étant arrivé à Mehroud,
le dihkan de cette ville vint le trouver, et qu'il
lui accorda la paix. Dans des temps beaucoup plus modernes,
ce mot conserva sa signification. Nous apprenons d'Ibn Athir
(Kamel, tome III, fol. 355 r.) que le sultan
Seldjoukide Massoud conféra à Daoud le commandement de la
province de Dehestan, à Thogrul-bek celui de la ville de
Nisa, celui de Farawah à Babgher, et que chacun de ces
officiers reçut le titre de dihkan. Ailleurs, on lit,
en parlant d'un personnage important (tome IV, fol. 140 v.)
: « Il appartenait à une famille de dihkans de la province
de Tous, et son père avait perdu tout ce qu'il possédait
d'autorité et de richesses. » Enfin on lit chez l'historien
Ibn Djouzi (man. arabe 640, fol. 110 r.) que Serouin, roi du
Tabaristan, ayant reçu du khalife Motasem l'ordre de mettre
à mort Abd-Allah, frère du célèbre rebelle Babek, Abd-Allah
demanda à l'exécuteur de la sentence qui il était. Serouin
s'étant fait connaître comme prince souverain, Abd-Allah
s'écria: Louange à Dieu, qui veut bien me faire la grâce de
périr par les mains d'un dihkan,
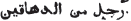 .
.
[49] Le
mot  , employé pour
désigner le vin, a, chez les Arabes, une origine fort
ancienne. On lit dans le Kitab-alagâni (tome II, fol.
97 r.) :
, employé pour
désigner le vin, a, chez les Arabes, une origine fort
ancienne. On lit dans le Kitab-alagâni (tome II, fol.
97 r.) : 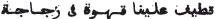 . « Tu feras
circuler devant nous du vin dans un verre. » Les poésies d'Abou'lala
nous offrent cet hémistiche (man. de E. Scheidius 17, p.
436):
. « Tu feras
circuler devant nous du vin dans un verre. » Les poésies d'Abou'lala
nous offrent cet hémistiche (man. de E. Scheidius 17, p.
436):
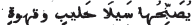 . « Sur elle se
précipiteront deux torrents de lait et de vin. » Au reste,
il est assez singulier de voir, à une époque plus ancienne
que l'hégire, le mot
. « Sur elle se
précipiteront deux torrents de lait et de vin. » Au reste,
il est assez singulier de voir, à une époque plus ancienne
que l'hégire, le mot  indiquer
une substance amère que l'on mêlait avec de l'eau chaude.
indiquer
une substance amère que l'on mêlait avec de l'eau chaude.
[50] Le
mot  désignait un fossé
que l'on creusait autour d'une tente et dont on rejetait la
terre sur le bord, afin d'empêcher l'eau des pluies de
pénétrer dans l'intérieur de l'habitation. Ce terme se
trouve employé dans le troisième vers du poème de Nabegah (Chrestomathie
arabe, tome II, page
désignait un fossé
que l'on creusait autour d'une tente et dont on rejetait la
terre sur le bord, afin d'empêcher l'eau des pluies de
pénétrer dans l'intérieur de l'habitation. Ce terme se
trouve employé dans le troisième vers du poème de Nabegah (Chrestomathie
arabe, tome II, page
 ); et l'on peut
consulter sur ce passage la note de M. Silvestre de Sacy (ib.,
page 499). Soïouti, commentant les vers de Nabegah (man. ar.
1938, fol. 19 v.), explique
); et l'on peut
consulter sur ce passage la note de M. Silvestre de Sacy (ib.,
page 499). Soïouti, commentant les vers de Nabegah (man. ar.
1938, fol. 19 v.), explique par
par
 . Abou'lala (man. ar. de
E. Schedius 17, page 901) s'exprime ainsi: « Pleure la perte
de Hinil, et non pas celle du fossé et des pierres de son
habitation. » Et le poète ajoute en note :
. Abou'lala (man. ar. de
E. Schedius 17, page 901) s'exprime ainsi: « Pleure la perte
de Hinil, et non pas celle du fossé et des pierres de son
habitation. » Et le poète ajoute en note :
 . Le mot
. Le mot
 désigne un fossé que
l'on creuse autour d'une maison, afin d’empêcher que les
torrents n'y pénètrent. » L'auteur du Kitab-alagâni
(tome II, fol. 33 v.), transcrivant une chanson dont un des
vers commence ainsi :
désigne un fossé que
l'on creuse autour d'une maison, afin d’empêcher que les
torrents n'y pénètrent. » L'auteur du Kitab-alagâni
(tome II, fol. 33 v.), transcrivant une chanson dont un des
vers commence ainsi :  ,
fait observer que d'autres exemplaires portent :
,
fait observer que d'autres exemplaires portent :
 . Le mot
. Le mot désigne
une barrière que l'on établit autour des maisons des Arabes,
afin que les eaux pluviales ne puissent y pénétrer. »
désigne
une barrière que l'on établit autour des maisons des Arabes,
afin que les eaux pluviales ne puissent y pénétrer. »
[51] Dans des vers du poète Abou Sakhr-Abd-Allah ben Selmah, cités par Soïouti (Commentaire sur le Mogni, man. arabe 1238, fol. 43 v.), on lit:
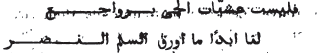
« Ces soirées que nous passions sur ce terrain inviolable ne reviendront jamais pour nous, tant que l'arbrisseau épineux et verdoyant portera des feuilles. »
[52] Le texte porte : tant que j'entendrai la voix.
[53] Le
texte porte:  ,
c'est-à-dire le pédoncule auquel est attachée la datte.
,
c'est-à-dire le pédoncule auquel est attachée la datte.
[54] Dans l'Orient, de temps immémorial, les rois et les personnages d'un rang distingué avaient l'usage de confier leurs enfants aux. soins de princes étrangers ou de regnicoles, que leur âge, leur expérience et leurs qualités morales rendaient dignes d'un si haut témoignage de considération. Nous lisons dans le IIe livre des Rois (chap. x, vers. 1 et suiv.) que soixante-dix fils d'Achab, roi d'Israël, avaient été placés sous la tutelle d'un pareil nombre d'habitants de la ville de Samarie. L'historien Josèphe nous apprend (Antiquit. judaic., lib. XX, chap. n, tome I, page 957) que Monobaze, roi de l'Adiabène, voulant mettre en sûreté son fils Izates, l'envoya à la cour d'Abennerige, roi de la ville de Spasinu-Charax. Phraatès, roi des Parthes, avait remis à l'empereur Auguste une partie de ses enfants (Taciti Annales, lib. II, cap. i). Behram- Gour, fils d'Iezdegherd, et l'un des princes de la dynastie des Sassanides, avait été élevé à la cour de Nomiui, roi de Hirah. Aussi il avait pris un goût très vif pour la langue arabe, et il se plaisait à composer des vers dans cet idiome. (Voyez Monumenta vetustiora Arabiœ, p. 50 et suiv.)
[55] Nowaïri (man.ar. 700, fol. 7) parle également de ce surnom que portaient les fils du roi Mondhar.