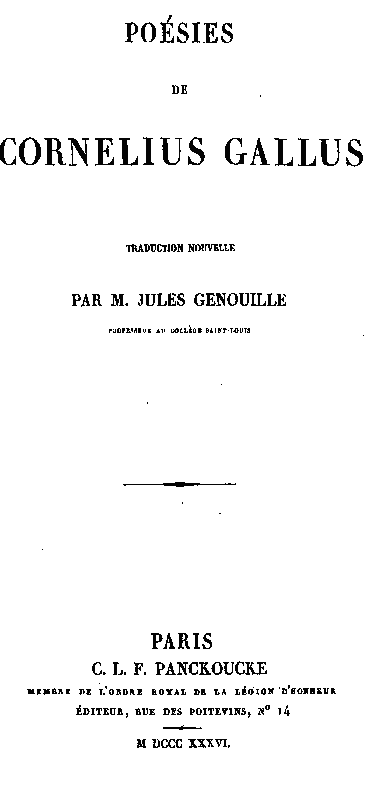
GALLUS
POÉSIES.
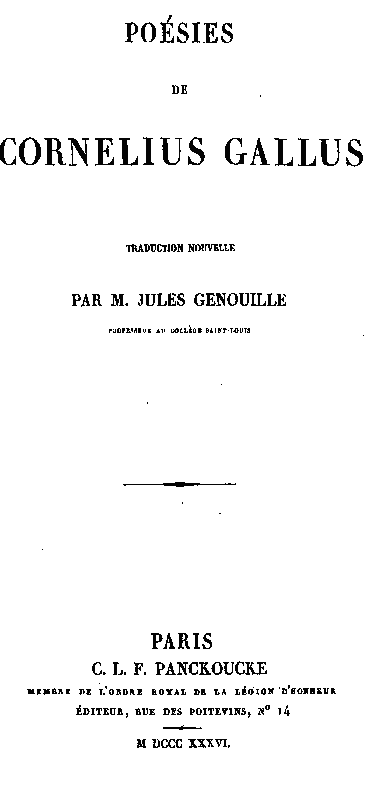
PARMI les poètes élégiaques qui ont illustré le siècle d’Auguste, un nom a surnagé jusqu’à nous à côté des noms plus célèbres d’Ovide, de Catulle, de Tibulle et de Properce : c’est celui de Cnéus ou Publius Cornelius Gallus. Suétone en a consacré la mémoire dans ses écrus; Virgile, dans sa dixième églogue; Ovide et Properce, dans leurs ouvrages, lui ont payé le tribut que réclamait d’eux l’amitié; enfin Quintilien l’a cité comme l’un de ceux qui ont placé l’élégie latine à côté des chefs-d’œuvre de la Grèce antique.
Tous les auteurs et tous les critiques qui se sont occupés de Gallus, quand ils veulent indiquer sa patrie, lui donnent le surnom de Forojuliensis. Quelques auteurs en ont conclu qu’il était né à Fréjus; en sorte que la Gaule romaine pourrait le compter parmi les illustrations littéraires. Malheureusement il ne s’agit point de la ville ainsi appelée dans la Narbonnaise, mais d’une autre ville du même nom située dans l’ancienne Vénétie, et aujourd’hui dans le Frioul. Flavio Biondo, qui était né à Forli, près de Ravenne, a essayé de revendiquer pour sa patrie la gloire d’avoir produit Gallus, prétendant qu’il faut lire Foroliviensis, donné, suivant lui, par un assez grand nombre de manuscrits: mais il a été démontré que les manuscrits furent altérés à une époque quelconque, et les autres raisons de Biondo ne sont pas de nature à entraîner toute conviction contre l’opinion universellement admise. Nous dirons donc que Cornelius Gallus naquit à Fréjus, l’an de Rome 688. Son nom donnerait à penser qu’il était issu par quelque branche, de la famille Cornelia,[1] qui avait produit les Scipions et tant de grands hommes. En supposant qu’il en fût ainsi, il y aurait eu du moins longtemps que la branche se serait détachée de la tige, puisque rien n’indique la parenté la plus éloignée, et que des témoignages unanimes[2] font sortir au contraire Gallus d’une famille pauvre et obscure. C’est ainsi qu’on dispute encore aujourd’hui sur la famille et la patrie d’Homère, de Properce et de tant d’autres hommes dont la littérature ou les arts proclament les noms de siècle en siècle. Leur naissance a été à peine remarquée, parce qu’on jette à peine un regard sur une vie qui paraît, dès son principe, dévouée à l’obscurité. Mais que de fois le génie a triomphé de la fortune! que de fois il a conquis l’immortalité, alors même que ses œuvres ne sont plus! et des monuments gigantesques, tant de provinces ravagées, tant de sang répandu, n’ont valu souvent aux conquérants et aux rois qu’une réputation bien éphémère.
On ignore ce qui commença la fortune politique de Gallus; mais en 712, après la bataille de Philippes, on le voit nommé triumvir avec Asinius Pollion et Alphenus Varius, pour lever des tributs dans la Gaule Transpadane, au profit des vétérans de César et d’Auguste. C’est à lui particulièrement que Virgile eut recours, lorsqu’il fut dépouillé de son héritage. Gallus apprécia le jeune poète, lui fit rendre une justice qu’il méritait, le présenta même à Auguste sans s’arrêter aux calculs d’une vanité égoïste, et s’unit enfin à lui de la plus étroite amitié. Après cette conduite généreuse que l’on a trop passée sous silence, comme si la vertu n’était pas assez rare pour mériter toujours d’être encouragée par un juste éloge, Gallus rentra dans la vie obscure qu’il avait menée jusqu’alors, et l’histoire ne s’en occupe plus. Il reparaît dans la guerre d’Antoine. César, victorieux à Actium, l’envoya devant lui en Egypte, et Gallus se montra digne de la confiance que mettait en lui son général. Il recueillit quatre légions d’Antoine, s’empara d’Alexandrie, repoussa les attaques des ennemis et coula même à fond la plus grande partie de leur flotte. Aussi, après la mort de Cléopâtre et la réduction de l’Égypte en province romaine, Auguste le créa préfet de cette nouvelle conquête, mais autant par politique que par reconnaissance, s’il en faut croire Dion, parce qu’il craignait, dit l’historien, de confier à un noble une province riche, puissante, nouvellement conquise, et que des intrigues, ou même une hauteur maladroite, auraient aisément fait soulever. Thèbes ne s’en révolta pas moins sous la préfecture de Gallus, parce qu’il la frappa d’une contribution exorbitante. Le soulèvement fut réprimé avec bonheur et activité, mais puni avec une cruauté barbare; car le préfet ordonna, suivant Ammien, le pillage de la ville, ou même la détruisit de fond en comble, au rapport de quelques autres historiens. Enorgueilli par cette victoire, que sa mauvaise administration seule lui avait donné occasion de remporter, Gallus se fit ériger des statues dans toute l’Égypte, dont il venait de traiter si indignement l’ancienne capitale, et fit graver ses exploits sur les Pyramides. La légèreté de ses propos[3] n’épargna pas même Auguste, qui l’avait comblé de tant de bienfaits. Le prince fut irrité de son ingratitude: mais, suivant Suétone, il se contenta de le rappeler et de lui interdire son palais et ses provinces.[4] La chose cependant n’en resta pas là. Ses ennemis, et même Valerius Largus, son collègue et son ami, avaient dénoncé au sénat sa conduite. Unanimement condamné à une forte amende et à la peine infamante de l’exil, il ne put survivre à sa honte et se donna la mort. Auguste, ajoute Suétone, loua le zèle de ceux qui le vengeaient ainsi : mais il pleura et se plaignit amèrement quod sibi soli non liceret amicis, quatenus vellet, irasci, « de ce qu’il ne lui était pas permis, à lui seul, de se fâcher avec mesure contre ses amis. » On convient assez généralement que Gallus vécut de quarante à quarante-trois ans, et qu’il mourut l’an de Rome 727, vingt-six ans avant notre ère. Cette date n’a cependant rien de bien certain, comme il est aisé de le voir en parcourant les commentateurs. Il en est qui lui font gouverner di ans la province d’Égypte, qui ne fut soumise qu’en 724; Servius, le commentateur de Virgile, va même jusqu’à reculer la préfecture d’Égypte à l’année 742, et la mort de Gallus à l’année 758. Mais tous les critiques regardent cette assertion comme une erreur de mémoire, et, à quelque temps qu’ils aient parus, ils s’accordent à placer la mort de Gallus quelques années au moins avant celle de Virgile, qui s’éteignit à Brindes, comme on le sait, en 7, par une maladie de langueur.
Gallus aima, dit-on, une certaine Cythéris, affranchie de Volumnius, et la célébra dans ses chants sous le nom de Lycons. C’était lui assurer l’immortalité que Properce donnait à Cynthie; mais elle en parut peu touchée, puisqu’elle l’abandonna pour s’attacher un autre amant.[5] Gallus en fut inconsolable. Virgile avait déjà rendu au talent poétique de son ami un éclatant hommage, églogue vi, v. 64:
Tum canit, errantem Permessi ad flumina Gallum
Aonas in montes ut duxerit una sororum
Utque iro Phœbi chorus assurrexerit omnis.
Il essaya, dans la dixième églogue, de ranimer son courage abattu et de détacher son cœur, si la chose était possible, d’une ingrate qui ne méritait pas de tels regrets. On n’en a pas moins prétendu qu’après avoir payé à la douleur d’un ami un tribut si noble et si touchant, Virgile se serait rendu coupable envers lui d’une lâcheté insigne. S’il en faut croire certains commentateurs, il avait encore consacré à son éloge une partie du quatrième livre de ses Géorgiques; mais après la disgrâce de Gallus, il y aurait substitué, par la crainte d’offenser Auguste, le magnifique épisode d’Aristée. A ne consulter que nos plaisirs, il semble au premier aspect que nous aurions tort de nous en plaindre: tant l’inspiration du poète, dans cet épisode, a été constamment heureuse ! Cependant, si l’on observe que l’intelligence se resserre ordinairement avec le cœur, que jamais une jouissance ne fut complète sans être en même temps chaste et pure, et que toute âme généreuse la répudiera toujours, quand il faudra ramper dans la boue avant d’arriver jusqu’à elle, on gémit de voir peser un tel soupçon sur le créateur de l’épopée latine. Heureusement, rien n’est venu confirmer l’assertion de quelque détracteur obscur; au contraire, la liaison parfaite qui existe entre l’épisode d’Aristée et le commencement du livre, le caractère bien connu de Virgile, l’estime de ses contemporains, de ses amis, d’Auguste lui-même, surtout d’après les paroles de Suétone, qu’il aurait perdue par une semblable palinodie; tout nous porte à regarder cette anecdote, avec le P. La Rue, comme calomnieuse et invraisemblable.
Gallus avait commencé sa réputation poétique par une traduction en vers latins des poésies grecques d’Euphorion de Chalcis; mais ni la traduction ni l’original ne sont parvenus jusqu’à nous. On peut seulement conjecturer, d’après la sixième églogue de Virgile,[6] que parmi les poésies d’Euphorion, il y en avait quelques-unes sur l’agriculture et dans le genre de la Théogonie d’Hésiode, et les commentateurs nous apprennent que Gallus, en marchant sur les traces de son modèle, avait célébré la forêt de Grynée, en Éolide, où Apollon avait un temple et rendait des oracles. Ensuite, à l’exemple d’Ovide, de Catulle, de Tibulle et de Properce, Gallus chanta aussi ses amours et composa quatre livres d’élégies, dont nous avons également à regretter la perte. Sa réputation a survécu à ses ouvrages. Quintilien, au dixième livre de son Institution oratoire, assigne à Tibulle le premier rang dans l’élégie, mais en ajoutant qu’on lui préférait souvent Properce; il nomme ensuite Ovide, qui est, dit-il, trop fleuri, et il donne enfin à Gallus la quatrième place, mais en lui reprochant sa dureté. On suppose qu’il avait probablement contracté ce vice à l’école des poètes d’Alexandrie, et d’Euphorion en particulier qu’il avait pris pour modèle, et qui, selon saint Clément, ne pouvait être clair et harmonieux dans le style, puisqu’il était si souvent et si profondément obscur dans les choses. »
Ovide, dans ses élégies,[7] n’en avait pas moins promis à Gallus et à Lycoris l’immortalité, et leurs noms ont survécu en effet à la barbarie du moyen âge. Il n’en est pas de même des écrits du poète, qui sont perdus aujourd’hui, et peut-être sans retour. L’estime que les anciens avaient eue pour eux les faisait universellement regretter, lorsque Pomponius Gauricus fit imprimer à Venise, en 1501, six élégies ayant pour titre: Cornelii Galli fragmenta. Ces pièces étaient connues depuis très longtemps; mais tous les manuscrits les donnaient sous le nom d’un certain Maximien, dont on n’avait point encore recherché la vie. Pomponius appuya son opinion sur des raisons assez peu convaincantes qu’il énonça dans une préface, avec toute la confiance d’un jeune homme de dix-neuf ans: car tel était son âge quand il publia cet opuscule. « Les écrits de Gallus, dit-il, sont entièrement perdus pour nous, à l’exception des élégies que je publie, et qu’il paraît avoir écrites en Égypte un peu avant sa mort. Qu’il soit né dans la Toscane, qu’il ait été poète, orateur, adonné au vin; qu’il ait aimé Lycoris, qu’il ait été préfet en Égypte : c’est ce que leur lecture indique avec la plus grande évidence. Si l’on pèse avec soin ces rapprochements nombreux, on avouera, sans doute, que cet ouvrage appartient à Gallus seul, et non pas à un autre, comme l’ont pensé quelques savants, faute d’une attention assez sérieuse. »
Quand bien même les assertions de Pomponius seraient exactes, on pourrait encore lui demander comment il concilie le langage de Gallus dans ses élégies avec ce que l’histoire nous apprend de lui. Ainsi, il est reconnu qu’il mourut à quarante-trois ans au plus tard et d’une mort volontaire : comment se fait-il donc qu’il se plaigne continuellement des incommodités de la vieillesse? Dira-t-on qu’il y a fiction de sa part? Il faut alors n’accorder à ses écrits aucune créance (car comment reconnaître ce qui est vrai, de ce qui ne l’est pas?), et chercher ailleurs que dans son ouvrage des preuves d’authenticité: Mais c’est à Pomponius lui-même qu’il faut renvoyer le reproche de n’avoir pas lu avec une attention assez sérieuse l’ouvrage qu’il éditait. Sans doute Cornelius Gallus était poète; il a pu être orateur et s’adonner même aux plaisirs de la table : mais il était du Frioul, et l’auteur des élégies est né, de son propre aveu, en Toscane ou tout au moins en Italie; mais il était préfet d’Égypte, et l’on ne trouve aucune trace de ses hautes fonctions dans le vers[8] de la ve élégie auquel fait allusion Pomponius, puisque legatus n’a jamais signifié préfet, comme on l’entendait au temps d’Auguste, et que l’expression oriens ne s’appliquait point alors à l’Égypte, mais à des contrées bien différentes, telles que les Indes et le pays des Sères, aujourd’hui la Chine. Enfin, si l’on trouve dans la seconde élégie le nom de Lycoris, ce n’est point une raison suffisante de conclure que ce soit la Lycoris de Gallus, puisque d’autres poètes ont également donné ce nom à quelqu’une de leurs maîtresses, ou à une femme en général, comme l’emploie Horace, Od., l. i, 33:
Insignem tenui fronte Lycorida
Cyri torret amor ...................
Pomponius a donc entassé des probabilités assez peu convaincantes, et, de plus, il mérite le reproche d’avoir agi de mauvaise foi. Deux vers de la quatrième élégie[9] attestaient que Maximien, et non pas Gallus, était l’auteur de ces différentes pièces : plutôt que de se rendre à l’évidence, il a retranché le distique, comme si tous les manuscrits ne le donnaient pas unanimement, de manière à ce que l’on ne pût admettre, malgré toute la bonne volonté possible, l’hypothèse d’une interpolation quelconque. L’erreur n’en était pas moins facile à saisir. Les six élégies présentent une foule d’expressions barbares, qui trahissent un siècle de décadence, et un assez grand nombre de fautes contre la métrique : ce n’est assurément ni la pureté, ni la délicatesse qui régnaient au siècle d’Auguste; et Quintilien n’aurait pas conseillé à la jeunesse un auteur chez qui la langue et la mesure étaient si maltraitées.
Mais si Pomponius fait preuve de peu de goût et de bonne foi dans sa critique, en attribuant ces pièces à Cornelius Gallus, à quel auteur devrons-nous les restituer?
Nous l’avons dit plus haut: tous les manuscrits avant Pomponius écrivaient à la suite du titre le nom seul de Maximien; tous les critiques qui vinrent après lui, et qui reconnurent si facilement l’erreur ou la fraude, rétablirent le nom de Maximien à la tête de ses élégies. Après une tradition aussi constante et aussi unanime, le doute n’est plus permis, et toute discussion serait aussi inutile que superflue.
On s’est peu occupé pendant longtemps de la personne de Maximien et du temps où il vécut, parce que l’attention se reportait tout entière sur son pseudonyme. Son nom même a varié suivant le caprice des éditeurs: Broukhuse en plusieurs endroits de ses notes sur Tibulle et Properce, et Markland, d’après Broukhuse, lui donnent le prénom de Longinus; Goldastus, qui fit imprimer les six élégies parmi les poésies érotiques d’Ovide, appelle leur auteur Cornelius Maximianus Gallus Etruscus, et toutes les éditions vulgaires ont adopté les noms de Goldastus, car l’alliance de Gallus et de Maximien dispensait la paresse de toute recherche, et laissait indécise une question de propriété qui était pourtant si facile à résoudre. Tous ces noms supposés ont tombé devant les faits. Les travaux des érudits ont prouvé que le nom de Cornelius n’a jamais été un des noms de famille des Maximiens. Quant à Longinus et Gallus, rien n’appuie les suppositions de Goldastus et de Broukhuse, et le surnom d’Etruscus, comme celui de Forojuliensis donné à Gallus, indique simplement la patrie du poète.
En effet, s’il en faut croire strictement ce que Maximien dit de lui-même dans ses élégies, il serait né en Toscane, sans que l’on puisse toutefois conjecturer la ville ou l’endroit précis qui lui aurait donné le jour. Toutefois, on a observé qu’après la chute de l’empire d’occident, l’appellation Etruscus était devenue synonyme de Romanus ou Italus, comme le prouvent certains passages extraits des auteurs de cette époque. C’est une conjecture dont rien n’appuie la vérité ou la fausseté. En la supposant vraie, elle ne ferait que jeter encore plus de vague sur la patrie de Maximien.
Les opinions ont été partagées sur l’époque où il a vécu. Un critique assez distingué l’a confondu avec un autre Maximien, abbé de Saint Grégoire, à Rome, et plus tard évêque de Syracuse, qui fut un littérateur célèbre vers le commencement du septième siècle, et l’ami du pape Grégoire le Grand; mais, indépendamment de tout autre motif, l’on répugne à attribuer des poésies aussi licencieuses à un évêque, dont les mœurs, au rapport des auteurs contemporains, ont toujours été pures. Un autre suppose Maximien encore plus près de nous. Il le recule jusque vers le commencement du dixième, et peut-être même, ajoute-t-il, du onzième siècle, parce que le nom de Maximien ne paraît, dans les ouvrages du moyen âge, qu’à l’année 1240. A cette époque, Alexandre de Villedieu, professeur en l’Université de Paris, proscrivait dans les écoles ce qu’il appelait nugas Maximiani, et prétendait les remplacer par une grammaire dont il était l’auteur. C’était une singulière substitution aux élégies de notre Maximien. Mais la vérité ne tarda pas à paraître ; Ducange[10] et Fontanini[11] découvrirent, par de savantes et laborieuses recherches, qu’il avait existé deux Maximiens : l’un, auteur des six élégies; l’autre, Français et auteur d’une grammaire qui était encore adoptée dans l’Académie de Paris quand Alexandre de Villedieu écrivit la sienne. Dès lors, on attribua encore à ce second Maximien des pièces de vers sur la vertu, l’envie, la colère, la patience et l’avarice, dont les ouvrages du temps ont fait mention, et quelques distiques cités avec le nom de Maximien, mais que l’on n’a retrouvés dans aucun manuscrit ni dans aucune édition de nos six élégies.[12]
Reste une troisième opinion plus généralement adoptée par les critiques, et d’après laquelle Maximien aurait vécu au temps de la domination des Goths en Italie. On l’appuie en rapprochant des faits connus d’ailleurs, certains passages de notre poète: car, nous le répétons, on ne connaît guère de sa vie que ce qu’il nous en a appris lui-même.
En quelque endroit qu’il soit né, il est certain qu’il fut élevé à Rome, et l’éducation qu’il y reçut indiquerait assez qu’il naquit d’une famille noble ou du moins d’une famille riche. On le oit, en effet, se livrer à tous les exercices qui pouvaient développer le corps ou l’intelligence. D’un côté, il s’adonna à la poésie et à l’éloquence, et soit au Parnasse, soit au barreau, il obtint les plus brillants succès, s’il en faut croire sa jactance; de l’autre, il cultivait tous les vieux exercices du Champ de Mars, la course, la lutte, etc., et, comme au temps d’Horace, il franchissait ensuite à la nage les eaux du Tibre.[13] Cette coutume a fourni une première indication sur l’époque où vivait Maximien. Rien, en effet, ne nous porte à croire qu’elle ait survécu à la domination romaine, surtout au milieu des guerres continuelles qui suivirent. Végèce, au contraire, qui vivait au cinquième siècle, nous apprend positivement[14] qu’alors encore les jeunes Romains s’adonnaient à ces exercices du Champ de Mars, et se jetaient ensuite dans le Tibre pour laver en nageant et la poussière et la sueur. Cette première observation, sans être une preuve convaincante, circonscrit cependant la difficulté en deçà du sixième siècle.
Une probabilité plus grande résulte du distique que nous avons déjà cité, él. V:
Missus ad Eoas legati rnunere partes
Tranquillum cunctis nectere pacis opus
Dum studeo gemini componere fœdera regni.
On y voit, en effet, que le monde romain était déjà divisé en deux empires, qui n’étaient plus unis comme sous les enfants de Théodose, mais qui conservaient ensemble des relations assez fréquentes. Or, tant que la postérité d’Honorius régna en Italie, les empereurs d’orient, après Marcien, n’ayant de titre à l’empire que l’intrigue et l’élection du peuple ou des soldats, et attaqués sans cesse par les Perses, ne songeaient aucunement à disputer aux empereurs d’occident le légitime héritage de Théodose. Ce ne fut qu’après l’attentat de Maxime sur le dernier Valentinien, qu’ils jetèrent leurs regards sur l’Italie, et qu’ils essayèrent de réunir sous leur sceptre généralement débile, ce qu’on appelait encore les deux empires. Donc Maximien n’a pu exister qu’entre l’usurpateur Maxime, ou mieux encore, entre Romulus Augustule et les conquêtes de Bélisaire. L’histoire vient appuyer ces conjectures. On trouve dans Cassiodore[15] une lettre de Théodoric, roi des Goths, à un Maximien qu’il appelle vir illustris, et auquel il recommande certains travaux et certains détails de police à Rome. Dans une autre lettre,[16] il est encore fait mention de ce même Maximien, auquel est donné le même titre, vir illustris. Enfin, on sait les velléités que Zénon et son successeur Anastase montrèrent plusieurs fois, de revendiquer l’Italie, et que s’ils en laissèrent Théodoric en possession, si même ils lui envoyèrent les ornements royaux, c’est qu’ils ne se sentaient pas assez forts pour lui arracher sa conquête. Il y eut donc entre eux des négociations fréquentes, et ce fut, sans aucun, doute à l’une d’elles que fut employé Maximien, à qui ses talents avaient dû valoir, puisqu’il le dit lui-même, et une grande réputation, et par conséquent, surtout dans un siècle de décadence, les plus importantes dignités.
Un passage de la troisième élégie semble confirmer ces premières réflexions. On y lit, en effet, dans tous les manuscrits avant Pomponius[17] :
Hic mihi magnarum scrutator maxime rerum
Solus, Boheti, fers miseratus opem.
Nam quum me curis intentum sæpe videres,
Nec posses causam noscere tristitiæ,
Tandem prospiciens tali me peste teneri
Mitibus alloquiis pandere clausa jubes.
Le premier distique, en effet, parait se rapporter merveilleusement à Boèce, poète, écrivain et philosophe distingué, qui fut longtemps le ministre et l’ami de Théodoric, mais qui périt de mort violente, parce qu’il fut impliqué, quoique innocent, dans une conspiration contre son prince. Telle est l’opinion admise généralement par les commentateurs, et l’on en a admis plus d’une fois de beaucoup moins probables. Rien de plus naturel, que l’union entre deux hommes que leurs talents et leurs fonctions rassemblent. Le caractère de Boèce répugne, il est vrai, aux poésies licencieuses de Maximien, comme l’a observé judicieusement un critique: mais Boèce pouvait conserver avec lui des relations intimes sans approuver cependant sa conduite. Puis, si Maximien a eu dans sa vieillesse quelques écarts, ne peut-il pas avoir mené dans sa jeunesse une vie plus pure? C’est ce que ne démentirait pas la troisième élégie, ni la quatrième, et lui-même a dit dans la première:
.................... Nam me natura pudicum
Fecerat et casto pectore durus eram.
Il est une autre considération qui me ferait douter que Maximien veuille en effet parler de Boèce. En relisant l’élégie entière, il me semble qu’il emploie toujours, à l’égard de Boèce, des expressions qui indiquent le respect, du moins une grande déférence, comme si ce dernier n’eût pas été seulement un ami, mais un mentor et un second père. Or, Boèce, à comparer les dates, devait être au plus du même âge que Maximien. Ce fut, en effet, dans l’année 525 que Théodoric, oubliant ses services, le fit mettre à mort avec le patrice Symmaque. Ce fut au contraire dans les premières années du règne d’Anastase, c’est-à-dire vers 495, s’il en faut croire les recherches des érudits, que Maximien fui envoyé en ambassade à Constantinople, et, d’après son propre témoignage, il devait être déjà d’un âge assez avancé; car on ne peut supposer en lisant ses écrits, qui nous donnent seuls des détails précieux sur sa personne, qu’il ait eu à gémir, comme tant d’autres, sur une vieillesse prématurée. On pourrait répondre, d’un côté, que les termes dont se sert Maximien conviennent à l’époque où il écrivait plutôt qu’au temps de l’anecdote, ou, de l’autre, que les critiques après tout auraient pu avancer faute de documents la date de l’ambassade mais en admettant même comme vraies l’une et l’autre objection, je n’en persiste pas moins à douter que le Boèce, ministre de Théodoric, aussi âgé et probablement moins âgé que Maximien, soit le Boèce dont il est parlé au quarante-huitième vers de la troisième élégie, quoiqu’il ait pu et dû exister entre eux une liaison d’amitié et de convenance.
En cherchant à quelle époque parut Maximien, nous avons dit ce que l’on connaît sur sa vie. Ses poésies, quelque nombreuses qu’elles aient été jadis, se réduisent aujourd’hui aux six élégies sur tes Incommodités de la vieillesse. Rien n’a plus varié que l’opinion des critiques à son égard. Les uns l’ont vanté outre mesure, et un éditeur allemand n’a pas craint de faire imprimer en titre de ses œuvres : Maximiani philosophi atque oratoris clarissimi ethica suavis et perjocunda incipit feliciter. D’autres l’ont traité au contraire avec beaucoup moins d’indulgence; témoin Broukhuse, qui l’appelle pessimus nebulo ac nugator, scriptor barbarus, lutulentus ac tantum non stercoreus. Il en est enfin qui, tout en remarquant un défaut général d’élégance et de grâce, ont trouvé dans ses écrits un certain nombre d’idées bien rendues, et quelquefois même un si grand air de ressemblance avec les écrivains du bon siècle, que Barth se croit fondé à émettre une opinion assez vraisemblable : c’est que Maximien aurait fait aux anciens, et notamment peut-être à Cornelius Gallus, des emprunts plus ou moins nombreux. Le dernier éditeur des Pœtæ minores, Wernsdorf, dont la critique et le goût font aujourd’hui autorité, lui reconnaît, indépendamment de tout emprunt, un mérite personnel, qui, pour n’avoir pas triomphé de tous les défauts de son siècle, n’en a pas moins droit à quelques éloges de la postérité. Ajoutons que ces éloges seraient mieux fondés et plus unanimes, s’il avait condamné quelquefois sa plume à plus de correction dans le style, et de Chasteté dans la pensée.
Les six élégies de Maximien furent éditées séparément dans l’origine et portaient le nom de leur auteur. L’édition Princeps est celle de Pomponius Gauricus, Venise, 1501, bien qu’il existe une édition antérieure, qui a dû être imprimée de 1470 à 1480, mais qui est réduite aujourd’hui à un ou deux exemplaires. Maximien parut souvent après Catulle, Tibulle et Properce, sous le faux nom de Cornelius Gallus, et avec toutes les fautes de l’édition Princeps, malgré les avertissements des critiques. Pulmann, Van Ommeren, Wernsdorf et plusieurs autres ont essayé de rétablir le texte dans sa pureté. Le succès a couronné heureusement des efforts soutenus et opiniâtres.
A la suite des six élégies, Pomponius fit paraître le premier une septième pièce d’une délicatesse charmante, qui commence par ces mots Lydia, bella puella, candida. C’était attribuer à Maximien un morceau qui fait avec le reste disparate complet. De là vient peut-être que Gyraldus, tout en s’élevant contre la fraude qui chargeait Gallus de poésies indignes de lui, reconnaissait cependant qu’il y en avait une ou deux que Gallus aurait pu avouer; ce que l’on a entendu quelquefois des élégies dont nous aurons bientôt à faire la critique.
Quant à celle dont nous nous occupons, elle a partagé deux hommes du plus grand mérite, Burmann et Wernsdorf. Le premier a prétendu que le latin n’en était pas pur et trahissait un âge postérieur; il a cité, entre autres mos, columbatim, rubidas, gemipomas. Le second a lutté au contraire pour lui donner rang parmi les productions du bon siècle. Il a répondu, en premier lieu, que les termes attaqués ou étaient plus anciens que ne le supposait Burmann, ou qu’après tout, comme Burmann semblait l’avouer pour gemipomas, ils avaient pu être introduits dans le texte par l’ignorance de quelque copiste. Mais il a fait plus encore. Parmi les poètes dont nous regrettons la perte, il en est un à qui Suétone a consacré un article dans ses Grammairiens illustres: c’est Valérius Caton. Dépouillé de son patrimoine au milieu des guerres de Sylla, il vint à Rome, enseigna la grammaire et la poésie avec une grande distinction, et mérita cet éloge que rapporte Suétone:
Cato grammaticus, Latina siren,
Qui solus legit ac facit pœtas.
Outre plusieurs traités de grammaire, il avait composé plusieurs poèmes, dont il ne nous est parvenu que des fragments, réunis ensemble par Putsch, avec des noies savantes et le titre de Dirœ, fragments qu’à une certaine époque on a attribué à Virgile même. On y reconnaît facilement deux parties bien distinctes. La première n’est qu’une imprécation continuelle, ce qui les a fait appeler Dirœ: mais dans la seconde, le poète déplore avec amertume, et quelquefois avec la vraie éloquence du cœur, l’éloignement de Lydie qu’il aimait. La similitude des noms a fait penser à Wernsdorf que notre élégie devait appartenir au même poète; et il est en effet difficile, quand on compare les deux morceaux, de ne pas saisir, entre les idées et pour le style, une foule de rapprochements qui ne laissent plus à la critique aucun doute.
A côté des différentes pièces que nous venons de parcourir, on trouve encore sous le nom de Cornelius Gallus une élégie, trois fragments, et quelquefois cinq distiques sur la mort de Virgile. Le dernier morceau est évidemment supposé, puisque, au jugement unanime des biographes de Gallus, il a dû mourir quelques années avant son ami. Celte observation de Scaliger a suffi pour démontrer la fraude, et aujourd’hui on le regarde généralement comme l’ouvrage de quelque poète ou rhéteur du moyen âge. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet; maintenant, exposons les opinions des critiques sur l’élégie et les fragments, afin d’en constater, s’il y a lieu, l’authenticité.
Alde Manuce est le premier qui les ait publiés à Florence, en 1590, sous le nom d’Asinius Cornelius Gallus. Le jugement de Giraldus, qui vivait quarante ans auparavant, jugement qui a été précédemment rapporté, a fait penser aux savants qu’il avait eu connaissance du manuscrit d’Alde Manuce : mais rien n’appuie cette conjecture, et Giraldus, comme nous l’avons vu, a pu vouloir parler d’une autre pièce. Quoi qu’il en soit, cette élégie et les fragments qui l’accompagnent, sont de beaucoup supérieurs aux élégies de Maximien; en sorte que Manuce les a attribués avec plus d’apparence à Cornelius Gallus. Cependant rien n’est moins prouvé que l’assertion qu’il a émise.
Manuce lui-même a fourni des armes contre elle, en donnant à Gallus les prénoms d’Asinius Cornelius; car il est certain, par tous les monuments historiques, que le premier n’a jamais appartenu à noire poète. De plus, Manuce le dit fils d’Asinius Pollion,[18] homme consulaire et l’un des favoris d’Auguste; ce qui est une seconde erreur. Il est bien vrai que Pollion eut un fils, qui joignit au nom de sa famille le surnom de Gallus, et dont parlent plusieurs auteurs, notamment Tacite en plusieurs endroits de ses Annales.[19] Nous admettrons encore, si l’on veut, malgré un défaut de preuves trop complet, que cet Asinius Gallus fut poète; et peut-être, en effet, serait-ce à lui qu’il faudrait attribuer le distique rapporté par Suétone dans sa notice sur les Grammairiens les plus célèbres:
Qui caput ad lævam rejicit, glossemata nobis
Præcipit: os nullum, vel potius pugilis.
(Cap. xxii.)
Celui qui penche sa tête à gauche nous enseigne des expressions recherchées; il n’a point de faconde, ou plutôt il a celle d’un athlète. (Trad. de M. de Golbery, éd. Panckoucke.)
Malgré ces rapprochements, la moindre attention eût empêché Manuce de confondre Asinius avec Cornelius Gallus. Le premier, en effet, était Romain, et le second, du Frioul. L’un fut consul avec Censorinus, l’an de Rome 746; l’autre se donna lui-même la mort, vers l’an 727, à cause des poursuites intentées contre lui. Enfin, Cornelius Gallus fut intimement lié avec Pollion, son collègue dans le triumvirat de la Gaule Transpadane, et il n’a pu exister, au contraire, aucune amitié entre lui et le fils de Pollion, vu la grande différence d’âge. Nous n’entrerons pas, après tant d’autres, dans la discussion qui partage les savants, si Virgile, dans sa quatrième églogue, a obéi à des idées religieuses qui avaient cours de son temps parmi tous les peuples, et qui annonçaient un changement dans la face du monde,[20] ou si, prenant pour point de départ la naissance du fils de Pollion, il a seulement tracé le thème facile, l’idéal convenu d’un âge d’or imaginaire.[21] Quelque opinion que l’on adopte, la dernière, défendue par Heyne et beaucoup d’autres, nous prouve au moins que la naissance d’Asinius Gallus doit être rejetée vers l’an de Rome 743, puisque Virgile ne connut son père qu’en 742, et que par conséquent le fils de Pollion n’avait guère que douze ou treize ans lorsque Cornelius Gallus renonça à la vie.
Ce qui a pu tromper Manuce, c’est que pendant longtemps on a lu dans la Vie de Virgile : Caium Asinium Cornelium Gallum, oratorem clarum et pœtam non mediocrem miro amore dilexit. Aujourd’hui, la collation des manuscrits et les recherches philologiques ont rétabli ainsi les mots et la ponctuation: C. Asinium, oratorem clarum et C. Gallum, p. n. mediocrem; leçon qui ne laisse aucun prétexte à l’erreur.
Entrons maintenant dans la discussion de l’élégie elle-même.
Ce fut l’an de Rome 714 que Ventidius fit la guerre aux Parthes. Tandis qu’Antoine s’endormait avec Cléopâtre au sein des plaisirs, son lieutenant remportait sur les vainqueurs de Crassus trois victoires consécutives, et la dernière coûtait la vie à Pacorus, fils du roi. Le pays était ouvert aux Romains; la consternation était si grande, que si Ventidius fût entré en Mésopotamie, les historiens conviennent unanimement que rien ne lui aurait résisté. Il craignit la jalousie d’Antoine, et préféra réduire la Syrie.
Telle est, en peu de mots, d’après l’histoire, l’expédition qui aurait entraîné Gallus en Orient, loin de sa Lycoris. Ses regrets et ses craintes font le sujet de notre élégie.
A ne considérer que la date, on ne saurait l’attribuer à Asinius Gallus, puisqu’il était à peine né : mais rien n’empêcherait de l’attribuer, en effet, à Cornelius, puisqu’il était alors âgé de vingt-six ans, et l’histoire ne nous apprend rien de lui vers cette époque. Deux passages pourraient cependant jeter quelques doutes. Le poète dit, au vers 17:
Me quoque jam canis narrat splendere capillis;
ce qui ne convient guère à l’âge qu’avait alors Gallus; et au vers 57 :
..................... Rosese nec flore juventæ
Nec capitur missis lux mea muneribus;
ce qui paraîtrait indiquer que l’amant de Lycoris ne possédait plus, en effet, toute la fraîcheur de la jeunesse. Cependant, le raisonnement n’est pas très rigoureux. Dans le second passage, le poète a pu s’exprimer d’une manière générale, sans aucun retour sur lui-même; dans le premier., on veut détacher Lycoris de son amant, et chacun sait qu’en tel cas on n’épargne guère les mensonges, que la chose soit ou non vraisemblable.
Mais le nom même de Lycoris, l’un des motifs qui ont pu déterminer Manuce à reconnaître Cornelius Gallus comme l’auteur de l’élégie, est précisément l’argument le plus fort qu’on ait fait valoir contre l’opinion qu’il a émise : c’est que l’on regardait comme certain, d’après le témoignage de Donat et de Servius, dans leurs commentaires sur Virgile, que l’amante de Gallus était la comédienne Cythéris, affranchie de Volumnius, et plus tard la maîtresse d’Antoine. Nous avons précédemment exposé les raisons qui permettent au moins d’en douter, et pour moi, plus j’y songe, et plus le doute se change en certitude. Quant aux deux commentateurs de Virgile, l’un s’est trompé si souvent sur le compte de Gallus, qu’il ne mérite aucune créance, et Donat ne jouit aujourd’hui, dans le monde savant, d’aucune autorité.[22] Il est vrai que nous n’avons plus aucune lumière sur le personnage de Lycoris; mais vaut-il mieux en avoir de fausses? Si nous connaissons la Cynthie de Properce, la Délie de Tibulle, la Lesbie de Catulle, c’est que les ouvrages de ces poètes nous sont parvenus avec les commentaires des anciens Gallus n’a pas joui du même bonheur.
Telles sont cependant les raisons les plus fortes sur lesquelles Scaliger a fondé son jugement, quand il a prononcé, comme un arrêt irrévocable, que l’élégie était supposée. Il avait aussi relevé dans son commentaire une foule de passages qui ne s’accordaient, suivant lui, ni avec l’histoire romaine, ni avec le temps où vécut Gallus, ni avec les mœurs de l’époque, et dans lesquels la langue même n’était pas toujours respectée. Passerat et Barh se sont montrés aussi sévères, mais sans entrer dans les mêmes détails. On a été jusqu’à prétendre qu’Aide Manuce, plus coupable encore que Pomponius, avait voulu abuser les littérateurs de son temps et des temps futurs, en imprimant, sous le nom de Gallus, une pièce qu’il aurait composée lui-même. Tel n’a pas été le sentiment de tous les érudits qui se sont occupés de Galles. Wernsdorff surtout, dans son excellente édition des Pœtœ latini minores, est revenu sur toutes les observations historiques ou grammaticales de Scaliger, et en a généralement montré la fausseté; en sorte que, si une ou deux difficultés au plus nous arrêtent encore, on peut en accuser le mauvais état du manuscrit dont s’est servi Alde Manuce. Cependant les remarques de Scaliger sur Lycoris ont embarrassé le savant éditeur, parce qu’il regardait comme un fait constant son identité avec la comédienne Cythéris. En conséquence, sans nier positivement que l’élégie appartienne à Gallus, et, au contraire, tout en l’éditant sous son nom, il a pensé qu’après tout elle pouvait être l’ouvrage d’un de ces poètes scolastiques du moyen âge qui traitaient, par forme d’exercice, la vie, les passions, les amours, ou même certains passages des poètes antiques. Nous avons, en effet, un assez grand nombre de semblables morceaux, centons trop souvent informes, où la langue, l’histoire et la vérité ne sont pas plus respectées l’une que l’autre. Il y a au contraire beaucoup de suite dans notre élégie. En outre, l’opinion de Wernsdorff n’est qu’une pure hypothèse, et une hypothèse n’est pas preuve.
Que conclurons-nous de ce qui précède? rien de positif, car les éléments de conviction nous manquent; mais nous admettrons comme très probable l’authenticité de l’élégie, puisque tout ce qu’on a allégué jusqu’à présent contre elle, ou a été réfuté, ou ne repose que sur des suppositions. Les trois fragments suivront naturellement sa destinée. Quant aux distiques sur la mort de Virgile, nous dirons, avec les éditions les plus anciennes, que l’auteur en est incertain. On pourrait l’attribuer, peut-être avec justice, surtout à cause de la confusion des noms dans Aide Manuce, à Asinius Gallus, fils de Pollion. Ce serait un bien faible tribut qu’il aurait payé au protégé et à l’ami de son père.
Indépendamment de ces différentes pièces, authentiques ou supposées, et des ouvrages perdus que l’on attribue à Gallus, Fontanini, dans son Histoire littéraire d’Aquilée, affirme qu’il avait composé : 1° la fable de Térée et de Philomèle; 2° la métamorphose de Scylla, fille de Phorcus; 3° celle d’une autre Scylla, fille de Nisus, changée en alouette (Ciris), et, de plus, il donne comme étant de lui ces neuf vers de Virgile:
Tu procul a patria, nec sit mihi credere tantum!
Alpinas, ab dura, nives et frigora Rheni
Me sine sola vides. Ah! te ne frigora lædant!
Ah! tibi ne teneras glacies secet aspera plantas
Ibo, et Chalcidico quæ sunt mihi condita versu
Carmina, pastoris Siculi modulabor avena.
Certum est in silvis, inter spelæa ferarum,
Malle pati, tenerisque meos incidere amores
Arboribus: crescent illæ : crescetis amores.
(Bucol., ecl. x, v. 46.)
Voyons sur quels fondements repose l’opinion du biographe de Gallus.
Les neuf vers de la dixième églogue ont été attribués à Gallus par le commentateur Servius, qui s’exprime en ces termes: Hi autem omnes versus Galli sunt de ipsius translati carminibus. Des manuscrits postérieurs donnent la même scolie, quelquefois en termes différents; ce qui ne prouve aucunement qu’elle ne dérive pas de la même source. Or, nous avons déjà eu occasion d’observer plus d’une fois combien l’autorité de Servius devait paraître suspecte, du moins en ce qui concerne notre poète.
C’est à Virgile que Fontanini demande une preuve de l’authenticité des trois autres pièces, et même cette preuve est l’unique qu’il produise pour la métamorphose de Scylla, fille de Phorcus, et pour la fable de Térée et de Philomèle. En effet, dans la sixième églogue (v. 74), le vieux Silène, après avoir chanté Gallus et le concert avec lequel les Muses l’ont accueilli, se demande ensuite:
Quid loquar? Aut Scyllam Niai, quam fama locuta est,
Candida succinctam latrantibus inguina monstris,
Dulichias vexasse rates, et gurgite in alto
Ah! timidos nautas canibus lacerasse marinis:
Aut ut mutatos Terei narraverit artus?
Quas illi Philomela dapes , quæ dona pararit?
Silène venait de parler de Gallus: immédiatement après, il rappelle quelques pièces du temps, sans doute; car de semblables sujets ont dû féconder souvent la verve de bien des poètes : donc Gallus en est incontestablement l’auteur; raisonnement d’une force admirable et parfaitement concluante.
Nous avons toutefois excepté la métamorphose de Scylla, fille de Nisus, autrement dit, l’opuscule intitulé Ciris, que l’on trouve communément imprimé à la suite des poésies de Virgile. Bien des commentateurs, et notamment Scaliger, ont cru voir dans ce petit poème un essai ou un délassement du chantre d’Enée. Mais Vossius et Scriverius ont douté que nous le devions à sa plume: Broukhuse l’a formellement nié; un autre l’a mis sur le compte de Catulle; Barth, enfin, a employé toute son érudition à prouver qu’il était de Gallus. C’est la dernière opinion que Fontanini embrasse. Quelles sont cependant les preuves? une ressemblance plus ou moins grande entre les vers du Ciris et plusieurs passages des Bucoliques ou des Géorgiques; comme si Virgile n’avait pu faire à ses premiers chants quelques emprunts dans l’intérêt des poésies suivantes; comme si de pareils emprunts, s’ils eussent été faits à Gallus, pouvaient avoir échappé à l’investigation érudite des nombreux commentateurs de Virgile.
Ce qui montre d’ailleurs dans Fontanini peu de critique, c’est qu’il fait à Gallus une haute réputation d’éloquence, parce que Quintilien cite, dit-il, un discours de Gallus contre Asinius Gallus, fils de Pollion. Cependant il ajoute lui-même que des critiques ont voulu lire Labienus au lieu de Gallus comment peut-il donc compter cet ouvrage parmi ceux dont Gallus est reconnu comme l’auteur?
Résumons.
1° Nous avons dit en traitant la vie de Gallus, les poésies dont il est l’auteur authentique. Il ne nous en reste qu’un vers que Vibius Sequester nous a conservé dans un traité sur les fleuves.
2°. Rien ne prouve que le Ciris soit de lui, que la métamorphose de Scylla, fille de Phorcus, que la fable de Térée et de Philomèle aient été célébrées par un autre poète que par Ovide.
3°. Les six élégies de Pomponius Gauricus doivent être à jamais restituées à Maximien, leur véritable auteur.
4°. L’élégie et les trois fragments d’Alde Manuce peuvent appartenir, en effet, à Cornelius Gallus, assertion probable, mais qui aurait besoin de preuves.
5°. La pièce à Lydie paraît devoir être attribuée à Valérius Caton le grammairien.
6°. Les distiques sur la mort de Virgile sont d’un auteur ancien. Peut-être faudrait-il en reconnaître auteur le poète Asinius Gallus, dont Suétone nous a conservé un distique.
Telles sont les faibles lumières qu’un travail consciencieux nous a données sur la vie et les ouvrages de Cornelius Gallus.
Si l’on demande maintenant pourquoi M. Panckoucke a fait figurer dans sa Bibliothèque quelques élégies apocryphes, nous répondrons que ça été pour mettre en repos sa conscience d’éditeur. Comme ces différentes pièces ont été généralement admises à la suite de Catulle, de Tibulle et de Properce, il a voulu qu’on ne pût rien reprocher, même à tort, au monument élevé par ses soins à la littérature latine du grand siècle. C’est ainsi que Pezai avait fait entrer la plus grande partie de ces pièces dans sa traduction des Élégiaques : mais il en avait exclus les œuvres de Maximien, qui, je le crois du moins, u’ont point encore été traduites.
***********************
ÉDITIONS ET TRADUCTIONS
les plus rares et les plus estimées
DE MAXIMIEN ET DE GALLUS.
Utrecht 1473. Édition précédée de l’Enlèvement de Proserpine, par Claudien.
Paris 1496
Venise 1501. Édition Princeps de Pomponius Gauricus.
Paris 1503. Édition d’Ascensius, calquée sur la précédente.
Bâle 1530
Paris Recueil de. Épigrammes et Poèmes anciens, par Pithon.
Francfort 1610. Recueil des Poésies érotiques d’Ovide, par Goldast.
Hanovre 1618. Catulle, Tibulle, Properce et Gallus, par Janus Gebbard.
Paris 1743. Idem, chez Coustellier.
Paris 1754. Idem, chez Barbon.
Paris 1771. Édition de Maximien et Traduction de Gallus, par Pezai.
Altembourg 1780-1798. Recueil des Poètes latins du second ordre, par Wernsdorff, tomes iii et vi.
Deux-Ponts 1783
Paris 1806. Traduction de Gallus et de Catulle, par Fr. Noël.
|
CARMINA DIVERSA. |
POÉSIES DIVERSES |
|
ELEGIA. |
ELEGIE. |
|
Non fuit
Arsacidum tanti expugnare
Seleucen, |
QUE m’importait la défaite du Parthe, la prise de ses villes, et de rapporter à Jupiter Vengeur les drapeaux de Crassus, si ma Lycoris, en proie aux regrets de l’absence et à des soucis rongeurs, doit rester, hélas! neuf mois entiers ensevelie dans sa tristesse! Mais elle redoute moins ses chagrins que le courroux d’une mère; car une mère se joint à l’absence pour la tourmenter tour à tour. Et cependant j’excuse sa tendresse elle voudrait qu’une fille chérie enrichît la maison paternelle de rejetons nombreux. |
|
QUID, quod
lena meos avertere tentat amores, |
Mais que dire de cette courtisane infâme qui veut séduire celle que j’aime? voyez-la colporter en secret de brillantes parures ; écoutez-la prodiguer des louanges à l’amant généreux qui envoie des présents si riches. Un léger duvet couvre à peine son frais visage; une blonde chevelure tombe de son front en boucles épaisses; il chante et touche de la lyre avec grâce, tandis que, pour me nuire, on rappelle la guerre et ses horreurs, on compte tous les moments d’un éloignement odieux, ou me représente même la tête déjà couverte de cheveux blancs, et affaibli par une affreuse blessure. |
|
MULTA quoque adfingit, mentitur et omnia: fluxa
|
Au milieu de tant d’intrigues et de mensonges, qu’il est à craindre que Lycoris ne vienne à m’oublier un jour! Une femme est naturellement inconstante et volage; ou ignore si elle sait mieux haïr ou aimer: mais son cœur porte tout à l’excès, et elle n’est jamais fidèle qu’à sa légèreté. |
|
FILIUS Europæ
Minos, seu poneret arcum, |
Heureux Minos! qu’il dépose son glaive, ou qu’il emprisonne sa chevelure sous un casque d’airain, il est toujours beau, toujours le même. A peine la vierge royale l’a vu, du haut des murs, s’élancer au combat, et le cruel Amour lui a conseillé le crime. Amour, irrésistible puissance, c’est toi qui domptes la lionne farouche; c’est par ton nom divin que Scylla excuse son forfait. Si Jupiter n’avait pas veillé sur la ville éternelle, Rome tombait aussi par la trahison d’une jeune fille. périsse à jamais, comme elle, l’insensé qui conspire contre le sol sacré de la patrie! Le châtiment suivit son sacrilège, car elle fut ensevelie sous les boucliers sabins, et son nom reste encore à la citadelle auguste, où réside Jupiter dans toute sa gloire. |
|
Quid
loquor, ah! demens? roseœ nec flore juventæ, |
Mais quel langage! insensé que je suis! Ni la fleur du jeune âge, ni les riches présents ne séduiront jamais ma Lycoris. Ni l’autorité d’un père, ni l’ordre et les poursuites d’une mère ne sauraient l’émouvoir; son cœur persiste inébranlable dans son premier amour. Comme le rocher au milieu des vagues en courroux de la mer Égée, elle résiste, elle défie tous les efforts du vent et de la tempête. C’est un feu qui grandit peu à peu dans l’ombre, embrase l’aliment nourricier, et brille tout à coup d’une flamme plus pure. Un juste espoir assure Lycoris de mon retour; elle en nourrit secrètement dans son cœur une douce allégresse; absent, elle m’appelle, elle ne respire que pour moi; c’est à moi qu’elle pense sans cesse et la nuit et le jour. |
|
Quin
etiam argento, puroque intexitur auro |
Déjà elle brode en argent et de l’or le plus pur, un autre manteau pour ma prochaine campagne. Là, son adroite aiguille dessine avec soin l’image des jeunes guerriers, et les combats qu’elle a appris de la renommée. Elle peint l’Euphrate qui roule plus mollement ses ondes, et nos aigles victorieuses que conduit Ventidius, vengeant enfin, sous les auspices d’Auguste, les mânes des Crassus et nos étendards ravis. Parthe farouche, qu’enorgueillissaient nos désastres, là encore tu es vaincu et renversé par le soldat romain. Au premier rang on me voit paraître vainqueur, juste tribut de tant d’amour, de fidélité et de constance. Elle aussi s’est représentée, mais pâle, défaite, le visage en pleurs; on dirait que mon nom va s’échapper de ses lèvres. |
|
QUAM bene, quum ferrum nondum prodiret in auras,
|
O l’heureux temps, où le fer était encore caché sous la terre, où la paix régnait seule ici-bas, où chacun était content de sa fortune! on était riche alors, quand on possédait un mince héritage; on y semait quelques herbes, que l’on apprêtait ensuite pour ses repas. On ne connaissait point l’envie, quand le patrimoine voisin abondait en troupeaux, en moissons et en vignes. L’amour était libre; un époux ne soupçonnait point son épouse; une femme était chaste, quand elle n’avouait sa défaite qu’avec mystère. Vénus alors inspirait les feux les plus doux, et l’Amour, au sein des forêts, ne lançait que des traits assurés. Pourquoi, ma Lycoris, pourquoi le destin ne me fit-il pas naître à cette époque? quel dieu m’envia un tel avantage? Jours de calme! époque de bonheur! c’était bien l’âge d’or sous le vieux Saturne. Mais aujourd’hui le fer règne; il exerce les plus terribles ravages; le carnage et la fureur sont déchaînés. Qui sait? mon sang peut-être rougira la main d’un hôte, ou un frère chéri succombera sous mes coups. |
|
QUID mihi cum bello? pugnent, quibus inclyta
regna, |
Que m’importe la guerre? Combattez, vous qui ambitionnez les richesses ou les empires qu’elle dispense; il me faut d’autres combats et d’autres armes. Que l’Amour sonne le clairon, qu’il donne le signal de la lutte; et si je ne combats avec courage depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher, que Vénus aussitôt proclame ma lâcheté et m’enlève mes armes. Mais si tout réussit selon mes vœux, si j’obtiens de justes éloges, sois à moi pour toujours, femme adorée, que je presserai contre mon sein, que je couvrirai de mes caresses, tandis que j’ai encore ma vigueur, et que je puis aimer sans rougir. Versez-moi alors un vin pur au milieu des parfums et des roses; couronnez-moi de fleurs; répandez des flots de nard sur ma chevelure. Pourquoi rougir de reposer sur le sein de mon amie, et de quitter à peine ses bras au milieu du jour? Si quelque indifférent me blâme, parce qu’il n’aime pas, eh bien! qu’il brûle dans sa vieillesse, qu’il apprenne alors le tourment d’aimer; qu’esclave de l’amour, il loue, mais en vain, ma tendre flamme; qu’il me trouve sage alors au milieu du feu nouveau qui le consume. |
|
HEU male, crede mihi, si quis sua gaudia
differt! |
Crois-moi, Lycoris, l’homme a tort de différer ses plaisirs. Tandis que nous parlons, la nuit vient, et la mort s’avance. |
DE VIRGILII MORTE. |
SUR LA MORT DE VIRGILE |
|
TEMPORIBUS lætis tristamur, maxime Cæsar, |
VIRGILE n’est plus, divin César, et sa perte, que je déplore, répand sur nos beaux jours la tristesse. Mais le souffrirez-vous, prince? Il ordonne d’anéantir ces vers harmonieux par lesquels sa voix puissante immortalise Énée. Rome et l’univers entier vous adressent leurs suppliantes prières. Faut-il que la flamme dévore les hauts faits de tant de héros; que Troie succombe encore sous un plus funeste incendie? Ordonnez, et nos neveux reliront la gloire de l’Italie et vos destinées, et l’antique Énée brillera d’une renommée plus belle: car un seul mot du divin César peut plus que le destin. |
AD LYDIAM. |
A LYDIE. |
|
LYDIA, bella puella, candida, |
LYDIE, fille charmante, qui l’emportes, par ta blancheur, et sur le lait, et sur le lis, et sur l’ivoire que l’Indien polit et travaille, et sur la rose au blanc légèrement empourpré ; ô ma Lydie! déploie, déploie ces cheveux blonds qui brillent comme un or pur. Jeune fille, dévoile ce cou d’albâtre qui tombe si bien sur de blanches épaules. Ouvre tes yeux, brillantes étoiles, sous l’arc de tes noirs sourcils. Montre, ma Lydie, les roses et la pourpre de Tyr qui se fondent sur tes joues. Tends-moi tes lèvres, ces lèvres de corail, et donne-moi le doux baiser de la tourterelle. Baiser charmant! comme il pénètre mon cœur! comme il dévore mon âme! comme il attire à lui mon sang le plus pur! Ah! couvre ces pommes et leurs jolis boutons, d’où jaillit sous la lèvre un lait délicieux. |
|
SINUS expansa profert
cinnarna: |
Quel parfum ton sein exhale! quelles délices s’échappent de tout ton être! Cache-moi cette mamelle qui me blesse par sa blancheur et par sa neige épaisse.... Cruelle, ne vois-tu pas comme je languis? Je me meurs, et tu m’abandonnes! |
FRAGMENTA. |
FRAGMENTS. |
I |
I |
|
OCCURRIS quum mane mihi, ni purior ipsa |
QUAND tu m’apparais au matin, que je meure, astre charmant, si tu n’es plus brillant et plus pur que l’aurore nouvelle. Quand tu viens la nuit, grands dieux! pardonnez mon erreur; c’est l’astre du soir qui s’élance des flots de l’occident. |
II. |
II. |
|
......
matris amor, deliciumque meum. |
O vous! délices d’une mère et mes amours, gardez-vous, sœurs charmantes, de rechercher avec envie qui des deux a la peau la plus blanche ou la moins brune. Rivalisez plutôt qui charmera le mieux celui qu’elle aime, l’une par son regard peut-être, et l’autre par sa chevelure. Est-ce l’or, Gentia, qui a donné à tes cheveux un blond si riche, ou, plutôt, ne leur a-t-il pas emprunté leur couleur? Conon, ce Grec affamé, amis jadis au rang des astres les boucles qui tombèrent de la tête de Bérénice: que ta chevelure, Gentia, devienne un astre à son tour, et qu’elle dirige, plus sûrement que l’Ourse, les vaisseaux d’Illyrie. Quand l’oiseau de Junon déploie sa riche queue et l’étale, on ne voit de toutes parts que des yeux et des pierreries. Lorsque Chloé promène de tous côtés son regard, on croit voir s’échapper mille étincelles. |
III. |
III. |
|
Subrides si virgo, faces jacularis ocellis, |
Quand tu souris, ton œil pétille de mille feux, et tes lèvres paraissent s’ouvrir à je ne sais quel murmure: ne laisseras-tu donc échapper jamais un seul mot d’amour? |
IV. |
IV. |
|
Uno tellures dividit amne duas. |
Ses flots séparent deux contrées. |
Arsacidum (v. 1). Arsace fonda le royaume des Parthes, 255 ans avant J.-C., de plusieurs provinces de la Haute Asie, qui se révoltèrent contre Antiochus Théos. Ses descendants sont appelés, dans l’histoire, les Arsacides.
Seleucen (v. 1). Il y avait en Asie plusieurs villes du nom de Séleucie, parce qu’elles avaient été bâties par les rois de Syrie descendants de Séleucus. Les plus célèbres étaient Séleucie sur l’Oronte, dans la Syrie proprement dite, et Séleucie sur le Tigre, dans la Babylonie. Cette dernière tomba au pouvoir des Parthes, et devint même leur capitale, ce qui a fait appeler la province entière, par Pline l’Ancien, Seleucia Parthorum (liv. x, ch. 67).
On dit ordinairement Seleucia, et non pas Seleuce. Le poète donc pris ici une licence que Scaliger trouve un barbarisme insupportable. Observons, contre lui, que plusieurs noms de villes et de pays ont les deux terminaisons. Ainsi on dit également Sebaste et Sebastia, Thrace et Thracia; Messene et Messenia, comme on trouve, pour les noms propres, Calliope et Calliopia, Cassiope et Cassiopia, etc. En admettant donc, ce qui est vrai, que l’expression du poète soit insolite, il faut reconnaître au moins qu’elle est fondée sur l’analogie.
Signa (v. 2). Il s’agit des étendards qui furent enlevés aux Romains après la défaite et la mort de Crassus. Tons les généraux qui commandèrent en Orient voulurent forcer les Parthes à restituer ces trophées de leur sanglante victoire; mais on ne les rendit que sous l’empire d’Auguste, pour détourner la guerre que ce prince méditait contre l’Asie.
Lycoris (v. 3). Voyez la Vie de Gallus.
Lena (v. 9). M. de Pezai, dans sa traduction, attribue à la mère de Lycoris cette épithète et les vers qui suivent. C’est une erreur. Remarquons encore la forme dubitative employée par le poète. C’est une crainte qu’il parait exprimer, et non un fait certain dont il se plaigne.
Indole (v. 12). Aucun manuscrit n’a pu donner la fin de ce vers, qui reste ainsi lacéré. Il en sera de même dans quelques autres passages.
Citharœ (v. 15). Scaliger prétend que la jeunesse romaine, au siècle d’Auguste, dédaignait encore la lyre, et il veut en conclure que cette élégie est d’une époque plus reculée. On peut lui répondre, 1° que rien n’empêche de prendre les mots citharœ cantusque sciens dans le sens de poésie, aussi bien que dans celui de musique, comme on l’a fait souvent en expliquant les poètes, et notamment Horace (Od., liv. i, ode 31, v. 20); 2° que le même Horace (Sat., liv. ii, sat. 3, v. 104) tourne en ridicule ceux qui achètent des lyres (citharas) pour ne pas s’en servir: d’où il est évident que les Romains de son temps ne dédaignaient pas la musique, et en particulier la lyre, autant que Scaliger l’a prétendu.
Splendere capillis (v. 17). Expression forcée, dirons-nous avec Scaliger, et que ne légitiment nullement les exemples rapportés dans l’édition Lemaire.
Fœmina (v. 21). On retrouve en partie ce vers dans Virgile (En., liv. iv, v. 569), et la pensée dans Properce (liv. ii, élég., v. 31).
Et tantum (v. 24). Ovide applique le même vers à la Fortune (Tristes, liv. v, élég. 8, v. 18).
Minos (v. 25). Minos, roi de Crète, assiégeait Mégare. Scylla, fille de Nisus, s’éprit d’amour pour l’ennemi de sa patrie, et lui livra la ville. On dit qu’elle fut changée en alouette, et Nisus en épervier. Voyez Ovide, Métam., liv. viii, v. 6.
Fetas (v. 29). Pœnas ou sœvas conviendrait mieux, si l’autorité des manuscrits permettait l’une ou l’autre de ces deux leçons.
Virginis (v. 32). Il s’agit de Tarpéia, livrant aux Sabins le Capitole. C’est ce que M. de Pezai n’a pas compris, parce que la transition est brusque.
Turris (v. 35). Scaliger voit dans le mot turris un idiotisme français ou italien qui décèle l’écrivain du moyen Age. Il est vrai qu’à dater des Lombards, tout château ou citadelle consistait surtout dans une tour plus ou moins forte, environnée de fortifications secondaires : de là vient cette apparition si fréquente du mot tour dans la géographie des époques suivantes, et même dans la géographie moderne. Mais s’ensuit-il nécessairement que l’expression latine doive avoir cette acception? Rien ne le prouve. On pourrait d’abord la regarder comme un hellénisme, πὺργος, qui en est la traduction, étant pris indifféremment pour tout lieu fortifié. Mais sans nous arrêter davantage à cette considération, observons que turres au pluriel, il est vrai, est souvent employé, même par les écrivains du bon siècle, comme synonyme de arx ou du pluriel arces, avec la signification de lieu élevé naturellement ou par l’art. — Voyez Virgile, Georg., liv. iv, v. 125; Horace, Od., liv. i, ode 4, v. 13; Properce, liv. iii, élég. 20, v. 15, etc. Resterait dès lors à justifier le singulier pour le pluriel. Or, ce serait une synecdoque fort usitée en général, et dont se serait servi Juvénal au vers 290 de la sixième satire:
..........................................Proximus urbi
Annibal, et stantes collina in turre mariti.
L’exemple a été suivi par Claudien, Guerre de Gildon, v. 86:
Muro sustinui Martem, noctesque cruentas
Collina pro turnre tuli ...................................
Pourquoi Juvénal lui-même n’aurait-il pas imité un écrivain antérieur?
Non secus (v. 41). Scaliger proposait: Non secus ac moles œg. obj. fragori; car, dit-il, la conjonction ac ne peut pas se retrancher après non secus. De même, au vers 43, il faudrait non minus ac vires paul. ut colligit ignis. Je ne partage pas son avis, que la prévention a probablement dicté. En général, on peut, quand il y a comparaison, faire ellipse de l’un des deux termes, pourvu que le sens soit assez clair pour qu’il n’en résulte aucune méprise. C’est ce que fait ici le poète, en comparant, non pas la constance de Lycoris à un rocher, mais un rocher à la constance de Lycoris, et en laissant de côté, par un artifice de style, le second terme de comparaison. Maximien offre un semblable exemple, élég. i, v. 171.
Ventidio (v. 54). Ventidius fut pris dans la guerre sociale par le père du grand Pompée, et mené à Rome en triomphe. Plus avancé en âge, il servit, sous César, dans la guerre des Gaules. Celui-ci remarqua en lui du talent, et l’éleva successivement par tous les degrés de la milice. Ventidius parvint à la préture et au consulat. Son expédition la plus célèbre est celle qu’il fit contre les Parthes, dont il triompha à Rome le premier de tous les généraux romains.
Augusti (v. 56). Quel anachronisme! s’écrie Scaliger. Cornelius Gallus s’est donné la mort la quatrième année du règne d’Octave, et le consentement unanime des historiens nous apprend que le surnom d’Auguste ne fut donné par le sénat au vainqueur d’Actium, que dans la vingtième année après son avènement à l’empire. On a répondu en citant un fait semblable dans le Panégyrique de Trajan par Pline le Jeune, puisque l’orateur donne au prince le surnom d’Optimus, qui ne lui fut donné que six ans plus tard, par un sénatus-consulte. Ce rapprochement ne prouve rien, parce qu’il est certain que Pline a retouché son Panégyrique longtemps après l’avoir prononcé. Mais le triomphe de Scaliger n’a rien de plus solide. Horace, pour ne citer aucun autre auteur, a fréquemment employé le surnom d’Auguste, et dans des pièces reconnues comme plus ou moins antérieures à l’époque désignée. C’est que la voix du peuple avait précédé le sénatus-consulte, et rendait ainsi hommage à l’administration ferme et sage d’un grand prince.
Cœdes (v. 78). Des éditions signalent une lacune de plusieurs vers. Qu’elle soit réelle ou non, la suite des idées n’en souffre guère.
Forsan et hic (v. 79). On a demandé comment Gallus pouvait avoir une semblable crainte, tandis qu’il combattait les Parthes. Une telle pensée était naturelle dans un siècle où les guerres civiles étaient fréquentes, dans un moment où une rupture était facile à prévoir entre Octave et Antoine, et, de plus, elle est amenée par les idées générales qui précèdent.
Unanimis (v. 80). Expression peu claire. Si les deux frères combattent l’un contre l’autre, comment peut-on dire qu’ils soient unanimes? Je préfèrerais lire exanimis.
Nardo (v. z). Bien que le nard des anciens ait assez de rapport avec le nard moderne (andropogon nardus), on le rapporte plus généralement, d’après la description de Pline, à la famille des valérianées, et l’espèce la plus estimée serait la valeriana jatamansi, qui croit sur les montagnes des Indes. Cette plante odoriférante était très recherchée des Romains. On en faisait des parfums d’une odeur très suave; mais, de plus, on s’en servait pour aromatiser les vins, et même pour faire certains vins factices. Voyez Pline, Hist. Nat., liv. xii, ch. 26; liv. xiii, ch. i; liv. xiv, ch. 19. On obtenait également d’autres vins en traitant convenablement des feuilles de rose. Voyez Pline, Hist. Nat., liv. xiv, ch. i.
Nox est (v. 100). Des éditions ponctuent : nox est mortis, et umbra subit.
DE VIRGILII MORTE. Les premières éditions donnaient cette élégie sans nom d’auteur. Celle de Venise, en 1480, l’attribua à Cornelius Gallus; et Pulmann suivit cette opinion, que Scaliger a prouvée inadmissible.
Quem gemo (v. 2). C’est ainsi qu’écrivent les manuscrits et les meilleures éditions. On ne sait pourquoi Burmann, sur l’autorité d’un seul manuscrit, a préféré quem fleo, car il serait facile de citer bien des exemples de gemo avec l’accusatif, soit dans Virgile, Horace, etc., soit même dans les prosateurs, et dans Cicéron lui-même.
Præcibus totus (v. 5). Le manuscrit de Saumaise lit precibusque isdem; celui de Vossius et l’édition de Venise, precibus etenim tibi.
Atque iterum (v. ). Barth voudrait anne iterem: le sens y gagnerait-il beaucoup?
Major nuncius (v. 9). Un manuscrit donne Mincius, qu’ont approuvé Heinsius et Burmann, La pensée n’en est pas plus claire, et il n’est aucunement probable que le poète ait écrit ainsi. Quant à la leçon vulgaire, il y a deux manières de l’expliquer littéralement, en rapportant nuncius, soit à Virgile, soit à Auguste. Si nous entendons Auguste, ce sera major Virgilio, flatterie possible; si Virgile, major suffragio tuo, et je préfèrerais Æneamque tuum: mais aucun manuscrit ne donne cette leçon.
AD LYDIAM. Voyez la Vie de Gallus.
Rubidam (v. 3). Des critiques ont attaqué cette expression, comme étant d’une latinité inférieure. On ne la trouve pas, il est vrai, dans les auteurs du bon siècle, tandis qu’elle a été employée par Suétone et Aulu-Gelle; mais elle est cependant fort ancienne, puisque Plante s’en est servi dans Carma, acte ii, sc. 5:
Una, edepol, opera in furnum calidum condito,
Atque ibi torreto me pro pane rubido.
Wernsdorff ne conçoit pas cette alliance de couleurs. Il voudrait rubeam, dans le même sens que certains commentateurs lui donnent, à ce vers de Virgile (Géorg., liv. i, v. 266):
Nunc facilis rubea texatur fiscina virga;
mais il s’en faut de tout que l’on s’accorde unanimement à entendre rubus dans le sens d’épineux. Servius le fait dériver de Rubi, ville d’Italie dans la Pouille, dont parle Horace, Sat., liv. i, sat. 5, v. 94, ou de rubus, ronce, ce qui entre mieux dans le sens de Wernsdorff. D’autres enfin rapprochent le vers de Virgile d’un passage de Pline, qui parle de baguettes d’un bois rouge ou sanguin, virgœ coloris rubei aut sanguinei.
Collum candidum (v. 7). Ce vers manque dans quelques éditions
Productum (v. 8). Ovide a rendu différemment la même pensée dans ses Fastes, liv. V, v. 712:
Ultor adest Pollux; et Lyncea perforat hasta,
Qua cervix humeros continuata premit.
Roseas (v. 11). On trouve, mais rarement, rubidas.
Corallina (v. 13). D’autres auteurs ont parlé du corail; mais l’adjectif corallinus n’existe que dans cette élégie. On en pourrait presque dire autant de la comparaison, qui est si fréquente chez nos poètes.
Columbatim (v. 14). Autre expression qui appartient seulement à notre élégie. Il y en a une analogue dans Aulu-Gelle, liv. xx, ch. 9 :
Sinuque amicam refice frigidam caldo
Columbulatim labra conserens labris.
Plusieurs éditions et Aulu-Gelle ont même donné columbatim.
Animi (v. s 5). Burmann voudrait animœ, et il cite à l’appui nombre de passages dans Properce, Pétrone, etc. Des citations encore plus nombreuses prouveraient que, dans Cicéron même, ces deux mots, malgré la nuance qui les distingue, sont employés souvent comme synonymes.
Gemipomas (v. z8). Burmann attaque encore cette expression comme étrange et rompant la mesure; il voudrait la remplacer par gemellulas. Nous répondrons avec Wernsdorff que, dans toute la pièce, la quantité est assez lâche; que le mot a pu être composé par le poète, comme tant d’autres l’ont été par Plaute, par Catulle, etc.; enfin, que si la comparaison exprimée ne se retrouve dans aucun auteur latin, elle existait du moins chez les Grecs, ce qui suffit pour la justifier.
Cinnama (v. 20). Le cinname ou cinnamome était un arbrisseau d’Arabie, que l’on suppose un amyris, et dont l’écorce, surtout à l’extrémité des branches, répandait un parfum délicieux, voyez ce qu’en dit Pline dans son Histoire Naturelle, liv. xii, ch. 42.
Quantum ego langueo (v. 24)? Nous avons adopté la leçon de Pricæus, sur les Métamorphoses d’Apulée, liv. x, page 589. On lit ordinairement:
Sæva non cernis quod ego langueo;
mais alors la mesure, comme l’observe Burmann, est fautive.
Occurris (v. s). On trouve quelquefois occurit, ce qui donne à la pensée plus de délicatesse.
Quod si nocte (v. 3). Cicéron (de la Nature des dieux, liv. i, ch. 28) rapporte une épigramme à peu près semblable de Q. Catulus, sur Roscius:
Consisteram exorientem Auroram forte salutans,
Quum subito a læva Roscius exoritur.
Pace mihi liceat, cœlestes, dicere vestra,
Mortalis visas pulchrior esse Deo,
L’une et l’autre pièce sont une imitation de Platon.
AO’lipILc .oOp.c, ‘Ao7 ilr siG. yiœsv - Opavk, àc wo.Àoîc eperg, .c e-
Matris amor (v. 1). On peut voir dans Burmann (Anthologie latine) les efforts qu’il a faits pour rétablir le commencement de cette pièce.
Les premières éditions ont donné pour titre: De duabus sororibus, meretriculis ex Illyrico, Gentia et Chlœ, quœ Romana castra cum matre lena sequerentur. Est-il ou non de Gallus? c’est ce qu’on ne saurait affirmer. Des critiques ont prétendu qu’il avait été écrit par une main d’un siècle postérieur; car, disent-ils, Properce atteste formellement (liv. iii, élég. 3, v. 45) qu’il n’était pas permis d’introduire des femmes dans les camps romains, et son témoignage est corroboré par celui de plusieurs auteurs. Cependant, on voit dans Suétone (Vie d’Auguste, ch. xxiv) qu’il a fallu rendre des édits pour faire observer cette ancienne coutume.
Berenicœo (v. 8). Les manuscrits donnent .Beronicœo, qu’on ne trouve nulle autre part, et Catulle a dit:
Idem me ille Conon cœlesti lumine vidit
E Berenicæo vertice cæsariem.
(De coma Berenices, v. 8.)
Bérénice, fille de Ptolémée Philadelphe, selon les uns, et d’Assinoé, ou, selon d’autres, de Magas, frère de Ptolémée Philadelphe et roi de Cyrène, et d’Apamée, épousa Ptolémée Évergète, son frère ou son cousin. Ce prince étant engagé dans une expédition dangereuse, Bérénice, qui l’aimait tendrement, fit vœu de consacrer sa chevelure dans le temple de Vénus, si Ptolémée revenait vainqueur. Le vœu fut religieusement accompli; mais, le lendemain, on ne retrouva plus la chevelure. Comme le roi en éprouvait une vive douleur, Conon, mathématicien célèbre, déclara qu’elle avait été transportée au ciel, et changée en une constellation de sept étoiles, qui se trouvent à la queue du Lion.
Esuriens Grœcus (v. 9). Juvénal a imité ce passage, sat. iii, v. 78:
Græculus esuriens in cœlum, jusseris, ibit.
Huc illuc (v. 14). On a proposé de rétablir ainsi le premier hémistiche:
Fusca Chlœ geininos ........................
Il est évident, en effet, que le poète veut parler, dans ces deux vers, de la sœur de Gentia.
Subides (v. s). Les anciennes éditions donnent soffrides, vrai barbarisme, d’après le manuscrit publié par Manuce.
Uno tellures. Cornelius Gallus avait écrit quatre livres sur les amours, et voilà le seul vers qui nous en reste. Il a été conservé par Vibius Sequester, qui l’applique à l’Hypanis, dans son Traité des Fleuves. Barth l’a déterré le premier et l’a cité dans ses Adversaria, lib. xvii, c. 2, en s’étonnant que les siècles, dans leur course, aient épargné si peu les vers d’un grand poète. Scaliger, qui rapporte aussi ce fragment dans son travail sur Eusèbe, 1362, a préféré lire:
Uno qui terras dividit amne duas.
Il attaque, de plus, Vibius Sequester, parce qu’il dit que l’Hypanis séparait l’Europe de l’Asie. Mais on a observé, contre Scaliger, qu’il y avait eu deux Hypanis, l’un qui se jetait dans le Borysthène, l’autre appelé encore Phase, que les anciens regardaient, en effet, comme la limite de ces deux parties du monde. Cette querelle n’intéresse d’ailleurs en rien le vers de Gallus. Voyez Fontanini, Histoire littéraire d’Aquilée, Vie de Gallus, chapitre ii, § i.
La pièce de Lydie, et celle Occuris si mane mihi, ont été traduites ou plutôt paraphrasées en vers français sur la fin du siècle dernier. Nous pensons qu’on lira avec plaisir ce double essai d’un poète peu connu, car il ne faut pas le confondre avec Gentil Bernard.
O Lydie! objet enchanteur,
Qui du lis le plus blanc répète la blancheur;
Toi, dont la rose égale à peine
Et l’incarnat et la fraîcheur;
Déploie à mes regards tes longs cheveux d’ébène,
Et montre-moi deux noirs sourcils
Sur tes deux yeux en voûtes arrondis;
Montre-moi ton beau col et tes lèvres de rose;
Que j’imprime un baiser sur ta bouche mi-close;
Laisse-moi le plaisir charmant
De m’enivrer d’une faveur si chère;
Pour un, oui, pour un seul, reçois-en plus de cent.
Que te demandé-je, imprudent?
Ah! plutôt, si tu veux m’en croire,
Cache-moi, par pitié, tant d’attraits ravissants.
Cache-moi bien surtout ces deux globes d’ivoire,
Dont la blancheur ajoute au trouble de mes sens.
Lydie, ah! cruelle Lydie,
Tu m’abandonnes sans pitié.
Eh bien! prends tout mon sang, je te le sacrifie;
Va, j’aime mieux sortir tout à fait de la vie,
Que de ne vivre qu’à moitié.
(Bernard, 1786.)
Occuris, si mane .....................
Rare objet, quand tes yeux, quand ta bouche m’enchante,
Quand d’un si doux murmure elle parle mon cœur,
Ne l’ouvriras-tu pas, cette bouche charmante,
Pour prononcer le mot qui ferait mon bonheur?
(Bernard, 1786.)
[1] Cette opinion aurait plus de poids, si l’on parvenait à démontrer une opinion que de nombreux commentateurs ont émise, savoir, que la cinquième élégie du premier livre de Properce est adressée à Cornelius Gallus. On y lit, en effet, vers 23: « Nec tibi nobilita, porerit succurrere amanti. »
[2] Cependant Bernardin de Saint-Pierre, dans le préambule de l’Arcadie, fait naître Gallus d’un consul romain. Il n’avait sans doute étudié la biographie de notre poète que dans les commentateurs de Virgile, dont nous parlerons dans la suite de cette Notice.
[3] Ovide a dit (Tristes, liv. ii, élég. i, v. 445):
Nec fuit opprobrio celebrasse Lycorida Gallo,
Sed linguam nimio non tenuisse mero.
[4] Auguste s’était réservé le commandement des provinces les plus riches, et les faisait gouverner par des préfets qu’il révoquait à son gré. Les autres étaient données par le sénat, comme au temps de la république.
[5] On a cru que c’était Antoine le triumvir, parce que Cicéron a écrit plusieurs fois, notamment dans ses Lettres à Atticus, qu’Antoine promenait avec lui dans ses expéditions la comédienne Cythéris. La ressemblance de nom a donc trompé plusieurs critiques, et, parmi eux, Scaliger. En effet, l’une des lettres de Cicéron porte la date de 704, et Gallus n’avait que seize ans: il était par conséquent impossible qu’il eût aimé, qu’il eût écrit quatre livres d’élégies en l’honneur de Lycoris, et qu’ensuite il en eût été abandonné. D’un autre côté, on croit pouvoir affirmer que la dixième églogue de Virgile a été composée onze ans avant la mort de Gallus, c’est-à-dire en 716. Il aurait fallu assurément que Gallus fût bien inconsolable, pour que son ami se crût obligé de lui rendre le courage douze ans après la fuite de son infidèle.
Cette notice était déjà sous presse, lorsque j’ai trouvé le même calcul fait par l’abbé Souchay (Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. t. xvi, 1751). Son travail avait probablement échappé aux modernes biographes de Gallus.
[6] ...... Hos tibi dant calamos, en accipe, Musæ,
Ascræo quos ante seni: quibus ille solebat
Cantando rigidas deducere montibus ornos.
His tibi Grynœi nemoris dicatur origo:
Ne quis sit lucus quo se plus jactet Apollo.
(Bucol., ecl. vi, v. 69.)
[7] Gallus et Hesperiis, et Gallus notus Eois,
Et sua cum Gallo nota Lycoris erit.
(Amor. lib. i, eleg. 15, v. 29.)
[8] Missus ad Eoas legati munere partes.
[9] Atque aliquis, cui læta foret bene nota voluptas.
Cantet; cantantem Maximianus amat.
[10] Nomencl. ad Gloss. latinum.
[11] Histoire littéraire d’Aquilée, ch. iii, p. 50.
[12] Maximien a dû composer cependant d’autres vers, puisqu’il nous dit lui-même (élég. i, v. 11) que, dans sa jeunesse, « Sæpe pœtarum mendacia dulcia finsi. » Mais ces premiers essais ne sont point arrivés jusqu’à nous; et les pièces dont il est ici question, ou ne nous sont connues que par leurs titres, ou ne présentent, soit pour les idées, soit pour le style, aucune analogie avec ce qui nous reste de Maximien.
[13] « Innaham gelidos Tiberini fluminis undas. » (Eleg. i, v. 37.)
[14] « Sudorem cursu et campestri exercitio collectam nando juventus abluebat in Tiberi. » (De Acte milit., lib. i, c. 3.).
[15] Liv. I, lettre 21.
[16] Liv. IV, lettre 22.
[17] Pomponius donne Bobeti. C’est, dit-on, pour appuyer davantage son mensonge, en faisant disparaître un nom qui suffisait pour le prendre en quelque sorte en flagrant délit.
[18] Servius, dans son Commentaire sur la dixième églogue de Virgile, avait fait depuis longtemps la même méprise.
[19] Voyez liv. i, ch. 12 ; liv. vi, ch. 22, etc.
[20] Voyez M. CHARPENTIER DE SAINT-PREST, dans l’Étude sur Virgile, qui précède sa traduction des Bucoliques et des Géorgiques.
[21] Voyez le même, notes sur la quatrième églogue.
[22] On sait, en effet, que Donat, le biographe de Virgile, n’est pas le grammairien du troisième siècle dont la renommée était si grande, et dont Barth a si vivement regretté les écrits. Ceux que l’on a publiés pendant longtemps sous son nom, appartiennent à un grammairien d’un siècle plus rapproché de nous, Claude Tibère Donat, et sa Vie de Virgile est regardée par les critiques comme un tissu d’absurdités. Les remarques du savant Vossius ont fait enfin reconnaître et rectifier à ce sujet toute erreur.