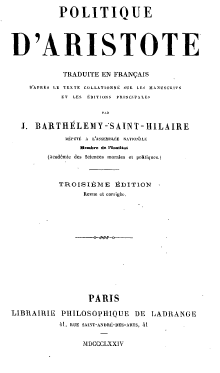
ARISTOTE
POLITIQUE
LIVRE III.
Traduction française : BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE.
LA POLITIQUE
LIVRE III
DE L'ÉTAT ET DU CITOYEN.
- THÉORIE DES GOUVERNEMENTS ET DE LA SOUVERAINETÉ.
- DE LA ROYAUTÉ.
|
De l'État et du citoyen ; conditions nécessaires du citoyen ; le domicile ne suffit pas ; le caractère distinctif du citoyen, c'est la participation aux fonctions de juge et de magistrat ; cette définition générale varie suivant les gouvernements, et s'applique surtout au citoyen de la démocratie ; insuffisance des définitions ordinaires. - De l'identité ou du changement de l'État dans ses rapports avec les citoyens; l'identité du sol ne constitue pas l'identité de l'État; l'État varie avec la constitution elle-même. |
||
|
[1274b] § 1. Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία τις, σχεδὸν πρώτη σκέψις περὶ πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γὰρ ἀμφισβητοῦσιν, οἱ μὲν φάσκοντες τὴν πόλιν πεπραχέναι τὴν πρᾶξιν, οἱ δ' οὐ τὴν πόλιν ἀλλὰ τὴν ὀλιγαρχίαν ἢ τὸν τύραννον· τοῦ δὲ πολιτικοῦ καὶ τοῦ νομοθέτου πᾶσαν ὁρῶμεν τὴν πραγματείαν οὖσαν περὶ πόλιν, ἡ δὲ πολιτεία τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἐστὶ τάξις τις. § 2. Ἐπεὶ δ' ἡ πόλις τῶν συγκειμένων, καθάπερ ἄλλο τι τῶν ὅλων μὲν συνεστώτων δ' ἐκ πολλῶν μορίων, δῆλον ὅτι πρότερον ὁ πολίτης ζητητέος· ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν τι πλῆθός ἐστιν. [1275a] Ὥστε τίνα χρὴ καλεῖν πολίτην καὶ τίς ὁ πολίτης ἐστὶ σκεπτέον. Καὶ γὰρ ὁ πολίτης ἀμφισβητεῖται πολλάκις· οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦσι πάντες εἶναι πολίτην· ἔστι γάρ ὅστις ἐν δημοκρατίᾳ πολίτης ὢν ἐν ὀλιγαρχίᾳ πολλάκις οὐκ ἔστι πολίτης. § 3. Τοὺς μὲν οὖν ἄλλως πως τυγχάνοντας ταύτης τῆς προσηγορίας, οἷον τοὺς ποιητοὺς πολίτας, ἀφετέον· ὁ δὲ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτης ἐστίν καὶ γὰρ μέτοικοι καὶ δοῦλοι κοινωνοῦσι τῆς οἰκήσεως, οὐδ' οἱ τῶν δικαίων μετέχοντες οὕτως ὥστε καὶ δίκην ὑπέχειν καὶ δικάζεσθαι (τοῦτο γὰρ ὑπάρχει καὶ τοῖς ἀπὸ συμβόλων κοινωνοῦσιν καὶ γὰρ ταῦτα τούτοις ὑπάρχει· πολλαχοῦ μὲν οὖν οὐδὲ τούτων τελέως οἱ μέτοικοι μετέχουσιν, ἀλλὰ νέμειν ἀνάγκη προστάτην, ὥστε ἀτελῶς πως μετέχουσι τῆς τοιαύτης κοινωνίας), § 4. ἀλλὰ καθάπερ καὶ παῖδας τοὺς μήπω δι' ἡλικίαν ἐγγεγραμμένους καὶ τοὺς γέροντας τοὺς ἀφειμένους φατέον εἶναι μέν πως πολίτας, οὐχ ἁπλῶς δὲ λίαν ἀλλὰ προστιθέντας τοὺς μὲν ἀτελεῖς τοὺς δὲ παρηκμακότας ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον - οὐδὲν γὰρ διαφέρει· δῆλον γὰρ τὸ λεγόμενον -. Ζητοῦμεν γὰρ τὸν ἁπλῶς πολίτην καὶ μηδὲν ἔχοντα τοιοῦτον ἔγκλημα διορθώσεως δεόμενον, ἐπεὶ καὶ περὶ τῶν ἀτίμων καὶ φυγάδων ἔστι τὰ τοιαῦτα καὶ διαπορεῖν καὶ λύειν. Πολίτης δ' ἁπλῶς οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὁρίζεται μᾶλλον ἢ τῷ μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς. Τῶν δ' ἀρχῶν αἱ μέν εἰσι διῃρημέναι κατὰ χρόνον, ὥστ' ἐνίας μὲν ὅλως δὶς τὸν αὐτὸν οὐκ ἔξεστιν ἄρχειν, ἢ διὰ τινῶν ὡρισμένων χρόνων· ὁ δ' ἀόριστος, οἷον ὁ δικαστὴς καὶ ὁ ἐκκλησιαστής. § 5. Τάχα μὲν οὖν ἂν φαίη τις οὐδ' ἄρχοντας εἶναι τοὺς τοιούτους, οὐδὲ μετέχειν διὰ ταῦτ' ἀρχῆς· καίτοι γελοῖον τοὺς κυριωτάτους ἀποστερεῖν ἀρχῆς. Ἀλλὰ διαφερέτω μηδέν· περὶ ὀνόματος γὰρ ὁ λόγος· ἀνώνυμον γὰρ τὸ κοινὸν ἐπὶ δικαστοῦ καὶ ἐκκλησιαστοῦ, τί δεῖ ταῦτ' ἄμφω καλεῖν. Ἔστω δὴ διορισμοῦ χάριν ἀόριστος ἀρχή. Τίθεμεν δὴ πολίτας τοὺς οὕτω μετέχοντας. Ὁ μὲν οὖν μάλιστ' ἂν ἐφαρμόσας πολίτης ἐπὶ πάντας τοὺς λεγομένους πολίτας σχεδὸν τοιοῦτός ἐστιν· § 6. δεῖ δὲ μὴ λανθάνειν ὅτι τῶν πραγμάτων ἐν οἷς τὰ ὑποκείμενα διαφέρει τῷ εἴδει, καὶ τὸ μὲν αὐτῶν ἐστι πρῶτον τὸ δὲ δεύτερον τὸ δ' ἐχόμενον, ἢ τὸ παράπαν οὐδὲν ἔνεστιν, ᾗ τοιαῦτα, τὸ κοινόν, ἢ γλίσχρως. Τὰς δὲ πολιτείας ὁρῶμεν εἴδει διαφερούσας ἀλλήλων, καὶ τὰς μὲν ὑστέρας τὰς δὲ προτέρας οὔσας· [1275b] τὰς γὰρ ἡμαρτημένας καὶ παρεκβεβηκυίας ἀναγκαῖον ὑστέρας εἶναι τῶν ἀναμαρτήτων (τὰς δὲ παρεκβεβηκυίας πῶς λέγομεν, ὕστερον ἔσται φανερόν). Ὥστε καὶ τὸν πολίτην ἕτερον ἀναγκαῖον εἶναι τὸν καθ' ἑκάστην πολιτείαν. Διόπερ ὁ λεχθεὶς ἐν μὲν δημοκρατίᾳ μάλιστ' ἐστὶ πολίτης, § 7. ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις ἐνδέχεται μέν, οὐ μὴν ἀναγκαῖον. Ἐν ἐνίαις γὰρ οὐκ ἔστι δῆμος, οὐδ' ἐκκλησίαν νομίζουσιν ἀλλὰ συγκλήτους, καὶ τὰς δίκας δικάζουσι κατὰ μέρος, οἷον ἐν Λακεδαίμονι τὰς τῶν συμβολαίων δικάζει τῶν ἐφόρων ἄλλος ἄλλας, οἱ δὲ γέροντες τὰς φονικάς, ἑτέρα δ' ἴσως ἀρχή τις ἑτέρας. Οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ περὶ Καρχηδόνα· πάσας γὰρ ἀρχαί τινες κρίνουσι τὰς δίκας. § 8. Ἀλλ' ἔχει διόρθωσιν ὁ τοῦ πολίτου διορισμός. Ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις πολιτείαις οὐχ ὁ ἀόριστος ἄρχων ἐκκλησιαστής ἐστι καὶ δικαστής, ἀλλὰ ὁ κατὰ τὴν ἀρχὴν ὡρισμένος· τούτων γὰρ ἢ πᾶσιν ἢ τισὶν ἀποδέδοται τὸ βουλεύεσθαι καὶ δικάζειν ἢ περὶ πάντων ἢ περὶ τινῶν. Τίς μὲν οὖν ἐστιν ὁ πολίτης, ἐκ τούτων φανερόν· ᾧ γὰρ ἐξουσία κοινωνεῖν ἀρχῆς βουλευτικῆς ἢ κριτικῆς, πολίτην ἤδη λέγομεν εἶναι ταύτης τῆς πόλεως, πόλιν δὲ τὸ τῶν τοιούτων πλῆθος ἱκανὸν πρὸς αὐτάρκειαν ζωῆς, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν. § 9. Ὁρίζονται δὲ πρὸς τὴν χρῆσιν πολίτην τὸν ἐξ ἀμφοτέρων πολιτῶν καὶ μὴ θατέρου μόνον, οἷον πατρὸς ἢ μητρός, οἱ δὲ καὶ τοῦτ' ἐπὶ πλέον ζητοῦσιν, οἷον ἐπὶ πάππους δύο ἢ τρεῖς ἢ πλείους. Οὕτω δὲ ὁριζομένων πολιτικῶς καὶ ταχέως, ἀποροῦσί τινες τὸν τρίτον ἐκεῖνον ἢ τέταρτον, πῶς ἔσται πολίτης. Γοργίας μὲν οὖν ὁ Λεοντῖνος, τὰ μὲν ἴσως ἀπορῶν τὰ δ' εἰρωνευόμενος, ἔφη, καθάπερ ὅλμους εἶναι τοὺς ὑπὸ τῶν ὁλμοποιῶν πεποιημένους, οὕτω καὶ Λαρισαίους τοὺς ὑπὸ τῶν δημιουργῶν πεποιημένους· εἶναι γάρ τινας λαρισοποιούς. Ἔστι δ' ἁπλοῦν. Εἰ γὰρ μετεῖχον κατὰ τὸν ῥηθέντα διορισμὸν τῆς πολιτείας, ἦσαν πολῖται· καὶ γὰρ οὐδὲ δυνατὸν ἐφαρμόττειν τὸ ἐκ πολίτου ἢ ἐκ πολίτιδος ἐπὶ τῶν πρώτων οἰκησάντων ἢ κτισάντων. § 10. Ἀλλ' ἴσως ἐκεῖνο μᾶλλον ἔχει ἀπορίαν, ὅσοι μετέσχον μεταβολῆς γενομένης πολιτείας, οἷον Ἀθήνησιν ἐποίησε Κλεισθένης μετὰ τὴν τῶν τυράννων ἐκβολήν· πολλοὺς γὰρ ἐφυλέτευσε ξένους καὶ δούλους μετοίκους. Τὸ δ' ἀμφισβήτημα πρὸς τούτους ἐστὶν οὐ τίς πολίτης, ἀλλὰ πότερον ἀδίκως ἢ δικαίως. Καίτοι κἂν τοῦτό τις ἔτι προσαπορήσειεν, [1276a] ἆρ' εἰ μὴ δικαίως πολίτης, οὐ πολίτης, ὡς ταὐτὸ δυναμένου τοῦ τ' ἀδίκου καὶ τοῦ ψευδοῦς. Ἐπεὶ δ' ὁρῶμεν καὶ ἄρχοντάς τινας ἀδίκως, οὓς ἄρχειν μὲν φήσομεν ἀλλ' οὐ δικαίως, ὁ δὲ πολίτης ἀρχῇ τινὶ διωρισμένος ἐστίν (ὁ γὰρ κοινωνῶν τῆς τοιᾶσδε ἀρχῆς πολίτης ἐστίν, ὡς ἔφαμεν), δῆλον ὅτι πολίτας μὲν εἶναι φατέον καὶ τούτους·
περὶ δὲ τοῦ δικαίως ἢ μὴ δικαίως
συνάπτει πρὸς τὴν εἰρημένην πρότερον ἀμφισβήτησιν. Ἀποροῦσι γάρ
τινες πόθ' ἡ πόλις ἔπραξε καὶ πότε οὐχ ἡ πόλις, οἷον ὅταν ἐξ
ὀλιγαρχίας ἢ τυραννίδος γένηται δημοκρατία (τότε γὰρ οὔτε τὰ
συμβόλαια ἔνιοι βούλονται διαλύειν, ὡς οὐ τῆς πόλεως ἀλλὰ τοῦ
τυράννου λαβόντος, οὔτ' ἄλλα πολλὰ τῶν τοιούτων, ὡς ἐνίας τῶν
πολιτειῶν τῷ κρατεῖν οὔσας, ἀλλὰ οὐ διὰ τὸ κοινῇ συμφέρον)· § 11.
εἴπερ οὖν καὶ δημοκρατοῦνταί τινες κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον, ὁμοίως
τῆς πόλεως φατέον εἶναι ταύτης τὰς τῆς πολιτείας ταύτης πράξεις καὶ
τὰς ἐκ τῆς ὀλιγαρχίας καὶ τῆς τυραννίδος. Ἔοικε δ' οἰκεῖος ὁ λόγος
εἶναι τῆς ἀπορίας ταύτης πως ποτὲ χρὴ λέγειν τὴν πόλιν εἶναι τὴν
αὐτὴν ἢ μὴ τὴν αὐτὴν ἀλλ' ἑτέραν. Ἡ μὲν οὖν ἐπιπολαιοτάτη τῆς
ἀπορίας ζήτησις περὶ τὸν τόπον καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐστίν· ἐνδέχεται
γὰρ διαζευχθῆναι τὸν τόπον καὶ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ τοὺς μὲν ἕτερον
τοὺς δ' ἕτερον οἰκῆσαι τόπον. Ταύτην μὲν οὖν πραοτέραν θετέον τὴν
ἀπορίαν, πολλαχῶς γὰρ τῆς πόλεως λεγομένης, ἐστί πως εὐμάρεια τῆς
τοιαύτης ζητήσεως· § 13. ἀλλὰ τῶν αὐτῶν κατοικούντων τὸν αὐτὸν τόπον, πότερον ἕως ἂν ᾖ τὸ γένος ταὐτὸ τῶν κατοικούντων, τὴν αὐτὴν εἶναι φατέον πόλιν, καίπερ αἰεὶ τῶν μὲν φθειρομένων τῶν δὲ γινομένων, ὥσπερ καὶ ποταμοὺς εἰώθαμεν λέγειν τοὺς αὐτοὺς καὶ κρήνας τὰς αὐτάς, καίπερ αἰεὶ τοῦ μὲν ἐπιγινομένου νάματος τοῦ δ' ὑπεξιόντος, ἢ τοὺς μὲν ἀνθρώπους φατέον εἶναι τοὺς αὐτοὺς διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν, τὴν δὲ πόλιν ἑτέραν; [1276b] Εἴπερ γάρ ἐστι κοινωνία τις ἡ πόλις, ἔστι δὲ κοινωνία πολιτῶν πολιτείας, γινομένης ἑτέρας τῷ εἴδει καὶ διαφερούσης τῆς πολιτείας ἀναγκαῖον εἶναι δόξειεν ἂν καὶ τὴν πόλιν εἶναι μὴ τὴν αὐτήν, ὥσπερ γε καὶ χορὸν ὁτὲ μὲν κωμικὸν ὁτὲ δὲ τραγικὸν ἕτερον εἶναί φαμεν, τῶν αὐτῶν πολλάκις ἀνθρώπων ὄντων, § 14. ὁμοίως δὲ καὶ πᾶσαν ἄλλην κοινωνίαν καὶ σύνθεσιν ἑτέραν, ἂν εἶδος ἕτερον ᾖ τῆς συνθέσεως, οἷον ἁρμονίαν τῶν αὐτῶν φθόγγων ἑτέραν εἶναι λέγομεν, ἂν ὁτὲ μὲν ᾖ Δώριος ὁτὲ δὲ Φρύγιος. Εἰ δὴ τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, φανερὸν ὅτι μάλιστα λεκτέον τὴν αὐτὴν πόλιν εἰς τὴν πολιτείαν βλέποντας· ὄνομα δὲ καλεῖν ἕτερον ἢ ταὐτὸν ἔξεστι καὶ τῶν αὐτῶν κατοικούντων αὐτὴν καὶ πάμπαν ἑτέρων ἀνθρώπων. § 15. Εἰ δὲ δίκαιον διαλύειν ἢ μὴ διαλύειν, ὅταν εἰς ἑτέραν μεταβάλῃ πολιτείαν ἡ πόλις, λόγος ἕτερος. |
[1274b] § 1. Quand on étudie la nature et l'espèce particulière des gouvernements divers, la première des questions, c'est de savoir ce qu'on entend par l'État. Dans le langage vulgaire, ce mot est fort équivoque; et tel acte pour les uns émane de l'État, qui pour les autres n'est que l'acte d'une minorité oligarchique ou d'un tyran. Pourtant l'homme politique et le législateur ont uniquement l'État en vue dans tous leurs travaux ; et le gouvernement n'est qu'une certaine organisation imposée à tous les membres de l'État. § 2. Mais l'État n'étant, comme tout autre système complet et formé de parties nombreuses, qu'une agrégation d'éléments, il faut évidemment se demander tout d'abord ce que c'est que le citoyen, puisque les citoyens, en certain nombre, sont les éléments mêmes de l'État. [1275a] Ainsi, recherchons en premier lieu à qui appartient le nom de citoyen et ce qu'il veut dire, question souvent controversée et sur laquelle les avis sont loin d'être unanimes, tel étant citoyen pour la démocratie, qui cesse souvent de l'être pour un État oligarchique. § 3. Nous écarterons de la discussion les citoyens qui ne le sont qu'en vertu d'un titre accidentel, comme ceux qu'on fait par un décret. On n'est pas citoyen par le fait seul du domicile ; car le domicile appartient encore aux étrangers domiciliés et aux esclaves. On ne l'est pas non plus par le seul droit d'ester en justice comme demandeur et comme défendeur ; car ce droit peut être conféré par un simple traité de commerce. Le domicile et l'action juridique peuvent donc appartenir à des gens qui ne sont pas citoyens. Tout au plus, dans quelques États, limite-t-on la jouissance pour les domiciliés on leur impose, par exemple, de se choisir une caution ; et c'est une restriction au droit qu'on leur accorde. § 4. Les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de l'inscription civique, et les vieillards qui en ont été rayés sont dans une position presque analogue : les uns et les autres sont bien certainement citoyens ; mais on ne peut leur donner ce titre d'une manière absolue, et l'on doit ajouter pour ceux-là qu'ils sont des citoyens incomplets ; pour ceux-ci, qu'ils sont des citoyens émérites. Qu'on adopte, si l'on veut, toute autre expression, les mots importent peu ; on comprend sans peine quelle est ma pensée. Ce que je cherche, c'est l'idée absolue du citoyen, dégagée de toutes les imperfections que nous venons de signaler. A l'égard des citoyens notés d'infamie et des exilés, mêmes difficultés et même solution. Le trait éminemment distinctif du vrai citoyen, c'est la jouissance des fonctions de juge et de magistrat. D'ailleurs les magistratures peuvent être tantôt temporaires, de façon à n'être jamais remplies deux fois par le même individu, ou bien limitées, suivant toute autre combinaison ; tantôt générales et sans limites, comme celles de juge et de membre de l'assemblée publique. § 5. On niera peut-être que ce soient là de véritables magistratures et qu'elles confèrent quelque pouvoir aux individus qui en jouissent ; mais il nous paraîtrait assez plaisant de n'accorder aucun pouvoir à ceux-là même qui possèdent la souveraineté. Du reste, j'attache à ceci peu d'importance ; c'est encore une question de mots. La langue n'a point de terme unique pour rendre l'idée de juge et de membre de l'assemblée publique ; j'adopte, afin de préciser cette idée, les mots de magistrature générale, et j'appelle citoyens tous ceux qui en jouissent. Cette définition du citoyen s'applique mieux que toute autre à ceux que l'on qualifie ordinairement de ce nom. § 6. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que, dans toute série de choses où les sujets sont spécifiquement dissemblables, il peut se faire que l'un soit premier, l'autre second, et ainsi de suite, et qu'il n'existe pourtant entre eux aucun rapport de communauté, dans la nature essentielle de ces choses, ou bien que ce rapport ne soit qu'indirect. De même, les constitutions se montrent à nous diverses dans leurs espèces, [1275b] celles-ci au dernier rang, celles-là au premier, puisqu'il faut bien placer les constitutions faussées et corrompues après celles qui ont conservé toute leur pureté : je dirai plus tard ce que j'entends par constitution corrompue. Dès lors, le citoyen varie nécessairement d'une constitution à l'autre, et le citoyen tel que nous l'avons défini est surtout le citoyen de la démocratie. § 7. Ceci ne veut pas dire qu'il ne puisse l'être encore ailleurs ; mais il ne l'y est pas nécessairement. Quelques constitutions ne reconnaissent pas de peuple ; au lieu d'assemblée publique, c'est un sénat ; et les fonctions de juge sont attribuées à des corps spéciaux, comme à Lacédémone, où les Éphores se partagent toutes les affaires civiles, où les Gérontes connaissent les affaires de meurtre, et où les autres causes peuvent ressortir encore à différents tribunaux ; et comme à Carthage, où quelques magistratures ont le privilège exclusif de tous les jugements. § 8. Notre définition du citoyen doit donc être modifiée en ce sens. Nulle part ailleurs que dans la démocratie, il n'existe de droit commun et illimité d'être membre de l'assemblée publique et d'être juge. Ce sont au contraire des pouvoirs tout spéciaux ; car on peut étendre à toutes les classes de citoyens, ou limiter à quelques-unes, la faculté de délibérer sur les affaires de l'État et celle de juger ; cette faculté même peut s'appliquer à tous les objets, ou bien être restreinte à quelques-uns. Donc évidemment, le citoyen, c'est l'individu qui peut avoir à l'assemblée publique et au tribunal voix délibérante, quel que soit d'ailleurs l'État dont il est membre ; et j'entends positivement par l'État une masse d'hommes de ce genre, qui possède tout ce qu'il lui faut pour fournir aux nécessités de l'existence. § 9. Dans le langage usuel, le citoyen est l'individu né d'un père citoyen et d'une mère citoyenne ; une seule des deux conditions ne suffirait pas. Quelques personnes poussent plus loin l'exigence et demandent deux ou trois ascendants, ou même davantage. Mais de cette définition, qu'on croit aussi simple que républicaine, naît une autre difficulté, c'est de savoir si ce troisième ou quatrième ancêtre est citoyen. Aussi, Gorgias de Léontium, moitié par embarras, moitié par moquerie, prétendait-il que les citoyens de Larisse étaient fabriqués par des ouvriers qui n'avaient que ce métier-là et qui fabriquaient des Larissiens comme un potier fabrique un pot. Pour nous, la question serait fort simple : ils étaient citoyens, s'ils jouissaient des droits énoncés dans notre définition ; car être né d'un père citoyen et d'une mère citoyenne, est une condition qu'on ne peut raisonnablement exiger des premiers habitants, des fondateurs de la cité. § 10. On révoquerait en doute avec plus de justice le droit de ceux qui n'ont été faits citoyens que par suite d'une révolution, comme Clisthène en fit tant après l'expulsion des tyrans à Athènes, en introduisant en foule dans les tribus les étrangers et les esclaves domiciliés. Pour ceux-là, la vraie question est de savoir, non pas s'ils sont citoyens, [1276a] mais s'ils le sont justement ou injustement. Il est vrai que, même à cet égard, on pourrait se demander encore si l'on est citoyen, quand on l'est injustement; l'injustice équivalant ici à une véritable erreur. Mais on peut répondre que nous voyons tous les jours des citoyens injustement promus aux fonctions publiques, n'en être pas moins magistrats à nos yeux, bien qu'ils ne le soient pas justement. Le citoyen est pour nous un individu investi d'un certain pouvoir ; il suffit donc de jouir de ce pouvoir pour être citoyen, comme nous l'avons dit ; et même les citoyens faits par Clisthène l'étaient bien positivement. Quant à la question de justice ou d'injustice, elle se rattache à celle que nous avions posée en premier lieu : tel acte est-il émané de l'État, ou n'en est-il pas émané ? C'est ce qui peut faire doute dans bien des cas. Ainsi, quand la démocratie succède à l'oligarchie ou à la tyrannie, bien des gens pensent qu'on doit décliner l'accomplissement des traités existants, contractés, disent-ils, non par l'État, mais par le tyran. Il n'est pas besoin de citer tant d'autres raisonnements du même genre, qui se fondent tous sur ce principe que le gouvernement n'a été qu'un fait de violence, sans aucun rapport à l'utilité générale. § 11. Si la démocratie, de son côté, a contracté des engagements, ses actes sont tout aussi bien actes de l'État que ceux de l'oligarchie et de la tyrannie. Ici, la vraie difficulté consiste à reconnaître dans quel cas on doit soutenir, ou que l'État est resté le même, ou qu'il n'est pas resté le même, mais qu'il est complètement changé. C'est un examen bien superficiel de la question que de considérer seulement le lieu et les individus ; car il peut arriver que l'État ait son chef-lieu isolé, et ses membres disséminés, ceux-ci résidant dans tel endroit, et ceux-là dans tel autre. La question ainsi envisagée deviendrait extrêmement simple ; et les acceptions diverses du mot cité suffisent sans peine à la résoudre. § 12. Mais à quoi reconnaîtra-t-on l'identité de la cité, quand le même lieu reste constamment occupé par des habitants ? Ce ne sont certainement pas les murailles qui constitueront cette unité ; car il serait possible en effet d'enclore d'un rempart continu le Péloponnèse entier. On a vu des cités avoir des dimensions presque aussi vastes, et représenter dans leur circonscription plutôt une nation qu'une ville : témoin Babylone prise par l'ennemi depuis trois jours, qu'un de ses quartiers l'ignorait encore. Du reste, nous trouverons ailleurs l'occasion de traiter utilement cette question ; l'étendue de la cité est un objet que l'homme politique ne doit pas négliger, de même qu'il doit s'enquérir des avantages d'une seule cité, ou de plusieurs, dans l'État. § 13. Mais admettons que le même lieu reste habité par les mêmes individus. Dès lors est-il possible, tant que la race des habitants reste la même, de soutenir que l'État est identique, malgré l'alternative continuelle des décès et des naissances, de même qu'on admet l'identité des fleuves et des sources, bien que les ondes s'en renouvellent et s'écoulent perpétuellement ? Ou bien doit-on prétendre que seulement les hommes restent les mêmes, mais que l'État change ? [1276b] L'État, en effet, est une sorte d'association ; s'il est une association de citoyens obéissant à une constitution, cette constitution venant à changer et à se modifier dans sa forme, il s'ensuit nécessairement, ce semble, que l'État ne reste pas identique ; c'est comme le choeur, qui, figurant tour à tour dans la comédie et dans la tragédie, est changé pour nous, bien que souvent il se compose des mêmes acteurs. § 14. Cette remarque s'applique également à toute autre association, à tout autre système, qu'on déclare changé quand l'espèce de la combinaison vient à l'être ; c'est comme l'harmonie, où les mêmes sons peuvent donner tantôt le mode dorien, tantôt le mode phrygien. Si donc ceci est vrai, c'est à la constitution surtout qu'il faut regarder pour prononcer sur l'identité de l'État. Il se peut, d'ailleurs, qu'il reçoive une dénomination différente, les individus qui le composent demeurant les mêmes; ou qu'il garde sa première dénomination, malgré le changement radical des individus. § 15. C'est d'ailleurs une autre question de savoir s'il convient, après une révolution, de remplir les engagements contractés ou de les rompre. |
§ 3. Aux étrangers domiciliés. Sur l'état des domiciliés, des métèques, voir Boeckh, Economie politique des Athéniens, L I, p. 130, et une excellente dissertation de Sainte-Groix, dans le tome XLVIIIe de l'Acad. des Insc. et Belles-Lettres. Une caution. Voir l'Isocrate de Coraï, t. II, p. 130, et les Remarques de Valois sur Harpocration, à ce mot. § 4. L'inscription civique. Sur le registre public, nommé à Athènes Leriarchique. § 6. Il ne faut pas perdre de vue. Le manuscrit 2023 de la Bibliothèque royale donne ici en marge une glose qui peut servir à expliquer ce passage ; la voici: « Prenons pour exemple le mot « chien », qui s'applique d'abord à l'animal domestique qui vit sur la terre ; puis, en second lieu, au poisson marin que nous connaissons; puis, en troisième lieu, à l'astre qui porte aussi ce nom ». Plus tard. Voir plus-bas, même livre, ch. V, § 4. § 7. A Lacédémone. Voir plus haut, liv. II, ch. VI, § 16. A Carthage. Voir plus haut, livre II, ch. VIII, § 4, l'analyse de la constitution carthaginoise. § 9. Gorgias. Gorgias de Léontium, sophiste, contemporain de Périclès. C'est le personnage qui a fourni son nom au fameux dialogue de Platon, et qui jouissait d'une très grande renommée. § 10. Clisthène. Ce fut Clisthène qui établit à Athènes dix tribus au lieu de quatre, vers la LXVIIIe olympiade, 508 ans av. J.-C. § 12. Depuis trois jours. Il s'agit ici de la prise de Babylone par Cyrus, et non par Alexandre, comme l'ont cru quelques commentateurs. Hérodote (Clio, chapitre CXCX, § 5, page 63, édition Firmin Didot) dit seulement que les ennemis étaient déjà maîtres du centre de la ville, que l'autre extrémité n'avait point encore appris l'attaque. II répète, du reste ceci comme une tradition dont il ne répond pas. Diodore (liv. II, ch. VII, § 3, p. 86, édit. Firmin Didot) donne à Babylone quatre cent quatre stades de tour, ou quatorze lieues. Hérodote (Clio, ch. CLXVIII, § 2, p. 59, édit. Firmin Didot) lui en donne plus de dix-sept, ou quatre cent quatre-vingts stades. C'est deux fois à peu près le circuit de Paris, y compris les fortifications. Londres est beaucoup plus grand. Ailleurs. Voir, livre IV (7), chapitre IV. §. 14. Dorien... Phrygien. Voir liv. V (8), ch. VII, § 8. |
|
Suite : la vertu du citoyen ne se confond pas tout à fait avec celle de l'homme privé; le citoyen a toujours rapport à l'État. La vertu de l'individu est absolue et sans rapports extérieurs qui la limitent. Ces deux vertus ne se confondent même pas dans la république parfaite ; elles ne sont réunies que dans le magistrat digne du commandement ; qualités fort diverses qu'exigent le commandement et l'obéissance, bien que le bon citoyen doive savoir également obéir et commander : la vertu spéciale du commandement, c'est la prudence. |
||
|
§ 1. Τῶν δὲ νῦν εἰρημένων ἐχόμενόν ἐστιν ἐπισκέψασθαι πότερον τὴν αὐτὴν ἀρετὴν ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ πολίτου σπουδαίου θετέον, ἢ μὴ τὴν αὐτήν. Ἀλλὰ μὴν εἴ γε τοῦτο τυχεῖν δεῖ ζητήσεως, τὴν τοῦ πολίτου τύπῳ τινὶ πρῶτον ληπτέον. Ὥσπερ οὖν ὁ πλωτὴρ εἷς τις τῶν κοινωνῶν ἐστιν, οὕτω καὶ τὸν πολίτην φαμέν. Τῶν δὲ πλωτήρων καίπερ ἀνομοίων ὄντων τὴν δύναμιν νὁ μὲν γάρ ἐστιν ἐρέτης, ὁ δὲ κυβερνήτης, ὁ δὲ πρῳρεύς, ὁ δ' ἄλλην τιν' ἔχων τοιαύτην ἐπωνυμίανν δῆλον ὡς ὁ μὲν ἀκριβέστατος ἑκάστου λόγος ἴδιος ἔσται τῆς ἀρετῆς, ὁμοίως δὲ καὶ κοινός τις ἐφαρμόσει πᾶσιν. Ἡ γὰρ σωτηρία τῆς ναυτιλίας ἔργον ἐστὶν αὐτῶν πάντων· τούτου γὰρ ἕκαστος ὀρέγεται τῶν πλωτήρων. § 2. Ὁμοίως τοίνυν καὶ τῶν πολιτῶν, καίπερ ἀνομοίων ὄντων, ἡ σωτηρία τῆς κοινωνίας ἔργον ἐστί, κοινωνία δ' ἐστὶν ἡ πολιτεία· διὸ τὴν ἀρετὴν ἀναγκαῖον εἶναι τοῦ πολίτου πρὸς τὴν πολιτείαν. Εἴπερ οὖν ἔστι πλείω πολιτείας εἴδη, δῆλον ὡς οὐκ ἐνδέχεται τοῦ σπουδαίου πολίτου μίαν ἀρετὴν εἶναι, τὴν τελείαν· τὸν δ' ἀγαθὸν ἄνδρα φαμὲν κατὰ μίαν ἀρετὴν εἶναι τὴν τελείαν. Ὅτι μὲν οὖν ἐνδέχεται πολίτην ὄντα σπουδαῖον μὴ κεκτῆσθαι τὴν ἀρετὴν καθ' ἣν σπουδαῖος ἀνήρ, φανερόν· § 3. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ κατ' ἄλλον τρόπον ἔστι διαποροῦντας ἐπελθεῖν τὸν αὐτὸν λόγον περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας. Εἰ γὰρ ἀδύνατον ἐξ ἁπάντων σπουδαίων ὄντων εἶναι πόλιν, δεῖ γ' ἕκαστον τὸ καθ' αὑτὸν ἔργον εὖ ποιεῖν, τοῦτο δὲ ἀπ' ἀρετῆς· ἐπειδὴ ἀδύνατον ὁμοίους εἶναι πάντας τοὺς πολίτας, [1277a] οὐκ ἂν εἴη μία ἀρετὴ πολίτου καὶ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ. Τὴν μὲν γὰρ τοῦ σπουδαίου πολίτου δεῖ πᾶσιν ὑπάρχειν (οὕτω γὰρ ἀρίστην ἀναγκαῖον εἶναι τὴν πόλιν), τὴν δὲ τοῦ ἀνδρὸς τοῦ ἀγαθοῦ ἀδύνατον, εἰ μὴ πάντας ἀναγκαῖον ἀγαθοὺς εἶναι τοὺς ἐν τῇ σπουδαίᾳ πόλει πολίτας. § 4. Ἔτι ἐπεὶ ἐξ ἀνομοίων ἡ πόλις, ὥσπερ ζῷον εὐθὺς ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, καὶ ψυχὴ ἐκ λόγου καὶ ὀρέξεως, καὶ οἰκία ἐξ ἀνδρὸς καὶ γυναικός, καὶ κτῆσις ἐκ δεσπότου καὶ δούλου, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ πόλις ἐξ ἁπάντων τε τούτων καὶ πρὸς τούτοις ἐξ ἄλλων ἀνομοίων συνέστηκεν εἰδῶν, ἀνάγκη μὴ μίαν εἶναι τὴν τῶν πολιτῶν πάντων ἀρετήν, ὥσπερ οὐδὲ τῶν χορευτῶν κορυφαίου καὶ παραστάτου. § 5. Διότι μὲν τοίνυν ἁπλῶς οὐχ ἡ αὐτή, φανερὸν ἐκ τούτων· ἀλλ' ἆρα ἔσται τινὸς ἡ αὐτὴ ἀρετὴ πολίτου τε σπουδαίου καὶ ἀνδρὸς σπουδαίου; Φαμὲν δὴ τὸν ἄρχοντα τὸν σπουδαῖον ἀγαθὸν εἶναι καὶ φρόνιμον, τὸν δὲ πολίτην οὐκ ἀναγκαῖον εἶναι φρόνιμον. Καὶ τὴν παιδείαν δ' εὐθὺς ἑτέραν εἶναι λέγουσί τινες ἄρχοντος, ὥσπερ καὶ φαίνονται οἱ τῶν βασιλέων υἱεῖς ἱππικὴν καὶ πολεμικὴν παιδευόμενοι, καὶ Εὐριπίδης φησὶ Μή μοι τὰ κόμψ' . . . Ἀλλ' ὧν πόλει δεῖ, ὡς οὖσάν τινα ἄρχοντος παιδείαν. § 6. Εἰ δὲ ἡ αὐτὴ ἀρετὴ ἄρχοντός τε ἀγαθοῦ καὶ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ, πολίτης δ' ἐστὶ καὶ ὁ ἀρχόμενος, οὐχ ἡ αὐτὴ ἁπλῶς ἂν εἴη πολίτου καὶ ἀνδρός, τινὸς μέντοι πολίτου· οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ ἄρχοντος καὶ πολίτου, καὶ διὰ τοῦτ' ἴσως Ἰάσων ἔφη πεινῆν ὅτε μὴ τυραννοῖ, ὡς οὐκ ἐπιστάμενος ἰδιώτης εἶναι. § 7. Ἀλλὰ μὴν ἐπαινεῖταί γε τὸ δύνασθαι ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι, καὶ πολίτου δοκεῖ που ἡ ἀρετὴ εἶναι τὸ δύνασθαι καὶ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι καλῶς. Εἰ οὖν τὴν μὲν τοῦ ἀγαθοῦ ἀνδρὸς τίθεμεν ἀρχικήν, τὴν δὲ τοῦ πολίτου ἄμφω, οὐκ ἂν εἴη ἄμφω ἐπαινετὰ ὁμοίως. Ἐπεὶ οὖν ποτε δοκεῖ ἀμφότερα, καὶ οὐ ταὐτὰ δεῖν τὸν ἄρχοντα μανθάνειν καὶ τὸν ἀρχόμενον, τὸν δὲ πολίτην ἀμφότερ' ἐπίστασθαι καὶ μετέχειν ἀμφοῖν, ... Κἀντεῦθεν ἂν κατίδοι τις. § 8. Ἔστι γὰρ ἀρχὴ δεσποτική· ταύτην δὲ τὴν περὶ τὰ ἀναγκαῖα λέγομεν, ἃ ποιεῖν ἐπίστασθαι τὸν ἄρχοντα οὐκ ἀναγκαῖον, ἀλλὰ χρῆσθαι μᾶλλον· θάτερον δὲ καὶ ἀνδραποδῶδες. Λέγω δὲ θάτερον τὸ δύνασθαι καὶ ὑπηρετεῖν τὰς διακονικὰς πράξεις. Δούλου δ' εἴδη πλείω λέγομεν· αἱ γὰρ ἐργασίαι πλείους. Ὧν ἓν μέρος κατέχουσιν οἱ χερνῆτες· οὗτοι δ' εἰσίν, ὥσπερ σημαίνει καὶ τοὔνομ' αὐτούς, οἱ ζῶντες ἀπὸ τῶν χειρῶν, [1277b] ἐν οἷς ὁ βάναυσος τεχνίτης ἐστίν. Διὸ παρ' ἐνίοις οὐ μετεῖχον οἱ δημιουργοὶ τὸ παλαιὸν ἀρχῶν, πρὶν δῆμον γενέσθαι τὸν ἔσχατον. § 9. Τὰ μὲν οὖν ἔργα τῶν ἀρχομένων οὕτως οὐ δεῖ τὸν ἀγαθὸν οὐδὲ τὸν πολιτικὸν οὐδὲ τὸν πολίτην τὸν ἀγαθὸν μανθάνειν, εἰ μή ποτε χρείας χάριν αὐτῷ πρὸς αὑτόν· (οὐ γὰρ ἔτι συμβαίνει γίνεσθαι τὸν μὲν δεσπότην τὸν δὲ δοῦλον). Ἀλλ' ἔστι τις ἀρχὴ καθ' ἣν ἄρχει τῶν ὁμοίων τῷ γένει καὶ τῶν ἐλευθέρων. Ταύτην γὰρ λέγομεν εἶναι τὴν πολιτικὴν ἀρχήν, ἣν δεῖ τὸν ἄρχοντα ἀρχόμενον μαθεῖν, οἷον ἱππαρχεῖν ἱππαρχηθέντα, στρατηγεῖν στρατηγηθέντα καὶ ταξιαρχήσαντα καὶ λοχαγήσαντα. Διὸ λέγεται καὶ τοῦτο καλῶς, ὡς οὐκ ἔστιν εὖ ἄρξαι μὴ ἀρχθέντα. § 10. Τούτων δὲ ἀρετὴ μὲν ἑτέρα, δεῖ δὲ τὸν πολίτην τὸν ἀγαθὸν ἐπίστασθαι καὶ δύνασθαι καὶ ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν, καὶ αὕτη ἀρετὴ πολίτου, τὸ τὴν τῶν ἐλευθέρων ἀρχὴν ἐπίστασθαι ἐπ' ἀμφότερα. Καὶ ἀνδρὸς δὴ ἀγαθοῦ ἄμφω, καὶ εἰ ἕτερον εἶδος σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης ἀρχικῆς. Καὶ γὰρ ἀρχομένου μὲν ἐλευθέρου δὲ δῆλον ὅτι οὐ μία ἂν εἴη τοῦ ἀγαθοῦ ἀρετή, οἷον δικαιοσύνη, ἀλλ' εἴδη ἔχουσα καθ' ἃ ἄρξει καὶ ἄρξεται, ὥσπερ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἑτέρα σωφροσύνη καὶ ἀνδρεία (δόξαι γὰρ ἂν εἶναι δειλὸς ἀνήρ, εἰ οὕτως ἀνδρεῖος εἴη ὥσπερ γυνὴ ἀνδρεία, καὶ γυνὴ λάλος, εἰ οὕτω κοσμία εἴη ὥσπερ ὁ ἀνὴρ ὁ ἀγαθός· ἐπεὶ καὶ οἰκονομία ἑτέρα ἀνδρὸς καὶ γυναικός· τοῦ μὲν γὰρ κτᾶσθαι τῆς δὲ φυλάττειν ἔργον ἐστίν). § 11. Ἡ δὲ φρόνησις ἄρχοντος ἴδιος ἀρετὴ μόνη. Τὰς γὰρ ἄλλας ἔοικεν ἀναγκαῖον εἶναι κοινὰς καὶ τῶν ἀρχομένων καὶ τῶν ἀρχόντων, ἀρχομένου δέ γε οὐκ ἔστιν ἀρετὴ φρόνησις, ἀλλὰ δόξα ἀληθής· ὥσπερ αὐλοποιὸς γὰρ ὁ ἀρχόμενος, ὁ δ' ἄρχων αὐλητὴς ὁ χρώμενος.
§ 12. Πότερον μὲν οὖν ἡ αὐτὴ ἀρετὴ
ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ πολίτου σπουδαίου ἢ ἑτέρα, καὶ πῶς ἡ αὐτὴ καὶ πῶς
ἑτέρα, φανερὸν ἐκ τούτων. |
§ 1. Une question qui fait suite à celle-ci, c'est de savoir s'il existe identité entre la vertu de l'individu privé et la vertu du citoyen ; ou bien, si elles diffèrent l'une de l'autre. Pour procéder régulièrement à cette recherche, il faut d'abord nous faire une idée de la vertu du citoyen. Le citoyen, comme le matelot, est membre d'une association. A bord du navire, quoique chacun ait un emploi différent, que l'un soit rameur, l'autre pilote, celui--ci second, celui-là chargé de telle autre fonction, il est clair que, malgré les appellations et les fonctions qui constituent à proprement parler une vertu spéciale pour chacun d'eux, tous concourent néanmoins à un but commun, c'est-à-dire au salut de l'équipage, que tous assurent pour leur part, et que chacun d'entre eux recherche également. § 2. Les membres de la cité ressemblent exactement aux matelots : malgré la différence de leurs emplois, le salut de l'association est leur oeuvre commune ; et l'association ici, c'est l'État. La vertu du citoyen se rapporte donc exclusivement à l'État. Mais comme l'État revêt bien des formes diverses, il est clair que la vertu du citoyen dans sa perfection ne peut être une ; la vertu qui fait l'homme de bien, au contraire, est une et absolue. De là, cette conclusion évidente, que la vertu du citoyen peut être une tout autre vertu que celle de l'homme privé. § 3. On peut encore traiter cette question d'un point de vue différent, qui tient à la recherche de la république parfaite. S'il est impossible en effet que l'État ne compte parmi ses membres que des hommes de bien ; et chacun cependant doit y remplir scrupuleusement les fonctions qui lui sont confiées, ce qui suppose toujours quelque vertu ; comme il n'est pas moins impossible que tous les citoyens agissent tous identiquement, il faut dès lors avouer [1277a] qu'il ne peut exister d'identité entre la vertu politique et la vertu privée. Dans la république parfaite, la vertu civique doit appartenir à tous, puisqu'elle est la condition indispensable de la perfection de la cité ; mais il n'est pas possible que tous y possèdent la vertu de l'homme privé, à moins d'admettre que, dans cette cité modèle, tous les citoyens doivent nécessairement être gens de bien. § 4. Bien plus : l'État se forme d'éléments dissemblables ; et de même que l'être vivant se compose essentiellement d'une âme et d'un corps ; l'âme, de la raison et de l'instinct ; la famille, du mari et de la femme ; la propriété, du maître et de l'esclave ; de même tous ces éléments-là se trouvent dans l'État, accompagnés encore de bien d'autres non moins hétérogènes ; ce qui empêche nécessairement qu'il n'y ait unité de vertu pour tous les citoyens, de même qu'il ne peut y avoir unité d'emploi dans les choeurs, où l'un est coryphée et l'autre figurant. 5. Il est donc certain que la vertu du citoyen et la vertu prise en général, ne sont point absolument identiques. Mais qui donc pourra réunir cette double vertu du bon citoyen et de l'honnête homme ? Je l'ai dit : c'est le magistrat digne du commandement qu'il exerce et qui est à la fois vertueux et habile ; car l'habileté n'est pas moins nécessaire que la vertu à l'homme d'État. Aussi a-t-on dit qu'il fallait donner aux hommes destinés au pouvoir une éducation spéciale ; et de fait, nous voyons les enfants des rois apprendre tout particulièrement l'équitation et la politique. Euripide lui-même, quand il dit : Point de ces vains talents à l'État inutiles, semble croire qu'on peut apprendre à commander. § 6. Si donc la vertu du bon magistrat est identique à celle de l'homme de bien, et si l'on reste citoyen même en obéissant à un supérieur, la vertu du citoyen en général ne peut être dès lors absolument identique à celle dé l'homme honnête. Ce sera seulement la vertu d'un certain citoyen, puisque la vertu des citoyens n'est point identique à celle du magistrat qui les gouverne. C'était là sans doute la pensée de Jason, quand il disait : « qu'il mourrait de misère s'il cessait de régner, n'ayant point appris à vivre en simple particulier. » § 7. On n'en estime pas moins fort haut le talent de savoir également obéir et commander ; et c'est dans cette double perfection de commandement et d'obéissance, qu'on place ordinairement la suprême vertu du citoyen. Mais si le commandement doit être le partage de l'homme de bien, et que savoir obéir et savoir commander soient les talents indispensables du citoyen, on ne peut certainement pas dire qu'ils soient dignes de louanges absolument égales. On doit accorder ces deux points : d'abord, que l'être qui obéit et celui qui commande ne doivent pas apprendre tous deux les mêmes choses; et en second lieu, que le citoyen doit posséder l'un et l'autre talent de savoir tantôt jouir de l'autorité, et tantôt se résigner à l'obéissance. Voici comment on prouverait ces deux assertions. § 8. Il y a un pouvoir du maître ; et ainsi que nous l'avons reconnu, il n'est relatif qu'aux besoins indispensables de la vie ; il n'exige pas que l'être qui commande soit capable de travailler lui-même ; il exige bien plutôt qu'il sache employer ceux qui lui obéissent. Le reste appartient à l'esclave ; et j'entends par le reste, la force nécessaire pour accomplir tout le service domestique. Les espèces d'esclaves sont aussi nombreuses que le sont leurs métiers divers ; on pourrait bien ranger encore parmi eux les manoeuvres, qui, comme leur nom l'indique, vivent du travail de leurs mains. [1277b] Parmi les manoeuvres, on doit comprendre aussi tous les ouvriers des professions mécaniques ; et voilà pourquoi, dans quelques États, on a exclu les ouvriers des fonctions publiques, auxquelles ils n'ont pu atteindre qu'au milieu des excès de la démagogie. § 9. Mais ni l'homme vertueux, ni l'homme d'État, ni le bon citoyen n'ont besoin, si ce n'est quand ils peuvent y trouver leur utilité personnelle, de savoir tous ces travaux-là, comme les savent les hommes destinés à l'obéissance. Dans l'État, il ne s'agit plus ni de maître ni d'esclave : il n'y a qu'une autorité qui s'exerce à l'égard d'êtres libres et égaux par la naissance. C'est donc là l'autorité politique à laquelle le futur magistrat doit se former en obéissant d'abord lui-même, de même qu'on apprend à commander un corps de cavalerie, en étant simple cavalier ; à être général, en exécutant les ordres d'un général ; à conduire une phalange, un bataillon, en servant comme soldat dans l'une et dans l'autre. C'est donc dans ce sens qu'il est juste de soutenir que la seule et véritable école du commandement, c'est l'obéissance. § 10. Il n'en est pas moins certain que le mérite de l'autorité et celui de la soumission sont fort divers, bien que le bon citoyen doive réunir en lui la science et la force de l'obéissance et du commandement, et que sa vertu consiste précisément à connaître ces deux faces opposées du pouvoir qui s'applique aux êtres libres. Elles doivent être connues aussi de l'homme de bien ; et si la sagesse et l'équité du commandement sont tout autres que la sagesse et l'équité de l'obéissance, puisque le citoyen reste libre même lorsqu'il obéit, les vertus du citoyen, et, par exemple, sa sagesse, ne sauraient être constamment les mêmes ; elles doivent varier d'espèce selon qu'il obéit ou qu'il commande. C'est ainsi que le courage et la sagesse diffèrent complètement pour la femme et pour l'homme. Un homme paraîtrait lâche, s'il n'était brave que comme l'est une femme brave; une femme semblerait bavarde, si elle n'était réservée qu'autant que doit l'être l'homme qui sait se conduire. C'est ainsi que dans la famille les fonctions de l'homme et celles de la femme sont fort opposées, le devoir de l'un étant d'acquérir, et celui de l'autre de conserver. § 11. La seule vertu spéciale du commandement, c'est la prudence ; quant à toutes les autres, elles sont nécessairement l'apanage commun de ceux qui obéissent et de ceux qui commandent. La prudence n'est point une vertu de sujet ; la vertu propre du sujet, c'est une juste confiance en son chef ; le citoyen qui obéit est comme le fabricant de flûtes ; le citoyen qui commande est comme l'artiste qui doit se servir de l'instrument. § 12. Cette discussion a donc eu pour objet de faire voir jusqu'à quel point la vertu politique et la vertu privée sont identiques ou différentes, en quoi elles se confondent, et en quoi elles s'éloignent l'une de l'autre. |
§ 5. Point de ces vains talents. Aristote ne cite ici qu'un portion des deux vers d'Euripide ; Stobée nous les a conservés tout entiers (Sermo 45) ; ils sont tirés d'une pièce intitulée « Eole », que nous ne possédons pas. Voir l'édition de Firmin Didot, p. 626, frag. III. § 6. Jason. C'est sans doute le même Jason dont Aristote cite un mot qui passe pour fort sage (Rhétor., liv. I, XII, 20, p. 142 de ma traduction). Jason était tyran de Phères en Thessalie. Il fut assassiné dans la troisième année de !a CIIe olymp., en 375 av. J.-C., au moment où il méditait, contre la Grèce livrée à des guerres intestines, le projet qui, plus tard, réussit à Philippe le Macédonien. Voir Diodore de Sicile, liv. XV, p. 375, édition Firmin Didot. § 8. Ainsi que nous t'avons reconnu. Voir plus haut, liv. 1, ch. II, 21 et suiv. § 9. La seule et véritable école. C'était un des préceptes de Solon. Voir Stobée, p. 518. § 11. Une juste confiance en son chef. Le mot dont se sert Aristote a ici un sens tout spécial, que j'ai tiré logiquement de ce qui précède. Schneider a traduit opinio vera, ce qui ne veut rien dire de très précis bien que ce soit la traduction fidèle du grec. D'autres ont traduit « un jugement sain » ; mais un jugement sain parait devoir être bien plutôt le partage du chef qui commande que celui du sujet qui obéit. |
|
Suite et fin de la discussion sur le citoyen ; les ouvriers ne peuvent être citoyens dans un État bien constitué. Exceptions à ce principe ; position des ouvriers dans les aristocraties et les oligarchies ; nécessités auxquelles les États doivent parfois se soumettre. - Définition dernière du citoyen. |
||
|
§ 1. Περὶ δὲ τὸν πολίτην ἔτι λείπεταί τις τῶν ἀποριῶν. Ὡς ἀληθῶς γὰρ πότερον πολίτης ἐστὶν ᾧ κοινωνεῖν ἔξεστιν ἀρχῆς, ἢ καὶ τοὺς βαναύσους πολίτας θετέον; Εἰ μὲν οὖν καὶ τούτους θετέον οἷς μὴ μέτεστιν ἀρχῶν, οὐχ οἷόν τε παντὸς εἶναι πολίτου τὴν τοιαύτην ἀρετήν (οὗτος γὰρ πολίτης)· εἰ δὲ μηδεὶς τῶν τοιούτων πολίτης, ἐν τίνι μέρει θετέος ἕκαστος; Οὐδὲ γὰρ μέτοικος οὐδὲ ξένος. Ἢ διά γε τοῦτον τὸν λόγον οὐδὲν φήσομεν συμβαίνειν ἄτοπον; [1278a] Οὐδὲ γὰρ οἱ δοῦλοι τῶν εἰρημένων οὐδέν, οὐδ' οἱ ἀπελεύθεροι. § 2. Τοῦτο γὰρ ἀληθές, ὡς οὐ πάντας θετέον πολίτας ὧν ἄνευ οὐκ ἂν εἴη πόλις, ἐπεὶ οὐδ' οἱ παῖδες ὡσαύτως πολῖται καὶ οἱ ἄνδρες, ἀλλ' οἱ μὲν ἁπλῶς οἱ δ' ἐξ ὑποθέσεως· πολῖται μὲν γάρ εἰσιν, ἀλλ' ἀτελεῖς. Ἐν μὲν οὖν τοῖς ἀρχαίοις χρόνοις παρ' ἐνίοις ἦν δοῦλον τὸ βάναυσον ἢ ξενικόν, διόπερ οἱ πολλοὶ τοιοῦτοι καὶ νῦν· ἡ δὲ βελτίστη πόλις οὐ ποιήσει βάναυσον πολίτην. Εἰ δὲ καὶ οὗτος πολίτης, ἀλλὰ πολίτου ἀρετὴν ἣν εἴπομεν λεκτέον οὐ παντός, οὐδ' ἐλευθέρου μόνον, ἀλλ' ὅσοι τῶν ἔργων εἰσὶν ἀφειμένοι τῶν ἀναγκαίων. § 3. Τῶν δ' ἀναγκαίων οἱ μὲν ἑνὶ λειτουργοῦντες τὰ τοιαῦτα δοῦλοι, οἱ δὲ κοινοὶ βάναυσοι καὶ θῆτες. Φανερὸν δ' ἐντεῦθεν μικρὸν ἐπισκεψαμένοις πῶς ἔχει περὶ αὐτῶν· αὐτὸ γὰρ φανὲν τὸ λεχθὲν ποιεῖ δῆλον. Ἐπεὶ γὰρ πλείους εἰσὶν αἱ πολιτεῖαι, καὶ εἴδη πολίτου ἀναγκαῖον εἶναι πλείω, καὶ μάλιστα τοῦ ἀρχομένου πολίτου, ὥστ' ἐν μὲν τινὶ πολιτείᾳ τὸν βάναυσον ἀναγκαῖον εἶναι καὶ τὸν θῆτα πολίτας, ἐν τισὶ δ' ἀδύνατον, οἷον εἴ τίς ἐστιν ἣν καλοῦσιν ἀριστοκρατικὴν καὶ ἐν ᾗ κατ' ἀρετὴν αἱ τιμαὶ δίδονται καὶ κατ' ἀξίαν· οὐ γὰρ οἷόν τ' ἐπιτηδεῦσαι τὰ τῆς ἀρετῆς ζῶντα βίον βάναυσον ἢ θητικόν. § 4. Ἐν δὲ ταῖς ὀλιγαρχίαις θῆτα μὲν οὐκ ἐνδέχεται εἶναι πολίτην (ἀπὸ τιμημάτων γὰρ μακρῶν αἱ μεθέξεις τῶν ἀρχῶν), βάναυσον δὲ ἐνδέχεται· πλουτοῦσι γὰρ καὶ οἱ πολλοὶ τῶν τεχνιτῶν. Ἐν Θήβαις δὲ νόμος ἦν τὸν διὰ δέκα ἐτῶν μὴ ἀπεσχημένον τῆς ἀγορᾶς μὴ μετέχειν ἀρχῆς. Ἐν πολλαῖς δὲ πολιτείαις προσεφέλκει τινὰς καὶ τῶν ξένων ὁ νόμος· ὁ γὰρ ἐκ πολίτιδος ἔν τισι δημοκρατίαις πολίτης ἐστίν, § 5. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔχει καὶ τὰ περὶ τοὺς νόθους παρὰ πολλοῖς. Οὐ μὴν ἀλλ' ἐπεὶ δι' ἔνδειαν τῶν γνησίων πολιτῶν ποιοῦνται πολίτας τοὺς τοιούτους (διὰ γὰρ ὀλιγανθρωπίαν οὕτω χρῶνται τοῖς νόμοις), εὐποροῦντες δὴ ὄχλου κατὰ μικρὸν παραιροῦνται τοὺς ἐκ δούλου πρῶτον ἢ δούλης, εἶτα τοὺς ἀπὸ γυναικῶν, τέλος δὲ μόνον τοὺς ἐξ ἀμφοῖν ἀστῶν πολίτας ποιοῦσιν. § 6. Ὅτι μὲν οὖν εἴδη πλείω πολίτου, φανερὸν ἐκ τούτων, καὶ ὅτι λέγεται μάλιστα πολίτης ὁ μετέχων τῶν τιμῶν, ὥσπερ καὶ Ὅμηρος ἐποίησεν Ὡς εἴ τιν' ἀτίμητον μετανάστην· ὥσπερ μέτοικος γάρ ἐστιν ὁ τῶν τιμῶν μὴ μετέχων. Ἀλλ' ἐστὶν ὅπου τὸ τοιοῦτον ἐπικεκρυμμένον ἐστίν, ἀπάτης χάριν τῶν συνοικούντων ἐστίν. Πότερον μὲν οὖν ἑτέραν ἢ τὴν αὐτὴν θετέον,
[1278b] § 7. αθ' ἣν ἀνὴρ ἀγαθός
ἐστι καὶ πολίτης σπουδαῖος, δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι τινὸς μὲν
πόλεως ὁ αὐτὸς τινὸς δ' ἕτερος, κἀκεῖνος οὐ πᾶς ἀλλ' ὁ πολιτικὸς καὶ
κύριος ἢ δυνάμενος εἶναι κύριος, ἢ καθ' αὑτὸν ἢ μετ' ἄλλων, τῆς τῶν
κοινῶν ἐπιμελείας. |
§ 1. Il reste encore une question à résoudre à l'égard du citoyen. N'est-on réellement citoyen qu'autant que l'on peut entrer en participation du pouvoir, ou ne doit-on pas mettre aussi les artisans au rang des citoyens ? Si l'on donne ce titre même à des individus exclus du pouvoir public, dès lors le citoyen n'a plus en général la vertu et le caractère que nous lui avons assignés, puisque de l'artisan on fait un citoyen. Mais si l'on refuse ce titre aux artisans, quelle sera leur place dans la cité ? Ils n'appartiennent certainement ni à la classe des étrangers, ni à celle des domiciliés. On peut dire, il est vrai, qu'il n'y a rien là de fort singulier, [1278a] puisque ni les esclaves ni les affranchis n'appartiennent davantage aux classes dont nous venons de parler. § 2. Mais il est certain qu'on ne doit pas élever au rang de citoyens tous les individus dont l'État a cependant nécessairement besoin. Ainsi, les enfants ne sont pas citoyens comme les hommes : ceux-ci le sont d'une manière absolue ; ceux-là le sont en espérance, citoyens sans doute, mais citoyens imparfaits. Jadis, dans quelques États, tous les ouvriers étaient ou des esclaves ou des étrangers ; et dans la plupart, il en est encore de même aujourd'hui. Mais la constitution parfaite n'admettra jamais l'artisan parmi les citoyens. Si de l'artisan aussi l'on veut faire un citoyen, dès lors la vertu du citoyen, telle que nous l'avons définie, doit s'entendre, non pas de tous les hommes de la cité, non pas même de tous ceux qui ne sont que libres, elle doit s'entendre de ceux-là, seulement qui n'ont point à travailler nécessairement pour vivre. § 3. Travailler aux choses indispensables de la vie pour la personne d'un individu, c'est être esclave; travailler pour le public, c'est être ouvrier et mercenaire. Il suffit de donner à ces faits la moindre attention pour que la question soit parfaitement claire, dès qu'on la pose ainsi. En effet, les constitutions étant diverses, les espèces de citoyens le seront nécessairement autant qu'elles ; et ceci est vrai surtout du citoyen considéré en tant que sujet. Par conséquent, dans telle constitution, l'ouvrier et le mercenaire seront de toute nécessité des citoyens. Ailleurs, ils ne sauraient l'être en aucune façon, par exemple dans l'État que nous appelons aristocratique, où l'honneur des fonctions publiques se répartit à la vertu et à la considération ; car l'apprentissage de la vertu est incompatible avec une vie d'artisan et de manoeuvre. § 4. Dans les oligarchies, le mercenaire ne peut être citoyen, parce que l'accès des magistratures n'est ouvert qu'aux cens élevés ; mais l'artisan peut l'être, puisque la plupart des artisans parviennent à la fortune. A Thèbes, la loi écartait de toute fonction celui qui n'avait pas cessé le commerce depuis plus de dix ans. Presque tous les gouvernements ont appelé des étrangers au rang de citoyens; et dans quelques démocraties, le droit politique peut s'acquérir du chef de la mère. § 5. C'est ainsi qu'on a fait encore assez généralement des lois pour l'admission des bâtards ; mais c'est la pénurie seule de véritables citoyens qui en fait faire de cette sorte, et toutes ces lois n'ont d'autre source que la disette d'hommes. Quand, au contraire, la population abonde, on élimine d'abord les citoyens nés d'un père ou d'une mère esclaves, puis ceux qui sont citoyens seulement du côté des femmes, et enfin l'on n'admet que ceux dont le père et la mère étaient citoyens. § 6. Il y a donc évidemment des espèces diverses de citoyens, et celui-là seul l'est pleinement qui a sa part des pouvoirs publics. Si Homère fait dire à son Achille : ... Moi, traité comme un vil étranger ! c'est qu'à ses yeux on est un étranger dans la cité, quand on n'y participe pas aux fonctions publiques ; et partout où l'on a soin de dissimuler ces différences politiques, c'est uniquement dans la vue de donner le change à ceux qui n'ont que le domicile dans la cité. [1278b] § 7. Ainsi toute la discussion qui précède a montré comment la vertu de l'honnête homme et la vertu du bon citoyen sont identiques, et comment elles diffèrent; nous avons fait voir que dans tel État le citoyen et l'homme vertueux ne font qu'un, que dans tel autre ils se séparent ; et enfin que tout le monde n'est pas citoyen, mais que ce titre appartient seulement à l'homme politique qui est maître ou qui peut être maître, soit personnellement, soit collectivement, de s'occuper des intérêts communs. |
§ 2. La constitution parfaite n'admet jamais l'artisan... Toute cette théorie, qui nous paraît maintenant si fausse, découle des principes posés plus haut sur la nécessité du loisir pour les citoyens. Voir plus haut, liv. II, ch. VI, § 2. Aujourd'hui, des classes entières de citoyens, qui répondent aux artisans du philosophe grec, sont encore bannies par le fait de toute participation aux fonctions publiques, aux droits politiques ; mais légalement elles peuvent y parvenir. § 5. La disette des hommes. Il faut se rappeler que l'oliganthropie, la disette des hommes, est ce qui fit périr toutes les républiques anciennes. Ceci a été sensible surtout à Sparte. Voir plus haut, liv. II, ch. VI, § 12. Les États de l'antiquité n'avaient qu'un moyen de vivre : c'était de se retremper dans l'esclavage ; ils ont préféré mourir. Il n'a pas moins fallu que l'invasion des Barbares pour amener ce grand résultat dans l'Occident. § 6. Homère, Iliade, IX, vers 648. Toute la discussion qui précède. Voir plus haut la fin du ch. II. |
|
Division des gouvernements et des constitutions. - Idée générale et but de l'État ; amour instinctif de la vie et sociabilité dans l'homme ; le pouvoir, dans la communauté politique doit toujours avoir en vue lé bien des administrés. Ce principe sert à diviser les gouvernements en gouvernements d'intérêt général : ce sont les bons ; et en gouvernements d'intérêts particuliers : ce sont les gouvernements corrompus, dégénération des autres. |
||
|
§ 1. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα διώρισται, τὸ μετὰ ταῦτα σκεπτέον, πότερον μίαν θετέον πολιτείαν ἢ πλείους, κἂν εἰ πλείους, τίνες καὶ πόσαι, καὶ διαφοραὶ τίνες αὐτῶν εἰσιν. Ἔστι δὲ πολιτεία πόλεως τάξις τῶν τε ἄλλων ἀρχῶν καὶ μάλιστα τῆς κυρίας πάντων. Κύριον μὲν γὰρ πανταχοῦ τὸ πολίτευμα τῆς πόλεως, πολίτευμα δ' ἐστὶν ἡ πολιτεία. Λέγω δ' οἷον ἐν μὲν ταῖς δημοκρατίαις κύριος ὁ δῆμος, οἱ δ' ὀλίγοι τοὐναντίον ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις, φαμὲν δὲ καὶ πολιτείαν ἑτέραν εἶναι τούτων. Τὸν αὐτὸν δὲ τοῦτον ἐροῦμεν λόγον καὶ περὶ τῶν ἄλλων. § 2. Ὑποθετέον δὴ πρῶτον τίνος χάριν συνέστηκε πόλις, καὶ τῆς ἀρχῆς εἴδη πόσα τῆς περὶ ἄνθρωπον καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς ζωῆς. Εἴρηται δὴ κατὰ τοὺς πρώτους λόγους, ἐν οἷς περὶ οἰκονομίας διωρίσθη καὶ δεσποτείας, καὶ ὅτι φύσει μέν ἐστιν ἄνθρωπος ζῷον πολιτικόν. Διὸ καὶ μηδὲν δεόμενοι τῆς παρὰ ἀλλήλων βοηθείας οὐκ ἔλαττον ὀρέγονται τοῦ συζῆν· § 3. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸ κοινῇ συμφέρον συνάγει, καθ' ὅσον ἐπιβάλλει μέρος ἑκάστῳ τοῦ ζῆν καλῶς. Μάλιστα μὲν οὖν τοῦτ' ἐστὶ τέλος, καὶ κοινῇ πᾶσι καὶ χωρίς· συνέρχονται δὲ καὶ τοῦ ζῆν ἕνεκεν αὐτοῦ καὶ συνέχουσι τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν, ἴσως γὰρ ἔνεστί τι τοῦ καλοῦ μόριον καὶ κατὰ τὸ ζῆν αὐτὸ μόνον· ἂν μὴ τοῖς χαλεποῖς κατὰ τὸν βίον ὑπερβάλῃ λίαν, δῆλον δ' ὡς καρτεροῦσι πολλὴν κακοπάθειαν οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων γλιχόμενοι τοῦ ζῆν, ὡς ἐνούσης τινὸς εὐημερίας ἐν αὐτῷ καὶ γλυκύτητος φυσικῆς. § 4. Ἀλλὰ μὴν καὶ τῆς ἀρχῆς γε τοὺς λεγομένους τρόπους ῥᾴδιον διελεῖν· καὶ γὰρ ἐν τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις διοριζόμεθα περὶ αὐτῶν πολλάκις. Ἡ μὲν γὰρ δεσποτεία, καίπερ ὄντος κατ' ἀλήθειαν τῷ τε φύσει δούλῳ καὶ τῷ φύσει δεσπότῃ ταὐτοῦ συμφέροντος, ὅμως ἄρχει πρὸς τὸ τοῦ δεσπότου συμφέρον οὐδὲν ἧττον, πρὸς δὲ τὸ τοῦ δούλου κατὰ συμβεβηκός, οὐ γὰρ ἐνδέχεται φθειρομένου τοῦ δούλου σῴζεσθαι τὴν δεσποτείαν. § 5. Ἡ δὲ τέκνων ἀρχὴ καὶ γυναικὸς καὶ τῆς οἰκίας πάσης, ἣν δὴ καλοῦμεν οἰκονομικήν ἤτοι τῶν ἀρχομένων χάριν ἐστὶν ἢ κοινοῦ τινὸς ἀμφοῖν, καθ' αὑτὸ μὲν τῶν ἀρχομένων, ὥσπερ ὁρῶμεν καὶ τὰς ἄλλας τέχνας, [1279a] οἷον ἰατρικὴν καὶ γυμναστικήν, κατὰ συμβεβηκὸς δὲ κἂν αὐτῶν εἶεν. Οὐδὲν γὰρ κωλύει τὸν παιδοτρίβην ἕνα τῶν γυμναζομένων ἐνίοτ' εἶναι καὶ αὐτόν, ὥσπερ ὁ κυβερνήτης εἷς ἐστιν ἀεὶ τῶν πλωτήρων· ὁ μὲν οὖν παιδοτρίβης ἢ κυβερνήτης σκοπεῖ τὸ τῶν ἀρχομένων ἀγαθόν, ὅταν δὲ τούτων εἷς γένηται καὶ αὐτός, κατὰ συμβεβηκὸς μετέχει τῆς ὠφελείας. Ὁ μὲν γὰρ πλωτήρ, ὁ δὲ τῶν γυμναζομένων εἷς γίνεται, παιδοτρίβης ὤν. § 6. Διὸ καὶ τὰς πολιτικὰς ἀρχάς, ὅταν ᾖ κατ' ἰσότητα τῶν πολιτῶν συνεστηκυῖα καὶ καθ' ὁμοιότητα, κατὰ μέρος ἀξιοῦσιν ἄρχειν, πρότερον μέν, ᾗ πέφυκεν, ἀξιοῦντες ἐν μέρει λειτουργεῖν, καὶ σκοπεῖν τινα πάλιν τὸ αὑτοῦ ἀγαθόν, ὥσπερ πρότερον αὐτὸς ἄρχων ἐσκόπει τὸ ἐκείνου συμφέρον· νῦν δὲ διὰ τὰς ὠφελείας τὰς ἀπὸ τῶν κοινῶν καὶ τὰς ἐκ τῆς ἀρχῆς βούλονται συνεχῶς ἄρχειν, οἷον εἰ συνέβαινεν ὑγιαίνειν ἀεὶ τοῖς ἄρχουσι νοσακεροῖς οὖσιν. Καὶ γὰρ ἂν οὕτως ἴσως ἐδίωκον τὰς ἀρχάς. § 7. Φανερὸν τοίνυν ὡς ὅσαι μὲν πολιτεῖαι τὸ κοινῇ συμφέρον σκοποῦσιν, αὗται μὲν ὀρθαὶ τυγχάνουσιν οὖσαι κατὰ τὸ ἁπλῶς δίκαιον, ὅσαι δὲ τὸ σφέτερον μόνον τῶν ἀρχόντων, ἡμαρτημέναι πᾶσαι καὶ παρεκβάσεις τῶν ὀρθῶν πολιτειῶν· δεσποτικαὶ γάρ, ἡ δὲ πόλις κοινωνία τῶν ἐλευθέρων ἐστίν. § 8. Διωρισμένων δὲ τούτων ἐχόμενόν ἐστι τὰς πολιτείας ἐπισκέψασθαι, πόσαι τὸν ἀριθμὸν καὶ τίνες εἰσί, καὶ πρῶτον τὰς ὀρθὰς αὐτῶν· καὶ γὰρ αἱ παρεκβάσεις ἔσονται φανεραὶ τούτων διορισθεισῶν. |
§ 1. Ces points une fois fixés, la première question qui les suit, c'est celle-ci : Existe-t-il une ou plusieurs constitutions politiques ? Et s'il y en a plusieurs, quels en sont la nature, le nombre et les différences ? La constitution est ce qui détermine dans l'État l'organisation régulière de toutes les magistratures, mais surtout de la magistrature souveraine ; et le souverain de la cité, c'est en tous lieux le gouvernement. Le gouvernement est la constitution même. Je m'explique : par exemple, dans les démocraties, c'est le peuple qui est souverain ; dans les oligarchies, au contraire, c'est la minorité composée des riches ; aussi dit-on que les constitutions de la démocratie et de l'oligarchie sont essentiellement différentes, et nous appliquerons les mêmes distinctions à toutes les autres. § 2. Il faut d'abord rappeler ici quel est le but assigné par nous à l'État, et quelles sont les diversités que nous avons reconnues dans les pouvoirs, tant ceux qui s'appliquent à l'individu que ceux qui s'appliquent à la vie commune. Au début de ce traité, nous avons dit, en parlant de l'administration domestique et de l'autorité du maître, que l'homme est par sa nature un être sociable ; et j'entends par là que, même sans aucun besoin d'appui mutuel, les hommes désirent invinciblement la vie sociale. § 3. Ceci n'empêche pas que chacun d'eux n'y soit aussi poussé par son utilité particulière, et par le désir de trouver la part individuelle de bonheur qui lui doit revenir. C'est là certainement le but de tous en masse et de chacun en particulier; mais les hommes se réunissent aussi, ne fût-ce que pour le bonheur seul de vivre ; et cet amour de la vie est sans doute une des perfections de l'humanité. On s'attache à l'association politique, même quand on n'y trouve rien de plus que la vie, à moins que la somme des maux qu'elle cause ne vienne véritablement la rendre intolérable. Voyez en effet quel degré de misère supportent la plupart des hommes par le simple amour de la vie ; la nature semble y avoir mis pour eux une jouissance et une douceur inexprimables. § 4. Il est, du reste, bien facile de distinguer les divers genres de pouvoir dont nous voulons parler ici ; nous en traitons à plusieurs reprises dans nos ouvrages exotériques. Bien que l'intérêt du maître et l'intérêt de son esclave s'identifient, quand c'est le voeu réel de la nature qui assigne au maître et à l'esclave le rang qu'ils occupent tous deux, le pouvoir du maître a cependant pour objet direct l'avantage du maître, et pour objet accidentel, l'avantage de l'esclave, parce que, l'esclave une fois détruit, le pouvoir du maître disparaît avec lui. § 5. Le pouvoir du père sur les enfants, sur la femme et la famille entière, pouvoir que nous avons nommé domestique, a pour but l'intérêt des administrés, ou tout au plus un intérêt commun à eux et à celui qui les régit. Quoique ce pouvoir en lui-même soit fait surtout pour les administrés, il peut, [1279a] comme dans tant d'autres arts, la médecine, la gymnastique, tourner secondairement à l'avantage de celui qui gouverne. Ainsi, le gymnaste peut fort bien se mêler aux jeunes gens qu'il exerce, comme, à bord, le pilote' est toujours un des passagers. Le but du gymnaste, comme celui du pilote, c'est le bien de ceux qu'ils dirigent ; si l'un ou l'autre viennent se mêler à leurs subordonnés, ils ne prennent leur part de l'avantage commun qu'accidentellement, l'un comme simple matelot, l'autre comme élève, malgré sa qualité de professeur. § 6. Dans les pouvoirs politiques, lorsque la parfaite égalité des citoyens, tous semblables, en fait la base, chacun a droit d'exercer l'autorité à son tour. D'abord, chose toute naturelle, tous regardent cette alternative comme parfaitement légitime, et ils accordent à un autre le droit de décider par lui-même de leurs intérêts, comme ils ont eux-mêmes antérieurement décidé des siens ; mais, plus tard, les avantages que procurent le pouvoir et l'administration des intérêts généraux, inspirent à tous les hommes le désir de se perpétuer en charge ; et si la continuité du commandement pouvait seule infailliblement guérir une maladie dont ils seraient atteints, ils ne seraient certainement pas plus âpres à retenir l'autorité, une fois qu'ils en jouissent. § 7. Donc évidemment, toutes les constitutions qui ont en vue l'intérêt général sont pures, parce qu'elles pratiquent rigoureusement la justice. Toutes celles qui n'ont en vue que l'intérêt personnel des gouvernants, viciées dans leurs bases, ne sont que la corruption des bonnes constitutions ; elles tiennent de fort près au pouvoir du maître sur l'esclave, tandis qu'au contraire la cité n'est qu'une association d'hommes libres. § 8. Après les principes que nous venons de poser, nous pouvons examiner le nombre et la nature des constitutions, et nous nous occuperons d'abord des constitutions pures ; une fois que celles-ci seront déterminées, on reconnaîtra sans peine les constitutions corrompues. |
§ 1. Le souverain... c'est le gouvernement. Jusqu'à Rousseau, ce fut une opinion généralement reçue, que le gouvernement et le souverain sont tout un. Le Contrat social est le premier ouvrage, et c'est là un grand mérite, qui ait nettement tracé la limite. Aujourd'hui, personne ne s'y trompe. § 2. Au début de ce traité. Voir plus haut, liv. I, ch. II, § 10, et ch. III, § 1. § 4. Dans nos outrages exotériques. On sait que les ouvrages d'Aristote se divisaient en deux classes : ceux. qui moins profonds s'adressaient à la masse de ses élèves : c'étaient les «exotériques » ; et ceux qu'il gardait pour l'enseignement particulier de ses élèves les plus avancés : c'étaient les acroamatiques ». Voir la dissertation de M. Ravaisson, de la Métaphysique d'Aristote, t. I, p. 210. Il est évident par ce seul passage que la Politique appartient à la seconde classe d'ouvrages, qui se nommaient aussi « ésotériques », ouvrages philosophiques. Voir plus loin dans ce livre, ch. VII, § 1. L'intérêt du maître. Voir plus haut, liv. I, ch. II, § 13 et suiv. § 5. Le gymnaste, mot à mot le « pédotribe ». Le « pédotribe », comme son nom l'indique, est le professeur de gymnastique pour les enfants ; le gymnaste est pour les hommes faits. Le pédotribe était inférieur au gymnaste ; il n'enseignait que les mouvements ; le gymnaste, au contraire, était capable d'approprier les exercices aux divers tempéraments ; il avait une certaine science hygiénique, que l'autre ne possédait pas au même degré. § 7. Donc évidemment. Ce grand principe est incontestable. Platon l'avait déjà mis en pleine lumière, et Aristote est ici parfaitement fidèle aux enseignements de son maître. Voir les Lois, liv. IX, p. 194, trad. de M. Cousin, et la Républ., liv. V, p. 45, même traduction. Un des plus célèbres parmi les publicistes contemporains, le vénérable M. Destutt de Tracy, n'a trouvé rien de plus à dire dans son Commentaire sur Montesquieu (liv. II, p. 26). Il a divisé les gouvernements en deux classes, gouvernements nationaux ou d'intérêt général, et gouvernements spéciaux ou d'intérêt privé. C'est la division même d'Aristote. |
|
Division des gouvernements : gouvernements purs, royauté, aristocratie, république ; gouvernements corrompus, tyrannie, oligarchie, démagogie. - Les objections faites contre cette division générale ne reposent que sur des hypothèses, et non sur des faits. - Dissentiment des riches et des pauvres sur la justice et le droit politiques ; les uns et les autres ne voient qu'une partie de la vérité ; notion exacte et essentielle de la cité et de l'association politique, qui ont surtout en vue la vertu et le bonheur des associés, et non pas seulement la vie commune. Solution générale du litige entre la richesse et la pauvreté. |
||
|
§ 1. Ἐπεὶ δὲ πολιτεία μὲν καὶ πολίτευμα σημαίνει ταὐτόν, πολίτευμα δ' ἐστὶ τὸ κύριον τῶν πόλεων, ἀνάγκη δ' εἶναι κύριον ἢ ἕνα ἢ ὀλίγους ἢ τοὺς πολλούς, ὅταν μὲν ὁ εἷς ἢ οἱ ὀλίγοι ἢ οἱ πολλοὶ πρὸς τὸ κοινὸν συμφέρον ἄρχωσι, ταύτας μὲν ὀρθὰς ἀναγκαῖον εἶναι τὰς πολιτείας, τὰς δὲ πρὸς τὸ ἴδιον ἢ τοῦ ἑνὸς ἢ τῶν ὀλίγων ἢ τοῦ πλήθους παρεκβάσεις. Ἢ γὰρ οὐ πολίτας φατέον εἶναι τοὺς μετέχοντας, ἢ δεῖ κοινωνεῖν τοῦ συμφέροντος. § 2. Καλεῖν δ' εἰώθαμεν τῶν μὲν μοναρχιῶν τὴν πρὸς τὸ κοινὸν ἀποβλέπουσαν συμφέρον βασιλείαν, τὴν δὲ τῶν ὀλίγων μὲν πλειόνων δ' ἑνὸς ἀριστοκρατίαν (ἢ διὰ τὸ τοὺς ἀρίστους ἄρχειν, ἢ διὰ τὸ πρὸς τὸ ἄριστον τῇ πόλει καὶ τοῖς κοινωνοῦσιν αὐτῆς), ὅταν δὲ τὸ πλῆθος πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύηται συμφέρον, καλεῖται τὸ κοινὸν ὄνομα πασῶν τῶν πολιτειῶν, πολιτεία. § 3. Συμβαίνει δ' εὐλόγως· ἕνα μὲν γὰρ διαφέρειν κατ' ἀρετὴν ἢ ὀλίγους ἐνδέχεται, πλείους δ' ἤδη χαλεπὸν ἠκριβῶσθαι πρὸς πᾶσαν ἀρετήν, [1279b] ἀλλὰ μάλιστα τὴν πολεμικήν· αὕτη γὰρ ἐν πλήθει γίγνεται· διόπερ κατὰ ταύτην τὴν πολιτείαν κυριώτατον τὸ προπολεμοῦν καὶ μετέχουσιν αὐτῆς οἱ κεκτημένοι τὰ ὅπλα. § 4. παρεκβάσεις δὲ τῶν εἰρημένων τυραννὶς μὲν βασιλείας, ὀλιγαρχία δὲ ἀριστοκρατίας, δημοκρατία δὲ πολιτείας. Ἡ μὲν γὰρ τυραννίς ἐστι μοναρχία πρὸς τὸ συμφέρον τὸ τοῦ μοναρχοῦντος, ἡ δ' ὀλιγαρχία πρὸς τὸ τῶν εὐπόρων, ἡ δὲ δημοκρατία πρὸς τὸ συμφέρον τὸ τῶν ἀπόρων· πρὸς δὲ τὸ τῷ κοινῷ λυσιτελοῦν οὐδεμία αὐτῶν. Δεῖ δὲ μικρῷ διὰ μακροτέρων εἰπεῖν τίς ἑκάστη τούτων τῶν πολιτειῶν ἐστιν· καὶ γὰρ ἔχει τινὰς ἀπορίας, τῷ δὲ περὶ ἑκάστην μέθοδον φιλοσοφοῦντι καὶ μὴ μόνον ἀποβλέποντι πρὸς τὸ πράττειν οἰκεῖόν ἐστι τὸ μὴ παρορᾶν μηδέ τι καταλείπειν, ἀλλὰ δηλοῦν τὴν περὶ ἕκαστον ἀλήθειαν. § 5. Ἔστι δὲ τυραννὶς μὲν μοναρχία, καθάπερ εἴρηται, δεσποτικὴ τῆς πολιτικῆς κοινωνίας, ὀλιγαρχία δ' ὅταν ὦσι κύριοι τῆς πολιτείας οἱ τὰς οὐσίας ἔχοντες, δημοκρατία δὲ τοὐναντίον ὅταν οἱ μὴ κεκτημένοι πλῆθος οὐσίας ἀλλ' ἄποροι. Πρώτη δ' ἀπορία πρὸς τὸν διορισμόν ἐστιν. Εἰ γὰρ εἶεν οἱ πλείους, ὄντες εὔποροι, κύριοι τῆς πόλεως, δημοκρατία δ' ἐστὶν ὅταν ᾖ κύριον τὸ πλῆθος ὁμοίως δὲ πάλιν κἂν εἴ που συμβαίνοι τοὺς ἀπόρους ἐλάττους μὲν εἶναι τῶν εὐπόρων, κρείττους δ' ὄντας κυρίους εἶναι τῆς πολιτείας, ὅπου δ' ὀλίγον κύριον πλῆθος, ὀλιγαρχίαν εἶναί φασιν οὐκ ἂν καλῶς δόξειεν διωρίσθαι περὶ τῶν πολιτειῶν. § 6. Ἀλλὰ μὴν κἄν εἴ τις συνθεὶς τῇ μὲν εὐπορίᾳ τὴν ὀλιγότητα τῇ δ' ἀπορίᾳ τὸ πλῆθος οὕτω προσαγορεύῃ τὰς πολιτείας, ὀλιγαρχίαν μὲν ἐν ᾗ τὰς ἀρχὰς ἔχουσιν οἱ εὔποροι, ὀλίγοι τὸ πλῆθος ὄντες, δημοκρατίαν δὲ ἐν ᾗ οἱ ἄποροι, πολλοὶ τὸ πλῆθος ὄντες, ἄλλην ἀπορίαν ἔχει. Τίνας γὰρ ἐροῦμεν τὰς ἄρτι λεχθείσας πολιτείας, τὴν ἐν ᾗ πλείους οἱ εὔποροι καὶ τὴν ἐν ᾗ ἐλάττους οἱ ἄποροι, κύριοι δ' ἑκάτεροι τῶν πολιτειῶν, εἴπερ μηδεμία ἄλλη πολιτεία παρὰ τὰς εἰρημένας ἔστιν;§ 7. Ἔοικε τοίνυν ὁ λόγος ποιεῖν δῆλον ὅτι τὸ μὲν ὀλίγους ἢ πολλοὺς εἶναι κυρίους συμβεβηκός ἐστιν, τὸ μὲν ταῖς ὀλιγαρχίαις τὸ δὲ ταῖς δημοκρατίαις, διὰ τὸ τοὺς μὲν εὐπόρους ὀλίγους, πολλοὺς δ' εἶναι τοὺς ἀπόρους πανταχοῦ (διὸ καὶ οὐ συμβαίνει τὰς ῥηθείσας αἰτίας γίνεσθαι διαφορᾶς), ᾧ δὲ διαφέρουσιν ἥ τε δημοκρατία καὶ ἡ ὀλιγαρχία ἀλλήλων πενία καὶ πλοῦτός ἐστιν, [1280a] καὶ ἀναγκαῖον μέν, ὅπου ἂν ἄρχωσι διὰ πλοῦτον, ἄν τ' ἐλάττους ἄν τε πλείους, εἶναι ταύτην ὀλιγαρχίαν, ὅπου δ' οἱ ἄποροι, δημοκρατίαν, ἀλλὰ συμβαίνει, καθάπερ εἴπομεν, τοὺς μὲν ὀλίγους εἶναι τοὺς δὲ πολλούς. Εὐποροῦσι μὲν γὰρ ὀλίγοι, τῆς δὲ ἐλευθερίας μετέχουσι πάντες· δι' ἃς αἰτίας ἀμφισβητοῦσιν ἀμφότεροι τῆς πολιτείας. § 8. Ληπτέον δὲ πρῶτον τίνας ὅρους λέγουσι τῆς ὀλιγαρχίας καὶ δημοκρατίας, καὶ τί τὸ δίκαιον τό τε ὀλιγαρχικὸν καὶ δημοκρατικόν. Πάντες γὰρ ἅπτονται δικαίου τινός, ἀλλὰ μέχρι τινὸς προέρχονται, καὶ λέγουσιν οὐ πᾶν τὸ κυρίως δίκαιον. Οἷον δοκεῖ ἴσον τὸ δίκαιον εἶναι, καὶ ἔστιν, ἀλλ' οὐ πᾶσιν ἀλλὰ τοῖς ἴσοις· καὶ τὸ ἄνισον δοκεῖ δίκαιον εἶναι, καὶ γὰρ ἔστιν, ἀλλ' οὐ πᾶσιν ἀλλὰ τοῖς ἀνίσοις· οἱ δὲ τοῦτ' ἀφαιροῦσι, τὸ οἷς, καὶ κρίνουσι κακῶς. Τὸ δ' αἴτιον ὅτι περὶ αὑτῶν ἡ κρίσις· σχεδὸν δ' οἱ πλεῖστοι φαῦλοι κριταὶ περὶ τῶν οἰκείων. § 9. Ὥστ' ἐπεὶ τὸ δίκαιον τισίν, καὶ διῄρηται τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπί τε τῶν πραγμάτων καὶ οἷς, καθάπερ εἴρηται πρότερον ἐν τοῖς Ἠθικοῖς, τὴν μὲν τοῦ πράγματος ἰσότητα ὁμολογοῦσι, τὴν δὲ οἷς ἀμφισβητοῦσι, μάλιστα μὲν διὰ τὸ λεχθὲν ἄρτι, διότι κρίνουσι τὰ περὶ αὑτοὺς κακῶς, ἔπειτα δὲ καὶ διὰ τὸ λέγειν μέχρι τινὸς ἑκατέρους δίκαιόν τι νομίζουσι δίκαιον λέγειν ἁπλῶς. Οἱ μὲν γὰρ ἂν κατά τι ἄνισοι ὦσιν, οἷον χρήμασιν, ὅλως οἴονται ἄνισοι εἶναι, οἱ δ' ἂν κατά τι ἴσοι, οἷον ἐλευθερίᾳ, ὅλως ἴσοι. Τὸ δὲ κυριώτατον οὐ λέγουσιν. § 10. Εἰ μὲν γὰρ τῶν κτημάτων χάριν ἐκοινώνησαν καὶ συνῆλθον, τοσοῦτον μετέχουσι τῆς πόλεως ὅσον περ καὶ τῆς κτήσεως, ὥσθ' ὁ τῶν ὀλιγαρχικῶν λόγος δόξειεν ἂν ἰσχύειν (οὐ γὰρ εἶναι δίκαιον ἴσον μετέχειν τῶν ἑκατὸν μνῶν τὸν εἰσενέγκαντα μίαν μνᾶν τῷ δόντι τὸ λοιπὸν πᾶν, οὔτε τῶν ἐξ ἀρχῆς οὔτε τῶν ἐπιγινομένων)· § 11. εἰ δὲ μήτε τοῦ ζῆν μόνον ἕνεκεν ἀλλὰ μᾶλλον τοῦ εὖ ζῆν (καὶ γὰρ ἂν δούλων καὶ τῶν ἄλλων ζῴων ἦν πόλις· νῦν δ' οὐκ ἔστι, διὰ τὸ μὴ μετέχειν εὐδαιμονίας μηδὲ τοῦ ζῆν κατὰ προαίρεσιν), μήτε συμμαχίας ἕνεκεν, ὅπως ὑπὸ μηδενὸς ἀδικῶνται, μήτε διὰ τὰς ἀλλαγὰς καὶ τὴν χρῆσιν τὴν πρὸς ἀλλήλουσκαὶ γὰρ ἂν Τυρρηνοὶ καὶ Καρχηδόνιοι, καὶ πάντες οἷς ἔστι σύμβολα πρὸς ἀλλήλους, ὡς μιᾶς ἂν πολῖται πόλεως ἦσαν· εἰσὶ γοῦν αὐτοῖς συνθῆκαι περὶ τῶν εἰσαγωγίμων καὶ σύμβολα περὶ τοῦ μὴ ἀδικεῖν καὶ γραφαὶ περὶ συμμαχίας. [1280a] Ἀλλ' οὔτ' ἀρχαὶ πᾶσιν ἐπὶ τούτοις κοιναὶ καθεστᾶσιν, ἀλλ' ἕτεραι παρ' ἑκατέροις, οὔτε τοῦ ποίους τινὰς εἶναι δεῖ φροντίζουσιν ἅτεροι τοὺς ἑτέρους, οὐδ' ὅπως μηδεὶς ἄδικος ἔσται τῶν ὑπὸ τὰς συνθήκας μηδὲ μοχθηρίαν ἕξει μηδεμίαν, ἀλλὰ μόνον ὅπως μηδὲν ἀδικήσουσιν ἀλλήλους. Περὶ δ' ἀρετῆς καὶ κακίας πολιτικῆς διασκοποῦσιν ὅσοι φροντίζουσιν εὐνομίας. ᾟ καὶ φανερὸν ὅτι δεῖ περὶ ἀρετῆς ἐπιμελὲς εἶναι τῇ γ' ὡς ἀληθῶς ὀνομαζομένῃ πόλει, μὴ λόγου χάριν. Γίγνεται γὰρ ἡ κοινωνία συμμαχία, τῶν ἄλλων τόπῳ διαφέρουσα μόνον, τῶν ἄπωθεν συμμάχων. Καὶ ὁ νόμος συνθήκη καί, καθάπερ ἔφη Λυκόφρων ὁ σοφιστής, ἐγγυητὴς ἀλλήλοις τῶν δικαίων, ἀλλ' οὐχ οἷος ποιεῖν ἀγαθοὺς καὶ δικαίους τοὺς πολίτας. § 12. Ὅτι δὲ τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, φανερόν. Εἰ γάρ τις καὶ συναγάγοι τοὺς τόπους εἰς ἕν, ὥστε ἅπτεσθαι τὴν Μεγαρέων πόλιν καὶ Κορινθίων τοῖς τείχεσιν, ὅμως οὐ μία πόλις· οὐδ' εἰ πρὸς ἀλλήλους ἐπιγαμίας ποιήσαιντο· καίτοι τοῦτο τῶν ἰδίων ταῖς πόλεσι κοινωνημάτων ἐστίν. Ὁμοίως δ' οὐδ' εἴ τινες οἰκοῖεν χωρὶς μέν, μὴ μέντοι τοσοῦτον ἄπωθεν ὥστε μὴ κοινωνεῖν, ἀλλ' εἴησαν αὐτοῖς νόμοι τοῦ μὴ σφᾶς αὐτοὺς ἀδικεῖν περὶ τὰς μεταδόσεις, οἷον εἰ ὁ μὲν εἴη τέκτων ὁ δὲ γεωργὸς ὁ δὲ σκυτοτόμος ὁ δ' ἄλλο τι τοιοῦτον, καὶ τὸ πλῆθος εἶεν μύριοι, μὴ μέντοι κοινωνοῖεν ἄλλου μηδενὸς ἢ τῶν τοιούτων, οἷον ἀλλαγῆς καὶ συμμαχίας, οὐδ' οὕτω πω πόλις. § 13. Διὰ τίνα δή ποτ' αἰτίαν; Οὐ γὰρ δὴ διὰ τὸ μὴ σύνεγγυς τῆς κοινωνίας. Εἰ γὰρ καὶ συνέλθοιεν οὕτω κοινωνοῦντες ςἕκαστος μέντοι χρῷτο τῇ ἰδίᾳ οἰκίᾳ ὥσπερ πόλεἰ καὶ σφίσιν αὐτοῖς ὡς ἐπιμαχίας οὔσης βοηθοῦντες ἐπὶ τοὺς ἀδικοῦντας μόνον, οὐδ' οὕτως ἂν εἶναι δόξειεν πόλις τοῖς ἀκριβῶς θεωροῦσιν, εἴπερ ὁμοίως ὁμιλοῖεν συνελθόντες καὶ χωρίς. Φανερὸν τοίνυν ὅτι ἡ πόλις οὐκ ἔστι κοινωνία τόπου, καὶ τοῦ μὴ ἀδικεῖν σφᾶς αὐτοὺς καὶ τῆς μεταδόσεως χάριν· ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἀναγκαῖον ὑπάρχειν, εἴπερ ἔσται πόλις, οὐ μὴν οὐδ' ὑπαρχόντων τούτων ἁπάντων ἤδη πόλις, ἀλλ' ἡ τοῦ εὖ ζῆν κοινωνία καὶ ταῖς οἰκίαις καὶ τοῖς γένεσι, ζωῆς τελείας χάριν καὶ αὐτάρκους. § 14. Οὐκ ἔσται μέντοι τοῦτο μὴ τὸν αὐτὸν καὶ ἕνα κατοικούντων τόπον καὶ χρωμένων ἐπιγαμίαις. Διὸ κηδεῖαί τ' ἐγένοντο κατὰ τὰς πόλεις καὶ φατρίαι καὶ θυσίαι καὶ διαγωγαὶ τοῦ συζῆν. Τὸ δὲ τοιοῦτον φιλίας ἔργον· ἡ γὰρ τοῦ συζῆν προαίρεσις φιλία. Τέλος μὲν οὖν πόλεως τὸ εὖ ζῆν, ταῦτα δὲ τοῦ τέλους χάριν. Πόλις δὲ ἡ γενῶν καὶ κωμῶν κοινωνία ζωῆς τελείας καὶ αὐτάρκους, [1281a] τοῦτο δ' ἐστίν, ὡς φαμέν, τὸ ζῆν εὐδαιμόνως καὶ καλῶς. Τῶν καλῶν ἄρα πράξεων χάριν θετέον εἶναι τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν ἀλλ' οὐ τοῦ συζῆν. § 15. Διόπερ ὅσοι συμβάλλονται πλεῖστον εἰς τὴν τοιαύτην κοινωνίαν, τούτοις τῆς πόλεως μέτεστι πλεῖον ἢ τοῖς κατὰ μὲν ἐλευθερίαν καὶ γένος ἴσοις ἢ μείζοσι κατὰ δὲ τὴν πολιτικὴν ἀρετὴν ἀνίσοις, ἢ τοῖς κατὰ πλοῦτον ὑπερέχουσι κατ' ἀρετὴν δ' ὑπερεχομένοις. § 16. Ὅτι μὲν οὖν πάντες οἱ περὶ τῶν πολιτειῶν ἀμφισβητοῦντες μέρος τι τοῦ δικαίου λέγουσι, φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων. |
§ 1. Le gouvernement et la constitution étant choses identiques, et le gouvernement étant le maître suprême de la cité, il faut absolument que ce maître soit, ou un seul individu, ou une minorité, ou enfin la masse des citoyens. Quand le maître unique, ou la minorité, ou la majorité gouvernent dans l'intérêt général, la constitution est nécessairement pure ; quand ils gouvernent dans leur propre intérêt, soit dans l'intérêt d'un seul, soit dans l'intérêt de la minorité, soit dans l'intérêt de la foule, la constitution est déviée de son but, puisque de deux choses l'une : ou les membres de l'association ne sont pas vraiment citoyens ; ou, s'ils le sont, ils doivent avoir leur part de l'avantage commun. § 2. Quand la monarchie ou gouvernement d'un seul a pour objet l'intérêt général, on la nomme vulgairement royauté. Avec la même condition, le gouvernement de la minorité, pourvu qu'elle ne soit pas réduite à un seul individu, c'est l'aristocratie, ainsi nommée, soit parce que le pouvoir est aux mains des gens honnêtes, soit parce que le pouvoir n'a d'autre objet que le plus grand bien de l'État et des associés. Enfin, quand la majorité gouverne dans le sens de l'intérêt général, le gouvernement reçoit comme dénomination spéciale la dénomination générique de tous les gouvernements, et se nomme république. § 3. Ces différences de dénomination sont fort justes. Une vertu supérieure peut être le partage d'un individu, d'une minorité ; mais une majorité ne peut être désignée par aucune vertu spéciale, [1279b] excepté toutefois la vertu guerrière, qui se manifeste surtout dans les masses ; la preuve, c'est que, dans le gouvernement de la majorité, la partie la plus puissante de l'État est la partie guerrière ; et tous ceux qui ont des armes y sont citoyens. § 4. Les déviations de ces gouvernements sont : la tyrannie, pour la royauté ; l'oligarchie, pour l'aristocratie ; la démagogie, pour la république. La tyrannie est une monarchie qui n'a pour objet que l'intérêt personnel du monarque ; l'oligarchie n'a pour objet que l'intérêt particulier des riches ; la démagogie, celui des pauvres. Aucun de ces gouvernements ne songe à l'intérêt général. Il faut nous arrêter quelques instants à bien noter la différence de chacun de ces trois gouvernements, car la question offre des difficultés. Quand on observe les choses philosophiquement, et qu'on ne veut pas se borner seulement au fait pratique, on doit, quelque méthode d'ailleurs qu'on adopte, n'omettre aucun détail, et n'en négliger aucun, mais les montrer tous dans leur vrai jour. § 5. La tyrannie, comme je viens de le dire, est le gouvernement d'un seul, régnant en maître sur l'association politique ; l'oligarchie est la prédominance politique des riches ; et la démagogie, au contraire, la prédominance des pauvres, à l'exclusion des riches. On fait une première objection contre cette définition même. Si la majorité maîtresse de l'État est composée de riches, et que le gouvernement de la majorité soit appelé la démocratie ; et réciproquement, si, par hasard, les pauvres, en minorité relativement aux riches, sont cependant, par la supériorité de leurs forces, maîtres de l'État ; et si le gouvernement de la minorité doit être appelé l'oligarchie, les définitions que nous venons de donner deviennent inexactes. § 6. On ne résout même pas cette difficulté en réunissant les idées de richesse et de minorité, celles de misère et de majorité, et en réservant le nom d'oligarchie pour le gouvernement où les riches, en minorité, occupent les emplois, et celui de démagogie, pour l'État où les pauvres, en majorité, sont les maîtres. Car comment classer les deux formes de constitution que nous venons de supposer : l'une où les riches forment la, majorité, l'autre où les pauvres forment la minorité, souverains les uns et les autres de l'État ? si toutefois quelques autres formes politiques n'ont point échappé à notre énumération. § 7. Mais la raison nous dit assez que la domination de la minorité et celle de la majorité sont choses tout accidentelles, celle-ci dans les oligarchies, celle-là dans les démocraties, parce que les riches forment partout la minorité, comme les pauvres forment partout la majorité. Ainsi, les différences indiquées plus haut ne sont pas de véritables difficultés. Ce qui distingue essentiellement la démocratie et l'oligarchie, c'est la pauvreté et la richesse ; [1280a] et partout où le pouvoir est aux riches, majorité ou minorité, c'est une oligarchie ; partout où il est aux pauvres, c'est une démagogie. Mais il n'en est pas moins vrai, je le répète, que généralement les riches sont en minorité, les pauvres en majorité. La richesse n'est qu'à quelques-uns, mais la liberté est à tous. Ce sont-là, du reste, les causes des dissensions politiques entre les riches et les pauvres. § 8. Voyons d'abord quelles sont des deux parts les limites qu'on assigne à l'oligarchie et à la démagogie, et ce qu'on appelle le droit dans l'une et dans l'autre. Les deux côtés également revendiquent un certain droit qui est bien réel. Mais, de fait, leur justice ne va que jusqu'à un certain point; et ce n'est pas le droit absolu qu'établissent ni les uns, ni les autres. Ainsi, l'égalité paraît le droit commun, et sans doute elle l'est, non pas pour tous cependant, mais seulement entre égaux ; et de même pour l'inégalité : elle est certainement un droit, non pas pour tous, mais bien pour des individus inégaux entre eux. Si l'on fait abstraction des individus, on risque de porter un jugement erroné. C'est qu'ici les juges sont juges et parties ; et l'on est ordinairement mauvais juge dans sa propre cause. § 9. Le droit restreint à quelques-uns, pouvant s'appliquer aussi bien lux choses qu'aux personnes, comme je l'ai dit dans la Morale, l'on s'accorde sans peine sur l'égalité même de la chose, mais pas le moins du monde sur les personnes à qui cette égalité appartient ; et cela, je le répète, tient à ce qu'on juge toujours fort mal quand on est intéressé. Parce que les uns et les autres expriment une certaine portion du droit, ils croient qu'ils expriment le droit absolu : d'une part, supérieurs en un point, en richesse par exemple, les uns se croient supérieurs en tout ; d'autre part, égaux en un point, en liberté par exemple, les autres se croient absolument égaux. On oublie des deux côtés de dire l'objet capital. § 10. Si l'association politique n'était en effet formée qu'en vue des richesses, la part des associés serait dans l'État en proportion directe de leurs propriétés, et les partisans de l'oligarchie auraient alors pleine raison ; car il ne serait pas équitable que l'associé qui n'a mis qu'une mine sur cent, eût la même part que celui qui aurait fourni tout le reste, qu'on appliquât ceci à la première mise ou aux acquisitions postérieures. § 11. Mais l'association politique a pour objet non pas seulement l'existence matérielle des associés, mais leur bonheur et leur vertu ; autrement, elle pourrait s'établir entre des esclaves ou des êtres différents des hommes, qui ne la forment point cependant, étant incapables de bonheur et de libre arbitre. L'association politique n'a point non plus pour objet unique l'alliance offensive et défensive entre les individus, ni leurs relations mutuelles, ni les services qu'ils peuvent se rendre; car alors les Étrusques et les Carthaginois et tous les peuples liés par des traités de commerce, devraient être considérés comme citoyens d'un seul et même État, grâce à leurs conventions sur les importations, sur la sûreté individuelle, sur les cas de guerre commune ; [1280a] ayant, du reste, chacun des magistrats séparés sans un seul magistrat commun pour toutes ces relations, parfaitement indifférents à la moralité de leurs alliés respectifs, quelque injustes et quelque pervers que puissent être ceux qui sont compris dans ces traités, et attentifs seulement à se garantir de tout dommage réciproque. Mais comme c'est surtout à la vertu et à la corruption politiques que s'attachent ceux qui regardent à de bonnes lois, il est clair que la vertu est le premier soin d'un État qui mérite vraiment ce titre et qui n'est pas un État seulement de nom. Autrement, l'association politique est comme une alliance militaire de peuples éloignés, s'en distinguant à peine par l'unité de lieu ; la loi, dès lors, est une simple convention ; et, comme l'a dit le sophiste Lycophron : « Elle n'est qu'une garantie des droits individuels, sans aucune puissance sur la moralité et la justice personnelles des citoyens. » § 12. La preuve de ceci est bien facile. Qu'on réunisse par la pensée les localités diverses, et qu'on enferme dans une seule Muraille Mégare et Corinthe ; certes on n'aura point fait par là de cette vaste enceinte une cité unique, même en supposant que tous ceux qu'elle renferme aient contracté entre eux des mariages, liens qui passent pour les plus essentiels de l'association civile. Ou bien encore qu'on suppose des hommes isolés les uns des autres, assez rapprochés toutefois pour conserver des communications entre eux ; qu'on leur suppose des lois communes sur la justice mutuelle qu'on doit observer dans les relations de commerce, les uns étant charpentiers, les autres laboureurs, cordonniers, etc., au nombre de dix mille par exemple ; si leurs rapports ne vont pas au delà des échanges quotidiens et de l'alliance en cas de guerre, ce ne sera point encore là une cité. § 13. Et pourquoi? Ici pourtant on ne dira pas que les liens de l'association ne sont pas assez resserrés. C'est que là où l'association est telle que chacun ne voit l'État que dans sa propre maison, là où l'union est une simple ligue contre la violence, il n'y a point de cité, à y regarder de près ; les relations de l'union ne sont alors que celles des individus isolés. Donc évidemment, la cité ne consiste pas dans la communauté du domicile, ni dans la garantie des droits individuels, ni dans les relations de commerce et d'échange ; ces conditions préliminaires sont bien indispensables pour que la cité existe ; mais, même quand elles sont toutes réunies, la cité n'existe point encore. La cité, c'est l'association du bonheur et de la vertu pour les familles et pour les classes diverses d'habitants, en vue d'une existence complète qui se suffise à elle-même. § 14. Toutefois on ne saurait atteindre un tel résultat sans la communauté de domicile et sans le secours des mariages ; et c'est là ce qui a donné naissance dans les États aux alliances de famille, aux phratries, aux sacrifices publics et aux fêtes qui réunissent les citoyens : La source de toutes ces institutions, c'est la bienveillance, sentiment qui pousse l'homme à préférer la vie commune ; le but de l'État, c'est le bonheur des citoyens, et toutes ces institutions-là ne tendent qu'à l'assurer. L'État n'est qu'une association où les familles réunies par bourgades doivent trouver tous les développements, toutes les facilités de l'existence ; [1281a] c'est-à-dire, je le répète, une vie vertueuse et fortunée. Ainsi donc, l'association politique a certainement pour objet la vertu et le bonheur des individus, et non pas seulement la vie commune. § 15. Ceux qui apportent le plus au fonds général de l'association, ceux-là ont dans l'État une plus large part que ceux qui, égaux ou supérieurs par la liberté, par la naissance, ont cependant moins de vertu politique ; une plus large part que ceux qui, l'emportant par la richesse, le cèdent toutefois en mérite. § 16. Je puis conclure de tout ceci qu'évidemment, dans leurs opinions si opposées sur le pouvoir, les riches et les pauvres n'ont trouvé les uns et les autres qu'une partie de la vérité et de la justice. |
§ 1. Un seul individu... Je ne crois pas qu'il soit possible de donner à la division scientifique des gouvernements une base plus réelle ni plus claire. Montesquieu n'a reconnu que les deux premiers termes, « un » et « plusieurs » ; il n'a point admis le troisième. Voir Esprit des Lois, liv. I, ch. III. Cette distinction de gouvernements en monarchiques, oligarchiques et démocratiques, n'appartient point à Aristote ; on la trouve exposée tout au long dans la curieuse délibération d'Otanès et des conjurés Perses, après le meurtre des Mages. Voir Hérodote, Thalie, ch. LXXX et suiv. Platon admet aussi cette division des gouvernements. Voir la Républ., liv. I, p. 28, trad. de M. Cousin, et le Politique, p. 421, ici. Mais Aristote a le mérite d'avoir le premier systématisé et mis dans tout le jour nécessaire cette classification déjà vulgaire de son temps ; c'est sur elle qu'il a construit toute l'ordonnance de sa politique. Spinosa, Montesquieu, ont la même méthode ; l'un, dans son traité Théologico-Politique; l'autre, dans son Esprit des Lois. Cette classification est acquise à la science politique, qui l'a dès longtemps acceptée et qui n'aura point à la changer. Voir Machiavel, Discours sur les Décades de Tite-Live, liv. I, ch. II. Voir Rousseau, Contrat social, liv. III, ch. III et X. - Gouvernent dans l'intérêt général. Voir Rousseau, Contrat social, liv. II ch. VI. Est déviée de son but. J'a tâché de conserver la force de l'expression grecque ; on traduit ordinairement par le mot «corrompue », qui est moins exact, quoiqu'au fond tout aussi juste. Dans cette théorie qui partage les gouvernements en deux classes, ceux d'intérêt général et ceux d'intérêt particulier, Platon a devancé Aristote en prouvant que le pouvoir ne doit s'exercer jamais qu'au profit des sujets. Voir la République, liv. I, p. 45 et suiv., traduction de M. Cousin. § 4. Les déviations. Hobbes atrouvé avec raison (Imperium , cap. VII, § 3) que ces trois secondes dénominations sont toutes de haine et de mépris, mais qu'elles ne désignent pas des gouvernements de principes différents ; c'est précisément ce qu'Aristote a entendu dire en employant le mot de « déviation ». Hobbes, du reste, montre fort bien que le principe de la monarchie et celui du despotisme sont identiques, et que l'usage seul diffère dans l'une et dans l'autre. Montesquieu, pour n'avoir point osé trancher aussi nettement la question, s'est fatigué, pendant plusieurs livres de son immortel ouvrage, à tracer entre la monarchie et le despotisme une limite qui scientifiquement n'existe pas. Voltaire, dans la IVe observation de son Commentaire, a remarqué cet embarras de Montesquieu, et il ajoute avec son bon sens ordinaire : « La monarchie et le despotisme sont deux frères qui ont tant de ressemblance qu'on les prend souvent l'un pour l'autre. » Voir aussi la XIe observation de Voltaire et la XXXIIIe. Polybe, qui ne paraît point avoir connu l'ouvrage d'Aristote, présente une division des gouvernements moins juste que celle-ci : « royauté, aristocratie, démocratie », dont les corruptions sont la « monarchie, l'oligarchie et l'ochlocratie » (liv. VI, p.629). Voir aussi Platon, Rép., liv. VIII, traduction de M. Cousin, p. 126-128.
-- La démagogie. J'ai
rendu le mot « democratia » par démagogie, chaque fois qu'Aristote a
pris « democratia » en mauvaise part, comme ici. Le mot « démocratie
» est, de nos jours, dégagé de toute idée défavorable, et n'eut
point rendu la pensée du philosophe grec. Platon a remarqué très
justement que, dans la langue de la science politique, le mot de «
démocratie » avait une double acception, et que pour elle il n'y
avait pas lieu de distinguer comme pour les autres gouvernements.
Voir le Politique, p. 428 et 458. C'est, du reste, le lieu de faire
observer qu'Aristote prend toujours le mot « peuple » pour la partie
la plus pauvre et la plus nombreuse des citoyens, du corps
politique. Toutes les fois donc qu'on rencontrera dans cette
traduction le mot « peuple », il faut entendre non pas la totalité
ou la majorité de la nation, ce qui comprendrait aussi les esclaves,
mais seulement la dernière classe du corps politique, celle qui
prévalut à Athènes, mais qui, dans la plupart des républiques
grecques, ne joua jamais qu'un rôle tout à fait secondaire. Voir
ci-dessus, liv. II, ch. IX, §§ 3 et 4, et liv. III, ch. III, § 1 et
2. § 9. Dans la Morale. Morale à Nicomaque, livre V, chap. V, pages 152 et suiv. de la traduction. § 11. Les Étrusques. Aristote dit : « les Tyrrhéniens ». Ce sont les étrusques; leur nom a toujours été changé par les nations étrangères. Les Grecs les nommaient, comme ici, Tyrrhéniens ; les Romains, Tusci : leur nom national était Racena. Voir Niebuhr, Histoire rom., t. I, p. 60. - Lycophron. Aristote cite plusieurs fois Lycophron dans sa Rhétorique, liv. III, ch. III, § 1, p. 22 de ma traduction ; Réfutation des sophistes, ch. XV, § 16, p. 384 de ma traduction. Il ne faut pas le confondre avec le poète de même nom, qui a été postérieur d'un demi-siècle environ, et dont il nous reste un poème fameux par son style ampoulé et déclamatoire. § 12. Mégare et Corinthe. Mégare était à deux cent dix stades, ou huit lieues environ, de Corinthe. |
|
De la souveraineté; le gouvernement de l'État peut être profondément injuste ; prétentions réciproques et également iniques de la foule et de la minorité. Arguments divers en faveur de la souveraineté populaire, et énumération des objets auxquels elle peut s'étendre ; objections contre ces arguments et réponse à ces objections. La souveraineté doit appartenir autant que possible aux lois fondées sur la raison ; rapports intimes des lois avec la constitution. |
||
|
§ 1. Ἔχει δ' ἀπορίαν τί δεῖ τὸ κύριον εἶναι τῆς πόλεως. Ἢ γάρ τοι τὸ πλῆθος, ἢ τοὺς πλουσίους, ἢ τοὺς ἐπιεικεῖς, ἢ τὸν βέλτιστον ἕνα πάντων, ἢ τύραννον. Ἀλλὰ ταῦτα πάντα ἔχειν φαίνεται δυσκολίαν. Τί γάρ; Ἂν οἱ πένητες διὰ τὸ πλείους εἶναι διανέμωνται τὰ τῶν πλουσίων, τοῦτ' οὐκ ἄδικόν ἐστιν; Ἔδοξε γὰρ νὴ Δία τῷ κυρίῳ δικαίως. Τὴν οὖν ἀδικίαν τί χρὴ λέγειν τὴν ἐσχάτην; Πάλιν τε πάντων ληφθέντων, οἱ πλείους τὰ τῶν ἐλαττόνων ἂν διανέμωνται, φανερὸν ὅτι φθείρουσι τὴν πόλιν. Ἀλλὰ μὴν οὐχ ἥ γ' ἀρετὴ φθείρει τὸ ἔχον αὐτήν, οὐδὲ τὸ δίκαιον πόλεως φθαρτικόν· ὥστε δῆλον ὅτι καὶ τὸν νόμον τοῦτον οὐχ οἷόν τ' εἶναι δίκαιον. § 2. Ἔτι καὶ τὰς πράξεις ὅσας ὁ τύραννος ἔπραξεν ἀναγκαῖον εἶναι πάσας δικαίας· βιάζεται γὰρ ὢν κρείττων, ὥσπερ καὶ τὸ πλῆθος τοὺς πλουσίους. Ἀλλ' ἆρα τοὺς ἐλάττους δίκαιον ἄρχειν καὶ τοὺς πλουσίους; Ἂν οὖν κἀκεῖνοι ταῦτα ποιῶσι καὶ διαρπάζωσι καὶ ἀφαιρῶνται τὰ κτήματα τοῦ πλήθους, τοῦτ' ἐστὶ δίκαιον· καὶ θάτερον ἄρα. Ταῦτα μὲν τοίνυν ὅτι πάντα φαῦλα καὶ οὐ δίκαια, φανερόν· § 3. ἀλλὰ τοὺς ἐπιεικεῖς ἄρχειν δεῖ καὶ κυρίους εἶναι πάντων; Οὐκοῦν ἀνάγκη τοὺς ἄλλους ἀτίμους εἶναι πάντας, μὴ τιμωμένους ταῖς πολιτικαῖς ἀρχαῖς· τιμὰς γὰρ λέγομεν εἶναι τὰς ἀρχάς, ἀρχόντων δ' αἰεὶ τῶν αὐτῶν ἀναγκαῖον εἶναι τοὺς ἄλλους ἀτίμους. Ἀλλ' ἕνα τὸν σπουδαιότατον ἄρχειν βέλτιον; Ἀλλ' ἔτι τοῦτο ὀλιγαρχικώτερον· οἱ γὰρ ἄτιμοι πλείους. Ἀλλ' ἴσως φαίη τις ἂν τὸ κύριον ὅλως ἄνθρωπον εἶναι ἀλλὰ μὴ νόμον φαῦλον, ἔχοντά γε τὰ συμβαίνοντα πάθη περὶ τὴν ψυχήν. Ἂν οὖν ᾖ νόμος μὲν ὀλιγαρχικὸς δὲ ἢ δημοκρατικός, τί διοίσει περὶ τῶν ἠπορημένων; Συμβήσεται γὰρ ὁμοίως τὰ λεχθέντα πρότερον. § 4. Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἔστω τις ἕτερος λόγος· ὅτι δὲ δεῖ κύριον εἶναι μᾶλλον τὸ πλῆθος ἢ τοὺς ἀρίστους μὲν ὀλίγους δέ, δόξειεν ἂν λύεσθαι καί τιν' ἔχειν ἀπορίαν, τάχα δὲ κἂν ἀλήθειαν. Τοὺς γὰρ πολλούς, ὧν ἕκαστός ἐστιν οὐ σπουδαῖος ἀνήρ, [1281b] ὅμως ἐνδέχεται συνελθόντας εἶναι βελτίους ἐκείνων, οὐχ ὡς ἕκαστον ἀλλ' ὡς σύμπαντας, οἷον τὰ συμφορητὰ δεῖπνα τῶν ἐκ μιᾶς δαπάνης χορηγηθέντων· πολλῶν γὰρ ὄντων ἕκαστον μόριον ἔχειν ἀρετῆς καὶ φρονήσεως, καὶ γίνεσθαι συνελθόντας ὥσπερ ἕνα ἄνθρωπον τὸ πλῆθος, πολύποδα καὶ πολύχειρα καὶ πολλὰς ἔχοντ' αἰσθήσεις, οὕτω καὶ περὶ τὰ ἤθη καὶ τὴν διάνοιαν. Διὸ καὶ κρίνουσιν ἄμεινον οἱ πολλοὶ καὶ τὰ τῆς μουσικῆς ἔργα καὶ τὰ τῶν ποιητῶν· ἄλλοι γὰρ ἄλλο τι μόριον, πάντα δὲ πάντες. § 5. Ἀλλὰ τούτῳ διαφέρουσιν οἱ σπουδαῖοι τῶν ἀνδρῶν ἑκάστου τῶν πολλῶν, ὥσπερ καὶ τῶν μὴ καλῶν τοὺς καλούς φασι, καὶ τὰ γεγραμμένα διὰ τέχνης τῶν ἀληθινῶν, τῷ συνῆχθαι τὰ διεσπαρμένα χωρὶς εἰς ἕν, ἐπεὶ κεχωρισμένων γε κάλλιον ἔχειν τοῦ γεγραμμένου τουδὶ μὲν τὸν ὀφθαλμὸν ἑτέρου δέ τινος ἕτερον μόριον. Εἰ μὲν οὖν περὶ πάντα δῆμον καὶ περὶ πᾶν πλῆθος ἐνδέχεται ταύτην εἶναι τὴν διαφορὰν τῶν πολλῶν πρὸς τοὺς ὀλίγους σπουδαίους, ἄδηλον, ἴσως δὲ νὴ Δία δῆλον ὅτι περὶ ἐνίων ἀδύνατον (ὁ γὰρ αὐτὸς κἂν ἐπὶ τῶν θηρίων ἁρμόσειε λόγος· καίτοι τί διαφέρουσιν ἔνιοι τῶν θηρίων ὡς ἔπος εἰπεῖν;)· ἀλλὰ περὶ τὶ πλῆθος οὐδὲν εἶναι κωλύει τὸ λεχθὲν ἀληθές. § 6. Διὸ καὶ τὴν πρότερον εἰρημένην ἀπορίαν λύσειεν ἄν τις διὰ τούτων καὶ τὴν ἐχομένην αὐτῆς, τίνων δεῖ κυρίους εἶναι τοὺς ἐλευθέρους καὶ τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν. Τοιοῦτοι δ' εἰσὶν ὅσοι μήτε πλούσιοι μήτε ἀξίωμα ἔχουσιν ἀρετῆς μηδὲ ἕν. Τὸ μὲν γὰρ μετέχειν αὐτοὺς τῶν ἀρχῶν τῶν μεγίστων οὐκ ἀσφαλές (διά τε γὰρ ἀδικίαν καὶ δι' ἀφροσύνην τὰ μὲν ἀδικεῖν ἀνάγκη τὰ δ' ἁμαρτάνειν αὐτούς)· τὸ δὲ μὴ μεταδιδόναι μηδὲ μετέχειν φοβερόν νὅταν γὰρ ἄτιμοι πολλοὶ καὶ πένητες ὑπάρχωσι, πολεμίων ἀναγκαῖον εἶναι πλήρη τὴν πόλιν ταύτηνν. Λείπεται δὴ τοῦ βουλεύεσθαι καὶ κρίνειν μετέχειν αὐτούς. § 7. Διόπερ καὶ Σόλων καὶ τῶν ἄλλων τινὲς νομοθετῶν τάττουσιν ἐπί τε τὰς ἀρχαιρεσίας καὶ τὰς εὐθύνας τῶν ἀρχόντων, ἄρχειν δὲ κατὰ μόνας οὐκ ἐῶσιν. Πάντες μὲν γὰρ ἔχουσι συνελθόντες ἱκανὴν αἴσθησιν, καὶ μιγνύμενοι τοῖς βελτίοσι τὰς πόλεις ὠφελοῦσιν, καθάπερ ἡ μὴ καθαρὰ τροφὴ μετὰ τῆς καθαρᾶς τὴν πᾶσαν ποιεῖ χρησιμωτέραν τῆς ὀλίγης· χωρὶς δ' ἕκαστος ἀτελὴς περὶ τὸ κρίνειν ἐστίν. § 8. Ἔχει δ' ἡ τάξις αὕτη τῆς πολιτείας ἀπορίαν πρώτην μὲν ὅτι δόξειεν ἂν τοῦ αὐτοῦ εἶναι τὸ κρῖναι τίς ὀρθῶς ἰάτρευκεν, οὗπερ καὶ τὸ ἰατρεῦσαι καὶ ποιῆσαι ὑγιᾶ τὸν κάμνοντα τῆς νόσου τῆς παρούσης· οὗτος δ' ἐστὶν ὁ ἰατρός. [1282a] Ὁμοίως δὲ τοῦτο καὶ περὶ τὰς ἄλλας ἐμπειρίας καὶ τέχνας. Ὥσπερ οὖν ἰατρὸν δεῖ διδόναι τὰς εὐθύνας ἐν ἰατροῖς, οὕτω καὶ τοὺς ἄλλους ἐν τοῖς ὁμοίοις. Ἰατρὸς δ' ὅ τε δημιουργὰς καὶ ὁ ἀρχιτεκτονικὸς καὶ τρίτος ὁ πεπαιδευμένος περὶ τὴν τέχνην (εἰσὶ γάρ τινες τοιοῦτοι καὶ περὶ πάσας ὡς εἰπεῖν τὰς τέχνας)· ἀποδίδομεν δὲ τὸ κρίνειν οὐδὲν ἧττον τοῖς πεπαιδευμένοις ἢ τοῖς εἰδόσιν. § 9. Ἔπειτα καὶ περὶ τὴν αἵρεσιν τὸν αὐτὸν ἂν δόξειεν ἔχειν τρόπον. Καὶ γὰρ τὸ ἑλέσθαι ὀρθῶς τῶν εἰδότων ἔργον ἐστίν, οἷον γεωμέτρην τε τῶν γεωμετρικῶν καὶ κυβερνήτην τῶν κυβερνητικῶν. Εἰ γὰρ καὶ περὶ ἐνίων ἔργων καὶ τεχνῶν μετέχουσι καὶ τῶν ἰδιωτῶν τινες, ἀλλ' οὔ τι τῶν εἰδότων γε μᾶλλον. Ὥστε κατὰ μὲν τοῦτον τὸν λόγον οὐκ ἂν εἴη τὸ πλῆθος ποιητέον κύριον οὔτε τῶν ἀρχαιρεσιῶν οὔτε τῶν εὐθυνῶν. § 10. Ἀλλ' ἴσως οὐ πάντα ταῦτα λέγεται καλῶς διά τε τὸν πάλαι λόγον, ἂν ᾖ τὸ πλῆθος μὴ λίαν ἀνδραποδῶδες (ἔσται γὰρ ἕκαστος μὲν χείρων κριτὴς τῶν εἰδότων, ἅπαντες δὲ συνελθόντες ἢ βελτίους ἢ οὐ χείρους), καὶ ὅτι περὶ ἐνίων οὔτε μόνον ὁ ποιήσας οὔτ' ἄριστ' ἂν κρίνειεν, ὅσων τἆργα γινώσκουσι καὶ οἱ μὴ ἔχοντες τὴν τέχνην, οἷον οἰκίαν οὐ μόνον ἐστὶ γνῶναι τοῦ ποιήσαντος, ἀλλὰ καὶ βέλτιον ὁ χρώμενος αὐτῇ κρινεῖ ῖχρῆται δ' ὁ οἰκονόμος), καὶ πηδάλιον κυβερνήτης τέκτονος, καὶ θοίνην ὁ δαιτυμὼν ἀλλ' οὐχ ὁ μάγειρος. Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἀπορίαν τάχα δόξειέ τις ἂν οὕτω λύειν ἱκανῶς· § 11. ἄλλη δ' ἐστὶν ἐχομένη ταύτης. Δοκεῖ γὰρ ἄτοπον εἶναι τὸ μειζόνων εἶναι κυρίους τοὺς φαύλους τῶν ἐπιεικῶν, αἱ δ' εὔθυναι καὶ αἱ τῶν ἀρχῶν αἱρέσεις εἰσὶ μέγιστον· ἃς ἐν ἐνίαις πολιτείαις, ὥσπερ εἴρηται, τοῖς δήμοις ἀποδιδόασιν· ἡ γὰρ ἐκκλησία κυρία πάντων τῶν τοιούτων ἐστίν. Καίτοι τῆς μὲν ἐκκλησίας μετέχουσι καὶ βουλεύουσι καὶ δικάζουσιν ἀπὸ μικρῶν τιμημάτων καὶ τῆς τυχούσης ἡλικίας, ταμιεύουσι δὲ καὶ στρατηγοῦσι καὶ τὰς μεγίστας ἀρχὰς ἄρχουσιν ἀπὸ μεγάλων. § 12. Ὁμοίως δή τις ἂν λύσειε καὶ ταύτην τὴν ἀπορίαν. Ἴσως γὰρ ἔχει καὶ ταῦτ' ὀρθῶς. Οὐ γὰρ ὁ δικαστὴς οὐδ' ὁ βουλευτὴς οὐδ' ὁ ἐκκλησιαστὴς ἄρχων ἐστίν, ἀλλὰ τὸ δικαστήριον καὶ ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος· τῶν δὲ ῥηθέντων ἕκαστος μόριόν ἐστι τούτων (λέγω δὲ μόριον τὸν βουλευτὴν καὶ τὸν ἐκκλησιαστὴν καὶ τὸν δικαστήν)· ὥστε δικαίως κύριον μειζόνων τὸ πλῆθος· ἐκ γὰρ πολλῶν ὁ δῆμος καὶ ἡ βουλὴ καὶ τὸ δικαστήριον. Καὶ τὸ τίμημα δὲ πλεῖον τὸ πάντων τούτων ἢ τὸ τῶν καθ' ἕνα καὶ κατ' ὀλίγους μεγάλας ἀρχὰς ἀρχόντων. § 13. Ταῦτα μὲν οὖν διωρίσθω τοῦτον τὸν τρόπον· [1282b] ἡ δὲ πρώτη λεχθεῖσα ἀπορία ποιεῖ φανερὸν οὐδὲν οὕτως ἕτερον ὡς ὅτι δεῖ τοὺς νόμους εἶναι κυρίους κειμένους ὀρθῶς, τὸν ἄρχοντα δέ, ἄν τε εἷς ἄν τε πλείους ὦσι, περὶ τούτων εἶναι κυρίους περὶ ὅσων ἐξαδυνατοῦσιν οἱ νόμοι λέγειν ἀκριβῶς διὰ τὸ μὴ ῥᾴδιον εἶναι καθόλου διορίσαι περὶ πάντων. Ὁποίους μέντοι τινὰς εἶναι δεῖ τοὺς ὀρθῶς κειμένους νόμους, οὐδέν πω δῆλον, ἀλλ' ἔτι μένει τὸ πάλαι διαπορηθέν. Ἅμα γὰρ καὶ ὁμοίως ταῖς πολιτείαις ἀνάγκη καὶ τοὺς νόμους φαύλους ἢ σπουδαίους εἶναι, καὶ δικαίους ἢ ἀδίκους. Πλὴν τοῦτό γε φανερόν, ὅτι δεῖ πρὸς τὴν πολιτείαν κεῖσθαι τοὺς νόμους. Ἀλλὰ μὴν εἰ τοῦτο, δῆλον ὅτι τοὺς μὲν κατὰ τὰς ὀρθὰς πολιτείας ἀναγκαῖον εἶναι δικαίους τοὺς δὲ κατὰ τὰς παρεκβεβηκυίας οὐ δικαίους. |
§ 1. C'est un grand problème de savoir à qui doit appartenir la souveraineté dans l'État. Ce ne peut qu'être ou à la multitude, ou aux riches, ou aux gens de bien, ou à un seul individu supérieur par ses talents, ou à un tyran. L'embarras est, ce semble, égal de toutes parts. Quoi ! les pauvres, parce qu'ils sont en majorité, pourront se partager les biens des riches ; et ce ne sera point une injustice, attendu que le souverain de par son droit aura décidé que ce n'en est point une ! Et que sera donc la plus criante des iniquités ? Mais, quand tout sera divisé, si une seconde majorité se partage de nouveau les biens de la minorité, l'État évidemment sera anéanti. Et pourtant, la vertu ne ruine point ce qui la possède; la justice n'est point un poison pour l'État. Cette prétendue loi ne peut donc être certainement qu'une flagrante injustice. § 2. Par le même principe, tout ce qu'aura fait le tyran sera nécessairement juste ; il emploiera la violence parce qu'il sera le plus fort, comme les pauvres l'auront été contre les riches. Le pouvoir appartiendra-t-il de droit à la minorité, aux riches ? Mais s'ils agissent comme les pauvres et le tyran, s'ils pillent la multitude et la dépouillent, cette spoliation sera-t-elle juste ? Les autres alors ne le seront pas moins. Ainsi de toutes parts, on le voit, ce ne sont que crimes et iniquités. § 3. Doit-on remettre la souveraineté absolue sur toutes les affaires aux citoyens distingués ? Alors, c'est avilir toutes les autres classes exclues des fonctions publiques ; les fonctions publiques sont de véritables honneurs, et la perpétuité du pouvoir aux mains de quelques citoyens déconsidère nécessairement tous les autres. Vaut-il mieux donner le pouvoir à un seul, à l'homme supérieur ? Mais, c'est exagérer le principe oligarchique ; et une majorité plus grande encore sera bannie des magistratures. On pourrait ajouter que c'est une faute grave de substituer à la souveraineté de la loi la souveraineté d'un individu, toujours sujet aux mille passions qui agitent toute âme humaine. Eh bien ! dira-t-on : Que la loi soit donc souveraine. Oligarchique ou démocratique, aura-t-on mieux évité tous les écueils ? Pas le moins du monde ; les mêmes dangers que nous venons de signaler subsisteront toujours. § 4. Mais nous reviendrons ailleurs sur ces divers sujets. Attribuer la souveraineté à la multitude plutôt qu'aux hommes distingués, qui sont toujours en minorité, peut sembler une solution équitable et vraie de la question, quoiqu'elle ne tranche pas encore toutes les difficultés. On peut admettre en effet que la majorité, dont chaque membre pris à part n'est pas un homme remarquable, [1271b] est cependant au-dessus des hommes supérieurs, sinon individuellement, du moins en masse, comme un repas à frais communs est plus splendide que le repas dont une personne seule fait la dépense. Dans cette multitude, chaque individu a sa part de vertu, de sagesse ; et tous en se rassemblant forment, on peut dire, un seul homme ayant des mains, des pieds, des sens innombrables, un moral et une intelligence en proportion. Ainsi, la foule porte des jugements exquis sur les oeuvres de musique, de poésie ; celui-ci juge un point, celui-là un autre, et l'assemblée entière juge l'ensemble de l'ouvrage. § 5. L'homme distingué, pris individuellement, diffère de la foule, comme la beauté, dit-on, diffère de la laideur, comme un bon tableau que l'art produit diffère de la réalité, par l'assemblage en un seul corps de beaux traits épars ailleurs ; ce qui n'empêche pas que, si l'on analyse les choses, on ne puisse trouver mieux encore que le tableau, et que tel homme puisse avoir les yeux plus beaux, tel l'emporter par toute autre partie du corps. Je n'affirmerai pas que ce soit là, dans toute multitude, dans toute grande réunion, la différence constante de la majorité au petit nombre des hommes distingués ; et certes on pourrait dire plutôt sans crainte de se tromper que, dans plus d'un cas, une différence de ce genre est impossible, car on pourrait alors pousser la comparaison jusqu'aux animaux : et en quoi, je le demande, certains hommes diffèrent-ils des animaux ? Mais l'assertion, si on la restreint à une multitude donnée, peut être parfaitement juste. § 6. Ces considérations répondent à notre première question sur le souverain, et à celle-ci qui lui est intimement liée : A quels objets la souveraineté des hommes libres et de la masse des citoyens doit-elle s'étendre ? Je comprends par la masse des citoyens tous les hommes d'une fortune et d'un mérite ordinaires. Il y a danger à leur confier les magistratures importantes : faute d'équité et de lumières, ils seront injustes dans tel cas et se tromperont dans tel autre. Les repousser de toutes les fonctions n'est pas plus sûr : un État où tant de gens sont pauvres et privés de toute distinction publique, compte nécessairement dans son sein autant d'ennemis. Mais on peut leur laisser le droit de délibérer sur les affaires publiques, et le droit de juger. § 7. Aussi, Solon et quelques autres législateurs leur ont-ils accordé l'élection et la censure des magistrats, tout en leur refusant des fonctions individuelles. Quand ils sont assemblés, leur masse sent toujours les choses avec une intelligence suffisante ; et réunie aux hommes distingués, elle sert l'État, de même que des aliments peu choisis, joints à quelques aliments plus délicats, donnent par leur mélange une quantité plus forte et plus profitable de nourriture. Mais les individus pris isolément n'en sont pas moins incapables de juger. § 8. On peut faire à ce principe politique une première objection, et demander si, lorsqu'il s'agit de juger du mérite d'un traitement médical, il ne faut point appeler celui-là même qui serait, au besoin, capable de guérir le malade de la douleur qu'il souffre actuellement, c'est-à-dire, le médecin; [1282a] et j'ajoute que ce raisonnement peut s'appliquer à tous les autres arts, à tous les cas où l'expérience joue le principal rôle. Si donc le médecin a pour juges naturels les médecins, il en sera de même dans toute autre chose. Médecin signifie à la fois celui qui exécute l'ordonnance, et celui qui la prescrit, et l'homme qui a été instruit dans la science. Tous les arts, on peut dire, ont, comme la médecine, des divisions pareilles ; et l'on accorde le droit de juger à la science théorique aussi bien qu'à l'instruction pratique. § 9. L'élection des magistrats remise à la multitude peut être attaquée de la même manière. Ceux-là seuls qui savent faire la chose, dira-t-on, ont assez de lumières pour bien choisir. C'est au géomètre de choisir les géomètres, au pilote de choisir les pilotes ; car si, pour certains objets, dans certains arts, on peut travailler sans apprentissage, on ne fait certainement pas mieux que les hommes spéciaux. Donc, par la même raison, il ne faut laisser à la foule ni le droit d'élire les magistrats, ni le droit de leur faire rendre des comptes. § 10. Mais peut-être cette objection n'est-elle pas fort juste par les motifs que j'ai déjà dits plus haut, à moins qu'on ne suppose une multitude tout à fait dégradée. Les individus isolés jugeront moins bien que les savants, j'en conviens ; mais tous réunis, ou ils vaudront mieux, ou ils ne vaudront pas moins. Pour une foule de choses, l'artiste n'est ni le seul ni le meilleur juge, dans tous les cas où l'on peut bien connaître son oeuvre, sans posséder son art. Une maison, par exemple, peut être appréciée par celui qui l'a bâtie ; mais elle le sera bien mieux encore par celui qui l'habite ; et celui--là, c'est le chef de famille. Ainsi encore le timonier du vaisseau se connaîtra mieux en gouvernails que le charpentier ; et c'est le convive et non pas le cuisinier qui juge le festin. Ces considérations peuvent paraître suffisantes pour lever cette première objection. § 11. En voici une autre qui s'y rattache. Il y a peu de raison, dira-t-on, à investir la multitude sans mérite, d'un plus large pouvoir que les citoyens distingués. Rien n'est au-dessus de ce droit d'élection et de censure que bien des Etats, comme je l'ai dit, ont accordé aux classes inférieures, et qu'elles exercent souverainement dans l'assemblée publique. Cette assemblée, le sénat et les tribunaux sont ouverts, moyennant un cens modique, à des citoyens de tout âge ; et en même temps on exige pour les fonctions de trésorier, celles de général, et pour les autres. magistrature; importantes, des conditions de cens fort élevées. § 12. La réponse à cette seconde objection n'est pas ici plus difficile. Les choses sont peut-être encore fort bien telles qu'elles sont. Ce n'est pas l'individu, juge, sénateur, membre de l'assemblée publique, qui prononce souverainement ; c'est le tribunal, c'est le sénat, c'est le peuple, dont cet individu n'est qu'une fraction minime, dans sa triple attribution de sénateur, de juge et de membre de l'assemblée générale. De ce point de vue, il est juste que la multitude ait un plus large pouvoir ; car c'est elle qui forme et le peuple et le sénat et le tribunal. Le cens possédé par cette masse entière dépasse celui que possèdent individuellement, et dans leur minorité, tous ceux qui remplissent les fonctions éminentes. § 13. Je n'irai pas du reste plus loin sur ce sujet. [1282b] Mais quant à la première question que nous nous étions posée sur la personne du souverain, la conséquence la plus évidente qui découle de notre discussion, c'est que la souveraineté doit appartenir aux lois fondées sur la raison, et que le magistrat, unique ou multiple, ne doit être souverain que là où la loi n'a pu rien disposer, par l'impossibilité de préciser tous les détails dans des règlements généraux. Nous n'avons point encore expliqué ce que doivent être des lois fondées sur la raison, et notre première question reste entière. Je dirai seulement que, de toute nécessité, les lois suivent les gouvernements ; mauvaises ou bonnes, justes ou iniques, selon qu'ils le sont eux-mêmes. Il est du moins de toute évidence que les lois doivent se rapporter à l'État ; et, ceci une fois admis, il n'est pas moins évident que les lois sont nécessairement bonnes dans les gouvernements purs, et vicieuses dans les gouvernements corrompus. |
§ 4. Nous reviendrons ailleurs Voir plus loin, ch. X, § 4. -- Chaque membre pris à part. Aristote a exposé ici les droits rationnels de la majorité aussi bien que pourrait le faire un démocrate de nos jours. Voir plus bas, ch. X, § 5, une répétition de ceci. Montesquieu trouve le peuple entièrement incapable de prendre des résolutions actives, bien qu'il soit plein de discernement ; et c'est là le motif qui fait préférer à Montesquieu le gouvernement représentatif. Esprit des Lois, liv. II, ch. II, et liv. XI, ch. VI, p. 15.§ 7. La censure. On peut voir dans Boeckh (Econom. Polit. des Ath., liv. II, ch. VIII, p. 313 et suiv.) quelle importance le peuple athénien attachait à la reddition des comptes et à l'examen des dépenses publiques. Voir plus loin, liv. VII (6), ch. V. § 10. Que j'ai déjà dits plus haut. Voir plus haut, même chapitre, § 5. -- O u ils vaudront mieux. Machiavel est complètement de l'avis d'Aristote sur l'aptitude politique de la majorité pour élire les magistrats. Voir Discours sur Tite-Live, liv. III, ch. XXXIV. Montesquieu partage cette opinion, Esprit des Lois, liv. II, Ch. II.-- Une maison, par exemple. Voir des idées tout à fait analogues dans Platon, République , liv. X, p. 250, trad. de M. Cousin. § 11. Comme je l'ai dit. Voir plus haut, § 7. § 13. Fondées sur la raison. C'est, en d'autres termes, la souveraineté de la raison. Platon, à qui Aristote emprunte en partie ces théories, conclut d'une façon toute contraire, et préfère le pouvoir d'un chef éclairé à celui de la loi. V. le Pol. p. 435, tr. de M. Cousin. |
|
Suite de la théorie de la souveraineté ; pour savoir à qui elle appartient, on ne peut tenir compte que des avantages vraiment politiques, et non des avantages quels qu'ils soient : la noblesse, la liberté, la fortune, la justice, le courage militaire, la science, la vertu. Insuffisance des prétentions exclusives ; l'égalité est, en général, le but que le législateur doit se proposer, afin de les concilier. |
||
|
§ 1. Ἐπεὶ δ' ἐν πάσαις μὲν ταῖς ἐπιστήμαις καὶ τέχναις ἀγαθὸν τὸ τέλος, μέγιστον δὲ καὶ μάλιστα ἐν τῇ κυριωτάτῃ πασῶν, αὕτη δ' ἐστὶν ἡ πολιτικὴ δύναμις, ἔστι δὲ τὸ πολιτικὸν ἀγαθὸν τὸ δίκαιον, τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ κοινῇ συμφέρον, δοκεῖ δὴ πᾶσιν ἴσον τι τὸ δίκαιον εἶναι, καὶ μέχρι γέ τινος ὁμολογοῦσι τοῖς κατὰ φιλοσοφίαν λόγοις, ἐν οἷς διώρισται περὶ τῶν ἠθικῶν ντὶ γὰρ καὶ τισὶ τὸ δίκαιον, καὶ δεῖν τοῖς ἴσοις ἴσον εἶναι φασινν, ποίων δὴ ἰσότης ἐστὶ καὶ ποίων ἀνισότης, δεῖ μὴ λανθάνειν. Ἔχει γὰρ τοῦτ' ἀπορίαν καὶ φιλοσοφίαν πολιτικήν.
§ 2. Ἴσως γὰρ ἂν φαίη τις κατὰ παντὸς
ὑπεροχὴν ἀγαθοῦ δεῖν ἀνίσως νενεμῆσθαι τὰς ἀρχάς, εἰ πάντα τὰ λοιπὰ
μηδὲν διαφέροιεν ἀλλ' ὅμοιοι τυγχάνοιεν ὄντες· τοῖς γὰρ διαφέρουσιν
ἕτερον εἶναι τὸ δίκαιον καὶ τὸ κατ' ἀξίαν. Ἀλλὰ μὴν εἰ τοῦτ' ἀληθές,
ἔσται καὶ κατὰ χρῶμα καὶ κατὰ μέγεθος καὶ καθ' ὁτιοῦν τῶν ἀγαθῶν
πλεονεξία τις τῶν πολιτικῶν δικαίων τοῖς ὑπερέχουσιν. τοῦτο
ἐπιπόλαιον τὸ ψεῦδος; Φανερὸν δ' ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν καὶ
δυνάμεων· τῶν γὰρ ὁμοίων αὐλητῶν τὴν τέχνην οὐ δοτέον πλεονεξίαν τῶν
αὐλῶν τοῖς εὐγενεστέροις (οὐδὲν γὰρ αὐλήσουσι βέλτιον), δεῖ δὲ τῷ
κατὰ τὸ ἔργον ὑπερέχοντι διδόναι καὶ τῶν ὀργάνων τὴν ὑπεροχήν. § 3.
Εἰ δὲ μήπω δῆλον τὸ λεγόμενον, ἔτι μᾶλλον αὐτὸ προαγαγοῦσιν ἔσται
φανερόν. Εἰ γὰρ εἴη τις ὑπερέχων μὲν κατὰ τὴν αὐλητικήν, πολὺ δ'
ἐλλείπων κατ' εὐγένειαν ἢ κάλλος, εἰ καὶ μεῖζον ἕκαστον ἐκείνων
ἀγαθόν ἐστι τῆς αὐλητικῆς (λέγω δὲ τήν τ' εὐγένειαν καὶ τὸ κάλλος),
καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν ὑπερέχουσι πλέον τῆς αὐλητικῆς ἢ ἐκεῖνος κατὰ
τὴν αὐλητικήν, ὅμως τούτῳ δοτέον τοὺς διαφέροντας τῶν αὐλῶν. § 4. Ἔτι κατά γε τοῦτον τὸν λόγον πᾶν ἀγαθὸν πρὸς πᾶν ἂν εἴη συμβλητόν. Εἰ γὰρ μᾶλλον τὸ τὶ μέγεθος, καὶ ὅλως ἂν τὸ μέγεθος ἐνάμιλλον εἴη καὶ πρὸς πλοῦτον καὶ πρὸς ἐλευθερίαν· ὥστ' εἰ πλεῖον ὁδὶ διαφέρει κατὰ μέγεθος ἢ ὁδὶ κατ' ἀρετήν, καὶ πλεῖον ὑπερέχει ὅλως ἀρετὴ μεγέθους, εἴη ἂν συμβλητὰ πάντα. Τοσόνδε γὰρ μέγεθος εἰ κρεῖττον τοσοῦδε, τοσόνδε δῆλον ὡς ἴσον. § 5. Ἐπεὶ δὲ τοῦτ' ἀδύνατον, δῆλον ὡς καὶ ἐπὶ τῶν πολιτικῶν εὐλόγως οὐ κατὰ πᾶσαν ἀνισότητ' ἀμφισβητοῦσι τῶν ἀρχῶν (εἰ γὰρ οἱ μὲν βραδεῖς οἱ δὲ ταχεῖς, οὐδὲν διὰ τοῦτο δεῖ τοὺς μὲν πλεῖον τοὺς δ' ἔλαττον ἔχειν, ἀλλ' ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν ἡ τούτων διαφορὰ λαμβάνει τὴν τιμήν)· ἀλλ' ἐξ ὧν πόλις συνέστηκεν, ἐν τούτοις ἀναγκαῖον ποιεῖσθαι τὴν ἀμφισβήτησιν. Διόπερ εὐλόγως ἀντιποιοῦνται τῆς τιμῆς οἱ εὐγενεῖς καὶ ἐλεύθεροι καὶ πλούσιοι. Δεῖ γὰρ ἐλευθέρους τ' εἶναψ καὶ τίμημα φέροντας, οὐ γὰρ ἂν εἴη πόλις ἐξ ἀπόρων πάντων, ὥσπερ οὐδ' ἐκ δούλων· § 6. ἀλλὰ μὴν εἰ δεῖ τούτων, δῆλον ὅτι καὶ δικαιοσύνης καὶ τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς, οὐδὲ γὰρ ἄνευ τούτων οἰκεῖσθαι πόλιν δυνατόν· πλὴν ἄνευ μὲν τῶν προτέρων ἀδύνατον εἶναι πόλιν, ἄνευ δὲ τούτων οἰκεῖσθαι καλῶς. Πρὸς μὲν οὖν τὸ πόλιν εἶναι δόξειεν ἂν ἢ πάντα ἢ ἔνιά γε τούτων ὀρθῶς ἀμφισβητεῖν, πρὸς μέντοι ζωὴν ἀγαθὴν ἡ παιδεία καὶ ἡ ἀρετὴ μάλιστα δικαίως ἂν ἀμφισβητοίησαν, καθάπερ εἴρηται καὶ πρότερον. § 7. Ἐπεὶ δ' οὔτε πάντων ἴσον ἔχειν δεῖ τοὺς ἴσους ἕν τι μόνον ὄντας, οὔτε ἄνισον τοὺς ἀνίσους καθ' ἕν, ἀνάγκη πάσας εἶναι τὰς τοιαύτας πολιτείας περεκβάσεις. Εἴρηται μὲν οὖν καὶ πρότερον ὅτι διαμφισβητοῦσι τρόπον τινὰ δικαίως πάντες, ἁπλῶς δ' οὐ πάντες δικαίως· οἱ πλούσιοι μὲν ὅτι πλεῖον μέτεστι τῆς χώρας αὐτοῖς, ἡ δὲ χώρα κοινόν, ἔτι πρὸς τὰ συμβόλαια πιστοὶ μᾶλλον ὡς ἐπὶ τὸ πλέον· οἱ δὲ ἐλεύθεροι καὶ εὐγενεῖς ὡς ἐγγὺς ἀλλήλων (πολῖται γὰρ μᾶλλον οἱ γενναιότεροι τῶν ἀγεννῶν, ἡ δ' εὐγένεια παρ' ἑκάστοις οἴκοι τίμιος)· ἔτι διότι βελτίους εἰκὸς τοὺς ἐκ βελτιόνων, εὐγένεια γάρ ἐστιν ἀρετὴ γένους· § 8. ὁμοίως δὲ φήσομεν δικαίως καὶ τὴν ἀρετὴν ἀμφισβητεῖν, κοινωνικὴν γὰρ ἀρετὴν εἶναί φαμεν τὴν δικαιοσύνην, ᾗ πάσας ἀναγκαῖον ἀκολουθεῖν τὰς ἄλλας· ἀλλὰ μὴν καὶ οἱ πλείους πρὸς τοὺς ἐλάττους, καὶ γὰρ κρείττους καὶ πλουσιώτεροι καὶ βελτίους εἰσίν, ὡς λαμβανομένων τῶν πλειόνων πρὸς τοὺς ἐλάττους. § 9. Ἆρ' οὖν εἰ πάντες εἶεν ἐν μιᾷ πόλει, [1283b] λέγω δ' οἷον οἵ τ' ἀγαθοὶ καὶ οἱ πλούσιοι καὶ εὐγενεῖς, ἔτι δὲ πλῆθος ἄλλο τι πολιτικόν, πότερον ἀμφισβήτησις ἔσται τίνας ἄρχειν δεῖ, ἢ οὐκ ἔσται; Καθ' ἑκάστην μὲν οὖν πολιτείαν τῶν εἰρημένων ἀναμφισβήτητος ἡ κρίσις τίνας ἄρχειν δεῖ ῖτοῖς γὰρ κυρίοις διαφέρουσιν ἀλλήλων, οἷον ἡ μὲν τῷ διὰ πλουσίων ἡ δὲ τῷ διὰ τῶν σπουδαίων ἀνδρῶν εἶναι, καὶ τῶν ἄλλων ἑκάστη τὸν αὐτὸν τρόπονν· ἀλλ' ὅμως σκοπῶμεν, ὅταν περὶ τὸν αὐτὸν ταῦθ' ὑπάρχῃ χρόνον, πῶς διοριστέον. § 10. Εἰ δὴ τὸν ἀριθμὸν εἶεν ὀλίγοι πάμπαν οἱ τὴν ἀρετὴν ἔχοντες, τίνα δεῖ διελεῖν τρόπον; Ἢ τὸ ὀλίγοι πρὸς τὸ ἔργον δεῖ σκοπεῖν, εἰ δυνατοὶ διοικεῖν τὴν πόλιν ἢ τοσοῦτοι τὸ πλῆθος ὥστ' εἶναι πόλιν ἐξ αὐτῶν; Ἔστι δὲ ἀπορία τις πρὸς ἅπαντας τοὺς διαμφισβητοῦντας περὶ τῶν πολιτικῶν τιμῶν. Δόξαιεν γὰρ ἂν οὐδὲν λέγειν δίκαιον οἱ διὰ τὸν πλοῦτον ἀξιοῦντες ἄρχειν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ κατὰ γένος· δῆλον γὰρ ὡς εἴ τις πάλιν εἷς πλουσιώτερος ἁπάντων ἐστί, δηλονότι κατὰ τὸ αὐτὸ δίκαιον τοῦτον ἄρχειν τὸν ἕνα ἁπάντων δεήσει, ὁμοίως δὲ καὶ τὸν εὐγενείᾳ διαφέροντα τῶν ἀμφισβητούντων δι' ἐλευθερίαν. § 11. Ταὐτὸ δὲ τοῦτο ἴσως συμβήσεται καὶ περὶ τὰς ἀριστοκρατίας ἐπὶ τῆς ἀρετῆς· εἰ γάρ τις εἷς ἀμείνων ἀνὴρ εἴη τῶν ἄλλων τῶν ἐν τῷ πολιτεύματι σπουδαίων ὄντων, τοῦτον εἶναι δεῖ κύριον κατὰ ταὐτὸ δίκαιον. Οὐκοῦν εἰ καὶ τὸ πλῆθος εἶναί γε δεῖ κύριον διότι κρείττους εἰσὶ τῶν ὀλίγων, κἂν εἷς ἢ πλείους μὲν τοῦ ἑνὸς ἐλάττους δὲ τῶν πολλῶν κρείττους ὦσι τῶν ἄλλων, τούτους ἂν δέοι κυρίους εἶναι μᾶλλον ἢ τὸ πλῆθος. § 12. Πάντα δὴ ταῦτ' ἔοικε φανερὸν ποιεῖν ὅτι τούτων τῶν ὅρων οὐδεὶς ὀρθός ἐστι καθ' ὃν ἀξιοῦσιν αὐτοὶ μὲν ἄρχειν τοὺς δ' ἄλλους ὑπὸ σφῶν ἄρχεσθαι πάντας. Καὶ γὰρ δὴ καὶ πρὸς τοὺς κατ' ἀρετὴν ἀξιοῦντας κυρίους εἶναι τοῦ πολιτεύματος, ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς κατὰ πλοῦτον, ἔχοιεν ἂν λέγειν τὰ πλήθη λόγον τινὰ δίκαιον· οὐδὲν γὰρ κωλύει ποτὲ τὸ πλῆθος εἶναι βέλτιον· τῶν ὀλίγων καὶ πλουσιώτερον, οὐχ ὡς καθ' ἕκαστον ἀλλ' ὡς ἀθρόους. Διὸ καὶ πρὸς τὴν ἀπορίαν ἣν ζητοῦσι καὶ προβάλλουσί τινες ἐνδέχεται τοῦτον τὸν τρόπον ἀπαντᾶν. Ἀποροῦσι γάρ τινες πότερον τῷ νομοθέτῃ νομοθετητέον, βουλομένῳ τίθεσθαι τοὺς ὀρθοτάτους νόμους, πρὸς τὸ τῶν βελτιόνων συμφέρον ἢ πρὸς τὸ τῶν πλειόνων, ὅταν συμβαίνῃ τὸ λεχθέν· τὸ δ' ὀρθὸν ληπτέον ἴσως· τὸ δ' ἴσως ὀρθὸν πρὸς τὸ τῆς πόλεως ὅλης συμφέρον καὶ πρὸς τὸ κοινὸν τὸ τῶν πολιτῶν· πολίτης δὲ κοινῇ μὲν ὁ μετέχων τοῦ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαί ἐστι, [1284a] καθ' ἑκάστην δὲ πολιτείαν ἕτερος, πρὸς δὲ τὴν ἀρίστην ὁ δυνάμενος καὶ προαιρούμενος ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν πρὸς τὸν βίον τὸν κατ' ἀρετήν. |
§ 1. Toutes les sciences, tous les arts ont un bien pour but ; et le premier des biens doit être l'objet suprême de la plus haute de toutes les sciences ; or, cette science, c'est la politique. Le bien en politique, c'est la justice ; en d'autres termes, l'utilité générale. On pense communément que la justice est une sorte d'égalité ; et ici l'opinion vulgaire est, jusqu'à un certain point, d'accord avec les principes philosophiques par lesquels nous avons traité de la morale. On s'accorde en outre sur la nature de la justice, sur les êtres auxquels elle s'applique, et l'on convient que l'égalité doit régner nécessairement entre égaux ; reste à fixer à quoi s'applique l'égalité et à quoi s'applique l'inégalité ; questions difficiles qui constituent la philosophie politique. § 2. On soutiendra peut-être que le pouvoir politique doit se répartir inégalement, en raison de la prééminence en un mérite quelconque, tous les autres points restant d'ailleurs parfaitement pareils, et les citoyens étant d'ailleurs parfaitement semblables ; et que les droits et la considération doivent être différents, quand les individus diffèrent. Mais si ce principe est vrai, même la fraîcheur du teint, ou la grandeur de la taille, ou tel autre avantage, quel qu'il soit, pourra donc donner droit à une supériorité de pouvoir politique. L'erreur n'est-elle pas ici manifeste ? Quelques réflexions tirées des autres sciences et des autres arts le prouveront assez. Si l'on distribue des flûtes à des artistes égaux entre eux en tant qu'occupés du même art, on ne donnera pas les meilleurs instruments aux individus les plus nobles, puisque leur noblesse ne les rend pas plus habiles à jouer de la flûte ; mais on devra remettre l'instrument le plus parfait à l'artiste qui saura le plus parfaitement s'en servir. § 3. Si le raisonnement n'est pas encore assez clair, qu'on le pousse un peu plus loin. Qu'un homme très distingué dans l'art de la flûte le soit beaucoup moins par la naissance et la beauté, avantages qui, pris chacun à part, sont, si l'on veut, très préférables à un talent d'artiste, et qu'à ces deux égards, noblesse et beauté, ses rivaux l'emportent sur lui beaucoup plus que lui-même ne l'emporte sur eux comme virtuose ; je soutiens que c'est toujours à lui qu'appartient l'instrument supérieur. [1283a] Autrement, il faudrait que l'exécution musicale profitât beaucoup des supériorités de naissance et de fortune ; mais ces avantages ne peuvent y procurer le plus léger progrès. § 4. A suivre encore ce faux raisonnement, un avantage quelconque pourrait entrer en parallèle avec tout autre. Parce que la taille de tel homme l'emporterait sur la taille de tel autre, il s'ensuivrait qu'en règle générale la taille pourrait être mise en balance avec la fortune et la liberté. Si, parce que l'un est plus distingué par sa taille que l'autre par sa vertu, on place en général la taille fort au-dessus de la vertu, les objets les plus disparates pourront être mis dès lors au même niveau ; car si la taille à certain degré peut surpasser telle autre qualité à certain degré, il est clair qu'il suffira de proportionner les degrés pour obtenir l'égalité absolue. § 5. Mais comme il y a ici une impossibilité radicale, il est clair qu'on ne prétend pas le moins du monde, en fait de droits politiques, répartir le pouvoir selon toute espèce d'inégalité. Que les uns soient légers à la course et les autres fort lents, ce n'est pas une raison pour qu'en politique les uns aient plus et les autres moins ; c'est aux jeux gymniques que ces différences-là seront appréciées à leur juste valeur. Ici, on ne doit nécessairement mettre en concurrence que les objets qui contribuent à la formation de l'État. Aussi a-t-on toute raison d'accorder une distinction particulière à la noblesse, à la liberté, à la fortune ; car les individus libres et les citoyens qui possèdent le cens légal, sont les membres de l'État ; et il n'y aurait point d'État si tous étaient pauvres, non plus que si tous étaient esclaves. § 6. Mais à ces premiers éléments, il en faut joindre évidemment aussi deux autres : la justice et la valeur guerrière, dont l'État ne peut pas davantage se passer; car si les uns sont indispensables à son existence, les autres le sont à sa prospérité. Tous ces éléments, ou du moins la plupart, peuvent se disputer à bon droit l'honneur de constituer l'existence de la cité ; mais c'est surtout, je le répète, comme je l'ai dit plus haut, à la science et à la vertu de s'attribuer son bonheur. § 7. De plus, comme l'égalité et l'inégalité complètes sont injustes entre des individus qui ne sont égaux ou inégaux entre eux que sur un seul point, tous les gouvernements où l'égalité et l'inégalité sont établies sur des bases de ce genre, sont nécessairement corrompus. Nous avons dit aussi plus haut que tous les citoyens ont raison de se croire des droits, mais que tous ont tort de se croire des droits absolus : les riches, parce qu'ils possèdent une plus large part du territoire commun de la cité et qu'ils ont ordinairement plus de crédit dans les transactions commerciales ; les nobles et les hommes libres, classes fort voisines l'une de l'autre, parce que la noblesse est plus réellement citoyenne que la roture, et que la noblesse est estimée chez tous les peuples ; et de plus, parce que des descendants vertueux doivent, selon toute apparence, avoir de vertueux ancêtres ; car la noblesse n'est qu'un mérite de race. § 8. Certes, la vertu peut, selon nous, élever la voix non moins justement ; la vertu sociale, c'est la justice, et toutes les autres ne viennent nécessairement que comme des conséquences après elle. Enfin la majorité aussi a des prétentions qu'elle peut opposer à celles de la minorité ; car la majorité, prise dans son ensemble, est plus puissante, plus riche et meilleure que le petit nombre. § 9. Supposons donc la réunion, dans un seul État, [1283b] d'individus distingués, nobles, riches d'une part ; et de l'autre, une multitude à qui l'on peut accorder des droits politiques : pourra-t-on dire sans hésitation à qui doit appartenir la souveraineté ? Ou le doute sera-t-il encore possible ? Dans chacune des constitutions que nous avons énumérées plus haut, la question de savoir qui doit commander n'en peut faire une, puisque leur différence repose précisément sur celle du souverain. Ici la souveraineté est aux riches ; là, aux citoyens distingués ; et ainsi du reste. Voyons cependant ce que l'on doit faire quand toutes ces conditions diverses se rencontrent simultanément dans la cité. § 10. En supposant que la minorité des gens de bien soit extrêmement faible, comment pourra-t-on statuer à son égard ? Regardera-t-on si, toute faible qu'elle est, elle peut suffire cependant à gouverner l'État, ou même à former par elle seule une cité complète ? Mais alors se présente une objection qui est également juste contre tous les prétendants au pouvoir politique, et qui semble renverser toutes les raisons de ceux qui réclament l'autorité comme un droit de leur fortune, aussi bien que de ceux qui la réclament comme un droit de leur naissance. En adoptant le principe qu'ils allèguent-pour eux-mêmes, la prétendue souveraineté devrait évidemment passer à l'individu qui serait à lui seul plus riche que tous les autres ensemble ; et de même, le plus noble par sa naissance l'emporterait sur tous ceux qui ne font valoir que leur liberté. § 11. Même objection toute pareille contre l'aristocratie, qui se fonde sur la vertu ; car si tel citoyen est supérieur en vertu à tous les membres du gouvernement, gens eux-mêmes fort estimables, le même principe lui conférera la souveraineté. Même objection encore contre la souveraineté de la multitude, fondée sur la supériorité de sa force relativement à la minorité ; car si un individu par hasard, ou quelques individus moins nombreux toutefois que la majorité, sont plus forts qu'elle, la souveraineté leur appartiendra de préférence plutôt qu'à la foule. § 12. Tout ceci semble démontrer clairement qu'il n'y a de complète justice dans aucune des prérogatives, au nom desquelles chacun réclame le pouvoir pour soi et l'asservissement pour les autres . Aux prétentions de ceux qui revendiquent l'autorité pour leur mérite ou pour leur fortune, la multitude pourrait opposer d'excellentes raisons. Rien n'empêche, en effet, qu'elle ne soit plus riche et plus vertueuse que la minorité, non point individuellement, mais en masse. Ceci même répond à une objection que l'on met en avant et qu'on répète souvent comme fort grave on demande si, dans le cas que nous avons supposé, le législateur qui veut établir des lois parfaitement justes doit avoir en vue l'intérêt de la multitude ou celui des citoyens distingués. La justice ici, c'est l'égalité ; et cette égalité de la justice se rapporte autant à l'intérêt général de l'État qu'à l'intérêt individuel des citoyens. Or, le citoyen en général est l'individu qui a part à l'autorité et l'obéissance publiques, [1284a] la condition du citoyen étant d'ailleurs variable suivant la constitution ; et dans la république parfaite, le citoyen, c'est l'individu qui peut et qui veut obéir et gouverner tour à tour, suivant les préceptes de la vertu. |
§ 1. Ont un bien pour but. Voir plus haut, liv. I, ch. 1, § 1, la même pensée. Avec les principes philosophiques. C'est la même chose que les « études ésotériques ». Voir plus haut, même livre, ch. IV, § 4, et ch. V, § 9. De la morale. Voir la Morale à Nicomaque, liv. V, ch. V, pages 152 et suiv. de ma traduction. § 5. Le cens légal. Voir Boeckh, Iiv. III, ch. II, Econom. polit. des Athén. Le cens était le revenu net d'après lequel on classait les citoyens ; mais les Grecs n'ont jamais connu le système d'impôts réguliers et permanents comme les nôtres. § 6. Comme je l'ai dit plus haut. Voir plus haut, ch. v, § 14. § 7. Nous avons dit aussi plus haut. Voir plus haut, ch. v, § 15. -- Les nobles et les hommes libres. On voit ici nettement la différence de ces deux mots. Voir plus haut, liv. I, ch. II, § 17. -- Noblesse... roture. Voir aussi plus haut, liv. I, ch. II, § 19.§ 9. Plus haut. Voir plus haut la division théorique des trois gouvernements purs et corrompus, chapitre v, §§ 3 et 4. § 12. Que nous avons supposé. Plus haut, § 11. -- Le citoyen en général. Voir la discussion spéciale sur ce point très important, plus haut, ch. I, §§ 4 et suiv., et ch. II §§ 3 et suiv. |
|
Suite de la théorie de la souveraineté ; exception au principe de l'égalité en faveur de l'homme supérieur ; origine et justification de l'ostracisme ; usage de l'ostracisme dans les gouvernements de toute espèce ; l'ostracisme n'est pas possible dans la cité parfaite ; l'État doit se soumettre à l'homme supérieur; apothéose du génie. |
||
|
§ 1. Εἰ δέ τις ἔστιν εἷς τοσοῦτον διαφέρων κατ' ἀρετῆς ὑπερβολήν, ἢ πλείους μὲν ἑνὸς μὴ μέντοι δυνατοὶ πλήρωμα παρασχέσθαι πόλεως, ὥστε μὴ συμβλητὴν εἶναι τὴν τῶν ἄλλων ἀρετὴν πάντων μηδὲ τὴν δύναμιν αὐτῶν τὴν πολιτικὴν πρὸς τὴν ἐκείνων, εἰ πλείους, εἰ δ' εἷς, τὴν ἐκείνου μόνον, οὐκέτι θετέον τούτους μέρος πόλεως· ἀδικήσονται γὰρ ἀξιούμενοι τῶν ἴσων, ἄνισοι τοσοῦτον κατ' ἀρετὴν ὄντες καὶ τὴν πολιτικὴν δύναμιν· ὥσπερ γὰρ θεὸν ἐν ἀνθρώποις εἰκὸς εἶναι τὸν τοιοῦτον. § 2. Ὅθεν δῆλον ὅτι καὶ τὴν νομοθεσίαν ἀναγκαῖον εἶναι περὶ τοὺς ἴσους καὶ τῷ γένει καὶ τῇ δυνάμει, κατὰ δὲ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος· αὐτοὶ γάρ εἰσι νόμος. Καὶ γὰρ γελοῖος ἂν εἴη νομοθετεῖν τις πειρώμενος κατ' αὐτῶν. Λέγοιεν γὰρ ἂν ἴσως ἅπερ Ἀντισθένης ἔφη τοὺς λέοντας δημηγορούντων τῶν δασυπόδων καὶ τὸ ἴσον ἀξιούντων πάντας ἔχειν. Διὸ καὶ τίθενται τὸν ὀστρακισμὸν αἱ δημοκρατούμεναι πόλεις, διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν· αὗται γὰρ δὴ δοκοῦσι διώκειν τὴν ἰσότητα μάλιστα πάντων, ὥστε τοὺς δοκοῦντας ὑπερέχειν δυνάμει διὰ πλοῦτον ἢ πολυφιλίαν ἤ τινα ἄλλην πολιτικὴν ἰσχὺν ὠστράκιζον καὶ μεθίστασαν ἐκ τῆς πόλεως χρόνους ὡρισμένους. § 3. Μυθολογεῖται δὲ καὶ τοὺς Ἀργοναύτας τὸν Ἡρακλέα καταλιπεῖν διὰ τοιαύτην αἰτίαν· οὐ γὰρ ἐθέλειν αὐτὸν ἄγειν τὴν Ἀργὼ μετὰ τῶν πλωτήρων τῶν ἄλλων, ὡς ὑπερβάλλοντα πολύ. Διὸ καὶ τοὺς ψέγοντας τὴν τυραννίδα καὶ τὴν Περιάνδρου Θρασυβούλῳ συμβουλίαν οὐχ ἁπλῶς οἰητέον ὀρθῶς ἐπιτιμᾶν (φασὶ γὰρ τὸν Περίανδρον εἰπεῖν μὲν οὐδὲν πρὸς τὸν πεμφθέντα κήρυκα περὶ τῆς συμβουλίας, ἀφαιροῦντα δὲ τοὺς ὑπερέχοντας τῶν σταχύων ὁμαλῦναι τὴν ἄρουραν· ὅθεν ἀγνοοῦντος μὲν τοῦ κήρυκος τοῦ γιγνομένου τὴν αἰτίαν, ἀπαγγείλαντος δὲ τὸ συμπεσόν, συννοῆσαι τὸν Θρασύβουλον ὅτι δεῖ τοὺς ὑπερέχοντας ἄνδρας ἀναιρεῖν). § 4. Τοῦτο γὰρ οὐ μόνον συμφέρει τοῖς τυράννοις, οὐδὲ μόνον οἱ τύραννοι ποιοῦσιν, ἀλλ' ὁμοίως ἔχει καὶ περὶ τὰς ὀλιγαρχίας καὶ τὰς δημοκρατίας· ὁ γὰρ ὀστρακισμὸς τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν τρόπον τινὰ τῷ κολούειν τοὺς ὑπερέχοντας καὶ φυγαδεύειν. Τὸ δ' αὐτὸ καὶ περὶ τὰς πόλεις καὶ τὰ ἔθνη ποιοῦσιν οἱ κύριοι τῆς δυνάμεως, οἷον Ἀθηναῖοι μὲν περὶ Σαμίους καὶ Χίους καὶ Λεσβίους (ἐπεὶ γὰρ θᾶττον ἐγκρατῶς ἔσχον τὴν ἀρχήν, ἐταπείνωσαν αὐτοὺς παρὰ τὰς συνθήκας), [1284b] ὁ δὲ Περσῶν βασιλεὺς Μήδους καὶ Βαβυλωνίους καὶ τῶν ἄλλων τοὺς πεφρονηματισμένους διὰ τὸ γενέσθαι ποτ' ἐπ' ἀρχῆς ἐπέκοπτε πολλάκις. § 5. Τὸ δὲ πρόβλημα καθόλου περὶ πάσας ἐστὶ τὰς πολιτείας, καὶ τὰς ὀρθάς· αἱ μὲν γὰρ παρεκβεβηκυῖαι πρὸς τὸ ἴδιον ἀποσκοποῦσαι τοῦτο δρῶσιν, οὐ μὴν ἀλλὰ περὶ τὰς τὸ κοινὸν ἀγαθὸν ἐπισκοπούσας τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον. Δῆλον δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν· οὔτε γὰρ γραφεὺς ἐάσειεν ἂν τὸν ὑπερβάλλοντα πόδα τῆς συμμετρίας ἔχειν τὸ ζῷον, οὐδ' εἰ διαφέροι τὸ κάλλος, οὔτε ναυπηγὸς πρύμναν ἢ τῶν ἄλλων τι μορίων τῶν τῆς νεώς, οὐδὲ δὴ χοροδιδάσκαλος τὸν μεῖζον καὶ κάλλιον τοῦ παντὸς χοροῦ φθεγγόμενον ἐάσει συγχορεύειν. § 6. Ὥστε διὰ τοῦτο μὲν οὐδὲν κωλύει τοὺς μονάρχους συμφωνεῖν ταῖς πόλεσιν, εἰ τῆς οἰκείας ἀρχῆς ὠφελίμου ταῖς πόλεσιν οὔσης τοῦτο δρῶσιν. Διὸ κατὰ τὰς ὁμολογουμένας ὑπεροχὰς ἔχει τι δίκαιον πολιτικὸν ὁ λόγος ὁ περὶ τὸν ὀστρακισμόν. Βέλτιον μὲν οὖν τὸν νομοθέτην ἐξ ἀρχῆς οὕτω συστῆσαι τὴν πολιτείαν ὥστε μὴ δεῖσθαι τοιαύτης ἰατρείας· δεύτερος δὲ πλοῦς, ἂν συμβῇ, πειρᾶσθαι τοιούτῳ τινὶ διορθώματι διορθοῦν. Ὅπερ οὐκ ἐγίγνετο περὶ τὰς πόλεις· οὐ γὰρ ἔβλεπον πρὸς τὸ τῆς πολιτείας τῆς οἰκείας συμφέρον, ἀλλὰ στασιαστικῶς ἐχρῶντο τοῖς ὀστρακισμοῖς. Ἐν μὲν οὖν ταῖς παρεκβεβηκυίαις πολιτείαις ὅτι μὲν ἰδίᾳ συμφέρει καὶ δίκαιόν ἐστι, φανερόν, ἴσως δὲ καὶ ὅτι οὐχ ἁπλῶς δίκαιον, καὶ τοῦτο φανερόν· § 7. ἀλλ' ἐπὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας ἔχει πολλὴν ἀπορίαν, οὐ κατὰ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν τὴν ὑπεροχήν, οἷον ἰσχύος καὶ πλούτου καὶ πολυφιλίας, ἀλλὰ ἄν τις γένηται διαφέρων κατ' ἀρετήν, τί χρὴ ποιεῖν; Οὐ γὰρ δὴ φαῖεν ἂν δεῖν ἐκβάλλειν καὶ μεθιστάναι τὸν τοιοῦτον· ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἄρχειν γε τοῦ τοιούτου· παραπλήσιον γὰρ κἂν εἰ τοῦ Διὸς ἄρχειν ἀξιοῖεν, μερίζοντες τὰς ἀρχάς. Λείπεται τοίνυν, ὅπερ ἔοικε πεφυκέναι, πείθεσθαι τῷ τοιούτῳ πάντας ἀσμένως, ὥστε βασιλέας εἶναι τοὺς τοιούτους ἀιδίους ἐν ταῖς πόλεσιν. |
§ 1. Si dans l'État un individu, ou même plusieurs individus, trop peu nombreux toutefois pour former entre eux seuls une cité entière, ont une telle supériorité de mérite que le mérite de tous les autres citoyens ne puisse entrer en balance, et que l'influence politique de cet individu unique, ou de ces individus, soit incomparablement plus forte, de tels hommes ne peuvent être compris dans la cité. Ce sera leur faire injure que de les réduire à l'égalité commune, quand leur mérite et leur importance politiques les mettent si complètement hors de comparaison ; de tels personnages sont, on peut dire, des dieux par les hommes. § 2. Nouvelle preuve que la législation ne doit nécessairement concerner que des individus égaux par leur naissance et par leurs facultés. Mais la loi n'est point faite pour ces êtres supérieurs ; ils sont eux-mêmes la loi. Il serait ridicule de tenter de les soumettre à la constitution ; car ils pourraient répondre ce que, suivant Antisthène, les lions répondirent au décret rendu par l'assemblée des lièvres sur l'égalité générale des animaux. Voilà, aussi l'origine de l'ostracisme dans les États démocratiques, qui, plus que tous les autres, se montrent jaloux de l'égalité. Dès qu'un citoyen semblait s'élever au-dessus de tous les autres par sa richesse, par la foule de ses partisans, ou par tout autre avantage politique, l'ostracisme venait le frapper d'un exil plus ou moins long. § 3. Dans la mythologie, les Argonautes n'ont point d'autre motif pour abandonner Hercule ; Argo déclare qu'elle ne veut pas le porter, parce qu'il est beaucoup plus pesant que le reste de ses compagnons. Aussi a-t-on bien tort de blâmer d'une manière absolue la tyrannie et le conseil que Périandre donnait à Thrasybule : pour toute réponse à l'envoyé qui venait lui demander conseil, il se contenta de niveler une certaine quantité d'épis, en cassant ceux qui dépassaient les autres. Le messager ne comprit rien au motif de cette action ; mais Thrasybule, quand on l'en informa, entendit fort bien qu'il devait se défaire des citoyens puissants. § 4. Cet expédient n'est pas utile seulement aux tyrans ; aussi ne sont-ils pas les seuls à en user. On l'emploie avec un égal succès dans les oligarchies et dans les démocraties. L'ostracisme y produit à peu près les mêmes résultats, en arrêtant par l'exil la puissance des personnages qu'il frappe. Quand on est en mesure de le pouvoir, on applique ce principe politique à des États, à des peuples entiers. On peut voir la conduite des Athéniens à l'égard des Samiens, des Chiotes et des Lesbiens. A peine leur puissance fut-elle affermie, qu'ils eurent soin d'affaiblir leurs sujets, en dépit de tous les traités ; [1284b] et le roi des Perses a plus d'une fois châtié les Mèdes, les Babyloniens et d'autres peuples, tout fiers encore des souvenirs de leur antique domination. § 5. Cette question intéresse tous les gouvernements sans exception, même les bons. Les gouvernements corrompus emploient ces moyens-là clans un intérêt tout particulier ; mais on ne les emploie pas moins clans les gouvernements d'intérêt général. On peut éclaircir ce raisonnement par une comparaison empruntée aux autres sciences, aux autres arts. Le peintre ne laissera point dans son tableau un pied qui dépasserait les proportions des autres parties de la figure, ce pied fût-il beaucoup plus beau que le reste ; le charpentier de marine ne recevra pas davantage une proue, ou telle autre pièce du bâtiment, si elle est disproportionnée ; et le choriste en chef n'admettra point, dans un concert, une voix plus forte et plus belle que toutes celles qui forment le reste du choeur. § 6. Rien n'empêche donc les monarques de se trouver en ceci d'accord avec les États qu'ils régissent, si de fait ils ne recourent à cet expédient que quand la conservation de leur propre pouvoir est dans l'intérêt de l'État. Ainsi les principes de l'ostracisme appliqué aux supériorités bien reconnues ne sont pas dénués de toute équité politique. Il est certainement préférable que la cité, grâce aux institutions primitives du législateur, puisse se passer de ce remède ; mais si le législateur reçoit de seconde main le gouvernail de l'État, il peut, dans le besoin, recourir à ce moyen de réforme. Ce n'est point ainsi, du reste, qu'on l'a jusqu'à présent employé ; on n'a point considéré le moins du monde dans l'ostracisme l'intérêt Véritable de la république, et l'on en a fait une simple affaire de faction.Pour les gouvernements corrompus, l'ostracisme, en servant un intérêt particulier, est aussi par cela même évidemment juste ; mais il est tout aussi évident qu'il n'est point d'une justice absolue. § 7. Dans la cité parfaite, la question est bien autrement difficile. La supériorité sur tout autre point que le mérite, richesse ou influence, ne peut causer d'embarras ; mais que faire contre la supériorité de mérite ? Certes, on ne dira pas qu'il faut bannir ou chasser le citoyen qu'elle distingue. On ne prétendra pas davantage qu'il faut le réduire à l'obéissance ; car prétendre au partage du pouvoir, ce serait donner un maître à Jupiter lui-même. Le seul parti que naturellement tous les citoyens semblent devoir adopter, est de se soumettre de leur plein gré à ce grand homme, et de le prendre pour roi durant sa vie entière. |
§ 1. Dans l'État un individu. Quelques auteurs ont soutenu, d'après ce passage, qu'Aristote était partisan de la tyrannie ; c'est une erreur que réfute l'ouvrage entier, pour peu qu'on le lise avec attention. Aristote fait une réserve pour le génie ; et en cela l'humanité a pensé précisément comme le philosophe qui la connaissait si profondément. L'humanité s'est soumise à César, à Cromwell, à Napoléon ; elle a toujours permis l'usurpation au génie, et elle en a quelquefois profité. Aristote n'a point prétendu dire autre chose. Voir plus loin, même chapitre, § 8, ch. XI, § 12, et liv. IV (7), ch. XIII, § 1. Je renvoie le lecteur à la préface, où sont discutées ces accusations, qui sont fort injustes selon moi. Du reste, Platon a présenté avant son disciple des théories tout à fait pareilles à celles-ci. Voir le Politique, passim, et surtout page 455, traduction de M. Cousin. § 2. Antisthène, Athénien, disciple de Socrate. « Les lièvres réclamaient l'égalité pour tous les animaux; les lions leur dirent : - Il faudrait soutenir de telles prétentions avec des ongles et des dents comme les nôtres ». Voir l'Ésope de Coraï, p. 225. § 3. Argo. A la hauteur d'Aphété en Thessalie, Argo, le merveilleux vaisseau, prit la parole et déclara qu'il ne pouvait porter Hercule, tant il pesait (Apollodor. , Bib., liv. I, ch. IX, § 19, et Schol. d'Apollonius, chant I, v. 1201). Périandre. Aristote rappelle ce fait, liv. VIII (5), ch. VIII, § 7 ; Hérodote prétend, au contraire, que c'est Thrasybule qui donna ce conseil emblématique à Périandre (Terpsichore, ch. XCII, § 15, page 268, édit. Firmin Didot). Pour Périandre, voir liv. VIII (5), ch. IX §§ 2 et 22. Thrasybule était tyran de Milet, vers l'an 600 av. J.-C. La conduite des Athéniens. On trouvera dans l'histoire de Thucydide vingt exemples de la conduite cruelle des Athéniens envers leurs alliés. Il faut lire surtout ce qui regarde Mitylène, liv. III, ch. XXXVI et suiv. Le roi des Perses. On peut voir dans Hérodote le soulèvement des Babyloniens et des Mèdes contre Darius, et le châtiment qui les comprima (Clio , ch. CXCII ; Thalie, ch. CL). § 6. Dénués de toute équité politique. Voir Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XXVI, ch. XVII. § 7. Le seul parti. Voir plus haut, même chapitre, § 1 ; et plus loin, ch. XI, § 12. |
|
Théorie de la royauté. De l'utilité ou des dangers de cette forme de gouvernement. Cinq espèces diverses de la royauté, qui doit toujours être légale ; la première espèce n'est guère qu'un généralat viager ; la seconde est celle de certains peuples barbares, et se rapproche de la tyrannie par ses pouvoirs illimités; la troisième comprend les aesymnéties, ou tyrannies volontaires, consenties pour un temps plus ou moins long ; la quatrième espèce est la royauté des temps héroïques, souveraine maîtresse à. la guerre et dans les procès de tout genre ; la cinquième enfin est celle où le roi est maître de tous les pouvoirs, à peu près comme le père les possède tous dans la famille. |
||
|
§ 1. Ἴσως δὲ καλῶς ἔχει μετὰ τοὺς εἰρημένους λόγους μεταβῆναι καὶ σκέψασθαι περὶ βασιλείας· φαμὲν γὰρ τῶν ὀρθῶν πολιτειῶν μίαν εἶναι ταύτην. Σκεπτέον δὲ πότερον συμφέρει τῇ μελλούσῃ καλῶς οἰκήσεσθαι καὶ πόλει καὶ χώρᾳ βασιλεύεσθαι, ἢ οὔ, ἀλλ' ἄλλη τις πολιτεία μᾶλλον, ἢ τισὶ μὲν συμφέρει τισὶ δ' οὐ συμφέρει. Δεῖ δὴ πρῶτον διελέσθαι πότερον ἕν τι γένος ἔστιν αὐτῆς ἢ πλείους ἔχει διαφοράς. § 2. Ῥᾴδιον δὴ τοῦτό γε καταμαθεῖν, ὅτι πλείω τε γένη περιέχει καὶ τῆς ἀρχῆς ὁ τρόπος ἐστὶν οὐχ εἷς πασῶν. Ἡ γὰρ ἐν τῇ Λακωνικῇ πολιτείᾳ δοκεῖ μὲν εἶναι βασιλεία μάλιστα τῶν κατὰ νόμον, οὐκ ἔστι δὲ κυρία πάντων, ἀλλ' ὅταν ἐξέλθῃ τὴν χώραν ἡγεμών ἐστι τῶν πρὸς τὸν πόλεμον· ἔτι δὲ τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς ἀποδέδοται τοῖς βασιλεῦσιν. Αὕτη μὲν οὖν ἡ βασιλεία οἷον στρατηγία τις αὐτοκρατόρων καὶ ἀίδιός ἐστιν· κτεῖναι γὰρ οὐ κύριος, εἰ μὴ ἔν τινι καιρῷ, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἀρχαίων ἐν ταῖς πολεμικαῖς ἐξόδοις, ἐν χειρὸς νόμῳ. Δηλοῖ δ' Ὅμηρος· ὁ γὰρ Ἀγαμέμνων κακῶς μὲν ἀκούων ἠνείχετο ἐν ταῖς ἐκκλησίαις, ἐξελθόντων δὲ καὶ κτεῖναι κύριος ἦν· λέγει γοῦν
Ὃν δέ κ' ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης § 3. Ἓν μὲν οὖν τοῦτ' εἶδος βασιλείας, στρατηγία διὰ βίου, τούτων δ' αἱ μὲν κατὰ γένος εἰσὶν αἱ δ' αἱρεταί· παρὰ ταύτην δ' ἄλλο μοναρχίας εἶδος, οἷαι παρ' ἐνίοις εἰσὶ βασιλεῖαι τῶν βαρβάρων. Ἔχουσι δ' αὗται τὴν δύναμιν πᾶσαι παραπλησίαν τυραννίσιν, εἰσὶ δὲ καὶ κατὰ νόμον καὶ πάτριαι· διὰ γὰρ τὸ δουλικώτεροι εἶναι τὰ ἤθη φύσει οἱ μὲν βάρβαροι τῶν Ἑλλήνων, οἱ δὲ περὶ τὴν Ἀσίαν τῶν περὶ τὴν Εὐρώπην, ὑπομένουσι τὴν δεσποτικὴν ἀρχὴν οὐδὲν δυσχεραίνοντες. Τυραννικαὶ μὲν οὖν διὰ τὸ τοιοῦτόν εἰσιν, ἀσφαλεῖς δὲ διὰ τὸ πάτριαι καὶ κατὰ νόμον εἶναι. § 4. Καὶ ἡ φυλακὴ δὲ βασιλικὴ καὶ οὐ τυραννικὴ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. Οἱ γὰρ πολῖται φυλάττουσιν ὅπλοις τοὺς βασιλεῖς, τοὺς δὲ τυράννους ξενικόν· οἱ μὲν γὰρ κατὰ νόμον καὶ ἑκόντων οἱ δ' ἀκόντων ἄρχουσιν, ὥσθ' οἱ μὲν παρὰ τῶν πολιτῶν οἱ δ' ἐπὶ τοὺς πολίτας ἔχουσι τὴν φυλακήν.
§ 5. Δύο μὲν οὖν εἴδη ταῦτα μοναρχίας,
ἕτερον δ' ὅπερ ἦν ἐν τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλησιν, οὓς καλοῦσιν αἰσυμνήτας.
Ἔστι δὲ τοῦθ' ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν αἱρετὴ τυραννίς, διαφέρουσα δὲ τῆς
βαρβαρικῆς οὐ τῷ μὴ κατὰ νόμον ἀλλὰ τῷ μὴ πάτριος εἶναι μόνον. Ἦρχον
δ' οἱ μὲν διὰ βίου τὴν ἀρχὴν ταύτην, οἱ δὲ μέχρι τινῶν ὡρισμένων
χρόνων ἢ πράξεων, οἷον εἵλοντό ποτε Μυτιληναῖοι Πιττακὸν πρὸς τοὺς
φυγάδας ὧν προειστήκεσαν Ἀντιμενίδης καὶ Ἀλκαῖος ὁ ποιητής. τὸν κακοπάτριδα
Πίττακον πόλιος τᾶς ἀχόλω καὶ
βαρυδαίμονος [1285b] Αὗται μὲν οὖν εἰσί τε καὶ ἦσαν διὰ μὲν τὸ δεσποτικαὶ εἶναι τυραννικαί, διὰ δὲ τὸ αἱρεταὶ καὶ ἑκόντων βασιλικαί· § 7. τέταρτον δ' εἶδος μοναρχίας βασιλικῆς αἱ κατὰ τοὺς ἡρωικοὺς χρόνους ἑκούσιαί τε καὶ πάτριαι γιγνόμεναι κατὰ νόμον. Διὰ γὰρ τὸ τοὺς πρώτους γενέσθαι τοῦ πλήθους εὐεργέτας κατὰ τέχνας ἢ πόλεμον, ἢ διὰ τὸ συναγαγεῖν ἢ πορίσαι χώραν, ἐγίγνοντο βασιλεῖς ἑκόντων καὶ τοῖς παραλαμβάνουσι πάτριοι. Κύριοι δ' ἦσαν τῆς τε κατὰ πόλεμον ἡγεμονίας καὶ τῶν θυσιῶν, ὅσαι μὴ ἱερατικαί, καὶ πρὸς τούτοις τὰς δίκας ἔκρινον. Τοῦτο δ' ἐποίουν οἱ μὲν οὐκ ὀμνύοντες οἱ δ' ὀμνύοντες· ὁ δ' ὅρκος ἦν τοῦ σκήπτρου ἐπανάτασις. § 8. Οἱ μὲν οὖν ἐπὶ τῶν ἀρχαίων χρόνων καὶ τὰ κατὰ πόλιν καὶ τὰ ἔνδημα καὶ τὰ ὑπερόρια συνεχῶς ἦρχον· ὕστερον δὲ τὰ μὲν αὐτῶν παριέντων τῶν βασιλέων, τὰ δὲ τῶν ὄχλων παραιρουμένων, ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν αἱ θυσίαι κατελείφθησαν τοῖς βασιλεῦσι μόνον, ὅπου δ' ἄξιον εἰπεῖν εἶναι βασιλείαν, ἐν τοῖς ὑπερορίοις τῶν πολεμικῶν τὴν ἡγεμονίαν μόνον εἶχον. § 9. Βασιλείας μὲν οὖν εἴδη ταῦτα, τέτταρα τὸν ἀριθμόν, μία μὲν ἡ περὶ τοὺς ἡρωικοὺς χρόνους (αὕτη δ' ἦν ἑκόντων μέν, ἐπὶ τισὶ δ' ὡρισμένοις· στρατηγός τε γὰρ ἦν καὶ δικαστὴς ὁ βασιλεύς, καὶ τῶν πρὸς τοὺς θεοὺς κύριος), δευτέρα δ' ἡ βαρβαρική ήαὕτη δ' ἐστὶν ἐκ γένους ἀρχὴ δεσποτικὴ κατὰ νόμονν, τρίτη δὲ ἣν αἰσυμνητείαν προσαγορεύουσιν (αὕτη δ' ἐστὶν αἱρετὴ τυραννίς), τετάρτη δ' ἡ Λακωνικὴ τούτων (αὕτη δ' ἐστὶν ὡς εἰπεῖν ἁπλῶς στρατηγία κατὰ γένος ἀίδιος). Αὗται μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον διαφέρουσιν ἀλλήλων· § 10. πέμπτον δ' εἶδος βασιλείας, ὅταν ᾖ πάντων κύριος εἷς ὤν, ὥσπερ ἕκαστον ἔθνος καὶ πόλις ἑκάστη τῶν κοινῶν, τεταγμένη κατὰ τὴν οἰκονομικήν. Ὥσπερ γὰρ ἡ οἰκονομικὴ βασιλεία τις οἰκίας ἐστίν, οὕτως ἡ παμβασιλεία πόλεως καὶ ἔθνους ἑνὸς ἢ πλειόνων οἰκονομία. |
§ 1 . Les développements qui précèdent nous conduisent assez bien à l'étude de la royauté, que nous avons classée parmi les bons gouvernements. La cité ou l'État bien constitué doit-il ou ne doit-il pas, dans son intérêt, être régi par un roi ? N'existe-t-il point de gouvernement préférable à celui-là, qui, s'il est utile à quelques peuples, peut ne pas l'être à bien d'autres ? Telles sont les questions que nous avons à examiner. Mais recherchons d'abord si la royauté est simple, ou si elle ne se divise pas en plusieurs espèces différentes. § 2. Il est bien aisé de reconnaître qu'elle est multiple, et que ses attributions ne sont pas identiques dans tous les États. Ainsi, la royauté dans le gouvernement de Sparte, parait être celle qui est la plus légale ; mais elle n'est pas maîtresse absolue. Le roi dispose souverainement de deux choses seulement : des affaires militaires, qu'il dirige quand il est hors du territoire national, et des affaires religieuses. La royauté ainsi comprise n'est vraiment qu'un généralat inamovible, investi de pouvoirs suprêmes. Elle n'a point le droit de vie et de mort, si ce n'est dans un seul cas, réservé aussi chez les anciens : dans les expéditions militaires, dans la chaleur du combat. C'est Homère qui nous l'apprend. Agamemnon, quand on délibère, se laisse patiemment insulter ; mais quand on marche à l'ennemi, son pouvoir va jusqu'au droit de mort, et il peut s'écrier :
Celui qu'alors je trouve auprès de nos
vaisseaux , § 3. Cette première espèce de royauté n'est donc qu'un généralat viager ; elle peut être du reste tantôt héréditaire et tantôt élective. Après celle-là, je placerai une seconde espèce de royauté, que l'on trouve établie chez quelques peuples barbares ; en général, elle a les mêmes pouvoirs à peu près que la tyrannie, bien qu'elle soit légitime et héréditaire. Des peuples poussés par un esprit naturel de servitude, disposition beaucoup plus prononcée chez les barbares que chez les Grecs, dans les Asiatiques que dans les Européens, supportent le joug du despotisme sans peine et sans murmure ; voilà pourquoi les royautés qui pèsent sur ces peuples sont tyranniques, bien qu'elles reposent d'ailleurs sur les bases solides de la loi et de l'hérédité. § 4. Voilà encore pourquoi la garde qui entoure ces rois-là est vraiment royale, et qu'elle n'est pas une garde comme en ont les tyrans. Ce sont des citoyens en armes qui veillent à la sûreté d'un roi ; le tyran ne confie la sienne qu'à des étrangers. C'est que là, l'obéissance est légale et volontaire, et qu'ici elle est forcée. Les uns ont une garde de citoyens ; les autres ont une garde contre les citoyens. § 5. Après ces deux espèces de monarchies, en vient une troisième, dont on trouve des exemples chez les anciens Grecs, et qu'on nomme Aesymtétie. C'est, à bien dire, une tyrannie élective, se distinguant de la royauté barbare, non en ce qu'elle n'est pas légale, mais seulement en ce qu'elle n'est pas héréditaire. Les aesymnètes recevaient leurs pouvoirs, tantôt pour la vie, tantôt pour un temps ou un fait déterminé. C'est ainsi que Mitylène élut Pittacus, pour repousser les bannis, que commandaient Antiménide et Alcée, le poète. § 6. Alcée lui-même nous apprend dans un de ses Scolies que Pittacus fut élevé à la tyrannie ; il y reproche à ses concitoyens « d'avoir pris un Pittacus, l'ennemi de son pays, pour en faire le tyran de cette ville, qui ne sent ni le poids de ses maux, ni le poids de sa honte, et qui n'a point assez de louanges pour son assassin. » [1285b] Les aesymnéties anciennes ou actuelles tiennent, et du despotisme par les pouvoirs tyranniques qui leur sont remis, et de la royauté par l'élection libre qui les a créées. § 7. Une quatrième espèce de royauté est celle des temps héroïques, consentie par les citoyens, et héréditaire par la loi. Les fondateurs de ces monarchies, bienfaiteurs des peuples, soit en les éclairant par les arts, soit en les guidant à la victoire, en les réunissant ou en leur conquérant des établissements, furent nommés rois par reconnaissance et transmirent le pouvoir à leurs fils. Ces rois avaient le commandement suprême à la guerre, et faisaient tous les sacrifices où le ministère des pontifes n'était pas indispensable. Outre ces deux prérogatives, ils étaient juges souverains de tous les procès, tantôt sans serment, et tantôt en donnant cette garantie. La formule du serment consistait à lever le sceptre en l'air. § 8. Dans les temps reculés, le pouvoir de ces rois comprenait toutes les affaires politiques de l'intérieur et du dehors sans exception ; mais plus tard, soit par l'abandon volontaire des rois, soit par l'exigence des peuples, cette royauté fut réduite presque partout à la présidence des sacrifices ; et là où elle méritait encore son nom, elle n'avait gardé que le commandement des armées hors du territoire de l'État. § 9. Nous avons donc reconnu quatre sortes de royautés : l'une, celle des temps héroïques, librement consentie, mais limitée aux fonctions de général, de juge et de pontife ; la seconde, celle des barbares, despotique et héréditaire par la loi ; la troisième, celle qu'on nomme Aesymnétie, et qui est une tyrannie élective ; la quatrième, enfin, celle de Sparte, qui n'est, à proprement parler, qu'un généralat perpétuellement héréditaire dans une race. Ces quatre royautés sont ainsi suffisamment distinctes entre elles. § 10. Il en est une cinquième, où un seul chef dispose de tout, comme ailleurs le corps de la nation, l’État, dispose de la chose publique. Cette royauté a de grands rapports avec le pouvoir domestique ; de même que l'autorité du père est une sorte de royauté sur la famille, de même la royauté dont nous parlons ici est une administration de famille s'appliquant à une cité, à une ou plusieurs nations. |
§ § 1. Que nous avons classés. Voir plus haut, ch. V, § 1.
§ 2. Dans le gouvernement
de Sparte. Voir plus haut l'analyse de la constitution
lacédémonienne, liv. II, ch. VI. -- Celui qu'alors je trouve. Ces fragments se rapportent à l'Iliade, chant II, v. 391, et chant XV, v. 349.-- C ar j'ai droit de tuer. Ce commencement de vers ne se retrouve plus dans les poèmes d'Homère, tels qu'ils nous restent aujourd'hui. On sait que depuis le temps d'Aristote ils ont été altérés de plusieurs manières. Voir plus loin, liv. V (8), ch. II. Voir aussi ma préface à la trad. d'Homère, p. LVIII et suiv.§ 3. Par un esprit naturel de servitude. Voir un passage du liv. IV (7), ch, VI, § 1. § 5. Aesymnétie. Denys d'Halicarnasse compare les aesymnètes aux dictateurs romains. Voir la fin du VIe livre des Antiquités romaines. - Pittacus. Pittacus; tyran de Mitylène, l'un des sept Sages de la Grèce, vers l'an 600. -- Alcée le poète. C'est le fameux poète lyrique. Je n'ai pas mis sous forme de vers la citation d'Aristote, parce qu'il est difficile de juger si ce sont bien exactement toutes les expressions d'Alcée. On a vu plus haut qu'Aristote n'est pas toujours très fidèle dans ses citations. Des éditeurs ont cru reconnaître dans celle-ci des vers choriambiques à trois mesures, terminés par un ïambe.
§ 6. Les aesymnéties. Denys
d'Halycarnasse, en expliquant le mot « aesymnètes » (Antiquités
romaines, à la fin du livre VI), paraît avoir eu ce passage en vue.
Pittacus, selon lui, a été une sorte de dictateur, d'aesymnète,
comme Aristote le dit ici. -- Lever le sceptre en l'air. Voir plusieurs exemples de ce genre dans l'Iliade, chant VII, v. 412 ; et chant x, v. 321. |
|
Suite de la théorie de la royauté; les cinq espèces peuvent être réduites à deux principales. - De la royauté absolue ; vaut-il mieux remettre le pouvoir à un seul individu qu'à des lois faites par des citoyens éclairés et honnêtes ? Arguments pour et contre la royauté absolue ; l'aristocratie lui est très préférable ; causes qui ont amené l'établissement et ensuite la ruine des royautés. - L'hérédité du pouvoir royal n'est pas admissible. - De la force publique mise à la disposition de la royauté. |
||
|
§ 1. Σχεδὸν δὴ δύο ἐστὶν ὡς εἰπεῖν εἴδη βασιλείας περὶ ὧν σκεπτέον, αὕτη τε καὶ ἡ Λακωνική· τῶν γὰρ ἄλλων αἱ πολλαὶ μεταξὺ τούτων εἰσίν· ἐλαττόνων μὲν γὰρ κύριοι τῆς παμβασιλείας, πλειόνων δ' εἰσὶ τῆς Λακωνικῆς. § 2. Ὥστε τὸ σκέμμα σχεδὸν περὶ δυοῖν ἐστιν, ἓν μὲν πότερον συμφέρει ταῖς πόλεσι στρατηγὸν ἀίδιον εἶναι, καὶ τοῦτον ἢ κατὰ γένος ἢ κατὰ μέρος, ἢ οὐ συμφέρει, [1286a] ἓν δὲ πότερον ἕνα συμφέρει κύριον εἶναι πάντων, ἢ οὐ συμφέρει. § 3. Τὸ μὲν οὖν περὶ τῆς τοιαύτης στρατηγίας ἐπισκοπεῖν νόμων ἔχει μᾶλλον εἶδος ἢ πολιτείας (ἐν ἁπάσαις γὰρ ἐνδέχεται γίγνεσθαι τοῦτο ταῖς πολιτείαις), ὥστ' ἀφείσθω τὴν πρώτην· ὁ δὲ λοιπὸς τρόπος τῆς βασιλείας πολιτείας εἶδός ἐστιν, ὥστε περὶ τούτου δεῖ θεωρῆσαι καὶ τὰς ἀπορίας ἐπιδραμεῖν τὰς ἐνούσας. § 4. Ἀρχὴ δ' ἐστὶ τῆς ζητήσεως αὕτη, πότερον συμφέρει μᾶλλον ὑπὸ τοῦ ἀρίστου ἀνδρὸς ἄρχεσθαι ἢ ὑπὸ τῶν ἀρίστων νόμων. Δοκοῦσι δὴ τοῖς νομίζουσι συμφέρειν βασιλεύεσθαι τὸ καθόλου μόνον οἱ νόμοι λέγειν, ἀλλ' οὐ πρὸς τὰ προσπίπτοντα ἐπιτάττειν, ὥστ' ἐν ὁποιᾳοῦν τέχνῃ τὸ κατὰ γράμματ' ἄρχειν ἠλίθιον (καὶ ἐν Αἰγύπτῳ μετὰ τὴν τετρήμερον κινεῖν ἔξεστι τοῖς ἰατροῖς, ἐὰν δὲ πρότερον, ἐπὶ τῷ αὑτοῦ κινδύνῳ). Φανερὸν τοίνυν ὡς οὐκ ἔστιν ἡ κατὰ γράμματα καὶ νόμους ἀρίστη πολιτεία, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. Ἀλλὰ μὴν κἀκεῖνον δεῖ ὑπάρχειν τὸν λόγον, τὸν καθόλου, τοῖς ἄρχουσιν. Κρεῖττον δ' ᾧ μὴ πρόσεστι τὸ παθητικὸν ὅλως ἢ ᾧ συμφυές· τῷ μὲν οὖν νόμῳ τοῦτο οὐχ ὑπάρχει, ψυχὴν δ' ἀνθρωπίνην ἀνάγκη τοῦτ' ἔχειν πᾶσαν. § 5. Ἀλλ' ἴσως ἂν φαίη τις ὡς ἀντὶ τούτου βουλεύσεται περὶ τῶν καθ' ἕκαστα κάλλιον. Ὅτι μὲν τοίνυν ἀνάγκη νομοθέτην αὐτὸν εἶναι, δῆλον, καὶ κεῖσθαι νόμους, ἀλλὰ μὴ κυρίους ᾗ παρεκβαίνουσιν, ἐπεὶ περὶ τῶν γ' ἄλλων εἶναι δεῖ κυρίους· ὅσα δὲ μὴ δυνατὸν τὸν νόμον κρίνειν ἢ ὅλως ἢ εὖ, πότερον ἕνα τὸν ἄριστον δεῖ ἄρχειν ἢ πάντας; Καὶ γὰρ νῦν συνιόντες δικάζουσι καὶ βουλεύονται καὶ κρίνουσιν, αὗται δ' αἱ κρίσεις εἰσὶ πᾶσαι περὶ τῶν καθ' ἕκαστον. Καθ' ἕνα μὲν οὖν συμβαλλόμενος ὁστισοῦν ἴσως χείρων· ἀλλ' ἐστὶν ἡ πόλις ἐκ πολλῶν, ὥσπερ δ' ἑστίασις συμφορητὸς καλλίων μιᾶς καὶ ἁπλῆς· διὰ τοῦτο καὶ κρίνει ἄμεινον ὄχλος πολλὰ ἢ εἷς ὁστισοῦν. § 6. Ἔτι μᾶλλον ἀδιάφθορον τὸ πολύκαθάπερ ὕδωρ τὸ πλεῖον, οὕτω καὶ τὸ πλῆθος τῶν ὀλίγων ἀδιαφθορώτερον· τοῦ δ' ἑνὸς ὑπ' ὀργῆς κρατηθέντος ἤ τινος ἑτέρου πάθους τοιούτου ἀναγκαῖον διεφθάρθαι τὴν κρίσιν, ἐκεῖ δ' ἔργον ἅμα πάντας ὀργισθῆναι καὶ ἁμαρτεῖν. Ἔστω δὲ τὸ πλῆθος οἱ ἐλεύθεροι, μηδὲν παρὰ τὸν νόμον πράττοντες ἀλλ' ἢ περὶ ὧν ἐκλείπειν ἀναγκαῖον αὐτόν. Εἰ δὲ δὴ τοῦτο μὴ ῥᾴδιον ἐν πολλοῖς, ἀλλ' εἰ πλείους εἶεν ἀγαθοὶ καὶ ἄνδρες καὶ πολῖται, πότερον ὁ εἷς ἀδιαφθορώτερος ἄρχων, ἢ μᾶλλον οἱ πλείους μὲν τὸν ἀριθμὸν ἀγαθοὶ δὲ πάντες; [1286b] Ἢ δῆλον ὡς οἱ πλείους; Ἀλλ' οἱ μὲν στασιάσουσιν ὁ δὲ εἷς ἀστασίαστος. Ἀλλὰ πρὸς τοῦτ' ἀντιθετέον ἴσως ὅτι σπουδαῖοι τὴν ψυχήν, ὥσπερ κἀκεῖνος ὁ εἷς. § 7. Εἰ δὴ τὴν μὲν τῶν πλειόνων ἀρχὴν ἀγαθῶν δ' ἀνδρῶν πάντων ἀριστοκρατίαν θετέον, τὴν δὲ τοῦ ἑνὸς βασιλείαν, αἱρετώτερον ἂν εἴη ταῖς πόλεσιν ἀριστοκρατία βασιλείας, καὶ μετὰ δυνάμεως καὶ χωρὶς δυνάμεως οὔσης τῆς ἀρχῆς, ἂν ᾖ λαβεῖν πλείους ὁμοίους. Καὶ διὰ τοῦτ' ἴσως ἐβασιλεύοντο πρότερον, ὅτι σπάνιον ἦν εὑρεῖν ἄνδρας πολὺ διαφέροντας κατ' ἀρετήν, ἄλλως τε καὶ τότε μικρὰς οἰκοῦντας πόλεις. Ἔτι δ' ἀπ' εὐεργεσίας καθίστασαν τοὺς βασιλεῖς, ὅπερ ἐστὶν ἔργον τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν. § 8. Ἐπεὶ δὲ συνέβαινε γίγνεσθαι πολλοὺς ὁμοίους πρὸς ἀρετήν, οὐκέτι ὑπέμενον ἀλλ' ἐζήτουν κοινόν τι καὶ πολιτείαν καθίστασαν. Ἐπεὶ δὲ χείρους γιγνόμενοι ἐχρηματίζοντο ἀπὸ τῶν κοινῶν, ἐντεῦθέν ποθεν εὔλογον γενέσθαι τὰς ὀλιγαρχίας· ἔντιμον γὰρ ἐποίησαν τὸν πλοῦτον. Ἐκ δὲ τούτων πρῶτον εἰς τυραννίδας μετέβαλλον, ἐκ δὲ τῶν τυραννίδων εἰς δημοκρατίαν· αἰεὶ γὰρ εἰς ἐλάττους ἄγοντες δι' αἰσχροκέρδειαν ἰσχυρότερον τὸ πλῆθος κατέστησαν, ὥστ' ἐπιθέσθαι καὶ γενέσθαι δημοκρατίας. Ἐπεὶ δὲ καὶ μείζους εἶναι συμβέβηκε τὰς πόλεις, ἴσως οὐδὲ ῥᾴδιον ἔτι γίγνεσθαι πολιτείαν ἑτέραν παρὰ δημοκρατίαν. § 9. Εἰ δὲ δή τις ἄριστον θείη τὸ βασιλεύεσθαι ταῖς πόλεσιν, πῶς ἕξει τὰ περὶ τῶν τέκνων; Πότερον καὶ τὸ γένος δεῖ βασιλεύειν; Ἀλλὰ γιγνομένων ὁποῖοί τινες ἔτυχον, βλαβερόν. Ἀλλ' οὐ παραδώσει κύριος ὢν τοῖς τέκνοις. Ἀλλ' οὐκ ἔτι τοῦτο ῥᾴδιον πιστεῦσαι· χαλεπὸν γάρ, καὶ μείζονος ἀρετῆς ἢ κατ' ἀνθρωπίνην φύσιν. Ἔχει δ' ἀπορίαν καὶ περὶ τῆς δυνάμεως, πότερον ἔχειν δεῖ τὸν μέλλοντα βασιλεύειν ἰσχύν τινα περὶ αὑτόν, ᾗ δυνήσεται βιάζεσθαι τοὺς μὴ βουλομένους πειθαρχεῖν, ἢ πῶς ἐνδέχεται τὴν ἀρχὴν διοικεῖν; Εἰ γὰρ καὶ κατὰ νόμον εἴη κύριος, μηδὲν πράττων κατὰ τὴν αὑτοῦ βούλησιν παρὰ τὸν νόμον, ὅμως ἀναγκαῖον ὑπάρχειν αὐτῷ δύναμιν ᾗ φυλάξει τοὺς νόμους. Τάχα μὲν οὖν τὰ περὶ τὸν βασιλέα τὸν τοιοῦτον οὐ χαλεπὸν διορίσαι· δεῖ γὰρ αὐτὸν μὲν ἔχειν ἰσχύν, εἶναι δὲ τοσαύτην τὴν ἰσχὺν ὥστε ἑκάστου μὲν καὶ ἑνὸς καὶ συμπλειόνων κρείττω τοῦ δὲ πλήθους ἥττω, καθάπερ οἵ τ' ἀρχαῖοι τὰς φυλακὰς ἐδίδοσαν, ὅτε καθισταῖέν τινα τῆς πόλεως ὃν ἐκάλουν αἰσυμνήτην ἢ τύραννον, καὶ Διονυσίῳ τις, ὅτ' ᾖτει τοὺς φύλακας, συνεβούλευε τοῖς Συρακουσίοις διδόναι τοσούτους τοὺς φύλακας. |
§ 1. Nous n'avons réellement à
considérer que deux formes de la royauté : la cinquième, dont nous
venons de parler, et la royauté de Lacédémone. Les autres se
trouvent comprises entre ces deux extrêmes, et sont, ou plus
restreintes dans leurs pouvoirs que la monarchie absolue, ou plus
étendues que la royauté de Sparte. § 4. Le premier point, dans cette recherche, est de savoir s'il est préférable de remettre le pouvoir à un individu de mérite, ou de le laisser à de bonnes lois ? Les partisans de la royauté, qui la trouvent si bienfaisante, prétendront, sans nul doute, que la loi, ne disposant jamais que d'une manière générale, ne peut prévoir tous les cas accidentels, et que c'est déraisonner que de vouloir soumettre une science, quelle qu'elle soit, à l'empire d'une lettre morte, comme cette loi d'Égypte, qui ne permet aux médecins d'agir qu'après le quatrième jour de la maladie, et qui les rend responsables, s'ils agissent avant ce délai. Donc, évidemment, la lettre et la loi ne peuvent jamais, par les mêmes motifs, constituer un bon gouvernement. Mais d'abord, cette forme de dispositions générales est une nécessité pour tous ceux qui gouvernent ; et l'emploi en est certainement plus sage dans une nature exempte de toutes les passions que dans celle qui leur est essentiellement soumise. La loi est impassible ; toute âme humaine au contraire est nécessairement passionnée. § 5. Mais, dit-on, le monarque sera plus apte que la loi à prononcer dans les cas particuliers. On admet alors évidemment qu'en même temps qu'il est législateur, il existe aussi des lois qui cessent d'être souveraines là où elles se taisent, mais qui le sont partout, où elles parlent. Dans tous le cas où la loi ne peut pas du tout prononcer, ou ne peut pas prononcer équitablement, doit-on s'en remettre à l'autorité d'un individu supérieur à tous les autres, ou à celle de la majorité ? En fait, la majorité aujourd'hui juge, délibère, élit dans les assemblées publiques ; et tous ses décrets se rapportent à des cas particuliers. Chacun de ses membres, pris à part, est inférieur peut-être, si on le compare à l'individu dont je viens de parler ; mais l'État se compose précisément de cette majorité, et le repas où chacun fournit son écot est toujours plus complet que ne le serait le repas isolé d'un des convives. C'est là ce qui rend la foule, dans la plupart des cas, meilleur juge qu'un individu quel qu'il soit. § 6. De plus, une grande quantité est toujours moins corruptible, comme l'est par exemple une masse d'eau ; et la majorité est de même bien moins facile à corrompre que la minorité. Quand l'individu est subjugué par la colère ou toute autre passion, il laisse de toute nécessité fausser son jugement ; mais il serait prodigieusement difficile que, dans le même cas, la majorité tout entière se mît en fureur ou se trompât. Qu'on prenne d'ailleurs une multitude d'hommes libres, ne s'écartant de la loi que là où nécessairement la loi doit être en défaut, bien que la chose ne soit pas aisée dans une masse nombreuse, je puis supposer toutefois que la majorité s'y compose d'hommes honnêtes comme individus et comme citoyens ; je demande alors si un seul sera plus incorruptible, ou si ce n'est pas cette majorité nombreuse, mais probe ? [1286b] Ou plutôt l'avantage n'est-il pas évidemment à la majorité ? Mais, dit-on, la majorité peut s'insurger; un seul ne le peut pas. On oublie alors que nous avons supposé à tous les membres de la majorité autant de vertu qu'à cet individu unique. § 7. Si donc on appelle aristocratie le gouvernement de plusieurs citoyens honnêtes, et royauté le gouvernement d'un seul, l'aristocratie sera certainement pour les États très préférable à la royauté, que d'ailleurs son pouvoir soit absolu ou ne le soit pas, pourvu qu'elle se compose d'individus aussi vertueux les uns que les autres. Si nos ancêtres se sont soumis à des rois, c'est peut-être qu'il était fort rare alors de trouver des hommes supérieurs, surtout dans des États aussi petits que ceux de ce temps-là ; ou bien ils n'ont fait des rois que par pure reconnaissance, gratitude qui témoigne en faveur de nos pères. Mais quand l'État renferma plusieurs citoyens d'un mérite également distingué, on ne put souffrir plus longtemps la royauté ; on chercha une forme de gouvernement où l'autorité pût être commune,- et l'on établit la république. § 8. La corruption amena des dilapidations publiques, et créa fort probablement, par suite de l'estime toute particulière accordée à l'argent, des oligarchies. Celles-ci se changèrent d'abord en tyrannies, comme les tyrannies se changèrent bientôt en démagogies. La honteuse cupidité des gouvernants, tendant sans cesse à restreindre leur nombre, fortifia d'autant les masses, qui purent bientôt renverser les oppresseurs et saisir le pouvoir pour elles-mêmes. Plus tard, l'accroissement des États ne permit guère d'adopter une autre forme de gouvernement que la démocratie. § 9. Mais nous demandons à ceux qui vantent l'excellence de la royauté, quel sort ils veulent faire aux enfants des rois ? Est-ce que, par hasard, eux aussi devront régner ? Certes, s'ils sont tels qu'on en a tant vu, cette hérédité sera bien funeste. Mais, dira-t-on, le roi sera maître de ne point transmettre le pouvoir à sa race. La confiance est ici bien difficile ; la position est fort glissante, et ce désintéressement exigerait un héroïsme qui est au-dessus du coeur humain. § 10. Nous demanderons encore si, pour l'exercice de son pouvoir, le roi, qui prétend dominer, doit avoir à sa disposition une force armée capable de contraindre les factieux à la soumission ? Ou bien comment pourra-t-il assurer son autorité ? En supposant même qu'il règne suivant les lois, et qu'il ne leur substitue jamais son arbitraire personnel, encore faudra-t-il qu'il dispose d'une certaine force pour protéger les lois elles-mêmes. Il est vrai que, pour un roi si parfaitement légal, la question peut se résoudre assez vite : il doit avoir certainement une force armée, et cette force armée doit être calculée de façon à le rendre plus puissant que chaque citoyen en particulier, ou qu'un certain nombre de citoyens réunis, mais de façon aussi à le rendre toujours plus faible que la masse. C'est dans cette proportion que nos ancêtres réglaient les gardes , quand ils les accordaient en remettant l'État aux mains d'un chef qu'ils nommaient Aesymnète, ou d'un tyran. C'est encore sur cette base, lorsque Denys demanda des gardes, qu'un Syracusain, dans l'assemblée du peuple, conseilla de lui en accorder. |
§ 3. Je ne m'arrêterai donc point à la royauté de Sparte. Ainsi Aristote ne voit de royauté réelle que dans la royauté absolue ; c'est également l'opinion de Hobbes (Imperium, cap. VII, § 13). Voir plus loin, ch. XI, § 1. § 4. Le laisser à de bonnes lois. C'est à ce passage que se rapporte la partie des Questions de Buridan qu'on a souvent citée.
Cette loi d'Égypte. Hérodote
(Euterpe, ch. LXXXIV, page 97, édit. Firmin Didot), parle de ces
lois égyptiennes sur la médecine. § 5. Chacun de ses membres. Ceci est une répétition presque textuelle de ce qui déjà a été dit plus haut, ch. VI, § 4. § 9. Aux enfants des rois. Plusieurs auteurs ont essayé de prouver qu'Aristote était partisan de la monarchie, ce qui est en contradiction manifeste avec tous ses principes ; mais ces auteurs auraient dû ajouter, au moins, qu'il n'était point partisan de l'hérédité dans la monarchie. Il serait difficile, en effet, de trouver contre le principe de l'hérédité une déclaration plus formelle que celle-ci. Voir livre VIII (5), ch. VIII, § 23. L'empereur Julien, dans sa lettre à Thémistius, a cité ce passage (t. I, p. 306), et il le tire, dit-il, des «Écrits politiques d'Aristote». Sa citation comprend depuis : « nous demandons », jusqu'à : « du coeur humain », c'est-à-dire tout le § 9. Voir plus loin un autre passage cité par Julien, ch. XI, § 2. § 10. Aesymnète. Voir plus loin, ch. XI, § 9. |
|
Suite et fin de la théorie de la royauté absolue. Supériorité de la loi ; bien qu'elle dispose toujours d'une manière générale, elle vaut mieux que le pouvoir arbitraire d'un individu ; auxiliaires obligés que le monarque doit toujours se donner pour pouvoir exercer l'autorité ; condamnation générale de la royauté absolue. Exception maintenue en faveur du génie. - Fin de la théorie de la royauté. |
||
|
[1287a] § 1. Περὶ δὲ τοῦ βασιλέως τοῦ κατὰ τὴν αὑτοῦ βούλησιν πάντα πράττοντος ὅ τε λόγος ἐφέστηκε νῦν καὶ ποιητέον τὴν σκέψιν. Ὁ μὲν γὰρ κατὰ νόμον λεγόμενος βασιλεὺς οὐκ ἔστιν εἶδος, καθάπερ εἴπομεν, πολιτείας (ἐν πάσαις γὰρ ὑπάρχειν ἐνδέχεται στρατηγίαν ἀίδιον, οἷον ἐν δημοκρατίᾳ καὶ ἀριστοκρατίᾳ, καὶ πολλοὶ ποιοῦσιν ἕνα κύριον τῆς διοικήσεως· τοιαύτη γὰρ ἀρχή τις ἔστι καὶ περὶ Ἐπίδαμνον, καὶ περὶ Ὀποῦντα δὲ κατά τι μέρος ἔλαττον)· § 2. περὶ δὲ τῆς παμβασιλείας καλουμένης ςαὕτη δ' ἐστὶ καθ' ἣν ἄρχει πάντων κατὰ τὴν ἑαυτοῦ βούλησιν ὁ βασιλεύσσ δοκεῖ δέ τισιν οὐδὲ κατὰ φύσιν εἶναι τὸ κύριον ἕνα πάντων εἶναι τῶν πολιτῶν, ὅπου συνέστηκεν ἐξ ὁμοίων ἡ πόλις· τοῖς γὰρ ὁμοίοις φύσει τὸ αὐτὸ δίκαιον ἀναγκαῖον καὶ τὴν αὐτὴν ἀξίαν κατὰ φύσιν εἶναι, ὥστ' εἴπερ καὶ τὸ ἴσην ἔχειν τοὺς ἀνίσους τροφὴν ἢ ἐσθῆτα βλαβερὸν τοῖς σώμασιν, οὕτως ἔχειν καὶ τὰ περὶ τὰς τιμάς· ὁμοίως τοίνυν καὶ τὸ ἄνισον τοὺς ἴσους· § 3. διόπερ οὐδένα μᾶλλον ἄρχειν ἢ ἄρχεσθαι δίκαιον, καὶ τὸ ἀνὰ μέρος τοίνυν ὡσαύτως. Τοῦτο δ' ἤδη νόμος· ἡ γὰρ τάξις νόμος. Τὸν ἄρα νόμον ἄρχειν αἱρετώτερον μᾶλλον ἢ τῶν πολιτῶν ἕνα τινά, κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον τοῦτον, κἂν εἴ τινας ἄρχειν βέλτιον, τούτους καταστατέον νομοφύλακας καὶ ὑπηρέτας τοῖς νόμοις· ἀναγκαῖον γὰρ εἶναί τινας ἀρχάς, ἀλλ' οὐχ ἕνα τοῦτον εἶναί φασι δίκαιον, ὁμοίων γε ὄντων πάντων. § 4. Ἀλλὰ μὴν ὅσα γε μὴ δοκεῖ δύνασθαι διορίζειν ὁ νόμος, οὐδ' ἄνθρωπος ἂν δύναιτο γνωρίζειν. Ἀλλ' ἐπίτηδες παιδεύσας ὁ νόμος ἐφίστησι τὰ λοιπὰ τῇ δικαιοτάτῃ γνώμῃ κρίνειν καὶ διοικεῖν τοὺς ἄρχοντας. Ἔτι δ' ἐπανορθοῦσθαι δίδωσιν ὅ τι ἂν δόξῃ πειρωμένοις ἄμεινον εἶναι τῶν κειμένων. Ὁ μὲν οὖν τὸν νόμον κελεύων ἄρχειν δοκεῖ κελεύειν ἄρχειν τὸν θεὸν καὶ τὸν νοῦν μόνους, ὁ δ' ἄνθρωπον κελεύων προστίθησι καὶ θηρίον· ἥ τε γὰρ ἐπιθυμία τοιοῦτον, καὶ ὁ θυμὸς ἄρχοντας διαστρέφει καὶ τοὺς ἀρίστους ἄνδρας. Διόπερ ἄνευ ὀρέξεως νοῦς ὁ νόμος ἐστίν. § 5. Τὸ δὲ τῶν τεχνῶν εἶναι δοκεῖ παράδειγμα ψεῦδος, ὅτι τὸ κατὰ γράμματα ἰατρεύεσθαι φαῦλον, ἀλλὰ αἱρετώτερον χρῆσθαι τοῖς ἔχουσι τὰς τέχνας. Οἱ μὲν γὰρ οὐδὲν διὰ φιλίαν παρὰ τὸν λόγον ποιοῦσιν, ἀλλ' ἄρνυνται τὸν μισθὸν τοὺς κάμνοντας ὑγιάσαντες· οἱ δ' ἐν ταῖς πολιτικαῖς ἀρχαῖς πολλὰ πρὸς ἐπήρειαν καὶ χάριν εἰώθασι πράττειν, ἐπεὶ καὶ τοὺς ἰατροὺς ὅταν ὑποπτεύωσι πιστευθέντας τοῖς ἐχθροῖς διαφθείρειν διὰ κέρδος, τότε τὴν ἐκ τῶν γραμμάτων θεραπείαν ζητήσαιεν ἂν μᾶλλον. [1287b] § 6. Ἀλλὰ μὴν εἰσάγονταί γ' ἐφ' ἑαυτοὺς οἱ ἰατροὶ κάμνοντες ἄλλους ἰατροὺς καὶ οἱ παιδοτρίβαι γυμναζόμενοι παιδοτρίβας, ὡς οὐ δυνάμενοι κρίνειν τὸ ἀληθὲς διὰ τὸ κρίνειν περί τε οἰκείων καὶ ἐν πάθει ὄντες. Ὥστε δῆλον ὅτι τὸ δίκαιον ζητοῦντες τὸ μέσον ζητοῦσιν· ὁ γὰρ νόμος τὸ μέσον. Ἔτι κυριώτεροι καὶ περὶ κυριωτέρων τῶν κατὰ γράμματα νόμων οἱ κατὰ τὰ ἔθη εἰσίν, ὥστ' εἰ τῶν κατὰ γράμματα ἄνθρωπος ἄρχων ἀσφαλέστερος, ἀλλ' οὐ τῶν κατὰ τὸ ἔθος. § 7. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ῥᾴδιον ἐφορᾶν πολλὰ τὸν ἕνα· δεήσει ἄρα πλείονας εἶναι τοὺς ὑπ' αὐτοῦ καθισταμένους ἄρχοντας, ὥστε τί διαφέρει τοῦτο ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς ὑπάρχειν ἢ τὸν ἕνα καταστῆσαι τοῦτον τὸν τρόπον; Ἔτι, ὃ καὶ πρότερον εἰρημένον ἐστίν, εἴπερ ὁ ἀνὴρ ὁ σπουδαῖος, διότι βελτίων, ἄρχειν δίκαιος, τοῦ γε ἑνὸς οἱ δύο ἀγαθοὶ βελτίους· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ Σύν τε δύ' ἐρχομένω καὶ ἡ εὐχὴ τοῦ Ἀγαμέμνονος Τοιοῦτοι δέκα μοι συμφράδμονες. Εἰσὶ δὲ καὶ νῦν περὶ ἐνίων αἱ ἀρχαὶ κύριαι κρίνειν, ὥσπερ ὁ δικαστής, περὶ ὧν ὁ νόμος ἀδυνατεῖ διορίζειν, ἐπεὶ περὶ ὧν γε δυνατός, οὐδεὶς ἀμφισβητεῖ περὶ τούτων ὡς οὐκ ἂν ἄριστα ὁ νόμος ἄρξειε καὶ κρίνειεν. § 8. Ἀλλ' ἐπειδὴ τὰ μὲν ἐνδέχεται περιληφθῆναι τοῖς νόμοις τὰ δὲ ἀδύνατα, ταῦτ' ἐστὶν ἃ ποιεῖ διαπορεῖν καὶ ζητεῖν πότερον τὸν ἄριστον νόμον ἄρχειν αἱρετώτερον ἢ τὸν ἄνδρα τὸν ἄριστον· περὶ ὧν γὰρ βουλεύονται νομοθετῆσαι τῶν ἀδυνάτων ἐστίν. Οὐ τοίνυν τοῦτό γ' ἀντιλέγουσιν, ὡς οὐκ ἀναγκαῖον ἄνθρωπον εἶναι τὸν κρινοῦντα περὶ τῶν τοιούτων, ἀλλ' ὅτι οὐχ ἕνα μόνον ἀλλὰ πολλούς. §. 9. Κρίνει γὰρ ἕκαστος ἄρχων πεπαιδευμένος ὑπὸ τοῦ νόμου καλῶς, ἄτοπον τ' ἴσως ἂν εἶναι δόξειεν εἰ βέλτιον ἴδοι τις δυοῖν ὄμμασι καὶ δυσὶν ἀκοαῖς κρίνων καὶ πράττων δυσὶ ποσὶ καὶ χερσίν, ἢ πολλοὶ πολλοῖς· ἐπεὶ καὶ νῦν ὀφθαλμοὺς πολλοὺς οἱ μόναρχοι ποιοῦσιν αὑτῶν καὶ ὦτα καὶ χεῖρας καὶ πόδας· τοὺς γὰρ τῇ ἀρχῇ καὶ αὑτοῖς φίλους ποιοῦνται συνάρχους. Μὴ φίλοι μὲν οὖν ὄντες οὐ ποιήσουσι κατὰ τὴν τοῦ μονάρχου προαίρεσιν· εἰ δὲ φίλοι κἀκείνου καὶ τῆς ἀρχῆς, ὅ γε φίλος ἴσος καὶ ὅμοιος, ὥστ' εἰ τούτους οἴεται δεῖν ἄρχειν, τοὺς ἴσους καὶ ὁμοίους ἄρχειν οἴεται δεῖν ὁμοίως. Ἃ μὲν οὖν οἱ διαμφισβητοῦντες πρὸς τὴν βασιλείαν λέγουσι, σχεδὸν ταῦτ' ἐστίν. § 10. Ἀλλ' ἴσως ταῦτ' ἐπὶ μὲν τινῶν ἔχει τὸν τρόπον τοῦτον, ἐπὶ δὲ τινῶν οὐχ οὕτως. Ἔστι γάρ τι φύσει δεσποτικὸν καὶ ἄλλο βασιλευτικὸν καὶ ἄλλο πολιτικὸν καὶ δίκαιον καὶ συμφέρον ἄλλο ἄλλοις· τυραννικὸν δ' οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, οὐδὲ τῶν ἄλλων πολιτειῶν ὅσαι παρεκβάσεις εἰσί· ταῦτα γὰρ γίνεται παρὰ φύσιν. [1288a] Ἀλλ' ἐκ τῶν εἰρημένων γε φανερὸν ὡς ἐν μὲν τοῖς ὁμοίοις καὶ ἴσοις οὔτε συμφέρον ἐστὶν οὔτε δίκαιον ἕνα κύριον εἶναι πάντων, οὔτε μὴ νόμων ὄντων, ἀλλ' ὡς αὐτὸν ὄντα νόμον, οὔτε νόμων ὄντων, οὔτε ἀγαθὸν ἀγαθῶν οὔτε μὴ ἀγαθῶν μὴ ἀγαθόν, οὐδ' ἂν κατ' ἀρετὴν ἀμείνων ᾖ, εἰ μὴ τρόπον τινά. Τίς δ' ὁ τρόπος, λεκτέον· εἴρηται δέ πως ἤδη καὶ πρότερον. § 11. Πρῶτον δὲ διοριστέον τί τὸ βασιλευτὸν καὶ τί τὸ ἀριστοκρατικὸν καὶ τί τὸ πολιτικόν. Βασιλευτὸν μὲν οὖν τὸ τοιοῦτόν ἐστι πλῆθος ὃ πέφυκε φέρειν γένος ὑπερέχον κατ' ἀρετὴν πρὸς ἡγεμονίαν πολιτικήν, ἀριστοκρατικὸν δὲ ὃ πέφυκε φέρειν πλῆθος ἄρχεσθαι δυνάμενον τὴν τῶν ἐλευθέρων ἀρχὴν ὑπὸ τῶν κατ' ἀρετὴν ἡγεμονικῶν πρὸς πολιτικὴν ἀρχήν, πολιτικὸν δὲ ἐν ᾧ πέφυκεν ἐγγίνεσθαι πλῆθος πολεμικὸν δυνάμενον ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν κατὰ νόμον τὸν κατ' ἀξίαν διανέμοντα τοῖς εὐπόροις τὰς ἀρχάς. § 12. Ὅταν οὖν ἢ γένος ὅλον ἢ καὶ τῶν ἄλλων ἕνα τινὰ συμβῇ διαφέροντα γενέσθαι κατ' ἀρετὴν τοσοῦτον ὥσθ' ὑπερέχειν τὴν ἐκείνου τῆς τῶν ἄλλων πάντων, τότε δίκαιον τὸ γένος εἶναι τοῦτο βασιλικὸν καὶ κύριον πάντων, καὶ βασιλέα τὸν ἕνα τοῦτον. Καθάπερ γὰρ εἴρηται πρότερον, οὐ μόνον οὕτως ἔχει κατὰ τὸ δίκαιον ὃ προφέρειν εἰώθασιν οἱ τὰς πολιτείας καθιστάντες, οἵ τε τὰς ἀριστοκρατικὰς καὶ οἱ τὰς ὀλιγαρχικὰς καὶ πάλιν οἱ τὰς δημοκρατικάς (πάντες γὰρ καθ' ὑπεροχὴν ἀξιοῦσιν, ἀλλὰ ὑπεροχὴν οὐ τὴν αὐτήν), ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ πρότερον λεχθέν. Οὔτε γὰρ κτείνειν ἢ φυγαδεύειν οὐδ' ὀστρακίζειν δή που τὸν τοιοῦτον πρέπον ἐστίν, οὔτ' ἀξιοῦν ἄρχεσθαι κατὰ μέρος· οὐ γὰρ πέφυκε τὸ μέρος ὑπερέχειν τοῦ παντός, τῷ δὲ τὴν τηλικαύτην ὑπερβολὴν ἔχοντι τοῦτο συμβέβηκεν. Ὥστε λείπεται μόνον τὸ πείθεσθαι τῷ τοιούτῳ καὶ κύριον εἶναι μὴ κατὰ μέρος τοῦτον ἀλλ' ἁπλῶς. § 13. Περὶ μὲν οὖν βασιλείας, τίνας ἔχει διαφοράς, καὶ πότερον οὐ συμφέρει ταῖς πόλεσιν ἢ συμφέρει, καὶ τίσι, καὶ πῶς, διωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον. |
[1287a] § 1. Notre sujet nous conduit maintenant à la royauté où le monarque peut tout faire selon son bon plaisir, et nous allons l'étudier ici. Aucune des royautés dites légales ne forme, je le répète, une espèce particulière de gouvernement, puisqu'on peut établir partout un généralat inamovible, dans la démocratie aussi bien que dans l'aristocratie. Bien souvent l'administration militaire est confiée à un seul individu ; et il y a une magistrature de ce genre à Épidamne et à Opunte, où cependant les pouvoirs du chef suprême sont moins étendus. § 2. Quant à ce qu'on nomme la royauté absolue, c'est-à-dire celle où un seul homme règne souverainement suivant son bon plaisir, bien des gens soutiennent que la nature des choses repousse elle-même ce pouvoir d'un seul sur tous les citoyens, puisque l'État n'est qu'une association d'êtres égaux, et qu'entre des êtres naturellement égaux, les prérogatives et les droits doivent être nécessairement identiques. S'il est physiquement nuisible de donner une égale nourriture et des vêtements égaux à des hommes de constitution et de taille différentes, l'analogie n'est pas moins frappante pour les droits politiques. Et à l'inverse, l'inégalité entre égaux n'est pas moins déraisonnable. § 3. Ainsi il est juste que les parts de pouvoir et d'obéissance pour chacun soient parfaitement égales, ainsi que leur alternative ; car c'est là précisément ce que procure la loi, et la loi c'est la constitution. Il faut donc préférer la souveraineté de la loi à celle d'un des citoyens ; et, d'après ce même principe, si le pouvoir doit être remis à plusieurs parmi eux, on ne doit les faire que gardiens et serviteurs de la loi ; car si l'existence des magistratures est chose indispensable, c'est une injustice patente de donner à un seul homme une magistrature suprême, à l'exclusion de tous ceux qui valent autant que lui. § 4. Malgré ce qu'on en a dit, là où la loi est impuissante, un individu n'en saura jamais plus qu'elle ; une loi qui a su convenablement instruire les magistrats, peut s'en rapporter à leur bon sens et à leur justice pour juger et régler tous les cas où elle se tait. Bien plus, elle leur accorde le droit de corriger tous ses défauts, quand l'expérience a démontré l'amélioration possible. Ainsi donc, quand on demande la souveraineté de la loi, c'est demander que la raison règne avec les lois ; demander la souveraineté d'un roi, c'est constituer souverains l'homme et la bête ; car les entraînements de l'instinct, les passions du coeur corrompent les hommes quand ils sont au pouvoir, même les meilleurs ; mais la loi, c'est l'intelligence sans les passions aveugles. § 5. L'exemple emprunté plus haut aux sciences ne paraît pas concluant. Il est dangereux de suivre en médecine des préceptes écrits, et il vaut mieux se confier aux praticiens. Un médecin ne sera jamais entraîné par amitié à donner quelque prescription déraisonnable ; tout au plus aura-t-il en vue le prix de la guérison. En politique, au contraire, la corruption et la faveur exercent fort ordinairement leur funeste influence. Ce n'est que lorsqu'on soupçonne le médecin de s'être laissé gagner par des ennemis pour attenter à la vie de son malade, qu'on a recours aux préceptes écrits. § 6. Bien plus, le médecin malade appelle pour le soigner d'autres médecins ; le gymnaste montre sa force en présence d'autres gymnastes ; pensant tous deux qu'ils jugeraient mal s'ils jugeaient dans leur propre cause, parce qu'ils n'y sont pas désintéressés. Donc évidemment, quand on ne veut que la justice, il faut prendre un moyen terme ; et ce moyen terme, c'est la loi. D'ailleurs, il existe des lois fondées sur les moeurs, bien plus puissantes et bien plus importantes que les lois écrites ; et si l'on peut trouver dans la volonté d'un monarque plus de garantie que dans loi écrite, certainement on lui en trouvera moins qu'à ces lois dont les moeurs font toute la force. § 7. Mais un seul homme ne peut tout voir de ses propres yeux ; il faudra bien qu'il délègue son pouvoir à de nombreux inférieurs ; et dès lors, n'est-il pas tout aussi bien d'établir ce partage dès l'origine que de le laisser à la volonté d'un seul individu ? De plus, reste toujours l'objection que nous avons précédemment faite : si l'homme vertueux mérite le pouvoir à cause de sa supériorité, deux hommes vertueux le mériteront bien mieux encore. C'est le mot du poète : Deux braves compagnons, quand ils marchent ensemble... c'est la prière d'Agamemnon, demandant au ciel D'avoir dix conseillers sages comme Nestor. Mais aujourd'hui même, dira-t-on, quelques États possèdent des magistratures chargées de prononcer souverainement, comme le fait le juge, dans les cas que la loi n'a pu prévoir ; preuve qu'on ne croit pas que la loi soit le souverain et le juge le plus parfait, bien qu'on reconnaisse sa toute puissance là où elle a pu disposer. § 8. Mais c'est justement parce que la loi ne peut embrasser que certains objets et qu'elle en laisse nécessairement échapper d'autres, qu'on doute de son excellence et qu'on demande si, à mérite égal, il ne vaut pas mieux substituer à sa souveraineté celle d'un individu ; car disposer législativement sur des objets qui exigent délibération spéciale est chose tout à fait impossible. Aussi ne conteste-t-on pas que pour ces objets-là il faille s'en remettre aux hommes ; on conteste seulement qu'on doive préférer un seul individu à plusieurs ; car chacun des magistrats, même isolé, peut, guidé par la loi qui l'a instruit, juger fort équitablement. § 9. Mais il pourrait bien sembler absurde de soutenir qu'un homme, qui n'a pour former son jugement que deux yeux, deux oreilles, qui n'a pour agir que deux pieds et deux mains, puisse mieux faire qu'une réunion d'individus avec des organes bien plus nombreux. Dans l'état actuel, les monarques eux-mêmes sont forcés de multiplier leurs yeux, leurs oreilles, leurs mains, leurs pieds, en partageant le pouvoir avec les amis du pouvoir et avec leurs amis personnels. Si ces agents ne sont pas les amis du monarque, ils n'agiront pas suivant ses intérêts ; s'ils sont ses amis, ils agiront dans son intérêt et dans celui de son autorité. Or, l'amitié suppose nécessairement ressemblance, égalité ; et si le roi admet que ses amis doivent partager sa puissance, il admet en même temps que le pouvoir doit être égal entre égaux. Telles sont à peu près les objections faites contre la royauté. § 10. Les unes sont parfaitement fondées, les autres le sont peut-être moins. Le pouvoir du maître, comme la royauté ou tout autre pouvoir politique, juste et utile, est dans la nature; mais la tyrannie n'y est pas, et toutes les formes corrompues de gouvernement sont tout aussi contraires aux lois naturelles. [1288a] Ce que nous avons dit doit prouver que, parmi des individus égaux et semblables, le pouvoir absolu d'un seul n'est ni utile ni juste ; peu importe que cet homme soit d'ailleurs comme la loi vivante en l'absence de toute loi, ou même en présence des lois, ou qu'il commande à des sujets aussi vertueux ou aussi dépravés que lui, ou bien enfin qu'il soit tout à fait supérieur par son mérite. Je n'excepte qu'un seul cas, et je vais le dire, bien que je l'aie déjà indiqué. § 11. Fixons d'abord ce que signifient pour un peuple les appellations de monarchique, d'aristocratique, de républicain. Un peuple monarchique est celui qui naturellement peut supporter la domination d'une famille douée de toutes les vertus supérieures qu'exige la domination politique. Un peuple aristocratique est celui qui, tout en ayant les qualités nécessaires pour la constitution politique qui convient à des hommes libres, peut naturellement supporter l'autorité de chefs que leur mérite appelle à gouverner. Un peuple républicain est celui où naturellement tout le monde est guerrier et sait également obéir et commander, à l'abri d'une loi qui assure à la classe pauvre la part de pouvoir qui lui doit revenir. § 12. Lors donc qu'une race entière, ou même un individu de la masse, vient à briller d'une vertu tellement supérieure qu'elle surpasse la vertu de tous les autres citoyens ensemble, alors il est juste que cette race soit élevée à la royauté, à la suprême puissance, que cet individu soit pris pour roi. Ceci, je le répète, est juste, non seulement de l'aveu des fondateurs de constitutions aristocratiques, oligarchiques, et même démocratiques, qui ont unanimement reconnu les droits de la supériorité , tout en différant sur l'espèce de supériorité , mais encore par le motif que nous en avons donné plus haut. Il n'est équitable ni de tuer ni de proscrire par l'ostracisme un tel personnage, ni de le soumettre au niveau commun ; la partie ne doit pas l'emporter sur le tout, et le tout est ici précisément cette vertu si supérieure à toutes les autres. Il ne reste donc plus que d'obéir à cet homme et de lui reconnaître une puissance, non point alternative, mais perpétuelle. § 13. Nous terminerons ici l'étude de la royauté, après en avoir exposé les espèces diverses, les avantages et les dangers, suivant les peuples auxquels elle s'applique, et avoir étudié les formes qu'elle revêt. |
§ 1. Je le répète. Voir plus haut, chapitre X, § 3. -- Une espèce particulière de gouvernement. Digge, Filmer et plusieurs monarchistes anglais se sont appuyés de ce passage pour repousser toute monarchie tempérée et soutenir la monarchie absolue. L'empereur Julien a aussi rappelé ce passage.-- Épidamne. Voir plus haut, liv. II, ch. VI, § 13, et plus loin, liv. VIII, ch. I, § 6.-- Opunte, ville de la Locride. § 2. La royauté absolue. Julien cite encore ce passage et l'approuve. L'empereur ici a complètement disparu ; il ne reste que le philosophe. Julien, quand il commentait cette pensée d'Aristote, était maître absolu de l'empire romain ( Oeuvres de Julien, t. I, p. 360). Voir ci-dessus, ch. X, § 9 ; et plus loin dans ce chapitre, § 4. § 4. La souveraineté de la loi. Julien cite encore ce passage (t. I, p. 360). Voir plus haut, § 2. --- La bête. Massillon a dit : « N'est-il pas juste d'imprimer le sceau douloureux de la croix sur une chair qui a été marquée tant de fois du caractère honteux de la bête ! » (Sermon pour le mercredi des Cendres, sur le jeûne.)§ 7. Précédemment faite. Voir plus haut la discussion sur les droits de la majorité, ch. VI, § 4. -- Deux braves compagnons. Iliade, chant X, v. 224.-- D'avoir dix conseillers. Iliade, chant II, v. 372.Dira-t-on. J'ai ajouté ces mots pour éclaircir la pensée. -- Là où elle a pu disposer. Platon, qui a exposé les mêmes théories, conclut tout autrement qu'Aristote. La loi lui semble inférieure à un législateur éclairé. Voir le Politique, page 435, traduction de M. Cousin, et plus haut, ch. VI, § 13.§ 9. Il pourrait bien sembler absurde. Le scholiaste d'Aristophane (ad Acharn., 97) cite ce passage comme tiré du livre III de la Politique ; mais ce scholiaste me paraît, à son style, fort récent. Les éditeurs d'Aristophane n'ont pas, du reste, eu le soin de distinguer les auteurs des scholies, dont quelques-uns sont très anciens, et dont les autres, beaucoup plus modernes, sont même du XVIe siècle. § 10. Je l'ai déjà indiqué. Voir plus haut, ch. XIII, § 1 et suiv. § 12. Je le répète. Voir ci-dessus, ch. VIII, §§ 1 et 7. Pour toute cette discussion sur la royauté et sur la monarchie, il faut lire Montesquieu, liv. XI, ch. VIII, IX, X, XI. Il prétend que les anciens n'avaient pas une idée bien claire de la monarchie. La discussion d'Aristote semble prouver le contraire ; à moins que Montesquieu n'entende parler de la monarchie constitutionnelle, qu'il vient d'exposer dans les chapitres précédents. Il ajoute qu'Aristote paraît visiblement embarrassé quand il traite de la monarchie. A mon avis, l'élimination si nette et si vraie des quatre premières espèces de monarchies, ne paraît pas dénoter le moindre embarras dans le philosophe grec. Ce que dit ensuite Montesquieu, en analysant les idées d'Aristote, ferait croire qu'il ne l'a point lu peut-être avec assez d'attention. Il lui reproche d'avoir distingué ses cinq espèces de monarchies par des choses d'accident et non par la forme de la constitution. Il suffit de lire le texte grec pour voir que ce reproche n'est pas juste, et qu'Aristote, ayant soin de déterminer les attributions du pouvoir dans les divers systèmes de monarchies, ayant soin de spécifier si elles sont ou non fondées sur la loi, a précisément appuyé sa classification sur des différences constitutives, quine sont points accidentelles. Enfin, Montesquieu blâme Aristote d'avoir mis au rang des monarchies l'empire des Perses et le royaume de Lacédémone, attendu que l'un était un état despotique, et l'autre une république. Montesquieu me semble encore ici se tromper. Dans le langage ordinaire, Sparte peut être une république ; mais dans le langage de la science, il n'y a point de république là où le pouvoir suprême de l'État est héréditaire. Quant à la monarchie des Perses, Aristote n'en parle point ici ; et Montesquieu a tort de vouloir que, comme lui, Aristote distingue spécifiquement deux choses qui ne diffèrent que du plus au moins. Voir plus haut, ch. v, § 6. Il faut lire aussi l'admirable et laconique traité de La Boétie, le Contre un ou la Servitude volontaire, imprimé le plus ordinairement à la suite des oeuvres de Montaigne. -- Donné plus haut. Voir ci-dessus, ch. VIII, § 1 et 7 |
|
Du gouvernement parfait, ou de l'aristocratie.... (lacune). |
||
|
§ 1. Ἐπεὶ δὲ τρεῖς φαμεν εἶναι τὰς ὀρθὰς πολιτείας, τούτων δ' ἀναγκαῖον ἀρίστην εἶναι τὴν ὑπὸ τῶν ἀρίστων οἰκονομουμένην, τοιαύτη δ' ἐστὶν ἐν ᾗ συμβέβηκεν ἢ ἕνα τινὰ συμπάντων ἢ γένος ὅλον ἢ πλῆθος ὑπερέχον εἶναι κατ' ἀρετήν, τῶν μὲν ἄρχεσθαι δυναμένων τῶν δ' ἄρχειν πρὸς τὴν αἱρετωτάτην ζωήν, ἐν δὲ τοῖς πρώτοις ἐδείχθη λόγοις ὅτι τὴν αὐτὴν ἀναγκαῖον ἀνδρὸς ἀρετὴν εἶναι καὶ πολίτου τῆς πόλεως τῆς ἀρίστης, φανερὸν ὅτι τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ἀνήρ τε γίνεται σπουδαῖος καὶ πόλιν συστήσειεν ἄν τις ἀριστοκρατουμένην ἢ βασιλευομένην, [1288b] ὥστ' ἔσται καὶ παιδεία καὶ ἔθη ταὐτὰ σχεδὸν τὰ ποιοῦντα σπουδαῖον ἄνδρα καὶ τὰ ποιοῦντα πολιτικὸν καὶ βασιλικόν. § 2. Διωρισμένων δὲ τούτων περὶ τῆς πολιτείας ἤδη πειρατέον λέγειν τῆς ἀρίστης, τίνα πέφυκε γίγνεσθαι τρόπον καὶ καθίστασθαι πῶς. ¨[Ἀνάγκη δὴ τὸν μέλλοντα περὶ αὐτῆς ποιήσασθαι τὴν προσήκουσαν σκέψιν]. |
§ 1. Des trois constitutions que nous avons reconnues bonnes, la meilleure doit être nécessairement celle qui a les meilleurs chefs. Tel est l'État où se rencontre par bonheur une grande supériorité de vertu, que d'ailleurs elle appartienne soit à un seul individu à l'exclusion de tous, soit à une race entière, soit même à la multitude ; et où les uns savent obéir aussi bien que les autres savent commander, dans l'intérêt du but le plus noble. Il a été démontré précédemment que dans le gouvernement parfait la vertu privée est identique à la vertu politique ; il n'est pas moins évident qu'avec les mêmes moyens et les mêmes vertus qui constituent l'homme de bien, on peut constituer aussi un État entier, aristocratique ou monarchique ; [1288b] d'où il suit que l'éducation et les moeurs qui font l'homme vertueux sont à peu près les mêmes que celles qui font le citoyen d'une république ou le chef d'une royauté. § 2. Ceci posé, nous essayerons de traiter de la république parfaite, de sa nature, et des moyens de l'établir. Quand on veut étudier cette question avec tout le soin qu'elle exige, il faut. |
§ 1. Précédemment. Voir plus haut, ch. Il, § 3 et suiv. § 2. Il faut... Il est évident que cette phrase n'est point terminée ; on la retrouve entière et complète au commencement du IVe (7e) livre, avec quelques changements qui sont exigés par la transposition même admise jusqu'à ce jour, et rectifiée dans cette traduction. La plupart des éditeurs et des traducteurs ont cru lever toute difficulté en retranchant ces mots : « quand on veut ». Vettorio, qui les avait supprimés dans sa première édition, a eu grand soin de les rétablir dans la seconde. Il est certain que le texte traduit ici est la véritable leçon, et que les mots : « quand on veut » doivent être acceptés, bien qu'ils suspendent la phrase, qui sans eux serait parfaitement close dans l'original. M. Goettling les garde et pense qu'il ne manque rien à la phrase ; seulement il propose quelques changements de ponctuation. Il appuie cette leçon sur le manuscrit 2023. Mais outre que les manuscrits sont une très faible autorité en fait de ponctuation, la construction serait grammaticalement peu régulière. Voir, du reste, l'appendice et le commencement des livres IVe, VIe, VIIe et VIIIe. |