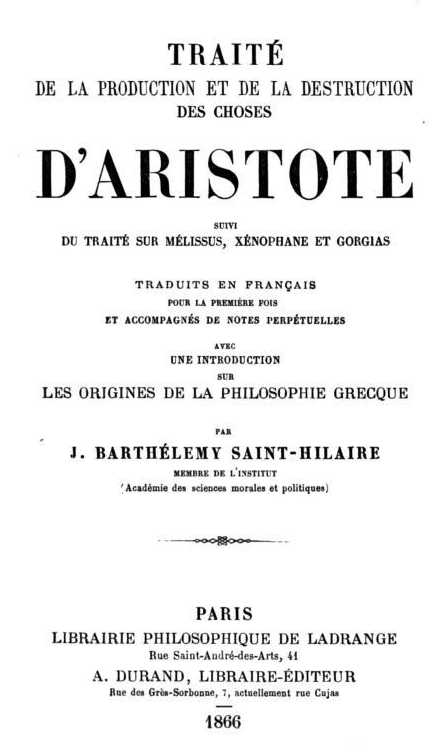|
table
des matières de l'œuvre d'Aristote
table des matières de la génération et de
la corruption
ARISTOTE
DE LA PRODUCTION ET DE LA DESTRUCTION DES CHOSES
(DE GENERATIONE ET CORRUPTIONE)
ORIGINES DE LA PHILOSOPHIE GRECQUE.
(pages I - CLXXII)
ORIGINES DE LA PHILOSOPHIE GRECQUE. |
|
J'ai réuni avec intention les deux traités qui remplissent ce volume. Ils me semblent répondre l'un et l'autre à un même ordre d'idées. Dans le premier, Aristote s'efforce de démontrer, contre le système de l'unité et de l'immobilité de l'être, comment les choses se produisent et comment elles finissent; dans le second (01), c'est la même discussion directement soutenue contre des représentants de l'école d'Élée, Xénophane, qui en est le fondateur, et Mélissus, qui a conservé encore les principes de cette doctrine, au moment où Socrate substitue aux incertitudes antérieures une philosophie nouvelle et définitive. La pensée est identique dans les deux traités ; la forme seule est différente ; ici, l'exposition générale d'un principe; là, une réfutation spéciale du principe contraire. Je reviendrai brièvement, à la fin de cette préface, sur la valeur de ces deux ouvrages, qui méritent d'être plus connus qu'ils ne le sont ; mais d'abord, je tiendrais à faire voir, aussi clairement que je le pourrai, ce qu'était le mouvement philosophique auquel Xénophane et Mélissus ont concouru, soit pour le créer, soit pour le suivre. Xénophane et Mélissus! ce sont là des noms bien anciens ; au premier coup d'œil, il est assez difficile de comprendre qu'ils puissent exciter de nos jours un sérieux intérêt. Ces deux philosophes vivaient cinq ou six siècles avant notre ère ; et à cette distance, il semble que l'érudition seule puisse encore se sentir pour eux quelque sympathie surannée, et s'informer de leurs systèmes oubliés depuis si longtemps. Je ne veux pas certainement faire le procès de l'érudition ; mais je conçois les préventions qu'elle soulève, quand elle s'enfonce dans l'étude de ces temps reculés, où les documents font défaut, et dont il ne nous est resté que d'informes débris. Ici cependant plus que partout ailleurs, je demande qu'on veuille bien l'écouter un instant; car le sujet dont elle traite, à propos de Xénophane, est un des plus importants et un des plus vivants de toute l'histoire de l'esprit humain. Ce n'est pas moins que la naissance de la philosophie, dans le monde auquel nous appartenons. Pour la philosophie orientale, nous ne savons et peut-être ne saurons-nous jamais rien de précis en ce qui concerne ses époques principales et ses révolutions. Les temps, les lieux, les personnages nous échappent presqu'également, insaisissables et douteux dans l'obscurité impénétrable qui les recouvre. Nous connaîtrions même ces détails avec toute l'exactitude nécessaire, qu'ils pourraient satisfaire notre curiosité sans nous toucher beaucoup. La philosophie orientale n'a pas influé sur la nôtre; en admettant même qu'elle l'ait précédée dans l'Inde, dans la Chine, dans la Perse, dans l'Égypte, nous ne lui avons emprunté quoi que ce soit ; nous n'avons point à remonter à elle pour connaître qui nous sommes et d'où nous venons. Au contraire, avec la philosophie grecque, nous nous rattachons au passé d'où nous sommes sortis. Malgré les aveuglements d'un orgueil trop souvent coupable d'ingratitude, nous devons ne jamais oublier que nous sommes les fils de la Grèce ; elle est notre mère à peu près dans toutes les choses de l'intelligence. Interroger ses débuts, c'est encore interroger nos propres origines. De Thalès, de Pythagore, de Xénophane, d'Anaxagore, de Socrate, de Platon, d'Aristote jusqu'à nous, il n'y a qu'une différence de degré ; nous sommes tous dans la même voie, ininterrompue depuis tant de siècles, poursuivie sans relâche, et qui ne change pas de direction, tout en devenant de plus en plus longue et plus belle. Apparemment, nous n'avons point à rougir de tels ancêtres; et tout ce que nous avons à faire, c'est d'en rester dignes en les continuant. On a pu dire, non sans justice, que la philosophie était née avec Socrate (02), et cet admirable personnage tient en effet une telle place qu'on a pu lui faire cet honneur insigne d'associer son nom à ce grand événement. Mais Socrate, modeste comme il l'était, n'eût pas accepté cette gloire ; il savait mieux que personne qu'avant lui il y avait déjà près de deux siècles que la philosophie s'essayait, quand il lui donna la force et le charme qui depuis lors ne l'ont plus quittée. Ce n'est pas à Athènes que la philosophie est née ; c'est dans l'Asie-Mineure ; car à moins de rayer de l'histoire les premiers des grands noms que je viens de rappeler, il faut reculer cet événement de deux cents ans environ ; le progrès inauguré par Socrate était une continuation ; ce n'était pas une initiative. Toutes les origines sont nécessairement obscures; on s'ignore toujours soi-même au début, et la tradition pour ces premiers temps est incertaine, comme les faits eux-mêmes, qui ont passé presque inaperçus. Cependant si l'on n'exige point ici des précisions impossibles, les commencements de la philosophie grecque doivent nous paraître assez clairs pour qu'il n'y ait aucun motif plausible d'en douter. Thalès était de Milet; et l'histoire a constaté sa présence à l'armée d'un des rois de Lydie, vers la fin du Vie siècle avant notre ère. Un peu plus tard que lui, Pythagore, rentré, après de longs voyages, à Samos, sa patrie, la fuit pour éviter la tyrannie de Polycrate, qui l'opprime, et il va porter ses doctrines sur les côtes orientales de la grande Grèce à Sybaris et à Crotone. Xénophane, pour des raisons assez analogues, s'éloigne de Colophon ; et se réunissant à des fugitifs de Phocée, qui, à travers bien des périls, avaient enfin trouvé un asile sur les bords de la mer Tyrrhénienne à Élée (Hyéla ou Vélia), il fonde dans cette ville, alors toute récente, une école qui en a illustré le souvenir. Pour le moment, je m'en tiens à ces trois personnages, les uns et les autres chefs d'écoles qui sont immortelles, quoique nous en sachions bien peu de chose: l'école d'Ionie, l'école Pythagoricienne et l'école d'Élée. Tout à l'heure, je pourrai associer à ces trois noms une foule d'autres noms que l'histoire de la philosophie ne peut pas omettre plus que ceux-là. Mais rien qu'à considérer Thalès, Pythagore et Xénophane, un fait me frappe. Ils sont tous les trois de cette partie du monde Hellénique qui s'appelle l'Asie-Mineure, et ils sont presque contemporains. Milet sur le continent, Samos dans l'île de ce nom, et Colophon, un peu au nord d'Éphèse, sont à peine à vingt-cinq lieues de distance; sur cet étroit espace, presqu'au même moment, la philosophie trouve son glorieux berceau. Pour ne pas sortir de ces limites soit de lieux, soit de temps, soit même de sujet, joignez à ces trois noms de Thalès, de Pythagore et de Xénophane, ceux d'Anaximandre et d'Anaximène, qui sont aussi de Milet ; d'Héraclite, qui est d'Éphèse; d'Anaxagore, qui est de Clazomènes, un peu à l'ouest de Smyrne dans le golfe de l'Hermus ; de Leucippe et de Démocrite, qui étaient peut–être également de Milet, ou d'Abdère, colonie de Téos ; de Mélissus, qui est de Samos, comme Pythagore. Joignez en outre les noms de quelques sages, moins éclairés que les philosophes, mais non moins vénérés : Pittacus de Mytilène dans l'île de Lesbos, compagnon d'armes du poète Alcée pour renverser la tyrannie, et déposant, après dix ans de bienfaits, la dictature que ses concitoyens lui avaient remise ; Bias de Priène, donnant à la Confédération Ionienne des conseils qui, selon Hérodote, eussent pu la sauver ; Ésope, qui résida longtemps à Samos, et à Sardes près de Crésus, et dont Socrate ne dédaignait pas de mettre les fables en vers (03), ce pauvre esclave de Phrygie que la philosophie ne doit pas oublier de compter parmi les siens; enfin, même cette Aspasie de Milet, à qui Platon a laissé la parole dans le Ménexène, qui causait avec Socrate, qui donnait des leçons d'éloquence à Périclès, dont elle composait parfois les discours politiques, et à qui Raphaël a réservé une place dans son École d'Athènes. On le voit donc : l'ingénieur Tiedemann a eu bien raison d'appeler l'Asie-Mineure « la mère de la philosophie, et la patrie de la sagesse (04) ». Les quelques faits que je viens de citer, et auxquels on pourrait en joindre bien d'autres, le prouvent assez; désormais, quand on parlera de la naissance de la philosophie dans notre monde Occidental, par opposition au monde Asiatique, nous saurons à qui appartient cette gloire, et à qui l'on doit équitablement la rapporter. Mais pour peu qu'on y réfléchisse, on voit qu'il est impossible que la philosophie se développe toute seule. Évidemment tous les éléments de l'intelligence doivent être épanouis avant la réflexion ; la réflexion, régulière et systématique, ne se montre que très tard et après les autres facultés. Je n'ai pas besoin de m'étendre sur cette vérité, qu'on peut observer dans les peuples aussi bien que dans les individus. Je constate seulement que les choses ne se sont point passées dans l'Asie-Mineure autrement qu'ailleurs; sur cette terre fertile, la philosophie n'a point été une plante solitaire ni un fruit imprévu. Quelques mots suffiront pour rappeler ce qu'était la contrée prédestinée à ce noble enfantement. Je ne fais qu'indiquer des noms, les plus beaux et les plus incontestables. A la tête de cette phalange, apparaît Homère, qui est né et a vécu certainement sur les côtes et dans les îles de l'Asie-Mineure, mille ans environ avant notre ère. Que dirais-je encore de ses poèmes? Comment égaler la louange à son génie? Tout ce que j'affirme, c'est qu'Homère n'est pas seulement le plus grand des poètes ; il en est aussi le plus philosophe. Un pays qui produit si tôt de tels chefs-d'œuvre est fait pour créer plus tard toutes les merveilles de la science et de l'histoire. Après Homère, je cite Callinus d'Éphèse, contemporain de l'invasion des Cimmériens, qu'il a chantée, et martial comme Tyrtée; Alcman de Sardes, digne d'instruire et de charmer l'austère Lacédémone de Lycurgue; Archiloque de Paros; Alcée de Lesbos, à la lyre d'or, selon Horace ; Sapho de Mytilène ou d'Érèse, qu'on ne peut guère plus louer qu'Homère (05) ; Mimnerme de Smyrne, chantre des victoires de l'Ionie sur les Lydiens; Phocylide de Milet, portant la morale dans la poésie Anacréon de Téos; tout près des poètes, Terpandre de Lesbos, créent la musique, dont il fixe les trois modes principaux, le Lydien, le Phrygien et le Dorien; et peut-être aussi le fabuleux Arion, de Lesbos comme Terpandre. Voilà pour la poésie. A côté d'elle, que de trésors moins brillants que les siens, quoique non moins précieux! L'astronomie et la géographie, créées par Anaximandre, et par Scylas, de Caryatide sur le golfe de lassus; les mathématiques, créées par Pythagore et ses disciples, prédécesseurs d'Aristarque de Samos, maître d'Archimède et d'Hipparque de Rhodes; l'histoire, créée par Xanthos de Sardes, décelée de Milet, Hellanicus de Mytilène, surtout par Hérodote d'Halicarnasse, appelé dès longtemps le père de l'histoire, et à qui je donnerais un autre nom, si j'en connaissais un plus juste et un plus beau; la médecine, partie de Samos pour Cyrène, Crotone, Rhodes et Cnide, avant de se fixer à Cos par Hippocrate, aussi grand peut-être dans son genre et aussi fécond qu'Homère peut l'être dans le sien; l'architecture des villes, créée par Hippodamos de Milet, qui fut aussi écrivain politique dont Aristote analyse les ouvrages (Politique, Livre Il, ch. 5); la sculpture et le moulage, par Théodore de Samos, fils de Rhoecus; la métallurgie par les Lydiens, etc., etc. Je m'arrête pour ne pas pousser plus loin ces nomenclatures un peu trop arides. Mais il faut rappeler encore que cette fécondité prodigieuse ne cesse pas avec les temps dont nous nous occupons. Théophraste est d'Érèse; Épicure est élevé à Samos et à Colophon ; Zénon, l'honneur du Portique, naît à Cittium en Chypre; Éphore est de Cymé: Théopompe est de Chios ; Parrhasius et Appelle sont d'Éphèse et de Colophon; Strabon est d'Amasée sur le Pont, colonie d'une des villes grecques de la côte occidentale de l'Asie-Mineure, etc., etc. J'avoue que, devant de pareilles splendeurs, que n'effacent en rien celles qui ont éclaté plus tard, je reste comme ébloui et je me demande si l'on a su rendre en général un juste hommage à tant de génie, à tant de perfection et à tant d'originalité. Je ne le crois pas; et ce serait là, selon moi, un motif de retracer, en partie du moins, l'histoire de ces colonies grecques de l'Asie-Mineure, auxquelles nous devons tant. Mais si j'aborde ce travail, et si j'essaie ici une rapide esquisse, ce n'est pas tout à fait pour réparer une injustice séculaire ; mon objet est moins vaste; c'est uniquement en vue de mieux comprendre ce mouvement extraordinaire et unique dans les fastes de l'esprit humain, et le mérite de ces promoteurs de la philosophie, et de ces pères de la science. J'exposerai donc, sans d'ailleurs dépasser les bornes légitimes, ce qu'étaient ces colonies venues de la Grèce sur les côtes occidentales de l'Asie onze ou douze siècles avant l'ère chrétienne, et quels furent les principaux événements politiques qui agitèrent ces contrée durant deux siècles, de Xénophane à Mélissus, de Thalès à la guerre du Péloponnèse. Nous verrons nos philosophes prendre une large part à ces événements, et parfois même les diriger, bien que le plus souvent ils aient beaucoup à en souffrir. Pour tout ce qui va suivre, je m'appuierai à peu près exclusivement sur Hérodote, sur Thucydide, sur Xénophon, et sur la chronologie des marbres de Paros ou d'Arundel (06). Les colonies grecques des côtes de l'Asie-Mineure se partageaient en trois races distinctes, formant des confédérations séparées : les Éoliens au nord, les Ioniens au milieu, et les Doriens au sud, occupant les uns et les autres des espaces à peu près égaux. Les Éoliens, sortis les premiers de la métropole commune, étaient venus s'établir dans l'Asie un siècle environ après la prise de Troie, chassés du Péloponnèse par l'invasion des Héraclides. Les Ioniens étaient arrivés les seconds, à peu près quarante ans plus tard ; et les Doriens avaient été les derniers à suivre cet exemple, ou à sentir cette nécessité. Les Éoliens, qui ont été les moins célèbres, et, à ce qu'il paraît, les moins distingués de ces trois peuples, occupaient douze villes (07): Cymé de Phricon, Larisses de Phricon, Néotichos, Temnus, Cilla, Notium, Æguiroëssa, Pitane, Égée, Myrine, Grynée et Smyrne. Cette dernière ville leur fut bientôt enlevée et jointe à la confédération Ionienne par des exilés de Colophon, qui s'y étaient réfugiés, et qui s'en emparèrent par surprise. Les Éoliens perdirent aussi quelques autres villes qu'ils avaient fondées dans les montagnes de l'Ida. Hors du continent, ils possédaient cinq villes dans l'île de Lesbos, une ville dans l'île de Ténédos, et une enfin dans ce groupe d'îlots qu'on appelait les Cent îles, du temps d'Hérodote. Les cités Éoliennes n'ont joué pour la plupart qu'un rôle obscur. Le sol de l'Éolide était meilleur que celui de l'Ionie ; mais le climat y était un peu plus rude, et surtout moins régulier. Les Ioniens avaient douze villes, presque toutes fameuses. C'étaient, Milet, Myous et Priène en Carie; Éphèse, Colophon, Lébèdos, Téos, Clazomène et Phocée en Lydie; Érythrées, sur le promontoire que forme le mont Mimas; et deux îles, Samos au midi et Chios au nord. Une chose assez singulière, c'est que les Ioniens avaient quatre dialectes très différents. Samos avait le sien, qui ne ressemblait à aucun des trois autres; Milet, Myous et Priène avaient toutes trois le même ; les six villes suivantes avaient le leur; enfin les Chiotes et les Érythréens parlaient la même langue. Les Doriens, venus après tous les autres, s'étaient établis plus bas vers la partie méridionale; et ils ne possédaient que six villes, bientôt réduites à cinq : Lindus, Talysus, Camirus, dans l'île de Rhodes; Cos, Cnide, et Halicarnasse. Cette dernière avait été exclue de la confédération, en punition d'un sacrilège qu'un de ses citoyens était accusé d'avoir commis.
Chacune de ces petites confédérations avaient un temple commun où elles se
réunissaient. Pour les Doriens, c'était le temple de Triope. Pour les Ioniens,
c'était le temple de Neptune Héliconien, sur le promontoire de Mycale, presqu'en
face de Samos. C'est à ce temple que s'assemblait le conseil de la confédération
Ionienne, le Panionium, dont la présidence était toujours réservée à un jeune
homme de Priène. On ne connaît pas précisément le temple de l'Éolide. Ces
temples servaient d'ordinaire à des fêtes purement religieuses; et dans les
circonstances graves, on y délibérait sur les dangers de l'alliance et sur ses
plus chers intérêts.
Naturellement je m'occuperai des Ioniens plus que des autres ; ils ont été de
beaucoup les plus actifs et les plus intelligents, dans le domaine de la
navigation, du commerce, de la politique, des arts, des sciences et des lettres.
Des nations très populeuses ont fait mille fois moins qu'eux. Les émigrants qui suivirent les fils de Codrus paraissent avoir été fort mêlés; ce n'étaient pas de purs Ioniens, comme on aurait pu le penser. Ceux qui étaient venus originairement de l'Achaïe dans l'Attique avaient rencontré, dans ce dernier pays, des races très diverses et très confuses, qui n'avaient rien de commun ni avec eux ni entre elles. C'étaient des Abantes de l'Eubée, des Miniens d'Orchomène, des Cadméens, des Dryopes, des Phocidiens, des Molosses, des Arcadiens, des Pélasges, des Doriens d'Épidaure, et une foule d'autres. Toutes ces peuplades étaient sur le pied de l'égalité; mais cependant les Ioniens qui descendaient des prytanes d'Athènes passaient pour les plus nobles, sans avoir d'ailleurs aucune prééminence réelle. Le surnom d'Ioniens était même à cette époque, et plus tard aussi, très peu relevé; les Athéniens en rougissaient, et les Milésiens, quand ils furent à l'apogée de leur puissance, aimaient à se séparer du reste de la confédération, qui jouissait toujours d'une assez faible estime. De leur côté, les Ioniens se faisaient vanité de leur origine ; et ils célébraient avec persévérance les Apatouries Athéniennes, fêtes intimes de la famille et de la phratrie, excepté ceux de Colophon et d'Éphèse, qui en avaient été privés par suite d'un meurtre sacrilège qu'ils avaient commis. L'émigration d'ailleurs, quoique conduite par des fils de roi, n'était pas facile. Les fugitifs qui abordèrent à Milet n'avaient point amené de femmes avec eux. Ils s'en procurèrent par la violence; ils tuèrent les parents, les maris et les enfants de quelques Cariennes, et se firent ainsi des épouses de celles qu'ils avaient épargnées dans le massacre. Mais pour se venger, les femmes de Carie jurèrent de ne jamais manger avec leurs féroces conquérants et de ne jamais leur accorder le doux nom de mari. Pendant plusieurs générations, les filles tinrent le serment de leurs mères. C'est qu'en effet le pays où abordaient les nouveau-venus était depuis longtemps occupé. Il y avait déjà, entre autres indigènes, des Pélasges, des Teucriens, des Mysiens, des Bithyniens au nord; des Phrygiens, des Lydiens ou Méoniens, au centre; des Cariens, des Lélèges, etc., au midi. C'étaient des tribus encore plus divisées entre elles que les Grecs eux-mêmes, bien qu'elles eussent aussi des sacrifices communs, par exemple à Mylasa, dans le temple de Jupiter Carien. Au début, les royaumes comme celui de Lydie ne s'étaient pas encore organisés, bien que les Lydiens, rejetés ensuite vers le centre, étendissent d'abord leur domination jusque sur les côtes, et qu'ils eussent envoyé des colonies dans la grande Grèce, dans l'Ombrie et sur la mer Tyrrhénienne. Les Mysiens, un peu au nord et à l'ouest de la Lydie, passaient pour les plus belliqueux de ces peuples. Les Phrygiens, plus septentrionaux encore, s'enrichissaient par l'élève des troupeaux. Leurs laines, leurs fromages, leurs viandes salées se vendaient à très haut prix sur les marchés de Milet. Les Lydiens exerçaient surtout l'industrie des métaux, que leur sol à moitié volcanique renfermait en énorme quantité, or, argent, fer, cuivre etc. Les Phrygiens et les Lydiens étaient d'un caractère timide ; et c'était de leur contrée que venaient la plupart des esclaves. Quoiqu'arrivés par mer, les Ioniens ne paraissent pas avoir été fort habiles dans l'art de la navigation ; au rapport de Thucydide, ce ne fut guère que sous le règne de Cyrus et de Cambyse, son fils, que la marine Ionienne devint réellement puissante. Encore fallut-il que les Corinthiens, qui étaient alors les plus savants constructeurs, leur donnassent des leçons, dont ils profitèrent avec ardeur et avec succès. Ils durent cependant avoir le plus grand besoin, dès les premiers temps, du secours du cabotage. Ces villes, qui tiraient presque tout de l'intérieur, ne pouvaient s'enrichir que par un grand commerce d'exportation et d'importation. Elles servaient de comptoirs et de centre d'échange entre les indigènes et les pays d'où étaient venus les étrangers. Bientôt toutes ces cités prospérèrent d'une façon inouïe. Regorgeant d'habitants et de richesses, elles purent avoir des flottes puissantes ; elles peuplèrent de colonies toutes les côtes de la Méditerranée, au nord de l'Afrique, où Tyr et Sidon avaient déjà des établissements, dans la grande Grèce et la Sicile, dans la Gaule, dans l'Espagne en deçà et même au-delà des Colonnes d'Hercule, surtout dans la partie nord de la mer Égée, dans l'Hellespont, sans négliger la Propontide, et même la mer Noire, appelée alors le Pont. Milet à elle seule fonda, dit-on, soixante-quinze ou quatre-vingts colonies. Ces premiers développements des colonies Grecques de l'Asie mineure, et surtout des colonies Ioniennes, sont peu connus, quoiqu'ils remplissent trois ou quatre siècles au moins de durée ; l'histoire ne commence réellement qu'au moment où les cités Helléniques des côtes entrent en lutte contre la monarchie Lydienne, c'est-à-dire vers le VIIIe siècle de notre ère, à l'époque de l'avènement des Mermnades. Hérodote a raconté tout au long l'histoire de Gygès, arrivant au trône de Lydie par le meurtre de Candaule. Cette tradition n'a rien que de vraisemblable, bien qu'elle ne semble pas d'accord avec le récit de Platon, lequel est évidemment fabuleux. La colère de la reine, femme de Candaule, la trahison de Gygès, son amant, n'ont rien d'impossible; l'anneau n'est qu'un conte populaire, qui se retrouve plus tard, sous une autre forme, dans les Mille et une nuits. Archiloque, contemporain de Candaule et de Gygès, avait parlé de l'audace et du triomphe de ce soldat devenu roi, dans un de ses iambes trimètres que lisait encore Hérodote (08). Avec Candaule, finit la première dynastie Lydienne, qui prétendait descendre d'Hercule, et qui avait duré cinq cents cinq ans, pendant vingt-deux générations, à partir du demi-Dieu, à qui son orgueil la rattachait. Gygès inaugurait la seconde dynastie, celle des Mermnades. Gygès, vers le début du VIIe siècle avant notre ère, ouvre un nouvel ordre de choses. Peut-être pour légitimer son usurpation, et aussi pour céder à des nécessités politiques, il se mit à attaquer les cités grecques, Milet, Smyrne et Colophon. Cependant la Lydie avait alors avec les Grecs, du moins ceux du continent, des relations qui semblaient toutes pacifiques. Comme tous les Grecs, ceux de l'Asie mineure ainsi que les autres, Gygès croyait et se soumettait à l'oracle de Delphes. Entouré de pièges aussitôt après son accession au trône, et craignant le mécontentement des Lydiens, fort attachés au roi qu'il avait assassiné, il avait voulu mettre le Dieu dans sa cause; il l'avait consulté en lui envoyant de riches présents. Le Dieu avait donné raison à l'usurpateur et au meurtrier. Mais la Pythie avait annoncé que la famille des Héraclides serait vengée sur le cinquième des descendants de Gygès. Ce cinquième successeur devait être l'infortuné Crésus, plus fameux encore par ses malheurs que par ses trésors, passés en proverbe. Mais ni Gygès, au comble de la prospérité, ni les Lydiens, tout indignés qu'ils avaient été, ne tinrent compte de l'avertissement de la Pythie ; le soldat adultère et assassin avait régné trente-huit ans très paisiblement, sauf ses guerres contre les villes de la côte. Il parait que Milet, Smyrne et Colophon avaient succombé sous ses armes. Ardys, premier successeur de Gygès, régna plus longtemps encore que lui, c'est-à-dire pendant quarante-neuf ans. Il s'empara de Priène, et attaqua vainement Milet, qui put lui résister. Sadyatte, fils d'Ardys, ne resta que douze ans sur le trône. Quand il mourut, il y avait déjà six ans qu'il était en guerre contre Milet, comme son père. La ville, qu'il ne pouvait investir par mer, se défendait avec succès, bien que la campagne fût ravagée chaque année par l'ennemi, toujours prêt à recommencer ses incursions dévastatrices. Toutes les fois que les Milésiens essayaient de lutter en rase campagne, ils étaient presque certains d'une défaite; et deux fois, ils furent rudement battus à Liménée sur leur territoire, et dans les plaines du Méandre, où ils s'étaient imprudemment hasardés. Alyalte, fils de Sadyatte, continua encore cinq ans la guerre contre Milet. Il se croyait sur le point de réduire la ville par la famine, lorsque, sur la réponse de l'oracle de Delphes, qu'il consultait comme ses aïeux, il consentit à faire la paix, que facilita aussi le stratagème de Thrasybule, tyran de Milet à cette époque. Averti par son ami Périandre, tyran de Corinthe et fils de Cypsèle, Thrasybule avait su dissimuler à un envoyé Lydien la véritable situation de la ville assiégée, et faire croire, dans ses murs, à une abondance qu'elle n'avait pas. Alyatte, trompé par le rapport de son ambassadeur abusé, se résolut à traiter avec Milet, quoiqu'il eût encore bien peu à faire peur la vaincre. Cette paix, conclue grâce à l'oracle et à l'adresse de Thrasybule, dura assez longtemps. Alyatte mourut après cinquante-sept années d'un règne d'ailleurs fort troublé. Pendant ce temps, il ne cessa ses bons rapports avec la Pythie. Guéri d'une longue maladie sur laquelle il l'avait consultée, il dédia au Dieu de Delphes une magnifique coupe en argent, dont la base était de fer, artistement soudé par Glaucus de Chios, l'inventeur de ce procédé alors tout nouveau et très admiré. La guerre contre Milet n'avait pas été la seule qu'eût faite Alyatte; il s'était emparé de Smyrne, colonie de Colophon, et il avait même attaqué Clazomènes, située à quelque distance à l'ouest dans le même golfe. Mais Clazomènes l'avait repoussé victorieusement, en lui infligeant un assez rude échec. Alyatte avait été mieux inspiré et avait rendu un vrai service à l'Asie entière, en tournant ses armes contre les Cimmériens, qui avaient envahi ces riches et paisibles contrées, sous le règne d'Ardys, son grand-père. Chassés de leurs demeures par les Scythes nomades, ils avaient dû émigrer vers le midi. Débouchant sans doute par le Caucase, qu'ils avaient franchi, ils avaient tourné à l'ouest, et passant l'Halys, ils s'étaient avancés jusqu'au cœur de l'Asie mineure. Ils avaient surpris et brûlé Sardes, la capitale de la Lydie ; la forteresse seule placée sur un rocher très élevé, au pied duquel coulait le Pactole, avait pu leur résister. Ils avaient ensuite été repoussés; mais ils restaient toujours menaçants et toujours avides dans les régions environnantes. Alyatte les chassa de l'Asie et les rejeta à l'est, parmi les races sémitiques, dont l'Halys était la limite. Il paraît même qu'il put dès lors entretenir avec eux des relations assez faciles et assez bienveillantes. Mais ce furent ces rapports de la Lydie avec les Scythes nomades qui attirèrent sur l'Asie mineure, d'abord les armes des Mèdes, et ensuite celles des Perses, bien autrement redoutables. Une troupe de Scythes, chassée de ses rudes climats, était descendue sur le territoire de la Médie, au nord-ouest de l'Euphrate. Cyaxare, qui régnait alors sur les Mèdes, avait reçu les fugitifs avec bonté. Non seulement il leur avait permis de s'établir sur ses terres; mais de plus il leur avait confié des enfants Mèdes, qui devaient apprendre leur langue et s'instruire, à leur école, dans l'art de lancer les flèches. Quelques-uns de ces barbares qui approchaient de plus près le roi Mède avaient eu à se plaindre, dans une occasion insignifiante, de paroles violentes qu'il leur avait adressées. Afin de se venger d'une insulte, ils tuèrent des enfants qui leur avaient été confiés, et ils se retirèrent à la cour d'Alyatte pour éviter le châtiment qui les menaçait. Cyaxare réclama les coupables; le roi de Lydie ne voulut pas les livrer ; et de là, une guerre qui dura plus de cinq ans, entre les Lydiens et les Mèdes. Cette cause était très futile ; mais le conflit aurait éclaté pour tout autre motif; car les deux royaumes se touchaient, et la collision entre des nations encore si farouches était inévitable. Ici se place un événement qui a la plus haute importance, à la fois pour l'histoire de ces peuples, pour l'histoire de la science astronomique, et pour celle de la philosophie. On en était à la sixième année de la guerre ; une nouvelle rencontre avait eu lieu, et les deux armées étaient au plus fort d'une mêlée, quand tout à coup une éclipse de soleil les couvrit d'une nuit sombre, et les força subitement à cesser le combat, qui devenait un combat nocturne. Ce fait n'a rien d'improbable en lui-même, et il n'est pas étonnant qu'un phénomène de ce genre ait alors profondément ému les esprits. Mais Hérodote, qui nous en a gardé le souvenir, ajoute que cette éclipse de soleil avait été prédite à l'avance par Thalès de Milet, et qu'il avait indiqué aux Ioniens l'année où elle devait se produire (09). Ce récit de l'historien, que j'admets pleinement pour ma part, a donné lieu à divers problèmes du plus grand intérêt. On a cherché à calculer cette éclipse, avec les procédés à peu près infaillibles dont dispose aujourd'hui notre astronomie, et l'on a espéré trouver par là une date irréfragable au milieu de cette chronologie confuse et douteuse. Mais sur un terrain qui semblait purement scientifique, on n'a pu s'entendre ni s'orienter sûrement. Le P. Pétau a calculé que l'éclipse a dû avoir lieu la 4e année de la 45e olympiade, c'est-à-dire l'an 592 avant l'ère chrétienne. Saint Martin, qui s'est occupé le dernier de cette question, a trouvé qu'une éclipse totale visible sur l'Halys, où se rencontraient les deux armées, n'avait pu se produire que le 30 septembre 610 (Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, nouvelle série, tome XII ). Il y a donc une différence de 18 ans entre les deux évaluations. Je pourrais en citer d'autres, non moins diverses parmi les auteurs modernes. Pline, chez les anciens, fixe la date de cette éclipse très précisément ; il la rapporte à la 4e année de la 48e olympiade, et à l'année 170 de la fondation de Rome (10). Cette concordance peu régulière nous reporte à peu près à l'an 580. Je ne veux pas entrer dans ces détails, parce que je ne me flatte pas de pouvoir les éclaircir; je me borne à désirer que la science astronomique puisse, sur cette donnée de l'histoire, établir quelque computation décisive. La seconde question qu'on a soulevée, c'est de se demander s'il est possible que Thalès ait réellement calculé cette éclipse, et l'ait prédite, comme Hérodote l'avait entendu dire. Les historiens postérieurs en ont douté; de nos jours, M. G. Grote (11), en particulier, a nié que la science fût en état, à cette époque, de faire de pareilles prédictions, et d'aussi savants calculs. Je ne voudrais pas contredire une autorité aussi compétente; mais je ferai remarquer que, par le récit même d'Hérodote, vrai ou faux, il est avéré que, de son temps, c'est-à-dire un siècle après Thalès environ, on croyait au calcul possible des éclipses. Cela seul suffit à prouver que la science était déjà assez avancée. Une telle supposition atteste un très sérieux progrès. Pour que le vulgaire pût l'admettre et la répéter, il fallait bien que les savants en sussent plus que lui. Ce qui est encore non moins incontestable, c'est que, parmi ces peuples, la réputation de Thalès devait être grande pour qu'on lui attribuât sans hésitation ce miracle de science. Hipparque de Rhodes, au rapport de Pline, avait pu dresser un catalogue d'éclipses de soleil et de lune pour six cents ans. Du temps de l'écrivain romain, les calculs de l'astronome n'avaient pas été une seule fois démentis ; on eût dit qu' « Hipparque avait été admis aux conseils de la nature. » Hipparque est de 400 ans environ postérieur à Thalès: mais peut-être la distance qui sépare la science de l'un et de l'autre, est-elle assez bien proportionnelle à l'intervalle de temps qui est entr'eux. Or, ce n'est pas en un jour qu'on arrive à de telles précisions ; et je ne vois rien d'impossible à ce que Thalès, sous le règne d'Alyatte, ait inauguré une science qu'Hipparque poussait déjà si loin, 150 ans avant l'ère chrétienne. Mais je poursuis. La paix fut bientôt conclue entre les Lydiens et les Mèdes, par les bons offices de Syennésis, roi de Cilicie, et de Labynétus, roi de Babylone. Alyatte donna sa fille en mariage à Astyage, fils de Cyaxare. Le traité fut solennellement juré des deux parts; et selon l'usage de ces peuples, les ambassadeurs chargés de le conclure se firent une incision au bras, et sucèrent mutuellement le sang les uns des autres. Cette alliance, toute sincère qu'elle pouvait être, fut fatale à la Lydie, en l'entraînant dans une nouvelle guerre, où elle devait succomber et périr tout entière.
Alyatte mort, son fils Crésus, qui devait être le dernier roi de sa race, et
accomplir la fatale prophétie de l'oracle de Delphes, monta sur le trône.
Crésus, dont le nom est devenu synonyme de celui de richesse, était un prince
des plus distingués; et bien que très fier de ses trésors héréditaires,
accumulés par ses ancêtres, les Héraclides et les Mermnades, il n'était pas du
tout l'homme voluptueux et faible qu'en général on suppose. A peine sur le
trône, il songea à terminer l'œuvre de ses prédécesseurs, et à soumettre
complètement toutes les cités grecques de la côte. Il leur chercha querelle sous
divers prétextes plus ou moins plausibles, en commençant par Éphèse, et il eut
bientôt réduit toutes les colonies à lui obéir. L'Ionie et l'Éolide étaient
vaincues. Crésus sentit bien qu'il n'avait rien fait tant qu'il n'avait pas les
îles en sa possession ; il se préparait donc à équiper une flotte pour traverser
la mer, quand un conseil de Bias de Priène, d'autres disent de Pittacus de
Mytilène, vint le faire renoncer è ce projet, peu sensé pour un peuple tel que
les Lydiens. Le sage était venu à Sardes, et interrogé par le roi sur ce qui se
passait de nouveau dans les îles :
«
Les gens des îles, répondit Bias, se disposent à venir attaquer Sardes avec dix
mille hommes de cavalerie. - Plût au ciel, dit Crésus, qu'ils fissent cette
imprudence ! -
«
Tu as bien raison, ô roi, répartit le sage, de désirer que les insulaires
commettent une telle faute. Mais que crois-tu qu'ils pensent aussi de leur côté,
quand ils apprendront que tu songes à les attaquer par mer?
»
Crésus comprit la leçon, toute piquante qu'elle était; et il se contenta de
faire un traité d'alliance et d'hospitalité avec les Ioniens des îles. De très grands changements venaient de s'opérer dans l'Orient et dans les contrées limitrophes du royaume de Lydie, si démesurément étendu. Cyrus avait renversé l'empire d'Astyage, beau–frère de Crésus, avait vaincu les rois d'Assyrie, s'était fait un allié de celui d'Hyrcanie, et il pensait à attaquer la Lydie, qui avait semblé faire cause commune avec ses ennemis. Maître de tous les pays à l'est de l'Halys, il ne pouvait pas tarder à franchir ce fleuve. Par une pente à peu près irrésistible, la puissance des Perses déjà considérable devait chercher à s'étendre jusqu'à la mer, et à conquérir la presqu'île, avec tous les peuples qu'elle renfermait, les barbares et les Grecs compris. Crésus aperçut assez vite le danger qui le menaçait; et instruit par la défaite d'Astyage, il se prépara à la lutte le mieux qu'il put. A peine consolé de la mort de son fils tué dans un accident de chasse, il résolut d'arrêter les progrès des Perses, en se donnant pour alliés les Grecs des côtes et tous ceux du Péloponnèse et de l'Occident. A cet effet, il envoya d'abord consulter tous les oracles, afin de s'assurer l'appui des Dieux et de la religion populaire. Les envoyés se rendirent à Delphes, à Dodone, à Abas dans la Phocide, à l'antre de Trophonius, au temple d'Amphiaraüs, à celui des Branchides près de Milet, à celui même de Jupiter Ammon. Crésus voulait d'abord leur poser quelques questions insidieuses pour éprouver leur véracité, et les consulter ensuite régulièrement sur la grande question de la guerre contre les Perses, qui alarmait déjà sa prudence. L'oracle de Delphes ayant été trouvé le plus sincère, avec celui d'Amphiaraüs, Crésus leur envoya des présents d'une magnificence inouïe, dont on peut lire la description détaillée dans Hérodote, qui avait avait vu encore dans les sanctuaires une partie de ces prodigieuses richesses. En même temps qu'il offrait ces cadeaux opulents, le roi de Lydie consultait les deux oracles sur l'opportunité de la guerre. Les oracles répondirent assez obscurément à cette question embarrassante, en disant que « si Crésus faisait la guerre aux Perses un grand empire serait détruit. » Lequel? Celui des Perses, ou celui de Lydie? Les devins ne le décidaient point. Mais ils donnaient à Crésus un excellent conseil: c'était de se faire des alliés et des appuis parmi les peuples les plus puissants de la Grèce. Consulté de nouveau sur ce point, l'oracle de Delphes désigna les Lacédémoniens dans la race Dorienne, et les Athéniens dans la race Ionienne, ceux-ci Pélasgiques, et les autres Hellènes. Crésus envoya donc des ambassadeurs dans les différentes parties de la Grèce ; mais ses avances ne furent acceptées que par les Lacédémoniens, bien disposés envers lui par quelques services antérieurs qu'ils en avaient reçus. Les autres Grecs, et les Athéniens en particulier, ne comprirent pas le danger prochain, et ne répondirent point aux ouvertures du roi lydien. Si l'on en croit la Cyropédie, Crésus était allé chercher des secours jusqu'en Égypte. Mais il est douteux qu'il eût à sa solde 120,000 Égyptiens, comme le veut ce bon Xénophon. Crésus, se fiant à une réponse de l'oracle qu'il avait mal interprétée, envahit la Cappadoce, territoire Mède qui appartenait depuis peu à Cyrus. II fallait traverser l'Halys, assez large en cet endroit. La difficulté était fort grande, et le roi de Lydie ne put la vaincre que grâce à l'habileté de Thalès, qui avait suivi l'armée Lydienne avec un bon nombre de ses compatriotes. Thalès fit construire une vaste digue qui sépara le fleuve en plusieurs bras, ce qui permit de le franchir à gué. Telle est la tradition qu'Hérodote recueillit encore toute récente. Quant à lui, il semble croire que l'armée Lydienne passa tout simplement sur des ponts, qui, selon le dire populaire, n'avaient été construits que plus tard. Le fleuve, une fois traversé, Crésus s'empara de toute la contrée qu'il dévasta ; elle s'appelait la Ptérie. Cyrus accourut à sa rencontre avec toutes ses troupes et avec tous les gens du pays qui avaient pu se joindre à lui. Mais avant d'engager la lutte, il fit parvenir aux Ioniens des propositions d'accommodement, afin qu'ils consentissent à quitter l'armée de Crésus. les Ioniens restèrent fidèles, prévoyant bien qu'une honteuse trahison ne pourrait que les déshonorer sans les servir, les Grecs étant hors d'état de résister seuls aux Perses, si, comme on pouvait le craindre, la Lydie était vaincue et conquise. Il valait encore mieux risquer une défaite commune, puisqu'on ne voulait point se rendre dès ce moment à la puissance des Perses, quelque menaçante qu'elle fût. La bataille, livrée dans les plaines de la Ptérie, à l'est de l'Halys, fut terrible; elle dura toute une journée et ne cessa qu'avec la nuit. la victoire ne se décida d'aucun des deux côtés. Toutefois le désavantage fut évidemment du côté de Crésus; son armée s'était très vaillamment conduite ; mais elle était de beaucoup la moins nombreuse. Voyant que le lendemain Cyrus, affaibli quoique supérieur en forces, ne songeait pas à l'attaquer, Crésus leva le camp et se retira assez précipitamment vers Sardes, décidé à la défendre jusqu'à l'extrémité. En même temps, il fit appel à ses alliés, Amasis, roi d'Égypte, Labynétus, roi de Babylone, et à Lacédémone. Il comptait, en réunissant tous les contingents qu'on lui enverrait, reprendre l'offensive au printemps suivant. II donnait sa capitale pour rendez-vous général dans cinq mois. Toutes ces mesures étaient sages; mais il commit la lourde faute de laisser disperser l'armée qui venait de combattre, persuadé que Cyrus ne pourrait amener de si tôt devant Sardes, la sienne, qui avait aussi beaucoup souffert. Au contraire, Cyrus se garda bien de licencier ses troupes; et après quelque repos, il marcha sur la Lydie, et arriva bientôt dans la vaste plaine où Sardes est bâtie. Crésus, quoique surpris, ne perdit pas courage. Il se fiait à la valeur bien connue des Lydiens, et surtout à leur cavalerie, qui passait alors pour invincible, à la fois par son habileté à manier les chevaux et à se servir des longues lances qu'elle portait. De son côté, Cyrus compensa ce désavantage en mettant à son avant-garde toute la masse de ses chameaux les chevaux des Lydiens, peu habitués à l'aspect et à l'odeur de ces bêtes, devinrent indomptables. Les Lydiens mirent pied à terre; et malgré cet inconvénient, ils luttèrent avec vigueur. Vaincus après un grand carnage réciproque, ils n'eurent plus qu'à se renfermer dans leurs murs. Crésus, bloqué par des forces victorieuses, s'adressa en toute hâte à ses alliés et particulièrement aux Lacédémoniens. Ils s'étaient décidés à lui envoyer le secours promis par le traité, quand ils apprirent que Sardes venait d'être emportée d'assaut, après quatorze jours de siège régulier, et que Crésus avait été fait prisonnier. Tombé aux mains des soldats et chargé de chitines, le malheureux roi de Lydie avait été condamné à être brûlé vif, avec quelques enfants des meilleures familles, et déjà les flammes commençaient à l'atteindre, quand le cœur de Cyrus s'amollit; il fut clément envers le vaincu, qui supportait avec résignation l'infortune dont il était frappé, et qui se rappelait à cet instant suprême les sages conseils que Solon, venu à sa cour, lui avait jadis donnés. Crésus avait alors 49 ans, et il en avait régné quatorze, depuis la mort de son père. Il vécut encore assez longtemps à la suite de Cyrus, l'accompagnant et le dirigeant même quelquefois dans ses expéditions. La date de la prise de Sardes n'est pas moins flottante que celle de l'éclipse de Thalès. D'après les marbres de Paros, Sardes aurait été saccagée dans la 3e année de la 59e Olympiade, c'est-à-dire dans Vannée 537 avant notre ère. Fréret, d'après le témoignage de Sosicrate, cité dans la vie de Périandre par Diogène de Laërte, croit pouvoir fixer cette date à l'an 545. Volney, dans la chronologie d'Hérodote, la recule jusqu'en 557. En d'autres termes, le doute subsiste ; et cette date, tout importante qu'elle serait, reste à connaître. Les Lydiens vaincus, les cités grecques sentirent tout le péril de leur situation. Les Éoliens et les Ioniens firent proposer au vainqueur de se soumettre aux mêmes conditions que, naguère, ils avaient obtenues de Crésus. Cyrus repoussa dédaigneusement ces offres, et il fit rappeler aux Ioniens qu'il les avait conviés vainement à lui quelques mois auparavant. Après ce refus hautain, il ne restait plus qu'a se préparer à la guerre. Le Panionium fut convoqué, et toutes les cités s'y rendirent, à l'exception de ceux de Milet, qui s'étaient arrangés préalablement; Cyrus les avait accueillis aux mêmes conditions que l'avait fait le royaume de Lydie. Il est probable que c'est vers cette époque qu'on doit placer le conseil donné par Thalès à la confédération Ionienne. Avec une profonde prévoyance, il voulait que toutes les cités Ioniennes n'eussent qu'une seule assemblée se réunissant à Téos, qui était au centre; elles auraient d'ailleurs conservé chacune leurs institutions particulières. Mais en joignant leurs forces, elles eussent évidemment résisté mieux à l'ennemi de tous. les dissensions intestines les avaient affaiblies; la concorde seule pouvait les sauver. Le sage avis de Thalès ne fut pas écouté, à un moment où les affaires de l'Ionie n'étaient pas encore très mauvaises. Un avis plus énergique encore, donné quand elles s'étaient fort empirées, ne fut pas suivi davantage. Plus tard, Bias de Priène, membre du Panionium, voulait que tous les Ioniens réunis abandonnassent l'Asie ; et que ne faisant qu'une seule grande flotte, ils allassent s'établir dans l'île immense de Sardaigne, où ils fonderaient, tous d'accord, une puissante république. En restant au contraire sur le sol asiatique, Bias augurait qu'ils ne pourraient y défendre leur liberté. Hérodote croit que cette résolution héroïque aurait pu faire des Ioniens le peuple le plus fortuné de la Grèce entière. On se contenta de se concerter avec les Éoliens pour députer des ambassadeurs à Sparte, tant en leur nom qu'au nom des Ioniens, et pour implorer le secours de la république. Sparte ne se décida pas à envoyer des forces réelles; mais elle chargea un des citoyens les plus recommandables, Lacrine, d'aller à Sardes enjoindre au vainqueur de ne faire de mal à aucune ville de la Grèce, sous menace de s'attirer le courroux de Lacédémone. Cyrus, qui ne savait pas même l'existence de Sparte, demanda ce que c'était; et se raillant de ces peuples qu'il croyait efféminés, il leur annonça qu'ils auraient bientôt à s'occuper de leurs propres dangers sans se mêler de ceux qui menaçaient l'Ionie. Appelé d'ailleurs dans d'autres parties de l'Asie par les affaires de Babylone, de Bactriane, des Saces et même de l'Égypte, il partit précipitamment de Sardes pour Ecbatane, laissant la garde de la ville à un Perse nommé Tabalus, et chargeant un Lydien, du nom de Paetyas, du transport de tous les trésors que les rois y avaient amassés depuis plusieurs siècles. Pendant qu'il allait faire le siège de Babylone, Pactyas, gardant pour lui les trésors qui lui étaient confiés, se retira vers la côte et appela les Lydiens à l'insurrection. Il se forma bientôt une armée grâce à ses largesses, et il vint mettre le siège devant Sardes, que Tabalus défendait. Mais cette révolte ne dura pas longtemps. Un des lieutenants de Cyrus, Mazarès, arrivant au secours de la place, Pactyas fut forcé de prendre la fuite et de se retirer à Cymé. Réclamé par Mazarès, les Cymiens allaient le livrer, d'après le conseil de l'oracle des Branchides, sur le territoire des Milésiens, quand un courageux citoyen, nommé Aristodicus, sauva le fugitif en s'opposant, malgré le dieu, à ce qu'on violât contre un suppliant les lois de l'hospitalité. Pactyas se sauva à Mytilène, où les habitants de Cymé, revenus à de meilleurs sentiments, voulaient aussi le protéger; mais le malheureux fut arraché de force du temple de Minerve par des Chiotes, et il fut livré aux Perses, Cyrus ayant ordonné qu'on le lui amenât vivant. Pour prix de cette infamie, les Chiotes avaient reçu le canton d'Atarné, situé en Mysie, en face de Lesbos. Mais cette possession, acquise à ce prix honteux, ne leur porta pas bonheur ; et Hérodote assure qu'il se passa beaucoup de temps sans que les habitants de Chios osassent rien offrir aux Dieux, ni rien employer aux sacrifices, de ce qui venait dans ce pays maudit. Mazarès, châtia rudement tous ceux qui avaient pris part à la révolte de Pactyas. Il réduisit en esclavage les habitants de Priène, vendus à l'encan. Il ravagea sans pitié toutes les plaines du Méandre pour enrichir ses soldats de butin ; mais la mort le surprit bientôt au milieu de ces vengeances. Par là, les Perses comptaient décourager de nouvelles insurrections. Mais les Grecs de la côte et les colonies de l'Éolide, de l'Ionie et de la Doride, ne se laissèrent pas effrayer, et elles se disposèrent bravement à une lutte inégale, où elles devaient succomber. C'est ce qu'on peut distinguer comme la troisième et dernière période de l'histoire des Grecs de l'Asie-Mineure. La première période, qui dure de la fondation jusqu'au règne de Gygès, usurpateur de la monarchie Lydienne, est la plus longue; elle ne contient guère moins de 500 ans. La seconde est remplie par le conflit entre les cités grecques et le royaume des Lydiens ; elle s'étend jusqu'à la défaite de Crésus et la prise de Sardes. Mais la puissance des rois Lydiens était peu de chose en comparaison de la puissance des Perses, qui possédaient une partie considérable de l'Asie, qui étaient fort belliqueux, et qui, guidés par le génie de Cyrus, avaient fait de grands progrès dans l'art militaire. Celui qui remplaçait Mazarès et était chargé de poursuivre l'œuvre de répression et de conquête, était un homme qu'on pouvait croire capable de toutes les cruautés et de toutes les bassesses. Il se nommait Harpagus, et s'était fait connaître par un acte de servilité presqu'inouï dans les fastes si avilis cependant de la cour des Perses. Astyage, roi des Mèdes, effrayé par un songe, avait chargé Harpagus, son confident, de faire périr l'enfant que sa fille Mandane venait d'avoir de Cambyse. Ce petit-fils d'Astyage devait être Cyrus. Harpagus, tout en acceptant l'ordre homicide, n'avait pas voulu tuer l'enfant de ses propres mains, et il avait remis le soin du meurtre à un berger. Celui-ci, attendri par les supplications de sa femme, avait substitué son enfant mort en naissant à celui qu'on lui remettait; et il avait fait croire à Harpagus que l'enfant royal avait péri. Plus tard la vérité avait été découverte; Astyage l'avait apprise tout entière; mais il avait dissimulé son courroux. Par un raffinement de barbarie abominable, il avait fait tuer un jeune fils d'Harpagus, et dans un repas solennel il avait servi au père les chairs de son enfant. Puis, il avait fait apporter, au milieu du festin, la tête et les mains de la victime cachées sous un voile dans une corbeille. Harpagus avait dû lui-même lever le voile; et en présence de cet épouvantable spectacle, il avait conservé tout son sang-froid. A la question du féroce Astyage, il avait répondu qu'il reconnaissait bien la viande qu'il avait mangée, et qu'il avait qu'à louer tout ce que le roi avait daigné faire. Cependant il avait médité une vengeance; et pour renverser Astyage du trône, il avait secrètement suscité Cyrus à la rébellion. Le jeune prince n'avait pas ou de peine à soulever les Perses contre le joug odieux des Mèdes. Astyage, attaqué par son petit-fils, avait poussé l'aveuglement jusqu'à confier son armée à Harpagus, qu'il avait si affreusement outragé; et Harpagus n'avait pas manqué de le trahir. Astyage vaincu avait été épargné par Cyrus, qui l'avait laissé vivre ignominieusement. L'empire des Mèdes se trouvait détruit après 328 ans de durée, depuis Déjocès, fils de Phraorte. Cette partie de l'Asie appartenait désormais aux Perses, qui devaient la garder moins longtemps, et périr, environ deux siècles après, sous les coups d'Alexandre. Tel était l'homme que Cyrus chargeait de réduire les cités grecques. J'ai tenu à rappeler ces détails, quoique d'ailleurs très connus, pour montrer à quels peuples et à quelles mœurs les Hellènes de la côte allaient avoir affaire. Harpagus, usant de moyens d'attaque alors tout nouveaux, entourait les villes qu'il assiégeait de circonvallations, et bloquant les habitants, les forçait à se rendre. Il se dirigea d'abord contre Phocée. Ce siège, qui fit grand bruit à cette époque, doit nous intéresser encore vivement, parce que nous allons y retrouver un de nos philosophes, Xénophane, exilé de Colophon, et fuyant avec ses compatriotes sur les rives lointaines de la Tyrrhénie. Les Phocéens étaient les premiers, parmi toute la race hellénique, qui eussent tenté les grands et périlleux voyages. Les premiers, ils avaient appris au monde ce que c'était que la mer Adriatique, la mer de Tyrrhène, l'Ibérie et Tartesse, reculées aux bornes de la terre, par delà les colonnes d'Hercule. Ils avaient même réformé les constructions navales ; et, laissant de côté les gros navires ronds, ils avaient employé les navires à cinquante rangs de rames, les Pentécontores. Dans le pays de Tartesse, ils avaient trouvé les relations les plus bienveillantes et les plus lucratives. Quand Phocée fut menacée, Arganthonius, monarque puissant de ces contrées, leur avait offert un asile dans son royaume, s'ils voulaient quitter l'Ionie; et comme on ne s'était pas encore décidé à l'émigration, le roi, en excellent allié, avait donné aux Phocéens une somme d'argent considérable pour les aider à ceindre leur ville d'une forte muraille. En effet, cette muraille, qui avait une étendue énorme, avait été construite contre les assaillants, et elle était formée de grandes pierres parfaitement jointes. La précaution était efficace, et Harpagus se trouvait arrêté devant ces fortifications, qu'il ne pouvait prendre. La ville était bloquée depuis assez longtemps et soufrait déjà beaucoup, quand il fit proposer un accommodement aux assiégés : ils détruiraient un seul des ouvrages avancés de la place ; et ils y recevraient une garnison Perse, en signe de soumission. Les Phocéens, très affligés de cette extrémité, demandèrent un jour de trêve, et l'éloignement de l'armée perse. Harpagus, tout en prévoyant bien ce qui allait se passer, consentit à cet arrangement provisoire, et fit écarter ses troupes. Les Phocéens, profitant de ce répit, embarquèrent sur leurs pentécontores, les femmes, les enfants, et tout ce qu'on pouvait emporter, surtout les objets religieux enlevés aux temples, et ils firent voile pour Chios. les Perses, en entrant le lendemain dans la ville, n'y trouvèrent plus un seul habitant. Cependant les Phocéens avaient d'abord voulu acheter, des Chiotes, les îles qu'on appelle les Oenusses; mais ceux-ci, craignant de nuire à leur propre commerce en se créant des concurrents si redoutables, refusèrent le marché. Alors les Phocéens pensèrent à se diriger vers la Corse (Cyrné, de ce temps), où vingt ans plus tôt ils avait fondé la ville d'Alalia, par le conseil d'un oracle. Mais avant de partir pour cet exil définitif, ils revinrent à Phocée et y surprirent la garnison Perse, qu'ils égorgèrent. Ce hardi coup de main ne leur servit pas cependant à rester dans leur ancienne demeure; ils remontèrent sur leur flotte, et pour bien prouver qu'ils ne la quitteraient point, ils jetèrent à la mer un bloc de fer, jurant de ne pas revenir avant que cette lourde masse ne surnageât sur l'eau. Mais en dépit de ce serment, l'épreuve était trop forte; la moitié des émigrants descendit à terre, et rentra dans Phocée ; l'autre partie, fidèle à l'engagement qu'on venait de prendre, résolut de fuir le joug intolérable des barbares, et cingla vers la Corse. On y arriva bientôt, et l'on s'y établit comme on le désirait. Pendant cinq ans, on y fut assez tranquille, avec les compatriotes qu'on y retrouvait et qui y étaient arrivés depuis longues années. Mais soit esprit de rapine, soit besoin, soit jalousie, les Phocéens furent bientôt attaqués par leurs voisins, les Tyrrhéniens et les Carthaginois. Les Phocéens, qui n'avaient que soixante vaisseaux contre cent vingt, n'hésitèrent pas à engager la bataille ; ils allèrent chercher l'ennemi dans la mer de Sardaigne, et le défirent. Mais ils avaient perdu dans ce triomphe les deux tiers de leurs navires. Revenus en toute hâte à Alalie, ils y avaient repris leurs familles et leurs richesses, pour aller chercher un autre asile plus sûr que celui-là. Il paraît qu'une partie des exilés fut assaillie et massacrée par les Tyrrhéniens et les Carthaginois ; l'autre partie alla d'abord toucher à Rhégium en Sicile ; et delà se dirigeant au nord, ils allèrent fonder sur la terre d'Oenotrie la ville qui, du temps d'Hérodote, se nommait Hyélé. C'est celle qui est connue sous le nom d'Élée, illustrée par l'école philosophique qui s'y forma bientôt après. C'est à Élée que Xénophane se réfugia, vers la même époque, fuyant Colophon, opprimée par les Perses, et se réunissant aux courageux Phocéens, qui détestaient la servitude autant que lui. Il est bien clair, que, quand Xénophane parle dans ses vers de l'invasion des Perses, qu'il appelle encore les Mèdes, il entend parler de cette attaque d'Harpagus, et non de la guerre Médique (12) comme on l'a cru quelquefois. La fondation d'Elée, qu'a chantée Xénophane ainsi que celle de Colophon, remonte, à ce qu'il semble, à l'année Cinq cent trente six ou Cinq cent trente-deux avant notre ère, peut-être même encore un peu plus bas; mais elle est à trente ans au moins de l'invasion de la Grèce par Mardonius et Datis, et rien ne doit faire croire que Xénophane ait pu vivre jusque-là. On ne voit pas dans les détails que nous a conservés l'histoire quel a été le destin particulier de Colophon, qui était en Lydie comme Phocée. Mais il est bien présumable qu'elle partagea le même sort, et que les habitants, qui n'acceptèrent pas la domination des barbares, durent se réfugier par mer dans des contrées plus paisibles. Il est vrai qu'Hérodote ne parle, après les Phocéens, que des habitants de Téos, qui firent de même en emportant tout ce qu'ils purent sur leurs vaisseaux et, en allant fonder Abdère en Thrace, qu'avait déjà occupée jadis un citoyen de Clazomènes. Toutes les autres villes de l'Ionie, ajoute Hérodote, se soumirent après une vigoureuse résistance. On peut bien supposer que Xénophane faisait partie « de ces vaillants hommes » que loue l'historien, et qui ne cédèrent que devant la nécessité. Les Milésiens seuls firent exception. Ils étaient entrés en arrangement avec Cyrus, ainsi que je l'ai dit plus haut; et Harpagus respecta leur neutralité, se contentant d'avoir écrasé ou dispersé tout le reste de l'Ionie continentale. Les insulaires étaient à l'abri par leur situation; la Perse n'avait pas encore de flotte pour les atteindre et les subjuguer. Mais l'Ionie et l'Éolide furent si bien soumises qu'elles durent fournir des contingents à Harpagus, quand il marcha contre la Carie, qu'il réduisit bientôt. Les Cnidiens, qui avaient essayé de se défendre, en coupant à la hôte l'isthme qui les joignait à la terre ferme, avaient renoncé à leur entreprise, d'après le conseil de la Pythie, et ils s'étaient résignés à obéir aux Perses. les Pédasiens des environs d'Halicarnasse résistèrent un peu plus longtemps ; mais ils furent vaincus, ainsi que les Lyciens, qui montrèrent un héroïque courage. Quand Cyrus marcha contre Babylone, il pouvait se dire que toute l'Asie inférieure lui appartenait jusqu'à la mer. Samos était alors la plus puissante des îles; par ses relations, soit avec la Grèce, soit avec l'Égypte, elle s'était fait une situation prépondérante. Pendant que Cambyse, le fils insensé de Cyrus, allait attaquer l'Égypte et s'y perdre, Polycrate régnait à Samos; et par une administration habile et peu scrupuleuse, il avait amené la prospérité de l'île à un degré qui la rendait l'envie de tous ses rivaux. A la faveur d'une insurrection qu'il avait fomentée, il s'était emparé du pouvoir avec ses deux frères, Pantagnote et Syloson. Tous trois s'étaient d'abord partagé la ville, et chacun y exerçait un pouvoir séparé. Mais bientôt Polycrate s'était défait de ses deux frères, en tuant l'un et en chassant l'autre ; Samos entière lui obéissait. Pour affermir son usurpation, il s'était lié avec Amasis, roi d'Égypte ; il lui envoyait des dons magnifiques; et il en recevait de lui. En peu de temps, il s'était acquis dans la Grèce une réputation immense ; toutes ses entreprises lui réussissaient à souhait; sa flotte se composait de cent vaisseaux à cinquante rangs de rames, et ses archers seuls étaient au nombre de mille. D'ailleurs, sans ménagement pour aucun de ses voisins, il les rançonnait audacieusement; et un de ses principes politiques, c'était de ne pas même épargner ses amis quand l'occasion l'exigeait, sauf à les indemniser ensuite. Il avait conquis plusieurs îles aux environs de Samos, et même quelques villes sur le continent. Les Lesbiens, ayant secouru les Milésiens, qu'il attaquait, il les avait vaincus dans une bataille navale; et tous les prisonniers, chargés de chaînes, avaient été contraints de travailler an fossé profond dont il avait entouré les murs de la cité. Des exilés de Samos, fuyant les violences du tyran, avaient demandé du secours à Sparte et l'avaient obtenu. Les Lacédémoniens, avec une flotte assez forte, étaient venus assiéger la ville; mais après quarante jours d'efforts inutiles, ils avaient dû se retirer devant la vigueur de Polycrate, ou peut-être devant son or. Resté maître de Samos, le tyran y semblait invincible ; ceux des Samiens qui ne voulurent pas se résigner à son joug durent aller au loin chercher un asile, et fonder des colonies. Afin de se mettre à l'abri de tout danger, Polycrate, outre le vaste fossé que vit encore Hérodote, avait alimenté la ville d'eaux abondantes, qu'amenait un aqueduc passant sous une montagne. II avait fait construire un môle très haut qui s'avançait fort avant en mer, et qui rendait le port plus accessible. Enfin il avait élevé un temple qui était renommé comme le plus grand de tous les temples connus. Aristote signale aussi ces grands travaux de Polycrate. Ami des lettres et des arts, le tyran avait, dit-on, assemblé le premier une bibliothèque, luxe alors fort rare, et dont l'Égypte seule avait donné le modèle; il attirait les poètes auprès de lui ; et Anacréon de Téos fut assez longtemps au nombre de ses convives et de ses flatteurs. C'est à cette époque de la tyrannie de Polycrate qu'il faut sans doute rapporter les relations que Pythagore dut avoir avec lui, et pour lesquelles nous possédons des renseignements assez précis. Jamblique, Porphyre et Diogène de Laërte se rencontrent sur ce point ; et ils ne sont évidemment que l'écho d'auteurs beaucoup plus rapprochés du temps de Pythagore et qui avaient écrit sa vie, tels qu'Aristoxène le musicien, disciple d'Aristote, Apollonius de Tyr, Hermippe, Diogène, Antiphon, etc. Pythagore, fils de Mnésarque, appartenait par sa mère aux plus grandes familles de Samos, et pouvait faire remonter son origine jusqu'à Ancée, le fondateur de la colonie. Mnésarque, son père, semble avoir fait une fortune considérable dans le commerce des bleds. Tyrien selon les uns, Tyrrhénien selon les autres, il emmenait son fils dans ses voyages, et l'enfant parcourut de bonne heure les contrées qu'il devait étudier plus tard. Dès qu'il fut en âge de recevoir des leçons, son père, voyant en lui des facultés extraordinaires, l'avait mis en rapport avec les hommes les plus distingués de ce temps : Thalès, dit-on, Anaximandre, Anaximène de Milet, Phérécyde de Syros.
Le jeune homme connaissait déjà la Phénicie, où son père l'avait conduit; et
lorsqu'il voulut se rendre en Égypte, Polycrate l'introduisit auprès d'Amasis
par une lettre de recommandation. Ceci prouve qu'à cette époque du moins,
Pythagore ne jugeait pas le tyran comme il le fit plus tard. Malgré les obscurités qui couvrent la vie de Pythagore, quoique tant d'écrivains s'en soient occupés dans l'antiquité, un point paraît avéré, c'est qu'il quitta Samos, privée de la liberté, pour aller trouver dans la Grande-Grèce un pays où la tyrannie ne choquât pas ses yeux, et qui lui assurât l'indépendance dont il avait besoin. Xénophane, vers la même époque, en avait fait autant, puisqu'il fuyait l'oppression des Perses, plus durs encore, s'il est possible, que les despotes locaux. C'était là le sort commun; il n'était pas facile de rester patriote ou philosophe sous la main pesante de tels maîtres. Pythagore alla donc porter à Crotone et à Sybaris des doctrines admirables, qui sans doute conservent quelque chose des religions orientales qu'il avait vues, mais qui sont dignes du respect de tous ceux qui aiment la sagesse et l'humanité. Ces doctrines ne nous sont connues que par des intermédiaires ; rien ne nous est parvenu des ouvrages assez nombreux que, d'après le témoignage d'Héraclite, Pythagore parait avoir écrits (13) et qui, divulgués pour la première fois trois ou quatre générations plus tard par Philolaüs, étaient recherchés à si haut prix par Platon. Polycrate, qui pour sa part avait contribué à l'instruction de Pythagore, finit d'une manière bien misérable, assez peu d'années après que le sage s'était exilé de Samos, devenue indigne de lui. Oréetès, commandant de Sardes nommé par Cyrus, s'efforçait d'étendre la domination perse du continent sur les îles, et il résolut de se défaire du tyran qui donnait tant de force à Samos, placée en face de son gouvernement. Voici le stratagème dont il s'avisa. Il envoya un émissaire secret à Polycrate pour lui faire savoir que, Menacé personnellement par les fureurs épileptiques de Cambyse, il désirait d'abord mettre en sûreté ses trésors, et qu'il priait le maître de Samos de vouloir bien les lui garder. Comme Polycrate pouvait ne pas se rendre à cette ouverture, Oroetès l'invitait à envoyer à Sardes un homme de confiance, à qui les coffres-forts remplis de pièces de monnaie seraient montrés. La moitié de cette richesse resterait au satrape; mais l'autre partie serait remise à Polycrate, qui pourrait s'en servir pour ses projets ambitieux, allant jusqu'à la conquête de toute la Grèce. La convoitise de Polycrate ne sut pas résister; il envoya son secrétaire Maesandrius à Sardes, pour vérifier les assertions d'Oroetès. Le secrétaire, trompé par la vue des caisses, dont la surface seule était couverte d'or mais qui n'étaient remplies que de pierres, vint faire à son maître un rapport qui le combla de joie. Enivré d'une si belle espérance, Polycrate voulut aller de sa personne auprès de son complice. En vain ses amis et sa famille même voulurent le retenir. Il menaça sa fille, qui essayait de l'arrêter jusque sur le vaisseau, de ne la marier qu'après longues années ; et il partit, accompagné de son devin, nommé Hélée, qui ne prévoyait pas le piège. A peine arrivé à Magnésie, où Oroetès l'attendait, le traître le fit saisir et expirer sur la croix. Hérodote, qui n'est pas suspect de faiblesse pour les tyrans, plaint cependant Polycrate, dont le génie et la magnificence ne méritaient pas une si triste fin. Parmi les suivants de Polycrate dans cette malheureuse aventure, se trouvait, outre le devin imprudent, le fameux Démocède, médecin de Crotone, qui fut alors réduit en esclavage, et qui fut bientôt appelé à la cour de Darius pour le guérir d'une entorse, quand le roi de Perse, destructeur des Mages, eût fait tuer Oroetès, coupable de cruautés inutiles (14). Privée de Polycrate, Samos ne pouvait tarder à tomber entre les mains des Perses. Le tyran, en partant pour le fatal rendez-vous, avait confié le pouvoir à Mmandrius; mais trop au-dessous de cette tache, Maeandrius s'était hâté de quitter la ville, quand les troupes d'Otanès, le nouveau Satrape, s'y étaient présentées conduites par Syloson, le frère exilé de Polycrate, qui avait su gagner la faveur de Darius, pour l'avoir vu jadis en Égypte. Syloson avait été rétabli dans Samos, à peu près complètement déserte d'habitants, et désormais sous la main des barbares, après une vive résistance que dirigeait Charilaüs, le frère de Maeandrius. Aussi quand Darius, vainqueur de Babylone, par le dévouement de Zopyre, voulut aller porter la guerre chez les Scythes, le fameux pont où son armée traversa le Bosphore fut construit par un ingénieur de Samos, Mandroclès. Ce pont de bateaux n'avait pas moins de 4 stades de long, c'est-à-dire près de 800 mètres ; ce devait être un travail des plus difficiles. II était placé, à ce que croit Hérodote, entre Byzance et un temple construit à l'embouchure du Bosphore. Le Grand Roi, pour conserver ce souvenir, avait comblé l'ingénieur samien des plus splendides récompenses; et il avait fait élever sur le rivage deux colonnes avec des inscriptions grecques et assyriennes. Mandroclès avait consacré, dans le temple de Junon, un tableau où il avait fait représenter le vaste pont et l'armée des Perses défilant sous les regards de Darius, monté sur son trône. A son armée de terre, Darius avait joint une flotte considérable que conduisaient les Ioniens et les Éoliens, avec les gens de l'Hellespont. Elle avait ordre d'entrer dans la Mer noire, de remonter le cours du Danube, de l'Ister, et de jeter un pont sur le fleuve, à l'endroit où il se divise pour la première fois en plusieurs branches. Darius se dirigeait vers le même point par la Thrace avec toutes ses troupes. l'armée de terre comptait, dit-on, 700,000 hommes, et la flotte six cents vaisseaux. On y voyait figurer tous les peuples que renfermait l'empire des Perses dans ses vastes limites, depuis les côtes de l'Asie mineure jusqu'à l'Indus. Le Grand Roi s'avançait péniblement au milieu de ces peuples farouches, qui s'appliquaient à fuir devant lui, et à l'attirer de plus en plus dans leurs steppes infranchissables, ainsi que, de nos jours, y fut attiré un autre conquérant non moins imprudent et non moins malheureux. Darius, pour signaler ses prétendus triomphes, élevait des colonnes avec des inscriptions pompeuses sur la soumission des Gètes. Il construisait de faciles monuments en ordonnant à chaque soldat de son innombrable armée de jeter, en passant, une pierre sur un endroit désigné, où se formait bientôt un énorme amas qu'on prenait pour une pyramide. L'armée Perse trouvait même dans ces sombres contrées quelques traces de l'influence grecque. Ces peuplades adoraient Zalmoxis, qui avait été, disait-on, esclave de Pythagore, fils de Mnésarque, à Samos, et qui, devenu riche et libre, avait apporté à ses grossiers compatriotes les germes de la civilisation hellénique, en leur transmettant quelques-unes des croyances de son savant maître. Hérodote n'admet pas cette tradition, et il pense que Zalmoxis ou Guébéleizis était de beaucoup antérieur à Pythagore, dont il admire d'ailleurs la haute sagesse (15). Mais cette tradition, toute fausse qu'elle pouvait être, atteste du moins dans quelle estime était tenu dès lors le nom du philosophe samien. C'était à lui qu'on rapportait la culture des mœurs et la réforme bienfaisante, quoiqu'incomplète, qui avait adouci les sauvages habitants de la Thrace. Cependant, Darius était parvenu au Danube, et il y avait trouvé le pont de bateau: que, par ses ordres, y avaient construit les Ioniens, comme ils avaient construit celui du Bosphore. L'armée des Perses ayant passé, Darius voulait faire détruire le pont, pour que les Grecs pussent le suivre; mais, par bonheur, Coès, le chef des Mytiléniens, fut plus sage que le roi, et il parvint à lui persuader de conserver le seul moyen de passage qu'il pût espérer en cas de retraite. Darius se contenta donc de recommander aux Ioniens de l'attendre soixante jours, et de partir en détruisant le pont si, dans cet intervalle de temps, il n'était pas revenu.
Ce qu'il était facile de prévoir arriva. L'armée des Perses, après des marches
aussi vaines que fatigantes vers le nord, dut rétrograder avec des pertes
considérables et en abandonnant ses malades et ses blessés, aussi malheureuse
que la Grande armée de 1812, à peu près dans les mêmes contrées, et contre les
mêmes ennemis usant de la même tactique. Les Scythes, vainqueurs sans avoir
livré de bataille, devancèrent les Perses au pont du Danube ; et Darius y aurait
rencontré une Bérézina, sans la fidélité des Grecs auxquels le pont était
confié. les Scythes les exhortèrent à le rompre, leur représentant que les
soixante jours étaient passés, et que la promesse faite par eux avait été
tenue. Un conseil qui pouvait avoir plus de poids sur les Ioniens, était celui
de Miltiade, d'Athènes, qui était alors général et tyran de la Chersonèse de
l'Hellespont. Que serait-il advenu si les Ioniens eussent rompu le pont et eussent fait périr l'armée avec son chef? C'eût été sans doute un affreux désastre pour l'empire des Perses; mais ce coup, quelque terrible qu'il eût été, n'aurait pu être décisif. Les défaites de Marathon, de Salamine, de Platée, n'y suffirent même pas. L'Ionie eût certainement respiré; quelque temps peut-être, elle aurait recouvré son indépendance; mais une nouvelle invasion, plus furieuse encore que les précédentes, l'aurait subjuguée. Le temps n'était pas arrivé pour la chute des Perses, qui étaient alors dans toute l'énergie d'un premier développement. Mais l'égoïsme des chefs Ioniens n'en fut pas moins coupable, et ils pouvaient se décider à garder leur poste par des motifs plus honorables que ceux qui les guidèrent. Arrivé à Sestos, Darius s'en retourna par mer en Asie, laissant Mégabaze pour commander en Europe, et soumettre la Thrace avec la Macédoine. Bientôt, Mégabaze fut rappelé à Suse, ainsi qu'Histiée, qu'il ne parut pas prudent de laisser seul en Thrace, où Darius lui avait concédé un vaste territoire, à Myrcine, pour le récompenser de ses services. Mais un nouvel effort et de nouveaux malheurs se préparaient pour l'Ionie. Histiée, en quittant Milet, avait remis le pouvoir à Aristagoras, son gendre et son cousin. Quelques exilés de Naxos, étant venus demander du secours à Aristagoras, celui-ci, ne se sentant pas assez fort pour tenter l'entreprise à lui seul, en avait référé à Artapherne, frère de Darius, qui résidait à Sardes, et commandait à toute cette satrapie, la première de l'Empire. Artapherne, séduit par l'espoir de s'emparer de Naxos et de toutes les Cyclades, avait obtenu de Darius de mettre deux cents vaisseaux à la disposition d'Aristagoras. Mais la discorde avait éclaté bientôt entre les alliés. Naxos avait pu se défendre et repousser un siège de quatre mois. Aristagoras n'avait donc tenu aucune des belles promesses qu'il avait faites au satrape de Sardes. Craignant pour son propre pouvoir, il résolut de n'être pas coupable à demi, et d'en venir à une révolte ouverte, à laquelle le poussait Histiée, demeuré à Suse, auprès du Grand Roi. Afin de se gagner le cœur des Milésiens, il abdiqua spontanément la tyrannie, et rétablit le gouvernement populaire. II appela les autres villes Ioniennes à l'insurrection, et elles chassèrent tous les tyrans qui leur avaient été imposés. C'était là une grande audace, et Aristagoras, avant de prendre ce parti extrême, avait consulté ses amis. Hécatée de Milet, l'historien, s'était prononcé pour qu'on ne fît pas la guerre sur le champ, parce qu'on n'avait pas les ressources nécessaires. Ne pouvant faire prévaloir cet avis, il avait insisté pour qu'on tournât toutes ses forces vers la mer, où l'on pouvait se flatter davantage de lutter. A cet effet, il conseillait de saisir toutes les richesses que Crésus avait naguère accumulées dans le temple des Branchides. Mais on n'écouta point Hécatée, quelque sage que fût son avis, et l'on résolut de s'insurger néanmoins. Aristagoras, qui sentait bien la faiblesse de l'Ionie, se rendit à Sparte, pour obtenir son alliance. Dans sa conférence avec le roi Cléomène, Aristagoras, pour lui faire mieux comprendre ses projets, lui montrait les pays dont il lui parlait : Lydie, Phrygie, Cappadoce, Perse, etc., tracés sur une table d'airain qu'il avait apportée avec lui. C'était alors une chose fort nouvelle qu'une carte de géographie, et il paraît que c'était Anaximandre qui en était l'ingénieux inventeur. Cléomène ne lit qu'une question à son interlocuteur : « Quelle distance y a t-il de la mer d'Ionie au lieu qu'habite le Roi? - Trois mois de marche, » répondit assez naïvement Aristagoras, qui devait bien prévoir l'effet que cette réponse allait produire sur un Spartiate. Cléomène ordonna à l'étranger de quitter Lacédémone avant le coucher du soleil, et repoussa avec dédain des offres d'argent par lesquelles Aristagoras essayait de le séduire. Il y avait bien, en effet, la distance indiquée; et Hérodote énumère avec soin les cent onze stations royales de la grande et belle route que Darius avait fait construire, de Sardes à Suse, sur le Choaspe ou Karasou, fort loin encore à l'est de Babylone. C'était en tout 13,500 stades ou 450 parasanges, le parasange étant en moyenne de 30 stades ; en d'autres termes, c'était près de 600 de nos lieues. Pour affronter de telles entreprises et de tels obstacles, il fallait l'audacieux génie d'Alexandre, et deux cents ans de lutte de plus contre l'empire colossal des Perses. Cléomène n'était ni d'un caractère, ni d'un temps, à oser de telles choses. Aristagoras, repoussé de Sparte, se rendit à Athènes, qui devenait de jour en jour plus puissante, depuis qu'elle avait renversé la tyrannie des Pisistratides ; tout récemment, elle venait d'envoyer des ambassadeurs à Artapherne, satrape de Sardes, pour l'empêcher de soutenir les prétentions d'Hippias, réfugié auprès de lui. Aristagoras, qui n'avait pu persuader le seul Cléomène, réussit, comme le remarque assez ironiquement Hérodote, à persuader les trente mille citoyens d'Athènes, en leur rappelant que jadis Milet avait été une colonie de leurs ancêtres. Il fut décidé qu'on enverrait vingt vaisseaux au secours de l'Ionie. Ce fut là, comme le dit aussi l'historien, le commencement de la guerre où la république devait se couvrir de gloire en sauvant la Grèce, et où l'empire des Perses devait recevoir de rudes échecs, précurseurs d'une ruine complète assez prochaine. En même temps, Aristagoras fit insurger les Péons, qui, des bords du Strymon, avaient été transportés en Phrygie par les ordres de Darius; s'échappant malgré la poursuite des Perses, ils passèrent du continent à Chios, de Chios à Lesbos, et de Lesbos à Doriscus, d'où ils retournèrent dans leur ancien pays. Les vingt vaisseaux d'Athènes, rejoints par cinq vaisseaux d'Érétrie, arrivèrent à Éphèse; là, ils trouvèrent les frères d'Aristagoras amenant les troupes de Milet. Aristagoras était resté lui-même dans la ville pour tout organiser. On laissa la flotte à Coressus, sur le territoire d'Éphèse, et l'on s'avança vers Sardes, en suivant les bords du Caïstre et en traversant le Tmolus. La ville fut prise presque sans coup férir et incendiée facilement, la plupart des maisons étant couvertes en roseaux. Artapherne n'eut que le temps de se retirer dans la citadelle avec toutes ses troupes. Les Perses et les Lydiens, d'abord épouvantés par les flammes, reprirent courage et firent tête aux assaillants, qui furent bientôt obligés de se retirer et de regagner la côte. Les Perses, qui stationnaient sur l'Halys, accoururent promptement ; et ne trouvant plus les Ioniens à Sardes, ils les allèrent chercher jusqu'à Éphèse, où ils les défirent dans une grande bataille. Les Athéniens, très découragés par cet échec, se retirèrent malgré toutes les instances d'Aristagoras; mais, lui, ne se découragea pas ; et réduit à ses seules forces, il s'assura tout à la fois l'assistance des villes de l'Hellespont, de la Carie et de la grande île de Chypre, où le tyran de Salamine, Onésilus, s'était, de son côté, soulevé contre les Perses. Darius, en apprenant ce qu'avaient fait les Athéniens et la part qu'ils avaient prise à l'incendie de Sardes, jura de se venger sur eux de cette humiliation. Afin de préparer la guerre, il envoya d'abord Histiée pour ramener l'Ionie à l'obéissance par ses intrigues. Les affaires Ioniennes n'allaient pas bien d'ailleurs; Chypre venait d'être soumise après une vive résistance; la Carie, qui s'était révoltée, avait été réduite; Clazomène venait d'être reprise par Artapherne et Otanès; Cymé d'Aeolide avait également succombé. Aristagoras, trop faible pour supporter tant de revers, s'était retiré à Myrcine, l'ancien domaine de son beau-père Histiée. Hécatée de Milet voulait qu'on allât seulement à l'île de Léros, où l'on pouvait aisément s'abriter, pour revenir à Milet au moment favorable. Aristagoras, parti pour la Thrace, s'y fit tuer obscurément devant une citadelle; et son armée fut détruite. Le sort d'Histiée ne valut pas beaucoup mieux. Suspect à Artapherne, qui avait surpris ses intrigues, il se sauva non sans peine de Sardes, et gagna l'île de Chios. Repoussé d'abord comme un agent des Perses, il gagna la confiance des Chiotes en leur révélant tout ce qu'il avait fait pour l'insurrection de l'Ionie. Ramené par eux à Milet, il n'y trouva pas le même accueil, parce que le peuple, redevenu libre, craignait de nouveau sa tyrannie. Chassé de sa patrie, il obtint des Lesbiens quelques navires, avec lesquels il alla faire la course aux environs de Byzance, pillant tous ceux qui ne voulaient pas se réunir à lui. Cependant l'orage, préparé par la révolte d'Aristagoras, allait fondre sur l'Ionie, qui ne recula pas devant cet effroyable danger. Le Panionium, assemblé, résolut de faire la guerre. II n'y avait pas à penser à la soutenir sur le continent ; on n'y forma donc pas d'armée, et Milet dut songer à défendre à elle toute seule ses murailles menacées. Mais on organisa une flotte considérable, qui devait se réunir à Ladé, petite île en face de Milet. On s'y rendit en effet de toutes parts. Les Éoliens même de Lesbos y envoyèrent un contingent de soixante-dix vaisseaux. Les Milésiens, avec quatre-vingts, étaient placés à l'aile droite, vers l'Orient. Les Priéniens en avaient douze ; les Myontins, trois ; les Téïens, dix-sept ; les Chiotes, cent ; les Érythréens, huit; les Phocéens, trois seulement, comme les Myontins; enfin, les Samiens, placés à l'extrême gauche, à l'occident, avaient soixante-dix navires. Cette flotte était nombreuse; et elle aurait pu résister aux Phéniciens, aux Cypriotes, aux Ciliciens et aux Égyptiens, alliés des Perses. Mais la discorde se glissa parmi les Ioniens ; et le jour de la bataille, irrités les uns contre les autres, on se soutint mal. Les Samiens et les Lesbiens désertèrent les premiers ; les Chiotes furent à peu près les seuls qui firent bien leur devoir; mais ils étaient trop faibles. La défaite fut complète. Le chef courageux des Phocéens, Denys, dont l'énergie aurait pu sauver tout, si on l'eût écouté, n'eut d'autre parti à prendre que de s'enfuir sur les côtes de la Phénicie, et de là en Sicile, où il fit la course contre les Carthaginois et les Tyrrhènes. Après la défaite de Ladé, Milet, assiégée par terre et par mer, résista vaillamment; mais elle fut prise d'assaut après un siège meurtrier; les guerriers furent massacrés ; les femmes et les enfants furent emmenés en esclavage et conduits, par ordre de Darius, près de l'embouchure du Tigre, tandis que les Perses occupaient la ville, avec la plaine où elle est située, et donnaient le reste du territoire, avec la montagne, aux Pédasiens de Carie. Athènes, qui avait abandonné Milet, fut profondément affligée de ses malheurs, avertissement de malheurs plus grands encore ; et un poète dramatique, Phrynichus, ayant osé mettre sur la scène ce lugubre épisode, tous les spectateurs fondirent en larmes ; le poète fut condamné à une amende de mille drachmes, et sa pièce fut sévèrement défendue. Quant aux Samiens, prévoyant le destin qui les menaçait, ils le prévinrent en émigrant à Calacté, où les appelaient, en Sicile, les habitants de Zancle. Æacès, fils de Syloson, leur ancien tyran, expulsé par Aristagoras, revenait avec les Perses; et les Samiens, plutôt que de le subir, préférèrent changer de patrie. Ce furent, du reste, les seuls Ioniens qui adoptèrent ce parti ; ils ne furent suivis que par ceux des Milésiens qui avaient pu échapper au massacre. Aeacès rentra, en effet, à Samos, sous la protection des Perses, qui s'abstinrent de brûler les temples de cette seule ville, pour récompenser, disaient-il, la conduite des navires Samiens à Ladé. Histiée, avait fait une nouvelle tentative à la tête de quelques Ioniens et Éoliens qui étaient venus se joindre à lui ; il fut surpris près d'Atarné en Mysie. Emmené vivant à Sardes, Artapherne le fit mourir sur la croix, et il envoya sa tête, déposée dans du sel, à Darius, qui était à Suse. La flotte perse, après avoir hiverné à Milet, avait soumis toutes les îles, Chios, Lesbos, Ténédos, etc., tandis que, sur la terre ferme, on achevait de soumettre toutes les cités grecques. La victoire des barbares avait des conséquences épouvantables; et, ainsi que les Perses l'avaient annoncé six ans auparavant, lorsqu'avait commencé l'insurrection d'Aristagoras, les hommes étaient égorgés; les enfants les mieux faits étaient châtrés; les jeunes filles les plus belles étaient conduites à Suse ; les villes étaient brûlées, avec les temples qu'elles renfermaient, pour venger l'incendie du temple de la divinité nationale de Sardes, la déesse Cybèle. En attendant, Artapherne, lieutenant de son frère, intervenait pour arranger à l'amiable les différends des Ioniens entr'eux ; et il leur imposait des tributs, dont la quotité n'avait pas changé au temps d'Hérodote, c'est-à-dire soixante ans plus tard. Mardonius, gendre de Darius, mis à la tête d'une grande armée de terre et de mer, rétablissait partout en Ionie le gouvernement populaire, tout en se dirigeant vers l'Europe, pour châtier Athènes et Érétrie, qui avaient secondé l'insurrection des colonies de l'Asie mineure. Érétrie, livrée par des traîtres, avait été bientôt vaincue par Datis; les temples incendiés ; et les hommes, chargés de chaînes, emmenés en esclavage près de Suse. Athènes, menacée quelques jours après Érétrie, affronte héroïquement, et presque seule avec les Platéens, les barbares à Marathon. Marathon! Je m'arrête, parce que je n'ai point à raconter les merveilles de tant de courage et de patriotisme. Que dis-je, de patriotisme I Athènes, qui devait éclairer le monde par son intelligence, le sauva alors par son imperturbable énergie. Si les Perses avaient triomphé, que devenait la civilisation occidentale? Que devenaient les destinées de l'Europe? Dieu seul le sait; mais Athènes mérite une éternelle reconnaissance. Marathon rendit possible les Thermopyles, Artémisium, Salamine, Platée, et Mycale, en face de Samos. La première condition pour vaincre les barbares était de ne pas les craindre. Voilà l'admirable exemple qu'avait donné l'Ionie, et qu'Athènes donnait à son tour, en présence d'un péril bien plus effrayant. Il y a vingt-deux siècles que la ville de Minerve nous a rachetés de la servitude asiatique. Nous qui connaissons aujourd'hui l'Asie en la civilisant, nous pouvons voir, mieux que les Grecs de Miltiade et de Thémistocle, de quel abîme ils nous ont tirés. Nous pouvons en jurer, comme Démosthène, par les héros morts à Marathon. Mais c'est dans Hérodote qu'il faut lire ce grand et simple récit. Hérodote écrit à moins de trente ans de distance; à Olympie, il parle à des hommes qui avaient pris part à la victoire, et aux événements dont lui-même aurait presque pu être un témoin oculaire. Je ne veux pas répéter le noble historien de tant de gloire ; mais j'ai encore à dire quelques mots sur l'Ionie, pour conduire les choses jusqu'à l'époque où Mélissus, le dernier de nos philosophes professait, à Samos, les doctrines de l'école d'Elée. Les Ioniens vaincus avaient été forcés de servir leurs maîtres et de les suivre contre la Grèce. A Salamine, deux amiraux Samiens, Théomestor, fils d'Androdamas, et Phylacus, fils d'Histiée, s'étaient distingués en combattant vaillamment contre les vaisseaux de Lacédémone, tandis que les Phéniciens combattaient ceux d'Athènes. Mais tout en formant une grande partie de la flotte de Darius et de Xerxès, les Grecs de l'Asie mineure n'attendaient qu'une occasion favorable pour se soulever. Après la défaite de Salamine, la flotte des Perses vint hiverner à Cymé et à Samos, après avoir reconduit le roi vaincu et son escorte; mais lorsque l'année suivante la flotte grecque, sous le commandement de Léotychidès, roi de Sparte, vint chercher les Perses dans les eaux de l'Asie mineure, toutes les cités de la côte et des îles étaient prêtes à lui donner la main et à se révolter. Samos en particulier brûlait de renverser Théomestor, que les barbares lui avaient imposé pour tyran. Elle avait envoyé des émissaires auprès de Léotychidès, soit à Sparte soit à Délos, pour l'assurer de ses dispositions ; et ce furent probablement ces ouvertures qui donnèrent au chef des Grecs l'assurance de venir attaquer les Perses à leur station. Mais les barbares, depuis la terrible leçon de Salamine, n'osaient plus affronter de bataille sur mer. La flotte phénicienne avait eu la permission de se retirer; et les Perses, qui n'avaient plus guère que des Ioniens et des Grecs de la côte avec eux, avaient changé leur station, de Samos à Mycale. Là, ils avaient tiré leurs navires à terre et les avaient entourés d'une forte palissade, et même d'une muraille qui pouvait servir de camp. A leur portée, était rassemblée une armée de soixante mille hommes sous le commandement de Tigrane, que Xerxès avait laissée pour maintenir l'Ionie. Dans cette position, les Perses se croyaient inexpugnables. Pour plus de sûreté, ils avaient désarmé les Samiens, qu'ils soupçonnaient avec raison d'avoir des intelligences avec Léotychidès, et qui avaient racheté tout récemment des prisonniers d'Athènes pour les renvoyer dans leur pays. De plus, les Perses avaient chargé les Milésiens de garder les routes qui menaient aux sommets de Mycale. Restés seuls dans leur camp, ils ne doutaient pas de pouvoir s'y défendre victorieusement. Ils y furent au contraire écrasés par la valeur des Athéniens et des Corinthiens, et par la défection des gens de Samos et de Milet. L'armée fut détruite, et Tigrane tué; la flotte fut brûlée; et les vainqueurs se retirèrent, après cet exploit, chargés d'un immense butin. Après Mycale, l'Ionie était délivrée. Mais pourrait-elle se suffire à elle-même et se défendre contre la fureur des barbares, quand elle serait abandonnée à ses seules ressources? Il était bien douteux qu'elle fût de force à résister. Les généraux, rassemblés à Samos, délibérèrent pour savoir si les Ioniens ne devaient pas quitter pour toujours les côtes de l'Asie mineure, et se réfugier dans quelque partie de la Grèce qu'on leur assignerait. Les Athéniens s'opposèrent vivement à cette résolution, quoiqu'on eût pu indemniser très facilement les Ioniens, aux dépens des traîtres qui, dans l'invasion médique, avaient déserté la cause commune. Les Péloponnésiens cédèrent sans trop de peine à cet avis ; et l'on se borna à faire un traité d'alliance avec les Samiens, les Chiotes, les Lesbiens et tous ceux qui avaient aidé à la victoire. L'armée Perse s'était sauvée à Sardes, où Xerxès était resté depuis son retour humiliant, et qu'il quitta bientôt pour aller cacher à Suse sa honte et ses fureurs. La flotte Grecque, maîtresse de toute la mer Égée, et n'y redoutant plus d'ennemis, était revenue vers le Péloponnèse, en longeant toutes les côtes, et en rapportant d'Abydos quelques débris du fameux pont de Xerxès, qu'on voulait consacrer dans les temples, en souvenir du triomphe. A l'abri désormais des entreprises de la Perse, l'Ionie s'empressa de réparer ses ruines, et se mit aussi étroitement qu'elle le put sous la protection d'Athènes, à qui la rattachaient tous les souvenirs du passé, et tous les intérêts du présent. Aussi l'Ionie, dès cette époque, prit-elle parti pour les Athéniens contre Sparte, dont les deux rois, Léotychidès et Pausanias, n'inspiraient qu'une médiocre confiance dans leurs rapports avec les barbares. Athènes, très puissante sur mer, pouvait apporter dans toutes les occasions un secours rapide et efficace, que Sparte, si même elle l'eût voulu, n'aurait pas pu garantir. Par toutes ces raisons, les Ioniens prirent une part très active à la confédération de Délos, qui les regardait plus que personne, et ils contribuèrent largement au fonds commun que firent les alliés pour se défendre contre le retour offensif des barbares (16). On était au lendemain de Platée et de Mycale, c'est-à-dire dans toute la ferveur de l'indépendance recouvrée et de la confiance réciproque. (vers 477 av. J.-C.) Mais Athènes devait abuser de l'hégémonie qui lui était spontanément dévolue; et elle amassait dès lors contre elles ces jalousies et ces haines qui amenèrent plus tard la guerre fratricide du Péloponnèse, à un moment où l'ennemi commun n'était pas encore détruit. La domination athénienne, comme le remarque Aristote, se faisait sentir lourdement à ses alliés, qui devaient être ses égaux et non ses sujets ; elle fut d'une sévérité inique envers les habitants de Naxos et de Thasos (467-465), qui n'avaient pas été assez dociles à ses ordres hautains. Mais la flotte athénienne, forte de 200 voiles, croisait sans cesse sur les côtes de l'Asie, et maintenait en respect celle des Phéniciens et des Perses, qu'elle poursuivait jusque dans les eaux du Nil. C'était là un service essentiel rendu à l'Ionie ; et l'Ionie, de son côté tolérait de sa grande alliée bien des vexations, en retour de la protection constante qu'elle en recevait. Sa reconnaissance dut être au comble, quand elle vit son indépendance garantie par un traité qu'Athènes arracha au Grand-Roi, après quelques victoires qui vinrent réparer une défaite en Égypte (455 av. J-C.) Ce traité, préparé par l'habileté et les exploits de Cimon en Chypre, stipulait que la Perse laisserait toutes les côtes de l'Asie mineure occupées par des Grecs parfaitement libres, sans les soumettre au tribut et sans faire approcher ses armées à une certaine distance de la côte. En retour, les Athéniens et leurs alliés n'attaqueraient plus Chypre, la Cilicie, la Phénicie ni l'Égypte. Les Grecs envoyèrent des ambassadeurs à Suse, où la convention fut ratifiée régulièrement, Callias représentant les Athéniens (17). (vers 449 av. J.-C. )
La république d'Athènes fut alors à l'apogée de sa puissance. A la tète d'une
confédération maritime dont elle disposait à peu près à son gré, soutenue par
une foule d'alliances sur le continent, maîtresse de nombreuses possessions sur
toutes les côtes de la mer Égée, de l'Hellespont et des mers de la Grèce,
dirigée par un homme tel que Périclès, elle pouvait aspirer à la domination
absolue de toute la race grecque. Ce fut cette ambition qui l'aveugla et la
perdit. Parmi ses alliés, Samos était le plus puissant ; et cette grande île
avait conservé vis-à-vis d'Athènes une sorte d'égalité qui ne convenait guère
aux projets dominateurs de la République. Une querelle de peu de gravité,
survenue entre Samos et Milet, pour le petit territoire de Priène, amena
l'intervention athénienne. Les deux partis furent invités à soumettre leurs
différends à l'arbitrage de la République. Samos, qui craignait sans doute la
partialité de Périclès pour Milet, patrie d'Aspasie, refusa d'accepter ce
tribunal suspect. Athènes envoya sur-le-champ quarante vaisseaux pour
contraindre Samos à l'obéissance. Le gouvernement oligarchique fut changé au
profit de la démocratie; et cinquante des principaux citoyens, avec un même
nombre d'enfants des meilleures familles, furent pris pour otages et déposés
dans Ille de Lemnos. Une garnison fut laissée à Samos pour assurer le changement
qui venait d'avoir lieu. (vers 439 avant notre ère.)
Aussi, Athènes se promit-elle bien de châtier rudement Samos, et d'empêcher par
un exemple terrible que personne fût tenté de l'imiter. Soixante vaisseaux
furent expédiés sur-le-champ contre les rebelles ; seize furent détachés, soit
pour aller observer la flotte phénicienne sur les côtes de l'Asie, Pissouthnès
ne devant pas manquer de la mettre à la disposition des insurgés, soit pour
aller demander des secours à Chios et à Lesbos, qui demeuraient dans le devoir,
mais qui pouvaient aussi s'en écarter. Les quarante-quatre vaisseaux restés
devant Samos étaient sous la conduite de Périclès, un des dix généraux annuels,
parmi lesquels on comptait le poète Sophocle, qui venait de donner, l'année
précédente, son Antigone. Les Samiens, bien qu'ils attendissent l'attaque,
étaient allés assiéger Milet ; et ils en revenaient quand ils furent rencontrés,
près de l'île Tragie, par Périclès. Quoi qu'ils eussent soixante et dix
vaisseaux, dont vingt montés par des hommes de guerre, Périclès n'hésita pas à
leur offrir la bataille. Il remporta la victoire; et les pertes qu'il avait pu
faire furent réparées aussitôt par quarante navires venus d'Athènes, et
vingt-cinq que Lesbos et Chios avaient loyalement fournis. A bout de ressources, les Samiens se rendirent enfin. Périclès rasa leurs murailles, se fit livrer les vaisseaux, et exigea le paiement des frais de la guerre, qui se montaient, dit-on, à 1,000 talents ou 5 millions 500,000 francs de notre monnaie. Samos acquitta immédiatement une partie de cette somme alors immense, et prit pour le reste des engagements garantis par des otages. On ajoute même que Périclès se montra d'une inhumanité révoltante envers un certain nombre de prisonniers, qu'il fit mourir sous le bâton après dix jours de torture. Mais c'est un historien postérieur, Duris de Samos, qui raconte ces atrocités, assez longtemps après, sous le règne de Ptolémée Philadelphe, sans doute par une rancune patriotique. Plutarque réfute ce récit, dont il ne trouve aucune trace ni dans Thucydide, ni dans Aristote, ni dans Éphore, qui lui ont surtout servi de guides pour la biographie de Périclès. Athènes parait avoir attaché la plus grande importance à cette réduction de la ville révoltée. L'exemple pouvait être contagieux ; c'en était fait des vastes desseins que la république nourrissait, si les Samiens trouvaient des imitateurs. Aussi, quand le vainqueur revint à Athènes, il y fut accueilli avec enthousiasme. On fit des funérailles magnifiques aux guerriers morts dans cette expédition, et ce fut Périclès à qui l'Aréopage confia le soin de l'oraison funèbre. Nous n'avons pas celle-là ; mais nous pouvons nous en faire une idée par celle que nous a conservée Thucydide, du moins pour le fonds des idées. Cette autre oraison célébrait les guerriers qui avaient succombé dans la première année de la guerre du Péloponnèse. C'était aussi des victimes tombées sous les discordes civiles qui déchiraient la Grèce. Il y avait donc assez de ressemblance. L'éloge des citoyens perdus devant Samos reçut le plus vif accueil. Quand Périclès descendit de la tribune, toutes les femmes, dans leur émotion reconnaissante, se précipitèrent vers lui pour l'embrasser, elle couronnèrent de fleurs et de bandelettes, comme un athlète revenu victorieux des jeux publics. Une seule femme dans la foule ne partagea pas cette admiration unanime. C'était Elpinice, la sœur de Cimon, qui avait été longtemps le rival de Périclès : « Vraiment, lui dit-elle, voilà des exploits bien glorieux et qui méritent certainement tant de couronnes! Nous avons perdu de braves citoyens, non en faisant la guerre aux Phéniciens ou aux Mèdes, comme la fit mon frère Cimon, mais en ruinant et détruisant de fond en comble une ville alliée, qui tirait de nous son origine. » La critique n'était que trop vraie; mais le triomphe enivrait les vainqueurs; le destin de Samos n'était qu'un prélude de celui qui attendait bien d'autres cités grecques, dans la grande guerre que prévoyait déjà Périclès. Lui aussi il paraissait touché de son succès plus qu'il ne convenait à la modération habituelle de son caractère. Si l'on en croit le poète Ion de Chios, il se vantait d'avoir surpassé le fameux Agamemnon, qui avait mis dix ans à prendre une ville étrangère, tandis qu'il n'avait mis que neuf mois à prendre la plus riche et la plus puissante des villes de l'Ionie. Le mot de Périclès, rapporté par un ami de Cimon son adversaire, n'est pas très probable; car dans la bouche d'un tel homme d'état il eût été bien imprudent. C'était à la fois une vanité personnelle d'assez mauvais goût, et un défi bien inutile contre les alliés. Mais ce reproche du poète, qu'il soit faux ou qu'il soit vrai, suffit à montrer quelle importance Athènes avait attachée à cette guerre, courte mais très sanglante. Au jugement d'un observateur bien compétent, Thucydide, les Samiens victorieux auraient pu arracher à Athènes l'empire de la mer; et dans cette lutte, quelque regrettable qu'elle fût, il n'y allait de rien moins que de l'existence des deux républiques. Samos soumise, malgré l'énergique résistance de Mélissus, Athènes n'avait plus rien à craindre de personne, si ce n'est d'elle-même, sorte de danger que les états ne sentent jamais, pas plus que ne le sent l'orgueil des simples individus. Je ne veux pas pousser plus loin ces considérations historiques ; mais il me semble qu'elles suffisent, toutes brèves qu'elles sont, pour nous faire entrevoir assez nettement le milieu réel où est née la philosophie, et où ont vécu et agi les vénérables personnages dont nous avions à nous occuper. Je résume les traits les plus saillants de ce tableau, par lequel j'ai tâché de ranimer, du moins en partie, la vie éteinte de ces temps solennels.
Oui, la philosophie a paru pour la première fois dans l'Asie mineure, six ou
sept siècles avant notre ère. Ce sont des colonies grecques, sorties jadis de
l'Ionie du Péloponnèse, qui ont allumé ce flambeau dans des contrées
demi-barbares, et qui l'ont transmis à Athènes, où tout était prêt pour le
recevoir. Anaxagore de Clazomènes a vécu avec Socrate; et Socrate est le père de
Platon, on pourrait dire aussi le père d'Aristote. Mais avant Aristote, avant
Platon, avant Socrate, le germe avait levé sur une autre terre ; et il a fallu
qu'il fût enfin transplanté dans l'Attique pour y porter tous ses fruits. Oui,
la philosophie a été précédée là, comme partout ailleurs, de la poésie ; Homère
a chanté quatre ou cinq cents ans avant que Pythagore ne pensât. La science,
sous toutes ses formes, astronomie, mathématiques, physique, histoire, médecine,
a suivi et secondé la philosophie, qui a donné l'impulsion à tous ces rameaux,
en en recevant elle-même de nouvelles forces. C'est au sein des dissensions
civiles, de la guerre étrangère, du commerce, de l'industrie, des navigations
lointaines, des combats et des périls de tous genres, c'est au sein des luttes
héroïques d'une poignée d'hommes intelligents et libres contre un empire
colossal, qu'il faut placer son humble et glorieux berceau. Pythagore et
Xénophane n'ont émigré sur les rivages de l'Italie et dans la Grande Grèce que
par horreur pour la tyrannie ou l'oppression. L'Italie, qui n'a été fécondée que
per ces maîtres venus de l'autre côté des mers, n'a pu se développer, parce que
la plante exotique n'avait pas trouvé en elle les aliments nécessaires à sa
maturité. La philosophie devait revenir au foyer antique d'où étaient sortis les
premiers émigrants, pour y rencontrer sa forme vraie, sa beauté, sa grandeur, et
son indépendance, qu'a scellée le martyre. Nous connaissons nos philosophes, et nous savons en partie les événements principaux de leur vie ; nous avons des fragments de leurs ouvrages, quand nous ne les possédons pas en entier; si Homère est le seul, avec Platon, qui nous soit parvenu à peu près dans son intégrité, les autres auraient pu nous parvenir, quoique moins beaux, si le hasard des choses n'eût fait périr les écrits dépositaires de leurs pensées. Les anciens ont donc écrit ! Qui peut en douter ? Mais alors se présente ce problème, que je touche ici pour Thalès, Pythagore, Xénophane, et leurs contemporains, mais qui est le même pour l'Antiquité tout entière, en remontant plus haut qu'eux et en descendant beaucoup plus bas : ces ouvrages que nous possédons aujourd'hui, dans des débris mutilés ou dans toute leur étendue, comment sont-ils sortis des mains de leurs auteurs ? Sur quelle matière ont-ils été d'abord déposés? Quels moyens d'écrire avait-on du temps de Xénophane, et même du temps de Lycurgue ou d'Homère? Et pour circonscrire la recherche dans des limites étroites et positives, comment écrivait-on dans les colonies Grecques de l'Asie mineure, pour les besoins d'un commerce très actif, d'une politique très compliquée et très énergique, d'une poésie ardente, d'une science curieuse, en un mot pour tous les besoins d'une vie sociale déjà très développée et très intense? Je crois qu'aujourd'hui nous sommes en mesure de répondre à cette question d'une manière parfaitement claire, et absolument décisive. Mais avant de donner le mot de cette énigme, je crois bon d'établir quelques faits incontestables pour démontrer que, sept siècles avant l'ère chrétienne, l'usage de l'écriture dans l'Asie mineure et même dans la Perse, à demi-sauvage, était presqu'aussi répandu et aussi facile qu'il peut l'être parmi nous. Les matériaux sont autres; mais ils valent à peu près ceux que nous avons encore, en dehors de la merveille de l'imprimerie. Les hommes de ces temps reculés n'ont pas le papier précisément comme les modernes; mais ils ont quelque chose qui le vaut, et qui ne leur rend pas moins de services. J'ouvre au hasard Hérodote, Thucydide, Xénophane, Platon, Aristote; et je prends les choses telles qu'ils les racontent, ou mieux telles qu'ils les voient et telles qu'ils les pratiquent. Harpagus est à la cour d'Astyage, le roi des Mèdes; et méditant une vengeance trop légitime contre un maître cruel, il veut s'entendre avec Cyrus, qui, malgré sa jeunesse, jouit déjà parmi les Perses d'une autorité d'où sortira tout à l'heure un vaste empire. Harpagus ne pouvant communiquer directement avec le jeune prince, qui a aussi bien des griefs à venger, lui fait porter par un serviteur affidé quelques produits de sa chasse; et dans le ventre d'un lièvre qu'il lui envoie, il coud et cache une lettre pour le pousser à la révolte et l'assurer de sa coopération. Que fait Cyrus? Comme il a ouvert le lièvre de sa propre main, ainsi que son complice le lui avait fait dire, et qu'il a lu la lettre hors de la présence de qui que ce soit, il fabrique une autre lettre, dans laquelle Astyage le nomme chef des Perses, alors soumis aux Mèdes. Cette lettre fausse est lue aux membres de la famille des Achéménides; elle les persuade, et Cyrus les mène à leur insu contre Astyage, qu'il renverse (18). Harpagus et Cyrus ne sont cependant que des barbares. Mais voici des gens plus cultivés dans l'Asie mineure et dans l'Égypte. Polycrate, tyran de Samos, est sur le trône ; sa prospérité est au comble ; et le monde, qui l'admire on le craint, adore tant d'habileté et tant de fortune. Le sage Amasis, roi d'Égypte, qui est entré en relation d'alliance et même d'amitié avec le tyran heureux et redoutable, est alarmé de succès si constants; et connaissant l'instabilité des choses humaines, il conseille au trop fortuné mortel de se tenir sur ses gardes contre les retours de la destinée. Il lui écrit donc une lettre bienveillante et prophétique, où il lui recommande de s'imposer à lui-même quelque sacrifice, pour désarmer, s'il le peut, cette implacable faveur d'un sort trop souvent trompeur et perfide. Polycrate, presqu'aussi inquiet que celui qui le conseille, fait réponse à son ami ; il lui raconte dans une lettre, qu'il lui envoie en Égypte, le moyen qu'il a pris pour s'infliger de son propre choix, une perte douloureuse, et le hasard extraordinaire qui a rendu son sacrifice inutile. Amasis et Polycrate échangent des lettres et correspondent de Samos à Memphis, aussi facilement que pourraient le faire de nos jours des négociants de Smyrne et d'Alexandrie (19).Je ne prétends pas que la lettre d'Amasis, telle que l'historien la rapporte, soit bien authentique ; mais il n'y a point à élever le moindre doute sur le fait même d'un commerce épistolaire entre les deux rois. Ainsi que je l'ai rappelé plus haut, ce même Polycrate passe pour avoir amassé une nombreuse bibliothèque, et avoir été un des premiers dans le monde Grec à se donner cette jouissance sérieuse, qui coûtait alors fort cher. On en dit autant de Pisistrate, un peu antérieur à Polycrate, et qui aurait rendu publique la bibliothèque qu'il avait fondée à Athènes, adoucissant le peuple par cette flatterie intelligente, comme par tant d'autres. Les témoignages qui nous attestent ces faits sont assez tardifs, puisque l'un est d'Athénée et l'autre d'Aulu-Gelle ; mais je ne vois pas de motif de les révoquer en doute. Par l'Égypte, Polycrate recevait un exemple qu'il était facile d'imiter, comme je le dirai plus loin; et il pouvait appliquer cet exemple aux auteurs qui charmaient, depuis Homère, toute cette population des côtes, si sensible aux plaisirs de la poésie et aux leçons de la science. Quant à Pisistrate, il est certain que, s'il n'a pas ouvert de bibliothèque au public, il avait du moins des livres, et qu'il s'en occupait personnellement avec une attention toute politique. Plutarque raconte, dans la vie de Thésée, que Pisistrate retrancha dans Hésiode un vers qui pouvait blesser la vanité nationale des Athéniens, et qu'il en ajouta un au contraire dans Homère pour leur faire plaisir. Ces retranchements, ces additions, comment était-il possible de les faire? Uniquement, parce qu'on avait des copies de ces poèmes, où l'on pouvait à son gré opérer des changements qu'on croyait utiles. Mais je reviens à l'usage des lettres missives dans l'époque que j'étudie. Le satrape de Sardes, Orcetès, qui avait si cruellement traité Polycrate, s'était rendu odieux par sa conduite féroce envers tout ce qui l'entourait. Un de ses collègues lui ayant reproché le piège tendu au tyran de Samos, il l'avait tué ainsi que son fils. Darius, nouvellement monté sur le trône, était fort irrité contre Oroetès, qui, outre tant de crimes, était coupable encore d'avoir hésité dans la lutte des Mages et des Perses, après la mort de Cambyse. C'était plus qu'il n'en fallait pour que le nouveau roi eût tout intérêt à se défaire du satrape puissant qui commandait à la Phrygie, à la Lydie et à l'Ionie tout entières, et qui avait autour de lui une nombreuse armée. L'attaquer à force ouverte pouvait être une imprudence grave dans les débuts d'un règne difficile. Cependant Oroetès avait fait mourir secrètement les envoyés de Darius, qui lui avaient porté l'ordre de se rendre auprès du roi. Tant d'insolence devait être châtié, et il fallait prévenir la révolte, qui semblait imminente. Darius convoque les plus grands personnages parmi les Perses, et il leur demande de le délivrer du rebelle, soit en le tuant soit en le lui amenant. Mais il ne faut recourir qu'à la ruse. Trente exécuteurs de la volonté royale s'offrent aussitôt, chacun d'eux proposant d'accomplir seul l'entreprise. Darius, ne voulant pas choisir entre tant de dévouements, fait tirer ses amis au sort; et c'est Ragée, fils d'Artoutès, qui est désigné. Que fait Ragée? Il écrit un grand nombre de dépêches, traitant de diverses affaires, et il les revêt du cachet de Darius. Arrivé à Sardes, il remet ces dépêches au secrétaire royal en présence d'Oroetès, chaque satrapie ayant auprès d'elle un représentant de l'autorité souveraine. Le cachet rompu, le secrétaire lit ces dépêches aux principaux officiers qui entouraient Orcetès, et à qui elles s'adressaient plus particulièrement. Tous ils reçoivent les ordres du maître, avec la plus profonde soumission et les marques ordinaires d'un respect sans bornes. Ragée, satisfait de cette première épreuve, et voyant qu'il pouvait compter sur leur obéissance, leur fait communiquer secrètement d'autres dépêches où Darius leur ordonne de ne plus servir Orcetès. Les officiers obéissent encore, et déposent leurs lances pour témoigner qu'ils quittent le satrape. Enfin Ragée, assuré qu'il peut tout sur eux, leur fait lire par le secrétaire royal ses dernières dépêches, où le roi leur prescrit de tuer le coupable. Aussitôt les officiers dociles attaquent leur chef et le font tomber sous le coup de leurs cimeterres. Darius et Polycrate étaient vengés (20). Ainsi les Perses eux-mêmes, du temps de Darius, font usage des lettres aussi aisément que les Grecs plus policés et plus instruits qu'eux. Le Grand roi envoie ses ordres officiels dans toutes les parties de son vaste empire, et ses ordres sont écrits avec les mêmes formes et sur les mêmes matières qu'ils pourraient l'être encore aujourd'hui dans ces contrées peu civilisées. Lorsque Pausanias, suspect aux Grecs et détesté des alliés, prend la résolution de trahir la noble cause qu'il avait tant servie à Platée, il entre en correspondance avec Xerxès, et dans la lettre qu'il lui fait tenir, il lui offre de lui soumettre Sparte et le reste de Grèce. Xerxès accepte les ouvertures du traître ; et lui écrivant de sa propre main, il lui fait remettre la lettre par Artabaze, satrape de Dascylitis. Les Éphores, soupçonnant l'infamie de leur roi, lui écrivent et le somment de revenir de la Troade à Sparte, pour y rendre compte de sa conduite. Pausanias, qui n'ose encore désobéir, se rend à l'injonction; et il n'en continue pas moins la correspondance criminelle. Mais l'homme qu'il a chargé d'une nouvelle lettre, craint pour sa propre sûreté, parce qu'il sait qu'aucun de ceux qui ont été chargés de ces messages avant lui n'est revenu de sa mission. Il ouvre les lettres qu'il porte, après avoir contrefait le cachet pour les refermer, s'il se trompe dans sa défiance ; et il y trouve la recommandation de le mettre à mort. Aussitôt il porte les lettres aux Éphores, et dénonce le roi qui livrait la Grèce aux barbares. L'histoire de Thémistocle est à peu près celle de Pausanias. Un peu moins coupable, puisque les Athéniens l'avaient provoqué en le frappant d'un ostracisme inique, il entre en correspondance avec Artaxerxés ; et fuyant d'Argos à Corcyre, de Corcyre chez Admète roi des Molosses, et chez Alexandre roi de Macédoine, il vient enfin aborder à Éphèse, d'où il écrit au Grand roi, pour lui demander un asile que la Grèce lui refuse. Thucydide rapporte la lettre que Thémistocle écrivit à Artaxerxés, et il n'y a pas lieu d'en suspecter l'authenticité (21). Il est inutile de multiplier les exemples; on pourrait en trouver beaucoup dans les auteurs, outre ceux que je viens d'indiquer. Mais il ne parait pas nécessaire d'aller plus loin; il est démontré que tout le monde, en Grèce et dans l'Asie mineure, emploie des lettres pour les affaires publiques et les affaires privées, à peu près comme nous le faisons de nos jours, et avec des moyens très analogues : matières qu'on se procure sans peine, qu'on peut sceller comme nous scellons les matières dont nous nous servons ; timbres officiels, cachets qu'on peut contrefaire sans les rompre, etc. Quelles étaient ces matières ? Un passage formel d'Hérodote nous l'apprend nettement. Le grand historien des temps primitifs du monde grec, rappelant comment Cadmus a jadis apporté l'alphabet de Phénicie, sur le continent et parmi les Ioniens, ajoute: « Les Ioniens donnent, de toute antiquité, aux livres le nom de Diphthères, ou de peaux, parce que, dans ces temps là, comme on n'avait pas de livres, on se servait de peaux de chèvre ou de mouton. Même encore de nos jours, il y a bien des barbares qui écrivent sur des Diphthères ou peaux de cette espèce (22). » Autre détail non moins curieux. Hérodote atteste avoir vu lui-même à Thèbes de Béotie, dans le temple d'Apollon Isménien, trois trépieds portant des inscriptions, en caractères dont on se servait en Ionie. Ces inscriptions remontaient à Laïus, père d'Oedi pe, quatre générations après Cadmus. Le mot dont se sert Hérodote pour exprimer des Livres, est celui de Biblos; et l'on sait de la façon la plus précise ce que ce mot signifie : c'est une certaine partie du papyrus d'Égypte. Théophraste ne peut laisser à cet égard le moindre doute. Dans son Histoire des Plantes (23), il décrit les végétaux paludéens, et il s'arrête assez longuement au Papyrus, qui croit dans les eaux du Nil. Il indique les nombreux et importants usages auxquels le Papyrus peut servir; et après avoir dit qu'on fait des bateaux avec le bois : « Avec la Biblos, dit-il, on fabrique des a voiles, des nattes, parfois des vêtements, des sandales, des tables et une foule de choses, entre autres les livres (Biblia), si connus des étrangers. » La Biblos de Théophraste est donc cette partie de la tige du Papyrus qui, par sa flexibilité et sa résistance, peut se prêter aux divers emplois où le tissage et la torsion soumettaient cette matière à des épreuves assez fortes. Sans parler des bibliothèques de Pisistrate et de Polycrate, il est constaté, par une foule de détails donnés par Platon, que, de son temps, les livres, au sens où nous comprenons ce mot, sont déjà fort répandus dans Athènes. Socrate raconte lui-même, dans le Phédon, qu'il a entendu quelqu'un lire un jour l'ouvrage d'Anaxagore, où il est avancé que l'Intelligence est la règle et le principe de toutes choses. Socrate, frappé de cette grande pensée et espérant trouver dans Anaxagore la solution de bien des problèmes, après ce noble début, se procure avec empressement ces livres, où il croit acquérir la science du bien et du mal ; il les lit avec avidité ; mais à mesure qu'il avance dans cette lecture, il se désenchante, et il met le livre de côté pour revenir à ses propres réflexions. Socrate a des livres, les consulte, et les quitte, absolument comme pourrait le faire parmi nous quelque amant de la science et de la sagesse, consultant les trésors de nos bibliothèques, et ne les trouvant pas toujours aussi féconds qu'il s'y attend. Au début du Parménide, Antiphon raconte, d'après le récit de Pythodore, un des amis de Zénon d'Élée, que, quand Parménide déjà vieux vint à Athènes, avec son disciple, il alla demeurer au Céramique hors des murs. Socrate s'y transporta, suivi de beaucoup d'autres personnes, pour y entendre lire les écrits de Zénon. C'était la première fois que Zénon et Parménide les avaient apportés avec eux à Athènes. Socrate était alors fort jeune. C'est Zénon qui faisait lui-même la lecture de son livre, Parménide étant absent à ce moment là. Il était déjà près d'achever, quand Pythodore survint accompagné de Parménide, qui rentrait, et d'un autre auditeur, Aristote, qui fut plus tard un des Trente. Pythodore n'entendit donc que fort peu de chose de ce qui restait encore à lire; mais il assista à la fin de la lecture, qu'il avait d'ailleurs entendue dans une autre séance. Socrate, ayant écouté jusqu'à la fin, invite Zénon à vouloir bien relire la première proposition du premier livre. Zénon s'y prête avec complaisance. Il reprend le livre, et relit la phrase qui avait arrêté Socrate, et dont Socrate veut avoir les expressions bien présentes pour engager la discussion sur les Idées : « Si les êtres sont multiples, disait Zénon, il faut qu'ils soient à la fois semblables et dissemblables entr'eux. Or cela est impossible ; car ce qui est dissemblable ne peut être semblable; et ce qui est semblable ne peut davantage être dissemblable. » La controverse commence alors; et Socrate, répétant la phrase de Zénon, lui demande si c'est bien ce qu'il a voulu dire; Zénon affirme que c'est bien là le but de son livre. Socrate se tournant alors vers Parménide : «Je vois clairement, lui dit-il, que Zénon s'attache à toi non seulement par les liens ordinaires de l'amitié, mais encore par ses écrits. Au fond, vous dites tous deux la même chose quoiqu'en termes différents, l'un soutenant que tout est un, et l'autre soutenant qu'il n'y a pas de pluralité. » Zénon avoue que Socrate a raison, et qu'il n'a écrit son livre que pour venir à l'appui du système de Parménide contre ceux qui voudraient le tourner en ridicule ; que son ouvrage répond aux partisans de la pluralité, et qu'il a pour objet de leur démontrer que leur système mène à des conséquences encore plus absurdes que le système opposé. Puis Zénon ajoute : « Entraîné par l'esprit de dispute, j'avais composé cet ouvrage dans ma jeunesse ; et on me le déroba avant que je me fusse demandé s'il fallait ou non le mettre au jour. Ainsi, Socrate, tu te trompais en croyant cet écrit inspiré par l'ambition d'un homme mûr, au lieu de l'attribuer au goût batailleur d'un jeune homme. » L'entretien se poursuit sur l'unité et la pluralité, avec les péripéties et les détours que l'on connaît, et que je ne suivrai pas. Mais ces détails nous prouvent que Zénon et Parménide, venus d'Élée, à l'Occident de la Grande-Grèce, ont dans leur pays des livres comme on en a dans Athènes, et que les interlocuteurs se servent de ces livres tout aussi commodément que nous le faisons des nôtres. On lit ces livres ; on les relit ; on en reprend quelques phrases, qu'on se fait répéter pour plus de certitude. Nous ne feuilletons pas autrement nos in-8° et nos in-12, qui ne sont pas plus maniables. Dans le gracieux préambule du Phèdre, Socrate rencontre le jeune homme, qui va se promener dans la campagne, après être resté assis toute la matinée. A quoi donc Phèdre a-t-il consacré son temps? Il a écouté avec enthousiasme un morceau admirable que lui a lu Lysias, fils de Céphale ; et il est encore tout plein de l'ardeur que cette lecture lui a causée. Lysias était venu tout exprès, pour la lui faire, du Pirée à Munychie. Socrate prie son jeune compagnon de lui analyser ce merveilleux discours; Phèdre s'en défend, comme trop peu digne de répéter de si belles choses. Mais Socrate, qui connaît la passion de son délicat ami, lui affirme qu'il doit savoir par cœur la pièce tout entière, qu'il a dû se la faire relire plusieurs fois par l'auteur, qu'il ne s'est même pas contenté de si peu et qu'il a dû prendre le cahier pour le relire à son loisir ; qu'aussi bien c'est là la grave occupation qui l'a retenu toute la matinée et l'a empêché de sortir plus tôt. Phèdre se justifie, mais assez faiblement; et sur les instances de Socrate, il montre en effet le manuscrit qu'il tient de la main gauche, caché sous sa robe. Les deux interlocuteurs cherchent donc sur les bords de l'llissus, où Socrate se baigne les pieds afin de se rafraîchir en marchant, un endroit favorable pour lire tout à leur aise. Ils découvrent bientôt un lieu charmant de repos, sous un platane large et élevé, près d'un agnus-castus, dont les fleurs embaument l'air, au doux murmure d'une source limpide, parmi des statues et des figurines consacrées aux nymphes et au fleuve Achéloüs. Phèdre et Socrate s'asseyent à l'ombre, sur le frais gazon ; et le jeune homme lit le discours de Lysias, dans le manuscrit qu'il tient entre ses mains. Socrate, tout en louant aussi le talent de Lysias, n'en fait pas autant de cas que son jeune ami; et il lui rappelle que, dans les temps passés, bien des sages ont écrit sur le même sujet, et au moins aussi bien, ne serait-ce que la belle Sapho, ou le docte Anacréon, ou même quelque prosateur. Phèdre n'en croit rien, et il somme Socrate de faire lui même mieux que Lysias, sous peine de ne lui rien lire désormais, s'il ne s'exécute pas sur-le-champ. Socrate essaie donc une concurrence qui ne lui semble pas impossible; et il refait le discours de Lysias, en se jouant sur le même thème, tout bizarre et paradoxal qu'il est. Mais il faut s'élever plus haut que cette lutte puérile sur un sujet rebattu; et Socrate saisit cette occasion pour donner au jeune homme une leçon de rhétorique et de goût. Lysias écrit beaucoup trop, il faut apprendre à juger ses œuvres pour ne pas leur attribuer plus de prix qu'elles n'en ont. Les hommes d'état, bien avisés, se gardent de composer des ouvrages et de laisser des écrits, qu'une postérité sévère pourrait critiquer. Si par hasard ils écrivent quelque chose, ils appliquent tous leurs soins à composer des écrits irréprochables. Mais Périclès, le plus parfait des orateurs et l'élève du grand Anaxagore, n'a rien laissé par écrit. Socrate, en traçant les règles de la vraie rhétorique, arrive à l'invention de l'écriture et des livres. D'après une tradition conservée à Naucratis, ville du Delta, et qu'avait peut-être recueillie Solon, l'écriture avait été inventée par le dieu Teuth ; celui-ci l'avait communiquée au roi Thamus, qui régnait à Thèbes. Thamus n'admire pas cette découverte autant que celui qui en est le père, et il craint que l'écriture, loin de rendre les Égyptiens plus sages, ne leur nuise, en leur faisant croire qu'ils savent ce qu'ils auront lu superficiellement dans leurs livres. « C'est être d'une grande simplicité, dit Socrate, soutenant l'avis de Thamus, que de s'imaginer qu'on puisse déposer un art quelconque dans des livres, qu'on puisse l'y apprendre, comme s'il sortait jamais des livres quelque chose de clair et de solide, si ce n'est de raviver la mémoire de celui qui sait déjà ce qu'ils contiennent. Les produits de l'écriture sont comme ceux de la peinture. Interrogez des tableaux; ils vous répondront par un majestueux silence. Interrogez des livres ; ils vous feront toujours la même réponse. Vous croiriez à les entendre qu'ils sont bien savants. Mais une fois écrit, un discours roule de tous côtés, dans les mains de ceux qui le comprennent comme de ceux pour qui il n'est point fait. II ne sait même pas à qui il doit parler, avec qui il doit se taire. Méprisé ou attaqué injustement, il a toujours besoin que son père vienne à son secours ; car il ne peut ni résister ni se secourir lui-même. » Socrate met bien au-dessus de ces discours, morts dans l'écriture qui les consigne, le discours que la science grave dans l'âme de celui qui étudie, le discours vivant et animé qui réside dans l'intelligence, et dont le discours écrit n'est qu'un pâle simulacre. C'est celui là qu'il conseille à Phèdre de cultiver avec le plus de soin. Le poète, le prosateur corrigent et raturent mille fois ce qu'ils écrivent; ils y ajoutent; ils y retranchent ; mais il faut avant tout qu'ils tiennent à la parole du dedans, et qu'ils la cultivent avec la plus profonde attention, pour mériter ce beau nom de philosophe. C'est un avis que Phèdre peut donner à Lysias ; c'est un avis que Socrate saura faire goûter à ses jeunes amis, et entre autres au bel Isocrate, qui promet tant. Je ne discute pas cette opinion du sage Athénien, quoiqu'elle ne me paraisse pas tout à fait digne de son bon sens ordinaire. Mais quelle qu'en soit la valeur, il en résulte que Socrate, Phèdre et tous leurs amis se servent de livres comme nous ; qu'ils écrivent leurs discours et leurs ouvrages comme nous écrivons les nôtres; qu'ils les étudient, qu'ils les corrigent, qu'ils les liment comme nous le faisons. Il en résulte, en outre, que, du temps de Platon, c'est à l'Égypte qu'on attribuait la découverte de l'écriture et l'invention des livres. Platon, descendant de Solon, devait être plus que personne au fait des traditions que son glorieux aïeul avait rapportées de la terre étrangère. A ces faits déjà bien décisifs, j'en ajoute encore quelques autres de la même époque. Quand Xénophon, chef de la retraite des Dix mille, arrive de Byzance à Salmydesse, le point extrême de sa marche au nord, il rappelle que beaucoup de bâtiments, en entrant dans le Pont-Euxin, s'engravent sur les bas fonds de la côte. Les Thraces, habitants de ces parages, accourent et pillent les malheureux naufragés, s'entre-tuant à qui volera le plus de butin. De là, une foule de meubles qu'on trouve sur cette côte inhospitalière, et que les navigateurs transportent dans des caisses de bois, entre autres des livres, que sans doute ces barbares ne comprenaient pas, mais qu'ils conservaient pour les revendre (24). Comme il y avait bon nombre de colonies grecques dans ces contrées, Byzance et d'autres, il n'est pas impossible que quelques navigateurs pensassent à faire le commerce des livres. On les transportait peut-être des côtes de l'Asie Mineure, d'Athènes et de bien d'autres villes, pour l'usage des colons et des émigrés, qui, loin de la patrie, n'en participaient pas moins à ses lumières, dont ils avaient besoin plus que jamais. Je ne dis pas qu'au temps de Platon ou même antérieurement, il n'y eût point déjà dans Athènes des libraires, achetant et vendant des livres. C'est très probable ; mais nous n'avons pas de témoignages remontant aussi haut. Le premier de ce genre se rapporte à Zénon de Cittium. Avant de quitter cette ville, colonie des Phéniciens en Chypre, Zénon achète une cargaison de pourpre, pour en tirer quelque profit à Athènes, et il va consulter l'oracle sur la meilleure manière de vivre. Celui-ci lui conseille de devenir de la couleur des morts. Zénon interprète cette réponse en ce sens qu'il doit lire les ouvrages des anciens, et pâlir dessus. A peine arrivé à Athènes, après un triste naufrage, il se rend chez un libraire, et là il lit avec une vive joie le second livre des Mémoires de Xénophon sur Socrate. Dans son ravissement, il demande au marchand où il pourra rencontrer les auteurs qui écrivent de tels chefs-d'œuvre. Le libraire lui montre du doigt Cratès, qui, dans ce moment même, venait à passer dans la rue. Zénon se précipite sur les pas du maître, l'aborde et se fait son élève. Mais ne pouvant goûter la rudesse cynique, il quitte bientôt Cratès, quand il est lui-même en état d'écrire des ouvrages non moins distingués, entre autres un traité sur Pythagore (25). Zénon a trente ans alors ; et selon toute probabilité, Aristote est encore vivant ; c'est sur la fin du règne d'Alexandre. Je cite un dernier fait, et je l'emprunte aux Problèmes d'Aristote, dans la section XVI, ch. 6 (page 914, a, 25, éd. de Berlin). L'auteur se demande pourquoi la tranche des livres présente diverses apparences, selon qu'on la coupe droit ou qu'on la coupe en biais. Je laisse l'explication de côté, parce qu'elle ne nous intéresse pas ici ; mais il est clair par là qu'Aristote avait des livres dans le genre des nôtres, à cet égard du moins qu'ils pouvaient être rognés de façon plus ou moins régulière. Plus loin, section XVIII, Aristote cherche pourquoi la lecture fait dormir certaines personnes, et pourquoi certaines autres au contraire prennent un livre quand elles veulent se tenir éveillées. Tout cela indique des emplois des livres tout à fait analogues à ceux que nous en faisons. On lisait dans son lit à Athènes, et les gens à qui cette fantaisie convenait ne s'en faisaient pas faute plus que nous. D'où venaient ces livres et sur quelle matière étaient-ils écrits? Je n'hésite pas à répondre : ils étaient écrits sur Papyrus, et le Papyrus venait d'Égypte. Dès les temps les plus reculés, l'Égypte avait eu des rapports suivis avec la Grèce, à plus forte raison avec l'Asie Mineure. Les colonies les plus anciennes, conduites par Inachus, Cécrops et bien d'autres, étaient venues des bords du Nil, apportant entr'autres choses aux Hellènes les noms de tous leurs Dieux, dans une infinie diversité. Plus tard, le commerce et la guerre avaient multiplié les relations; et dans les siècles qui nous occupent, l'Égypte se trouve perpétuellement mêlée, pour des intérêts divers, à la politique de toutes les nations voisines, particulièrement à celle des villes Grecques de la côte. Lorsque les Perses eurent fait la conquête de l'Égypte, ces relations devinrent plus étroites et plus suivies. La flotte des Égyptiens et leur armée figurent à tout moment dans les batailles sur terre et sur mer. Il est évident que les peuples qui sont ainsi en contact font une foule d'échanges inévitables, et l'Égypte, qui était la seule à peu près à produire le Papyrus, devait en fournir amplement au reste du monde. Il était tout simple que l'Égypte, qui avait découvert l'écriture, et qui possédait le Papyrus, dont elle faisait cet ingénieux usage, imaginât aussi des bibliothèques. Les livres une fois écrits, on devait les rassembler et les conserver, pour conserver avec avec eux la mémoire de tout ce qu'ils contenaient. En dépit du Thamus de Platon et de Socrate, ces manuscrits devaient paraître fort utiles et fort précieux. C'est en effet ce qui arriva. Un des rois d'Égypte, Osymandias, passe pour être le premier, ou un des premiers, qui eut une bibliothèque. Le souvenir de ce fait si curieux nous a été transmis par Diodore de Sicile, qui, dans la 180e olympiade, visita l'Égypte, comme l'avait visitée Hérodote quatre cent cinquante ans auparavant, et qui vit de ses propres yeux presque tout ce dont il parle. Après avoir dit un mot des tombeaux des rois, qui avaient été au nombre de quarante-sept, selon les récits des prêtres, et qui étaient encore au nombre de dix-sept quand Diodore y descendit (26), il décrit tout au long le fameux monument d'Osymandias. Parmi les édifices qu'on attribuait à ce roi, se trouve la bibliothèque sacrée, sur le fronton de laquelle on lisait cette inscription fameuse : « Remède de l'âme. » Il ne ressort pas des paroles mêmes de Diodore que cette bibliothèque subsistât encore de son temps. Mais qu'elle ait existé, c'est ce qui ne fait guère de doute. Les prêtres Égyptiens avaient des livres de la plus haute antiquité, où étaient enregistrées les annales régulières du pays, et la succession non interrompue, depuis les origines, de 470 Pharaons et de cinq reines. Diodore, qui semble avoir vu ces livres, ne veut pas répéter, pour chaque règne, tout ce qu'ils contiennent ; mais il en donne. un extrait, et c'est d'après ces documents qu'il travaille. Si donc la bibliothèque sacrée n'existait plus cinquante ans avant notre ère, elle était tout au moins mentionnée dans ces annales officielles, d'ailleurs plus ou moins exactes, qu'on pouvait encore consulter (27). D'après nos égyptologues les plus instruits, Ousimandouei, que les Grecs appelaient Osymandias, est un Pharaon de la XVIe dynastie ; cette dynastie répond à peu près à l'époque d'Inachus; c'est environ deux mille ans avant notre ère. Les Hyksos, ou pasteurs, forment la XVIIe dynastie. De tels récits pourraient nous paraître fabuleux, et on pourrait ne pas croire à des livres d'une si prodigieuse ancienneté, si nous n'avions actuellement, dans nos musées, les preuves les plus irrécusables de la vérité de ces assertions. A Paris, à Turin, à Leyde, à Berlin, etc., se trouvent des papyrus et des manuscrits remontant à 13 et 14 siècles avant l'ère chrétienne, et même au-delà. Chacun peut les voir; et pour en connaître la date, on n'a qu'à interroger MM. Champollion, de Bougé, Mariette, Amédée Peyron, Leemans, Lepsius, etc., etc. Le fameux papyrus de Turin, dont Champollion parle dans sa lettre à M. de Blacas (p. 42), est tout au moins du XIIIe siècle avant l'ère chrétienne, comme l'a démontré M. Lepsius (Todtenbuch, p. 17). Dans le Livre des Rois, M. Lepsius a représenté, planche 6, un manuscrit qui remonte à la XIIIe ou XIVe dynastie ; ce qui nous reporterait bien plus haut encore. M. Mariette, dans sa Notice du musée de Boulaq (p. 148), décrit un papyrus trouvé à Thèbes, de près de deux mètres de long, qui appartient à une des trois premières dynasties du Nouvel-Empire. Ce manuscrit ne peut donc pas avoir moins de 1288 ans avant notre ère, et il en a peut-être 1700. Un autre manuscrit (ibid. p. 153), de 4 mètres et demi de long sur 0 m35 de haut, est de la XVIIIe dynastie, et par conséquent de 17 siècles antérieurs à l'ère chrétienne. On pourrait multiplier ces exemples tant qu'on voudrait ; mais ceux-ci suffisent, et je ne crois pas qu'il soit besoin de pousser la démonstration plus loin ; elle est complète. Bien plus, à côté des manuscrits, on a trouvé les instruments qui servaient à les écrire, les godets à couleurs, les roseaux, répondant à nos encriers et à nos plumes; les polissoirs, pour unir le papyrus avant d'y tracer les caractères; les étuis, pour contenir les roseaux, etc. Au musée de Leyde, on voit des palettes de scribes, avec des godets, où l'on distingue fort nettement l'encre rouge ou noire, qui s'y est desséchée; avec des encriers en bronze, etc., etc. Tous ces débris sont antérieurs à la XVIe dynastie, selon M. Leemans (p. 108, n° 245 ). Au musée de Boulaq, il y a des palettes de scribes avec tous leurs accessoires, qui, suivant M. Mariette, sont antérieurs à Abraham (ibid., p.209). C'est une antiquité de 35 à 45 siècles. A Paris, dans notre musée Égyptien, il y a également tous les instruments à l'usage des scribes (salle civile, armoire P, vitrine X), de même que, dans la salle funéraire (vitrines LM), on peut voir des manuscrits roulés soit sur papyrus, soit sur toile, sans compter les grands papyrus déployés sous cadres vitrés et ayant plusieurs mètres de long. Des manuscrits à Leyde ont jusqu'à 12 mètres de longueur; et, en effet, ou pouvait fabriquer des papyrus d'une longueur indéfinie ; la hauteur seule était limitée, et n'allait guère au delà de 50 centimètres.
De tous les détails qui précèdent, et que je pourrais développer encore
davantage, s'il en était besoin, je crois pouvoir tirer les conclusions
suivantes, qui me semblent autant de faits certains. Que reste-t-il à savoir encore ? Une seule chose, peut-être, qui répondrait aux habitudes un peu minutieuses de notre curiosité moderne. C'est la fabrication du papyrus destiné aux lettres et aux ouvrages des écrivains. Par un hasard assez heureux, Pline, qui déjà était curieux à notre manière, nous a transmis ces renseignements; il nous dit comment, de son temps, se fabriquait le papier de papyrus. Il est à présumer que cette fabrication avait fait quelques progrès dans le long intervalle qui s'étend du règne d'Osymandias au premier siècle de notre ère; mais la partie essentielle de ces procédés devait être fort ancienne ; et, selon toute apparence, elle n'avait guère changé (28). Pline met, avec raison, grand intérêt à la description de ce roseau appelé Papyrus, attendu que «la civilisation et le souvenir des choses sont attachés à l'usage du papier; l'immortalité des hommes en dépend. »
Varron ne faisait pas remonter l'usage du papier (charta) plus haut que le règne
d'Alexandre-le-Grand et la fondation d'Alexandrie. Ceci pouvait être vrai pour
Rome; mais nous venons de voir que ce ne peut pas l'être pour l'Égypte ni pour
la Grèce. Pline ne partage pas cette opinion de Varron, toute considérable
qu'elle est; et voici ce qu'il dit de la plante précieuse qu'il veut étudier. Pour préparer le papier, on divise le Papyrus en bandes très minces, mais aussi larges que possible. La bande la meilleure est celle du centre de la plante, et ainsi de suite dans l'ordre de la division. C'était avec ces couches intérieures, exclusivement, qu'on faisait, jadis, les livres sacrés; et de là, le nom de Hiératique, appliqué à ce papier. Plus tard, on a donné au papier de première qualité, épuré par le lavage, le nom d'Auguste; de même qu'on a appelé du nom de Livie, femme d'Auguste, le papier de seconde qualité. L'Hiératique alors ne vint plus qu'au troisième rang. Au quatrième degré, était placé le papier Amphithéatrique, nommé du lieu où on le fabriquait. Puis venaient ensuite, en qualités de plus en plus inférieures, le papier de Saïs fait avec des rognures; le Ténéotique, d'une ville près de Saïs; il se vendait au poids; et enfin l'Emporétique, ou papier des marchands, qui ne servait qu'aux enveloppes et aux ballots. Au delà des bandes ainsi levées, venait l'écorce du Papyrus, assez pareille à celle du jonc ; elle ne servait qu'à faire des cordages, qui tiennent parfaitement à l'eau. Toutes les sortes de papiers se fabriquaient de la même manière, la nature seule de la feuille étant différente. Les bandes ayant été levées avec soin, on les étendait sur une table, qu'on humectait avec l'eau du Nil ; ce liquide limoneux servait de colle pour fortifier les bandes et les joindre entr'elles. Sur la table un peu inclinée, on collait les bandes de toute leur longueur, en les rognant à chaque extrémité pour qu'elles fussent plus régulières et plus uniformes. Puis, on posait transversalement d'autres bandes, en forme de treillage. Pour empêcher le papier de se déchirer, on soumettait le tout à la presse, et l'on obtenait une feuille de papier, qu'on séchait ensuite au soleil. En accumulant ces feuilles les unes sur les autres, on en faisait une main (scapus), qui n'en comptait jamais plus de vingt. La largeur des feuilles était variable; les meilleures avaient jusqu'à treize doigts ; le hiératique n'en avait guère que onze; le papier dit Fannius, du nom d'un habile fabricant qui avait perfectionné le hiératique, n'en avait que dix ; le papier marchand était réduit à six. On pouvait aussi mettre des feuilles bout à bout, et l'on confectionnait ainsi du papier sans fin, comme le nôtre. On estimait dans le papier, comme on le fait encore, la finesse, le corps, la blancheur, le poli. L'empereur Claude mit sa vanité à réformer le papier Auguste, qu'il trouvait trop fin et trop transparent, en faisant composer la chaîne avec des bandes de seconde qualité, et la trame, avec des bandes de première. De cette façon, on augmenta aussi la largeur, qui fut portée jusqu'à une coudée pour le plus grand papier. On préférait le papier de Claude pour les livres ; mais on garda celui d'Auguste pour la correspondance épistolaire. On polissait le papier avec un morceau d'ivoire ou avec un coquillage bien lisse. Mais il ne fallait pas pousser cet apprêt au-delà de certaines bornes ; autrement, l'encre ne prenait plus aussi bien, et les caractères étaient exposés à s'effacer plus vite. C'est encore ce qui arrive à notre papier, quand il est par trop uni; il est plus beau à l'œil, peut-être; mais il n'est pas d'un bon service. L'eau du Nil, bourbeuse comme elle l'était, causait aussi un inconvénient de ce genre ; quand elle était versée avec trop peu d'attention, au début de l'opération, elle rendait le papier rebelle à l'écriture ; elle lui imprégnait même une odeur qu'on reconnaissait ; elle y faisait en outre des taches; et alors il fallait, pour qu'elles disparussent, faire des trous et coller artistement de petites pièces dans le papier. L'acheteur ne s'en apercevait qu'à l'usage, tant la fraude était adroite ; mais en ces endroits, le papier buvait et faisait étaler l'encre des caractères, qui devenaient peu lisibles. Aussi Pline, pour éviter ces désagréments divers, indique-t-il des procédés de collage qui rendent le papier beaucoup plus doux que la toile de lin elle-même. Il trouve ces procédés très efficaces, et il dit avoir vu chez un de ses amis, grand amateur d'autographes, des manuscrits de Cicéron, du divin Auguste et de Virgile, sur du papier de ce genre. Il y a même vu des manuscrits de Tibérius et de Caïus Gracchus, monuments qui avaient deux cents ans de date, tant le papier ainsi collé résistait bien au temps. Après tous ces détails, Pline revient à l'opinion de Varron sur l'emploi récent du papier en Italie; et il essaie de prouver, contre l'opinion de son docte devancier, que les livres étaient connus dès le temps de Numa Pompilius. Dans le cercueil de ce roi, retrouvé sous le consulat de P. C. Céthégus et de Baebius Tamphilus, 535 ans après sa mort, on découvrit des livres en papier. Les trois livres que la sibylle apporta à Tarquin-le-Superbe étaient en papier également; elle en brûla deux ; et le troisième, qu'accepta le roi mieux avisé, avait été conservé jusqu'au temps de Sylla, où il périt dans l'incendie du Capitole. Si l'on veut une preuve décisive, autant qu'étendue, de l'usage qu'on faisait du papier dans l'antiquité, on n'a qu'à parcourir la correspondance de Cicéron ; à cet égard comme à tant d'autres, on y trouvera les renseignements les plus précis et les plus piquants. On se sert du papier avec la plus extrême facilité, et l'on en fait une prodigieuse consommation. Cicéron écrit à Atticus, tous les jours et même plusieurs fois par jour, tantôt des lettres très longues, et tantôt de simples billets ; il lui envoie par son messager quelques lignes, une page (pagella), quand il n'a pas plus à lui dire, ou une suite de pages interminables, quand il s'épanche ou qu'il discute des affaires importantes. Quand une lettre peut intéresser de nombreuses personnes, on en fait faire plusieurs copies, ou l'on autorise celui à qui l'on s'adresse à vouloir bien se charger de ce soin. Si le sujet de la lettre est délicat, on rature plus d'une d'une fois les expressions incomplètes qui ne rendraient pas tout à fait la pensée; on revient à plusieurs reprises sur son style ; on le polit; on l'aiguise. Si l'émotion de celui qui écrit est trop vive, il laisse parfois tomber ses larmes, qui effacent l'écriture. Quand la lettre est finie, on la ferme et on la cachette (obsignare). Si l'on a commis quelque oubli, si quelque détail a échappé, on ouvre sa lettre de nouveau ; et si le papier est plein, on écrit le supplément en travers (transversum). Quand on a lu la lettre qu'on vient de recevoir, et qu'elle ne contient rien qu'on veuille conserver, on la déchire (conscidere). On n'y manque point si le correspondant vous a par hasard demandé le secret. Si l'on a mis une lettre au rebut sans la déchirer, on peut la rendre à celui qui la réclame, et qui veut la faire revenir entre ses mains. Quand on manque de papier (charta, chartula), on efface ce qui est écrit sur un autre morceau, et l'on se sert de ce morceau lavé ou gratté pour un nouvel usage (delere.... in palimpsesto). Les lettres finies, on les remet en paquet (fasciculus) à un porteur, qui les rend fidèlement aux destinataires (label-tarins). On profite de l'occasion pour écrire à plusieurs amis en un seul voyage. Quand on a ouvert le paquet qu'on reçoit, on distribue les missives ; et s'il en est besoin, on expédie de nouveaux messagers pour les personnes absentes. On peut prendre soi-même toute cette peine, écrire ses lettres de sa propre main, les cacheter, et les faire partir ; mais on peut tout aussi bien s'en remettre à un secrétaire (librarius); on lui dicte la lettre qu'on n'a pas le temps d'écrire soi-même, et l'on se contente alors de la signer. Si l'on est fatigué, si l'on a mal aux yeux surtout, c'est à une main étrangère qu'on a recours; alors, on s'excuse auprès de son ami de l'impuissance où l'on est de tenir la plume, comme nous dirions. Ces secrétaires sont nécessairement des hommes de confiance, puisqu'ils doivent partager les secrets de la famille, des affaires, de la politique. Le plus souvent ils justifient l'estime qu'on leur accorde ; parfois ils trahissent leurs maîtres; et ils se sauvent, en emportant les papiers. Comme ce sont d'ordinaire de simples esclaves, on les poursuit, on les ressaisit ; et il faut qu'ils soient réfugiés bien loin pour qu'on ne puisse pas les atteindre. A un serviteur infidèle ou incapable, on en substitue promptement un autre, qui est plus honnête ou plus habile ; et la correspondance n'est pas interrompue longtemps. Si le commerce épistolaire est si rapide et si aisé pour l'usage privé, tout ce qui concerne la chose publique ne l'est pas moins. La rédaction de tous les actes officiels se fait avec une égale facilité. Dès que ces actes ont été accomplis dans les formes voulues, il en est fait à l'instant des copies sans nombre pour tous ceux qu'ils peuvent intéresser ; les ordres partent pour tous les fonctionnaires chargés de l'exécution à tous les degrés, et l'on correspond administrativement par des procédés prompts et sûrs, qui semblent bien valoir au moins les nôtres. Jusqu'aux limites les plus reculées de la République, le Sénat fait parvenir ses décrets ; et en même temps, il en fait des copies authentiques, qui restent dans ses archives. Sans les désordres de tout genre qui ont bouleversé la ville éternelle et l'Empire romain, tumultes civils, pillages, incendies, guerres étrangères, assauts, invasions, etc., il est bien à croire que nous aurions encore aujourd'hui tous ces documents, précieux pour l'histoire encore plus que pour notre curiosité archéologique. La matière sur laquelle tout cela était tracé peut se conserver presque sans altération, durant des trentaines de siècles; les papyrus de nos musées l'attestent. Si donc nous avons tant perdu de cette vénérable et féconde antiquité, c'est uniquement la faute des hommes; ce n'est pas celle du temps. Comme suite et complément des lettres-missives, l'usage des livres est aussi répandu et aussi vulgaire dans le siècle de Cicéron qu'il peut l'être de nos jours. Il n'y a pas de citoyen un peu riche et un peu instruit qui n'ait sa bibliothèque, à l'exemple de celles qu'on avait depuis deux ou trois siècles à Alexandrie et dans toutes les villes de la Grèce (30). Chacun, à Rome, a des collections de livres, qu'on choisit personnellement, ou qu'on prie quelqu'ami de choisir à votre place, s'il est mieux placé pour le faire, ou si on lui reconnaît plus de goût qu'on n'en a soi-même. Cicéron charge Atticus, qui est à Athènes, de lui envoyer des statues et des ornements divers pour sa bibliothèque, qu'il appelle son Académie. Comme Atticus veut se défaire de quelques livres, qu'il a fait copier et qu'il vend, Cicéron le supplie de ne pas traiter avec un autre que lui ; la bibliothèque d'Atticus, composée avec un soin tout particulier, lui plaît infiniment; les copies qu'il demande seront le fond de la sienne, et il n'aura plus qu'à les compléter, selon ses besoins, ses études et ses plaisirs. On est en 686; Cicéron n'a pas plus de 40 ans, et il pense déjà à se retirer des affaires dans quelque beau et calme séjour, où il vivra avec ses livres, ces vieux amis qu'il aime tant à pratiquer, comme il le dit à Varron, passionné plus encore que lui pour la science, et les recherches de tout genre sur les antiquités de la patrie et celles des peuples étrangers. Plus tard, quand Cicéron peut se ménager quelques heures de repos et de solitude, il va s'enfermer dans sa bibliothèque, qu'il a fait si coquettement parer ; il s'y cache au milieu de ses livres; il en a des piles énormes amoncelées tout autour de lui. Quand il n'a pas tous ceux qu'il désire consulter, il se les fait copier (describere) chez les amis qui les possèdent. Si des amis éprouvent les mêmes lacunes, Cicéron est aussi complaisant qu'on l'a été à son égard ; il fait copier, par ses scribes, par ses lecteurs (anagnostes), par ses secrétaires, l'ouvrage réclamé, et il se procure la joie de l'offrir, de même qu'il avait été charmé d'en recevoir un autre qui ne lui agréait pas moins. Sans même qu'un ami vous en adresse la requête, on lui fait présent de quelque bon livre qu'il souhaite en secret, et qui peut lui être de quelque utilité. Si l'on est en visite chez quelqu'un et qu'on y trouve un livre à sa convenance, on le lui emprunte, et on le lui rend après qu'on s'en est servi, etc., etc. Je pourrais multiplier ces détails à l'infini ; mais à quoi bon? On voit de reste que les Romains, à la fin de la République, et 150 ans avant Pline, qui nous a si bien décrit la fabrication du papier, avaient tiré du papyrus tout le parti que nous tirons aujourd'hui du lin et du coton. On écrivait tout autant à Rome que nous pouvons nous-mêmes écrire, pour les mêmes besoins sociaux, avec la même facilité, avec la même ardeur, et aussi avec les mêmes passions et la même vanité. La matière était autre; l'objet était le même. La grande différence, c'est l'imprimerie, qui ne devait être découverte que quinze ou seize siècles plus tard. Les copies des livres, des actes administratifs, des lettres, étaient coûteuses et lentes ; par suite, peu nombreuses et fort exposées à se perdre. La presse est venue rendre la publication, la transmission, la conservation, mille fois plus sûres, mille fois plus rapides, mille fois moins chères. A la main des copistes, on a substitué l'infaillible précision d'une machine, sa puissance sans borne, et son bon marché. Mais ce n'est là, quoi qu'on en puisse dire, qu'une transformation toute matérielle. L'essentiel était trouvé dans les temps les plus reculés. Le grand et véritable inventeur était encore le vieux Teuth, ou tel autre magicien d'Égypte, qui avait fait parler le papyrus et les caractères qu'y traçait le roseau du scribe, trempé dans la couleur. Malgré ce qu'en pensait le prudent Thamus, le discours écrit dans la pensée et dans l'intelligence ne suffisait qu'à celui qui le portait dans son âme, solitaire et presque muet. Le discours vivait par l'écriture, et pouvait se promettre une durée que l'individu éphémère ne devait jamais avoir. Les papyrus nous parlent encore et parleront longtemps à nos neveux, tandis que Thamus s'est tu depuis quarante siècles. Qui saurait même ce qu'il a pensé, si quelque hiérogrammate, moins scrupuleux que lui, n'eût consigné ses paroles ironiques sur une de ces feuilles de papyrus tant dénigré par le trop sage Pharaon? Après avoir ainsi replacé nos philosophes dans la réalité des événements où leur vie s'est écoulée, studieuse ou guerrière, tranquille ou errante; après avoir replacé les ouvrages qu'ils ont écrits dans les conditions matérielles où ils les ont composés, il me semble que je puis me demander avec plus de certitude, et avec plus de sécurité en quelque sorte, jusqu'où va l'originalité de cette philosophie. Née, à ce qu'il nous apparaît, dans l'Asie Mineure, vers le vile siècle avant l'ère chrétienne, en rapports très fréquents et très intimes avec tous les pays qui l'entourent, que leur doit-elle? Leur a-t-elle emprunté quelque chose? Ou bien en est-elle absolument indépendante ? N'a-t-elle rien puisé que dans ses propres inspirations? Les doctrines de Thalès, de Pythagore, de Xénophane, sont-elles aussi spontanées, aussi originales que les poésies d'Homère, de Sapho, d'Archiloque ou d'Alcée? En d'autres termes, l'Occident, qui s'ouvre alors à la vie scientifique, doit-il quelque chose à l'Orient, avec lequel il est en contact, et qui passe pour l'avoir précédé de beaucoup dans ces voies austères, dont le terme suprême est la philosophie?
Je réponds sans hésiter : Non, la Grèce ne doit rien à personne, si ce n'est à
elle-même ; les secours qu'elle a reçus peut-être ont été si légers qu'on peut
affirmer que, dans la science, elle a été aussi nouvelle et aussi ingénieuse que
dans tout le reste. Elle n'a pu recevoir de ses voisins que des germes informes,
si elle en a reçu quelque chose, et elle les a transformés si complètement qu'on
peut dire qu'elle les a réellement créés. « L'idée désintéressée de la science. » Observer pour savoir, sans autre but que de comprendre le monde où nous vivons, ses phénomènes, son origine et sa fin, voilà l'idée qui naît alors pour la première fois dans l'intelligence humaine, et qui, depuis Thalès, Pythagore et Xénophane jusqu'à nous, n'a fait que se développer de siècles en siècles, et qui se développera désormais sans interruption, tant que les siècles et le temps qu'ils mesurent, dureront pour le genre humain. C'est là si bien ce que fait la philosophie qu'au début elle embrasse toutes les sciences sans exception, et que c'est uniquement par la faiblesse de notre esprit et les nécessités de l'analyse universelle, que peu à peu les sciences particulières se spécialisent, et que la philosophie, qui n'en reste pas moins leur mère féconde, s'isole aussi de ses filles, sans cesser de les nourrir et de s'appuyer sur elles. La philosophie a reconnu assez vite son domaine propre, superposé à celui de toutes les autres sciences, dont elle est à la fois la racine et l'achèvement. Mais à ces premiers jours, elle se confondait avec toutes les sciences qui n'étaient pas encore issues de son sein. De là le beau et modeste nom qu'elle s'est donné. Pythagore, interrogé par Léon, tyran des Phliasiens (Sicyonie), lui répondit qu'il était philosophe, nom jusque-là inouï. Le philosophe n'est qu'un ami de la sagesse, c'est-à-dire de la raison, qui étudie les choses et s'étudie elle-même. « Les hommes, disait Pythagore, sont et marchent dans la vie à peu près comme la foule qui se rend aux fêtes solennelles. Dans ces vastes assemblées de la multitude, chacun de ceux qui s'y pressent ont des desseins divers. L'un y va pour vendre ses marchandises et par amour du gain ; l'autre n'est guidé que par l'amour de la gloire et par le désir de remporter le prix de la force ou de l'adresse. Une troisième classe, plus noble encore, n'y paraît que pour contempler la beauté des lieux où l'on se réunit, et les merveilles d'industrie qui y sont exposées aux yeux de tous. De même, dans la vie, les hommes réunis en société ont des occupations différentes. Les uns sont entraînés par les attraits irrésistibles de la richesse et du plaisir: les autres sont dominés par l'ambition du pouvoir et des honneurs, qui ne se gagnent que par les luttes ardentes et les rivalités homicides. Mais le but le plus relevé de l'homme, c'est de contempler dans cet univers toutes les beautés qu'il nous offre, et de mériter ainsi le titre de philosophe. Il est bien de contempler l'immense étendue des cieux et d'y suivre le cours des astres, qui s'y meuvent dans un ordre si régulier. Mais on ne peut le bien comprendre que par le principe purement intelligible qui régit tout avec nombre et mesure. La sagesse consiste à connaître autant qu'on le peut ces phénomènes divins, éternels, primitifs, immuables ; et la philosophie n'est que la poursuite assidue de cette noble étude, qui éclaire et corrige les hommes (31). » Dès le début, la philosophie a donc su ce qu'elle faisait ; depuis vingt-cinq siècles, elle n'a cherché qu'à réaliser de plus en plus complètement la pensée qui l'animait à ses premiers pas. La sagesse de Pythagore est encore la nôtre, bien que les sciences aient fait de très grands progrès; mais le philosophe n'est pas changé; il sera toujours celui qui contemple et observe les choses, pour les comprendre et se comprendre lui-même. Voilà l'idée de la science et de la philosophie, dont je fais un honneur exclusif à la Grèce ; c'est de la Grèce que nous l'avons reçue, sans que personne avant elle y eût songé dans cet Orient, qu'elle croyait, et qu'on croit souvent encore, la source de toute lumière et de toute sagesse. Cette idée, à qui la Grèce pouvait-elle alors l'emprunter? A l'Égypte, à la Phénicie, à la Perse, à l'Inde? Je ne vois pas d'autres peuples que ceux-là qui eussent à enseigner quelque chose aux Grecs; et je dis que ceux-là, tout en leur apprenant beaucoup de choses, ne leur ont point enseigné la philosophie. Sans doute, plusieurs de nos philosophes, et Pythagore en particulier, ont fait de longs voyages dans ces contrées, et ils y sont allés pour s'instruire. Pythagore, Phénicien peut-être par sa famille, ainsi que Thalès, s'est rendu en Égypte, comme Hérodote un siècle plus tard; il s'y est fait initier, dit-on, aux mystères, et on peut le croire sans peine ; car Solon aussi y était allé ; et, suivant toute apparence, il ne s'était pas borné à parler de l'Atlantide avec les prêtres de Saïs (32). Il est assez probable aussi que de l'Égypte Pythagore aura poussé en Chaldée, et que là il aura conféré avec les Mages, de même qu'il avait conversé avec les prêtres égyptiens. Grâce à la route royale que Darius avait fait construire, on se rendait de Sardes à Suse, au fond de la Perse, au-delà de l'Euphrate et du Tigre, sans autre embarras que la longueur d'un voyage qui durait trois mois. On ne voit pas pourquoi l'amour de la science n'aurait pas fait entreprendre de tels voyages, quand la politique, même avant la route de Darius, exigeait à tout moment des rapports de ce genre. Les sages parmi les Grecs ont été tentés de visiter l'Égypte, la Phénicie et la Chaldée, pays très curieux où ils croyaient trouver des trésors de science ; et, en réalité, ils ont bien pu parcourir ces contrées lointaines, quoiqu'elles fussent peu accessibles. Qu'en ont-ils rapporté ? Aujourd'hui, et par suite de toutes les découvertes philologiques et archéologiques de notre siècle, hiéroglyphes, inscriptions cunéiformes, papyrus égyptiens, livres zends de Zoroastre, livres sacrés de l'Inde, religion des Brahmanes et des Bouddhistes, tout cela nous est ouvert; et nous pouvons voir, bien mieux que jamais les Grecs ne l'ont pu, ce que c'était que la prétendue sagesse de l'Orient. En face des monuments interprétés, si ce n'est complètement, du moins en partie, avec une exactitude suffisante, nous savons ce qu'ils valent et ce qu'ils peuvent donner. On y cherche vainement la philosophie; elle est absente. Comment les Grecs, même en se faisant initier aux plus secrets mystères, l'y eussent-ils trouvée, puisqu'elle n'y était pas? J'écarte d'abord la Phénicie et la Judée tout entières; la Bible est un monument d'un prix incomparable, à la fois par ce qu'elle renferme et par ce qui en est sorti. Mais je ne vois pas que la Grèce en ait emprunté quoi que ce soit. Pourquoi, si les livres saints des Juifs lui eussent été communiqués, d'une manière ou d'une autre, s'en serait-elle cachée ? Elle a proclamé bien haut, et même beaucoup trop haut, la sagesse de l'Égypte et celle des Mages? Quelle difficulté aurait-elle éprouvée à exalter la sagesse hébraïque, si elle l'eût connue? On peut déplorer qu'elle l'ait ignorée ; et je crois aussi que la Grèce, déjà si capable de progrès par elle seule, eût été puissamment secondée par l'étude des livres de Moïse ; mais enfin elle n'en a rien su. Soutenir le contraire, ce peut être la preuve d'une foi ardente ; mais c'est une erreur manifeste, qui ne peut un seul instant résister à l'observation des faits. Lorsque plus tard, la Bible, traduite par les Septante, sous le règne de Ptolémée II, Philadelphe (275 avant J.-C. ), put être lue par les Grecs, on ne voit pas qu'elle les ait beaucoup émus ni éclairés. Au temps de Thalès et de Pythagore, elle aurait exercé bien moins d'influence encore; leur eût-elle été expliquée, ils ne l'eussent guère comprise ni écoutée. En fait, elle ne leur a rien fourni. J'en dis à peu près autant de l'Égypte. Depuis la grande découverte de Champollion, et par tous les travaux qui l'ont confirmée en s'en inspirant, on sait assez bien ce qu'était la terre antique des Pharaons. Sauf des révélations tout à fait inattendues et d'un genre tout nouveau, on est certain qu'on n'y rencontrera pas de philosophie. Les croyances y abondent, d'un caractère très original, et assez beau quoique bizarre ; mais la science proprement dite n'y est pas; et tout concourt à prouver que, malgré la plus réelle intelligence, elle n'y a jamais été et n'y pouvait pas être. L'étude de l'Égypte n'en est pas moins curieuse ; mais il ne faut pas en attendre ce qu'elle ne contient point; elle a des annales, et elle n'a pas d'histoire ; elle a peut-être des observations exactes de certains phénomènes naturels, astronomiques surtout, et elle n'a pas de science ; elle a des doctrines religieuses, et elle n'a pas de philosophie. Comme la Phénicie, sa voisine, comme la Judée qu'elle a jadis subjuguée, et qui lui échappait, déjà du temps de Moïse, elle peut avoir de grandes notions ; elle ne les a jamais systématisées et assises sur des principes. Pour juger des Mages de Chaldée, nous avons à la la fois, et ce que nous en apprend Hérodote, avec les autres écrivains contemporains, et ce que nous en apprennent les livres Zends, qui nous ont été tout récemment ouverts par la sagacité pénétrante de philologues en tête desquels il faut compter notre Eugène Burnouf. Pour Hérodote, qui semble avoir vu les Mages de très près, ils ne sont guère plus que des devins. Lorsqu'Astyage, roi des Mèdes, veut faire interpréter un songe étrange qu'a eu sa fille Mandane, il s'adresse à ceux des Mages qui exercent cette profession, et il suit scrupuleusement leur conseil en donnant l'ordre de tuer son petit-fils, Cyrus. Lorsque Cambyse va tenter sa folle expédition en Égypte, c'est à un Mage qu'il remet le soin de gérer les affaires pendant son absence. Ce Mage abuse de la confiance du roi, et il fait monter sur le trône le faux Smerdis, son frère. Mais les Perses sont indignés de l'usurpation, qui les soumet à un Mage; sept conjurés, conduits par le Perse Darius, fils d'Hystaspe, égorgent les deux frères, détenteurs illégitimes du pouvoir. Ce sont des Mages qui expliquent le songe de Xerxès, quand il se dispose à marcher contre la Grèce, et c'est sur leur avis qu'il se décide. Quand il est en marche et sur les bords du Strymon, des Mages immolent des chevaux blancs, pour obtenir de favorables augures. La flotte, ayant été dispersée (en 480 avant J.-C.), par une tempête sur les côtes de Thrace, au cap Sépias, non loin de l'Athos, où une autre flotte avait péri dix ans auparavant, les Mages offrent des victimes au Vent et l'apaisent le quatrième jour. En un mot, on ne peut jamais faire un sacrifice sans la présence obligée d'un Mage, qui, pour accomplir la cérémonie pieuse, chante ce qu'Hérodote appelle une Théogonie. Delà, dans l'antiquité Grecque et surtout à Rome, la réputation, et en même temps aussi l'horreur, des Mages. C'est de leur nom que s'appelle cet art mystérieux de la magie, redoutable dans l'opinion du vulgaire, qui faisait sans doute beaucoup de dupes, et que Pline a flétri avec plus de colère qu'il n'en mérite (33). Dès le temps d'Aristote, ces accusations étaient portées contre les Mages de la Perse et de la Chaldée; le philosophe avait fait un ouvrage tout exprès, le Magique (34), pour les défendre contre des soupçons qui lui semblaient sans fondement. Dans son livre De la Philosophie, il avait cru devoir s'occuper aussi des Mages, qu'il regardait comme plus anciens que les prêtres d'Égypte ; et rappelant leur théologie, il parlait des deux principes qu'il reconnaissent, le bon et le mauvais, Oromase et Arimane. D'autres écrivains postérieurs à Aristote ont fait des Mages les ancêtres des Gymnosophistes de l'Inde, et même des Juifs. Dans le livre de Daniel, écrit du temps de Darius, les Mages de Babylone ne sont que des astrologues, des enchanteurs et des interprètes de songes. On leur accorde cependant le titre de sages; mais les services qu'on leur demande ne semblent guère au-dessus du charlatanisme et de la fourberie des sorciers. Sont-ce les mêmes hommes qui, à Babylone, faisaient des observations astronomiques dont Aristote parle avec la plus grande estime (35) ? Mais si les Mages sont des astronomes habiles, ils ne sont pas des philosophes, et les Ouvrages Zends que nous connaissons aujourd'hui d'une manière certaine le démontrent évidemment. Le Vendidad, le Yaçna, les Yashts, et tous les fragments attribués à Zoroastre (Sarathustra) renferment les débris d'une religion, qui paraît majestueuse et forte au travers de toutes ces obscurités; mais ils ne renferment pas une doctrine philosophique. Or, ces livres sont les seuls qu'on puisse attribuer aux Mages de la Chaldée; et si par hasard Pythagore a pu les consulter, il n'en a rien fait passer dans son propre système. Des prières, des invocations, des hymnes, des croyances confuses et peu arrêtées, quelques traces de légendes sacrées, une mythologie qui n'est plus celle des Védas et qui n'est pas non plus celle des Grecs, voilà surtout ce qu'on y peut lire. Ce n'est certainement pas sans une haute importance, et l'histoire des religions peut y découvrir les éléments les plus précieux ; mais l'histoire de la philosophie n'a rien à y recueillir. Les Mages, pas plus que les Égyptiens, n'ont inspiré les Grecs de l'Ionie. Est-ce l'Inde? Pas davantage. Une épaisse nuit couvre encore les origines et la chronologie indiennes. Comme ce pays n'a jamais écrit son histoire, nous avons la plus grande peine à classer les événements et les faits de toute sorte qui le concernent; les faits intellectuels n'échappent pas à cette confusion générale. Cependant au milieu de ce chaos, qui peut-être ne sera jamais débrouillé, quelques lignes principales se détachent, certaines quoique très vagues. On peut affirmer que tels monuments de l'esprit Hindou sont plus anciens ou plus récents que tels autres. Ainsi les Védas, et surtout le Véda historique, comme on l'a surnommé avec bien de l'indulgence, le Rik, sont de beaucoup antérieurs à tout le reste. Les Védas, ou tout au moins celui-là, n'ont guère moins de quinze siècles avant l'ère chrétienne. Mais, dans ces hymnes poétiques, il n'y a pas de philosophie. La mythologie exubérante qui s'y développe ne laisse pas de ressembler à la mythologie grecque, de même que les deux idiomes de la Grèce et de l'Inde brahmanique ont une ressemblance fraternelle. Mais le caractère philosophique y manque entièrement. Les Oupanishads, où on pourrait le retrouver peut-être après les Brahmanes, sont certainement postérieures aux temps qui nous occupent; et tandis que Thalès, Pythagore et Xénophane sont du VIe siècle avant notre ère, on ne peut pas faire remonter au-delà du IVe siècle les Oupanishads les plus vieilles. Ainsi là encore les Grecs n'ont pu rien emprunter, en supposant même que dès-lors il fût possible d'entretenir quelque commerce un peu suivi avec les sages des bords de l'Indus, sans parler de ceux du centre ou de l'est de la presqu'île. Les Gymnosophistes n'ont été connus du monde grec que par l'expédition aventureuse d'Alexandre, et par l'ambassade de Mégasthène. Mais Alexandre et Mégasthène sont, de deux cents ans au moins, postérieurs à nos sages de Samos, de Milet et de Colophon. Il est vrai que l'Inde, par un contraste frappant avec l'Égypte, la Judée et la Perse, possède une vraie philosophie. Nous en connaissons l'ensemble et déjà quelques monuments particuliers. En attendant une étude plus complète, nous savons que cette philosophie remplit toutes les conditions qui constituent la science telle que nous l'entendons aujourd'hui, telle que les Grecs l'ont toujours entendue. Elle est absolument indépendante, et elle a pour but, comme la sagesse des Grecs, de comprendre le monde et l'homme. Sans doute, elle les étudie fort mal l'un et l'autre ; mais elle en a fait son occupation unique ; et dans l'histoire générale de l'esprit humain, elle doit tenir une place considérable avec les six écoles qui la divisent et la composent. Quelle est la date de cette philosophie? A quel moment la rapporter? C'est là tout ce qui nous intéresse ici. On avait cru longtemps que l'une au moins de ces écoles, celle du Sânkhya-ath de Kapila, avait précédé l'apparition du Bouddhisme; et comme le Bouddha est mort en l'an 543 avant l'ère chrétienne, le Sânkhya devenait à peu près le contemporain de Thalès et de nos philosophes. A la suite du Sânkhya, on classait les autres écoles dans un ordre systématique et plus ou moins arbitraire, les faisant toutes plus récentes que lui, et par conséquent, postérieures à la philosophie de l'Asie-Mineure. Aujourd'hui, cette opinion ne parait plus soutenable, et les plus instruits des Brahmanes s'accordent à mettre le Sânkhya lui-même assez longtemps après le Bouddhisme. La philosophie n'est apparue dans l'ancienne religion que pour combattre ou tout au moins atténuer l'hérésie. Le Sânkhya, athée et spiritualiste tout ensemble, ne serait qu'une tentative de conciliation entre les croyances de la religion nouvelle et les croyances issues du Véda. Le Nyâya ou la Logique serait venue même avant le Sânkhya, pour les besoins de la discussion; et le Védânta serait postérieur à tous deux (36). Je n'ai point à entrer dans des discussions de ce genre; et je ne veux pas pousser cet examen au-delà de ce que je viens d'en dire; ce serait fort inutile. II est clair pour nous qu'à placer même le Sânkhya avant l'apparition du Bouddhisme, les Grecs n'ont pu en rien connaître quand ils commençaient eux-mêmes à philosopher. Les voyages de Pythagore, en supposant qu'ils l'aient conduit jusqu'à Babylone et à Suse, ne lui ont pas appris des systèmes qui n'étaient pas nés encore dans le Pandjab ou sur les bords du Gange. II faut ajouter que les Darçanas de la philosophie hindoue, tels qu'ils nous sont connus depuis Colebrooke, et par tous les renseignements postérieurs à ses fameux Mémoires, n'ont quoi que ce soit de commun avec les systèmes de la philosophie grecque de ces premiers temps. Ni dans Thalès, ni dans Pythagore, ni dans Xénophane, on ne peut surprendre aucune trace de ressemblance et d'imitation; et cela se conçoit, puisque, selon toute apparence, la philosophie brahmanique ne s'est développée que deux ou trois siècles plus tard. Sortant de l'Inde, il serait bien plus inutile encore de pousser nos recherches jusqu'à la Chine. Lao-Tseu passe pour avoir vécu dans le VIe siècle avant l'ère chrétienne; mais les premiers philosophes grecs, eussent-ils lu le Tao-té-King, le Livre de la Voie et de la Vertu, qu'auraient-ils pu y trouver à leur usage (37) ? Ainsi, ni la Chine, ni l'Inde, ni la Perse, ni même l'Égypte, n'ont inspiré aux Grecs leur philosophie. Je dirai, tout à l'heure, quelle part d'influence les doctrines égyptiennes ont pu exercer sur celle de Pythagore ; mais, d'une manière générale, on peut affirmer que la philosophie grecque. considérée à son berceau, est profondément originale ; et que l'idée de la science telle qu'elle a été conçue alors, l'a été pour la première fois par l'esprit humain. C'est là un très grand résultat. Je m'y fie d'autant plus volontiers qu'il n'est pas nouveau. Les considérations qui précèdent le démontrent; mais bien avant moi d'autres avaient émis cette opinion, sans en avoir déjà toutes les raisons que nous en possédons aujourd'hui. Le docte et consciencieux Brucker, qui écrivait voilà juste un siècle, avant d'arriver à la philosophie grecque, recherche les débuts de la philosophie dans la terre entière ; il interroge successivement les Hébreux, les Chaldéens, les Perses, les Indiens, les Arabes, les Phéniciens, les Égyptiens, et une foule d'autres peuples. Il n'y rencontre pas la philosophie, qu'il leur demande bien en vain ; et, abordant enfin la Grèce : « Maintenant, dit-il, arrivons-en aux Grecs, ce peuple illustré, dès le berceau même de la nation, par la culture de la sagesse et des arts, chez qui la philosophie a enfin trouvé son siège si longtemps désiré, après, que ce peuple eut reçu des barbares quelques germes de la connaissance des choses divines et humaines. » Puis, après avoir étudié les vieilles théogonies allégoriques et la philosophie politique des Sages, le grave historien de la philosophie ajoute, en parlant de l'école d'Ionie : « Jusqu'ici, nous n'avons considéré la philosophie des Grecs que dans les bégaiements de son berceau et de son enfance; mais nous voilà parvenus maintenant à cette époque où l'esprit humain commence à faire de la philosophie véritable, et à se montrer, par ses méditations régulières, sérieusement curieux de pénétrer la vérité des choses. C'est au génie des Grecs qu'il faut rapporter cette gloire, ainsi que je l'ai démontré, au seuil même de cette histoire, en recherchant les origines réelles de la philosophie (38). » Pour ma part, je ne fais que répéter Brucker, et je m'estime heureux de m'appuyer sur cette respectable et solide autorité, qui a devancé de cent ans les lumières plus précises de notre âge. Ma conclusion est comme la sienne : Oui, la Grèce est absolument originale; elle a donné tout au monde, et le monde ne lui a rien donné, si ce n'est peut-être des semences partout ailleurs stériles, qu'elle seule a su féconder. Je ne m'étendrai pas sur les systèmes de Thalès, de Pythagore et de Xénophane. Je les suppose connus, dans la mesure où ils peuvent l'être, d'après les rares fragments qui ont surnagé. Je me borne à quelques remarques très générales. Il est évident que, de ces trois systèmes, le plus complet et le plus grand de beaucoup, c'est celui de Pythagore. Nous ne pouvons l'entrevoir que par les analyses qui en ont été faites, sept ou huit siècles plus tard, par des esprits peu distingués ; mais elles suffisent pour nous montrer que les études embrassées par le sage de Samos étaient infiniment plus vastes, et en même temps plus exactes que toutes celles de ses contemporains. La philosophie y est déjà presque tout entière avec les parties essentielles qui la composent; et de plus, la culture des sciences, spécialement des mathématiques, est poussée très avant. Par malheur, le personnage de Pythagore, ainsi que sa doctrine, reste entouré d'une obscurité que rien ne peut dissiper. Ces ténèbres sont venues, sans doute, en grande partie, du silence qu'il a gardé lui-même, et qu'il a imposé à ses disciples, restés fidèles à cette prescription rigoureuse pendant plusieurs générations. Philolaüs, un peu antérieur à Platon, fut le premier qui enseigna la règle, à ce qu'on assure, et qui divulgua le système et peut-être aussi les livres du maître. Ce qui n'est pas moins certain, c'est que Pythagore, tout philosophe qu'il est, conserve, à nos yeux, quelque chose de l'hiérophante, si ce n'est dans ses idées, au moins dans la société qu'il organise et où l'on n'entre que par une sévère initiation. Le Pythagorisme n'est pas ouvert aux profanes comme le naturalisme de Thalès, ou la métaphysique de Xénophane. Pythagore a des élèves; mais ils font partie d'une communauté régulière, soumise aux plus strictes observances et renfermée dans des limites infranchissables; c'est une sorte de cité philosophique, religieuse et politique, étroite et rigide. Elle porte bientôt ombrage à ses voisins, qui la détruisent par le fer et par le feu, d'autant plus aisément qu'elle est toute pacifique. Évidemment, cette organisation de l'école pythagoricienne rappelle les collèges des prêtres Égyptiens, et peut-être aussi ceux des Mages. La métempsycose est un dogme tout oriental, qui ne s'est point naturalisé dans le monde Hellénique, quoique Platon l'ait pris sous son patronage. Pythagore, tout ensemble le fondateur d'une école, le chef d'une association, l'initiateur d'une doctrine qui ne s'adresse qu'à des adeptes, est le seul parmi les philosophes Grecs à nous présenter ces aspects. On doit croire que ce sont ses voyages en Égypte et en Chaldée qui lui ont inspiré de tels desseins, transportés dans des pays auxquels ils convenaient si peu. Pythagore en a gardé une auréole au moins aussi sainte que scientifique; il reste à part, au milieu de tout ce qui l'a précédé et de tout ce qui l'a suivi. Sa doctrine est incomplète, mais grandiose et majestueuse; sa morale est d'une irréprochable pureté, que celle de Platon n'a pas même surpassée, tout en étant beaucoup plus profonde. Laissant de côté les individus, on peut remarquer que la philosophie Grecque tout entières été placée dans cette condition exceptionnelle, et très favorable, de n'avoir point devant elle une religion fondée sur des livres sacrés. En Égypte, en Judée, en Perse, et dans l'Inde, il en est autrement. Non seulement la religion dans ces contrées a précédé la philosophie comme partout ailleurs ; mais de plus, elle s'est appuyée sur des monuments réputés divins. Pendant de longs siècles, elle a suffi à tous les besoins moraux et intellectuels de ces peuples. Plus tard, la philosophie est sortie des sanctuaires. Dans l'Inde Brahmanique ou Bouddhiste, par exemple, elle a pu se développer avec une grande fécondité, si ce n'est avec un grand succès, libre quoique toujours un peu suspecte. Dans la Grèce au contraire, ou plutôt dans les colonies Grecques de l'Asie-Mineure, il n'y a rien de semblable. La Grèce n'a jamais eu de livres divins et révélés. Orphée, Linus et les chantres antiques des premiers mystères n'ont parlé qu'en leur nom ; le polythéisme, variable et dispersé comme il l'était, n'est jamais arrivé à se concentrer dans un corps de doctrines qui pût devenir une orthodoxie. Jamais les pontifes n'ont formé une corporation puissante et dominatrice ; on les révérait, on ne leur obéissait pas. Quelques croyances communes modifiées par les diversités infinies des légendes locales, quelques cérémonies générales qui n'avaient rien d'obligatoire, des oracles que l'on consultait à son gré, des jeux solennels, voilà les liens très relâchés de l'Hellénisme. Le seul livre qui l'ait passionné, c'est une épopée. Mais une épopée charme les esprits et ne les conduit pas; elle ravit les cœurs, mais n'impose pas la foi; elle entretient de nobles sentiments par des souvenirs patriotiques, mais elle ne règle pas les mœurs. Un poème épique n'est ni la Bible, ni le Zendavesta, ni les Mantras du Brahmanisme, ni la Triple Corbeille des Bouddhistes. A vrai dire, la philosophie a été la seule religion sérieuse des Hellènes. C'est de l'indépendance absolue de la philosophie dans le monde Grec qu'est venue sa grandeur, qui nous étonne et nous instruit encore après vingt-cinq siècles. Sous la tutelle d'une religion mieux disciplinée, qui sait si elle fût née aussi promptement, si elle eût vécu d'une vie aussi énergique et aussi belle, si elle eût enfanté de tels chefs-d'œuvre et porté des fruits si savoureux? Sans doute, la race Hellénique était admirablement douée ; et elle a réussi dans le domaine de la philosophie à peu près comme dans tous les autres. Mais ces qualités merveilleuses eussent pu ne pas s'épanouir aussitôt, si la sève se fût épanchée d'abord dans d'autres canaux, et notamment dans ceux de la religion. La mythologie n'était qu'une sorte de jeu pour les imaginations; les facultés plus hautes de l'âme devaient se prendre ailleurs et chercher un aliment plus substantiel et plus vrai. Je suis très loin de nier les bienfaits des religions, et je pense qu'il est bon qu'elles aient toujours et chez tous les peuples précédé la philosophie; mais je ne puis m'empêcher de penser que, si la religion des Hellènes eut été plus sérieuse, leur philosophie et leur science l'eussent été peut-être beaucoup moins, dommage irréparable pour la Grèce, et pour nous, qui ne sommes que ses enfants et ses continuateurs. Enfin, tout en attribuant à l'Asie-Mineure et à ces petites républiques Grecques qui en occupaient les côtes, la gloire insigne d'avoir inventé la philosophie et la science, avec la poésie, la musique et tant d'autres arts, j'entends bien ne porter aucune atteinte à la gloire incomparable d'Athènes. D'abord c'était en partie d'Athènes qu'étaient sorties ces colonies si actives, si intelligentes, si poétiques, si guerrières, au temps de Codrus. C'était à Athènes que s'étaient réunis, si non que s'étaient recrutés, les Ioniens; et l'on peut croire qu'Athènes n'avait pas laissé de donner de son sang et de son esprit aux colons qu'elle ne pouvait plus abriter, et qu'elle devait bannir après un assez long séjour. Puis, ces colonies elles-mêmes ne purent conserver dans leur propre sein le germe qu'elles avaient conçu. Si Thalès reste à Milet, Pythagore quitte Samos pour Sybaris et Crotone ; Xénophane quitte Colophon pour Élée ; et la philosophie exilée un instant dans la Grande-Grèce, y compris la Sicile, trouve enfin son véritable empire dans Athènes avec Socrate et Platon, au temps d'Anaxagore, de Périclès, de Phidias et de Sophocle. Alors, elle y est le chef-d'œuvre de l'intelligence Grecque, inépuisable mère de tant de chefs-d'œuvre en tout genre. Après avoir été deux fois transplantée, elle revient au sol primitif des colonies Ioniennes, pour y produire sa fleur la plus exquise et son fruit le plus mûr. Dans la Grande-Grèce, la philosophie n'a été qu'un accident apportée par les catastrophes politiques; elle y a peu duré, quoiqu'elle y ait jeté un vif éclat. Une fois fixée à Athènes, elle y est restée plus de mille ans, depuis le siècle de Périclès jusqu'à celui de Justinien, institutrice de Rome, aïeule et rivale toujours vénérée d'Alexandrie. Athènes et l'Ionie, ou d'un seul mot, la Grèce nous apparaît donc avec une supériorité prodigieuse sur tout ce qui n'est pas elle. Nous la plaçons à une distance incommensurable de tous les peuples qui l'entourent, qui la combattent, qui la déchirent, et qui mille fois plus nombreux qu'elle ne peuvent cependant la vaincre. En fait de poésie, d'art, de science, de philosophie, que pèsent auprès des Grecs, je ne dis pas des Scythes et toutes ces nations nomades du septentrion, mais les Perses, les Hindous, et même les Égyptiens? Que serait l'antiquité sans les Hellènes? Que n'est-elle pas grâce à eux? Les historiens de l'humanité, Herder entr'autres, ont voulu découvrir les causes de cette prééminence extraordinaire dans des circonstances toutes matérielles, la configuration des lieux, le climat, les besoins du commerce, etc. Sans nier des influences de cet ordre, on peut trouver qu'elles n'expliquent pas suffisamment les choses, et qu'elles ne donnent pas le mot de ce problème délicat. Les côtes de l'Asie-Mineure, celles de la mer Égée, de l'Attique, du Péloponnèse, de la Grande-Grèce n'ont pas varié ; et néanmoins, où est l'esprit qui animait les Hellènes à ces fécondes époques? Qu'est devenue l'âme de ces peuples au milieu d'une nature immuable, toujours aussi riche et aussi belle, pour des races qui ne comptent plus dans les destinées et les progrès de l'intelligence? A cette question, il n'est guère possible de répondre autrement que par le fait lui-même. La Grèce est au-dessus de toutes les nations. Nous voyons bien comment, même d'après les débris insuffisants qui nous sont restés de ses œuvres. Mais pourquoi ce petit peuple, à un moment déterminé, dans un court intervalle de quelques siècles, a-t-il été choisi pour être la lumière et le guide immortel de tous les peuples dans l'empire de l'esprit? C'est là un secret de la Providence, impénétrable comme tant d'autres, que l'on peut admirer, mais qu'il est si difficile de comprendre. Les Grecs, qui ne pouvaient pas avoir sur le genre humain les larges vues que nous présente aujourd'hui la philosophie de l'histoire, appuyée sur tant d'observations, ont cependant essayé de s'expliquer à eux-mêmes la merveille de leur génie ; je préfère encore les interroger plutôt que de répondre à leur place. Écoutons trois témoins également dignes de foi, et presque contemporains : Hippocrate, Platon, Aristote, l'un au nom de la physiologie, l'autre au nom de la philosophie et du patriotisme, le troisième au nom de la politique. A côté d'eux, nous pourrions en attester encore la poésie; Eschyle, qui combattit à Marathon, nous donnerait son héroïque suffrage. Dans ce traité des Airs, des Eaux et des Lieux, qu'on pourrait croire une inspiration de la science moderne, Hippocrate est amené par son sujet à faire le parallèle des deux races et des deux contrées qu'il connaît si bien, pour i avoir toujours vécu : « Je veux, dit-il, en comparant l'Asie et l'Europe, montrer combien ces deux contrées diffèrent l'une de l'autre en toute chose, et faire voir que les peuples qui les habitent, n'ont entr'eux aucune ressemblance de conformation. Il serait trop long d'énumérer toutes les différences; mais me bornant à celles qui sont les plus importantes et les plus sensibles, j'exposerai l'opinion que je me suis faite. Je dis donc que l'Asie diffère considérablement de l'Europe par la nature de toutes ses productions, par celles qui viennent de la terre aussi bien que par les hommes qui la cultivent. Tout ce qui naît en Asie est beaucoup plus beau et plus grand, le climat y est meilleur, et les peuples y ont un caractère plus doux et plus docile. La cause en est dans le juste équilibre des saisons....; les bestiaux qu'on y nourrit sont florissants; leur fécondité est étonnante, et l'élevage réussit à souhait ; les hommes y sont bien développés ; ils se distinguent des autres races par la beauté de leurs formes, par leur taille avantageuse, et entr'eux ils ne diffèrent presque point d'apparence et de stature. On peut dire que c'est avec le printemps qu'une telle contrée a le plus de rapport, à cause de la constitution et de la douceur des saisons de l'année. Mais ni le courage viril, ni la patience dans les fatigues, ni la souffrance dans le travail, ni l'énergie morale ne se développent dans une telle nature, que la race soit indigène ou étrangère; et nécessairement l'amour du plaisir l'emporte sur tout le reste. Quant à la pusillanimité et au défaut de courage, si les Asiatiques sont moins belliqueux et d'un naturel plus pacifique que les Européens, la cause en est surtout dans le climat, qui n'offre de grandes vicissitudes ni de chaud ni de froid, mais dont les inégalités ne sont que peu sensibles.
Là, en effet, l'intelligence n'éprouve pas de secousses, et le corps ne subit
pas de changements extrêmes, impressions qui rendent le caractère plus farouche
et qui y mêlent une part plus grande d'indocilité et de fougue qu'une
température toujours égale. Ce sont les changements du tout au tout qui
éveillent l'intelligence humaine et l'empêchent de s'endormir dans l'immobilité.
Telles sont les causes d'où dépend, ce me semble, la pusillanimité des
Asiatiques. Il faut y ajouter les institutions. La plus grande partie de l'Asie
est soumise à des rois. Or, là où les hommes ne sont pas maîtres de leurs
personnes, ils s'inquiètent peu de s'exercer aux armes, mais uniquement de se
faire paraître impropres au service militaire; car les dangers ne sont pas
également partagés; les sujets vont à la guerre, en supportent les fatigues, et
ils meurent pour leurs maîtres, loin de leurs enfants, de leurs femmes et de
tout ce qui leur est cher. Tandis que tout ce qu'ils déploient d'activité et de
courage tourne au profit de leurs maîtres, qui grandissent et s'accroissent,
eux, n'en recueillent d'autre fruit que les périls et la mort. Il est
inévitable, en outre, que de tels hommes voient souvent les incursions de
l'ennemi et la cessation des travaux changer leurs champs en déserts. Ainsi,
ceux mêmes à qui la nature aurait donné, chez ces peuples, du cœur et
d'heureuses dispositions, seraient par les institutions politiques empêchés d'en
faire usage. La grande preuve de ce que j'avance, c'est qu'en Asie tous les
peuples, grecs ou barbares, qui, exempts de maîtres, se régissent par leurs
propres lois et travaillent pour eux-mêmes, sont les plus belliqueux de tous.
S'exposant aux dangers pour leur propre compte, ils jouissent du prix de leur
courage, ou ils subissent la peine de leur lâcheté!... Ils ne sont pas, comme
les Asiatiques, gouvernés par des rois... Chez les hommes qui sont soumis à la
royauté, le courage manque forcément. Leur âme est asservie, et ils se soucient
peu de s'exposer aux périls, de leur plein gré, pour accroître la puissance
d'autrui. Mais, au contraire, quand on n'obéit qu'à ses propres lois, et qu'on
s'expose aux dangers dans son propre intérêt et non dans l'intérêt d'un autre,
on les accepte volontiers, et l'on se jette de tout cœur dans tous les hasards,
parce qu'on recueille pour soi-même le fruit de la victoire. C'est ainsi que les
lois contribuent largement à former le courage. Dans le Ménexène de Platon, Aspasie, cette citoyenne de Milet, dont Socrate ne fait que répéter les discours, consacre un hymne à la gloire des Grecs, vainqueurs des hordes asiatiques : « Quand les Perses, maîtres de l'Asie, marchaient à l'asservissement de l'Europe, nos pères, les enfants de ce sol, les repoussèrent victorieusement. Pour bien apprécier cette valeur, transportons- nous par la pensée à l'époque où toute l'Asie obéissait déjà à son troisième monarque (40). Le premier, Cyrus, après avoir affranchi par son génie les Perses, ses compatriotes, subjugua encore leurs maîtres, les Mèdes, et régna sur le reste de l'Asie jusqu'à l'Égypte. Son fils soumit l'Égypte et toutes les parties de l'Afrique où il put pénétrer. Darius, le troisième, étendit les limites de son empire jusqu'à la Scythie par les conquêtes de son armée de terre, et ses flottes le rendirent maître de la mer et des îles. Nul n'osait résister ; les peuples étaient asservis; tant de nations puissantes et belliqueuses avaient passé sous le joug des Perses !... C'est en se reportant à ces circonstances, qu'on pourra estimer ce qu'il y eut de courage déployé à Marathon par ces guerriers qui soutinrent l'attaque des barbares, châtièrent l'insolent orgueil de toute l'Asie, et qui, par ces premiers trophées, apprirent aux Grecs que la puissance des Perses n'était pas invincible, et qu'il n'y a ni multitude ni richesse qui ne cèdent au courage... Il faut donc déférer la première palme à ces guerriers. La seconde appartient aux vainqueurs des journées navales de Salamine et d'Artémise. Ceux de Marathon avaient appris aux Grecs qu'un petit nombre d'hommes libres suffisaient pour repousser sur terre une multitude infinie de barbares ; mais il n'était pas encore prouvé que cela fût possible sur mer... Ils méritent donc des éloges ces braves marins qui délivrèrent les Grecs de leur frayeur, et rendirent les vaisseaux des Perses aussi peu redoutables que leurs soldats. Le troisième fait de l'indépendance grecque, en date et en vaillance, est la bataille de Platée, la première dont la gloire ait été commune aux Lacédémoniens et aux Athéniens. La conjoncture était critique, le péril imminent; ils triomphèrent de tout. Tant de vertu mérite nos éloges et ceux des siècles à venir. » Et Aspasie, à quoi attribue-t-elle ce courage et cette gloire? A une seule cause, à la liberté, dont jouissait Athènes : « Voilà pourquoi les ancêtres de ces guerriers et les nôtres, et ces guerriers eux-mêmes nés si heureusement, et élevés au sein de la liberté, ont fait tant de belles actions publiques et particulières dans le seul but de servir l'humanité (41). »
Le panégyrique est au niveau des hauts faits qu'il loue ; Aspasie est digne de prononcer l'éloge
d'Athènes et de ses enfants; et quand Ménexène remercie Socrate en le quittant,
il ne peut s'empêcher de s'écrier :
«
Par Jupiter, Aspasie est bien heureuse de pouvoir, étant femme, composer de
pareils discours._ » Le jeune homme avait raison ; mais il pouvait ajouter que
cette femme était de Milet, et que ses aïeux, plus faibles encore qu'Athènes,
avaient aussi plus d'une fois combattu les Perses, avant qu'Athènes ne les
vainquit. « Pour se faire une idée de ces qualités, on n'a qu'à jeter les yeux sur les cités les plus célèbres de la Grèce et sur les diverses nations qui se partagent la terre. Les peuples qui habitent les climats froids, même dans l'Europe, sont en général pleins de bravoure ; mais ils sont certainement inférieurs en intelligence et en industrie. Aussi ils conservent bien leur liberté; mais ils sont politiquement indisciplinables, et ils n'ont jamais pu conquérir leurs voisins. En Asie, au contraire, les peuples ont plus d'intelligence et plus d'aptitude pour les arts; mais ils manquent de cœur, et ils restent sous le joug d'un esclavage perpétuel. La race grecque, qui topographiquement est intermédiaire, réunit les qualités des deux autres. Elle possède à la fois l'intelligence et le courage. Elle sait en même temps garder son indépendance et former de très bons gouvernements, capable, si elle était réunie en un seul état, de conquérir l'univers (42). » Voilà ce qu'ont pensé trois hommes tels qu'Aristote, Platon et Hippocrate, sur le génie de la Grèce. Ils n'ont pas nié les influences extérieures, dont l'action est trop visible ; mais ils se sont surtout attachés aux causes morales. Ils ne se sont pas trompés. Aujourd'hui même, quoique nous soyons plus éclairés par une plus longue expérience, que pourrions nous ajouter à des considérations si justes et prises en quelque sorte sur le fait ? Que la Grèce reste donc ce qu'elle a été, ensevelie dans sa gloire, mais immortelle autant que peuvent l'être les œuvres de l'homme, naissant à un certain jour, et destinées inévitablement à périr, toutes belles et toutes parfaites qu'elles sont. Je voudrais terminer ici cette préface déjà trop longue ; mais elle ne serait pas complète, si je ne revenais aux deux traités qui en ont été l'occasion, et si je n'insistais sur la grande question à laquelle s'est principalement arrêtée l'école d'Élée, représentée par Xénophane et Mélissus : je veux dire l'unité et l'immobilité de l'être. Qu'est-ce que signifie cette discussion surgissant au début de la philosophie, et soulevée par des hommes qui se sont mêlés à toutes les choses pratiques de la vie, guerre, politique, voyages, colonisations ? Outre qu'ils sont philosophes et spéculatifs, nous les voyons tous agir avec une énergie qui nous étonnerait, si nous ne connaissions les mœurs et les nécessités terribles de ces temps agités. Thalès est à l'armée d'Alyatte, et il délibère au Panionium ; Pythagore parcourt longtemps les pays étrangers, malgré tous les périls et toutes les traverses ; Xénophane, exilé volontaire de sa patrie subjuguée par les Perses, va rejoindre les Phocéens au-delà des mers; Mélissus défend Samos contre les Athéniens, avec une vigueur que Périclès ne surmonte qu'à grand-peine. Voilà des généraux et des hommes d'état qui s'occupent de métaphysique, chose toujours fort rare; et de plus, voilà des hommes d'action qui semblent se perdre dans des subtilités, dont on a accusé, trop souvent avec raison, l'école Éléatique. A en juger par le Parménide de Platon, ces critiques seraient assez méritées ; et l'on pourrait à bon droit être surpris que ces minuties dialectiques aient absorbé l'attention de pareils esprits. Mais il faut bien le remarquer : Parménide, quoique disciple et successeur de Xénophane, est déjà sur une autre voie que son maître ; il dénature, et il exagère ses idées, peut-être sous l'influence de cet esprit général de la Grande-Grèce, qui inventait alors l'art de la rhétorique en Sicile, et qui déjà poussait à l'excès les théories Pythagoriciennes sur les nombres. Ce n'est pas là l'esprit de Xénophane, autant qu'on en peut juger par les fragments qui nous restent de lui, et par le traité même dont je donne la traduction, Selon moi, voici le point de vue auquel il convient de se placer pour apprécier au vrai la valeur ou l'insuffisance de ces doctrines, s'essayant alors, et mal affermies dans l'intelligence des hommes qui s'éveillait. Le premier coup-d'oeil jeté sur la nature, au milieu de laquelle nous vivons, nous en montre tout d'abord l'unité ; ce n'est que plus tard, et par l'effort de l'analyse, que nous distinguons des parties diverses dans cet ensemble et dans cette totalité, dont la splendeur nous éblouit et dont l'étendue nous frappe et nous déconcerte. L'Inde, soit antérieure, soit postérieure à la philosophie Grecque, n'a jamais pu sortir de cette impression accablante de l'unité ; elle s'y est absorbée tout entière, et la science. proprement dite lui est demeurée absolument étrangère durant toute son existence. Des théories plus ou moins hardies, des intuitions plus ou moins raisonnables sur le principe universel des choses, jamais d'études spéciales et positives sur les phénomènes naturels, tel est l'écueil et la grandeur du génie Indien. On ne trouve rien de plus dans les Védas, les Brahmanas, les Oupanishads, les épopées, les codes, et même dans les Darçanas philosophiques. Mais pour le génie Grec, il a évité cette fascination et ce péril. S'il s'est appliqué un instant à l'idée de l'unité, par bonheur il a su bientôt s'en détacher, pour considérer de plus près et avec plus de succès quelques-unes des portions principales de cette unité, qui n'est pas autre chose que le reflet de l'infini lui-même. Cela est si vrai que, tout en cherchant à expliquer le monde, Thalès étudie le principe matériel dont il est formé. Quoique se trompant sur ce principe, qu'il voit dans l'eau, c'est cependant à l'observation de la nature qu'il s'adresse et qu'il demande le secret des choses. Il fait de la géométrie, et il suit curieusement le cours des astres, puisqu'il est peut-être en état de prédire une éclipse de soleil. Selon Aristote, dont le témoignage est décisif, Thalès admettait que l'univers était plein de Dieux, qui y entretenaient l'âme et le mouvement. Pythagore n'est pas moins fidèle à l'idée de l'ensemble, tout en le décomposant; ses découvertes en mathématiques et en astronomie ne lui font pas perdre de vue un seul instant l'harmonieux arrangement du monde, dans lequel il reconnaît des catégories, mais où il reconnaît surtout une admirable unité. Pour lui, les contraires forment toujours, deux à deux, un tout, qui leur est supérieur. C'est l'unité qui est le principe véritable dans l'univers matériel, aussi bien que dans les nombres ; Pythagore s'élève ainsi à la notion de Dieu, sans le distinguer suffisamment du monde, qu'il ordonne et qu'il régit. Dans Xénophane, la pensée d'un Dieu un et tout puissant est éclatante, sans être encore approfondie, comme elle doit l'être plus tard dans Platon, et surtout dans la théologie chrétienne. Je crois que c'est cette première vue de l'unité divine qui a jeté ses éblouissements et ses obscurités dans les théories de l'école d'Élée. A mon sens, c'est ainsi qu'on doit expliquer les erreurs de cette noble doctrine. Le regard de Xénophane ne s'étend pas très loin, si l'on veut ; mais du moins il ne s'égare pas. Parménide incline déjà aux sophismes, qui porteront son disciple, l'intrépide Zénon, à nier le mouvement, et Gorgias, à soutenir le nihilisme le plus faux et le moins sincère. Mélissus tient, en quelque sorte, le milieu entre le fondateur du système et ceux qui l'ont poussé à l'extrême et à l'absurde. Je rapproche Xénophane et Mélissus, et voici. les différences principales qui m'apparaissent de l'un à l'autre. Plein de respect et de piété pour cette grande idée, que personne, jusqu'à lui, n'avait conçue aussi nettement, Xénophane écarte avec le même soin les fictions gracieuses, mais dégradantes, des poètes et l'anthropomorphisme grossier du vulgaire. Dieu n'a ni les vices, ni la figure des mortels et des misérables humains qui le font à leur image. Dans l'univers, il n'est rien qui lui ressemble ; car pourquoi le semblable serait-il créateur plutôt que créé? Dieu, qui ne peut venir d'un être qui lui ressemblerait, peut venir bien moins encore de ce qui serait au dessous de lui. Il ne vient donc de rien ; il est nécessairement éternel. Par une conséquence non moins nécessaire, il est tout-puissant. S'il y avait plusieurs dieux, ces dieux seraient plus forts ou plus faibles les uns que les autres. Il n'y aurait donc plus de Dieu ; car le propre de Dieu, c'est de dominer tout et de n'être dominé par qui que ce soit. Éternel, tout-puissant, Dieu est un ; car s'il avait à côté de lui des rivaux, il ne pourrait accomplir ses décrets et sa volonté souveraine. Voilà, dans la théodicée de Xénophane, quelques principes excellents, que la théologie chrétienne n'a pas repoussés, et qu'elle a même soigneusement recueillis. Mais ici la vue de Xénophane se trouble, ce qui. n'a rien de surprenant; et voulant pénétrer dans la nature plus intime de Dieu, il fait des faux pas sur cette route ardue, où tant d'autres que lui ont échoué. A l'entendre, Dieu, qui ne ressemble à aucun autre être, est du moins semblable à soi ; il est pareil dans toutes ses parties, et tout entier dans chacune d'elles. Ceci peut être encore admis ; mais Xénophane, retombant dans des métaphores qui ne valent pas mieux que l'anthropomorphisme critiqué, par lui si justement, compare Dieu à une sphère. En conséquence, il déclare que Dieu ne peut être ni infini ni fini, qu'il ne peut avoir ni mouvement ni repos, pas plus qu'il n'a ni commencement, ni milieu, ni fin. D'ailleurs, Xénophane ne se fait pas illusion sur les difficultés insondables de cette question, et dans de très beaux vers, que nous a conservés Sextus Empiricus, il s'écrie : « Il n'est pas de mortel qui ait pu voir clair dans ces profondeurs; il n'y en aura pas qui puisse jamais savoir à fond ce que sont les Dieux et l'univers, dont j'essaie de parler. Si quelqu'un, par hasard, rencontrait un jour la vérité complète, il ne saurait pas lui-même jusqu'à quel point il la possède ; et sur tout cela, il n'y a jamais eu que vraisemblance. » Parménide ne paraît pas être allé aussi loin que son maître sur ce grand sujet. Zénon, élève de Parménide et fondateur de la Dialectique, si l'on en croit Diogène de Laërte citant Aristote, en arriva bientôt à ce scepticisme que Gorgias devait porter à son dernier terme. Mais, encore une fois, je n'ai point à m'occuper ni de Zénon ni de Parménide ; et j'en arrive à Mélissus, que je dois seul étudier encore après Xénophane. Mélissus, quoique séparé du chef de l'école par trois ou quatre générations, est plus fidèle à son exemple et à ses enseignements. Seulement, au lieu de rester attaché au Dieu de Xénophane, éternel, un, tout puissant et peut-être aussi tout intelligent, il dévie ; à la place de Dieu, c'est à l'être qu'il s'adresse, l'être pris dans toute son abstraction et dans toute sa stérilité. Mais les spéculations du métaphysicien, bien qu'elles ne soient plus aussi justes, n'en sont pas moins encore d'une beauté et d'une profondeur singulières. L'être ne peut venir de l'être ; car alors, il se précéderait lui-même, ce qui est contradictoire. Ce qui ne le serait pas moins, c'est qu'il pût venir du néant. L'être n'a donc pas été produit à un instant quelconque ; l'être est donc éternel. Il ne peut pas davantage être détruit ni finir ; car ou il se changerait en néant, ce qui est impossible ; ou il se changerait en un autre être, ce qui n'est plus périr. L'être a donc toujours été, et il sera toujours. S'il n'a pas été produit, il n'a pas de commencement ; s'il ne peut être anéanti, il n'a pas de fin. Or, sans fin et sans commencement, il est précisément infini. S'il est infini, il est un ; car l'infinitude exclut la pluralité. Deux infinis ou plusieurs infinis sont inintelligibles. Éternel, un, infini, l'être est par conséquent immobile et immuable; car en quel lieu pourrait-il se mouvoir autre que lui-même? Doué d'une unité absolue, quelle modification, quel changement, quelle altération pourrait-il subir ? S'il pouvait jamais devenir autre en quoi que ce fût, il ne serait plus semblable à lui-même. Sa première forme périrait, une forme nouvelle viendrait à être, et avec le progrès du temps, cet être éternel et infini disparaîtrait et serait réduit à n'être rien. L'être, étant éternel, infini, un, ne peut avoir de corps ; il ne peut être matériel ; car alors, il aurait des parties distinctes, et c'en serait fait de son unité, de son infinité, de son éternité. Il n'y a que l'être qui existe et soit réellement ; toutes les choses, dont nos sens nous affirment l'existence, ne sont que des apparences plus ou moins trompeuses et fugitives; elles ne sont pas à proprement parler, puisqu'elles changent et qu'elles périssent après être nées. Mais l'être véritable ne se modifie, ni ne change jamais; et si les choses qui nous apparaissent étaient ce que nous les croyons, elles seraient alors immuables et éternelles comme l'être lui-même. Il n'y a que l'unité qui existe, et la pluralité n'existe point. Pour ma part, je trouve ces idées de Mélissus tout à fait dignes de celui à qui on les attribue, et de l'école dont il fait partie. Elles sont sans contredit fausses à quelques égards ; mais au travers même de ces ruines et de ces fragments, on sent une grandeur et une puissance que l'histoire de la philosophie, à commencer peut-être par Aristote, n'a pas toujours appréciées avec assez de justice. J'avoue qu'après Xénophane, après Mélissus, Anaxagore, me semble plus explicable. Anaxagore, contemporain du général de Samos, est venu éclairer la physique, et la cosmologie de son temps, en introduisant cette féconde idée de l'univers régi par l'Intelligence. On sait l'admiration de Socrate pour cette doctrine, quoiqu'Anaxagore, à son avis, n'en eût pas tiré tout ce qu'elle contenait ; on sait l'éloge magnifique d'Aristote, disant qu'après tant d'aberrations, Anaxagore faisait l'effet d'un homme de bon sens venant parler raison au milieu d'insensés (43). Il serait inique de diminuer la gloire d'Anaxagore et de la contester contre Socrate et Aristote ; elle lui appartient bien toute entière, et ce n'est pas la première fois qu'un mot de génie a été comme une révélation. Mais on peut trouver que Xénophane et même Mélissus l'avaient préparée par des théories qui s'en rapprochaient beaucoup. On doit revendiquer pour eux ce mérite, qui ne laisse pas d'être encore assez haut. Tel est le sens véritable de ce système de l'unité dans l'école d'Élée, si souvent obscurcie et rapetissée à des proportions peu exactes. L'unité Éléatique n'est pas autre chose que Dieu, recherché, entrevu, étudié, comme on pouvait le faire à ces débuts de la science et de l'observation; ce n'était pas encore tout à fait l'Intelligence d'Anaxagore, encore bien moins la providence de Socrate et de Platon ; mais c'était le pressentiment certain de tout cela ; et malgré les justes critiques qu'on peut adresser à l'école dont Xénophane est le chef, ce sont ces vues sublimes qui font sa grandeur et son importance dans l'histoire de la philosophie. Je m'arrête ici, et je résume, pour plus de clarté, les idées que je viens de développer, avec moins de concision peut-être que je n'eusse voulu le faire. L'avènement de la philosophie dans notre monde occidental m'a paru un fait si considérable que j'ai voulu l'entourer de toutes les lumières suffisantes, en interrogeant l'histoire sur les peuples et sur les circonstances au milieu desquelles il s'est produit. Il est très remarquable que ce fait se soit passé au contact de l'Europe et de l'Asie, et à leur première rencontre, la guerre de Troie, où elles s'étaient heurtées auparavant, étant laissée de côté, comme fabuleuse ou tout au moins comme trop peu connue. Ce contact a eu lieu sur un espace de terre où les colonies Grecques avaient à peine la place de se mouvoir ; c'est à une époque relativement barbare, mais pleine d'une fécondité qui depuis lors ne s'est jamais renouvelée. L'Asie-Mineure est l'antécédent d'Athènes, qu'elle a même dépassée à quelques égards, témoin Homère. Mais l'Asie, qui avait conçu ce germe admirable sous l'influence de peuples qui lui étaient étrangers, n'a pas pu le développer ; pour qu'il parvint à toute sa puissance et à toute sa perfection, il fallut qu'il retournât à l'antique contrée d'où il était sorti cinq ou six siècles antérieurement. J'ai cherché, en outre, à montrer que, dans cette production virile, le génie Hellénique, à qui le monde la doit, ne devait rien qu'à lui-même. Les peuples voisins ne lui ont donné que de très vagues inspirations, si toutefois il en a reçu quelque chose. Les Égyptiens, les Chaldéens, les Hindous tiennent une grande place dans le passé de l'humanité; mais en philosophie et d'une manière plus générale, en fait de science, ils ne sont rien à côté de la Grèce, et certainement ils ne l'ont pas instruite. La philologie comparée a constaté, de nos jours, que la langue de l'Iliade et celle du Véda étaient au fond une seule et même langue, et que le Grec et le Sanskrit sont deux frères issus d'une mère commune. Mais si l'origine, rejetée dans des temps que l'histoire ne peut atteindre, est la même, les destinées ont été tout autres. Le monde Grec a produit les lettres, les sciences, les arts que nous cultivons sur ses traces ; il a contribué, pour une part immense, au progrès de la civilisation chrétienne, telle que nous en jouissons. Le monde Hindou a produit le Brahmanisme et le Bouddhisme, relégué au-dessous de nous, on sait à quelle distance, malgré des qualités de plus d'un genre, qu'il serait injuste de méconnaître. Entre le monde Grec et le monde Hindou, la Perse, qui est leur intermédiaire par les lieux aussi bien que par les temps, n'a joué presqu'aucun rôle, et la Grèce n'en a tiré que la gloire impérissable des Miltiade, des Léonidas, des Thémistocle et des Alexandre. Cependant l'Inde, la Perse, la Grèce, l'Égypte, la Judée même, toutes différentes qu'elles sont entr'elles, et avec les diversités intellectuelles qui les séparent, appartiennent toutes les cinq à une race unique. L'ethnologie, qui ne doit pas usurper trop d'importance dans ces études, mais qui ne doit pas non plus en être tout à fait bannie, découvre une identité manifeste, sous les oppositions de mœurs, d'esprit et de langage. Cette race supérieure est celle qui est appelée Indo-Caucasique. Les peuples Sémitiques eux-mêmes en relèvent comme les autres, bien que leurs aptitudes soient absolument distinctes, toutes puissantes en fait de religion, infécondes pour presque tout le reste. Mais dans cette vaste et belle famille, qui a comme le monopole de la véritable intelligence, c'est la Grèce, qui, tout compris, occupe encore le premier rang ; lorsque jadis elle dédaignait le monde entier sous le nom de Barbares, son orgueil n'était pas aussi mal inspiré qu'on pouvait le croire ; quoiqu'il eût mieux valu être plus modeste, les Hellènes, guidés par un sûr instinct, ne se trompaient pas trop ; et aujourd'hui que nous pouvons prononcer impartialement, c'est toujours à eux que nous décernons la palme. L'avenir, quel qu'il puisse être, aura bien de la peine à la leur ravir ; pour ma part, je ne balance pas à la leur assurer, sans nier la grandeur, et, même à quelques égards, la supériorité de leurs rivaux. Mais qui peut-on mettre au-dessus des Hellènes, quand ils se présentent à nous avec la poésie, les lettres et les arts, avec les sciences, la philosophie et l'histoire?
Enfin, j'ai essayé de marquer, dans ce berceau de la philosophie naissante, la
place de l'école d'Élée, et le mérite spécial de Xénophane et de Mélissus, entre
Thalès et Pythagore. C'est elle qui a instruit Rome; et c'est par Rome et par la Grèce que le Christianisme nous a conquis et civilisés, profitant lui-même de tout ce qui l'avait précédé et lui frayait la route. La science sous toutes les formes avait manqué à l'orient ; c'est la Grèce qui l'a inventée et qui nous l'a transmise (44). Rome, et le monde moderne tout entier depuis l'invasion des barbares, n'ont fait que suivre cette trace, parfois bien effacée, mais jamais perdue. En m'efforçant de jeter un jour nouveau sur ces premiers vestiges, j'ai voulu rendre justice à nos ancêtres et nous rappeler nos devoirs en rappelant leurs titres et leurs services. L'intelligence humaine marche bien lentement, quoi qu'elle en puisse penser ; et dans la route indéfinie qu'elle parcourt, il est bon qu'elle porte quelquefois ses regards en arrière, pour voir d'où elle est partie, et mieux conduire ses pas dans l'avenir illimité qui l'attend.
Février 1866.
(01) Voir plus loin, pages 191 et
suivantes, la Dissertation spéciale sur l'authenticité et le caractère du Traité
sur Mélissus, Xénophane et Gorgias.
|