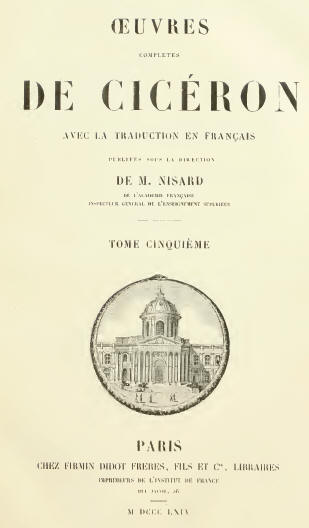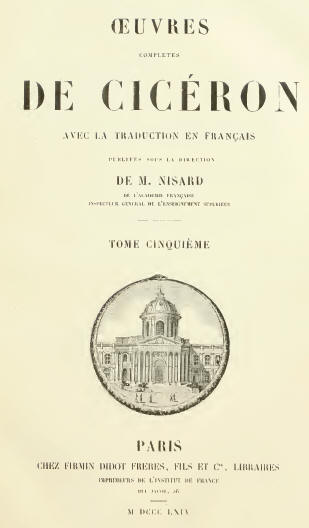|
250. — A M.
CÉLIUS, ÉDILE CURULE. Laodicée, février.
F. II, 14. Marcus Fabius est
mon intime : c'est un homme de bien par excellence et des plus
instruits , mais ce n'est pas seulement pour son esprit et son
savoir que je l'aime, c'est encore pour sa modestie, qui est sans
égale. Je vous recommande son affaire comme s'il s'agissait de mes
propres intérêts. Or je connais vos allures, à vous autres grands
avocats. C'est peine perdue de s'adresser à vous, si l'on n'a tué
son homme. Mais ici point d'excuse, je n'en reçois pas. Et pour peu
que vous ayez d'amitié pour moi, vous quitterez tout pour prêter
votre appui à Fabius, à sa première réclamation. J'attends avec
impatience des nouvelles de Rome. J'en suis sevré absolument. Je
désire par-dessus tout savoir comment vous vous portez. L'hiver qui
se prolonge nous prive depuis longtemps de toute communication.
251. - A PETUS.
Laodicée, février.
F. IX, 25. Me voilà devenu,
grâce à votre lettre, le premier capitaine du monde. Je ne vous
aurais jamais cru si profond dans le grand art de la guerre. Vous
avez, je le vois bien, lu et relu les livres de Pyrrhus et de Cinéas.
Aussi veux-je mettre vos leçons en pratique. J'y ferai une seule
addition ; j'aurai une petite escadre mouillée sur la côte. On dit
qu'il n'y a pas de meilleure tactique contre la cavalerie des
Parthes. Je plaisante ! 237
mais vous ignorez à quel général vous avez affaire. Je savais à fond
en théorie l'institution de Cyrus. Je l'applique aujourd'hui d'un
bout à l'autre sur le terrrain. — Mais avant peu, j'espère, nous
rirons bien sur ce chapitre; maintenant, soyez attentif au
commandement, comme disaient nos anciens, c'est-à-dire, soyez prêt à
obéir. Je suis intimement lié avec M. Fabius, vous le savez, je
pense. Fabius est un homme que j'aime passionnément, d'abord pour sa
parfaite droiture et sa rare modestie, puis pour l'appui excellent
qu'il me prête toujours dans mes querelles avec les Épicuriens vos
chers compagnons à boire. Il est venu me joindre à Laodicée, et je
le pressais de rester avec moi, quand il a reçu, comme un coup de
foudre, l'abominable nouvelle que Q. Fabius son frère mettait en
vente une terre d'Herculanum, qui leur appartient en commun. M.
Fabius est outré de ce procédé ; et il se persuade que son frère,
qui n'a pas le moindre caractère, ne se porte à cette extrémité que
par de perfides suggestions. Prouvez-moi votre amitié, mon cher
Pétus, en vous chargeant d'arranger cette affaire, et de tirer
Fabius d'embarras. Il nous faut votre autorité, vos conseils, je
dirai même votre gracieuse intervention. Prévenez un éclat entre les
deux frères, et ne laissez pas engager un procès scandaleux. Les
ennemis de Fabius sont Maton et Pollion. Je n'ajoute rien.
J'écrirais des pages entières que je ne vous exprimerais jamais
assez ma reconnaissance, si vous rendez à Fabius sa tranquillité. Il
croit que cela dépend de vous, et il m'en a convaincu.
252. — A C.
CURTIUS PÉDUCÉUS, Laodicée, février.
F. XIII, 59. J'aime tendrement
M. Fabius. Nous avons des rapports intimes, et c'est une liaison qui
date de loin. Je ne vous demande pas quelle sera votre décision dans
le procès qui l'intéresse. Vous suivrez là-dessus votre édit et vos
principes, comme l'exigent l'honneur et le devoir. Mais je vous
demande de lui donner ses entrées libres chez vous, et de lui
accorder tout ce qui sera conforme à l'équité, afin qu'il voie
qu'entre nous, malgré l'éloignement, l'amitié n'a rien perdu de ses
droits. Je vous le demande avec instance.
253. — A C.
TITIUS RUFUS, PRÉTEUR URBAIN. Cilicie, février.
F. XIII, 58. L. Custidius et
moi nous sommes de la même tribu, de la mémo ville, et de plus amis,
lia un procès. Ce procès est porté devant vous. Je vous recommande
Custidius, en tant que votre devoir et mon propre caractère le
permettent. Seulement, qu'il ait facile accès auprès de vous; qu'il
obtienne de bonne grâce tout ce qu'il demandera de juste; et
puissé-je reconnaître à votre obligeance que, si loin que nous
soyons l'un de l'autre, mon amitié est un titre auprès de vous I
254. — A APPIUS
PULCHER. Clicie, février.
F. III, 9. Enfin voici une
lettre digne d'Appius Clodius, une lettre pleine d'amabilité, de
bienveillance, d'affection. On dirait que la vue de la ville vous a
rendu tout d'un coup votre urbanité d'autrefois. Je n'avais pas été
content, je l'avoue, des deux lettres que vous m'avez écrites en
route 238 avant de
quitter l'Asie, l'une sur les députations auxquelles j'ai fait
défense de partir, l'autre sur ces travaux de constructions des
Appiens suspendues par mon ordre. Aussi, fort de mes sentiments,
ai-je mis quelque vivacité dans ma réponse. Il m'est démontré
aujourd'hui par la lettre dont vous avez chargé mon affranchi
Philotime qu'il y a plus d'une personne dans la province qui
voudrait nous voir en toute autre disposition l'un pour l'autre, et
que, vous trouvant aujourd'hui à portée de Rome et en rapport avec
les vôtres, vous avez appris d'eux quelle avait été mon attitude
pendant votre absence, et quel zèle, quel dévouement j'avais montrés
pour vous en toute occasion. Ah! combien me sont précieuses ces
paroles que je lis dans votre lettre : » que si jamais « l'occasion
se présente de me rendre la pareille, « si toutefois la pareille est
possible, vous vous garderez d'y manquer. » Rien ne vous sera plus
facile, je vous assure. Car il n'est rien qu'on ne puisse accomplir
avec le zèle, l'affection, et, pour tout dire, avec l'amitié. — Mon
opinion était faite sur votre triomphe et ma correspondance
particulière me laissait chaque jour moins d'incertitude à cet
égard. Cependant j'éprouve une joie infinie en voyant dans votre
lettre votre confiance plus forte et même tout à fait établie. Non
que je m'en applaudisse, au moins comme d'un antécédent favorable;
je ne suis pas si Epicurien. Mais, par Hercule, j'aime tout ce qui
vous honore et vous élève. Comme vous avez plus d'occasions que
personne pour ma province, étant comme le centre des communications,
faites-moi la grâce de m'écrire un mot, dès que vous aurez atteint
le but de vos espérances et de mes vœux. La sage lenteur et la
maturité des longs bancs, comme Pompée les appelle, pourront bien
vous faire perdre une journée ou deux. Mais c'est le plus. Et le
jour de l'honneur aura bientôt son tour. Si vous m'aimez et si vous
voulez que je vous chérisse, faites que j'en aie la joie le plus
vite possible. — J'attends encore de vous l'acquittement d'une
promesse et le complément d'une dette dont je ne vous ferai pas
grâce, par Hercule. Outre que je tiens à connaître le droit augurai
, je mets trop de prix à vos attentions et à vos dons. Quant au
retour que vous me demandez, rien de plus juste. Mais il faut qu'il
vous prouve toute ma reconnaissance, et l'écrivain que vous avez
parfois la bonté d'admirer, et qui met quelque amour-propre à bien
faire, tient surtout à ne pas compromettre sa réputation dans une
circonstance où le crime de l'ingratitude viendrait se joindre au
crime d'un mauvais livre. Je passe à un autre point. — Vous m'avez
promis et je vous demande, au nom de votre loyal dévouement , au nom
de notre amitié, qui n'est pas d'hier, et qui se fait déjà vieille,
je vous demande d'employer tous vos soins, tous vos efforts, pour
que les supplications me soient décernées avec le plus d'éclat et de
promptitude possible. J'ai présenté ma demande beaucoup plus tard
que je ne voulais : la mer a été d'abord véritablement odieuse.
Puis, je crains que ma lettre ne soit tombée juste au moment où le
sénat était dispersé. J'ai agi d'ailleurs sous l'influence de votre
exemple et de votre conseil ; et je crois qu'il était plus sage de
ne pas écrire au moment où l'on me proclamait imperator, et
d'attendre que de nouveaux faits, et les résultats de la campagne,
vinssent corroborer mes premiers titres. Veuillez prendre bonne note
de tout ceci 239 comme
vous m'eu témoignez l'intention. Je me recommande à vous, moi, mes
intérêts et mes amis.
255. — CICÉRON A
ATTICUS. Laodicée, 13 février.
A. V. 21. J'apprends avec
plaisir que vous êtes arrivée en Épire en bonne santé et que votre
navigation a été heureuse : si je regrette beaucoup que vous ne
soyez pas à Rome quand vous m'y seriez si nécessaire, je m'en
console par l'espoir que vous ne passerez pas l'hiver en Épire, où
vous ne trouveriez ni agrément ni tranquillité d'esprit. — La lettre
de Cassius, père de Q. Cassius votre ami, était fort modeste au prix
de celle qu'il a écrite depuis, et où il dit qu'il a mis fin à la
guerre des Parthes. Ceux-ci étaient, il est vrai, retirés d'Antioche
avant l'arrivée de Bibulus, mais nous n'en sommes pas plus en
sûreté; car ils ont pris leurs quartiers d'hiver dans la
Cyrrhestique, et l'on est à la veille d'une grande guerre. Le fils
du roi Orode est sur les terres de l'empire, et Déjotarus ne doute
pas, car il a pu le savoir d'Artavasde, dont la fille est promise à
son fils, que le roi lui-même ne passe l'Euphrate avec toutes ses
troupes au commencement de la campagne. Le jour même qu'on lut dans
le sénat la lettre triomphante de Cassius, c'est-à-dire le 7
d'octobre, on y lut aussi la mienne, où j'annonçais la guerre. Axius
notre ami m'écrit que mon rapport a obtenu toute la confiance
refusée au sien. Les lettres de Bibulus n'étaient pas encore
arrivées; je suis certain qu'elles annonceront les mêmes dangers. —
Ce que je crains de tout cela, c'est qu'on ne retienne Pompée à
Rome, dans l'appréhension de quelque trouble, si le sénat ne veut
rien accorder à César, et que, pendant ces incertitudes, le sénat
n'ordonne que nous ne partirons pas avant l'arrivée de nos
successeurs, pour éviter de confier à des lieutenants, dans de
telles conjonctures, des provinces aussi importantes. Je tremble
que, si l'on veut proroger mon gouvernement, personne n'ose s'y
opposer, surtout pendant que vous serez absent, vous dont la
prudence, le crédit et le zèle lèveraient bien des obstacles. Mais
vous me direz que je cherche à m'inquiéter. C'est malgré moi, et je
voudrais bien que ce fût sans sujet ; mais je crains tout. Vous me
rassurez cependant à la fin de la lettre que vous avez écrite en
débarquant à Buthrote : «Je compte et j'espère que vous pour« rez
revenir bientôt. » Je compte, suffisait ; pourquoi ajouter
j'espère?—J'ai reçu assez promptement, à Iconium, par les exprès des
fermiers publics, une autre lettre datée du jour du triomphe de
Lentulus, et où vous me confirmez la même espérance mêlée de
crainte; je ne dois, y dites-vous, appréhender aucune prolongation;
vous ajoutez ensuite que, si les choses tournent autrement, vous
viendrez me trouver. Cette incertitude est pour moi un supplice.
Vous voyez par cette réponse quelles lettres j'ai reçues de vous;
Hermon, l'affranchi du centurion Camula, ne m'a pas encore remis
celle que vous me dites lui avoir donnée. Pour celle dont vous aviez
chargé les gens de Lénius, comme vous me l'avez écrit plusieurs
fois, Lénius me l'a enfin rendue à mon arrivée à Laodicée, le 22 de
septembre, quoiqu'elle fût datée du 11 de février. J'ai aussitôt
convaincu Lénius du pouvoir que ces recommandations ont sur moi, et
la suite le lui prouvera. Cette lettre ne m'apprenait rien de
nouveau, I si ce n'est ce qui regarde les panthères de Cibyre.
240 Je vous approuve fort
d'avoir répondu à M. Octavius que vous ne pensiez pas que la chose
fût possible. En tout, quand vous douterez, niez comme si vous ne
doutiez pas. Je puis vous protester, et vous saurez par vous-même
que personne n'a porté plus loin que moi le désintéressement', la
justice, l'affabilité, la douceur. J'ai suivi en cela mon
inclination, et surtout vos conseils. Vous ne sauriez croire combien
l'on a été charmé de voir que, depuis mon gouvernement, aucun des
miens n'ait rien demandé, ni en son nom, ni au nom de l'État,
excepté le lieutenant L. Tullius, qui, réservé sur tout le reste,
s'est fait donner ce que la loi Julia lui permettait d'exiger, mais
seulement dans les endroits où il couchait, et non pas, comme tant
d'autres, dans tous les bourgs indifféremment. Il est le seul qui
ait reçu quelque chose. C'est à Q. Titinius que je dois ce honteux
présent. — La campagne finie, j'ai laissé à mon frère Quintus le
soin de mettre l'armée en quartiers d'hiver dans la Cilicie, et j'ai
envoyé dans l'île de Cypre pour quelques jours Q. Volusius, gendre
de votre .ami Tibérius, et celui de nies officiers dont je suis le
plus sûr, et dont le désintéressement est le plus complet. Quoique
les citoyens romains qui y trafiquent soient en petit nombre, il ne
faut pas qu'ils se plaignent d'avoir manqué déjuges, car ils ont le
droit de ne pas sortir de l'île. — Pour moi, je suis parti de Tarse
le 5 de janvier; je ne puis exprimer avec quels témoignages
d'admiration j'ai été reçu dans celte ville et dans toutes celles de
la Cilicie. Quand j'eus passé le mont Taurus, je fus accueilli avec
un empressement extraordinaire de tous les peuples de ma province
d'Asie qui, pendant six mois de mon gouvernement, n'avaient reçu de
ma part ni lettres, ni hôte quelconque. Mes prédécesseurs, au
contraire, vendaient chaque année aux villes riches, pour de fortes
sommes, le droit de ne loger pendant l'hiver aucune troupe. La seule
île de Cypre payait deux cents talents attiques, et moi, pendant mon
année, je n'en tirerai pas un sesterce ; ce n'est pas une
hyperbole', mais la vérité. Pour ces bienfaits qui les étonnent, je
n'accepte d'eux que leurs remercîments, et je refuse tous les
honneurs qu'ils veulent me décerner, statues, temples, arcs de
triomphe. Enfin je ne suis en aucune manière à chargea la province,
mais je vous le suis peut-être à vous-même, en me vantant ainsi ;
supportez-le en raison de votre amitié pour moi et de mon obéissance
à vos conseils. Je vous dirai donc que la famine même, le plus grand
de tous les maux, est devenue pour moi dans ma province où la
moisson avait manqué entièrement!, une circonstance heureuse.
Partout où je me suis présenté, je suis parvenu sans menace, sans
violence, sans contrainte, et par la seule autorité de mes
exhortations , à engager ceux des Grecs et des citoyens romains qui
avaient fait des provisions de blé, à en fournir à chaque ville une
quantité suffisante. — Je commencerai aujourd'hui, jour des ides de
février, à régler à Laodicée, les affaires de Cibyre et d'Apamée.
Aux ides de mars, je réglerai, dans la même ville, celle de Synnade
et de Pamphylie (je ferai alors chercher un cor pour Phémius); et
finissant par celle de Lycaonie et d'Isaurie, je partirai aux ides
de mai pour la Cilicie, où je passerai tout le mois de juin. Je
voudrais bien que les Parthes ne fissent aucun mouvement;
j'emploierais, dans ce cas-là, le mois de juillet à traverser la
province pour mon retour; car je
241 suis entré la veille des kalendes d'août, sous le
consulat de Sulpicius et de Marcellus, et je veux la quitter le 4
des kalendes. Il me faudra auparavant obtenir de mon frère Quintus
qu'il reste en qualité de lieutenant; je n'aurai pas moins de peine
que lui à m'y résoudre; mais l'honneur ne me laisse pas d'autre
parti, surtout lorsque Pomptinius, le seul qui convient, ne veut pas
même attendre mon départ ; Postumius le rappelle à Rome; peut-être
aussi Poslumia. — Voilà mes plans. Il faut maintenant vous faire
juger des plaintes de votre ami Brutus. Il m'a fort recommandé M.
Scaptius, et P. Matinius, de Cypre, créanciers de la ville de
Salamine. Je n'ai point vu le dernier : pour Scaptius, il m'est venu
trouver dans mon camp, et je lui ai promis qu'à la considération de
Brutus, j'aurais soin de le faire payer. Il me remercia, et me
demanda une place de préfet. Je lui répondis que je n'en voulais
donner à aucun négociant, comme je vous l'avais marqué à vous-même;
que Cn. Pompée, m'ayant adressé la même demande, avait approuvé ma
résolution; enfin, que j'avais fait un refus semblable à Torquatus,
pour M. Lénius. votre ami, et à beaucoup d'autres encore. Que s'il
ne voulait être préfet qu'afin d'assurer sa créance, je lui
répondais qu'il serait payé sans cela. Il se retira, après m'avoir
remercié. Vous saurez qu'Appius avait donné à ce Scaptius quelques
compagnies de cavalerie pour tenir Salamine dans le devoir, et qu'il
l'avait fait préfet. Scaptius abusait de son autorité. Je fis
retirer ces troupes de l'île de Cypre. Il m'en voulut beaucoup. Pour
finir en deux mots, je lui tins parole, et les députés de Salamine
m'étant venu trouver à Tarse, avec lui, je leur enjoignis de le
payer. Ils se plaignirent longuement de l'intérêt qu'il
exigeait, et de ses vexations. Je feignis de n'en rien savoir, et je
les exhortai, je les priai même, en considération des services que
j'avais rendus à leur ville, de terminer cette affaire. J'ajoutai
que j'userais de mon autorité. Non-seulement ils ne firent aucune
résistance, mais ils me direntque je servirais à les acquitter; que
puisque je n'avais point voulu recevoir l'argent qu'ils avaient
coutume de donner au préteur, cette somme leur suffirait et au delà
pour payer Scaptius. Je les approuvai. Bien, dit Scaptius ; mais
comptons. J'avais fixé dans mon édit, comme d'autres gouverneurs,
l'intérêt de l'argent à un pour cent par mois, en ajoutant au bout
de l'année l'intérêt au principal : Scaptius réclamait quatre pour
cent. — Quelle est cette prétention? lui dis-je : puis-je aller
contre mon édit? — II me produisit aussitôt un sénatus-consulte, du
consulat de Lentulus et de Philippus, qui portait, « que les
gouverneurs de Cilicie auraient égard en justice à cette obligation.
«Cela me fit trembler d'abord car c'était la perte de cette ville :
mais je découvris deux sénatus consultes de la même époque sur ce
traité. Les Salaminiens voulaient emprunter de l'argent à Rome, pour
payer leurs impositions; mais comme la loi Gabinia le défendait, les
amis de Brutus, qui offraient de leur en prêter à quatre pour cent
par mois, demandaient pour leur sûreté un sénatus-consulte, que
Brutus leur fit obtenir. Ils comptèrent l'argent, mais ils firent
ensuite réflexion que la loi Gabinia défendait de recevoir en
justice ces sortes d'obligations, et qu'ainsi le premier
sénatus-consulte ne leur suffisait pas. Ils en obtinrent donc un
autre, qui déclarait leur obligation recevable en justice. J'ex-
242 pliquai à Scaptius les
intentions du sénat. Il me prit alors en particulier, et me dit
qu'il ne faisait aucune objection ; que, de cette manière, ce qui
lui était dû n'allait pas tout à fait jusqu'à deux cents talents;
mais que, puisque les députés de Salamine croyaient les devoir, il
me priait de les lui faire donner. Fort bien, lui dis-je, et l'ayant
fait retirer, j'appelai près de molles députés. Combien devez-vous?
leur demandai-je. Ils me répondirent : cent six talents. J'en
instruisis Scaptius ; il commença à faire grand bruit. A quoi bon
ces cris? lui dis-je; il s'agit de régler vos comptes. Ils
s'asseyent , font la supputation, et tombent d'accord de part et
d'autre. Les députés se disposent à compter l'argent, et pressent
Scaptius de le recevoir; mais il me prit de nouveau en particulier,
et me pria de laisser cette affaire indécise. Je n'ai pu tenir à
l'impudence de cet homme, et malgré les plaintes de nos Grecs, qui
demandaient à mettre l'argent en dépôt dans un temple, je ne voulus
pas y consentir. Tous ceux qui étaient présents se récrièrent sur
l'effronterie de Scaptius, qui osait refuser un intérêt aussi élevé;
d'autres traitaient cette prétention de folie. Pour moi, je le
trouve plus impudent que fou ; car si ses débiteurs sont bons, il
est toujours sûr d'avoir un pou r cent d'intérêt ; et s'il hasarde
quelque chose, il espère aussi se faire payer sur le pied de quatre
pour cent. — Voilà ma justification ; si Brutus me condamne encore,
je ne sais pas pourquoi nous l'aimons. Je suis du moins certain que
son oncle ne me condamnera pas; maintenant surtout qu'un
sénatus-consulte, depuis votre départ, à ce que je crois, a fixe
l'intérêt de l'argent a un pour cent par mois, et défendu d'ajouter
les intérêts au principal. Vous voyez bien, vous qui savez compter,
de combien ce que j'accorde à Scaptius monte plus haut. A propos de
cela, Luccéius me dit dans une de ses lettres qu'il craint bien que
tous ces décrets ne nous mènent à une banqueroute générale, et il me
rappelle tout le mal que fit autrefois G. César par un simple délai
de quelques jours, qui faillit tout perdre. Mais je reviens à cette
affaire. Pensez bien à plaider ma cause contre Brutus; cela ne vous
sera pas fort difficile , car on ne peut rien alléguer contre moi de
raisonnable. Après tout, rien n'est changé. — Je finis par mes
affaires de famille. Je pense comme vous sur celle que vous savez;
il faudra songer au fils de Postumia, puisque Pontidia ne conclut
rien ; mais je voudrais que vous fussiez à Rome. N'attendez aucune
lettre de mon frère Quintus d'ici à quelques mois ; car les neiges
rendent le Taurus impraticable jusqu'au mois de juin. J'ai écrit
plusieurs fois à Thermus sur vos affaires, comme vous m'en priez. Le
roi Déjotarus me dit que P. Valérius n'a rien, et que ses bienfaits
le soutiennent. Quand vous saurez s'il y aura cette année
intercalation à Rome, je vous prie de me le mander; écrivez-moi
aussi quel jour auront lieu les mystères. Je compte un peu moins sur
vos lettres que si vous étiez à Rome ; cependant j'y compte
toujours.
256. — A
SILIUS, PROPRÉTEUR. Laodicée, mars.
F. XIII, 63. Je n'aurais pas
cru que les mots pussent me manquer jamais, et pourtant je ne trouve
pas d'expressions pou r vous recommander C. Laenius. Je vais donc
être court, en tâchant toutefois de rendre claire ma pensée. Vous ne
243 sauriez croire à
quel point nous affectionnons M. Laenius moi et mon bien-aimé frère.
Je ne me suis séparé de lai qu'avec une peine infinie. Il nous a
rendu de tels services, il est si plein d'honnêteté, de modestie !
je trouvais tant de charme dans son commerce, tant de profit dans
les conseils de sa fidèle amitié ! — Mais voilà que les expressions
qui me faisaient faute tout à l'heure me viennent en foule
maintenant. Vous parler ainsi de Laenius, c'est vous dire avec quel
intérêt je vous le recommande : je vous conjure d'expédier les
affaires qui l'appellent dans votre province et de lui indiquer les
voies les plus directes et les meilleures. C'est le plus heureux et
le plus aimable caractère du monde ; vous en jugerez vous-même.
Renvoyez-le-nous bien vite, débarrassé de tout souci, de tout
tracas, de toute affaire. Mon frère et moi nous vous en saurons un
gré infini.
257. — CICÉRON A ATTICUS. Laodicée,
mars.
A. VI, 1. J'ai reçu votre lettre à Laodicée, le 5 des fêtes de
Terme, et j'y ai trouvé avec un vif plaisir de nouvelles marques de
votre amitié, de votre bonté, de votre zèleetde votre empressement à
me servir. Je vais y répondre comme vous me le demandez, et je ne me
tracerai point d'autre ordre que le vôtre. Vous me dites d'abord que
la dernière des lettres que vous avez reçues de moi était datée de
Cybistre, le 10 des kalendes d'octobre, et vous voulez
savoir quelles sont celles que j'ai reçues de vous. De toutes celles
dont vous me parlez, il ne me manque que les deux que vous avez
données aux esclaves de Lentulus, l'une à Equotutique, l'autre à
Brindes. Vous n'avez donc pas perdu votre peine, comme vous l'appréhendiez, car ce n'est point la perdre que de me faire plaisir, et rien
ne m'en a causé davantage. — Je suis charmé de voir que vous
approuvez ma réserve avec Appius et ma liberté avec Brutus ; j'avais
craint le contraire. Appius m'a écrit, en s'en retournant, deux ou
trois lettres un peu aigres, parce que je fais certaines choses
autrement que lui. C'est comme si un médecin à qui l'on aurait ôté
un malade, trouvait mauvais que son successeur eût recours à
d'autres remèdes. Appius , qui a traité la province par le fer et
le. feu, qui l'a saignée, épuisée, qui me l'a remise expirante,
trouve mauvais que je répare le mal qu'il a fait. Cependant, en même
temps qu'il se plaint, il me remercie, et il a raison, car ce que je
fais sauve son honneur. Ce qui l'irrite, c'est que je ne lui
ressemble pas ; on ne peut en effet se ressembler moins : la
province a été, sous son gouvernement, ruinée de toutes les
manières; sous le mien, il n'en a été rien exigé sous aucun
prétexte. Que ne pourrais-je pas dire des préfets d'Appius, de ceux
de sa suite, de ses lieutenants? de leurs rapines, de leurs
violences, de leurs brutalités? Maintenant au contraire, la maison
la mieux réglée ne présente pas autant d'ordre, de régularité,
d'économie que cette province. Quelques amis d'Appius allèguent
ridiculement que je n'affecte une bonne conduite que pour décrier la
sienne, et que je me propose moins pour but, en faisant le bien, ma
propre gloire que son déshonneur. Au reste, s'il est vrai qu'Appius
me fasse des remercîments, comme le dit Brutus dans la lettre qu'il
vous a envoyée, je les accepte; mais cela ne m'empêchera pas de
changer, ce matin même, beau- 244 coup de ses actes et de ses institutions
iniques.
— J'arrive maintenant à Brutus, dont j'avais, à votre
sollicitation, recherché l'amitié avec tout l'empressement possible,
et que j'avais même commencé à aimer; mais, le dirais-je? non, je ne
le veux pas, de peur de vous fâcher. Soyez certain que je n'ai rien
préféré au désir de l'obliger, et que ce fut là mon premier soin. Il
m'avait donné un mémoire ; vous m'aviez vous-même recommandé ses
intérêts, et je n'ai rien négligé. D'abord, j'ai été jusqu'à presser
Ariobarzane de donner à Brutus l'argent qu'il m'offrait. Tant que ce
roi est resté près de moi, il y a paru très-disposé ; mais ensuite
il s'est vu pressé par une infinité de mandataires de Pompée, qui a
seul plus de crédit que personne, surtout depuis qu'il passe pour
devoir être chargé de la guerre des Parthes. Voici toutefois ce
qu'il a pu obtenir : il touche par mois, sur les impositions
extraordinaires, trente-trois talents attiques; ce n'est pas même
l'intérêt de son argent ; mais il veut bien s'en contenter, et ne
presse point pour le principal. Ariobarzane ne paye, ni ne peut
payer aucun autre créancier ; car il n'a point de trésor ni de
revenu réglé : il est obligé, à l'exemple d'Appius, d'imposer des
taxes, qui suffisent à peine pour payer les intérêts de Pompée. Ce
roi a bien deux ou trois amis fort riches, mais ils gardent leur
argent avec autant de soin que vous ou moi. Je ne laisse pas de lui
écrire des lettres très-pressantes et très-énergiques. Déjotarus m'a
dit qu'il lui avait fait aussi parler pour Brutus, et qu'Ariobarzane
avait répondu qu'il n'avait point d'argent. Et certes, je le sais
bien, car il n'y a pas de royaume plus misérable, ni de roi plus
pauvre. Aussi je pense à me décharger de cette tutelle, ou bien,
comme le disait Scévola pour Glabrion, je demanderai que l'on
remette à mon pupille les intérêts et le principal. Quant à ces
places de préfets que j'avais promises par vous à Brutus, j'en ai
donné à M. Scaptius, et à L. Gavius, lesquels faisaient ses affaires
dans la Cappadoce, et n'en faisaient point dans ma province. Vous
vous rappelez que nous étions convenus qu'il pourrait disposer de
ces places; pourvu que ce ne fût point pour des gens engagés dans
les affaires de la Cilicie. Je lui en réservais encore deux autres,
mais ceux pour qui il me les avait demandées n'étaient plus dans la
province. — Venons à ceux de Salamine. Je vois bien que vous ne
saviez pas plus que moi que cet argent fût à Brutus; il ne m'en
avait jamais rien dit; bien plus, j'ai encore son mémoire qui
commence ainsi : « La ville de Salamine doit de l'argent à M.
Scaptius et à P. Matinius, mes amis particuliers. » Après me les
avoir recommandés, il ajoute, afin de m'y intéresser davantage,
qu'il leur a servi de caution pour une forte somme. J'avais obtenu
qu'on les paierait sur le pied d'un pour cent par mois, en ajoutant
à la fin de chacune des six années, les intérêts au principal ; mais
Scaptius demandait quatre pour cent ; j'aurais craint, en les lui
faisant obtenir, de perdre votre amitié. C'était aller contre mon
édit, et ruiner entièrement une ville qui est sous la protection de
Caton et de Brutus même, et que j'avais comblée de biens. Maintenant
Scaptius : me présente une lettre de Brutus, qui dit que
245 c'est lui qui est le
plus Intéressé dans cette affaire, ce qu'il ne m'avait jamais dit
non plus qu'à vous. Il me demande aussi une place de préfet pour
Scaptius ; mais dans les offres que je lui fis par votre entremise,
j'avais excepté les négociants. Et quand j'accorderais une de ces
places à quelqu'un , il faudrait toujours exclure Scaptius. Il en
avait une sous Appius, qui lui avait aussi donné quelques compagnies
de cavalerie, avec lesquelles il avait tenu assiégé le sénat de
Salamine, au point que cinq sénateurs moururent de faim. Aussi, le
jour même où j'arrivai dans ma province, et où je l'appris, à
Ephèse, des députés de Cypre, j'envoyai des ordres pour faire
aussitôt repasser la mer à cette cavalerie. Voilà sans doute la
cause des plaintes injustes que Scaptius a faites de moi à Brutus.
Mais j'en ai pris mon parti. Si Brutus prétend que je devais faire
payer Scaptius sur le pied de quatre pour cent par mois, malgré mes
règlements et mes édits qui fixaient l'intérêt à un, et pendant que
les usuriers les moins traitantes se contentent de ce taux-là ; s'il
trouve mauvais que je lui aie refusé une place de préfet pour un
négociant, lorsque Torquatus et Pompée, à qui j'en ai refusé, au
premier, pour Lœnius, votre ami, et au second, pour Sext. Statius,
ont approuvé mon refus; s'il me reproche d'avoir fait revenir cette
cavalerie, je regrette beaucoup de le mécontenter, mais je regrette
bien davantage de le trouver si différent de ce que je l'avais cru.
Scaptius avouera lui-même que j'ai voulu le faire payer sur le pied
marqué dans mon édit. J'ai fait plus, et je ne sais si vous
m'approuverez. L'intérêt ne devait plus courir du moment que les
députés de Salamine offraient de payer et qu'ils voulaient mettre la
somme en dépôt; j'ai obtenu d'eux qu'ils ne feraient point de
sommations, et ils ont bien voulu s'y engager, mais que
deviendront-ils si Paullus vient me remplacer? J'ai agi en tout cela
par considération pour Brutus, lequel vous parle de moi en ternies
fort obligeants, quoique les lettres qu'il m'écrit, même pour me
demander quelque chose, soient au contraire dures, arrogantes,
emportées. Je vous prie de lui rendre compte de tout ce que je vous
ai dit, afin que je sache ce qu'il en pense; car vous m'en
informerez. Je vous avais déjà rendu un compte détaillé de tout ceci
dans ma dernière lettre; mais j'ai voulu vous montrer que je n'ai
pas oublié ce que vous me dites dans une des vôtres, que quand mon
gouvernement ne me donnerait que l'occasion de gagner l'amitié de
Brutus, ce serait assez. Soit, puisque vous l'avez dit; mais vous ne
voudriez pas, je pense, que ce fût aux dépens de la justice. J'ai
fait pour Scaptius tout ce que me permettait mon édit. Si j'ai bien
fait, je vous le laisse à juger, et n'en appellerai point même à
Caton. — Je n'ai certes pas oublié les préceptes que vous m'avez
donnés ; je les porte en moi. Vous m'avez en pleurant recommandé le
soin de ma réputation, et quelle est celle de vos lettres qui ne
m'en fasse souvenir ? Me blâme donc qui voudra. Je m'en consolerai,
pourvu que j'aie la justice de mon côté, maintenant surtout que j'ai
pris comme des engagements avec elle, en donnant mes six livres de
la République, dont je suis charmé que vous soyez content. Vous y
relevez seulement une faute contre l'histoire, au sujet de Cn.
Flavius, fils de Cnéius. Mais on ne peut le placer avant les
décemvirs, puisqu'il fut édile curule, magistrature établie
longtemps après le décemvirat. De quelle utilité, dites-vous,
était-il qu'il publiât les fastes? L'ordre qui les réglait était,
dit-on, inconnu autrefois, de sorte qu'un
246 petit nombre de
jurisconsultes disaient les jours où il était permis de plaider;
beaucoup d'auteurs ont écrit que c'est Cn. Flavius, alors greffier,
qui publia les fastes et les formules du droit; et je ne l'ai pas
dit, ou plutôt fait dire à Scipion l'Africain, sans de bonnes
autorités. Ce que j'ai dit des gestes de comédien, vous l'avez
interprété malignement; je n'y ai pas entendu finesse. — Vous avez
appris, me dites-vous, par les lettres de Philotimus que j'ai été
proclamé imperator; mais je compte que depuis votre arrivée en
Épire, vous aurez reçu les deux lettres où je vous fuis de tout cela
un récit détaillé, et que j'ai données à vos gens, l'une après la
prise de Pindénissum, et l'autre à Laodicée. J'ai envoyé à Rome par
deux vaisseaux différents, pour plus de sûreté, deux copies de mon
rapport des ces événements. — Je suis de votre avis sur ce qui
regarde ma Tullia, et je lui ai écrit, ainsi qu'à Térentia, que leur
projet me convenait. Je me souviens de ce que vous me disiez dans
une de vos lettres : Je voudrais que vous fussiez revenu à votre
ancien troupeau. Il n'était point nécessaire de rien changer à
la lettre de Memmius ; car je préfère de beaucoup celui que Pontidia
propose à celui de Servilia. Vous emploierez pour cela Auflus, qui
n'a point cessé de m'aimer, et qui, avec le bien que lui a laissé
son frère Appius, a, je pense, hérité de cette amitié, dont j'ai
reçu des marques dans plus d'une occasion, et surtout dans l'affaire
de Bursa. Vous me délivrerez ainsi d'une grande inquiétude. — Je ne
suis pas du tout content de la clause de Furnius , le temps qu'il
excepte est le seul pendant lequel j'aie quelque chose à craindre.
Je vous en écrirais davantage là-dessus, si vous étiez à Rome. Je ne
suis pas étonné que vous placiez tout votre espoir en Pompée, pour
la tranquillité publique ; vous avez raison, et je crois qu'il faut
retirer votre expression « en apparence. » S'il n'y a pas beaucoup
de suite dans cette lettre, ne vous en prenez qu'à vous; car je vous
suis pied à pied. — Les deux jeunes Cicéron s'aiment beaucoup; on
les instruit, on les exerce ensemble; mais on peut leur appliquer ce
qu'Isocrate disait d'Éphore et de Théopompe ; l'un a besoin qu'on
lui tienne la bride, l'autre qu'on lui donne de l'éperon. Je me
propose de faire prendre la robe virile au jeune Quintus le jour des
Liberalia; car son père me l'a recommandé ; je su ppose, dans mon
calcul, qu'il n'y a point eu d'intercalation. Je suis enchanté de
Dionysius; nos jeunes gens disent qu'il est colère et violent; mais
on ne peut avoir plus de science, de meilleurs mœures, et plus
d'affection pour vous et pour moi. — On a raison de vous dire que
Thermus et Silius sont fort estimés; leur conduite est desplus
honorables, ainsi que celle de M. Nonius et de Bibulus, et que la
mienne, si vous voulez. Je voudrais que Scrofa eût aussi l'occasion
de se distinguer : il est pour cela dans une position admirable.
Pour tous les autres, ils ne se piquent guère de suivre les maximes
de Caton. Je vous suis fort obligé d'avoir recommandé mes intérêts à
Hortensius. Dionysius pense qu'il ne fau trien espérer d'Amianus. Je
n'ai aucune nouvelle de Térentius. Pour Méragène, il faut
certainement qu'il soit mort. J'ai passé par ses terres, où il n'y a
plus être vivant. Je ne le savais pas encore, lorsque je parlai à
votre affranchi Démocrite. Je vous ai commandé des vases de Rhosus;
mais comment l'entendez-vous? Vous nous faisiez servir des légumes
dans votre vaisselle si artistement ciselée ; que nous donne-
247 rez- vous dans ce plat
de terre ? L'ordre est donné de chercher un cor pour Phémius, et on
en trouvera un ; mais qu'il ne joue alors que des airs qui en
vaillent la peine. — Nous sommes menacés d'une guerre contre les
Parthes. Cassius n'a écrit que des lettres ridicules. Celles de
Bibulus n'étaient pas encore arrivées ; mais, quand elles le seront,
j'espère qu'elles réveilleront le sénat. Pour moi, je suis dans une
grande inquiétude d'esprit. Si, comme je le souhaite, on ne me
continue pas dans mon gouvernement, je dois toujours craindre juin
et juillet. Que Bibulus résiste pendant ces deux mois-là, que
deviendra celui que je laisserai à ma place? et si c'est mon frère?
et si je ne puis moi-même m'en aller sitôt? Tout cela m'embarrasse
fort. Je suis néanmoins convenu avec Déjotarus qu'il viendra joindre
mon armée avec toutes ses troupes. Elles sont composées de trente
cohortes, chacune de quatre cents hommes armés à la romaine, et de
deux mille chevaux. Avec ce secours on pourra arrêter les ennemis
jusqu'à l'arrivée de Pompée, qui me dit dans ses lettres qu'il sera
chargé de cette guerre. Les Parthes sont en quartiers d'hiver sur
les terres de l'empire. Orode est attendu. Ce n'est pas une petite
affaire. — Mon édit est conforme à celui de Bibulus, à cette clause
près sur laquelle vous me disiez « que ce serait un préjugé trop peu
honorable pour l'ordre auquel nous appartenons. » J'en ai mis
néanmoins une qui signifie la même chose, mais moins explicitement;
je l'ai prise de l'édit de Q. Mucius, pour les provinces d'Asie ;
elle porte que si les conditions d'un traité sont injustes, on
réglera les choses selon la bonne foi. J'ai conservé aussi beaucoup
d'articles de Scévola, entre autres, celui qui permet aux Grecs
déterminer entre eux leurs différends selon leurs lois, ce qui fait
qu'ils croient jouir de la liberté. Mais mon édit est court, parce
que j'ai tout réduit sous deux chefs ; dans l'un, je traite des
affaires qui sont proprement de la juridiction des gouverneurs,
comme les comptes des villes, leurs dettes, l'intérêt de l'argent,
les obligations, tout ce qui regarde les fermiers publics; l'autre
contient plusieurs affaires que l'on juge ordinairement sur l'édit,
et qu'on ne peut guère juger autrement, comme les testaments, les
acquêts, les biens décrétés, les syndics des créanciers. Pour le
reste, j'ai déclaré que je jugerais conformément aux édits des
préteurs. Je m'attache et suis parvenu à contenter tout le monde.
Les Grecs sont ravis d'avoir des juges de leur nation. Ce sont,
médirez-vous, de plaisants juges ; qu'importé? ces peuples croient
avoir reconquis leur liberté. Ceux que vous avez à Rome sont, sans
doute, des gens d'importance, un Turpion naguère cordonnier, un
Vettius, revendeur!— Vous désirez savoir comment je suis avec les
fermiers. Je les traite au mieux ; je les accable d'honnêtetés , de
louanges, de caresses ; mais j'ai soin qu'ils ne soient à charge à
personne. Ce que vous aurez peine à croire, c'est que Servilius leur
adjugeait l'intérêt marqué dans leurs traités avec les villes ; moi,
je donne aux débiteurs un ternie raisonnable; en les prévenant que
s'ils payent avant ce temps-là, ils ne seront taxés qu'à un pour
cent par mois, sinon, à l'intérêt convenu. Ainsi les Grecs ne sont
pas trop chargés, et les fermiers sont très-contents. Ils reçoivent
de moi force compliments, et des invitations fréquentes. Que vous
dirai-je de plus? Ils sont si bien avec moi qu'il n'en est pas un
qui ne se croie mon meilleur ami. Cependant
μηδὲν αὐτοῖς. Vous savez le reste. - Quant à la statue de
Scipion l'Africain (oh ! la chose bizarre! mais elle m'a réjoui dans
votre lettre), quoi ! Métellus Scipion ne sait pas que son bisaïeul
n'a point été censeur? Cependant il n'a pas d'autre qualité que
celle de consul dans l'inscription de la statue que vous avez fait
placer dans uu lieu élevé du temple d'Ops. Il en est de même de
celle qu'on voit dans le temple de Pollux, et qui est certainement
du même artiste, comme la posture, l'habillement, l'anneau et le
visage même le démontrent. Et, en vérité, lorsque dans la foule de
ces statues équestres dorées, que Métellus a fait placer dans le
Capitule, je vis au bas de celle de Scipion l'Africain le nom de
Sérapion, je pensai que c'était une erreur de l'ouvrier ; je vois
maintenant que c'est Métellus qui l'a commise, et cette ignorance
est impardonnable. S'il est faux que Flavius ait publié les fastes ,
cette erreur m'est commune avec beaucoup d'auteurs, et vous avez eu
raison de ne rien décider : j'ai suivi l'opinion générale, comme
font le plus souvent les Grecs. Qui n'a pas dit qu'Eupolis, poète de
l'ancienne comédie, fut, en passant dans la Sicile, précipité dans
la mer par Alcibiade ? Ératosthène est contraire à cette assertion,
puisqu'il avance que quelques-unes des pièces de ce poète furent
composées depuis la guerre de Sicile. Duris de Samos, historien
exact, perdra-t-il tout crédit pour avoir commis cette erreur avec
tant d'autres? Qui n'a pas dit que Zaleucus avait donné des lois aux
Locriens? en estime-t-on moins Théophraste, depuis que Timée, votre
auteur favori, lui a fait un reproche de l'avoir répété? Mais il est
honteux pour Métellus de ne pas savoir que son bisaïeul n'a pas été
censeur, d'autant plus que personne de ce nom ne le fut depuis son
consulat jusqu'à sa mort. - Quant à ce que vous me dites de
Philotimus et du payement de ces cinq cent quatre-vingt mille
sesterces, je sais seulement qu'il est arrivé dans la Chersonnèse
vers les kalendes de janvier, et je n'en ai pas encore reçu de
lettres. Camillus m'écrit qu'il a touché le reste de mon argent ; ce
que c'est, je n'en sais rien, et désire bien le savoir. Mais je vous
parlerai de cela une autre fois, et peut-être mieux verbalement. Il
y a, mon cher Atticus, vers la fin de votre lettre un endroit qui
m'a fait tressaillir. Après m'avoir dit : qu'ai-je encore à ajouter?
vous me recommandez affectueusement de ne pas me relâcher de ma
prudence et de prendre garde à tout. Est-ce qu'il vous serait revenu
quelque chose? Mais non, il n'y a pas d'apparence; cela ne m'aurait
pas échappé, et rien ne m'échappera. Cependant cet avis, donné avec
tant de soin, m'a paru devoir signifier je ne sais quoi. —
J'approuve de nouveau la réponse que vous avez faite à M. Octavius;
j'y aurais voulu un peu plus d'assurance. Célius m'a envoyé un
affranchi avec une lettre des plus pressantes; mais rien n'est moins
raisonnable que ce qu'il demande au sujet des panthères et des
villes. Je lui ai répondu sur ce dernier article que j'étais bien
malheureux d'être si peu connu à Rome, qu'on n'y sût pas que je ne
levais sur ma province aucune imposition extraordinaire, sinon pour
le payement des dettes ; que je ne pouvais pas plus lui accorder cet
argent que lui l'accepter; je lui dis enfin, comme son ami, qu'il
devait, après avoir accusé les autres, mettre plus de retenue dans
sa conduite, et que, pour ces panthères, je ferais tort à ma
réputation, si je contraignais les Cibyrates à faire pour lui une
chasse publique. — Votre lettre a transporté de joie Lepta; elle est
en effet 249
très-aimable pour lui, et il m'en sait beaucoup de gré. Je suis fort
obligé à votre chère fille de ce qu'elle vous a si instamment
recommandé de me saluer de sa part; je remercie aussi Pilia; mais
plus particulièrement la première, qui ne m'a pas vu depuis
longtemps ; vous leur ferez donc mes compliments à toutes deux. Dans
votre lettre du dernier de décembre, vous me rappelez un bien doux
souvenir, celui du plus beau des serments ; je ne l'avais certes pas
oublié : je fus ce jour-là un grand consul. J'ai répondu à toutes
vos lettres, non pas, comme vous le vouliez, en vous envoyant de
l'or pour du cuivre, mais en vous servant comme vous m'aviez servi.
Mais voici encore une petite lettre que je ne laisserai pas sans
réponse. Luccéius pouvait certes vendre sa maison de Tusculum ; à
moins toutefois... car il soupe d'ordinaire avec son joueur de
flûte; je voudrais bien savoir où en sont ses affaires. J'apprends
aussi que Lentulus a mis en vente, à cause de ses dettes, sa maison
de Tusculum. Je souhaite de les voir plus à leur aise, ainsi que
Sextius, et, si vous voulez, Célius. On peut dire d'eux tous : « Ils
rougissent de fuir et craignent de combattre. » Vous savez, je
pense, que Curion songe à faire rappeler Memraius. J'espère, sans
cependant y trop compter, vous faire payer par Egnatius de Sidicinum.
Pinarius, que vous me recommandez, est tombé Brièvement malade chez
Déjotarus, qui en a le plus grand soin. Voilà tout ce que j'avais à
répondre à cette petite lettre. Ne laissez pas, je vous prie,
languir notre correspondance pendant mon séjour à Laodicée,
c'est-à-dire jusqu'aux ides de mai ; et lorsque vous serez arrivé à
Athènes (on aura sans doute alors des nouvelles des affaires de Rome
et de la distribution des provinces, dont on doit délibérer dans le
mois de mars), envoyez-moi un exprès. — Mais est-il vrai, dites-moi,
que vous ayez tiré de César, par le moyen d'Hérode, cinquante
talents attiques? Pompée vous en veut, dit-on, beaucoup, car il
regarde cette somme comme de l'argent que vous lui auriez enlevé. On
dit aussi que César ne fera plus tant de dépenses pour la
construction de sa maison d'Aricie. J'ai su tout cela par P. Védius,
qui est un grand étourdi, mais ami de Pompée. Il est venu au-devant
de moi avec deux chariots, un char attelé de chevaux, une litière,
et un si grand nombre d'esclaves, que si Curion fait passer sa loi,
Védius sera certainement taxé à plus de cent mille sesterces. Il
avait de plus un cynocéphale sur un de ses chariots; on y voyait
même des onagres. Je n'ai vu de ma vie un homme si insensé. Mais
écoutez le reste. Il logea à Laodicée chez Pompéius Vindullus, et y
laissa ses effets lorsqu'il me vint trouver. Pendant ce temps mourut
Vindullus, dont les biens devaient passer à Pompée. C. Vennonius
étant allé mettre le scellé chez Vindullus, tomba sur ce qui
appartenait à Védius. On y trouva cinq portraits de nos dames
romaines, entre autres celui de la sœur de votre ami (Brutus), qui
devrait mieux choisir les siens, et de la femme de ce mari commode (Lépidus),
qui prend tout cela avec tant d'indolence. J'ai voulu vous divertir,
car nous sommes tous deux un peu curieux de pareilles histoires.—
J'ai encore une chose à laquelle vous prie de songer; j'apprends qu'Appius
fait construire un portique à Eleusis ; pourra-t-on me blâmer d'en
élever un à l'Académie? Non, me direz-vous; écrivez-moi donc à cet
égard. J'aime beaucoup Athènes; je veux y laisser quelque monu-
250 ment de cette
affection. J'ai horreur de ces fausses inscriptions que l'on met à
des statues qu'ont érigées les autres; mais je m'en rapporte
entièrement à vous. Mandez-moi quel jour tombent les mystères cette
année, et comment vous avez passé l'hiver. Ayez soin de votre santé.
Le sept cent soixante cinquième jour depuis la bataille de Leuctres.
258. — A THERMIUS, PROPRETEUR.
Laodicée, mars.
F. XIII, 54.
Vous avez mis bien de la grâce dans tout ce que vous avez fait à
ma recommandation, surtout dans l'accueil charmant qu'a reçu de vous
M. Marcilius, fils de mon interprète et de mon ami. Il est venu à
Laodicée et m'a témoigné dans les termes les plus vifs sa
reconnaissance pour vous et pour moi, à cause de vous. Mais j'ai une
nouvelle grâce à vous demander : vous voyez que vous n'avez pas
affaire à des ingrats. Vous n'en devez être que plus disposé à faire
pour eux tout ce qui sera d'accord avec la justice. Eh bien,
empêchez, je vous prie, que la belle-mère de ce jeune homme ne soit
mise en accusation. Je vous ai toujours parlé avec beaucoup
d'intérêt de Marcilius. Je vous le recommande avec bien plus
d'intérêt encore aujourd'hui , à raison des excellents services de
son père, qui, dans un long exercice des fonctions d'appariteur, a
fait preuve d'une exactitude, d'un désintéressement et d'une
modération, je ne dirai pas bien rares, mais presque sans exemple.
259 — A
THERMUS, PROPRÉTEUR. Laodicée, mars.
F. XIII, 57. La guerre prend de
jour en jour plus de gravité en Syrie : toutes mes lettres et tous
mes courriers me l'annoncent. Je viens donc faire un nouvel et plus
pressant appel à votre amitié, et je vous conjure de me renvoyer,
sans tarder une minute, M. Annéius, mon lieutenant. Son activité,
ses conseils, son expérience militaire deviennent, je le sens,
indispensables et pour la république et pour moi. S'il ne se fût agi
d'une affaire aussi importante, rien au monde ne l'eût décidé à me
quitter; et, pour rien au monde, je ne l'aurais laissé partir. Mon
intention est de me mettre en route pour la Cilicie vers les
kalendes de mai, il faut absolument qu'à cette époque Annéius soit
revenu. — Je vous ai déjà parlé et écrit bien des fois pour vous
recommanderses intérêts. Je vous en conjure, prenez à cœur son
affaire avec les habitants de Sardes, et faites qu'elle se termine à
son avantage et à son honneur. Je sais vos bonnes dispositions, vous
me les avez témoignées suffisamment, lorsque j'eus occasion de vous
voir à Éphèse. Je vous saurai un gré infini, si vous voulez bien
régler vous-même toute cette affaire par un bon édit, et ne pas le
faire attendre; je vous le demande instamment.
260. — A CÉLIUS,
ÉDILE CURULE. Laodicée, avril.
F. II, 11. Croiriez-vous que
pour vous écrire j'en suis à chercher mes mots? je ne dis pas les
mots de votre langue oratoire, mais ceux de la langue vulgaire que
nous parlons ici. C'est l'effet du tourment d'esprit où me jette
l'attente d'une décision sur les provinces. Je soupire après Rome,
après les miens plus qu'on ne saurait croire, après vous en première
ligne ; et j'ai pris ma province en dégoût. Serait-ce qu'au point de
gloire 251 où je suis
arrivé, il faille moins songer à y ajouter, que craindre un retour
de la fortune? Est-ce dédain de mon esprit pour ces minces détails
du gouvernement provincial, quand les plus grandes affaires de
l'État sont à sa taille et dans ses habitudes? N'est-ce pas plutôt
qu'il recule d'instinct sous la menace d'une guerre redoutable , et
cherche à la conjurer par un rappel nu temps marqué par la loi? — On
s'occupe activement de vos panthères. Les ordres sont donnés à des
chasseurs de profession ; mais elles sont singulièrement rares, et
le peu qu'on rencontre se plaignent amèrement, dit-on, de ce
qu'elles sont les seules créatures mal menées de la province. L'on
m'assure même qu'elles sont décidées à quitter mon gouvernement, et
à se retirer dans la Carie. On ne laisse pas de leur faire bonne
chasse. Patiscus y est des premiers. Tout ce qu'on prendra sera pour
vous. Je ne sais à quel nombre on en est. Croyez que je me fais une
affaire d'honneur de votre édilité, et ce n'est pas aujourd'hui que
je vous oublierais ; car nia lettre est datée des fêtes mégaliennes.
— Vous me feriez bien plaisir de m'écrire un peu en détail sur
l'état présent des affaires. J'ai foi pardessus toutes choses aux
nouvelles qui me viennent de vous.
261. — A
ATTICUS. Laodicée, avril
A. VI, 2. Philogène, votre
affranchi, est venu me saluer à Laodicée, et va, dit-il, vous
retrouver bientôt : je lui remets cette lettre, par laquelle je
réponds à celle que j'ai reçue par le messager de Brutus. Je
commencerai par le dernier article, qui m'a beaucoup affligé, et où
vous me parlez de ce que Cincius vous mande qu'il a entendu dire à
Statius. Ce qui m'afflige par-dessus tout, c'est que Statius ait osé
dire que j'approuvais cette résolution. Moi, l'approuver! mais il
n'est pas besoin de me justifier. Je voudrais serrer encore
davantage les liens étroits qui nous unissent, vous et moi, quoique
ceux de notre amitié soient indissolubles, tant je suis éloigné de
vouloir les rompre. Je l'ai souvent entendu (Quiutus) dire à ce
sujet des choses un peu dures; mais j'ai toujours apaisé sa colère ;
je pense que vous le savez. Et il est vrai que pendant le voyage, et
durant nos expéditions, je l'ai vn souvent très-courroucé, mais je
l'ai calmé autant de fois. Je ne sais pas ce qu'il a écrit à Statius,
et quelque intention qu'il ait eue, ce n'est pas à un affranchi
qu'on doit s'en ouvrir. Je ne négligerai rien pour l'empêcher de
prendre un mauvais parti ; mais chacun doit s'y employer ; c'est
surtout le devoir et l'intérêt du jeune Cicéron, qui n'est déjà plus
un enfant, et je ne masque pas de l'y exhorter. Il me paraît avoir
pour sa mère, et surtout pour vous, toute l'affection qu'il doit
avoir. Il a beaucoup d'esprit, mais c'est un esprit changeant et
difficile ; et j'ai assez de peine à le gouverner. — Maintenant que
j'ai répondu à la fin de votre lettre, je vais reprendre le
commencement. Ce n'est pas sur le témoignage de quelque méchant
auteur, que j'ai avancé que toutes les villes du Péloponnèse étaient
maritimes; c'est sur la foi de Dicéarque, dont vous faites un grand
cas. Il reproche pour beaucoup de motifs aux Grecs, dans le récit
que Chéron fait de l'antre de Trophonius, d'avoir bâti tant de
villes sur le bord de la mer, et il n'en excepte aucune de celles du
Péloponnèse. Quoique j'estime fort cet auteur, (car il a du savoir
et a vécu dans le Péloponnèse) , cela ne manqua pas de m'étonner, et
je proposai mon doute à Dionysius. Il fut d'abord surpris; mais
comme il n'a pas une moins grande
252 estime pour Dicéarque, que vous pour G. Vestorius, et
moi pour M. Clavius, il me dit que je pouvais m'en rapporter à cet
auteur. Il prétend qu'il y a dans l'Arcadie une ville maritime nommé
Lépréon. Pour Ténée, Aliphéra, et Tritria, il pense que ce sont des
villes modernes, et il le prouve par le dénombrement d'Homère, où
elles ne sont pas nommées. J'ai copié tout cet endroit mot pour mot
de Dicéarque. Je sais bien qu'il faut dire Phliasii, et vous mettrez
ce mot dans votre exemplaire, comme je l'ai mis dans le mien. C'est
l'analogie qui m'avait trompé d'abord; et j'ai cru qu'il en était de
Φλιοῦς, comme d'Ὀποῦς;
et de Σιποῦς, d'où l'on a fait
Ὀπούντιοι, Σινούτιοι; mais je suis bientôt
revenu de cette erreur. — Je vois que ma douceur et mon
désintéressement sont pour vous un grand sujet de joie ; vous en
auriez bien davantage, si vous étiez ici, en voyant ce que j'ai fait
à Laodicée, où, depuis le 13 de février jusqu'au premier de mai,
j'ai réglé toutes les affaires de mon
gouvernement, excepté celles de Cilicie. Beaucoup de villes sont
entièrement libres de toutes dettes; beaucoup d'autres sont fort
soulagées. Les peuples jugent entre eux leurs différends selon leurs
lois, et ils revivent. J'ai fourni aux villes deux grands moyens
pour se libérer, le premier, en ne tirant rien de la province pour
ma subsistance, absolument rien, je le dis sans exagération, rien,
pas même une obole; vous ne. sauriez croire combien cette attention
les a soulagées. Voici le second. Comme les Grecs qui avaient exercé
des magistratures s'étaient frauduleusement enrichis aux dépens de
leurs concitoyens, j'ai interrogé moi-même ceux qui ont été en
charge depuis dix ans ; ils m'ont tout avoué, et sans essuyer la
honte d'un jugement, ils ont d'eux-mêmes restitué aux peuples
l'argent qu'ils leur avaient pris. Les villes ont donc pu payer sans
peine ce qu'elles devaient du bail actuel, dont les fermiers
n'avaient rien touché, et tous les arrérages du précédent. Aussi
suis-je au mieux avec ceux-ci. Ce ne sont pas des ingrats, me
dites-vous ; je m'en suis aperçu. Je m'acquitte de mes autres
fonctions avec le même succès, et mon affabilité fait l'admiration
de tout le monde. Je ne suis pas si difficile à approcher que les
gouverneurs de provinces; rien ne se fait par mes gens ; avant le
jour, je me promène chez moi /comme autrefois quand j'étais
candidat. On est charmé de ces manières, qui me coûtent bien peu,
car je n'ai qu'à me rappeler mes premières armes. Je compte partir
aux noues de mai pour la Cilicie ; j'y passerai tout le mois de juin
; et si les Parthes, qui nous menacent d'une grande guerre, me
laissent en repos, je me mettrai en route au mois de juillet, afin
de sortir de mon gouvernement le 3 des kalendes d'août, qui sera le
dernier jour de mon année ; j'ai en effet le plus grand espoir de
n'être pas continué. J'ai reçu les actes de Rome jusqu'aux nones de
mars, par où je juge que Curion s'opposera toujours avec la même
fermeté à ce qu'on règle l'affaire des provinces. J'espère donc vous
voir bientôt. — Je viens à Brutus, votre ami, ou plutôt le nôtre,
puisque vous le voulez. J'ai fait pour lui tout ce que j'ai pu dans
ma province, et auprès d'Ariobarzane. J'ai employé avec ce roi
253 tous les moyens, et je
lui écris encore tous les jours. Je l'ai eu trois ou quatre jours
avec moi, pendant une sédition, dont je l'ai sauvé. Tant que je l'ai
tenu, et depuis son départ, je n'ai cessé de le prier d'en finir ;
j'ai fait valoir auprès de lui et l'intérêt que je prends à cette
affaire , et son propre avantage. J'ai fort avancé le succès ; mais
comme je suis maintenant très-éloigné de lui, j'ignore jusqu'où j'ai
pu réussir. Pour ceux de Salamine, sur qui j'avais autorité, je les
ai obligés à payer Scaptius sur le pied d'un pour cent par mois, en
comptant depuis leur dernière obligation, et en ajoutant, après
chaque année, l'intérêt au principal. Ils comptèrent l'argent;
Scaptius ne voulut pas le recevoir ; et vous me dites, après cela,
que Brutus veut bien perdre quelque chose? L'obligation portait
quatre pour cent par mois ; on ne pouvait payer cet intérêt, et
quand on l'aurait pu, je ne l'aurais pas souffert. Scaptius, me
dit-on, se repent beaucoup de ce qu'il a fait En effet, le
sénatus-consulte dont il s'appuyait et qui déclare cette obligation
valable, n'a été porté que parce que les Salaminiens lui avaient
emprunté de l'argent contre la loi Gabinia, qui frappait de nullité
de telles obligations. Le sénat a voulu seulement lui assurer le
payement de sa dette, sans le dispenser des lois ordinaires par
rapport à l'intérêt. — Voilà ce que j'ai fait; je pense que Brutus
m'approuverait; je ne sais si vous serez content; Caton sera
certainement pour moi. Mais c'est maintenant à vous que je
m'adresse. Quoi! mon cher Atticus, vous qui aimez tant l'intégrité
et la délicatesse, vous me priez de donner des cavaliers à Scaptius
pour se faire payer I « Quel mot, comme dit Ennius, est sorti de ta
bouche ! » Si vous étiez ici, vous qui m'écrivez que vous êtes
quelquefois fâché de n'y être pas venu avec moi, me laisseriez-vous
faire ce que vous me demandez ? Scaptius ne veut, me dites-vous, que
cinquante cavaliers. Spartacus n'en avait pas tant lorsqu'il
commença la guerre. Quel mal n'eussent-ils pas fait dans une ile si
faible ? Ou plutôt quel mal n'y ont-ils pas fait déjà, avant mon
arrivée? Ils ont tenu le sénat de SaIaminé assiégé pendant plusieurs
jours, et plusieurs sénateurs sont morts de faim. Scaptius était
préfet d'Appius ; c'est Appius qui lui avait donné ces cavaliers. Et
vous, vous que j'ai toujours devant les yeux quand je fais ou mon
devoir ou plus que mon devoir, vous me priez de conférer ce titre à
un tel homme ! ne sommes-nous pas convenus de ne le donner à aucun
négociant, et cela, avec l'approbation de Brutus? Scaptius demande
de la cavalerie ; pourquoi pas de l'infanterie? Depuis quand est-il
devenu si prodigue? Mais, dites-vous, les principaux habitants
consentent; je le sais, et c'est sans doute pour cela qu'ils sont
venus me trouver à Éphèse, et qu'ils me firent en pleurant le récit
des maux et des atrocités qu'ils ont eus à souffrir de ces soldats.
Aussi donnai-je immédiatement des ordres pour les faire sortir de
l'île avant une époque fixe. Cet ordre et toute ma conduite envers
les Salaminiens m'ont valu de leur part les décrets les plus
honorables. Mais que veut faire Scaptius de cette cavalerie ? Les
Salaminiens veulent le payer. Il faudrait peut-être les obliger les
armes à la main à payer quatre pour cent par mois ? Et comment
oserai-je, après cela, lire ou seulement toucher ces livres dont
vous êtes si content? Vous avez eu dans cette occasion, mon cher
Atticus, trop, oui trop d'amitié pour Brutus, et trop peu
251 pour moi. Je l'ai
informé de tout ce que vous m'avez écrit pour lui. — Passons
maintenant à autre chose. Je fais tout ici pour Appius, tout ce que
l'honneur peut me permettre ; je suis loin de le haïr, et j'aime
Brutus. Pompée , pour qui je me sens de jour en jour plus d'amitié,
me recommande aussi cette affaire avec beaucoup d'instance. Vous
avez entendu dire que C. Célius vient ici comme questeur ; je ne
sais ce qu'il en est ; mais... Cette affaire de Pammène me déplaît.
J'espère être à Athènes au mois de septembre ; je voudrais savoir
quand vous partirez , et quelle route vous prendrez. J'apprends par
votre lettre de Corcyre ce trait de simplicité de Sempronius Rufus.
Que voulez-vous? j'envie le pouvoir de Vestorius. Je voulais causer
plus longtemps avec vous, mais il commence à faire jour ; la foule
est à ma porte; Philogène est pressé de partir. Adieu donc; faites
mes compliments à Pilia et à notre chère Cécilia, quand vous leur
écrirez. Mon fils vous salue.
262. — A CÉLIUS,
ÉDILE CURULE. Laodicée, avril.
F. II,13. Vos lettres sont
rares : peut-être ne m'arrivent-elles pas exactement. Mais elles me
charment toujours. Dans votre dernière, par exemple , quel cachet de
sagesse ! que d'obligeance et de raison! Mes intentions avaient, il
est vrai, deviné les vôtres ; mais on est bien plus sur de soi avec
l'assentiment de gens habiles et de bon conseil. J'ai, je vous le
répète, beaucoup d'affection pour Appius, et il commence à y
répondre ; je m'en aperçois depuis que notre différend a cessé. Je
l'ai trouvé soigneux de mon honneur comme consul, charmant comme ami
et s'intéressant marne à mes goûts littéraires. Mes bons offices non
plus ne lui ont pas manqué. J'en appelle à votre témoignage; et mou
témoin de comédie, Phanias, viendra, je le suppose, l'appuyer.
Depuis que je sais qu'Appius vous aime, je l'en aime, je vous
assure, davantage encore. Je suis à Pompée sans réserve; vous le
savez, et vous n'ignorez pas à quel point je chéris Brutus. Comment
pourrais-je ne pas mettre du prix à vivre dans de bons et intimes
rapports avec un homme dans la force de l'âge, riche, honoré, qui a
des fils, des proches, des alliés, des amis, qui est de plus du même
collège que moi, et qui m'a donné un souvenir flatteur, à la suite
des succès qu'il a obtenus dans la science de l'augurât ? Si je
m'arrête si longuement sur ce sujet, c'est que j'ai cru reconnaître
que vous doutez de mes sentiments pour Appius. On vous aura dit
quelque chose. Mais tout ce- qu'on a pu vous dire est faux, je vous
en réponds. A la vérité mes principes ne sont pas les si ns en
matière d'administration, et j'ai établi d'autres règles. Peut-être
en aura-t-on conclu qu'il y avait entre nous animosité, et non pas
simplement divergence. Mais je me serais bien gardé de rien faire et
de rien dire qui ne fût parfaitement honorable pour lui. Enfin après
cette affaire et la démarche inconsidérée de Dolabella, ne me
suis-je pas mis en avant pour le couvrir? — La langueur, dites-vous,
s'est emparée de toute la ville. J'aimerais assez voir notre ami
(Curion) s'engourdir dans le repos. Mais les dernières lignes de
votre main m'ont mis la puce à l'oreille. Quoi! Curion est
aujourd'hui pour César! Excepté moi, qui le croira? sur ma vie, je
m'en doutais. Dieux immortels ! que ne puis-je en rire avec vous ! —
Maintenant que le terme arrive, que j'ai enrichi les villes,
conservé aux publicains 255
les restes de leur dernier bail, sans exciter de plaintes de la part
des alliés, que je sais enfin m'être rendu agréable à tous les
habitants, grands et petits, je ne songe plus qu'à partir pour la
Cilicie aux nones de mai ; et dès les premiers jours de l'été, après
avoir réglé tout ce qui regarde la guerre, j'exécute le
sénatus-consulte et je pars. Je veux absolument vous voir édile, et
vous ne sauriez croire à quel point je soupire après Rome, après mes
amis, après vous, par dessus tout.
263. — A Q.
THERMUS, PROPRÉTEUR Laodicée, mai.
F. II, 18. Le service que j'ai
rendu à Rhorion et les attentions que j'ai eues pour vous ou les
vôtres ont excité la gratitude de votre noble cœur, et j'en suis
heureux. Sachez que chaque jour mon dévouement pour vous ne peut que
s'accroître. A vrai dire, votre conduite sans reproche et la
noblesse de votre caractère vous ont porté si haut, qu'il ne me
reste en quelque sorte rien à faire. mais plus je réfléchis sur
votre position, plus je persiste dans l'opinion que j'ai tout
d'abord émise lorsque Ariston vint me voir. Oui, vous vous exposez à
des inimitiés graves, si vous faites un affront à un jeune homme (C.
Antonius) noble et puissant; et certes, il y aurait affront bien
caractérisé lorsque vous n'avez près de vous personne de son rang.
Je ne parlerai pas de sa noblesse : il suffit qu'il soit questeur et
votre questeur, pour avoir le pas même sur les plus capables et les
plus purs qui ne sont que vos lieutenants. Je veux bien qu'on n'ait
pas le pouvoir autant que l'envie de vous nuire. Toujours est-il
qu'il ne faut pas indisposer et indisposer ajuste titre trois frères
qui tiennent par leur naissance à ce qu'il y a déplus élevé, qui
sont ardents, qui ne manquent pas d'éloquence, et qu'avant peu vous
allez voir tribuns du peuple pour trois ans. Quelle sera la
situation politique alors ? bien agitée, ou je me trompe. Pourquoi
de gaieté de cœur vous placer sous le coup de l'hostilité
tribunitienne, lorsqu'il est si simple (personne n'a dans ce cas à
réclamer) de donner la préférence au questeur sur les lieutenants de
questeur? Si, comme je l'espère et le désire, il se montre digne de
ses ancêtres, il vous en reviendra quelque avantage; s'il s'oublie
au contraire, il ne fera tort qu'à lui. J'ai cru nécessaire, avant
mon départ pour la Cilicie, de vous communiquer ces réflexions. Quoi
que vous fassiez, que les Dieux vous secondent ! mais si vous m'en
croyez, évitez des haines, et ménagez-vous du repos dans l'avenir.
264. - A MEMMIUS.
Laodicée, mai.
F. XIII, 2. C. Avianus Evander demeure
dans votre enceinte consacrée. Je le vois souvent et je suis
très-lie avec M. Émilius, son patron. Je ne voudrais pas vous causer
la moindre gêne. Mais je désirerais bien que vous pussiez lui donner
quelques facilités pour son logement. Il a beaucoup de travaux à
livrer et il se trouvera singulièrement pris de court, s'il est
obligé de déménager pour les kalendes de juillet. Je craindrais
d'insister, mais je ne doute pas que vous ne fassiez pour moi dans
cette occasion, si vos intérêts n'en souffrent pas du tout, ou pas
trop, ce que moi-même je ferais pour vous en pareil cas avec grand
plaisir. Vous m'obligerez singulièrement.
256 265. — A MEMMIUS. Laodicée,
mai.
F. XIII, 3. Vous m'avez promis
un bon accueil pour A. Fuflus, et je viens vous le rappeler. Il est
de mes intimes, plein de zèle et de dévouement pour moi, d'une
extrême instruction, d'une égale politesse, en un mot vraiment digne
de l'amitié que je vous demande pour lui. Vous me rendrez un
sensible service. C'est d'ailleurs un homme dont vos bontés
gagneront le cœur, et qui va s'attacher à vous pour jamais. Adieu.
266. — A
APPIUS PULCHER. Laodicée, mai.
F .III,10. J'ai été d'abord
étourdi, àla nouvelle d'une agression aussi téméraire : c'est la
chose du monde à laquelle assurément je m'attendais le moins. Mais
après m'être remis, j'ai compris que vous en auriez facilement
raison, car ma foi est grande en vous et en vos amis, et je vois
plus d'un motif de penser que cette épreuve tournera même à votre
honneur. Ce qui m'afflige profondément, c'est de voir l'envie
arracher de vos mains un triomphe aussi certain que mérité.
Cependant si vous voyez ces choses-là du même œil que moi, vous
agirez eu homme sage, et, victorieux de vous-même, vous remporterez
en même temps sur la haine de vos ennemis le plus beau triomphe.
Vous avez, j'en suis sûr, tout ce qu'il faut d'énergie, de prudence
et de ressources pour faire repentir vos ennemis de cet excès
d'audace. Quant à moi, je vous le jure, et j'en prends à témoin tous
les Dieux, il n'y aura ville de cette province, que vous commandiez
naguères, où je n'aille pour votre honneur ( la vie n'est pas en
question) supplier en défenseur, solliciter en parent, faire appel
aux sentiments des peuples à mon égard, et,s'il le faut, à
l'autorité dont je suis investi. Demandez, exigez, je suis prêt à
répondre à votre attente, à aller même au delà. — Q. Servilius m'a
remis votre lettre qui est très-courte et qui m'a paru trop longue.
Me prier, c'est me faire injure. Je regrette la circonstance qui
veut que j'aie à vous prouver mon estime pour vous, pour Pompée qui
est à mes yeux le premier des hommes; pour Brutus en un mot. Ces
preuves seront de tous les jours, et l'avenir vous en réserve
encore; mais puisque cette malheureuse occasion se présente, je
consens, si j'y fais faute, à ce que le crime en reste à ma mémoire
et le déshonneur à mon nom. Pomptinius, que vous avez traité avec
une si grande et si particulière faveur, et dont je connais mieux
que personne les obligations envers vous, vient de vous donner une
preuve de sa reconnaissance et de son dévouement. Rappelé par des
affaires personnelles de la plus haute importance, il avait pris
congé de moi, à mon grand déplaisir. Mais quand il a su qu'il y
allait de votre intérêt, quoique déjà à bord, il est revenu d'Ephèse
à Laodicée. Quand je vois de pareils dévouements à votre service, et
l'on ne saurait les compter, je ne puis douter que tout ce qu'on a
fait contre vous n'ait pour effet de vous grandir. Si vous parvenez
à faire créer des censeurs, et à exercer la censure d'une manière
digne de cette haute fonction et de vous-même , je suis persuadé que
vous vous placerez pour toujours dans une position inexpugnable pour
vous et les vôtres. Luttez, combattez pour que j'échappe à toute
prorogation, afin qu'après avoir satisfait ici à ce que je vous
dois, je puisse aller aussi là-bas mettre pour vous la main à
257 l'œuvre. — Ce que vous
me mandez des témoignages qui éclatent à votre occasion dans le
public et dans tous les ordres me charme en vérité, mais ne me
surprend pas le moins du monde. Les lettres de mes amis m'en disent
autant. N'est-ce pas en effet une joie pour moi qui vous aime, et
qni prends tant plaisir à vous aimer, de voir que l'on vous rend
justice? n'est-ce pas une joie pour moi qui ai toujours placé là le
prix de mes travaux et de mes veilles, de voir qu'il se trouve
encore à Rome un semblable concert en faveur des hommes de cœur et
de capacité? Ce qui me passe, c'est l'audace de ce jeune homme, dont
j'ai à grand' peine deux fois sauvé la tête, dans les luttes
judiciaires, et qui, au mépris de ce qu'il doit au protecteur de sa
fortune et de son existence, s'en va prendre parti contre vous;
songeant peu à tout ce qu'il y a de consistance et de dignité dans
l'homme auquel il s'attaque, lui qui ne remplit guères ces
conditions, pour ne rien dire de plus. Je savais déjà quelque chose
de ses propos extravagants et de ses étourderies. Mon ami M. Célius
m'en parlait dans ses lettres, et les vôtres m'en ont souvent
entretenu. Son hostilité gratuite envers vous me porterait plutôt à
rompre les relations établies qu'à eu contracter de nouvelles. Car
vous ne doutez pas de mon dévouement. Il a suffisamment éclaté aux
yeux de tous et à Rome et dans la province. — Cependant je vois
percer le soupçon, le doute au moins dans votre lettre. Ce n'est pas
le moment de me plaindre. Mais je ne puis remettre à me disculper.
Quand me vit-on jamais empêcher l'envoi d'une députation en votre
honneur? Et pouvais-je, ennemi déclaré, vous faire moins de mal ?
ennemi secret, me démasquer plus étourdiment? Eussé-je même été
aussi perfide que ceux qui nous suscitent ces querelles, au moins ne
serais-je pas stupide au point de trahir le secret de ma haine. et
de montrer la dernière envie de nuire, sans nuire effectivement. Je
me souviens qu'on est venu à moi, notamment de la ville d'Epictète,
pour réclamer contre l'exagération des sommes allouées aux
députations. J'ai moins prescrit que recommandé de se renfermer
autant que possible dans les termes de la loi Camélia, et la preuve
que je n'y ai pas même tenu la main bien strictement se trouve dans
les comptes de plusieurs villes, où l'on voit porté en dépense tout
ce qu'il leur a plu d'accorder à vos députés. — De combien de
mensonges ne vous a-t-on pas chargé, et avec quelle inconséquence !
Les allocations ont été rayées, ont-ils dit ; on a même exigé des
restitutions des fondés de pouvoirs de députés déjà en route; et
beaucoup de députations ont ainsi manqué. Je pourrais me plaindre et
récriminer, si je n'avais dit tout à l'heure que, dans la position
où vous êtes, me justifier est bien plus digne. Deux mots seulement
sur les raisons que vous aviez de ne pas tout croire aussi
implicitement que vous l'avez fait. Si vous m'avez toujours connu
pour homme de bien, fidèle aux études et aux doctrines qui m'ont
occupé dès l'enfance, pour un homme qui a quelque élévation dans
l'âme, et dont l'intelligence n'est pas trop au-dessous des plus
grandes affaires, vous devez tenir ces qualités pour incompatibles
non-seulement avec la perfidie, la trahison , la duplicité, mais
avec tout ce qui dénote platitude d'esprit ou sécheresse de cœur.
Voulez- 258 vous au
contraire que je sois un homme astucieux et caché? qu'y a-t-il alors
de plus opposé à ce caractère que de mépriser les bontés d'un homme
puissant, d'attaquer sa réputation en province, après avoir chanté
ses louanges à Borne? de montrer une velléité de nuire, sans nuire
en effet; une perfidie qui éclate en démonstrations, et en résultat
ne sait être qu'inoffensive? Où aurais-je pris contre vous ce
ressentiment Implacable? moi qui sais par mon frère que vous n'étiez
pas mon ennemi alors même que vous étiez, par position , presque
tenu de le paraître. Plus tard eut lieu cette réconciliation de tous
deux désirée. Depuis, et pendant votre consulat, avez-vous en vain
réclamé de moi une seule démarche, un témoignage quelconque?
Lorsque, vous faisant cortège à Pouzzol, je fus chargé de vos
volontés, en est-il une seule dont l'accomplissement n'ait été au
delà de votre attente ? Si c'est le propre de l'adresse de chercher
toujours son intérêt, quoi de plus utile et de plus favorable pour
moi, je vous prie, qu'une liaison avec l'homme le plus noble et le
plus honoré; avec l'homme qui par ses richesses, son esprit, ses
enfants, ses alliés, ses proches, peut si efficacement me servir,
soit en ajoutant à l'éclat de mes dignités, soit en me protégeant
contre mes ennemis? En recherchant votre amitié, je me suis proposé
tous ces avantages, il est vrai ; mais ce n'était pas un caicni
d'égoïsme, c'était une inspiration de sagesse. Que dirai-je de tant
de liens qui font ma joie en m'attachant à vous? conformité dégoûts,
douceur de commerce, charme du savoir vivre, intimité des
entretiens, sympathies littéraires ; voilà pour les rapports privés.
Parlerai-je de nos liens politiques? de cette réconciliation au
grand jour dont je ne pourrais enfreindre les droits, même à mon
insu, sans passer pour un traître; de cette confraternité du plus
grand des sacerdoces, dans le sein duquel la moindre atteinte aux
droits de l'amitié passait pour crime chez nos ancêtres ; auquel
même, de leur temps, nul n'eût songé à prétendre, pour peu qu'il fût
en inimitié avec un seul membre du collège? — Je passe sur une foule
d'autres considérations capitales. Mais est-il quelqu'un au monde
qui par inclination, comme par devoir, honore autant que moi Cn.
Pompée, le beau-frère de votre fille? A ne voir que les services, je
lui dois d'avoir retrouvé ma patrie, mes enfants, mon existence, mes
dignités ; de m'être retrouvé moi-même enfin. Parlons-nous de
penchant? où trou ver dans nos annales un seul exemple d'union si
intime entre deux consulaires? De témoignages d'affection? qu'a-t-il
eu de secret, de caché pour moi ? Quel autre a-t-il jamais choisi
pour le représenter près du sénat en son absence? A qui voulut-il
jamais plus de bien? Quelle condescendance, quels procédés pour moi,
quand je mettais dans la défense de Milon une chaleur qui
contrariait ses vues ! Et craignant les ressentiments de parti,
quels soins n'a-t-il pas pris de me protéger contre toute atteinte,
en me plaçant sous l'égide de ses conseils, de son nom et même de
ses armes? Il poussa la noblesse, la magnanimité à cette époque,
jusqu'à fermer l'oreille à toute insinuation maligne, lors môme
qu'elle émanait des sources les plus respectables. Ce n'était pas
pour donner crédit à des propos de Phrygiens, de Lycaoniens, comme
vous l'avez fait au sujet des 259
députations! Eh bien ! sou fils est votre gendre ; je sais que,
indépendamment de ce lien, Pompée vous chérit et vous recherche;
quels sentiments, je vous le demande, ne dois-je pas avoir pour
vous? Ajoutez qu'il m'a écrit des lettres qui m'auraient désarmé,
n'eussé-je dans le cœur qu'aversion pour vous au lieu de tendresse,
et qui, venant d'un homme à qui je suis si redevable, auraient en un
clin d'œil opéré en moi une complète révolution. Voilà bien des
paroles; en voilà trop peut-être. Connaissez maintenant ce que j'ai
fait, ce que je me propose de faire. [Il y a ici une lacune
considérable]. Voilà ce que j'ai fait, ce que je me propose de faire
encore, dans la vue de vous honorer bien plus que de vous défendre ;
car j'espère, au premier jour, apprendre que vous êtes censeur; et
je suis bien d'avis que les devoirs de cette magistrature, qui exige
tant de courage et de sagesse, méritent autrement d'attention et de
soin de votre part que le peu que je fais pour vous.
267. — A C.
CÉLIUS, QUESTEUR. Cilicie, juin.
F. II, 19. Lorsque j'appris
que, suivant mon vœu le plus cher, le sort vous avait désigné pour
mon questeur, j'en eus d'autant plus de joie que j'espérais vous
avoir assez longtemps à mes côtés; et c'était à mes yeux un grand
avantage de pouvoir rattacher à d'anciennes habitudes les relations
que le sort allait établir entre nous. Mais ne recevant de vous ni
de personne avis de votre arrivée, je commençai à craindre, et c'est
encore ma crainte en ce moment, de voir les choses s'arranger de
telle façon que lorsque vous viendrez dans la province, je l'aurais
déjà quittée. J'ai bien reçu de vous une lettre en Cilicie, le 10
des kalendes de juillet, dans mon camp. Elle est fort aimable. J'y
reconnais votre tact et votre esprit; mais elle ne porte date ni de
lieu ni de jour; elle ne me dit point à quelle époque je puis
compter sur vous; et je n'ai pu savoir du porteur, qui ne la tient
pas de vos mains, en quel endroit ni à quelle époque vous l'avez
écrite; Dans cette incertitude, je n'en crois pas moins devoir vous
envoyer mes huissiers et mes licteurs avec cette lettre. Si vous la
recevez à temps, je vous saurai gré de ne pas tarder un moment à
venir me joindre en Cilicie. Votre cousin Curius, avec qui je suis
très-lie, comme vous le savez, m'a écrit à votre sujet d'une façon
toute particulière; C. Virgilius, votre parent et mon intime ami, en
a fait autant. J'aurai pour leur recommandation les égards qu'on se
doit entre amis. Mais la meilleure de toutes, c'est ce que vous
m'avez écrit vous-même; c'est surtout ce que vous me dites de votre
dignité et des rapports qu'elle établit entre nous. Il ne pouvait
m'être donné par le sort un questeur plus désiré. Aussi croyez que
je mets bien du prix à faire éclater ma considération pour votre
mérite et pou r le non* que vous portez. Mais j'en aurai plus
facilement l'occasion, si vous venez me rejoindre en Cilicie: Il y
va essentiellement de votre intérêt et de ce» lui de la république.
268. — A M.
CÉLIUS, ÉDILE CURULE. Cilicie.
F. II, 12. Je suis en peine des
affaires de Rome: J'apprends que les assemblées ont été tumultueu-
260 ses et que les
quinquatrides se sont mal passées. Mais on ne me dit pas quelle en a
été la suite. Au demeurant, ce qui me met le plus en peine, c'est de
ne pouvoir pas rire avec vous de ce qu'il y a de risible dans tous
ces embarras ; il y a matière. Mais je n'ose me confier à une
lettre. Je ne vous pardonne pas. de ne m'avoir encore envoyé aucun
détail. Quoique mon année d'exercice doive être Unie, au moment où
vous lirez ceci, je n'en désire pas moins recevoir en chemin une
lettre de vous qui me mette au courant des affaires , afin que je ne
tombe pas à Rome comme un homme tout neuf. Personne ne peut remplir
cette mission mieux que vous. — Votre Diogène, qui est un garçon
fort sage, m'a quitté avec Philon à Pessinunte. Ils se rendent
auprès d'Adiatorix, quoiqu'ils sachent très-bien tous deux par
expérience qu'il n'y a libéralité ni faveur à y attendre. Rome!
Rome! mon cher Rufus. Là est la vie; là luit le soleil. Voyager,
pour quiconque peut faire figure à Rome, c'est aller chercher
l'obscurité et la fange. Voilà ce que j'ai toujours pensé dès ma
jeunesse. Ah ! puisque c'était ma conviction, que ne m'y suis-je
tenu! Pour une seule de nos causeries, de nos promenades, je
donnerais tout ce que me vaut la province. — Je m'y suis fait, je
crois, une réputation d'intégrité. Mais je me faisais autant
d'honneur en refusant qu'en acceptant la mission. Et la perspective
du triomphe? allez-vous dire. Mon triomphe serait assez beau. Je
n'eusse pas été si longtemps sevré de tout ce qui peut m'être
agréable. Enfin je vais vous revoir. Faites que je trouve en chemin
une de ces lettres comme vous en savez écrire.
269. — A
ATTICUS. Cilicie, juin.
A. VI, 3. Il n'est rien survenu
depuis que je vous ai écrit par la voie de votre affranchi Philogène.
Mais je renvoie Philotime à Rome; il faut bien le charger de
quelques mots pour vous. Parlons d'abord de mon plus grand souci.
Vous n'y pouvez rien toutefois; car l'affaire est en main et vous
êtes aux rives lointaines. « La vaste mer roule ses flots entre
nous. » Mais le temps a marché. C'est le 3 des kalendes d'août que
mon mandat expire. De successeur point de nouvelles. Qui vais-je
laisser à la tête de la province? La raison et l'opinion générale
désignent mon frère. D'abord, parce que c'est un honneur, et qu'il
en est le plus digne. Puis 11 est le seul de mes lieutenants qui ait
été préteur. Car Pomptinius m'a quitté depuis longtemps, et ne
m'avait suivi qu'à cette condition. Le questeur, de l'aveu de tous,
n'est pas l'homme qu'il faut. Il est léger, sans mœurs, avide de
tout gain. D'un autre côté , je n'ai guère l'espoir d'amener là mon
frère. Il a cette province en aversion. Et certes, c'est bien la
plus odieuse, la plus triste des provinces. Supposons d'ailleurs
qu'il n'ose pas refuser son consentement ; puis-je , en conscience ,
m'en prévaloir? La guerre menace sérieusement la Syrie; le feu peut
gagner cette province. Elle n'est pas gardée , elle n'a de subsides
assurés que pour mon temps d'exercice. Est-ce agir en frère que de
laisser au mien un tel fardeau? Est-ce agir en ami de la république
que d'y laisser un homme sans consistance? Vous voyez quelle
perplexité est la mienne, et si j'ai besoin de conseils. Voulez-vous
que je vous le dise? je me serais bien
261 passé de tout ce
tracas. Parlez-moi de votre province. Vous pouvez la quitter
celle-là, quand il vous plaira, si ce n'est déjà fait, et déléguer à
qui bon vous semble les gouvernements de Thesprotie et de Chaonie.
Quintus ne m'a pas rejoint. Je ne sais donc pas encore ce que je
pourrai gagner sur lui. Et j'aurais son adhésion, que je ne saurais
quel usage en faire. — Voilà où j'en suis sur ce point. Sous tout
autre rapport, mon administration n'est que gloire et popularité.
J'ai mis en action les principes de ces ouvrages que vous louez
tant. J'ai ménagé les villes et satisfait les fermiers. Nul n'a
essuyé de moi un affront. J'ai eu rarement à user de rigueur, et
aucun de ceux que ma justice a frappés n'oserait s'en plaindre. J'ai
acquis des droits au triomphe. On ne m'eu verra pas ambitieux outre
mesure. Je ne ferai de démarches que de votre aveu. L'affaire
difficile est la remise de la province. Quelque dieu viendra s'en
mêler, j'espère. — Vous savez mieux que moi ce qui se passe à Rome.
Vous avez les nouvelles plus fraîches et plus sûres; je suis fâché
de n'en pas trouver un seul mot dans vos lettres. On dit ici de
vilaines choses de Curion et de Paullus. Ce n'est pas que je voie
rien à craindre pour la république, tant que Pompée est là, debout
et en sentinelle, ou même tant que Pompée respire. Pourvu seulement
que les Dieux nous le conservent. Mais j'aimais Curion, j'aimais
Paullus, et je m'afflige pour eux. Il faut, si déjà vous êtes à
Rome, aussitôt du moins que vous y serez, que vous vous occupiez de
me dresser un aperçu général de la situation, de telle manière que
je puisse avoir une règle sur tout, et ma leçon faite à l'avance.
C'est quelque chose e n arrivant que de ne pas se trouver tout
dépaysé, comme si l'on venait d'un autre monde. — Et Bru tus que
j'oubliais ! Je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien négligé pour son
affaire. Les Cypriens allaient s'exécuter ; mais Scaptius n'a pas
voulu se contenter d'un pour cent par mois et de l'intérêt cumulé
d'année en année. Pompée, travaillant pour son propre compte, n'a
pas tiré d'Ariobarzane plus que moi pour Brutus. Je ne puis
cependant lui forcer la main. Il est si pauvre, ce roi! De loin, il
n'y avait moyen de s'entendre que par lettres. Je l'en ai assailli.
En résumé, la créance de Brutus aura été mieux traitée quo celle de
Pompée. Déjà cette année Brutus a reçu comptant cent talents
environ. Pompée en six mois n'a eu que des assurances pour deux
cents. Relativement à Appius, je ne saurais dire quelles concessions
j'ai faites à mon amitié pour Brutus. Enfin, je cherche ce que je
pourrais me reprocher à son égard. Il a de tristes amis dans Matinus
et Scaptius. Ce dernier peut-être jette feu et flamme contre moi,
parce que je n'ai pas voulu mettre de cavalerie à sa disposition
pour réduira les Cypriens, ce qu'il avait obtenu précédemment ; ou
peut-être encore parce qu'il n'est pas préfet, position que je n'ai
voulu laissé prendre à aucun mandataire d'intérêts privés; pas même
à C. Vennonius, mon ami particulier, ni à M. Lénius qui est le
vôtre. Je vous avais fait part de cette détermination à Rome, en
vous quittant, et j'ai tenu bon. Mais de quoi se plaint-il? Il était
maître d'emporter l'argent. Il n'a pas voulu. Quant au Scaptius de
Cappadoce, celui-là doit être content de moi. Je l'ai nommé tribun à
la recommandation de Brutus. Il a accepté ; puis m'a écrit qu'il
n'exercerait pas. — II y a encore un certain Gavius dont j'avais
fait un préfet, à la prière de 262
Brutus, et dont la conduite et les propos, en toute occasion, n'ont
cessé d'être fort blessants pour moi. On dirait un des aboyeurs de
Clodius. Il m'a laissé partir pour Apamée sans me suivre. Puis,
ayant rejoint le camp, il en est reparti sans me demander mes
ordres. Enfin il s'est mis, je ne sais pour quelle raison, en
opposition flagrante avec moi. Quelle opinion auriez-vous de mon
caractère, si j'eusse continué à l'employer? Moi qui jamais ne
souffris les insolences des grands personnages, je me serais résigné
à essuyer celles de cet avorton? et, qui plus est, à l'avoir près de
moi, bien rétribué, honorablement placé? Dernièrement je le
rencontrai à Apamée, comme il allait s'en retourner à Rome; et le
voilà qui m'apostrophe d'un ton que je me permettrais a peine avec
un Culléolus. A qui prétendez-vous que je m'adresse, dit-il, pour
mes indemnités de préfet? Je répondis avec une douceur qu'on a
trouvée excessive, que je n'allouais d'indemnités qu'à ceux dont
j'avais accepté les services. Il partit furieux. Si Brutus épouse
les ressentiments d'un faquin de cette espèce, vous pouvez l'aimer
tout seul. Je ne vous ferai pas concurrence. Mais je suis sûr qu'il
prendra la chose comme il le doit. Je suis bien aise cependant de
vous rendre juge de ces détails, dont je n'ai pas manqué de
l'instruire tout au long. Brutus (je le dis entre nous) ne m'écrit
jamais sans se laisser aller ça et là à un certain ton d'arrogance
et de hauteur. Témoin sa dernière lettre au sujet d'Appius. Il y a
un passage que vous citez souvent. « Granius lui ne se méprise pas
tant, et il a en « aversion ces airs superbes. » Au surplus il vaut
mieux rire de tout cela que de s'en fâcher. Mais vraiment Brutus ne
songe pas assez à ce qu'il dit, ni à qui il parle— Le jeune Quintus
aura lu, j'imagine, ou plutôt j'en suis sûr, quelques-unes de vos
lettres à son père. II a coutume de les ouvrir, et c'est moi qui l'y
ai engagé, car il peut s'y trouver des choses essentielles. Vous y
aurez sans doute parlé de votre sœur comme à moi. Le fait est que
j'ai vu ce jeune homme tout hors de lui, et il m'a confié son
chagrin en fondant en larmes. Que vous dire, sinon qu'il a donné là
une preuve touchante de sa tendresse pour sa mère, de son heureux
naturel et de son bon cœur. J'en augure de plus en plus qu'il
justifiera tout ce que nous espérons de lui. C'est pourquoi je vous
fais part de cet incident. — II fait que je vous dise aussi que le
dis d'Hortensius s'est montré à Laodicée aux combats de gladiateurs,
dans une tenue indécente et scandaleuse. A cause de son père, je le
priai à souper le jour de son arrivée, et à cause de son père aussi,
je m'en tins là. Il me dit qu'il m'attendait à Athènes, et de là me
tiendrait compagnie jusqu'à Rome. Fort bien ! repris-je. Comment
répondre autrement? J'espère qu'il n'y songera plus. Pour moi, je
n'en ai pas la moindre envie ; je craindrais de désobliger son père
que j'aime beaucoup. Toutefois, s'il faut subir le fils, je saurai
bien m'arranger de façon à ne pas blesser le père ; ce que je veux
éviter à tout prix— Voilà tout. Autre chose encore. Envoyez-moi le
discours de Q. Celer contre M. Servilius. Une lettre, je vous prie,
le plus tôt possible. S'il n'y a rien, dites-le-moi par un mot ou
par votre messager. Mes compliments à Pilia et à votre fille.
Portez-vous bien.
270 A
APPIUS PULCHER (CENSEUR, J'ESPÈRE). Cilicie, juin,
F. III, 11. J'étais dans mon
camp, près du fleuve Pyrame, lorsque j'ai reçu à la fois deux
lettres de vous que Q. Servilius m'a envoyées de Tarse. L'une est
datée des nones d'avril; l'autre, que Je crois plus récente, est
sans date. Je répondrai d'abord à la première où vous m'annoncez que
vous avez été absous du crime de lèse-majesté. Je le savais déjà par
ma correspondance, par les courriers et par la renommée elle-même,
car rien n'a fait plus de bruit. Non qu'il y eût deux opinions à
votre égard, mais quand il s'agit de personnages aussi illustres, il
y a toujours du retentissement. Cependant votre lettre est venue
ajouter à ma Joie, et parce que mes nouvelles n'étaient ni aussi
précises ni aussi détaillées, et parce qu'en tenant le récit de
vous-même, je me surprenais a vous féliciter à chaque instant. — Je
vous ai embrassé par la pensée. J'ai pressé votre écriture contre
mes lèvres et je me suis moi-même félicité. C'est peut-être une
illusion d'amour-propre ; mais quand je vois le peuple, le sénat,
les juges rendre hommage an caractère, au talent, à la vertu, je
m'Imagine qu'il y a quelque chose de tout cela à mon adressé. Ce qui
m'étonne au surplus, ce n'est pas la glorieuse issue de votre
procès, c'est la méchanceté de vos accusateurs. Mais qu'importé,
direz-vous, que je sois acquitté de l'accusation de lèse-majesté, si
je ne le suis point sur l'accusation de brigue? L'objection est sans
application Ici, puisque d'un côté vos mains sont pures de toute
brigue, et que, de l'autre, ces mêmes mains ont accru et non lésé la
majesté romaine. Cette loi cependant, quoi qu'en ait fait Sylla,
peut servir aussi à défendre l'honnête homme des attaques des
pervers. Quant à la brigue, elle procède si ouvertement qu'il faut
bien du front, soit pour accuser, soit pour se défendre. Est-ce que
chacun ne sait pas bien, si l'argent a été distribué ou non ? Or
dans le cours de vos honneurs, s'est-il élevé contre vous un soupçon
? Pourquoi u'étais-je pas là? Ah! que j'aurais fait rire à leurs
dépens ! —Deux choses m'ont charmé dans votre lettre. D'abord la
république, dites-vous, a pris elle-même votre défense. C'était de
droit en vérité , eût-elle en profusion les hommes d'honneur et de
courage. Mais quand l'espèce est si rare dans tous les rangs, aussi
bien que dans tous les âges ; pauvre orpheline qu'elle est, la cité
ne doit-elle pas tout faire pour se conserver de pareils tuteurs ?
Le second article de votre lettre se rapporte à Pompée et à Brutus,
que vous dites avoir été admirables de loyauté et de dévouement pour
vous. Je me réjouis de cette fidélité à la vertu et au devoir chez
deux de vos plus proches alliés, de mes meilleurs amis; dont l'un
est le premier homme de tous les siècles et de toutes les nations,
et dont l'autre, dès longtemps le modèle de notre jeunesse,
deviendra bientôt, j'espère, le modèle de la cité tout entière. Les
témoins gagnés seront signalés dans les villes auxquelles ils
appartiennent. Déjà Flaccus a dû s'en occuper ; à son défaut j'y
veillerai moi-même à ma prochaine tournée en Asie. —J'arrive à votre
seconde lettre, à cette peinture frappante de notre époque et de la
situation de la république. Je reconnais et j'aime la haute
intelligence qui en a saisi les traits. J'y vois le danger moindre
que je me le figurais, et les ressources plus considérables, s'il
est vrai, 264 comme
vous me l'écrivez, que toutes les forces de l'État tendent à se
concentrer dans les mains de Pompée. J'y vois en même temps l'esprit
confiant et résolu qui vous anime pour défendre la république. Enfin
c'est un bonheur inexprimable pour moi de songer qu'au milieu de vos
immenses occupations, votre bonté n'a voulu s'en remettre à personne
du soin de me faire connaître toute notre position. Réservez vos
/ivres de droit augurai pour le temps où nous aurons l'un et l'autre
des loisirs. Lorsque j'insistais , dans mes lettres, sur
l'accomplissement de votre promesse, je vous croyais entièrement
oisif à Rome. Provisoirement, à la place de ces livres, envoyez-moi
tous les discours que vous avez prononcés et que vous m'avez
offerts. Tullius qui a des commissions pour moi n'a pas encore paru
; et je n'ai plus personne des vôtres auprès de moi, si ce n'est
tous les miens qui tous sont vôtres assurément. Je ne sais quelles
sont ces lettres où j'ai, dites-vous, trop pris la mouche. Je ne
vous en ai écrit que deux où je me justifiais avec soin, mais ne
vous accusais que bien doucement de vous être laissé trop facilement
prévenir. J'ai cru ne me plaindre qu'en ami ; si le ton vous en a
déplu, je m'en abstiendrai à l'avenir. Les lettres étaient-elles mal
écrites? Oh ! alors elles n'étaient pas de moi. Aristarque déclare
que tout vers d'Homère qui ne lui plaît pas n'est pas d'Homère. De
votre côté, (il faut bien rire un peu) si quelque chose n'est pas de
bon style, comptez que ce n'est pas de moi. Adieu, et si déjà vous
êtes censeur, comme je l'espère, songez sans cesse, dans l'exercice
de votre charge, à la censure de votre bisaïeul.
271. CATON A
CICÉRON. Rome, juin.
F. XV, 5. Je me réjouis comme
homme public et comme ami de voir cette force d'âme, cette pureté,
cet amour du devoir dont vous avez fait preuve à Rome comme citoyen,
dans les plus grandes circonstances, se retrouver en vous au même
degré, quand vous administrez au dehors et commandez les armées.
Aussi ai-je loué dans mon discours et dans mon décret le magistrat
sans reproche, l'homme de conseil et d'action à qui nous devons la
conservation d'une province, le salut de la personne et du royaume
d'Ariobarzane, et le retour d'alliés incertains à l'attachement pour
la domination romaine. C'est d'après mon jugement ce que je pouvais
faire; je l'ai fait. Les supplications sont ordonnées. Et je vous en
félicite, si, après un succès qui n'a rien de fortuit, et dont vous
n'êtes redevable qu'à votre vertu et à votre conduite, vous aimez
mieux voir notre reconnaissance remonter aux Dieux, immortels que se
reporter sur vous. Que si vous regardez les supplications comme un
droit au triomphe et que vous aimiez mieux par conséquent que l'on
en fasse honneur au hasard qu'à vous, je vous dirai que le triomphe
n'est pas toujours une conséquence nécessaire des actions de grâces,
et qu'il y a quelque chose de plus éclatant que le triomphe, c'est
d'entendre proclamer par le sénat qu'on est redevable du salut et de
la conservation d'une province, à l'esprit de mansuétude et d'équité
du gouverneur, plutôt qu'au courage des soldats et à la faveur des
Dieux. Si cette lettre est assez longue, contre mon usage, c'est que
je tenais particulièrement à vous faire bien comprendre que si j'ai
opiné pour ce qui est le plus grand honneur à mon avis, je n'en suis
pas moins heureux de ce que vous avez obtenu ce que vous préfériez.
C'est dans ce sens que j'ai voté. Portez-vous bien, aimez-moi
toujours et continuez avec la même sévérité de principes et
265 le même zèle à servir,
comme vous le faites, la république et ses alliés.
272. — CÉLIUS
A CICÉRON. Rome, juin.
F. VIII, 11. L'affaire de vos
supplications n'a pas été longue, mais elle m'a donné bien de la
tablature. Il y avait un point difficile à saisir. Avec les
meilleures dispositions pour vous, Curion, voyant que c'était à qui
tâcherait d'entraver les comices, avait déclaré qu'il s'opposerait
absolument aux supplications, ne voulant pas qu'on pût l'accuser de
négliger l'avantage que lui avait donné l'extravagance de Paullus,
ni se faire accuser de prévarication dans la cause publique. Il a
fallu composer, et les consuls se sont engagés à n'en décerner à
personne autre cette année. Vous leur devez des remercîments à tous
deux, à Paullus surtout. Marcellus a dit vaguement, qu'il n'espérait
pas d'autres supplications cette année; Paullus positivement, qu'il
n'y en aurait pas. — On m'avait averti qu'Hirrus voulait faire un
long discours. Je l'ai entrepris ; et non seulement il n'a pas
péroré, mais lorsqu'il s'est agi de victimes, au lieu de demander,
comme il le pouvait, l'appel nominal, ce qui arrêtait tout, il est
resté muet. Seulement il s'est rangé du côté de Caton qui, après
s'être exprimé sur vous en termes fort honorables, n'a point opiné
pour les supplications. Favonius a fait le troisième. Il faut de
votre part un mot de remercîment à chacun selon son caractère et ses
engagements : aux trois derniers pour leur bienveillance passive,
pour n'avoir point combattu et par conséquent point empêché le vote,
comme il dépendait d'eux de le faire; et, à Curion, pour avoir bien
voulu s'écarter en votre faveur de la voie dans laquelle il était
entré. Quant à Furnius et à Lentulus, ils ont fait leur devoir et se
sont donné les mêmes peines, les mêmes mouvements que moi,
travaillant comme pour leur propre compte. Je puis aussi rendre
justice à Balbus Cornélius, à son zèle, à son adresse; il a
fortement parlé à Curion , lui affirmant que César prendrait son
hostilité dans cette circonstance comme une injure personnelle , et
insinuant même quelques doutes sur sa bonne foi. Les Domitius et les
Scipions qui auraient bien voulu faire tout manquer, ont toutefois
voté le décret, comptant sur l'opposition de Curion qui, au premier
mot qu'ils lui en ont dit, leur a répondu fort spirituellement qu'il
trouvait assez naturel de renoncer à son opposition, quand il voyait
le décret voté par des gens qui n'en voulaient pas. — A l'égard des
affaires publiques, il n'y a de chaleur en ce moment que sur la
question des provinces. Pompée paraît d'accord avec le sénat pour
exiger absolument le retour de César aux ides de novembre. Curion
est décidé à tout plutôt que de le souffrir. Il fait bon marché du
reste. Nos gens, que vous connaissez bien, n'osent s'engager dans
une lutte à outrance. Voici l'état de la scène. Pompée, en homme qui
n'attaque point César, mais qui entend ne lui concéder que ce qui
est juste, accuse Curion d'être un agent de discorde. Au fond, il ne
veut pas du tout, et redoute singulièrement que César ne soit
désigné consul avant d'avoir remis son ar-
266 mée, cl sa province.
Il est assez mal mené par Curion qui lui jette continuellement au
nez son second consulat. Je vous le prédis : si l'on ne garde des
ménagements avec Curion, César y gagnera un défenseur. Avec l'effroi
qu'ils laissent voir de l'opposition d'un tribun, ils feront que
César va rester indéfiniment le maître dans les Gaules. —
Vous-trouverez dans la relation que je vous envoie les opinions
individuelles comme elles ont été prononcées. Prenez de ce recueil
ce qui vous conviendra. Il y a beaucoup à passer; par exemple, les
cabales de théâtre, les funérailles et autres fatras. Le bon
toutefois y domine. J'aime mieux pécher en ce sens, et vous faire
lire bien des détails dont vous ne vous souciez guère, que de
risquer d'omettre un seul fait important. Je vous remercie d'avoir
pris à cœur l'affaire de Sittius. Mais si la bonne foi de ces
gens-là vous est suspecte, vous avez pleins pouvoirs. Agissez en
conséquence.
273. - A
ATTICUS. Tarse, juin.
A. VI, 4. Je suis arrivé à
Tarse le jour des nones de juin. Des soucis graves m'y attendaient :
une guerre sérieuse en Syrie, la Cilicie infestée de brigands, un
plan de conduite à arrêter; chose d'autant plus difficile que je
n'ai plus que quelques jours à passer en charge; enfin, et c'est là
le pis, un successeur à désigner; ainsi le veut le sénatus-consulte.
Le moins justifiable de tous les choix serait le questeur Mescinius.
De Célius, point de nouvelles. Le mieux serait de laisser mes
pouvoirs à mon frère avec le commandement des troupes, mais que
d'inconvénients I notre séparation d'abord, puis la guerre
imminente, et de si méchantes troupes; mille autres choses encore.
L'insupportable position ! je m'abandonne au sort, la prudence
humaine n'y peut rien. — Vous voilà de retour à Rome, et en bonne
santé je pense. Je compte sur vos bons offices ordinaires pour tout
ce qui me concerne, pour ma chère Tullie notamment. Pendant que vous
étiez en Grèce, j'ai mandé à Térentia mes intentions. Je vous
recommande aussi la marque d'honneur que je sollicite. Je crains
qu'en votre absence on n'ait pas assez fait valoir au sénat le
compte rendu de mes opérations. — Autre chose, mais je ne veux ici
vous parler qu'à mots couverts. Exercez votre sagacité. « Aux
propos décousus que m'a débités l'affranchi de ma femme, vous savez
qui je veux dire, je suppose quelque infidélité dans le compte qu'il
m'a rendu des biens du tyrannicide Crotoniale (Milon). Je
crains que vous n'ayez pas le talent d'Œdipe, Examinez cela et
tâchez de mettre le reste en sureté ». Je n'ose exprimer toute
ma crainte. Faites voler votre réponse, et que je la trouve en
chemin. Je vous écris à la hâte au milieu d'une marche. Mes
compliments à Pilia et à la charmante Attica.
274. — A
ATTICUS. Tarse, juin.
A. VI, 5. Vous ôtes sans doute
à Rome. Cela étant, que je vous félicite de votre heureux retour. Il
me semblait qu'en Grèce vous étiez pour moi plus absent encore. Et
en effet j'étais moins au courant de mes affaires et de celles de
l'État. Aussi, sans vous occuper du chemin que j'aurai déjà pu faire
pour revenir, ne laissez pas d'échelonner le plus possible vos
lettres sur ma route. Entrez-y dans les plus grands détails,
notamment sur le point touché dans ma dernière ; savoir qu'aux
phrases entortillées et décousues, aux circonlocution de l'affranchi
de ma femme, je soupçonne qu'il ne m'a pas rendu bon compte de
267 sa gestion touchant
les biens du Crotoniate. Tâchez de pénétrer cela avec le coup d'œil
gué je vous connais. Autres renseignements. Il t'est reconnu devant
Camille, dans la ville des sept collines, débiteur envers moi de
soixante-douze mines sur les biens du Crotoniate, et de
quarante-huit sur ceux de la Chersonèse ; et bien que depuis il lui
soit rentré sur une succession douze cent quatre vingt mines en deux
payements, il en est encore à se libérer d'une obole de cette dette,
dont le terme est échu depuis les kalendes du second mois. Son
affranchi, qui s'appelle comme le père de Conon, ne s'est donné non
plus le moindre mouvement. Je vous recommande donc en premier lieu
de me faire payer du principal, et s'il est possible d°s intérêts,
qui ont couru du jour susdit. Je l'ai eu quelques jours ici sur les
bras, et il m'a mis fans les transes. Il espérait quelque remise, et
venait me tâter. Voyant que c'était peine perdue, il est parti
brusquement, en disant : « Je me retire. Je rougirais d'attendre
plus longtemps. » Il m'a encore jeté au nez l'ancien proverbe. « A
cheval donné, etc. » Mais songeons à autre chose ; et voyons quel
parti prendre. Mes fonctions vont expirer (je n'ai plus que 33 jours
), et jamais elles ne m'ont donné plus de tourment. Laguerre désole
la Syrie; et Bibulus en a tout le poids à soutenir, au milieu de son
cruel chagrin. Ses lieutenants, son questeur, ses amis m'écrivent
lettre sur lettre pour solliciter ma coopération. Mon armée est bien
faible. Ce ne sont pas les auxiliaires qui me manquent; mais tous
sont Galates, Sidiens, ou Lyciens : c'est à peu près là mon
effectif. Cependant je crois de mon devoir, tant que j'aurai le
commandement légal de la province, de me tenir toujours le plus près
possible de l'ennemi. Mais, ce qui me charme, c'est que Bibulus
n'est rien moins que pressant. S'il m'écrit, c'est de toute autre
chose. Et, insensiblement, le jour du départ approche. Le terme une
fois venu, autre problème à résoudre. Qui laisser à ma place? Encore
si le questeur Caldus arrivait ; mais je n'ai pas même entendu
parler de lui. Sur ma parole, je voudrais vous en écrire plus long;
mais la matière me manque. Et je ne suis guère en humeur de
plaisanter pour remplir ma lettre. Adieu donc. Mes compliments à
Atticula et à notre chère Pilia.
275. — A
ATTICUS. Tarse, juillet.
A. VI, 7. Le jeune Quintus, en
bonfils, a réconcilié son père avec votre sœur. Je le poussais assez
souvent ; mais c'était peine superflue. Vos lettres aussi y ont été
pour beaucoup. Enfin tout va se retrouver, je crois, sur le pied que
nous désirons. Avez-vous reçu de. moi deux lettres d'affaires en
grec et en style énigmatique? Ne brusquez rien. Seulement vous
pouvez, tout en causant, lui demander s'il m'a remis le solde du
compte de Milon, et l'engager à en finir avec moi. Peut-être en
tirerez-vous quelque chose. J'ai donné rendez-vous à Laodicée à mon
questeur Mescinius, afin de pouvoir régler mes comptes , et en
laisser copie, comme le veut la loi Julia, dans deux villes de la
province. Je compte toucher à Rhodes, à cause de nos enfants, et de
là voguer en toute diligence vers Athènes en dépit des vents
étésiens qui nous soufflent vigoureusement en face. Je veux
absolument arriver à Rome sous les magistrats actuels, qui se sont
montrés pour moi dans l'affaire des supplications. Marquez-moi
toutefois, avant que j'arrive, s'il y a quelque raison politique
pour ne pas trop presser mon retour. Tiron vous aurait écrit, mais
je l'ai laissé en arrière grièvement malade. Bien que les dernières
nouvelles annoncent du mieux, je n'en suis pas moins au supplice. Je
ne vis jamais de sentiments plus purs, un zèle plus soutenu que chez
ce jeune homme.
276. — A
CANINIUS SALLUSTIUS, PROQUESTEUR. Tarse.
F. II, 17. Votre huissier m'a
remis deux lettres de vous, à Tarse, le 16 des kalendes d'août. Je
vous y répondrai par article comme vous semblez le désirer. Je ne
sais rien sur mon successeur, et je ne pense pas qu'on m'en donne
un. Mais rien ne m'empêche de partir au jour fixé, puisqu'il n'y a
plus à craindre de guerre avec les Parthes. Je ne compte pas
m'arrêter en route. Je toucherai seulement à Rhodes, à cause de mes
jeunes Cicérons. Encore la chose n'est-elle pas certaine. Je veux
arriver à Rome sans perdre un moment. Toutefois je réglerai ma route
d'après ce que je saurai des affaires publiques, et de l'état de la
ville. Il n'est pas possible que votre successeur fasse assez de
diligence pour que je me rencontre avec vous en Asie. — Ce serait
sans doute un embarras de moins pour vous de n'avoir pas de comptes
à rendre comme Bibulus vous y autorise. Mais cette facilité ne se
concilie guère avec la loi. Julia Bibulus a des raisons à lui pour
ne pas s'y soumettre : mais mon avis est que vous ne pouvez vous y
soustraire sous aucun prétexte. — Vous pensez qu'on n'aurait pas dû
retirer la garnison d'Apamée ; c'est aussi, je le vois, l'avis de
bien d'autres; et je regrette les interprétations malveillantes
auxquelles ce fait a donné lieu. Il n'y a plus que vous qui demandez
si les Parthes ont passé on non. Les rapports que j'ai reçus ont été
si positifs à cet égard qu'après avoir fait occuper fortement tous
les postes, j'ai congédié toutes mes garnisons. — II n'est pas exact
que Je veuille vous envoyer les comptes de mon questeur. Ils ne sont
pas même prêts : et mon intention est de les déposer à Apamée. Quant
au butin de mon expédition, personne, excepté les questeurs de Rome,
c'est-à-dire excepté le peuple romain, n'y a touché et n'y touchera.
Je compte prendre à Laodicée des mesures de garantie pour que
l'argent de la république ne coure pas les risques du transport.
Touchant les CCIƆƆƆ drachmes dont vous me parlez , il n'y a pas
moyen de disposer pour aucun prêt de cette somme. Tout l'argent est
considéré comme butin, et les trésoriers seuls en ont le maniement.
Quant à la part qui m'en revient, c'est le questeur que cela
concerne. — Vous me demandez ce que je pense des légions qui sont
décrétées pour la Syrie. J'ai toujours douté qu'on les envoyât, et
je suis sûr aujourd'hui que si, avant leur départ, on vient à savoir
que la Syrie est tranquille, elles ne partiront point. Ce qui
pourrait bien arriver, c'est que votre successeur Marius se fît
attendre ; le décret du sénat portant expressément qu'il ait à
partir avec les légions. J'ai répondu à votre première lettre.
J'arrive maintenant à la seconde. — Vous voulez que je vous
recommande à Bibulus le plus chaudement possible. J'y suis tout
disposé ; mais auparavant j'ai quelques observations à vous faire.
Seul de tout 269
l'entourage de Bibulus, vous ne m'avez jamais dit mot de l'aversion
que, sans aucun motif, il a conçue pour moi. J'ai su de plus d'un
côté qu'à l'époque où Ton craignait pour Antioche, et où l'on
n'avait d'espérance qu'en moi et mon armée, il disait hautement
qu'il s'exposerait à tout plutôt que de paraître avoir eu besoin de
mon secours. Je ne vous en veux pas de votre silence; parce que près
du préteur, votre position eu qualité de questeur était assez
délicate, et pourtant on parlait déjà à cette époque de la manière
dont il se conduisait avec vous. En ce qui me concerne ; il écrivait
à Thermus, au sujet de la guerre des Parthes, et il ne m'écrivait
pas un mot à moi, sur qui il n'ignorait pas que pesait la
responsabilité. Il ne m'a adressé qu'une seule lettre ; c'était pour
l'augurât de son fils. Je ne voulus me souvenir que de ses malheurs,
et comme j'ai toujours beaucoup aimé le jeune Bibulus, je me suis
fait un devoir de faire une réponse très-obligeante. Si c'est
misanthropie chez lui (ce que je ne savais pas), ces procédés me
deviendront moins sensibles ; si c'est à moi personnellement qu'il
en veut, à quoi ma recommandation vous servirait-elle? Dans ses
dépêches au sénat, il s'attribuait ce qui nous était commun ; par
exemple, le change si avantageux de l'argent du peuple, dont on
était, disait-il, redevable à ses soins. Il s'est même approprié un
honneur qui m'était dû exclusivement, osant bien se prévaloir du
refus que j'avais fait d'employer des auxiliaires Transpadans, comme
s'il eût eu le mérite de l'économie- D'un autre côté il m'associe
généreusement à ce qu'il a fait sans moi, lorsque nous avons demandé
tous deux que la ration de pain de la cavalerie auxiliaire fui
augmentée. Mais ce qui me semble marquer surtout en lui la petitesse
d'esprit, et je ne sais quelle vague envie de nuire, c'est que, dans
ses lettres, en parlant d'Ariobarzane, que le sénat sur ma
proposition a nommé roi, et qu'il a placé sous mon patronage, il lui
refuse le titre de roi, et affecte même de l'appeler le fils du roi
Ariobarzane. C'est un de ces caractères que les avances ne font
qu'aigrir. Toutefois, pour ne pas vous refuser, j'ai tracé une
lettre pour lui et je vous l'envoie. Faites-en ce que vous voudrez.
277 — DE
CÉLIUS A CICÉRON. Rome, juin
F, VIII, 13. Recevez mes
compliments sur l'alliance de votre famille avec cethomme excellent,
car c'est l'opinion que j'ai conçue de lui. S'il s'est fait du tort
par quelques écarts, l'âge a passé là-dessus; et ce qui pourrait lui
en rester encore, va disparaître, j'en suis certain, dans ses
nouveaux rapports avec vous, devant l'autorité de votre raison, et
son respect pour Tullia. L'entêtement n'est pas son défaut, et, ce
qui vaut encore mieux, il a le sentiment du bien. Enfin, et c'est
tout pour moi, je l'ai pris en affection. — Vous auriez bien voulu
voir l'opposition de Curion triompher dans l'affaire des provinces ;
mais lorsqu'on eut fait le rapport, suivant le décret du sénat, et
que Marcellus le premier eut donné son avis, qui était de s'entendre
avec les tribuns du peuple, la majorité du sénat s'est tout à coup
prononcée en sens contraire. Notre grand Pompée est d'un
affadissement à ne plus trouver rien qui le réveille. Mais
aujourd'hui les opinions ont tourné au point qu'on trouve bon de
compter comme candidat tel qui ne veut se départir d'armée ni de
province. Comment 270
Pompée, quand il en sera instruit, prendra-t-il la chose? Et que
devient la république, s'il ne la prend à cœur? à vous le souci,
anciens et riches. Hortensias , an moment où je vous écris , rend le
dernier soupir.
278. — A M.
CÉLIUS , ÉDILE CURULE. Juillet.
F. II, 15. On ne pouvait agir
avec plus d'adresse et de prudence que Curion et vous dans l'affaire
des supplications. Certes, j'ai été servi à souhait. Une célérité
admirable ! Et cet autre , de si mauvaise humeur, votre compétiteur
et le mien, qui donne son suffrage à ce magnifique éloge de mou
administration. Savez- vous que je me flatte maintenant d'obtenir le
reste , et vous allez, j'espère, y travailler.— Je vois avec joie le
1 bien que vous dites de Dolabella, et surtout l'affection qu'il
vous inspire. Car je comprends dans quel sens vous me dites que la
prudence de ma Tullie saura le modérer. Ah! si vous pouviez voir ce
que je viens d'écrire à Appius d'après vos propres lettres! Que
voulez-vous? Telle est la vie. Fasse le ciel que ce qui est fait
soit bien fait! J'espère n'avoir qu'à me louer de mon gendre ; et
vos bons soins y feront beaucoup. — La république m'inquiète; mes
vœux sont pour Curion :j'en fais aussi pour que César soit honnête
homme. Je donnerais ma vie pour Pompée : mais la république avant
tout. De votre côté, je ne vois pas que vous vous tourmentiez
grandement pour elle. Il y a deux hommes en vous, le citoyen et
l'ami - En quittant la province, je laisse le questeur Célius à ma
place. C'est un enfant, direz- vous. Oui, mais il est questeur et de
première noblesse. J'ai suivi l'exemple général. Pais il n'y avait
en rang personne au-dessus de lui. Pomptinius était parti te» puis
longtemps. Je n'ai pu décider mon frère. Et si je lui eusse laissé
le pouvoir, mes ennemis n'auraient pas manqué de di re que, mon
année finie, je ne quitte pas tout à fait la province, comme le veut
l'ordre du sénat, puisque j'y laisse un autre moi-même. Peut-être
allégueraient-ils encore la volonté du sénat de ne donner de
gouvernement qu'à ceux qui n'en ont point encore obtenu. Or mon
frère a commandé trois ans en Asie : quoi qu'il en soit, me voilà
tranquille. Laissant mon frère derrière moi, j'aurais eu mille
sujets de crainte. Après tout, j'ai moins suivi mon sentiment que
l'exemple donné par deux hauts personnages, qui jamais n'ont manqué
de combler de leurs faveurs les Cassius et les Antoine. Célius est
de noble famille. J'ai moins voulu le gagner qu'éviter d'en faire un
ennemi. Il me faut votre approbation, car il n'y a pas à y revenir.
— Et Ocella? à peine m'en avez-vous écrit deux mots ; votre journal
n'en dit pas davantage. Vos actes ont un tel retentissement que le
nom de Matrinius est prononcé par delà le Taurus. Si les vents
étésiens ne m'arrêtent, j'espère vous revoir bientôt.
279.— A
MARCELLUS, CONSUL. Cilicie, août.
F. XV, 11. Je sais ce que vous
avez fait en mon honneur; je sais que, consul aujourd'hui, vous vous
êtes montré pour moi ce que vous fûtes toujours, vous, vos parents,
toute votre famille. Là-dessus les faits parlent assez d'eux-mêmes,
et les lettres que l'on m'écrit n'en tarissent pas. A mon tour, il
n'est rien, je vous assure, que je ne fisse pour vous avec
empressement et avec joie. Il n'est pas indifférent de regarder à
qui l'on est obligé. Or à qui 271
puis-je me sentir plus heureux de l'être qu'à vous dont les goûts
sont les miens, et qui m'enchaînez déjà par vos propres bienfaits et
ceux de votre père? Je dirai plus, (et c'est à mes yeux notre lien
le plus indissoluble), à vous que j'ai vu et vois encore gouverner
une patrie si chère de façon à créer dans tous les cœurs honnêtes
une dette immense de gratitude, et à m'engager personnellement, je
ne crains pas de le dire, moi seul autant que tous. Puisse le succès
être celui que vous méritez et que j'espère ! — Moi, si les vents
étésiens, qui me soufflent en face, ne contrarient point mon voyage,
je dois vous revoir au premier jour.
280. A APPIUS
PULCHER. Sida, août.
F. III, 12. Les félicitations
d'abord ; c'est l'ordre. Plus tard, je parlerai de moi. Je vous
félicite, et bien vivement, du résultat de votre procès de brigue.
Je ne parle pas de votre absolution dont personne n'a douté un
instant. Mais plus vous êtes bon citoyen, homme illustre, ami
fidèle, plus votre vertu, vos talents, ont d'éclat et de lustre, et
plus il faut admirer que l'envie n'ait glissé dans les secrets de
l'urne aucun bulletin contre vous. Voilà qui n'est certes ni de
notre temps, ni des hommes, ni des mœurs d'aujourd'hui. Jamais je ne
fus plus étonné.— Pour parler de moi, mettez-vous un instant à ma
place, et figurez-vous que vous êtes Cicéron. S'il vous est facile
alors de trouver des paroles, allez, et soyez sans pitié pour mon
embarras. Puisse-t-il se réaliser l'aimable vœu que votre amitié
exprime ! Puissions-nous, moi et ma Tullie, nous bien trouver de ce
que les miens ont fait a mon insu ! Et puisse la coïncidence n'avoir
rien que d'heureux ! Je le souhaite et je l'espère ; mais à cet
égard, je compte moins sur les circonstances que sur votre raison et
sur votre bonté. Me voilà enragé dans des réflexions dont je ne sais
plus comment sortir. Je ne puis rien dire de fâcheux d'un événement
dont vous voulez bien tirer l'augure le plus heureux. Cependant il
me reste encore un scrupule: je crains que vous n'ayez pas bien
compris que tout s'est fait par des intermédiaires; et qu'attendu
mon éloignement, ceux-ci a\aient reçu de moi pouvoir d'agir, sans
m'en référer, d'après ce qu'ils jugeraient convenable. Ici on peut
m'objecter, mais, vous présent, qu'eussiez-vous dit? Oui, quant au
fait. Quant à l'époque, je n'eusse agi qu'avec votre aveu et par vos
conseils. Vous le voyez; depuis une heure je sue sang et eau pour
défendre les points défendables de la cause, sans vous donner sujet
d'irritation. De grâce, venez à mon aide. Jamais plaidoirie ne me
coûta davantage. Écoutez cependant ce que j'ai a vous dire. J'ai
rempli jusqu'à présent à votre égard les devoirs d'une amitié
attentive; et l'on pouvait, je crois, défier mon zèle d'aller plus
loin ; cependant, à la nouvelle de cette alliance, je sentis le
besoin, non pas de faire pour vous davantage, mais de donner à ce
que je fais plus d'éclat, plus de publicité— J'étais en route (mon
année de gouvernement venant d'expirer), et je débarquais à Sida,
vers les noues d'août; Servilius était avec moi, quand je reçus de
ma famille la lettre qui me donnait avis de tout. Je dis aussitôt à
Servilius, qui paraissait assez ému, que mes obligations envers vous
venaient de grandir. Que vous dirai-je? Mon affection ne
272 s'est pas accrue sans
doute, mais je tiendrai bien plus a vous en fournir les preuves.
Déjà j'étais excité par le souvenir môme de nos différends, ù ne pas
souffrir que de ma part la réconciliation parût suspecte. Eh bien !
cette alliance est pour moi un avertissement nouveau, et je ne
permettrai à personne de croire que mes sentiments en aient reçu la
moindre altération.
281. — A
ATTICUS. Sida, août.
A. VI, 6. Tandis que je me
constitue ici le fauteur d'Appius en toute chose, ne voilà-t-il pas
que son accusateur devient mon gendre? Grand bien vous fasse,
dites-vous. Soit : et vous le désirez , j'en suis sûr. Quant a moi,
je ne pensais à rien moins, vous pouvez m'en croire. Tib. Néron
m'avait même fait des ouvertures, et j'avais en son nom fait porter
parole à ma femme par des gens de confiance. A leur arrivée, à Rome,
les fiançailles étaient déjà faites. Après tout, je crois que ce
parti vaut mieux. Ces dames paraissent enchantées des assiduités du
jeune homme et de ta grâce de ses manières. N'allez pas trop
l'éplucher. Ah ! vous faites distribuer du blé au peuple, à Athènes?
Votre conscience est-elle bien en repos là-dessus? Au surplus, il
n'y a rien de contraire à ce que je dis dans ma République. Ici ce
n'est pas faire largesse à des concitoyens, mais bien à des
étrangers. Vous voulez donc que je m'occupe de ce portique de
l'Académie, quoique Appius ne songe plus à celui d'Eleusis. Vous
devez être bien chagrin au sujet d'Hortensius. Pour moi, j'en suis
malade. J'avais décidé de me rapprocher tout à fait de lui. — J'ai
laissé la province à Célius. C'est un enfant, me direz-vous; vous
pourriez ajouter, un fat sans cervelle, esclave de ses caprices.
D'accord, mais je n'avais pas à choisir. Vos lettres à ce sujet sont
d'une indécision qui m'a mis au supplice. Cette indécision , je le
voyais bien, venait des mêmes causes que la mienne. Donner ma
confiance à un étourdi ! Mais à mon frère? ce n'était pas faisable;
or il n'y avait que lui que je pusse préférer à un questeur, et à un
questeur noble surtout. Tant que les Parthes ont menacé, j'étais
décidé ou à laisser mon frère, ou moi-même à rester d'urgence, en
dépit du sénatus-consulte. Mais par un bonheur inouï, les Parthes
ont fait retraite. Adieu l'incertitude. J'entendais déjà les propos
: « Ah ! il laisse le commandement à son frère! N'est-ce pas «
garder de fait la province au delà de son an« née? Que devient la
volonté du sénat de n'appeler aux gouvernements que ceux qui n'ont
pas « encore de provinces? En voilà un qui a déjà trois ans
d'exercice. » Ceci est pour le monde. Mais, entre nous, j'eusse été
dans des transes continuelles. Un accès de colère, un mot
outrageant, une boutade; que sais-je? Les hommes ne se changent pas.
Et son fils, un véritable enfant ! et si sûr de lui-même ! Quel
chagrin si.... Le père entendait l'avoir avec lui, et trouvait fort
mauvais que vous fussiez d'avis contraire. Quant à Célius, sans dire
précisément : qu'il s'arrange, toujours est-il que j'y prends bien
moins souci. Mais voyez Pompée, cette puissance si robuste et si
profondément implantée, Pompée a choisi de lui même Q. Cassius ;
César a choisi Antoine ; et j'irais , moi, faire un affront au
questeur que le sort m'a donné? créer un ennemi au successeur démon
choix? Non, j'ai fait mieux, et j'ai pour
273 moi plus d'un exemple.
C'est le parti surtout le mieux entendu à mon âge. Mais -vous,
grands dieux! quel chemin je vous ai fait faire dans son affection,
en lui lisant, comme de vous, une lettre de la main de votre
secrétaire ! Mes amis m'excitent à demander le triomphe. En effet ce
ne serait pas mal ouvrir l'ère d'une nouvelle existence. Allons, mon
cher Atticus, ayez donc l'air d'y prendre un peu d'intérêt aussi.
J'en serai moins ridicule à mes propres yeux.
282 — A APPIUS
PULCHER. août.
F. III, 13. Était-ce par
pressentiment, et pour me créer un titre à la réciprocité de vos
bons offices, que je me dévouais avec tant de zèle à vous faire
rendre les honneurs qui vous sont dus pour votre administration?
Cependant je dois à la vérité de le dire ; vous aviez moins reçu que
vous n'avez donné. De quel côté ne m'est-il pas revenu que vous
n'aviez rien laissé à faire pour personne, et par l'autorité de
votre parole, et par votre suffrage (je n'eusse pas demandé plus
d'un homme tel que vous ), que dis-je? par votre coopération
personnelle, par vos conseils, par vos démarches ; jusqu'à venir
chez moi, aller vous-même trouver mes amis? De pareils témoignages
valent plus à mes yeux que l'avantage même qu'ils m'ont procuré. Il
n'est pas rare d'obtenir, sans être vertueux, les distinctions de la
vertu. Mais ce n'est que pour la vertu qu'un homme comme vous se
passionne ainsi. Aussi, je ne me propose d'autre prix de notre
amitié que cette amitié même ; amitié qui fructifie si heureusement
quand on a les goûts que nous avons tous deux. Oui, je vous le
déclare, la conformité de nos sentiments pour la république nous a
rendus amis politiques. Mais l'amitié de tous les moments est liée
du rapport de nos esprits et de nos études. Je n'ai qu'un vœu à
adresser à la fortune : c'est qu'elle vous donne un jour pour tous
les miens les mêmes dispositions que j'ai moi-même pour les vôtres.
Si j'en crois je ne sais quelle divination qui se manifeste en moi ,
je ne dois pas en désespérer. Mais je ne puis rien vous demander à
cet égard. C'est une conquête dont j'ai seul à faire les frais.
Soyez seulement convaincu, je vous en conjure, que cette alliance
nouvelle , loin d'altérer mes sentiments pour vous, ne fait au
contraire que les accroître, chose que j'aurais crue impossible. Au
moment où je vous écris, vous êtes censeur, j'espère. J'abrège donc
ma lettre ; on ne saurait trop s'observer avec le magistrat des
mœurs.
283. - A M.
CATON. Cilicie, août.
F. XV , 6. « J'aime à être loué
par vous , mon père (dit, je crois, l'Hector de Névius) , par un
homme qu'on loue. » En effet , si les éloges ont du prix, c'est dans
la bouche de ceux qui en ont su mériter eux-mêmes. Quant à moi,
félicité par votre lettre, exalté par le témoignage public que vous
m'avez rendu , je ne vois pas ce qui me reste à désirer. Ce qui
m'enorgueillit et me charme tout ensemble , c'est de voir ici
l'amitié s'applaudir de ce qui n'est donné qu'à la stricte justice.
Rome fût-elle peuplée de Gâtons, au lieu de n'en posséder qu'un ( ce
qui est déjà un assez grand prodige), quel char de triomphe, quelle
couronne mettrais-je en comparaison avec vos éloges? A mon
sentiment, et à juger sainement des choses, rien n'est plus glorieux
pour moi que le discours que vous avez prononcé, et
274 que mes amis ont pris
soin de me transcrire. Ma dernière lettre vous expliquait les motifs
démon désir, je ne dirai point de mon ambition. Vous ne les avez pas
approuvés. Ils ont cependant un côté plausible. Il ne faut pas sans
doute montrer pour les honneurs une avidité excessive. Mais ceux que
le sénat confère de son propre mouvement, qui pourrait les
dédaigner? J'espère des services par moi rendus à la république que
cet ordre ne me jugera pas indigne d'un prix que l'usage lui-même y
a mis. Dans ce cas, je ne vous demande pas plus que votre lettre
n'exprime en termes si affectueux. Quand vous aurez voté pour le
témoignage, à votre sens, le plus honorable, réjouissez-vous avec
moi, si j'obtiens ce que j'ai préféré. Ainsi déjà vous avez agi et
voté dans la droiture de votre âme. Je le vois dans ce que vous
m'écrivez. D'ailleurs, une preuve matérielle que les supplications
n'ont pu vous déplaire, c'est que vous vous êtes associé à la
rédaction du décret. On sait que des amis seuls prennent une part
semblable aux actes de cette nature. Je compte vous voir
incessamment. Puisse la situation de la république être alors
meilleure que je n'ose l'espérer !
284 CÉLIUS A
CICÉRON. Rome, septembre.
F. VIII, 12. Il m'en coûte de
vous révéler de pareilles turpitudes. Mais il faut que je vous
signale les procédés de cet ingrat d'Appius, qui, en qualité de mon
obligé, n'a rien trouvé de mieux que de me prendre en haine. Ne
pouvant, l'avare qu'il est, se résoudre à s'acquitter envers moi, le
voilà qui me fait sourdement la guerre. Pas si sourdement toutefois
qu'on ne m'en donne avis de tous côtés, et que je n'aie bien su
m'apercevoir moi-même de ses menées. J'ai eu vent de tentatives
auprès de son collègue, de propositions faites directement à
certaines personnes , de consultations entre lui et L. Domitius,
aujourd'hui mon ennemi mortel ; le tout pour se faire un petit
mérite aux yeux de Pompée. Le prendre lui-même à partie, et le
conjurer de ne pas me faire tort, lui qui, dans mon opinion, me doit
la vie, c'est ce que je n'ai pu gagner sur moi. Qu'ai-je fait? je me
suis adressé à quelques amis, parfaitement au fait de tous les
services que je lui ai rendus. Mais j'ai cru au-dessous de moi
d'avoir même une explication avec lui ; j'ai mieux aimé contracter
une obligation avec son collègue, tout mal disposé, tout irrité
qu'il soit de mes liaisons avec vous, que de me voir face à face
avec cette figure de singe. A peine Appius en fut-il instruit qu'il
devint blanc de colère, et qu'il se mit à crier partout que je lui
cherchais querelle, afin d'avoir un prétexte de le persécuter pour
un peu d'argent qu'il me doit. Depuis lors il ne cesse de pousser
Pola Servius à se porter mon accusateur et continuellement il se
concerte avec Domitius.— Cependant ils n'avançaient guère, ne
trouvant dans nos lois rien qui pût se prêter à leurs vues, quand
tout à coup ils se sont avisés de la plus inapplicable des
dispositions. Voilà donc que le dernier jour de mes jeux du cirque,
ils ont l'effronterie de me faire appeler en justice en vertu de la
loi Scantinia. A peine Pola eut-il articulé sa plainte que j'eus
l'idée de former à l'instant même une contre-plainte contre le
censeur Appius. Jamais je ne fus mieux inspiré. Tout le peuple et
même les gens de bien d'applaudir hau-
275 tement, si bien que le
bruit a mortifié Appius plus que l'accusation elle-même. De plus je
le sommai de s'expliquer sur une chapelle secrète qu'il a dans sa
maison. — Je suis inquiet de l'esclave qui vous a porté ma lettre.
Voilà quarante jours qu'il m'a remis la vôtre et qu'on ne l'a revu.
Je ne sais que vous écrire. Vous savez que l'approche du jour fatal
fait trembler Domitius. Je vous attends avec impatience, et j'ai un
besoin extrême de vous voir. J'espère que vous prendrez part à mes
peines, moi qui suis si sensible aux vôtres, et si ardent à vous
venger.
285. — CÉLIUS
A CICÉRON. Rome, septembre.
F. VIII, 14. Eussiez-vous fait
Arsace prisonnier, pris d'assaut Séleucie, vous troqueriez toute
votre gloire contre le spectacle qu'ici l'on -vient de nous donner.
Il y avait de quoi vous guérir les yeux radicalement, je vous le
jure, de voir la figure de Domitius après le refus qu'il a essuyé.
Les comices étaient nombreux et les partis bien tranchés. Très-peu
de votes ont été donnés aux affections particulières. Aussi Domitius
m'en veut-il mortellement. Il me déteste plus qu'aucun de ses amis.
C'est que dans son opinion, on lui fait une grande injustice; et que
j'en suis la cause. Il est outré de voir comme on se réjouit de ce
qui le désole, et furieux de ce que nul n'a montré pour Antoine une
préférence plus décidée que moi. Aussi son fils Cn. Domitius
vient-il de se porter en personne accusateur du jeune Cn. Saturninus,
dont la conduite, on ne peut le nier, a été jusqu'ici assez
répréhensible. L'opinion publique est fort préoccupée de ce procès.
L'acquittement de S. Péducéus donne bon espoir.— Quant aux affaires
en général, je vous ai souvent écrit que je ne voyais pas une année
de paix assurée. Plus nous approchons de la lutte inévitable, plus
on est frappé de la grandeur du péril. Voici le terrain où vont se
heurter les deux puissants du jour. Cn Pompée est décidé à ne pas
souffrir que C. César soit consul avant d'avoir remis son armée et
ses provinces. Et César se persuade qu'il n'y a pour lui de salut
qu'en gardant son armée. Il y consent toutefois, si la condition de
quitter le commandement devient réciproque. Ainsi ces grandes
tendresses et cette alliance tant redoutée aboutiront, non pas à une
animosité occulte, mais à une guerre ouverte : pour ce qui me
touche, je ne sais guère quel parti prendre dans cette conjoncture.
Et je ne doute pas que cette perplexité ne nous soit commune. Dans
l'un des partis, j'ai des obligations de reconnaissance et des
amitiés. Dans l'autre, c'est la cause et non les hommes que je hais.
Mes principes que vous partagez sans doute sont ceux-ci : dans les
dissensions intérieures, tant que les choses se passent entre
citoyens sans armes, préférer le plus honnête parti. Mais quand la
guerre éclate et que deux camps sont en présence : se ranger autour
du plus fort ; chercher la raison où se trouve la sûreté. Or que
vois-je ici? D'un côté, Pompée avec le sénat, et la magistrature ;
de l'autre, César avec tout ce qui a quelque chose à craindre ou à
convoiter. Nulle comparaison possible, quant aux armées. Fassent les
Dieux qu'on nous laisse le temps de peser les forces respectives et
de faire notre choix I — J'allais oublier le plus important;
Savez-vous qu'Appius fait des prodiges comme censeur? qu'il est sans
pitié pour les statues, ta- 276
bleaux, les bornes des champs et les dettes. Il attribue à la
censure la vertu détersive du nitre. Il se trompe, je crois. Il veut
enlever des taches, il découvre le nu, et se laisse voir jusqu'à
l'âme. De par tous les Dieux, de par tous les hommes, allons, vite,
venez rire avec nous. Drusus informant au nom de la loi Scantinia;
Appius proscrivant et tableaux et statues, c'est à accourir de
toutes ses forces. On approuve Curion de n'avoir pas persiste-dans
son opposition aux subsides de Pompée. En résumé, voulez-vous savoir
ce que j'augure : à moins que l'un des deux ne s'en aille faire la
guerre aux Parthes, un grand conflit va éclater; et c'est la force,
c'est le fer.qui en décidera. Chacun d'eux a son parti pris, et
s'est mis en mesure. Au danger près, quel plaisir pour vous dans le
spectacle que la fortune s'apprête à vous donner!
286. A ATTICUS.
Ephèse, octobre.
A. VI, 8. J'allais vous écrire
et déjà j'avais la plume à la main, lorsque Batonius débarque,
arrive droit chez moi à Éphèse et me remet votre lettre. C'était
hier 2 des kalendes. J'apprends avec joie et votre heureuse
traversée, et l'à-propos de votre bonne rencontre avec Pilia, sans
oublier ce qu'elle vous a dit du mariage de ma Tullie. Batonius m'a
fait sur César des récits épouvantables, et il a dit pis encore à
Lepta. Tout cela sera faux, j'espère ; mais c'est à faire frémir :
que César ne veut à aucun prix remettre son armée; qu'il a pour lui
les préteurs désignés, le tribun du peuple Cassius et le consul
Lentulus ; que Pompée songe à quitter la ville. Ah ! dites-moi, ne
vous attendrissez-vous pas un peu sur cet homme qui se mettait
au-dessus de l'oncle de votre neveu? Battu ! et par qui? Je reviens
à la question? prendre le pas sur l'oncle du fils de votre sœur.' ma
s au fait, au fait. Les vents étésiens m'ont teiriblement retardé :
voilà vingt jours que ces bateaux plats de Rhodes me font perdre. Je
m'embarque à Éphèse aujourd'hui, jour des kalendes, et je donne
cette lettre à L. Torquitius qui fait voile en même temps que moi,
mais qui voguera plus vite. Avec mes navires de Rhodes et mes longs
bâtiments, il nous faut guetter les temps calmes. A cela près, nous
ferons toute diligence possible. Mille remercîments pour cette
misère de Pouzzol. Maintenant, mon cher Atticus, voyez un peu comme
le vent souffle à Rome, et s'il est moyen de songer au triomphe; mes
amis me pressent de le demander. Je ne m'en préoccuperais pas
autrement, je vous assure, si je ne voyais Bibulus y prétendre; lui
qui tant qu'il y a eu mine d'étranger en Syrie, n'a pas plus mis le
pied hors de ses murailles qu'autrefois hors de sa maison.
Maintenant il y aurait honte à se taire. Examinez la question sous
toutes ses faces, afin que nous puissions en causer à mon arrivée et
prendre un parti. Mais en voilà bien long, car j'ai hâte; le porteur
de celte lettre n'arrivera qu'en même temps que moi, ou me devancera
de bien peu. Cicéron vous fait mille compliments. Rappelez-nous tous
deux au souvenir de Pilia et de votre fille.
287. — A ATTICUS.
Athènes, 15 octobre.
A. VI, 9. Comme je débarquais au
Pirée, la veille des ides d'octobre, mon esclave Acaste me remit une
lettre de vous. J'en attendais une depuis longtemps; et, voyant
celle-ci sous le cachet, je m'étonnai d'abord de son petit volume.
Je l'ouvre, 277 ma
surprise augmente à l'aspect de cette petite écriture toute confuse,
nu lieu de votre main d'ordinaire si posée et si nette. Bref, j'y
vois que vous êtes arrivé à Rome avec la fièvre le 12 des kalendes.
Naturellement je prends l'alarme;j'appelle bien vite Acaste : cette
Indisposition n'est rien, assure-t-il ; vous lelui avez dit
vous-même, et c'est ainsi que chez vous tout le monde en parlait. Ce
qui me le confirme, c'est ce mot à la fin de votre lettre, « un
léger sentiment de fièvre ». Que vous êtes bon toutefois et que je
vous ai admiré d'écrire malgré cela de votre main ! Je ne vous en
dis pas davantage. Vous êtes prudent et sobre, et j'espère, sur la
parole d'Acaste, que vous êtes maintenant aussi bien que je le
souhaite. — J'apprends avec plaisir que vous avez reçu la lettre
dont j'avais chargé Turannius. Prenez bien garde, je vous prie, aux
manœuvres de certain drôle (Philotime) dont le nom signifie
cupidité. Assurez-moi cette petite succession de Précius, qui m'est
bien douloureuse, car j'aimais beaucoup le défunt; st peu que ce
soit, que notre homme n'y mette pas la griffe. Dites que j'ai besoin
de ces fonds pour les dépenses du triomphe, de ce triomphe qu'on ne
me verra au surplus, suivant vos conseils, ni rechercher avec
vanité, ni dédaigner avec orgueil. — Turannius, vous a assuré,
dites-vous, que j'avais laissé mon frère à la tête de la province.
Comment pouvez-vous croire que je n'aie pas compris votre réserve?
Vous ne me donniez aucun conseil ; mais si vous n'aviez eu de fortes
objections, auriez-vous hésité pour un frère que vous savez que
j'aime si tendrement? Ne pas se prononcer en pareil cas, c'est di re
non. A aucun prix, disiez-vous, ne laissez le fils avec le père ;
c'était ma pensée que vous exprimiez. Nous nous serions vus que nous
n'aurions pas été plus d'accord. Il n'y avait pas d'autre parti à
prendre, et votre persistance* ne pas vous expliquer a fait cesser
mon irrésolution. Mais je vous ai écrit là-dessus fort en détail ,
et vous devez avoir maintenant ma lettre. Je compte vous expédier
demain un exprès qui pourra bien arriver avant notre ami Sauféius :
mais, en conscience, je ne pouvais pas le laisser partir sans un mot
pour vous. Ainsi que vous me l'avez promis, parlez-moi de ma chère
Tullie, c'est-à-dire de Dolabella ; puis de la république pour
laquelle je prévois de grands orages ; puis des censeurs, et surtout
de ce qu'on fait pour les statues et les peintures. La loi est-elle
proposée? C'est aujourd'hui le jour des ides d'octobre, et pendant
que je vous écris, César fait sans doute entrer, comme vous me
l'annoncez, quatre légions dans Plaisance. Où allons-nous et
qu'allons-nous devenir? J'ai bien envie de m'enfermer dans la
citadelle d'Athènes d'où je vous écria ceci.
288. — A SA
CHÈRE TERENTIA. Athènes, 18 d'octobre.
F. XIV, 5. Si vous vous portez
bien vous et Tullie, mes amours, nous nous portons bien aussi, moi
et mon bien-aimé Cicéron. Nous sommes arrivés à Athènes la veille
des ides d'octobre, après avoir eu des vents tout à fait contraires,
et une navigation aussi lente que pénible. Acaste s'est trouvé là
juste à notre débarquement. Il avait fait fa route en 21 jours.
C'est aller rondement. Il m'a remis une lettre de vous où vous
témoignez la crainte que les précédentes ne me soient point
parvenues. Je les ai reçues toutes exactement, et j'y trouve
278 tous les détails que
je pouvais désirer. Je vous en remercie mille fois. La brièveté de
celle que m'a remise Acaste ne m'a pas surpris. Vous m'attendiez ou
plutôt vous nous attendiez, et nous ne sommes pas moins impatients
de vous revoir, bien que je n'ignore pas en quel état nous allons
trouver la république. Les lettres dont plusieurs de mes amis ont
chargé Acaste pour moi, sont toutes à la guerre. Il me sera
impossible d'imposer silence à mes sentiments, lorsque je serai à
Rome. Mais on ne peut échapper à son sort ; et c'est une raison de
plus pour moi de me hâter : je pourrai mieux sur les lieux envisager
l'ensemble de la situation. Venez au-devant de nous aussi loin que
votre santé vous le permettra ; c'est un plaisir que vous nous ferez
.— Voici ce que je vous recommande pour l'héritage do Précius,
héritage dont je suis bien éloigné de me réjouir ; car j'aimais
tendrement le défunt- Si l'adjudication se fait avant mon retour,
priez Pomponius, ou, en cas d'empêchement de sa part, priez Camille
d'y paraître pour nous. Une fois arrivé à bon port, je me charge du
reste. Si vous êtes déjà partie de Rome, ne laissez pas d'y envoyer
des instructions dans ce sens. J'espère avec l'aide des Dieux, être
en Italie vers les ides de novembre. Vous, ma chère et tant désirée
Térentia, vous ma Tullie, faites, si je vous suis cher, que je vous
retrouve en santé.
289. — A
ATTICUS. Athènes, octobre.
A. VII, 1. Je vous ai écrit par
Sauféius et je n'ai écrit qu'à vous. J'étais si pressé! mais je ne
pouvais laisser partir sans un mot de moi un nomme qui est si fort
de vos amis. D'ailleurs les philosophes vont à pas comptés, et la
lettre que voici vous parviendra, j'en suis sûr, avant celle dont il
est porteur. Si vous avez reçu l'autre, vous savez déjà que je suis
arrivé la veille des ides d'octobre à Athènes ; qu'au moment de mon
débarquement Acaste m'a remis votre lettre; que j'ai été d'abord aux
champs de cette fièvre que vous aviez en arrivant à Rome ; puis, que
je me suis remis sur l'assurance d'Acaste que, Dieu merci ! vous
vous étiez senti bientôt soulagé. J'ajoutais que vos nouvelles des
légions de César m'avaient fait frémir; je vous priais de plus de
veiller à ce que l'homme dont je vous avais parlé déjà et dont le
nom signifie cupidité, ne fit tort à mes intérêts, Enfin je
rétablissais un fait dont je vous avais déjà entretenu, un fait que
Turanuius a entièrement dénaturé a Brindes, ainsi que je le vois par
la lettre que l'excellent Xénon m'a apportée de votre part; et je
vous disais que je n'avais pas laissé mon frère à la tête de ma
province, vous expliquant en peu de mots pourquoi et par quels
motifs. Voilà à peu près le contenu de ma lettre. — Maintenant je
continue : au nom de tout ce qui vous est cher, appliquez, je vous
en conjure, à un seul objet et cette tendre amitié que vous m'avez
vouée, et cette sagesse qui vous a tant de fois si bien inspiré pour
moi, et réfléchissez bien sur ma situation. Je vois fondre sur nous
la guerre civile, mais une guerre comme il n'y en eut jamais. A
moins que les Dieux qui nous ont prêté un secours si inespéré contre
les Parthes, ne jettent encore sur la république un regard de pitié.
C'est, me direz-vous, un mal qui nous est commun à tous. Aussi
n'est-ce pas là-dessus que je vous consulte. Voici le problème
particulier à résoudre. Ne savez-vous pas que j'ai donné mon
affection des deux côtés, et que c'est vous qui l'avez ainsi voulu?
Ah! que n'ai-je dans l'origine 279
entendu votre voix amie me rappeler « Qu'il n'est rien qu'il faille
aimer plus que sa patrie. » Enfin vous m'avez persuadé qu'il fallait
m'attacher , à l'un par reconnaissance , à l'autre par politique.
J'ai fait tout ce qui vous a plu ; et si bien qu'ils semblent tous
deux à la fois n'avoir pas de meilleur ami que moi. — Je me disais
en effet qu'étant lié avec Pompée je ne pouvais jamais rien faire de
nuisible à la république ; et qu'étant lié avec César , je ne
pouvais jamais me trouver en opposition avec Pompée. Leur union
était si étroite ! Les voici maintenant , vous le dites , et je ne
le vois que trop , prêts à se ruer l'un contre l'autre. Tous deux
comptent sur moi, l'un peut-être , il est vrai , moins qu'il ne veut
le faire entendre. Pour Pompée, il ne doute pas , et il a raison ,
que ses vues sur la république n'aient mon approbation tout entière.
Avec votre lettre, j'en ai reçu une de chacun d'eux, où c'est à qui
me donnera la première place dans son estime. — Que faire? je ne
vous demande pas conseil pour le cas extrême; car si on en vient aux
armes , j'aime mieux tomber avec l'un que triompher avec l'autre.
Mais je vous demande conseil sur la question qui va s'agiter à mon
arrivée; à savoir; l'exclura-t-on comme absent ou le forcera-t-on à
quitter son armée? Quand j'entendrai ; « A votre tour, Marcus
Tullius, parlez! » Que dirai-je? « que j'attends Atticus? » ... Il
n'y aura plus à tergiverser. Me prononcerai-je contre César? mais
que devient alors cette foi jurée? quand, pour ce même privilège
qu'il réclame , j'ai , moi , sur sa prière à Ravenne, été solliciter
Célius tribun du peuple. Que dis-je sur sa prière? à la prière de
Pompée lui-même, alors investi de son troisième consulat,
d'immortelle mémoire. Si je suis pour César, que va dire Pompée? Et
avec Pompée tons les Troyens et Troyennes, « Polydamas le premier va
me tomber sur les bras.» Qui? Polydamas ? Vous, tout le premier.
Vous, le prôneur en titre de mes actes et de mes œuvres. — L'année
dernière et la précédente, sous le consulat de Marccllus, lorsqu'il
s'agissait de la province de César, j'ai su par deux fois éviter
l'écueil et voilà que je m'y jette en plein. Aussi laissant aux fous
l'initiative de la parole, je crois que je ferai bien de travailler
à obtenir ce triomphe, ne fût-ce que pour avoir une raison de ne pas
être dans Rome ; mais on saura bien trouver le moyen de venir
m'arracher mon opinion. Vous allez vous moquer de moi. Que je
voudrais être reste dans ma province ! C'était l'unique parti avec
ce qui nous attendait. Triste extrémité pourtant ! Par parenthèse,
il faut que je vous dise que ce que vous vantez si fort dans vos
lettres s'est évanoui en fumée. — Que la vertu est chose peu facile,
et combien peu même il est facile d'en garder longtemps le faux air!
J'avais remis par exemple à Célius pour son année une part des
économies que j'ai faites sur les allocations de la mienne, et j'ai
reversé au trésor public le surplus qui est d'un million de
sesterces environ. Je croyais cette façon d'agir délicate et grande.
Tout mon monde n'en a pas moins crié à l'injustice : dans leur
opinion cet argent leur revenait de droit, comme si je devais être
moins ménager des deniers de la république que de ceux des habitants
de la Phrygie et de la Cilicie. J'ai laissé dire. L'honneur avant
tout. Mais j'ai cherché le plus possible à les dédommager en
témoignages, d'estime et de considération. Cette digression, comme
dit Thucydide, aura bien son utilité. —
280 Pour en revenir à ma
position, veuillez d'abord, je vous prie, trouver un biais, pour me
maintenir dans les bonnes grâces de César. Puis pensez à ce triomphe
qui, sauf empêchement de circonstances politiques, me paraît chose
faisable. J'en juge parce que m'écrivent mes amis, et par
l'événement des supplications, où le seul vote qui m'ait été
contraire, m'est plus glorieux que tous les triomphes du monde. Je
ne parle pas des deux voix qui ont appuyé ce vote; Favonius, qui est
de mes amis, et Hirrus, qui me déteste. Caton d'ailleurs a pris part
à la rédaction ; de plus il m'a expliqué les raisons de son vote,
dans la plus aimable lettre du monde. César, en me faisant son
compliment, ne s'en empare pas moins du refus de Caton ; et, sans
entrer dans aucun détail, il me dit d'un air de triomphe, que Caton
a voté contre moi. — Je reviens à Hirrus. Vous aviez commencé à me
le ramener. Achevez, je vous prie; vous avez Scrofa; vous avez
Silius. Je leur ai précédemment écrit à tous deux. J'ai écrit à
Hirrus lui-même; car il leur avait dit avec assez d'obligeance qu'il
n'avait tenu qu'à lui d'empêcher le décret, mais qu'il s'était borné
à voter comme Caton, l'un de mes meilleurs amis, qui venait de
s'expliquer sur mon compte en termes si honorables; qu'au reste,
j'avais écrit à tout le monde, lui seul excepté. En effet, il n'y a
que lui et Crassipçs qui n'aient pas eu de lettre de moi. — Voilà
pour les affaires publiques. Un mot maintenant de mes affaires
privées, je veux absolument rompre avec l'homme que vous savez.
C'est un maître fripon ; un second Lartidius : mais le passé est
sans remède. H faut en prendre son parti. — Tâchons de voir clair
sur le reste. Et d'abord, pour parler d'un sujet qui m'afflige, tout
modique que soit l'héritage de Précius, je ne veux point qu'il
vienne faire là d'amalgame à su façon avec mes autres affaires dont
il est encore chargé. J'ai écrit à Térentia, je lui ai écrit à
lui-même que tout ce que je pourrais réaliser en ce moment devait
vous être remis pour les dépenses du triomphe qu'on me fait espérer.
Le prétexte est plausible. D'ailleurs qu'il le prenne comme il le
voudra. Encore un embarras que je vous donne, encore une chance à
courir. Vous m'y avez paru disposé dans certaine lettre d'Épire ou
d'Athènes. De mon côté je vous prêterai bonne assistance.
290. — ClCERON,
SON FII.S, SON FRÈRE ET SON NEVEU, A TIRON. 3 novembre.
F. XVI. 1. Je croyais pouvoir
supporter facilement votre absence : décidément, je ne saurais m'y
faire; et, malgré ce grand intérêt des honneurs qui m'appelle à
Rome, je me reproche comme un tort de vous avoir quitté. Cependant
vous aviez tant de répugnance à vous embarquer avant le retour de
vos forces, que j'ai dû me rendre, et que je vous approuve encore,
pour peu que vous persistiez. Mais si depuis que vous avez cessé la
diète, vous vous croyez en état de partir, vous en êtes le maître.
Je vous envoie Marion qui vous accompagnera ou qui reviendra
immédiatement, si vous devez encore retarder. — Persuadez-vous bien
que, votre santé le permettant, je tiens sur toute chose à vous
avoir près de moi; mais que s'il faut pour votre rétablissement
quelque séjour à Patras, je ne souhaite rien tant que votre santé.
En vous embarquant sur-le-champ, vous me re-
281 trouveriez à Leucade.
Si vous aimez mieux attendre que vous soyez plus fort, ne manquez
pas de choisir pour votre retour, bonne compagnie, beau temps et
vaisseau commode. La seule chose que j'exige de votre amitié, mon
cher Tiron, c'est de ne pas vous laisser influencer par Marion et
par ma lettre. Faites ce qu'exigé votre santé, c'est le plus sûr
moyen de me satisfaire. —Avec votre esprit, vous allez me comprendre
à merveille. Je vous aime pour vous et pour moi. L'un de ces
sentiments dit, revenez bien portant ; l'autre , revenez bien vite ;
mais le premier a le dessus. Commencez donc par vous bien porter. De
vos services sans nombre ce sera le plus précieux.
291. — A SON
CHER TIRON. Athènes, 5 novembre.
F. XVI, 2. Vous écrire ce qui
se passe en moi, c'est ce que je ne puis ni ne veux faire. Je vous
dis seulement : venez vite et bien portant. C'est tout ce que je
puis désirer pour votre satisfaction comme pour la mienne.
Aujourd'hui troisième jour de notre séparation, j'arrive à Alysia,
cent vingt stades en deçà de Leucade, où je compte voir arriver vous
en personne ou Marion avec «ne lettre de vous. Soignez-vous autant
que vous m'aimez, ou autant que vous savez que je vous aime.
292. ClCÉRON,
SON FILS, SON FRÈRE ET SON NEVEU, A LEUR CHER TlRON. Alysia, 3
novembre.
F. XVI, 3. Quintus n'étant pas
arrivé, je me suis arrêté un jour à Alysia, d'où je vous ai déjà
écrit : c'était le jour des nones de novembre. Comme je compte
partir d'ici avant le lever du soleil, je puis dater ma lettre du s
des ides. Si vous avez quelque amitié pour nous tous, mon cher Tiron,
pour moi surtout votre maître, de grâce, rétablissez-vous. — Je
serai dans une grande anxiété jusqu'à ce que je vous voie arriver
vous d'abord, puis, si ce n'est pas vous, Marion et une lettre. Nous
souhaitons tous ardemment, et moi le premier, de vous voir, mon cher
Tiron, mais de vous voir bien portant. Ainsi ne précipitez rien.
Quand vous serez rétabli, nous aurons bien le temps de nous voir
tous les jours. Je puis me passer de vos services. Je veux que vous
vous portiez bien, pour vous d'abord, ensuite pour moi. Adieu.
293. ClCÉRON ,
SON FILS SON FRÈRE ET SON NEVEU, A Tiron. Leucade, 7 novembre.
F. XVI, 4. La lecture de votre
lettre m'a fait éprouver des sensations bien diverses. La première
page m'a tout bouleversé ; la seconde m'a un peu remis. Je vois à
présent que vous ne vous mettrez en route par mer ni par terre,
avant d'être tout à fait rétabli. J e vous verrai toujours assez
tôt, si je vous revois bien portant. Vous m'écrivez que votre
médecin a votre confiance, et l'on en dit du bien. Cependant je
n'approuve pas en tout son régime. Le bouillon ne va pas à un
estomac malade. Je ne laisse pas de lui écrire avec tout plein
d'égards, ainsi qu'à Lyson. — J'écris aussi une longue lettre à
Curius, homme charmant, plein d'obligeance, d'une bonté infinie. Je
l'engage notamment à vous prendre chez lui, si bon vous semble. A
vrai dire, je crains que Lyson ne soit un peu négligent; d'abord
parce que tous les Grecs le sont; puis parce qu'il ne répond pas à
282 mes lettres. Mais
vous m'en faites l'éloge ; c'est à vous de décider ce qui convient
le mieux. La seule chose que j'exige de vous, mon cher Tiron, c'est
de ne pas regarder à la dépense pour votre santé. J'ai mandé à
Curius de vous donner tout ce que vous demanderiez. Mon avis est
qu'il faut aussi faire un présent au médecin, pour stimuler son
zèle. — Vous m'avez rendu d'innombrables services dans mon
intérieur, au forum, à la ville, dans ma province, pour mes affaires
particulières, pour les affaires publiques, pour mes études, pour ma
correspondance. Eh bien ! revenez-moi aussi vaillant que je
l'espère, et je vous en saurai plus de gré que de tout ce que vous
avez fait pour moi. Je crois qu'une fois rétabli vous ne sauriez
mieux faire que de partir avec mon questeur Mescinius. C'est un
assez aimable homme, et il m'a paru vous aimer beaucoup; mais
consultez bien votre force, mon cher Tiron, avant de songer à vous
mettre en mer. Ne précipitez rien, je vous le défends. Je n'ai qu'un
souci, votre santé. — Soyez-en persuadé, qui m'aime vous aime, et si
votre santé nous préoccupe vous et moi, le nombre est grand de ceux
qui s'y intéressent. D'ailleurs jusqu'ici vous n'avez voulu faire
trêve aucune à votre assiduité près de moi, et votre guérison en a
souffert. Rien ne vous gêne aujourd'hui, laissez tout soin de côté.
N'en ayez que de votre personne. Je jugerai de vos sentiments par
l'attention que vous mettrez à votre santé. Adieu, mon cher Tiron.
Adieu, adieu et portez-vous bien. Lepta vous envoie mille bonjours,
et tout le monde.
294. — ClCÉRON
ET SON FILS QUINTUS ET SON FILS SON FRÈRE ET SON NEVEU, A LEUR
EXCELLENT ET SI AIMABLE TlRON. Leucade, 7 novembre.
F. XVI, 5. Voyez quelle
séduction est la vôtre ; nous ne sommes restés que deux heures à
Thyréc, et voilà Xenomène, notre hôte, qui vous aime comme s'il
avait passé toute sa vie avec vous. 11 s'offre à pourvoir à tous vos
besoins, et je crois qu'il tiendra parole. Je souhaiterais, pour peu
que vous vous sentiez mieux, qu'il vous fit transporter à Leucade,
pour y achever votre rétablissement. Prenez là-dessus l'avis de
Curius, l'avis de Lyson, l'avis du médecin. J'ai eu un moment l'idée
de vous renvoyer Marion. Vous me l'eussiez renvoyé dès qu'il y
aurait eu un peu de mieux; mais j'ai réfléchi que Marion ne pourrait
me rapporter qu'une lettre et que j'en veuxquise suivent de près.
Vous pouvez, et vous n'y manquerez pas, si vous m'aimez, vous pouvez
envoyer chaque jour Acaste sur le port. Il trouvera une foule de
gens à qui on peut en toute sûreté remettre des lettres, et qui se
feront un plaisir de me les apporter. De mon côté, je ne laisserai
pas échapper une seule occasion pour Fatras. Je ne compte absolument
que sur les soin s de Curius. C'est le meilleur homme du moude et
celui qui m'aime le plus. Abandonnez-vous à lui sans réserve. J'aime
bien mieux vous avoir bien portant un peu plus tard, que languissant
tout de suite. Ne vous occupez que d'une chose ; de votre santé. Je
saurai pourvoir au reste. Adieu, mille fois adieu. Au moment de
quitter Leucade, le 7 des ides de novembre.
295 —
CicÉron Et Son Fils, QUintus Et Son Fils, A Tiron. Aclium, 7
novembre.
F. XVI, 6. Cette lettre est la
troisième d'aujourd'hui, non que j'aie rien de nouveau à vous dire,
ce n'est que pour tenir mon engagement, et profiter d'une occasion
qui se présente. Toujours même recommandation. Donnez-moi par les
soins 283 que vous
prenez de vous, la mesure de votre attachement pour moi. J'exige
encore ce témoignage après tant d'autres, et nul ne m'aura plus
touché. Votre santé, d'abord : votre retour, après. Que personne ne
vienne en Italie sans lettre de vous; que personne ne parte pour
Fatras sans lettre de moi. Soignez-vous, cher Tiron, soignez-vous;
puisqu'il ne nous a pas été donné de faire le trajet ensemble, rien
désormais ne doit plus vous presser. Votre santé! votre santé! Ne
songez qu'à cela. Mille fois adieu, Le 8 desides de novembre, dans
la soirée, à Actium.
296. — A TIRON.
Corcyre, 17 novembre.
F. XVI, 7. Me voilà depuis sept
jours cloué à Corcyre. Quintus et sou fils sont à Buthrote. Je suis
dans une anxiété mortelle ; sans trop m'étonner pourtant de n'avoir
pas de vos lettres ; car je ne serais pas à Corcyre, si j'avais le
vent qui peut m'en apporter. Soignez-vous, rétablissez-vous ; et
lorsque l'occasion, la santé, la saison des mers pourront vous le
permettre, revenez à ceux qui vous aiment. Règle sans exception :
Qui m'aime vous aime. Partout on vous chérit, on vous appelle pour
la centième fois ; soignez-vous, vous qui nous êtes cher à tous.
Adieu. Le 15 des kalendes de décembre, à Corcyre.
297. - ClCÉRON
ET SON FILS A TlRON. Brindes, novembre.
F. XVI, 9. Nous vous avons
quitté, comme vous le savez, le 4 des nones de novembre, nous sommes
arrivés à Leucade le 8 des ides et le 7 à Actium, où nous avons été
forcés par le mauvais temps d'y rester jusqu'au 6. Le 5, journée
magnifique pour notre passage à Corcyre Là, le mauvais temps nous a
encore retenus jusqu'au 16 des kalendes de décembre. Le 15 des
kalendes de décembre nous avons parcouru une distance de 120 stades,
du port de Corcyre à Cassiope, où les vents nous ont encore arrêtés
jusqu'au 9 des kalendes. Beaucoup de gens se sont trop pressés de
partir, et il en est résulté quantité de naufrages. — Le même jour,
après souper, nous avons mis à la voile ; et, grâce au plus doux des
austers; grâce à un ciel constamment serein, en une nuit et un jour,
nous sommes arrivés, comme en nous jouant, à Hydrunte, en Italie. Le
lendemain, qui était le 7 des kalendes, à la quatrième heure, le
même vent nous faisait entrer à Rrindes, à l'instant même où
Térentia, qui vous aime si fort, entrait par terre dans la ville.
C'est seulement le 5 des kalendes de décembre que l'esclave de Cn.
Plaucius m'a enfin apporté votre lettre tant désirée, datée des ides
de novembre. De quel poids elle m'a soulagé! que ne m'a-t-elle ôté
toute inquiétude? cependant Asclapon, votre médecin, assure qu'au
premier jour vous serez sur pied. — Que puis-je dès lors vous dire?
De vous garder jusque-là de toute imprudence. Je connais votre
sagesse, votre esprit réfléchi, votre tendre affection pour moi.
Vous ferez tout, je le sais, pour être bien vite au milieu de nous.
Pourtant, je vous en conjure , ne précipitez rien. J'aurais bien
voulu vous voir dispensé de la symphonie de Lyson, de peur d'une
rechute à la quatrième semaine. Enfin , les égards ont prévalu sur
le soin de votre santé. Au moins ne vous y exposez plus. J'ai prié
Curius de se charger des honoraires du médecin et de vous donner
tout l'argent qu'il vous faudrait. Je ferai les fonds à son ordre.
Je vous laisse 284 un
cheval et une mule à Brindes. Il est fort à craindre que les
kalendes de janvier n'amènent a Rome de grands désordres. J'aurai
soin de ne pas trop m'avancer. — Je finis en vous demandant, en vous
conjurant de ne point vous embarquer à la légère. Les marins sont
toujours pressés de partir. Us ne voient que leurs profits. De la
prudence, mon cher Tiron, de la prudence ! Il vous reste une
traversée longue et difficile. Tâchez de partir avec Mescinius.
C'est un navigateur circonspect. Si vous ne le pouvez pas, cherchez
quelque personne considérable qui ait autorité sur l'équipage. Ce
sera me combler que d'avoir toutes ces attentions, et d'arriver sain
et sauf. Adieu, notre cher ami, adieu. J'ai écrit sur tous les
points au médecin, à Curius et à Lyson. Adieu, bonne santé.
298. — CICÉRON
A ATTICUS. Brindes, novembre.
A. VII, 2. Je suis arrivé à
Brindes le 7 des kalendes de décembre, et j'ai été cette fois aussi
heureux que vous dans ma traversée ; Si doux était le vent qui nous
venait d'Épire. Voilà un vers qui m'échappe, et que vous pouvez
citer comme vôtre à quelqu'un de nos jeunes gens. — Votre santé me
donne beaucoup de souci ; car je vois par vos lettres que vous êtes
tout à fait souffrant. Et comme je sais combien vous avez de
courage, je juge que votre mal n'est pas sans quelque gravité,
puisqu'il vous force à céder, et que vous en paraissez presque
abattu. Cependant Pamphile m'a dit que votre fièvre double quarte
était changée en quarte, et qu'elle était bien moins forte : et
Térentia qui arrivait à la porte de Brindes comme j'entrais dans le
port, et qui m'a rencontré sur la place, m'a dit qu'elle avait su à
Trébule, par L. Pontius, que tous n'aviez plus de fièvre. Si cela
est, c'est ce que je désire le plus pour vous ; et je n'espérais pas
moins de votre sagesse et de votre bon régime. — II faut maintenant
répondre à vos lettres, si nombreuses qu'elles soient ; je les ai
reçues toutes à la fois et toutes plus agréables les unes que les
autres, surtout celles qui étaient écrites de votre main. J'ai
toujours aimé l'écriture d'Alexis, parce qu'elle approche beaucoup
de la vôtre : cette fois-ci je ne l'ai plus aimée, parce qu'elle
voulait dire que vous n'alliez pas bien. A propos d'Alexis, j'ai
laissé Tiron malade à Fatras. Excellent jeune homme, comme vous
savez, et honnête ! je ne sache rien de meilleur que lui. Aussi je
sens vivement qu'il me manque, et quoiqu'il ne parût pas qu'il fût
dangereusement malade, je ne laisse pas d'en être fort inquiet.
J'espère beaucoup des soins de Curius, dont je suis informé par
Tiron et par d'autres : de mon côté, j'ai fait comprendre à Curius
combien vous souhaitiez qu'il fût de mes amis ; et en effet je suis
charmé de lui. C'est un homme qu'on aime à la première vue ; et je
lui trouve un fonds de grâce naturelle. Je vous porte son testament
cacheté du cachet de mon frère, de notre neveu, de mou fils, et de
tous ceux de ma suite; il vous a fait, en leur présence, son
héritier principal, et moi, pour un quart de son bien. Alexion m'a
traité d'une manière splendide à Actium de Corcyre. Il n'y a pas eu
moyen d'empêcher Quintus d'aller voir le Thyamis. — Je suis ravi que
vous aimiez tant votre chère fille, et que vous reconnaissiez par
vous-même que c'est la nature qui nous fait aimer nos enfants. Et
certainement, si elle n'y est pour rien, il ne peut y avoir de lien
naturel qui 285 unisse
l'homme à l'homme; et alors plus de société dans ce monde. Je trouve
encore le « petit bonheur » de Carnéade, ce vilain mot qu'il a dit
là-dessus, plus raisonnable que le sentiment de Lucius et de Patron.
Ceux-ci, rapportant tout à eux, et croyant par conséquent qu'on ne
peut rien faire pour les autres, vont jusqu'à dire qu'il faut faire
le bien, non pas parce que c'est le bien, mais parce que c'est une
manière d'éviter le mal : aussi ils ne voient pas que leur sage ne
sera qu'un homme habile, et point un honnête homme. Mais tout cela
se trouve dans ces livres, pour lesquels vous m'avez tant soutenu,
en les louant de si bon cœur. Revenons à vos lettres. — J'attendais
avec impatience celle que vous aviez donnée à Philoxène, parce que
je savais par une autre que vous me parliez dans celle-ci de
l'entretien que vous avez eu à Naples avec Pompée. Patron me l'a
enfin rendue à Blindes, et je crois qu'il l'avait rapportée de
Corcyre. Rien ne pouvait m'être plus agréable; car vous m'y parliez
des affaires publiques, de l'excellente opinion qu'a Pompée de mon
intégrité, et du bon vouloir qu'il a montré pour moi dans la
conversation que vous avez eue avec lui au sujet de mon triomphe.
Mais ce qui m'a fait le plus de plaisir, c'est que j'ai compris que
vous l'aviez visité pour sonder ses intentions à mon égard : rien,
je vous le répète, ne m'a fait plus de plaisir. Quant au triomphe,
l'envie ne m'en est guère venue que depuis cette lettre si impudente
de Ribulus qui lui a fait accorder les plus longues supplications.
Si tout ce dont il se vante était véritablement de lui, je m'en
réjouirais, et j'applaudirais le premier à ses prétentions : mais
que lui qui n'a pas mis le pied hors de son camp, tant que les
ennemis ont été en deçà de l'Euphrate, obtienne unhonneur auquel je
ne pourrai prétendre, mol dont l'armée a été un moment l'unique
espérance de la sienne, ce serait une honte pour nous, pour vous,
Atticus, aussi bien que pour moi. Je suis donc résolu à employer
tous les moyens possibles, et j'espère que je réussirai. Si vous
vous portiez bien, je ne serais déjà pas en peine d'un parti : mais
vous allez vous remettre, j'espère. Je vous suis bien obligé pour
cette petite dette de Numérius. Mandez-moi ce qu'a fait Hortensius,
et donnez-moi des nouvelles de Caton, qui m'a desservi d'une manière
bien indigne. Il a témoigné, ce que je ne lui demandais pas, de mon
intégrité, de mon équité, de ma douceur; et il m'a refusé ce que
j'attendais de lui. Aussi il faut voir comme César, dans la lettre
où il me félicite et me promet tout, sait bien se prévaloir de cette
abominable ingratitude de Caton ! Mais ce même Caton a fait accorder
vingt jours à Bibulus : passez-moi d'être rancunier ; mais c'est là
une chose que je ne puis souffrir et que je ne lui pardonnerai
jamais.— Je voudrais bien répondre à toutes vos lettres; mais à quoi
bon, si je vais vous revoir. Un mot pourtant sur Chrysippus ; pour
cet autre affranchi, je m'en suis beaucoup moins étonné : je
n'attendais rien de bon d'un vil artisan comme lui, bien que je
l'aie connu déjà pour un fort méchant homme. Mais que Chrysippus ait
quitté mon fils sans m'en rien dire, lui auquel je voulais du bien,
que j'avais même distingué, A cause d'un petit savoir tel quel.qui
m'allait en lui ! je ne vous parle point de beaucoup d'autres choses
dont on m'a averti, comme de ses rapines; c'est son évasion que je
ne lui pardonne pas, et qui me paraît un vrai tour pendable. Je suis
donc résolu à user de l'ancien procédé qu'on attribue au préteur
Drusus, à l'égard des affranchis qui
286 ne jureraient pas
d'être toujours aussi fidèles à leurs maîtres : je déclarerai que je
ne leur ai point accordé la liberté ; aussi bien personne n'était là
ayant qualité pour les affranchir. Il n'en sera néanmoins que ce que
vous voudrez ; je vous donne d'avance mon assentiment. Je ne réponds
point à votre lettre si sage et si éloquente sur les dangers de la
république : que vous dirai-je? tout s'embrouille ici, mon esprit et
mes affaires. Pourtant j'ai de quoi me rassurer, quand je songe aux
Parthes, qui ont lâché tout à coup Bibulus, au moment où il se
mourait de peur.
299. — A
ATTICUS. Trébule, 9 décembre.
A. VII, 3. J'arrivai le 8 des
ides de décembre à Herculanum, où je lus votre lettre que Philotimus
me remit. La première vue m'en a charmé; la lettre était de votre
main; enfin j'ai été enchanté du compte exact que vous m'y rendez de
tout. Pour y répondre, je vous dirai d'abord que, selon vos
principes, qui ne sont pas certes ceux de Dicéarque, j'ai vivement
désiré n'être qu'une année hors de Rome ; la chose était de votre
goût ; et elle s'est faite d'elle-même et sans mon aide. Car sachez
bien qu'on n'a pas parlé une seule fois dans le sénat de continuer
aucun gouverneur au delà du temps marqué dans le sénatus-consulte.
Ainsi, je n'aurais pas même à m'imputer la petite faute d'être
demeuré dans ma province un peu moins qu'il n'eût été peut-être
nécessaire. — Mais, comme on dit souvent bien à propos, « qui sait
si ce n'est pas mieux ainsi ? » Ici, par exemple, que les affaires
prennent la tournure d'un accommodement ou bien d'un triomphe pour
les honnêtes gens, je serais bien aise d'aider pour ma part aux deux
choses, ou au moins de n'y pas perdre : et si les gens de bien sont
vaincus, quelque part que je fusse, je le serais toujours avec eux.
Si donc je précipite ainsi mon retour, ce doit être sans repentir.
Sans cette envie du triomphe qu'on m'a donnée, et que vous approuvez
vous-même, vous auriez à peu près ce bon citoyen, dont j'ai fait le
portrait dans le sixième de mes livres : mais qu'ai-je à y revenir?
vous les avez plutôt dévorés que lus. Je ferai même ,s'il le faut,
bon marché de cet honneur, tout grand qu'il est. Car on ne peut pas
dans le même temps se remuer pour un triomphe et parler librement
sur les affaires publiques : mais n'appréhendez pas que, ce qui sera
le plus honnête, ne me soit pas le plus cher. — Quant à la pensée où
vous êtes qu'il sera plus utile et plus sûr pour moi, et aussi plus
avantageux pour la république, que je reste imperator, nous en
raisonnerons dans le tête-à-tête. La chose veut qu'on en délibère,
quoique je sois assez de votre sentiment. Vous avez raison de croire
que je suis toujours de cœur à la république ; et vous remarquez
fort bien que César a été bien peu grand avec moi, après ce que j'ai
fait pour lui, et quand on voit comme il se répand avec les autres.
Vous en avez pénétré les véritables raisons, avec lesquelles
s'accorde bien ce que vous me mandez de Fabius et de Caninius. Mais
quand même César se serait jeté tout entier audevant de moi, cette
Minerve dont vous me parlez, et que je laissai gardienne de Rome, me
ferait toujours souvenir de cette inscription où mon devoir m'est si
bien marqué, et ne me permettrait pas même de tenir le milieu, comme
ont fait Volcatius et Servius, dont vous paraissez content : elle
voudrait que j'eusse des sentiments
287 et une énergie plus
dignes de moi. Je n'hésiterais pas à me déclarer, s'il ne s'agissait
pas de quelque chose de moins que l'État ; mais aujourd'hui c'est
l'ambition de deux hommes qui met tout en feu et en péril. Car si
c'est la république qu'on songe à défendre, pourquoi ne l'a-t-on pas
défendue, quand César lui-même était consul ? Pourquoi, l'année
suivante, ne m'a-t-on pas défendu, moi dont la cause était celle de
Rome? Pourquoi a-t-on fait continuer à César son commandement, et
par de telles voies? Pourquoi s'est-on donné tant de mouvements pour
faire proposer, par les dix tribuns, le décret qui le dispensait de
venir à Rome demander le consulat? Il est devenu par là si puissant,
que tout notre espoir de résistance n'est plus que dans un seul
citoyen ; et encore celui-ci eût bien mieux fait de ne pas donner
tant de force à César, que d'essayer de lui résister, après l'avoir
fait si puissant. Cependant, puisque nous en sommes là, je ne
demanderai point, pour parler comme vous, où est le vaisseau des
Atrides ; je n'en aurai point d'autre que celui où Pompée tiendra le
gouvernail. Mais dans le sénat que répondrez-vous , quand on vous
dira : parlez, M. Tullius? Ce que je répondrai? le voici en deux
mots : Je suis de l'avis de Pompée. Je ne laisserai pas, en
particulier, de l'exhorter à la concorde ; je l'entends bien ainsi ;
sans cela, le danger est des plus grands. Vous le voyez encore mieux
que moi, vous autres qui Êtes à Rome ; mais il est clair que nous
avons affaire à l'homme le plus audacieux et le plus entreprenant;
il est clair qu'il aura pour lui tous les gens condamnés et notés
d'infamie, tous ceux qui méritent de l'être, presque toute notre
jeunesse, toute cette populace des rues misérable et factieuse, des
tribuns qui seront fort puissants, surtout si Cassius est des leurs,
enGn tous les gens perdus de dettes, qui sont en plus grand nombre
que je ne pensais. Il ne manque à ce parti qu'une bonne cause ; tout
le reste y abonde. Ainsi il n'y a rien qu'on ne doive faire plutôt
que d'en venir à la guerre; l'événement en est toujours incertain,
et combien n'est-il pas plus à redouter pour nous? Bibulus revient
de son gouvernement; il a laissé Véienton pour y commander : on dit
qu'il sera longtemps en chemin. Catou, en le favorisant, a prouvé
que, s'il est quelqu'un dont il ne soit pas jaloux, ce sont ceux que
de nouveaux honneurs ne peuvent guère mettre plus haut qu'ils ne
sont. — Je viens maintenant à mes affaires domestiques ; car je
crois avoir répondu à tout ce que vous me dites sur celles de
l'État, dans vos deux lettres écrites, l'une de votre faubourg de
Rome, et l'autre quelques jours après : passons donc à mes affaires
de famille. Un mot seulement de Célius. Bien loin qu'il me. fasse
changer de sentiment, je suis au contraire persuadé qu'il se
repentira lui-même de sa légèreté. Mais à propos de Célius,
qu'est-ce que j'apprends, qu'on lui a adjugé les maisons de Luccéius?
je suis surpris que vous no m'en ayez rien dit. Pour Plulotimus, je
suivrai votre conseil. Je ne m'attendais pas à avoir sitôt les
comptes qu'il vous a rendus; mais il y manque un article, qu'il me
fit mettre lui-même sur mon livre à Tusculum, et dont il m'a donné
un billet de sa main pendant que j'étais en Asie. Ce serait assez et
au delà de cet article, pour m'acquitter de ce qu'il prétend que je
lui dois. Dorénavant je ne me laisserai plus prendre en faute sur
mes affaires, pourvu que celles de la repu-
288 blique me le
permettent. Ce n'est pas que j'aie jamais négligé les miennes; mais
j'en ai été distrait par la multitude de mes amis. J'userai donc,
pour me remettre au net, et de vos conseils et de l'aide que vous
m'offrez; et j'espère ne point trop vous importuner de moi. — Ne
soyez pas en peine des officiers instructeurs de ma suite. Ils se
sont rangés d'eux-mêmes et par pure admiration pour mon
désintéressement. Il n'y en avait point qui m'eût plus piqué que
celui dont vous l'auriez cru le moins. J'avais été d'abord
très-content de lui, et il est bien encore le môme pourmoi; mais,
lorsque je partis, il laissa voir qu'il comptait sur quelque chose.
Ce n'est pas qu'il ait tenu à ce qu'il s'était mis en tête d'avoir;
il est bientôt revenu à ses premiers sentiments, et les marques de
distinction qu'il a reçues de moi l'ont assez touché pour qu'il en
fît plus de cas que de tout l'argent du monde. — Je vous porte le
testament de Curius : j'ai vu celui d'Hortensius. Je voudrais
maintenant savoir les intentions de sou fils, et ce qu'il pense à
mettre en vente. Je ne vois pas pourquoi Célius s'étant saisi de la
porte Flumentane, je n'en ferais pas autant de Pouzzol .— Parlons un
peu de mon « Pirœea. » Si l'écrire ainsi est une faute de grammaire
très-blâmable dans un Latin, quand tous nos auteurs écrivent «
Pirœeum, » elle est plutôt dans le mot, que dans la préposition in
que j'y ai ajoutée : car je ne l'ai mise là que parce que le Pirée
n'est pas une ville. Dionysius, que j'ai avec moi, et Nieias de Cos
ne pensent pas non plus que le Pirée soit une ville. Au surplus j'y
regarderai encore. Mais enfin toute la faute, si faute il y a, est
d'en avoir parlé comme d'un lieu et non comme d'une ville. Mes
autorités sont, je ne dis pas Cécilius, qui n'écrit pas assez bien
et qui dit : Mane ut ex portu in Piraeaeum, mais Térence, dont le
style est si pur, qu'on a attribué ses comédies à Lélius : Il dit :
Heri aliquot adolescentuli coimus in Pirœeum; et ailleurs : Mercator
hoc addebat, captam e Sunio. Si nous voulons que les dèmes soient
des villes, Sunium en fera une aussi bien que le Pirée. Mais puisque
vous êtes si bon grammairien , voici une autre question : si vous me
la pouvez résoudre, vous me tirerez d'un grand embarras . — Je
reçois de César des lettres flatteuses ; Balbus m'en écrit tout
autant de sa part. Je suis bien résolu à ne pas m'écarter d'un doigt
du chemin de l'honneur : mais vous savez si je suis encore en reste
avec César. Pensez-vous que j'aie à craindre qu'on ne me reproche ma
dette, si j'opine pour lui seulement en douceur, et si je me roidis,
qu'on ne me la réclame tout haut? que faire? Le payer? me direz-vous
: eh bien, j'emprunterai à Célius. Pensez-y pourtant, je vous prie.
Car je m'attends bien, que s'il m'arrive de parler avec fermeté dans
le sénat, votre bon ami de Tartessus viendra aussitôt me dire :
Payez donc ce que vous devez. — Qu'ai-je encore à vous mander? Ah!
voici. Ma femme, ma fille et moi, trouvons mon gendre un homme
charmant : on ne peut avoir plus d'esprit et de politesse. Cela fait
passer sur bien des choses, comme nous disons. Vous savez ce que
nous avons découvert des autres, sauf celui dont nous nous sommes
occupés tous deux. Ils pré- 289
tendent que j'aurais beaucoup gagné à les mettre dans ma famille, et
qu'ils n'ont point de dettes ; c'est que personne ne voudrait leur
prêter. Mais attendons que nous soyons ensemble : nous en avons tant
à nous dire. J'espère en M. Curius pour le rétablissement de Tiron;
j'ai écrit a Curius que vous lui en seriez très-obligé. Le 5 des
ides de décembre, à Trébule, chez Pontius. |