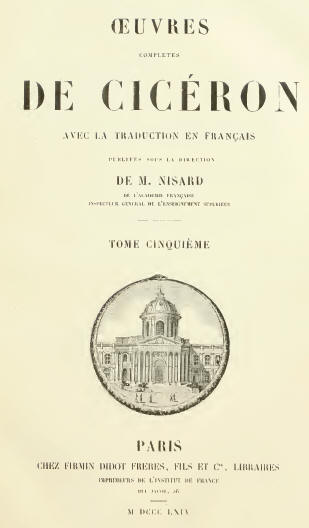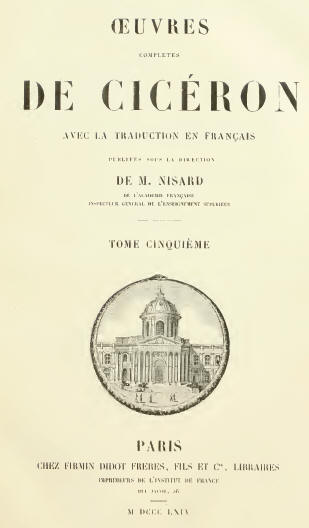|
150. — A
TREBATIUS. Rome, septembre.
F. VII, 16. Vous savez ce qu'on
dit à la fin du Chenal de Troie (Tragédie de
Livius Andronicus) : «Les voilà sages un peu tard.» Tard,
n'est pas le mot pour vous, cher petit vieillot; car tout d'abord
vous avez eu de petites boutades de dépit passablement ridicules.
Puis, vous ne vous êtes pas montré grandement curieux de voir la
Bretagne, et je ne vous en blâme pas trop. Enfin vous voilà sans
doute enfoncé dans quelque quartier d'hiver, puisque vous ne donnez
signe de vie.— « Ah ! soyons toujours sages. La sagesse est. le
meilleur bouclier. » — Si je soupais en ville, je n'aurais pas
manqué d'aller chez Cn. Octavius votre ami. Cependant , à ses
fréquentes invitations, j'ai quelquefois répondu : « Ami, quel est
ton nom?» Plaisanterie à part, sur ma parole, c'est un homme
charmant. Que ne l'a vez-vous emmené avec vous ! — Ne manquez pas de
me tenir au courant de ce que vous faites, et dites-moi si vous
revenez en Italie cet hiver. Balbus m'a encore assuré que vous
alliez devenir riche. Mais comment l'entend-il? est-ce à la romaine,
c'est-à-dire cousu d'or ; ou à la façon des stoïciens qui appellent
riche quiconque jouit du ciel et de la terre? c'est ce que la suite
m'apprendra. Les gens qui viennent d'où vous êtes, vous accusent de
fierté ; ils disent que vous ne répondez plus à personne. Et en
vérité, vous avez de quoi être content de vous-même. Chacun sait
qu'il n'y a pas dans tout Samarobrive un jurisconsulte plus habile
que vous.
151. — A P.
LENTULUS, IMPERATOR. Septembre.
F. I, 9. Votre lettre me charme
; je vois que vous rendez justice à ce que j'appellerai ma piété
pour vous. Pourrais-je me contenter de dire mon attachement, quand
je trouve le nom de piété, ce nom si respectable et si saint, trop
faible encore pour exprimer les sentiments que je vous dois? Vous me
parlez de reconnaissance; il faut une bonté comme la vôtre pour
puiser un motif de gratitude dans des témoignages dont on ne
pourrait se dispenser sans crime et sans infamie. Que n'avons-nous
été ensemble, que n'avons-nous été à Rome, au lieu d'être jetés l'un
d'un côté, l'autre de l'autre, dans tous ces temps! Vous auriez pu
encore mieux connaître et mieux juger mon cœur. — Avec les projets
que vous m'annoncez, que mieux que personne vous pouvez mener à
bien, et dont la réalisation tarde à mon impatience, quel rôle
n'eussions-nous pas joué, soit dans les délibérations du sénat, soit
dans les phases diverses des affaires? Tout a l'heure je vous dirai
quelle est ma manière de voir et comment je me trouve placé. Aucune
de vos questions ne restera sans réponse. J'aurais eu en vous le
plus dévoué et le plus sage des guides, et de votre côté, peut-être
n'auriez-vous pas trouvé en moi un conseiller trop inhabile ; vous
auriez pu compter du moins sur son dévouement et sa loyauté. Je me
réjouis pour vous, comme je le dois, du titre d'Imperator et du
succès de cette habile campagne qui vous laisse maître paisible de
la province à la tête d'une armée victorieuse. Mais certes vous
eussiez ici, vous présent, recueilli de trop justes efforts de mon
zèle et plu» de fruit et des résultats plus immédiats : je vous
aurais merveilleusement servi de second, par exemple, contre ceux
qui se sont faits vos enne- 146
mis pour avoir soutenu pour moi une lutte généreuse, et qui ne
peuvent vous pardonner l'éclat et la gloire qui en ont rejailli sur
vous. Ce n'est pas qu'il n'ait pris soin de nous venger cet homme
(C. Caton?) qu'on est sûr de trouver toujours l'ennemi de ses
propres amis, et qui, comblé de vos bienfaits, vient d'épuiser
contre vous le reste de sa vigueur expirante et de ses impuissants
efforts. Ses machinations mises à jour lui ôtent désormais toute
force morale et même toute liberté. — Vous voyez le fonds qu'il y a
à faire sur les hommes; j'aurais voulu que mes disgrâces eussent
suffi sans les vôtres à vous en convaincre, et je me réjouis du
moins, quoique dans l'amertume de mon cœur, que vous n'achetiez
point trop cher une expérience qui m'a coûté tant de souffrances.
Mais il est temps de vous expliquer toute cette affaire et de
répondre à vos questions. — On vous a appris ma réconciliation avec
César et Appius ; vous ne m'en blâmez point. Mais vous désirez
savoir par quel enchaînement de faits j'ai pu aller jusqu'à
entreprendre la défense et l'apologie de Vatinius. Pour vous mettre
plus complètement au fait, il est nécessaire de reprendre les choses
de plus haut. — J'avais cru, mon cher Lentulus, en voyant le premier
effet de vos soins, que j'étais enfin rendu à mes amis et à la
république; et ma reconnaissance vous vouait pour jamais à vous et à
la patrie, dont la sympathie avait si bien secondé vos efforts, une
affection et un dévouement éternels. Si ce dévouement et cette
affection sont le devoir de tous les citoyens, à plus forte raison
d'un homme lié à elle par le plus grand des bienfaits. Tels étaient
mes sentiments ; el pi us d'une fois, le sénat et vous, le sénat
pendant que vous étiez consul, et vous, dans les confidences de
l'intimité, vous en avez entendu l'expression. Dès lors cependant
j'avais déjà bien des raisons de prendre ombrage. Au moment où vous
parliez de ce qui restait à faire pour compléter la réparation,
j'entrevis plus d'une haine cachée, plus d'un attachement équivoque.
Lors du rétablissement de mes maisons, vous ne fûtes pas soutenu par
ceux sur qui vous deviez compter. Il en fut de même lors des
violences odieuses qui nous expulsèrent, moi et mon frère, de mes
foyers; de même encore, au sujet des indemnités allouées par le
sénat, indemnités qui, bien que fort inférieures à mes pertes, n'en
étaient pas moins une planche de salut dans le naufrage de ma
fortune. Il n'y avait pas moyen de me dissimuler ces mécomptes, mais
le chagrin que j'en ressentais était moins vif que la joie de ce
qu'on venait de faire pour mon retour. Malgré toutes les obligations
que j'ai à Pompée, obligations que vous étiez le premier à
reconnaître et à exalter, malgré mon attachement fondé à la fois sur
la reconnaissance, l'inclination et une estime qui ne s'est pas
démentie, ne pouvant m'expliquer sa pensée, je restais fidèle à mes
vieux principes en matière de gouvernement. Un jour que Pompée était
venu à Rome et au sénat pour l'affaire de P. Sextius, Vatinius, qui
était là comme témoin, se prit à dire que c'était la fortune et le
bonheur de César qui m'avaient fait son ami : je lui répliquai à
l'instant que la position de Bibulus, toute malheureuse qu'elle lui
parût, me semblait à moi préférable à tous les triomphes et à toutes
les victoires des autres. Dans une autre occasion, Vatinius étant
encore témoin, je dis 147
que c'étaient par les mêmes hommes que Bibulus avait été emprisonné
dans sa maison et moi chassé de la mienne. Mon interrogatoire ne fut
qu'une censure amère de son tribunat. J'étais animé; je passai tout
en revue, les voies de fait, l'affaire des auspices, la distribution
des royaumes. Dans cette occasion, comme dans toutes les autres, je
n'ai cessé de garder la même attitude et de renouveler mes attaques
dans le sénat. Sous le consulat de Marcellinus et de Philippe, le
jour des nones d'avril, j'obtins de l'assemblée alors nombreuse
l'ajournement de l'affaire des terres de Campanie, jusqu'aux ides de
mai. Je ne pouvais entrer plus avant dans le corps de la place,
montrer plus d'abnégation pour moi-même, et rester plus fidèle à mon
passé. L'émotion fut vive à ces paroles, qui non-seulement
arrivèrent à leur adresse, mais eurent encore une portée à laquelle
je ne songeais point. Le sénatus-consulte fut rédigé dans le sens de
mon vote. Pompée, sans laisser paraître d'ailleurs le moindre
mécontentement, partit pour la Sardaigne et l'Afrique; il passait
par Lucques, où se trouvait César. César se plaignit vivement à lui
de ma conduite. Il avait vu antérieurement Crassus à Ravenne, et
Crassus l'avait monté contre moi. Il est positif que Pompée lui-même
n'était pas content, j'en eus la certitude, entre autres par mon
frère qui le vit quelques jours après son départ de Lucques. « Ah !
vous voilà ? lui dit Pompée, je vous cherchais; c'est à merveille.
Eh bien! « si vous ne vous hâtez de faire entendre raison » à Marcus
votre frère, je vous rends responsable des promesses que vous m'avez
faites en son nom. » Que vous dirai-je de plus? Ils se
répandit en plaintes, rappela les obligations que je lui ai, ses
conventions avec mon frère au sujet des actes de César, et les
engagements à lui donnés en mon nom. Il prit mon frère à témoin que
tout ce qu'il avait fait pour moi, il l'avait fait par la volonté de
César, et finit par lui demander que j'eusse à ménager un peu plus
César, sa position , son caractère, et à m'abstenir au moins
d'hostilités, si je ne voulais pas ou ne croyais pas pouvoir le
servir. — Ces communications de mon frère coïncidaient avec un
message officiel de Vibullius ; au nom de Pompée, il me priait de ne
pas pousser l'affaire de Campanie avant son retour. Je me
recueillis, j'interrogeai la république et la suppliai de permettre
qu'après tant de peines et de travaux à son service, il me fût
loisible de remplir les devoirs de la reconnaissance, de dégager la
parole de mon frère et de faire voir à tous que le bon citoyen est
aussi un honnête homme. Notez qu'au moment où Pompée me faisait
témoigner ainsi son mécontentement de mes opinions et de mes actes,
il me revenait une foule de propos de gens que vous devinez d'ici,
qui ont toujours été et qui sont encore dans les mêmes rangs que
moi. Eh bien! ils se réjouissaient ouvertement de me savoir, à la
fois, déjà en froid avec Pompée et prêt à me brouiller avec César.
Avouez que c'était bien dur. Mais il y avait quelque chose de plus
cruel encore dans l'attitude des mêmes individus, à l'égard de mon
ennemi; que dis-jc! mon ennemi ; de l'ennemi des lois, de la
justice, de l'ordre, de la patrie et de tout ce qui est honnête;
c'était de les voir, moi présent, l'embrasser,
148 le flatter, le
cajoler, le combler de caresses ; le tout assurément sans révolter
ma sensibilité désormais émoussée. Mais l'intention y était. Dans
cette perplexité, je jetai les yeux autour de moi, et tout bien
considéré, tout calcul fait, autant que le permet la prudence
humaine, j'arrivai à une conclusion que je vais vous soumettre en
peu de mots. — Si, en premier lieu, je voyais la puissance publique
en des mains immorales et perverses, cela s'est vu au temps de mes
malheurs, et nous savons qu'il en est d'autres exemples.
Non-seulement il n'y aurait point d'avantages personnels, qui ne
sont rien à mes yeux; mais il n'y aurait sorte de périls, de ceux
mêmes où l'on a vu succomber des âmes plus fermes, qui pussent me
déterminer à faire cause commune avec les pervers , quand même
j'aurais été par eux comblé de bienfaits. Mais c'est Pompée qui est
à la tête de la république, Pompée qui n'est arrivé au comble de la
puissance et de la gloire qu'après des services éminents et des
hauts faits sans nombre; Pompée dont je suis partisan depuis
l'adolescence et que j'ai servi pendant sa préture et son consulat;
Pompée qui, comme vous, a toujours mis à mon service, sou influence
et ses votes, ses conseils et ses démarches, et qui n'avait enfin
qu'un seul ennemi dans Rome, l'ennemi de Cicéron. Je n'ai pas cru
dès lors compromettre mon caractère en me relâchant de mes opinions
sur quelques points, et en m'alliant à la politique d'un homme d'un
tel mérite, et à qui je dois tant. — Cette concession, vous le
voyez, entraînait pour moi la nécessité d'épouser aussi la cause et
les intérêts de César. J'y étais très-porté d'ailleurs par les
souvenirs de la vieille amitié que vous lui avez connue pour moi et
pour Quintus mon frère, par la noblesse et la générosité de ses
procédés dont les assurances et les preuves ne se sont pas fait
attendre. Un autre motif bien puissant pour moi, c'est qu'évidemment
toute opposition à ces grands hommes, surtout depuis les éclatants
succès de César, était antipathique au sentiment général et
unanimement repoussée. J'avais encore, pour me déterminer, des
paroles données pour moi à César par Pompée et à Pompée par mou
frère. Enfin jene pouvais oublier cette maxime si admirablement
développée dans Platon : « Les « masses sont toujours ce que sont
les chefs. " C'était ainsi, je me le rappelais, qu'au temps de mon
consulat, la première impulsion imprimée au sénat dès les kalendes
de janvier, fit que personne ne s'étonna de son attitude et de sa
résolution aux nones de novembre. C'était ainsi encore que depuis ma
rentrée dans la vie privée, jusqu'au consulat de Bibulus et de
César, la seule continuité de mon influence, quand je parlais dans
le sénat, y maintint une espèce d'unanimité parmi les gens de bien.
— Plus tard, lorsque vous allâtes commander dans l'Espagne
citérieure, et qu'au lieu de consuls, la république ne vit plus à sa
tête que des trafiquants de provinces et des ! provocateurs ou
artisans de séditions, il arriva que ma tête fut comme jetée aux
partis ainsi qu'un enjeu au milieu des luttes et des discordes
civiles. A ce moment critique, il y eut encore pour me défendre un
accord merveilleux, incroyable, du sénat, de l'Italie et de tout ce
qu'il y avait de bons citoyens. Je ne veux point rappeler le passé.
149 Que de fautes, et
que de coupables ! Je dirai en deux mots que ce ne sont pas les
soldats , mais les chefs qui m'ont manqué. Ceux qui ne me
défendirent point ne sont pas plus excusables que ceux qui
m'abandonnèrent, et si la peur fut un crime, un faux semblant de
peur fut un bien plus grand crime encore. Certes, je pris une
résolution dont il faut qu'on me loue. Je ne voulus pas que,
déshérités de leurs chefs naturels , mes concitoyens que j'avais
préservés du naufrage et qui voulaient m'en préserver à leur tour,
allassent se commettre avec des esclaves armés. J'aimai mieux qu'on
vît, par l'exemple de la force à laquelle je dus mon retour, quelle
eût été la puissance des gens de bien pour me défendre, si on
s'était décidé à combattre quand j'étais encore debout. Mieux que
personne vous avez pu en juger, vous dont le concours fut si actif,
vous qui avez tant contribué à maintenir et à fortifier ces bonnes
dispositions pour moi. Je suis loin de nier; j'aime, au contraire, à
reconnaître et je proclame avec joie, qu'à cette époque vous avez
trouvé parmi les plus nobles d'entre les Romains plus d'énergie pour
mon rappel qu'ils n'en avaient montré contre mon bannissement. Un
degré de vigueur de plus, et ils assuraient à la fois leur puissance
et ma conservation. Les gens de bien avaient pris le dessus pendant
votre consulat; votre courageuse constance, vos admirables mesures,
et surtout l'adjonction de Pompée leur avaient donné du cœur. César
lui-même fort de ses beaux succès, ainsi que des récompenses, des
honneurs et des témoignages dont il était comblé par le sénat,
venait prêter à cet ordre illustre son éclat et son influence ;
toute voie était fermée aux mauvais citoyens pour nuire à la
république. Malheureusement c'est la suite qu'il faut voir. D'abord
un furieux souille les rites féminins de sa présence; il ne respecte
pas plus la Bonne Déesse qu'il n'a respecté ses trois sœurs; et il
obtient l'impunité. Un tribun du peuple défère à la justice publique
ce séditieux ; des juges régulièrement choisis dérobent à la
république et son juste châtiment, et l'éclatant exemple qui aurait
jeté l'effroi dans l'âme des perturbateurs à venir. Plus tard, on
souffre qu'un monument, l'œuvre du sénat, car il ne venait pas de
dépouilles remportées à la guerre, le sénat en avait fait les frais
par mes mains; on souffre, dis-je, que ce monument soit souillé d'un
nom ennemi qu'on y grave avec du sang. Je suis rendu à la république
; c'est très-bien sans doute, et j'en ai le cœur plein de
reconnaissance ; mais ne devait-on pas faire un peu plus ; ne se
point contenter, comme les médecins, de m'empêcher de mourir, et me
rendre aussi force et couleur, à l'exemple de l'alipte des athlètes?
On dit qu'Apelle, après avoir employé tout ce qu'il avait de talent
à faire la figure et le sein d'une Vénus, laissa le reste en
ébauche. On a agi de même à mon égard; on n'a travaillé qu'a la
tête, sans se soucier du reste du corps, qu'on ne reconstitue pas.
Et pourtant, que j'ai bien trompé l'espérance de mes envieux et de
mes ennemis! Ils me comparaient déjà à un homme dont ils se sont
fait au surplus une bien fausse idée, à un homme de courage et de
résolution, qui n'a pas, selon moi, son égal pour ¡a grandeur d'âme
et la noble constance ; à Q. Métellus, fils de Lucius, qui fut,
disent-ils, dépourvu d'énergie et de dignité à son retour : comme si
se retirer de son plein gré, supporter gaiement l'exil, être sans
souci du retour, pouvait prouver le défaut d'énergie !
150 Comme si, au
contraire, Métellus, par cette égalité d'humeur et cette attitude,
ne s'était pas placé au-dessus de tous les autres hommes, sans en
excepter même l'homme unique, M. Scaurus! Quoi qu'il en soit, ils
pensaient de moi ou ce qu'on leur avait dit, ou ce qu'ils avaient
cru voir de Métellus ; que j'étais abattu et découragé, moi à qui la
république venait de donner plus d'élan que je n'en sentis jamais;
moi qu'elle venait de nommer le citoyen nécessaire, le seul
nécessaire! Métellus fut rappelé sur la demande unique d'un tribun
du peuple; moi, c'est que cris de la république entière, c'est le
sénat en tête, avec l'Italie pour cortège ; c'est sur la
proclamation de huit tribuns et le rapport du consul ; c'est par
l'énergique et unanime volonté des comices, des centuries, des
divers ordres et de tous les habitants; c'est enfin avec le concours
et l'adhésion de toutes les forces de l'empire que je rentrai dans
Rome. Cependant ai-je montré alors ou depuis le moindre mouvement
d'orgueil dont les plus malveillants même pussent prendre ombrage?
Je m'applique, au contraire, à aider de mes démarches, de mes
conseils, de mon temps, et mes amis, et bien des gens qui n'ont pas
ce titre. Peut-être cette conduite blesse-t-elle ceux qui ne sont
frappés que de l'éclat des surfaces , et qui ne voient pas ce qu'il
m'en coûte d'efforts et de tourments. Ils m'accusent ouvertement de
palinodie pour les éloges que je donne à César. — Ici, sans déroger
à l'ordre que je me suis tracé, il faut que je place quelques
réflexions qui naissent de ce que je viens de dire, et que je ne
puis renvoyer à la fin. Les gens de bien, mon cher Lentulus, ne sont
plus ce que vous les avez laissés. Leur bon esprit, qu'avait affermi
mon consulat, et qui depuis n'avait jamais fait défaut dans
l'occasion; ce bon esprit, qui était bien déchu quand vous devîntes
consul, consul, vous l'aviez remonté; mais aujourd'hui il n'y a plus
personne pour l'entretenir, personne de ceux-là même dont c'est le
devoir. Et cette décadence se voit non pas seulement sur les
visages, qu'il est pourtant si facile de faire mentir, mais souvent
aussi dans le langage et dans les votes, et je parle des hommes qui
étaient les plus honnêtes gens de notre temps. C'est donc une
nécessité pour les citoyens sages , au nombre desquels je me place
et yeux que l'on me compte, de changer à leur tour de marche et de
système. Platon, qui fera toujours autorité pour moi, le prescrit
positivement. « Il ne faut jamais , dit-il, élever de luttes dans
une république que quand on est sûr de l'approbation de ses
concitoyens ; la violence n'est permise ui contre un père ni contre
la patrie. » Et c'est par ce principe qu'il s'est, dit-il, abstenu
de prendre part aux affaires publiques. Le peuple athénien étant
alors comme un vieillard radoteur sur qui la raison et la contrainte
sont sans effet, Platon avait désespéré de la raison, et ne s'était
pas cru en droit d'employer la contrainte. Ma situation était
différente. Le peuple romain ne radote pas encore , et je n'ai pas
été libre de prendre ou de ne pas prendre part au gouvernement. Dans
la situation donnée, je pouvais agir d'une manière utile pour
moi-même et avantageuse aux gens de bien ; j'en ai saisi l'occasion
avec joie. Ajoutez que les procédés mémorables et vraiment divins de
César pour moi et pour mon frère, m'ont imposé le devoir de le
seconder dans tous ses projets. Avec un bonheur comme le sien, après
tant de victoires, pourrais-je, je vous
151 le demande, quand même
il ne serait pas ce qu'il est pour nous, me dispenser de lui rendre
hommage? Faites attention, je vous prie, qu'après vous, à qui je
dois mon salut, il n'est personne, je le proclame hautement, je le
proclame avec joie, à qui je me tienne plus obligé qu'à César. —
Maintenant, il va m'être plus facile de vous répondre sur ce qui
concerne Vatinius et Crassus. Je laisse de côté Appius et César, à
l'égard desquels ma conduite obtient de vous une approbation dont je
m'applaudis. Quanta Vatinius, mon rapprochement date de sa préture;
c'est Pompée quien fut l'intermédiaire. Je dois déclarer d'abord
que, dans la vive opposition que je lui fis au sénat, j'avais
beaucoup moins en vue de l'attaquer lui, personnellement, que de
défendre et de louer Caton. Mais vous ne pouvez vous imaginer
ensuite quelles furent les instances de César pour me charger de la
cause. Si vous m'interrogez sur les éloges que j'ai donnés à
Vatinius, ma réponse est qu'il ne faut jamais me faire cette
question pour aucun accusé, pas plus pour celui-là que pour tout
autre, de peur que je n'aie à vous l'adresser moi-même à votre
retour. Déjà même vous n'en êtes pas à l'abri, tout absent que vous
soyez ;car je pourrais vous demander à qui, de l'extrémité du monde,
vous envoyez de si beaux compliments; mais tranquillisez-vous, j'en
ai fait moi-même de semblables aux mêmes personnes, et ce n'est pas
fini. Un autre motif, au surplus, me poussait à défendre Vatinius,
et je l'ai dit nettement dans mon plaidoyer. Je me conduisais
d'après le conseil que le parasite donne au capitaine dans l'Eunuque
de la comédie. « Si elle prononce le nom de Phédrie, ayez aus sitôt
Pampliila à la bouche. Si elle dit : Faisons , venir Phédrie, pour
souper avec nous, dites aussitôt : Faisons venir Paraphila ; elle
nous chantera quelque chose. Si elle loue la bonne mine de Phédrie,
vantez la beauté de Pnmphila. Ayez pour chaque mot une réplique :
c'est le moyen de la piquer.- J'ai dit, dans le même sens, aux juges
: Voyez quel est pour mon ennemi le faible de nobles personnages
qui, certes, ont fait beaucoup pour moi. Voyez tantôt ces graves
entretiens à part, en ma présence et en plein sénat; tantôt ces
accolades familières et ces embrassements à cœur joie. Eh bien!
s'ils ont leur Publius, qu'ils me permettent d'avoir le mien ; s'ils
me touchent la peau, qu'à mon tour je leur effleure au moins
l'épiderme ; et ce que je dis ainsi, je le mets assez souvent en
pratique, avec l'approbation des dieux et des hommes. — Voilà pour
Vatinius. Arrivons à Crassus. J'étais fort bien avec lui. J'avais
fait à la paix publique le sacrifice de mes griefs, en les
ensevelissant dans l'oubli. Tout à coup il se charge de l'affaire de
Gabinius, qu'il poursuivait peu de jours auparavant avec une
vivacité extrême. Je n'aurais rien dit s'il n'y avait rien eu de
désobligeant pour moi dans son plaidoyer. Mais le voilà qui
m'attaque sans provocation aucune, moi qui m'étais renfermé dans les
bornes de la discussion. Alors j'éclatai; peut-être, et je le crois,
mon irritation ne vint-elle pas toute du moment; peut-être quelques
restes d'une vieille rancune, que je croyais tout à fait éteinte, et
qui fermentait encore en moi à mon insu, se réveillèrent-ils
soudain. Ce qu'il y a de sûr, c'est que certains hommes, auxquels
j'ai déjà fait allusion plusieurs fois, trouvèrent que l'explo-
152 sion leur était d'un
grand profit, et se prirent à dire que j'étais redevenu en cette
occasion ce que je fus jadis pour la république. Enfin ce démêlé
ayant eu de fort bous effets au dehors, ils m'assurèrent qu'ils
voyaient avec une grande joie ma rupture avec Crassus, et que ceux
qui tenaient pour lui ne seraient jamais mes amis. Ces injustes
discours me furent rapportés par les plus honnêtes gens. Pompée,
d'ailleurs, me pressa de me réconcilier avec Crassus, et y mit plus
d'ardeur que je ne lui en vis jamais. César aussi, dans ses lettres,
se montra vivement affecté de notre désunion. Je tins donc compte de
toutes ces circonstances, et suivis le penchant de ma nature. Le
peuple romain fut en quelque sorte témoin de notre réconciliation.
C'est presque du sein de mes dieux lares que Crassus est parti pour
sa province. Il était convenu qu'il souperait chez moi dans les
jardins de mon gendre Crassipès. Ce qu'on vous a mandé est donc tout
simple. Oui, j'ai pris sa défense dans le sénat, comme de hautes
recommandations et mes propres engagements m'en faisaient une loi. —
Vous savez maintenant comment j'ai été amené à embrasser le parti et
la cause que j'ai défendus. Voilà ma position et la part que je
prends aux affaires. La conduite que j'ai tenue, soyez-en bien
convaincu, est celle que j'adopterais encore, si tout était à
recommencer, et que ma liberté fût complète. Mes principes sont :
qu'il ne faut jamais lutter contre le plus fort ; qu'on doit se
garder de détruire, même quand on le pourrait, de grandes
existences; qu'il ne faut pas s'opiniâtrer dans une manière de voir,
quand tout change autour de soi, et quand les dispositions des gens
de bien se modifient comme le reste ; qu'en un mot il fout marcher
avec son temps. Voyez les hommes qui ont excellé dans l'art de
gouverner : les loue-t-on d'avoir éternellement suivi la même ligne?
Les navigateurs habiles cèdent quelquefois à la tempête, qui
pourtant les éloigne du port. Lorsqu'en changeant de voiles et en
déviant, on peut arriver au but de sa course, n'est-il pas absurde
de persister, en dépit de tout danger, dans la première direction
qu'on aura prise? Aussi ce que nous devons nous proposer, nous
hommes d'État qui n'aspirons, comme je l'ai dit souvent, qu'à nous
reposer un jour avec honneur, ce n'est pas l'unité de langage, mais
l'unité de but. Je vous le proteste donc encore; si j'avais liberté
entière, je ne prendrais pas dans les conjonctures actuelles une
autre attitude. Ajoutez qu'agissant en cela sous la double impulsion
du ressentiment et de la reconnaissance, j'accepte trèsvolontiers
une situation politique qui me permet de voter et de parler suivant
ce qui me paraît être à la fois dans l'intérêt de l'État et dans le
mien. Je me cache d'autant moins que Quintus, mon frère, est l'un
des lieutenants de César. Or, je ne dis pas un mot, je ne fais pas
une démarche dans l'intérêt de César, qu'aussitôt il ne témoigne
hautement y attacher un prix qui m'assure de son affection. Aussi je
dispose, comme de choses à moi, de son crédit qui est prépondérant ,
et de ses ressources qui, vous le savez, sont immenses. Il n'y avait
pour moi qu'un moyen de déjouer la scélératesse de mes ennemis ;
c'était de joindre au dévouement de mes appuis naturels la
bienveillance des hommes puissants. — Je suis
152 convaincu que vos
conseils, si je vous avais eu a Rome , auraient été tous dans le
même sens. Je connais votre caractère, votre modération, votre cœur
si plein d'affection pour moi, si éloigné de tout sentiment haineux
; votre cœur si grand, si haut placé et en même temps si droit et si
candide. J'ai vu employer contre vous les mêmes procédés dont vous
avez vu user contre moi. Les mouvements auxquels j'ai cédé, vous y
eussiez cédé de même. Mais en toute occasion où il me sera donné
d'être près de vous, vous serez mon guide et ma règle. Comme naguère
de mon salut, je m'en remets sur vous du soin de mon honneur. En
retour, je m'engage à concourir, à m'associer sans réserve à vos
actes, à vos démarches, à vos désirs. L'occupation du reste de ma
vie sera de vous rendre heureux de tout le bien que vous m'avez
fait. — Vous me demandez les ouvrages que j'ai composés depuis votre
départ : ce sont quelques discours que je donnerai à Ménocrite ; il
y en a peu, ne vous effrayez donc pas d'avance. J'ai aussi composé
(car vous saurez que je fais trêve aux travaux oratoires pour
cultiver des Muses d'un plus doux commerce et que j'aime depuis mon
enfance), j'ai, dis-je, composé, à l'imitation d'Aristote, dans mon
intention du moins, trois livres de dissertation ou dialogues sur
l'orateur qui pourront n'être pas inutiles à voire Lentulus. Rien ne
ressemble moins aux préceptes qu'on trouve partout. J'y ai renfermé
la substance de l'antiquité et ce que j'appellerai la doctrine
oratoire d'Aristote et d'Isocrate. De plus, j'ai fait un poème en
trois chants sur les événements de ma vie ; vous l'auriez déjà si
mon intention était de le publier. C'est un monument de ma
reconnaissance et de mon pieux dévouement pour vous. Mais j'ai
craint de me faire des ennemis, non pas de ceux que j'attaque, je
l'ai fait avec trop de douceur et de ménagement, mais de ceux dont
je n'ai pas cité les noms, parce que je n'en aurais pas fini s'il
avait fallu nommer tous ceux à qui j'ai des obligations. Cependant
si je trouve une occasion sûre, je vous enverrai ce poème. Soyez
encore mon juge pour cette partie de ma vie et de mes affections. Je
livre de grand cœur a votre volonté souveraine tout ce que je
pourrai tirer de mes deux vieilles amies, la littérature et l'étude,
que vous aimez vous-même autant que moi. — Quant à vos affaires
privées, dont vous m'avez écrit, et que vous me recommandez , j'en
prends tant de soin, que je souffre, à peine qu'on m'avertisse, et
c'est tout au plus si les prières qu'on me fait à cet égard ne me
causent pas un vrai chagrin. Vous n'avez pu, dites-vous, terminer
l'affaire de Quintus mon frère dans la dernière campagne. Une
maladie vous a empêché d'aller en Cilicie, mais vous vous en
occuperez maintenant sans désemparer. Sachez seulement que dans ces
domaines mon frère voit sa fortune, et qu'il la voit faite par vous.
Je vous prie de m'écrire avec un entier abandon et souvent sur tout
ce qui vous touche, sur les études et les progrès de votre enfant,
ou plutôt de notre jeune Lentulus. Croyez qu'il n'est personne au
monde qui me soit plus cher que vous et que je trouve plus de
plaisir à aimer. Que votre cœur en soit bien persuadé ! mon vœu est
que l'univers entier le sache et que
154 la mémoire en aille à
la postérité la plus reculée. — Appius a répété plusieurs fois en
conversation, et adit ensuite en plein sénat, que s'il pouvait faire
passer sa loi dans les curies, il tirerait sa province au sort avec
son collègue ; mais que, si la loi ne passait pas, il se
concerterait avec son collègue pour devenir votre successeur; qu'une
loi curiale était une affaire de convenance, non de nécessité ; et
qu'ayant obtenu sa province par un décret du sénat, il en
retiendrait le commandement en vertu de la loi Cornelia jusqu'à son
entrée dans Rome. J'ignore ce que vos amis ont pu vous écrire à ce
sujet. Les opinions sont très-partagées. Les uns pensent que vous
pouvez ne pas vous démettre, parce qu'on ne peut pas venir prendre
votre place sans une loi curiale ; les autres, que si vous vous
démettez, vous pouvez déléguer vos pouvoirs avant de partir. Pour
moi, je suis moins certain du droit, qui au fond cependant ne me
paraît pas douteux, que de ce qu'exigent votre rang, votre honneur,
et cette indépendance dont je vous sais si jaloux. Ce qu'il vous
importe, c'est de ne pas retarder d'un moment la remise de la
province à votre successeur, surtout quand vous ne pouvez l'accuser
d'avidité sans vous en faire soupçonner vous-même. Je me crois
obligé, vous le voyez, de vous dire ma pensée sans détour ; mon
devoir sera ensuite de vous défendre, quel que soit le parti que
vous preniez. — Ma lettre était finie, lorsque j'ai reçu la vôtre au
sujet des publicains. Je ne saurais disconvenir que la justice ne
soit de votre côté. Seulement, pourquoi faut-il que votre bonheur ne
vous ait pas fait trouver un moyen de ne point heurter dans ses
intérêts ou ses sentiments un ordre à la splendeur duquel vous avez
toujours concouru 7 Je ne cesserai pas de défendre vos décrets, mais
vous connaissez les hommes. Vous savez quels ennemis terribles
Quintus Scévola trouva parmi les chevaliers. Tâchez donc, s'il vous
est possible, de les ramener de façon ou d'autre, ou du moins
d'adoucir leur mécontentement. Ce n'est pas chose facile, mais la
prudence l'exige.
152. — A
QUINTUS. Rome, octobre.
Q. III, 3. Voyez combien je
suis occupé : j'emploie la main d'un secrétaire. Je ne passe pas un
jour sans défendre un accusé. Aussi ne me reste-t-il pour composer
ou méditer que le temps de la promenade. Voilà pour le dehors. Au
dedans, tout marche à mon gré. Nos enfants se portent bien, sont
appliqués à l'étude, ont de bons maîtree ; ils nous aiment et
s'aiment entre eux. Nos maisons s'achèvent. On en est aux décors.
Vos campagnes d'Arcanum et de Latérium sont entièrement finies. Je
vous ai parlé dans une lettre précédente des eaux et des chemins.
Vous êtes instruit maintenant sur faits et articles. Mais une chose
m'inquiète et me tourmente on ne peut plus. Voilà cinquante jours
passés sans que ni de vous, ni de César, ni même de vos parages, il
soit venu lettre ou signe de vie. J'ai peur de la terre, j'ai peur
de la mer ; et ma tendresse alarmée ne manque pas, comme c'est
l'ordinaire, de supposer ce qu'elle craint le plus. Je vous conjure
de me donner de vos nouvelles. Je sais bien qu'il n'y a pas de votre
faute, mais vous saurez que je n'ai jamais si impatiemment attendu
vos lettres qu'en ce moment. — Parlons maintenant des af-
155 faires publiques.
Chaque jour nouvelles oppositions des augures, et chaque jour
ajournement des comices. Les honnêtes gens ne demandent pas mieux,
tant les consuls sont soupçonnés de s'être laissé corrompre par les
candidats ! Quatre candidats consulaires, autant d'accusés. Ce sont
des causes bien délicates. Je ferai de mon mieux pour que notre
Messalla s'en tire. Ce sera pour les autres un bon précédent.
Gabinius est accusé de brigue par P. Sylla, assisté de son beau-fils
Memmius et de son frère Cécilius, fîls de Sylla. On a vu avec
plaisir échouer L. Torquatus qui leur disputait l'accusation. — Mais
que devient Gabinius? me direz-vous; dans trois jours on saura à
quoi s'en tenir sur le chef de lèse-majesté. Il a contre lui dans
cette affaire la haine de tous les ordres. Les témoins sont
accablants, mais les accusateurs sont d'une mollesse déplorable. Le
conseil est partagé. Aldus, chargé de l'instruction, est un homme
grave et ferme. Pompée s'évertue en sollicitations près des juges.
Je ne sais ce qui arrivera; mais je crois que Gabinius ne pourra
guère se montrer à Rome. Je serai modéré s'il succombe ; calme dans
tous les cas. —Voilà à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Je
n'ajoute qu'un mot sur votre Cicéron, qui ne m'est pas moins cher
qu'à vous-même. Il est tout ardeur aux leçons de Péonius, son maître
de rhétorique, à qui je reconnais i lu talent et beaucoup
d'habitude. Ma méthode, vous le savez, a quelque chose de plus
profond et de plus philosophique. Mais je ne veux pas lui faire
changer de voie ni de maître, d'autant qu'il est bien conduit, et
qu'il parait prendre singulièrement goût à ce genre déclamatoire.
Moi-même j'ai commencé par suivre cette route, et je le laisse
volontiers y marcher sur mes pas. J'espère qu'elle l'amènera où je
suis arrivé ; cependant la première fois queje le conduirai à la
campagne, je tâcherai de le convertir à mon système. Votre affection
m'a promis une si douce récompense qu'il ne tiendra pas à moi de
l'obtenir. Où comptez-vous hiverner? Aurez-vous bonne chance? Des
détails, je vous prie, des détails.
153. — A
TRÉBATIUS. Rome, octobre.
F. VII, 17. D'après votre
dernière lettre, j'adresse des remercîments à mon frère Quintus et
je vous félicite vous-même de ce que vous paraissez avoir enfin un
parti arrêté. Je ne vous cache point que, dans les premiers mois,
vos lettres me désespéraient. Je voyais, soit dit sans vous fâcher,
bien de la légèreté dans vos regrets de Borne et des choses de Rome;
puis vous montriez peu de vigueur et de goût pour le service
militaire; souvent même enfin vous preniez des airs de fatuité qui
vont mal à votre caractère. Vous me faisiez l'effet d'un homme
chargé d'une traite à recevoir et non d'une lettre pour un général,
et qui, l'argent en poche, n'a de cesse qu'il ne soit de retour.
Pensez donc que ceux qui vont à Alexandrie avec de bons billets au
porteur, en sont encore à attendre aujourd'hui le premier écu. —
Certes, à ne voir que mon intérêt, je ne souhaiterais rien tant que
de vous avoir près de mol. J'étais heureux de nos rapports, de vos
conseils, de vos bons offices; mais, depuis votre début dans la
carrière, vous avez mis votre affection et votre confiance en
156 moi, et je considère
comme un devoir de ne me préoccuper que de votre avancement et de
votre fortune. Ainsi, lorsque je songeais à partir pour la province,
vous savez quelles offres je m'empressai de vous faire; plus tard,
je changeai d'avis. César me traitait avec honneur, avec affection.
Je connaissais la merveilleuse générosité de son âme et la sûreté de
ses sentiments. Je voulus vous donner à lui et je vous recommandais
dans les termes les plus vffs et les plus significatifs. L'accueil
qu'il fit à mon vœu, les lettres qu'il m'adressa, le langage qu'il
vous tint, ses procédés pour vous, tout a prouvé le prix qu'il
attachait à ma recommandation. Puisque vous êtes en de telles mains,
ayez foi en mou expérience et en mon amitié, et gardez-vous de
quitter la partie. Et si votre susceptibilité s'alarmait de quelque
froideur apparente, effet de la préoccupation ou d'une autre cause,
armez-vous de patience et attendez la fin ; elle sera bonne et
profitable, je m'en porte garant. — Il est inutile d'insister. Une
fois l'occasion perdue, vous ne vous retrouverez plus ni avec un
protecteur aussi généreux et aussi illustre, ni dans une aussi belle
province, ni dans un âge aussi favorable pour profiter de tous ces
avantages. Ainsi le pensait, c'est la formule de vos livres de
droit, ainsi le pensait Q. Cornelius. Vous avez bien fait de ne pas
aller en Bretagne. C'est beaucoup de fatigue de moins, et puis il
n'y a pas de merveilles à en raconter. Où comptez-vous passer
l'hiver? qu'espérez-vous? comment vous trouvez-vous?
154. — A QUINTUS.
Rome, octobre.
Q. III, 2. Le 6 des kalendes
d'octobre, Salvius s'est embarqué pour Ostie vers le soir, avec tout
ce que vous avez demandé. Le même jour au forum , Gabinius a été
chauffé de si près par Memmius que Calidius ne put trouver un mot
pour le défendre. Aujourd'hui (qui est encore à venir, car je vous
écris avant le jour), doit se faire par-devant Caton le choix de
l'accusateur. Le débat est entre Memmius, T. Néron et L. et G.
Antonius, fils de Marcus. Je pense que Memmius l'emportera, malgré
tous les efforts de Néron. Que vous dirai-je? Il faut que Gabinius
succombe, à moins que l'ami Pompée, en dépit des hommes et des
dieux, ne vienne faire tourner la chance. — Mais voyez quel front,
et tâchez de rirex un peu dans des circonstances si tristes.
Gabinius qui, partout où il va, dit qu'il sollicite le triomphe, que
son entrée nocturne est d'une tactique habile, qu'il a surpris
l'ennemi, n'ose avec tout cela se présenter au sénat. Cependant le
dixième jour, lorsqu'il fallait déclarer le nombre des ennemis et
des soldats, il se glissa dans l'assemblée. Les rangs n'avaient
jamais été moins garnis. Il voulait sortir. Les consuls le
retinrent, et les fermiers publics furent introduits. Pressé de tous
côtés, par moi surtout qui lui portais de rudes coups, il perdit la
tête et me lança d'une voix tremblante le nom de banni. A l'instant
(il n'y eut jamais pour moi de plus beau moment) le sénat jette un
cri d'indignation et se lève comme pour se précipiter sur lui. Même
cri, même élan de la part des publicains. Que vous dire? Tout le
monde se montra tel que vous auriez été vous-même. Au dehors,
manifestation non moins éclatante.
157 En vérité, je me fais
violente pour ne pas me porter accusateur. Mais je tiens bon : je ne
veux point de difficultés avec Pompée ; il s'en prépare assez au
sujet de Milon. D'ailleurs est-ce que nous avons des juges? si
j'allais échouer? Et puis la malveillance est là : que sais-je? Il
peut y avoir inconvénient à me mettre en évidence, au lieu que,
l'affaire allant sans moi, mais sans que j'y nuise, je ne désespère
pas de la voir arriver à bien. — Tous les prétendants an consulat
sont accusés de brigue, Domitius par Memmius, Memmius par Q. Curtius
jeune, homme aimable et instruit; Messalla parQ. Pompée, Scaurus par
Triarius. L'agitation des esprits est extrême, car il est visible
que c'en est fait des coupables ou des lois. On travaille à ce que
les choses n'en viennent pas au jugement. Tout tend à un interrègne.
Les consuls veulent les comices. Les accusés n'en veulent pas,
Memmius surtout, parce qu'il compte sur un voyage de César pour être
nommé consul; mais ses espérances sont bien bas. Domitius et
Messalla paraissent certains du succès. Scaurus a du dessous. Appius
prétend remplacer notre ami Lentulus sans loi curíate. Il a été
admirable (moi qui l'oubliais!) le jour de cette célèbre
manifestation contre Gabinius. Il lança contre lui l'accusation de
lèse-majesté et nomma ses témoins. L'autre resta muet. Voilà les
nouvelles publiques. Chez vous tout va bien. Les entrepreneurs font
marcher vos travaux assez rondement.
155. - A
ATTICUS. Rome, octobre.
A. IV, 16. Vous voyez combien
je suis occupé : j'emploie la main d'un secrétaire. Je ne vous
reproche point la rareté de vos lettres, je me plains de ce que la
plupart se bornent à ces mots : je suis ici, c'est moi qui vous
écris ; ou encore je me porte bien. 11 y en a deux de ce genre qui
m'ont fait cependant un très-grand plaisir ; elles venaient de
Buthrote, à peu près à la même date. J'étais inquiet de votre
traversée, et si vous avez été bref, du moins vous ne m'avez pas
fait attendre, c'est ce qui m'en plaît. J'en ai reçu d'un autre côté
une raisonnable et bien remplie, que votre hôte Paccius m'a remise :
c'est à celle-là que je vais répondre. D'abord Paccius a pu voir à
mon langage et à mes démarches le prix que j'attache à votre
recommandation. Je ne le connaissais pas, et il est aujourd'hui l'un
de mes intimes. Passons. Vous me parlez de Varran; pour peu qu'il y
ait jour, il figurera dans l'un de mes ouvrages. Mais vous
connaissez le genre de mes dialogues; par exemple , dans ceux qui
traitent de l'art oratoire et que vous vantez tant, les
interlocuteurs doivent avoir connu ou entendu les personnages dont
ils s'entretiennent. Il en est de même des dialogues sur la
république, où je mets en scène Scipion, Philus, Lélius et Manilius.
Je leur adjoins quelques-uns de leurs jeunes contemporains, Q.
Tubéron, P. Rutilius, les deux gendres de Lélius, Scévola et Fannius
; mais comme je mets toujours une préface à chaque livre, ainsi
qu'Aristote l'a fait pour ceux qu'il appelle exotériques, Varron y
trouvera tout naturellement place. Ainsi, si je ne me trompe, votre
vœu sera rempli. Puissé-je seulement m'en tirer à mon honneur!
L'entreprise , vous le savez, est importante, sérieuse, de longue
haleine surtout, et j'ai bien peu de
158 temps à moi. — Au
milieu de vos éloges vous mêler une critique. Scévola, dites-vous,
se retire trop tôt; j'ai eu mes raisons, et notre dieu Platon, a
fait de même dans sa République. Socrate vient au Pirée, chez
Céphale, riche et aimable vieillard. Durant le premier livre,
Céphale prend part au débat. Puis, après avoir discouru
très-agréablement, il allègue un devoir religieux et s'en va pour ne
plus reparaître. Platon a pensé, je suppose, que la vraisemblance
aurait souffert de l'assistance prolongée d'un homme de cet âge à
une si longue conversation; la même convenance et de plus puissants
motifs encore existaient pour Scévola. Vous vous rappelez quel âge
il avait, quelles étaient sa santé et ses hautes dignités, qui ne
lui permettaient pas de passer décemment plusieurs jours de suite à
Tusculum chez Crassus. Enfin le sujet du premier livre rentre tout à
fait dans le genre de ses études, au lieu que l'espèce de
technologie, qui fait la matière des deux autres, ne m'a pas paru
comporter la présence de ce vieillard assez enclin, comme vous le
savez, à tourner les choses en ridicule. — Je donnerai tous mes
soins à l'affaire de Pilia, puisqu'elle est si bonne, au dire
d'Aurélien. Je m'en ferai un mérite auprès de ma Tullie. Je ne me
ménage pas pour Vestorius. Je sais quel intérêt vous lui portez, et
je veux qu'il en soit convaincu. Mais, malgré nos deux bonnes
volontés réunies, il n'est pas facile de le contenter. — J'arrive à
vos questions sur Caton : il a été absous sur le fait des lois Junia
et Licinia, et il sera absous de même sur le fait de la loi Fufia,
je vous le déclare, le tout à la joie de ses accusateurs plus encore
que de ses défenseurs. Au reste, il est tout à fait revenu à moi et
à Milon. Lucretius a lancé une accusation contre Drusus. La
récusation des juges est fixée au 5 des nones de juillet. Il court
de mauvais bruits sur Procilius ; mais vous savez ce que c'est que
nos tribunaux. Hirrus est réconcilié avec Domitius. Le
sénatus-consulte que les consuls ont fait pour les gouvernements,
Quiconque A L'aveniR
.... peut plaire au sénat, mais non pas à moi qui savais d'avance
que la déclaration de Memmius déplaisait à César. Notre cher
Messalla et son compétiteur Domitius ont été fort généreux dans
leurs largesses au peuple. On leur en a su un gré infini, et leur
élection était certaine. Mais le sénat vient de décider qu'il y
aurait jugement, jugement non public, avant l'ouverture des comices,
et le sort a composé les commissions pour chaque candidat de manière
à leur donner vivement l'alarme. Quelques juges, entre autres
Opimius Antius, des tribus Véientina et Trementina , se sont pourvus
près des tribuns pour faire suspendre tout jugement jusqu'à ce que
le peuple en eût ordonné. Ainsi fut fait. Un sénatus-consulte a
prononcé l'ajournement des comices jusqu'à ce qu'il intervint une
loi pour ce jugement. Le jour pris pour la proposition de la loi,
Térentius y fait opposition. Les consuls qui ne montrent pas
beaucoup de vigueur portent l'affaire aus énat. Lamentable scène
d'Abdéritains ! si bien que je ne pus me taire. Quoi donc,
allez-vous dire, n'aviez-vous pas résolu de rester en repos?
Pardonnez-le-moi ; mais il n'y avait pas moyen ; c'était par trop
ridicule. Le sénat décide que les comices n'auront lieu qu'après que
la loi sera rendue, et qu'en cas d'opposition, on en délibérera de
nouveau. Les consuls proposent la loi par manière d'acquit.
L'opposition a lieu, ce qui ne leur déplaît guère. L'affaire revient
au sénat, et voilà qu'on décide
159 cette fois que les comices auront lieu au préalable,
l'intérêt public le voulant ainsi. — Scaurus que j'avais fait
absoudre quelques jours auparavant par une plaidoirie qui a eu assez
d'éclat, voit que, depuis la veille des kalendes d'octobre jusqu'au
moment où je vous écris, les auspices, interrogés par Scévola, font
remettre de jour en jour l'assemblée, etil en profite pour faire
distribuer des largesses au peuple dans sa maison, tribu par tribu.
Il a plus largement donné, mais en apparence, avec moins de succès
que ceux qui avaient pris les devants. Je voudrais bien voir la mine
que vous faites à ce passage; car vous n'avez aucun intérêt,n'est-cepas,àceque
tout ceci dure encore longtemps? C'est aujourd'hui que le sénat
s'assemble. Par aujourd'hui, j'entends les kalendes d'octobre. Le
jour commence seulement à paraître. Personne ne dira ce qu'il pense,
excepté Antius et Favonius. Quant à Caton, il est malade. Ne
craignez pas pour moi. Toutefois je ne réponds de rien. — Après,
direz-vous? après? ah ! les procès sans doute? Eh bien! Drusus et
Scaurus ont été acquittés. Il est vraisemblable que trois candidats
seront poursuivis; savoir : Pomitius par Memmius, Messalla par Q.
Pompéius, enfin Scaurus par Triarius ou L. César. Que dire en leur
faveur? allez-vous me demander; sur ma tête, je l'ignore. Ces trois
livres, tant loués par vous a tort et à travers, ne me fournissent
rien .... Maintenant voulez-vous savoir ce queje pense? qu'il faut
se résigner. Quelle a été mon attitude? ferme et indépendante. Mais
loi (Pompée) comment s'est-il comporté? convenablement. Il était de
mon honneur de poursuivre la satisfaction qui m'était due. C'est ce
qu'il a parfaitement compris. Comment donc Gabinius a-t-il été
absous ? Le procès n'était que fan-
159 tasmagorie pure. Ici,
des accusateurs muets ft n'y pas croire. Je parle de L. I.entulus,
fils de Lucius, contre qui on crie ft la prévarication. Là, Pompée
remuant ciel et terre, puis des juges infâmes. Pourtant il y a eu
trente-deux voix pour la condamnation et trente-huit pour
l'acquittement. D'autres accusations l'attendent. 11 n'est point
hors d'affaire. — Comment est-ce que je m'arrange de tout cela, moi
? fort bien, je vous le jure, et je m'en sais un gré infini. Il n'y
a plus, mon cher Pomponius, il n'y a plus dans le corps de l'État ni
nerfs ni sang. Il a perdu môme la couleur et jusqu'à l'apparence de
la vie. Plus de république qui m'intéresse et avec laquelle j'aime à
m'identifier. Et vous vous accommoderez, direz-vous, de cette
manière d'être ! Oui. Je me rappelle de quel éclat la république
brillait naguère quand je présidais à ses destinées, et de quelle
faveur on paya mes efforts. Aucun reproche ne trouble ma conscience.
Le pouvoir absolu d'un seul pèse aujourd'hui de tout son poids sur
ceux qui m'enviaient jadis le peu de part que j'eus au pouvoir de
tous. Ce sont là des consolations. D'ailleurs, mon caractère reste
intact. Je reviens à une existence la plus rapprochée possible de la
nature, aux lettres, à l'étude. Le rôle de l'orateur est pénible,
mais il a des jouissances qui dédommagent. Ma maison et mes champs
font mes délices ; j'oublie d'où je suis tombé ; je vois seulement
d'où je me suis relevé. Que j'aie près de moi mon frère et vous,
puis arrive que pourra. Avec vous je philosopherai à mon aise. La
région de mon âme où la sensibilité réside s'est comme pétrifiée. Il
n'y a plus pour moi que la vie privée, que l'intérieur. Enfin vous
me trouverez dans un calme incroyable que d'ailleurs je dois surtout
à l'espoir de votre 169
prochain retour ; car jamais il n'exista de Sympathie semblable a
celle qui nous unit.— Mais apprenez le reste. La situation tend à un
interrègne. Il y a dans l'air comme une odeur de dictature. On en
parle partout, et c'est ce qui a agi pour Gabinius sur la
pusillanimité de ses juges. L'accusation de brigue intentée contre
les candidats consulaires a été admise pour tous. Il y a de plus
celle de Gabinius, que P. Sylla a portée dans la prévision d'un
acquittement, et qui a été reçue en dépit de Torquatos et de son
opposition. Mais ils seront tous absous, et il n'y aura désormais de
condamnation que pour meurtre. Oh! sur cet article on est sé\ère et
l'on procède chaudement. M. Fulvius Nabilior vient d'être condamné;
d'autres plus avisés n'ont pas voulu môme en courir la chance. —
Ai-je quelque chose encore à dire? ah ! voici. Une heure après
l'acquittement de Gabinius, d'autres juges se sont monté la tête et
ont appliqué tout net la loi Papia à je ne sais quel Antiochus
Gabinius, élève du peintre Sopolis, et qui a été affranchi, et l'un
des officiers de Gabinius. Cet homme s'est écrié à l'arrêt qui le
condamne comme criminel de lèse-majesté : " Ne sais-je point, Mars,
que tu étais avec Vénus ?» — Pomptinius prétend triompher le 4 des
nones de novembre; Caton et Servilius, préteurs, s'y opposent
ouvertement, ainsi que le tribun Q. Mucins. Ils soutiennent qu'il
n'y a point de décret qui l'ait nommé imperator, et il est certain
que celui qui existe est fait en dépit du bon sens. Mais Pomptinius
aura pour lui le consul Appius. Caton crie que Pomptinius ne
triomphera pas, lui vivant. Je crois moi que Caton aura comme à son
ordinaire fait du bruit pour rien. Appius songe à se passer de loi
et à se rendre à ses frais en Cilicie. — J'ai répondu sur tous les
points à la lettre que vous avez remise a Paccius. Mais j'ai encore
à vous dire que mon frère me raconte des merveilles de César et de
son attachement pour moi, et ce que dit mon frère, César lui-même me
le confirme. On s'attend à le voir revenir de l'expédition de
Bretagne ; les abords de l'île sont défendus par des fortifications
très redoutables. Il est de plus avéré qu'il n'y a pas une once
d'argent à recueillir dans toute l'Ile et que les esclaves sont le
seul butin qu'on puisse y faire. Je pense que vous n'irez pas
chercher parmi eux vos hommes de lettres ou vos musiciens. — Paullus
a presque terminé la restauration de la vieille basilique du forum,
en se servant des anciennes colonnes. Celle qu'il bâtit sera tout ce
qu'il y a de plus magnifique. C'est une construction, s'il faut vous
le dire, qui le rend très populaire et lui fait le plus grand
honneur. Aussi deux amis de César (Oppius et moi ; pendez-vous si
vous voulez) viennent-ils de sacrifier dans la même vue soixante
millions de sesterces pour développer, dans le forum, cet édifice
dont vous avez toujours l'éloge à la bouche, et pour l'étendre
jusqu'au portique de la Liberté. Il n'y avait pas moyen de traiter à
moins avec les propriétaires. Ce sera la plus belle chose du monde.
Il y aura dans le Champ de Mars sept enceintes électorales de marbre
et des galeries de marbre qui seront entourées d'un grand portique
de mille pas. Auprès se trouvera une villa publique. Et qu'ai-je à
faire de tout cela, direz-vous? Ne me demandez-vous pas les
nouvelles de Rome, ou aimez-vous mieux que je vous parle du
dénombrement qui ne se fera jamais et des arrêts qui se rendent
suivant la loi Coctia? — Maintenant que je vous gronde, et il y a de
quoi. Vous me dites, dans vo- 161
tre lettre de Buthrote, dont vous aviez chargé G. Décimius, que vous
serez peut-être obligé de faire un tour eu Asie. Mais, de par tous
les dieux, je ne vois pas ici pour vous un cheveu de différence
entre agir par vous-même et donner pouvoir. Vos absences ne
sont-elles pas déjà assez fréquentes, et faut-il encore qu'elles
deviennent si longues! Vous auriez bien dû me prévenir à temps de ce
projet. J'aurais tenté de vous en dissuader; mais je renfonce mes
reproches. Puisse ce peu de mots hâter votre retour ! Je ne vous
écris pas plus souvent, faute de savoir d'une manière certaine où
vous êtes et où vous allez. J'ai chargé je ne sais plus qui de cette
lettre; il a chance de vous voir, cela me suffit. Puisque vous
songez à aller en Asie, mandez-moi au moins vers quelle époque vous
comptez être de retour, et ce que vous avez fait pour Eutychide.
156. — A QUINTUS.
Rome, 24 octobre.
Q. III, 4. Gabinius est acquitté. On
n'est pas plus stupide que l'accusateur Lentulus et que ses
auxiliaires, ni plus vil que les juges. Après tout, sans les
incroyables efforts et les prières de Pompée, sans le bruit menaçant
d'une dictature, l'accusé n'et'it pas tenu, môme devant Lentulus.
Jugez-en, puisque avec un accusateur comme Lentulus et un tribunal
de cette espèce, il a eu contre lui trente-deux voix sur
soixante-dix. On s'est , au surplus, si fort récrié contre le
jugement , qu'il ne lui sera pas possible d'échapper aux autres
chefs, notamment à celui de concussion. Mais, vous le voyez, il n'y
a plus de république, plus de sénat, plus de justice, plus de
dignité publique ni privée. Que vous dire encore de ces juges? Il y
avait parmi eu deux prétoriens; Domitius Calvinus qui a ouvertement
voté pour l'absolution, afin que tout le monde le vît ; et Caton
qui, à peine le relevé des votes fait, s'est esquivé et s'en est
allé porter à Pompée la nouvelle. — Quelques personnes prétendent,
Salluste entre autres, que j'aurais dû me charger de l'accusation.
Moi! me commettre avec de tels juges! et où en serais-je, s'il fût
sorti absous de même d'une lutte directe avec moi ? Mais ma réserve
avait d'autres motifs. Pompée se serait imaginé que j'en voulais
moins à Gabinius qu'à sa propre considération à lui. Il serait entré
dans la ville: la chose en serait venue aux inimitiés ouvertes.
J'aurais été comme Pacidéianus aux prises avec Éserninus le Samnite,
et peut-être il m'eût arraché l'oreille à belles dents ; sa
réconciliation avec Clodius était du moins inévitable. Enfin je me
loue fort du parti que j'ai pris, sauf votre approbation toutefois.
A uue époque où Pompée avait reçu de ma part le plus rare témoignage
de dévouement, à une époque où je ne lui devais rien, tandis qu'il
me devait tout, je l'ai vu, à propos d'un dissentiment politique, se
cabrer contre moi, je ne veux pas dire plus; il était moins puissant
qu'aujourd'hui, et j'étais alors dans tout l'éclat de ma fortune.
Aussi me donna-t-il dès ce moment la mesure de son caractère. Dans
ma position actuelle je ne mets aucun prix à être quelque chose. La
république est sans pouvoir, Pompée seul est puissant; et j'irais
entrer en lutte avec lui? Les choses en fussent arrivées là
pourtant. Ce. n'est pas vous sans doute qui m'auriez conseille
d'encourir le risque. — Hé bien! dit Salluste,
162 tout un ou tout autre.
Il fallait entreprendre la défense. C'était là «ne belle concession
à faire à Pompée. Il vous en priait instamment. — L'aimable ami que
Salluste ! et la belle alternative ! Me faire un ennemi mortel ou me
couvrir à jamais d'infamie ! j'ai pris un moyen terme dont je suis
content et qui m'a procuré la satisfaction d'entendre dire à
l'accusé, après ma déposition, toute de vérité et de conscience, que
s'il lui était permis dé rester à Rome, je n'aurais plus à me
plaindre de lui. Et il ne m'a fait aucune question. — Vous me
demandez des vers; mais, pour ce genre de travail, il faut du loisir
et de la liberté d'esprit, il faut aussi de l'enthousiasme, et je
n'en puis avoir. L'année qui vient me préoccupe, quoique je n'en
redoute rien. Et puis vraiment, pour parler sans ironie, vous êtes
le meilleur poète de nous deux. — Oui, je voudrais bien aussi que
vous eussiez complété votre bibliothèque grecque, fait vos échanges
et vos achats de livres latins, je le voudrais, puisque votre
bibliothèque est réellement à mon usage; mais je n'ai personne à qui
m'en remettre d'un tel soin pour moi-même. Les ouvrages qu'il vous
faut ne se trouvent pas à vendre; et pour les faire copier, il faut
un homme habile et intelligent. En attendant, Chrysippe aura des
ordres de moi a ce sujet, et j'en dirai un mot à Tyrannion. Je
saurai où en est Scipion pour le fisc, et j'agirai pour le mieux.
Faites ce que vous voudrez d'Ascanion ; je ne m'en mêle pas. Quant à
la maison des faubourgs, vous avez raison de ne pas vous presser;
mais il vous en faut une. — Je vous écris le 9 des kalendes de
novembre, jour d'ouverture des jeux, au moment de partir pour
Tusculum. J'emmène avec moi mon Cicéron qui va s'en donner, non des
jeux, mais de l'étude. Mon absence ne sera pas aussi longue que je
le souhaiterais, parce que je veux être à Rome pour le triomphe de
Pomptinius, le 3 des ides de novembre. Je m'attends à quelque petite
bagarre. Il y a deux préteurs, Caton et Servilius, qui menacent de
leur opposition. Et je ne sais trop ce qui peut en résulter. Il aura
pour lui le consul Appius, les préteurs et les tribuns du peuple ;
mais les autres montrent bien les dents ,Quintus Scévola surtout,
qui ne respire que Mars et les combats. Mon cher et aimable frère,
ayez soin de vous.
157. —
A QUINTUS. Tusculum, novembre.
Q. Ill, 5 et 6. Vous me
demandez où j'en suis de mon ouvrage commencé à Cumes. Je n'ai cessé
d'y travailler; mais j'ai à plusieurs reprises change de plan et
modifié mes idées. Deux livres déjà se trouvaient finis. J'y
supposais une conversation qui aurait eu lieu pendant neuf jours
fériés, sous le consulat de Tuditanus et d'Aquillius. J'avais pour
interlocuteurs Scipion l'Africain, mort peu de temps après, Lélius,
Philus, Manilius, Q. Tubéron et les deux gendres de Lélius, Fannius
et Scévola. L'entretien roulait sur la question de savoir quel est
le meilleur gouvernement et le citoyen par excellence. Il devait
durer neuf jours et être distribué en autant de livres. L'ouvrage
marchait merveilleusement d'après cette donnée, et l'illustration
des personnages donnait de l'autorité à leurs paroles. Mais un jour
que je me le faisais lire, à Tus-
163 culum, Salluste, qui se trouvait là, me fit remarquer
que des idées sur le gouvernement auraient bien plus de poids dans
ma bouche, à moi qui ne suis pas un Héraclide du Pont, mais no
consulaire et un consulaire mêlé aux plus grandes affaires de l'État
; qu'en mettant en scène des personnages si anciens, je créais une
fiction ; qu'il n'en était pas de ces livres comme de mes Dialogues
sur l'art oratoire, où il a été de bon goût de me mettre en dehors;
que d'ailleurs je n'y avais introduit que des personnages que je
pouvais avoir personnellement connus; qu'enfin, Aristote, lorsqu'il
traite de politique ou de ce qui constitue un grand homme, a
toujours soin de parler en son propre nom. Ces observations me
frappèrent d'autant plus, que mon plan primitif m'interdisait toute
allusion aux plus intéressantes de nos commotions politiques, qui
sont d'une date postérieure à l'existence des personnes que je fais
parler. C'était même, dans le principe, une combinaison de ma part.
Je ne voulais pas toucher à notre époque, de peur d'allusions
involontaires et de personnalités. Mais je saurai éviter l'écueil,
en supposant un dialogue entre vous et moi. Lorsque je serai à Rome,
je vous enverrai ce que j'avais fait d'après mon premier plan, et
vous sentirez tout ce qu'il a dû m'en coûter pour le laisser là. —
Les témoignages d'amitié que me donne César sont un bonheur pour
moi. Quant à ses ouvertures, je n'en suis que médiocrement touché.
Je n'ai plus la soif des honneurs, la passion de la gloire. Je tiens
plus à la durée de son affection qu'à l'accomplissement de ses
promesses. Cependant ma vie est tout aussi agitée, tout aussi
remplie que si je me proposais un prix que je ne demande pas. — Vous
voulez que je vous fasse des vers. Si vous pouviez imaginer à quel
point le temps me manque ! Et puis, à dire vrai, le sujet que vous
indiquez à ma Muse ne m'inspire nullement. Vous me demandez un
cadre, des idées sur une matière que je connais à peine, vous notre
maître à tous en cette forme d'expression de la pensée! J'y ferais
de mon mieux cependant, si j'avais encore cette vivacité
d'imagination, nécessaire au poète, vous le savez, et que les
circonstances m'ont ôtée. Le soin des affaires de l'État ne me
préoccupe pas, il est vrai, et je me livre tout entier aux lettres.
Mais il faut que je vous avoue ce que je voudrais voit? cacher plus
qu'à tout autre : c'est un supplice pour moi, mon cher frère, que de
penser qu'il n'y a plus de république ni de magistrature; que de
consumer dans les vains travaux du forum, ou d'employer à des études
purement littéraires le temps de ma vie ou il m'appartenait de jouir
d'une autorité puissante au sein du sénat; que de renoncer à la
devise chérie de ma jeunesse : « Toujours le premier, toujours avant
les autres. » C'est un supplice que de me voir réduit à l'inaction
en face de mes ennemis, et quelquefois même contraint de les
défendre; que de n'avoir pas la liberté de penser, la liberté de
haïr; en un mot, que de ne trouver plus que César qui m'aime .encore
comme je le désire, et qui de lui-même, comme on me l'assure, ait
voulu devenir mon ami. Ce n'est pas cependant que j'en sois à
n'avoir plus de consolation, mais la plus grande serait d'être avec
vous ; et, pour comble, il faut précisément que vous me soyez
enlevé. — Pansa voulait que je défendisse Gabinius; c'était me
perdre. Ceux qui le haïssent, tous les
164 ordres de l'État,
allaient par contrecoup me prendre en haine. Je me suis, je crois,
tenu dans une bonne ligne, en n'allant pas plus loin que le vœu de
tous. En tout enfin je suis votre conseil , je ne veux plus que le
repos et la paix. — Tyrannion est en retard pour vos livres. J'en
parlerai à Chrysippe ; mais la tâche est difficile et demande un
soin infini. J'en sais quelque chose, moi dont la passion pour les
livres ne peut jamais être satisfaite en rien. Je cherche en vain à
qui m'adresser pour les livres latins. Qu'on fasse copier ou qu'on
achète, on est toujours sûr de n'avoir que des exemplaires fautifs :
comptez cependant sur mes soins. —Ainsi que je vous l'ai marqué
précédemment, Crébrius est à Rome, et des personnes, qui ont
toujours un serment à la bouche, crient à tue-tête qu'il ne vous
doit rien. Je crois que, pendant mon absence, l'affaire de finance a
été terminée. — Quatre tragédies en seize jours ! et vous vous
adressez à autrui !De la gloire d'emprunt à vous, auteur d'une
Electre et d'une Troade! allons ! point de pause, et sachez bien que
le fameux connais-toi toi-même a été dit non-seulement pour réprimer
notre vanité, mais pour nous éclairer sur ce que nous valons.
Envoyez-moi ces nouvelles productions avec l'Érigone. Voilà pour vos
deux dernières lettres.
158. — A
QU1NTUS. Tusculum, novembre.
Q. III, 7. Tout est inondé à
Rome, principalement la voie Appienne et le temple de Mars. La
terrasse de Crassipès a été emportée par les eaux, ainsi qu'un grand
nombre de boutiques et de jardins. Le débordement s'étend jusqu'au
vivier public. Voilà qui réalise le vers d'Homère. « Dans les jours
d'automne, quand Jupiter epanche l'eau par torrents ; » ce qui suit
offre une application frappante à l'absolution de Gabinius : «
Irrité de voir dans les tribunaux la force décidant contre le droit,
et la justice ex« puisée, au mépris de la vengeance des dieux. "
Mais je ne veux plus songer à tout cela. — Lorsque je serai à Rome,
je vous écrirai tout ce que je pourrai découvrir, surtout pour la
dictature. Je vous enverrai aussi des lettres pour Labiénus et
Ligurius. Je trace ces lignes avant le jour, à la lueur d'une petite
lampe de bois à laquelle je tiens singulièrement, parce que c'est
vous, diton, qui l'avez fait faire, lorsque vous étiez à Samos.
Adieu, cher et excellent frère.
159. — A
ATTICUS. Rome, novembre.
A. IV, 17. La voilà donc cette
lettre si impatiemment attendue ! ô retour qui m'enchante ! quelle
exactitude! quelle ponctualité merveilleuse 1 que la mer est aimable
! moi qui frissonnais rien qu'en songeant à tout l'attirail de vos
précautions lors de la première traversée. Je vais donc vous voir,
et si je ne me trompe, plus tôt même que vous ne le dites; car vous
comptiez trouver vos dames dans l'Apulie. Et que feriez-vous en
Apulie, si elles n'y étaient pas? Vous aurez toutefois quelques
jours à donner à Vestorius; il faut vous remettre un peu en goût de
latin attique. Ne prendrez-vous pas des ailes pour revoir plus tôt
la propre sœur de ma République? On y voit dans un même lieu
distribuer l'argent tribu par tribu, à la face des comices, et
absoudre publiquement Gabinius. Il ne manque plus que de voir
Gabinius en crédit. — 165
Que demandez-vous de Messalla? je ne sais qu'en dire. Je n'ai jamais
vu de candidats se présenter avес des forces si égales. Vous
connaissez les appuis et les forces de Messalla.Triarius a porté
plainte contre Scaurus qui, s'il faut vous le dire, ne trouve pas
jusqu'à présent grande sympathie. Cependant son édilité a laissé de
favorables souvenirs, et le nom de son père est toujours puissant
sur les tribus de la campagne. Les deux compétiteurs plébéiens
marchent à peu près ex œguo, l'un, Domitius, appuyé sur ses amis et
se faisant un mérite de ses jeux, dont le succès pourtant a été
médiocre; l'autre, Memmius, recommandé par les soldats de César et
soutenu par la Gaule de Pompée. S'il ne se sent pas assez fort, on
pense qu'il trouvera quelqu'un pour rompre les comices en attendant
César, surtout Caton ayant été absous. — J'ai reçu des lettres de
Quintus mon frère et de César, le 11 des kalendes de novembre :
l'expédition était finie, les otages donnés; on n'avait pas fait de
butin; on avait seulement imposé des contributions. Les lettres
écrites sur les rivages bretons sont datées du 6 des kalendes
d'octobre, au moment d'embarquer l'armée qu'on ramène. — Q. Pilius
est allé au-devant de César. Quanta vous, si vous avez quelque
amitié pour moi et pour les vôtres, si vous êtes bomme de parole ou
simplement homme de sens, et si vous songez aux biens dont vous
pouvez jouir, vous pressez le pas, j'en suis sûr, et vous êtes bien
près. Je ne puis, je vous assure, me passer de vous ; est-ce donc
merveille, quand j'ai tant de peine a me passer de Dionysius?
Apprêtez-vous à nous entendre, au jour venu, vous le réclamer à
grands cris, moi et Cicerón. Les dernières lettres que j'ai reçues
de vous étaient datées d'Éphèse, du 5 des ides d'août.
160. — A
ATTICUS. Rome, novembre.
A. IV, 18. Vous
m'accusez, j'en suis sûr , de négligence et d'oubli, en voyant ma
correspondance se ralentir ; mais vos séjours et votre itiuérairc
n'ayant rien de fixe, je n'adresse mes lettres ni en Épire, ni à
Athènes, ni en Asie, et n'en confie qu'à ceux qui partent exprès
pour se rendre près de vous. Nos lettres ne sont pas telles qu'elles
puissent tomber eu d'autres mains sans inconvénients. Elles sont si
essentiellement confidentielles que je me défie même souvent d'un
secrétaire. — Il est curieux de voir la fin de tout ceci. Les
consuls sont dans la boue, depuis que le candidat С Memmius a lu en
plein sénat le marché d'élection passé entre eux et lui, de moitié
avec Domitius, son compétiteur, et par lequel Memmius et Domitius
s'engagent, sous la condition d'être désignés consuls pour l'année
prochaine , soit à payer aux consuls un dédit de quatre cent mille
sesterces chacun ; soit à leur procurer 1° trois augures affirmant
avoir assisté à la promulgation de la loi curiate qui n'a pas été
promulguée; 2°deux consulaires déclarant s'être trouvés à la séance
de règlement d'état des provinces consulaires, séance qui n'a jamais
eu lieu. Comme ce marché n'était pas verbal, que les livres du
compte et les obligations souscrites en font foi, Memmius a tout
produit par le conseil de Pompée. Appius est resté impassible, ne
perdant rien de son aplomb ordinaire ; mais son col lègue était sens
dessus dessous : c'est un homme enterré. — Quant à Memmius, il a
beaucoup perdu en rompant ainsi le marché, malgré Calvi-
166 nus ( Domitius). Aussi
ne rêve-t-il que dictature et fomente-t-il le désordre tant qu'il
peut. Admirez, je vous prie, mon sang-froid au milieu de tout cela,
le jeu tranquille de mon esprit, mon dédain pour l'argent des
Sélicius, et la précieuse consolation que je trouve, comme une
planche en mon naufrage, dans ma liaison avec César, qui comble mon
frère, je dirai votre frère, bons dieux! d'honneurs, d'égards, de
bonnes grâces, au point que Quintus ne serait pas mieux avec moi
pour imperator. Croiriez-vous que César vient, à ce qu'il m'écrit,
d« lui abandonner le choix d'un quartier d'hiver pour ses légions?
Et vous ne l'aimeriez pas? et qui donc aimerez-vous de tous ces
gens-là? A propos, vous ai-je mandé que je suis lieutenant de
Pompée, et que je quitte Rome aux ides de janvier? j'y trouve mon
compte de plus d'une façon. Qu'ai-je encore à vous dire? Vous saurez
le reste quand je vous verrai. Je suis bien aise de tenir un peu
votre curiosité en haleine. Mille compliments à Dionysius. Je lui ai
ménagé un logement ou plutôt je lui en ai bâti un. Je vous l'avoue,
sa présence mettra le comble à la joie que me cause votre retour. Si
vous m'aimez , ce sera chez moi que vous descendrez avec tous les
vôtres, le jour de votre arrivée.
161. — A
QUINTUS. Rome, novembre.
Q. III, 8. Il y a une lettre de
vous à laquelle je n'ai rien à répondre ; elle n'est que bile et
mauvaise humeur. Vous en avez, dites-vous, remis une autre dans le
même genre à Labiénus. Il n'est pas encore arrivé. Mais j'en reçois
une qui dissipe tout mon chagrin. Je vous adresserai seulement un
conseil, une prière. Vous êtes exposé sans doute à des tourments
d'esprit, à des fatigues, à des regrets; mais veuillez vous rappeler
la pensée qui a présidé à votre départ. Il ne s'agissait pas d'un
intérêt faible et mesquin. Quel prix nous proposions-nous en effet
d'an sacrifice aussi grand que la séparation? La consolidation de
notre existence politique par l'amitié d'un homme puissant et bon :
c'était une question d'avenir, et non une question d'argent ; quant
au reste, on n'y peut rien fonder qui ne s'écroule. Oui, en ayant
sans cesse présent à l'esprit et le but de notre détermination, et
les espérances qui s'y rattachent , vous trouverez moins pénibles
les fatigues militaires et tous vos tracas. Certes, vous êtes bien
le maître d'ailleurs de vous en affranchir. Je ne crois pas le
moment venu, mais il approche. — Voici un avis important. Il ne faut
rien m'écrire de ce qui pourrait nous tourner à mal, si on venait à
lire votre lettre. J'aime mieux ignorer certaines choses que de
m'exposer pour les savoir. Je vous en dirai davantage quand j'aurai
l'esprit plus libre, c'est-à-dire quand Cicéron sera tout à fait
bien, comme je l'espère. Mais dites-moi, je vous en prie, à qui
donner mes lettres? aux courriers de César qui vous les enverra
sur-le-champ? ou à ceux de Labiénus? Où est situé le pays des
Nerviens? est-ce bien loin ? Je n'en sais pas un mot. — J'ai lu avec
une -vive joie ce que vous me dites du courage et de la force d'âme
de César, dans cette cruelle épreuve. Vous m'engagez à mettre à fin
le poème que j'ai ébauché à son intention. Eh bien I en dépit de mes
occupations, en dépit d'une disposition d'esprit bien contraire, j'y
reviendrai, puisque César sait par la lettre où je vous en parlais,
que j'ai tant 167 fait
que de commencer. Je finirai pendant les vacances des supplications
dont je suis ravi qu'on ait profité pour tirer d'embarras Messalla
et les autres. Vous comptez le voir consul avec Domitius ; je le
crois comme vous. Je réponds à César de Messalla. Memmius attend
tout d'un voyage de César. Il s'abuse ; ses affaires vont mal. Quant
à Scaurus, il y a déjà longtemps que Pompée l'a abandonné. — Tout
est en suspens. Les comices vont droit à un interrègne. On parle de
dictature; les honnêtes gens font la grimace. Ce qui me la fait
faire à moi, ce sont les propos qu'ils tiennent ; mais on a peur et
on ne décide rien. Pompée dit tout haut qu'il n'en veut pas. Avec
moi naguère il était moins positif. C'est Hirrus, dit-on, qui fera
la proposition. Quel sot, tons dieux !quel adorateur de
lui-même, et sans rival assurément ! Pompée a agi par moi sur
Crassus Junianus qui m'est tout dévoué. Je l'ai neutralisé. Mais au
fond, Pompée veut-il de la dictature? n'en veut-il pas? qui peut le
dire? si Hirrus agit, ce n'est pas la preuve qu'il n'en veut pas. On
ne s'entretient plus d'autre chose. Stagnation complète de tout le
reste. — Les obsèques du fils de Serranus Domesticas ont eu lieu le
8 des kalendes de décembre, avec un grand appareil de deuil. Le père
a prononcé un éloge funèbre, qui est de moi. — Un mot sur Milon
maintenant. Pompée ne le seconde en rien ; il est tout à Gutta, et
il se fait fort, dit-il, d'obtenir de César une intervention active.
Milon en a la fièvre et vraiment il y a de quoi. Si Pompée est une
fois dictateur, Milon n'a plus rien à espérer, ou à peu près rien.
Si Milon appuie l'opposition à la dictature , et fait agir sa
troupe, il se fait un ennemi de Pompée, et c'est ce qu'il redoute.
S'il reste tranquille, la dictature peut être enlevée d'un coup de
main. Il prépare des jeux magnifiques, si magnifiques qu'il n'y eut,
je crois, jamais rien de pareil. Sottise! double et trlple sottise!
Rien ne l'y obligeait. 1° Il a déjà splendidement payé sa dette. 2°
Il n'a pas la fortune nécessaire. 3° Il n'est que curateur à la
succession, et pouvait fort bien se considérer comme curateur et non
comme édile. Je crois avoir tout dit. Ayez bien soin de votre santé,
mon cher frère.
162. — A QUINTUS.
Rome, décembre.
Q. III, 9. Tous ces avis partaient de
la meilleure intention du monde. Mais j'ai bien fait de ne les pas
suivre. « Que la terre m'engloutisse, si je » me trompe ! » Mon
attitude a été, de l'aveu de tous, ferme autant que modérée. Je n'ai
ni harcelé ni ménagé le coupable. J'ai fait ma déposition avec
force, puis j'ai attendu. Quand un arrêt ignoble et déplorable est
venu clore le débat, j'en ai pris mon parti d'assez bonne grâce. J'y
ai trouvé d'ailleurs un grand avantage. J'étais toujours hors de moi
à l'aspect des maux de l'État et de l'audace des méchants;
maintenant je n'en suis pas même ému : c'est que j'en suis venu à
désespérer des hommes et du siècle. Je n'ai plus rien à attendre de
la république ; irais-jc me remuer la bile à cause d'elle? Les
lettres, l'étude, de doux loisirs dans mes campagnes, et avant tout
la société de nos enfants, voilà désormais mes plaisirs. Milon seul
me tourmente. Puisse-t-il me rendre le repos en devenant consul I
J'y travaille avec ardeur comme autrefois pour moi. Continuez d'agir
de votre côté. Tout 168
ira bien, si la violence ne s'en mêle, mais je | crains pour sa
fortune. — C'est une démence intolérable que de jeter ainsi dans ses
jeux trois cent mille sesterces. Pour cette fois cependant je me
prêterai à sa folie autant que faire se pourra, et vous me
seconderez de toutes vos forces. — Mes appréhensions sur le
mouvement des choses pour l'année qui vient, n'ont rien qui me soit
personnel ; elles n'ont rapport qu'à la république ; j'ai beau
cesser d'y prendre part, je ne cesse point d'y prendre intérêt.
Voici qui vous donnera la mesure de la réserve que je vous
recommande dans notre correspondance : Il y a ici des troubles qui
éclatent publiquement. Eh bien ! je ne vous en parie pas, de peur
qu'une de mes lettres interceptée n'aille me faire des ennemis de
ceux qui y verraient leurs noms. Ainsi tranquillisez-vous en ce qui
nous concerne. Quant à la république, je connais votre sollicitude.
Notre ami Messalla sera consul, je le vois; si c'est à la suite d'un
interrègne, point de jugement; si c'est avec un dictateur, rien à
craindre non plus. Il n'a pas un seul ennemi. La chaleur dHortensius.
pour lui fait beaucoup d'impression. Puis l'acquittement de Gabinius,
c'est l'impunité décrétée d'avance. Mais, à propos, cette dictature
en reste là : Pompée est absent. Appius intrigue. Hirrus met des
jalons. Déjà on compte les opposants par centaines. Le peuple est
neutre. Les »rands n'en veulent point. Moi, je ne bouge. — Mille
remercîments pour les esclaves que vous me promettez. Il est certain
que j'en suis un peu à court à Rome et à la campagne; mais dans vos
bonnes intentions pour moi, ne faites, je vous prie, que ce que vous
pouvez absolument sans vous priver vous-même et sans vous gêner. —
La lettre de Vatinius m'a fait rire. Je sais bien qu'il est chargé
de me surveiller; mais il est de ces gens qu'on avale facilement et
dont je ne veux faire qu'une bouchée. — J'ai prévenu vos nouvelles
instances. Le poème pour César est fini, et je crois avoir lieu d'en
être content. J'attends un messager qui m'en réponde. Je ne veux pas
qu'il lui arrive comme à votre Érigone, pour qui seule les Gaules
n'ont pas eu de routes sûres pendant le gouvernement de César. —
Quoi ! faute de bon ciment, je jetterais bas tout l'édifice ! mais
il me plaît de plus en plus; le portique inférieur et les pièces
attenantes ont surtout bon air. Quant à votre Arcanum, c'est sur ma
parole un ouvrage à la César ou quelque chose de plus distingué
encore. Ces statues, cette palestre, lе vivier, ce Nil, tout cela
demanderait des Philotimes par milliers, et vous n'avez qu'un
Diphile. Mais j'irai moi-même, j'y enverrai et je donnerai mes
ordres.—Vous crierez encore plus fort après Félix, quand vous saurez
tout. Ce n'est pas le testament, par lequel il tenait tant à régler
le partage, qu'il a fait sceller. Par une méprise de lui et de son
esclave Sicura, il a pris un ancien testament dont il ne voulait
plus ; ct c'est ce malheureux testament qu'on a scellé. Honni soit
du défunt ! et consolons-nous-en. — J'aime votre Cicéron tendrement
: vous le voulez, il le mérite, et je ne saurais m'en défendre. Je
le renvoie, pour le rendre à la surveillance de ses maîtres. Sa mère
Pomponia va partir, et quand elle n'est pas là, je crains sa
gourmandise. Il n'en sera pas moins très-souvent avec moi. Ma
réponse est maintenant complète. Cher et excellent frère, adieu.
163. — A TIRON.
Rome
F. XVI, 10. Et moi aussi je
voudrais bien qu'il vous fût possible de me rejoindre; mais je
crains pour vous le voyage. La diète, les purgations , la force du
mal vous ont épuisé. Les rechutes sont graves à la suite de maladies
si graves; la moindre imprudence y expose. Aux deux jours
nécessaires pour arriver à Cumes, ajoutez-en cinq autres sans
interruption pour le reste du voyage. Je veux être à Formies le 3
des kalendes. Faites, mon cher Tiron, que je vous y trouve tout à
liait vaillant. Privées de votre concours, mes études chéries, je
devrais dire nos études chéries, sont dans une langueur mortelle. La
lettre que vous m'avez envoyée par Acaste les a un peu ranimées.
Pompée qui est là quand je vous écris, rit et plaisante; il voulait
entendre quelque chose de moi ; je lui ai répondu que chez moi, sans
vous, tout était mort. Revenez donc bien vite à ces Muses qui vous
appellent. Je serai, le jour dit, Adèle à ma parole. Pourrais-je y
manquer, quand c'est moi qui vous ai appris la signification
étymologique du mot fidèle. Rétablissez-vous entièrement. Je suis
tout prêt. Adieu. Le 14 des kalendes.
164. —A
L. CULLÉOLUS, PROCONSUL. Rome.
F. XIII, 42. Mon ami L.
Luccéius, qui est très-sensible à ce qu'on fait pour lui, est venu
chez moi me témoigner dans les termes les plus forts sa gratitude
des assurances explicites et obligeantes que ses fondés de pouvoirs
ont reçues de vous, dit-il, sur tous les points. Si quelques paroles
excitent ainsi sa reconnaissance, que ne fera pas la réalité,
lorsque vous aurez fait, comme je l'espère, ce que vous avez promis?
Les Bullions ( habitants d'un canton de l'Illyrie) ont manifesté
l'intention positive de prendre Pompée pour arbitre entre eux et
Luccéius. C'est bien; mais nous n'en avons pas moins le plus grand
besoin de votre intérêt, de votre appui, de votre autorité que je
sollicite. Ce qui me charme au delà de toute expression, c'est que
nulle recommandation ne vaut la mienne auprès de vous ; que Luccéius
le voit par ce que vous lui écrivez ; et que les gens d'affaires le
savent. Faites, je vous en conjure, que les faits le prouvent mieux
encore.
165 A С
MUNATIUS, FILS DE CAIUS. Rome, décembre.
F. XIII, 60. L. Livinéius
Tryphon est l'affranchi de L. Régulus, l'un de mes intimes amis,
qui, étant malheureux, a droit de me trouver plus empressé que
jamais, et qui certes ne me trouvera pas plus de bonne volonté,
parce que c'est impossible. Cet affranchi d'ailleurs, je l'aime
aussi lui-même. J'ai reçu de lui les plus grandes marques de zèle
dans les moments d'adversité où l'on peut juger de la fidélité et de
l'attachement des hommes. Je vous le recommande donc comme on
recommande, quand on n'est pas ingrat, ceux à qui l'on doit
beaucoup. Il a affronté mille périls pour me sauver; il s'est
souvent embarqué au plus fort de l'hiver. Témoignez-lui que votre
amitié pour moi lui tient compte des obligations que je lui ai. Je
vous en saurai un gré infini.
166. — A
CULLÉOLUS. Rome.
F. XIII, 41. Vous saurez qu'en
obligeant L. Luccéius, vous n'avez pas prêté à un ingrat;
170 qu'il est fort touché
de vos bontés, et que Pompée , chaque fois qu'il vient me voir, et
il vient souvent, me parle aussi en termes tout particuliers de sa
gratitude. J'ajoute, parce que je sais le plaisir que cela vous
fait, que vos attentions pour Luccéius sont en même temps un vrai
bonheur pour moi. Si vous n'avez eu d'abord en vue que le plaisir de
m'être agréable, il faut maintenant persévérer pour l'honneur du
début. Quoique je n'aie là-dessus aucun doute, je ne vous en demande
pas moins avec instance de continuer comme vous avez commencé et de
couronner votre œuvre. Luccéius et Pompée en seront reconnaissants
au dernier point, et vous vous mettrez dans une excellente position
vis-à-vis de l'un comme de l'autre. C'est moi qui vous le dis et qui
en serai au besoin garant. Je vous ai donné, il y a peu de jours,
des détails sur les affaires publiques et j'y ai joint mes
réflexions. J'ai remis ma lettre à vos esclaves.
167. — A
CURIUS, PROCONSUL. Rome.
F. XIIII, 49. Q. Pompéius, fils
de Sextus, m'est attaché de vieille date et à bien des titres. Il
s'est habitué à compter sur mon influence, quand sa fortune, son
crédit ou son autorité se trouvent en cause. Aujourd'hui que c'est
vous qui commandez dans la province, je me trouve plus que jamais
engagé à lui prouver ce que ma recommandation a de puissance, pour
le mettre mieux que qui que ce soit dans vos bonnes grâces. Si c'est
pour vous un devoir d'amitié de traiter mes amis à l'égal des
vôtres, je vous demande avec instance d'accorder votre bienveillance
à Pompéius, et de lui faire voir que, pour le profit et l'honneur,
il n'y a rien au monde qui vaille une recommandation de moi.
168. — A. L.
VALERIUS, JURISCONSULTE. Rome.
F. I, 10. Oui, jurisconsulte; pourquoi
ne vous donnerais-je pas cette qualité, dans un temps surtout où
ceux qui ne doutent de rieu sont réputés tout savoir? Je n'ai pas
manqué d'écrire à Lentulus et de le remercier en votre nom. Mais
cessez, je vous en conjure, de nous obliger à vous écrire, et venez
quelquefois nous voir. Ne vaut-il pas mieux pour vous vivre ici, où
l'on vous apprécie, que là-bas où il n'y a, je crois, que vous de
créature douée de raison? Aussi parmi les gens qui en viennent, les
uns disent : il est fier, on ne peut en tirer une réponse; les
autres : c'est un bourra, il rudoie tout le monde. Mais je ne veux
plus vous plaisanter qu'en face. Venez donc au plus vite, et laissez
de côté votre Apulie : c'est parmi nous que vous trouverez des
figures amies, heureuses de vous revoir; dans cette Apulie, au
contraire, vous serez comme Ulysse, vous ne reconnaîtrez plus
personne.
169. — A Q. PHILIPPUS, PROCONSUL Rome,
décembre.
F. XIII, 73. Je vous félicite, vous
voilà de retour de votre province, au sein de votre famille, bien
portant, laissant après vous une réputation intacte et les affaires
de votre gouvernement dans le meilleur ordre. Si vous étiez venu à
Rome, je vous au rais vu, je vous aurais remercié des bontés que
vous avez eues pour un absent, Egnatius, mon ami intime, et pourL.
Oppius, qui était avec vous.—Antipater Derbetès a sur moi les droits
d'un hôte et ceux d'un ami. Je sais que vous avez beaucoup à vous
plaindre de lui, et je m'en afflige. Je ne saurais juger de vos
griefs, mais je sais que vous n'êtes pas homme à agir légèrement. Je
demande seulement à votre vieille amitié d'user à ma considération
d'indulgence envers les fils de Derbetès. Leur sort est entre vos
mains. Si votre honneur n'est pas engagé, je vous les recommande
avec instance ; si non, je retire ma prière, votre réputation
m'étant mille fois plus obère que l'intérêt que je leur porte. Je me
persuade cependant (il se peut que je me trompe), que vous seriez
approuvé plutôt que blâmé d'user d'indulgence. Serait-ce vous donner
trop de peine, que de vous prier de m'écrire ce qu'il y a à espérer
et ce que vous pouvez faire ? Je ne doute pas que ma recommandation
ne vous dispose favorablement.
170. DE
QUINTUS A SON FRÈRE. Bretagne.
F. XVI, 16. Oui, mon cher
Marcus, aussi vrai que vous m'êtes cher, vous et mon Cicéron et
votre petite Tullie, et votre bon fils, vous m'avez rendu heureux en
réparant une indignité de la fortune, en faisant de Tiron un ami, au
lieu d'un esclave. J'ni sauté de joie, je vous assure, quand j'ai lu
votre lettre et la sienne. Je vous remercie, je vous félicite! Si je
regarde comme un bonheur d'avoir près de moi quelqu'un d'aussi
dévoué que Statius, que dire de celui chez qui les mêmes qualités se
retrouvent, accompagnées de tant d'autres mille foré préférables
encore, du goût des lettres, du charme de la conversation, de tous
les dons du cœur ! J'ai bien des motifs pour vous aimer, mon frère ;
mais aujourd'hui je vous aime davantage pour ce que vous venez de
faire et pour votre empressement à me le dire. Je vous reconnais là
tout entier. Il n'est rien que je n'aie promis aux gens de Sabinus,
et je tiendrai parole.
AN DE R. 701. — AV. J. C.
53. — AGE DE C. 54.
Cn. Domitius Calvinus, M.
Valérius Messala, consuls.
171. — A C. CURION.
Rome.
F .II, 1. Vous supposez que je vous
néglige, c'est bien mal ; mais si le reproche est pénible, il part
d'une exigence qui me charme. L'accusation d'ailleurs tombe à faux,
et dansée regret de mes lettres je reconnais une vieille amitié dont
je ne doute pas depuis longtemps, mais dont les témoignages me sont
toujours doux et chers. La vérité est que toutes les fois que j'ai
vu jour à vous faire parvenir de mes nouvelles, je vous ai écrit. Ne
suis-je pas le correspondant le plus infatigable qu'il y ait au
monde? vous, vous m'avez écrit deux fois, trois fois au plus, et des
lettres d'une ligne. Cessez donc de m'accuser injustement, ou je
vous fais votre procès à vous-même, et soyez plus équitable à mon
égard, si vous voulez que je vous traite à mon tour avec indulgence.
.Mais brisons là-dessus : je suis homme à vous gorger de lettres à
satiété, pour peu que vous mettiez le moindre prix à ces gages de
mon, attachement. Oui, j'ai gémi de votre absence et de cette longue
privation d'un commerce dont je m'étais fait une si charmante
habitude ; mais vous avez obtenu de brillants succès pendant notre
séparation : la fortune n'a cessé pour vous de sourire à mes vœux,
et c'est ce qui fait ma joie. Ecoutez ce que m'inspire une affection
sans 172 borne; le
conseil ne sera pas long. Vous avez donné la plus haute idée des
qualités de votre cœur et de votre esprit. Eh bien! je vous prie, je
vous conjure de montrer à votre retour qu'il n'est rien en vous qui
ne soit digne de l'attente générale. Et, comme l'oubli ne viendra
jamais effacer en mon cœur le souvenir de ce que vous avez fait pour
moi, je vous demande de vous rappeler, toujours, de votre côté, à
quelque degré de fortune et d'honneur qu'il vous soit donné de
parvenir, que rien ne vous eût été possible sans l'attention docile
qu'enfant vous prêtâtes jadis à mes tendres et fidèles conseils.
Soyez donc pour moi ce que vous devez être; et quand l'âge
s'appesantit déjà sur ma tête, que je puisse trouver pour mes vieux
ans l'appui de votre affection et de votre jeunesse.
172. — A
TRÉBATIUS. Rome.
F.VII, 11. Si vous n'aviez déjà
quitté Rome, à coup sûr vous voudriez en être dehors aujourd'hui ;
car à quoi sert un jurisconsulte au milieu de tant d'interrègnes?
Pour moi, j'engage tout débiteur à réclamer deux remises à chaque
interroi. Heim! mon maître, ne trouvez-vous point que votre élève
est d'une assez jolie force en droit civil? Mais, peste!
qu'arrivé-t-il et quelle métamorphose ? de la gaieté, des
plaisanteries, dans vos lettres! Voilà qui a bonne mine. J'en
voudrais dire autant de mes statues de Tusculum. Mais je veux être
au fait. On dit que César vous consulte; j'aimerais mieux qu'il
consultât votre intérêt. S'il a l'intention de s'occuper de vous, ou
si déjà même il s'en occupe, résignez-vous à ce maudit service
militaire et demeurez. Je me consolerai de votre absence en pensant
qu'elle est utile à votre fortune. Si nos efforts n'aboutissent ù
rien, revenez. Il faudra bien qu'un jour il y ait ici quelque chose
à votre convenance. Au pis aller, est-ce qu'un de nos entretiens ne
vaut pas toutes les Samarobrives du monde? De plus, considérez qu'un
prompt retour ne permettrait pas aux mauvais plaisants de mordre ;
mais qu'en prolongeant votre absence sans résultat, je ne vous
réponds point des lardons de Labérius, peut-être même de notre ami
Valérius. Au fait, ce serait une bonne figure à mettre en scène
qu'un jurisconsulte breton. — Vous riez : moi, je ne ris pas. Je
badine pour n'en pas perdre l'habitude. Au fond je parle
sérieusement. Voici donc, plaisanterie à part, ce que je vous
conseille eu ami : si ma recommandation atteint son but, point de
regrets. Ne songez qu'à votre fortune, à votre réputation. Si
l'effet ne répond pas aux promesses , revenez auprès de nous. Mais
je me persuade que, si vous le voulez bien, on ne refusera rien à
votre mérite et à mon amitié.
173. - A
C. CURION. Rome.
F. II, 2. En perdant votre
illustre père, ce glorieux citoyen, ce père fortuné à qui il n'a
rien manqué que la joie de vous voir avant de quitter la vie, je
perds celui de tous les hommes qui pouvait le mieux vous dire la
tendre affection que je vous porte. Mais, entre vous et moi,
l'amitié, j'ose le croire, n'a pas besoin de tiers qui lui serve de
garant. Que les dieux fassent prospérer votre héritage! Vous
trouverez en moi une affection, une tendresse égale à celle de ce
père qui vous a tant aimé et chéri ; n'en doutez jamais.
173
174. - A C. CURION. Rome.
F. II, 3. Ce n'est pas la faute
de Rupa, si on n'a point annoncé votre grand projet de jeux et de
fêtes; c'est moi, ce sont tous vos amis qui n'ont pas voulu qu'en
votre absence on fit rien qui pût vous engager, à votre retour. Je
vous écrirai plus tard pour vous expliquer au long ce que je pense
de votre dessein ; ou peut-être, sans vous laisser le temps de la
réflexion, vous prendrai-je au dépourvu, face à face, et vous
dirai-je de vive voix mes motifs et mes arguments. Je vous amènerai
ainsi surle-champ à mon avis, ou je ferai du moins sur vous assez
d'effet, pour que mes observations demeurent. Mais si, dès à
présent, vous renonciez de vous-même à vos projets de dépenses , et
je n'ose l'espérer, je vous dirais en peu de mots que votre retour
aura lieu dans des circonstances où les avantages que vous tenez de
la nature, du travail, de la fortune, serviront plus que toutes les
largesses du monde à vous ouvrir la voie à ce qu'il y a de plus
élevé. On est désabuse aujourd'hui de ces prestiges de la richesse ,
où le mérite n'entre pour rien ; et il n'est personne qui n'en soit
las jusqu'à la satiété. Mais voilà que je me laisse aller, contre
mon intention, à développer ma thèse. Je m'arrête et je remets la
suite de mon discours à votre retour. Sachez qu'un a ici de vous la
plus haute opinion et qu'on attend de vous tout ce qu'on doit
attendre d'une haute vertu et d'un esprit élevé. Que si, comme je
n'en doute pas, vous répondez à l'attente générale, c'est le plus
magnifique présent que vous puissiez faire à nous vos amis, à tous
vos concitoyens et à la république. En ce qui me concerne, vous
verre/ dans toutes les occasions, qu'il n'y a personne au monde qui
me soit plus cher et que j'aime plus que vous.
175. — A
TRÉBATIUS. Rome.
F. VII, 12. Je ne pouvais
m'expliquer votre silence. Pansa me dit que vous êtes devenu
épicurien. Le beau résultat de votre campagne ! Que serait-il donc
arrivé si je vous^avais envoyé à Tarente, au lieu de vous envoyer à
Samarobrive? Je n'aimais déjà pas trop à vous voir dans les mêmes
eaux que mon ami Séius. Que va devenir votre droit civil, maintenant
que vous rapportez tout à votre intérêt, rien à l'intérêt de vos
clients? Que va devenir chez vous cet axiome de la bonne foi :
Bien agir avec les gens de bien? Est-ce être homme de bien que
de ne songer qu'à soi, comme vous l'allez faire? Quel droit
ferez-vous présider aux partages des biens communs, vous qui ne
reconnaissez de communauté avec personne, et qui ne prenez que le
plaisir pour guide et pour mesure? Comment ferez-vous pour jurer,
une pierre à la main, par Jupiter, puisque vous savez d'aujourd'hui
que Jupiter ne se fâche jamais contre personne? Enfin , que vont
devenir vos clients d'Ulubre, puisque vous faites profession de ne
pas vous mêler de politique? Sérieusement, si vous nous désertez, je
m'en afflige; si votre épicuréisme n'est au contraire qu'un calcul
de flatterie pour Pansa, je vous le pardonne. Seulement mandez moi
de temps en temps ce que vous faites, et ce que je puis moi-même ici
faire, ou faire faire pour vous.
176. — A
TRÉBATIUS. Rome, 4 mars.
F. VII, 13. Moi me fâcher
contre vous, parce 174
que vous avez peu de persévérance et trop d'envie de revenir! moi ne
pas vous écrire par humeur ! pouvez-vous me croire si injuste? Votre
première lettre montrait de l'inquiétude d'esprit, et je m'en suis
affligé. Si j'ai interrompu ma correspondance, c'est que j'ignorais
absolument où vous étiez. Il n'y a pas d'autre cause. Cependant vous
me poursuivez encore et vous n'acceptez pas mon excuse.
Répondez-moi, mon cher Testa, d'où vous viennent ces façons
superbes? De ce que vous êtes riche, ou de ce que \'Imperator vous
consulte? J'en jure sur ma tête, à vos airs glorieux, vous aimez
mieux être consulté qu'enrichi par César. Mais si l'un et l'autre
vous arrive, qui pourra désormais vous supporter, excepté moi qui
supporte tout? Revenons. Vous ne vous déplaisez point là-bas, et
j'en suis aussi charmé, que j'étais triste du contraire. Je crains
seulement que vous n'y tiriez pas grand fruit de votre science ; car
d'après ce que j'en entends dire, « ce n'est point par le droit,
c'est par le glaive qu'on y soutient ses prétentions.» Or votre
habitude à vous n'est pas de procéder par voie de fait; et vous ne
risquez guère qu'on vous applique les termes de l'édit du préteur,
attendu que l'agression est constatée ; car jamais je ne vous connus
bien querelleur. Cependant il faut que je vous donne un avis sur les
sûretés que vous avez à prendre. Gardez-vous bien des Trévirs. Il y
va aussi de (a tête avec eux, dit-on ; j'aimerais mieux pour vous
que ce fût des Trévirs d'or, de cuivre et d'argent (Triple
Jeu de mois sur les Trévirs habitants de Trêves ; les Trévirs ou
Triumvirs chargés des prisons (capitales) ; et les Trévirs qui
présidaient aux monnaies.). Mais assez debadlnage. Ne me
laissez rien ignorer, je vous prie, de toutes ces choses.
177. - A
TREBATIUS. Rome.
F. VII, 15. Voulez-vous voir
par un seul trait comme on est maussade quand on aime? je vous
savais fâché d'être là-bas, et j'étais triste; vous m'écrivez que
vous vous plaisez là-bas, et je m'afflige encore. Je voyais avec
peine ma recommandation stérile pour votre bonheur, et je suis au
supplice que vous soyez heureux sans moi. Pourtant j'aime mieux mes
regrets que de ne pas vous voir obtenir tout ce que je vous
souhaite. Vous vous êtes lié avec C. Matius, le plus aimable et le
plus savant des hommes : je ne puis vous dire combien j'en suis
joyeux. Faites qu'il vous aime le plus possible. Croyez-moi, il n'y
a, dans toute votre province, rien de meilleur que son amitié. Bonne
santé.
178. — A
TRÉBATIOS. Pomptinum, 8 avril.
F.VII, 18. J'ai reçu d'un seul
coup plusieurs de vos lettres écrites à des dates différentes; elles
m'ont toutes causé un grand plaisir. Je vois que vous vous faites au
service, que vous devenez un homme, et que vous mettez de la tenue
dans vos idées. Vous m'avez bien paru d'abord en manquer un peu.
Mais je vous accusais moins de faiblesse d'âme que d'un excès
d'impatience de nous revoir. Voilà un premier pas de fait. Il faut
continuer. Tenez bon contre les fatigues de la campagne. Vous irez
loin maintenant, croyez-moi. Je renouvellerai mes recommandations
pour vous, mais en temps et lieu. Autant que vous, j'ai à cœur que
notre séparation vous profite le plus possible. Et pour meilleure
sûreté, 175 en voici
l'obligation en grec écrite de ma main. En revanche, je vous demande
des détails sur votre guerre des Gaules. Eu fait d'informations de
ce genre, je me fie surtout aux poltrons. Pour en revenir à vos
lettres, où tout est bien d'ailleurs, j'admire qu'écrivant soi-même
on ait le courage de se recopier tant de fois. Des palimpsestes!
Bon! voilà de l'économie. Mais que contenait donc cette petite page
que vous avez effacée pour récrire dessus? quelque formule de droit
peut-être? car je ne veux pas supposer que vous vous serviez de mes
lettres, et qu'à la place de mon écriture vous mettiez la vôtre.
Cela signifie-t-il que vos affaires n'avancent point, qu'on vous
oublie et qu'on vous laisse même manquer de papier? N'en accusez que
vous : pourquoi emporter votre modestie, au lieu de la laisser chez
nous ? — Je vous recommanderai à Balbus , avant son départ, et cela,
à la romaine. Ne vous étonnez pas d'être quelque temps sans lettres.
Je serai absent tout le mois d'avril. 'Je vous écris de Pomptinum,
où je suis venu chez Métrilius Philémon. J'entends ici le bruit que
fout tous les clients que vous m'avez procurés, car c'est un
remue-ménage universel des grenouilles d'Ulubre, en l'honneur de ma
venue. Bonne santé.— J'ai déchiré la lettre, fort innocente
d'ailleurs, que L. Arruntius m'a remise de votre part. Il ne s*y
trouvait rien qu'on ne pût sans inconvénient lire tout haut en plein
forum. Mais Arruntius m'en a prié de votre part, et vous me le
marquiez vous-même. Soit, mais je m'étonne que vous ne m'ayez point
écrit depuis, quand il y a tant de nouvelles.
179. - A CURION.
Rome.
F. II, 4. Vous n'ignorez pas
qu'il y a plus d'un genre de lettres ; qu'en première ligne, et
c'est ce qui les a fait inventer, les lettres sont la voie
d'information ordinaire entre absents touchant les intérêts
réciproques. Ce n'est pas là sans doute ce que vous attendez de moi.
Ni les correspondants, ni les moyens de communication ne vous
manquent pour vos affaires domestiques, et je n'aurais absolument
rien à vous dire des miennes. Il y a deux autres espèces de
correspondance qui me plaisent également ; l'une familière et
enjouée, l'autre sérieuse et grave. Je ne sais en vérité laquelle
des deux me sied le moins aujourd'hui. Prendrai-je le ton badin?
mais un citoyen peut-il rire au temps où nous sommes? Veut-il y
mettre du sérieux? je ne puis parler à Curion que des affaires
publiques, et il y a encore cette difficulté pour moi que je ne veux
pas écrire ce que je pense. Puisque tout sujet de correspondance
m'est interdit, j'en reviens à mon refrain : aimez, aimez la gloire.
Vous avez ici une ennemie terrible et qui guette votre arrivée :
c'est l'immense idée qu'on a de vous. Mais cette ennemie, voici le
moyen de la vaincre, et vous y réussirez sans peine ; c'est d'être
fermement résolu d'arriver à la perfection dans tout ce qui donne
cette gloire dont votre cœur est épris. Je pourrais m'étendre sur ce
sujet, si je n'étais certain qu'il ne faut pas d'aiguillon à votre
généreuse nature, et je l'effleure en passant, moins pour stimuler
votre ardeur que pour vous prouver ma tendre amitié. Adieu.
176. 180. - A CURION. Rome.
F. II, 5. Je n'ose confier
même au secret d'une lettre les détails de ce qui se passe. Je vous
l'ai déjà dit, en quelque lieu que vous soyez, vous faites route
avec moi sur le même navire ; mais je ne vous en félicite pas moins
de votre absence, soit parce que vos yeux n'ont pas le spectacle de
ce que nous voyons, soit parce que vous avez un théâtre où votre
mérite brille avec éclat aux regards des citoyens et des alliés ; et
je n'en parle pas d'après un bruit incertain et sourd, mais d'après
l'unanime et éclatante voix de l'opinion publique. Toutefois, il y a
une chose dont je ne sais que dire : c'est l'incroyable attente que
vous excitez ici. Dois-je vous en féliciter? dois-je en prendre
l'alarme? Je ne crains pas que vous soyez incapable de répondre à la
haute idée qu'on a de vous; mais, par Hercule, je crains qu'en
arrivant vous ne trouviez plus rien à guérir, tant il est vrai que
tout s'affaisse et s'anéantit ! Sur ce sujet-là même, je ne sais si
je dois m'expliquer par écrit ; j'aime mieux laisser à d'autres le
soin de vous en parler. En attendant, que vous désespériez ou non de
la république, il faut vous occuper d'elle, penser à elle,
travailler pour elle, avec patriotisme et courage, afin qu'en dépit
de tant de misères et des mœurs si corrompues , vous puissiez, du
sein de son abaissement et de ses ruines, la rendre à son antique
splendeur et à la liberté.
181. — A P.
SEXTIUS. Rome.
F. V, 17. Ce n'est ni par
indifférence ni par oubli que je suis resté si longtemps sans vous
écrire. D'abord je n'en avais pas la force dans l'abattement où
m'ont plongé les désastres de la république et .les miens. Ensuite
vos injustes et cruelles disgrâces sont encore venues me paralyser.
Mais enfin l'intervalle dure depuis assez longtemps sans doute;
votre fermeté, votre grandeur d'âme reviennent frapper ma pensée, et
je ne crois pas me montrer inconséquent avec moi-même, en vous
écrivant aujourd'hui. Au commencement de cette trame ourdie par
l'envie en votre absence, lors de l'accusation dont vous devîntes
l'objet, je vous ai défendu, mon cher Sestius; et quand, sous le
coup d'une accusation grave, les périls de votre ami furent devenus
les vôtres, je me suis employé pour vous, pour votre cause, avec
tout le dévouement dont je suis capable. Récemment encore, presqu'à
mon retour, les choses assurément n'étaient plus les mêmes et
n'allaient pas comme si je fusse resté à Rome ; cependant, en aucun
cas, mon assistance ne vous a manqué, et lorsque vers la même époque
le mécontentement causé par la cherté des vivres, l'animosité de vos
ennemis, qui s'en prenait même à vos amis, la corruption de la
magistrature; lorsque toutes ces causes et mille autres non moins
déplorables se furent réunies pour accabler le droit et étouffer la
vérité, alors j'ai mis à la disposition de votre fils mes services,
mes conseils, ma recommandation , mou crédit. Après m'être ainsi
fidèlement et religieusement acquitté de tous les devoirs que
l'amitié impose, il m'en reste un encore à remplir, c'est de vous
rappeler que vous êtes homme, homme de courage ; que comme tel vous
devez vous résigner aux chances communes de l'humanité, et supporter
en sage ce qu'il n'é- 177
était au pouvoir de personne de prévenir ou de détourner; qu'il faut
vous raidir contre la douleur, contre les coups du sort; ne pas
oublier enfin que chez nous, comme dans toutes les villes qui se
gouvernent par elles-mêmes, rien n'est plus commun que de voir les
hommes les plus recommandables froissés par des jugements iniques.
J'ajouterai, et plût aux dieux que.je ne disse pas vrai ! qu'il n'y
a plus rien dans la république qu'un homme de sens puisse voir avec
satisfaction. — J'ai besoin maintenant de vous parler de votre fils,
pour ne pas dérober à sa haute vertu le témoignage qu'elle mérite;
mais je ne vous dirai pas tout ce que je pense. Je craindrais de
renouveler votre douleur et vos regrets. Vous ne pouvez faire mieux
cependant que de, penser sans cesse à ses rares qualités, à sa
tendresse, à son courage, à l'activité de son esprit, et de vous
dire que partout où vous serez, tout cela est à vous et avec vous.
Ce que l'imagination nous retrace, nos yeux le voient en quelque
sorte. Aussi quelle consolation pour vous qu'une vertu, une piété
filiale comme la sienne ; que notre attachement à nous tous qui vous
aimons, qui ne cesserons jamais de vous aimer pour vous et non pour
votre fortune : quelle consolation surtout que cette conscience qui
vous dit que vous n'avez point mérité votre sort, et qui vous
apprend que le sage doit s'affliger de la honte et non des revers,
des fautes personnelles et non de l'injustice d'autrui 1 Quant à
moi, le souvenir toujours présent de notre vieille amitié, la vertu
de votre fils et les égards qu'il me témoigne, vous sont garants des
efforts que je ne cesserai de faire pour adoucir votre sort ou pour
le faire changer. S'il vous plaît de me donner quelques ordres,
soyez sûr que je ne les aurai pas reçus en vain.
182. — A
TRÉBATIUS. Rome.
F. VII, 14. Sans Chrysippus
Vettius, l'affranchi de l'architecte Cyrus, qui vient de m'apporter
vos compliments, je croirais que vous m'avez entièrement oublié.
Vous êtes donc devenu un bien grand personnage, que vous ne pouvez
plus écrire vous-même, surtout quand l'homme qui part est presque de
ma maison. Si vous ne savez plus écrire, heureux vos clients 1 Ils
perdront un peu moins souvent leurs procès. Si vous m'oubliez, gare
que je ne tombe sur votre dos, avant que mon souvenir ne soit tout à
fait effacé chez vous. Enfin si c'est la peur d'une campagne qui
vous utiles forces, trouvez quelque défaite comme pour l'expédition
de Bretagne. Quoi qu'il en soit, j'ai appris avec bien du plaisir
par Chrysippe, l'intimité de vos rapports avec César. Mais j'aurais
mieux aimé, et vous conviendrez qu'il eût été plus juste que je
fusse constamment informé par vousdecequi vous touche. Certes, vous
n'y auriez pas manqué, si vous étiez aussi fort sur les droits de
l'amitié que sur le droit civil. Je badine, vous le voyez, à votre
exemple, et un peu aussi à ma manière. Je ne vous en aime pas moins.
Je veux que vous m'aimiez de même; et vous m'aimez, je m'en flatte.
183. — A. C.
CURION. Rome.
F II, 6. On ne parle pas encore
de votre arrivée en Italie, au moment où je vous écris ce mot que
vous remettra Sextus Villius, ami de mon cher Milon. On croit que
vous arriverez bientôt; on sait même positivement que vous avez
quitté l'Asie pour vous rendre en droite ligne à
178 Rome. Mais ce que j'ai
à vous dire est si important, et j'ai tant de hâte de savoir cette
lettre entre vos mains, que j'ai passé sur ce que mon empressement
peut avoir d'indiscret. Si je mesurais mes droits sur vous, mon cher
Curion, à votre reconnaissance plutôt qu'à leur véritable valeur, je
serais moins hardi à vous solliciter. En effet, il y a je ne sais
quoi qui répugne à la délicatesse à réclamer un service de celui
qu'on croit soi-même avoir obligé. La prière dans ce cas a l'air
d'une exigence. Ce n'est plus une grâce qu'on demande, c'est une
dette qu'on se fait payer. Heureusement ce que je vous dois est
connu de l'univers entier, et les obligations que je vous ai tirent
de l'étrange fatalité de mes épreuves un éclat immense. Heureusement
encore c'est le propre des caractères généreux d'aimer à se sentir
attachés par le plus de liens possibles. Aussi ne me fais-je aucun
scrupule de vous demander une chose qui est immense pour moi, une
chose qui m'est tout à fait indispensable. Je ne recule point devant
l'étendue des obligations que je contracte. Je sens que mon cœur a
place pour une gratitude sans borne et qu'il peut suffire à
l'immensité de sa dette.-Je n'ai plus qu'une pensée, et j'y rapporte
tout ce que j'ai d'activité, de zèle, d'adresse, de puissance, mon
âme tout entière enfin; c'est le consulat de Milon. Chez moi, ce
n'est pas seulement le sentiment d'un devoir, c'est une religion.
Jamais homme n'eut plus à cœur l'intérêt de sa fortune ou sa propre
conservation, que moi l'honneur d'un ami à qui j'ai attaché toutes
mes espérances. Je sais tout ce que peut votre concours; et si vous
nous l'accordiez, je serais au comble de mes vœux. Déjà nous avons
pour nous les honnêtes gens qu'il s'est attachés, vous le comprenez
bien sans doute, par son zèle pour moi pendant son tribunal ; le
vulgaire et la foule dont il s'est assuré la faveur par sa
magnificence dans les jeux et la grandeur de ses manières; la
jeunesse et les gens en crédit dans les élections qu'il a gagnés
passa bonne grâce et son obligeance sans égale; enfin il faut tenir
compte démon propre suffrage, qui n'a pas grand poids peut-être,
mais qu'on prise pourtant, et qui doit peut-être à la justice de son
principe une sorte de faveur toute particulière. Poussés par tant de
vents divers, nous avons besoin d'un pilote assez habile pour
gouverner leur action et nous faire arriver au port. Or si nous
avions à choisir, il n'y en a pas un entre tous que nous voulussions
vous préférer. Si donc vous pouvez juger de mes sentiments de
gratitude, de mon honnêteté, par le zèle même dont je me sens si
profondément animé pour Milon ; si, enfin, vous ne me croyez pas
indigne de vos bienfaits; je vous demande de venir en aide à ma
peine, et de me seconder dans une occasion où il y va démon honneur:
je pourrais presque dire, où il y va de mon existence. En ce qui
concerne T. Annius (Milon) personnellement, je me bornerai à vous
garantir que, si vous prenez en main sa candidature, vous ne
trouverez personne de plus noble , de plus ferme et de plus dévoué
dans sa reconnaissance. Quant à moi, je recevrais par vous de son
triomphe un tel surcroît de lustre et d'éclat, que je croirais vous
devoir autant pour l'honneur que je vous dois déjà pour la vie. —
J'en 179 dirais
davantage, si vous ne voyiez pas sur ce peu de mots quelle est la
grandeur de ma tâche, et tout ce que j'ai d'efforts à faire, de
combats à soutenir. Je vous en supplie, que les intérêts de Milon,
que sa cause deviennent désormais les vôtres : c'est moi, moi que je
vous recommande et que je vous livre. Car sachez bien que le succès
me placerait envers vous dans cette position que je me regarderais
comme votre obligé presque autant que je le suis à Milon lui-même.
Je tiens moins au bienfait de la vie qu'il a tant contribué à me
conserver, qu'au plaisir de lui en témoigner ma reconnaissance, et
c'est de vous seul que tout dépend.
AN DE R. 702. — AV. J. C.
52. — DE C. 55.
Cn. Pompée et Métellus,
consuls.
184. — A T.
FADIUS. Rome.
F. V, 18. Je veux vous consoler
et j'aurais besoin moi-même de consolation, car depuis longtemps
rien ne m'avait été aussi pénible que le contrecoup de vos
tribulations. Je ne laisserai pas pourtant de vous demander, de vous
supplier par toute l'amitié que je vous porte, de montrer de
l'énergie et d'agir en homme. Songez à la condition commune de
l'humanité et aux malheurs des temps. Vous devez à votre vertu plus
que ne vous a enlevé la fortune. Vous avez acquis ce qu'il est donné
à bien peu d'hommes nouveaux d'acquérir, et vous ne perdrez que ce
qu'ont souvent perdu les plus illustres citoyens. Avec les lois, les
magistrats et la république d'aujourd'hui, il faut s'estimer heureux
d'en être quitte à ce prix. — Vous avez une fortune, des enfants,
des amis, omme moi et bien d'autres, qui vous sont attachés par une
longue habitude et par une tendre affection. Vous pourrez, et c'est
là un avantage immense, vous pourrez vivre au milieu de nous et des
vôtres. Enfin, de tant de jugements rendus, l'opinion n'en réprouve
qu'un seul, celui qui vous condamne ; et ce jugement n'a tenu qu'à
une voix peureuse, dominée par une puissante influence. Voilà bien
des motifs pour adoucir l'amertume de votre disgrâce. Quant à mes
sentiments pour vous et vos enfants, ils seront toujours tels qu'ils
doivent être et que vous pouvez les désirer.
185. A
APPIUS PULCHER IMPERATOR. Rome.
F. III, 1. La république, si
elle pouvait parler ne vous expliquerait point sa situation mieux
que ne fera votre affranchi Phanias, tant il y a chez lui de tact,
et, ce qui n'est pas un moindre avantage, d'esprit d'observation.
Vous saurez tout de sa bouche. Cette voie d'information est la plus
courte et la meilleure, sous tous les rapports. Quant à mon
affection pour vous, Phanias pourrait bien vous en parler aussi,
mais c'est un soin que je me réserve. Oui, je vous aime pour le
charme de votre esprit, pour la prévenance et la grâce de vos
manières ; enfin pour le prix que vous attachez, comme je le vois
dans vos lettres, comme je l'apprends de toutes parts, au peu que
j'ai pu faire pour vous; Les droits de l'amitié, dans notre
séparation, sont restés longtemps en souffrance. Mais je ferai tant
par le nombre et par la valeur des services que je veux vous rendre,
que tout cet ar- 180
riéré s'acquittera. En cela, je ne croirai pas, quoi que vous en
disiez, agir malgré Minerve; car si ma Pallas retourne des
mains des vôtres dans les miennes, ce n'est plus Pallas, mais Appias
que je veux la nommer. — Je ne connaissais pas votre affranchi Cilix;
mais son langage, en me remettant votre obligeante et affectueuse
lettre, s'est trouvé merveilleusement d'accord avec les sentiments
que vous y exprimez, .l'éprouvais du bonheur à l'entendre raconter
ce que journellement vous avez fait, vous avez dit à mon intention.
Enfin, voulez-vous le savoir? en deux jours, il a fait ma conquête,
sans préjudice toutefois de Phanias dont j'appelle le retour de tous
mes vœux. Lorsqu'il reviendra à Rome, bientôt j'espère, ne manquez
pas de lui donner tous vos ordres pour moi. — Je vous recommande
instamment le jurisconsulte L. Valérius, et même je vous le
recommande jurisconsulte ou non. Car je prétends que ma
recommandation ait plus d'effet que ses consultations. Je l'aime
beaucoup. C'est un des habitués et des intimes de ma maison. Il vous
exprime déjà toute sa reconnaissance. Mais il m'écrit aussi qu'il
compte grandement sur le pouvoir d'une lettre de moi. Faites, je
vous prie, qu'il n'ait pas eu cette confiance en vain. Adieu.
186. — A T.
TITIUS, Lieutenant. Rome.
F. XIII, 75. Quoique je
ne doute point de l'effet de mes premières recommandations auprès de
vous, je cède aux instances de C. Avianus Flaccus, l'un de mes plus
intimes amis, a qui je désire, et véritablement à qui je dois ne
rien refuser. Je vous ai de vive voix exprimé tout l'intérêt que je
lui porte, et vous m'avez répondu de la manière la plus obligeante.
Depuis, je vous ai écrit; mais il croit important que je le rappelle
souvent à votre souvenir. Vous m'excuserez donc si dans cette
occasion ma déférence pour lui ma donne l'air de douter de vos
bonnes dispositions. C'est toujours la même demande que j'ai à vous
faire : accordez à Avianus des facilités de lieu et de temps pour le
transport des blés : je lui avais fait obtenir trois ans lorsque
Pompée était à la tête des subsistances. Je serais charmé qu'Avianus,
qui sait mon attachement pour lui, pût aussi reconnaître dans vos
procédés quel est votre attachement pour moi. Je vous en aurais une
grande reconnaissance.
187. — A M.
MARIUS. Rome, décembre.
F. VII, 2. J'accomplirai
fidèlement vos prescriptions. Mais vous êtes habile en vérité de
choisir pour mandataire un homme qui a précisément intérêt à ce
qu'on vende le plus cher possible. Au moins est-ce de la prévoyance
que de m'avoir donné votre mot. Si vous m'aviez laissé pleins
pouvoirs, par pure amitié pour vous, j'aurais arrangé l'affaire avec
les cohéritiers. Maintenant que je sais votre prix, j'aposterai un
enchérisseur plutôt que de laisser vendre au-dessous. Mais trêve de
plaisanteries. Je m'occuperai sérieusement de cette affaire. — La
condamnation de Bursa vous a réjoui, je n'en doute pas. Cependant
vous êtes bien réservé dans vos compliments; c'est un homme si
abject, direz-vous, que ma joie ne peut pas être bien grande. Je
vous assure moi que je me félicite de ce jugement plus que de la
mort de mon ennemi (Clodius). D'abord justice vaut mieux que voie
181 de fait ; et
parlez-moi d'un succès qui soit glorieux pour vos amis, sans
entraîner leur ruine. Enfin ce qui me charme par-dessus tout, c'est
la sympathie des gens de bien, dans cette incroyable lutte où se
mêlait un homme aussi illustre et aussi puissant (Pompée.) — De
plus, je vous dirai, dussiez-vous ne pas me croire, que je déteste
ce misérable plus encore que je ne détestais Clodius. J'avais
attaqué celui-ci ; celui-là je l'avais défendu. Le premier, pour
avoir ma tête, mettait en péril toute la république; il y avait du
moins de la grandeur dans ses projets. D'ailleurs il n'agissait pas
d'instinct. Il était poussé par des gens qui se sentaient perdus,
s'ils ne me perdaient ; au lieu que ce petit singe m'avait pris
spontanément pour point de mire. Si bien que mes ennemis s'étaient
flattés de l'avoir toujours sous main pour le lancer sur moi. Sautez
donc de joie, mon cher Marius, je vous l'ordonne ; c'est un grand
point de gagné. Il a fallu chez les juges un courage comme on n'en a
jamais vu, pour oser prononcer une condamnation en dépit de la
puissance même qui les avait choisis; et ils ne l'eussent jamais
fait, s'ils ne s'étaient associés à mes ressentiments, comme à des
injures personnelles. — Nous avons ici, pour nous récréer, tant de
causes célèbres et tant de nouvelles lois que, dans l'impatience de
vous voir, nous faisons tous les jours des vœux pour qu'il n'y ait
point d'intercalation cette année.
ANS DE R. 703. — AV. J. C.
51. — A. DE C. 56.
Serv. Sulpicius Rufus, et
M. Claudius Marcellus, consuls.
188. — A APPIUS
PULCHER imperator. Rome.
F. lll, 2. Quand je me trouve,
contre ma volonté et mon attente, forcé d'aller prendre la
gouvernement de votre province (la Cilicie), au milieu des soucis et
des inquiétudes qui m'assiègent, j'ai du moins une consolation;
c'est de penser que jamais vous ne pouviez avoir un successeur qui
vous aimât davantage, et que moi, je ne trouverais chez personne
autant de désir que chez vous, de me remettre le pouvoir dégagé de
tout embarras. Si vous comptez également sur moi, vous !e pouvez en
toute assurance. De mon côté, je vous en conjure, au nom de l'amitié
qui nous unit, et par cette générosité qui vous est naturelle, je
vous conjure d'agir désormais, autant que vous le pourrez, (et vous
pouvez beaucoup), dans mes intérêts. — C'est un décret du sénat,
vous le savez, qui me confie la province. Si je la reçois de vos
mains libre de toute difficulté, je gagnerai avec moins de peine le
terme de mon mandat. Vous êtes seul juge de ce qu'il faut faire : je
vous supplie seulement de faire tout ce qui me sera utile.
J'insisterais davantage , si votre caractère ne repoussait les longs
discours, et si notre amitié ne devait pas s'en offenser. D'ailleurs
les mots sont superflus là où les choses parlent d'elles-mêmes.
Croyez que vous n'aurez jamais qu'à vous réjouir et à vous féliciter
d'avoir écouté ma prière. Adieu.
189. — A ATTICUS.
En chemin. Mai.
A. V, 1. Oui, j'ai bien vu
votre cœur au moment de mon départ, et j'ai senti le mien, je vous
l'atteste. C'est à vous de prévenir de nouvelles causes
d'éloignement, et de faire en sorte que nous ne soyons pas privés
plus d'une année l'un de l'autre. — Je vous remercie de vos soins
dans 182 mon affaire
avec Annius Saturninus. Si on l'exige, veuillez, autant que vous
serez à Rome, fournir des cautions. Quant à la vente des terres de
Memmius et d'Attilius, c'est une affaire qui de sa nature ne
comporte qu'une simple garantie. Vous avez agi selon mes vœux avec
Appius. J'approuve surtout la parole que vous lui avez donnée pour
huit cent mille sesterces. Je veux les payer, dusse-je emprunter
sans attendre qu'on me paye moi-même. — J'arrive maintenant à ce que
vous avez écrit en marge sur votre sœur. Je vous dirai ce qui s'est
passé à mon arrivée à Arpinum. Mon frère vint me voir, nous parlâmes
de vous longuement; la conversation tomba naturellement sur les
entretiens que nous avions eus à Tusculum, et dont votre sœur était
l'objet. J'ai admiré l'aménité et la modération de mon frère envers
sa femme : on ne lui aurait supposé aucun mécontentement. Voilà pour
le premier jour : le lendemain nous quittâmes Arpinum. Quintus passa
un jour à Arcanum à cause de la fête; moi j'allai à Aquiuum; mais
nous dînâmes ensemble à Arcanum. Vous connaissez cette propriété. En
y arrivant, mon frère dit du ton le plus doux « : Pomponia, veuillez
inviter les «dames, moi je me chargerai des hommes. » Bien de plus
inoffensif à mon avis et d'intention et de ton et d'expression.
Devant nous votre sœur répondit : « Moi ! je ne suis qu'étrangère
ici. » Son humeur venait probablement de l'arrivée de Statius que
nous avions envoyé en avant pour faire préparer le dîner. « Voilà,
dit mon frère, un « échantillon de ce que je supporte chaque jour. »
— Qu'est-ce que cela? direz-vous, quelque chose de très-grave. Mon
émotion devint extrême à une réponse aussi aigre et aussi déplacée.
Le ton et la physionomie étaient à l'avenant. Néanmoins je souffris
sans mot dire. Nous nous sommes mis à table sans elle. Mon frère lui
fit passer des plats ; elle refusa. Que vous dirai-je de plus?
Jamais je ne vis mon frère plus prévenant ni sa femme plus
intraitable. J'omets d'autres détails qui me firent plus mal au cœur
à moi qu'à Quintus lui-même. J'allai coucher à Aquinum, où mon frère
qui était resté à Arcanum vint me rejoindre le lendemain matin. Il
m'apprit que sa femme n'avait pas voulu partager son lit, et qu'à
son départ, elle était dans l'humeur où je l'avais laissée la
veille. Me demandez-vous ce que je pense? En vérité , dussiez-vous
le lui redire, c'est votre sœur cette fois qui a tort. Je m'étends
sur ces détails, un peu plus qu'il ne faut peut-être; mais c'est
pour vous convaincre que vous aussi vous avez à jouer le rôle de
censeur et de redresseur de torts. — Il me reste à vous prier de
terminer toutes mes affaires avant votre départ et de me tenir au
courant. Pressez Pomptinius ; et quand vous serez parti, mandez-
le-moi. J'ai quitté à Minturne Aulus Torquatus que j'aime beaucoup,
et qui est un excellent citoyen. Lorsque vous le verrez, jetez, je
vous prie, au milieu de la conversation , la mention que je fais ici
de lui.
190-— A ATTICUS.
Pompéi, 10 mai.
A. V, 2. Je vous écris le 6 des
ides de mai, au moment de partir de Pompéi, pour aller coucher le
soir chez Pontius, à Trébule ; je compte ensuite faire des journées
pleines sans m'arrêter. — Pendant que j'étais à Cumes, Hortensius
est venu me voir et m'a laissé enchanté de lui. Il
183 s'est mis de lui-même
à ma disposition, et j'en ai profité. Surtout, je lui ai recommandé
de ne me laisser à aucun prix proroger dans mon gouvernement.
Parlez-lui dans le même sens, je vous prie, et témoignez-lui combien
je suis touché de sa démarche et de son obligeance sur ce point et
sur tout le reste. Je me suis assuré aussi de la bonne volonté de
Furnius, dont l'élection comme tribun du peuple me paraît
infaillible pour l'année prochaine. — C'était vraiment une petite
Rome que Cumes ces jours derniers, tant l'affluence y était grande !
Notre Rufius, voyant sans doute Vestorius épier le moment de le
trouver chez moi, l'a bien attrapé, je vous le jure. Il n'y a pas
mis les pieds. Est-il possible? quoi! Hortensius est venu, si mal
portant, de si loin , Hortensius et tant d'autres, et Rufius n'y a
point paru? point paru, vous dis-je. — Ainsi vous êtes parti sans le
voir? — Sans le voir; c'eût été difficile. En traversant le marché
de Pouzzol, je l'aperçus qui paraissait fort affairé; je le saluai.
Une autre fois encore il me rencontra comme il sortait de sa villa;
il me demanda ce que je souhaitais. Bonne santé pour vous, lui
dis-je. Est-ce là de l'ingratitude? eh non ! il faut lui savoir gré
au contraire d'épargner aux gens la peine de le recevoir. — Je
reviens à ce qui me touche : soyez sûr que la seule chose qui me
fasse supporter mon éloignement, c'est l'espoir de n'en pas voir
prolonger l'immense ennui au delà d'une année. Là-dessus bien des
gens ne veulent pas m'en croire. Ils jugent de moi par les autres.
Vous qui savez à quoi vous en tenir, ne négligez rien, quand le
moment sera venu. — A votre retour d'Epire, soyez assez bon pour me
mander ce que vous savez des affaires publiques et ce que vous
prévoyez. Rien n'a transpiré ici sur la manière dont César aura pris
le dernier projet de décret du sénat. Le bruit court que l'ordre est
arrivé à toutes les villes au delà du Pô d'élire quatre magistrats;
si cela est, je crains de grands troubles. Je saurai bientôt quelque
chose par Pompée.
191. — A ATTICUS.
Trébule, 11 mai.
A. V, 3. Me voici à Trébule chez
Pontius, aujourd'hui 6 des ides de mai ; j'y ai trouvé deux lettres
de vous de trois jours de date, c'est-à-dire du jour où je vous
écrivis moi-même par Philotime en quittant Pompéi. Je n'ai
véritablement rien à vous mander ; c'est à vous à me mettre au
courant ; car je vois dans les villes beaucoup d'inquiétude, sans
fondement, je crois, mais dont je voudrais savoir ce que vous pensez
vousmême. — J'ignore à quelle lettre vous me demandez réponse. Je
n'en ai pas reçu d'autres de vous que les deux de Trébule ; la
première, datée des nones de mai, contenait l'édit de Licinius ; la
seconde répondait à mr lettre de Minturne. Estce qu'il y en aurait
une troisième plus importante qui aurait fait fausse route et à
laquelle je devrais réponse? j'en tremble. — Oui, je vous mettrai
dans les bonnes grâces de Lenlulus ; Dionysius a gagné mon cœur, et
je me loue beaucoup des services de votre Nicanor. J'ai épuisé ce
que j'avais à dire et voici le jour ; je coucherai aujourd'hui à
Bénévent. On sera satisfait partout, je vous assure, de ma
modération et de mon activité. — Le 5 des ides de mai, à Trébule,
chez Pontius.
184 192. —A ATTICUS. Bénévent, mai.
A. V, 4. Je suis arrivé à
Bénévent le 5 des ides de mai; j'y ai trouvé la lettre dont vous me
parliez dans une précédente, à laquelle je répondis, à Trébule, ce
jour-là môme, par Pontius. J'ai reçu de plus deux autres lettres de
vous à Bénévent; l'une m'a été remise au lever du jour par
Funisulanus, et l'autre par Tullius, mon secrétaire. Mille
remercîments de vos soins pour la première et la plus importante de
mes recommandations. Mais voici votre départ, et mes espérances
diminuent; on insiste, et j'incline à accepter, non que le parti me
convienne absolument, mais faute de mieux. — Quant à l'autre
personne qui vous paraîtrait, dites-vous, disposée à se mettre sur
les rangs, ma fille en voudra-t-elle? j'en doute, et c'est, comme
vous le dites, ce qu'on ne peut guère savoir. Moi personnellement,
je ne suis pas difficile. Mais vous serez absent et je ne suis pas
là pour régler tout. Ayez égard à cette circonstance. Car s'il n'y
avait que l'un de nous deux absent, n'importe lequel, Servilia s'en
mêlant, il y aurait probabilité de conclure avec Servius, tandis
qu'aujourd' hui, en supposant que l'affaire convînt, je ne vois pas
par quel moyen on pourrait la traiter. — J'arrive ii la lettre que
Tullius m'a apportée. Vous avez fait merveille auprès du Marcellus.
Écrivez-moi si le décret est rendu; et, s'il ne l'est pas encore,
insistez pour eu finir; il faut bien de toute nécessité qu'on règle
cet article, pour moi, comme pour Bibulus. Mais je ne doute pas que
le sénatus-consulte n'ait été vite expédié, puisqu'on a pu se passer
du peuple. Vous avez fort bien fait ma petite commission au sujet de
Torquatus. Pour Mason et Ligur, voyons-les venir. Quant aux plaintes
de Chérippus,oh! les charges! encore un point où vous refusez de
vous prononcer. Faut-il donc que je m'en casse la tête? Oui, il le
faut, de peur qu'au sénat quelqu'un ne vienne à dire aux voix' ou
l'appel ! Pour le reste mais c'est heureux cependant qu'il ait parlé
à Scrofa. Je suis de votre avis sur Pomptinius, mais s'il arrive à
Brindes avant les kalendes de juin, il est inutile de presser tant
Annius et Tullius. J'adopte volontiers les observations de Sicinius,
pourvu que st-s amendements ne fassent point de tort à mes amis. Il
y faudra réfléchir, mais j'adopte le principe. Je vous dirai la
route que je compte suivre. Vous saurez aussi la résolution de
Pompée sur les cinq préfets, aussitôt qu'il m'en aura lui-même fait
part. Je ratifie la promesse que vous avez faite à Appius de lui
payer huit cents sesterces ; profitez du séjour de Philotime,
arrêtez les comptes, voyez le chiffre; et, pour demander plus encore
à votre amitié, terminez tout avant votre départ. Vous me
soulageriez d'un grand poids. — Je crois avoir répondu à tout : ah !
j'allais oublier un article, le papier qui vous a manqué,
c'est-à-dire le vol que vous m'avez fait. Si vous aviez été moins
gêné, votre lettre n'aurait-elle pas été plus longue? Eh. bien,
prenez sur mon compte deux cents sesterces. Mais ne voilà-t-il pas
que mes lignes serrées montrent chez moi le même esprit d'économie;
et que je n'ai plus de place pour les nouvelles et les on dit.
Mandez-moi ce que vous saurez de César; et plus tard, par Pomptinius,
des détails sur tout ce qui se passe, je vous prie.
193. - A ATTICUS.
Venouse, mai.
A. V, 5. Je suis à court,
absolument. Mes recommandations , je vous les ai faites ; de nou-
185 elles, il n'y en a
point. Quant aux plaisanteries, j'ai l'esprit à bien autre chose.
Sachez seulement que c'est ce matin, jour des ides de mai, partant
de Venouse, que je vous écris. Je crois que vous avez séance au
sénat aujourd'hui. Cela fournira matière à vos lettres. Les faits et
les on dit, je veux tout savoir. — Je recevrai votre courrier à
Brindes, où j'ai résolu d'attendre Pomptinius jusqu'au jour par vous
indiqué. Quand j'aurai vu Pompée à Tarente, je vous ferai part de
nos entretiens sur la république. Cependant je désire savoir
l'époque jusqu'à laquelle je puis vous écrire, c'est-à-dire combien
de temps encore vous resterez à Rome; j'écrirai jusqu'à votre
départ, pas au delà. Avant de partir, terminez, je vous prie, pour
les huit cent vingt mille sesterces ; mettez cette affaire au nombre
des plus pressées et des plus importantes pour moi. Vous m'avez le
premier poussé dans cette voie, il faut m'y soutenir jusqu'au bout.
194. — A ATTICUS.
Tarente, mai.
A. V, 6. Me voici à Tarente
depuis le 15 des kalendes de juin. En attendant Pomptinius, j'ai
jugé à propos de passer le temps avec Pompée, à qui je crois avoir
fait plaisir ; il m'a demandé de le voir tous les jours, et je ne me
suis pas fait prier. J'attends de lui bien des choses intéressantes
sur la république : et en même temps de bons conseils pour mes
nouvelles fonctions. — Dans l'incertitude où je suis de votre séjour
à Rome ou de votre départ, j'abrège dès à présent ma correspondance
; toutefois tant que je ne sais rien positivement, je continue de
vous écrire plutôt que de laisser partir un courrier sans lettre.
Aujourd'hui je n'ai rien, pas môme une anecdote à vous raconter.
Vous avez mes instructions, et vous ne manquerez pas de pourvoir à
tout, comme vous me l'avez promis. Quand j'aurai du nouveau, je vous
l'écrirai. Il y a cependant une affaire dont je ne cesserai de vous
parler, tant que je vous croirai à Rome ; c'est la créance de César.
Libérez-moi, je vous en conjure, avant de partir. J'attends vos
lettres avec impatience , surtout pour savoir l'époque de votre
départ.
195. — A ATTICUS.
Tarente, 20 mai.
A. V, 7. Chaque fois que je
vous écris, c'est-àdire, chaque jour, mes lettres deviennent plus
courtes; c'est que chaque fois que je vous écris, je me figure un
peu plus que vous êtes parti pour l'Épire. Vous saurez cependant que
votre recommandation n'a pas été oubliée. J'ai parlé à Pompée de vos
préfets; cinq seront nommés, le même nombre qu'auparavant, mais ils
n'auront ni le droit de rendre la justice ni l'exemption du service
militaire : c'est la condition de Pompée. J'ai 'passé trois jours
chez lui et avec lui. Je pars pour Brindes aujourd'hui 13 des
kalendes de juin. Je l'ai quitté plein de patriotisme et où ne peut
mieux disposé à faire tête aux dangers qui nous menacent. Je soupire
après vos lettres. J'ai besoin de savoir où vous êtes et ce que vous
faites.
196. — A APPIUS
PULCHER. Brindes, mai.
F. III, 3. En arrivant à
Brindes le 11 des kalendes de juin, j'ai trouvé Q. Fabius, votre
lieutenant, porteur de vos ordres. Il m'apprit que le sénat
186 tout entier, sans même
attendre une provocation de ma part, à moi que l'affaire concerne,
avait, de son propre mouvement, reconnu la nécessité d'augmenter nos
forces dans la province; l'opinion qui prévalait généralement était
de recourir aune levée en Italie pour accroître l'effectif de mes
légions et de celles de Bibulus. Le consul Sulpicius déclara qu'il
n'y consentirait jamais. Je me récriai, mais l'unanimité du sénat
désirait si vivement mon départ immédiat, qu'il me fallut obéir, et
je partis. Je viens en ce moment vous renouveler les prières que je
vous ai adressées dans la lettre dont j'ai chargé vos messagers à
Rome. Faites, je vous en supplie, au nom de cette communauté de
rapports et de sentiments qui existe entre nous, faites que
j'obtienne de vos soins habiles et dévoués, tout ce qu'un gouverneur
qui se retire peut faire en faveur d'un ami qui lui succède, afin de
montrer à tous et que je ne pouvais rencontrer un prédécesseur plus
bienveillant, et que vous ne pouviez, ,vous, remettre, votre
province à un successeur que vous aimiez davantage. — J'avais
compris par les lettres dont vous m'avez envoyé copie et dont j'ai,
par vos ordres, donné lecture au sénat, que vous aviez congédié une
partie de vos troupes. Mais Fabius m'a expliqué que c'étai
tseulement votre intention, et que, lorsqu'il vous a quitté, les
rangs étaient encore au grand complet. S'il en est ainsi,
obligez-moi d'affaiblir le moins possible les forces déjà si
insuffisantes de la province. Vous avez reçu, je le suppose, les
décrets du sénat à ce sujet Dans ma profonde déférence pour vous, je
ratifie d'avance tout ce que vous ferez. Mais je suis persuadé que
vous ne ferez rien qui ne soit parfaitement dans mon intérêt.
J'attends à Brindes C. Pomprinius mon lieutenant, j'espère qu'il
arrivera avant les kalendes de juin, et au premier vent favorable,
nous nous embarquerons.
197. DE CÉLIUS
A CICÉRON. Rome, mai.
F. VIII, 1. Je vous avais
promis en vous quittant de vous tenir au courant de toutes les
nouvelles de Rome; aussi ai-je donné ce soin à une personne si bien
à la piste de tout, que je crains pour vous l'excès de sa minutieuse
exactitude. Ce n'est pas que je ne connaisse votre goût pour les
détails et que je ne sache quel intérêt donne l'absence aux moindres
particularités. Je ne veux pas toutefois vous laisser croire que
c'est par fierté que je renvoie à un autre le soin de remplir ma
promesse. Non, tout accablé d'affaires que je suis, et paresseux
pour écrire comme vous me connaissez, j'aurais cependant été charmé
d'avoir à travailler pour vous. Mais le volume que je vous envoie
est si gros que vous me pardonnerez facilement, je pense. Quels
loisirs suffiraient, je ne dis pas pour écrire tant de faits, mais
même pour en prendre note? Sénatus-consultes, édits, anecdotes,
bruits divers, tout y est. Si l'échantillon n'est pas de votre goût,
dites-le-moi ; il serait bien inutile de me mettre en frais pour
vous ennuyer. — Tout événement politique, dont l'exposé, les traits
caractéristiques, l'Influence sur l'opinion, les conséquences enfin
passeraient la portée de ces écrivains de relais, vous sera
fidèlement rapporté par moi-même. Mais il n'y a rien en ce moment
qui excite l'attention. On avait fait grand bruit à Cumes
d'assemblées tenues dans les colonies au delà du Pô. Je n'ai pas
187 trouvé trace de ces
bruits à Rome, à mon arrivée. Marcellus n'a pas encore proposé de
mutation dans le gouvernement des Gaules ; son intention , que je
sais de lui-même, est d'attendre les kalendes de juin, et,
conséquemment l'opinion publique ne s'en préoccupe pas plus que
quand vous étiez à Rome avec noué. — Avez-vous vu Pompée en route,
comme c'était votre dessein? comment l'avez-vous trouvé? quel
langage vous a-t-il tenu? Et qu'a-t-il laissé voir du fonds de son
âme? car c'est son habitude de parler d'une façon et de penser de
l'autre. Mais il n'a pas assez de tête pour ne point se laisser
pénétrer. — Quant à César, on dit de lui bien des choses, non pas de
belles choses. Mais ce ne sont encore que des chuchoteries. L'un
prétend qu'il a perdu sa cavalerie; ce que je ne suis pas éloigné de
croire ; l'autre que la septième légion a été battue et qu'il est de
sa personne cerné par les Bellovaques (habitants de Beauvais,) et
coupé du reste de ses troupes. La vérité est qu'il n'y a rien de
positif; et même on n'ose pas donner en public ces nouvelles
hasardées ; on se les communique en secret dans un cercle que vous
connaissez bien. Domitius n'en parle que le doigt sur la bouche. Les
nouvellistes des Rostres, que le ciel confonde 1 ont débité que vous
aviez péri le 11 des kalendes de juin ; et voilà qu'à la ville, au
forum, partout, le bruit court que vous aviez été tué sur la route
par Q. Pompée. Moi qui savais Q. Pompée à Rauli ramant sur les
galères et mourant de faim, à m'en faire pitié à moi-même, je n'ai
pas été fort ému de ce conte, et je vous ai souhaité d'être quitte à
ce prix de tous les maux dont vous pourriez être menacé. Votre
Plancus est à Ravenne. César lui a fait des largesses considérables
, et il n'en est ni plus heureux ni plus riche. Votre traité de la
République est en grande faveur partout.
198. — A ATTICUS.
Brindes, juin.
A. V, 8. Je suis retenu à
Brindes depuis douze jours, d'abord par une indisposition dont je me
suis débarrassé promptement, parce qu'il ne s'y est pas mêlé de
lièvre, et puis, par le désir de voir Pomptinius dont je n'ai pas
même entendu parler. J'attends d'heure en heure le moment du départ.
— Êtes-vous à Rome? j'en doute; mais si vous y êtes, voici ce que je
vous recommande instamment : ma correspondance de Rome m'apprend que
Milon me fait dans ses lettres un grief d'avoir permis à Philotime
d'entrer en participation dans l'achat de ses biens. En cela je n'ai
agi que de l'avis de Duronius que je regarde comme l'un des hommes
les plus dévoués à Milon, et qui a justifié tout à fait à mes yeux
l'opinion que vous en avez vous-même. Son plan et le mien étaient
d'abord de nous rendre maîtres de l'affaire; d'empêcher qu'elle ne
tombât aux mains de quelque étranger avide auquel Milon ne pourrait
rien soustraire du grand nombre d'esclaves qu'il a avec lui.
Ensuite, nous voulions, et en cela nous ne faisions que suivre un
vœu de Milon lui-même, assurer la dot de Fausta sa femme ; notre
désir enfin était, autant que possible, de sauver pour lui quelques
débris. Il faut que vous tâchiez de savoir ce qu'au fond il y a de
vrai dans ce qu'on me mande ; car en écrivant on grossit souvent les
choses. Si en effet Milon se plaint dans ses lettres, et si tel est
le désir de Fausta, il faut que Philo-
158 time, ainsi qu'il a
clé expressément convenu entre nous à mon départ, abandonne une
affaire où il ne peut rester malgré Milon. Aussi bien je n'y ai pas
grand intérêt. Si la chose est moins grave, voyez ce qu'il faut
faire. Ayez un entretien avec Duronius. J'écris aussi à Camille et à
Lamia. J'ai dû le faire, ne sachant si vous êtes à Rome. En résumé
voici mon mot : Agissez dans le sens de mon honneur, de ma
réputation et de mes intérêts.
199. — A APPIUS
PULCHER. Brindes, juin.
F. III, 4. J'ai reçu votre
lettre à Brindes la veille des nones de juin. Vous m'annoncez
l'arrivée de L Clodius porteur d'instructions verbales de vous pour
moi. Je l'attends avec impatience. Vous connaissez mon affection et
mon dévouement-pour vous. Vous en avez déjà reçu bien des gages. Je
m'appliquerai surtout à vous prouver combien j'ai à cœur tout ce qui
se rapporte à l'honneur de votre nom et de votre caractère. Quant à
vos dispositions pour moi, je sais ce que m'en ont dit et Q. Fabius
Virgilianus et C. Flaccus, fils de Lucius, et surtout M. Octavius,
fils de Cnéus : j'en ai pu juger moi-même par maintes preuves, entre
lesquelles je place au premier rang, et comme le plus doux de tous
les témoignages, l'envoi du Livre augurai que vous m'avez dédié
d'une manières! aimable. — Il n'est rien, croyez-le bien, que vous
ne deviez attendre de moi. Depuis que vous avez commencé à m'aimer
je vous aime chaque jour davantage. D'autres liaisons ont encore
resserré la nôtre, celles par exemple que j'ai formées avec deux
personnes d'âges bien différents, mais que je chéris au même degré,
Cn. Pompée, beau-père de votre fille, et M. Brutus, votre gendre.
Nous sommes membres du même collège, et cette circonstance, où vous
avez trouvé l'occasion d'une distinction si flatteuse pour moi, n'a
pas peu contribué à rendre nos rapports plus intimes. Quand j'aurai
vu Clodius, je vous écrirai, et je ferai mes dispositions pour vous
joindre le plus tôt possible. Vous me charmez , je l'avoue, en me
disant que vous n'êtes encore dans la province que par le désir de
vous y rencontrer avec moi.
|