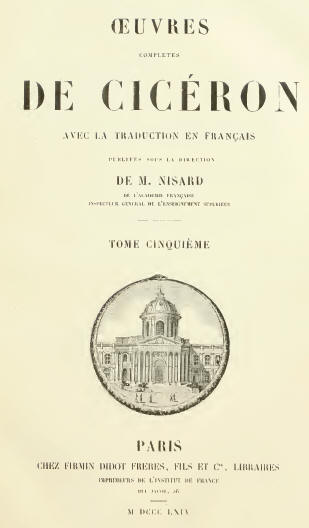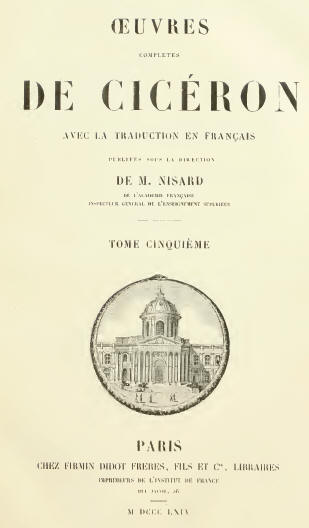|
800. — A D. BRUTUS, 1MPERATOR. Rome.
F. X1, 16. Il m'importe beaucoup de savoir dans quelle disposition vous
trouvera cette lettre. Aurez-vous l'esprit agité ou libre? J'ai
recommandé à mon messager de bien choisir le moment. Rien n'est à
charge comme une visite intempestive; rien n'indispose comme une lettre
arrivant mal à propos; mais si, comme je l'espère, rien ne vous trouble ni
ne vous préoccupe, et si le porteur de ma lettre sait habilement s'y
prendre, je ne doute pas du succès de ma prière. L. Lamia sollicite la
préture. Je n'ai avec personne des relations plus intimes : elles datent
de loin, le temps les a consacrées. Je dirai plus, je m'eu suis fait la
plus douce des habitudes. Les meilleurs offices, les services les plus
importants m'ont rendu son obligé. Du temps de Clodius, il était chef de
l'ordre équestre; et comme il avait épousé ma querelle avec feu, il fut
exilé par le consul Gabinius, traitement
jusqu'alors sans exemple pour un citoyen romain. Rome entière s'en
souvient : il y aurait de la honte à moi à l'oublier. Je veux que vous
vous figuriez, mon cher Brutus, que c'est moi-même qui sollicite la
préture. L'éclat personnel, une haute popularité, une édilité splendide,
je mets de côté tous les titres de Lamia; mais s'il est vrai que vous
m'aimiez comme vous m'aimez en effet, les centuries de l'ordre équestre
sont à vous, vous en disposez eu roi : eh bien ! envoyez un exprès à
Lupus, et que Lupus nous assure leurs suffrages. Je n'insiste pas : un
seul mot pourtant, avant de finir, qui vous dise bien ma pensée : c'est
qu'il n'y a pas d'occasion, mon cher Brutus, ou votre amitié, qui
n'aura jamais de refus pour moi, puisse faire quelque chose dont je sois
touché davantage.
801. — AD. BRUTUS, IMPERATOR.
Rome, décembre.
F. XI, 17. Je n'ai pas d'ami plus
intime que Lamia. Il m'a obligé, ou plutôt il a fait pour moi des
merveilles : le peuple romain le sait. Son édilité a été remarquable par
la magnificence de ses jeux. Il demande la
préture. On lui rend cette justice, que son caractère et sa popularité
justifient pleinement sa prétention ; mais l'intrigue me fait trembler,
et c'est pour la combattre que j'épouse sa candidature. Vous pouvez
beaucoup pour moi dans cette circonstance, et vous voudrez tout ce que
vous pouvez : voila ce dont je ne doute pas. Persuadez-vous donc,
moucher Brutus, qu'il n'est rien que je vous demande avec plus d'instance et dont je puisse vous savoir plus
de gré
que de concourir de tout votre pouvoir et de toutes vos forces à la
nomination de Lamia : je vous le demande instamment.
802. — DE PLANCUS A C1CÉRON. Gaule transalpine.
Décembre.
F. X, 4. Je suis bien touché de la lettre que vous avez la bonté de
m'adresser. Vous aviez causé avec Furnius, je le vois bien, avant de
l'écrire. Je vous fais des excuses pour être resté si longtemps sans
vous donner de mes nouvelles ; mais je vous savais parti, et ce n'est guère que par votre lettre que
j'ai connu votre retour. Je ne me pardonnerais pas de manquer le moins du monde à ce que je vous dois. J'ai plus d'un motif de penser ainsi :
l'union de nos familles, l'espèce de vénération avec laquelle je vous
vois depuis mon enfance, et l'affection dont vous avez toujours payé ma
tendresse. Vous êtes le seul, mon cher Cicéron, vous dont l'âge me le
permet, le seul pour qui je mêle à mes sentiments quelque chose de ce
qu'inspire le nom sacré de père. Aussi n'y a-t-il pas une de vos
observations qui ne me paraisse empreinte et de cette sagesse qui vous
distingue à un si haut degré, et de ce tendre dévouement dont je trouve
la mesure en mon cœur. Égaré ou incertain, il n'eut fallu qu'une
exhortation, qu'un mot de vous pour me ramener ou me confirmer dans la
bonne voie; Aujourd'hui qui pourrait m'en faire sortir? Je dois à la
fortune ou à mes propres efforts des avantages que votre amitié exagère
peut-être, mais qui rendent mon existence assez belle aux yeux de mes
ennemis mêmes, pour qu'il ne lui manque plus que l'éclat d'une grande
réputation ; aussi, n'en doutez pas, tout ce que j'ai de force pour agir,
de sagesse pour combiner, d'influence pour entraîner, tout en moi sera
toujours au service de la république. Je connais le fond de votre
pensée; et si je vous avais auprès de moi, comme je le souhaite tant, je
suivrais en tout vos conseils. Je ne ferai rien du moins qui puisse
m'attirer un reproche de votre part. — Je suis dans une grande attente
des nouvelles : que se passe-t-il dans la Gaule citérieure?
qu'aura-t-on fait à Rome pendant le mois de janvier? En attendant, j'ai
eu de vives inquiétudes. Je redoute que les peuples de ces pays, cédant
à de perverses influences du dehors, et voyant les maux qui nous
accablent, ne croient pour eux l'occasion venue. Mais que la fortune me
serve comme elle le doit, et, je le jure, on sera content de moi, vous
le premier, dont j'ambitionne si vivement le suffrage, et tous les gens
de bien. Ayez soin de votre santé, et aimez-moi comme je vous aime.
AN DE R. 711. — AV. J. C. 42. — A. DE C.
64.
M. Vibius Pansa et A. Hirtius, consuls.
803. — A CORNIFIC1US. Rome, janvier.
F. XII, 24. Je ne laisse échapper aucune occasion de vous faire valoir,
ou de vous servir plus solidement encore. En cela , j'acquitte une
dette; mais ce que je fais pour vous, j'aime mieux qu'un autre que moi
vous l'écrive. La chose publique réclame tous les efforts de votre zèle.
Il y a là une belle carrière pour vos talents, votre courage, et la
juste ambition qui vous anime. Une autre fois je vous en dirai davantage.
Tout est en suspens au moment ou je vous écris : on attend le retour des
députés que le sénat a envoyés, non pour demander la paix, mais pour
notifier la guerre à défaut de soumission immédiate. De mon côté, je
n'ai pas manque cette occasion de reprendre mon ancien rôle de défenseur
de la république. J'ai déclaré hautement que je me mettais à la tête du
sénat et du peuple, et le nouveau patron de la liberté ne cesse de
veiller au salut publie et à la commune indépendance. Mais j'aime mieux
que vous sachiez encore tout cela par d'autres. — T. Pinarius est
l'un de mes plus intimes amis. Je vous le recommande aussi fortement que
possible. Ce sont ses belles qualités (il les a toutes) et la parfaite
conformité de nos goûts qui me l'ont rendu cher. Il s'est chargé des
comptes et des affaires de mon ami Dionysius, que vous aimez tant et que
je chéris plus que personne. Je ne devrais pas vous les recommander.
Faites que T. Pinarius, qui est le plus reconnaissant des hommes, me
remercie de vos bontés pour lui et pour Dionysius.
804. — A D. BRUTUS. Rome, janvier.
F. XI, 8. Votre chère Polla vient de me faire demander si je voulais la
charger d'une lettre pour vous. Je n'ai en ce moment aucune nouvelle à
vous donner. Il y a complète stagnation. Les députés ne sont pas encore
de retour, et l'on ne sait rien de leur mission. Je profiterai toutefois
de l'occasion pour vous dire que le sénat et le peuple romain se
préoccupent vivement de vous, dans le double intérêt de leur existence
et de votre
gloire. C'est chose surprenante que la faveur qui s'attache à votre nom,
et l'amour universel dont vous êtes l'objet, vous avez délivré la
république du tyran. Vous allez aujourd'hui la délivrer de la
tyrannie. Voilà l'espoir ou plutôt la ferme confiance de chacun. — On
fait un appel déjeunes soldats à Rome et en Italie : appel n'est pas le
mot propre; car tout le monde vient s'offrir, tant le ressentiment de
la liberté perdue, tant la haine d'un trop long esclavage ont exalté les
esprits. Sur le reste, c'est à vous à nous donner des nouvelles. Où en
êtes-vous? que fait Hirtius? que fait mon jeune César? J'espère
qu'avant peu la victoire aura cimenté cotre vous une triple alliance.
De moi je n'aurais à vous dire que ce que vous trouverez, (je m'en
flatte et je l'aime mieux ainsi) dans les lettres de votre famille, à
savoir que je ne laisse et ne laisserai jamais échapper une occasion de
vous servir.
805. — A PLANCUS. Rome, janvier.
F. X, 3. J'ai toujours du plaisir à voir Furnius ; j'en ai eu cette fois
bien plus encore. En l'écoutant, je croyais vous entendre. Il m'a parlé
de vous, de vos talents comme général, de votre équité comme
administrateur, de votre sagesse en toute chose. Il s'est étendu sur les
charmes à moi bien connus de votre commerce et de votre intimité. Enfin
il ne m'a pas laissé ignorer combien vous aviez été bon pour lui.
Jusque-là je prenais plaisir à l'entendre; ici j'ai été touché au cœur.
Savez-vous, mon cher Planeus, que mes liaisons avec votre famille datent
de plus loin que votre naissance? Dès votre enfance, je me suis pris d'affection pour
vous. L'âge vous est venu, et des rapports que j'ai mis du soin à
entretenir, que vous mettiez du prix à cultiver, se sont à la fin
changes en une vive et étroite amitié. Voilà pourquoi je m'unis si
incroyablement à vos intérêts, et que j'ai résolu de De jamais les
séparer des miens. Guidé par la vertu, secondé par la fortune, vous êtes
arrivé au faîte des grandeurs. Vous étiez bien jeune encore; l'envie
s'en émut : mais vous sûtes eu triompher à force de talent et de
conduite. Aujourd'hui, si vous voulez me croire, moi qui vous aime
tendrement et à qui personne ne peut contester le privilège d'elle
votre plus ancien ami, vous ferez, de la bonne administration de la
chose publique, la gloire de votre vie. Vous n'ignorez point, car rien
ne vous échappe, que dans un temps on vous reprochait de vous être un
peu trop fait l'homme des circonstances. Et j'aurais partagé cette
opinion, si j'avais pu croire votre volonté complice de votre laisser
aller. Mais moi qui lisais dans votre cœur, j'interprétais votre
inaction par le sentiment de votre impuissance. La position a changé.
Votre jugement n'est plus contraint; vous avez votre libre arbitre.
Désigné consul à la fleur de l'âge, puissant par la parole , l'homme
qu'il faut enfin dans le dénuement actuel delà république, attachez-vous,
au nom des Dieux immortels, attachez-vous à la seule pensée qui puisse
vous conduire au faîte de la gloire. Oui, après une tourmente politique
si prolongée, je ne vois qu'un moyen d'y parvenir, c'est une
administration habile et forte. — Ne voyez dans ce que je vous écris que
l'amitié qui s'épanche; je n'ai pas la prétention de vous avertir et de
vous diriger. C'est aux mêmes sources que moi que vous avez puisé vos
principes. Il suffit, je m'arrête. J'ai songé à faire preuve
d'affection , non à faire parade d'habileté. Comptez sur l'invariable
concours de mes efforts et de mon zèle pour tout ce qui vous touche.
806. — A CASSIUS. Rome, janvier.
F. XII, 4. Que ne m'invitiez-vous au festin des ides de mars
! il n'y
aurait pas eu de restes, je vous jure. Ce sont ces restes aujourd'hui
qui me donnent tant de tablature, à moi plus qu'à tout autre. Nous avons
d'admirables consuls; mais les consulaires, quels misérables ! On trouve
du courage dans le sénat, mais en raison inverse du rang que chacun y
occupe. On n'est pas plus ferme, on n'est pas meilleur que le peuple par
toute l'Italie; mais les deux députés Philippe et Pison sont ce qu'il y
a de plus vil et de plus criminel. On les charge d'ordres précis du
sénat pour Antoine, et, sur son refus d'y obéir, ils ne font aucune
difficulté de nous rapporter de sa part les propositions les plus
intolérables. Aussi revient-on à moi de tous côtés, et me voilà devenu
populaire pour une bonne cause; mais j'ignore ce que vous faites, ce
que vous avez en vue, et jusqu'aux lieux où vous êtes. On vous
dit en
Syrie ; sur quel fondement? on ne sait. Brutus n'est pas si loin. Cela
fait qu'on accorde plus de confiance à ce qui nous revient sur son
compte. Des plaisants d'assez bon goût gourmandent fort Dolabella de
son impatience à vous succéder en Syrie, quand vous avez à peine trente
jours d'exercice. Ils sont d'avis qu'il ne faut pas l'y recevoir. Vous
et Hrusus êtes portés aux nues pour avoir, dit-on, trouvé le moyen de
former nue armée contre toute espérance. Je vous en dirais davantage, si je savais à quoi m'en tenir sur le fait et
les circonstances. Je ne parle que sur des présomptions et des ouï-dire.
J'attends de vos nouvelles avec impatience.
807. — A TRÉBONTUS. Rome, février.
F. X, 28. Ah! que ne m'avez-vous invité à votre beau festin des ides de
mars ! Il n'y aurait pas eu de restes, je vous en réponds.
Mais le tracas que nous donnent ces gens-là nous gâte bien un peu
l'admirable service rendu par vous à la république. Quand je songe
que
c'est vous, le meilleur des citoyens, qui avez empêché, en le tirant à
l'écart, que nous ne fussions délivrés de cette peste, je me surprends,
et c'est bien mal, à m'emporter contre vous. C'est qu'en vérité vous
m'avez laissé par là plus d'embarras qu'à tout autre. Car le sénat n'eut
pas plutôt retrouvé sa liberté, après l'ignoble disparition d'Antoine,
que je repris, moi, mon rôle d'autrefois, ce rôle dont vous et le zélé
patriote votre père vous vous êtes toujours montrés enthousiastes si
passionnés. Les tribuns du peuple ayant réuni le sénat, le treize des
kalendes de janvier, et ne l'entretenant que de choses
ordinaires, j'embrassai, moi, l'ensemble de la situation, j'en fis une
énergique peinture; et le sénat, du sein de sa mollesse et de son
abâtardissement, se sentit, à ma voix, renaître à la vie et à la vertu.
Le courage y fit plus que le talent. Depuis ce jour de protestations et
d'efforts, le peuple romain a compris que toute espérance de liberté
n'était pas perdue, et je ne cesse de veiller et d'agir. Si je ne savais
pas qu'on vous tient exactement informé de ce qui se passe à Rome et de
tous les actes officiels, je vous donnerais des détails, malgré mes
grandes occupations; mais ces détails, vous les aurez par d'autres.
Quelques mots donc seulement, et en forme de sommaire. Le sénat est
plein de résolution, les consulaires sont mous ou mal pensants. On a
fuit une grande perte dans Servius. L. César a des sentiments parfaits;
mais il est oncle, et ses avis manquent de nerf. Les consuls sont
parfaits, D. Brutus admirable, l'enfant César parfait aussi. Je vois
en
lui notre avenir. Ne doutez pas que s'il ne s'était hâté de rassembler
les vétérans, que si deux légions de l'armée d'Antoine n'étaient pas
venues se placer sous ses ordres, que si Antoine enfin ne s'était ainsi
senti en bride, nous n'eussions eu à parcourir toutes les phases de ses
fureurs et de ses cruautés. Vous devez savoir tout cela; mais je suis
bien aise de vous le confirmer. Je vous écrirai plus au long quand j'aurai plus de loisir.
808 - A CASSIUS. Rome, février.
F. XII, 5. C'est l'hiver, je le suppose, qui nous prive de vos nouvelles,
et nous laisse dans l'ignorance non-seulement de ce que vous faites,
mais même des lieux où vous vous trouvez. On dit partout cependant, sans
doute parce qu'on le désire, que vous êtes en Syrie et que vous y avez
des troupes; et on le croit, parce qu'en effet la chose est
vraisemblable. Notre cher Brutus s'est acquis une merveilleuse gloire;
il a fait de grandes choses, et d'une manière si inopinée, que la
satisfaction qu'elles inspirent s'accroit de tout ce qu'il y a de mérite
et de prix dans la promptitude de l'exécution. Si, de votre côté, vous
possédez les ressources qu'on vous suppose, la république se trouve en fonds pour se
défendre. Des extrêmes rivages de la Grèce aux confins de l'Egypte, nous
avons pour appui deux gouverneurs, excellents citoyens, et toutes les
troupes du pays. Cependant, ou je me trompe grandement sur l'ensemble de
la situation, ou ce sera D. Brutus qui décidera tout. S'il réussit,
comme nous l'espérons, à faire une sortie de Modène, la guerre est
terminée. Les forces qui l'assiègent sont peu nombreuses, parce
qu'Antoine en a renfermé de considérables dans Bologne. Notre Hirtius est
à Claterne, et César à Forum-Cornelii, chacun avec une bonne armée; et
Pansa recrute de grandes forces parmi les levées d'Italie. L'hiver a
empêché jusqu'ici les opérations. Hirtius me mande qu'il n'entreprendra
rien qu'à bon escient. Outre Bologne, le Rhégium de Lépide, Parme,
toute la Gaule tient en notre faveur. Vos clients d'au-delà du Pô font
cause commune avec nous. Le sénat est très ferme, aux consulaires près.
Parmi eux il n'y a que L. César qui marche droit. La mort nous a fait
perdre un bien bon appui en Ser. Sulpicius. Le reste se compose
d'imbéciles et de pervers. Quelques-uns voient avec envie la gloire et
la faveur publique qui s'attachent à certains noms. D'ailleurs il y a
une admirable unanimité parmi le peuple et dans toute l'Italie. Voilà à
peu près ce que j'avais à vous dire. Je n'ai maintenant à vous exprimer
qu'un vœu, c'est de voir votre gloire faire à son tour resplendir
l'Orient d'un nouvel éclat.
809. — A PÉTUS. Rome, février.
F. IX, 24. Ce Rufus est votre ami. C'est la seconde fois que vous m'écrivez à son
sujet. En voyant un intérêt si vif, je serais donc tout disposé à lui
rendre service, eussé-je même personnellement à m'en plaindre. Mais je
vois, au contraire, par vos lettres et les copies des siennes que vous
me communiquez, qu'il s'est donné beaucoup de mouvement pour me sauver
la vie. Je ne puis donc que l'aimer, et non pas seulement pour vous
complaire, mais parce que je le veux et le dois; car il faut que vous
sachiez, mon cher Pétus, que vos lettres m'ont bien donné l'éveil, et
m'ont fait tenir sur mes gardes, mais que depuis j'en ai reçu de
différents côtés d'autres parfaitement d'accord avec les vôtres. On
avait formé contre moi, à Aquinum et à Fa-bratéria, le complot dont vous
avez appris quelque chose. Ce complot, comme si on avait deviné à quel
point je serais gênant, n'allait à rien moins qu'à se défaire de moi. Je
ne me doutais de rien, et je n'aurais pris aucune précaution, si vous ne
m'aviez averti. Vous voyez donc que votre ami n'a pas besoin de
recommandation près de moi. Puisseut seulement les destinées de la
république me permettre de lui témoigner un jour ma
reconnaissance! —Je passe à autre chose. Vous avez donc renoncé aux soupers
en ville. Ah ! tant pis : c'est une grande jouissance, un délicieux
plaisir dont vous vous privez. Et puis je crains, si j'ose le dire, que
vous n'ayez désappris et oublié l'art de ce je ne sais quoi qui fait le
charme d'un petit souper. Déjà vous n'étiez pas de première force au
temps où vous aviez sous les yeux de si bons modèles (Hirtius et
Dolabella) : que sera-ce aujourd'hui! J'en parlai l'autre jour à
Spurinna et, lui racontant le fait, je lui dis quel était précédemment
votre genre de vie. Il m'a fort bien prouvé qu'il y aura danger pour la
république , si vous ne reprenez vos habitudes au premier souffle du zéphyr. La température alors sera supportable, et vous
n'aurez plus l'excuse du froid. Mais, toute plaisanterie à part, je vous
recommande, mon cher Pétus, comme une chose essentielle au bien-être, de
vous faire une société d'honnêtes gens qui soient aimables et qui vous
aiment. C'est le plus doux et le plus sûr clément du bonheur de la vie.
Il n'entre rien de sensuel dans ma pensée. Je ne parle que de
délassements d'esprit entre amis vivant sous le même toit, à la même
table; car c'est à table que la causerie devient plus intime et qu'il y
a plus d'épanchement. En quoi la langue latine a l'avantage sur celle
des Grecs: ce qu'ils appellent
συμπόσιον,
σύνδειπνον, mots qui ne
présentent que l'idée de boire et manger ensemble, nous l'avons, nous,
plus heureusement nommé convivium, parce que c'est l'acte qui constitue
essentiellement le vivre ensemble. Voulez-vous conserver votre santé?
soupez souvent en ville : le moyen est facile et sûr. Mais n'allez pas,
je vous en prie, conclure de ce badinage que le soin de la chose
publique a cessé de me toucher. Persuadez-vous, au contraire, que jour et
nuit je n'ai d'autre occupation, d'autre souci que le salut et la
liberté de mes concitoyens; je parle, agis, prévois. Enfin, je le dis
sincèrement, s'il faut le sacrifice de ma vie pour l'accomplissement de
cette tâche, c'est de grand cœur que je le ferai. Encore une fois,
portez-vous bien.
810. — A PLANCUS. Rome, février.
F. X, 5. Votre lettre m'est arrivée par duplicata. C'est une attention de
votre part. Vous avez compris quelle était mon impatience, et vous
n'avez pas voulu qu'elle fût trompée. J'ai été deux fois heureux en la
lisant, et je ne saurais dire ce qui m'a causé le plus de plaisir, ce
que je dois estimer le plus ou de votre tendresse pour moi, ou de vos
sentiments pour la république. De toutes nos affections, la plus noble,
a mon avis, c'est l'amour de la patrie; mais l'amitié qui rapproche et
confond les volontés a certes bien de la douceur. Aussi ce que vous
rappelez de ma liaison avec votre père, de ses bontés, de la constante
amitié que je vous inspirai dès votre jeunesse, et de mille autres
circonstances, tout cela m'a-t-il causé une satisfaction inexprimable; et
la déclaration des sentiments où vous êtes et ou vous persisterez pour
la république est venue y mètre le comble. Le bonheur que j'éprouvais à
recueillir ce témoignage de votre bouche était d'autant plus grand,
qu'il se joignait au bonheur de me sentir si tendrement aimé. Je vous
l'ai déjà dit dans cette lettre à laquelle vous répondez avec tant de
bonté, je vous conseille et je vous conjure de consacrer, de dévouer à
la république toute la puissance de votre esprit, toute l'énergie de
votre âme. Vous ne pouvez aspirer à rien de plus utile et de plus
glorieux pour vous-même; de toutes les choses de ce monde, il n'en est
point de plus grande et de plus belle que de bien mériter delà patrie.
Jusqu'à présent (avec un aussi bon esprit, vous me permettrez de dire ce
que je pense), jusqu'à présent dans les grandes choses que vous avez
faites, vous avez eu le sort pour second ; et s'il est vrai que sans
talent vous ne les auriez pas faites, toujours est-il que l'opinion y
fait une large part aux circonstances et à la
fortune. Mais dans le temps de crise où nous sommes, quelque service que
vous rendiez à la république, l'honneur en revient à vous, à vous seul.
Chez tous les citoyens, à part les brigands , c'est une haine mortelle
contre Antoine. On espère, ou attend beaucoup de vous et de votre
armée. Au nom des Dieux, n'allez pas perdre une si belle occasion pour
votre popularité et votre gloire! Je vous parle comme à un fils ; je
m'intéresse pour vous comme, pour moi-même; je vous exhorte avec le zèle
que me commandent la patrie et l'amitié.
811. — C. CASSIUS, PROCONSUL, A CICÉRON.
Du camp de Tarichée
(Ville très-forte, dont parle Josèpbe, liv. xi, 23 et suiv.en Judée) 7 mars.
F. XII, 11. Apprenez que je viens de rejoindre en Syrie les généraux L.
Murcus et Q. Crispus. Hommes de cœur autant que bons citoyens, ils
m'ont remis leurs armées, à la première nouvelle des événements de
Rome. De leurs personnes, ils s'associent avec ardeur à mes efforts
pour la direction des affaires. Apprenez de plus que la légion dont
Cécilius Bassus avait le commandement s'est réunie à moi. Apprenez
enfin que A. Alliénus m'a livré les quatre légions qu'il avait ramenées
d'Egypte. Inutile, je pense, après cela, d'ajouter un seul mot pour vous
engager à défendre de toutes vos forces la république en notre absence.
Je veux seulement que vous sachiez que le sénat et vous , vous avez de
vigoureux soutiens, et que vous pouvez maintenant en toute confiance
prendre cœur à la défense de la république. L. Cartéius, mon ami, vous
dira le reste. Adieu. Le jour des nones de mars.
812. — ASINIUS POLLION A CICÉRON.
Cordoue, 16 mars.
F. X, 31. Vous ne devez pas être surpris de n'avoir rien reçu de moi sur
les affaires publiques , depuis le commencement de la guerre. Le pas de
Castulon, toujours si fatal à nos messagers et plus que jamais en ce
moment infesté de bandits, offre bien moins de danger pour les
communications que les essaims de partisans dont la campagne fourmille,
et qui, dans l'intérêt des uns ou des autres, fouillent et retiennent
partout les courriers. C'est au point que, sans les nouvelles qui me sont
arrivées par mer, j'ignorerais entièrement ce qui se passe où vous
êtes. Aujourd'hui qu'enfin la navigation est ouverte, je saisirai avec
empressement toutes les occasions de vous écrire. — Il n'y a pas de
danger que je me laisse prendre aux belles paroles de cet homme que
personne ne veut voir, et qu'on ne hait pourtant pas encore autant
qu'il le mérite. Je l'ai tellement en aversion, que mon esprit se
révolte à la seule idée d'un rapprochement entre lui et moi. Mon
caractère et mes goûts sont pour la paix et la liberté, et j'ai bien
gémi en voyant s'allumer la guerre civile; mais la neutralité ne m'était
pas possible. J'avais de trop puissants ennemis dans l'un et l'autre
camp. Celui que j'ai quitté ne m'offrait plus de sûreté contre les
embûches de mon ennemi principal. Je me décidai donc bien à contrecœur à
affronter d'autres dangers, pour me soustraire à une perte certaine.
César au faîte des grandeurs m'avait traité comme il traitait ses vieux
amis. Je m'attachai, je me dévouai à lui de cœur. En tout ce que j'ai
fait de mon choix, ma conduite a dû me concilier l'approbation des gens de bien; chaque fois que je n'ai
fait qu'exécuter un ordre, le temps que j'y ai mis, la manière dont je
m'y suis pris ont assez témoigné de mes répugnances : c'est ce dont on
n'a pas eu la justice de me tenir compte ; et j'ai appris à mes dépens
quels sont les avantages de la liberté et les misères d'une condition
dépendante. Aussi, je le déclare, si de la crise actuelle il doit sortir
un nouveau maître, quel qu'il soit, je suis son ennemi; et pour la
liberté il n'est pas de péril que je redoute et que je n'affronte. Mais
je n'ai encore reçu ni conseils, ni instructions, ni décrets, depuis
les ides de mars. Il m'est seulement parvenu une lettre de Pansa, où il
m'engage à écrire au sénat pour me mettre à sa disposition, moi et mon
armée. Or, c'est ce qui offrait les plus grandes difficultés depuis que
Lépide, dans ses harangues et dans sa lettre à tout le monde, se
proclamait d'accord avec Antoine. En effet, comment aurais-je pu,
traversant malgré lui sa province, y assurer la subsistance de mes
légions? Et les Alpes, dont il garde tous les passages, avais-je des
ailes pour les franchir, en supposant même que j'eusse pu pénétrer
jusque-là? Ajoutez l'impossibilité de faire passer aucune lettre par
quelque voie que ce fût. Une correspondance aurait eu d'abord à
échapper à mille visites, pour tomber en définitive dans les mains de
Lépide, qui arrête tous les courriers. On ne peut du moins mettre en
doute, car je l'ai publiquement déclaré à Cordoue, ma détermination
absolue de ne livrer ma province que sur un ordre du sénat. Dirai-je combien
j'ai combattu avant de remettre la trentième légion? Et qui ne sait ce
que par cette mesure on m'a ôté de force pour le service de la
république? Jamais on ne vit soldats plus
ardents, plus opiniâtres sur un champ de bataille. En somme, je suis
amoureux de la paix avant tout, car je ne veux que du bien à mes
concitoyens; et toutefois je suis prêt à combattre pour ma liberté et
pour celle de tous.— Je vous sais mille fois plus de gré que vous ne le
pouvez croire de vos bontés pour mon ami (Vraisemblablement
Cornélius Gallus.), que vous traitez comme le
vôtre. Mais combien je l'envie de pouvoir se promener et badiner
avec
vous! Savez-vous bien quel prix je mettrais à cette bonne fortune?
Vienne pour moi le temps du repos, et vous serez à même d'en juger,
je
ne vous quitterai pas plus que votre ombre. Une chose me confond, c'est
que vous ne vous soyez pas expliqué sur ce que j'ai de mieux à faire
dans l'intérêt de la république : si je dois rester dans ma province, ou
passer en Italie avec mon armée. Demeurer est certainement pour moi le
plus sûr et le moins embarrassant. Mais je comprends que, dans l'état
des choses, Rome a plus besoin de soldats que de provinces que ce ne
sera jamais une affaire de reprendre plus tard ; et je viens de me
décider à me mettre en route avec mon armée. Vous saurez tout par la
lettre que j'adresse à Pansa. Je vous en envoie copie. Le 17 des
kalendes.
813 A PLANCUS. Rome, 20 mars.
F. X, 6. Ce que Furnius a dit de vos sentiments pour la république a été
écouté avec une grande faveur par le sénat, et fort applaudi par le
peuple. Mais vos lettres qu'on a lues en séance ne sont nullement
d'accord avec les paroles de Furnius. Vous vous déclarez pour la paix,
au moment où votre collègue, l'un de nos plus illustres citoyens, se trouve assiégé par ces
infâmes bandits. Il leur faut, s'ils veulent la paix, commencer par
mettre bas les armes; sinon, qu'ils songent à vaincre et non à traiter.
Vous saurez, par votre excellent frère et par Furnius, quel accueil on a
fait dans le sénat à ce que vos lettres et celles de Lipide disent sur
cet article. Votre bon esprit ne manquera point de vous suggérer
d'utiles réflexions. Vous avez de plus votre frère et Furnius, dont les
avis toujours sages el l'amitié ne vous feront pas défaut. C'est assez
sans doute. Mais l'attachement que j'ai pour vous me presse de vous
soumettre aussi quelques observations auxquelles mon expérience peut
donner du poids, et qui naissent des mille raisons qui nous unissent.
Croyez-moi, mon cher Flancus, vos honneurs, vos dignités (et vous êtes
bien haut placé sans doute), tout cela ne signifie rien. Tout cela est
en dehors du véritable honneur, si vous les séparez de la liberté du
peuple et de l'autorité du sénat. Rompez des alliances que vous avez
contractées par la forée des choses et non par choix. Dans ce chaos
politique, combien ont clé appelés consuls que personne ne tient
aujourd'hui pour consulaires! On ne reconnaît pour tels que ceux qui en
ont montré les sentiments. Ce sont là des modèles à suivre. Et d'abord
rompez, je le répète, rompez tout pacte avec les impies auxquels vous
ressemblez si peu; devenez l'âme, le guide et le chef du sénat, et de
tout ce qui s'appelle les honnêtes gens. Enfui, croyez-le bien, la
paix, ce n'est pas avoir déposé les armes, c'est n'avoir à redouter les
armes ni la domination de personne. Si telle est votre conduite, si tels sont vos sentiments, non-seulement
vous 6eree consul et consulaire de fait comme de nom, vous serez encore
un grand consulaire. Hors de là, les titres et les distinctions
n'honorent plus, ils dégradent. Ces paroles sont sévères, mais l'amitié
me les dicte, et si vous prenez un parti digne de vous, vous verrez à
l'épreuve que c'est la vérité qui vous parle par ma bouche. Le 13 des
kalendes d'avril.
814. — A LÉPIDE Rome, mars.
F. X, 27. Dans mon profond intérêt pour vous, je me préoccupe vivement de
tout ce qui vous touche, et je regrette, je l'avoue, que vous n'ayez pas
cru devoir un remerciement au sénat, après avoir été comblé de tant
d'honneurs. Je vois en même temps avec joie vos vœux ardents pour le
rétablissement de la paix entre les citoyens. J'entends la paix sans
l'esclavage , c'est ainsi qu'il la faut pour la république et pour
votre gloire; car si la paix devait avoir seulement pour résultat de
nous livrer de nouveau à l'intolérable despotisme d'un misérable, il
n'y a pas un homme sensé qui ne préférât la mort à la servitude. Il
serait donc sage à vous, selon moi, de laisser là des projets de
pacification qui n'ont l'assentiment ni du sénat, ni du peuple, ni des
honnêtes gens. Je ne suis pas le seul de qui vous entendrez ce langage,
et votre correspondance, à coup sûr, ne me dément point. Décidez ce que
vous avez à faire. Vous seul en êtes juge.
815. — PLANCUS, IMPERATOR. ET CONSUL DESIGNE, AUX CONSULS, AUX
PRÉTEURS, AUX TRIBUNS, AU SÉNAT ET AU PEUPLE ROMAIN. Des Gaules, mars.
F. X, 8. S'il s'élève une seule voix parmi vous pour me
reprocher la trop longue attente des moyens et un ajournement volontaire
des espérances de la république, je me laverai de ce reproche avant de
m'engager pour l'avenir. Il ne me convient pas d'avoir l'air plus
tard
de racheter le passé : j'agis en bon citoyen, d'après un plan mûrement
réfléchi, et c'est le moment de vous le dire. II eût été, je le sais,
d'un bon calcul, au milieu de l'agitation des esprits et du chaos où
nous vivons, de faire une déclaration publique de mes sentiments. Je
vois beaucoup de gens qui sont arrivés par ce moyen à de grands
honneurs. Mais, dans la position où la fortune me plaçait, je ne pouvais
donner des espérances prématurées sans tout compromettre ; en laissant
au contraire la réserve de mon langage donner le change sur mes
ressources, je multipliais mes chances de succès. Aussi devant l'intérêt
commun ai-je fait taire l'amour-propre. Est-ce dans ma situation, avec
mes antécédents connus, avec l'avenir entre mes mains, que j'irais
écouter des sentiments bas et former de coupables pensées? J'avais
besoin de temps, de beaucoup d'efforts et de sacrifices, pour préparer
l'accomplissement de ce que la république et les gens de bien ont droit
d'attendre de moi, et pour apporter à l'enjeu non pas une bonne volonté
toute nue, mais des forces sûres et des ressources imposantes. La
séduction n'avait cesse d'agir sur l'armée : il fallait nous la
rattacher, en faisant comprendre à mes soldats que la promesse
d'avantages sans bornes de la main d'un seul homme, ne valait pas les
récompenses médiocres que la république tout entière réservait à leur
valeur. Des largesses et des concessions avaient détaché plusieurs
villes de notre cause. Il fallait nous les rattacher de
même, en leur montrant la vanité de ces avantages, et les sources plus
pures où leur propre intérêt leur commandait de puiser dorénavant. Il
fallait enfin attirer à nous les commandants des provinces et des armées
voisines, afin de pouvoir marcher avec de gros bataillons à la défense
de la liberté, au lieu de laisser se préparer contre notre faiblesse un
triomphe funeste à l'univers. C'était surtout pour moi une obligation
d'être fort, en augmentant mon armée et multipliant mes alliances, afin de
pouvoir, le moment venu et en dépit de ceux qui s'abusent sur mes
sentiments véritables, proclamer sans danger le parti que je défends.
Pour arriver à mes fins, je ne le nie pas, j'ai dû beaucoup feindre et
beaucoup dissimuler. Mon collègue m'a appris à ses dépens le danger de
se prononcer trop tôt et sans être en mesure. C'est la même prudence qui
me conseille en ce moment de vous envoyer mon lieutenant C. Furnius,
homme aussi dévoué que brave, et de le charger de communications
verbales plutôt que de dépêches écrites. Un rapport de vive voix pare à
tous les périls de la route, et me laisse ici en pleine sécurité. Vous
saurez par Furnius combien j'avais à faire pour vous mettre en bonne
position et pour m'organiser. Vous en conclurez infailliblement que ce
n'est pas d'hier que je veille et me consume pour la défense de la
république aux abois. — Maintenant que, grâce à la bonté des Dieux, je
suis en mesure de défier les événements, j'ai droit de demander qu'on
m'accorde quelque confiance et qu'on ne me juge point à la légère. J'ai
cinq légions sous les armes : la république peut compter sur leur
fidélité comme sur leur vaillance. Ma générosité m'assure leur
affection. Ma province marche comme un seul homme. Il n'est pas une de
ses villes qui ne rivalise d'efforts et de zèle. J'en ai tiré autant de
cavalerie et d'auxiliaires qu'elles en pouvaient fournir pour la défense
de leur propre territoire et de leur liberté. Quant à moi, je suis prêt
à remplir ici mon devoir, à voler ailleurs si la république m'appelle, à
remettre même entre les mains d'un autre mon armée, mes auxiliaires, mon
gouvernement. J'assume volontiers sur ma tête toutes les luttes et tous
les combats de cette fatale guerre, heureux si, au prix de ma vie, je
puis assurer le salut de l'empire ou retarder seulement l'heure du
danger ! Peut-être, dans l'instant où je parle, la question est décidée
et la sécurité rendue à Rome. Peu m'importe alors une occasion perdue
pour ma gloire, je ne veux que me réjouir du bien de la république. Si
je dois, au contraire, partager les assauts et les périls, je réclame la
justice de mes concitoyens pour me défendre contre la malveillance et
l'envie. Le salut de l'empire est la seule récompense que j'ambitionne
pour mon compte. Mais des hommes sont restés fidèles à l'autorité de
leur général, ou plutôt à votre propre voix. Ils ont résisté à la
séduction , ils se sont montrés insensibles à la crainte. Ne les oubliez
pas, c'est tout ce que je demande.
816. — DE PLANCUS à CICÉRON. Des
Gaules, mars.
F. X, 7. Je voudrais pouvoir
m'entretenir longuement avec vous et vous donner la clef de toute ma
conduite. Vous verriez si je me suis dévoué et si j'ai failli à vos
conseils comme a vos espérances, moi qui tiens à votre estime autant qu'a votre amitié, et qui
veux vous avoir pour défenseur si je fais mal, et pour panégyriste si
je fais bien. Mais il y a deux raisons pour que je sois bref : d'abord
ma lettre officielle dit tout, puis l'un de mes intimes, M. Varisidius,
chevalier romain, a ordre de passer chez vous et de vous satisfaire sur
tous les points. Ce n'est pas, je le jure, sans un profond chagrin que
je vois les trompettes de la renommée employées pour d'autres que pour
moi. Je n'ai pas voulu faire sonner jusqu'ici mes services. J'aimais
mieux me préparer en silence, à des actes qui pussent honorer le consul
et justifier votre attente. Pour peu que la fortune ne me soit pas
rebelle, mes concitoyens verront où est leur meilleur défenseur, et la
postérité à son tour consacrera son nom. Aidez-moi de votre suffrage, je
vous le demande : vous avez parlé de gloire; faites que je recueille
ces fruits dont vous m'avez tenté, et que je m'élance dans la carrière
avec plus d'ardeur. Vous avez tout pouvoir et bonne volonté.
Portez-vous bien, et aimez-moi comme je vous aime.
817. — A CASSIUS. Rome, mars.
F. XII, 7. Votre correspondance, vous dira avec quelle chaleur mon amitié
vous a servi au sénat et devant le peuple, et j'aime mieux que vous le
sachiez par d'autres que par moi. Au sénat, j'aurais d'emblée emporté
les suffrages, sans l'opposition obstinée de Pansa. Après y avoir aussi
soutenu mes propositions, je fus présenté à la tribune aux harangues par
Servilius; j'y parlai avec toute la force dont je suis capable. Ma voix
remplissait l'étendue du forum. Jamais je ne
vis de semblables applaudissements et de plus unanimes transports. Vous
me pardonnerez de n'avoir pas écouté les scrupules de votre belle-mère.
Celte femme craintive redoutait par-dessus tout d'irriter Pansa. Or, il
avait avancé à la tribune que votre mère elle-même et votre frère
n'étaient pas d'avis de mes propositions. Que m'importait? ce n'est pas
là ce qui me préoccupait, c'est la république que je vois partout,
c'est votre honneur et votre gloire. Je me suis avancé au sénat et près
du peuple sur un point pour lequel j'ai besoin que vous dégagiez ma
parole. J'ai dit, j'ai solennellement déclaré que vous n'aviez pas
attendu, que vous n'attendriez point les décrets du sénat pour agir, et
que vous prendriez sur vous de faire tout ce que vous croiriez utile à
la défense de la république. J'étais pourtant sans nouvelles, je ne
savais pas même où vous étiez, ni quelle était la force de vos troupes.
Je n'en ai pas moins posé en fait que vous étiez maître de toutes les
ressources, de toutes les troupes de la contrée, et que je ne doutais
pas qu'au moment où je parlais, l'Asie ne fût rentrée sous notre
domination. Vous le voyez, une nouvelle moisson de lauriers vous
attend. C'est à vous à vous surpasser. Adieu.
818. — A PLANCUS. Rome. 30 mars.
F. X, 10. Quoique Furnius m'eut dit votre pensée sur nos affaires, je me
suis fait une idée plus nette de l'ensemble de vos vues à la lecture de
vos dépêches au sénat. La fortune de l'empire dépend d'une bataille, et
je pense que son sort sera décidé au moment où vous lirez ce mot.
Quoiqu'il en soit, il n'est bruit aujourd'hui que de vous et de votre
belle conduite. Si nous avions un consul à Rome, le sénat aurait rendu
un hommage à vos efforts et aux forces que votre zèle a créées. Ce qui
est différé n'est pas perdu , et d'ailleurs mon opinion est que les
choses ne sont pas mûres ; car enfin les honneurs ne doivent aller qu'a
des services rendus, et non à des services en perspective. Mais
croyez-en ma parole : pour peu que la république subsiste et que la
confusion n'y étouffe pas toute lumière, il n'y a honneurs au monde
auxquels vous ne deviez prétendre : je parle de ces honneurs qui ne
mentent pas à leur nom, c'est-à-dire qu'on ne donne point comme un
encouragement passager, mais qu'on décerne comme la palme de
l'immortalité. Ne songez donc qu'au véritable honneur, mon cher Plancus,
ne trompez pas l'attente de la patrie. Sauvez un collègue, et donnez un
point d'appui au patriotisme de tant de nations qui de tous côtés font
cause commune avec nous. Vous me trouverez prêt à vous aider dans vos
plans, à vous servir dans vos intérêts, à vous rendre enfin tous les
devoirs d'un ami fidèle et dévoué. Aux mille causes qui nous unissent, à
l'affection réciproque , aux services mutuels, à cette longue
consécration dont le temps a scellé nos nœuds, un lien plus puissant se
joint encore, l'amour de la patrie, amour sacré qui me ferait en ce jour
donner ma vie pour conserver la vôtre. Le 3 des kal. d'avril.
819.—A PLANCUS. Rome, 11 avril.
F. X, 12. Sans doute c'est surtout pour la république que je me félicite
du puissant appui que vous venez de lui prêter : mais le sauveur
de Rome m'est si cher, qu'une fois la république raffermie sur ses
bases, je sens que je ferai ma plus grande joie de sa gloire, de cette
gloire immense à laquelle tant d'avenir est promis encore! Jamais
dépêches ne trouvèrent au sénat autant de faveur que les vôtres. Cela
s'explique par les services si grands et si particuliers que vous rendez
à la république, ainsi que par la dignité de. votre langage et de vos
sentiments. Rien ne m'a étonné, moi qui sais quelles promesses vous me
faisiez dans vos lettres, et que Furnius a initié à vos plus secrètes
pensées. Mais le sénat ne s'attendait pas à tant. Ce n'est pas qu'il eut
le moindre doute sur vos intentions, mais il ne connaissait pas vos
moyens et ne savait pas jusqu'où vous voudriez pousser les choses.
Aussi vous comprendrez ma joie lorsque, le 7 des ides d'avril, M.
Varisidius m'apporta votre lettre. Une foule de grands personnages et
de bons citoyens s'étaient réunis chez moi pour me faire cortège. Je
leur fis à l'instant partager mon bonheur. Notre ami Munatius survint à
son heure accoutumée; je lui donnai votre lettre. Il ne savait rien
encore, car Varisidius n'avait vu personne avant de venir chez moi. Vous
le lui aviez, m'a-t-il dit, ordonné. A son tour, Munatius me communiqua
la lettre particulière que vous lui avez adressée, ainsi que votre
dépêche officielle. Je jugeai à propos de porter le tout sur-le-champ à
Cornutus, préteur de la ville, qui, suivant l'antique usage, remplace les
consuls en leur absence. On convoqua immédiatement le sénat; l'assemblée
fut nombreuse. Le bruit de vos lettres s'était répandu, et l'attente
était grande. Après la lecture des dépêches, un scrupule de religion
vint à Cornutus : les pullaires avaient déclaré que les auspices n'avaient pas été consultés
par lui convenablement. Notre collège était de cet avis à l'unanimité.
On s'ajourna au lendemain. Ce fut ce jour-là que j'eus à votre sujet une
prise des plus fortes avec Servilius. A force de condescendance, il
avait obtenu de parler le premier; mais, pendant qu'il parlait, presque
tous les sénateurs désertèrent, et furent s'occuper d'autres affaires.
Quand mon tour vint (j'étais le second), les rangs se regarnirent, et
mes propositions allaient réunir les suffrages, lorsque P. Tittus,
poussé par Servilius, fit opposition. Nouvel ajournement. Le lendemain,
Servilius se présenta armé de toutes pièces, et prêta affronter Jupiter
lui-même, dans le temple duquel nous étions réunis. Je l'écrasai, et mes
efforts parvinrent à faire tomber ensuite l'opposition de Titius. Mais
j'aime mieux que vous appreniez ces détails par d'autres que par moi.
Je me bornerai à un mot. Impossible d'être mieux, de se montrer plus
digne, surtout plus jaloux de votre gloire que le sénat dans cette
occasion. Toutefois si le sénat vous aime, Rome entière ne reste certes
pas en arrière. C'est admirable : le peuple romain n'a qu'une pensée :
cette pensée vit dans tous les rangs, dans tous les ordres : Il faut
sauver la république ! Persistez, mon cher Plancus, persistez dans la
voie où vous êtes. Il ne tient qu'à vous de rendre votre nom immortel à
jamais. Dédaignez les vains ornements et les frivoles parures de la
fausse gloire; tout cela n'a qu'un moment de durée, fuit et passe sans
retour : la vertu seule luit d'un solide éclat, et c'est en servant la
patrie qu'elle se revêt de son plus beau lustre.
L'occasion est belle. Vous la tenez, ne la laissez point échapper et
poussez ferme. Il ne faut pas que la république vous doive moins que
vous ne lui devez vous-même. Nous savez que vous pouvez compter sur moi
pour tout ce qui tient à vos intérêts, à vos honneurs. C'est un devoir
que me commandent à la fois mon amour pour la république, qui m'est
plus chère que la vie, et la longue amitié qui nous lie. Au milieu de
mes luttes, pour faire valoir vos efforts, j'ai eu la joie de voir le
sage et loyal Munatius rester fidèle aux sentiments que je lui connais,
et se signaler de plus en plus par son zèle et son dévouement pour vous.
820. — A CORNIFICIUS. Rome, avril.
F. XII, 28. Vous avez raison, c'est à Lilybée même qu'il aurait fallu
faire justice des misérables qui vous ont fait trembler pour Lilybée;
mais vous avez craint, dites-vous, de montrer de la passion dans la
vengeance : je vous entends; vous avez craint de ne point paraître assez
grave, assez puissant sur vous-même, assez fidèle à votre noble
caractère, il existait entre votre père et moi une sorte d'alliance pour
la défense de la république. Je suis charmé de voir cette alliance se
renouveler entre nous : ce sont là des nœuds qui ne s'affaibliront
jamais, mon cher Cornificius. Non, point de remercîments : voilà qui est
fort bien encore, et c'est un usage à maintenir entre nous. Le sénat
s'occuperait de vous davantage, si, pendant l'absence des consuls, il
s'assemblait pour autre, chose que pour des incidents extraordinaires.
Nulle apparence qu'il puisse traiter l'affaire des deux
millions ni celle des cinq millions de sesterces. Mon avis est que vous
agissiez en vertu du sénatus-consulte, et que vous mettiez un emprunt
en recouvrement. Je pense qu'on vous donne des détails sur ce qui se
passe, à mesure qu'on vous envoie les actes officiels. J'ai bonne
espérance. La république occupe et remplit toutes mes pensées.
J'attaque de front ses ennemis. Les choses se débrouillent ; elles
auraient été beaucoup plus faciles, si tout le monde avait fait son
devoir.
821. — A CORNIFICIUS. Rome, avril.
F. XII, 29. Vous qui savez tout ce qui me touche, vous savez l'intimité
de mes rapports avec L. Lamia : je ne crois pas qu'il y ait un seul
citoyen qui les ignore, car il s'eu lit une révélation publique à
l'époque ou le consul Gabinius força Lamia de s'exiler pour avoir
défendu ma vie avec indépendance et courage. Ce n'est pas au surplus de
ce moment que date notre liaison, et c'est même parce que nous étions
alors fort étroitement liés depuis longtemps qu'il ne recula devant
aucun danger pour moi. Indépendamment de ses titres, de ses droits
sacrés à ma reconnaissance, Lamia est un homme charmant ; je n'en
connais pas de. plus aimable au monde. Cela dit, dois-je me mettre en
peine des termes dans lesquels je vous le recommanderai? Imaginez tout
ce que la plus tendre affection peut inspirer de plus pressant. Mais je
veux que vous sachiez quel prix infini j'attache à tout ce que vous
ferez pour lui, pour ses affaires, ses agents, ses affranchis , toute sa
maison enfin. Je vous en saurai autant de gré que pour moi-même.
Il y a une chose dont je suis sûr : c'est que vous jugez trop bien les
hommes pour ne pas accueillir Lamia avec empressement, même sans ma
recommandation. On m'a dit, il est vrai, que vous lui reprochiez d'avoir
apposé sa signature à certain sénatus-consulte dont vous avez fort à
vous plaindre. Je vous assure qu'il n'a pris part à aucun des décrets de
ces consuls-là : combien de décrets faux ne faisait-on pas d'ailleurs à
cette époque? Croyez-vous, par exemple, que j'aie pris part au
sénatus-consulte de Sempronius, moi qui n'étais pas même à Rome alors, et
qui vous en ai écrit tout chaud? Assez là-dessus. Je vous prie, mon
cher Cornificius, avec toute sorte d'instances, de regarder les
affaires de Lamia comme les miennes, et de le traiter de façon qu'il ait
des remerciements à ne faire. Vous ne pouvez rien faire qui me soit plus
agréable. Ayez soin de votre santé.
822. — A CASSIUS. Rome, avril.
F. XII, 6. C. Tidius Strabon vous dira quelle est notre situation au
moment où je vous écris. C'est un homme de bien. Ses sentiments pour la
république sont admirables. Comment parler autrement d'un homme qui,
dans l'impatience de son dévouement à votre personne, abandonne sa
fortune et sa maison uniquement pour vous rejoindre? Je ne vous le
recommande point, sa présence le recommande suffisamment. Croyez et
persuadez-vous bien, mon cher Cassius, qu'en cas de revers (ce que je me
plais à croire impossible) il n'y a pour les gens de bien de ressource
qu'en vous et Brutus. Au moment où je vous écris, une catastrophe est
imminente. Brutus est serré de près dans Modène. S'il se maintient, la
victoire est à nous; sinon.... (ah ! que les Dieux nous préservent d'un tel
malheur!) l'émigration sera générale auprès de vous. Élevez votre
courage et vos forces au niveau des besoins de la république; elle ne
peut être sauvée qu'à ce prix. Adieu.
823.— BRUTUS A CICÉRON. Dyrrachium, avril.
B. 23 et et 21. J'attends avec bien
de l'impatience votre réponse aux nouvelles que je vous ai envoyées au
sujet de mes affaires et de l'assassinat de Trébonius. Point de doute
que vous ne me fassiez connaître votre avis. Nous avons perdu par un
forfait atroce un excellent citoyen et la possession d'une grande
province qu'il nous serait facile de reprendre, et qu'il serait honteux,
criminel même de ne pas reprendre, si on le peut. Caïus est toujours
sous ma main ; mais, je vous le jure, il m'attendrit par ses prières.
D'un autre côté, j'ai à craindre qu'il ne trouve de l'appui dans
quelques furieux. J'en ai vraiment le cerveau échauffé. Un avis de vous pourrait seul me
tranquilliser, car je suis sûr que ce serait le meilleur. Hâtez-vous
donc de me dire ce qui vous en plaît. — Notre cher Cassius est maître de
la Syrie et des légions qui s'y trouvent ; Murcus et Marcius l'ont
appelé eux-mêmes, d'accord avec leur armée. J'ai écrit à Tertia, ma
sœur, et à ma mère d'attendre vos réflexions et votre avis avant
d'ébruiter les succès de l'habile et heureux Cassius. J'ai lu deux de
vos discours, dont l'un remonte aux kalendes de janvier, et dont l'autre
est une sortie contre Calénus au sujet de ma lettre. Vous comptez sans
doute sur mes compliments. Eh bien! mon cher Cicéron, je ne sais ce
qu'il faut louer le plus en vous, de votre courage ou de votre
éloquence; et j'approuve fort ce nom de Philippiques que, dans une de
vos lettres, vous donniez en riant à ces discours.— Nous manquons à la
fois d'argent et d'hommes. Quant aux hommes, vous pourrez nous en
envoyer en détachant une partie de vos troupes, soit à l'insu de Pansa
qui s'y opposerait, soit en vertu d'un sénatus-consulte : mais l'argent
nous est encore plus nécessaire; je sens toutefois qu'il ne l'est pas
moins aux autres armées qu'à la mienne. Le plus cruel de mes tourments
est de voir qu'en Asie... C'est en Asie, croyez-moi, qu'il laut pousser
la guerre. Rien de mieux à faire , quant à présent... En Asie, la
conduite de Dolabella est tellement tyrannique, que l'assassinat de
Trébonius ne peut plus passer pour le plus atroce de ses attentats.
Vetus Antistius m'a procuré quelque secours d'argent. Votre fils, mon
cher Cicéron, me révèle chaque jour plus d'habileté, de constance, de
zèle, de magnanimité. Par ce développement progressif de toutes les
vertus, il fait bien voir que le nom qu'il porte est sans cesse présent
à sa pensée. S'il n'est pas en mon pouvoir de vous le faire aimer
davantage , croyez du moins que je l'ai assez étudié pour me porter
garant de son avenir, et soyez persuadé que, pour arriver aux honneurs
paternels, votre fils n'aura pas besoin de se faire un manteau de votre
gloire.
824. - A BRUTUS. Rome, avril.
B. 24. Vous avez besoin de deux
choses indispensables, de renforts et d'argent. Que faire? je ne vous
vois d'autre ressource pécuniaire que des emprunts forcés aux villes,
moyen mis à votre disposition par le décret du sénat. Quant aux renforts
, je ne sais où donner de la tête. Il est impossible de rien détacher de
l'armée de Pansa, ni même des nouvelles levées. Il a déjà un dépit
extrême de voir tant de volontaires courir vous rejoindre. Il pense,
sans doute, que, dans les grandes affaires qui se débattent en Italie,
il ne saurait y avoir ici trop de forces : peut-être aussi n'est-il pas
fâché de vous laisser un peu faible ; c'est un soupçon assez général,
mais que je ne partage point. — Vous avez mandé a Tertia, votre sœur, de
ne publier qu'avec mon agrément les nouvelles de Cassius; vous redoutiez
avec raison de choquer le parti de César, puisque le parti de César
subsiste toujours; mais, avant l'arrivée de vos dépêches, les nouvelles
étaient déjà connues et publiques. Beaucoup de vos amis les avaient lues
dans des lettres portées par vos propre messagers. Le secret n'était
donc plus possible; l'eut-il été, j'aurais préféré encore la publicité
au mystère. — Si mon fils est tel que vos lettres le dépeignent, j'en
éprouve une satisfaction bien naturelle; mais si le portrait est flatté,
il ne peut l'être que par un ami , et cette affection que vous portez à
Cicéron me comble de joie plus que je ne puis le dire.
825. — A BRUTUS. Rome, avril.
B. 20. La lettre de Plancus, dont
on vous a communiqué sans doute une copie, vous a fait connaître ses
nobles sentiments pour la république, ainsi que l'état de ses légions,
de ses auxiliaires et de toutes ses ressources. Votre famille ne vous a
pas laissé ignorer non plus la légèreté et l'inconstance de Lépide ,
dont l'esprit est toujours hostile à la république, et qui, après son
frère, ne hait rien tant que tous ses proches. — Nous
sommes dans une anxiété bien vive; car le moment de la crise est
arrivé. Tout notre espoir est dans la délivrance de Décimus, pour qui
nous sommes dans des transes continuelles. J'ai ici sur les bras ce
furieux de Servilius; je l'ai souffert plus longtemps qu'il ne
convenait à ma dignité; mais je m'y suis résigné dans l'intérêt de
l'Etat. Je ne voulais pas donner à une foule d'hommes perdus qui
l'entourent un meneur d'une bien pauvre tète , il est vrai , mais d'un
nom illustre. Quoique les brouillons trouvent déjà en lui un point de
ralliement, je ne voulais pas le jeter dans les rangs des ennemis de la
république. Mais enfin il m'a, par ses insolences, en s'oubliant jusqu'à
nous traiter en esclaves. L'affaire de Plancus l'enflamma de dépit et de
rage; il tenta pendant deux jours de l'emporter sur moi de haute lutte,
mais il est sorti tout broyé de mes mains avec une leçon de modestie qui
jamais , je crois , ne sortira de sa mémoire. C'est le 5 des ides
d'avril , au fort de ce débat si animé , que je reçus au sénat une
lettre de Lentulus remplie de détails sur la situation de Cassius, des
légions et de la Syrie. La lecture que j'en fis aussitôt confondit Servilius et
bien d'autres ; car il règne un mauvais esprit chez
beaucoup de nos plus illustres sénateurs. Servilius
fut piqué au vif de voir, dans l'affaire de Plancus, le sénat passer
à mon avis. N'est-ce pas une monstruosité dans une république que ...
(Le reste manque.)
826. — ANTOINE A HIRTIUS ET A CESAR (Cette
lettre extraite de la 13e Philippique, est publiée pour la première fois
dans la correspondance de Cicéron.).
J'ai trouvé dans la mort de Trébonius autant
de cause d'affliction que de joie. Le sang d''un scélérat offert à la
tombe et aux mânes du plus
illustre des citoyens; la justice divine se manifestant dans l'année
même du crime, et par un commencement d'expiation et par la vengeance
qu'elle montre suspendue sur le reste des parricides, voila de quoi se
réjouir: mais Dolabella déclaré ennemi public, pour avoir mis à mort un
assassin; le peuple romain montrant plus de sympathie pour le fils d'un
bouffon que pour César, le père de la patrie; c'est ce qu'on ne peut
trop déplorer. Je souffre par-dessus tout de vous voir, vous Hirtius que
César a comblé de bienfaits, qu'il a élevé à un faîte qui vous étonne
vous-même; et vous aussi, jeune homme, qui devez un nom de César tout ce
que vous êtes; de vous voir, dis-je, travailler tous deux à faire que la
condamnation de Dolabella soit légitime, à délivrer cette sorcière que
je tiens assiégée, à accroître sans limite le pouvoir d'un Cassius, d'un
Brutus. Est-ce donc toujours la vieille prétention? Appelez-vous sénat
le camp de Pompée? Cicéron, un vaincu de Pharsale, est votre chef; la
Macédoine est envahie par vos troupes. A Varus, deux fois prisonnier, on
donne l'Afrique, à Cassius la Syrie. Vous souffrez qu'un Casca ait la
puissance tribunitienne! On arrache aux ministres des Lupercales les
dotations accordées par César. Les colonies de vétérans supprimées en
vertu d'une loi et d'un sénatus-consulte; les Marseillais sur le point
de recouvrer ce dont ils ont été dépossédés par le droit de la guerre;
au mépris de la loi Hirtia , les Pompéiens survivants redevenus
admissibles aux
honneurs; Brutus enrichi des dépouilles d'Apulée: Pétus et
Ménédème, tous deux hôtes de César, citoyens de sa création, livrés à
la hache, et ce meurtre traité d'acte méritoire ;Théopompe
volé, chassé par Trébonius, et qu'on laisse languir à Alexandrie,
Servius Galba se montrant dans votre camp, sous vos yeux , encore armé
de son poignard sanglant; mes soldats, les vétérans, appelés soi-disant
pour venger la mort de César, et que l'on pousse, à leur insu, contre
leur questeur, contre leur général, contre leurs compagnons d'armes ;
voila ce que vous avez fait ou laissé faire : que fera il de plus
Pompée, s'il venait à revivre? ou son fils, s'il pouvait remettre le
pied dans Rome? — Aucune parole de paix, dites-vous, ne sera écoutée
qu'au préalable je n'aie rendu la liberté à Décimus, ou que je ne lui
aie fourni des vivres. Est-ce bien là ce que demandent les vétérans,
pour qui toute chose est encore entière? Vous vous êtes vendus pour des
paroles flatteuses et des dons empoisonnés. Vous voulez sauver les
soldats enfermés dans Modène; ce n'est pas moi qui m'y oppose. Désignez
le lieu ou ils doivent se rendre. Ils sont libres, mais qu'ils laissent
périr celui dont il faut qu'il soit fait justice. On a parlé de paix
dans le sénat, et d'une députation de cinq consulaires. J'ai peine à
attacher une pensée de modération , l'idée d'une démarche conciliatrice,
au nom de gens qui se sunt montrés a mon égard si intraitables quand
j'offrais les termes les plus modérés, avec l'intention d'en rabattre
encore. Ceux qui ont condamné Dolabella pour un acte de justice me
ménageront-ils, moi qui m'y suis joint d'intention? Enfin, c'est à vous
de peser s'il est de meilleur goût, s'il est plus dans l'intérêt de
notre parti, de venger la mort de César ou celle de Trébonius; s'il vaut
mieux nous entrégorger pour faire revivre une faction tant de fois
terrassée, ou nous entendre pour ne pas donner à rire à nos ennemis
communs? Qui que ce soit de nous qui succombe, sa chute leur sera
profitable. Quel spectacle! la fortune nous l'avait épargné jusqu'ici;
deux armées du même parti en venir aux mains, tandis qu'un Cicéron est
là pour jouer des coups comme un maître d'escrime! Il faut vraiment
qu'il ait la main heureuse! Vous prendre aux mêmes pièges ou lui-même
il s'est glorifié tout haut d'avoir fait tomber César! Mes résolutions
sont arrêtées : ne laisser outrager ni moi ni les miens; rester fidèle
au parti que détestait Pompée; ne pas souffrir qu'on dépossède les
vétérans, ni qu'on les traîne un à un au supplice; conserver à Dolabella
la foi jurée; rester l'ami de Lépide, le plus consciencieux des hommes;
ne pas trahir Plancus, qui a bien voulu faire cause commune avec moi. Si
les Dieux, comme, je l'espère, me secondent dans ma juste entreprise,
alors la vie aura de l'attrait pour moi : sinon, je me fais d'avance une
joie de vos supplices. Car si, tout vaincus qu'ils sont, les Pompéiens
montrent tant d'insolence, ils vous apprendront, à vos dépens, ce
qu'ils sont après la victoire. Voici mon dernier mot. Je pardonne à mes
amis, s'ils veulent eux-mêmes oublier les injures qu'ils m'ont faites,
on m'aider à venger César. Je ne crois pas que les députés se hasardent
sur le théâtre de la guerre. S'ils viennent, je saurai ce qu'ils
veulent.
827. - A BRUTUS. Rome, 13 avril.
B. 22. J'avais remis hier, 6 des ides d'avril, dans la matinée, une
lettre pour vous à Scaptius; le même jour, je reçus votre lettre, datée
de Dyrrachium, le soir des kalendes d'avril. Ce matin, Scaptius m'informe que
ma dépêche d'hier n'est pas en route, mais qu'elle va partir
à l'instant.
Je me hâte d'y joindre un mot, que je vous écris au milieu de ma
nombreuse réception du matin. Des succès de Cassius me charment; je m'en
réjouis pour la république et pour moi-même, qui, malgré l'opposition
et le dépit furieux de Pansa, ai fait confier à Cassius la conduite de
cette guerre. Je déclarai hardiment que déjà, sans attendre le
sénatus-consulte, Cassius l'avait commencée. Je dis aussi de vous tout
ce que je crus en devoir dire; et puisque vous prenez goût à mes
Philippiques, je vous enverrai mon nouveau discours. — Vous me consultez
sur ce que vous devez faire de Caius. Je suis d'avis qu'il reste votre
prisonnier, tant que nous ne serons pas hors d'incertitude sur Décimus.
Votre correspondance m'apprend que Dolabella commet toutes sortes
d'excès en Asie, et qu'il s'y conduit abominablement. Vous avez écrit à
diverses personnes que Rhodes lui avait fermé ses portes. Mais s'il
s'approche de Rhodes, il abandonne donc l'Asie? Dans ce cas-là, je crois
que vous devez rester en position où vous êtes : mais s'il s'est rendu
maître de l'Asie, croyez-moi, mettez-vous en mouvement.
828. — GALBA A CICÉRON. DU camp de Modène. 20 avril.
F. X, 30. C'est le 17 des kalendes de mai qu'on attendait Pansa dans
le camp
d'Hirtius. J'avais été à cent milles au-devant de lui pour hâter sa
marche, et je l'avais rejoint. Antoine fit avancer deux légions, la
seconde et la trente-cinquième, deux cohortes prétoriennes, la sienne et
celle de Silanus, et une partie des rappelés. C'était contre nous qu'il
dirigeait ces forces, persuadé que nous n'avions que quatre légions
toutes de recrues.
Mais, pendant la nuit, Hirtius, voulant favoriser votre entrée au camp,
nous avait envoyé la légion Martiale que je commande ordinairement, et
deux cohortes prétoriennes. A peine commençâmes-nous à apercevoir la
cavalerie d'Antoine, qu'il fut impossible de contenir la légion Martiale
et les cohortes. Nous cédâmes à leur ardeur, après quelques efforts
impuissants pour l'arrêter. Antoine avait caché ses troupes derrière
Forum-Gallorum, et ne voulait pas qu'on sût qu'il avait des légions. Il
ne mettait en avant que sa cavalerie et l'infanterie armée à la légère.
Pansa, voyant que la légion Martiale allait s'engager malgré lui, se
fit
suivre par deux légions de recrues. Lorsque nous eûmes passé les défilés
des marais et des bois, nous mîmes douze cohortes en ordre de bataille.
Les deux légions n'étaient pas encore arrivées. A ce moment Antoine
déboucha du village, démasqua toutes ses forces et fit attaquer. On se
battit d'abord de part et d'autre avec acharnement. Le premier choc de
l'aile gauche , ou j'étais avec huit cohortes de la légion Martiale, mit
en déroute la trente-cinquième légion d'Antoine , et la poursuivit plus
de cinq cents pas au delà du champ de bataille. M'apercevant bientôt
que la cavalerie ennemie cherchait à m'envelopper, j'ordonnai le
ralliement, et j'opposai mon infanterie légère aux cavaliers maures
ennemis pour les empêcher de nous tourner. Au milieu de ces mouvements,
je me trouvai tout à coup dans le gros des gens d'Antoine, que je vis
lui-même à deux pas derrière moi. Je n'eus que le temps de me couvrir de
mon bouclier, et de pousser vivement mon cheval du côté de la légion de
recrues qui venait du camp. Les gens d'Antoine me poursuivirent : les
nôtres leur lancèrent quelques traits. Enfin j'échappai je ne sais
comment, mais surtout grâce à nos soldats, qui me reconnurent sur-le-champ. C'est sur la
voie Emilienne même, où se trouvait la cohorte prétorienne de César, que
le combat dura le plus longtemps. Notre aile gauche, qui était plus
faible, n'étant composée que de deux cohortes de la légion Martiale et
d'une cohorte prétorienne, commença à lâcher pied, en se voyant prise à
revers par la cavalerie, qui fait la principale force d'Antoine.
Cependant les rangs parvinrent à se reformer, et nous nous dirigeâmes en
bon ordre, moi le dernier de tous, vers le camp. Antoine, qui
s'imaginait nous avoir vaincus, s'en regardait déjà comme maître. Il
attaqua, et perdit beaucoup de monde sans le moindre avantage,
Hirtius, averti de ce qui se passait, vint avec vingt cohortes de
vétérans couper la retraite à Antoine. Ce fut une défaite complète,
une déroute de toute son armée, la où l'on venait de combattre déjà,
près de Forum-Gallorum. A la quatrième heure de la nuit, Antoine et ses
cavaliers étaient rentrés dans leur camp devant Modène. Hirtius de son
côte regagna le camp que Pansa avait quitté le matin, y laissant deux
légions qu'Antoine y tenait resserrées. En résultat, nous avons fait
perdre à Antoine la plus grande partie de ses vétérans; mais ce n'est
pas sans avoir laissé de notre côté quelques soldats des cohortes
prétoriennes et de la légion Martiale. Nous avons pris deux aigles et
soixante enseignes. Tout le monde a fait son devoir.
829. — DE PLANCUS A CICÉRON. Des Gaules, avril.
F. X, 9. Non, je ne vous avais rien promis de trop, et vous ne vous étiez
pas vous-même trop avancé sur mon compte. Combien j'en suis heureux
!
Certes, je vous ai donné une grande preuve d'affection, en voulant que
vous fussiez le premier à connaître mes plans; et vous voyez
parfaitement, j'espère, combien de services je rends et combien tous les
jours j'en puis rendre encore. Quant à ce qui me touche personnellement,
mon cher Cicéron, que mon bras délivre d'abord la république des maux
qui la menacent ! Je me préoccupe peu des honneurs et des récompenses,
gages pourtant si flatteurs d'immortalité : l'espoir ne m'en serait pas
permis, que mes efforts et mon dévouement seraient encore les mêmes.
Si, entre un si grand nombre de citoyens, je ne me distingue pas par une
ardeur extraordinaire et quelque effort décisif, je repousse toute
proposition de récompense que vous voudriez faire en ma faveur. Je ne
demande rien, je désire même qu'on ne s'occupe pas de moi. Il me suffit
de vous avoir là. Vous jugerez les temps et les circonstances. A mon
avis, ce que la patrie donne à l'un de ses enfants ne vient jamais trop
tard, et n'est jamais trop peu. A la suite de marches forcées, mes
troupes ont passe le Rhône le 6 des kalendes de mai ; j'ai envoyé de
Vienne mille chevaux en avant par une route qui abrège. Si Lépide ne
vient pas contrarier mes opérations, j'arriverai à temps. Si, au
contraire, ma marche est inquiétée par son fait, j'agirai suivant les
circonstances. L'armée que j'amène est formidable par le nombre, par sa
composition et son excellent esprit. Aimez-moi toujours, je vous le
demande, mon cher Cicéron, si vous croyez que je vous aime. Adieu.
830. A QUNTUS CORNIFICIUS. Rome, avril.
F. XII, 25, 1ere partie. J'ai reçu votre lettre le jour des fêtes de
Bacchus, quoique Cornificius prétende l'avoir apportée le 21e jour. Il
n'y a eu séance au sénat, ni le 21e ni le lendemain ; mais on s'est
réuni le jour des quinquatrides, et on était fort nombreux. J'ai plaidé
votre cause. Je n'ai pas, comme on dit, parlé malgré Minerve, puisque le
même jour ma pauvre Minerve, protectrice de la ville, qu'un ouragan
avait renversée, a été rétablie par le sénat. Pansa a donné lecture de
vos lettres : un murmure d'approbation et de joie a aussitôt circulé
dans l'assemblée. Le Minotaure seul a rugi, je veux dire Calvisius et
Taurus. Le décret honorifique a été rendu. On avait demandé leur rappel
à l'ordre, mais Pansa, plus indulgent, a passé outre. — Quant à moi, mon
cher Cornificius, le jour où une lueur d'espoir pour la liberté est
rentrée dans mon âme, le jour où, au milieu de la torpeur universelle.
je jetai les fondements de la république, c'était le 13 des kalendes de
janvier; ce jour-là même, je pourvus à une foule de choses, et je
songeai en particulier à l'intérêt de votre gloire. Le sénat, vous le
savez, a ratifié toutes mes propositions sur la répartition des
provinces. Depuis, je n'ai cessé de me plaindre de ce qu'à votre
préjudice et au grand détriment de la république, on laissât une
province à un absent. J'insistai si opiniâtrement, je revins si fort
chaque jour à la charge, que j'ai forcé l'adversaire à venir à Rome en
dépit de lui-même; et là mes énergiques et florissantes attaques lui
ont arraché du même coup ses espérances et sa proie. Je jouis vivement, je vous assure, du beau caractère que
vous avez montré dans votre province et des magnifiques témoignages que
vous y avez reçus. — J'accepte votre justification sur Sempronius. Il y
a de ces moments où l'esclavage rend aveugle. Moi qui vous parle et de
qui vous reçûtes des conseils, moi qui fus si jaloux de votre honneur,
je me sentis emporté dans le tourbillon, et, la colère et le désespoir
dans l'âme, je fuyais vers la Grèce, lorsque, comme de bons citoyens,
les vents étésiens vinrent arrêter en quelque sorte le déserteur de la
république, et lui dire : Tu n'iras pas plus loin. L'aquilon me barra
passage, et d'un souffle violent me rejeta à Rhégium chez les gens de
votre tribu. Le vent et la rame m'eurent bientôt ensuite rendu à la
patrie; et le lendemain, quand tout courbait encore la tête, seul je me
réveillai libre. J'attaquai Antoine de front. L'ivrogne bondit, et
concentra sur moi sa rage. En vain chercha-t-il à m'attirer sous les
coups de ses sicaires, en vain me prépara-t-il des embûches, je le
lançai moi-même, tout écornant de rage et de vin, dans les filets de
César Octavianus. Cet admirable enfant ne manqua ni à son propre salut,
ni au mien, ni à celui de la république. Sans lui, le retour d'Antoine
de Brindes devenait fatal à la patrie. Vous n'ignorez pas, je pense ,
ce qui s'est passé. — Mais revenons au sujet qui m'a mené si loin. Oui,
j'accepte votre justification sur Sempronius. Peut-on se faire une
règle fixe au milieu de si grandes perturbations? « Chaque jour, dit
Térence, le temps modifie notre être et nous donne d'autres pensées. »
A bord,
mon cher Quintus, a bord avec nous! c'est à la poupe même qu'il faut
vous asseoir. Un seul et même vaisseau porte tous les bons citoyens.
Puissé-je le bien diriger! Puisse la traversée être heureuse, quels que
soient les vents ! Mon expérience ne fera pas faute à la manœuvre. La
vertu ne peut rien de plus. De votre côté, fortifiez, agrandissez votre
âme , et, dans votre pensée, ne séparez jamais votre existence de celle
de la république.
831. —
A CORNIFICIUS. Rome, avril.
F. XII, 25, 2e partie.
Me recommander à moi Luccéius mon ami? certes je ne
lui ferai faute en rien de ce que je puis. C'est une perte bien
malencontreuse que celle de nos collègues Hirtius et Pansa, de deux
consuls si utiles à la république. Nous sommes, il est vrai, délivrés des brigandages d'Antoine; mais
il reste tant de choses à faire! Je veillerai pour la république, s'il
plaît aux Dieux, jusqu'au dernier épuisement de mes forces affaiblies.
Rien n'a pouvoir contre le devoir et l'honneur. Je m'arrête : j'aime
mieux que les autres vous parlent de moi que de vous en parler moi-même.
Tout ce qui me revient de
vous satisfait à mes vœux les plus chers. Quelques-unes de vos lettres
portent aux nues Cn. Minueius. Il courait sur son compte des bruits assez
peu flatteurs. Dites-moi sincèrement ce qui en est, et tenez-moi au
courant de tout ce qui se passe là-bas.
832. —
A BRUTUS. Rome, 18 avril.
B.2. J'avais écrit et fermé ma lettre; j'en reçois une de vous pleine de
faits nouveaux et assurément bien extraordinaires : Dolabella a jeté
cinq cohortes dans la Chersonèse. Il ne pouvait plus tenir en Asie,
disait-on, et le voilà maître de pousser une pointe en Europe; mais
qu'espère-t-il faire avec cinq cohortes sur un point où vous pouvez agir
avec cinq légions, une cavalerie excellente et un corps
nombreux d'auxiliaires? C'est un acte de folie de ce brigand; et je me
flatte que déjà les cinq cohortes sont a vous. J'approuve fort que vous
ayez maintenu votre armée a Dyrrachium et Apollonie, tant que vous avez
ignoré la fuite d'Antoine, la sortie de D. Brutus et la victoire du
peuple romain. Vous m'écrivez que ces événements vous ont décidé à
marcher sur la Chersonèse, et à ne plus souffrir qu'un scélérat insulte
à la puissance romaine : c'est bien entendre votre honneur et l'intérêt
public. Quant à la sédition soulevée par les Antoines au sein de votre quatrième légion, vos soldats, soit dit
sans offense, en voulaient faire meilleure justice, .le me réjouis, au
surplus, que cette occasion ait fait éclater l'affection que vous
portent les légions et la cavalerie. Selon votre promesse, tenez-moi au
courant des nouvelles de Dolabella. Combien je m'applaudis aujourd'hui
de ma prévoyance, lorsque je vous fis
donner pleins pouvoirs pour décider seul ce qu'il faudrait y faire! Je
n'avais en vue que le bien de la république : il y aura aussi tout
profit pour votre gloire. J'étais, d'après votre lettre, fort à mon aise
pour prendre à partie les Autoines , comme je viens de le faire. Vous
m'approuvez pourtant de l'avoir entrepris, et je crois votre éloge
sincère; mais je repousse, sous tous les rapports, cette distinction
qu'il vaut mieux déployer de l'énergie à prévenir les. guerres civiles
que de s'acharner plus tard contre des vaincus. Je pense tout le contraire, mon cher Brutus, et
votre démenée ne me séduit pas. Une rigueur salutaire est plus efficace
qu'un vain étalage de douceur. Soyons cléments, et nous perpétuerons les
guerres civiles. Au reste, c'est à vous de décider; car je puis dire
avec le père dans le Trinummus de Plaute : « Je touche au terme de ma
carrière; ce sont tes intérêts plus que les miens. » Croyez-moi , vous
êtes perdu, si vous ne changez de mesures. Vous ne trouverez pas toujours
le peuple, le sénat, le guide du sénat dans les mêmes dispositions.
Recevez cet oracle comme sorti du trépied de Delphes : Apollon n'en rend
pas de plus infaillibles.
833 — A BRUTUS, Rome, 19 avril.
B. 25. Votre famille, à qui vous n'êtes pas plus cher qu'à moi, vous aura
sans doute écrit au sujet de lettres qu'on a lues dans le sénat aux ides
d'avril, sous votre nom et sous celui de Caius. Il n'était pas
nécessaire que tout le monde vous écrivît les mêmes choses ; il l'est
que je m'explique avec vous sur la nature de cette guerre, ainsi que sur
la manière dont je l'envisage et la juge. — En politique générale,
Brutus, nos vues ont été constamment les mêmes; mais quelquefois, je ne
dis pas toujours, j'aurais voulu plus de vigueur dans les mesures. Vous
savez comme je comprenais le salut de la république: guerre à mort, non
pas seulement au tyran , mais à la tyrannie. Vous fûtes plus modéré, à
votre gloire immortelle. Mais il y avait mieux à faire. C'est ce que me
disait alors un pressentiment douloureux ; c'est ce que nos périls ne
confirment que trop aujourd'hui, La paix, la paix ! disiez-vous, aux premiers jours; comme si on l'obtenait avec des
paroles. Moi je rapportais tout à la liberté, qui n'est rien sans la
paix, j'en conviens; mais cette paix , il fallait, selon moi, l'arracher
à la pointe de l'épée. Ni les sympathies, ni les bras ne manquaient;
mais nous avons retenu l'élan, étouffé l'enthousiasme. Enfin , nous nous
sommes fait une position si fausse, que, sans l'intervention d'Octave,
inspiré par le ciel même, il nous fallait subir le joug d'Antoine, le
plus vil et le plus dégradé de tous les hommes. Au moment ou j'écris,
quelle lutte n'avons-nous pas encore à soutenir contre lui ! Tout était
fait si on ne l'eût pas épargné. Mais passons : un acte mémorable, un effort divin, doit vous
placer au-dessus du blâme comme il est
au-dessus de l'éloge. -- Depuis peu, votre front s'est rembruni. Vous
avez pris sur vous de recruter, d'armer, d'improviser des légions.
Quelle nouvelle, grands Dieux! quel accueil à votre message! que de joie
au sénat! quels transports dans le peuple ! Jamais applaudissements
plus unanimes. Il restait à en finir avec Caius, à qui vous veniez
d'enlever sa cavalerie et la meilleure partie de ses légions. Nouveau
succès qui a comblé les espérances. Le sénat put apprécier par votre
rapport tout ce que le général avait montré de talent, le soldat de
courage, vos officiers, et mon fils avec eux, de conduite et d'habileté.
On était au fort de l'agitation qui a suivi le départ de Pansa, et vos
parents ne voulurent pas qu'il fût ouvert de proposition. Autrement des
actions de grâces eussent été rendues, par décret, aux Dieux immortels
avec un éclat proportionné à de tels services. Mais ne voilà-t-il pas
que, le matin des ides d'avril, arrive en diligence Pilus chargé d'un double message
! Quel homme,
grands Dieux ! quelle noblesse ! quel dévouement à la bonne cause! Il
apporte deux lettres: l'une de vous, l'autre de Caïus. Il les remet
à Servilius, tribun du peuple; celui-ci, à Cornutus. Ou les lit au sénat.
« Antoine, proconsul. » Étonnement général! Les mots , Dolabella,
imperator, n'auraient pas produit plus de sensation, car Dolabella
aussi venait d'écrire. Mais lui n'avait pas trouvé de Pilus pour se
charger de son épître et pour oser la remettre aux magistrats. On arrive
à votre lettre, qui était courte et singulièrement indulgente pour
Caius. La stupeur redouble. Je ne savais quel parti prendre. Déclarer la
lettre supposée? mais si vous veniez à l'avouer plus tard ! la
reconnaître comme de vous? c'était vous compromettre : je gardai le
silence. Le lendemain , affaire ébruitée. Pilus était vu du plus mauvais
œil. Je me décidai à entamer le débat, et je me donnai carrière sur le
proconsul Caius : Sextius m'appuya fortement. Nous causâmes plus tard,
et je le vis très-préoccupé de l'hypothèse fâcheuse où son fils et le
mien auraient effectivement pris les armes contre un proconsul. Vous le
connaissez; jugez s'il me seconda franchement. D'autres prirent aussi la
parole. Notre Labéon remarqua que la lettre ne portait pas votre cachet
; qu'elle était sans date; et que, contrairement à votre usage, vous ne
l'aviez accompagnée d'aucune lettre particulière. II en voulait induire
que la dépêche était fausse; et s'il faut vous le dire, c'est la
conclusion que tout le monde a tirée. — Maintenant, mon cher Brutus,
c'est vous qui déciderez du caractère à donner à toute cette guerre. La
douceur, je le vois, a de l'attrait pour vous, et vous la considérez
comme un moyen fécond en politique. Cette disposition vous honore. Mais
la clémence, croyez-en l'histoire et la raison, veut, pour se déployer,
de tout autres conjonctures; car enfin, quelle est la position? Une
tourbe de misérables, de gens perdus menace jusqu'aux temples des Dieux
immortels. Il ne s'agit pour nous de rien moins que d'être. De la
clémence ! et pour qui? quel intérêt nous préoccupe? Celui de gens qui,
vainqueurs, anéantiraient jusqu'à notre souvenir. Quelle différence, je
vous prie, entre Dolabella et celui qu'on voudra des trois Antoines?
Indulgents pour un de ceux-ci, nous aurons été cruels pour Dolabella.
Telle est l'opinion que j'ai puissamment contribué à enraciner dans
l'esprit du sénat et du peuple; opinion que, à défaut de mes conseils et
de mon influence, la force des choses eût invinciblement établie. Si
vous persistez à suivre un plan de conduite opposé , je vous seconderai
encore de tout mon pouvoir; mais je garderai mon opinion. On n'attend de
vous ni faiblesse ni cruauté. Entre ces deux extrêmes, il est un terme
moyen facile à saisir; et le voici : Sévérité pour les chefs, indulgence
pour les soldats. — Mon cher Brutus, rapprochez de vous mon fils le plus
possible. Il n'est pas de meilleure école pour lui que vos exemples et
le spectacle de vos vertus.
834. — BRUTUS A CICERON. De la Macédoine, avril.
B. 11. Je connais les sentiments de Vetus Antistius, et je suis sûr que,
pour lutter contre César et Antoine avec toute l'énergie d'un défenseur
de la liberté, il ne lui a manqué que
l'occasion. On l'a vu en Achaïe, où Dolabella avait une force imposante
et de la cavalerie, refuser des subsides à ce brigand et le braver en
face, aux risques de sa vie; et le même homme qui résistait à cette
exaction, quand il pouvait donner à sa condescendance l'excuse de la
contrainte, venait spontanément nous offrir et nous compter deux
millions de sesterces; il a fait plus, il nous a offert son bras et est
venu se joindre lui-même à nous. Je l'avais presque persuadé de rester
dans mon camp, avec son titre de général, pour défendre la république;
mais il a résolu de partir, par la raison qu'il a de fait remis son
commandement; il m'a promis toutefois, aussitôt qu'il en aura reçu la
mission officielle , de revenir prendre un commandement sous mes ordres,
à moins que les consuls n'assemblent les comices prétoriens. Touché d'un
si pur civisme, je l'ai engagé de toutes mes forces à ne pas différer sa
candidature. La conduite de Vetus doit être applaudie de ceux du moins
qui regardent mon armée comme l'armée de la république; elle doit vous
charmer surtout, vous dont le noble courage et la gloire sont les appuis
de la liberté, vous à qui tant d'honneur est réservé si la fortune
seconde nos desseins et nos vœux. Je vous prie donc, en mou propre nom
et comme votre ami, mon cher Cicéron, de vous attacher à Vetus, et de
travailler de tous vos efforts à lui faire la position la plus
considérable. Rien, sans doute, n'est capable de l'ébranler dans le
parti qu'il a pris. Pourtant vos éloges et vos bontés ne peuvent manquer
de le lier plus invinciblement encore à ses propres sentiments. Vous
aurez un titre de plus à ma reconnaissance.
835. A BRUTUS, Rome, avril.
B. 19. Au moment ou je vous écris, chacun croit à l'imminence
d'une catastrophe. Les lettres et les courriers apportent à la fois de
mauvaises nouvelles de Décimus. Cependant je n'en suis pas grandement
troublé. Avec des soldats et des généraux tels que les nôtres, il m'est
impossible de manquer de confiance et de m'associer aux alarmes du plus
grand nombre des citoyens. Je sais qu'on suspecte la fidélité des
consuls, mais moi je ne la révoque pas en doute : je voudrais seulement
leur voir un peu plus de prudence et de fermeté. S'ils en avaient
montré, la république serait aujourd'hui rétablie. Vous n'ignorez pas
quel est en politique le prix d'un moment, et quelle différence il y a
du jour au lendemain pour décider une chose, pour l'entreprendre, pour
l'exécuter. Si nos troubles durent encore, ce n'est pas faute de mesures
vigoureuses. Que n'a-t-on su les prendre le jour même ou je les avais
proposées? Mais on tergiversa d'un jour à l'autre. Si du moins quand on
eut commencé d'agir, on eût agi avec suite, sans rien remettre au
lendemain, il n'y aurait plus de guerre aujourd'hui. J'ai fait pour la
république, mon cher Brutus, tout ce que devait faire un homme aussi haut
placé dans l'estime du sénat et du peuple-le dévouement, l'activité, le
patriotisme, sont d'obligation pour tous les citoyens, il n'est permis à
personne d'en manquer; mais je pense que pour ceux qui sont à la
tête de
l'État, la prudence n'est pas moins indispensable. Quand je me suis
senti assez sûr de moi-même pour saisir le gouvernail, j'ai compris que
toute proposition de fausses mesures me rendrait aussi coupable que des conseils infidèles. Vous êtes au courant
de ce qui s'est fait et de ce qui se passe; mais je veux que vous
sachiez de moi que toute ma confiance est dans une bataille. En avant
donc! et sans me ménager une retraite, à moins que l'intérêt de Rome ne
me commande de faire un pas en arrière. C'est vous dire que la plupart
de mes pensées s'arrêtent sur vous et sur Cassius. Tenez-vous prêt à
tout événement, mon cher Brutus : en cas de succès, vous aurez à mettre
la république sur un meilleur pied ; en cas de revers , vous la ferez
recouvrer.
836. — A BRUTUS.
Rome, 11 avril.
B. 3. Vous avez su que nos affaires prenaient un meilleur tour; car je me
suis assuré qu'on vous a mandé le détail des événements. Ce que je vous
ai souvent écrit des consuls se trouve aujourd'hui justifié par leur
conduite. Il y a de merveilleuses qualités dans la jeune âme de César.
Puisse l'éclat des honneurs er la faveur populaire ne pas le rendre
moins docile à la main qui l'a gouverné, jusqu'à ce jour ! La tâche, il
est vrai, devient plus délicate; mais je suis loin d'en désespérer.
C'est chez lui une conviction (et je n'ai pas peu contribué à la faire
naître) que notre salut est son ouvrage. En effet, s'il n'eût pas réussi
a refouler Antoine qui marchait sur Rome, tout était perdu. Trois ou
quatre jours avant ce grand succès, c'était comme un débordement de la
population entière , qu'une terreur subite précipitait vers vous,
hommes, femmes, enfants. Rome enfin , rassurée par la journée du 12 des
kalendes de mai, vous aurait volontiers vu venir dans son sein, mais
n'aurait plus couru elle-même s'abriter sous vos pavillons. Dans cette journée mémorable, j'ai recueilli le prix de mes longs
travaux et de toutes mes veilles, si c'est une récompense que la
véritable et solide gloire. Une multitude prodigieuse, tout ce que Rome
contient d'habitants, s'est portée à ma demeure , m'a escorté jusqu'au
Capitole, et je me suis vu hisser à la tribune au milieu des transports
et des applaudissements. Je n'ai point de vanité et n'ai pas le droit
d'en avoir; cependant le concert de tous les ordres, ces témoignages de
reconnaissance, ces félicitations unanimes me causent une vive émotion.
Je sens qu'il est beau d'être populaire, quand on l'est, comme moi,
pour avoir sauvé le peuple ; mais j'aime mieux que ces détails vous
viennent d'une autre main. — Faites-moi savoir exactement où vous en
êtes et ce que vous vous proposez de faire; surtout prenez garde que
votre généreuse indulgence ne soit taxée de faiblesse. Car c'est le
sentiment du sénat, c'est celui du peuple romain , que si jamais ennemis
méritèrent le dernier supplice, ce sont les citoyens qui, dans cette
guerre, ont pris les armes contre la patrie. Je les attaque, je les
poursuis sans relâche dans mes discours , et j'ai l'assentiment de tous
les gens de bien. Votre opinion sur cette matière ne doit avoir d'autre
juge que vous-même. Quant à moi, je pense que la cause des trois frères
n'est qu'une seule et même cause. — Nous avons perdu les deux consuls,
braves gens sans doute, mais rien de plus. Hirtius est mort au sein même
de la victoire, peu de jours après avoir gagné une grande bataille;
Pansa reçut dans l'action des blessures qui le forcèrent de se retirer,
et auxquelles il succomba. Décimus et le jeune César poursuivent les
restes de nos ennemis. Un sénatus-consulte a déclaré
tels tous ceux qui ont pris parti pour Antoine; et, suivant l'opinion
dominante, cette disposition s'applique tant à vos prisonniers de guerre
qu'à ceux qui sont venus se rendre à vous. — Je n'ai pas fait de
proposition rigoureuse contre Caïus en le nommant dans le sénat, qui ne
peut, selon moi, s'occuper de cette cause que sur votre rapport.
837. — DÉCIMUS BRUTUS A CICÉRON.
Au camp de Régium, 29 avril.
F. XI, 9. Vous comprenez tout ce que peut avoir de funeste pour la
république la perte de Pansa. C'est à vous à redoubler d'efforts et de
prudence pour empêcher que la mort des deux consuls ne redonne confiance
à nos ennemis. Je tâcherai, de mon côté, qu'Antoine ne puisse tenir en
Italie. Je me mets de ce pas à sa poursuite. Ventidius ne pourra
m'échapper, j'espère, et je me hâte de purger le sol italique de la
présence d'Antoine. Toute chose cessante, envoyez, je vous en conjure,
envoyez auprès de Lépide : c'est une tête à tous vents. Qu'il n'aille
pas nous faire recommencer la guerre, en se joignant à Antoine. Vous
devez savoir ce qu'on peut attendre d'Asinius Pollion. Lépide et lui ont
beaucoup de légions, tous bons et vaillants soldats. Je n'ai pas, en
parlant ainsi, la prétention de vous instruire de ce que vous savez
aussi bien que moi; mais ma profonde conviction est que Lépide ne
marchera jamais droit. Peut-être vous autres ne pensez-vous pas ainsi.
Ne négligez pas Plancus, je vous en supplie. Après la défaite d'Antoine,
il est impossible qu'il fasse défaut à la république. Dans le cas où
Antoine se jetterait au delà des Alpes, mon intention est d'en faire
occuper tous les passages. Je vous tiendrai au courant. Le 3 des
kalendes de mai.
838— D BRUTUS A CICÉRON.
Dertona, en Ligurie, 5 mai.
F. XI, 10. Non, la république ne m'a pas plus d'obligations que je ne
vous en ai moi-même. Vous êtes bien persuadé que je suis plus capable de
reconnaissance pour vous que ces mauvais citoyens ne le sont pour moi;
et ce n'est point sous l'impression du moment que je déclare préférer
votre jugement à celui de tous ces ingrats (Allusion
à la froideur du sénat pour Decimus Brutus.). Vous me jugez, vous,
par des règles certaines de raison et de vérité : l'excès de la
malveillance et de l'envie aveugle les autres. Qu'ils se mettent donc à
la traverse pour me priver des honneurs qui me sont dus; mais au moins
qu'on me laisse libre de servir la république. Je vais vous expliquer
aussi brièvement que possible combien ses dangers sont grands. Vous
savez d'abord mieux que personne quelle perturbation la mort des consuls
jette dans les affaires de Rome, et combien elle met enjeu d'ambitions!
J'en dis assez pour une lettre, je pense; je sais à qui j'écris.
J'arrive maintenant à Antoine. Il n'était accompagné, dans sa fuite, que
d'une poignée de soldats sans armes; mais en ouvrant les prisons, en
prenant toute espèce de gens, il est parvenu à se former un noyau assez
fort. Ce noyau s'est grossi des troupes de Ventidus, qui, après les
marches les plus pénibles pour traverser les Alpes , est arrivé au gué ,
où il a fait sa jonction avec Antoine. Bon nombre de vétérans
el de volontaires armés marchaient avec Ventidius. Antoine prendra
nécessairement l'un de ces partis : ou il se jettera dans les bras de
Lépide, si Lépide veut le recevoir; ou il occupera la ligne des Apennins
et des Alpes, pour lancer de là sa cavalerie partout où elle pourra
faire ravage; ou enfin il se portera de nouveau vers l'Etrurie, qui est
la seule partie de l'Italie dégarnie de troupes. Si César avait voulu
m'entendre et passer les Apennins, j'aurais serré Antoine de si près,
que la faim m'en eut fait raison plutôt encore que le fer; mais César ne
reçoit d'ordres de personne, et son armée n'en reçoit pas de lui ; ce
qui est doublement déplorable. Voilà où nous en sommes : qu'on s'oppose
tant qu'on voudra, je le répète, à ce qui me concerne personnellement ,
pourvu que la position ne se complique pas, et que vous ne trouviez pas
trop de résistance lorsque vous voudrez pourvoir à ses nécessités. Je
n'ai plus le moyen de nourrir mes soldats. Au moment où je me mis à
l'œuvre, je possédais au delà de quatre millions de sesterces;
aujourd'hui il ne me reste plus un sou de fortune, et presque tous mes
amis sont criblés de dettes pour être venus à mon secours. J'ai sept
légions à entretenir ; ce n'est pas peu de chose, vous pouvez le croire.
Les trésors de Varron n'y suffiraient point. Aussitôt que j'aurai des
nouvelles positives d'Antoine, je vous en ferai part. Aimez-moi comme
vous savez que je vous chéris moi-même.
839. — A BRUTUS. Rome, 5 mai.
B. 5. Le 5 des kalendes de mai, on
a délibéré sur les moyens de faire la guerre à ceux qui avaient été déclarés
ennemis publics; Servilius parla d'ajouter à la liste Ventidius, et de
faire marcher Cassius contre Dolabella : j'appuyai sa proposition. Je
fis décider en outre que vous pourriez aussi vous-même attaquer
Dolabella, si vous jugiez utile de porter sur ce point les armes de la
république; mais, que, dans le cas où vous y verriez des inconvénients,
ou trop peu d'avantage, vous garderiez vos positions. Le sénat ne
pouvait plus hautement faire éclater son estime qu'en vous laissant
ainsi juge absolu des intérêts de l'État. Mon opinion à moi est que si
Dolabella dispose de forces imposantes, s'il a un camp ou quelque point
d'appui, il est de votre devoir, de votre honneur de le pousser à
outrance. Nous ne savons rien de l'armée de Cassius. Point de lettres de
lui , ni même de nouvelles dignes de foi. Vous comprenez sans doute
combien il importe d'écraser Dolabella, tant pour faire enfin justice de
ses crimes, que pour priver de tout refuge les chefs de bandits échappés
au désastre de Modène. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je tiens ce
langage. Reportez-vous à mes lettres précédentes. Alors cependant nous
n'avions que votre camp pour retraite, pour sauvegarde que votre armée.
Nous voici, je l'espère, hors de crise. Raison de plus pour nous occuper
sérieusement d'anéantir Dolabella. Mais vous y réfléchirez, et la
sagesse dressera vos plans. Vous me ferez connaître, si vous le jugez
convenable, et votre détermination et la suite que vous y aurez donnée. — Je
voudrais bien voir porter mon fils pour une place dans votre collège; car
aux comices pour le sacerdoce, l'absence, à mon avis, ne détruit pas
l'éligibilité. Les précédents sont en ma faveur. Marius était en
Cappadoce quand la loi Domitia le fit augure, et je ne connais pas de
loi subséquente qui ait dérogé à celle-là. Je m'appuie d'ailleurs de ce
texte de la loi Julia, la plus récente de toutes sur la matière : Celui qui demande ou celui qu'on jugera digne; alternative qui
implique aptitude de la part des absents. J'en ai écrit à mon fils, avec
recommandation de suivre votre avis en cela comme en toute chose. Vous
avez aussi à statuer sur Domitius et sur le jeune Caton mon pupille.
Après tout, si l'absence n'emporte pas exclusion, il y a de fait plus de
chances à se présenter en personne; mais comment faire paraître nos
jeunes gens aux comices, si vous vous déterminez à passer en Asie? Que
Pansa n'est-il encore vivant! L'affaire marcherait d'elle-même, car il
se serait aussitôt donné un collègue, et l'on aurait pu procéder à
l'élection des prêtres sans attendre les comices prétoriens. Aujourd'hui
j'appréhende que les auspices ne nous causent bien du retard , le droit
de les prendre ne pouvant revenir au sénat tant qu'il restera un seul
magistrat patricien. N'est-ce pas une véritable confusion? Un mot de
votre opinion sur tout cela.
840. — A PLANCUS. Rome, mai.
F. X, 14. Oh! quelle bonne nouvelle s'est répandue deux jours avant la
victoire : Que vos secours nous arrivaient, que vous accouriez plein de
patriotisme et d'ardeur, que vos forces étaient imposantes! Les ennemis
ont été dispersés, mais
notre espérance est encore en vous. Les principaux chefs de ces brigands
ont, dit-on , échappé au combat de Modène. Il n'y a pas moins de mérite
à mettre le dernier sceau à la victoire
: qu'à porter les premiers coups à l'ennemi. J'attends de vos nouvelles
avec une impatience que beaucoup d'autres partagent. J'espère que
Lépide, éclairé par la position et les nécessités du moment, va s'unir
intimement à vous et à la république. Faites votre unique affaire, mon
cher Plancus, du soin d'anéantir jusqu'à la dernière étincelle de cette infâme guerre. Si vous y réussissez, vous aurez
été un dieu pour la république, et votre nom sera couvert d'une gloire
immortelle.
841. — D. BRUTUS A C1CÉRON. De la Ligurie, mai.
F.XI, 11. Le double de la lettre que m'ont apportée mes esclaves m'est
parvenu. Je vous ai tant d'obligations, que je ne pourrai jamais
m'acquitter envers vous. Je vous ai fait connaître notre situation.
Antoine est en route. Il va joindre Lépide, et il ne désespérait pas
encore de gagner Plancus. J'en ai la certitude par ses papiers qui sont
tombés dans mes mains, et où j'ai trouvé les noms des affidés qu'il
devait envoyer à Asinius, à Lépide et à Plancus. Je n'ai pas la moindre
inquiétude sur Placeus, et je lui ai à l'instant même dépêché un exprès.
Dans deux jours, j'attends les députés des Allobroges et de toute la
Gaule; je les renverrai chez eux, après m'être assuré de leurs
dispositions, dont je réponds. De votre côté, pourvoyez à toutes les
nécessités. Que rien ne se fasse que par vous, et pour le plus grand
avantage de la république. Il y a bien de la malveillance contre moi.
Empêchez-la, si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez point,
consolez-vous en pensant que tous leurs outrages ne sauraient me faire
broncher. La veille des nones de mai ; de mon camp, près
d'Aquœ-Statiellœ.
842. — CASSIUS A SON CHER CICÉliON.
De l'Asie, 7 mai.
F. XII, 12. J'ai lu votre lettre, et je vois combien vous m'aimez : ce ne
sont plus les simples mouvements de cet intérêt qui ne m'a jamais manqué
non plus qu'à la république, c'est une préoccupation énergique et active
sur tout ce qui se passe de ce côté, c'est une vive inquiétude sur moi
personnellement. Je savais bien d'avance que vous ne me croiriez pas
capable d'assister, les bras croisés, à la ruine de la république, et
que vous ne pourriez me supposer engagé dans des entreprises, sans
éprouver des alarmes pour ma sûreté, et pour le succès de mes desseins.
A peine eus-je reçu les légions que A. Alliénus a ramenées d'Egypte, que
je vous ai écrit et que j'ai expédié des courriers à Rome. J'ai
écrit aussi au sénat, avec ordre de vous communiquer mes dépêches avant
de me les remettre. J'espère qu'on n'y aura pas manqué. Si elles ne vous
sont point parvenues, ce ne peut être que du fait de Dolabella, qui,
étant maître de l'Asie depuis l'abominable assassinat de Trébonius, peut
arrêter les courriers et intercepter les lettres. J'ai réuni sous mes
ordres toutes les troupes de Syrie. S'il y a eu un peu de retard dans
mes opérations, c'est que j'avais des engagements avec les soldats et
qu'il fallait y pourvoir. Mais je suis maintenant en mesure. J'ai la
confiance que vous voudrez être mon patron à Rome; vous êtes témoin que
mon patriotisme n'a reculé devant aucun effort, devant aucun péril, pour le salut de la république ; que c'est sur vos
conseils et à votre instigation que j'ai pris les armes contre ces
infâmes brigands; que j'ai formé une armée pour défendre la république
et la liberté, et que cette armée je l'ai enlevée à d'abominables
oppresseurs. Si je m'étais laissé prévenir par Dolabella, le bruit de
son arrivée, l'idée et l'espérance d'un renfort, auraient suffi pour
redonner de la vie à Antoine. — Devenez donc, je vous en conjure, par
tous ces motifs, devenez le protecteur de mes soldats. Vous comprenez ce
que leur dévouement à la patrie a d'admirable. Faites qu'ils ne se
repentent pas d'avoir préféré la république à l'appât du vol et du
pillage. Ne manquez pas surtout de faire valoir la belle conduite de
Murcus et de Crispus, imperators. Ce misérable Bassus refusait de me
livrer sa légion ; et si ses soldats ne m'eussent envoyé une députation
malgré lui, il m'aurait fallu emporter de vive force Apamée, dont il
avait fermé les portes. C'est au nom de la république que je vous parle,
mon cher Cicéron; de la république que vous avez toujours tant aimée. Je
vous parle aussi au nom de l'amitié, qui a, je ne l'ignore pas, tant de
pouvoir sur votre âme. Mon armée est l'armée du sénat, l'armée des gens
de bien, la vôtre surtout. Elle entend parler sans cesse de vos bons
sentiments pour elle, et elle apprend ainsi à s'attacher à votre nom, à
le chérir. Pour elle, c'est déjà tout que de vous avoir pour défenseur
et pour ami. — Ma lettre écrite, j'apprends l'arrivée de Dolabella en
Cilicie avec ses troupes. Je pars pour l'y rejoindre. J'aurai soin de
vous informer aussi vite que possible de mes opérations. Puissé-je être
assez
heureux pour bien mériter de la république! Portez-vous bien et
aimez-moi toujours.
843. — PLANCUS A CICÉRΟΝ. Des Gaules, mai.
F. X, 11. Je vous rends et vous rendrai jusqu'à mon dernier soupir
d'immortelles actions de grâces. Comment m'acquitterais-je jamais
autrement envers vous? Tant de bienfaits ne peuvent se payer; il n'y a
pour y répondre, ainsi que vous l'avez dit vous-même avec tant de
sentiment et de bonheur, il n'y a que le souvenir éternel que mon cœur
en conservera. Vous n'auriez pas agi avec plus d'affection même pour un
fils. Je sais tout, et cette perspective infinie que vos premiers
discours offraient à ma jeune ambition, et ces paroles que vous sûtes si
bien approprier ensuite aux circonstances des temps et aux exigences de
mes amis, et vos éloges dans toutes les occasions, et vos luttes avec
mes détracteurs. Non, je ne ferai pas faute à vos louanges. La
république verra mes efforts, et l'amitié me trouvera fidèle. C'est avons
à continuer votre ouvrage, et, si je réponds à votre pensée, si je
remplis vos souhaits, à vous constituer partout mon défenseur et mon
patron. — J'avais passé le Rhône avec mes troupes, fait prendre les
devants à mon frère à la tête de trois mille chevaux, et je me dirigeais
de ma personne vers Modène, lorsque j'appris, en chemin, la bataille, la
levée du siège et la délivrance de Brutus. Antoine n'a plus d'autre
ressource que de se jeter par ici avec les débris de ses troupes. Il a
encore deux chances, l'armée de Lépide et Lépide lui-même. Une partie de
cette armée est aussi mauvaise que celle d'Antoine; aussi ai-je cru de
voir rappeler ma cavalerie. Moi-même j'ai fait halte dans le pays des
Allobroges; j'y suis eu bonne position et prêt à agir suivant les
circonstances. Si
Antoine se présente seul, il me sera facile d'en avoir raison et de
mener les choses à votre satisfaction, quand même l'armée de Lépide lui
aurait ouvert ses rangs. Mais s'il amène avec lui quelques troupes, et
si les vétérans de la dixième légion, que j'avais ramenée comme les
autres à leur devoir, s'insurgent de nouveau, je ne songerai qu'à ne pas
me laisser entamer. Je saurai, j'espère, donner le temps aux autres
troupes d'arriver, et de faire leur jonction avec moi. Nous serons alors
en mesure d'écraser ces misérables. Ni le cœur ni le zèle ne me
manqueront, je vous le garantis, mon cher Cicéron; il faut en finir.
Tant qu'il subsistera le moindre sujet d'inquiétude, je ne veux pas
qu'il soit dit qu'un seul d'entre vous ait montré plus de courage,
d'ardeur et de persévérance que moi. Je ne néglige rien pour obtenir le
concours de Lépide. S'il est franc et sincère, je suis prêt à m'effacer.
J'ai pris près de lui pour négociateurs et pour agents mon frère,
Latérensis et notre ami Furnius. J'oublie tous mes griefs. Pour sauver
l'empire, je donnerais la main à mon plus mortel ennemi. Si je ne gagne
rien sur Lépide, je ne perdrai pas courage, je redoublerai d'efforts au
contraire pour que vous soyez content de moi, et ma gloire n'en sera que
plus brillante. Portez-vous bien et aimez-moi comme je vous aime.
844. — PLANCUS A C1CÉRON. Des Gaules, mai.
F. X, 15. Il est utile de vous tenir au courant
de ce qui s'est passé depuis ma lettre écrite. Mes soins seront, je m'en
flatte, de quelque profit pour moi-même et pour la république. J'avais
échangé plusieurs notes avec Lépide, je lui proposais de déposer nos
rivalités, d'accepter une réconciliation franche, et de travailler
de concert au salut commun. Vous devez faire plus de cas, disais-je, de
vos enfants, de la patrie, de vous-même, que d'un vil et ignoble bandit.
J'ai ajouté que, s'il déférait à mon vœu , il pouvait compter sur moi en
tout et pour tout. La négociation a été suivie par Latérensis. Lépide
m'a donné sa parole que si Antoine mettait le pied dans sa province, il
lui ferait bonne guerre. Il m'a demandé de réunir mes forces aux
siennes, observant qu'Antoine a une bonne cavalerie, et que la sienne
peut à peine compter. Dix de ses meilleurs escadrons sont venus, il y a
quelques jours, se ranger sous mes drapeaux. Les moments étaient
précieux, il fallait profiter des bonnes dispositions de Lépide. Les
avantages de notre jonction sont clairs : j'ai une cavalerie qui peut
tenir tête à celle d'Antoine et l'écraser. De plus, j'agis par la
présence de mon armée sur la partie gâtée et mauvaise de celle de
Lépide. J'espère du moins la contenir. En vingt-quatre heures un pont a
été jeté sur l'Isère, grand fleuve qui baigne la frontière des
Allobroges, et le 4 des ides de mai j'y ai fait passer mon armée : en
même temps, sur l'avis que Lucius Antoine avait poussé une
reconnaissance jusqu'à Forum-Julii avec de la cavalerie et des cohortes,
j'ai fait partir mon frère le 5 des ides, à la tête de quatre mille
chevaux, pour aller à sa rencontre. Je le suivrai moi-même
à marches forcées avec quatre légions, sans bagages, et le reste de ma
cavalerie. Pour peu que la fortune de Rome me favorise, ces misérables
trouveront ici leur tombeau, et nous, la fin de nos peines. Si ce
bandit, averti trop tôt de mes mouvements, parvient à gagner encore une
fois l'Italie, ce sera à D. Brutus à lui courir sus. Le courage et le
zèle ne lui manqueront pas, j'en réponds, .l'enverrai, dans ce cas, mon
frère a la poursuite d'Antoine avec de la cavalerie, afin que l'Italie
n'ait pas trop à souffrir des excès de ces brigands. Ayez soin de votre
santé et aimez-moi comme je vous aime.
845. — BRUTUS A CICERON,
de son camp, mai.
B. 4. L'extrême joie que m'ont causée les succès de notre cher Décimus
et des consuls est plus facile à imaginer qu'à peindre. Il faut se
féliciter et se réjouir de tout ce qui est arrivé, et particulièrement
de cette sortie de Brutus qui a si bien tourné pour lui-même, en
décidant de la victoire. Vous regardez, dites-vous, la cause des trois
Antoines comme une seule et même cause, et vous m'en laissez juge. Voici
ma décision : c'est au sénat et au peuple romain qu'il appartient de
statuer sur le sort des citoyens que les combats ont épargnés. A tort,
direz vous, j'appelle citoyens des hommes qui nourrissent des sentiments
hostiles contre la république. Rien de plus juste, au contraire. Tant
que le sénat n'a pas délibéré, tant que la volonté du peuple ne s'est
pas fait connaître, je ne m'arroge pas le droit de rien préjuger, et je
n'usurpe point une autorité arbitraire. Je ne me fais nul reproche à l'égard de mon prisonnier;
aucun motif ne me commandait de sacrifier Caïus. Je ne lui ai rien
enlevé par cruauté, rien accordé par faiblesse; je l'ai retenu captif
tant qu'a duré la guerre. Il est plus honorable, selon moi, et plus
conforme à l'esprit d'une république de ne pas aggraver le sort des
malheureux, que de prodiguer sans mesure aux puissants tout ce qui peut
exciter les ambitions et autoriser les exigences. Sur ce point, mon cher
Cicéron, vous, le meilleur et le plus courageux des hommes, vous, à qui
je suis si légitimement attaché par inclination et par patriotisme, vous
vous abandonnez trop à vos confiantes illusions, vous vous hâtez trop, au
moindre service rendu, de tout donner et de tout permettre; comme si le
cœur, échauffé par ces profusions corruptrices, ne pouvait aisément
devenir un foyer de mauvaises passions. Un esprit bien fait comme le
vôtre ne pourra que prendre en bonne part ces avis, dictés par l'intérêt
public. Suivez, au surplus, votre façon de voir : c'est ce que je ferai
moi-même, après que vous m'aurez éclairé. Mais il est temps d'agir, mon
cher Cicéron ; sans quoi la défaite d'Antoine ne nous aura causé qu'une
vaine joie, et le mal détruit fera renaître un mal plus funeste encore.
Nul revers désormais, sans qu'on nous accuse tous d'imprévoyance ou de
pusillanimité, sans qu'on vous accuse, vous surtout, que la complaisance
ou plutôt l'aveu décidé du sénat et du peuple investit de toute
l'autorité qu'un homme peut avoir dans un Etat libre. Cette autorité
conquise par la droiture de vos intentions, maintenez-la par la sagesse
de vos actes. Vous avez fait preuve d'une prudence consommée, à laquelle
il ne manque peut-être qu'un peu plus de réserve à faire décerner les honneurs. Sous tout autre rapport,
vos qualités brillent d'un si vif éclat, que l'antiquité n'a pas de
vertu dont vous puissiez redouter le parallèle. Tenez-vous donc en
défiance contre cette générosité, seule erreur de votre belle âme. Le
sénat ne doit rien accorder dont une mauvaise pensée puisse se prévaloir
et s'autoriser plus tard. Je crains, par exemple, que votre César ne se
croie porté assez haut par vos décrets pour afficher la prétention
d'atteindre au consulat. Si Antoine a pu régner en ramassant le sceptre
tombé de la main d'un autre, quelle excitation, je vous le demande, pour
un ambitieux, que de se sentir poussé aux envahissements, non par la
mort fortuite d'un tyran, mais par les faveurs spontanées du sénat !
J'attendrai donc, pour louer votre prévoyance et votre bonheur, que
j'aie vu Octave s'en tenir aux honneurs extraordinaires qu'on lui aura
décernés. Mais, direz-vous, c'est là me rendre responsable des torts
d'autrui : oui, des torts d'autrui, s'il a dépendu de vous de les
prévenir. Que ne pouvez-vous lire dans mon cœur les appréhensions dont
Octave le remplit ! — Ma lettre écrite, le bruit se répand que vous êtes
nommé consul. Si tant de bonheur m'est réservé, je verrai donc la
république telle qu'elle doit être, assez forte pour se soutenir
elle-même. Votre fils se porte bien : il me devance en Macédoine avec la
cavalerie.
846. — A DÉCIMUS BRUTUS, IMPERATOR. Rome, mai.
F. XI, 22. Je suis fort lié avec Appuis Claudius, fils de
Caius. Notre
liaison est née de ses bons procédés pour moi, et je ne suis pas demeuré
en reste. Votre cœur est généreux, vous m'aimez et vous êtes puissant :
à ce triple titre je vous
prie de prendre Appius sous votre égide. On vous sait le plus courageux
des hommes; je veux que vous en soyez aujourd'hui le plus clément. Ce
sera une belle gloire que de sauver un aussi illustre jeune homme. Sa
position mérite d'autant plus d'intérêt que le dévouement filial l'a
seul jeté dans les bras d'Antoine. C'était pour obtenir le
rétablissement de son père. Ainsi, quand vous n'auriez pas de meilleure
raison, en voilà une que vous pouvez mettre en avant, et certes on en
sera touché. Un seul signe de vous, et vous .sauverez et vous
conserverez à la république un homme de la plus haute naissance, de
l'esprit le plus distingué, et qui joint à ces avantages le caractère le
plus aimable et le cœur le plus reconnaissant. Accordez-moi cette grâce;
je vous la demande avec plus d'intérêt et plus du fond du cœur que je ne
saurais vous l'exprimer.
847. — DE PLANCUS A CICÉRON. Des Gaules, mai.
F. X, 17. Antoine est arrivé à Forum-Julii avec son avant-garde, le jour
des ides de mars. Ventidius est à deux journées de marche. Lépide campe à
Forum-Voconii, à vingt-quatre milles du camp d'Antoine : c'est là qu'il
m'attend, il vient lui-même de me l'écrire. Si la fortune et Lépide me
restent fidèles, je vous réponds que j'aurai bientôt mis bon ordre à nos
affaires, comme je vous l'ai dit. Mon frère, épuisé par la fatigue et
des marches sans fin , s'est trouvé dans une situation grave. Je vous
l'ai mandé précédemment. A peine a-t-il été un peu sur pied, que, plus
occupé de la république que de lui-même, on l'a vu partout s'offrir le
premier au danger. Je lui ai représenté son imprudence, et j'ai dû le
forcer à partir pour Rome. En restant, son état ne pouvait qu'empirer, et il était
incapable de me rendre ici le moindre service. J'ai considéré
d'ailleurs que, dans le veuvage de ses deux consuls, un préteur tel que
lui pouvait être fort utile à Rome. Que si quelqu'un de vous se récrie,
qu'on n'accuse que moi, et qu'on se garde surtout de soupçonner mon
frère d'avoir manqué à la patrie. Lépide a fait ce que je désirais
beaucoup, à part moi. Il m'a envoyé Apella, comme garant de sa foi dans
tout ce que nous entreprendrons en commun pour le service de la
république. Lucius Gellius ayant eu occasion de me montrer, ainsi qu'à
Sext. Gavianus, ses vrais sentiments au sujet des trois frères, je l'ai
chargé à mon tour de me représenter près de Lépide. C'est un fidèle :
j'aime à lui rendre ce témoignage, que je rendrai de même à tous ceux
qui le mériteront. Ayez soin de votre santé. Aimez-moi comme je vous
aime, et ne manquez pas à mes intérêts dans l'occasion. Vous avez
toujours été si bon pour moi !
848. — A PLANCUS. Rome, mai.
F. X, 16. Non, de mémoire d'homme, jamais rien n'a eu autant d'éclat, n'a
causé plus d'émotion et n'est arrivé plus à propos que votre dernière
dépêche. Le sénat était nombreux. Elle fut apportée à Cornutus, au
moment où il achevait la lecture d'une lettre de Lépide, glaciale et
inconséquente comme à l'ordinaire. La vôtre, lue immédiatement après,
excita mille acclamations. Les nouvelles qu'elle contient sont si
rassurantes ! Puis quel dévouement ! quels services ! quel noble
langage! et que de profondeur dans vos vues! Le sénat requit
délibération, séance tenante ; Cornutus voulut gagner du temps, on le
hua. Cinq tribuns s'étant constitués rapporteurs, on alla aux opinions.
Servilius vota pour l'ajournement. Mon tour vint, et je fus assez
heureux pour réunir toutes les opinions à la mienne; mais vous
connaîtrez mes propositions par le sénatus-consulte. - Certes vous
n'avez pas besoin de conseils, et vous êtes à cet égard assez riche de
votre propre fonds; cependant je vous engage à ne nous rien renvoyer
ici. Si les événements se pressent avec rapidité, les moments
sont trop précieux: ne référez de quoi que ce soit au sénat. Soyez-vous un
sénat à vous-même, et allez hardiment quand l'intérêt de la république
vous le dit. Pourquoi nous entretenir de vos espérances? Précipitez les
événements et annoncez-nous vos succès. Le sénat ratifiera tout, et vous
proclamera le plus fidèle et le plus sage des citoyens.
849. — BRUTUS A CICÉRON. De la Candavie, mai.
B. 7. Personne ne sait mieux que vous combien je dois aimer Bibulus, qui
s'est donné tant de mouvement et de soins pour la république, ,1e pense
que son mérite et mon amitié parlent assez haut pour lui, et me
dispensent d'une apologie plus longue. Une recommandation de moi ne peut
manquer son effet sur vous, quand elle est juste et dictée par un devoir
rigoureux. Bibulus se met sur les rangs pour remplacer Pansa (Au
collège des pontifes ou des simples prêtres.): je
vous demande votre appui. Vous ne pouvez servir ni un ami plus tendre
que moi, ni un candidat plus digne
que Bibulus. Je n'ai pas à intervenir en faveur d'Apuléius ni de
Domitius, tous deux déjà si bien placés dans votre estime. Votre
protection est acquise au premier, et je laisse à Domitius qui vous
écrit le soin de faire lui-même valoir ses titres. Ne perdez pas un
instant de vue les intérêts de Bibulus; servez de cœur un homme déjà si
grand, et destiné à compter un jour, croyez-m'en, dans le petit nombre
de vos rivaux de gloire. |