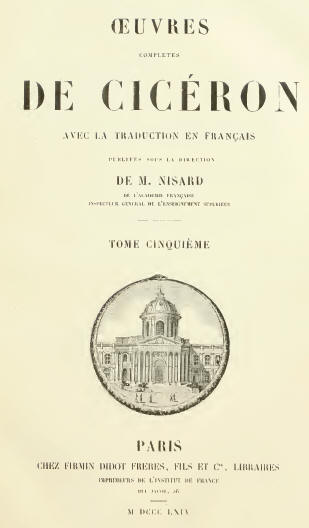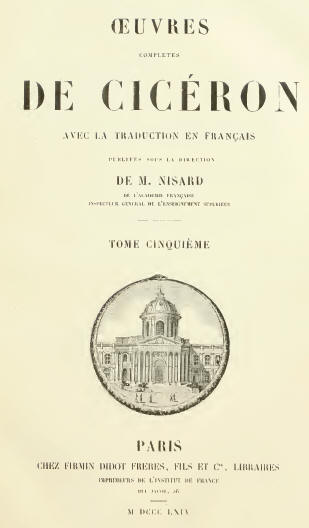|
850. — BRUTUS A CICÉRON.
De son camp, au fond de la Catdavie , 16
mai.
B. 6. Ne vous attendez pas à des
remercîments. Depuis longtemps notre amitié, mutuellement éprouvée par
tant de services, doit en avoir entre nous banni l'usage. Votre fils
n'est pas auprès de moi. Nous nous retrouverons eu Macédoine. Il a ordre
de partir d'Ambracie avec la cavalerie qu'il commande, pour traverser la
Thessalie et venir au-devant de moi jusqu'à Héraclée; là, puisque vous
vous en reposez sur moi , nous concerterons ensemble les moyens de
l'envoyer aux comices soutenir personnellement ou du moins déclarer sa
candidature. Je vous recommande avec instance Glycon , médecin de Pansa
, qui a épousé la sœur de notre Achille (C'était
quelque Grec de distinction, ami de Brutus.). J'apprends que
Torquatus a élevé des soupçons contre lui à l'occasion de la mort du
consul, et qu'il l'a fait arrêter sous une prévention de parricide.
Cette accusation n'a pas la moindre vraisemblance. Qui a perdu plus que
Glycon à la mort de Pansa? C'est un homme plein de délicatesse, de
moeurs simples, et que l'intérêt même ne pousserait jamais au crime. Je
vous en prie donc et même je vous en conjure, mettez un terme aux
inquiétudes si légitimes de notre Achille; tirez son beau-frère de
prison et veillez sur sa vie. De tous mes soins particuliers il n'en est
aucun qui me préoccupe davantage. — Pendant qe jel vous écris, on
m'apporte une lettre de Satrius, lieutenant de Treboniusj'y vois que
Dolabclla vient d'être défait et mis en fuite par Tillius et Déjotarus.
Je vous transmets la lettre grecque d'un certain Cychérée à Satrius.
Notre Flavius vous a pris pour juge de son procès contre les Dyrrachiens
au sujet d'un héritage. Je me joins à lui , mon cher Cicéron, pour vous
prier de terminer cette affaire. La succession dévolue à Flavius était
créancière de la ville. C'est un point hors de question : les
Dyrrachiens le reconnaissent , mais ils allèguent que César a prononcé
l'abolition de toutes leurs dettes. Ne souffrez pas que mon ami soit
injustement sacrifié à vos amis.
851. — A CONINIFICIUS.
Rome, mai.
F. XII, 30. Je ne vous écris, dites-vous,
que par des plaideurs; j'en conviens, et même fort souvent. Vous avez si
bien fait qu'on ne se croit bienvenu de vous que quand on a une lettre
de moi. Ai-je d'ailleurs laissé partir un seul des vôtres sans vous
donner de mes nouvelles? privé de vous et de vos entretiens, ai-je de
plus doux passe-temps que de vous écrire et de vous lire?
Malheureusement je ne puis me donner carrière pour mon compte au gré de
mon envie. C'est un de mes chagrins; je suis si occupé! Si je l'étais
moins, ce ne sont pas des lettres que vous recevriez, ce sont des
volumes, oui, des volumes, et c'est vous qui devriez m'en écrire; car
bien que vous ayez fort à faire aussi sans doute, vous avez cependant
plus de temps : et quand il n'en serait rien, vous devriez au moins vous
taire et ne pas me chercher querelle. Comment oser, m'écrivant si peu,
me reprocher de ne pas vous écrire assez? Mes occupations naguère
étaient immenses, consacré tout entier, comme je l'étais , à la défense
de la république; aujourd'hui, je vous assure, elles sont plus grandes
encore. Semblable à ces malades qu'on croit sauvés et dont une rechute
vient empirer la position, nous sommes dans un redoublement; après le
combat et la guerre, il nous faut tirer le glaive encore. Mais c'est
assez de ces réflexions. — Croyez, mon cher Cornificius, que je n'ai le
cœur ni assez froid ni assez barbare pour ne pas répondre avec effusion
à de bons procédés et à l'amitié qu'on me témoigne. Je ne doutais pas de
voire affection sans doute , mais elle m'est mieux connue encore depuis
que j'ai vu Chérippe. Quel homme excellent! si je me suis toujours senti
du goût pour lui , je puis dire que ce goût est devenu une passion. Il
m'a si bien représenté non-seulement vos sentiments et vos paroles, mais
jusqu'aux moindres mouvements de votre visage ! Aussi ne craignez pas
que je sois fâché de n'avoir reçu de vous qu'une circulaire comme les
autres. Mais je vous somme de m'écrire désormais pour moi; encore ne
vous fais-je cette sommation qu'avec un doux visage et d'un ton amical.
— J'en viens aux dépenses où les besoins de la guerre vous entraînent.
Malheureusement, il m'est impossible de vous fournir
651
des secours, parce que le sénat est sans chef depuis la mort des consuls
, et que les embarras du trésor public sont au delà de tout ce qu'on
peut imaginer. On cherche de l'argent de tous cotés pour s'acquitter
envers les soldats qui ont si bien mérité de la république; et je ne
crois pas qu'on réussisse à en trouver. Il faudra recourir à un tribut (On
n'y avait pas eu recours depuis Paul-Emiile.). —Ce doit être peu
de chose que l'affaire d'Attius Dionysius. Stratorius ne m'en a pas
parlé. Non certes , vous ne pouvez vous intéresser à P. Luccéius plus
que je ne le fais. Nous sommes intimement liés. Mais lorsque j'ai pressé
les commissaires d'accorder un ajournement, ils m'ont démontré que le
compromis et le serment leur liaient absolument les mains. Luccéius n'a
d'autre parti à prendre que de venir. Au surplus, s'il en a cru mes
avis, il sera à Rome au moment ou vous lirez ma lettre. Vous comptiez
sur Pansa pour obtenir, par mon entremise, divers objets dont vous me
parlez , surtout de l'argent; vous ignoriez sa mort. Assurément s'il
vivait , votre attente n'eût pas été trompée; il vous aimait tant! Mais
que faire aujourd'hui qu'il n'est plus? Je ne vois rien de possible. —
Vous avez cent fois raison pour Vénuléius , Latinus et Horatius (Lieutenants
de Calvisius, par lesquels il voulait gouverner l'Afrique en son absence)
; mais je suis loin de vous approuver lorsque, pour les consoler, vous
voulez ôter les licteurs à vos propres lieutenants. Il ne faut jamais
placer sur la même ligne des hommes honorables et des hommes déshonorés.
Mon opinion est que , s'ils ne renoncent pas à leurs prétentions, vous
devez vous prévaloir du sénatus-consulte et les y contraindre. Je crois
avoir à peu près répondu à tous les articles de votre lettre, qui m'est
arrivée en double. Il ne me reste plus qu'à vous assurer de nouveau que
rien ne m'est plus cher au monde que tout ce qui vous touche.
852. — A DÉCIMUS
BRUTUS. Rome, 19 mai.
F. XI, 18. La mission dont vous avez
chargé Galba et Volumnius pour le sénat nous a fait connaître vos
appréhensions; mais, après votre victoire, après la victoire du peuple
romain, vous vous exagérez certainement le danger. Le sénat, mon cher
Brutus, est plein d'énergie, et il a des chefs déterminés. Il n'a donc
pu voir qu'avec regret sa vigueur et son courage mis en doute par un
homme qu'il regarde à bon droit lui-même comme le plus courageux de tous
les hommes. Quand vous étiez emprisonné dans Modène, en face d'Antoine
triomphant, personne n'a douté de Brutus et de son grand cœur. Que
voulez-vous donc que l'on redoute, aujourd'hui qu'Antoine est battu et
que vous êtes délivre? Nous sommes rassurés sur Lépide. Comment le
croire assez fou pour faire la guerre à la république , au milieu de la
paix et du contentement général, quand, au sein de la guerre, il
n'avait, disait-il, qu'un désir, qu'un but, celui de rétablir la paix?
Je ne doute pas que vous ne sachiez mieux que nous encore à quoi vous en
tenir à cet égard. Cependant, lorsque les temples retentissent encore
des actions de grâces qu'on adresse en votre nom aux Dieux immortels, il
nous est extrêmement pénible d'avoir à retomber dans de nouvelles
alarmes. Puisse la fortune d'Antoine être, à l'heure qu'il est, abattue
et ruinée sans retour! C'est mon espérance. Que si , au contraire , il
est parvenu à réunir de nouveau quelques forces, il sentira bientôt que
la sagesse ne manque pas au sénat, ni le courage au peuple romain, et
que, tant que vous vivrez , la république aura un général pour la
défendre.
652
853. - DECIMUS BRUTUS A CICERON, Verceil, 21 mai.
F. XI,19. Veuillez lire avec soin mes
lettres avant de les remettre au sénat, et faites tous les changements
nécessaires. Vous verrez que je ne pouvais nie dispenser d'écrire.
J'avais compté sur la quatrième légion et sur la légion Martiale; Drusus
et Paulus en étaient d'accord ; vous y aviez donné votre assentiment :
je pouvais alors m'inquiéter peu du reste. Mais puisque pour toute armée
on me laisse les recrues les plus pauvres du monde, il m'est impossible
de ne pas trembler pour moi et pour vous. La population du Vicentin
m'est toute dévouée, ainsi qu'à M. Brutus. Ne souffrez pas , je vous en
conjure , qu'on leur fasse tort au sénat dans l'affaire des esclaves.
Ils ont pour eux le bon droit ; ils ont de plus rendu de grands services
à la république, et c'est à toute une race de séditieux et de brutes
qu'ils ont affaire.
854. — LEPIDE, IMPERATOR II, GRAND
PONTIFE, A CICÉRON., Du Pont d'Argent, 22 mai.
F. X, 34. Lorsque j'ai
su qu'Antoine se dirigeait avec ses troupes vers ma province , et que
son frère Lucius avait pris les devants avec une partie de sa cavalerie,
j'ai fait faire un mouvement à mon armée qui campait au confluent du
Rhône, et je me suis porté à leur rencontre. Je suis arrivé en droite
ligne à Fonum-Vocuntium , où j'ai pris position, sur les bords de la
rivière d'Argent, faisant front à son armée. P. Ventidius venait de lui
amener ses trois légions. Leur camp est au delà du mien. Avant ce
renfort, Antoine n'avait conservé intacte que la cinquième légion, outre
un très-grand nombre de soldats sans armes, débris des autres corps ; sa
cavalerie est considérable; pas un de ses cavaliers n'avait donné. Il en
a au delà de... (le chiffre manque), beaucoup de ses soldats, fantassins
et cavaliers , désertent et m'arrivent. Aussi ses forces diminuent-elles
tous les jours. Silanus et Culléon l'ont quitté. Ils m'avaient porté un
coup bien sensible, en allant se joindre à lui , sans être retenus par
la crainte de me froisser. Je n'ai pas voulu les perdre : ma bonté et
les souvenirs d'une ancienne amitié ont prévalu en moi ; mais je ne les
emploie point. Je leur ai même interdit l'entrée de mon camp, et je
m'abstiens à leur égard de tout témoignage de confiance. Je ne manquerai
point, dans la conduite de cette guerre, à ce que le sénat et la
république attendent de moi, et je vous tiendrai au courant de mes
opérations ultérieures. Nous avons toujours eu l'un pour l'autre un
grand attachement manifesté par des services mutuels, et rien n'a pu
altérer jusqu'ici l'amitié qui nous lie. Je ne doute pas pourtant qu'au
milieu des violentes et subites agitations de la république, la calomnie
n'ait cherché à me nuire dans votre esprit par d'indignes insinuations
qui ont dû émouvoir profondément votre patriotisme. Mes agents m'ont dit
quelle réserve vous aviez mise à les accueillir, et que vous aviez
refusé d'ajouter légèrement foi à ces rumeurs. Je vous en sais un gré
infini. Je n'ai rien oublié de ce que vous avez fait précédemment pour
moi, pour ma fortune et mes dignités. Ma mémoire reconnaissante en
gardera à jamais le souvenir. Je n'ai qu'une chose à vous demander, mon
cher Cicéron : si toutes les circonstances de ma vie, si les témoignages
de dévouement que dans le passé j'ai donnés à la république, vous ont
paru jusqu'ici dignes de Lépide, croyez que je serai fidèle à ce que je
fus toujours, ou plutôt que je ferai plus que je n'ai fait. Veuillez
donc me servir au besoin de défenseur; plus je vous dois déjà, plus je
veux vous devoir encore. Adieu. 11 des kal. de juin.
855. — A FURNIUS. Rome,
mai.
F. X, 25. S'il importe à la république,
comme personne n'en doute, que vous continuiez de mettre la main à
l'œuvre, et que vous n'abandonniez pas le grand intérêt du moment,
l'extinction de la guerre civile et de ses derniers brandons, assurément
vous ne pouvez rien faire de mieux, de plus digne et de plus honorable,
que de vous y dévouer ; et vous ne devez pas mettre en balance le besoin
de l'empire et le cri de la patrie, avec l'avantage d'arriver un peu
plus toi à la préture. N'oubliez pas la gloire que vous avez acquise;
cette gloire vous place bien près de Plancus : c'est moi qui vous le
dis, avec Plancus lui-même, avec la renommée et la conscience publique.
S'il vous reste donc quelque bien à faire, mon opinion est qu'il y faut
tout sacrifier; l'honneur le veut : l'honneur avant tout! Cependant si
vous croyez avoir suffisamment payé votre dette à la patrie, je vous
engage à ne pas perdre un moment pour être aux comices qui sont a la
veille de se réunir; mais prenez garde qu'une démarche faite dans un
intérêt tout personnel n'aille jeter une ombre sur la gloire qui
s'attache il nos rangs. Voyez combien d'hommes haut placés ont accepté
avec empressement le sacrifice d'une année de leur carrière pour
les besoins de la république. Votre sacrifice à vous serait d'autant
plus facile, que voire année n'est pas encore venue. Ce n'est pas comme
si vous aviez été édile, et comme si votre tour venait après deux ans.
On trouverait aujourd'hui que c'est trop avidement profiter d'un usage
et d'une espèce de droits qui se sont établis. Vous dirai-je ce que je
pense? Attendez le consulat de Plancus : vous n'avez pas besoin sans
doute de ce secours: mais, pour peu que d'ici là toutes nos espérances
soient accomplies, que d'éclat sur votre candidature ! Vous avez trop
bonne tète et trop excellent esprit pour que j'insiste; mais je ne
pouvais vous cacher ma pensée, que je résume ainsi : Préférer l'intérêt
de l'honneur à l'intérêt de son ambition , et rechercher ce qui ne passe
pas plutôt que ce qui vient trop vite, la gloire avant la Préture. Je me
suis expliqué dans ce sens chez moi avec Dardanus, votre affranchi,
devant mon frère Quintus et en présence de Cécina et Calvisius, les plus
passionnés de vos amis. Tous trois faisaient chorus. Mais vous en
jugerez mieux que personne.
856. — PLANCUS A
CICERON. Des Gaules, mai.
F. X, 18. Vous saurez par mes lettres, et
surtout par Lévus et Nerva qui vous les portent, quelle est ma pensée au
moment de leur départ. Ils ont vu tout, et il n'est pas de conseil
auquel ils n'aient assisté. Lorsqu'on craint la honte et qu'on veut
remplir ses devoirs, c'est-à-dire lorsqu'on porte un cœur honnête, on
tombe toujours dans une faute que je n'ai point évitée ; on choisit le
parti le plus dangereux par scrupule d'honneur, et on laisse le plus
sûr, de peur de donner prise à l'en-
654
vie. Après le départ des députés, je fus sollicité à la fois par Lépide
et par Latérensis d'aller les joindre. La lettre de Latérensis
était fort pressante; il se mettait à mes genoux , et me jurait qu'il
n'avait à craindre que l'esprit inconstant et la trahison de l'armée :
c'est ce que je ne crains que trop aussi. Il s'agissait de leur prêter
main-forte et de partager leurs dangers. Je ne pouvais donc hésiter ; le
plus sage eût été d'attendre Brutus et son armée sur les bords de
l'Isère, et de marcher ensuite à l'ennemi d'après un plan concerté. Un
homme de guerre l'aurait fait. Mais si Lépide fidèle avait éprouvé un
échec, on n'eût pas manqué de me reprocher un esprit haineux et un cœur
lâche. On eût dit que je sacrifiais à mes inimitiés personnelles un
loyal serviteur de la république, et que c'était la peur qui me faisait
reculer devant une occasion de combattre. J'ai donc voulu à tout prix
soutenir Lépide et agir par ma présence sur le moral de son armée, sans
écouter les conseils d'une prudence timorée. J'en ai fait voir plus que
personne dans des occasions qui ne peuvent pas mètre reprochées. Mais
voila que l'inquiétude me saisit; oui, je redoute une bataille, moi qui,
sans Lépide et son armée, n'eusse pas un seul moment douté de la
fortune. Certes, si j'eusse été assez heureux pour rencontrer Antoine le
premier, il n'aurait pas tenu , je le jure , une heure , tant j'ai foi
en moi, et tant j'ai de mépris pour ses troupes démoralisées, et pour ce
muletier de Ventidius qui se cache derrière ses retranchements. Mais je
ne puis m'empêcher de frémir en pensant au mal secret que nous portons
peut-être dans notre sein, et aux ravages qu'il peut causer tout d'un
coup, avant même qu'on ait constaté sa présence et recherche les moyens
de le guérir. Ce qu'il y a de certain, c'est que si je n'arrivais point,
il y aurait beaucoup a craindre pour Lépide et pour la portion saine de
son armée. Quel avantage, bons Dieux! pour nos infâmes ennemis, s'ils
réussissaient à lui débaucher quelques troupes! Puisse ma présence
prévenir ce malheur ! Je n'aurai que des grâces à rendre à la fortune et
à la résolution qui m'a poussé là. En résumé, j'ai quitté mon camp et
les bords de l'Isère le 12 des kalendes de juin, non sans avoir placé
deux redoutes à la tète du pont que j'avais fait jeter sur le fleuve, ni
sans laisser une forte garnison pour maintenir le passage et ne pas
retarder Brutus, lorsqu'il y arrivera avec son armée. Sous huit jours
d'ici, j'aurai, j'espère, opéré ma jonction avec Lépide.
857. — A PLANCUS. Rome,
mai.
F. X, 22. Que les Dieux nous soient en
aide ! nous n'avons d'espérance qu'en vous et votre collègue. Votre bon
accord, dont le sénat a vu la preuve dans votre lettre, a causé parmi
les sénateurs et dans la ville une joie incroyable. Vous m'avez
recommandé une affaire de partage des terres ; si le sénat en avait été
saisi , la proposition la plus large et la plus honorable eût été celle
que j'aurais adoptée. Et certes je n'en aurais abandonné à personne
l'initiative; mais comme on ne peut obtenir de décision sur rien, à
cause de la lenteur des délibérations et des embarras du moment, nous
avons pensé, votre frère Plancus et moi , que le plus simple était de
s'appuyer 655
sur le décret tel qu'il est. Plancus n'aura pas manqué de vous faire
connaître, je le suppose, par la faute de qui il n'est pas conçu dans
les termes que nous aurions désirés. Cependant s'il vous paraissait trop
incomplet, ou si sur toute autre matière vous aviez un désir à former,
vous êtes si cher à tous les gens de bien , qu'il n'y a rien de si
considérable et de si grand qu'on croie au-dessus de votre mérite et
qu'on ne fasse pour vous. J'attends avec impatience de vos nouvelles.
J'espère que les premières combleront tous mes vœux. Adieu.
858 A DÉCIMUS BRUTUS.
Rome, mai.
F. XI ,15. Vos lettres me sont précieuses
: mais vous êtes si occupé, que je vous sais un gré infini d'avoir pensé
à vous faire excuser par votre collègue Plancus de ne pas m'écrire;
Plancus s'en est fidèlement acquitté. Je ne connais rien de plus aimable
que votre bonté et votre exactitude. La nouvelle de votre jonction avec
votre collègue , et le parfait accord dont votre lettre commune est
garant, ont été accueillis avec la plus vive satisfaction par le sénat
et le peuple romain. Vous n'avez plus, mon cher Brutus, à rivaliser avec
les autres ; ne cherchez qu'à vous surpasser vous-même. Je n'en dirai
pas davantage. Je veux surtout ici prendre votre brièveté pour modèle.
Avec quelle impatience j'attends de vos nouvelles! Puissent-elles, comme
je l'espère, combler tous mes vœux !
859. - A PLANCUS.
Rome, mai.
F. X, 13. Aussitôt que je l'ai pu, j'ai
proposé en votre faveur des dignités nouvelles, et je n'ai rien épargné
pour donner quelque relief aux récompenses que méritait votre vertu, et
pour en accroître l'honneur par l'éclat des expressions qui les
consacrent. Lisez au surplus le sénatus-consulte, et jugez-en. Il
reproduit les termes mêmes de ma proposition. C'est avec le plus vif
intérêt et des acclamations unanimes que le sénat fort, nombreux, en
avait suivi le développement. J'ai bien vu par vos lettres que l'estime
des gens de bien a plus de prix a vos yeux que toutes les distinctions
du monde; mais la république avait une dette à acquitter envers vous, et
parce que vous ne la réclamiez pas, elle ne pouvait s'en croire dégagée.
Vos actes seront jusqu'au bout fidèles à vos promesses. Il faut vaincre
Antoine, et la guerre est finie. Ce n'est ni Ajax, ni Achille, c'est
Ulysse qu'Homère appelle le destructeur de villes. Adieu.
860. — A PLANCUS. Rome,
mai.
F. X, 19. Je n'attendais aucun
remercîment; il me suffisait de savoir que vous étiez très sensible à ce
que j'ai fait pour vous. Cependant, je ne le cache point, les
expressions de votre gratitude me vont au cœur. Je vois comme avec mes
yeux combien vous m'aimez. Est-ce donc d'aujourd'hui seulement,
allez-vous dire? Non sans doute. Il y a bien longtemps, et votre
affection ne s'est jamais démentie; mais jamais aussi elle ne m'apparut
sous un plus beau jour. Le sénat a été prodigieusement ému de vos
dépêcher. Rien de plus important et de plus considérable que les
nouvelles qu'elles renferment, rien de comparable à votre sang-froid , à
votre sagesse, a la noblesse de vos pensées et même de votre langage.
Mais à l'œuvre, à l'œuvre, mon cher Plancus! Éteignez les derniers feux
de 656
la guerre : vous arriverez ainsi au comble de la popularité et de la
gloire! La république a tous mes vœux ; mais, après tant de luttes et de
combats pour elle, je doute en vérité que l'amour de la pat rie me
préoccupe plus vivement que celui de votre renommée. Les Dieux immortels
ont placé devant vous une immense moisson de gloire. Ne la dédaignez
point, je vous en conjure. C'est celui qui nous débarrassera d'Antoine
qui mettra véritablement fin à cet horrible et dangereux confllit.
861. — A DECIMUS
BRUTUS. Rome, mai.
F. XI, 12. J'ai reçu trois lettres de vous
le même jour : l'une très-courte dont vous aviez chargé F. Volumnius,
les deux autres plus longues, dont la première m'a été remise par le
messager de T. Vibius, et la dernière envoyée par Lupus. Ce que vous me
mandez et ce que dit Grécéius montre que, loin de s'éteindre, la guerre
gagne chaque jour du terrain. Vous avez trop de sagacité pour ne pas
sentir qu'il y va de votre gloire à ne pas laisser Antoine prendre de la
consistance. On avait annoncé , et Rome entière était convaincue ,
qu'Antoine n'avait sauvé de sa défaite qu'un petit nombre d'hommes sans
armes et démoralisés; que lui-même était tombé dans le découragement.
Si, au contraire, il y a encore des périls à courir pour le réduire, et
c'est ce que Grécéius affirme, il n'est pas permis de donner le nom de
fuite à sa retraite de Modène. Il aurait tout simplement changé le
théâtre de la guerre. Ces nouvelles ont produit un mouvement fâcheux
dans l'opinion. Beaucoup de gens se plaignent de ce que vous ne vous
êtes pas mis à sa poursuite , et se persuadent qu'avec un peu d'activité
vous l'auriez facilement atteint et détruit. C'est bien là le peuple, et
surtout le peuple romain; il abuse de sa liberté contre celui à qui il
en est redevable. Mais veillons à rendre vaines ces récriminations. La
vérité , c'est que celui qui détruira Antoine est le seul qui finira
véritablement la guerre. Je vous laisse sur cette réflexion terrible que
vous apprécierez , et sur laquelle je ne veux pas m'expliquer plus
ouvertement.
862.. — POLLION A
CICÉRON. De l'Espagne, mai.
F. X, 33. Lépide a retenu mes courriers
pendant neuf jours, pour empêcher les nouvelles de Modène du m'arriver.
Il vaut mieux sans doute , quand on n'y peut rien , apprendre le plus
tard possible des événements si déplorables. Pourquoi , quand un
sénatus-consulte appelait Plancus et Lépide en Italie, ne m'y aviez-vous
fait venir aussi? A coup sûr, on aurait prévenu le coup qui vient de
frapper la république. On peut se réjouir un moment de la mort de tant
de chefs et de vétérans de l'armée de César. Mais la plaie est trop
grande pour que l'Italie n'ait pas un jour à en gémir : car, d'après les
nouvelles qui m'arrivent, c'est la fleur et la graine de nos guerriers
qui a péri. Quelle différence , si j'avais été près de Lépide ! J'aurais
infailliblement prévenu toutes ses hésitations, surtout avec un second
comme Plancus. Quand il m'écrivait des lettres que je vous ferai lire et
qui ressemblent à ce qu'on m'a dit de ses harangues de Narbonne, il
fallait que je fisse patte de velours pour ne pas m'exposer à manquer de
vivres en traversant sa province. Je me serais d'ailleurs exposé à des
interprétations fâcheuses : si la guerre s'était terminée sans me
657
laisser le temps de manifester mon but , mes ennemis, qui connaissent
mes anciens rapports d'amitié avec Antoine, rapports qui n'ont jamais
été toutefois aussi intimes qu'avec Plancus, n'auraient pas manqué de
dénaturer et d'empoisonner mes intentions. C'est d'après toutes ces
considérations qu'au mois d'avril je fis partir de Gadès, sur deux
navires différents, de doubles messages pour vous, pour les consuls,
pour Octave, et que je vous demandai des instructions sur ce que j'avais
à faire pour rendre le plus de services possible à la république.
Malheureusement, suivant mes calculs, les deux navires n'ont pu partir
de Gadès que le jour même où Pansa a livré bataille. L'hiver avait
jusque-là tenu la navigation fermée; j'étais si loin, j'en atteste les
Dieux , de croire à la possibilité d'une guerre civile, que j'avais mis
toutes mes légions en quartiers d'hiver au fond de la Lusitanie. Mais de
part et d'autre on a eu hâte de se battre, comme si on n'avait à
craindre que de ne pas faire assez de mal à la république. Toujours
est-il du moins qu'en admettant la nécessité de cette précipitation ,
Hirtius n'a pas été sans montrer les talents d'un grand général. Voici
ce qu'on m'écrit de la Gaule de Lépide : Que l'armée de Pansa est
détruite, que Pansa lui-même a succombé à ses blessures , qu'il n'est
pas resté un seul homme de la légion Martiale; que L. Fabatus, G.
Péducéus et D. Carfulénus ont été tués; que, dans le combat d'Hirtius,
la quatrième légion et toutes les légions d'Antoine ont été massacrées;
qu'il en a été de même de celle d'Hirtius; que la (luatrième légion
s'était déjà emparée du camp d'Antoine, lorsqu'elle a été taillée en
pièces par la cinquième; qu'Hirtius a péri, ainsi que Pontius Aquila;
qu'Octave lui-même, ajoute-t-on, est resté sur le champ de bataille. Ah
! fassent les Dieux que rien de tout cela ne soit vrai , ou j'en mourrai
de douleur! On ajoute qu'Antoine a honteusement levé le siège de Modène,
mais qu'il lui reste (le chiffre manque) de cavalerie, trois légions qui
peuvent entrer en ligne , une de P. Bagiennus, et un grand nombre de
soldats sans armes; que Ventidius s'est joint à lui avec la septième, la
huitième et la neuvième légions; que si Lépide tient bon, Antoine est
résolu à se porter à toutes les extrémités , et qu'il armera
non-seulement le peuple des provinces, mais encore les esclaves; que
Parme a été livrée au pillage; que L. Antoine s'est emparé des passages
des Alpes. S'il en est ainsi, c'est un devoir d'agir de soi-même et sans
attendre les ordres du sénat. La maison brûle, il faut éteindre le feu ,
à moins de vouloir assister, les bras croisés, à l'incendie de Rome et à
la chute du nom romain. J'entends dire que Brutus a dix-sept cohortes et
deux légions qui comptent peu de recrues, celles qui avaient été levées
par Antoine. Point de doute que tout ce qui a échappé de l'armée d'Hirtius
n'aille se réunir à ce noyau, il faut l'espérer; car on ne peut, à mon
avis, faire aucun fond sur les levées nouvelles. Ne serait-il pas
d'ailleurs de la dernière imprudence de laisser à Antoine le temps de se
remettre? La saison où nous sommes me donne toute liberté : les blés
sont partout à couvert, soit dans les champs, soit dans les fermes. Vous
saurez par le prochain courrier quelles résolutions j'aurai prises. Je
ne
veux ni faire défaut à la république, ni lui survi-
658
vre. Mais quel malheur de me trouver si loin , et que les routes soient
si peu sûres qu'il faille quarante jours et souvent davantage pour
que les nouvelles m'arrivant !
863. — PLANCUS A
CICERON. Des Gaules , mai.
F. X, 21. Je rougirais du peu de
consistance de mes lettres, si je n'avais à en rejeter la faute sur
autrui. J'ai tout fait pour obtenir de Lépide une coopération qui
diminuât vos alarmes et doublât mes forées contre les rebelles. J'ai
souscrit à toutes ses demandes, j'ai souvent même devancé ses vœux.
Aussi vous écrivais-je, il y a deux jours encore, qu'il n'y avait pas à
douter de Lépide, et que nous allions tout concerter ensemble. Je devais
croire à ses assurances, écrites de sa propre main, et à la parole de
Latérensis qui était prés de moi , et qui ne cessait de me prêcher la
confiance et l'union; mais il n'y a plus d'illusion à se faire sur
Lépide. Rien heureusement, grâces aux dispositions que j'ai prises, ne
se trouve compromis par ma sotte crédulité. J'avais, en vingt-quatre
heures, vous le savez, jeté un pont sur l'Isère pour me porter en avant
avec mon armée. Le moment était grave et pressant ; Lépide m'écrivait
lettre sur lettre. Tout à coup je vois arriver un exprès de sa part pour
m'engager à suspendre ma marche. Il était, disait-il, en état d'en finir
à lui seul , et je n'avais en attendant qu'à rester en position sur le
fleuve. Je pris là-dessus , je le confesse, une résolution téméraire: ce
fut de ne tenir aucun compte de ses avis, persuadé qu'il voulait
simplement ne pas partager avec un autre l'honneur de la victoire. Je ne
prétendais pas disputer une portion de gloire à sa voracité à jeun, mais
je désirais me placer en position de le secourir, en cas de malheur. Je
ne soupçonnais encore aucune trahison. C'est la vieille probité de
Latérensis qui m'a dessillé les yeux ; il m'écrit de sa propre main à
moi et aux miens qu'il n'y a plus de fond a faire sur lui, sur l'armée,
sur Lépide; qu'il a été indignement trompé; et loin de s'en cacher, il
me le déclare publiquement dans sa douleur, pour m'empêcher de tomber
aussi dans le piège; qu'il n'a que ce moyen de dégager sa responsabilité
, et qu'il me conjure de ne pas abandonner la république. Je viens
d'envoyer à Titius une copie de cette lettre : quant à l'original et à
toutes les autres dépêches que j'ai reçues, celles que j'ai crues
sincères, comme celles qui ont éveillé ma défiance, je charge Lévus
Cispius, qui a été témoin de tout, de les porter à Rome. — Il faut dire
qu'au moment où Lépide haranguait son armée, il se fit une grande rumeur
parmi ses soldats , soit mauvaises dispositions de leur part, soit
suggestions des Canidius, des Rufrénus, et autres généraux que je
nommerai , quand il en sera temps ; ils se mirent à crier qu'ils étaient
de trop bons citoyens pour ne pas demander la paix ; que c'était bien
assez
de deux consuls tués et de tant de braves gens perdus pour la patrie ;
qu'on les avait déclarés ennemis publics, que leurs biens étaient
confisqués, et qu'en définitive ils étaient décidés à ne pas se battre.
Lépide ne fit rien pour avoir raison des mutins et pour arrêter le mal.
Il y aurait eu des lors témérité et folie de ma part à me porter plus
avant, et à compromettre contre deux armées réunies une armée fidèle, de
nombreux auxiliaires, les premiers citoyens de la Gaule, toute une
659
province enfin. Il est clair qu'en m'exposant à une ruine certaine, en
me livrant ainsi moi-même et la république tout ensemble , ma mort ,
loin d'honorer ma mémoire, n'exciterait pas même la pitié. Je vais
retourner sur mes pas , et ne point faire encore plus beau jeu à ces
misérables. Je prendrai de bonnes positions; je veux pouvoir couvrir la
province, même dans le cas où l'oubli des devoirs pénétrerait dans mon
armée. Je tâcherai enfin de ne me laisser entamer sur aucun point ,
jusqu'à ce que vous m'ayez envoyé de nouvelles troupes, et que la
fortune de Rome ait une seconde fois vengé la république. Je suis prêt à
tout pour le salut commun : à combattre, si l'occasion le demande; à
soutenir un siège, s'il le faut, et à mourir, si telle est la volonté du
sort. C'est pourquoi, mon cher Cicéron , je vous demande des renforts
toute affaire cessante, et vous conjure d'envoyer ici une armée, sans
laisser aux ennemis le temps de se fortifier encore et à la
démoralisation de pénétrer dans nos rangs. Si vous ne perdez pas une
minute, la république sera encore en mesure d'anéantir ses infâmes
ennemis et de sortir triomphante de la lutte. Portez-vous bien et
aimez-moi. — P .S. Ai-je besoin d'excuser mon frère auprès de vous , mon
frère , le plus courageux et le plus ardent de tous les citoyens?
L'excès du travail lui a occasionné une petite fièvre qui ne le quitte
point, et dont il ne laisse pas que de souffrir. Aussitôt qu'il sera en
état de revenir ici, il reviendra pour ne pas faire faute à la
république. Je me recommande toujours à vous. Je ne veux rien demander.
Ne vous ai-je pas là, vous ami si dévoué , vous si puissant enfin ,
selon vœu le plus cher'? Vous examinerez comment et quand vous pourriez
agir pour moi. Je ne désire qu'une chose, c'est de remplacer Hirtius
dans votre affection comme dans son dévouement.
864. — A FURNIUS. Rome,
mai.
F. X, 26. Quand j'ai lu votre lettre où
vous posez deux alternatives, abandonner la Gaule Narbonnaise ou s'y
résigner à une lutte périlleuse, j'ai tremblé à l'idée de l'abandon, et
je suis fort aise qu'on l'ait évité. Ce que vous me mandez du bon accord
de Plancus et de Brutus est du plus heureux présage. Quant aux Gaulois
qui sont animés d'un si bon esprit, c'est à leurs œuvres que nous
connaîtrons un jour votre ouvrage. Mais déjà je le connais. Aussi
n'aurais-je rien trouvé que de bon dans votre lettre, sans la fin, qui
m'a mis de mauvaise humeur. Vous viendrez, dite-vous, pour les comices,
s'ils s'assemblent en août ; et beaucoup plus tôt, si leur réunion a
déjà eu lieu. Il y a trop longtemps, dites-vous encore, que vous faites
un métier de dupe là ou il n'y a que des coups à gagner. Oh! mon cher
Furnius, que vous entendez mal vos intérêts, vous qui voyez si clair
dans ceux des autres! Quoi! c'est en ce moment que vous songez à une
candidature, que vous parlez d'assister à des comices, de rentrer dans
vos foyers, d'abandonner enfin la partie périlleuse que vous jouez,
dites-vous, sans aucune chance de profit ! Non , vous ne dites pas là ce
que vous pensez. Je vous connais, il n'y a en vous que de généreux
instincts. Si vous pensiez ce que vous écrivez, je n'aurais pas
d'observations à faire, je n'aurais qu'a me reprocher la bonne opinion
que j'ai de vous. Quoi ! c'est pour une magistrature si frivole et si
vulgaire (car vous ne la
660
jugez pas sans doute autrement que tout le monde) qlue vous êtessi
follement impatient, et que vous allez à plaisir faire taire ce concert
unanime d'éloges qui vous portent aux nues! La seule question pour vous
est donc de savoir si vous serez préteur cette année ou l'année
prochaine, et non pas si vous mériterez assez de la république pour
qu'on vous juge digne de tous les honneurs du monde. Ignorez-vous le
rang que vous avez atteint? ou n'en tenez-vous aucun compte? Si vous
l'ignorez, je vous le pardonne sans me le pardonner à moi-même ; si vous
le savez, au contraire , il n'y a point de préture au monde qui vaille
le devoir et l'honneur : le devoir qu'on recherche si peu maintenant,
l'honneur qu'on estime tant encore. Nous ne pouvons vous comprendre, ni
moi ni Calvisius, dont le sens est si droit et qui vous aime tant. Mais
enfin, puisque vous n'avez que les comices en tête, j'ai cru bien agir
pour la république, en les rejetant au mois de janvier. D'ici là vous
avez le temps de vaincre. Adieu.
865. — A DÉCIMUS
BRUTUS. Rome, mai.
F. XI, 14. J'apprends avec une bien vive
satisfaction, mon cher Brutus, que vous approuvez mes vues et mes
propositions au sujet des décemvirs et de ce que mérite notre jeune
homme; mais ce n'est pas là ce que j'ai à dire. Écoutez un homme que la
vanité n'aveugle point et qui est de sang-froid. Je tirais ma force du
sénat , cette force nous échappe. On croyait tant à la victoire après
votre brillante sortie de Modène, après la fuite d'Antoine et la défaite
de son armée, qu'on en est tombé dans un profond découragement, et que
la véhémence de mes mouvements n'a plus l'air que d'une guerre en
peinture. Mais pour revenir à notre sujet , ceux qui connaissent la
légion Martiale et la quatrième légion affirmer qu'à aucun prix on ne
les déterminerait à vous rejoindre. Quant à l'argent que vous demandez,
il est possible de l'avoir, et vous l'aurez. Je pense comme vous qu'il
faut appeler Brutus, et retenir en même temps Clésar pour couvrir
l'Italie. Oui, vous avez des ennemis envieux; il ne me faut pas beaucoup
d'efforts pour les comprimer, et néanmoins c'est un embarras. On attend
les légions d'Afrique. Comment la guerre a-t-elle pu recommencer du côté
ou vous êtes ? Voilà ce qu'on ne peut comprendre. On s'y attendait si
peu ! Votre victoire, dont la nouvelle nous parvint le jour même de
votre naissance, nous avait si bien fait croire à des siècles de paix et
de liberté! Or, les nouvelles craintes font revivre toutes les
anciennes. D'après votre lettre des ides de mai, Plancus vous mande que
Lépide refusera certainement asile à Antoine. S'il en est ainsi , tout
ira bien; sinon, on aura une grosse affaire à débrouiller. Ce n'est pas
que j'aie le moindre doute sur le résultat en définitif, puisque ce
résultat dépend de vous. Moi , je ne puis rien au delà de ce que je
fais. Je fais seulement des vœux pour que vous deveniez le plus grand et
le plus glorieux des Romains, et ces vœux ne seront pas trompés, j'en ai
la confiance.
866. — D. BRUTUS A
CICÉRO. Eporédia, 23 mai.
F. XI, 20. Ce que je ne ferais jamais pour
moi-même, mon amitié, ma reconnaissance me forcent à le faire pour vous,
c'est-à-dire à craindre quelque chose. Voici un propos que j'avais
entendu déjà plusieurs fois et qui m'avait frappé : mais tout récemment
Labéon Ségulius, qui est toujours le même , m'a raconté qu'étant l'autre
jour chez César, on y parla beaucoup de vous. César n'éleva
661
contre vous aucun grief, mais il cita un mot sorti de votre bouche : Ce
jeune homme, auriez-vous dit, mérite qu'où le loue, qu'on le comble,
qu'on le divinise. César observa qu'il s'arrangerait de manière à ne pas
être de sitôt placé parmi les Dieux. Je crois, moi, que c'est Labéon qui
aura répété, peut-être même inventé le propos, et que César n'y est pour
rien. Labéon prétend aussi que les vétérans tiennent les plus mauvais
discours sur votre compte, et que vous avez tout à en redouter en ce
moment. Ils s'indigneraient surtout de ce que ni César ni moi ne sommes
décemvirs, quand les décemvirs ont tous été nommés par votre influence.
J'étais en marche : mais en apprenant ces détails, j'ai jugé prudent de
ne point passer les Alpes, avant de savoir positivement ce qui se passe
autour de vous. Ces vains propos, ces confidences sur vos danger sont un
but, croyez-le bien. On veut vous faire peur et monter la tête à ce
jeune homme. Ils ont beaucoup à y gagner. Il leur faut le plus d'argent
possible. Voilà, selon moi, le fin mot de l'histoire. Je vous conseille
toutefois de prendre vos mesures et d'être sur vos gardes. Il n'est
personne au monde dont la vie me soit plus précieuse et plus chère que
la vôtre. Faites attention seulement que la manifestation de vos
craintes pourrait multiplier vos dangers, et que vous devez à tout prix
ramener les vétérans. Satisfaites-les d'abord pour les décemvirs;
occupez-vous ensuite des récompenses. Voyez s'il n'est pas à propos de
distribuer aux vétérans, en notre double nom, les terres de ceux qui ont
servi sous Antoine. Quant à l'argent, il faut aller plus doucement et se
rendre compte de la situation financière : on peut dire que le sénat
s'en occupe. Il me semble que les terres de Sylla et de la Campanie
conviennent pour les quatre légions à qui vous en destinez. Mon avis est
que le partage soit égal ou abandonné au sort. Dans tout ce que je viens
de vous dire, je ne consulte pas mon sentiment particulier; je n'écoute
que mon attachement pour vous et mon désir de la paix, qui, sans vous,
est impossible. A moins de nécessité absolue, je ne quitterai point
l'Italie. J'arme les légions, je les exerce, et j'aurai bientôt,
j'espère, à opposer à tous les événements, à toutes les surprises, une
armée assez formidable. Mais César ne me remet point la légion qui lui
est venue de l'armée de Pansa. Répondez-moi sans perdre un instant, et
si vous avez quelque chose de confidentiel à me dire, envoyez-moi un
homme à vous.
867. — D. BRUTUS A
CICÉRON. Eporédia, 25 mai.
F. XI, 23. Notre situation n'est pas
mauvaise, et je mets tous mes soins à la rendre meilleure. Lépide montre
de bonnes dispositions. Eloignons donc toute crainte de notre esprit, et
voyons sans préoccupation ce que demande l'intérêt de la république. En
mettant tout au pis d'un côté, nous avons de l'autre trois armées
formidables, fidèles et pleines d'ardeur. Voilà certes un motif de
confiance; vous n'en manquez jamais : seulement, que la fortune qui nous
seconde double aujourd'hui votre courage. Les bruits dont je vous ai
parlé dans ma précédente lettre, toute de ma main, n'ont d'autre but que
de vous effrayer. Piquez-vous au jeu une bonne fois ; faites la grosse
mine, et je vous réponds qu'il n'y en aura pas un capable de vous
regarder en face. Ainsi que je vous l'ai mandé, je reste en Italie
jusqu'à ce que j'aie de vos nouvelles.
662
868 A PLANCUS. Rome 29 mai.
F. X, 20. Il y a tant d'incertitudes dans
les nouvelles qui nous arrivent du théâtre de la guerre que je ne sais
que vous écrire. Tantôt tout est au mieux de la part de Lépide, tantôt
tout le contraire. Il n'y a que sur vous que les nouvelles 11e varient
pas : vous êtes toujours l'homme qu'on ne peut ni tromper, ni réduire.
C'est la fortune et votre propre sagesse qui vous gardent. Mais je viens
de recevoir une lettre de votre collègue des ides de mai ; vous lui
mandiez que Lépide fermait ses bras à Antoine; nous en serions plus
sûrs, si vous nous l'aviez écrit directement. Peut-être cette fausse
joie que vous nous avez donnée récemment vous rend-elle plus
circonspect. Vous avez pu vous tromper vous-même, mon cher Plancus : eh
! qui ne se trompe pas? mais tout le monde voit qu'on n'a pu vous
tromper. A présent vous devez savoir parfaitement à quoi vous en tenir.
C'est le cas du proverbe: Non bis in idem. Si les choses sont
telles que vous les avez mandées à votre collègue, nous devrions être
sans alarmes; mais nous ne serons parfaitement tranquilles qu'après une
lettre de vous. Je vous l'ai souvent dit, je vous le répète encore : à
qui finira l'œuvre, à celui-là toute la gloire; et celui-là, ce sera
vous, comme je le désire et je l'espère. Sans doute je n'aurais pas pu
faire pour vous plus que je n'ai fait ; et si j'apprends sans surprise
combien vous en êtes touché, ce n'est pas du moins sans la plus vive
joie. Mais que tout aille bien seulement, et vous en verrez bien
d'autres. Le 4 des kal. de juin.
869. LENTULUS A
SON CHER CICERON. Perga, 29 mai.
F. XII, 14. Ayant acquis dans ma visite à
Brutus la certitude qu'il n'irait pas prochainement en Asie, j'y suis
retourné pour terminer mes opérations et expédier au plus vite les fonds
a Rome. Là, j'ai su que la flotte de Dolabella était clans les eaux de
Lycie, qu'elle comptait plus de cent vaisseaux de transport en état de
recevoir à bord toute son armée, ce qui était effectivement la
destination de tout ce matériel. Le plan de Dolabella était, s'il
échouait en Syrie, de repasser la mer, et de venir en Italie se joindre
à Antoine et aux autres brigands; je frémis à cette idée, et toute
affaire cessante, malgré l'infériorité de mes bâtiments en nombre et en
force, je résolus d'aller sur-le-champ présenter le combat à sa flotte.
Sans la conduite des Rhodiens, mon coup demain avait peut-être un plein
succès. L'ennemi du moins a reçu une rude atteinte. Sa flotte est
dispersée ; chefs et soldats, à mon approche tout s'est enfui, et les
transports de Dolabella sont tombés entre mes mains, depuis le premier
jusqu'au dernier. Je suis donc rassuré sur un point capital : Dolabella
ne peut maintenant se rendre en Italie et aller accroître les
difficultés de votre position, par la force qu'il prêterait à ses
complices. Vous verrez, par ma dépêche officielle, à quel point les
Rhodiens ont manqué à leurs devoirs envers moi et la république. C'est
sur quoi même je n'insiste peut-être pas suffisamment. Que voulez-vous?
ils sont fous, et mes injures personnelles ne m'ont jamais touché : leur
mauvaise disposition pour moi, leur partialité pour nos ennemis leur
mépris ob- 663
stiné pour les hommes les plus honorables, auraient pourtant bien mérité
un châtiment. Ce n'est pas que je les croie tous également mauvais :
mais il arrive, comme par fatalité, que ceux qui ont refusé de recevoir
mon père alors fugitif, L. Lentulus, Pompée et tant d'autres citoyens
illustres, sont encore aujourd'hui eu possession du pouvoir, ou
disposent à leur gré de ceux qui le possèdent. Ils ont la même insolence
dans leur méchanceté. Il sera bon d'avoir raison d'une si détestable
audace, et de ne pas laisser le mal s'accroître par l'impunité;
l'intérêt de la république le réclame. — Je recommande de nouveau les
intérêts de ma gloire à votre sollicitude, et je compte aujourd'hui
comme toujours qu'au sénat et ailleurs votre appui ne me manquera pas.
Puisque le gouvernement d'Asie est décerné aux consuls avec faculté de
s'y faire remplacer jusqu'à ce qu'ils puissent s'y rendre, engagez-les ,
je vous prie, à me donner la préférence, et à me charger de leurs
pouvoirs ici jusqu'au moment de leur arrivée. Rien ne les oblige d'y
venir pendant la durée de leur magistrature , ou d'y envoyer une armée.
Dolabella est en Syrie, et, comme vous l'avez prophétiquement annoncé,
avant qu'il puisse être ici, Cassius aura raison de ce misérable. Il
s'est vu fermer les portes d'Antioche et repousser dans toutes ses
tentatives d'attaque; et, comme il ne pouvait espérer d'être plus
heureux devant aucune autre ville, il s'est jeté du côté de Laodicée,
place maritime de Syrie. Je ne doute pas qu'il n'y reçoive sous peu le
châtiment de ses crimes; car, d'une part, il ne lui reste plus de
retraite, et, de l'autre, il n'est pas en état de résister longtemps à
une aussi puissante armée que celle de Cassius. Je me flatte que c'est
une affaire faite, et que déjà il est écrasé. Aussi je crois qu'Hirtius
et Pansa ne sont pas bien pressés d'aller promener leurs faisceaux dans
la province, et qu'ils aimeront mieux exercer leur consulat à Rome.
Point de doute, en conséquence, que vous n'obteniez leurs pouvoirs en
mon nom pour l'Asie, si vous voulez bien les leur demander ; d'ailleurs
Pansa et Hirtius me l'ont promis positivement, me parlant à moi-même, et
ils me l'ont écrit depuis mon départ. De plus, Pansa a assuré notre ami
commun Verrius que je n'aurais pas de successeur pendant toute la durée
du consulat, et qu'il en faisait son affaire. Au reste, ce n'est pas,
sur ma parole, l'amour du pouvoir qui me fait tenir à cette
prolongation. Je n'ai trouvé ici que labeurs, périls et dommages
personnels. Je voudrais que tout cela ne fût pas en pure perte, et qu'il
me restât la satisfaction de finir ce que j'ai commencé ; c'est là ce
qui m'occupe. Si j'avais pu vous envoyer tout l'argent que j'ai perçu,
je serais le premier à demander un successeur ; mais je voudrais
remplacer les fonds dont je me suis mis à découvert pour Cassius, et
tout ce qui a été perdu par le meurtre de Trébonius, par les pillages de
Dolabella et par l'infidélité des mandataires, traîtres envers l'État;
et il me faut du temps pour en venir à bout. Faites, je vous prie, que
je vous aie cette obligation, et mettez-y votre zèle ordinaire. — Je
crois avoir assez bien mérité de la république pour prétendre, je ne
dirai pas seulement à obtenir le gouvernement de cette province, mais à
être traité sur le même pied que Cassius et les Brutus, comme ayant pris
part à leur glorieuse entreprise et à leurs dangers, et comme identifié
à leurs vues et à leurs sentiments politiques. Le premier, j'ai sapé les
lois d'Antoine ; le premier, j'ai fait passer la ca-
664
valerie de Dolabella du côté de la république, et je l'ai livrée a
Cassius ; le premier, j'ai fait des levées pour nous défendre tous
contre une conspiration détestable; seul j'ai mis aux ordres de Cassius
et de la république la Syrie et les armées qui s'y trouvaient. Certes,
si je n'avais pas fourni à Cassius tant de secours en argent et en
soldats, et si je n'avais pas mis la célérité que j'y ai mise, il n'eût
pas osé mettre le pied en Syrie, et la république n'aurait pas
aujourd'hui moins à craindre de Dolabella que d'Antoine. Et quand j'ai
fait tout cela, j'étais le compagnon et l'ami de Dolabella; les liens du
sang m'attachaient de très-près aux Antoines, je leur étais même
redevable de mon gouvernement; mais il n'est rien que je préfère à la
patrie, et j'ai commencé par déclarer la guerre à tous les miens.
Quoique je n'aie pas jusqu'ici obtenu de grands résultats, je ne
désespère point, et je sens que rien ne peut refroidir mon amour pour la
liberté, non plus que mon ardeur et mon courage. Cependant, si, grâce
aux bonnes dispositions du sénat et à l'appui des gens de bien, quelque
beau témoignage assurément bien mérité venait stimuler mon zèle,
j'aurais une action plus puissante sur les esprits, et je n'en pourrais
que mieux servir la république. Je n'ai pu voir votre fils, lorsque j'ai
été trouver Brutus; ii était déjà parti pour les quartiers d'hiver avec
la cavalerie. Sur ma parole, on parle de lui de manière à me causer une
vive joie pour vous, pour lui, et surtout pour moi-môme; car il est né
de vous et. digne de vous, et je le regarde comme un frère. Portez-vous
bien.
870. — LÉPIDE,
IMPERATOR РOUR LA SECONDE FOIS, GRAND PONTIFE, AU SÉNAT ET AU PEUPLE
ROMAIN. Du Pont d'Argent, 30 mai.
F. X, 35. Si votre santé, si la santé de
vos enfants est bonne, je m'en réjouis. Je me porte bien également. Je
prends les Dieux et les hommes à témoin, pères conscrits, que je n'ai
jamais eu qu'un but, qu'une pensée; que jamais je n'eus rien de plus à
cœur que le salut commun et la liberté : ces sentiments, vous les auriez
vus à mes œuvres, si la fortune ne m'en avait arraché le pouvoir. Il y a
eu sédition parmi mes soldats. L'armée tout entière a déclaré que sa
mission était de ménager les citoyens et de conserver la paix; qu'elle y
voulait rester fidèle. J'ai été à la lettre contraint de me mettre à sa
tête, afin de ne pas compromettre la vie et la sûreté de tant de braves
gens. Dans ces circonstances, je vous prie et vous conjure, pères
conscrits, d'oublier les injures personnelles, de songera la république
aux abois, et de ne pas voir un crime dans ce sentiment honorable qui me
fait reculer moi et mes soldats devant les fléaux de la guerre civile.
Que la vie et l'honneur des citoyens vous touchent; c'est le meilleur de
tous les partis pour vous et pour la république. Le 3 des kal. de juin.
871. — D. BRUTUS A
CICERON. Pollentia, en Etrurie.
F. XI, 13. Je m'abstiens de vous
remercier; ce n'est point par des paroles qu'on doit répondre, quand des
réalités suffiraient à peine pour témoigner sa reconnaissance. Je
voudrais que vous fissiez attention à ce que vous avez entre les mains.
Vous êtes pénétrant; une lecture attentive de
665
ma correspondance vous donnera la clef de tout. Voici, mon cher Cicéron,
pourquoi je n'ai pas pu me mettre immédiatement à la poursuite d'Antoine
: j'étais sans cavalerie et sans chevaux de charge ; j'ignorais la mort
d'Hirtius, et je ne voulais point me fier à César sans l'avoir vu et
entendu. Il y eut ainsi un premier jour de perdu. Le lendemain, Pansa me
fit prier de l'aller voir à Bologne ; j'appris sa mort en chemin. Je
retournai à mon fantôme d'armée; je ne puis parler autrement : ce sont
des ombres. Elles manquent de tout. Antoine avait une avance de deux
jours. Il se sauvait plus vite que je ne pouvais le poursuivre. Ses
rangs étaient rompus : je marchais en ordre. Partout sur son passage il
a ouvert les prisons et rassemblé des hommes, et il ne s'est arrêté
qu'en arrivant aux gués. Je vous dirai ce que c'est : les gués se
trouvent entre les Apennins et les Alpes, il n'y a point de passage plus
difficile. J'en étais éloigné de trente milles, et déjà Ventidius
l'avait joint, lorsque je sus qu'Antoine avait harangué ses soldats, et
qu'il les avait engagés à le suivre et à passer les Alpes, en les
assurant qu'il était d'accord avec Lépide. Il n'y eut qu'un cri pour
toute réponse : Vaincre ou mourir en Italie. Les troupes de Ventidius
surtout répétèrent mille fois : Vaincre ou mourir en Italie! Elles sont
nombreuses, celles d'Antoine presque nulles; elles demandèrent à être
conduites droit à Pollentia; Antoine ayant cherché vainement à les
ramener, le départ fut fixé au lendemain. Sûr "de mes avis, je détachai
à l'instant cinq cohortes sur Pollentia, et je m'y dirigeai moi-même.
Mon détachement y est arrivé uue heure avant Trébellius et sa cavalerie.
Jugez de ma joie ! Il y va de la victoire, ils espéraient que les quatre
légions de Plancus ne seraient pas aussi fortes qu'eux, et ils ne
pouvaient croire à un retour si rapide en Italie. Les Allobroges et la
cavalerie, à qui j'avais fait prendre les devants, étaient en position
de les arrêter: me voici moi-même. J'ai bien plus de confiance encore.
S'ils parvenaient pourtant à passer l'Isère, je mettrais tous mes soins
à en prévenir les conséquences. Prenez donc courage, et ayez bon espoir
dans le dénoûment qui approche. Vous voyez nos dispositions, celles de
nos armées, la parfaite intelligence qui règne entre nous. De votre
côté, ne vous relâchez pas de votre activité et pourvoyez à tout.
Mettez-nous en état de combattre à outrance cette conspiration
abominable sans avoir à nous préoccuper des besoins de notre armée et du
reste. Les misérables! ils assemblaient des troupes sous le
faux-semblant de l'intérêt public, et ils veulent s'en servir tout d'un
coup pour ruiner leur patrie !
872. — PUBLIUS
LENTULUS, FILS DE PIBLIUS, PROPRETEUR, AUX CONSULS, AUX PRÉTEURS, AUX
TRIBUNS DU PEUPLE, AU SÉNAT ET AU PEUPLE ROMAIN. Perga , 2 juin.
F. XII, 15. Si votre santé est bonne,
ainsi que celle de vos enfants, je m'en réjouis. Je me porto bien
moi-même. Durant l'oppression de l'Asie, suite du crime de Dolabella, je
me suis retiré dans la province voisine, la Macédoine, et dans les
places occupées, au nom de la république, par M. Brutus , et j'y ai
avisé aux moyens les plus prompts de vous remettre en possession de
l'Asie et de ses revenus. Mais à l'avance Dolabella avait pris
666
l'alarme; il s'est hâté de tout ravager, faisant main-basse sur les
impôts, allant jusqu'à dépouiller et vendre comme esclaves tout ce qu'il
a trouvé de citoyens romains; puis il a quitté le pays avant l'arrivée
d'une force suffisante. Moi-même alors, et sans attendre cet appui, j'ai
cru devoir sur-le-champ retourner à mon poste pour lever le reste des
tributs, rassembler les sommes mises en dépôt, vérifier ce qui en a pu
être détourné, informer contre les coupables, et vous rendre compte de
tout. J'étais en route et déjà dans l'Archipel, lorsque j'appris que la
flotte de Dolabella était en Lycie, et que les Rhodiens avaient en mer
beaucoup de navires équipés et armés. Je réunis les vaisseaux que
j'avais amenés avec moi à ceux qu'avait pris soin de rassembler le
proquesteur Patricius, à qui je suis doublement attaché et par les liens
de l'amitié et par une intime conformité de sentiments politiques, et je
fis voile pour Rhodes. J'étais plein de confiance dans l'autorité du
sénat et dans la puissance du décret qui déclare Dolabella ennemi
public, ainsi que dans le traité d'alliance renouvelé avec les Rhodiens
par les consuls M. Marcellus et Ser. Sulpieius; traité suivant lequel
ils s'engagent, sous serment, à considérer comme ennemis les ennemis du
sénat et du peuple romain. Je m'étais grandement trompé : loin d'unir
leurs forces navales aux miennes, ils ont fermé à nos soldats l'entrée
de la ville, du port et de la rade. Ils leur ont refusé des vivres et
jusqu'à de l'eau. C'est à peine s'ils ont consenti à me recevoir avec
quelques petites embarcations : il m'a fallu souffrir cette indignité,
et me taire devant cette atteinte portée non-seulement à mes droits,
mais encore à la majesté de l'empire et du peuple ; car j'avais appris
par des lettres Interceptées que Dolabella, s'il perdait tout espoir du
côté de la Syrie et de l'Egypte, voulait s'embarquer avec sa bande et
ses trésors et regagner l'Italie. Il bloquait, dans cette vue, les côtes
de Lycie, et avait mis embargo sur tous les navires de charge du port de
deux mille amphores et au-dessus. J'en conçus de vives craintes, et
voilà, pères conscrits, ce qui m'a contraint à passer l'insulte sous
silence, et à en accepter pour mon compte toute la mortification.
Introduit dans la ville comme par grâce, j'ai plaidé de mon mieux devant
le sénat la cause de la république ; j'ai insisté sur le danger de voir
le brigand s'embarquer avec ses complices; mais j'ai trouvé chez eux les
esprits pervertis au point de voir la force partout, excepté dans le bon
parti ; de traiter de chimère l'accord unanime de tous les ordres pour
la défense de la liberté, de croire le sénat et les honnêtes gens
résignés à tout souffrir, et de ne supposer à personne l'audace de
déclarer Dolabella ennemi public. Enfin tous les contes inventés par la
malveillance ont prévalu près d'eux sur les faits et mes assertions.
Déjà cette disposition avait éclaté avant mon arrivée, lorsque , après
le meurtre infâme de Trébonius, suivi de taut de forfaits et de crimes,
ils envoyèrent deux députations à Dolabella; nouveauté sans exemple,
contraire à leurs lois et accomplie malgré la défense de leurs
magistrats. Je ne sais s'ils agissent, comme ils le disent, par suite
de craintes pour leurs possessions du continent, plutôt que par
aveuglement, ou par l'impulsion d'un petit nombre de furieux qui naguère
ont fait les mômes outrages à nos plus illustres citoyens, et qui sont
aujourd'hui en possession des charges et du pou-
667
voir. Toujours est-il que tous les exemples que j'ai pu citer, que tout
ce que j'ai pu dire de mes dangers personnels et des périls dont Rome et
l'Italie sont menacées, si ce parricide, chassé d'Asie et de Syrie,
parvient à gagner l'Italie avec sa flotte, que rien n'a pu les décider à
s'opposer à des malheurs qu'il leur était si facile de prévenir.
Plusieurs des miens soupçonnent même leurs magistrats de m'avoir retenu
et voulu amuser jusqu'à ce que la flotte de Dolabella pût être Informée
de ma présence à Rhodes. Quelques circonstances postérieures donnent de
la consistance à ce soupçon : ainsi, par exemple, deux lieutenants de
Dolabella, Sex. Marius et С Tullius, ont quitté subitement la Lycie et
la flotte, et se sont enfuis sur une longue barque, abandonnant tous les
bâtiments de transport qu'ils avaient mis tant de peine et de temps à
rassembler. — Ayant quitté Rhodes pour la Lycie avec mes vaisseaux, j'ai
pu reprendre les navires de transport et les rendre à leurs maîtres.
Ainsi je suis délivré de ma plus grande crainte, qui était de voir
Dolabella et ses brigands passer en Italie. J'ai poursuivi sa flotte
jusqu'à Syda, qui est la dernière ville de ma province. Là, j'appris
qu'une partie s'était dispersée, et que le reste faisait voile pour la
Syrie et Chypre. Ce résultat obtenu, j'ai vu d'autant moins
d'inconvénients à retourner à mes fonctions, que Cassius, aussi bon
citoyen que bon général, se trouve en Syrie à la tête d'une puissante
flotte. — Je n'épargnerai ni efforts ni soins pour votre service, pères
conscrits, et pour celui de la république. Je ne perds pas un moment, je
ramasse autant d'argent que possible, et je vous l'enverrai avec tous
les comptes. Si je parcours la province, je tâcherai de connaître et
ceux dont la fidélité a conservé à la république l'argent que j'avais
déposé entre leurs mains, et les lâches qui se sont rendus complices de
Dolabella et de ses crimes, en lui remettant leurs fonds; et je ne
manquerai pas de vous signaler les uns et les autres. Il vous paraîtra
sans doute nécessaire de sévir avec vigueur contre les coupables, afin
de raffermir mon autorité et la vôtre, de faciliter les rentrées et
d'assurer la conservation de nos recouvrements. Déjà, pour protéger la
perception et mettre la province plus à l'abri, j'ai levé un corps de
volontaires; ce secours m'était absolument indispensable. Au moment où
je vous écris, j'apprends qu'une trentaine de déserteurs de Dolabella
provenant des levées par lui faites en Asie viennent d'arriver de Syrie
en Pamphylie. Ils racontent que Dolabella s'est présenté devant
Antioche, ville de Syrie; qu'il n'y a pas été reçu ; qu'il a plusieurs
fois tenté l'assaut, et qu'il a été constamment repoussé avec perte ;
qu'on lui a tué une centaine d'hommes, et qu'ayant abandonné ses
malades, il s'est enfui pendant la nuit, se dirigeant vers Laodicée;
que, pendant cette retraite nocturne, presque tous ses soldats d'Asie
ont déserté; que huit cents sont retournés à Antioche, et ont fait leur
soumission entre les mains des commandants laissés par Cassius, et que
les autres sont descendus dans la Cilicie par le mont Amanus : c'est
parmi ceux-là que se seraient trouvés les hommes de qui viennent ces
nouvelles. Ils ajoutent qu'au moment où Dolabella marchait vers
Laodicée, Cassius et ses
668
troupes n'en étaient qu'à quatre jours de distance. J'ai donc bon espoir
que le brigand recevra plus tôt qu'on ne le croyait le châtiment dû à
ses crimes. Le 4 des nones de juin.
873. — DÉCIMUS BRUTUS
A CICÉRON. De son camp , 3 juin.
F. XI, 26. J'ai, dans l'excès de ma
douleur, une consolation, c'est qu'on reconnaît maintenant la justesse
de mes prévisions et de mes craintes. Qu'on délibère donc s'il faut ou
non que les légions reviennent d'Afrique et de Sardaigne, si l'on doit
ou non appeler Brutus, s'il y a lieu de me donner ou de me refuser des
subsides. J'écris au sénat. Croyez bien que si on ne fait ce que je
demande, tout est à redouter. Je vous conjure de veiller au choix des
hommes qu'on chargera de m'amener les légions. Ne prenez que des gens
actifs et sûrs.
874. _ A DÉCIMUS
BRUTUS. Rome, 4 Juin.
F. XI, 21. Que les Dieux confondent
Ségulius ! II n'y a pas, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais de plus
grand misérable. Mais quoi ! vous figurez-vous donc qu'il ne parle ainsi
qu'à vous ou à César? Il tient le même langage à tous ceux qu'il
rencontre. Mon amitié ne vous en sait pas moins, mon cher Brutus, tout
le gré possible de m'avoir fait part de ces bagatelles, et j'y reconnais
une nouvelle preuve de votre vive affection. Les vétérans, dit Ségulius,
se plaignent de ce que ni vous, ni César, vous ne faites partie des
décemvirs. Eh! grands Dieux, que n'ai-je pu moi-même me dispenser d'en
être ! Il n'est pas de plus fâcheuse commission. J'avais proposé que les
généraux en fissent partie; les opposants d'habitude se sont récriés, et
vous en avez été exclus, quoi que j'aie pu dire. Mais laissons là
Ségulius, c'est de l'argent qu'il veut. Il a mangé, non pas le sien, il
n'en a jamais eu, mais celui qu'on venait de lui donner. — Vous
m'écrivez, mon cher Brutus, que si vous êtes sans crainte pour vous,
vous n'êtes pas aussi tranquille pour moi. Que vous êtes bon et que vous
m'êtes cher! mais je vous supplie de ne prendre aucune alarme à mon
sujet. Je saurai éviter tous les dangers contre lesquels on peut se
mettre en garde. Il en est d'autres où la prudence ne saurait que faire,
et il ne faut pas s'en préoccuper. Notre nature a des limites; l'homme
ne peut sans aveuglement prétendre aller au delà. Je reconnais votre
sagesse et votre amitié dans cette observation. D'ailleurs prenez garde,
me dites-vous, qu'une fois dans la voie de la crainte et des alarmes, on
ne s'arrête pas. Croyez que si l'impassibilité est le trait distinctif
de votre caractère, que si vous n'avez jamais connu la peur, j'ai bien
aussi quelque ressemblance avec vous. Rassurez-vous, je garde mon
sang-froid, et je ne néglige en même temps aucune précaution. Ce serait
bien au surplus votre faute, mon cher Brutus, si j'avais quelque chose à
redouter ; car enfin vous êtes à la tête de forces considérables, vous
allez être consul, chacun sait que vous êtes mon ami : comment,
669
avec tout cela, un homme même timide pourrait-il s'effrayer? J'approuve
entièrement vos vues au sujet des quatre légions, et sur le partage des
terres, dont vous êtes tous deux d'accord. Quelques-uns de nos collègues
avaient terriblement envie d'être de la commission de partage; mais ce
n'était pas mon compte, et je vous l'ai fait réserver tout entière. Oui,
si j'ai quelque avis important à vous transmettre, j'enverrai un exprès.
Mes lettres vous arriveront ainsi d'une manière sûre.
875. — A DÉCIMUS
BRUTUS. Rome, б juin.
F. XI, 24. Écoutez : la brièveté de vos
lettres me mettait naguère de mauvaise humeur. Il me semble aujourd'hui
que c'est moi qui allonge trop les miennes. Je vous imiterai. Que de
choses en peu de mots ! Votre position est bonne : vous travaillez à la
rendre meilleure. Vous êtes content de Lépide, et nous avons trois
armées excellentes. Certes, il y aurait là de quoi rassurer le plus
timide. Aussi, à votre voix, mon imagination s'est-elle emportée. Au
fait, comment ne se donnerait-elle pas carrière aujourd'hui, lorsqu'hier
vous étiez assiégé dans Modène, et que pourtant ma sécurité était
entière? Ah! que ne puis-je rester dans mon caractère et en même temps
vous céder ici mon rôle, mon cher Brutus? Vous attendez de mes
nouvelles, dites-vous, et jusqu'à ce que vous en ayez, vous resterez en
Italie. Vous en aurez, en effet, si l'ennemi veut bien le permettre; il
se passe tant de choses à Rome! Mais si vous croyez qu'en arrivant vous
mettrez fin à la guerre, n'ayez de cesse que vous ne soyez ici. Un
décret a mis à votre disposition tout ce qu'il y a d'argent disponible.
Servius vous est bien dévoué; je veille à tout.
876. - PLANCUS A
CICERÓN. Cularon ( aujourd'hui Grenoble), pays des Allobroges, 6 juin.
F. X, 23. Jamais, mon cher Cicéron,
jamais, je le jure, je ne reculerai devant un danger pour la patrie.
Mais dû moins qu'en cas de malheur on ne m'accuse pas de légèreté. Si
j'avais eu une confiance aveugle dans Lépide, je n'hésiterais pas à le
reconnaître. La confiance est une erreur plutôt qu'un crime, et même une
erreur où les plus honnêtes gens se laissent facilement prendre; mais ce
tort, je ne l'ai pas eu : je connaissais l'homme à fond. Ce qu'il y a à
dire, c'est qu'une sorte de respect humain (et c'est chose bien
dangereuse à la guerre) m'a entraîné. J'ai craint de prêter le flanc à
l'envie, si je n'allais pas le rejoindre ; j'ai craint qu'on ne vit
toujours en moi de la vieille rancune contre Lépide, et l'envie de
prolonger la guerre. C'est sous cette impression que j'ai conduit mes
troupes jusqu'en vue de Lépide et d'Antoine en quelque sorte, et que
j'ai pris position à quarante milles seulement de distance, de manière à
pouvoir, suivant les circonstances , me porter en avant avec rapidité,
ou battre en retraite sans dommage. Le terrain que j'avais choisi me
donnait pour barrière devant moi un fleuve que l'ennemi ne pouvait
passer sans perdre du temps : derrière j'avais les Vocontiens, dont la
fidélité me répondait de tous les passages. Lépide, ne me voyant pas
venir, après m'avoir attendu avec beaucoup d'inquiétude, avait fait
alliance avec Antoine le 4 des kalendes de juin, et le même jour tous
deux s'étaient mis en marche dans ma direction; ils n'étaient plus qu'à
vingt milles, lorsque j'en fus informé. En un clin d'œil, grâce à la
bonté des Dieux, tout fut disposé pour ma retraite ; et je pus
l'effectuer sans avoir l'air de fuir. Rien
670
n'est resté en arrière, et ces brigands, qui croyaient déjà tenir leur
proie, ne purent saisir ni un fantassin , ni un cavalier, ni le moindre
bagage. La veille des nones de juin, mes troupes avaient toutes repassé
l'Isère, et les ponts que j'avais fait jeter étaient rompus. Mes hommes
auront ainsi quelques jours de repos, et je pourrai faire ma jonction
avec mon collègue, que j'attends sous trois jours. — Je dois rendre
hommage à la loyauté de notre ami Latérensis et à son admirable
patriotisme. Aveuglé par son amitié pour Lépide, il n'a pas vu le
danger; et le malheureux, éclairé trop tard, a tourné contre lui-même
des armes qu'il aurait mieux fait de diriger contre Lépide. On s'est
précipité pour désarmer son bras: il vit encore et l'on espère le
sauver. J'en doute. Les parricides sont inconsolables d'avoir manqué
leur coup. C'était contre moi la môme rage que contre la patrie. Ils
sont furieux surtout de mes lettres à Lépide pour le presser d'en finir;
de la manière dont je me suis exprimé sur certaines conférences; de mon
refus d'admettre en ma présence des députés venus sous la garantie de
Lépide ; enfin de l'arrestation de С Catius Vestinus, tribun du peuple,
sur qui j'ai saisi des dépêches d'Antoine à Lépide. Fuis ils comptaient
si bien réussir, que je ne puis m'empêcher de rire en songeant à leur
mystification. — Restez toujours le même pour nous, mon cher Cicéron ;
pensez à ceux qui sont devant l'ennemi et soutenez-les vigoureusement.
Que César arrive avec ce qu'il a de meilleures troupes; en cas
d'empêchement personnel, qu'il m'envoie son armée, c'est certes lui qui
court le plus gros jeu. Ce camp est devenu le rendez-vous de tout ce
qu'il y a de misérables acharnés à la ruine de la patrie. Pourquoi, de
notre côté, ne pas tout employer pour la sauver? Faites votre devoir
là-bas, et je réponds ici de ne pas manquer au mien. Chaque jour je
m'attache à vous davantage, mon cher Cicéron, et vos bontés me pénètrent
si bien, que mon plus grand malheur, je le sens, serait de perdre dans
votre estime et dans votre amitié. Puisse ma pieuse reconnaissance vous
faire trouver quelque douceur dans le sentiment de tout ce que vous
faites pour moi !
877.—ASINIUS POLLION A
CICÉRON. Cordoue, 8 juin.
F. X, 32. Mon questeur Balbus vient de
s'embarquer furtivement à Gadès. Il emporte une somme immense, partie en
or, partie en argent, prélevée sur les impôts publics, et n'a pas même
payé la solde des troupes. Retenu pendant trois jours à Calpé par un
gros temps, il s''est jeté, le jour des kalendes de juin, dans les États
du roi Bogude, assez bien en fonds, comme vous voyez. Je ne sais pas
encore si, par les bruits qui courent, il retournera à Gadès ou se
rendra à Rome. Le misérable change à chaque instant de résolution,
suivant les nouvelles qui lui arrivent. Outre ses vols et ses rapines,
outre ses cruautés envers nos alliés, souvent frappés de verges par ses
ordres, voici certains faits dont il se vante, comme les ayant imités de
С César. Le dernier jour des jeux qu'il donna à Gadès, il décerna un
anneau d'or à l'histrion Hérennius Gallus, et le fit placer sur l'un des
quatorze bancs
671 institués par lui pour
l'ordre équestre; il s'est prorogé lui-même dans le quatuorvirat ; il a
tenu en deux jours les comices de deux ans, c'est-à-dire qu'il a nommé
pour la seconde année qui bon lui a semblé. Il a fait revenir les
exilés, non pas ceux de ces temps-ci, mais ceux du temps où les
sénateurs furent massacrés et chassés par des séditieux, Sextus Varus
étant proconsul. Mais voici maintenant ce dont César ne lui a pas donné
l'exemple : pendant ses jeux, il a fait représenter une pièce où l'on a
mis en scène toute l'histoire de sa mission auprès du proconsul L.
Lentulus. Les larmes lui sont venues aux yeux, pendant la pièce, au
souvenir de ses hauts faits. Ce n'est pas tout : il avait enrôlé de
force parmi les gladiateurs un certain Fadius, ancien soldat de Pompée ;
Fadius, après avoir deux fois déjà combattu gratis, refusa de s'engager
une troisième, et se sauva parmi le peuple, qui lança des pierres à la
troupe. Balbus lit charger la foule par sa cavalerie gauloise; puis le
pauvre soldat ayant été ramené nu cirque, on l'enterra à mi-corps au
milieu de l'arène et on l'y fit brûler vif. Cette exécution eut lieu
après le dîner de Balbus. Il y alla se promener sortant de table, les
pieds nus, sans ceinture et les mains derrière le dos. Et comme le
malheureux s'écriait : Je suis citoyen romain! Va, va, répondait Balbus,
implore à présent la protection du peuple. Mais n'a-t-il pas livré aux
bêtes des citoyens romains, notamment un employé aux encans, homme fort
connu à Hispalis, et cela uniquement parce qu'il était laid? Voilà le
monstre qu'on m'avait adjoint. J'ai eu moi-même une difficulté avec cet
infâme. Je vous en dirai bien d'autres quand nous nous verrons. — Ce qui
est plus important aujourd'hui, c'est que vous vouliez bien m'envoyer
des instructions. J'ai trois légions fidèles, dont l'une, la
vingt-huitième, fut fortement travaillée par Antoine. Au commencement de
la guerre, il promettait cinquante deniers à tout déserteur le jour de
l'arrivée au camp, et après la victoire les mêmes récompenses qu'à ses
propres troupes; et l'on sait si sa prodigalité connaîtrait des bornes.
Mes soldats étaient fort ébranlés; je les ai retenus, non sans peine, je
vous le jure, et même je n'y aurais pas réussi s'ils n'avaient été
disséminés; à telles enseignes que plusieurs cohortes se sont mutinées
dans différents quartiers. Antoine n'a cessé de faire agir aussi la
séduction sur mes autres légions, prodiguant sans mesure les promesses
et les messages. Pendant ce temps Lépide et Antoine me persécutaient de
leurs lettres pour avoir la trentième légion. De tout cela, il résulte
clairement qu'une armée que je n'ai voulu vendre à aucun prix, et à qui
la crainte des dangers dont la menace le triomphe de nos ennemis n'a pu
faire perdre un seul soldat, est une armée désormais acquise et dévouée
sans réserve à la république. Mon empressement à exécuter jusqu'ici vos
ordres vous garantit mon obéissance à venir. J'ai maintenu la
tranquillité dans la province et la soumission dans mes troupes ; je
n'ai pas mis le pied hors de mon gouvernement; je n'ai congédié aucun
soldat légionnaire, ni même auxiliaire, et, si j'ai eu quelques
déserteurs dans la cavalerie, des supplices m'en ont fait raison. Voilà
ce que j'ai fait, et je me croirai bien payé si la république est
sauvée. Mieux connu d'elle et de la majorité du sénat, j'eusse pu être
mieux employé. Je vous envoie
672
en communication la lettre que j'ai écrite à Balbus, avant qu'il eût
quitté la province. Si vous étiez tenté de lire aussi sa pièce,
demandez-la à Gallus Cornélius, mon ami. Le 6 des ides de juin.
878. — A CASSIUS.
Rome, juin.
F. XII, 8. Je sais positivement qu'on vous
envoie les actes officiels, et vous connaissez par conséquent le crime
de votre parent Lépide, suite de l'inconstance sans égale et de la
légèreté de son caractère. Ainsi, nous regardions la guerre comme
terminée, et voici que nous recommençons une guerre nouvelle. Nous
mettons aujourd'hui tout notre espoir en D. Brutus et en Plancus. Mais,
à vrai dire, c'est sur vous et sur mon cher Brutus queje compte
réellement comme notre refuge en cas de malheur, ce qu'à Dieu ne plaise,
et comme les seuls hommes d'ailleurs capables de reconstituer la liberté
d'une manière durable. On dit que vous en avez fini avec Dolabella :
malheureusement ce ne sont que des on dit, et l'on ne peut remonter à la
source. Ce qu'il y a de certain, mon cher Cassius, c'est qu'on vous
tient pour un homme de premier ordre, et pour ce que vous avez déjà
fait, et pour ce que vous pouvez faire encore. Que cette pensée vous
soit toujours présente, et vous irez loin. Il n'y a rien dont le peuple
romain ne vous croie capable et qu'il n'attende de vos généreux efforts.
Adieu.
879. — A CASSIUS.
Rome, Juin.
F. XII, 9. Vous êtes si bref dans vos
lettres, que je ne puis être long dans mes réponses. Et franchement il
ne me vient guère à vous dire. Tous nos actes passent sous vos yeux, et
nous sommes ici dans une complète ignorance des vôtres. L'Asie nous
semble fermée, il ne nous en vient aucune nouvelle; il a couru pourtant
un bruit de la défaite de Dolabella, et ce bruit a pris quelque
consistance; mais on n'a pu jusqu'ici remonter à sa source. Quant à
nous, nous avions cru la guerre terminée, et voilà, grâce à votre parent
Lépide, toutes nos alarmes qui recommencent. N'oubliez donc pas que vous
êtes, vous et vos troupes, la principale ressource de la république.
Nous avons des armées excellentes. Cependant nous avons besoin de vous
pour que tout aille" bien, car la république est bien malade. Ce serait
trop de dire qu'elle est désespérée, mais il est certain que ses
destinées dépendent de votre consulat. Adieu.
880. —CASSIUS,
QUESTEUR, A CICÉRON. Crommyu-acris, île de Chypre, 13 juin.
F. XII, 13. Ma joie est au comble; voilà
la république sauvée et votre gloire qui renaît plus belle. Ce qui me
charme et me surprend tout ensemble, c'est que vous ayez pu vous
surpasser, et que le consulaire soit plus grand que le consul. II y a je
ne sais quelle fatalité attachée à votre vertu : ce n'est pas
d'aujourd'hui que nous l'éprouvons. Votre toge a fait ce que n'ont pu
nos armes; c'est elle qui vient d'arracher des mains de l'ennemi la
république à moitié vaincue, et de la rendre à nos vœux. Enfin nous
serons libres. Le plus grand des citoyens, celui que je chéris tant, a
pu me juger durant les jours d'épreuve. Il a été témoin de mon
dévouement pour lui et pour la république , dont il est désormais
inséparable. Il m'a souvent dit qu'il serait muet tant que durerait la
servitude, mais qu'il saurait me rendre justice en temps et lieu. Je ne
vous demande pas de me
673
tenir parole, mon cher Cicéron; je vous demande de me conserver vos
bontés. Il m'importe moins d'être signalé par vous à l'estime publique
que d'avoir et de mériter votre propre estime, afin que vous n'imputiez
pas ma conduite à quelques mouvements passagers de jeunesse et
d'exaltation, mais aux principes que vous m'avez toujours connus, et
afin que vous me classiez parmi les hommes de quelque valeur sur qui la
patrie peut compter. Mon cher Tullius, vous avez des enfants et des
proches qui sont dignes de vous, et vous avez raison de les aimer. Après
eux, vous devez chérir encore vos émules de dévouement à la république,
et puisse le nombre en être aussi grand que je le souhaite ! mais la
foule n'en est pas telle, je pense, que vous ne puissiez me recevoir
parmi eux, et disposer de moi en tout et pour tout. Je crois avoir donné
peut-être quelques preuves de courage; quant à mes talents, si faibles
qu'ils soient, un long asservissement a dû les faire paraître plus
faibles encore qu'ils ne sont réellement. — Les cotes de l'Asie et les
îles m'ont fourni tout ce qu'on pouvait en tirer de vaisseaux, et,
malgré la résistance des villes, j'ai effectué assez lestement une levée
de matelots. J'ai voulu courir après la flotte de Dolabelln ; Lucilius
son commandant annonçait à chaque instant son arrivée ; mais il s'en
tenait aux paroles, et en définitive il a fait voile pour Corycum, où il
se tient enfermé dans le port. J'ai jugé à propos de l'y laisser. Comme
le plus pressé était d'arriver au camp, et comme j'avais d'ailleurs
derrière moi une flotte sous les ordres du questeur Turulius, cette
flotte qu'il y a un an Tillius Cimber rassembla en Bithynie, j'ai cinglé
vers Cypre. J'arrive, et je me hâte de vous envoyer les nouvelles que je
viens d'apprendre. A l'exemple de nos infidèles alliés de Tarse, ceux de
Laodicée , bien plus pervers encore, ont appelé à eux Dolabella, qui a
pu rassembler dans ces deux villes un certain nombre de soldats grecs et
s'en faire une sorte d'armée. 11 campe sous les murs de Laodicée, qu'il
a rasés en partie, pour que son camp ne fit qu'un avec la ville. Notre
cher Cassius, avec dix légions, vingt cohortes d'auxiliaires et quatre
mille chevaux, occupe Paltos, qui en est à vingt milks. Il espère
vaincre sans combat, car le blé vaut déjà douze drachmes au camp de
Dolabella ; et si les navires Laodicéens ne parviennent à le
ravitailler, il faut nécessairement qu'il y meure de faim. Or, il nous
sera facile d'empêcher le ravitaillement avec la nombreuse flotte de
Cassius commandée par Sextius Rufus, et les trois autres que Turulius,
Patiscus et moi avons amenées. Courage donc! nous allons ici mettre
ordre aux affaires, comme vous là-bas. Adieu. Le jour des ides de juin.
881. — A DÉCIMUS
BRUTUS. Rome, 18 Juin.
F. XI, 25. C'est moi qui attendais une
lettre de vous lorsque Lupus est venu me demander brusquement si je
voulais vous écrire. Je n'ai rien à vous mander. Je sais qu'on vous
envoie les actes officiels, et que les lettres qui ne renferment que des
mots vous déplaisent. Je serai donc bref, à votre exemple : toute notre
espérance est en vous et en votre collègue. —Rien de certain encore sur
Brutus. J'ai fait ce que vous dé-
674
siriez. Je lui ai écrit lettres sur lettres ; je le presse de se joindre
à nous. Que n'est-il déjà ici, nous aurions moins à craindre du mal
intérieur qui nous dévore et qui s'aggrave chaque jour. Mais que fais-je
? J'oublie votre laconisme : me voilà déjà à la seconde page. Victoire
et santé !
882. — BRUTUS A ATTICUS.
De Macédoine, juin.
B.17. Vous m'apprenez que Cicéron s'étonne
de voir que je ne m'explique jamais sur sa conduite politique, et vous
insistez pour connaître le fond de ma pensée. Puisque vous l'exigez,
j'obéis. Je commence par reconnaître que Cicéron n'agit que dans
d'excellentes intentions; qui pourrait être plus convaincu que moi de
ses sentiments pour la république? Mais je lui trouve en quelques
occasions, dirai-je de la maladresse ? mais c'est le plus prudent des
hommes; dirai-je des détours et les ménagements? mais il a bravé sans
hésitation pour la république la redoutable inimitié d'Antoine. Que dire
donc? Une vérité incontestable : c'est qu'il a irrité plutôt que réprimé
dans le cœur d'un enfant la passion du pouvoir et de l'arbitraire ;
c'est qu'il se laisse aller, pour lui complaire, à d'indécents propos
dont tout le poids retombe au surplus doublement sur sa tête, à lui qui
a fait périr plus d'un homme, et qui doit se décerner le nom de
meurtrier avant de le donner à Casca, avant de retourner contre Casca
les invectives de Bestia contre Cicéron. Quoi I parce qu'à tout propos
nous ne faisons pas sonner les ides de mars, comme lui les nones de
décembre, est-il plus autorisé à condamner un fait glorieux que Bestia
et Clodius ne l'étaient à dénigrer son consulat? — L'ami Cicéron se
vante que sa toge a suffi pour briser les armes d'Antoine. Que m'importe
si l'héritage d'Antoine devient le prix de sa chute; si le destructeur
de ce grand fléau le remplace par un autre mal dont les racines seront
bien autrement fortes et profondes, en supposant que nous leur
permettions de se développer? Il est évident que l'idée d'un maître ne
révolte Cicéron que si ce maître s'appelle Antoine. Et je lui saurais
gré de ne repousser d'un tyran que sa mauvaise humeur et non son
despotisme; de lui faire prodiguer à la fois et sans mesure triomphe,
argent, honneurs, décrets ! Octave rougira-t-il de son insolente
fortune, quand il peut l'afficher sous le patronage d'un consulaire tel
que Cicéron? —Vous m'avez contraint de m'expliquer ; résignez-vous donc
à entendre des vérités pénibles. Je ne sens que trop moi-même mon cœur
saigner de vous les écrire. Je sais comment vous jugez les plaies de la
république ; je sais que, toutes désespérées qu'elles sont, vous y voyez
encore du remède. Je suis loin de vous eu faire un reproche, mon cher
Attiras; vous n'êtes point un homme d'action; votre âge, vos habitudes,
vos enfants, vous paralysent : c'est ce que notre ami Flavius m'a fort
bien expliqué : mais je reviens à Cicéron. Quelle différence, je vous
prie, entre lui et Salvidiénus? Ce courtisan d'Octave eût-il proposé en
sa faveur des décrets plus complaisants? Cicéron, direz-vous, craint
encore la queue de la guerre civile; mais peut-on s'effrayer d'un ennemi
vaincu, au point de se fermer les yeux sur l'audace d'un enfant qui
dispose d'une armée victorieuse, ou de ne pas redouter sa puissance ? Ou
plutôt considère-t-il
675
déjà cette puissance comme tellement irrésistible qu'il n'y ait plus
qu'à venir volontairement mettre tout aux pieds du maître? Inconcevable
aberration de la peur, qui ne voit d'autre précaution contre un mal
qu'elle eût peut-être évité, que de l'aller chercher elle-même, et de
lui faire une sorte de violence! On s'effraie trop aujourd'hui de la
mort, de l'exil, de la misère. Voilà pour Cicéron le dernier degré du
malheur. Tant qu'il trouve à qui demander ce qu'il désire, tant qu'on
lui prodigue des attentions et des louanges, il souscrit aune servitude
honorable, s'il y a toutefois quelque chose d'honorable dans la plus
honteuse humiliation. Mais Octave appelle Cicéron son père, il le
consulte en tout, il l'accable de louanges et de remercîments. Soit :
les effets n'en viendront pas moins démentir les paroles. C'est se jouer
du bon sens que de donner le nom de père à qui l'on ne laisse pas même
la condition d'homme libre. Le bon Cicerón n'a qu'un but; il y tend, il
y marche, il y court : c'est la protection d'Octave. Pour moi, je le
déclare, ses merveilleux talents ne sont plus rien à mes yeux. Quel
profit tire-t-il de tant d'éloquents écrits sur la liberté de la patrie,
sur la dignité de l'homme, sur la mort, sur l'exil, sur la pauvreté?
Philippe entend mieux tout cela que Cicéron, car Philippe accorde moins
à son beau-fils que Cicéron à un étranger. Qu'il continue donc de se
vanter, mais qu'il cesse d'insulter à nos douleurs. Qu'avons-nous gagné
à la défaite d'Antoine, si on ne l'a expulsé que pour donner sa place à
un autre? Votre lettre, après tout, me laisse quelques doutes sur
l'importance de cette défaite. Eh! que Cicéron vive, puisqu'il peut
vivre suppliant et sujet, sans respect pour son âge, pour ses dignités,
pour ses grandes actions! Moi, c'est aux choses que je fais la guerre ;
je veux dire, à la tyrannie, aux commandements exceptionnels, à toute
domination, à tout pouvoir qui veut se mettre au-dessus des lois. La
servitude aura beau se faire douce et bonne ; elle m'épouvantera
toujours. Antoine, me dites-vous, est un honnête homme; voilà ce que je
n'ai jamais cru. Qu'importe d'ailleurs? Nos ancêtres n'ont pas voulu
même d'un père pour leur maître. Si je ne vous aimais pas autant que
Cicéron se croit aimé d'Octave, je ne vous aurais pas ainsi laissé lire
dans mon âme. Je m'afflige de la peine que cette lettre va vous causer,
à vous qui chérissez si tendrement tous vos amis, et surtout celui-là.
Mon affection pour lui, veuillez le croire, n'a rien perdu de sa
vivacité , mais mon estime a bien déchu. Comment gagner sur soi-même de
juger les choses autrement qu'on ne les voit ? — Je regrette que vous ne
m'ayez pas mandé ce qu'on propose pour notre chère Attica. J'aurais pu
vous en dire mon avis. Votre sollicitude pour la santé de Porcia ne me
surprend point. Enfin, je ferai avec plaisir ce que vous désirez ; mes
sœurs m'en prient de même. Je verrai l'homme et je saurai quelles sont
ses prétentions.
883. — A CASSIUS.
Rome, Juillet.
F. XII, 10. Suivant un sénatus-consulte
rendu à l'unanimité le 30 des ides de juin, Lépide, votre parent et mon
ami, vient d'être déclaré ennemi public, ainsi que tous ceux qui se sont
associés à sa défection. On leur donne jusqu'aux
676
kalendes de septembre pour venir à résipiscence : le sénat ne manque pas
de vigueur, vous le voyez; mais il en a parce qu'il voit en vous un
appui. Au moment où je vous écris, le cercle de la guerre s'est bien
agrandi par la trahison et la légèreté de Lépide. On répand chaque jour
d'excellentes nouvelles au sujet de Dolabella; mais ce ne sont que des
bruits, et on ne peut remonter à la source. Au milieu de ces rumeurs,
votre lettre, datée de votre camp le jour des nones de mai, a persuadé à
tout le monde que vous en aviez fini avec Dolabella, et que vous étiez
en marche vers l'Italie, vous et votre armée, pour nous aider soit de
vos conseils et de votre influence, si la guerre est finie; soit de vos
troupes, s'il reste, encore quelque chose à faire sur les champs de
bataille. Vous pouvez compter sur moi pour vos soldats; mais il sera
temps de s'occuper d'eux lorsqu'on saura ce qu'ils peuvent pour la
république, ou quels services ils ont rendus. On parle beaucoup de leurs
bonnes et brillantes dispositions , mais aucun résultat encore. Je me
persuade toutefois qu'à l'heure qu'il est tout est décidé, ou que le
moment approche. Il n'y a rien au-dessus de votre courage et de votre
grande âme. Aussi n'aspirons-nous qu'à vous posséder en Italie. Pour
nous vous êtes la république personnifiée. Hélas ! quel triomphe était
le nôtre, sans l'asile qu'Antoine vaincu, désarmé, fugitif, a trouvé,
près de Lépide? Aussi y a-t-il à Rome plus d'acharnement contre Lépide
que contre Antoine lui-même. C'est au milieu des agitations les plus
violentes que l'un a fait la guerre ; c'est du sein de la victoire et de
la paix que l'autre vient d'en ranimer les brandons. Nous lui opposerons
les consuls désignés; mais, quelque confiance qu'ils nous inspirent,
nous n'en sommes pas moins dans l'incertitude. Les armes sont si
journalières ! C'est par vous et par Brutus, par vous seuls, croyez-le
bien, que la question sera décidée. On vous attend l'un et l'autre,
Brutus plus impatiemment encore. Si, comme je l'espère, nos ennemis sont
vaincus avant votre arrivée, votre présence nous sera bien nécessaire
pour redonner de la vie à la république et lui rendre un peu d'assiette;
car même après avoir mis un terme aux attentats de ses ennemis, il y
aura bien des plaies à guérir. Adieu.
884. — A BRUTUS. Rome.
B. 9. Je voudrais, à mon tour, vous
apporter les consolations que j'ai reçues de vous dans une épreuve
semblable ; mais les remèdes que vous offriez alors à ma douleur ne vous
feront sans doute pas faute aujourd'hui (Brutus
avait perdu quelque personne chère). Puisse l'application cette
fois en être plus facile et plus efficace! Un homme tel que vous ne
recule pas devant la pratique de ce qu'il a conseillé lui-même. Vos
raisons et surtout votre ascendant sur moi ont retenu mon chagrin dans
de justes bornes. Je ne montrais pas, disiez-vous, toute la fermeté qui
convient à un homme, et à un homme accoutumé à consoler les autres. Ce
reproche est même exprimé dans votre lettre d'un ton de sévérité qui ne
vous est pas ordinaire. J'ai tant de respect pour votre jugement, que la
crainte de votre censure me fit faire un effort sur moi-même. Ce que
j'avais recueilli de leçons de sagesse dans les écoles, dans les livres,
dans le commerce de la vie, me semblait recevoir de vous une autorité
677
nouvelle ; et cependant, mon cher Brutus, je n'avais alors à obéir qu'au
devoir et aux inspirations de ma douleur, tandis que vous, placé, comme
on dit, sur le théâtre, vous vous devez au publie. Sur vous sont fixés
les yeux de votre armée, de | vos concitoyens, je puis dire de toute la
terre. Vous qui êtes le principe de notre courage, pourriez-vous en
manquer? Oui, votre douleur n'est que trop légitime. Ce que vous avez
perdu , l'univers ne peut vous le rendre. Insensible, vous seriez plus à
plaindre encore ; mais cette douleur, il faut la modérer. La raison le
conseille à tout le monde ; la nécessité vous en fait une loi. Je
pourrais continuer ce sujet, mais pour vous peut-être j'en ai déjà trop
dit. Nous vous attendons impatiemment vous et votre armée; sans vous,
quels que soient nos avantages, nous ne nous croirons pas vraiment
libres. C'est tout ce que je vous dirai sur notre situation politique.
Vous aurez plus de détail et peut-être des choses plus positives dans
une lettre dont je chargerai notre ami Vêtus.
885. — A BRUTUS. Rome,
juillet.
B. 12. Le départ de Messalla Corvinus
m'offrait une occasion prochaine de vous écrire; mais je n'ai pas voulu
laisser partir Vêtus sans une lettre de moi. Brutus, la crise de l'État
est plus grave que jamais : après avoir vaincu, il nous faut combattre
encore. C'est la criminelle démence de Lépide qui porte ses fruits. J'ai
en ce moment de rudes assauts à soutenir dans la part que je prends aux
affaires ; mais ma plus pénible épreuve a été de tenir bon contre les
supplications de votre mère et de votre sœur (Tertia,
sœur de la femme de Lépide). Près de vous, du moins, et c'est ce
qui me touche le plus, je compte sur une approbation facile. En effet,
il n'y avait absolument aucun moyen d'établir une distinction entre la
cause de Lépide et celle d'Antoine. Le crime même de Lépide est plus
odieux. Quoi ! le sénat le comble des plus brillants honneurs, lui-même
il le remercie en termes magnifiques, et, quelques jours à peine
écoulés, il recueille les débris de nos adversaires, et nous fait par
terre et par mer une guerre impitoyable! Quelle en sera l'issue?
Personne ne peut le dire. On vient implorer notre miséricorde pour ses
enfants; mais quelle garantie nous est offerte à nous contre les
derniers supplices, s'il arrive (puisse Jupiter en détourner le
présage.)que leur père ait le dessus? C'est une dure nécessité, j'en
conviens, que de faire passer du père aux enfants la solidarité du
crime; mais n'est-il pas admirable aussi que la sagesse des lois ait
fait servir la tendresse paternelle à resserrer les liens qui nous
attachent à la patrie? C'est Lépide qui est cruel envers sa famille, et
nou celui qui déclare Lépide ennemi public. Supposons le calme rétabli :
la seule condamnation pour violence, dont à coup sur rien ne pourrait le
défendre, entraînerait de même la confiscation de ses biens et la ruine
de ses enfants. Au reste, le sort qui les attend et que votre mère et
votre sœur veulent conjurer par leurs prières, Lépide, Antoine, et leurs
adhérents, vous le promettent, et cent fois pis encore. Notre unique
espoir est en vous et dans votre armée. Accourez donc au plus tôt, je
vous le répète ; il y va du salut de l'État, de votre honneur et de
votre gloire. La patrie a besoin de vos conseils
678
autant que de votre épée. J'ai fait à Vêtus, suivant votre désir,
l'accueil que méritent son attachement pour vous et de si rares
services. Je le tiens pour ami passionné de la république, et
constamment préoccupé de ses intérêts. Enfin, je vais revoir mon fils,
je l'espère; car je ne veux pas douter que vous n'arriviez bientôt en
Italie, et lui avec vous.
886. — BRUTUS A CICERON.
De Macédoine, Juillet.
B. 13. Je ne puis me défendre des craintes
que je vois chez les autres, au sujet de Lépide. Si sa défection se
réalise, si malheureusement les soupçons publics ne sont ni injustes ni
téméraires , je vous en conjure au nom de l'amitié, mon cher Cicéron, je
vous en conjure par tout ce que j'ai toujours trouvé chez vous de bonté
pour moi, oubliez que les enfants de ma sœur sont les fils de Lépide, et
considérez-moi comme devenu leur père. Alors, je le sais, il n'y aura
rien que vous ne fassiez pour eux. Chacun a sa manière d'être avec les
siens. Pour moi, selon mon penchant et mes principes, je ne crois jamais
faire assez pour les enfants de ma sœur. Or, en supposant que je ne sois
pas indigne de quelque égard, que pourrais-je attendre des bons
citoyens, que pourraient espérer de moi ma mère, ma sœur et ses
malheureux enfants, si, près de vous, près du sénat, l'oncle ne faisait
pas oublier le père, et si Brutus ne pesait rien dans la balance contre
Lépide? Ma préoccupation et mon chagrin ne me permettent point
d'insister davantage, et même je ne le dois pas ; car si dans une
circonstance aussi grave, aussi pressante, quelques mots ne suffisent
pas pour éveiller ou fortifier votre Intérêt, II n'y a pas de chance que
vous fassiez ce que je veux, ce qu'il faut. Ne vous attendez donc point
à de longues prières, mais voyez qui je suis. C'est moi, Brutus, qui
m'adresse à Cicéron ; moi, à qui l'ami ne peut refuser rien ; mol, à
qui, toute amitié à part, le personnage consulaire doit tout accorder.
Je désire que vous m'appreniez sans délai ce que vous vous proposez de
faire. De mon camp, le jour des kal. de Juillet.
887. — A BRUTUS. Rome,
juillet.
B. 10. Point de lettre de vous encore;
rien même qui nous annonce qu'au reçu de l'autorisation du sénat, vous
avez fait marcher votre armée vers l'Italie : toute l'attente de la
république est dans ce mouvement et dans sa promptitude. Chaque jour, à
l'intérieur, nouveau progrès du mal ; nous sommes travaillés à la fois
par les ennemis du dehors et par ceux du dedans. Ce sont les mêmes qu'au
début de la guerre, mais nous n'avons plus les mêmes moyens pour les
réduire. Alors l'attitude du sénat était plus ferme; mes discours
concouraient avec mes votes à la soutenir. Pansa y siégeait encore, et
trouvait des sorties vigoureuses contre tous les méchants et surtout
contre son beau-père (Q. Fufius Calémus, nommé
consul par Jules César.). Nous avions en lui un consul dont le
courage et la loyauté n'ont jamais failli. Dans la guerre de Modène,
conduite exemplaire de César; Hirtius moins irréprochable ; succès
médiocre en un temps de prospérité, mais dont on pouvait s'applaudir
dans un temps de malheur. La république était victorieuse, l'armée
d'Antoine en déroute, Antoine lui-même chassé d'Italie par Décimus; mais
depuis, que de fautes! La victoire a comme glissé de nos mains.
679
Nos généraux laissent respirer un ennemi consterné , désarmé, couvert de
blessures, et ménagent ainsi à la légèreté déjà trop éprouvée de Lépidee
l'occasion d'une défection plus funeste. Nous avons encore, sous Décimus
et sous Plancus, des armées affectionnées, mais peu aguerries. Les
auxiliaires des Gaules forment un corps respectable, et d'une fidélité a
l'épreuve. Mais voilà que César, jusqu'aujourd'hui si docile à ma voix,
si noble de cœur, si étonnant de fermeté, s'est laissé entraîner, par
des lettres insidieuses, par des rapports mensongers, par de perfides
commentaires , à la présomption que le consulat ne peut lui échapper. Au
premier soupçon de cette intrigue, je me suis empressé de lui écrire
lettres sur lettres pour le ramener. Je ne cesse de prendre à partie
quiconque ici me paraît promettre un suffrage à son ambition. Enfin j'ai
été jusqu'à déchirer le voile, en plein sénat, sur cette odieuse
machination et sur ses auteurs : jamais, en aucune occasion , les
sénateurs ni les magistrats n'ont mérité plus d'éloges, il est sans
exemple, en effet, qu'à la question seule de conférer un honneur
extraordinaire à un homme puissant, tout-puissant même, car la force
militaire est souveraine aujourd'hui, ni tribun, ni magistrat, ni homme
privé, n'ait fait entendre une voix pour l'appuyer. Cette épreuve a été
noblement soutenue , mais l'alarme n'en règne pas moins dans la ville.
C'est que nous sommes à la merci, mon cher Brutus, et de la licence des
soldats et de l'insolence du général. Chacun mesure ses exigences aux
forces dont il dispose. Plus de raison, plus de retenue; lois, usages,
devoirs, rien n'arrête; nulle considération, nul respect pour l'opinion
publique et le jugement de la postérité. C'est dans la prévision de tous
ces excès que je fuyais l'Italie, quand l'annonce de vos édits me fit
revenir sur mes pas. Vous me rendîtes le courage à Vélie. J'avais de la
répugnance à rentrer dans Rome, dont vous, son libérateur, étiez forcé
de vous bannir, comme j'en fus banni moi-même avant vous, mais avec des
circonstances plus pénibles encore. Pourtant, je pris sur moi de
continuer ma route. Je revis Rome ; et là, sans légions, je fis trembler
Antoine au milieu de sa puissance sacrilège. Plus tard, j'acceptai, je
fortifiai de mes conseils et de mon influence la protection armée
offerte par César à la patrie. Ah! qu'il se montre semblable à lui-même,
qu'il me conserve sa déférence, et nous pourrons défier tous les
dangers; mais s'il laisse prévaloir des conseils impies, ou s'il est
vrai que le fardeau des affaires soit au-dessus de son âge, nous n'avons
plus d'espoir qu'en vous. Accourez donc, je vous en conjure; venez
sauver d'un dernier coup cette patrie qui déjà vous devrait son salut,
s'il eût suffi, pour l'assurer, de l'effort d'une grande âme. C'est à
qui va se presser autour de vous. Écrivez à Cassius de se hâter aussi.
Plus d'espoir pour la liberté ailleurs que sous vos tentes. Venez,
l'Occident vous offre encore des armées et des commandants fidèles. Je
veux même, en ce moment, ne pas désespérer de l'appui de notre jeune
homme ; mais de tant de côtés on cherche à le séduire, que je crains
souvent qu'à la fin l'obsession ne l'emporte. Tel est l'ensemble de
notre position au départ de cette lettre. Je souhaite que l'avenir
s'améliore. S'il en est autrement, ce qu'aux Dieux ne plaise! je
porterai le deuil de la répu-
680
blique, après l'avoir crue immortelle. Quant à moi, j'ai peu de jours
encore à compter.
888. — A BRUTUS. Rome,
14 Juillet.
B. 8,14. Que votre lettre est courte ! que
dis-je, courte? ce n'est pas même une lettre. Comment, Dans des
circonstances si critiques, trois ligues de Brutus à moi ! mieux valait
ne pas écrire. Et vous me recommandez de l'exactitude dans ma
correspondance! Mais ai-je jamais laissé retourner près de vous, sans
une lettre, un seul de vos amis ; et avez-vous reçu de moi une seule
lettre insignifiante ? Si mes dépêches ne vous sont pas parvenues, à
coup sûr celles de votre famille vous ont aussi manqué. Vous me faites
espérer une plus longue lettre par Cicéron, fort bien ; mais il ne
fallait pas que celle-ci fût si brève. Dès que j'eus appris par vous le
départ de mon fils, je lui expédiai brusquement un exprès pour lui faire
rebrousser chemin, fût-il déjà en Italie. J'aime à le savoir près de
vous; c'est pour lui le poste de l'honneur. D'ailleurs il avait vu dans
plusieurs de mes lettres qu'après de vifs débats, j'avais fait différer
d'une année l'élection des pontifes. Cet ajournement est dans l'intérêt
de Cicéron , non moins que de Domitius, de Caton , de Lentulus et des
Bibulus; c'est ce que je vous avais mandé à vous-même. Il est vrai que,
quand vous m'avez adressé cette lettre si écourtée, vous ne le saviez
pas encore. Je vous conjure de nouveau avec instance, mon cher Brutus,
de ne pas laisser partir Cicéron, mais de le garder avec vous. Si la
république vous est chère, vous comprendrez qu'il n'y a pas un moment a
perdre pour revenir vous-même en Italie. La guerre recommence par
l'énorme forfait de Lépide. L'armée de César, qui était excellente,
n'offre plus de ressource. Bien plus, c'est elle qui nous force
d'appeler vos troupes à grands cris. Une fois que vous serez en Italie,
il n'est pas un citoyen digne de ce nom qui ne coure se ranger sous vos
drapeaux. Décimus a fait d'une manière brillante sa jonction avec
Plancus; mais vous n'ignorez pas le peu de fond qu'on doit faire sur la
constance des hommes, les aberrations de l'esprit de parti, et les
chances de la guerre. Si nous sommes vainqueurs, comme je l'espère, le
gouvernement de la république n'aura-t-il pas besoin de tout le poids de
votre nom et de toute l'autorité de vos conseils? Arrivez donc, au nom
des Dieux, arrivez à notre secours, toute affaire cessante. Si, aux ides
de mars, quand votre bras sauva de la servitude vos concitoyens, vous
avez bien mérité de la patrie, persuadez-vous que votre prompte arrivée
sera pour elle aujourd'hui un service non moins signalé.
889. — BRUTUS A CICÉRON.
De Macédoine, juillet.
B. 16. Atticus m'a fait passer un extrait
de votre lettre à Octave; je l'ai lu. Les marques de votre intérêt et de
votre sollicitude me touchent sans me surprendre ; vous m'en avez fait
une habitude, et je reconnais chaque jour, dans ce qu'on me rapporte de
vos discours et de vos actes, l'honorable constance de vos sentiments
pour moi ; mais c'est avec la douleur la plus vive dont mon âme soit
capable, que j'ai vu le passage où vous parlez de nous à Octave. Que
vous dirai-je? L'humiliation me fait monter le rouge au visage : il faut
pourtant que je m'explique. Oui, vous lui rendez de telles actions de
grâces sur les affaires publiques, vous employez tant de prières et de
soumissions pour lui recommander
681
notre vie, comme si la mort était pire ! qu'incontestablement pour vous
la tyrannie n'est pas détruite et que le tyran seul est changé. Revoyez
vos expressions, et niez, si vous l'osez, que ce soit là le langage d'un
sujet à son roi. On ne sollicite, lui dites-vous, on n'attend de lui
qu'une grâce : c'est qu'il daigne sauver des citoyens qu'entoure
l'estime des honnêtes gens et du peuple. Ainsi, qu'Octave dise non, et
c'en est fait de notre existence. Ah! plutôt cesser de vivre que de
vivre à ce prix. Mais je ne puis, je le jure, nous croire tellement
abandonnés des Dieux qu'il faille implorer Octave pour le dernier des
citoyens, bien moins encore pour les libérateurs du monde. Ce titre
pompeux sourit à ma fierté, et il convient devant ceux qui semblent
méconnaître de qui partent les vrais périls et à qui doivent s'adresser
les sollicitations. Quoi ! Cicéron, vous reconnaissez ce pouvoir à
Octave, et vous ne rompez pas avec lui! Vous m'aimez, et vous m'appelez
à Rome, à Rome, où je ne pourrais me montrer que sous le bon plaisir
d'un enfant ! De quoi le remerciez-vous, s'il faut se mettre à ses
pieds, pour qu'il nous accorde de vivre ou pour qu'il le tolère? Faut-il
lui savoir gré de s'être substitué à Antoine, pour recevoir de telles
supplications? Fût-il le destructeur des tyrans, au lieu d'en être
l'héritier, serait-ce une raison pour le supplier qu'il daigne laisser
vivre les meilleurs serviteurs de la république? Voilà pourtant où nous
a fait descendre cette pusillanimité, ce découragement, dont je ne vous
fais pas, d'ailleurs, un crime plus qu'à tous les autres; voilà ce qui a
jeté César dans les voies de l'usurpation, voilà ce qui, après sa mort,
a convié Antoine à son sanglant héritage ; voilà enfin ce qui élève
aujourd'hui un enfant si haut, que vous jugez nécessaire de l'implorer
pour des hommes tels que nous, et que vous ne voyez pour nous de
ressource que dans sa pitié, à lui qui n'est pas homme encore. Ah! si
nous nous souvenions que nous sommes Romains, les derniers des mortels
ne montreraient pas, pour arriver à la tyrannie, plus d'audace que nous
pour leur en fermer le chemin; l'ambition d'Antoine aurait été moins
stimulée par le triomphe de César que glacée par son trépas. Mais vous,
personnage consulaire, vous, le vengeur de tant de forfaits dont le
châtiment, je le crains bien, ne fera que retarder un peu notre ruine,
comment pouvez-vous songer à ce que vous avez fait et approuver ce qui
se passe, ou du moins vous y prêter avec cette facile résignation qui
vous donne l'apparence d'y consentir? Quels motifs particuliers de haine
aviez-vous contre Antoine? Il vous a révolté, si je ne me trompe, par
son insolence à nous imposer sa protection ; à nous forcer, nous, ses
libérateurs, de n'avoir sous lui qu'une existence précaire, et
d'abandonner la république aux caprices de son bon plaisir. Vous avez
fait un appel aux armes pour l'empêcher de régner. Dans quel but ?
Était-ce pour supplier un autre tyran de se laisser mettre à sa place,
ou pour rendre à la république son indépendance? N'avons-nous repoussé
en lui que les conditions de la servitude, non la servitude elle-même?
Mais il ne tenait qu'à nous de trouver dans Antoine un bon maître qui
nous eût comblés de biens et d'honneurs : qu'avait-il
682
à refuser à des hommes dont l'adhésion eût fait le principal appui de
son pouvoir? Mais il n'y a pas de prix assez haut pour notre honneur et
pour la liberté. Cet enfant même que son nom de César anime contre ceux
qui ont frappé César, quels trésors, si nous étions à vendre, ne
donnerait-il pas pour s'assurer par notre concours un pouvoir qu'après
tout il saura bien saisir seul, puisque la vie, l'opulence, un titre
consulaire, sont tout ce qu'on veut aujourd'hui ? C'est donc en vain que
César aura péri, en vain que nous nous serons réjouis de sa mort, qui
n'a pu conjurer la servitude. Mais que chacun à son gré se résigne !
Quant à moi, que les Dieux et les Déesses m'arrachent tout, plutôt que
d'affaiblir la résolution que j'ai prise de refuser à l'héritier du
tyran abattu sous mes coups ce que je n'ai pas toléré dans le tyran
lui-même, ce que je ne souffrirais pas de mon propre père sortant du
tombeau, une puissance au-dessus des lois et du sénat. Croyez-vous qu'il
garantisse bien la liberté pour les autres, celui qui ne laisse pas dans
Rome un coin que nous puissions occuper sans sa permission? Mais comment
entendez-vous, je vous prie, le succès de vos prières? Vous demandez
sûreté pour nos personnes : jugez-vous le salut assuré par cela seul
qu'on assure l'existence? Et que faire de la vie sans l'honneur, sans la
liberté? Suffit-il donc, à votre avis, d'habiter Rome pour être sauvé?
Ce n'est pas le lieu qui me touche, c'est la chose qu'il me faut. — Je
n'ai commencé à respirer du vivant de César que du jour où ma grande
résolution fut arrêtée. En aucun lieu pour moi il n'y aura d'exil, tant
que pour moi la servitude et les humiliations seront les seuls maux
insupportables. Sommes-nous revenus aux sombres jours du passé, pour
qu'on implore, en faveur des vengeurs du peuple et des destructeurs de
la tyrannie , l'homme qui fait revivre en lui ce nom de tyran que les
Grecs poursuivaient par des supplices jusque dans les fils des tyrans
immolés? Me croyez-vous donc bien empressé de revoir, et pensez-vous que
je reconnaisse pour ma patrie, une ville incapable de recevoir la
liberté qui lui est offerte, qui lui est donnée ; une ville qui n'a pas
foi en elle-même et qui redoute dans un enfant le nom d'un roi qui n'est
plus, quand, pour abattre ce roi dans l'apogée de sa puissance, il a
suffi de quelques bras et d'un instant de courage? Ne me recommandez
donc plus aux bontés de votre César; et si vous me pouvez croire,
renoncez à les demander pour vous-même. C'est mettre un prix exorbitant
au peu d'années qui vous restent, que de les marchander ainsi aux genoux
d'un enfant. Prenez-y garde, on pourrait cesser de voir, dans votre
admirable lutte contre Antoine, l'œuvre d'une grande âme, pour ne plus y
reconnaître que les suggestions de la peur. S'accommoder d'Octave quand
il faut l'implorer pour notre existence, c'est autoriser à dire que
l'idée de subir un maître ne vous a jamais révolté, mais que vous en
avez cherché un qui fût plus de votre goût. Louez dans Octave ce qu'il a
fait jusqu'ici, rien de mieux; il mérite vos éloges, si toutefois en
attaquant la domination d'un autre il n'a pas eu en vue d'assurer la
sienne : mais quand vous trouvez naturel qu'on le prie de ne pas nous
immoler ; quand vous vous exagérez à ce point le degré de
683
sa puissance, vous attachez un prix excessif à ses services, et vous lui
décernez ее que par lui la république semblait avoir ressaisi pour
jamais. Comment une réflexion ne vous est-elle pas venue? Octave,
dit-on, mérite des honneurs pour avoir combattu Antoine ; mais ceux qui
ont coupé dans sa racine le mal dont Octave ne poursuit que les restes,
dites-moi, je vous prie, quels honneurs accumulés sur leurs têtes
pourraient jamais, à ce compte, acquitter envers eux la reconnaissance
publique? Ce qui se passe montre au surplus combien chez les hommes la
crainte est puissante et la mémoire légère. On ne voit qu'Antoine, parce
qu'il vit, parce qu'il a les armes à la main. Quant à César, les efforts
et les devoirs sont accomplis, et le passé est désormais sans retour.
Quoi! ce serait d'un Octave que le peuple romain attendrait aujourd'hui
notre arrêt! Quoi! c'est nous dont le salut serait à la merci d'un seul
homme et au prix d'une humble prière ! Quant à moi, sachez que, pour
retourner à Rome, je ne m'abaisserai point à des supplications, que je
châtierai même l'insolence de quiconque exigera qu'on le supplie : ou
bien je fuirai le séjour des esclaves; tout pays me sera Rome où je
vivrai libre, et je plaindrai les hommes en qui l'âge et tant d'exemples
de courage et d'honneur ne diminuent pas l'attachement à la vie. En
restant à jamais fidèle à cette résolution, je jouirai d'un bonheur qui
me tiendra lieu de la reconnaissance due à mes pieux efforts. Est-il un
bien plus précieux que le témoignage d'une vie pure? et quand la liberté
suffit, qu'importe le reste? Non certes, on ne me verra pas tomber avec
ceux qui tombent ; non certes, je ne me laisserai pas vaincre par ceux
qui courent au-devant d'une défaite volontaire. Point de moyens que je
ne tente, point d'efforts que je ne fasse! je ne me lasserai jamais de
roidir les bras pour arracher ma patrie à la servitude. Si la fortune me
suit comme elle le doit, nous serons tous heureux; sinon, je serai
heureux en dépit d'elle. Qu'y-a-t-il en effet de meilleur, dans cette
vie d'un moment, que de dévouer sa force et sa pensée à la délivrance de
ses concitoyens? — О mon cher Cicéron, je vous en supplie, je vous en
conjure, ne vous laissez vaincre ni par la fatigue, ni par le
découragement. En luttant contre le mal qui nous dévore, ne vous en
préoccupez point jusqu'à négliger celui dont l'avenir menace de
développer les germes, s'ils ne sont étouffés d'avance. Consul et
consulaire, votre âme libre et vigoureuse a deux fois sauvé la patrie !
mais restez au niveau de vous-même, ou vous verrez s'évanouir l'honneur
de tant d'héroïsme. Ne vous y trompez point : la vertu qu'on a déjà vue
à l'œuvre impose de plus pénibles devoirs qu'une vertu encore ignorée.
On se croit des droits sur elle, et si elle ne paye pas sa dette, la
confiance trompée s'échappe en dépit et en haine. Cicéron résiste à la
tyrannie d'Antoine, voilà un grand acte de courage ; toutefois il
n'excite point d'admiration, car le consul avait annoncé le consulaire.
Mais que Cicéron manque une seule fois de déployer contre un autre tyran
la noble énergie qui a ruiné l'ambition d'Antoine, il se voit déshérité
d'un seul coup, et du surcroît de gloire que l'avenir lui réservait , et
des nobles souvenirs que son nom réveillait dans tous les cœurs. C'est
qu'il n'y a rien de vraiment grand sans fixité de principes. C'est à
vous plus qu'à tout autre qu'il appartient d'aimer la république et de
défendre la liberté. Votre génie, vos actions, l'amour du peuple, le cri
public, tout vous en fait la loi. Ne songez donc
684
plus à demander à Octave qu'il daigne nous laisser vivre, mais plutôt
secouez un engourdissement fatal, et vous comprendrez au réveil que,
pour redevenir libre et glorieuse encore, cette Rome, théâtre de vos
grandes actions, n'a besoin que de chefs qui lui apprennent à résister
aux méchants.
890. — A BRUTUS. 27
juillet.
B. 18. Quand je vous pressais dans mes
lettres de venir au secours de la république et de ramener votre armée
en Italie, je n'imaginais guère qu'il y eût doute sur ce point parmi les
vôtres. Cependant voyez la prudence extrême de votre mère, et cette
inquiète sollicitude qui rapporte à vous, qui consume en vous toutes ses
pensées. Elle m'a fait prier l'autre jour de passer chez elle ; c'était
le 8 des kalendes d'août : je m'y rendis, comme je le devais, à
l'instant même. Casca s'y trouvait avec Labéon et Scaptius. Elle entra
aussitôt en matière et posa ces questions : Devait-on vous proposer de
revenir, et vous était-il avantageux de le faire ; ou valait-il mieux
pour vous ne rien précipiter et attendre? Mon opinion était fixée :
L'honneur de Brutus, répondis-je, et l'attente de tous les citoyens lui
commandent de venir, en toute hâte, au secours de la patrie ébranlée et
chancelante. En effet, que manque-t-il encore, selon vous, aux chances
funestes de cette guerre, quand une armée victorieuse se refuse à
poursuivre l'ennemi dans sa fuite ; quand, de gaieté de cœur, un général
couvert d'honneurs, comblé de richesses, heureux époux, heureux père,
allié à votre famille, va tourner ses armes contre la république ; quand
enfin, en dépit de l'imposant accord du sénat et du peuple, le mal a son
foyer dans l'enceinte même de nos murs? — Au moment où je vous écris, je
me sens sous le poids d'un profond chagrin. Ce jeune homme, ou plutôt
cet enfant, pour qui je me suis porté garant envers la république, me
fait craindre que mon engagement ne puisse être rempli. Au milieu de si
grands intérêts, on se compromet bien plus gravement à répondre des
intentions et des opinions d'autrui qu'à se porter caution pour une
dette. Dans ce dernier cas, on se dégage avec de l'argent, parce qu'on
peut se résigner à une perte de fortune ; mais comment se libérer d'un
engagement politique pris pour un autre, si celui dont on a répondu ne
seconde pas son garant? Cependant j'ose encore espérer qu'en dépit de
tant d'influeuces contraires, il ne se soustraira pas à son devoir
envers moi. Je lui trouve un bon fonds; mais on est facile à cet âge, et
il y a presse autour de lui pour le corrompre. On se flatte de fausser,
par un vain prestige de gloire, la rectitude de son ! esprit. J'ai donc,
pour surcroît de soins, à mettre en jeu une foule de combinaisons pour
m'assurer de ce jeune homme, et pour échapper moi-même au reproche de
légèreté. De légèreté? mais après tout ne l'ai-je pas engagé plus que
moi, en répondant de lui? En quoi la république aurait-elle à se
plaindre de ma garantie, quand, par la fermeté de sa conduite, il y a
répondu au delà de mes promesses et de son propre caractère? — Le plus
sérieux embarras du gouvernement, si je ne me trompe, c'est la pénurie
de nos finances. Nos gens de bien deviennent sourds de plus en plus aux
appels de fonds. Le peu qu'a produit l'impôt du centième, grâce à
l'impudence des
685
riches dans leurs déclarations mensongères, a été absorbé par la
gratification promise à deux légions. D'immenses charges, cependant,
vont peser sur nous, par la présence des armées qui nous défendent ici,
et bientôt de la vôtre. Quant a Cassius, il y a lieu de présumer qu'il
aura fait face à ses besoins avant d'arriver. Il me tarde de
m'entretenir de vive voix avec vous sur ce sujet et sur bien d'autres. —
J'avais été au devant de vos recommandations en ce qui touche les
enfants de votre sœur. Comme la guerre va sans doute se prolonger, c'est
une affaire qui ne sera pas entamée avant votre retour. Mais, dès le
principe, et lorsque je ne pouvais deviner ces lenteurs , j'avais plaidé
vivement au sénat la cause de vos neveux ; votre mère aura eu soin de
vous l'écrire. Il n'est pas de circonstance où je ne sois prêt, au péril
même de ma vie, à dire et à faire tout ce qui me paraît propre à
répondre àvos désirs ou à servir vos intérêts. Adieu.
891. —PLANCUS A
CICERON. Des Gaules, 25 Juillet.
F. X, 24. Je ne puis me défendre, à chaque
nouveau service, de vous parler de ma gratitude; et pourtant, je le
jure, j'en ai quelque honte. La nature et l'intimité de nos rapports ne
comportent pas de remercîments entre nous, outre qu'il me répugne de
n'avoir à payer que d'une aussi pauvre monnaie des services aussi
importants. Quand je serai près de vous, mon respect, ma déférence et
mon dévouement vous diront bien mieux que je ne suis point ingrat. Oui,
je le jure, si l'occasion m'en est donnée, vous trouverez chez moi plus
de dévouement, de déférence et de respect, que chez l'ami le plus
reconnaissant ou le parent le plus tendre. Savez-vous que je serais fort
embarrassé de dire si votre amitié et la bonne opinion que vous avez de
moi répandront dans les temps à venir plus de relief sur mon nom
qu'elles ne répandent aujourd'hui de charme sur mon existence? Vous avez
plaidé la cause de nos soldats : si j'ai désiré que le sénat fit quelque
chose pour eux, ce n'est pas dans des vues personnelles : je ne
considère jamais que le bien commun. Mais d'abord ils méritaient des
récompenses; puis, j'ai voulu, dans de sages prévisions, les attacher
fortement à la république, et surtout les maintenir comme je l'ai fait
jusqu'ici à l'abri des séductions qui les travaillent de toutes parts.
Grâce aux Dieux, je ne suis entamé par aucun bout. Je sais que c'est une
victoire qu'on me demande, mais je suis persuadé qu'une conduite aussi
prudente aura votre approbation; car, au premier mécontentement de mes
soldats , la république, qui n'a aucune force en réserve , serait
désarmée contre un coup de main et contre les brigandages de nos
parricides. Vous connaissez, je crois, l'effectif de l'armée : il y a
dans mon camp trois légions de vétérans et une seule de recrues, mais la
plus excellente de toutes; au camp de Brutus, une légion de vétérans,
une autre qui a deux ans de service, et huit légions de recrues. Ainsi
l'armée est nombreuse sans être forte. Nous ne savons que trop qu'il
faut peu compter sur les recrues devant l'ennemi. Mais si, au noyau dont
je dispose, venait se joindre, ou l'armée d'Afrique toute composée de
vieilles troupes, ou l'armée de César, je livrerais sans crainte à la
chance d'un combat les destinées de la république. L'armée de César
étant bien plus à ma portée, je ne cesse de le harceler
686
de lettres, pour qu'il opère sa jonction avec moi. Il me répond toujours
qu'il arrive; malheureusement il n'en est rien, et je vois qu'il suit
aujourd'hui d'autres conseils. Je viens de faire une nouvelle tentative
par Furnius, que je lui envoie avec des instructions et des lettres.
Peut-être cette démarche sera-t-elle plus heureuse. — Vous savez, mon
cher Cicéron, que j'ai bien des motifs pour partager l'affection que
vous portez au jeune César : d'abord, j'étais trop lié avec César de son
vivant, pour ne pas aimer et chérir Octave. Depuis, autant que j'en ai
pu juger, j'ai reconnu chez ce jeune homme une grande modération de
sentiments et le plus aimable caractère. Enfin l'ami du père ne pourrait
pas sans honte être indifférent pour le fils adoptif. C'est donc, je le
jure, sous l'inspiration de la douleur et non de la haine, que je vous
ouvre ici mon âme : mais si Antoine vit et respire, si Lépide est avec
lui, s'ils sont à la tête de forces qu'il n'est plus permis de mépriser,
enfin s'ils ont des espérances et s'ils osent former des projets, c'est
à César seul qu'il faut s'en prendre. Je ne veux pas rappeler le passé.
Mais s'il fût venu me joindre à l'époque où il me le faisait espérer, il
n'y aurait plus de guerre aujourd'hui, ou du moins la guerre aurait été
refoulée du côté de l'Espagne, qui leur est hostile. Quel motif, quels
conseils ont pu le détourner d'un parti à la fois si glorieux et si
favorable à ses intérêts? Comment est-il venu, au grand effroi du
public, solliciter avec une si folle ardeur un consulat de deux mois?
c'est ce qu'il m'est impossible de deviner. Je crois que ses amis
pourraient beaucoup près de lui dans cette occasion pour la république
et pour lui-même : vous aussi, sans doute, à qui il doit plus que qui
que ce soit au monde, excepté moi pourtant; car je ne puis oublier les
obligations infinies que je vous ai. J'ai prescrit à Furnius de traiter
toutes ces questions de vive voix : s'il accorde à mes conseils la
confiance qu'ils méritent, je lui aurai rendu un grand service.
Jusque-là ma position est fort difficile; n'osant pas risquer une
bataille, et sachant que si je bats en retraite je fais un mal immense à
la république. Si, au contraire, César revient à de meilleures pensées,
ou si les légions d'Afrique arrivent, je réponds de tout. Vous, mon cher
Cicéron, continuez de m'aimer, comme vous le faites, et croyez que je
suis à vous, oui à vous, dans toute la force du mot. De mon camp, le 5
des kalendes d'août.
892. A BRUTUS.
Rome.
B. 8. Mes recommandations se multiplient,
elles sont une nécessité de ma position. Tout ce qu'il y a d'honnêtes
gens, de bons citoyens, se montre à l'envi jaloux de votre estime. Les
braves veulent mettre la main à l'œuvre et faire avec vous cause
commune, et chacun croit que personne n'a plus de crédit que moi près de
vous. Cette fois, c'est С Nasennius, de la ville municipale de Suesse,
queje vous recommande plus chaudement que tout autre. Dans la guerre de
Crète, il a commandé, sous Métellus, le huitième manipule des princes.
Depuis, il ne s'est occupé que du soin de ses affaires; mais
aujourd'hui, frappé des divisions de la république et du rôle admirable
que vous y avez pris, il voudrait tenir de vous un commandement
quelconque. C'est un homme de cœur, mon cher Brutus, que je
687
vous recommande, un honnête homme, et, si c'est là une considération, il
est fort riche. Vous m'obligerez beaucoup en le traitant assez bien pour
qu'il me remercie de vos bons offices.
893. —A BRUTUS. Rome,
juillet.
B. 15. Messalla est près de vous : quelle
lettre, quel récit même étudié peut valoir les détails qu'il vous
donnera de vive voix sur la marche des événements et le fond de la
situation, lui qui a tout vu, et qui est si habile à saisir et à exposer
les faits! N'allez pas croire, Brutus, qu'en fait d'honneur, de fermeté,
de vigilance, de patriotisme, il y ait rien à lui comparer. Vous le
savez aussi bien que moi, mais je ne résiste pas au besoin de louer un
si rare assemblage des dons les plus brillants. Il excelle en tant de
points, que son talent oratoire, tout merveilleux qu'il est, trouve à
peine place dans son éloge. Il est vrai que sa supériorité dans l'art de
la parole semble éclipsée par la sagesse qui lui a fait embrasser le
genre d'éloquence le plus vrai, celui qui atteste le mieux la solidité
de l'esprit. Il consacre ses veilles à l'étude, et s'approprie avec tant
d'ardeur toutes les ressources de l'art, qu'on serait tenté de douter
que la nature ait tant fait pour lui. Mais l'affection m'entraîne;
j'oublie l'objet de ma lettre, qui n'est point de louer Messalla,
surtout devant Brutus, qui connaît son mérite aussi bien que moi, et qui
est plus capable d'apprécier les hautes qualités auxquelles je rends
hommage. L'éloignement de Messalla m'est bien pénible; mais une
réflexion en adoucit l'amertume, c'est qu'en me quittant pour un autre
moi-même, il remplit un grand devoir et s'ouvre une glorieuse carrière.
Assez sur ce sujet. — Je reviens un peu tardivement peut-être sur
certaine lettre où je trouve un blâme articulé, au milieu de beaucoup
d'éloges. Je suis, dites-vous, trop facile ou même prodigue en fait
d'honneurs publics : voilà votre reproche. Un autre me trouvera d'une
rigueur outrée dans l'application des peines. Et vous-même peut-être ne
méjugez pas exempt de cet autre excès. Je vois qu'il faut m'expliquer
nettement sur ces deux points. Si je vous cite le plus admirable des
sept sages de la Grèce et le seul qui ait été législateur, ne croyez pas
que ce soit uniquement pour me prévaloir de l'autorité de Solon. Toute
la science du gouvernement, selon lui, se résume en deux mots :
récompenser et punir. Sans doute le jeu de ces deux leviers exige de la
réserve et une juste mesure ; il en est de cela comme de tout : mais je
n'aborderai pas une si grande question, je me contenterai d'un simple
exposé de principes relativement aux opinions que j'ai émises dans le
cours de cette guerre. — Après la mort de César, je vous dis, vous vous
en souvenez, ce qui avait manqué à vos mémorables ides de mars, et à
quelle tourmente vous laissiez exposée la république. Vous aviez anéanti
un grand fléau, lavé le nom romain d'une tache ignominieuse, attaché au
vôtre une gloire immortelle; mais le pouvoir suprême restait la proie
d'Antoine et de Lépide, l'un plus léger, l'autre plus pervers, tous deux
redoutant la paix, ennemis de tout repos. Contre ces perturbateurs
effrénés l'État se trouvait sans défense; l'énergie publique s'était
réveillée; on voulait être libre. Je fus alors jugé trop ardent ;
peut-être avez-vous montré trop de sagesse d'abord en sortant de cette
ville que vous
688 veniez de délivrer, puis en
déclinant les offres et les sympathies de l'Italie entière. Quand j'eus
vu Rome tombée entre des mains parricides, devenue un séjour dangereux
pour vous et pour Cassius, livrée aux violences d'Antoine et de ses
satellites, je dus penser à m'éloigner aussi; car c'est un cruel
spectacle que de voir son pays déchiré parles factions, sans pouvoir le
secourir. Cependant mon cœur, toujours possédé de l'amour de la patrie,
ne put se faire à l'idée d'être loin de Rome au moment de ses dangers.
Aux vents étésiens qui m'emportaient vers la Grèce succéda tout à coup
un vent du midi que je considérai comme un avertissement, et qui me
ramena sur nos côtes. Je vous vis à Vélie; et ma douleur fut amère, car
vous faisiez retraite, Brutus, retraite, dis-je, puisque nos Stoïciens
soutiennent que le sage ne fuit jamais. De retour à Rome, j'affrontai la
démence criminelle d'Antoine, et ne tardai pas à l'attirer sur moi.
Alors, je formai une résolution à la Brutus ; car c'est un droit
héréditaire de votre sang que d'affranchir la patrie. Le reste ferait un
long récit, je le passe, car je n'aurais à parler que de moi. Un mot
encore cependant ! Ce jeune César, à qui de bonne foi nous devons
d'exister encore, est tout entier l'œuvre de mes conseils. Je lui ai
fait décerner des honneurs, mais des honneurs strictement dus et
indispensables. Dans cette crise de la liberté renaissante, quand
l'héroïsme divin de Décimus en était encore à faire ses preuves, quand,
pour défense enfin , nous n'avions que le bras de cet enfant qui venait
de détourner de nos têtes le glaive d'Antoine , était-il un honneur
qu'on pût ne pas lui accorder? Cependant il n'eut de moi que des
louanges, et certes bien mesurées. Il est vrai que je lui fis donner un
commandement; à son âge sans doute c'était beaucoup, mais il le fallait,
puisqu'il avait une armée. Or, qu'est-ce qu'une armée commandée sans
titre? Philippe lui fit décerner une statue; Servius, une dispense d'âge
que Servilius fit étendre encore. Rien alors ne semblait de trop pour
lui. Mais je ne sais pourquoi on est plus facilement libéral dans le
danger, que reconnaissant après la victoire. Mes principes à moi sont
différents. Le jour où Décimus fut délivré était, par une coïncidence
remarquable, celui de sa naissance. Je fis décider que ce jour si beau
pour la patrie prendrait dans nos fastes le nom de Rrutus. Nos pères
m'en avaient donné l'exemple, en consacrant de même la mémoire d'une
femme, de Larentia, dont votre collège va tous les ans desservir l'autel
dans le Vélabre. Je voulais, en honorant le nom de Rrutus, éterniser
dans les fastes le souvenir d'une si heureuse victoire. Mais je pus
reconnaître ce jour-là même qu'il y avait dans le sénat plus d'esprits
malveillants que de cœurs ouverts à la reconnaissance. Vers le même
temps je fus encore, si vous voulez, prodigue d'honneurs envers les
morts; Pansa, Hirtius, Aquila même y eurent part. Mais qui m'en ferait
le reproche? ceux qui oublient le danger, dès qu'ils ont cessé de
craindre. A une inspiration de la reconnaissance se joignait pour moi la
pensée d'une leçon salutaire. Je voulais léguer à la postérité un
monument de la haine impérissable qui s'attache à la plus cruelle espèce
d'ennemis. L'opposition que je rencontrai chez vos amis, gens pleins de
droiture, mais sans expérience dans les affaires, me porte à soupçonner
que vous avez surtout pris ombrage de l'ovation que j'ai fait décerner à
César pour son entrée. Quant à moi, sauf erreur, et je ne suis pas homme
à ne trouver bon que ce que j'ai fait, il me semble que, depuis le
commencement de la guerre, je ne fis jamais rien de plus habile. Je
laisserai un voile sur le pourquoi. J'aurais trop peur qu'on ne vît dans
mon fait une pensée défiante plutôt qu'une pensée de rémunération :
c'est déjà en avoir trop dit. —Poursuivons. J'ai fait décerner des
honneurs à Décimus, des honneurs à Plancus. Mais ne sont-ils pas grands
ces cœurs que la gloire seule anime? Le sénat n'a-t-il pas montré une
baute sagesse en attachant les citoyens à l'intérêt public par des
séductions honorables et appropriées au caractère de chacun? On
m'objectera cette statue que j'ai fait ériger à Lépide, près de la
tribune, et que plus tard j'ai fait renverser. Eh bien ! par cet honneur
insigne, je me flattais de le détourner de ses projets insensés. Mais la
folie du plus léger des hommes a déjoué les calculs de ma prudence :
après tout, on a fait moins mal en dressant la statue que de bien en la
renversant. — A ces longues explications au sujet des honneurs ajoutons
quelques mots sur les punitions. J'ai vu plus d'une fois par vos lettres
que vous tenez beaucoup au mérite de la clémence envers les vaincus. Je
ne veux en rien contester votre sagesse ; mais l'impunité, décorée de ce
nom de clémence, quoique tolérable peut-être en d'autres occasions,
m'eût paru funeste dans la guerre actuelle. En effet, aussi loin que
remonte ma mémoire, je ne trouve aucune de nos guerres civiles qui ait
mis en péril le principe même du gouvernement. Aujourd'hui, quelle forme
de république aurons-nous si nous sommes vainqueurs? c'est ce que je ne
saurais dire; mais, si nous sommes vaincus, plus de république. Si donc
j'ai appelé une justice sévère sur Antoine et sur Lépide, ce n'était pas
dans un esprit de vengeance, mais dans le double but de réprimer par la
terreur des attentats flagrants contre la république, et d'apprendre aux
factions à venir ce que coûtent d'aussi coupables projets. Ce jugement
d'ailleurs n'a rien qui me soit propre; il a été porté par toutes les
voix. On le trouve cruel, en ce qu'il étend la peine sur des enfants
innocents ; mais c'est là une disposition pénale de tous les temps et de
tous les pays. Les enfants de Thémistocle ne languirent-ils pas dans le
besoin? Si cette rigueur frappe le citoyen condamné par la justice
ordinaire, pourquoi l'adoucirait-on en faveur d'un ennemi ? A quel titre
d'ailleurs se plaindre de moi, quand on est forcé de convenir que si
j'eusse été vaincu, je subirais une justice bien plus impitoyable?—
Telle est ma doctrine des récompenses et des peines : vous la connaissez
maintenant. Pour mes opinions et mes votes sur tout le reste, je pense
que vous en êtes instruit. C'est d'ailleurs un objet de moins
d'importance. Ce qui en a une immense, c'est votre prompt retour en
Italie avec votre année. L'impatience est à son comble, et du moment où
vous aurez touché le rivage, ce sera un concours universel pour vous
joindre. Vainqueurs (et nous le serions déjà si Lépide n'avait voulu
périr et tout perdre avec lui ), vainqueurs, nous ne saurions sans votre
autorité 690
asseoir le gouvernement sur ses bases. S'il faut affronter de nouvelles
chances les armes à la main, c'est encore à vous et votre armée que
s'attache tout l'espoir de notre avenir. Mais hâtez-vous, au nom des
Dieux ! l'occasion et la promptitude sont deux causes de succès dont
vous connaissez la puissance. Les lettres de votre mère et de votre sœur
vous auront appris, j'en suis sûr, ce que je fais pour vos neveux. Je
suis, diton , dans cette affaire, plus docile à une volonté que je
chéris, que fidèle à mes principes. Mais ma fidélité à vous aimer
demeure invariable, et je veux qu'elle éclate à tous les yeux.
FIN DES LETTRES DE M. T. CICERON. |