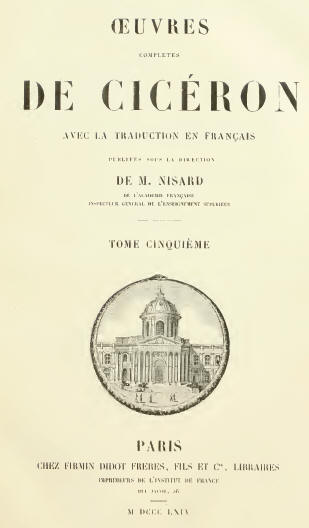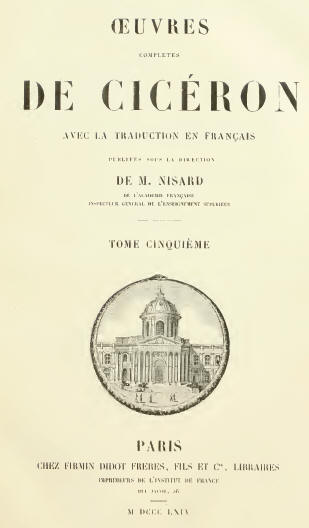|
550. —
A ATTICUS. Asture, mars.
A. XII, 20.
Vous ne savez pas encore, je le vois, à quel point je me soucie peu
d'Antoine, ni de quoi que ce soit en ce genre. Je vous ai parlé de
Térentia dans ma lettre d'hier. Vous voudriez, et vous n'êtes pas le
seul, dites-vous, me voir prendre un peu plus sur moi pour cacher ma
douleur. Mais que puis-je faire de plus que de passer mes journées
entières à écrire? Et cela non point, il est vrai, pour cacher ma peine,
mais pour tenter sérieusement de la soulager et de la guérir. Si je n'y
réussis pas, du moins fais-je assez pour le monde. - Ma lettre sera
courte, parée que j'attends votre réponse à mes observations d'hier,
principalement sur ce qui regarde le temple, et aussi sur Térentia.
Faites-moi le plaisir de me dire dans votre plus prochaine lettre si le
naufrage où périt Cn. Cépion, père de Servilia, femme de Claude, est
arrivé du vivant ou après la mort de son père; et si c'est avant ou
après le décès de son fils C. Cotta, qu'a eu lieu la mort de Rutilia.
Ces questions se rapportent à l'ouvrage dont je m'occupe sur les
consolations.
551. —
A DOLABELLA. Asture, mars.
F. IX, 11. Ah!
que n'a-t-on a vous expliquer mon silence par ma mort, plutôt que par le
coup affreux dont je suis frappé! Ma douleur serait plus calme, si je
vous avais près de moi. Votre sagesse et votre affection en adouciraient
l'amertume. Mais je vous verrai bientôt sans cloute. Vous me trouverez
encore bien triste, et votre présence me sera d'un grand secours. Dans
mon accablement toutefois je n'oublie pas que je suis homme, et que je
dois soutenir le poids de mon triste destin. Mais j'ai perdu cette
gaieté, cet enjouement que vous aimiez plus que personne. Du reste,
vous retrouverez en moi autant de constance et de fermeté que j'en eus
jamais. Vous avez, dites-vous, beaucoup de luttes à soutenir pour mon
compte. Je me soucie peu, je vous assure, qu'on impose silence à mes
détracteurs. Ce qui me touche, c'est que vous m'aimiez, et le témoigniez
hautement. Oh! pour cela, faites-le, faites-le : je vous le demanderai
toujours. Pardonnez-moi de ne pas vous en écrire davantage. Nous allons
nous voir bientôt ; et je suis à peine eu état d'écrire.
552. -
A ATTICUS. Asture, mars.
A. XII, 21.
J'ai lu la lettre de Brutus et je vous la renvoie. Il met assurément
bien peu de convenance dans ses réponses à vos observations : c'est son
affaire, mais il devrait rougir de son ignorance. Il croit que c'est
Caton qui le premier ouvrit l'avis de la peine capitale ; mais avant
Caton, tous, excepté César, avaient déjà voté dans ce sens: et quand
César lui-même, qui ne siégeait alors qu'aux rangs des préteurs, tint un
langage si sévère, il s'imagine qu'aux rangs consulaires les Catulus,
les Servilius, les Lucullus, les Curions, les Torquatus, les Lépides,
les Gellius, les Volcatius, les Figulus, les Cotta, les Lucius Césars,
les Pisons, et même que, parmi les consuls désignés, les M'. Glabrion,
les Silanus, les Muréna auraient montré plus d'indulgence! Pourquoi
Caton a-t-il attaché son nom au décret? uniquement parce qu'en exprimant
la même opinion que les autres, il y mit plus de développements et
d'énergie Brutus me loue cependant, mais comme rapporteur de l'affaire.
D'ailleurs pas un mot de la conjuration découverte, du mouvement imprimé
au sénat, de l'arrêt que j'avais déjà rendu même avant de recueillir les
voix ; toutes choses que Caton éleva jusqu'aux nues, et dont il voulut
que mention spéciale fût insérée au décret; c'est ce qui fit que son
vote emporta la décision, Brutus croit me faire beaucoup d'honneur en
m'appelant un excellent consul. Mais un ennemi, je vous le demande,
emploierait-il une expression plus sèche? Et comment répond-il sur le
reste? Il vous prie seulement de rectifier ce qui se rapporte au
sénatus-consulte. Quand il aurait pris leçon d'un Ranius, il ne
parlerait pas autrement; mais, encore. une fois, c'est son affaire. —
Puisque vous êtes d'accord avec moi sur les jardins, mettez-vous à
l'œuvre, je vous prie. Vous connaissez ma situation. Si je parviens à
tirer quelque chose de Fabérius, l'affaire ira toute seule; même sans
cela je puis encore me mettre, sur les rangs. Les jardins de Drusus sont
certainement à vendre, peut-être aussi ceux de Lamia et de Cassius. Je
ne saurais rien dire de mieux sur Térentia que ce que vous m'en écrivez.
Le devoir, le devoir avant tout! s'il y a des torts, j'aime mieux en
laisser peser la responsabilité sur elle que sur moi. Cent mille
sesterces sont à payer à Ovia, femme de C. Lollius. Éros dit ma
présence indispensable; sans doute à cause de quelque estimation
d'objets à prendre et a donner. Il aurait bien dû vous parler de cette
affaire. Si tout est prêt, comme il me le mande (et, à cet égard, il ne
dit rien qui ne soit vrai), vous pourriez me remplacer, faites-vous
rendre compte de l'état des choses, je vous prie, et suppléez-moi. Moi,
reparaître, au forum! au forum que j'avais abandonné avant même que ma
fortune eût reçu aucune atteinte, Eh! qu'y ferais-je aujourd'hui! quand
il n'y a plus de justice, plus de sénat ; quand il faudrait chaque jour
me trouver face à face avec des gens dont la vue seule me révolte?
L'opinion, dites-vous, me rappelle à Rome. On condamne mon absence; on
ne veut pas du moins que je la prolonge. Eh bien! sachez d'abord qu'il y
a un avis dont je fais plus de cas que de tous les autres ensemble,
c'est le vôtre; que de plus je prétends, moi, ne pas me compter pour
rien; enfin que j'ai ma manière de voir, crue je préfère à celle de tout
le monde. Mon chagrin ne dépasse point les bornes qu'y mettent les
philosophes, j'ai lu tout ce qu'ils disent sur ce sujet, et c'est déjà
quelque chose pour un malade que de chercher le remède à ses maux. Mais
ce n'est pas tout : j'ai fait passer la substance de leurs écrits dans
le traité que je compose; ce qui n'est pas, ce me semble, la marque d'un
esprit qui se laisse abattre et décourager. Gardez-vous donc
d'interrompre ce régime de tranquillité, pour me rejeter dans la
tourmente. Une rechute serait inévitable.
553. —
A ATTICUS.
F. XII, 7. J'ai
chargé Éros d'un billet qui répond I à toutes vos questions. Il est
court, et pourtant il dit plus que vous n'en vouliez savoir. Cicéron y a
trouvé place : c'est vous qui m'aviez mis sur la voie. Je lui ai parlé
de façon à le satisfaire, et je voudrais, si l'occasion se présente,
que vous le missiez vous-même sur ce chapitre : ou plutôt pourquoi vous
faire attendre ce détail? je lui ai dit que c'était de mon aveu que vous
l'aviez interrogé sur ses projets et ses besoins; que je connaissais son
désir d'aller en Espagne et ses nécessités d'argent. Quant à l'argent,
j'ai promis de le traiter à l'égal des fds de Publilius et de Lentulus
le flamine. Quant à l'Espagne, j'ai élevé deux objections : la première
que je vous ai faite à vous-même, c'est qu'il fallait craindre de se
faire tort; que c'était déjà bien assez d'avoir quitte un drapeau, sans
aller encore se ranger sous le drapeau contraire ; la seconde, que ce
serait un supplice pour lui de voir son frère (son cousin, le fils de
Quintus) devenu l'objet de toutes les préférences et de toutes les
faveurs. J'ai ajouté qu'il me ferait plaisir en payant mes sacrifices
par un peu de condescendance ; mais, après tout, je l'ai laissé le
maître, car j'ai cru m'apercevoir que vous n'étiez pas très-opposé à son
dessein. Je veux y penser et y repenser. Faites de même. Rester est le
meilleur parti et le plus simple. L'autre est bien hasardeux. Enfin nous
verrons. Je touchais aussi un mot de Balbus dans mon billet. Mon
intention est d'attendre son retour, pourvu que son absence ne se
prolonge pas trop. Sans cela, dans trois jours au plus tard. Ah !
j'oubliais de vous dire que Dolabella est ici avec moi.
554. —
A ATTICUS. Asture, mars.
A. XII, 22. Me
laisser l'embarras d'en finira avec Térentia! ah! je ne. reconnais pas
là votre amitié, ce sont de ces plaies qu'on ne touche pas soi- I môme
sans une extrême sensibilité. Votre médiation, je vous en conjure, votre
médiation ! je ne demande rien que ce qui vous sera possible. Et pour
savoir ce qu'il y a de bon à faire dans cette circonstance, il n'y a que
vous. A l'égard de Rutilia, puisque vous n'êtes pas sûr de vos
souvenirs, éclaircissez le fait et écrivez-moi ; mais le plus lot
possible, je vous prie. J'ai besoin de savoir également si Clodia a ou
non survécu à son fils D. Brutus le consulaire. Vous le saurez par
Marcellus, ou mieux encore par Postumia. Adressez-vous pour l'autre ou à
M. Cotla, ou à Syrus, ou à Satyrus. Et mes jardins, je vous en parle et
reparlerai sans cesse. J'y emploierai toutes mes ressources, et j'ai des
amis qui ne me manqueront pas. Mais j'espère y suffire seul. J'ai des
valeurs d'une réalisation facile. Il est vrai que j'aimerais mieux ne
rien vendre et servir des intérêts, en obtenant du temps du vendeur; un
an, pas plus ; et j'aurai ce délai, pour peu que vous me secondiez. Ce
qu'il y a de plus facile à acquérir sont les jardins de Drusus ; il veut
vendre : après les siens, ceux de Lamia. Mais celui-ci est absent :
auriez-vous moyen de pressentir ses dispositions? Silius en a aussi, et
il n'en fait rien. Il se contenterait probablement d'une rente.
Faites-en votre affaire, et ne vous arrêtez point, je vous prie, à des
considérations tirées de ma position pécuniaire. Je ne m'en soucie
nullement; ne considérez que ce que je veux et pourquoi je le veux.
555. —
A ATTICUS. Asture, mars.
A. XII, 23.
Quoique les affaires d'Espagne me. touchent fort peu, je m'attendais à
des nouvelles, d'après le commencement de votre lettre. Vous ne vous
occupez que de mes observations sur le forum et le sénat. Ma maison,
dites-vous, sera mon forum : du moment qu'il n'y a plus de forum pour
moi, qu'ai-je affaire de ma maison? La vie, mon cher Atticus, la vie est
depuis longtemps éteinte chez moi ; elle l'est surtout depuis que j'ai
perdu ce qui me la rendait chère. Aussi je cherche la solitude. Pourtant
si je me trouvais ramené aux lieux où vous êtes, je me contraindrais, et
je parviendrais môme à prendre assez sur moi pour dérober ma douleur à
tous les yeux; aux vôtres même, s'il est possible. Autre motif pour
rester : vous vous rappelez la démarche d'Alédius : je suis déjà
persécuté ici; que serait-ce, si j'étais là-bas? — Faites pour Térentia
tout ce que vous avez la bonté de m'écrire, et délivrez de ce surcroît
d'amertume un cœur en proie à de cruelles souffrances. Cependant je veux
vous prouver que la douleur ne m'absorbe pas. Vous avez consigné dans
vos annales sous quels consuls Carnéade et les autres députés vinrent à
Rome. Je voudrais savoir la cause qui les y amenait. L'affaire d'Orope,
je le suppose ; mais je n'en suis pas certain. Dans ce cas, veuillez me
rappeler leurs discussions; que je sache encore si, à cette époque, il y
avait à Athènes quelque Épicurien fameux qui présidât au jardin, et
quels philosophes politiques y étaient en renom. Je pense que vous
pourrez trouver tout cela dans Apollodore. — J'apprends avec bien du
regret qu'Attica est souffrante, mais son indisposition est légère, et
j'espère qu'elle n'aura pas eu de suite. Ce que vous me dites de Gamala
(fille de Ligus, morte) n'était pas douteux pour moi. Pourquoi donc
Ligus serait-il un si heureux père? Que dirai-je, hélas ! de moi, que
tout le bonheur du monde ne pourrait un moment consoler? — Le prix
auquel les jardins de Dru-sus ont été acquis est bien celui dont on
m'avait parlé, et je crois en avoir fait mention dans ma lettre d'hier.
Mais coûte qui coûte; le prix n'est rien à qui ne peut se passer des
choses. Quelle que soit a cet égard votre manière de voir, je sais ce qui est en moi, et je veux ôter ce poids de mon cœur. Ma douleur n'en
diminuera pas; mais j'aurai payé une délie sacrée. Je viens d'écrire à
Sica, parce que Cotta et lui se voient. Si rien ne se termine de l'autre
côté du Tibre, il faudra voir, dans l'un des endroits les plus
fréquentés d'Ostie, un bien qui appartient à Cotta. C'est très peu de
chose, mais c'est plus que suffisant pour ce que je veux. Veuillez y
réfléchir. Que le prix ne. vous fasse pas peur : les vaisselles, les
ameublements, les maisons de plaisance ne sont pas un besoin pour moi;
et ceci est un besoin. Je sais où m'adresser pour l'argent. Parlez donc
a Silius : c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai chargé également Sica de le
voir. Sica me mande qu'il a pris jour; il m'écrira ce qu'il aura fait,
et vous m'en direz votre avis.
556. —
A ATTICUS. Asture, mars.
A. XII, 24.
Silius m'a rendu service en transigeant, car je voulais répondre à sa
confiance et je craignais de n'être pas en position. Soyez assez bon
pour terminer avec Ovia, ainsi que vous me le marquez. Voyez, je crois,
pour Cicéron le moment venu : mais une fois a Athènes, les fonds dont il
aura besoin pourront-ils lui être comptés par la voie du change, ou
sera-t-on obligé de lui envoyer des espèces? Examinez tout, je vous
prie, et surtout le comment et le quand. Tous pourrez savoir d'Alédius
si Publilius va en Afrique, et à quelle époque. Informez-vous-en, et
écrivez-le-moi. Pour en revenir à mes impertinentes questions, je
voudrais savoir si P. Crassus, fils de Vémiléia, est mort avant son
père, P. Crassus le consulaire, comme je crois me le rappeler, ou
seulement après. Je fais la même demande pour Régillus, fils de Lépide.
Il me semble positivement que son père vivait quand il mourut. Ma
mémoire est-elle fidèle? Tâchez d'éclaircir l'affaire de Cispius et de
Précius. Je suis charmé des nouvelles d'Attica. Veuillez lui faire mes
compliments, ainsi qu'à Pilia.
557. —
A ATTICUS. Asture, mars.
A. XII, 25.
Sica a été très-exact à me répondre sur Silius. Il m'annonce vous en
avoir référé, et c'est ce que vous me mandez aussi. La chose et le prix, tout me convient ; mais j'aime mieux traiter argent comptant que par
échange, car Silius ne voudrait pas d'une propriété de pur agrément ; et
quant aux biens de rapport, si j'en ai assez, je n'en ai point trop.
Reste à trouver l'argent. Vous pouvez d'abord demander à Hermogène ses
six mille sesterces, c'est un cas de nécessité. J'en ai six mille autres
chez moi. Pour ie reste, ou j'en servirai l'intérêt à Silius, en
attendant Fabérius, ou je lui donnerai une délégation de Fabérius sur
l'un de ses débiteurs. J'attends quelques antres rentrées d'ailleurs.
C'est à vous, mon cher Atticus, a régler tout. Je préfère de beaucoup
ces jardins-là à ceux de Drusus. Il n'y a pas de comparaison. Un seul
motif me guide, croyez-le bien. Je conviens que cela touche à la manie,
mais vous aurez pitié de moi jusqu'au bout. Quant à ce que vous me dites
sur la vieillesse d'un citoyen, il ne s'agit plus de cela, et je pense à
bien autre chose.
558. -
A ATTICUS. Asture, mars.
A. XII, 26.
D'après ce que me mande Sica, il arrivera le 10 des kalendes, même quand
il n'aurait rien conclu avec Silius. J'accepte l'excuse de vos
occupations, je les connais. Que vous ne répugniez pas à vivre avec moi;
que vous le souhaitiez même et le désiriez avec ardeur: c'est ce dont je
ne puis douter. Je ne suis pas en état de profiter de la bonté de Nicias
: autrement, il n'y a personne dont je préférasse la société à la
sienne; mais malheureusement la solitude et la retraite me sont
imposées. Sica s'en arrangerait, et mon regret en est d'autant plus vif.
Ensuite vous connaissez la pauvre santé de Nicias, ses habitudes de
mollesse, les exigences de son régime. Pourquoi donc m'exposerais-je à
ce qu'il fût mal chez moi, quand de son côté il ne pourrait m'être bon à
rien? Je lui sais gré toutefois de son intention. 11 y a un article de
votre lettre auquel je m'abstiendrai de répondre ; car je crois avoir
obtenu de vous que vous m'épargneriez ce chagrin. Mes compliments a
Pilia et à Attica.
559. —
A ATTICUS. Asture, mars.
A. XII, 27. Je
sais déjà quelles sont les conditions de Silius, si je traite avec lui;
mais aujourd'hui, je le suppose, Sica m'en communiquera le détail. Vous
ne connaissez pas. dites-vous, la propriété de Cotta ; elle est au delà
des jardins de Silius, que vous connaissez, ce me semble. C'est une
misérable et chétive habitation sans dépendances. Il n'y a place pour
rien, ce n'est pas ce que je me propose. II me faut un endroit vivant.
Au surplus, si on termine, c'est-à-dire si vous terminez avec Silius,
car tout dépend de vous, nous n'aurons point à nous occuper de Cotta. Je
suivrai votre conseil pour Cicéron. Je le laisserai maître du temps.
Vous aviserez, n'est-ce pas, à lui faire passer, par la voie du change,
l'argent dont il aura besoin. Si vous tirez quelque chose de cet Alédius
dont vous me parlez, dites-le-moi. Je remarque dans vos lettres ce qui
vous frappe sans doute dans les miennes, c'est que nous n'avons rien a
nous dire. Nous nous répétons, et ne faisons que rebattre un fonds
depuis longtemps usé. Moi, j'écris pour vous donner à écrire ; je ne
puis m'en défendre. Parlez-moi de Brutus, si vous en savez quelque
chose. On doit aujourd'hui je le pense, connaître le lieu où il attend
Pansa. Si c'est, selon l'usage, à l'entrée de la province, il arrivera
vers les kalendes. Plus tard me conviendrait mieux, car j'ai bien des
motifs pour rester tout à fait loin de Rome. Je ne sais si même je ne
devrais pas le payer de quelque excuse; j'en trouverais facilement. J'ai
du temps pour y réfléchir. Mes compliments à Pilia et à Attica.
560. —
A ATTICUS. Asture, mars.
A. XII, 28.
Sica ne m'a absolument rien dit sur Silius de plus que ce qu'il m'avait
écrit. Sa lettre était fort exacte. Si de votre côté vous pouvez
rejoindre Silius, vous me manderez ce que vous en semble. Vous me parlez
d'une personne chargée d'une mission pour moi; cette personne a-t-elle
une mission, n'en a-t-elle pas, je l'ignore. Ce qu'il y a de certain,
c'est qu'elle ne m'en a pas ouvert la bouche. Continuez donc votre
œuvre; et si, contre mon attente, vous obtenez un résultat, voyez s'il
ne convient pas de mettre Cicéron en avant. Il importe qu'il montre ses
bonnes intentions de ce côté : pour moi, une seule chose m importe ;
vous la connaissez, elle est capitale. Vous désirez me voir reprendre
mes habitudes : c'en est une déjà ancienne pour moi que de pleurer sur
la république. Mais alors je pleurais sans être aussi malheureux.
J'avais ou reposer mon cœur. Aujourd'hui il n'y a plus rien qui me fasse
tenir à quoi que ce soit, ni même a la vie. A cet égard, l'opinion me
touche peu. J'ai mon sentiment, que je mets au-dessus de tous les
discours. J'ai cherché des consolations dans les lettres, et j'y ai
gagné quelque chose, en apprenant à me contraindre; mais, au fond, nia
peine est la même. Je ne puis la vaincre, et quand je le pourrais, je ne
le voudrais pas. Vous avez bien deviné mes intentions pour Triarius;
toutefois ne faites rien sans être d'accord avec eux. J'aimais ce pauvre
homme qui n'est plus. Je suis tuteur de ses enfants, et mon attachement
est grand pour toute sa famille. Quant à Castricius, s'il veut recevoir
l'argent de ses esclaves et s'il consent à être payé, comme on paye
aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple assurément. Si au contraire on
est convenu de les lui rendre, puisque vous m'en demandez mon avis, cela
ne me paraît pas juste. Je ne veux pas qu'on donne de l'embarras à mon
frère Quintus; si je vous ai bien compris, vous ne le voulez pas
davantage. Puisque Publilius attend l'équinoxe de printemps comme
Alédius l'annonce, c'est qu'il doit s'embarquer. Il m'avait dit
seulement pour la Sicile. Décidément pour quel pays, et quand? je
voudrais le savoir. Je voudrais bien aussi que de temps en temps, et
sans vous gêner, vous pussiez aller voir le petit Lentulus (fils de
Tullie et de Dolabella), et que vous eussiez la bonté de régler le
nombre d'esclaves à lui laisser pour son service. Mes compliments à
Pilia et à Attica.
561. —
A ATTICUS. Asture, mars.
A. XII, 29.
C'est aujourd'hui le rendez-vous avec Silius; demain donc, ou du moins
aussitôt que vous le pourrez, vous m'écrirez ce qu'il y a de fait.
Je ne cherche point à éviter Brutus. Ce n'est pas que j'attende de lui
la moindre consolation ; mais j'ai des raisons pour ne pas me montrer
dans ces circonstances. Si ces raisons se prolongent, ce qui est
vraisemblable, il faudra chercher quelque moyen de m'excuser près de
lui. Suivez bien l'affaire des jardins, je vous prie; j'en ai en quelque
sorte besoin pour moi-même. Je ne puis ni vivre au milieu du mouvement,
ni vivre séparé de vous. II n'y a donc pas de situation dont le choix
réponde mieux à mes intentions, et je vois bien tout ce que vous faites
pour réussir. Je le vois surtout par les témoignages de vif intérêt qu'Oppius
et Balbus vous ont paru disposés à me donner. Dites-leur, je vous prie,
à quel point et pourquoi je suis désireux de cette acquisition ; mais
que je ne puis la faire, si je ne termine auparavant avec Fabérius. Que
me conseilleraient-ils? Devrais-je par exemple me résigner à un
sacrifice, pour avoir, en argent comptant, tout ce qu'on pourrait tirer
de lui? car c'est désormais une chimère de compter sur une rentrée
complète. Enfin voyez jusqu'où vont leurs bonnes dispositions pour moi :
s'ils me secondent, c'est un grand point. S'ils s'y refusent, nous
chercherons une autre voie. N'oubliez pas qu'il s'agit de l'ornement de
ma vieillesse, peut-être de la couronne de ma tombe. Ne pensons pins à
Ostie. Si l'affaire de Silius manquait, comme il n'y a rien à espérer de
Lamia, il faudrait sonder Damasippus.
562. -
A ATTICUS. Asture, mars.
A. XII, 30.
Que vous dire? je cherche et ne trouve rien. J'en suis là chaque fois
que je vous écris. Mais vous avez été voir Lentulus, et je vous en sais
un gré infini. Attachez, je vous prie, quelques esclaves à son service,
et déterminez-en vous-même le nombre et le choix. Silius veut-il vendre?
et quel prix demande-t-il? Vous paraissez craindre un refus ou des
prétentions exorbitantes. Ce n'est pas là l'opinion de Sica, mais je
m'en rapporte à vous. J'ai écrit à Egnatius comme Sica m'en avait prié.
Silius désire que vous parliez à Clodius, faites-le; j'y donne
entièrement les mains ; car j'aime beaucoup mieux n'avoir pas à lui
écrire moi-même, comme Silius me l'avait demandé d'abord. Je crois qu'Egnatius
n'a pas de meilleur parti à prendre que de transiger avec Castrieius
pour ses esclaves, et vous croyez l'arrangement possible. Voyez, je vous
en supplie, à terminer avec Ovia. La nuit vous a surpris l'autre jour,
soit; mais demain j'en attends davantage.
563. —
A ATTICUS. Asture, mars.
A. XII, 31.
Sica s'étonne de ce que Silius a changé d'avis. Il y a une chose qui
m'étonne Men plus, c'est qu'après avoir mis en avant le prétexte de son
fils (et je trouve cela fort juste, puisque son fils lui donne toute
satisfaction), Silius soit encore, dites-vous, tout prêt, malgré la
déclaration, à traiter avec moi, moyennant me je lui achèterais en même
temps d'autres ardins dont il veut se défaire. Vous me demandez mon
dernier mot, et ce que j'y mettrais de plus qu'aux jardins de Drusus.
Ces jardins, je ne les ai jamais vus; quant à la villa Caponiana, je la
connais : bâtiments vieux et petits, mais bois superbes, .le ne sais ce
que rapportent l'une et l'autre de ces propriétés, renseignement
indispensable; mais c'est pour moi affaire de convenance plutôt que de
spéculation. Seulement voyez si je suis en état ou non d'acheter.
Liquidez ma créance de Fabérius. Je n'hésite pointa traiter, argent à la
main, avec Silius, supposé qu'il se détermine à vendre. S'il s'y refuse, j'irai avec Drusus jusqu'à la somme à laquelle Egnatius vous a dit
qu'il élevait ses prétentions. Hermogène me sera aussi d'un grand
secours pour l'argent comptant. Ne me blâmez pas de me présenter en
homme qui veut acheter; il faut me passer cette préoccupation ;
toutefois elle n'est pas si forte, et je ne suis pas tellement dominé
par le chagrin que je ne me laisse conduire entièrement par vous dans
cette affaire. Egnatius m'a écrit. Si vous l'avez vu, mandez-moi ce
qu'il vous aura dit : il n'y a personne de mieux placé pour me servir
d'intermédiaire, et je crois qu'il faut agir de ce côté, car il n'y a
pas d'apparence que Silius se décide. Mes compliments a Pilia et à
Attica. Ceci est écrit de ma main. Avisez, je vous en conjure, à
prendre un parti.
564. —
A ATTICUS. Asture, mars.
A. XII, 32.
Publilia m'écrit que sa mère se propose de venir me voir avec lui (c'est
avec Publiîius qu'elle a voulu dire) et elle me demande la permission
de les accompagner. Il n'y a sorte d'instances et de prières qu'elle ne
me fasse pour obtenir mon consentement et avoir réponse. Voyez s'il y
eut jamais rien de plus insupportable ! Je lui mande que je me sens
encore plus accablé par le chagrin qu'au moment où je lui exprimai ma
volonté d'être seul, et que dans ma situation il m'est impossible de
consentir à la voir. Je me suis dit qu'en ne répondant point, j'allais
voir arriver mère et fille; maintenant je ne le crois plus, d'autant
qu'il est clair que sa lettre avait été dictée. Je pense bien cependant
qu'elles viendront un jour ou l'autre. Il n'y avait qu'un moyen de
l'éviter; c'était de dire non d'une manière absolue. Je ne l'ai pas
voulu. Qu'en résulte-t-il? C'est que je vous demande d'être aux aguets
pour savoir combien de jours encore je puis rester ici, sans crainte de
surprise. Vous agirez avec discrétion, comme vous me le promettez.
—Voici la proposition que je vous prie de faire à Cicéron, si elle vous
parait juste : c'est qu'il se contente de dépenser, pendant son absence,
ce qu'il aurait dépensé à Rome, s'il y eût loué une maison comme il
voulait le faire, et qu'il prenne en conséquence pour base les revenus
de mes propriétés d'Argilète et du mont Aventin. Cela fait, vous
réglerez les détails, notamment la manière dont on lui fera passer les
fonds à mesure de ses besoins. Je réponds que les Bibulus, les Aeidinus
et les Messalla, qui vont aussi a Athènes, m'a-t-on dit, n'auront pas
plus a dépenser que ce qu'on tire de ces propriétés. Soyez donc assez
bon pour voir à qui l'on pourra louer et à quel prix. Puis veuillez
trouver un moyen défaire passer l'argent à jours fixes; enfin procurez à
Ci-eéron tout ce qui est nécessaire en espèces et effets pour le voyage.
Il n'a certainement pas besoin de chevaux à Athènes. Quant à ceux qu'il
lui faut en route, il y en a chez moi, comme vous l'observez avec
raison, beaucoup plus qu'il n'en a besoin.
565. — A ATTICUS.
A. XII,8. Je vois qu'on approuve mon plan pour Cicéron. Le compagnon est
bien. Mais occupons-nous d'abord déserte première échéance : le jour
approche et l'homme est pressé. Écrivez-moi, je vous prie, ce que Celer
rapporte de César au sujet des candidats : est-ce aux champs Féniculaires
(prairie dans l'Espagne extérieure) ou au champ de Mars qu'il songe (C'est-à-dire, César nominera-t-il les magistrats en
Espagne, a son
gré et militairement; ou laissera-t-il la liberté des élections?)
? Je désire savoir si je suis nécessaire à Rome pour les comices; car je
veux contenter Pilia et Attica.
566. — A ATTICUS. Asture, avril.
A. XII, 33. Ainsi que je vous l'ai mandé hier, si les dispositions de Silius sont telles que vous le supposez, et si Drusus se montre trop
difficile, je crois que vous devez sonder Damasippe. lia, je pense,
divisé en lots de je ne sais combien d'arpents ce qu'il possède le long
du rivage, et il veut établir des prix fixes pour chaque lot. Mais je ne
les connais pas. Tenez-moi au courant. — La santé d'Attica m'inquiète
beaucoup. Je crains qu'on ait quelques reproches à se faire. Cependant
lorsque je songe à la probité de l'instituteur, à l'assiduité du
médecin, au dévouement empressé de la maison entière, tout soupçon me
devient impossible. Toujours est-il que vos soins lui sont nécessaires.
Je ne puis malheureusement vous offrir que des vœux.
567. — A DOLABELLA. Asture, avril.
F. IX, 13. Caïus Subérinus de Calés est mon ami, et de plus intimement
lié avec Lepta mon autre ami. Pour éviter la guerre, il était allé en
Espagne avec Varron avant les hostilités, et il se trouvait dans cette
province, où, depuis la défaite. d'Afranius, pas un de nous n'aurait
supposé
que la guerre dût être encore possible. Mais le mal dont il mettait tant
de soins à se garantir l'a atteint à l'improviste; la guerre a éclaté.
Commencée par Seapula, elle a pris bientôt sous Pompée un tel caractère,
qu'il n'y a pas eu moyen pour lui de se préserver de son malheureux
contact. Le même cas se présente pour Planius Hérès, de Cales comme
Subérinus, et comme Subérinus l'ami de Lepta. Je vous les recommande
tous deux a\cc plus d'empressement, d'intérêt et d'instance que je ne
saurais dire. Je le fais pour eux d'abord, puis pour moi qui les aime
tendrement; puis enfin par humanité. Lepta est dans une inquiétude
mortelle pour sa fortune, qu'il croit compromise. Je comprends ses
inquiétudes mieux que personne ; je puis dire même que je m'en tourmente
tout autant que lui. Quoique vous m'ayez souvent prouvé votre affection,
je vous prie pourtant de croire qu'il n'y a pas d'occasion où je puisse
en mieux juger qu'eu ce moment. Je vous demande donc et, s'il le faut,
je vous conjure de sauver des hommes qui ne sont qu'à plaindre, dont la
volonté ne fut pas coupable, et qu'une de ces fatalités auxquelles
personne ne peut se soustraire a seuls placés dans cette position
critique. Que je puisse par mon entremise rendre ce bon office à mes
deux amis, à la ville municipale de Calés, qui a des relations intimes
avec moi, et enfin à Lepta, que je mets par-dessus tout. Un mot encore
de peu d'importance peut-être dans cette affaire, mais qui ne saurait y
nuire : c'est que l'un a bien peu de fortune, et l'autre possède à peine
le cens pour être chevalier. Or, puisque dans sa générosité César déjà
leur a accordé la vie (c'est-à-dire la seule chose à peu près qu'on
aurait pu leur prendre), complétez ce bienfait eu obtenant leur retour,
je vous en conjure, au nom de la vive amitié que vous avez pour moi.
Ils sont bien loin, il est vrai ; maison ne s'effraye pas d'une longue
route, quand il s'agit d'aller vivre au milieu des siens et de mourir
sous son toit. Employez pour eux vos soins, vos efforts, ou plutôt
faites ce qu'ils désirent, vous le pouvez, j'en suis convaincu, et je
vous le demande avec les plus vives instances.
568. — A
CESAR. Asture, avril.
F. XIII, 15. Je vous recommande tout particulièrement Précilius, dont
le père est votre ami, mon inlime à moi-même, et le meilleur des hommes.
Le jeune Précilius a su m'inspirer une très-vive affection par sa
modestie, la bonté de son âme, et l'attachement singulier qu'il a pour
moi. Puis, son père a toujours été de mes meilleurs amis; je le sais
pour l'avoir vu à l'œuvre : c'était un de ceux qui ne cessaient de me
plaisanter, et de me dire des injures, de ce que je n'allais pas vous
rejoindre, moi que vous y invitiez en termes si magnifiques. « Mais je
restai inaccessible a la persuasion. » J'entendais nos hauts
personnages s'écrier : » Courage! courage! si tu veux mériter un
regard de la postérité. » Un nuage épais troublait ma vue. Aujourd'hui
encore ne cherchent-ils pas à m'exciter, à faire revivre en moi l'amour
éteint de la gloire? Ils s'écrient que «je ne périrai pas lâchement et
sans honneur, que je laisserai après moi le souvenir de quelque
exploit qui retentira dans la postérité. » Paroles perdues, vous le
voyez. Laissons là Homère et ses grands mots. Vive Euripide et la vérité
! « Pauvre sage qui ne sait pas être sage « pour lui-même! «Voila
le vers par excellence, suivant le vieux Précilius, qui ajoute que «
savoir porter ses regards en avant et en arrière n'empêche pas de
se tenir toujours dans la ligne de l'honneur et de s'élever au-dessus
des autres. » — Mais je reviens a mon dire : cédez aux nobles penchants
de votre cœur, et accordez vos bontés au jeune Précilius. Vous êtes
déjà, je le suppose, très bien disposé pour cette famille. Que ma
recommandation mette un poids de plus dans la balance; je vous en saurai
un gré infini. Voila une lettre d'un nouveau genre. C'est que ma
recommandation, veuillez le croire, n'est pas une recommandation vulgaire.
569. — A CÉSAR. Asture, avril.
F. XIII, 16. Il n'y a personne dans notre jeune noblesse qui m'ait été
aussi cher que P. Crassus ; dès son entrée dans la vie, il m'avait
donné de lui des espérances qui se sont changées en estime, quand
l'effet est venu justifier mes prévisions. J'avais de son vivant
distingué son affranchi Apollonius. Il était si dévoué à son maître,
il le secondait si bien dans ses nobles travaux ! Aussi Crassus l'aimait
tendrement. Depuis sa mort, Apollonius s'est acquis de nouveaux droits à
ma confiance et à mon amitié par les égards et le respect dont il s'est
fait un devoir envers tous ceux que Crassus affectionnait, ou à qui
Crassus était cher. C'est guidé par ce sentiment qu'il est venu
me joindre en Cilicie, on il m'a été très-utile. Vous-même, dans la guerre
d'Alexandrie, vous avez eu lieu, si je ne me trompe, d'être satisfait de son zèle et de son
dévouement. Il se flatte que vous avez conserve bonne opinion de lui, et
dans cette confiance le voilà parti pour vous rejoindre en Espagne.
L'idée est de lui ; mais je l'approuve, .le ne lui ai pas proposé ma
recommandation, non que je la croie sans valeur auprès de vous; mais i!
vous a suivi à la guerre, il est à vous par le nom seul de Crassus, et
il aurait des recommandations par milliers, s'il en voulait. Je lui ai
promis seulement mon témoignage, auquel il tient beaucoup, et dont je
sais par expérience que vous ne faites pas ii. C'est un homme instruit
qui a toujours eu le goût de l'étude, et cela depuis sa jeunesse, qu'il
a passée presque toujours chez moi, avec le stoïcien Diodote, l'homme le
plus savant que je connaisse. il est aujourd'hui dans l'enthousiasme de
vos actions, et se propose d'en composer l'histoire en grec. Je l'en
crois très-capable; il a de l'esprit, il sait écrire, et s'exerce depuis
longtemps dans le genre historique. Enfin sa passion est de payer
dignement sa dette à votre gloire immortelle. Voilà ce que j'ai à vous
dire de lui. Votre tact exquis le jugera. Quoi que j'en aie dit
tout-à-l'heure, je vous le recommande, et j'aurai une gratitude extrême
de ce que vous ferez pour lui.
570. — A ATTICUS. Asture. avril.
A. XII, 34. Tiron va mieux, et je me trouverais ici, même sans Sica,
aussi bien que mes maux le permettent. Mais vous me donnez l'éveil sur
la possibilité d'une surprise; j'en conclus que vous ne savez pas le
jour précis du départ qui me menace, et je ne trouve dès lors rien de
plus simple que d'aller vous joindre, d'autant que vous le désirez aussi, je le vois bien. Demain donc je serai aux portes de la ville, chez Sica,
d'où, suivant votre conseil, je pense à me rendre du côté de Ficulea.
Puisque j'arrive, je remets à causer de vive voix avec vous sur ce que
vous m'écrivez. Laissez-moi vous dire seulement combien je suis
émerveillé et touché de tout ce que je trouve en vous de bienveillante
sollicitude, de sagesse et d'esprit de conduite, chaque fois qu'il se
présente une affaire à traiter, une résolution à prendre, un conseil à
donner.
571. — SERV. SlXPICIUS A CICÉRON. Athènes.
F. IV, 5. La mort de Tullie voire fille, dont on vient de me donner la
nouvelle, devait me porter un coup rude et pénible; et je m'en suis
afflige comme d'un malheur commun. Si j'eusse été à Rome, j'aurais couru
près de vous et je vous aurais dit ma douleur. Sans doute il y a quelque
chose de triste et d'amer dans ces consolations qui nous viennent de nos
proches et de nos amis, tout empreintes du sentiment de peine qui les
inspire, qu'on ne peut donner sans fondre soi-même eu larmes et sans
montrer le besoin d'être affermi, plutôt que la force de soutenir les
autres, .le veux pourtant vous soumettre en peu de mois quelques
réflexions qui me sont venues; je sui: sûr qu'elles ne vous ont pas
échappé : mais dans le trouble de votre âme vous n'en avez pas été assez
frappé peut-être. Comment se peut-il qu'un chagrin domestique agisse sur
vous avec tant de violence? Voyez comme la fortune nous a déjà traites:
à tous elle a ravi ce que chacun doit aimer a l'égal de ses enfants, la
patrie, l'honneur, les distinctions, les dignités. Qu'est-ce donc qu'une
disgrâce déplus peut ajouter à la mesure de nos douleurs? Après tant
d'assauts, comment ne pas se sentir abattu, et comment mettre encore du
prix à quelque chose? Est-ce le sort de votre fille que vous déplorez,?
mais que de fois, comme nous, n'avez-vous pas dû réfléchir qu'à l'époque
ou nous vivons, l'échange tranquille de la vie contre la mort n'est pas
le pire destin? Qu'y avait-il dans ces tristes temps qui pût lui rendre
chère l'existence? quel présent? quel avenir? quelle consolante pensée?
Était-ce dans le bonheur de passer ses jours unie à un époux jeune et
distingué? Sans doute votre position vous permettait de choisir parmi
notre brillante jeunesse des gendres à qui confier sans crainte le sort
de vos enfants ! Était-ce dans la douceur de posséder à son tour des
enfants, sortis de son propre sein; de jouir de leur prospérité, de
penser qu'ils recueilleraient un jour l'héritage paternel; qu'ils
arriveraient à leur tour aux honneurs, et qu'ils useraient de leurs
droits d'hommes libres pour servir la république et pour protéger leurs
amis? Mais lequel de ces biens dont on ne soit depuis longtemps privé?
C'est un malheur sans doute de perdre ses enfants; mais un malheur plus
grand peut-être, c'est d'avoir à souffrir et à endurer tant de maux ! —
.le veux vous faire part d'une réflexion qui m'a été d'un grand secours,
et ou vous puiserez peut-être quelque force. Je revenais d'Asie,
laissant Égine et me dirigeant vers Mégare. Je me mis à considérer au
loin les pays qui m'environnaient. Derrière était Égine; devant, Mégare;
à droite, le Pirée; à gauche, Corinthe; ces villes autrefois si
florissantes n'offraient à mes regards que désolation et ruines: cette
vue me fit faire un retour su: moi-même. Eh quoi! me dis-je, pauvre
espèce que nous sommes, nous dont la loi est de vivre comparativement si
peu, jetterons-nous toujours les hauts cris en voyant mourir ou
souffrir un de nos semblables, quand sur un seul point tant de cadavres
de villes gisent amoncelés? Ne voudras-tu point, ô Servius, descendre en
toi-même et reconnaître la condition de ton existence? Croyez-moi,
Cicéron, cette réflexion ne fut pas pour moi d'un médiocre effet. Placez
le même spectacle devant vos yeux, et faites-en vous-même l'épreuve.
Une foule d'hommes illustres ont péri; l'empire a perdu sa grandeur et
sa force; il n'est pas une province qui ne soit ébranlée jusqu'en ses
fondements; et quand le faible souffle qui animait une faible femme
vient à s'éteindre, vous en ressentez une telle commotion ! Supposé que
son dernier jour ne fût pas encore venu, il ne lui en aurait pas moins
fallu mourir dans quelques années, puisqu'elle appartenait à l'humanité.
Éloignez donc de ce sujet votre esprit et votre pensée, et songez plutôt
à soutenir la dignité de votre caractère ! Songez que la vie lui a été
exactement mesurée; qu'elle a vu son père préteur, consul, augure ; que
sa couche a été partagée par ce que la jeunesse de Rome a de plus
illustre; qu'elle a presque épuisé la coupe du bonheur; et qu'enfin, je
le répète, elle a quitte la vie au moment où la république rendait le
dernier soupir. Quelles plaintes avez-vous donc l'un ou l'autre à élever
contre la fortune? Ah ! rappelez-vous ce que vous êtes, mon cher
Cicéron; n'oubliez pas que c'est de vous que le reste des hommes est
accoutumé à recevoir l'impulsion et l'exemple. Répudiiez le rôle
de ces mauvais médecins qui prétendent posséder l'art de
guérir les autres, mais qui ne savent pas se guérir eux-mêmes ; et,
retraçant à votre esprit les prescriptions que vous avez si souvent
proclamées infaillibles, sachez vous y soumettre avec confiance et vous
les appliquer à votre tour. Il n'y a pas de chagrin que le temps ne
diminue et n'adoucisse à la longue. Eh bien! pour vous, c'est une honte
d'attendre votre guérison du temps, et de ne pas la demander à la raison.
D'ailleurs si tout sentiment ne s'éteint pas aux enfers, elle a trop de
piété filiale, elle aime trop les siens, pour ne pas condamner l'état où
vous vous réduisez. Au nom de votre fille qui n'est plus, au nom de vos
amis, de vos clients que votre douleur afflige, au nom de la patrie
elle-même, redevenez donc capable d'agir et de penser pour elle! Enfin,
puisque la fortune nous met dans la position d'avoir cette crainte,
craignez de laisser croire que ce n'est pas votre fille, et que c'est le
malheur du temps, c'est le triomphe de nos ennemis qui fait couler vos
larmes. Je me fais scrupule d'insister davantage : ce serait me délier
de votre sagesse. Je n'ajoute qu'une réflexion, et je me tais : On vous
a vu admirable dans la prospérité, et il vous en revient une gloire
éternelle. Montrez maintenant que l'adversité n'a pas le pouvoir de vous
abattre, et que le poids dont elle pèse sur vous n'est pas au-dessus de
vos forces. Il ne faut pas que, de toutes les vertus, celle-là seule
paraisse vous manquer. Quand vous serez plus calme, je vous
entretiendrai de ce qui se passe et de l'état de ma province. Adieu.
572. — A LUCCEIUS, FILS DE QUINTUS. Asture, avril.
F. V, 13. Les consolations que vous m'adressez
me touchent vivement. Elles respirent a la fois une exquise bonté et une
haute raison. Mais ce dont je vous remercie le plus, c'est de m'y avoir
montré un vertueux mépris des choses humaines, une âme préparée et comme
armée contre les coups de la fortune. Ce que je prise surtout dans le
sage, c'est son indépendance, c'est l'isolement absolu où il se place de
toute influence extérieure, dans le jugement du bien et du mal. Cette
manière d'être, je ne l'ai pas tout à fait perdue; elle avait en moi de
trop profondes racines. Mais elle a reçu de rudes atteintes au milieu de
tant de bouleversements, de tant d'assauts de tous les genres. Vous
avez voulu la raffermir, j'en vois l'intention dans votre lettre, et
j'en sens déjà les heureux, effets. Aussi, je vous le répète, et je ne
saurais trop souvent et trop hautement vous le dire, jamais plus douce
émotion ne toucha mon cœur. Quelque consolantes que soient les
réflexions nombreuses et choisies que vous vous êtes plu à rassembler
pour me les offrir, il n'y a rien d'aussi consolant pour moi que la
contemplation de tout ce que votre âme possède d'énergie et d'élévation.
Vous me donnez là un exemple que je rougirais de ne pas suivre. Mais il
est uu point sur lequel je me crois plus de courage que vous qui m'en
don nez des leçons : je vois que vous espérez un meilleur avenir. Voilà
le sens de toutes vos comparaisons tirées des combats de gladiateurs et
des vicissitudes qu'ils présentent: c'est là que tendent tous vos
raisonnements. Je m'explique votre courage, si l'espérance le soutient;
mais je ne m'explique pas l'espérance. Il n'est rien qui ne soit ébranlé
nu point de menacer d'une chute prochaine. Regardez autour de vous, vous
qui connaissez les ressorts de la république : en trouvez-vous un seul
qui ne soit brise ou détendu ? Je ferais l'énumération de nos maux, si
vous ne les connaissiez aussi bien que moi, cl si un pareil sujet
n'était pas trop douloureux au moment ou vous me reprochez ma douleur.
Ainsi que vous l'ordonnez, je saurai supporter mes chagrins domestiques;
et quant aux malheurs de la patrie, je veux leur opposer un courage
meilleur même que le vôtre, puisque l'espérance l'ait votre force, et
que. j'aurai la même force sans la moindre espérance. Vous me retracez
de bien doux souvenirs en rappelant les actions que j'ai faites, et aux»
quelles vos conseils, je dois le proclamer, eurent tant de part. J'ai
fait pour la patrie, je ne dirai pas plus je que ne devais, mais plus
assurément qu'on n'a jamais exigé du courage ou de la prudence d'aucun
homme, pardonnez-moi de parler ainsi de moi-même : c'est pour adoucir
mes maux que vous avez voulu reporter mon esprit sur le passé, et je
trouve du charme à m'y arrêter a mon tour. Je suivrai votre conseil ;
j'écarterai, autant que possible, de ma pensée les images qui la
blessent ou la déchirent. Je l'appliquerai uniquement aux objets qui
embellissent la vie dans la prospérité et qui la consolent dans les
revers. Je veux être avec vous autant que le permettent nos âges et nos
santés ; et si une nécessité plus forte que mon penchant s'oppose trop
souvent à l'accomplissement de. ce vœu, le rapport de nos esprits et la
conformité de nos études ne nous laisseront jamais du moins un seul
moment tout à fait séparés.
573. — A TORQUATUS. Asture, avril.
F. VI, 2. N'imputez pas a oubli, je vous en conjure, la rareté
inaccoutumée de mes lettres. Il faut vous en prendre au mauvais état de
ma santé, qui pourtant commence à se rétablir, et à mon éloignement de
la ville, qui m'empêche d'être au courant des occasions. Sachez, une
fois pour toutes, que je garde votre souvenir avec la plus tendre
affection, et (pie ce qui vous touche me préoccupe autant que ce qui me
touche moi-même. Si votre affaire éprouve plus de vicissitudes qu'on ne
l'eût souhaité ou pu prévoir, croyez-moi, eu égard au temps, c'est un
mal a prendre en patience. De trois choses l'une : ou la république sera
en proie à des déchirements sans fin, ou les luttes seront suivies de
quelques intervalles de repos, ou enfin tout s'écroulera de fond en
comble. Si l'état de guerre continue, vous n'avez à craindre ni ceux de
qui vous aurez reçu un refuge, ni ceux à qui vous aurez prêté votre
appui. Qu'on dépose les armes par accommodement, que la lassitude les
fasse tomber des mains, ou que la victoire les arrache aux partis,
alors la cité respirera, et vous retrouverez à la fois rang et fortune.
Si, au contraire, tout est bouleversé sans ressource, et si nous devons
assister à ce jour funeste dont s'effrayait déjà M. Antonius, lorsque sa
sage perspicacité pressentait l'orage épouvantable qui devait éclater
sur nos têtes, j'avoue que je n'ai à vous offrir qu'une consolation qui
est misérable, surtout pour un citoyen et un homme tel que vous, mais
qui cependant est la seule : c'est qu'on ne doit pas s'affliger pour soi
d'un malheur qui frappe également sur tous. Je n'ajouterai rien de plus
: si vous réfléchissez, comme je n'en doute pas, au sens profond de
ce
peu de mots ; vous en conclurez, sans que je vous le dise, qu'il y a
pour vous des motifs suffisants d'espérer, et que, dans l'une comme dans
l'autre des hypothèses ou j'ai placé la république, il n'y a pas pour
vous de quoi prendre l'alarme. Enfin, je le répète, si tout périt, comme
vous ne voudrez ni même ne pourrez survivre à la république, vous devez
vous résigner d'autant mieux que votre conscience est sans reproche.
J'en ai dit assez. Donnez-moi, je vous prie, de vos nouvelles, et
dites-moi où vous comptez aller, afin que je sache ou vous écrire, et au
besoin où vous joindre.
574. — A ATTICUS. Antium, avril.
A. XII, 34, 2eme part., et 35. Ayez la bonté, le jour même de mon arrivée
chez Sica, de me faire savoir ce que vous avez fait avec Silius, et
notamment quelle portion du terrain il veut se réserver. Vous m'écrivez
que c'est le bout ; mais il faut voir si ce n'est pas précisément la
partie que j'ai en vue et qui m'a fait décider l'affaire. — Je vous
envoie une bien aimable lettre que je viens de recevoir d'Hirtius. — Il
ne me serait jamais venu dans l'esprit, avant notre dernière entrevue,
qu'en dépensant pour un tombeau an delà de je ne sais quelle somme fixée
par une loi, on fût exposé à une amende égale à l'excédant. Je m'en
inquiéterais peu, si ce n'est que, sans trop savoir pourquoi, peut-être
même sans raison, je ne veux absolument pas que ce tombeau soit autre
chose qu'un temple, et je crains bien que pour un temple il ne faille un
autre emplacement. Pesez cette difficulté, je vous prie : quoique moins
abattu et revenu presque à mon état naturel, j'ai cependant besoin de
vos conseils. Prenez celte affaire à cœur;
je vous en supplie avec plus d'instance que ne le veut et ne le souffre
d'ordinaire votre amitié.
575. — A ATTICUS. Antium, avril.
A. XII, 36. C'est un temple que je veux : rien au monde ne me fera
changer. Quant a la ressemblance avec un tombeau, je chercherai à
l'éviter, moins à cause de la pénalité de la loi que pour indiquer le
plus possible, une apothéose. Si c'était dans l'intérieur d'une villa,
point de difficulté; mais, comme je vous l'ai dit souvent, le
changement de maître m'effraie. En plein champ, au contraire, n'importe
ou, on peut compter sur le respect de la postérité. Voilà des folies,
j'en conviens; il faut me les passer. Je m'ouvre avec vous plus
librement qu'avec tout autre, peut-être qu'avec moi-même. Si vous
approuvez le programme, le lieu et le plan, lisez la loi, je vous
prie, et faites-la-moi passer. Puis s'il nous vient à l'esprit quelque
biais pour en éviter l'application, nous le prendrons. — Quand vous
écrirez à Brutus, sauf meilleur avis, grondez-le de n'être pas venu à
dîmes et d'en avoir donné un pareil motif. Plus j'y réfléchis, plus je
trouve que c'est tout à fait manquer d'égards. — Encore une fois, si
vous voulez vous occuper du temple dans le sens que j'indique, je vous
prierai de déterminer et de presser Cluatius ; car même avec un autre
emplacement, j'aurais encore recours à ses soins et à ses avis. Demain
peut-être vous serez à la villa.
576. — A ATTICUS. Antium, mai.
A. XII, 37. Hier m'ont été remises deux de vos lettres, toutes deux de la
veille, l'une par Hila-rus, l'autre par un exprès; puis, le même jour,
par mon affranchi Egypta, encore une autre lette; celle-ci m'apprend que Pilia et Attica sont tout
à fait bien. Elle
a treize jours de date. vous m'avez fait plaisir en me communiquant
ce que vous a écrit Brutus. Il m'a écrit également : je vous envoie sa
lettre, avec une copie de ma réponse. — Si vous ne trouvez pas de
jardins poulie temple, (vous en trouverez pour peu que vous m'aimiez,
et certes vous m'aimez ;, votre idée de Tusculum me sourirait beaucoup.
Avec toute l'habileté que je vous connais, il ne fallait rien moins
encore que la chaleur de votre indulgente amitié pour rencontrer si
bien. Mais je tiens, avant tout, par je ne sais quelle secrète
préférence, a un lieu ou l'affluence se porte. Procurez-mui donc des
jardins. En fait d'affluence, il n'y a rien de mieux que ceux de Scapula.
En outre, l'avantage d'être tout près de vous et de n'avoir pas à perdre
une journée entière pour aller à votre villa! Tâchez d'avoir un
rendez-vous avec Othon avant votre départ, s'il est à Rome. S'il n'y a
rien à faire de ce côté, eh bien ! je veux pousser a bout votre
complaisance pour mes faiblesses. Drusus est décidé a vendre; ne
trouvant rien ailleurs, ce sera ma faute si je ne traite avec lui. Ne me
laissez donc pas faire un mauvais marché, je vous en prie; et traitez
avec Scapula, si c'est possible. Il n'y a que ce moyen. Dites-moi, je
vous prie, combien de temps vous comptez rester a voire villa, près de
Rome. — Vus bons offices et votre influence près de Térentia me sont
très-nécessaires, mais vous agirez absolument comme vous l'entendrez.
Je sais bien que, du moment ou mes intérêts seront en jeu, votre
sollicitude s'éveillera plus vivement que la mienne propre, c'est votre
coutume. Hirtius me mande que Sextus Pompée a abandonné Cordoue, et
qu'il se retire vers l'Espagne citérieure, et que Cnéius est en fuite, je ne
sais ou, et ne m'en soucie guère. Rien autre chose. Sa lettre est datée
de Narbonne le 11 des kalendes de mai. Vous me parlez du naufrage de
Caninius comme d'une chose douteuse. Si vous recevez quelque information
positive, communiquez-la-moi. Je dois, dites-vous, surmonter ma
tristesse; je le veux bien. Trouvez-moi un emplacement pour mon temple.
Il me vient une foule d'idées sur l'apothéose; mais il faut un lieu pour
bâtir. Voyez donc Othon.
577. — A ATTICUS.
Antium, mai.
A. XII, 38. Vous avez été surchargé d'occupations, j'en suis sur, puisque
vous ne m'avez pas écrit. Mais cet homme est un misérable de n'avoir pas
attendu votre loisir, quand je ne l'envoyais que pour cela. A moins
d'obstacle qui vous ait retenu, vous êtes maintenant, je le suppose, à
votre villa près de Rome. Je passe ici les journées entières a écrire;
non pour me consoler, du moins pour me distraire. Asinius Pollion m'a
écrit au sujet de notre indigne parent. (Leur neveu Quintus.) C'est eu
termes positifs ce que déjà Balbus le jeune et Dolabella m'avaient donné
à entendre; le premier assez clairement, le second d'une manière
détournée. J'en souffrirais, s'il y avait place dans mon cœur pour un
nouveau chagrin. Vit-on jamais infamie pareille! Qu'un tel homme est à
craindre! Quoique pour moi.... ; mais je retiens mon ressentiment. Comme
il n'y a pas nécessité, ne m'écrivez que si vous avez un moment à vous.
On commence à remarquer, dites-vous, mon peu de courage, et on en parle
en termes bien plus forts que vous et Brutus. Eh bien ! que ceux qui me
croient l'esprit abattu et affaibli viennent voir ce que j'écris et
les sujets que je traite. Ils jugeront, pour peu qu'ils aient de sens,
si l'homme dont la tête est assez libre pour aborder des questions si
difficiles mérite le reproche d'abattement, et s'il n'y a pas à le louer
plutôt d'avoir su faire à son chagrin une diversion si honorable et si
digne d'un esprit éclairé. Mais quand je fais tout pour prendre sur moi,
de votre côté achevez votre œuvre, cette couvre de votre sollicitude, je
le vois, autant que de la mienne. Il me semble qu'une dette me pèse. Je
ne serai soulagé que lorsque je pourrai m'acquitter, ou me voir en
position de le faire; c'est-à-dire lorsque j'aurai trouvé le terrain que
je veux. Si, comme Othon vous l'a dit, l'intention des héritiers de
Scapula est de faire quatre parts et de liciter entre eux, il n'y a pas
moyen de se présenter. S'ils vendent en bloc, c'est différent; on verra
ce qu'on doit faire. On était venu me parler du champ Publicianus, qui
appartient à Trébonius et à Cusinius. Mais vous savez que c'est un
terrain nu; je n'en veux pas. La propriété de Clodia convient
parfaitement. Malheureusement, je ne la crois pas à vendre. Quant aux
jardins de Drusus, malgré votre répugnance, il faudra bien que j'y
revienne, comme à ma dernière ressource, si vous ne me trouvez rien
autre. Les constructions me touchent peu. Je n'y bâtirais absolument que
ce que je serais obligé de bâtir partout ailleurs. J'ai lu Cyrus avec le
même genre de plaisir que les autres ouvrages d'Antisthène, où il y a
plus d'esprit que de fonds.
578. —
A ATTICUS. Asture, mai.
A. XII, 39.
Mon messager revient les mains vides ; c'est sans doute parce que vous
m'aviez écrit la veille sur les divers objets auxquels j'ai répondu dans
la lettre dont il était porteur. J'espérais pourtant quelques mots de
vous, au sujet de celle d'Asinius Pollion; mais je juge trop de vos
loisirs par les miens. Aussi, quoique je renvoie le messager, ne
m'écrivez qu'au besoin, à moins que vous ne soyez bien désœuvré.
J'enverrais des exprès, ainsi que vous me le conseillez, s'il se
présentait des cas d'urgence, comme à l'époque où chaque jour,
quoiqu'aux temps les plus courts de l'année, voyait partir la lettre et
revenir la réponse. Alors nous avions de quoi fournir à notre
correspondance. C'était Silius, c'était Drusus, mille autres encore.
Aujourd'hui, sans Othon, il n'y aurait rien, et encore l'affaire
est-elle différée. N'importe ! c'est un soulagement pour mot dans
l'absence, quand je cause avec vous; et j'éprouve un plus grand
bien-être encore, quand je lis vos lettres. Cependant vous n'êtes point
à Rome, je le suppose; et dès lors puisqu'il n'y a pas nécessité
d'écrire, faisons trêve à notre correspondance et attendons du nouveau.
579. —
A S. SULPICIUS. Asture, mai.
F. IV, 6. Et moi
aussi, mon cher Servius, j'aurais voulu vous avoir auprès de moi dans
mon affreux malheur. Que de secours n'aurais-je pas tirés de vos
consolations et même de vos larmes! J'en juge par le bien que me fait la
simple lecture de votre lettre. C'est que vous dites tout ce qui est
capable de me consoler, et qu'il n'y a pas en même temps une seule de
vos consolations qui ne témoigne d'une vive douleur. Votre bon Servius,
par son empressement dans cette triste circonstance, m'a montré combien
il a de déférence, pour moi, et combien il attache de prix à ce qu'il
suppose devoir vous plaire. Les témoignages que j'ai si souvent reçus de
lui m'ont été quelquefois plus agréables ; jamais ils ne m'inspirèrent
plus de gratitude. Quant à vous, ce ne sont pas seulement vos réflexions
et la sympathie de votre douleur qui me consolent, c'est encore le
caractère d'autorité qui appartient à votre langage. Oui, je comprends
qu'il serait honteux pour moi de supporter mon malheur autrement que ne
l'entend votre haute raison; mais il y a des moments ou la douleur
m'accable, ou la force m'abandonne ; c'est que je n'ai pas les
ressources qui ne manquèrent point dans une semblable infortune aux
pères dont je propose l'exemple. Car enfin quand Q. Maximus perdit un
fils consulaire, honoré par de brillantes qualités et de grandes
actions; quand L. Paullus vit mourir deux enfants en sept jours, lors du
malheur de votre ami Gallus; et quand M. Caton se vit enlever ce fils
dont l'esprit était si distingué et la vert « si haute, c'était à une
époque ou le caractère qu'ils tiraient de leur position dans la
république était un dédommagement aux peines de leur cœur. Mais moi qui
ai perdu ces distinctions que vous énumérez et que j'avais conquises par
tant d'efforts, il ne me restait plus qu'une consolation, et elle m'est
ravie. Rien ne vient distraire ma pensée, ni les intérêts de mes amis à
défendre, ni les affaires de la république a gérer. Je m'étais interdit
le forum. Je ne pouvais plus regarder la curie. Je considérais comme
entièrement perdus et le fruit de mes travaux et les avantages de ma
fortune. Mais lorsque je réfléchissais sur ces malheurs, qui nous sont
communs et que tant d'autres partagent; lorsque je sentais mon âme
brisée, et que je me faisais violence pour me vaincre, je savais au
moins ou trouver un refuge, ou reposer mon triste cœur, ou goûter dans
des entretiens pleins de charme l'oubli de mes soucis et de mes maux. Le
coup horrible qui me frappe aujourd'hui rouvre mes blessures qui
commençaient a se fermer. Tout ne m'était pas sensible autrefois. Dans
mes chagrins politiques, mon intérieur me gardait des dédommagements;
dans mes chagrins d'intérieur, la république me servait de refuge et le
spectacle de son état prospère reposait mon âme. Maintenant il faut que
je sorte à la fois et de ma maison cl du forum; de ma maison, qui n'a
rien à me donner en échange des peines que me cause la république ; du
forum, qui n'a point à m'offrir de consolation dans mes chagrins
domestiques. Voilà pourquoi je vous appelle avec tant d'instance;
pourquoi je suis si impatient de vous voir, rien ne me consolera mieux
que votre amitié et la douceur de vos entretiens, Je me flatte que le
moment de votre retour approche. Une foule de motifs, vous le concevez,
me font désirer votre présence. Nous aurons d'abord à nous entendre sur
la ligne de conduite qu'il convient d'adopter pour un temps ou tout se
fait par la volonté' d'un homme sage, généreux, que je ne crois pas mal
disposé pour moi, et qui me semble avoir beaucoup de penchant pour vous.
Mais en prenant tout cela en considération, ce n'en est pas moins encore
une grande affaire que de savoir quelle marche suivre, non pas pour
jouer un rôle, mais pour vivre en repos, avec sa permission et sous son
bon plaisir. Adieu.
580. —
S. SULPICIUS A CICÉRON. Athènes, mai.
F. IV, 12. J'ai
à vous annoncer une nouvelle bien fâcheuse : mais puisque les accidents
fortuits et la fragilité de la vie sont une des premières conditions de
notre être, il faut bien que je vous raconte ces tristes détails, au
risque du chagrin qu'ils peuvent vous faire. J'arrivai par mer au Pirée
le dixième jour avant les kalendes de juin, venant d'Epidaure. Là, je
trouvai Marcellus, mon ancien collègue, et je m'arrêtai un jour pour
avoir le plaisir de le passer avec lui. Le lendemain, je le quittai.
J'avais à me rendre d'Athènes en Béotie, afin d'achever ma tournée
judiciaire. Il allait, lui, me dit-il, s'embarquer pour l'Italie
au-dessus de Malée. Le jour suivant, comme je me disposais à partir
d'Athènes vers la dixième heure de la nuit, arrive P. Postumius, l'un
des habitués de sa maison, qui m'annonce que Marcellus a été poignardé,
la veille, après souper, par P. Magius Cilon, l'un de ses intimes;
qu'il a reçu deux blessures, l'une dans l'estomac, l'autre à la tète le
long de l'oreille; que néanmoins son état n'est pas désespéré ; qu'a
présent le coup Mugius s'est tué; qu'il venait de la part de Marcellus
lui-même pour m'informer de l'événement, et me demander des médecins.
J'en envoyai chercher, et je partis sur leurs pas à la pointe du jour. A
peu de distance du Pirée je rencontre un esclave d'Acidinus, porteur
d'un billet de son maître : .Marcellus avait succombé quelques moments
avant le jour, et Acidinius m'en faisait part. Ainsi vient de périr
d'une manière tragique, sous les coups d'un scélérat, l'un de nos plus
illustres citoyens; et l'homme dont le beau caractère avait désarmé ses
ennemis trouve un ami pour lui donner la mort. Je ne laissai pas de
poursuivre jusqu'à sa tente. J'y trouvai deux affranchis et un
très-petit nombre d'esclaves. Les autres, disaient-ils, s'étaient
enfuis, effrayés des conséquences de l'attentat, leur maître ayant été
lue au devant de sa tente. Je fus forcé de faire placer le corps dans la
litière même qui m'avait amené, et de le faire reconduire à la ville par
mes propres porteurs. Là, je fis célébrer ses funérailles en grande
pompe, eu égard à ce qu'on trouve de ressources en ce genre à Athènes.
Je ne pus obtenir la permission de l'enterrer dans l'intérieur de la
ville : les Athéniens m'objectèrent les prohibitions de leur culte,
prohibitions auxquelles on n'a jamais dérogé pour personne. A cela près,
ils me firent toutes les concessions possibles, en mettant à ma
disposition celui de leurs gymnases qui me conviendrait le mieux pour
placer la sépulture. Je choisis le plus célèbre de l'univers, le gymnase
de l'Académie. On y brûla le corps, et je donnai ensuite des ordres pour
que sur le lieu même les Athéniens lui élevassent un tombeau de marbre.
Ainsi tous les devoirs qu'il dépendait de moi de rendre à un collègue, à
un parent, je les lui ai rendus après sa mort comme pendant sa vie.
Athènes, la veille des kalendes de juin.
581. —
A ATTICUS. Antium, juin.
A. XII, 40.
J'ai un avant goût de la réplique de César à mon éloge de Caton par
l'écrit que m'envoie Hirtius, et où il a ramassé tout ce qu'il est
possible de dire de pis contre Caton, en y mêlant des compliments
infinis pour moi. J'ai envoyé ce livre à Musca, pour qu'il le remit à
vos copistes; je veux le publier. Dites-leur un mot, je vous prie, pour
les faire aller vile. Je songe souvent au morceau officiel. Il ne me
vient rien. J'ai sous les yeux les discours adressés à Alexandre par
Aristote et Théopompe. Mais quel rapport ! Leur langage était à la fois
honorable pour eux et flatteur pour Alexandre. Croyez-vous que la
position en permette un semblable aujourd'hui? En vérité, je ne sais
comment m'y prendre. — Vous craignez, dites-vous, que l'excès de mon
chagrin ne me nuise dans l'opinion publique, et n'affaiblisse la
considération dont je jouis. Mais que me reproche-t-on et que me veut-on
après tout? Que je ne sois pas triste? est-ce possible? Que je ne
m'abandonne pas du moins tout à fait? Mais qui s'abandonne moins que
moi? Ai-je refusé une seule visite, à l'époque où votre amitié donnait
asile à ma douleur? Et y a-t-il une seule personne qui ait eu alors à se
plaindre de ma réception? Je partis pour Astuce. Eh bien! je mets au
délices gens au cœur joyeux de lire seulement l'équivalent de tout ce
que j'ai écrit : bien ou mal, ce n'est pas là la question; toujours
est-il que le sujet (pie j'ai choisi serait inabordable pour un esprit
malade. J'ai passé trente jours à ma villa. Ma manière de recevoir et
mon langage ont-ils laissé quelque chose à désirer? Maintenant encore je
lis, j'écris tour-à-tour, et je vois ceux qui vivent avec moi plus en
peine de supporter leur loisir que moi mon travail. Enfin, me dit-on,
pourquoi ne suis-je pas à Rome? parce qu'il n'y a personne. Pourquoi pas
dans celles de mes villas qui sont plus de la saison? parce que le trop
grand monde ne me va point. Ne suis-je pas d'ailleurs là où l'homme qui
avait la plus délicieuse de toutes les habitations de Baies (Probablement
Lucullus) ne manquait jamais de passer le temps où nous sommes de
l'année? Si j'allais à Rome, on ne trouverait à reprendre ni à mon
maintien ni à mes paroles. Quant à ma gaieté d'autrefois, mon
préservatif contre les misères du temps, elle m'a fui sans retour. Mais,
je le répète, mon langage et mon maintien ne laisseront prise aucune. —
Il nie semble (pie, moitié par votre crédit, moitié parle mien, nous
pouvons obtenir qu'on mette en adjudication les jardins de Scapula.
C'est le seul moyen de les avoir. Une fois les enchères ouvertes, toute
la richesse d'Othon ne tiendra pas contre mon envie. Ce que vous dites
de Lentulus ne fait rien à l'affaire. Assurons-nous de Fabérius. Ne vous
relâchez pas de votre activité, nous en viendrons à nos fins. — Vous me
demandez combien de temps je dois rester ici? très-peu. Mais mon départ
n'est pas encore fixé. Quand il le sera, vous le saurez. Mandez-moi de
votre côté combien de temps vous serez à votre villa des faubourgs.
Aujourd'hui même, au moment où je vous écris, je reçois des lettres et
des courriers qui me donnent absolument les mêmes nouvelles que vous de
Pilia et d'Attica.
582.—
LUCCÉIUS A CICÉRON. Rome
F. V, 14. Si
votre santé est bonne, je m'en réjouis. La mienne est comme à
l'ordinaire; pourtant un peu moins bonne. Je me suis souvent informé de
vous. Je voulais vous voir. Lorsque j'ai su que vous n'aviez point paru
à Rome, depuis votre malheur, mon étonnement a été grand; et je n'en
reviens pas encore. A quels motifs attribuer votre retraite? Si c'est au
goût de la solitude, aux exigences de quelque composition et au charme
de nos études favorites, je vous en félicite, loin de vous en blâmer.
C'est effectivement ce qu'il y a de mieux et dans les temps de deuil et
de désastres, et dans les jours de calme et de prospérité. Cette vérité
vous est doublement applicable, à vous dont l'esprit a besoin de se
reposer de tant de grands travaux, et dont la pensée est si féconde dans
l'intérêt de nos jouissances et de votre réputation. Si au contraire
vous vous abandonnez encore comme au moment de votre départ, à la
tristesse et aux larmes, je gémis sans doute de vous savoir en proie à
la douleur et aux angoisses. Mais permettez-moi de laisser échapper ma
pensée, et de vous dire que vous êtes bien coupable. Eh quoi ! avec
cette pénétration qui découvre les choses les plus cachées, vous ne
voyez pas ce qui frappe tous les yeux ! Vous ne comprenez pas que vous
ne gagnez rien a répéter chaque jour les mêmes plaintes! Vous ne
comprenez pas que vous ne faites que redoubler vos ennuis, quand votre
sagesse devrait prendre à tâche de les diminuer. Je cherche à vous
persuader par la raison ! si la raison ne peut rien, laissez-vous du
moins gagner par mes prières. Pour l'amour de moi, rompez, rompez ces
tristes liens; cessez de fuir la société de vos amis, et revenez aux
habitudes que je partage avec vous, aux habitudes qui vous sont chères.
Je ne voudrais pas vous fatiguer de mes obsessions, dans le cas où le
zèle qui m'inspire vous déplairait. Je voudrais jeter un scrupule dans
voire âme, et vous arrêter dans la voie fatale on vous êtes. Et comme
ces deux choses contradictoires me troublent beaucoup, puissiez-vous ou
me donner satisfaction sur l'une, ou ne pas vous offenser de l'autre !
583. —
A LUCCÉIUS, FILS DE QUINTUS. Antium, juin.
F. V, 15. Il n'y
a pas une ligne dans votre dernière lettre où votre affection pour moi
ne se révèle tout entière. Cette affection m'était connue, mais les
témoignages que vous m'en donnez, et que mon cœur attendait, n'en
excitent pas moins ma gratitude : je dirais même qu'ils sont un bonheur
pour moi, si je n'avais perdu à jamais le droit de me servir de ce mot.
Le mal n'est pas seulement, comme vous semblez le croire, dans ce qui
vous donne lieu de former contre moi, avec les termes, il est vrai, les
plus doux et les plus tendres, une accusation au fond très-grave : il
vient à la fois de ce que je porte une plaie profonde, et de ce. que je
suis privé de tout moyen d'en adoucir l'amertume. Quelle ressource me
reste-t-il? Des amis? presque tous les miens étaient les vôtres. Les uns
ont disparu de la vie ; et, je ne sais pourquoi, le cœur des autres
s'est glacé. Je puis, il est vrai, vivre avec vous, et je le
souhaiterais ardemment. Conformité d'âge, de penchant, d'habitudes, de
goûts; que de gages d'une union solide! Ne pouvons-nous donc pas nous
rapprocher? je ne vois absolument rien qui s'y oppose. Pourtant nous ne
l'avons pas fait, quand nous étions voisins à Tusculum et à Pouzzol. Je
ne parle pas de Rome, où la vie commune du forum dispense d'autre
rapprochement. J'ignore par quelle fatalité il se l'ait qu'au moment ou
notre existence devrait être si brillante, nous en soyons au point de
rougir même de vivre. Dépouillé comme je le suis de tout ce qui fait le
charme et la consolation de la vie, soit au foyer domestique, soit au
forum, où trouver un refuge? dans l'étude sans doute. L'étude, qui l'ail
mon occupation continuelle et que rien ne pourrait remplacer, l'étude
même, le croirez-vous? me refuse asile et repos. Elle me représente sans
cesse, en quelque sorte, comme un reproche, cette existence que je
conserve, et qui n'est qu'une prolongation de misères. Et vous seriez
surpris de me voir éloigné d'une ville où je n'ai plus qu'une habitation
dépouillée de sa parure, où le temps, les hommes, le forum, le sénat,
tout m'est odieux! Cependant je me livre à l'étude; je lui donne toutes
mes journées. Ce n'est pas, il est vrai, dans l'espoir de guérir mes
maux pour toujours, c'est pour pouvoir un moment les oublier un peu. Si
nous avions fait ce qui ne nous est pas même venu dans la pensée, à
cause de nos continuelles alarmes, nous nous serions rapprochés l'un de
l'autre, et nous n'aurions à nous tourmenter, ni moi de votre état de
souffrance, ni vous de ma tristesse. Eh bien ! réalisons ce projet
autant qu'il nous est possible. Car qu'y a-t-il de mieux pour vous et
pour moi? Je compte donc vous voir au premier jour.
584. —
A ATTICUS. Antium, juin.
A. XII, 41. Je
n'ai rien à vous écrire : mais je veux savoir où vous êtes, si vous avez
quitté la ville, si vous devez la quitter, et quand vous reviendrez.
Dites-moi tout cela. De votre côte, vous me demandez quand je partirai
d'ici. Je coucherai à Lanuvium le lendemain des ides; le jour suivant,
je serai à Tusculum ou à Rome. Lequel des deux? vous le saurez au
moment. Vous savez combien le malheur aigrit, non que je vous en aie
fait faire l'expérience. Mais l'idée de ce temple me poursuit, et si je
ne le vois s'élever, je ne dis pas en espérance, mais en réalité, je
vous en avertis, et vous le prendrez, selon votre usage, en patience,
mon humeur va retomber sur vous. A tort, je ne le nie pas; mais vous
n'en aurez pas moins à la souffrir, comme tout ce que vous souffrez,
comme tout ce que vous avez déjà souffert pour moi. Je vous ai montré
mon βut et ma seule consolation : c'est là que doivent tendre tous vos
efforts. Voulez-vous savoir l'ordre de mes préférences? D'abord Scapula;
ensuite Clodia; puis, si Scapula ne veut pas vendre et si Drusus a des
prétentions exorbitantes, Cusinius et Trébonius. Je crois qu'il y a un
troisième propriétaire. Je suis sur du moins que Hébilus l'a été. Après
tout, si l'idée de Tusculum vous plaît, comme vous me l'avez témoigné
dans quelques lettres, j'y souscris. Mais, d'une façon on d'une autre,
concluez, concluez, si vous voulez me soulager d'un grand poids, au lieu
de m'accuser, comme vous le faites, avec une sévérité à laquelle votre
indulgence ne m'a pas habitué. Cette sévérité, c'est votre amitié qui
vous l'inspire, et peut-être ai-je mis votre patience à bout. Cependant,
si vous voulez consoler mes peines, ce moyen est le meilleur de tous;
pour dire la vérité, c'est le seul.— Avez-vous lu la lettre à Hirtius,
qu'on peut regarder, ce me semble, comme un véritable échantillon de la
diatribe de César contre Caton? Si vous avez le loisir, dites-moi ce que
vous en pensez. - Je reviens à mon temple :si mon vœu n'est pas accompli
cet été, voilà l'été qui commence à peine, il me semblera qu'un crime
pèse sur ma conscience.
585. —
A ATTICUS. Antium, juin.
A. XIII, 26.
Rien de mieux que celle part de Virgilius. Allez donc en avant. Après
cette affaire, celle de Clodia. Si la double négociation échoue, soyez
sur que je me ruine et que je traite avec Drusus. Vous connaissez mon
projet; l'impatience de l'accomplir me dévore. Je pense quelquefois
aussi à Tusculum. Je suis détenniné à tout plutôt que de laisser passer
labelle saison sans rien faire. Il n'est pas de séjour, dans la
situation ou Je suis, qui me convienne mieux qu'Asture. Mais ma société
sans doute s'accommode mal de ma tristesse; elle désire retourner à
Rome. Quoique rien ne m'empêche de rester, j'aime mieux partir, ainsi
que je vous l'ai déjà écrit, pour ne pas paraître délaissé. Maison
irais-je? à Lanuvium ? Je voudrais avoir assez de force pour retourner à
Tusculum. Je vous dirai ma résolution. De votre côté, ne manquez pas de
m'écrire. C'est quelque chose d'incroyable que ce que j'écris, moi, dans
une journée, et aussi dans mes nuits; je ne dors pas. Hier, je me suis
occupé de la lettre à César. Vous le vouliez; il est bon qu'elle soit
prête, si vous croyez que plus tard elle puisse être nécessaire. Quant à
présent, il ne faudra certainement pas l'envoyer : cependant, sur ce
point encore, je vous laisse juge. Je vous en enverrai une copie de
Lanuvium, peut-être de Rome. Vous le saurez demain.
586. —
A ATTICUS. Antium.
A. XII, 42. Je
n'ai certes pas à me plaindre de votre exactitude. Chaque jour, je
reçois de votre écriture; mais je vois et je comprends seulement que
vous n'avez rien à m'écrire. Depuis le 6 des ides, vous avez dû vous
absenter. Dès lors, plus de nouvelles ; je ne laisserai pas de vous
envoyer un courrier tous les jours, à peu près. J'aime mieux lui faire
faire une course inutile, que de vous laisser sans moyen de
communication dans un cas de besoin. J'ai reçu votre lettre vide, du C
des ides; qu'auriez-vous eu à m'écrire en effet? Mais je ne suis pas
fâché de savoir même que vous n'avez rien à m'écrire. Cependant vous
m'avez dit un mot de Clodia, je ne me rappelle plus quoi. Où est-elle?
quand revient-elle? A défaut de la propriété d'Othon, la sienne est ce
qu'il y a de mieux. Mais je doute qu'elle veuille vendre. Elle s'y plaît
et elle est riche. Quant à Othon, vous ne savez que trop combien il y a
de difficultés. Mais enfin faisons tous nos efforts, je vous en conjure,
et arrivons au but. Il est probable que je partirai demain. J'irai à
Tusculum ou à Rome; peut-être ensuite à Arpinum. Lorsque je serai
décidé, je vous en ferai part. J'avais eu la pensée de vous conseiller
précisément ce que vous faites. N'est-il pas tout simple de vous occuper
de cela chez vous et de faire fermer votre porte?
587. —
A ATTICUS. Antium, juin.
A. XII,43.
C'est le lendemain des ides, comme je vous l'ai précédemment écrit, que
je compte coucher à Lanuvium; j'irai de là à Rome ou à Tusculum. Je vous
le dirai. Vous ne me dites pas si j'ai raison d'attacher des idées
consolantes à l'accomplissement de mon projet : j'approuve votre,
silence ; ce sont la, croyez-moi, des choses qu'il ne vous était pas
possible de juger. Vous pouvez cependant avoir la mesure de mon
impatience dans l'aveu que je vous eu fais, à vous que je ne crois pas
partisan bien chaud des idées qui me préoccupent. Mais si je m'abuse, il
faut vous y résigner, mon cher Atticus. Que dis-je, vous y résigner? il
faut y donner les mains. Othon m'inquiète; mais je crains, peut-être
parce que je désire. En vérité, cette affaire est au-dessus de mes
forces, surtout avec un concurrent passionné, riche, et qui hérite.
Immédiatement après Othon, Clodia ; et si nous no réussissons ni d'un
côté ni do l'autre, vous chercherez ailleurs, je vous en prie. Je me
regarde comme engagé par un vœu sacré, plus engagé qu'on ne fut jamais.
Voyez aussi les jardins de Trébonius. Les propriétaires sont absents,
mais qu'importe? Puis, comme je vous l'ai dit hier, pensez à Tusculum,
de peur (pie l'été ne se passe ; c'est ce qu'il faut éviter a tout prix.
588. —
A ATTICUS. Antium, juin.
A. XII, 44.
Hirtius vous a témoigné de la sympathie pour moi, c'est une attention
dont je lui sais gré: mais je vous en sais plus encore de n'avoir pas
voulu me communiquer sa lettre; c'est là surtout une attention délicate.
Quant au livre qu'il m'a envoyé sur Caton, je veux que vos gens le
répandent, afin que le contraste d'indignes diatribes fasse mieux
ressortir l'éloge du grand citoyen. Vous faites bien d'employer Mustella
: c'est un homme spécial, et qui m'est absolument dévoué depuis
l'affaire de Pontianus. Tâchez d'arriver par lui au résultat. Que nous
faut-il autre chose, sinon qu'on laisse le champ libre aux acheteurs? et
pour cela il suffit de la volonté du premier venu parmi les héritiers.
Mustella, par exemple, ne vous refuserait pas, je le suppose. Ainsi, je
devrais à vos soins un lieu propice à l'accomplissement de mon vœu, et
en même temps un asile pour ma vieillesse. Le bien de Silius et celui de
Drusus n'ont, sous ce dernier rapport, rien qui convienne. Un
propriétaire peut-il du matin au soir rester les bras croisés dans sa
villa? Othon, Othon avant tout! Puis Clodia. A défaut de l'un et de
l'autre, usons de ruse avec Drusus, ou revenons-en à Tusculum.C'est un
parti sage de vous être enfermé chez vous. Mais hâtez-vous, je vous en
conjure; redevenez libre, et qu'Atticus me soit rendu ! Ainsi que je
vous l'ai déjà dit, j'irai d'ici couchera Lanuvium le lendemain des
ides, et le jour suivant à Tusculum. J'ai lutté, et pour peu que cela
dure, j'aurai, je crois, pris le dessus. Demain peut-être, ou
après-demain, au plus tard, vous en pourrez juger. Mais qu'est-ce, je
vous prie? voilà Philotime qui prétend que Pompée n'est pas cerné dans
Cartéia ! Oppius et Balbus m'ont envoyé la copie d'une lettre à Clodius
le Padouan, ou la nouvelle était donnée comme certaine. Philotime ajoute
que la guerre a de quoi durer longtemps encore: mais vous savez que
Philotime, c'est du Fulvius tout purs. Mandez-moi ce que vous en saurez,
et n'oubliez pas de me dire aussi ce qui en est du naufrage de Caninius.
589. —
A ATTICUS. Antium, juin.
A. XII, 47. Eh
bien! faites comme vous dites, et prenez votre temps. Vous pourrez
m'écrire jusqu'à deux fois. D'ailleurs j'irai moi-même, s'il le faut.
Consultez-vous. Parlez à Mustela, comme vous l'avez promis. Mais
l'affaire est bien difficile, et je n'en suis que plus disposé à revenir
à Clodia. Dans un cas comme dans l'autre, il est indispensable d'être
payé par Fabèrius. Il n'y aurait pas de mal que vous en dissiez quelque
chose à Balbus, et tout simplement ce qui en est ; que nous voulons
acheter ; que nous ne le pouvons pas sans l'argent que nous doit
Fabérius; que nous n'osons rien aventurer. Quand Clodia sera-t-elle à
Rome? Et à combien portez-vous ses prétentions? Voilà ce qui me tient en
suspens. Ce n'est pas que je ne préfère cette autre belle affaire. Mais
l'objet est lourd et la lutte difficile avec un concurrent ardent, homme
riche, et héritier. En fait d'ardeur, je ne le cède à personne, mais je
ne suis pas de force sur le reste. Nous en parlerons. Oui, répandez
l'écrit d'Hirtius. Ce que vous me mandez de Philotime est ce que j'en
pensais. Savez-vous bien que votre maison va gagner beaucoup, ayant
César pour voisin? J'attends aujourd'hui le retour de mon exprès. Il
m'apportera des nouvelles de Pilia et d'Attica.
590. —
A ATTICUS. Lanuvium près d'Antium, juin.
A. XII, 46.
Oui, j'en aurai, je crois, le courage : je quitterai Lanuvium et je
reverrai Tusculum. Comme tout en se modérant ma douleur restera
éternellement la même, je dois renoncer à jamais à Tusculum, ou
comprendre qu'il n'y a point de différence entre y aller aujourd'hui et
y aller dans dix ans. Je n'y trouverai pas plus qu'ailleurs ces images
cruelles qui me poursuivent jour et nuit, et qui me tuent. Mais quoi!
direz-vous, les lettres et vos études ne vous servent donc à lien? Hélas
! tout au contraire; et peut-être sans elles serais-je moins sensible.
Leur commerce anoblit le cœur, en lui ôtant sa rude écorce.
591. —
A ATTICUS. Tusculum, juin.
A. XII, 45. Je
viens d'achever ici deux longs traités. Le travail est pour moi le seul
moyen d'échapper à ma misère. Quand bien même vous n'auriez rien à
m'écrire, comme je le prévois, ne laissez pas que de le faire, ne
fût-ce que pour me dire : Je n'ai rien à vous mander : seulement
dites-le-moi en d'autres termes. Je suis charmé des nouvelles d'Attiea.
Mais je n'aime point cette langueur dont vous souffrez, quoique ce ne
soit rien, dites-vous. Je serai bien à Tusculum, pour avoir plus souvent
de vos lettres et pour vous voir quelquefois. A tous autres égards, le
séjour d'Asture me convenait mieux. Il y a des souvenirs qui
bouleversent, et ils sont ici mille fois plus poignants. Au surplus,
partout où je vais, mon mal me suit. — C'est d'après ce que vous me
mandiez que j'ai appelé César votre voisin. D'ailleurs j'aime mieux
qu'on l'ait logé avec Quirinus qu'avec la déesse Salus. Faites répandre
l'écrit d'Hirtius. Je suis tout à fait de votre avis; on rendra hommage
au talent de l'auteur. Mais l'idée d'attaquer Caton fera partout hausser
les épaules.
592. —
ATTICUS. Tusculum, juin.
A. XII, 48.
Vous vous trouvez bien de rester chez vous, je le crois sans peine :
mais dites-moi, je vous prie, ou vous en êtes et si vous avez fini. Je
vous attends positivement à Tusculum, puisque vous avez annoncé à Tiron
votre arrivée immédiate, en ajoutant que vous la croyiez nécessaire.
Quand vous étiez là près de moi, je sentais combien votre présence
m'était utile. Depuis votre départ, je le sens bien davantage encore.
Aussi j'en reviens à ce que j'ai dit : Ou chez vous ou chez moi, suivant
que le sort en décidera; mais nous ne pouvons être l'un sans l'autre.
593. —
A ATTICUS. Tusculum, juin.
A. XII, 49.
Hier, peu de temps après votre départ, des gens qui me parurent de bonne
mine vinrent me trouver de la part de C. Marius, fils de Caius,
petit-fils de Caius. Ils m'apportaient une lettre ou, dans un assez
long préambule, i! me demande au nom de nos liens de famille, au nom de
ce Marius que j'ai chanté, au nom de L.
Crassus, son éloquent aïeul, de consentir à plaider pour lui. Puis, il
entre dans l'exposé de son affaire. J'ai répondu qu'il n'avait pas
besoin de défenseur, étant parent de César, le meilleur et le plus
généreux des hommes, aujourd'hui tout puissant; que cependant je ne
lui ferai pas faute. — Quel temps que celui ou il peut arriver qu'un
Curtius ose songer au consulat! Je n'en dis pas davantage. Tiron
m'inquiète; mais je vais avoir de ses nouvelles, car j'ai envoyé hier
pour le voir. J'ai remis en même temps une lettre pour vous. Je vous ai
transmis ma lettre à César. Mandez-moi, je vous prie, pour quel jour la
vente des jardins est affichée.
594. — A ATTICUS. Tusculum, juin.
A. XII, 50. Autant j'ai eu de joie en vous voyant venir, autant j'ai de
peine depuis que vous m'avez quitté. Revenez-moi donc aussitôt que
possible, c'est-à-dire après que l'adjudication de Sextus n'exigera plus
vos soins. Un jour, un seul jour passé ensemble m'est si utile, et,
dirai-je aussi, m'est si doux ! J'irai à Rome rien que pour vous revoir
; mais il y a certaine chose sur laquelle je n'ai pas suffisamment
encore pris mon parti.
595. — A ATTICUS. Tusculum, juin.
A. XII, 51. Tiron m'est revenu plus tôt que je ne l'espérais. J'ai Nicias
aussi, et l'on m'annonce Valérius pour aujourd'hui. Voilà bien du monde
: eh bien 1 je serai plus seul que si je n'avais que vous; mais
l'affaire de Péducéus terminée, je vous attends; plus tôt même
peut-être, dites-vous. Oh oui, plus tôt; tâchez. Soit : parlez à
Virgilius; je voudrais seulement savoir à quand la vente.
Vous croyez donc que la lettre à César peut passer? Que vous dirai-je?
C'est aussi mon opinion, d'autant que je n'y ai rien mis qui ne soit
d'un bon citoyen, mais d'un bon citoyen allant selon le temps, et
suivant en cela le précepte de tous les écrivains politiques. Vous savez
que je regarde comme indispensable de la communiquer d'abord à
l'entourage. Veuillez vous en charger ; et si vous vous apercevez
qu'elle ne soit pas entièrement goûtée, ne l'envoyez point. Vous verrez
bien si leur approbation est naturelle ou feinte. Pour moi,
j'interpréterais l'hésitation comme un blâme; mais vous saurez bien
démêler le vrai. — En ce qui touche Cérellia, Tiron m'a dit votre pensée.
Il ne me convient pas, suivant vous, d'être son débiteur. Vous préférez
que je fasse un emprunt.
Il faut redouter l'un et ne pas craindre l'autre.
Nous en parlerons de
vive voix, ainsi que de beaucoup d'autres choses. Je crois pourtant
qu'il sera bon, sauf votre avis, d'ajourner le remboursement de Cérellia.
Il faut d'abord que je sache à quoi m'en tenir sur mes débiteurs Milon
et Fabérius.
596. — A ATTICUS. Tusculum. juin.
A. XII, 52. Vous connaissez L. Tullius Montanus, qui est parti
avec Cicéron. Je reçois une lettre du mari de sa sœur. Il parait que
Montanus est débiteur de Planeus, comme ayant garanti Flaminius pour
vingt-cinq mille sesterces. Je ne sais pas précisément ce que désire de
vous Montanus ; mais ne lui refusez pas, je vous en prie, ou de voir
Plancus, ou de le seconder de toute autre façon. J'y suis engagé par
devoir. Si vous en savez plus que moi, ou si vous croyez la démarche
près de Plancus faisable, faites-moi la grâce de me l'écrire. Il faut
que je sache ce qu'il en est, et quel est l'objet de cette démarche.
J'attends le résultat de vos soins pour ma lettre à César. Je ne tiens
pas aveuglément aux jardins de Silius, mais il faut que vous me fassiez
avoir ceux de Scapula ou de Clodia. Je ne comprends pas votre hésitation
au sujet de Clodia. Est-ce qu'elle ne vient pas à Rome, ou est-ce
qu'elle ne peut pas vendre? Que vient-on de «n'apprendre, que Spinther
divorce? Je vous parais donc bien hardi de traiter ce sujet en latin!
Songez que le fond est d'emprunt; ce qui diminue beaucoup le travail. Je
n'ai plus que les mots à trouver, et les mots sont toujours à mes
ordres.
597. — A ATTICUS. Tusculum, juin.
A. XII, 53. Je n'ai rien à vous écrire, et je ne laisse pourtant pas que
de le faire. Je crois causer avec vous. Nicias et Valérius sont ici.
J'attends une lettre de vous ce malin; peut-être en aurai-je une seconde
ce soir, si votre correspondance d'Épire ne vous en ôte pas la
possibilité, et je ne veux pas me mettre au travers. Je vous envoie des
lettres pour Marcianus et Montanus ; joignez-les à votre paquet, s'il
n'est pas encore parti.
598. — A ATTICUS. Tusculum, juin.
A. XIII, 1. Votre lettre à Cicéron offre un mélange .inimitable de
douceur et de sévérité. On ne pouvait mieux remplir mes intentions. Que
de sagesse aussi dans votre langage aux Tullius! Ou il leur profitera,
ou il faudra d'autres mesures. Je vois les bonnes dispositions que vous
allez prendre ou plutôt que vous avez déjà prises pour les
recouvrements. Si le succès les couronne, c'est à vous que je devrai mes
jardins.
Il n'y a pas, vous le savez, de genre de propriété que je préfère,
surtout à cause du motif qui me le fait rechercher. Vous m'ôtez bien du
souci en me donnant une espérance, je dirais même une assurance formelle
pour la belle saison. Je ne pourrais nulle part couler moins péniblement
ce qui me reste de jours. L'impatience de jouir me pousse quelquefois à
vous harceler. Puis je me retiens, car je sais que, lorsque vous me
connaissez un désir vif, votre impatience enchérit encore sur la mienne.
Tenez-vous pourtant pour harcelé. Que dit-on dans le parti de la lettre
à César? Nieios vous est attaché comme il le doit. Votre souvenir l'a
vivement ému. J'ai beaucoup d'amitié pour Peduceus. Il a remplacé son
père tout entier dans mon affection, et je l'aime à la fois pour
lui-même et pour le nom qu'il porte. C'est vous qui avez formé cette
liaison, et je vous en chéris davantage. Vous me ferez plaisir de donner
un coup d'œil à ces jardins. Tenez-moi aussi au courant de ce qui
concerne la lettre : ce me sera un sujet pour écrire. Dans tous les cas,
je vous écrirai; la matière ne me manquera jamais.
599. — A ATTICUS. Tusculum, juin.
A. XIII, 2. Mille grâces de votre empressement, qui me touche plus que la
chose même. Quelle indignité! Mais je suis fait à tout, et ma sensibilité
est épuisée. J'attends une lettre de vous. Des nouvelles? Non. Quelles
nouvelles en effet? Enfin,
peut-être Faites porter cette lettre à Oppius et à Balbus, et si vous rencontrez Pison, parlez-lui de, cet or. A l'arrivée
de Fabérius, ayez soin, s'il vous offre une assignation, qu'il me la
donne pour tout ce qu'il me doit. Vous recevrez ce qu'Éros vous
remettra. Ariarathes, fils d'Ariobarzane, est à Rome. Il vient sans doute
marchander quelque royaume à César. Au point où en sont les choses, il
n'a pas dans le sien de quoi reposer sa tète. Sextius, le pourvoyeur en
titre, s'est déjà emparé de sa personne. Je n'en suis pas jaloux.
Cependant je suis intimement lié avec les frères d'Ariarathes, à qui
j'ai rendu les plus grands services ; je lui écris pour lui offrir ma
maison. C'est pour ce motif que j'envoie Alexandre, et je le charge en
même temps de ma lettre. Demain, la vente de Péducéus. Venez donc
aussitôt que vous le pourrez ; peut-être Fabérius y fera-t-il obstacle,
mais enfin quand vous serez libre. Dyonisius jette les hauts cris, et
avec raison, de ce qu'on le tient si longtemps éloigné de ses élèves.
Il
m'a écrit une longue lettre, et sans doute vous en avez reçu une
pareille. Je crains que son absence ne se prolonge; ce serait à mon
grand déplaisir, car il me manque essentiellement.
|