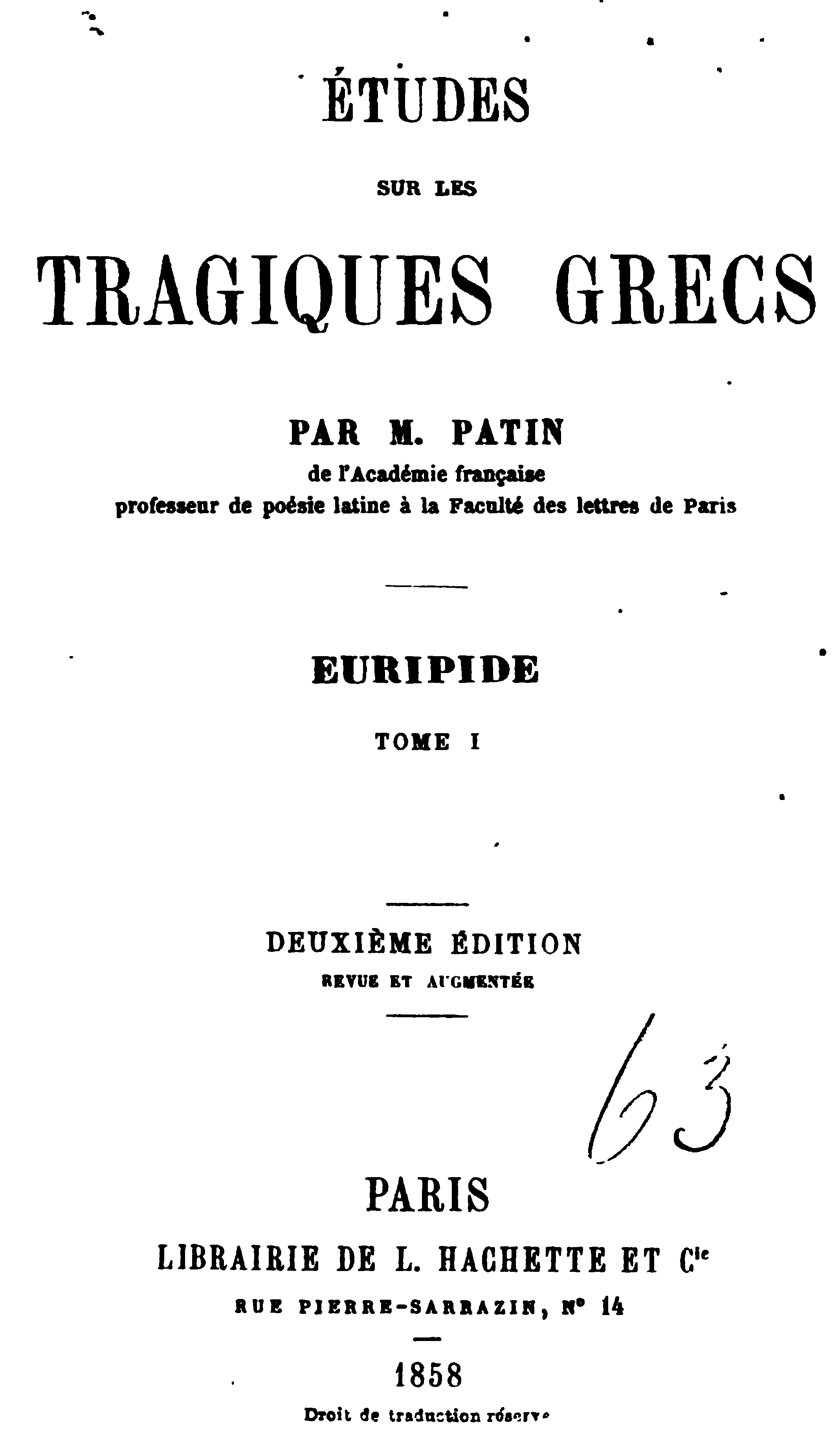
M. PATIN
ÉTUDES SUR LES TRAGIQUES GRECS
EURIPIDE. Tome I
CHAP. VII. ORESTE
CHAPITRE SEPTIÈME.
Oreste.
L'Oreste d'Euripide, l'un de ses derniers ouvrages, le dernier qu'il ait donné à Athènes (il fut joué sous l'archonte Dioclès, la quatrième année de la CXIIe olympiade, en 409 (01) ), représente le meurtrier de Clytemnestre, non pas , comme tant d'autres pièces anciennes et modernes, au moment de son parricide, mais lorsqu'il l'a déjà commis , dans la situation terrible et douloureuse où l'a placé, vis-à-vis des hommes et de lui-même , un acte de vengeance si légitime et si criminel.
La même idée avait déjà inspiré, au premier âge de la tragédie grecque, l'imagination d'Eschyle, et y avait produit , tout le monde se le rappelle, le drame célèbre des Euménides. Il est curieux de voir comment, à une époque plus récente, Euripide l'a renouvelée.
Rien de si divers que les deux ouvrages , et cette diversité n'est point accidentelle; c'est le résultat nécessaire des révolutions survenues dans l'art, comme du génie particulier de l'un et de l'autre poète.
Eschyle, par suite de cette préoccupation religieuse, qui était aussi celle de son temps, et qui possédait alors, au théâtre, auteurs et spectateurs, avait exprimé son sujet sous des formes toutes merveilleuses; sous le personnage d'Apollon, le dieu de la jeunesse et de l'énergie passionnée qu'elle inspire, les saints et pressants motifs qui poussèrent le parricide; sous celui des Furies, les
justes remords qui suivirent son attentat; enfin, sous l'image d'une cause portée au tribunal de la sagesse suprême, de Minerve elle-même, et que l'égalité des suffrages y laisse pourtant indécise, l'insoluble question de son innocence.Lorsque le merveilleux, usé par un long emploi et sans doute aussi par la curiosité philosophique des esprits, commençait à disparaître de la scène, Euripide ramena ce même sujet qu'Eschyle avait entouré d'une sorte de grandeur surnaturelle, à des proportions tout humaines. Cette lutte engagée auparavant, pour le fait d'un mortel, entre les puissances du ciel et des enfers, n'eut plus d'autres acteurs que les passions, d'autre théâtre que le cœur du coupable ; les Furies ne parurent plus que dans son imagination troublée. On eut à la place le spectacle plus réel de la conscience, qui, dans un doute pénible, s'absout et s'accuse tour à tour; qui reconnaît avec effroi, avec désespoir, jusqu'où l'ont égarée de trompeuses lueurs de justice et de piété; qui, par les tortures auxquelles elle est livrée, rompt l'harmonie des facultés humaines , et détruit, avec la raison et l'intelligence, le corps qui les renferme.
Le remords, voilà l'idée première des deux compositions : mais là elle revêtait l'apparence symbolique des antiques croyances ; ici, elle s'en dépouille, et paraît sous les traits naturels offerts à l'observation. Le tableau tracé par Eschyle est fantastique, gigantesque, effrayant ; celui d'Euripide, plus près de nous, est d'un inexprimable pathétique.
Ce n'est pas que le mérite de ces productions, marquées de caractères si opposés , se balance exactement. L'auteur des Euménides l'emporte incontestablement sur son rival par l'unité du dessein, la force de la conception. L'auteur d'Oreste ne peut opposer à de tels avantages que la beauté, merveilleuse il est vrai, de quelques scènes ; il manque de progression et d'ensemble ; et déjà nous voyons paraître sur son théâtre des défauts que nous n'avions encore qu'entrevus dans des ouvrages plus parfaits, l'incertitude du but, l'inconstance et la multiplicité des intentions et des effets, l'imprévoyance aventureuse et étourdie de la composition, une verve inégale, qui s'anime ou qui tombe capricieusement et laisse trop souvent à l'émotion et à l'intérêt de ces moments de relâche dont profite, contre le poète et son œuvre, la froide critique.
Quoi qu'on puisse reprocher à la tragédie d'Oreste pour la conduite de l'action, le développement des caractères , le choix de quelques pensées, la recherche de certaines peintures, ce n'en est pas moins, dans plusieurs parties, une pièce d'un effet frappant. Ainsi en jugeaient les anciens , qui, tout en blâmant sans ménagement les imperfections qui la déparent, ont toutefois assez montré, par les fréquentes mentions qu'ils en ont faites (02), quelle place elle occupait dans leur souvenir.
Elle a pour nous un attrait particulier : c'est d'elle que nous est venu l'Oreste moderne. Les traits dont l'a peint Racine, cette jeunesse dévouée au crime et flétrie par le malheur, cette âme blessée et souffrante, qu'arrachent par intervalles à sa langueur les emportements de la passion, cette faiblesse, si j'ose le dire, si énergique et si forcenée, tout cela semble un souvenir de l'Oreste d'Euripide.
Ce dernier est quelque chose de plus; le poète grec n'a pas craint de le représenter malade. La nuit qui suivit son parricide, tandis qu'il veillait près du bûcher de sa mère pour garder ses ossements et lui dresser une tombe, au milieu de ces funèbres soins , un mal étrange s'est tout à coup emparé de son esprit et de son corps. Ce sont des visions effrayantes, des transports frénétiques qui l'agitent et l'épuisent. Depuis six jours qu'il est en proie à ce supplice, il n'a point pris de nourriture, n'est point entré dans le bain ; il est resté étendu sur un lit à la porte du palais ; c'est là qu'Euripide nous le montre dans un moment de calme et de sommeil que lui ont laissé ses souffrances.
Près de lui est sa sœur Électre, qui a pris part au crime et en partage aussi les misères. Tandis qu'il repose , elle repasse en son esprit les malheurs de sa race parvenus à leur comble ; car le peuple d'Argos, indigné contre les meurtriers, leur a interdit l'eau et le feu ; nul ne peut les recevoir ni leur parler, et le jour est venu où l'on doit délibérer sur leur supplice. Un seul espoir leur reste ; Ménélas leur oncle vient d'aborder au port de Nauplie ; on l'attend au palais d'Argos, où Hélène l'a précédé pendant la nuit (03), pour éviter les regards et les insultes du peuple. Tous ces faits de l'avant-scène sont, à la manière d'Euripide, exposés dans un prologue (04), nécessairement un peu froid , mais que ranime le tableau touchant qui s'offre aux yeux , et qui a fourni à la statuaire et à la peinture plus d'une heureuse inspiration ; celui de ce malheureux, assoupi sur son lit de douleur, et de sa sœur, assise à son chevet, et protégeant son sommeil. C'est toujours ce même génie d'artiste qui s'adresse aux sens en même temps qu'à l'esprit, et, dès le début, s'applique à les captiver à la fois.
Hélène, qui nous a été tout à l'heure annoncée , vient trouver Électre. Après quelques paroles de pitié données au souvenir de Clytemnestre, quelques consolations adressées aux enfants d'Agamemnon, elle la prie d'aller, en son nom, vers le tombeau de sa sœur, pour y déposer les prémices de ses cheveux et y répandre des libations. Si elle ne s'acquitte pas elle-même de ce devoir religieux, c'est qu'elle n'ose paraître en public, aux yeux de ceux dont les fils sont morts pour elle sous les murs de Troie. Électre se montre, avec raison, blessée de l'étrange demande qui lui est faite, et qui semble un reproche indirect de son parricide; elle s'en venge par des allusions assez amères aux égarements d'Hélène. La scène se termine par le conseil qu'elle lui donne, et lui fait agréer, de charger de son offrande sa fille Hermione, nourrie par Clytemnestre, et à qui semble mieux convenir cet office de piété et^de reconnaissance.
Ces détails, qui rappellent avec infériorité de belles situations d'Eschyle et de Sophocle (05), ne sont certainement pas étrangers à la pièce dont, comme nous le verrons tout à l'heure, ils préparent le dénouement ; mais n'y a-t-il pas quelque chose de peu conforme à son caractère sombre et touchant, dans cet entretien de deux femmes qui, sous des dehors obligeants, cachent une intention blessante et cruelle? Euripide, en cet endroit, comme en bien d'autres, ne s'est-il pas laissé entraîner, aux dépens de la terreur et de la pitié, par le penchant qui le portait à l'expression satirique des mœurs, à ce qui devait bientôt, entre les mains de Ménandre, produire la comédie ? N'éprouve-t-on pas une surprise désagréable, lorsque, si près du parricide, entre le tombeau de la mère et le lit de douleur du fils, l'imagination remplie de lugubres et tristes images, on entend Électre, restée seule, remarquer, avec une malice ingénieuse, qu'Hélène, en coupant, par un semblant de devoir, seulement l'extrémité de ses cheveux, a pris soin de ménager sa beauté (06) ? Ces représentations d'une coquetterie raffinée, d'un commerce sans franchise et sans indulgence, si spirituelles et même si vraies qu'elles puissent être, ne détournent-elles pas le spectateur des émotions véritables du drame, de celles qu'il avait déjà fait naître et qu'il promettait?
On retrouve quelque chose de cette intention maligne dans la scène suivante, mais sans qu'on doive s'en trop formaliser, car elle ne porte que sur cette vivacité d'émotions, sur ce penchant à les produire au dehors par le discours, que de temps immémorial les hommes sont en possession de reprocher aux femmes. Cette satire innocente est d'ailleurs fort légèrement indiquée, avec une délicatesse exquise qui n'ôte rien au charme attendrissant de la situation. C'est un des défauts les plus ordinaires d'Euripide, que de mêler ainsi dans ses œuvres, non pas des peintures qui contrastent et ressortent par l'opposition, ce qui est un des triomphes de l'art, mais des effets contradictoires que détruit leur rencontre. Enclin à la censure de nos travers, et s'attachant de préférence à surprendre et à divulguer ceux des femmes, il s'est rarement refusé ce plaisir indiscret, et dans ses compositions les plus pathétiques , les plus tragiques, a presque toujours ménagé une place au portrait épigrammatique du sexe.
De jeunes Argiennes dont se compose le chœur, des compagnes, des amies d'Électre viennent auprès d'elle pour la consoler et s'informer de son frère. Électre répond à leurs questions empressées, à leurs tendres discours , et, dans sa sollicitude inquiète pour celui qu'elle veille, elle interrompt à chaque instant l'entretien par la recommandation, presque aussitôt oubliée, de ne point trop élever la voix, de ne point faire de bruit en marchant, de ne point troubler le sommeil si rare et si court du malheureux Oreste. Rien n'égale, même sur le théâtre grec, une telle naïveté de mœurs; nous sommes vraiment introduits, comme le dit fort bien Brumoy, dans une chambre de malade. Mais ce malade est Oreste, le parricide Oreste , et le poète, avec cette habileté de préparation que nous avons souvent louée chez lui comme chez ses devanciers, ne prodigue ces détails familiers, que pour nous faire plus impatiemment désirer le moment terrible de son réveil. C'est ainsi que ces génies faciles et flexibles prenaient tous les tons et passaient sans effort de ce qu'il y a de plus simple, et, le dirai-je? de plus ordinaire, à l'accent le plus relevé que puisse faire entendre la muse tragique.
Cette variété, ce mélange pleins de vérité, qui sont un des traits caractéristiques de la tragédie grecque, ne s'y montrent nulle part, peut-être, sous un jour aussi frappant que dans la scène justement célèbre à laquelle me conduit le cours de mon analyse. Je l'ai traduite en entier, mais je ne me flatte pas d'en avoir pu conserver entièrement le pathétique et surtout le naturel, malgré mon application et l'aide souvent utile de Brumoy et de Prévost.
Oreste s'éveille et s'écrie :
Toi, qui charmes les sens, qui apaises la souffrance, dons sommeil, que tu m'es venu à propos dans ma détresse ! Oubli des maux ! dieu bienfaisant ! que ton secours a de puissance, qu'il semble désirable aux infortunés !... Mais, où étais-je donc, et comment me trouvé-je en ce lieu ? Je ne sais plus ce que j'ai fait dans mon égarement.
ÉLECTRE.
Cher Oreste! avec quelle joie je t'ai vu t'assoupir ! Veux-tu que je t'aide à te soulever ?
ORESTE.
Oui, soutiens, soutiens-moi : essuie en même temps sur mes tristes lèvres, sur mes yeux, cette épaisse écume.
ÉLECTRE.
Oh ! c'est un doux office, et la main d'une sœur ne refusera pas
ses soins au corps affligé d'un frère.
ORESTE.
Approche-moi de ton sein ; ces cheveux desséchés et poudreux, écarte-les de mon front : à peine un faible jour me luit.
ÉLECTRE.
Pauvre tête, si échevelée, si défaite, que depuis si longtemps l'eau n'a point rafraîchie, comme ton aspect est devenu sauvage !
ORESTE.
Remets-moi sur mon lit : quand ce mal, quand cette fureur me quitte, je demeure brisé et sans force.
ÉLECTRE.
Oui, repose sur ton lit : le lit est cher au malade; c'est un séjour bien triste, mais nécessaire.
ORESTE.
Redresse mon corps, relève-moi...
ÉLECTRE.
Si tu essayais de poser tes pieds à terre et de faire doucement quelques pas? Changer paraît si bon!
ORESTE.
Sans doute : c'est l'apparence de la santé, et l'apparence est quelque chose où la réalité manque.
ÉLECTRE.
Écoute-moi maintenant, mon frère, tandis que les Furies te laissent maître de tes sens.
ORESTE.
As-tu quelque chose à m'apprendre? Si c'est une nouvelle heureuse, ah ! tu me charmes, et me ranimes. Sinon, j'ai bien assez de malheurs.
ÉLECTRE.
Ménélas arrive, Ménélas, le frère de ton père. Ses vaisseaux sont déjà dans le port de Nauplie.
ORESTE.
Qu'as-tu dit? Il arrive ! O lumière imprévue au milieu de mes maux et des tiens ! Un homme de notre sang, comblé des bienfaits de notre père !
ÉLECTRE.
Il vient, n'en doute pas ; et, pour preuve, sache qu'il ramène Hélène des murs de Troie.
ORESTE.
S'il eût échappé seul, je le trouverais plus digne d'envie. Revenir avec une telle épouse, c'est revenir chargé d'un funeste fardeau.
ÉLECTRE.
Tyndare a mis au jour des filles d'une bien triste renommée, bien malheureusement célèbres dans la Grèce.
ORESTE.
Toi donc, fuis, ta le peux, leurs exemples pervers. Qu'ainsi que tes paroles, ton cœur soit toujours pur.
ÉLECTRE.
Mon frère, ton œil se trouble : tout à l'heure plein de sens, tu passes tout à coup aux transports de la rage (07).
ORESTE.
Je t'en conjure, ô ma mère, ne lance point contre moi ces femmes aux yeux sanglants, à la tête hérissée de vipères. Les voilà, les voilà, qui bondissent à mes côtés.
ÉLECTRE.
Reste, infortuné, en repos , sur ta couche. Tu ne vois rien de ce que tu crois voir.
ORESTE.
O Phébus, ils me tueront, ces chiens dévorants, ces êtres hideux et farouches, ces prêtresses des morts, ces terribles déesses !
ÉLECTRE.
Je ne te quitte point : je veux t'entourer de mes bras, et contenir ces élans furieux.
ORESTE. Loin de moi, Furie, qui me tiens embrassé, pour me précipiter au Tartare (08).
ÉLECTRE. Malheureuse ! quel secours attendre, quand les dieux sont contre nous ?
ORESTE.
Donne-moi l'arc (09), présent d'Apollon, l'arc qu'il me remit pour repousser ces déesses , si elles venaient m'épouvanter de leur rage insensée.
ÉLECTRE.
Crois-tu qu'une main mortelle puisse atteindre des déesses?
ORESTE.
Oui, si elles ne se dérobent à mes yeux. Quoi ! vous n'entendez pas, vous ne voyez pas les traits ailés, partis de mon arc infaillible? Eh bien, qu'attendez-vous? prenez votre vol dans les airs, et allez, au lieu de moi, accuser Phébus et ses oracles. Hélas! pourquoi suis-je donc si épuisé, si haletant? Où m'égaré-je loin de ma couche ? Du sein des flots et de l'orage, je vois renaître le calme (10). Qu'as-tu , ma sœur? tu pleures ; tu caches ta tête dans tes voiles! Al, ! je rougis de t'associer à mes peines, de te faire partager, pauvre jeune fille, les ennuis de ma maladie. Cesse de te consumer ainsi pour des infortunes qui sont les miennes. Si tu as consenti au meurtre d'une mère, c'est moi qui l'ai commis. Que dis-je ? c'est Apollon que je dois accuser, lui qui, après m'avoir poussé à cet acte impie , m'a consolé de vaines paroles, et puis laissé sans secours. Mon père même, je n'en doute pas, si j'eusse pu l'interroger en face, et lui demander, faut-il tuer ma mère ? mon père eût étendu vers moi des mains suppliantes , et , avec d'instantes prières, il m'eût conjuré de ne point porter le couteau dans le sein qui m'enfanta , puisque, sans lui rendre le jour, je devais par là combler ma misère. Et, maintenant, ma sœur, découvre ton visage; sors de ces larmes, où tu te plonges, quel que soit notre triste sort. Lorsque tu me vois hors de moi-même, c'est à toi de calmer mes fureurs, de rappeler ma raison qui s'égare : et moi, quand tu gémis, je dois être là , près de toi, pour te consoler, pour te reprendre tendrement. Un tel échange de soins sied bien à l'amitié. Va donc , infortunée, rentre dans le palais , livre au sommeil tes paupières fatiguées d'une longue insomnie, baigne-toi, prends quelque nourriture. Si tu venais à me manquer, si par une veille trop assidue tu te rendais malade à ton tour, ah ! je serais perdu ; car je n'ai plus que toi pour me secourir, abandonné, tu le vois, de tout le reste.
ÉLECTRE.
Non, non. Avec toi je veux mourir, avec toi je veux vivre. Pour moi c'est même chose. Eh ! si tu meurs, que pourrai-je faire, que deviendrai-je, faible femme, seule au monde, sans frère, sans père, sans amis? Mais, tu le veux ; il faut t'obéir. Étends seulement sur ta couche tes membres fatigués ; ne te laisse pas trop facilement surprendre à ces terreurs qui t'en arrachent; demeures-y paisiblement. Lorsqu'on n'est pas malade, mais qu'on croit l'être, on ressent tout le trouble, toute la fatigue de la maladie (11).
Quelque clairement que s'expliquent à l'esprit de telles beautés, qu'il me soit permis, dans l'intérêt du sujet que je traite, de les reprendre avec quelque détail. Cette scène, par la nature du sentiment et du langage, la conduite du dialogue, la disposition des tableaux, est comme un abrégé du génie tragique des Grecs, et suffirait presque à son étude.
Les premiers vers d'Oreste, lorsque s'éveillant il fait l'éloge du sommeil (12), ont été imités par Ovide (13) et Sénéque (14) et cités par Plutarque (15). Ils étaient dignes de ce double hommage pour leur expression, leur harmonie véritablement ravissantes. Ce que nous y devons surtout remarquer, c'est le mérite dramatique d'une maxime générale présentée sous la forme d un mouvement passionné.
Ce mérite, on le sait, n'est pas toujours celui d'Euripide, qui prodigue trop les sentences, et a, parce dangereux exemple , autorisé l'intempérance philosophique des tragédies de Sénèque.
Rien de plus conforme à la vérité que l'ordre dans lequel se succèdent les pensées d'Oreste. Il s'abandonne d'abord tout entier au sentiment de son bien-être; puis il s'étonne en voyant où il est, et en cherchant vainement dans sa mémoire comment il y est venu. Peu à peu, ses souffrances assoupies se réveillent, et en même temps reparaissent les ennuis inquiets, les vœux inconstants de la maladie. Tout cela est d'une vérité bien vive, d'une familiarité bien hardie. Hardie, non pas pour les Grecs qui ne rougissaient point de la nature et ne croyaient point que ses faiblesses les plus vulgaires fussent indignes de l'art; mais pour nous, que la politesse et la dignité de nos mœurs sociales ont rendus malheureusement plus délicats. Je m'imagine qu'un héros endormi ou souffrant dont on répare le désordre, dont on soulage la faiblesse, que l'on relève, que l'on recouche, que l'on aide à marcher, nous eût paru longtemps un objet fort étrange. Du moins lui eût-on prêté , et peut-être lui prêterait-on encore, des douleurs plus vagues, des plaintes plus générales , un maintien de malade plus majestueux, l'appareil d'un lit de parade. Brumoy, qui admire beaucoup cette scène et la loue avec chaleur, ne s'est-il pas avisé d'ennoblir la couche d'Oreste et d'en faire, quoi! un canapé! Singulier ennoblissement qui me rappelle que, dans l'analyse d'une autre pièce d'Euripide (16) où paraît ce même Oreste, il le fait arriver d'un voyage avec ses malles (17).
Pourquoi cependant une telle peinture, par cela seul qu'elle est naïve et familière, serait-elle déplacée sur une scène où l'on a traduit avec tant de charme le tableau à peu près semblable de la défaillance et du trouble de Phèdre? Pourquoi n'y souffririons-nous pas ce qui nous paraît si touchant, si gracieux dans des vers d'André Chénier, tout remplis du souvenir et de l'inspiration des Grecs (18)?
Jusqu'ici le poète s'était borné à l'expression de la nature la plus générale : ce n'étaient ni Oreste, ni Électre, mais un jeune homme malade, une sœur dévouée. Des traits plus particuliers, plus individuels, nous montrent maintenant les enfants d'Agamemnon. On ne peut trop louer la transition habile qui amène la peinture de l'égarement et de la frénésie d'Oreste. Électre profite de ces courts instants de relâche où ses sens se calment, où sa raison s'éclaircit, pour lui apprendre la nouvelle heureuse du retour de Ménélas ; mais elle lui parle aussi du retour d'Hélène, et ce nom le rappelle aussitôt au souvenir de Clytemnestre, aux horribles images de son parricide, à ses effrayantes visions, à ses furieux transports.
Le tableau est court, mais plein de mouvement et de vie, et ici, comme dans tout le reste de la scène, par un artifice dont l'usage est continuel chez les tragiques grecs, les paroles peignent aux yeux l'expressive pantomime qui devait les animer. Elles ne peignent pas avec moins de vivacité ce qui ne peut se retracer qu'à l'imagination. Longin (19) en a cité et commenté quelque chose :
« Mère cruelle, arrête, éloigne de mes yeux
Ces filles de l'enfer, ces spectres odieux.
Ils viennent ; je les vois ; mon supplice s'apprête.
Quels horribles serpents leur sifflent sur la tête (20)!
....................................................
Le poète ne voyait pas les Furies : cependant il en fait une image si naïve , qu'il les fait presque voir aux auditeurs. Et, véritablement, je ne saurais pas bien dire si Euripide est aussi heureux à exprimer les autres passions : mais pour ce qui regarde l'amour et la fureur, c'est à quoi il s'est étudié particulièrement, et il y a fort bien réussi. Et même, en d'autres rencontres, il ne manque pas quelquefois de hardiesse à peindre les choses; car, bien que son esprit de lui-même ne soit pas porté au grand, il corrige son naturel et le force d'être tragique et relevé, principalement dans les grands sujets : de sorte qu'on peut lui appliquer ces vers du poète :
A l'aspect du péril au combat il s'anime,
Et, le poil hérissé, les yeux étincelants,
De sa queue il se bat les côtés et les flancs (21).
Euripide, dans un de ses deux Alcméon (22) , nous le savons par quelques restes de l'Alcméon qu'en imita sans doute Ennius (23), avait peint un autre parricide en proie aux mêmes égarements, poursuivi par les mêmes visions ; ce qui complète la ressemblance, il l'avait fait assister, consoler également par une jeune fille, qu'on peut supposer, d'après un récit romanesque et intéressant d'Apollodore (24), sa propre fille à lui inconnue et devenue même son esclave. L'énergie des images dans les rudes vers d'Ennius donne à penser que Longin eût pu citer ici l'Alcméon d'Euripide, aussi bien que son Oreste.
Un autre mérite me frappe dans ces figures si vives, c'est qu'elles ne sont pas jetées au hasard, mais ordonnées , enchaînées : elles s'éveillent l'une l'autre dans l'imagination d'Oreste, et quelques-unes paraissent appelées par ce qui parvient, sinon à son esprit, du moins à son oreille, des paroles d'Électre. Ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, lorsque, essayant en vain de contenir les transports de son frère, elle s'écrie dans son désespoir : « Malheureuse ! quel secours attendre, si les dieux sont contre nous? » frappé confusément de cet appel à la protection divine et l'interprétant dans le sens de ses visions, il demande l'arc d'Apollon pour chasser les Furies. Cette liaison secrète , qui se cache sous une apparence de confusion et de disparate, est ce que j'appellerais la logique du délire, logique bien peu connue des modernes, bien peu respectée dans ces lieux communs qu'en style de coulisses et de feuilletons on appelle des fureurs, et où le trouble des sens et de l'intelligence est d'ordinaire rendu par une incohérence continue et complète , aussi fausse qu'elle est facile et vulgaire ; logique au contraire toujours suivie chez les tragiques grecs, et dont ils se sont transmis le secret par une sorte de tradition : on la retrouve constamment la même dans leurs productions successives , depuis Eschyle, qui a soumis à ses lois les inspirations prophétiques de sa Cassandre, jusqu'à Sophocle et à Euripide, qui l'ont appelée à régler l'égarement désordonné l'un de son Philoctète, de son Hercule, l'autre de sa Phèdre, de son Oreste, ce qui semblait le plus rebelle à toute règle, à toute loi, les mouvements tumultueux, l'expression délirante de l'extase, de la souffrance, de la passion, de la folie. Ils savaient, ces observateurs attentifs, ces peintres fidèles de la nature, qu'il n'y a point de lacunes dans la pensée humaine ; que, si brusque, si arbitraire , si bizarre que puisse paraître la rencontre des idées qu'elle associe, elle passe toujours de l'une à l'autre par une marche, peu visible sans doute, mais dont la réflexion peut retrouver, dont l'art doit indiquer la trace.
Vers la fin de cette admirable scène, qui, par le nombre et la variété de ses beautés , fournirait presque à la critique une matière inépuisable, il se fait une révolution imprévue, une péripétie soudaine de sentiments. Oreste, jusqu'ici secouru par sa sœur, vient lui-même à son aide, et lui rend tendrement les consolations qu'il en a reçues. Je ne crois pas que l'amitié fraternelle ait jamais brillé au théâtre d'un jour plus doux et plus touchant ; la sombre destinée de ces deux malheureux en est un instant éclairée; ils se disent, en d'autres termes, ce qui se trouve si bien exprimé dans ce vers dont je ne sais plus l'auteur :
Nous souffrons, mais unis ; nous mourons, mais ensemble ;
ce que Ducis a rendu avec tant d'éloquence dans ce passage de son rôle d'Antigone (25) :
Vos ennuis sont les miens, ma douleur est la
vôtre.
Nous seuls, nous nous restons, consolés l'un par l'autre.
L'univers nous oublie : ah! recevons du moins,
Moi, vos tristes soupirs, et vous, mes tendres soins.
C'est un des plaisirs les plus exquis du spectacle tragique , que cette émotion indécise où nous jettent, par leur contraste , l'horreur d'une situation désespérée, et la secrète douceur des affections qui s'y développent. Le malheur nous semble alors adouci par ce plaisir douloureux mêlé à son amertume, et nous trouvons à le contempler un charme mélancolique qu'on ne peut rendre.
Il y a peu de mouvements aussi rapides, aussi inattendus que ceux par lesquels Oreste se charge seul du crime que sa sœur a partagé, puis le rejette sur Apollon qui l'a prescrit, et enfin se représente son père, interrogé par lui sur cet attentat, et s'efforçant, avec de vives prières, de l'en détourner. Cette dernière idée se retrouve , par un hasard singulier, mise en action dans l'Hamlet de Shakespeare. On se rappelle la scène où la mère et le fils s'expliquent sur le crime qui les sépare, l'un frémissant de fureur, l'autre palpitante d'effroi. Entre eux paraît tout à coup le spectre du mort qui vient rappeler à la mémoire d'Hamlet ses commandements sévères, et en même temps, par un mouvement de pitié, étrange en un tel personnage et qui remue profondément, en excepte cette femme, si coupable, mais si malheureuse.
« Regarde, dit-il, ta mère est en proie à l'égarement. Ah ! place-toi entre elle et son âme agitée : c'est dans un faible corps que l'imagination agit le plus fortement. Parle-lui, Hamlet (26). »
Un si long commentaire n'a pas épuisé tous les mérites de la scène qui nous occupe. Il me reste à faire remarquer, dans les vers par lesquels elle se termine, un passage d'une grande délicatesse. Oreste veut renvoyer sa sœur pour qu'elle prenne quelque repos, quelque nourriture ; mais il prévoit un refus, et, affectant l'égoïsme, il la presse de se conserver pour lui, qui ne peut se passer d'elle. Électre a compris le tendre détour de son amitié; elle répond à sa pensée plutôt qu'à ses paroles, et déclare que rien ne la séparera du sort d'un frère. Cette secrète intelligence de deux âmes qui s'entendent et ne peuvent se tromper est rendue avec la plus grande simplicité, sans qu'aucun mot paraisse destiné à la confidence d'une beauté si fine. Une telle réserve, fréquente dans les productions du théâtre antique, fait un honneur égal au génie vrai du poète et à la prompte intelligence du public athénien. Nous avons, nous autres modernes, un plus grand besoin d'être avertis ; nos auteurs craignent davantage que leurs intentions ne soient pas comprises ; trop souvent les personnages de notre scène joignent à leurs sentiments et à leurs actions une note explicative pour l'instruction du spectateur, et disent comme le héros orgueilleusement modeste de de Belloy :
Admirez de Bayard l'abaissement auguste (27) !
ou, pour citer un exemple plus concluant, comme le César de Voltaire :
Permettez que César ne parle point de loi (28).
Ne soyons pas, toutefois, injuste envers notre théâtre, en lui refusant entièrement le genre de beauté que nous louons chez Euripide, et n'oublions pas surtout de rappeler qu'il se trouve heureusement reproduit par Racine, dans ce dialogue de l'Andromaque :
ORESTE.
...................................
Mais toi, par quelle erreur veux-tu toujours sur toi
Détourner un courroux qui ne cherche que moi ?
Assez et trop longtemps mon amitié t'accable.
Évite un malheureux, abandonne un coupable.
Cher Pylade, crois-moi, ta pitié te séduit
Laisse-moi des périls dont j'attends tout le fruit.
Porte aux Grecs cet enfant que Pyrrhus m'abandonne.
Va-t'en.
PYLADE.
Allons, seigneur, enlevons Hermione (29).
Je revient à la scène grecque : elle finit comme elle avait commencé , par les conseils, les recommandations, qu'on me passe le mot, de garde-malade attentive, qu'Électre adresse à son frère en le quittant. Ainsi, l'expression terrible et déchirante du remords , la peinture touchante et élevée de la tendresse et du dévouement fraternels, sont comme encadrées dans ces mœurs naïves et familières, prises de la nature commune. Ces personnages héroïques, choisis pour représenter les plus nobles traits de l'humanité, ont été tirés de la foule, et, leur rôle rempli , retournent s'y confondre. L'esprit de l'art tragique fut toujours , chez les Grecs , d'unir ainsi la réalité à l'idéal et, par l'habile proportion du mélange, d'ajouter à l'une de la grandeur , à l'autre de la vraisemblance.
Le reste de la tragédie d'Oreste , fort inférieur à cette scène d'élite, nous arrêtera moins longtemps. Toutefois, dans les scènes suivantes , se rencontrent encore de grandes beautés.
Après un chant du chœur, qui implore pour Oreste le pardon des Furies, Ménélas arrive, et salue tristement ce palais, dont la vue lui rappelle de si affreux événements, la mort d'Agamemnon , dont il fut informé dans le cours de son voyage, la mort de Clytemnestre, qu'il vient d'apprendre à l'instant. Il demande qu'on lui montre ce meurtrier d'une mère , qu'il laissa enfant dans ses bras , en partant pour Troie , et qu'il ne pourrait reconnaître. Oreste alors se soulève de sa couche, et vient tomber à ses pieds :
ORESTE.
Le voici, Ménélas, cet Oreste que tu cherches....
MÉNÉLAS.
Dieux ! que vois-je? quelle ombre s'offre à mes regards ?
ORESTE.
Tu dis vrai : je ne vis plus, infortuné ! quoique je voie encore le jour.
MÉNÉLAS.
Quel sauvage aspect ! quels cheveux hérissés et souillés de poussière ! ah ! malheureux !
ORESTE.
Ce ne sont point ces tristes dehors , ce sont mes actions qui font mon supplice.
MÉNÉLAS
Quels effrayants regards lancent tes yeux ardents et desséchés !
ORESTE.
Ce corps n'est plus : un vain nom, voilà ce qui me reste.
MÉNÉLAS.
O étrange, horrible vue!
ORESTE.
Tu vois ce fils d'une malheureuse mère, ce meurtrier.. .
MÉNÉLAS.
Je sais tout. Épargne-toi un si funeste récit.
ORESTE.
Je me tais ; mais le destin est pour moi prodigue de misères.
MÉNÉLAS.
Qu'éprouves-tu? quel mal te consume?
ORESTE.
La conscience. Je sais quel acte j'ai commis.
............................
MÉNÉLAS.
Quand ces fureurs ont-elles commencé? en quel jour?
ORESTE.
En ce jour où j'élevai le tombeau de ma déplorable mère.
MÉNÉLAS.
Étais-tu dans le palais, ou bien près du bûcher?
ORESTE.
Il faisait nuit : je veillais sur ses ossements.
MÉNÉLAS.
N'avais-tu personne avec toi, pour soutenir ton corps abattu?
ORESTE.
Pylade y était, Pylade qui eut part au meurtre et au sang de ma mère.
MÉNÉLAS.
Et quels sont ces fantômes qui t'assiègent?
ORESTE.
Je crois voir trois filles semblables à la Nuit (30).
MÉNÉLAS.
Je sais qui tu veux dire, mais je ne prononcerai pas leur nom (31).
Cette sombre et terrible explication se continue, et développe aux yeux de Ménélas toute l'horreur du sort d'Oreste, abandonné des dieux qui l'ont poussé au crime, poursuivi par les ennemis d'Agamemnon , par les amis d'Êgisthe, et qui, dans ce jour où un jugement public doit prononcer son arrêt de mort, n'a plus de ressource ni d'espoir que dans le parent qu'il implore. En ce moment le chœur annonce l'arrivée du vieux Tyndare, le père de Clytemnestre, la tête rasée, et couvert d'habits de deuil. A sa vue , Oreste se sent saisi de honte et d'effroi ; ses paroles sont pleines du trouble le plus dramatique :
« Je suis perdu, Ménélas : c'est Tyndare qui s'approche, Tyndare, de qui surtout je redoute les regards, après ce que j'ai fait. Il éleva mon enfance, me couvrant de ses baisers, se plaisant à porter dans ses bras le fils d'Agamemnon : Léda en faisait de même, et tous deux me chérissaient à l'égal des fils de Jupiter. Hélas ! malheureux que je suis ! pensée qui déchire mon cœur ! de quel retour j'ai payé leurs soins ! N'est-il point de ténèbres où cacher mon visage? point de nuage devant moi, pour me dérober aux yeux de ce vieillard (32) ? »
La scène qui suit est digne de cette annonce véhémente. Tyndare a quitté le tombeau de Clytemnestre, où il répandait des libations funèbres, pour venir en hâte saluer Ménélas , dont on lui a annoncé l'arrivée. Il s'indigne de le trouver, contre la défense du peuple d'Argos, engagé dans un entretien avec le parricide Oreste. L'image par laquelle il désigne ce dernier est propre à faire comprendre jusqu'à quelle hardiesse de style peut s'élever le langage si simple du dialogue grec, quand il est soulevé par la passion. « Ce meurtrier d'une mère , dit-il, ce serpent abhorré , qui lance à la porte du palais le feu impur de ses regards (33). » Dans un discours suivi, de formes un peu étudiées, il lui reproche son attentat ; Oreste se défend de même, non sans quelque embarras , quelque confusion, à la vue du vieillard qu'il a privé d'une fille. Les Grecs, peuple amoureux de la parole et des combats judiciaires, se plaisaient à ces sortes de plaidoyers contradictoires, et Euripide mit peut-être trop de complaisance à les servir selon leur goût ; peut-être doit-on lui reprocher d'avoir quelquefois altéré la vérité dramatique par l'apprêt du rhéteur, la subtilité du sophiste. Nous retrouvons dans ce débat; du reste animé et intéressant, les arguments déjà développés par Eschyle, dans la scène des Euménides qui représente le jugement d'Oreste ; un entre autres des plus bizarres, que je me contenterai d'indiquer, en ayant parlé ailleurs plus au long (34), celui par lequel le père est représenté comme l'unique auteur de la naissance. Il ne paraît pas qu'il ait été reproché à Eschyle ; mais on ne le passa point à Euripide, et, lorsque son Oreste fit entendre ces paroles : « Sans père, il n'est point de fils (35), » une voix, probablement une voix de femme, s'écria dans l'amphithéâtre : « Et sans mère, infâme Euripide (36)? » Si l'Oreste, donné quatorze ans environ après les Nuées (37), les eût au contraire précédées , l'élève des sophistes, peint par Aristophane dans le personnage de Phidippide, n'eût pas manqué d'appuyer de cette autorité son étrange et scandaleuse thèse sur le droit qu'ont les fils de battre leur mère (38).
La défense d'Oreste anime Tyndare d'un nouveau courroux; il sort en annonçant qu'il va poursuivre auprès des Argiens la condamnation du parricide, et en menaçant Ménélas , s'il ose s'y opposer, de ne le point recevoir à Sparte. Cette menace, répétée deux fois et avec les mêmes termes, a paru à de savants interprètes (39) introduite, dans un des deux endroits, par une indiscrète interpolation. Peut-être y pourrait-on voir une imitation, assez dans le goût d'Euripide, et dans l'esprit de ce morceau , des redites ordinaires à la colère et naturelles à la vieillesse.
Partagé entre la pitié que lui a inspirée le sort d'Oreste, et la crainte d'offenser Tyndare, peut-être aussi, comme on le fait entendre plus loin, séduit par l'odieuse pensée d'hériter du trône d'Argos, Ménélas éprouve une hésitation que trahissent, selon l'observation du poète, toujours occupé de marquer la pantomime des acteurs, son air rêveur et le trouble de sa démarche. Oreste le supplie de nouveau, au nom des bienfaits qu'il reçut de son père, de prendre sa défense. Ses paroles ne sont pas exemptes de cet artifice oratoire dont nous nous plaignions tout à l'heure, et peut-être, comme l'a remarqué un scoliaste, le poète a-t-il voulu excuser la forme de harangue qu'il leur a donnée, par ce singulier exorde:
« Je vais parler, puisque tu l'approuves. Un discours de quelque étendue vaut mieux qu'un langage trop bref, et porte à l'esprit plus de clarté (40). »
Le même critique ancien croit voir encore dans ce début une allusion indirecte au laconisme affecté du roi de Sparte. Mais c'est supposer à Euripide une intention bien subtile, et surtout bien peu d'accord avec la situation. Comment Oreste se hasarderait-il à blesser, par un trait épigrammatique, celui qu'il veut émouvoir et de qui dépend son sort ?
Il termine par des mouvements d'une éloquence bien naturelle et bien touchante. Après avoir conjuré Ménélas au nom d'une coupable épouse , il s'interrompt, pour se plaindre à part de l'abaissement où le réduit le soin de sauver les restes de sa race. Puis, revenant à la prière : « Ô frère de mon père, dit-il, ô mon oncle , tu peux le croire ; celui que la terre a reçu, celui qui n'est plus nous écoute ; son âme, errante autour de toi, te parle par ma bouche (41) !... »
Une supplication si vive , les instances du chœur qui s'y joint, ne touchent point Ménélas. Il déguise, sous de longues protestations d'intérêt, sous la vaine promesse de s'employer à fléchir Tyndare et à persuader les Argiens , une froideur, un égoïsme, une lâcheté, qui n'échappent pas à la pénétration d'Oreste. Ce malheureux se voit trahi, perdu, et c'est dans ce moment d'extrême détresse que le poète, avec une science de composition qui ne s'est point encore démentie dans cet ouvrage, lui envoie Pylade, son fidèle ami.
En traversant la ville, il a vu le peuple qui se rendait en foule au jugement d'Oreste; il accourt (42) l'en avertir, et l'aider de ses conseils et de son appui. Pylade revient de la Phocide, sa patrie. Il s'y est réfugié après le meurtre de Clytemnestre ; mais Strophius, son père, a refusé de l'y recevoir. Les partisans de l'exacte vraisemblance pourront trouver que, pour ce double voyage, il n'a point perdu de temps.
Remarquons en passant, avec un scoliaste, que, pour peindre la rapidité de sa marche, le mouvement empressé de son zèle, la vivacité de l'entretien qui s'engage entre les deux amis, le poète a remplacé le mètre ordinaire du dialogue par un vers d'une allure plus agile, par le vers trochaïque. Ces changements , presque insensibles pour nous, devaient flatter agréablement l'oreille des Grecs, et plaire à leur esprit par le juste rapport des formes de la versification avec les vicissitudes de l'action dramatique.
La scène, ainsi commencée, s'accélère sans cesse, à mesure que la situation devient plus pressante. Les répliques , d'abord coupées par vers, le sont bientôt par hémistiches , disposition ingénieuse, mais quelque peu symétrique. Oreste se hâte d'expliquer à Pylade l'état désespéré où il se trouve, menacé dans l'instant d'une sentence de mort, et investi de gardes armés qui s'opposent à sa fuite. Dans cette extrémité, il conçoit tout à coup la pensée de se présenter à cette assemblée qui va décider de sa vie, d'y soutenir lui-même sa cause, et d'aller au-devant des heureux hasards que pourra lui offrir la fortune. Pylade approuve ce généreux dessein, et s'offre d'y participer. Il soutiendra son ami de sa présence, en prendra soin si ses fureurs le surprennent de nouveau ; rien ne découragera, ne rebutera son affection. Ils sortent en se donnant mutuellement les témoignages de la tendresse la plus dévouée, la plus reconnaissante, en s'encourageant l'un l'autre, comme il arrive d'ordinaire, de leurs vœux et de leurs espérances. Un trait admirable est jeté vers la fin de ce dialogue :
ORESTE.
Conduis-moi au tombeau de mon père.
PYLADE.
Qu'y veux-tu faire?
ORESTE.
Le prier de me sauver
PYLADE.
Tu le dois.
ORESTE.
Mais garde que je ne voie le monument de ma mère (43).
Le chœur, resté seul sur la scène, s'entretient de la fatalité qui poursuit la maison des Atrides , et, par les images effrayantes sous lesquelles il se représente le crime d'Oreste, fait pressentir la condamnation qui va le frapper.
Bientôt reparaît Électre, que ses inquiétudes n'ont pas laissée reposer longtemps, et à qui Pylade n'a pas permis qu'Oreste communiquât son dessein. Elle l'apprend et s'en effraye ; mais , lorsqu'elle commence à exprimer ses terreurs, un homme survient tout à coup qui lui annonce que l'assemblée des Argiens les a tous deux condamnés à mourir, les exemptant, pour unique grâce, du supplice de la lapidation, et leur permettant de se frapper eux-mêmes avec le fer. Le porteur do cette triste nouvelle est un vieux serviteur d'Agamemnon, que sa sollicitude pour ses jeunes maîtres a ramené des champs ce jour même, et qui, en arrivant à la ville, a été témoin de leur jugement. Il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu; mais, dans ce récit (44) plein d'intérêt, quelques allusions contemporaines décèlent chez Euripide une préoccupation étrangère à son sujet, et démentent la naïveté du personnage qu'il fait parler. Tels sont des portraits (45) d'orateur, où l'on a cru (46) reconnaître le démagogue Cléophon (47) et le sage Socrate. C'est une peinture fort piquante, et dont le modèle n'a malheureusement pas vieilli , depuis les temps homériques , que celle de Talthybius, autrefois le héraut d'Agamemnon, ami dévoué de la fortune et de la puissance comme ceux de sa profession, parlant avec respect de son ancien maître dont il accable le fils malheureux, caressant de l'œil les amis d'Égisthe prêts à triompher, et couvrant de raisonnements spécieux et de belles paroles cet ingrat et lâche abandon (48).
Électre, dans un chant lyrique mêlé, selon les scoliastes, d'emblèmes scientifiques assez déplacés, déplore la ruine complète de la maison de Pélops et de Tantale.
Oreste revient soutenu par Pylade. Son corps est défaillant, mais son âme demeure ferme. C'est ici le lieu de remarquer que, par une gradation habile, le poète nous l'a montré qui s'élevait graduellement, des langueurs ou des transports de la maladie, au courage , à la résignation. Sa constance ressort ici par le contraste d'Électre, qu'il conjure en vain de se contenir, et aux larmes de laquelle il finit par se laisser vaincre. Les apprêts de leur mort, leurs adieux, sont pleins de ce pathétique où triomphe la poésie d'Euripide. Il faut les entendre eux-mêmes : Elle en parcourt toutes les calamités successives, et, selon la doctrine consacrée du théâtre grec, les rapporte à l'implacable haine du destin.
ORESTE.
Je t'en conjure, au nom des dieux, ne me communique point ta faiblesse, ne m'attendris point par le tableau de notre infortune.
ÉLECTRE.
Nous mourrons tout à l'heure : comment ne pas gémir? Tous les hommes pleurent la vie.
ORESTE.
C'est maintenant notre dernier jour; c'est maintenant qu'il nous faut suspendre le nœud fatal, ou aiguiser le glaive.
ÉLECTRE.
Tue-moi donc, ô mon frère, tue-moi ; qu'aucun Argien ne puisse attenter à la race d'Agamemnon.
ORESTE.
C'est assez du sang de ma mère ; je ne te tuerai point : meurs de ta propre main, et choisis toi-même ton supplice.
ÉLECTRE.
Je le ferai : tu ne vaincras point ta sœur en courage. Mais qu'il lui toit permis de te presser dans ses bras.
ORESTE.
Jouis de ce vain plaisir, si c'est pour des mourants un plaisir que ces embrassements.
ÉLECTRE.
Ô mon ami ! toi, à qui fut si doux, si précieux le nom d'une sœur, toi qui n'eus qu'une âme avec elle !
ORESTE.
Mon cœur se fond à tes paroles. Je veux te rendre ces caresses. Et pourquoi en rougirais-je, infortuné? Ô sein d'une sœur! doux embrassements! dernier entretien de deux malheureux ! tenez-nous lieu de famille et d'hyménée!
ÉLECTRE.
Oh! si un même fer nous immolait! si un seul monument recevait nos cercueils !
ORESTE.
Plût aux dieux ! mais, tu le vols, nous n'avons point d'amis pour nous réunir au tombeau (49).
Ce dernier service, il le demande à Pylade; mais celui-ci , qui fut le complice d'Oreste , à qui Électre dut être unie, veut partager leur sort, et s'y obstine malgré leurs instances.
Ici s'arrêtent les mérites d'une tragédie commencée avec génie, mais bien médiocrement terminée. Ces personnages , dont la situation nous a paru jusqu'à ce moment si attendrissante, qui nous élevaient le cœur par le spectacle de leurs pures affections , de leur héroïque dévouement , perdent tout à coup leurs droits à notre intérêt, lorsque nous les voyons concevoir, exécuter des projets d'une froide atrocité. A cette action simple, mais attachante, succèdent une intrigue commune et un de ces dénouements à machine par lesquels Euripide, dans sa négligence, a gâté tant de beaux ouvrages.
Pylade (50) propose à ses amis de punir, sur Hélène, la trahison de son époux, proposition révoltante (51), adoptée avec une ardeur peu vraisemblable et qui ravale gratuitement tous ces caractères au rang de celui de Ménélas , dont Aristote a dit que le poète l'avait fait méchant sans nécessité (52).
Électre, à son tour, est d'avis qu'ils se saisissent d'Hermione, envoyée, on se le rappelle et c'est, on doit le dire, un souvenir déjà bien éloigné, envoyée par sa mère au tombeau de Clytemnestre ; qu'ils en fassent leur otage contre le courroux de Ménélas, et la rançon de leur vie.
L'exécution de ces deux entreprises remplit la fin de la pièce ; il n'y règne plus que l'espèce d'intérêt qui peut s'attacher à une vengeance cruelle et à une lutte vulgaire contre le danger.
En vain Euripide cherche à relever ce qui n'a aucune grandeur. Ces invocations à l'ombre d'Agamemnon, qu'il imite d'Eschyle (53), n'ont plus de sens , quand il s'agit, au lieu du châtiment de Clytemnestre, de l'assassinat d'Hélène. Ces exhortations d'Électre restée sur la scène, qui se mêlent au tumulte intérieur du palais, sont également un emprunt malheureux fait à un admirable passage de Sophocle (54).
La pitié que la jeune Hermione témoigne pour les enfants d'Agamemnon, rend plus insupportable encore le froid artifice par lequel on la trompe et le sort barbare qu'on lui prépare.
Il y a une scène où un Phrygien, esclave d'Hélène, échappé du palais et surpris par Oreste, lui demande lâchement la vie. Le but de cette scène, suivant l'ingénieuse explication de Prévost, est de montrer qu'Oreste tente de se sauver par une plus noble voie ; mais si cette intention est réelle, elle est bien détournée, bien difficile à apercevoir; et peut-être, loin de sauver ainsi l'héroïsme de son Oreste, le poète l'a-t-il rabaissé au niveau de l'esclave qu'il lui a opposé, par un égal amour de l'existence.
ORESTE.
Tu es esclave et tu crains la mort qui te délivrera de tes maux !
LE PHRYGIEN.
Tout homme, fût-il esclave, aime à voir la lumière.
ORESTE.
Tu dis vrai. Ton bon sens te sauve la vie. Rentre dans le palais (55).
Enfin , c'est une conclusion bien peu satisfaisante que l'apparition merveilleuse d'Apollon, qui vient au secours du poète embarrassé, en mettant tous ses personnages d'accord ; qui termine tant de discordes par l'apothéose d'Hélène, et, comme dans la comédie (56), par l'union de Pylade et d'Électre, d'Hermione et d'Oreste , par deux mariages de raison.
On éprouve véritablement quelque regret en voyant
le poète gâter à plaisir une œuvre qui promettait d'être si
belle. Toutefois cette dernière partie n'est pas sans intérêt
pour l'histoire de l'art. Elle témoigne du zèle d'Euripide à
chercher des effets nouveaux, une plus grande complication
d'événements, un plus vif attrait de curiosité et de surprise,
plus de mouvement et d'effet théâtral, toutes choses dont
manquait encore la tragédie, mais qu'elle ne devait recevoir que
des modernes. Les scoliastes (57),
en assimilant cette pièce à l'Alceste, pour ce mélange
d'impressions diverses qui les rapprochent l'une et l'autre de
la comédie, nous mettent sur la voie d'un jugement plus
favorable encore. Si l'Oreste, en effet, avait appartenu
comme l'Alceste (58)
à ce genre mixte de tragédie, qui, par l'heureux tour du
dénouement et aussi par les touches familières et égayées de la
peinture, pouvait prendre, dans la tétralogie, la place du drame
satyrique, il y aurait lieu de traiter moins sévèrement
certaines dérogations à la gravité, à la sévérité tragique ; ces
dérogations toutes volontaires devraient être considérées comme
attestant la liberté hardie, la souplesse du génie d'Euripide,
son habileté à varier, par une sorte de compromis entre les
genres admis au théâtre, les formes de l'art (59).
(01) Schol. Eurip., Orest., v. 365, 763. Cf. Clinton, Fast. hellenic., p. 85; Musgrave, Chronol. scenic. ; Th. Fix, Eurip. éd. F. Didot, 1843, t. I, p. VI, chronol. fabul.
(02) Arist., Poet, XV, XXV; Cic., Tusc. IV, 29; Horat., Sat. II, III, 133 sqq.; Ovid., Amor. I, VII, 9, eq.; Juvenal., Sat. XIV, 283 sq.; Longin., De Subl., XIII; Plutarch., de Superstitione, III; de Tranquillilate animi, XIX; de Placitis philoiophorum, III, 12; adversus Coloten, XXII , etc.
(03) V. 57 sq. On a pu voir, t. I, p. 123, 320 sq., comment à Rome, au temps de Cicéron, de Tite Live, d'Horace, la pompe du spectacle étouffa la tragédie; sous quel luxe extravagant d'accessoires disparaissait alors la simplicité des fables grecques, pour le divertissement d'un public de plus en plus grossier, désormais uniquement sensible au plaisir des yeux. Cette perversion de l'intérêt dramatique, par laquelle finissent tous les théâtres, les Grecs eux-mêmes n'y ont point échappé. Un temps vint où l'Oreste, toujours en crédit, eut besoin d'être soutenu par l'appareil préliminaire de l'entrée d'Hélène dans Argos, voiturant à sa suite toutes les richesses de Troie, et en plein jour ! Un scoliaste nous le dit dans sa note sur ce vers 57 auquel, par cette impertinente introduction, était donné d'avance un complet démenti
(04) Les trois premiers vers de ce prologue frappèrent assez Socrate à une répétition de l'ouvrage (voyez t. I, p. 56) pour qu'il les fît répéter. Cicéron qui raconte cette anecdote, Tusc. IV, 29, donne du passage une traduction critiquée par Muret, Var. Lec. VIII, 16 : « .... Quum Orestem fabulam doceret Euripides, primos tres versus revocasse dicitur Socrates :
Neque tam terrîbilis ulla fando oratio est,
Nec sors, nec ira cœlitum invectum malum,
Quod non natura humana patiendo efferat.
»
(05) Voyez t. , p. 342 sqq.; II, 309 sqq.; 383 sq.
(06) V. 128 sq.
(07) V. 243 sqq. Nous avons cité ailleurs, t. II, p. 51, les vers où Juvénal, Sat. XIV, 283 sq., peint, d'après ce passage, Oreste poursuivi, même dans les bras de sa sœur, par le terrible aspect et les flambeaux des Furies :
Non unus mentes agtlat furor : ille sororis
In manibus vultu Eumenidum terretur et igni....
(08) V. 204 sq. Horace s'est souvenu de ces vers dans les argumentations si mêlées d'allusions à la tragédie grecque, d'après la méthode ordinaire des maîtres du Portique, qu'il prête, Sat. II, m, 131 sqq., à son apprenti stoïcien Damasippe : « .... Et quand tu fais périr ta femme au moyen d'un lacet, ta mère parle poison, as-tu la tête bien saine ? Pourquoi pas? diras-tu. Et, en effet, ce n'est pas à Argos que tu agis ainsi; ce n'est pas le fer que tu emploies contre la vie d'une mère, comme ce fou d'Oreste. Penses-tu, par hasard, qu'Oreste ait perdu la raison seulement après son parricide; qu'il ne fût pas déjà égaré par le» Furies, quand il plongeait son épée dans le sein maternel, pour l'en retirer fumante? Bien plus, du moment où il passa pour n'avoir plus l'esprit à lui, il ne fit rien qui mérite d'être repris ; il ne frappa ni Pylade , ni sa sœur Électre ; il se contenta de leur dire à tous deux des injures, donnant à l'une le nom de Furie, et à l'autre tous ceux que lui suggérait sa bile.... »
Non Pyladen ferro violare aususve sororem est
Electram : tantum male dicit utrique vocando
Hanc Furiam, hunc aliud, jussit quod splendida bilis.
(09) V. 258 sqq. C'est maintenant le tour d'Ovide de payer son tribut d'hommages à cette belle scène. Cet arc d'Apollon demandé par le parricide Oreste pour se défendre contre les Furies , était présent à son souvenir, lorsque dans ses Amours, I, VII, 7 sqq., il s'excusait d'un acte de violence à l'égard de sa maîtresse, mythologiquement, littérairement, selon sa coutume, en alléguant, avec cet égarement de l'Oreste d'Euripide , celui de l'Ajax de Sophocle :
Quid? non et clypei dominas septemplicis Ajax
Stravit deprensos lata per arva greges ?
Et vindex in matre patris, malus ultor Orestes,
Ausus in arcanas poscere tela deas.
Selon un des nombreux scoliastes qui ont commenté l'Oreste, Euripide avait ici, comme il le fit encore dans son Hélène, suivi Stésichore. Dans les récits lyriques de ce poète « epici carminis onera lyra sustinentis » (Quintilian. Inst. orat., X, 1), Oreste recevait d'Apollon un arc pour chasser les Furies. Le scoliaste a tort, je pense, d'en conclure que , dans la scène d'Euripide, le comédien chargé du rôle d'Oreste, devait s'armer réellement d'un arc. Autant vaudrait-il prétendre que les Furies lui apparaissaient en réalité.
(10) V. 269. Ce vers fut, selon les scoliastes , l'occasion de la faute de prononciation qui rendit si ridicule l'acteur Hégélochus. Voyez t. I, p. 108.
(11) V. 201-306.
(12) Cf. Soph., Philoct., 827.
(13) Metam. XI, 623.
(14) Herc, fur., 1065.
(15) De Superstitione, III.
(16) Électre.
(17) Voyez t. II, p. 347.
(18) Je les ai déjà cités t. II, p. 82.
(19) Traité du Sublime, ch,. XIII, trad. de Boileau.
(20) V.245 sqq.
21) Hom., Iliad.,XX, 170.
(22) L'Alcméon à Psophis, l'Alcméon à Corinthe. Sur la difficile restitution de ces ouvrages et de leurs imitations latines, l'Alcméon d'Ennius, l'Alcméon et l'Alphésibée d'Attius, voyez, en dernier lieu, J. A. Hnrtung, Euripid. restitut., 1843, t. I, p. 187, II, 534 r,Fr. G. Wagner, Euripid. fragm., éd. F. Didot, 1846, p. 635 ; O. Ribbeck, tragic. latin, reliq., 1852, p. 15 et 268, 120 et 323.
(23) Cic, Acad , II, 28.
(24) Bibl. III, VII.
(25) Œdipe chez Admète, acte III, se. 2.
(26) Acte III, sc 4.
(27) Gaston et Bayard, acte III. sc. 5.
(28) Rome sauvée, acte V, sc. 3. Voyez à ce sujet La Harpe, Lycée.
(29) Acte III, sc. 1.
(30) Ajoutez ce vers aux passages cités t. I, p. 369 sq.
(31) V. 370-399.
(32) V. 449-459.
(33) 468 sq.
(34) T. 1, p. 379 sq.
(35) V. 543.
(36) Schol., ibid.
(37) En 409, je l'ai déjà dit p. 241 ; les Nuées avaient paru la deuxième et la troisième année de la LXXXIXe olympiade, en 423 et 422. Voyez Clinton, Fast, hellenic., p. 73, 75, 85.
(38) Nub., 1430.
(39) Brunck les efface dans le premier endroit, au v. 526.
(40) V. 629 sq.
(41) V. 663 sqq.
(42) «
D'un pas plus rapide qu'il ne serait convenable, » ajoute-t-il,
v. 717, à peu près comme Thésée dans l'OEdipe à Colone,
v. 879. Voyez
ce qui est dit à ce sujet, t. II, p. 231 sq.
(43) V. 785 sqq.
(44) Sur certains détails du morceau, voyez t. I, p. 179, 182.
(45) Voyez sur des peintures de ce genre, fréquentes chez Euripide, t.1, p. 59 sq.
(46) Prévost.
(47) Schol., v. 894. Cf. Aristoph., Thesmoph., 806 ; Ran , 692,1527, 1553. Platon le comique donna le nom de ce Cléophon à un de ses ouvrages, représenté en même temps que les Grenouilles d'Aristophane, la troisième année de la CXIIIe olympiade, deux ans après l'Oreste, Voyez Meineke, Fragm. com. graec., t. I, p. 171 sqq.
(48) V. 875-885.
(49) V. 1024-1048.
(50) On ne comprend pas trop pourquoi il est excepté du reproche général adressé aux autres personnages dans l'un des arguments anciens de l'Oreste. Voyez l'Euripide de M. Boissonade, t. I, p. 95.
(51) 3. Le poète s'efforce vainement de l'ennoblir par des raisons que Virgile, on l'a remarqué, a prêtées depuis à Énée, tente d'immoler Hélène (En,, II, 567 sqq.).
(52) Poet., XV, XXV.
(53) Voyez t. I, p. 352 sq.
(54) Voyez t. II, p. 332 sq.
(55) V. 1515 sqq.
(56) C'est l'expression d'un scoliaste dans un des arguments qui précèdent le texte. Voyez l'Euripide de M. Boissonade, t. I, p. 94.
(57) Voyez, avec leurs Arguments, leurs notes sur les derniers vers, 1686 sqq.
(58) Voyez dans notre t. I, p. 28 et 31, et dans celui-ci, p. 210, 220.
(59) C'est ce que s'applique ingénieusement à montrer M. Hartung, ibid., t. I, p. 386 sqq., 471 sqq., faisant de l'Oreste la pièce finale d'une tétralogie qu'il compose, en outre, de l'Antiope, de l'Hypsipyle et des Phéniciennes.