![]()
Gomperz,
Theodor (1832-1912)
Les penseurs de la Grèce : histoire de la philosophie
antique
trad. de Aug.
Reymond,... ; et précédée d'une préf. de M. A. Croiset,...
Griechische Denker : eine Geschichte der antiken Philosophie
2e éd. rev. et corr.
Paris : F. Alcan ; Lausanne : Payot, 1908-1910
LIVRE TROISIÈME
L'Epoque des Lumières.
Ce
furent les Grecs qui... fondèrent... la science rationnelle, dépouillée de
mystère et de magie, telle que nous la pratiquons maintenant.
MARCELIN BERTHELOT
(La Chimie dans l'antiquité et au moyen âge ; Revue des Deux-Mondes, 15 sep.
1893).
Peut-être
l'hypothèse atomistique sera-t-elle un jour supplantée par une autre;
peut-être, mais ce n'est pas probable.
LUDWIG BOLTZMANN
(Der zweite Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie ; Almanach der kais. Akad.
der Wissensch , Wien 1886, p. 234).
tòn
m¢n bÛon
² fæsiw ¦dvke, tò d¢ kalÇw z°n ² t¡xnh
POÈTE DRAMATIQUE INCONNU
(Passage tiré par nous d'une paraphrase de Philodème trouvée dans les papyrus
d'Herculanum: Wiener Studien, II 5).
CHAPITRE PREMIER
Les Médecins.
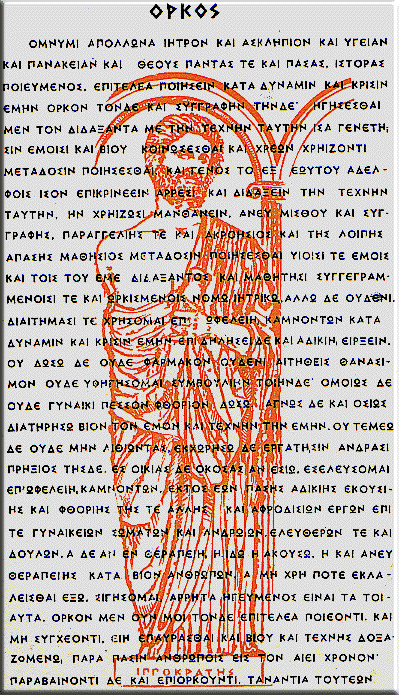
1. Supériorité scientifique des Hellènes. Médecine des peuples sauvages, des Indo-Européens et des Hindous. Débuts de la médecine grecque. - II. Situation et devoirs des médecins. - III. La collection hippocratique. Influences réciproques de la médecine sur la philosophie et de la philosophie sur la médecine. Médecine et superstition. Influence de la philosophie naturelle. - IV. L'ouvrage Sur le Régime. Bien-fondé de la pensée qui en fait le fond. Héraclitisme et éclectisme. Le livre Sur les Chairs. Questions et réponses téméraires. Noyau sérieux dans une enveloppe fantastique. Le livre Sur le nombre sept. Excès d'imagination. - V. Années d'apprentissage, de voyages et de maîtrise de la médecine. Réaction contre la méthode de la philosophie naturelle. La médecine et la science « exacte ». Violente polémique contre Empédocle. Science et beaux-arts. Prétentions modestes de la vraie science. - VI. Nature des recherches hypothétiques. Leur nécessité et leurs dangers. Hypothèses « vides » et hypothèses légitimes. Querelle des méthodes. Induction et déduction. Le vrai mérite de l'école de Cos. - VII Le fondateur de la psychologie ethnique. Les hippocratiques et le « divin ». Essais de science rigoureuse. Un penseur noble et profond.
I
La
nation grecque a plus d'un titre de gloire. Il lui a été donné, ou du moins
il a été donné aux grands génies qu'elle a produits, de faire les plus
brillants rêves spéculatifs. N'avaient-ils pas reçu le don de créer, par la
poésie ou les arts plastiques, des chefs-d'oeuvre incomparables ? Il est
toutefois une autre création de l'esprit grec que l'on peut qualifier non
seulement d'incomparable, mais d'unique : la science positive ou rationnelle.
Nous pouvons nous glorifier aujourd'hui de la souveraineté que nous exerçons
sur la nature grâce à la connaissance que nous avons acquise de ses lois ;
chaque jour, nos regards pénètrent plus profondément non pas sans doute
l'essence des choses, mais la suite des phénomènes; les sciences de l'esprit,
suivant les traces de celles de la nature, ont commencé à se rendre compte de
la causalité à laquelle sont soumises même les choses humaines et à
modifier, doucement mais sûrement, la tradition pour fonder sur des principes
nouveaux une règle de vie rationnelle, basée sur les moyens dont nous
disposons et appropriée au but à atteindre. Ces triomphes éclatants, à qui
les devons-nous si ce n'est aux créateurs de la science grecque? Les liens qui,
à cet égard, unissent les temps modernes aux temps antiques ne se dérobent
point à nos yeux ; ils apparaîtront, dans le cours de cette exposition, avec
toute la netteté désirable. Sur quoi repose ce privilège de l'esprit
hellénique? Non pas, pouvons-nous répondre avec une pleine confiance, sur un
don particulier accordé aux seuls Hellènes et refusé aux autres nations. Le
sens scientifique ne ressemble pas à une baguette magique qui, dans leurs
mains, mais non dans celle des autres, aurait pu arracher aux mines des faits le
trésor de la connaissance. D'autres peuples aussi ont pu à bon droit se vanter
de travaux vraiment scientifiques : la chronologie des Égyptiens, la
phonétique des antiques grammairiens de l'Inde n'ont pas à redouter la
comparaison avec les produits de l'esprit grec. Quand nous essayons de nous
expliquer l'avantage de ce dernier, il nous vient à l'esprit un mot d'Hérodote
: le père de l'histoire félicite son pays d'avoir obtenu en partage le plus
heureux mélange des saisons. Ici comme ailleurs, le secret de l'excellence et
du succès se trouve dans la réunion, dans la pénétration réciproque des
contraires. À côté d'une imagination constructive d'une richesse débordante,
le Grec possédait un esprit de doute toujours en éveil, qui examinait tout
froidement, et ne reculait devant aucune audace ; un irrésistible besoin de
généralisation uni à une observation si active et si pénétrante qu'elle ne
laissait pas échapper le plus menu détail des phénomènes ; une religion qui
accordait pleine satisfaction aux besoins du coeur, et malgré cela n'entravait
point la libre action d'une intelligence qui menaçait et même détruisait ses
créations. Ajoutez à cela une foule de centres intellectuels ayant chacun son
caractère propre et rivalisant les uns avec les autres ; une friction des
forces continuelle qui excluait toute possibilité de stagnation; enfin une
organisation politique et sociale assez stricte pour réfréner les désirs
vagues et puérils des gens médiocres, mais assez élastique pour ne pas mettre
sérieusement en danger l'essor hardi des esprits supérieurs : telle est la
réunion de dons naturels et de conditions favorables qui a valu à l'esprit
grec sa prééminence et lui a permis de se placer et de se maintenir au premier
rang dans le domaine de la recherche scientifique. Au point de développement
où nous sommes maintenant arrivés, la faculté critique, malgré le puissant
essor qu'elle avait pris, avait besoin de se fortifier encore davantage. Nous
avons appris à connaître les deux courants qui l'avaient alimentée : les
discussions métaphysiques et dialectiques engagées par les Éléates, et la
critique semi-historique des légendes, telle que l'ont pratiquée Hécatée et
Hérodote. Un troisième courant est sorti des écoles des médecins. Celles-ci
prirent pour tâche d'éliminer de l'étude et de la science de la nature
l'élément d'arbitraire qui était, en une mesure plus ou moins grande, mais
pour ainsi dire sans exception et en raison d'une nécessité interne,
inséparable de leurs débuts. En invitant à une observation plus attentive des
faits, la médecine mettait en garde contre les généralisations prématurées;
en exerçant la perception des sens et en inspirant en elle plus de confiance,
elle poussait à rejeter les fictions insoutenables, produits d'une imagination
excessive ou de la spéculation a priori : tels sont les principaux fruits que
nous verrons résulter de la pratique de la médecine. Mais avant de porter nos
regards sur celle-ci et d'étudier l'influence qu'elle a eue sur la pensée de
l'époque, nous devons envisager les rudiments de cette branche de la science,
ses auteurs et ses représentants.
«Un
homme habile à guérir vaut plusieurs hommes (01) », tel est l'éloge par
lequel la profession médicale est saluée au seuil de la littérature grecque,
et que la postérité ne devait pas démentir. La médecine des peuples naturels
est issue de superstitions grossières, et d'une expérience à peine moins
grossière, ordinairement incapable de bien interpréter les faits. C'est un
informe mélange d'exorcismes et de pratiques, les unes absurdes, les autres
efficaces, quoique dictées par des observations à peine analysées. Le «
médecin» des sauvages est pour une bonne moitié un conjureur, et pour le
reste le gardien des vieux secrets de la corporation, secrets qui reposent sur
un empirisme vrai ou seulement apparent. L'art médical du peuple indo-européen
primitif n'avait sans doute guère dépassé ce niveau. Nous en possédons
encore un souvenir dans une formule de bénédiction dont les rédactions
germanique et indienne concordent d'une manière si parfaite qu'il n'est guère
possible de douter de leur identité originelle (02). Nous avons aussi conservé
de la plus ancienne pratique de la médecine en Inde un agréable tableau dans la
Chanson d'un Médecin. Le guérisseur s'en va gaîment à travers la
campagne avec son élégante boîte de drogues en bois de figuier ; il souhaite
pleine guérison à ses malades, et à lui-même de beaux honoraires, puisqu'il
est obligé d'avoir habit, boeuf et cheval. Ses « herbages détruisent tout ce
qui afflige le corps » et « la maladie fuit devant eux comme devant les
griffes de l'huissier ». D'ailleurs il ne se qualifie pas seulement d' «
expulseur de la maladie », mais encore de « tueur de démons (03) ». En
effet, en Inde comme partout ailleurs autrefois, la maladie était regardée
soit comme une punition envoyée par Dieu, soit comme l'oeuvre de démons
hostiles, soit enfin comme la conséquence des malédictions et des maléfices
des hommes. La colère de la divinité offensée doit être apaisée par des
sacrifices et des prières ; le génie malfaisant est adouci par des paroles
aimables ou conjuré par des exorcismes ; pareillement, le mauvais sort est
combattu par des sortilèges contraires, et, si possible, reporté sur celui qui
l'a jeté. À côté des formules de conjuration, des amulettes et des actes
symboliques, les herbes médicinales et les onguents trouvent aussi leur emploi,
et il n'est pas rare que l'on recoure à un seul et même remède contre les
maux les plus divers. Tout cela est vrai de la médecine hindoue, telle qu'elle
nous est révélée en particulier par l'Atharva-Véda, mais cela ne l'est pas
moins de celle de tous les peuples naturels, ainsi que de la médecine populaire
du moyen âge et même des temps modernes si ce n'est contemporains. Le champ de
l'élément fantastique y est d'autant plus grand que le choix des médicaments
est déterminé également, si non plus, par l'association des idées que par
l'expérience spécifique. L'eufraise passait pour guérir les maux d'yeux parce
que sa corolle porte une tache noire qui fait songer à la pupille, tandis que
la couleur rouge de l'hématite paraissait la désigner pour arrêter
l'hémorragie. Pour empêcher les cheveux de blanchir, il fallait, à en croire
les Égyptiens, recourir au sang d'animaux noirs, et aujourd'hui encore, en
Styrie, comme autrefois en Inde, en Grèce et en Italie, la jaunisse est exilée
dans le corps d'oiseaux jaunes (04). En raison de sa nature, la chirurgie,
petite ou grande, devait échapper plus facilement à la superstition, et l'on
sait qu'elle a atteint un étonnant développement chez les Sauvages
d'aujourd'hui comme chez les nations de l'antiquité, même à une époque que
nous ne connaissons que par les découvertes préhistoriques ; de part et
d'autre, les praticiens ne reculent pas devant des interventions aussi hardies
que la trépanation ou l'opération césarienne (05).
Si
nous en venons aux plus anciens témoignages de la littérature grecque, nous ne
sommes pas peu surpris de voir que l'Iliade ne mentionne nulle part les
incantations. Des traits sont retirés du corps des héros blessés, le sang des
blessures est étanché, et celles-ci sont ointes de baumes ; les guerriers
épuisés sont ranimés au moyen de vin pur ou associé à l'orge et au fromage,
mais il n'est nulle part question de pratiques ou de formules superstitieuses
quelconques. Ce fait, qui avait déjà frappé les anciens commentateurs
d'Homère, s'accorde au mieux avec les autres traits qui dénotent un précoce
épanouissement des « lumières » (cf. p. 32 sq.). Mais les « lumières » ne
sortaient guère des cercles de la noblesse ; c'est ce que nous prouve la
littérature plus jeune, à partir d'Hésiode, où les incantations, les
amulettes, les songes salutaires, etc., jouent un rôle si important. L'Odyssée
déjà, qui nous décrit les débuts de la vie civile, et dont le héros est
plutôt l'idéal des marchands astucieux et des intrépides marins que celui des
nobles guerriers, connaît au moins en un passage, dans l'épisode de la chasse
au sanglier sur le Parnasse, l'incantation ou épode comme moyen de soigner les
blessures (06). C'est aussi dans la plus jeune des épopées homériques que
nous voyons apparaître pour la première fois les professionnels de l'art de
guérir ; semblables au médecin du Rig-Véda, ils parcourent le pays ; on
réclame leurs services comme ceux du charpentier, de l'aède ou du devin, et
ils les font payer à tous ceux qui en ont besoin.
Les
médecins acquirent de bonne heure en Grèce une grande considération.
L'aimable île de Cos, non loin de là la presqu'île de Cnide, au sud de la
ligne occidentale des côtes de l'Asie Mineure, Crotone, dans l'Italie
méridionale, Cyrène, sur les bords de la lointaine Afrique, telles furent les
plus anciennes et les plus célèbres écoles de médecine. Autour de Cyrène,
croissait une ombellifère nommée silphion, dont on appréciait au plus haut
degré les vertus curatives, et qui faisait l'objet d'un monopole royal. Cités
et princes se disputaient à l'envi et à prix d'or les services des médecins
éminents. Ainsi étaient recherchés ceux du Crotoniate Démocédès, qui passa
une année à la solde d'Athènes, une à celle des Eginètes et une troisième
à celle de Polycrate. Ses honoraires annuels s'élevèrent rapidement à une
hauteur dont témoignent les chiffres éloquents de 8.200,10.000 et 16.400
drachmes ou francs. Encore ces chiffres ne nous en donnent-ils une idée
suffisante que si l'on tient compte de l'énorme diminution de la valeur de
l'argent depuis l'antiquité. Après la chute du tyran de Samos, il fut emmené
comme prisonnier à Suse, où nous le retrouvons bientôt commensal et
conseiller intime du roi Darius (521-485). Il avait, en effet, si bien soigné
ce monarque et son épouse Atossa que les médecins égyptiens, jusqu'alors
extrêmement estimés, tombèrent en disgrâce et se virent même en danger de
mort (07). Vers le milieu du Ve siècle, le Chypriote Onasilos et ses
frères avaient rendu, comme médecins militaires, des services pendant le
siège de la ville d'Edalion par les Perses ; ils en furent récompensés par de
grands honneurs et par le don d'un riche domaine de la couronne. Mais si l'on
tenait les médecins en une haute estime, on exigeait d'eux de sérieuses
qualités morales. Il ne manquait sans doute pas de charlatans et d'ignorants
présomptueux dans une confrérie dont les membres pouvaient aspirer à des
gains aussi élevés et à de si rares honneurs. Mais la majorité était
formée de médecins qui à l'honorabilité alliaient la valeur scientifique, et
qui avaient pleine conscience de la hauteur de leur mission. Aussi ces parasites
de la médecine furent-ils toujours tenus en respect, et même souvent expulsés
de la corporation.
Au
début de notre étude, nous rencontrons un document que son âge n'est pas seul
à rendre respectable : le serment des médecins. C'est une pièce de la plus
haute valeur pour l'histoire de la civilisation ; elle renferme des
renseignements précieux sur l'organisation intérieure de la confrérie, et sur
les règles aux-quelles les médecins étaient tenus de se conformer. Nous y
saisissons sur le fait le passage du régime de la caste fermée à celui du
libre exercice de l'art. L'étudiant promet d'honorer son maître à l'égal de
ses parents, de lui prêter secours toutes les fois qu'il en aura besoin, et
d'en instruire gratuitement les descendants s'ils choisissent la même
profession que lui. À part cela, il ne peut former à la médecine que ses
propres fils et les jeunes gens qui se lieront à lui par contrat et par
serment. Il jure d'assister les malades « selon sa science et son pouvoir »,
et de s'abstenir de la manière la plus rigoureuse de tout emploi blâmable ou
criminel des moyens thérapeutiques. Il ne donnera pas de poison, même à ceux
qui lui en demandent ; ne fournira aux femmes aucun abortif, et enfin ne
pratiquera pas - même là où la guérison paraîtrait la demander -
l'opération de la castration, que réprouvait si vivement le sentiment
populaire de la Grèce. Enfin il promet de s'abstenir de tous les abus que sa
position lui permettrait de commettre, et spécialement des abus érotiques à
l'égard des libres ou des esclaves des deux sexes, et il s'engage à garder
inviolablement tous les secrets auxquels il peut être initié dans l'exercice
de sa profession ou même en dehors (08). C'est pas ces engagements, et par de
réitérées et solennelles invocations aux dieux, que se termine ce mémorable
document, d'autant plus significatif que, en l'absence de toute surveillance de
l'Etat, il formait la seule règle officielle pour la pratique de la médecine.
Il est heureusement complété pour nous par de nombreux passages des ouvrages
médicaux de cette époque, où la vanité de l'ignorance est percée de traits
aussi acérés que le charlatanisme des vendeurs d'orviétan. Ceux qui, sans
être en fait médecins, en prennent le titre, sont comparés aux personnages
muets ou simples figurants du drame. À la hardiesse fondée sur la science est
opposée la témérité qu'engendre l'ignorance. On enjoint aux médecins de ne
pas trop se préoccuper des honoraires; le recours à d'autres médecins en cas
d'incertitude et d'embarras est instamment recommandé. C'est là que nous
rencontrons cette belle parole : « Là où est l'amour des hommes est aussi
l'amour de l'art ». Lorsque s'offrent diverses méthodes de traitement, il faut
choisir la moins surprenante, - la moins sensationnelle; laisser les charlatans
éblouir l'oeil du patient par la montre d'une habileté inutile. Sont
réprouvés ceux qui visent à augmenter la considération dont ils jouissent en
organisant des séances publiques, surtout quand ils émaillent leurs exposés
de citations empruntées aux poètes. La raillerie s'attaque aux médecins qui
se flattent de s'apercevoir avec une sûreté infaillible de toutes les
infractions à leurs ordonnances, même des plus petites. Enfin on trouve des
prescriptions détaillées relativement à l'attitude personnelle du médecin ;
il doit s'astreindre à la plus scrupuleuse propreté, se mettre avec élégance
tout en fuyant le luxe ; il usera des parfums, mais sans en faire abus (09).
Sans
nous en apercevoir, nous voici arrivés au recueil en tête duquel est écrit le
nom du « père de la médecine». Hippocrate, « le Grand », comme l'appelle
déjà Aristote (10), est né dans l'île de Cos en
460, et toute l'antiquité l'a envisagé comme le type du parfait médecin, du
parfait écrivain médical. Sa gloire a éclipsé de beaucoup celle de tous ses
confrères. Ainsi s'explique qu'une importante collection d'ouvrages ait
circulé sous son nom, quoiqu'elle soit composée, de toute évidence, de
travaux d'auteurs différents et se rattachant même à des écoles contraires.
Les Anciens le savaient déjà, mais les essais de triage des savants de
l'époque n'ont guère été féconds, pas plus que ceux des critiques modernes
et même des plus modernes. Il ne nous appartient pas de traiter ici ce
problème, un des plus difficiles que connaisse l'histoire de la littérature.
Dans la plupart des cas, les dates de composition des ouvrages sont aussi
obscures pour nous que les noms des auteurs. Il nous suffira d'exprimer la
conviction qu'aucune partie de ce que l'on pourrait appeler le Corpus
Hippocraticum, à part quelques exceptions insignifiantes, n'est postérieure à
la fin du Ve siècle (11). Ces ouvrages
peuvent donc être considérés comme des témoignages certains du mouvement
intellectuel de l'époque qui nous occupe. Et même le sujet spécial de notre
exposition nous fournit, de l'exactitude de cette manière de voir, une preuve
qui ne souffre aucune contradiction. Dans cette vaste pile de livres, deux noms
de philosophes seulement sont cités : Mélissos (cf. p. 198) et Empédocle. Les
autres penseurs dont l'influence est reconnaissable dans l'un ou dans l'autre de
ces ouvrages, sont Xénophane, Parménide, Héraclite, Alcméon, Anaxagore et un
dernier, encore inconnu de nos lecteurs, Diogène d'Apollonie. Pas un indice,
même le plus faible, ne nous porte à leur assigner une date plus récente. Et
il serait bien étonnant pourtant qu'à une époque de développement
intellectuel si rapide, d'une circulation d'idées si active, les auteurs
d'ouvrages de médecine n'eussent admis ou combattu que des systèmes déjà
surannés ou en voie de le devenir. Si, d'ailleurs, il y a eu réellement
quelques retardataires, cela ne peut ébranler en aucun façon la certitude de
nos conclusions relativement à l'influence réciproque de la médecine et de la
philosophie.
Car des influences de ce genre sont incontestables, mais on a souvent eu le tort
de les chercher là où elles n'ont point existé et de les chercher rarement à
une suffisante profondeur. Il n'y a pas lieu de s'arrêter sérieusement ici à
des concordances extérieures, comme la tétrade des humeurs corporelles (sang,
phlegme, bile jaune et bile noire) qui, selon Hippocrate, déterminent la
maladie et la santé, et à son parallélisme avec les quatre éléments
d'Empédocle ; pas lieu de s'arrêter à des analogies verbales qui ne reposent
pas nécessairement et toujours sur des emprunts, et qui, même en ce cas, ne
prouveraient pas nécessairement un emprunt de doctrines. Ce qui est réellement
important, c'est l'esprit et la méthode de la recherche. De nouveau, nous
devons reporter nos regards en arrière. À un moment donné, sans aucun doute,
le trésor scientifique du praticien grec, à peu près comme celui du praticien
égyptien, ne consistait guère qu'en formules magiques et en recettes.
L'émancipation des superstitions antiques, qui s'est accomplie étonnamment
tôt dans certaines classes de la société, relativement tard et jamais
complètement dans d'autres, a conduit à l'abolition des éléments
superstitieux de la thérapeutique. Jamais complètement, disons-nous, car la
médecine populaire, dans laquelle les amulettes et les charmes jouaient le
rôle essentiel, n'a jamais disparu tout à fait. En ceci seulement se révèle
une différence des temps, c'est que la superstition vieillissante a recouvert
de plus en plus sa nudité d'oripeaux brillants, et s'est plu à se parer
d'autorités étrangères, telles que les médecins thraces, les thaumaturges
gètes et hyperboréens (Zalmoxis et Abaris) et les mages perses, jusqu'à ce
qu'enfin le fleuve débordant de la pseudo-science chaldéenne et égyptienne
souleva cette masse bigarrée et l'entraîna avec lui dans son lit élargi.
D'ailleurs, à côté de l'art laïque de guérir, l'art sacerdotal ou
hiératique a toujours revendiqué sa place. Nous ne mentionnerons qu'en passant
l'effet attribué au sommeil dans les temples et aux rêves salutaires qui
l'accompagnaient, et que l'on allait surtout chercher dans les sanctuaires
d'Asklépios. Ces pratiques superstitieuses, sanctifiées par la religion
nationale, devinrent également de très bonne heure un objet de raillerie pour
les gens éclairés (que l'on songe à une scène connue du Plutus
d'Aristophane), mais, dans les couches populaires, la croyance en leur
efficacité ne reçut pas la plus légère atteinte ; à l'occasion, elles
furent glorifiées par des hommes cultivés, mais extravagants, tels que le
rhéteur Aristide pendant l'époque impériale, et elles ont même survécu au
paganisme. Sans doute, si les lieux où s'exerçaient ces cures n'ont guère
perdu de leur force d'attraction, c'est en partie aussi grâce à l'emploi de
méthodes rationnelles et à la salubrité de leur situation et de leur
voisinage. C'est ainsi que la plus renommée de ces stations sacerdotales,
Épidaure, située non loin de la mer, et sur une chaîne de collines
recouvertes de magnifiques forêts résineuses, protégées contre le rude vent
du Nord par une bordure de hauteurs, et pourvues de la plus excellente eau de
source, répondait à toutes les exigences d'un sanatorium moderne (12).
Les besoins de récréation et de divertissement des baigneurs étaient
satisfaits par un hippodrome et par un théâtre dont nous admirons encore les
ruines imposantes. Que la médecine laïque ait tiré un grand profit des
observations des prêtres sur le cours et la guérison des maladies, c'est ce
qu'ont soutenu les Anciens. Il nous paraît difficile, à nous, de le croire.
Nous possédons depuis peu une longue série de notes découvertes précisément
à Épidaure ; elles sont tout ce que l'on voudra plutôt qu'un auxiliaire de
recherche médicale. Elles pourraient avec plus de raison revendiquer une place
dans les Mille et une Nuits. Une coupe brisée se répare sans intervention
humaine ; une tête a été séparée du tronc, les démons inférieurs qui
l'ont coupée ne peuvent la remettre en place, mais Asklépios accourt en
personne pour accomplir ce prodige - voilà deux échantillons des historiettes
dont nous devons la connaissance à ces pierres couvertes d'inscriptions. Les
facteurs de nature diététique ou thérapeutique qui ont réellement amené les
guérisons dans ces cures merveilleuses opérées par des prêtres, comme dans
les autres miracles de cette espèce, ont été soit inaperçus de leurs
auteurs, soit relégués intentionnellement dans l'ombre et soustraits à la
curiosité des générations suivantes. La médecine laïque fit des progrès
parce que les sujets d'observation s'accroissaient constamment, parce que les
descendants bénéficiaient d'un trésor d'expériences séculaires, et parce
que les médecins grecs possédaient la même faculté d'observation
pénétrante et de reproduction fidèle de la chose vue dont ont été si
largement doués les poètes et les sculpteurs de leur nation. Mais cette
accumulation, ce triage des matériaux a fourni tout au plus la pierre d'angle
d'une médecine scientifique ; la construction de l'édifice lui-même était
encore dans un avenir bien éloigné. Pour qu'elle se réalisât un jour, il
fallait d'abord d'autres travaux préliminaires, d'autres impulsions ; et ces
travaux, ces impulsions devaient sortir du besoin de généralisation qui
s'était fait jour et s'était développé dans les écoles philosophiques de la
Grèce plus que partout ailleurs.
Il n'est guère nécessaire de rappeler à nos lecteurs le philosophe-médecin
Alcméon et ses découvertes fondamentales. La variété des aspects sous
lesquels se présente la personnalité d'Empédocle ne nous a pas permis non
plus d'ignorer le médecin qui était en lui. Chez d'autres encore, le médecin
apparaît derrière le philosophe : tels sont, comme nous l'a appris une
trouvaille toute récente (13), Philolaos, Hippon,
et celui que nous nommions plus haut, Diogène d'Apollonie. Mais la combinaison
des deux sciences fut bien autrement féconde que leur réunion occasionnelle
chez un même savant. Et cette combinaison fut amenée par une conviction qui se
dégagea peu à peu de l'état de la culture de cette époque, et qui peut se
formuler ainsi: « L'homme, étant une partie de la nature, ne peut être
compris indépendamment de celle-ci. Ce qu'il faut posséder, c'est une vue
d'ensemble satisfaisante des phénomènes universels. Quand nous l'aurons
acquise, elle mettra dans nos mains la clef qui nous ouvrira les recoins les
plus secrets de l'art médical. » Tel est le point de vue auquel se placent bon
nombre des ouvrages attribués à Hippocrate. Ce qui est commun aux membres de
ce groupe, c'est de s'appuyer tous sur les systèmes de philosophie appliquée
à la nature - tous en usent d'une manière plus ou moins éclectique - et aussi
de se rattacher aux doctrines médicales de l'école de Cnide, sans qu'il soit
possible de déterminer, pour le moment, avec une pleine certitude si leur
adhésion est plutôt fortuite, ou si elle est fondée sur le caractère de ces
doctrines. En faveur de cette dernière alternative, on peut pourtant invoquer
le fait que les médecins de Cnide envisageaient eu général - avec Empédocle
(cf. p. 251 sq.) - les phénomènes de la vie comme des phénomènes physiques.
Nous distinguons en conséquence deux grands groupes d'écrits médicaux : ceux
dans lesquels domine ce point de vue et ceux qui le combattent. Nous étudierons
d'abord les ouvrages du premier de ces groupes, non pas que nous puissions
affirmer avec certitude qu'ils sont, sans exception, antérieurs à ceux du
second, mais parce que ces deux tendances fondamentales et les productions
essentielles qui en sont découlées se sont sans doute succédé dans cet
ordre. La philosophie de la nature acquiert de l'influence sur la science
médicale et commence à la transformer; il s'ensuit une réaction contre cette
influence et une tentative de retour à l'ancienne et plus empirique médecine.
Le récit de cette lutte et de son issue formera le sujet des pages qui vont
suivre; mais, pour nous conformer au plan de ce livre, nous devons nous
contenter de relever les points les plus caractéristiques des doctrines et des
méthodes relevant de ces deux tendances.
L'auteur
de l'ouvrage en quatre livres intitulé Du Régime (14),
- et qui pourrait bien être Hérodikos de Sélymbrie - commence son exposé par
une déclaration de principe. « Je dis, s'écrie-t-il à la fin de son
préambule, que celui qui veut écrire raisonnablement sur le régime de l'homme
doit avant tout connaître et comprendre la nature humaine. Il doit connaître
de quoi elle est composée à l'origine et comprendre par laquelle de ses
parties elle est surmontée. Car s'il n'en tonnait pas la composition
originelle, il ne pourra discerner ce que produisent ces éléments primitifs ;
et s'il ne sait pas ce qui l'emporte dans le corps, il ne sera pas en état
d'administrer les choses utiles ». L'écrivain formule ensuite une nouvelle
exigence : il faut connaître la composition de tous les mets et de toutes les
boissons, et comprendre en outre l'opposition fondamentale qui existe entre les
exercices et la nutrition. « Car les exercices tendent à consommer ce qui
existe, tandis que les aliments et les boissons ont pour effet. de combler le
vide (ainsi créé) ». La condition fondamentale de la santé est d'observer
une juste proportion entre le travail et la nourriture, en tenant compte de la
constitution de l'individu,. des différences d'âges, de saisons, de climats,
etc. L'homme serait à l'abri de toutes les maladies si un de ces facteurs, la
constitution individuelle, pouvait être déterminé par le médecin avant
qu'elles se déclarassent. Après cela, l'auteur indique les éléments du corps
animal et du corps humain ; il en trouve deux, à savoir - et ici nous croyons
reconnaître l'influence de Parménide chez un auteur qui suit d'habitude la
bannière d'Héraclite - le feu et l'eau. Dans le feu, il voit le principe
universel du mouvement ; dans l'eau le principe universel de la nutrition. «
Quand le feu est arrivé à la limite extrême de l'eau, lisons-nous dans un
passage qui se rapporte manifestement au mouvement des corps célestes, il
manque de nourriture ; alors il se retourne et revient aux sources de son
alimentation ; quand l'eau est arrivée à l'extrême limite du feu, elle manque
de mouvement, elle reste immobile et est consommée par le feu qui se précipite
sur elle pour s’en nourrir ». L'Univers se maintient dans son état actuel à
la condition que l'un de ces deux éléments ne prévale pas sur l'autre. Le
lien intime qui unit ces doctrines physiologique et matérielle est l'idée -
empruntée peut-être à Alcméon - de l'équilibre, d'une part entre le travail
et la nutrition, et de l'autre entre les agents cosmiques de ces fonctions.
Nous nous arrêtons. Nous en avons assez dit pour que le lecteur attentif se
rende compte du caractère de l'oeuvre, de sa force et de ses faiblesses. Nous
nous trouvons en présence d'une grande pensée, dont l'auteur s'exagère sans
doute la portée : « L'intégrité de l'économie organique repose sur
l'équilibre de ses recettes et de ses dépenses (15)
». Nous n'avons pas craint de citer mot à mot de longs passages pour éviter
qu'on nous soupçonne de prêter, même sans le vouloir, une pensée moderne à
cet antique auteur. Cette grande généralisation nous devient plus
compréhensible si nous nous souvenons qu'une pensée analogue, quoique d'une
portée moindre, a été exprimée par d'autres écrivains médicaux, et
probablement dans des temps plus anciens. Euryphon, le chef de l'école de
Cnide, contemporain aîné d'Hippocrate, supposait que les maladies avaient pour
cause une « surabondance » de nourriture. Un autre Cnidien, du nom
d'Hérodikos, se rapprochait encore davantage du point de vue de notre
diététicien quand il écrivait : « Les hommes tombent malades quand, avec
trop peu de mouvement, ils prennent beaucoup de nourriture (16)
». Toutefois il reste à notre auteur le mérite d'avoir exprimé le premier
une vérité fondamentale sous sa forme la plus générale ; et le reproche
d'avoir vu, dans une seule des conditions de la santé, sa seule cause réelle,
ne le touche pas davantage que ses prédécesseurs, qu'il dépasse par
l'étendue du regard. Découvrir de nouvelles et importantes vérités et se
rendre compte en même temps des limites au delà desquelles elles cessent
d'être légitimes sont deux choses distinctes ; il est difficile d'exercer
d'une manière géniale l'instinct de la généralisation, et de le contenir en
même temps dans de justes bornes ; aussi ne saurait-on raisonnablement demander
au pionnier d'une science à ses débuts de déployer à la fois ces qualités
opposées. La valeur de cette tentative fut plus sérieusement affectée par le
désir, louable en soi, mais irréalisable par les moyens dont disposait alors
et dont dispose encore aujourd'hui la science, de fonder la physiologie sur la
cosmologie. La théorie purement spéculative de la matière et l'astronomie
étrangement primitive et anthropomorphique de l'époque devaient déjà, par
elles-mêmes, entraîner de graves inconvénients. De même, cette pensée que
l'homme est une image du Tout, un microcosme à côté du macrocosme, ne pouvait
conduire qu'à des comparaisons fantastiques, semblables à celles de Schelling
et d'Oken dans leur philosophie de la Nature. Grande pensée en elle-même, elle
a servi plus souvent, même dans les époques plus avancées, à obscurcir qu'à
éclairer le chemin de la science ; dans celle qui nous occupe, par exemple,
elle a fait établir un rapport entre la mer et le ventre, ce dernier été «
le réservoir universel qui donne à tous et reçoit de tous (17)
». Mais ce n'est pas seulement contre ces barrières objectives que vient se
briser la haute ambition de notre diététicien. Il brille beaucoup plus par la
richesse que parla clarté de la pensée. La sagesse énigmatique d'Héraclite
l'avait pour ainsi dire grisé. Son désir d'illustrer les théories de son
maître par des exemples toujours nouveaux, et empruntés aux domaines les plus
divers de la vie, trouble de la manière la plus fâcheuse le cours tranquille,
l'ordonnance méthodique de son exposition. Il fait aussi le plus grand usage du
droit, légitime au moins en apparence par l'exemple de l'Ephésien et de son
style paradoxal, de se contredire lui-même. Une fois, il parle, tout à fait
selon l'esprit et dans les termes mêmes d'Héraclite, d'une « transformation
» continue et incessante de la matière; une autre fois, comme Anaxagore et
Empédocle, il ramène toute naissance et toute destruction à une combinaison
et à une séparation, et il s'excuse de l'emploi de ces expressions en disant
qu'il se conforme à la manière de voir et de s'exprimer du peuple. Il a
d'ailleurs beaucoup emprunté à Empédocle, sans se donner la peine de mettre
ces emprunts, même extérieurement, en harmonie avec ses principes
héraclitiques. C'est pourquoi il ne tient aucunement, dans l'exposition de
détail, ce qu'il promettait en faisant la déclaration fondamentale par
laquelle s'ouvre son livre. Cette déclaration forme, il est vrai, l'idée
directrice d'un grand nombre de ses prescriptions diététiques, en particulier
quand il traite les questions de l'alimentation et celles qui concernent les
exercices gymnastiques, et à propos desquelles il entre dans une foule de
détails intéressants. Mais cette partie de son entreprise, la plus importante,
a pâti des tentatives, vaines et répétées jusqu'à la satiété, qu'il fait
pour dériver du rapport de ses deux prétendues matières primordiales les
différences des états corporels et même psychiques. Pour être juste,
ajoutons qu'il y a mis à profit une quantité de faits constatés, et qu'il a
imaginé une expérience particulièrement originale, à savoir de provoquer le
vomissement chez individu afin de juger du degré de digestibilité des divers
aliments pris en même temps.
Arrivons au livre par lequel se termine l'ouvrage. On peut lui appliquer le vers
d'Horace : consacré aux songes, il fait songer à la belle femme dont le corps
se termine en queue de poisson. Il commence par établir la distinction, que
nous connaissons déjà par Hérodote, (p. 280) entre les visions surnaturelles
et les visions naturelles. L'explication des premières est abandonnée aux
interprètes qui possèdent - et cela est malheureusement dit sans la moindre
ironie - « une science exacte» sur ce sujet (18).
Mais les songes qui dérivent de causes naturelles permettent de tirer des
inférences relativement à la constitution du corps. Ici, on ne fera pas trop
de difficulté pour admettre que certains songes dénotent un état
d'obstruction, et qu'il y a lieu, par conséquent, de prescrire des purgatifs.
Mais les limites en dedans desquelles, sans promettre une riche moisson, cette
enquête évite l'absurde, sont bien vite franchies. Il ne faut pas longtemps à
notre auteur pour voguer à pleines voiles dans une superstition puérile, et
pour arriver - en se fondant sur des raisonnements dans le style d'Artémidore -
à des ports où nous n'avons nulle envie de le suivre.
Un autre type, caractéristique également, se révèle à nous dans un petit
livre intitulé Des Chairs, qui renferme des traits non moins
contradictoires et par suite non moins attrayants que le précédent (19).
Ce livre renvoie à des pages dont il est la suite, et il annonce une
continuation ; nous sommes donc en présence d'une section seulement d'un
ouvrage étendu Sur la Médecine. On reconnaît dans son auteur un
praticien riche d'expérience, qui a vu beaucoup de choses et sait observer
d'une manière pénétrante, aussi longtemps du moins que des opinions
préconçues ne l'empêchent pas de voir et d'observer sans parti pris. Il est
le premier à savoir que la moelle épinière n'a rien de commun avec la moelle
des os proprement dite, qu'elle est entourée de membranes et en relation avec
le cerveau ; il est donc infiniment plus près que ses prédécesseurs d'en
connaître la vraie nature et la vraie fonction. Il a vu des individus qui
avaient tenté de se couper la gorge, qui se trouvaient dans l'incapacité de
parler parce que le couteau avait pénétré jusque dans la trachée-artère, et
à qui la parole avait été rendue par le rapprochement des lèvres de la
plaie. Il tire de ce fait la conclusion exacte que s'ils ne pouvaient plus se
faire entendre, c'est que leur souffle s'échappait à travers la blessure, et
il met à profit cette observation pour confirmer la théorie vraie de
l'émission de la voix. Mais il ne se contente pas de simples observations de
cette nature, de l'expérience fortuite que pouvait lui fournir une lésion et
le traitement chirurgical qu'elle réclame : il imagine lui-même des
expériences proprement dites, bien que sur une modeste échelle. Il sait que le
sang se coagule quand il est extrait du corps, mais il a su prévenir, en le
secouant, la formation des caillots. Pour se rendre compte de la constitution
diverse des tissus, il les soumet à la cuisson ; il distingue ceux qui se
cuisent plus, ceux qui se cuisent moins facilement, et il tire dé là des
conclusions relativement à leur composition. Mais, à côté de ces
observations excellentes, de ces expériences méthodiques, de ces conclusions
logiques, combien d'observations incroyablement erronées, d'affirmations
arbitraires : il est persuadé que le nombre sept règle tous les phénomènes
de la vie de la nature et de celle de l'homme, et cette croyance l'aveugle
positivement sur l'évidence des faits. Il soutient hardiment, par exemple, que
jamais un foetus de huit mois n'a pu vivre ! À part la durée normale de la
grossesse, neuf mois et dix jours (280 ou 40 fois 7 jours), le terme de sept
mois est le seul selon lui, qui offre des chances de vie. Par contre, il
prétend avoir vu des embryons de sept jours chez lesquels tous les organes
étaient déjà clairement reconnaissables. C'est pareillement chose prouvée
pour lui que l'abstention d'aliments et de boisson ne peut pas durer plus de
sept jours sans amener la mort, soit dans le cours de cette période, soit - à
ce qu'il ajoute assez naïvement - à une époque ultérieure. Même ceux qui,
au bout des sept jours, se sont laissé détourner de cette sorte de suicide
assez fréquente dans l'antiquité, n'ont pu être sauvés, parce que leur corps
était devenu incapable de s'assimiler la nourriture.
Si la rigueur de pensée de notre médecin n'était pas suffisante pour le
préserver du sortilège du nombre, il ne savait pas résister davantage à
d'autres séductions de l'imagination. Mais comment répondre alors autrement
que par la fantaisie à des questions que la science de notre époque, avec les
moyens dont elle dispose, ne peut résoudre sûrement, même d'une manière
approximative ? Il y a plus. Les tentatives auxquelles il se livrait étaient
d'avance frappées de stérilité ; la science moderne écarte même
définitivement comme au delà de ses prises les problèmes qu'il se posait. Il
ne se préoccupait de rien moins en effet que de résoudre l'énigme de la
création organique. Mais comme tout pressentiment de la théorie de
l'évolution lui est étranger, il ne se demande pas ce que les plus hardis de
nos contemporains se sont en vain demandé jusqu'ici : comment les organismes
les plus simples ont pu faire leur apparition sur la terre, mais il veut faire
sortir des substances matérielles, sans aucun intermédiaire, l'homme
lui-même, le couronnement des existences terrestres. Et de quelles substances !
C'est du chaud et du froid, de l'humide et du sec, du gras et du glutineux que,
par la putréfaction et la coagulation, par la condensation et la raréfaction,
par la fusion et la cuisson, se sont formés nos divers tissus et les organes
qui en sont composés. Par exception seulement un « me semble-t-il » vient
introduire un élément de doute et de réserve dans cette exposition d'un
caractère tout à fait dogmatique et tranchant. « Ainsi est né le poumon » ;
« ainsi s'est formé le foie» ; « la raté a pris naissance comme suit » ;
« les articulations se sont composées de cette manière » ; «ainsi se sont
formées les dents » ; - voilà de quelle façon commencent les uns après les
autres les divers paragraphes dans une désolante monotonie. Nos lecteurs sont
sans doute indifférents au contenu de ces paragraphes ; néanmoins ils
n'apprendront pas sans intérêt à quel stade de développement intellectuel se
rattachent ces tentatives prématurées pour pénétrer dans les secrets les
plus intimes de la nature. Mais il est nécessaire de faire une remarque
importante. Si difficile que cela puisse être pour nous, nous devons surmonter
l'accès de mauvaise humeur que nous cause au premier abord la témérité de
l'entreprise, afin de pouvoir reconnaître dans cette enveloppe fantastique le
noyau de raison qui s'y trouve renfermé. Ici, nous voyons poindre une pensée
que la science même de nos jours ne désavouera pas. La médecine, disons-nous
aussi, doit se fonder sur la connaissance des phénomènes pathologiques, et
celle-ci sur là connaissance de la vie normale ; la connaissance des fonctions
corporelles présuppose la connaissance des organes dont elles dépendent ;
celle-ci ne peut s'acquérir si l'on ne se rend compte d'abord de leurs parties
constitutives ainsi que des matières et des forces qui agissent en eux et sur
eux, et finalement, pour parler avec Aristote : « Celui qui verrait croître
les choses dès le commencement les verrait de la manière la plus parfaite (20)
». En d'autres termes : la thérapeutique doit se fonder sur la pathologie,
celle-ci sur la physiologie et l'anatomie ; ces deux dernières sur
l'histologie, la chimie et la physique ; la théorie de la descendance nous
montre le chemin qui conduit des organismes les plus infimes ou les plus simples
jusqu'aux plus élevés et aux plus compliqués ; et, comme but suprême de ce
long voyage, brille enfin à nos yeux la perspective de jeter un jour un regard
sur la naissance du monde organique lui-même. Dans l'essai en présence duquel
nous nous trouvons, tous les degrés intermédiaires font défaut ou du moins ne
sont indiqués que de la manière la plus vague et la plus indécise ; la fin de
cette longue série est rattachée, autant dire sans aucune transition, à son
commencement. Mais la témérité qui caractérise en une mesure si
exceptionnelle l'oeuvre de notre auteur, cesse de nous surprendre dès que nous
envisageons cette oeuvre comme le produit d'une pensée encore dans l'enfance.
Animé d'espérances démesurées, l'esprit qu'aucun échec n'a rendu prudent se
flatte d'atteindre sans difficulté les buts les plus élevés de la
connaissance, parce qu'il les voit à la portée de ses prises. L'auteur du
livre Sur les Chairs est précisément un disciple de la philosophie de
la Nature; non seulement l'esprit dans lequel il entreprend ses recherches, mais
encore de nombreux détails de sa doctrine nous font reconnaître en lui un
homme qui s'est inspiré d'Héraclite, d'Empédocle et d'Anaxagore, et qui a
écrit dans un temps où la fusion éclectique de leurs doctrines avait déjà
commencé. Ne se réfère-t-il pas, au début de son livre, aux «enseignements
communs » de prédécesseurs à l'oeuvre desquels il a contribué pour sa part,
et ne se croit-il pas obligé de parler « des choses célestes autant qu'il
faut pour montrer, quant à l'homme et au reste des animaux, quelles parties
sont nées et se sont formées, ce qu'est l'âme, ce qu'est la santé et la
maladie, ce qu'est le bien et le mal dans l'homme, et par quelle cause il meurt
». Comme principe primordial, il indique « le chaud, qui est immortel, a
l'intelligence de tout, voit, entend, connaît tout, le présent comme l'avenir
». La plus grande partie de la masse constituée par ce corps premier a disparu
dans les régions supérieures de l'espace céleste lors de cette « secousse »
du Tout qui, pour notre médecin comme pour Anaxagore et pour Empédocle, est le
point de départ des phénomènes cosmiques ; c'est précisément, nous dit-il,
ce que les Anciens ont appelé « éther ». Quand nous aurons ajouté que la
révolution de l'univers lui apparaît aussi comme une suite de cette secousse,
nous aurons indiqué tout ce qui, dans sa théorie fondamentale, mérite d'être
relevé.
Nous ne nous arrêterons pas longtemps non plus à un livre Sur le Nombre
Sept, dont la plus grande partie ne nous a été conservée que dans une
traduction arabe et dans une traduction latine, et que nous considérons comme
la suite de l'ouvrage très improprement intitulé Des Chairs (21).
La croyance populaire en l'extraordinaire signification de ce nombre y acquiert
son plus merveilleux développement et y déploie les floraisons les plus
luxuriantes. Une fois encore, nous y apprenons que « l'embryon prend forme au
bout de sept jours et dénote alors son origine humaine ». De nouveau, on nous
présente, comme dans les livres Sur le Régime, les sept voyelles,
c'est-à-dire les signes des voyelles grecques, parmi lesquelles figurent le e
et le o longs, tandis que le a, le i et le u longs ne sont l'objet d'aucune
mention particulière, parce que, par hasard, l'écriture grecque ne les
distingue pas des a, i et u brefs ! Le grave Solon lui-même avait déjà
traité de la valeur du nombre sept pour la délimitation des âges de l'homme.
Mais, pour notre auteur, l'Univers lui-même, les vents, les saisons, l'âme
humaine, le corps humain, les fonctions de la tête, tout sans exception, doit
ressentir les effets et porter l'empreinte du chiffre sept. Une seconde pensée
domine ce petit écrit, pensée que nous a déjà fait connaître le livre Sur
le Régime : c'est la comparaison des individus avec le Tout, l'analogie du
microcosme et du macrocosme. Écoutons à ce sujet notre auteur lui-même : «
Les animaux et les plantes qui vivent sur la terre ont. une constitution qui
ressemble à celle du Tout. Donc, grâce à cette ressemblance collective, les
parties de ces êtres doivent révéler une composition analogue à celle des
parties du monde... La terre est ferme et immobile; elle ressemble, dans ses
éléments pierreux et solides, aux os... Ce qui entoure ces éléments est
analogue à la chair de l'homme et est soluble... L'eau, dans les rivières,
ressemble au sang qui coule dans les veines », etc., etc. Les deux pensées
s'amalgament dans cette comparaison de la terre avec le corps humain, qui frise
l'absurde, et où l'écrivain envisage, avec un égal arbitraire, sept parties
de chaque côté pour les opposer l'une à l'autre. Le Péloponnèse, « demeure
des hommes au grand esprit, » est mis en parallèle avec la « tête et le
visage » ; l'Ionie avec le diaphragme, l'Égypte et la mer égyptienne avec le
ventre, etc. Ces écarts d'une imagination déréglée n'ont d'analogues
peut-être que dans l'alchimie des Arabes avec ses sept métaux, ses. sept
pierres, ses sept corps volatils, ses sept sels naturels et ses sept sels
artificiels, ses sept sortes d'alun, ses sept opérations chimiques
fondamentales, etc. Ils étaient faits pour produire une réaction. La réaction
n'a pas manqué, en effet, et elle a été l'aurore de la vraie science grecque
et occidentale.
Sans
intrépidité, sans mépris du danger, pas de science ou du moins pas de science
de la nature. La conquête d'un domaine nouveau de la connaissance ressemble
sous beaucoup de rapports à la prise de possession d'un pays encore vierge.
Tout d'abord, des généralisations puissantes et qui ne reculent devant aucun
obstacle relient - semblables à autant de grandes routes - une foule de points
disséminés et jusqu'alors isolés. De hardis raisonnements par analogie
franchissent ensuite, tels des ponts immenses, des abîmes béants. Enfin la
construction d'hypothèses fournit des demeures qui offrent, provisoirement au
moins, un abri jusqu'à ce que des constructions moins frustes, assises sur des
fondements plus profonds et faites de matériaux plus durables, viennent prendre
leur place. Mais malheur à la colonie, si la main de ses fondateurs s'est
laissé guider par un zèle aveugle plutôt que par le froid raisonnement. Le
trafic se retirera de ses routes désertes, ses somptueux palais tomberont en
ruines, ses habitations seront abandonnées. Voilà le sort qui menaçait les
produits intellectuels de l'époque dont nous nous occupons. Aux années
d'apprentissage, consacrées simplement à réunir des faits, avaient succédé
les années itinérantes, marquées par une spéculation inquiète et vagabonde.
Ces années avaient assez longtemps duré ; elles devaient, pour que la science
pût devenir stable et se fixer, au lieu de dégénérer en un jeu d'esprit vain
et de se perdre dans des cercles vicieux, faire place aux années de maîtrise ;
il fallait en un mot élaborer, dans un travail tranquille et méthodique, les
matériaux que l'on avait amassés. C'est la gloire éternelle de l'école de
Cos, d'avoir provoqué cette révolution dans le domaine de la médecine, et
d'avoir, par là, exercé la plus salutaire influence sur l'ensemble de la vie
intellectuelle de l'humanité. « Fiction à gauche ! Réalité à droite ! » -
tel fut son cri de guerre dans la lutte qu'elle engagea la première contre les
excès et les défauts de la philosophie de la nature. Et qui donc aurait pu
engager cette lutte à sa place? La sérieuse et noble profession du médecin le
met chaque jour, chaque heure, en communion intime avec la nature ; les erreurs
théoriques qu'il peut commettre en l'exerçant produisent les conséquences
pratiques les plus funestes; elle a donc contribué en tout temps à développer
le sens le plus pur et le plus incorruptible de la vérité. Les meilleurs
médecins doivent être les meilleurs observateurs. Or celui qui possède des
sens vigoureux, fortifiés encore et affinés par un exercice continuel, qui a
la vue perçante et l'ouïe fine, ne peut, à part de rares exceptions, être un
rêveur ou un visionnaire. La ligne de démarcation qui sépare la réalité des
créations de l'imagination devient pour lui plus profonde, et s'élargit en
quelque sorte en un abîme infranchissable. La guerre contre les irruptions de
la fantaisie dans le domaine de la connaissance le trouvera toujours à son
poste. Au XIXe siècle également, c'est par les médecins que nous
avons été délivrés d'une philosophie arbitraire. Les réquisitoires les plus
amers contre les écarts de la pensée et contre les funestes effets qui en
découlent sortent encore aujourd'hui des lèvres d'hommes qui se sont assis un
jour aux pieds du grand physiologiste et anatomiste Jean Müller. Qu'on
n'objecte pas qu'entre la philosophie de la nature d'un Schelling ou d'un Oken
et celle d'un Héraclite ou d'un Empédocle, il n'y a qu'une ressemblance
purement nominale, extérieure et fortuite. Il est plus important de faire
remarquer que le défaut de rigueur dans la pensée, qui forme le trait
caractéristique commun de cette tendance dans les temps modernes comme dans
l'antiquité, était infiniment plus pardonnable alors que de nos jours. Ce qui,
aujourd'hui, nous apparaît comme une dégénérescence, une réaction, comme
une faiblesse sénile, était alors le phénomène concomitant de la lutte que
soutenait l'esprit scientifique pour se dégager peu à peu des conceptions
mythiques de l'enfance du monde. Quoi qu'il en soit, dans un cas comme dans
l'autre, il s'agissait de dissiper des ombres ; là elles tendaient à obscurcir
une lumière à peine allumée ; ici, elles menaçaient d'éteindre un flambeau
qui brillait depuis longtemps déjà d'un vif éclat.
C'est l'auteur de l'ouvrage Sur l'ancienne Médecine qui ouvre le combat
sur toute la ligne (22). Pénétré de
l'élévation et de la dignité de son art, persuadé de son immense valeur pour
le bien-être et la prospérité des hommes, il ne veut pas rester indifférent
en présence d'un mouvement qui tend à le déprécier, à supprimer toute
distinction entre bons et mauvais médecins, et, ce qui est plus important
encore, à saper l'édifice de la science elle-même. Ce n'est pas contre tel ou
tel résultat des recherches de ses adversaires qu'il s'insurge ; il attaque le
mal à sa racine. C'est la méthode elle-même de l'art « nouveau » de guérir
qu'il condamne sans égard et sans réserve. « On n'a pas le droit, dit-il, de
fonder sur une hypothèse l'art de la médecine. Sans doute, cela est assez
commode. On se rend les choses tout à fait faciles en admettant une seule cause
fondamentale de maladie et de mort, la même pour tous les hommes, et en la
représentant par un ou deux facteurs, le chaud ou le froid, l'humide ou le sec,
bref la première chose venue... Mais l'art de guérir - qui n'est pas un
semblant d'art et qui d'ailleurs a affaire aux objets sensibles - possède
depuis longtemps tout ce qui lui est nécessaire : un principe et une voie
frayée, le long de laquelle, dans le cours des âges, de nombreuses et
magnifiques découvertes ont été faites ; le long de laquelle il découvrira
ce qu'il ignore encore, si des hommes suffisamment doués et armés des
connaissances acquises jusqu'ici les prennent pour point de départ de
recherches ultérieures. Mais celui qui rejette et méprise tout cela pour
poursuivre ses investigations dans une autre voie et sous d'autres formes, et
prétend avoir fait quelque découverte, celui-là est trompé et se trempe
lui-même, car c'est là chose impossible. » Au premier abord, il semble qu'on
entende la voix de quelque partisan encroûté des traditions, de quelque
réfractaire à toutes les nouveautés. En réalité, il n'en est point ainsi,
et ce serait faire tort à notre auteur que de le croire. Il justifie fort bien
sa préférence exclusive pour la méthode ancienne et empirique - nous ne
disons pas inductive. En premier lieu, il en indique les mérites, et les met
dans la plus vive lumière en élargissant considérablement l'idée de la
médecine au-delà de ce que l'usage ordinaire de la langue entendait par ce
mot. Non seulement la diététique, au sens complet de ce terme, fait pour lui
partie intégrante de l'art de guérir ; il fait aussi rentrer dans son étude
le changement d'alimentation de l'humanité depuis l'époque reculée où, comme
il le remarque excellemment, elle partageait la rude nourriture des animaux,
jusqu'au moment où la civilisation amène les raffinements de la table. Si
simple et naturelle que la chose nous paraisse maintenant, cela n'en a pas moins
été « une grande invention, qui, pour se développer et se perfectionner dans
le cours des siècles, a exigé une mesure peu ordinaire d'intelligence et
d'imagination ». Les expériences que l'on a faites, dans les temps primitifs,
de la difficulté de supporter cette nourriture sauvage, sont tout à fait
analogues à celles qui ont porté les médecins à interdire à leurs patients
le régime de l'homme sain pour leur en prescrire un approprié à leur état.
Il n'y a pas lieu sans doute de s'étonner que la partie de l'art de se bien
porter que chacun connaît jusqu'à un certain point ait été séparée de
celle que possède seul le médecin professionnel. En vérité, toutefois, la
science est une, et dans les deux cas elle a procédé exactement de la même
manière. Il s'agissait de mélanger, d’adoucir, de diluer les mets que le
corps humain ne pouvait digérer, et cela de telle façon que l'organisme sain,
dans le premier cas, l'organisme malade dans le second, pussent se les assimiler
et en tirer profit. Après ces considérations, notre auteur en vient aux
différences individuelles qui se font jour en ce qui concerne le régime
alimentaire, et qu'il illustre par une riche collection d'exemples. Ces
différences reposent en partie sur des différences de tempérament, en partie
sur l'habitude, et l'on ne peut en rendre compte par un principe général
quelconque, mais seulement par une observation suivie et des plus attentives. La
nécessité qui résulte de là d'un traitement strictement individuel ne permet
pas de prescrire chaque fois le traitement approprié avec une précision
mathématique. L'auteur aperçoit une autre et non moins féconde source
d'erreur dans le fait qu'il y a des dangers de nature exactement contraire. Il
s'agit d'être en garde également contre le trop et contre le trop peu, contre
une alimentation trop forte et concentrée et contre une alimentation trop
diluée et trop faible. Dans cette exposition, nous voyons poindre pour la
première fois l'idée d'une science exacte, c'est-à-dire qui admette la
détermination de quantités, mais comme un idéal qu'il ne peut être question
d'atteindre jamais dans le domaine de la diététique et de la médecine. « Il
faut viser à une mesure, lisons-nous chez le médecin grec, mais une mesure,
poids ou nombre, qui puisse te servir de norme, tu ne la trouveras pas, car il
n'y en a pas d'autre que la sensibilité corporelle. » Et puisque cette mesure
n'est qu'approximativement exacte, et non rigoureusement, on ne peut éviter de
s'écarter légèrement, à droite ou à gauche, de la ligne moyenne du vrai.
Honneur au médecin qui ne se rend coupable que de légères fautes ! Mais la
majorité ressemblent sans doute à ces pilotes qui, par une mer tranquille et
un ciel serein, commettent impunément de nombreuses erreurs, et dont
l'incapacité se révèle de la manière la plus funeste quand se déchaîne une
tempête violente.
D'une importance plus décisive est l'objection élevée ensuite contre la
nouvelle médecine, à savoir que ses prémisses et ses prescriptions ne
répondent pas aux multiples aspects de la réalité. La doctrine nouvelle - et
par là il faut entendre aussi bien celle d'Alcméon que celle que développent
les livres Du Régime - ordonne « de recourir au froid contre le chaud,
au chaud contre le froid, à l'humide contre le sec, au sec contre l'humide ;
chaque fois que l'un de ces facteurs a exercé quelque influence fâcheuse, il
faut y parer en faisant intervenir son contraire... Malheureusement ces
médecins n'ont encore, que je sache, découvert rien qui soit chaud, froid, sec
ou humide, en soi et sans mélange d'aucune autre qualité. À ce que je pense,
ils n'ont à leur disposition que les mets et les boissons dont nous autres nous
nous servons tous. Il est donc impossible qu'ils ordonnent au malade « un chaud
». Car aussitôt le malade demanderait : Quel chaud? Sur quoi ils en seraient
réduits de toute nécessité ou à un verbiage dépourvu de sens ou à l'emploi
de l'une des choses connues. » Dans ce cas, en revanche, il serait de la plus
haute importance de distinguer si le chaud est en même temps astringent ou
laxatif... ou de laquelle il est doué des nombreuses autres propriétés qui se
rencontrent dans la nature - car ces différences de propriétés font sentir
leurs effets non seulement aux hommes, mais encore au bois, au cuir et à
beaucoup d'autres objets infiniment moins sensibles que le corps humain.
Mais le passage le plus important du livre dont nous nous occupons est bien
celui-ci, dans lequel l'auteur exprime d'une manière particulièrement incisive
son principe fondamental : « Quelques-uns disent, médecins aussi bien que
sophistes (par quoi, à notre avis, il entend désigner simplement des
philosophes), qu'il n'est pas possible de savoir la médecine sans savoir ce
qu'est l'homme, et que celui qui veut habilement pratiquer l'art de guérir doit
posséder cette connaissance. Ce discours fait allusion à la philosophie telle
que l'ont pratiquée Empédocle et les autres qui ont écrit et disserté sur la
nature, sur l'essence de l'homme, sur son origine, sur la façon dont ses
diverses parties se sont jointes les unes aux autres. Je crois, pour ma part,
que toutes les choses de ce genre qu'un sophiste ou un médecin a dites ou
écrites sur la nature sont moins du ressort de la médecine que de celui de la
peinture. Je pense, au contraire, qu'on ne peut acquérir une connaissance
certaine de la nature qu'en prenant comme point de départ la science médicale.
Or celle-ci peut s'acquérir à la condition qu'on l'étudie selon les moyens
propres à ce but et en l'embrassant dans toute son étendue. Mais il me semble
qu'il y a encore un bien long chemin à parcourir pour arriver à une science
qui puisse nous dire, jusque dans le plus petit détail, ce que c'est que
l'homme et pour quelle raison il est venu au monde. »
Certains points, dans ce passage, réclament des éclaircissements ; d'autres
demandent qu'on s'y arrête un peu. Tout d'abord, ce qui surprend, c'est la
répétition presque littérale des premiers mots du passage que nous avons
emprunté au livre Sur le Régime, et dans lequel la proposition si
vigoureusement contestée ici est soutenue avec non moins de vigueur (23).
Il n'est guère possible de méconnaître une intention de polémique directe,
et cet exemple nous montre d'une manière saisissante ce que nous devons penser
de l'unité de la collection des ouvrages attribués à Hippocrate. L'évocation
de la peinture dans ce raisonnement peut nous rendre un moment perplexes. Mais
un peu de réflexion nous montre que l'auteur n'aurait guère pu donner à sa
pensée une expression plus appropriée. Ce qu'il veut dire, c'est évidemment
ceci : « Des tableaux comme ceux que nous fait Empédocle de la naissance des
animaux et de l'homme peuvent être attrayants, séduisants, fascinants, mais ce
n'est pas de la science. La science ne vise pas à l'amusement, mais à la
vérité ; à ce point de vue, le domaine des beaux-arts peut être envisagé
comme son contraire, car ce qui prédomine en lui, c'est le jeu de l'invention
qui dispose librement des lignes et des couleurs. » Comme type des beaux-arts,
c'est la poésie que nous nommons le plus volontiers ; mais elle n'eût pas
été à sa place ici en raison de ta forme poétique de l'oeuvre d'Empédocle,
et elle eût peu convenu pour en désigner précisément le contenu. La manière
rude, presque brutale, avec laquelle l'écrivain oppose l'une à l'autre la
fiction et la réalité et bannit pour ainsi dire la première du domaine de la
discussion sérieuse nous rappelle la déclaration, à peine moins tranchante,
d'Hérodote relativement à l'Océan (cf. p. 286). Nous aimerions voir
développée plus à fond cette idée que la science médicale, cultivée comme
elle doit l'être et dans toute son ampleur, est le point de départ de toute
connaissance vraie de la nature. Avons-nous le droit de supposer que l'auteur de
cette phrase a au moins entrevu la vérité, à savoir que toute science de la
nature n'est que relative, que le but de la connaissance à laquelle nous
pouvons atteindre n'est point ce qu'elle est en elle-même, mais seulement ce
qu'elle est par rapport aux facultés perceptives de l'homme? C'est du moins à
une conclusion de ce genre que tend la suite de cet important passage, dont nous
ne voulons pas priver nos lecteurs : « Car il me semble nécessaire, à moi
aussi, continue l'auteur, que tout médecin ait une connaissance de la nature,
et qu'il fasse pour l'acquérir ses plus grands efforts, s'il veut être à la
hauteur de sa tâche. (Il doit savoir notamment) ce que l'homme est relativement
aux aliments et aux boissons qu'il prend, ce qu'il est par rapport à ce qu'il
fait : quel effet chaque chose produit sur chaque homme. Et (il ne suffit pas)
de penser que le fromage est une mauvaise nourriture parce qu'il cause des
désagréments à celui qui en mange trop, mais (il s'agit de savoir) quels
désagréments il cause, pourquoi il les cause, et à quelle partie du corps
humain il est contraire. Car il y a beaucoup d'autres mets et de boissons qui,
par leur nature, sont nuisibles, et qui cependant n'affectent pas l'homme de la
même manière. Comme exemple, je citerai le vin qui, pris non coupé d'eau et
en grande quantité, affecte l'homme d'une certaine manière. Et l'évidence
apprend à tous que cela est l'oeuvre et l'effet du vin. Nous savons également
par l'intermédiaire de quelles parties du corps il produit surtout cet effet.
Je désirerais voir répandre une égale clarté sur les autres cas de ce genre.
» Cette citation, aussi, demande un mot d'explication. Tout d'abord, que l'on
note le contraste frappant et voulu, croyons-nous, entre l'exemple trivial
invoqué plus haut et le ton familier dans lequel il est exposé d'une part, et,
d'autre part, les pensées sublimes et le style généralement magnifique
d'Empédocle et de ses adhérents. « Moi aussi, semble crier l'adversaire des
philosophes à ceux-ci, j'aspire à une connaissance compréhensive de la
nature, aussi bien que vous qui croyez déjà avoir débrouillé les fils de ses
énigmes les plus cachées, et qui proclamez votre triomphe en termes ampoulés.
Mais combien sont modestes mes buts immédiats, comme je reste en arrière du
vol audacieux de vos pensées, comme je m'attache au terre à terre des
événements ordinaires et des questions de tous les jours, qui cependant n'ont
trouvé jusqu'ici leur solution qu'en très petit nombre ! » L'excellent
écrivain se croit aussi dégagé que possible de toute témérité et de tout
orgueil de savant. Et pourtant, c'est justement là que l'attend le destin : la
Némésis le châtie de la raillerie amère qu'il déverse si généreusement
sur ses prédécesseurs. En raison de la preuve qu'il fournit du bon aloi de sa
science, on serait tenté de s'écrier que sa modestie se révélé immodeste,
que son humilité et son renoncement ne sont qu'orgueil et présomption ! Le peu
qu'il se flatte de savoir d'une manière si précise, ce qui pour lui est
vérité évidente, n'est qu'un semblant de science. Car la chimie de la
digestion lui étant aussi étrangère que la connaissance des fonctions du
cerveau, du coeur et des vaisseaux sanguins, les explications qu'il donnait du
peii de digestibilité du fromage et de l'ivresse produite par l'absorption du
vin étaient, quelles qu'elles aient été, radicalement fausses.
Cette étrange, nous allions presque dire humiliante constatation provoque chez
nos lecteurs et en nous-même une question. Que servait au clairvoyant médecin
son horreur de l'arbitraire, toute la satisfaction qu'il éprouvait à se borner
à l'investigation des faits, ses perpétuels emportements contre ceux qui
détournaient la médecine de son ancienne voie pour l'entraîner dans celle de
l'hypothèse? N'a-t-il pas cédé lui-même, sans s'en apercevoir, aux
séductions de la recherche conjecturale? Car, si l'on y regarde de près, on
voit qu'il ne s'agit pas ici simplement. d'une ou de plusieurs observations
fausses, ni de l'interprétation erronée de faits isolés, mais de tentatives
d'explication qui découlent évidemment de vues purement hypothétiques sur la
physiologie. Cela nous donne-t-il le droit de rabaisser ou de condamner les
travaux scientifiques de cet homme, ou du moins. de tenir sa polémique pour
absolument oiseuse et frivole? Ni l'un ni l'autre. Nous devons sans doute
recourir à une digression pour fonder notre jugement, mais nous ne craignons
pas ce détour, qui nous conduira sur une hauteur d'où, nous l'espérons, nous
pourrons apprécier d'une manière plus juste et plus compréhensive les deux
tendances ici en conflit.
Une
hypothèse consiste à admettre ou à supposer quelque chose. Lorsque, et aussi
longtemps que la pleine certitude de la science nous échappe, il est
nécessaire, et nécessaire doublement, de recourir à de simples suppositions :
l'objet même de l'étude nous y force, et elles s'imposent à la personne du
chercheur. Elles s'imposent à nous parce qu'il n'a pas été donné à l'esprit
humain d'emmagasiner et de garder une longue série de détails sans les
rattacher les uns aux autres par un lien commun. La mémoire veut être
soulagée ; et ce soulagement lui est apporté, dans le domaine de la
coexistence, par la classification; dans celui de la succession et de la
causalité par l'hypothèse. En dehors même de ce cas, l'aspiration à la
connaissance et à l'intelligence des causes ne peut exister réellement sans se
manifester, au moins à titre de tentative, déjà dans les premiers stades
d'une investigation. Mais des tentatives de ce genre sont absolument
indispensables aussi comme préliminaires des solutions vraies, réservées à
une phase ultérieure et plus mûre de développement. Presque tout ce qui,
aujourd'hui, est théorie certaine, a été un jour, comme on l'a remarqué avec
raison, hypothèse. Il est impossible subjectivement de garder comme éléments
épars d'une conception, et d'isoler pour ainsi dire psychiquement les uns des
autres, les innombrables faits de détail qui serviront à l'élaboration finale
d'une théorie compréhensive jusqu'au moment où celle-ci sera construite; de
même, il est absolument impossible, objectivement, de rechercher, de réunir,
de trier des faits isolés ou même de les produire en recourant à des moyens
artificiels tels que les expériences scientifiques, à moins qu'une supposition
ou hypothèse préalable et anticipant sur le résultat final ne vienne guider
les pas du chercheur et éclairer son sentier. Même là où il ne s'agit pas de
formuler des vérités générales, mais seulement d'établir des faits qui ne
se sont produits qu'une fois, on se sert exactement du même procédé. Avant de
prononcer sa sentence, le juge apprécie les soupçons qui pèsent sur
l'accusé, et chacun de ces soupçons s'exprime par une supposition ou
hypothèse. De plus, si son esprit a quelque vivacité, il ne pourra prendre
connaissance des dépositions des témoins et des autres indices recueillis sur
la base d'une première hypothèse, sans qu'à chaque phase du procès
surgissent de nouvelles hypothèses, et celles-ci équivaudront, si son esprit
est non seulement vif, mais juste, à de nouvelles et toujours plus exactes
approximations de la vérité qu'il s'agit d'établir. La supposition préalable
ne faut qu'en deux cas à son but, qui est de préparer le triomphe final de la
vérité : par suite d'une erreur du sujet imputable à quelque défaillance
d'intelligence ; ou par suite d'une erreur objective résultant des moyens
d'investigation employés. L'hypothèse ne facilite pas, mais elle complique, au
contraire, ou empêche la solution définitive lorsque l'esprit du chercheur n'a
pas la mesure nécessaire de souplesse, oublie le caractère provisoire de ses
conjectures, s'y arrête prématurément, et considère le chemin parcouru par
lui peut-être très court - comme représentant tout le chemin à parcourir.
Mais une hypothèse est aussi dépourvue en soi de valeur scientifique, ou du
moins elle n'a cette valeur qu'à un faible degré, lorsqu'en raison de sa
nature elle n'est pas susceptible de devenir de vérité provisoirement
accueillie vérité définitivement démontrée, en d'autres termes, lorsqu'elle
se refuse tout à fait à la vérification.
Il serait déraisonnable d'attendre une pleine clarté sur cette question et sur
les questions connexes de méthode de la part du premier écrivain chez lequel
nous trouvions des considérations sur la valeur des investigations par le moyen
de l'hypothèse, du premier même - pour autant que l'on peut l'affirmer en
présence de tant d'ouvrages perdus - qui ait employé le mot hypothèse
lui-même dans un sens technique. Il est d'autant plus honorable pour lui que la
plus importante des distinctions applicables ici ne lui ait pas échappé. Il
emploie, il est vrai, le terme d'hypothèse d'une manière un peu lâche, sans
distinguer expressément les hypothèses vérifiables de celles qui ne le sont
pas ; mais la fureur de son attaque est dirigée contre ces dernières, et c'est
à cette sorte de contrefaçon de l'hypothèse qu'il parait songer clairement
toutes les fois qu'il brise une lance contre la recherche hypothétique en
général. Car lorsqu'il réclame contre l'application de la nouvelle méthode
à la médecine, il fonde son objection sur une remarque très significative.
Cette science, dit-il en substance, n'a pas besoin, comme les choses invisibles
et insondables, d'hypothèses vicies. Sans doute, celui qui veut énoncer
quelque opinion relativement à ces choses doit recourir à l'hypothèse. Ainsi
quand il s'agit des choses du ciel ou de celles qui sont sous la terre. Même si
quelqu'un savait et disait la vérité à ce sujet, ni lui ni ses auditeurs ne
sauraient clairement si c'est la vérité ou pas. Car il ne peut recourir à
rien pour acquérir une pleine certitude (24).
Inscrivons tout d'abord à l'actif de la science ce qualificatif précieux de
vide appliqué à l'hypothèse indémontrable, indémontrable et par conséquent
analogue à une fiction oiseuse, qu'il faut bannir du domaine de la vraie
recherche. Souvenons-nous en outre de cette déclaration par laquelle Xénophane
(cf. p. 176) insistait avec tant de force sur l'importance de la vérification,
et avec laquelle le passage que nous venons de citer offre, du moins dans le
texte original, une analogie frappante. Enfin n'oublions pas non plus l'opinion
exprimée par l'historien Hérodote (cf. p. 286), et qui témoigne d'un
sentiment tout à fait identique. Et maintenant, cherchons à nous rendre compte
du gain qui découle de ces déclarations de principe. Le combat que livre notre
auteur à la recherche hypothétique, dans laquelle nous avons reconnu qu'il
condamnait une espèce particulière d'hypothèse, ne l'empêchait pas
nécessairement de recourir lui-même à l'hypothèse, et l'on ne peut, de ce
chef, lui faire le reproche d'inconséquence. Qu'il se formât sur le processus
de la digestion et sur les causes de l'ébriété des conceptions
hypothétiques, cela était inévitable; il était inévitable également que
ces conceptions et toutes celles qu'a formulées l'enfance de la physiologie et
des sciences sur lesquelles s'appuie celle-ci se révélassent erronées à
mesure que la science progressait. Mais autre chose est une hypothèse inexacte,
autre chose et même chose très différente est une hypothèse contraire à la
science, c'est-à-dire une hypothèse qui se soustrait à toute possibilité de
vérification totale ou partielle. Mais, pourrait-on objecter, une hypothèse ne
porte pas toujours la marque visible de son appartenance à l'une ou à l'autre
de ces catégories ; on ne voit pas toujours au premier abord si elle est
condamnée à rester éternellement hypothèse, ou si elle porte en elle la
possibilité de développer elle-même ses moyens de preuve, qui permettront de
juger définitivement, au moins d'une manière approximative, de son exactitude
ou de sa fausseté. Pas toujours, répondons-nous, assez souvent pourtant. Mais
nous n'avons pas à nous arrêter sur ce point; car le « chaud » et le «
froid », le « sec » et l'« humide », envisagés comme les parties
constitutives essentielles de l'organisme humain ou comme les principaux parmi
les facteurs qui agissent sur lui, n'étaient pas même, à parler
rigoureusement, des hypothèses; ce n'étaient que des fictions, ou mieux encore
des abstractions revêtues d'une apparence de réalité. Des qualités isolées
avaient été séparées de l'ensemble de propriétés avec lesquelles elles
sont indissolublement liées en réalité, et en outre elles avaient été
investies d'une suprématie à laquelle elles n'ont évidemment pas droit ; en
effet, le changement de température et d'état d'agrégation dont il s'agit ici
n'a pas absolument et toujours pour suite un changement décisif de tous les
autres attributs. C'est un des plus grands mérites positifs de l'écrit qui
nous occupe d'avoir insisté sur cette circonstance, et montré l'importance
bien plus considérable des propriétés chimiques des corps, en jetant en même
temps on coup d'oeil sur les effets que celles-ci produisent sur des substances
qui n'appartiennent pas à l'organisme vivant (cf. p. 317). C'est donc avec
raison que l'auteur du livre pouvait ne voir dans le froid et la chaleur que des
qualités et ne leur attribuer qu'une influence (relativement) très restreinte
sur le corps ; avec raison qu'il pouvait rappeler, par exemple, la réaction de
chaleur produite intérieurement par un bain froid, et les réactions analogues.
Mais laissons là ces détails, et même la question de savoir laquelle de ces
hypothèses présentait le caractère le plus scientifique, la plus grande
mesure de légitimité, pour revenir à la querelle de méthode dont nous avons
occupé nos lecteurs, et à laquelle nous devons accorder une attention
prolongée et exclusive. Cette querelle peut s'apaiser sans de trop grandes
difficultés. « Partir du connu ou du sensible pour conclure à l'inconnu),
telle est la règle de la saine raison ; elle était aussi familière à un
Hérodote et à un Euripide que plus tard à un Epicure (25),
mais elle a été violée d'une manière aussi évidente que grossière par les
médecins qui suivaient les traces des philosophes naturalistes. Des problèmes
que la science actuelle considère comme insolubles, tels que celui de l'origine
de la vie organique ou de l'origine du genre humain furent inscrits en tète de
leur programme, et les principes de l'art de guérir furent fondés sur les
essais non seulement hypothétiques, mais fantastiques, que l'on fit pour les
résoudre. Qui donc pourrait être surpris de la réaction qui se produisit, et
qui pourrait en mettre en doute les effets salutaires ? Toutefois il y a lieu,
encore ici, de se garder de partialité et d'exagération. Non seulement il
était inévitable qu'on s'engageât dans la « nouvelle voie », mais celle-ci
n'était pas absolument et exclusivement une voie d'erreur. Il ne pouvait pas se
faire que les doctrines de la philosophie appliquée à la nature ne
pénétrassent pas les sciences particulières et ne commençassent pas à en
transformer les méthodes. L'élément d'arbitraire inhérent à la plupart de
ces doctrines devait, comme nous l'avons déjà remarqué une fois, être
éliminé, mais cette élimination n'a pas annulé tous les effets, dont
plusieurs très heureux, de ces influences. Et d'abord, l'idéal qu'on se
propose n'est jamais complètement perdu pour la postérité, même si les
tentatives qu'on fait pour le réaliser échouent d'une manière pitoyable,
voire !grotesque. Or c'était un idéal que d'arracher la science médicale à
l'isolement dans lequel elle était menacée de s'étioler avec le temps, et de
la considérer comme un rameau de l'arbre puissant des sciences de la nature.
Tout d'abord, il est vrai, et pour de longues années encore, cette ambitieuse
entreprise manquait de la base nécessaire, et il fallait par conséquent une
volte-face, qui fût en même temps un retour aux méthodes de recherche plus
anciennes et confinées dans de plus étroites limites. Ici encore, il convient
de se garder de plus d'un malentendu. Il est peu exact de résumer les rapports
des deux tendances en conflit dans la formule conventionnelle, et de dire
qu'avec la philosophie de la nature a succombé la fausse méthode déductive,
et qu'avec Hippocrate a triomphé la vraie méthode, qui est celle de
l'induction. Car lorsqu'il s'agit de phénomènes extrêmement compliqués, de
processus généraux composés d'une infinité de processus particuliers, quelle
méthode pourrait être appropriée et recommandable, si ce n'est celle qui
consiste à bâtir l'ensemble au moyen de ses parties, et à ramener les lois
soi-disant empiriques (c'est-à-dire dérivées) aux lois causales simples ou
dernières d'où elles résultent ? Si alors la science devait et si elle doit
même encore aujourd'hui faire usage de méthodes plus grossières et répondant
moins bien à leur objet, ce n'est pas que celle de la déduction soit fausse ou
contradictoire, c'est qu'elle ne peut être employée avec succès que dans un
stade infiniment plus avancé de développement scientifique ; c'est qu'alors la
pathologie manquait - comme elle en manque encore partiellement aujourd'hui - de
base anatomique et physiologique, que la physiologie ne connaissait point
l'organisation de la cellule et les lois de la physique et de la chimie. On
inaugurait une période de transition dont nous ne sommes point encore sortis,
puis-que les parties les plus avancées de la biologie commencent seulement à
admettre l'emploi, et l'emploi partiel, de la déduction, et ne font par
conséquent que d'entrer dans la dernière et la plus haute phase de l'étude
scientifique. Le type de la déduction est le calcul, et celui-ci trouve
actuellement son emploi tous les jours dans l'oculistique, dans la mesure où
celle-ci est fondée sur l'optique. Mais d'autres branches encore, et des
branches très développées de la thérapeutique reposent déjà sur une base
déductive. Que l'on songe, par exemple, au traitement des blessures par
l'antisepsie. L'antisepsie a pour but l'anéantissement des micro-organismes
dans lesquels on a reconnu avec une parfaite certitude des agents pathogènes,
et elle y arrive par l'emploi de substances dont les propriétés chimiques
garantissent le . succès avec une certitude égale. Combien il en est autrement
lorsque les causes de la maladie ne sont par clairement connues, que des
guérisons directes et indiscutables ne viennent pas suppléer à cette
ignorance (vraie méthode expérimentale), ou encore lorsque l'on n'est pas
assuré de résultats favorables par une foule d'observations suffisante pour
exclure tout hasard (méthode statistique) ! Alors se prescrivent les
médicaments dont on a dit avec raison « qu'ils sont recommandés aujourd'hui,
universellement loués demain, et qu'ils seront oubliés dans deux ans (26)
»). Le titre de gloire de l'école de Cos ne se trouve donc pas dans le choix
ou dans l'application de méthodes meilleures par elles-mêmes ou plus
rapprochées de la perfection idéale. Ce qui constitue un très grand honneur
pour elle, c'est plutôt d'avoir compris que les prémisses indispensables à
l'emploi de la méthode déductive restaient à découvrir, qu'on ne les
pressentait même pas encore, et qu'au lieu des inductions solides par
lesquelles seulement on pouvait les établir, on n'avait que des conceptions
fantastiques. Une sage abnégation, une résignation prudente, le renoncement
provisoire à des ambitions attirantes et vraiment hautes, mais irréalisables
alors et pour longtemps encore, voilà les vertus qui distinguent ses adhérents
de leurs adversaires, et elles sont dignes de toute notre admiration. Les
membres de cette école ont déployé les plus grands mérites; sans se lasser
jamais, grâce à une foule d'observations ingénieuses et pénétrantes, ils
ont poussé fort loin les branches de la médecine susceptibles de se
développer sans être fondées sur de plus profondes assises, et en particulier
la sémeiologie, c'est-à-dire l'étude des symptômes des maladies, et, dans ce
domaine, ils font encore le plaisir et l'instruction des adeptes de cette
science par la richesse presque infinie et par la finesse de leurs
constatations, par l'acuité des distinctions qu'ils établissent. Ils ne
pouvaient pas se condamner à ne formuler aucune théorie d'ensemble ; pour
cela, ils devaient, eux aussi, recourir à des hypothèses, et celles-ci, dans
la mesure de leur compréhension, n'étaient pas moins fausses que celles de
leurs prédécesseurs ; si elles étaient entachées d'une dose moindre
d'erreur, c'est seulement qu'elles étaient beaucoup plus limitées dans leur
objet. La pathologie des humeurs, par exemple, qui est l'oeuvre par excellence
de l'école hippocratique, et qui ramenait toutes les maladies internes à la
constitution et à la proportion des quatre prétendues humeurs cardinales,
renferme, au jugement de la science moderne, tout juste autant de vérité que
la théorie exposée dans le livre Sur les Chairs relativement à
l'origine de l'homme, ou que la théorie fictive de la matière que combat
l'ouvrage Sur l'ancienne Médecine.
Mais,
qu'elles fussent vraies ou fausses, le génie des médecins de Cos s'est
révélé extraordinairement fertile en généralisations de toute espèce, dont
le mobile peut, croyons-nous, être cherché avec raison dans la spéculation
des philosophes naturalistes. L'« ancienne médecine » à laquelle on
s'efforçait et se flattait de retourner était aussi peu l'ancienne que la
France de la Restauration n'a été celle de l'ancien Régime. Mais le but et la
tendance du mouvement étaient désormais déterminés par l'esprit critique,
par le génie sceptique de l'école d'Hippocrate. Comme elle l'avait fait à
l'égard des excès fantastiques de mainte doctrine philosophique et des
théories des métaphysiciens qui franchissaient toutes les limites de
l'expérience (cf. p. 178 sq.), elle a pris de bonne heure position à l'égard
de la théologie supranaturaliste. Encore ici, comme cela nous est arrivé à
plus d'une reprise, nous nous trouvons en présence de l'opposition entre
l'école de Cos et celle de Cnide. Dans l'ouvrage Sur la Nature des Femmes
(27), qui, comme l'ouvrage plus considérable
auquel il se réfère, et intitulé Des Maladies des Femmes, dénote des
influences cnidiennes, le « divin » et les « choses divines » jouent un
rôle prédominant à la différence et aux dépens d'autres facteurs. Au début
du Pronostic hippocratique, le « divin » est mentionné comme un agent
d'une efficacité occasionnelle, si peu étranger au cours naturel des choses,
que le médecin est invité à ne point en perdre le rôle de vue dans ses «
prévisions ». Mais la guerre est déclarée avec une extrême véhémence à
tout supranaturalisme dans deux productions de l'école d'Hippocrate. La
première est une des plus étonnantes de la collection ; elle a pour titre Des
Airs, des Eaux et des Lieux. L'auteur est un homme dont le pied a foulé le
sol de la Russie méridionale comme celui de la vallée du Nil, dont l'oeil
scrutateur s'est reposé sur une foule inépuisable et infiniment variée
d'objets, et dont la pensée puissante s'est efforcée de combiner ensemble, en
un seul dessin, cette masse innombrable de détails. Mais ses nombreuses et
précieuses observations, ses nombreuses mais prématurées conjectures sur le
rapport qui existe entre le climat et la santé, entre la succession des saisons
et le cours des maladies, tout cela est dépassé et de beaucoup par l'immortel
honneur d'avoir, le premier, tenté d'établir un lien de causalité entre les
caractères des peuples et les conditions physiques dans lesquelles ils vivent.
Ce précurseur de Montesquieu, ce fondateur de la psychologie des peuples,
proteste énergiquement, à propos de la soi-disant « maladie féminine » des
Scythes, contre l'idée que cette maladie - ou une maladie quelconque puisse
être l'effet d'une dispensation divine. La même illusion est combattue en
termes partiellement identiques dans l'ouvrage Sur la Maladie sacrée,
c'est-à-dire sur le mal caduc ou épilepsie, qui passait, aux yeux du peuple,
pour être envoyé par les dieux. Et, dans l'un comme dans l'autre de ces
traités, la négation de toute intervention surnaturelle est tempérée par
cette affirmation : que la rigoureuse et absolue obéissance des phénomènes
naturels à une loi se concilie parfaitement avec la foi religieuse en une
source divine primordiale de laquelle découlent, en dernière analyse, ces
mêmes phénomènes. « Tout est divin et tout est humain » - telle est la
formule merveilleusement suggestive que l'auteur du livre Sur la Maladie
sacrée a frappée, et qui, ainsi qu'il l'explique lui-même, signifie
seulement qu'il n'y a pas de motif d'appeler une maladie plus divine que les
autres. En effet, ne sont-elles pas toutes produites par les grands agents
naturels, tels que la chaleur, le froid, le soleil, les vents, qui, sans
exception, sont de nature divine? Et y en a-t-il parmi elles une seule qui soit
« impénétrable et intraitatable », c'est-à-dire qui se dérobe à
l'intelligence et à l'influence de l'homme ? Et plus loin, sous une forme
encore plus générale : « La nature et la cause de cette maladie procèdent
précisément du même principe divin qui donne naissance à tout le reste ».
Tel est aussi le langage de l'auteur du livre Des Airs, des Eaux et des Lieux:
« À moi aussi, s'écrie-t-il, ces maux me paraissent divins, et pareillement
tous les autres; aucun plus divin, aucun plus humain que l'autre... Chacun d'eux
possède une nature (c'est-à-dire une cause naturelle), et aucun ne se produit
sans elle ». L'auteur du livre Sur l'Epilepsie est plus porté à la
polémique. Il se répand en plaintes prolixes et pleines d'une ironie amère
contre les « charlatans et les vendeurs de fumée » qui prétendent guérir
les maladies par des pratiques superstitieuses, par « des purifications et des
incantations », qui s'efforcent « de cacher leur ignorance et leur impuissance
sous le manteau du divin », et qui, si on les examine à la lumière du jour, -
ceci est le trait le plus acéré qu'il leur décoche - ne croient pas
eux-mêmes à la vérité de leur doctrine. - « Car si ces maux cèdent à ces
« purifications » et aux autres traitements que certains prescrivent contre
eux, rien n'empêche qu'ils ne se produisent et ne fondent sur les hommes en
suite de simagrées analogues. Mais alors leur cause ne serait plus divine ;
elle serait purement humaine. Car celui qui est en mesure d'écarter une telle
maladie par des sortilèges et des purifications pourrait aussi la produire en
mettant en. jeu d'autres moyens, et alors c'en serait fait du divin (et de son
efficacité). » Il n'en est pas autrement des autres artifices de ce genre, qui
reposent, dit-il, sur la supposition qu'il n'y a pas de dieux, ou du moins
qu'ils sont dépourvus de tout pouvoir : « Car s'il était vrai qu'un homme
puisse, par des sacrifices et des charmes, faire descendre la lune et
disparaître le soleil, soulever la tempête ou rendre le ciel serein, alors je
ne tiendrais rien de tout cela pour divin, mais pour humain, puisque, en ce cas,
la puissance de la divinité serait domptée et asservie par l'intelligence
humaine. » Cet écrit est encore extrêmement remarquable, soit dit en passant,
par le fait que la théorie d'Alcméon relativement au cerveau et à son rôle
dans la vie corporelle et surtout dans la vie psychique (cf. p. 160) y est
développée et défendue avec une conviction ardente. L'auteur, qui, comme
médecin, n'est pas un hippocratique, et qui comme philosophe est un
éclectique, a découvert - et la science moderne l'a confirmé - que
l'épilepsie est due à une anomalie de l'organe central, et c'est ce qui l'a
amené à cette importante digression.
Nous pourrions terminer ici ce chapitre. En effet, que nous manque-t-il encore
pour prouver notre thèse, à savoir que, de l'étude de la médecine, est
sortie la troisième et non la moins puissante vague de criticisme, et que, de
là, elle s'est répandue, répandant avec elle une bienfaisante fécondité,
sur les champs de la science hellénique? Les auteurs du livre Sur l'ancienne
Médecine et des deux ouvrages dont nous venons de parler se sont, en
particulier, montrés aussi libres et même plus libres qu'Hécatée ou que
Xénophane de toute influence mythique. Et non seulement ces champions des
lumières ont banni de leur esprit toute trace de la manière primitive de
penser, mais - et c'est en cela qu'ils se distinguent de ceux de leurs
prédécesseurs qui ouvrent la grande période de transition - ils ne se sont
pas arrêtés à la simple négation ; ils ont pris pour objet de leurs
méditations les méthodes de recherche positive et scientifique, en se laissant
guider par cette maxime d'Epicharme, le poète comique et philosophe de Syracuse
: « Sobriété et doute constant, c'est là le nerf de la sagesse. » De plus,
non contents de frayer la voie à tous les progrès ultérieurs concevables, par
une conception des choses divines qui n'entravait point l'essor de la science,
ils ont réalisé eux-mêmes des progrès considérables dans le domaine
spécial de leurs investigations. Il ne rentre pas dans le plan de cet ouvrage
d'en fournir la preuve. Mais nous ne voulons pas nous séparer de la précieuse
collection hippocratique, malheureusement encore peu connue et peu appréciée,
sans offrir à nos lecteurs encore quelques-uns des traits par lesquels se
manifeste le véritable esprit scientifique dont elle est animée dans sa plus
grande partie. Les grandes pensées exprimées pour la première fois dans le
camp adverse ne sont pas, en raison de leur origine, dédaignées ou démenties.
C'est ainsi que la très importante doctrine de la nécessité de l'équilibre
entre la dépense d'énergie et la nourriture, dont nous avons trouvé la
première expression chez les médecins de Cnide, réapparaît dans un livre qui
a pour titre : Du Régime dans les Maladies aiguës, et qui s'ouvre
cependant par une polémique acerbe contre l'oeuvre essentielle de cette école
: les Sentences cnidiennes. Le praticien de Cos est donc aussi éloigné
de toute prétention vaine à l'originalité que de toute recherche de succès
superficiels et de triomphes à bon marché. Car, selon le vrai esprit de la
science, il s'efforce, à l'occasion, de fortifier d'abord par de nouveaux et
sérieux arguments une doctrine qu'il combat. « On peut aussi, dit-iI une fois,
appuyer l'opinion contraire par la considération suivante. » On relève un
sens aussi puissant et aussi incorruptible de la vérité chez l'auteur de
l'ouvrage Sur les Articulations, que Littré a pu nommer « le grand
monument chirurgical de l'antiquité », en ajoutant : « et c'est aussi un
modèle pour tous les temps ». Ce médecin, aussi noble de caractère que
distingué d'esprit, ne craint pas de signaler à ses confrères même les
insuccès de ses traitements. « J'ai consigné ceci à dessein, - ainsi
s'exprime-t-il en termes inoubliables - car il est précieux d'apprendre à
connaître même les essais qui échouent, et de savoir pour quelle raison ils
ont échoué. Ici, il tenait à ne priver ses successeurs d'aucun moyen
quelconque de connaissance qui pût leur être utile ; une autre fois, c'est le
désir d'épargner aux patients toute espèce de souffrance évitable qui
l'entraîne au delà des limites habituelles de l'exposition didactique : « On
prétendra peut-être que des questions de ce genre sont en dehors du domaine
médical, et qu'il ne sert à rien de vouer une plus longue étude à des cas
qui se sont déjà révélés incurables. Grave erreur, répondrai-je... Dans
les cas curables, il faut tout mettre en oeuvre pour empêcher qu'ils ne
deviennent incurables... Mais les cas incurables doivent être reconnus comme
tels, afin de préserver les malades de tortures inutiles. » Cet homme, rempli
de l'ardeur au travail que donne le génie, n'a d'ailleurs pas l'habitude
d'imposer des limites à ses efforts. En effet, il a étendu ses recherches
anatomiques au monde des animaux, comparé la structure du squelette humain à
celle des autres vertébrés, et il l'a fait d'une manière si complète - comme
en font foi deux de ses propres déclarations - que nous n'hésitons pas à
l'appeler un des premiers, si ce n'est le premier représentant de l'anatomie
comparée. Nous terminons en citant une généralisation superbe, également
importante par son ampleur, par la vérité toujours confirmée de son contenu,
et par l'immense portée de ses conséquences ; nous voulons parler de la phrase
par laquelle il établit la nécessité de la fonction pour la préservation et
la santé de l'organe: « Toutes les parties du corps, étant destinées à un
usage précis, se maintiennent saines, et conservent une longue jeunesse. quand
elles servent à cet usage, et qu'on leur demande, dans une mesure raisonnable,
les services auxquels chacune d'elles est habituée. Mais si elles restent sans
emploi, elles deviennent malades, s'étiolent et vieillissent prématurément (28).»
(01) Iliade,
XI 514.
(02) Cette
formule de bénédiction indo-européenne est due à Ad. Kuhn, Zeifschr. f.
vergl. Sprachforschang, XIII 49.
(03) La
« chanson d'un médecin » a été traduite par Roth, dans Grassmann, Riig-Véda,
X 97 (vol. II 378 sq.). À ce sujet et au sujet de la plus ancienne médecine
hindoue, cf. Zimmer, Altindisches Leben, 375, 394, 396, 398, 399.
(04) Ces
exemples de superstitions populaires sont fournis par : le Dr Paris, Pharmacologia,
cité par J.-S. Mill, Logique, 1. V, ch. 3, § 8; Erman, Ægypt. Leben,
I 318; Pline, Nat. Hist., 30, 11 (94); Anonyme, dans le Thesaurus
ling. graecae, au mot àkterow;
Fossel, Volksmedicin u. medic. Aberglauben in Steiermark (cité
dans la Münch. Allg. Zeitung du 23 sept 1891).
(05) Sur
la chirurgie des sauvages et ses interventions hardies, cf. Bartels, Die
Medicin der Naturvölker, Leipzig 1893, pp. 300 et 305-6; von den Steinen, Unter
den Naturvölkern Centralbrasiliens, p. 373; Corresp-BI. d. deutschen
Gesellsch. f. Anthropologie, u. s. w. Avril 1900, p. 31 sq.
(06) Ici,
nous avons utilisé à plusieurs reprises l'essai de Welcker, Epoden oder das
Besprechen (Kleine Schriften, III 64 sq.), de même que plus loin, p. 300.
Sur ce qui suit, comp. Odyssée, XIX 457 sq. et XVIII 383 sq. Sur les
médecins itinérants de l'Inde à l'époque la plus ancienne, cf. Kaegi, Der
Rig-Veda, p. 111.
(07) Sur
Démocédès et ses aventures, cf. Hérod., III 125 sq. Sur le médecin
chypriote Onasilos, cf. l'inscription d'Edalion, dans Collitz, Griech.
Dialektinschr., I 26 sq.; en ce qui concerne la date de cette inscription,
je me range à l'opinion de O. Hoffmann, Die griech. Dialekte, I 41, de
préférence à celle de Larfeld dans le Bursians Jahresber., vol LXVI
(1892), p 36.
(08) Voir
ce serment dans les Œuvres d'Hippocrate, trad. E. Littré, IV 628 sq. Je trouve
l'interdiction de la castration dans les mots oé
tem¡v d¢ oéd¢ m¯n liyiÇntaw qui ne peuvent se
traduire que comme ceci : « Je ne couperai pas, pas même ceux qui souffrent
d'indurations pierreuses. » Or, comme une défense générale d'opérer serait
incompréhensible à une époque où « le fer et le feu » étaient les
principaux insignes de la pratique médicale, il ne reste d'autre alternative
que de prendre le mot t¡mnein
dans un sens particulier, c'est-à-dire dans celui d'émasculer, où il est
d'ailleurs employé par Hésiode, Œuvres et Jours, 786 et 790 sq., par
le Pseudo-Phocylide, v. 187 Bergk, et par Lucien, de Syria dea, § 15
(cf. aussi tomÛaw = ¤ktomÛaw
). Dans ce cas, par liyiÇntaw
il ne faut pas entendre les calculs vésicaux, mais ces indurations pierreuses
auxquelles on ne peut remédier que par la castration ; et, en fait, ce verbe
désigne les indurations les plus diverses. Cette conjecture, émise par nous
depuis longtemps, a été communiquée au monde médical et discutée par feu
mon collègue, Dr Théod. Puschmann, dans les Jahresber. Liber die
Fortschritte der gesamten Medicin, de Virchow-Hirsch, 1883, I p. 326, et
plusieurs fois depuis.
(09) Les
passages qui se rapportent â la conduite et à l'attitude personnelle des
médecins en général se trouvent dans Littré : IV 182, 184, 188, 312, 638,
640; IX 141, 204, 210, 254, 258, 239, 266, 268.
(10) Aristote parle d'Hippocrate comme d'un
grand médecin, Polit., IV (vulgo VII) 4, 1326 a, 24.
(11) Diels place à une date plus basse que
nous, c'est-à-dire au milieu du IVe siècle, les parties les plus
récentes de la collection hippocratique. (Déclaration verbale dans un exposé
fait au congrès des philologues de Cologne, septembre 1895.) - Le papyrus de
Londres a d'abord plus embrouillé que fait avancer la question hippocratique.
Il semblait, en effet, nous placer dans l'alternative ou de ne tenir aucun
compte de l'autorité de Ménon, l'élève d'Aristote, ou de considérer comme
l'oeuvre d'Hippocrate le traité assez insignifiant, et d'une rhétorique
ampoulée, intitulé perÜ fusÇn.
Le moyen de sortir d'embarras parait avoir été trouvé par Blass, Hermès, 36,
405. Ce n'est pas l'ouvrage qui nous a été conservé, mais celui dont s'est
servi son auteur, que Ménon considérait comme hippocratique.
(12) Nous avons nous-même visité les lieux.
Les inscriptions dont nous parlons ici ont été recueillies par Kavvadias, Les
fouilles d'Épidaure, I pp. 23-24. Cf. du même savant tò
ßeròn toè ƒAsklhpioè ktl.. Athènes
1900. Épidaure n'offre pas seulement une excellente eau de source; ils jaillit
aussi une eau minérale active. Les inscriptions figurent maintenant au complet
dans le Corp. Inscr. graec. Peloponnesi, etc., I p. 221 sq.
(13) Il
s'agit du papyrus de Londres : Anonymi Londinensis ex AristoteIis iatricis
Menoniis et aliis medicis eclogæ, éd. H. Diels, Berlin 1893. Cf. l'examen
de son contenu par Diels dans l'Hermès, XXVIII, Ueber die Excerpte von
Menons iatrika. - Sur les ouvrages de la collection hippocratique qui
appartiennent à l'école de Cnide, cf. en particulier Lit ,. VIII 6 sq. et Job.
Ilberg dans les Griech. Studien... H. Lipsius dargebracht, Leipzig 1894,
p. 22 sq.
(14) Les livres Sur le Régime ont
presque seuls, parmi les ouvrages hippocratiques, attiré l'attention des
philosophes et des philologues. Cf. Bernays, Gramm. Abhandl.., I 1 sq. ;
Teichmùller, Neue Studien z. Gesch. d. Begriffe, .II 3 sq.: Weygoldt
dans les Jahrb. f. Philol., 1882, 161 sq.; Zeller. Ph. der Gr., I,
5e éd., p. 694 sq. Weygoldt et Zeller ne me paraissent pas avoir réussi à
prouver que cet ouvrage est de date plus récente. Il est certain que l'auteur a
été influencé par Héraclite et par Empédocle; et la façon dont il a
utilisé les deux systèmes nous reporte à une époque où ils étaient encore
parfaitement vivants tous les deux, à une époque, par conséquent, où la
doctrine d'Empédocle était encore jeune, et où celle d'Héraclite n'était
pas encore vieillie. En revanche, je considère comme réfutée par Teichmziller
(pp. 48-50) la supposition que le diététicien a utilisé aussi Archélaos.
S'il faut lui trouver un prédécesseur quant au dualisme de la matière, ce
prédécesseur doit bien plutôt avoir été Parménide, qui, d'après Aristote,
Métaph.. I 3, envisageait le feu, tout comme notre auteur, comme une
sorte de cause motrice. Anaxagore parait ne pas lui être resté non plus
inconnu, mais n'avoir pas exercé sur lui une influence durable. Même dans les
chapitres dont Weygoldt, p. 174, ramène le contenu à Anaxagore et à
Archélaos; se trouve une phrase qui contredit directement la doctrine
fondamentale d'Anaxagore : "te gŒr oépote
katŒ tvétò ßst‹mena Žll' ŽeÜ Žlloioæmena ¤pÜ tŒ kaÜ ¤pÜ t‹
(VI 374, Littré). Immédiatement avant, on lit une phrase qui, il est vrai,
rappelle un fragment d'Anaxagore (3 Schaub). Elle est là comme pour nous
avertir de ne pas regarder ces ressemblances comme preuves concluantes. Si
l'auteur avait réellement ce fragment sous les yeux, il n'en a en tous cas pris
que la forme verbale et non la pensée, car il emploie le mot sp¡rmata
dans un sens tout différent. Je ne puis percevoir les réminiscences de
Démocrite qu'y découvre Zeller; son argument fondé sur les sept voyelles est
sans valeur, car si les signes distinctifs de l'H et de l'V
n'ont été introduits officiellement à Athènes qu'en 403, ils étaient en
usage longtemps auparavant non seulement en Ionie, mais encore à Athènes
même, où Zeller fait vivre l'auteur. ,Les passages cités en premier lieu du
traité Sur le Régime se trouvent à VI 468, 470 (cf. aussi 606) ; 742. La
conjecture qu'Hérodikos de Sélymbrie est l'auteur de ce livre a été émise
par Franz Spät, Die geschichtliche Entmicklung der segenannten
hippokratischen Medicin im Lichte der neuesten Forschung, Berlin 1897, p. 22
sq.; elle s'appuie sur des raisons auxquelles les recherches ultérieures
donneront peut-être la pleine évidence qui leur fait encore défaut.
(15) La théorie de l'équilibre organique est
formulée le plus nettement à VI 606, Littré, et aussi à la fin du 1. III p.
636.
(16) Ce que nous disons ici des Cnidiens
Euriphon et Hérodikos est tiré du Papyrus de Londres (p. 7), dans l'index
duquel tous les fragments d'Euriphon sont indiqués.
(17) Les citations se réfèrent au l. I,
Sur le Régime, VI 484, 474, 476. Sur l'expérience mentionnée plus bas,
cf. la remarque de Littré, VI 527.
(18) VI 642, oá
krÛnousi perÜ tÇn toioætvn Žkrib° t¡xnhn ¦xontew.
(19) Le
petit traité perÜ sarkÇn
(des Chairs ou des' Muscles) se trouve dans le VIIe vol. de Littré.
Vouloir, avec Littré, le tenir pour postaristotélicien parce que l'auteur sait
que les deux artères principales partent du coeur n'est certes pas justifié.
Il est impossible de dire avec certitude à quelle date des faits anatomiques
évidents comme celui-là ont été connus, même dans l'antiquité. La date de
composition du livre ressort surtout de son caractère éclectique, que nous
montrerons un peu plus loin.
(20) Aristote,
Pol., I 2, au commencement.
(21) Au
sujet du traité Sur le Nombre Sept (Littré, VIII 634 sq. et meilleure
version IX 433 sq.), cf. Ilberg, op. cit., et Harder, Zur
pseud-hippokratischere Schrift perÜ
¥bdom‹dvn (Rhein. Mus., N. F. XLVIII 433
sq.). - Les remarques que nous faisons à la fin de ce paragraphe sur le rôle
du nombre sept dans l'alchimie arabe sont empruntées à un article de
Berthelot;. Rev. des Deux Mondes du 1er oct. 1893 (p. 557). À ceci se rapporte
aussi un fragment nouvellement découvert d'Héraclite (n° 4 a, dans la
collection de Diels, dont nous ne partageons pas les doutes sur son
authenticité).
(22) Le traité Sur l'ancienne Médecine
se trouve à la fin du premier vol. de Littré. Les passages cités plus loin se
trouvent à pp. 570-606. L'important ch. 20, que nous étudions ensuite, est à
pp. 620-624.
(23) Rapprocher I 620 de VI 468.
(24) Voir trad. Littré, I 572.
(25) Hérodote, II 33; Euripide, frg.
574, Nauck, 2e éd.; Epicure, chez Diog. Laërce, X 32.
(26) Cette citation est empruntée à Bunge, Lehrbuch
der physiol. und pathol. Chemie, 2e éd., p. 86.
(27) Le traité Sur la Nature des Femmes se
trouve dans Littré, VII 312 ; lire l'introduction de ce traité ainsi que celle
du Prognostikon (II 110-112 L.); lire aussi Sur l'Air, l'Eau et le
Site, II 12 sq., et Sur la Maladie Sacrée, VI 352 sq. Les phrases
sur les maladies « à la fois divines et humaines,», sont à VI 394 et 364, et
II 76. - Les passages polémiques cités plus bas se trouvent à VI 354-362.
(28) Les déclarations ici utilisées de médecins
hippocratiques se trouvent dans Littré, II 302, 328; IV 212, 252 et 254; le
jugement de Littré sur le livre Sur les Articulations, IV 75. J'appelle
l'auteur de ce livre un représentant de l'anatomie comparée en raison des
déclarations qu'on y lit, IV 192 et 198.