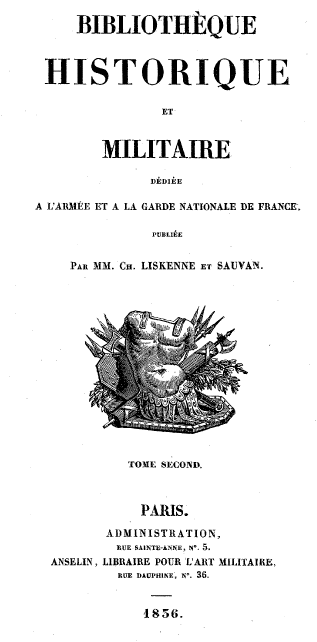
POLYBE
HISTOIRE GÉNÉRALE
LIVRE IIΙ.
Traduction française : THUILLIER.
autres traductions : Waltz - Bouchot
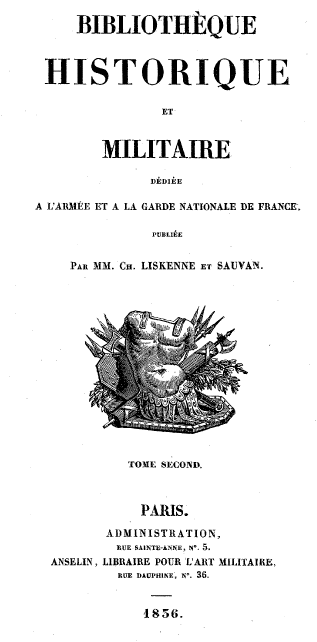
autres traductions : Waltz - Bouchot
LIVRE TROISIÈME
CHAPITRE PREMIER
But que Polybe se propose en écrivant
l'histoire de son temps. - Distribution des événements qu'il doit raconter.
On a vu dans le premier livre, que nous commencerions cet ouvrage par la
guerre sociale, celle d'Hannibal et celle de la Coïlé-Syrie ; nous y avons
dit aussi pourquoi, remontant à des temps plus reculés, nous écririons les
deux livres qui précèdent celui-ci. Il faut maintenant rapporter ces
guerres, et rendre compte tant des raisons pourquoi elles ont été
entreprises, que de celles pour lesquelles elles sont devenues si
considérables. Mais auparavant disons un mot sur le dessein de cet ouvrage.
Dans tout ce que nous avons entrepris de raconter, notre unique but a été de faire voir comment, en quel temps et pourquoi toutes les parties de la terre connues ont été réduites sous l'obéissance des Romains, événement dont le commencement est connu, le temps déterminé, et le succès avoué et reconnu de tout le monde. Pour parvenir à ce but, il est bon de faire mention en peu de mots des choses principales qui se sont passées entre le commencement et la fin ; rien n'est plus capable de donner une juste idée de toute l'entreprise ; car, comme la connaissance du tout sert beaucoup pour acquérir celle des choses particulières, et que réciproquement la connaissance des choses particulières aide beaucoup à connaître le tout, nous ne pouvions mieux faire, à mon sens, que d'instruire le lecteur de ces deux manières.
J'ai déjà fait voir quel était en général mon dessein, et jusqu'où je devais le conduire. Tout ce qui s'est passé en particulier commence aux guerres dont nous avons parlé, et finit au renversement de la monarchie macédonienne ; et entre le commencement et la fin il s'est écoulé cinquante-trois ans, pendant lesquels tant et de si grands événements sont arrivés, qu'on n'en a jamais vu de pareils dans un égal nombre d'années. En commençant donc à la quarantième olympiade, voici l'ordre que je garderai.
Après que nous aurons expliqué pourquoi les Carthaginois firent aux Romains la guerre qu'on appelle d'Hannibal, nous dirons de quelle manière les premiers se jetèrent sur l'Italie, et y ébranlèrent la domination des Romains jusqu'au point de les faire craindre pour leur propre patrie, et de voir les Carthaginois maîtres de la capitale de cet empire. Nous verrons ensuite Philippe de Macédoine venir se joindre aux Carthaginois, après qu'il eut fini la guerre qu'il faisait vers le même temps contre les Etoliens, et qu'il eut pacifié les affaires de la Grèce. Après cela, Antiochus et Ptolémée Philopator se disputeront la Coïlé-Syrie, et se feront la guerre pour ce royaume. Puis les Rhodiens et Prusias se déclareront contre les Byzantins, et les forceront à se désister du péage qu'ils exigeaient de ceux qui naviguaient dans le Pont. Là nous interromprons le fil de notre narration pour examiner la forme de gouvernement des Romains, et on verra qu'il ne pouvait être mieux constitué, non seulement pour se rétablir dans l'Italie et dans la Sicile, et pour soumettre les Espagnes et les Gaules, mais encore pour défaire entièrement les Carthaginois, et penser à conquérir tout l'univers. Cela sera suivi d'une petite digression sur la ruine de Hiéron, roi de Syracuse, d'où nous passerons en Egypte pour dire les troubles qui y arrivèrent, lorsqu'après la mort de Ptolémée, Antiochus et Philippe, conspirant ensemble pour se partager le royaume laissé au fils de ce roi, tâchèrent par fraude et par violence de se rendre maîtres, celui-ci de l'Egypte et de la Carie, celui-là de la Coïlé-Syrie et de la Phénicie.
Suivra un récit abrégé de ce qui se passa entre les Romains et les Carthaginois dans l'Espagne, dans la Libye et dans la Sicile, d'où nous nous transporterons en Grèce, où les affaires changèrent alors de face. Nous y verrons les batailles navales d'Attalus et des Rhodiens contre Philippe ; de quelle manière les Romains firent la guerre à ce prince; quelles en furent les causes, et quel en fut le succès. Nous joindrons à cela ce que produisit la colère des Etoliens, lorsque, ayant appelé Antiochus d'Asie, ils allumèrent le feu de la guerre entre les Achéens et les Romains. Nous dirons la cause de cette guerre, et ensuite nous suivrons Antiochus en Europe. D'abord il est obligé de se retirer de la Grèce ; puis, défait, il abandonne tout le pays qui est en deçà du mont Taurus ; et enfin les Romains, après avoir réprimé l'audace des Gaulois, se rendent maîtres de l'Asie, sans que personne la leur ose contester, et délivrent l'Asie Citérieure de la crainte des Barbares et de la violence des Gaulois. Nous exposerons après cela les malheurs dont les Etoliens et les Céphaléniens furent accablés ; d'où nous passerons aux guerres qu'Eumènes eut à soutenir contre Prusias et les Gaulois de Grèce, et à celle d'Ariarathe contre Pharnace. Après quoi nous dirons quelque chose de l'union et du gouvernement des Péloponnésiens, et des progrès que fit l'Etat des Rhodiens. Nous ferons ici une récapitulation, où toute l'histoire et les faits qu'on y aura vus seront représentés en peu de mots. Nous ajouterons à tout cela l'expédition d'Antiochus Épiphanes dans l'Egypte, la guerre de Persée et la ruine entière de la monarchie macédonienne.
Par là on verra en détail par quelle conduite les Romains sont venus à bout de soumettre toute la terre à leur domination. Si l'on devait juger de ce qu'il a de louable ou de répréhensible dans les hommes ou dans les Etats par le bonheur ou le malheur des événements, je devrais borner là mon ouvrage, puisque mon dessein est rempli, que les cinquante-trois ans finissent à ces derniers événements ; que la puissance romaine fut alors à son plus haut point, et que tout le monde était forcé de reconnaître qu'il ne restait plus qu'à leur obéir et à exécuter leurs ordres. Mais l'heureux ou malheureux succès des batailles ne suffit pas pour donner une juste idée des vainqueurs ni des vaincus ; souvent les plus heureux, faute d'en avoir fait bon usage, ont été cause de très grands malheurs, de même qu'il y a eu bon nombre de gens à qui des accidents très fâcheux ont été d'une très grande utilité, parce qu'ils ont su les supporter avec courage. Outre les événements, il faut donc encore considérer quelle a été la conduite des Romains, comment ils ont gouverné l'univers, les différents sentiments qu'on a eus pour ceux qui étaient à la tête des affaires ; les penchants et les inclinations dominantes des particuliers, tant dans le foyer domestique, que par rapport au gouvernement. Par ce moyen notre siècle connaîtra si l'on doit se soustraire à la domination romaine ou s'y soumettre, et les siècles à venir jugeront si elle était digne de louange ou de blâme. C'est de là que dépend presque tout le fruit que l'on pourra tirer de cette histoire, tant pour le présent que pour l'avenir. Car ne nous imaginons pas que les chefs d'armées n'ont, en faisant la guerre, d'autre but que de vaincre et de subjuguer ni que l'on ne doit juger d'eux que par leurs victoires et par leurs conquêtes. Il n'y a personne qui fasse la guerre dans la seule vue de triompher de ses ennemis. On ne se met pas sur mer pour passer simplement d'un endroit à un autre ; les sciences et les autres arts ne s'apprennent pas uniquement pour en avoir la connaissance ; on cherche en tout ce que l'on fait ou l'agréable ou l'honnête ou l'utile. Cet ouvrage ne sera donc parfait et accompli qu'autant qu'il apprendra quel fut, après la conquête du monde entier par les Romains, l'état de chaque peuple en particulier, jusqu'au temps où de nouveaux troubles se sont élevés, et qu'il s'est fait un nouveau changement dans les affaires. C'est sur ce changement que je me suis proposé d'écrire. L'importance des faits et les choses extraordinaires qui s'y sont passées, m'y ont engagé. Mais la plus forte raison, c'est que j'ai contribué à l'exécution de certaines choses, et que j'ai été le conducteur de beaucoup d'autres.
Ce fut dans ce soulèvement que les Romains allèrent porter la guerre chez les Celtibériens et les Vaccaïens ; que les Carthaginois la firent à Masinissa, roi dans l'Afrique ; qu'en Asie, Attalus et Prusias se la déclarèrent l'un à l'autre ; qu'Oropherne, aidé par Demetrius, chassa du trône Ariarathe, roi de Cappadoce, et que celui-ci y remonta par ses seules forces, que Seleucus, fils de Demetrius, après avoir régné douze ans dans la Syrie, perdit le royaume et la vie par la conspiration des autres rois, que les Romains permirent aux Grecs, accusés d'être les auteurs de la guerre de Persée, de retourner dans leur patrie, après qu'ils eurent reconnu leur innocence, que, peu de temps après, ces mêmes Romains attaquèrent les Carthaginois, d'abord pour les obliger à changer de pays, mais ensuite dans le dessein de les détruire entièrement, pour des raisons que nous déduirons dans la suite, qu'enfin, vers le même temps, les Macédoniens ayant renoncé à l'alliance des Romains, et les Lacédémoniens s'étant détachés de la République des Achéens, on vit le malheur commun de la Grèce commencer et finir tout ensemble.
Tel est le dessein que je me suis proposé. Fasse la fortune que ma vie soit assez longue pour l'exécuter et le conduire à sa perfection! Je suis cependant persuadé que, quand même je viendrais à manquer, il ne serait pas abandonné, et que d'habiles gens, charmés de sa beauté, se feraient un devoir de le remplir. Maintenant que, pour donner aux lecteurs une connaissance générale et particulière de cette histoire, nous avons rapporté sommairement les principaux faits sur lesquels nous devons dans la suite nous étendre, il est temps de rappeler ce que nous avons promis, et de reprendre le commencement de notre sujet.
Quelles furent les vraies causes de la guerre d'Hannibal. Réfutation de l'historien Fabius sur ces causes.
Quelques historiens d'Hannibal donnent deux raisons de la seconde guerre que les Romains déclarèrent aux Carthaginois. La première est, selon eux, le siège mis par ceux-ci devant Sagonte et l'autre, l'infraction du traité par lequel ils avaient solennellement promis de ne pas s'étendre au-delà de l'Ebre. Pour moi, j'accorderai bien que ce furent là les commencements de la guerre, mais je ne puis convenir que c'en aient été les motifs. En effet, c'est comme si l'on disait que l'invasion d'Alexandre en Asie a été la cause de la guerre contre les Perses, et que la guerre des Romains contre Antiochus, est venue de la descente que ce roi fit à Démétriade. Ces deux causes, loin d'être les vraies, ne sont pas même probables ; car qui pourrait penser que l'invasion d'Alexandre ait été la cause de plusieurs choses que ce prince, et avant lui Philippe son père, avaient faites pour se disposer à la guerre contre les Perses ? On doit dire la même chose de ce que les Etoliens firent contre les Romains avant qu'Antiochus vînt à Démétriade. Pour raisonner de la sorte, il faut n'avoir jamais connu la différence qu'il y a entre commencement, cause et prétexte, et ne savoir pas que ces deux derniers sont ce qui, dans toutes choses, précède tout, et que le commencement n'est que le dernier des trois. J'appelle commencement les premières démarches que l'on fait, les premiers mouvements que l'on se donne pour exécuter ce que l'on a jugé devoir faire ; mais les causes, c'est ce qui précède tout jugement et toute délibération. Ce sont les pensées qui se présentent, les dispositions que l'on prend, les raisonnements qui se font en conséquence, et sur lesquels on se détermine à juger et à former un dessein. Ce que je vais dire éclaircira ma pensée.
Rien n'est plus facile à découvrir que les vrais motifs de la guerre contre les Perses. Le premier fut le retour des Grecs, qui, revenant, sous la conduite de Xénophon, des satrapies de l'Asie supérieure, et traversant toute l'Asie avec laquelle ils étaient en guerre, n'avaient néanmoins trouvé personne qui osât s'opposer à leur retraite. Le second fut le passage d'Agésilas, roi de Lacédémone, en Asie, où il ne rencontra rien qui mît obstacle à ses desseins, quoique d'ailleurs il fût obligé d'en sortir sans avoir rien fait, rappelé qu'il était dans, la Grèce par les troubles dont elle était alors agitée ; car Philippe, considérant d'un côté la mollesse et la lâcheté des Perses, et de l'autre, les grandes ressources qu'il avait, lui et les siens, pour la guerre, excité d'ailleurs par l'éclat et la grandeur des avantages qu'il tirerait de la conquête de cet empire, après s'être concilié la faveur des Grecs, prit enfin son essor, conçut le dessein d'aller porter la guerre chez les Perses, et disposa tout pour cette expédition, sous prétexte de venger les Grecs des injures qu'ils en avaient reçues. Il est donc hors de doute que des deux choses que nous avons rapportées, les premières ont été les causes de la guerre contre les Perses, que la dernière n'en a été que le prétexte, et qu'enfin le commencement a été l'irruption d'Alexandre dans l'Asie.
Il est clair encore qu'il n'y a point d'autre cause de la guerre des Romains contre Antiochus, que l'indignation des Etoliens. Ceux-ci, croyant que les Romains, enflés du succès qu'avait eu leur guerre contre Philippe, les méprisaient, comme j'ai dit plus haut, non seulement appelèrent à leur secours Antiochus, mais la colère les emporta jusqu'à prendre la résolution de tout entreprendre et de tout souffrir pour se venger. Le prétexte fut de remettre les Grecs en liberté ; c'est à quoi ils exhortaient et animaient sans raison toutes les villes, les parcourant avec Antiochus, l'une après l'autre. Et enfin le commencement fut la descente d'Antiochus à Démétriade.
Je me suis arrêté longtemps sur cette distinction, non que j'eusse en vue de censurer les historiens, mais parce que l'instruction des lecteurs le demandait. Car de quelle utilité est pour les malades un médecin qui ne connaît pas les causes des maladies ? que peut-on attendre d'un ministre d'Etat qui ne connaît ni la raison ni l'origine des affaires qui arrivent dans un royaume ? Comme il n'y a pas d'apparence que le premier donne jamais de remède convenable, il n'est pas non plus possible que l'autre, sans la connaissance de ce que nous venons de dire, prenne prudemment un parti. C'est pour cela qu'on ne doit rien rechercher avec tant de soin que les causes des événements; car souvent une bagatelle, un rien donnent lieu à des événements très importants, et, en tout, on ne remédie à rien plus aisément qu'aux premiers mouvements et aux premières pensées.
Selon Fabius, historien romain, ce fut l'avarice et l'ambition démesurée d'Hasdrubal, jointes à l'injure faite aux Sagontins, qui furent la cause de la seconde guerre punique. Fabius prétend que ce général, s'étant acquis une domination fort étendue en Espagne, eut le projet, à son retour dans l'Afrique, d'abolir les lois de sa République, et de l'ériger en monarchie ; que les principaux magistrats, s'étant aperçus de son dessein, y furent unanimement opposés ; qu'Hasdrubal alors sortit d'Afrique, et que, de retour en Espagne, il la gouverna à sa fantaisie, sans aucun égard pour le Sénat de Carthage ; qu'Hannibal, qui dès l'enfance était entré dans les vues de son oncle et avait tâché de le suivre, tint la même conduite que lui, quand on lui eut confié le gouvernement de l'Espagne ; et que ce fut pour se conformer à ces vues d'Hasdrubal qu'il fit la guerre aux Romains malgré les Carthaginois, dont il n'y eut pas un seul, du moins entre les plus distingués, qui approuvât ce qu'Hannibal avait fait à l'égard de Sagonte. Fabius ajoute qu'après la prise de cette ville, les Romains vinrent en Afrique, dans le dessein ou de se faire livrer Hannibal ou de déclarer la guerre aux Carthaginois.
Mais si l'on demandait à cet historien, pourquoi, en supposant que l'entreprise d'Hannibal eût déplu aux Carthaginois, cette République n'a pas saisi une occasion si favorable de se délivrer de la guerre qui la menaçait ? ce que pouvaient faire les Carthaginois de plus juste et de plus avantageux que de se rendre à ce que les Romains demandaient d'eux ? si en abandonnant l'auteur des injustices faites aux Sagontins, ils ne s'étaient pas défaits par les Romains de l'ennemi commun de leur état, ils n'auraient pas assuré la tranquillité à leur patrie, et étouffé le feu de la guerre, lorsque pour se venger, il ne leur en aurait coûté qu'un sénatus-consulte ? si l'on fait, dis je, cette question à notre historien, il est clair qu'il n'aura rien à répondre, puisque les Carthaginois ont été si éloignés d'une sage conduite, qu'après avoir fait la guerre sous les ordres d'Hannibal pendant dix-sept ans de suite, ils ne la finirent que lorsqu'il n'y eut plus rien à espérer, et qu'ils virent enfin leur patrie à deux doigts de sa perte.
Au reste, si j'ai fait ici mention de Fabius et de son histoire, ce n'est pas de peur que la vraisemblance qu'il jette sur ce qu'il dit n'en impose à ses lecteurs ; car il n'y a point de lecteur qui, sans qu'on l'avertisse, ne puisse voir par lui-même combien cet historien est peu judicieux ; mais pour recommander à ceux entre les mains de qui ses livres tomberont, de ne point s'arrêter au titre, et d'examiner les faits mêmes qu'il rapporte ; car on voit des gens qui, faisant moins d'attention à ce qu'il débite qu'à lui-même, et se laissant prévenir par préjugé qu'il était contemporain et sénateur, aussitôt se persuadent qu'on doit ajouter foi à tout ce qu'il raconte. Mon sentiment est qu'on ne doit pas tout à fait mépriser son autorité, mais que, seule, elle n'est pas suffisante, et qu'il faut considérer les choses mêmes qu'il écrit, pour juger ensuite si on doit l'en croire ou non. Je reviens à mon sujet.
Première cause de la seconde guerre punique, la haine d'Hamilcar Barca contre les Romains : seconde cause, la nouvelle exaction des Romains sur les Carthaginois : troisième cause, la conquête de l'Espagne par Hamilcar.
Je crois donc qu'entre les causes pour lesquelles les Romains ont fait la guerre aux Carthaginois, la première est le ressentiment d'Hamilcar, surnommé Barca, et père d'Hannibal ; car, quoiqu'il eût été défait en Sicile, son courage n'en fut point abattu. Les troupes qu'il avait commandées à Éryce étaient encore entières, et dans les mêmes sentiments que leur chef. Si, cédant aux temps, il avait fait la paix après la bataille qu'avaient perdue sur mer les Carthaginois, son indignation restait toujours la même, et n'attendait que le moment d'éclater. Il aurait même pris les armes aussitôt après, sans la guerre que les Carthaginois eurent à soutenir contre les soldats mercenaires. Mais il fallut d'abord penser à cette révolte, et s'en occuper tout entier. Ces troubles apaisés, les Romains étant venus à déclarer la guerre aux Carthaginois, ceux-ci n'hésitèrent pas à se mettre en défense, persuadés qu'ayant la justice à leur côté, ils ne manqueraient pas d'avoir le dessus, comme j'ai dit dans les livres qui précèdent, et sans lesquels on ne pourrait comprendre ni ce que je dis ni ce que je dois dire dans la suite. Mais comme les Romains eurent fort peu d'égards à cette justice, les Carthaginois furent obligés de s'accommoder aux conjonctures. Accablés et n'ayant plus de ressources, ils consentirent, pour avoir la paix, à abandonner la Sardaigne, et ajouter douze cents talents au tribut qu'ils payaient déjà.
Et l'on ne doit point douter que cette nouvelle exaction n'ait été la seconde cause de la guerre qui l'a suivie, car Hamilcar, animé par sa propre indignation et par celle que ses concitoyens en avaient conçue, n'eut pas plus tôt affermi la tranquillité de sa patrie par la défaite des révoltés, qu'il tourna toutes ses pensées vers l'Espagne, s'imaginant bien qu'elle serait pour lui d'un puissant secours dans la guerre qu'il méditait contre les Romains.
Les rapides progrès qu'il fit dans ce vaste pays doivent être regardés comme la troisième cause de la seconde guerre punique : les Carthaginois ne s'y engagèrent que parce qu'avec le secours des troupes espagnoles, ils crurent avoir de quoi tenir tête aux Romains.
Quoique Hamilcar soit mort dix ans avant que cette guerre commençât, il est cependant aisé de prouver qu'il en a été le principal auteur. Entre les raisons sans nombre dont on pourrait se servir pour cela, je n'en citerai qu'une, qui rendra la chose évidente. Après qu'Hannibal eut été vaincu par les Romains, et qu'il fut sorti de sa patrie pour s'aller réfugier chez Antiochus, les Romains, sachant ce que méditaient contre eux les Etoliens, envoyèrent des ambassadeurs chez ce prince, dans le dessein de le sonder et de voir quelles pouvaient être ses vues. Les ambassadeurs, ayant découvert qu'il prêtait l'oreille aux propositions des Etoliens, et qu'il n'épiait que l'occasion de se déclarer contre les Romains, tâchèrent de lui rendre Hannibal suspect, et pour cela lui firent assidûment leur cour. La chose réussit selon leurs souhaits. Antiochus continua à se défier d'Hannibal, et ses soupçons ne firent qu'augmenter. Enfin l'occasion se présenta de s'éclairer l'un l'autre sur cette défiance. Hannibal se défendit du mieux qu'il put, mais voyant que ses raisons ne satisfaisaient pas Antiochus, il lui tint enfin ce discours : " Quand mon père se disposa à entrer en Espagne avec une armée, je n'avais alors que neuf ans ; j'étais auprès de l'autel pendant qu'il sacrifiait à Jupiter. Après les libations et autres cérémonies prescrites, Hamilcar, ayant fait retirer tous les ministres du sacrifice, me fit approcher, et me demanda en me caressant si je n'aurais pas envie de le suivre à l'armée. Je répondis, avec cette vivacité qui convenait à mon âge, non seulement que je ne demandais pas mieux, mais que je le priais instamment de me le permettre ; là-dessus il me prit la main, me conduisit à l'autel, et m'ordonna de jurer sur les victimes que jamais je ne serais ami des Romains. Jugez par là quelles sont mes dispositions. Quand il ne s'agira que de susciter des affaires aux Romains, vous pouvez compter sur moi comme sur un homme qui vous sera sincèrement dévoué : quand vous penserez à transiger et à faire la paix avec eux, n'attendez pas que l'on vous prévienne contre moi, mais méfiez-vous et tenez-vous sur vos gardes : je ferai certainement tout ce qui sera en moi pour traverser vos desseins. " Ce discours, qui paraissait être sincère et partir du cœur, dissipa tous les soupçons qu'Antiochus avait auparavant conçus sur la fidélité d'Hannibal.
On conviendra que ce témoignage de la haine d'Hamilcar et de tous les projets qu'il avait formés contre les Romains, est précis et sans réplique. Mais cette haine paraît encore plus dans ce qu'il fit ensuite, car il leur suscita deux ennemis, Hasdrubal son gendre, et Hannibal son fils, qui étaient tels, qu'après cela il ne pouvait rien faire de plus, pour montrer l'excès de la haine qu'il leur portait. Hasdrubal mourut avant que de pouvoir mettre son dessein à exécution, mais Hannibal trouva dans la suite l'occasion de se livrer avec éclat à l'inimitié que lui avait transmise son père contre les Romains. De là, ceux qui gouvernent doivent apprendre combien il leur importe de pénétrer les motifs qui portent les puissances à traiter de paix où à faire alliance avec eux. À moins que les circonstances ne soient impérieuses, on doit se tenir sur la réserve, et avoir toujours les yeux ouverts sur leurs démarches ; mais si leur soumission est sincère, on peut en disposer comme de ses sujets et de ses amis, et leur demander avec confiance tous les services qu'elles sont capables de rendre. Telles sont donc les causes de la guerre d'Hannibal. En voici les commencements.
Hannibal est nommé général des armées. - Ses conquêtes en Espagne. - Il se brouille avec les Romains sur un mauvais prétexte. - Prise de Sagonte par Hannibal. - Victoire remportée par les Romains sur Demetrius.
Les Carthaginois étaient fort sensibles à la perte qu'ils avaient faite de la Sicile, mais ils avaient encore plus de peine à supporter celle de la Sardaigne, et l'augmentation du tribut qu'on leur avait imposé. C'est pour cela qu'après qu'ils eurent soumis la plus grande partie de l'Espagne, tout ce qui leur était rapporté contre les Romains était toujours bien reçu. Lorsqu'ils eurent appris la mort d'Hasdrubal, qu'ils avaient fait gouverneur d'Espagne après la mort d'Hamilcar, d'abord ils attendirent, pour lui nommer un successeur, qu'ils sussent de quel côté pencheraient les troupes, et dès que la nouvelle fut venue, que d'un consentement unanime elles s'étaient choisi Hannibal pour chef, aussitôt le peuple, s'étant assemblé, confirma l'élection, et l'on donna à Hannibal le commandement des armées. Élevé à cette dignité, il pensa d'abord à soumettre les Olcades. Il vint camper à Althée, la principale ville de la nation, et en fit le siège avec tant de vigueur et d'impétuosité, qu'il en fut bientôt maître. Les autres villes épouvantées ouvrirent d'elles-mêmes leurs portes. Il les vendit ensuite à prix d'argent, et, s'étant ainsi amassé de grandes richesses, il vint prendre son quartier d'hiver à Carthagène. Généreux à l'égard de ceux qui servaient sous lui, payant libéralement les soldats, et leur promettant des récompenses, il se gagna les cœurs et donna de grandes espérances aux troupes. L'été venu, il ouvre la campagne par une expédition chez les Vaccaïens. Il prend d'emblée la ville de Salmantique. Arbucale, qui était grande, bien peuplée, et défendue par des habitants d'une grande valeur, lui résista longtemps, mais enfin il l'emporta. Il courut un grand danger en revenant ; les Carpésiens, nation la plus puissante du pays, avaient pris les armes, et les peuples voisins, soulevés par ceux des Olcades et des Salmantiquois qui s'étaient sauvés par la fuite, étaient accourus à leur secours. Si Hannibal eût été obligé de les combattre en bataille rangée, sa défaite était immanquable ; mais il eut la prudence de se retirer au petit pas, de mettre le Tage devant lui, et de se réduire à disputer aux ennemis le passage de ce fleuve. Cette conduite lui réussit. Les Barbares s'efforcèrent de passer la rivière par plusieurs endroits ; mais la plupart, au débarquement, furent écrasés par les quarante éléphants qui marchaient le long des bords. Dans la rivière même il y en eut beaucoup qui périrent sous les pieds de la cavalerie, qui rompait plus aisément le cours de l'eau, et du haut de ses chevaux combattait avec avantage contre l'infanterie. Enfin Hannibal passa lui-même le fleuve, et, fondant sur ces Barbares, il en tua plus de quarante mille sur le champ de bataille.
Ce carnage intimida tellement tous les peules d'en deçà de l'Ebre, qu'il n'y resta personne, hors les Sagontins, qui osât faire mine de résister aux Carthaginois. Hannibal se donna pourtant bien de garde d'attaquer Sagonte. Fidèle aux avis d'Hamilcar son père, il ne voulait pas se brouiller ouvertement avec les Romains, qu'il ne fût auparavant paisible possesseur du reste de l'Espagne. Pendant ce temps-là, les Sagontins, craignant pour eux et prévoyant le malheur qui devait leur arriver, envoyaient à Rome courriers sur courriers, pour informer exactement les Romains des progrès que faisaient les Carthaginois. On fut longtemps à Rome sans faire grande attention à ces progrès ; mais alors on fit partir des ambassadeurs pour s'éclairer sur la vérité des faits.
Hannibal, après avoir poussé ses conquêtes jusqu'où il s'était proposé, revint faire prendre à son armée ses quartiers d'hiver à Carthagène, qui était comme la ville capitale de la nation, et comme le palais de cette partie de l'Espagne qui obéissait aux Carthaginois. Là, il rencontra les ambassadeurs romains, et leur donna audience. Ceux-ci, prenant les dieux à témoin, lui recommandèrent de ne pas toucher à Sagonte, qui était sous leur protection, et de demeurer exactement en deçà de l'Ebre, selon le traité fait avec Hasdrubal. Hannibal, jeune alors, et passionné pour la guerre, heureux dans ses projets, et animé depuis longtemps contre les Romains, répondit, comme s'il eût pris le parti des Sagontins, qu'une sédition s'était depuis peu élevée parmi eux, qu'ils avaient pris les Romains pour arbitres, et que ces Romains avaient injustement condamné à mort quelques-uns des magistrats ; qu'il ne laisserait pas cette injustice impunie ; que de tout temps la coutume des Carthaginois avait été de prendre la défense de ceux qui étaient injustement persécutés. Et en même temps il dépêchait au Sénat de Carthage pour savoir comment il en agirait avec les Sagontins, qui, fiers de l'alliance des Romains, en usaient mal avec quelques-uns des sujets de la République. En un mot il ne raisonnait pas et n'écoutait que la colère et l'emportement qui l'aveuglaient. Au lieu des vraies raisons qui le faisaient agir, il se rejetait sur des prétextes frivoles, égarement ordinaire de ceux qui, s'inquiétant peu de la justice, n'écoutent que les passions par lesquelles ils se sont laissé prévenir. Combien n'eût-il pas mieux fait de dire qu'il fallait que les Romains rendissent la Sardaigne aux Carthaginois, et les déchargeassent du tribut qu'ils leur avaient injustement imposé dans les temps malheureux où ceux-ci avaient été chassés de cette île, et qu'il n'y aurait de paix entre eux et les Carthaginois qu'à cette condition ! Il est résulté de là que, pour avoir caché la vraie raison qui lui mettait les armes à la main, et en avoir allégué une qui n'avait nul fondement, il a passé pour avoir commencé la guerre, non seulement contre le bon sens, mais encore contre toutes les règles de la justice.
Les ambassadeurs, ne pouvant plus douter qu'il ne fallût prendre les armes, firent voile pour Carthage, dans le dessein de demander aux Carthaginois, comme ils avaient fait à Hannibal, l'observation du traité conclu avec son oncle. Mais ils ne pensaient pas qu'en cas que ce traité fût violé, la guerre dût se faire dans l'Italie ; ils croyaient plutôt que ce serait en Espagne, et que Sagonte en serait le théâtre. Le Sénat romain, qui se flattait de la même espérance, prévoyant que cette guerre serait importante, de longue durée, et fort éloignée de la patrie, crut qu'avant toutes choses il fallait mettre ordre aux affaires d'Illyrie.
Demetrius de Pharos, oubliant les bienfaits qu'il avait reçus des Romains, et allant même jusqu'à les mépriser, parce qu'il avait vu la frayeur où les avaient jetés les Gaulois, et qu'il voyait celle où les jetaient actuellement les Carthaginois, espérant d'ailleurs beaucoup des rois de Macédoine, qui dans la guerre de Cléomène s'étaient joints à Antigonus, s'était avisé vers ce temps-là de ravager et de renverser les villes d'Illyrie qui appartenaient aux Romains, de passer avec cinquante frégates au-delà du Lisse, contre la foi des traités, et de porter le ravage dans la plupart des îles Cyclades. Ces désordres attirèrent l'attention des Romains, qui voyaient la maison royale de Macédoine dans un état florissant ; et ils mirent tous leurs soins à pacifier et à s'assurer les provinces situées à l'orient de l'Italie. Ils se persuadaient qu'il serait encore temps de prévenir Hannibal, lorsqu'ils auraient fait repentir les Illyriens de leur faute, et châtié l'ingratitude et la témérité de Demetrius. Ils se trompaient : Hannibal les prévint, et se rendit maître de Sagonte, ce qui fut cause que la guerre ne se fit pas en Espagne, mais aux portes de Rome et dans toute l'Italie.
Cependant les Romains, suivant leur premier projet, envoyèrent une armée en Illyrie, sous la conduite de L. Emilius, vers le printemps de la première année de la cent quarantième olympiade. Hannibal alors sortit de Carthagène, et s'avança vers Sagonte. Cette ville est située à sept stades de la mer, sur le pied des montagnes où se joignent les frontières de Celtibérie, et qui s'étendent jusqu'à la mer : c'est le pays le plus fertile de toute l'Espagne. Hannibal vint camper devant cette ville, et en poussa le siège avec vigueur. Il prévoyait que de la prise de cette ville il tirerait pour la suite les plus grands avantages ; que par là il ôterait toute espérance aux Romains de faire la guerre dans l'Espagne ; qu'après avoir jeté l'épouvante dans les esprits, ceux qu'il avait déjà subjugués, seraient plus dociles, et ceux qui ne dépendaient encore de personne, plus circonspects ; que, ne laissant pas d'ennemi derrière lui, sa marche en serait plus sûre et plus tranquille ; qu'il y amasserait de l'argent pour l'exécution de ses desseins ; que le butin que les soldats en rapporteraient les rendrait plus vifs et plus ardents à le suivre; et qu'enfin, avec les dépouilles qu'il enverrait à Carthage, il se gagnerait la bienveillance de ses concitoyens. Animé par ces puissants motifs, il n'épargnait rien pour venir heureusement à bout du siège de Sagonte. Il donnait lui-même l'exemple aux troupes, et se trouvait à tous les travaux. Tantôt il exhortait les soldats, tantôt il s'exposait aux dangers les plus évidents. Enfin, après huit mois de soins et de peines, il emporta la ville d'assaut, et y fit un butin prodigieux d'argent, de prisonniers et de meubles. Il mit de côté l'argent pour servir à ses desseins ; il distribua aux soldats, chacun selon son mérite, ce qu'il avait fait de prisonniers, et envoya les meubles à Carthage. Le succès répondit à tout ce qu'il avait projeté. Les soldats devinrent plus hardis à s'exposer; les Carthaginois se rendirent avec plaisir à tout ce qu'il demandait d'eux, et, avec l'argent dont il s'était abondamment fourni, il entreprit beaucoup de choses qui lui réussirent.
Sur la nouvelle que les Romains se disposaient à venir dans l'Illyrie, Demetrius jeta dans Dimale une forte garnison et toutes les munitions nécessaires. Il fit mourir dans les autres villes les gouverneurs qui lui étaient opposés, mit à leur place les personnes sur la fidélité desquelles il pouvait compter, et choisit entre ses sujets six mille des hommes les plus braves pour garder Pharos, Le consul romain arrive dans l'Illyrie, et comme les ennemis comptaient beaucoup sur la force de Dimale, qu'ils croyaient imprenable, et sur les provisions qu'ils avaient faites pour la défendre, il résolut, pour étonner les ennemis, d'ouvrir la campagne par le siège de cette ville. Il exhorte les chefs chacun en particulier, et pousse les ouvrages en plusieurs endroits avec tant de chaleur, qu'au septième jour la ville fut prise d'assaut. C'en fut assez pour faire tomber les armes des mains des ennemis. Ils vinrent aussitôt de toutes les villes se rendre aux Romains, et se mettre sous leur protection. Le consul les reçut tous aux conditions qu'il crut les plus convenables, et aussitôt mit à la voile pour aller à Pharos attaquer Demetrius même. Mais ayant appris que la ville était forte, que la garnison était nombreuse et composée de soldats d'élite, et qu'elle avait des vivres et des munitions en abondance, il craignit que le siège ne fût difficile et ne traînât en longueur. Pour éviter ces inconvénients, il eut recours à un stratagème. Il prit terre pendant la nuit dans l'île avec toute son armée. Il en cacha la plus grande partie dans des bois et dans des lieux couverts; et, le jour venu, il se remit en mer, et entra tête levée dans le port le plus voisin de la ville avec vingt vaisseaux. Demetrius l'aperçut, et, croyant se jouer d'une si petite armée, il marcha vers ce port pour s'opposer à la descente des ennemis. À peine en fut-on venu aux mains, que, le combat s'échauffant, il arrivait continuellement de la ville des troupes fraîches au secours. Enfin toutes se présentèrent au combat. Ceux des Romains qui avaient débarqué pendant la nuit, s'étant mis en marche par des lieux couverts, arrivèrent en ce moment. Entre la ville et le port il y a une hauteur escarpée : ils s'en emparèrent, et arrêtèrent de là ceux qui de la ville venaient pour soutenir les combattants. Alors Demetrius ne songea plus à empêcher le débarquement ; il assembla ses troupes, les exhorta à faire leur devoir, et les mena vers la hauteur, dans le dessein de combattre en bataille rangée. Les Romains, qui virent que les Illyriens approchaient avec impétuosité et en bon ordre, vinrent sur eux, et les chargèrent avec une vigueur étonnante. Pendant ce temps-là les Romains qui venaient de descendre à terre, attaquaient aussi par derrière. Les Illyriens, enveloppés de tous côtés, se virent dans un désordre et une confusion extrêmes. Enfin, pressés de front et en queue, ils furent obligés de prendre la fuite. Quelques-uns se sauvèrent dans la ville, la plupart se répandirent dans l'île par des chemins écartés. Demetrius monta sur des frégates qu'il avait à l'ancre dans des endroits cachés, et, faisant voile pendant la nuit, arriva heureusement chez Philippe, où il passa le reste de ses jours. C'était un prince hardi et brave, mais d'une bravoure brutale et sans prudence. La fin de sa vie ne démentit point son caractère. Il périt à Messène, qu'il avait entrepris de prendre du consentement de Philippe, pour s'être exposé témérairement dans un combat. Mais nous parlerons de tout cela en détail, lorsqu'il en sera temps.
Emilius, après cette victoire, entra d'emblée dans Pharos, et la rasa : puis, s'étant rendu maître du reste de l'Illyrie, et y ayant donné ses ordres, l'été fini, il revint à Rome, et y entra en triomphe. On lui fit tous les honneurs, et il reçut tous les applaudissements que méritaient l'adresse et le courage avec lesquels il s'était conduit dans les affaires d'Illyrie.
Guerre des Romains contre les Carthaginois. - Ambassade des Romains à Carthage. - Différents traités faits entre les Romains et les Carthaginois.
Lorsque l'on apprit à Rome la prise de Sagonte, on n'y délibéra point si l'on ferait la guerre aux Carthaginois. Quelques historiens disent que cela fut mis en délibération, et ils rapportent même les discours qui se tinrent pour et contre ; mais c'est la chose du monde la moins vraisemblable. Comment se serait-il pu faire que les Romains, qui l'année précédente avaient déclaré la guerre aux Carthaginois s'il leur arrivait de mettre le pied sur les terres des Sagontins, après la prise de la ville même, doutassent, hésitassent un moment s'ils feraient la guerre ou non ? Comment passer à ces historiens ce qu'ils disent, que les Sénateurs, consternés de cette nouvelle, menèrent au Sénat des enfants de douze ans, et que ces enfants, à qui l'on avait fait part de tout ce qui s'y était passé, ne s'ouvrirent ni à leurs parents ni à leurs amis sur le secret qui leur avait été confié ? Il n'y a dans tout cela ni vérité ni apparence même de vérité, à moins que l'on n'ajoute, ce qui est ridicule, que les Romains ont reçu de la fortune le privilège d'apporter la prudence en naissant. De pareilles histoires ne valent pas la peine d'être réfutées plus au long, si toutefois on peut appeler histoires ce que nous débitent là-dessus Chéréas et Sosile. Ces contes m'ont tout l'air d'avoir été pris dans quelque boutique de barbier ou répétés d'après la plus vile populace.
Dès que l'on connut à Rome l'attentat d'Hannibal contre Sagonte, on envoya sur-le-champ deux ambassadeurs à Carthage, avec ordre de proposer deux choses, dont l'une ne pouvait être acceptée par les Carthaginois qu'à leur honte et à leur préjudice, et l'autre était pour Rome et pour Carthage le commencement d'une affaire très embarrassante et très meurtrière, car leurs instructions portaient ou de demander qu'on leur livrât Hannibal et ceux qui avaient pris part à ses desseins ou de déclarer la guerre. Les ambassadeurs, arrivés à Carthage, déclarèrent en plein Sénat leurs intentions. Les Carthaginois ne les entendirent qu'avec horreur, et donnèrent au plus capable, commission de défendre la cause de la République. Celui-ci ne parla pas plus du traité fait avec Hasdrubal que s'il n'eût jamais été fait ou que s'il eût été fait sans ordre du Sénat. Il justifia son silence sur cet article, en disant que, si les Carthaginois n'avaient aucun égard pour le traité d'Hasdrubal, ils ne faisaient en cela que suivre l'exemple du peuple romain, qui, dans la guerre de Sicile, cassa un traité fait par Luctatius, sous prétexte qu'il avait été conclu sans son autorité. Les Carthaginois appuyaient beaucoup sur le traité qui avait mis fin à la guerre de Sicile et y revenaient à tout moment, prétendant qu'il n'y avait rien qui regardât l'Espagne : qu'à la vérité il y était marqué que de part ni d'autre on ne ferait aucun tort aux alliés, mais que, dans le temps du traité, les Sagontins n'étaient point encore alliés du peuple romain, et là-dessus on ne cessait de relire le traité. Les Romains refusèrent absolument de répondre à cette apologie. Ils dirent que tette discussion pouvait avoir lieu, si Sagonte était encore dans son premier état, qu'en ce cas les paroles suffiraient peut-être pour terminer le différend, mais que, cette ville ayant été saccagée contre la foi des traités, les Carthaginois ne pouvaient, qu'en livrant les auteurs de l'infraction, se justifier de l'infidélité dont ils étaient accusés, qu'autrement, il fallait qu'ils tombassent d'accord de la part qu'ils avaient dans l'infraction, sans se défendre, comme ils faisaient, par des termes vagues et généraux qui ne décidaient rien. Il était à propos, ce me semble, que je ne passasse pas trop légèrement sur cet endroit. On peut se trouver dans des délibérations où il serait important de savoir au juste ce qui se passa dans cette occasion ; et d'ailleurs les historiens ont parlé de cette affaire avec tant d'ignorance et de partialité, que, sans ce que je viens de dire, je ne sais où l'on pourrait prendre une connaissance exacte des traités qui se sont faits jusqu'à présent entre les Romains et les Carthaginois, car il y en a plusieurs.
Le premier est du temps de L. Junius Brutus et de Marcus Horatius, les deux premiers consuls qui furent créés après l'expulsion des rois, et par l'ordre desquels fut consacré le temple de Jupiter Capitolin, vingt-huit ans avant l'invasion de Xerxès dans la Grèce. Le voici tel qu'il m'a été possible de l'expliquer, car la langue latine de ces temps-là est si différente de celle d'aujourd'hui, que les plus habiles ont bien de la peine à entendre certaines choses.
Entre les Romains et leurs alliés, et entre
les Carthaginois et leurs alliés, il y aura alliance à ces conditions : que
ni les Romains ni leurs alliés ne navigueront au-delà du beau promontoire,
s'ils n'y sont poussés par la tempête ou contraints par leurs ennemis :
qu'en cas qu'ils y aient été poussés par force, il ne leur sera permis d'y
rien acheter ni d'y rien prendre, sinon ce qui sera précisément nécessaire
pour le radoubement de leurs vaisseaux ou le culte des dieux, et qu'ils en
partiront au bout de cinq jours ; que les marchands qui viendront à Carthage
ne paieront aucun droit, à l'exception de ce qui se paie au crieur et au
scribe ; que tout ce qui sera vendu en présence de ces deux témoins, la foi
politique en sera garant au vendeur ; que tout ce qui se vendra en Afrique
ou dans la Sardaigne... . Que si quelques Romains abordent en Sicile, on
leur fera bonne justice en tout ; que les Carthaginois s'abstiendront de
faire aucun ravage chez les Antiales, les Ardéates, les Laurentins, les
Circéens, les Terraciniens, et chez quelque peuple des Latins que ce soit
qui obéisse au peuple romain ; qu'ils ne feront aucun tort aux villes mêmes
qui ne seront pas sous la domination romaine ; que s'ils en prennent
quelqu'une, ils la rendront aux Romains en son entier ; qu'ils ne bâtiront
aucune forteresse dans le pays des Latins ; que s'ils y entrent à main
armée, ils n'y passeront pas la nuit.
Ce beau promontoire c'est celui de Carthage, qui regarde le septentrion, et
au-delà duquel les Carthaginois ne veulent pas que les Romains passent sur
de longs vaisseaux vers le midi, de peur que ceux-ci, comme je crois, ne
connaissent les campagnes qui sont aux environs de Byzance et de la petite
Syrie, et qu'ils appellent Emporium, le marché, à cause de leur fertilité.
Ils consentent néanmoins que ceux que la tempête ou les ennemis y auront
poussés, y prennent ce qui leur sera nécessaire pour radouber leurs
vaisseaux ou pour les sacrifices, pourvu que ce soit sans violence, et
qu'ils en partent après cinq jours. Pour ce qui regarde Carthage, tout le
pays qui est en deçà du beau promontoire d'Afrique, la Sardaigne et la
Sicile, dont les Carthaginois sont les maîtres, il est permis aux marchands
romains d'aller dans tous ces pays, et on leur promet, sous la foi publique,
que partout on leur fera bonne justice. Au reste, dans ce traité on parle
autrement de la Sardaigne et de l'Afrique que de la Sicile, car on parle des
deux premières comme en étant les maîtres, mais à l'égard de la Sicile on
distingue, les conventions ne tombant que sur ces parties de la Sicile qui
obéissent aux Carthaginois. De la part des Romains, les conventions qui
regardent le pays latin sont conçues de la même manière. Ils ne font point
mention du reste de l'Italie, parce qu'il ne leur était pas soumis.
Il y eut encore depuis un autre traité, dans lequel les Carthaginois comprirent les Tyriens et les Uticéens, et où l'on ajoute au beau promontoire Mastie et Tarséion, au-delà desquels on défend aux Romains de piller et de bâtir une ville. Mais rapportons les termes du traité : entre les Romains et leurs alliés, et entre les Carthaginois, les Tyriens, les Uticéens et les alliés de tous ces peuples, il y aura alliance à ces conditions, que les Romains ne pilleront, ni ne trafiqueront, ni ne bâtiront de ville au-delà du beau promontoire de Mastie et de Tarséion, que si les Carthaginois prennent dans le pays latin quelque ville qui ne soit pas de la domination romaine, ils garderont pour eux l'argent et les prisonniers, et remettront la ville aux Romains, que si les Carthaginois prennent quelque homme faisant partie des peuples qui sont en paix avec les Romains par un traité écrit, sans pourtant leur être soumis, ils ne le feront pas entrer dans les ports des Romains, que s'il y entre et qu'il soit pris par un Romain, on lui donnera liberté de se retirer, que cette condition sera aussi observée du côté des Romains, que si ceux-ci prennent dans un pays qui appartient aux Carthaginois de l'eau ou des fourrages, ils ne s'en serviront pas pour faire tort à aucun de ceux qui ont paix et alliance avec les Carthaginois... que si cela ne s'observe pas, il ne sera pas permis de se faire justice à soi-même, que si quelqu'un le fait, cela sera regardé comme un crime public, que les Romains ne trafiqueront pas ni ne bâtiront pas de ville dans la Sardaigne ni dans l'Afrique, qu'il ne leur sera permis d'y aller que pour prendre des vivres ou pour radouber leurs vaisseaux, que s'ils y sont portés par la tempête, ils ne pourront y rester que cinq jours, que dans la partie de la Sicile qui obéit aux Carthaginois et à Carthage, un Romain aura pour son commerce et ses actions la même liberté qu'un citoyen, qu'un Carthaginois aura le même droit à Rome.
On voit encore dans ce traité que les Carthaginois parlent de l'Afrique et de la Sardaigne comme de deux pays qui leur sont soumis, et qu'ils ôtent aux Romains tout prétexte d'y mettre le pied ; qu'au contraire, en parlant de la partie de la Sicile, ils désignent la partie qui leur obéit. Les Romains font la même chose à l'égard du pays latin, en défendant aux Carthaginois de toucher aux Antiates, aux Ardéates, aux Circéens et Terraciniens, qui sont les peuples du pays latin qui occupent les villes maritimes.
Au temps de la descente de Pyrrhus, avant que les Carthaginois pensassent à la guerre de Sicile, les Romains firent avec eux un troisième traité, où l'on voit les mêmes conventions que dans les précédents, mais on ajoute que si les uns ou les autres font alliance par écrit avec Pyrrhus, ils mettront cette condition, qu'il leur sera permis de porter du secours à ceux qui seront attaqués, que, quel que soit celui des deux qui ait besoin de secours, ce seront les Carthaginois qui fourniront les vaisseaux, soit pour le voyage, soit pour le combat, mais que les uns et les autres paieront à leurs frais la solde à leurs troupes, que les Carthaginois secourront les Romains même sur mer, s'il en est besoin, et qu'on ne forcera point l'équipage à sortir d'un vaisseau malgré lui.
Ces traités étaient confirmés par des serments. Au premier, les Carthaginois jurèrent par les dieux de leurs pères, et les Romains une pierre en main, suivant un ancien usage, par Mars et Enyalius. Le jurement par une pierre se faisait ainsi : celui qui confirmait un traité pas un serment, après avoir juré sur la foi publique, prenait une pierre dans la main et prononçait ces paroles : Si je jure vrai, qu'il m'arrive du bien. Si je pense autrement que je ne jure, que tous les autres jouissent tranquillement de leur patrie, de leurs lois, de leurs biens, de leurs pénates, de leurs tombeaux, et que moi seul je sois brisé comme l'est maintenant cette pierre. Et en même temps il jetait la pierre.
Ces traités subsistent encore, et se conservent sur des tables d'airain au temple de Jupiter Capitolin dans les archives des édiles. Il n'est cependant pas étonnant que Philin ne les ait pas connus ; de notre temps même il y avait de vieux Romains et de vieux Carthaginois qui, quoique bien instruits des affaires de leur République, n'en avaient aucune connaissance. Mais qui ne sera surpris que Philin ait osé écrire tout le contraire de ce que l'on voit dans ces anciens monuments : qu'il y avait entre les Romains et les Carthaginois un traité par lequel toute la Sicile était interdite à ceux-là, et à ceux-ci toute l'Italie ; et que les Romains avaient violé le traité et leur serment, lorsqu'ils avaient fait leur première descente en Sicile, Il parle de ce traité comme s'il l'avait vu de ses propres yeux, quoique jamais pareil traité n'ait existé, et qu'il ne se trouve nulle part. Nous avions déjà dit quelque chose de ces traités dans notre introduction, mais il fallait ici un détail plus exact, pour tirer d'erreur ceux à qui Philin en avait imposé.
À regarder cependant la descente que les Romains firent dans la Sicile du côté de l'alliance qu'ils avaient faite avec les Mamertins, et du secours qu'ils avaient porté à ce peuple, malgré la perfidie avec laquelle il avait surpris Messène et Rhegio, il ne serait pas aisé de la justifier de tout reproche. Mais on ne peut dire sans une ignorance grossière, que cette descente fut contraire à un traité précédent.
Après la guerre de Sicile on fit un quatrième
traité, dont voici les conditions, que les Carthaginois sortiront de la
Sicile et de toutes les îles qui sont entre la Sicile et l'Italie, que de
part ni d'autre on ne fera aucun tort aux alliés, que l'on ne commandera
rien dans la domination les uns des autres, que l'on n'y bâtira point
publiquement, qu'on n'y lèvera point de soldats, qu'on ne fera point
d'alliance avec les alliés de l'autre parti, que les Carthaginois paieront
pendant dix ans deux mille deux cents talents, et cent d'abord après le
traité, que les Carthaginois rendront sans rançon tous les prisonniers
qu'ils ont faits sur les Romains.
La guerre d'Afrique terminée, les Romains ayant porté un décret pour
déclarer la guerre aux Carthaginois, on ajouta ces deux conditions, que les
Carthaginois abandonneront la Sardaigne, et qu'ils paieront douze cents
talents au-delà de la somme marquée ci-dessus.
Enfin, dans le dernier traité, qui fut celui que l'on fit avec Hasdrubal dans l'Espagne, on convint de ce nouvel article que les Carthaginois ne feraient pas la guerre au-delà de l'Ebre. Tels sont les traités conclus entre les Romains et les Carthaginois jusqu'au temps d'Hannibal, et l'on voit que les Romains pouvaient passer en Sicile sans violer leurs serments. Mais il faut avouer qu'au temps où ils conclurent le traité relatif à la Sardaigne, ils n'avaient ni cause ni prétexte plausibles de susciter une seconde guerre aux Carthaginois. Il est de notoriété publique que ce fut contre la foi des traités que l'on força les Carthaginois, dans des circonstances fâcheuses, à sortir de la Sardaigne et à payer le tribut énorme dont nous avons parlé. En vain les Romains objectent que leurs marchands furent maltraités en Afrique pendant la guerre des soldats mercenaires ; cette faute était pardonnée depuis que les Romains, ayant reçu des Carthaginois dans leurs ports, leur avaient remis par reconnaissance et sans rançon tous les prisonniers Carthaginois qu'ils avaient chez eux.
Lequel des deux peuples est cause de la seconde guerre punique. - Raisons de part et d'autre. Utilité de l'histoire. Avantages d'une histoire générale sur une histoire particulière.
Il nous reste à examiner à qui, des Romains ou des Carthaginois, l'on doit attribuer la guerre d'Hannibal. Nous avons vu ce que disaient ceux-ci pour se justifier voyons maintenant, non pas ce que disaient les Romains de ce temps-là, car ils étaient alors si indignés du sac de Sagonte, qu'ils ne pensaient point aux raisons qu'on leur prête aujourd'hui, mais ce que ceux de nos jours ne cessent de répéter. Ils disent donc premièrement que les Carthaginois avaient grand tort de ne faire aucun cas des conventions faites avec Hasdrubal, qu'il n'en était pas de ce traité-là comme de celui de Luctatius, où l'on avait ajouté qu'il serait authentique et inviolable, si le peuple le ratifiait, au lieu qu'Hasdrubal avait fait le sien avec pleine autorité, que ce traité portait en termes exprès que les Carthaginois ne passeraient pas à main armée au-delà de l'Ebre. Il est vrai, comme l'assurent les Romains, que, dans le traité fait au sujet de la Sicile, il était porté que les alliés des deux nations seraient en sûreté chez l'une comme chez l'autre, et que par ces alliés on ne doit pas seulement entendre ceux qui l'étaient alors, comme le prétendent les Carthaginois, car on aurait ajouté que l'on ne ferait point d'autres alliés que ceux que l'on avait déjà ou bien que les alliés que l'on ferait après le traité n'y étaient pas compris. Puis donc que l'on ne s'est exprimé ni de l'une ni de l'autre façon, il est évident que les alliés des deux Etats, soit présents, soit à venir, devaient chez l'un et l'autre être en sûreté. Cela est d'autant plus raisonnable, qu'il n'y a pas d'apparence qu'on dût conclure un traité par lequel on s'ôtât la liberté de faire de nouveaux alliés ou de nouveaux amis, toutes les fois qu'on le trouverait à sa bienséance ou de défendre ceux qu'on aurait pris de nouveau sous sa protection. On ne prétendait donc rien autre chose de part, et d'autre, sinon qu'à l'égard des alliés présents il ne leur serait fait aucun tort, et qu'il ne serait permis en aucune manière aux deux Etats de se faire des alliés l'un chez l'autre, et par rapport aux alliés à venir, qu'on ne lèverait point de soldats, que l'on ne commanderait rien dans les provinces ni chez les alliés les uns des autres, et que les alliés des deux Etats seraient chez l'un et l'autre en sûreté. Il est encore de la dernière évidence que, longtemps avant Hannibal, Sagonte s'était mise sous la protection des Romains. Une raison incontestable, et dont les Carthaginois même conviennent, c'est qu'une sédition s'étant élevée parmi les Sagontins, ce ne fut pas les Carthaginois, quoique voisins et maîtres de l'Espagne, qu'ils prirent pour arbitres, mais les Romains, et que ce fut aussi par leur entremise qu'ils remirent le bon ordre dans leur République. Concluons de toutes ces raisons, que, si la destruction de Sagonte est la cause de la guerre, on doit reconnaître que c'est injustement et contre la foi des traités faits, l'un avec Luctatius, et l'autre avec Hasdrubal, que les Carthaginois prirent les armes, puisque le premier portait que les alliés des deux nations seraient en sûreté chez l'une comme chez l'autre ; et que le second défendait de porter la guerre au-delà de l'Ebre. Mais, s'il est vrai que les Carthaginois n'aient déclaré la guerre que parce que, chassés de la Sardaigne, ils avaient en même temps été grevés d'un nouveau tribut, et pour saisir l'occasion favorable de se venger de ceux qui, dans un temps où ils ne pouvaient résister, leur avaient fait cette insulte, il faut absolument tomber d'accord que la guerre que les Carthaginois firent aux Romains, sous la conduite d'Hannibal, était très juste.
Des gens peu judicieux diront peut-être, en lisant ceci, qu'il était assez inutile de s'étendre si fort sur ces sortes de choses. J'avoue que si l'homme, dans quelque circonstance que ce soit, pouvait se suffire à lui-même, la connaissance des choses passées ne serait peut-être que curieuse et point du tout nécessaire ; mais il n'y a point de mortel qui puisse dire cela ni de lui-même ni d'une République entière. Quelque heureux et tranquille que soit le présent, la prudence ne permet pas qu'on se promette avec assurance le même bonheur et la même tranquillité pour l'avenir. Il n'est donc pas seulement beau, il est encore nécessaire de savoir les choses qui se sont passées avant nous. Sans la connaissance de ce que d'autres ont fait, comment pourra-t-on, dans les injustices qui nous seront faites à nous-mêmes ou à notre patrie, trouver des secours ou des alliés ? Si l'on veut acquérir ou entreprendre quelque chose de nouveau, comment gagnera-t-on des gens qui entrent dans nos projets, et qui nous aident à les exécuter ? En cas que l'on soit content de l'état où l'on est, comment portera-t-on les autres à nous l'assurer et à nous y conserver ? Ceux avec qui nous vivons s'accommodent presque toujours au présent ; ils ne parlent et n'agissent que comme des personnages de théâtre; de sorte que leurs vues sont difficiles à découvrir, et que la vérité est souvent cachée sous d'épaisses ténèbres. Il n'en est pas de même des actions passées. Elles nous font clairement connaître quels ont été les sentiments et les dispositions de leurs auteurs. C'est par là que nous connaissons de qui nous devons espérer des faveurs, des bienfaits, du secours, et de qui nous devons craindre tout le contraire. Enfin, c'est par les choses passées que nous apprenons à prévoir qui aura compassion de nos malheurs, qui prendra part à notre indignation, qui sera le vengeur des injustices que l'on nous a faites. Et qu'y a-t-il de plus utile, soit pour nous en particulier, soit pour la République en général ? Ceux donc qui lisent ou qui écrivent l'histoire ne doivent pas tant s'appliquer au récit des actions mêmes, qu'à ce qui s'est fait auparavant, en même temps et après. Ôtez de l'histoire les raisons pour lesquelles tel événement est arrivé, les moyens que l'on a employés, le succès dont il a été suivi, le reste n'est plus qu'un exercice d'esprit, dont le lecteur ne pourra rien tirer pour son instruction. Tout de réduira à un plaisir stérile que la lecture donnera d'abord, mais qui ne produira aucune utilité.
Ceux qui s'imaginent qu'un ouvrage comme le mien, composé d'un grand nombre de gros livres, coûtera trop à acheter et à lire, ne savent apparemment pas combien il est plus aisé d'acheter et de lire quarante livres qui apprennent par ordre et avec clarté ce qui s'est fait en Italie, en Sicile et en Afrique depuis Pyrrhus, où finit l'histoire de Timée, jusqu'à la prise de Carthage, et ce qui s'est passé dans les autres parties du monde depuis la fuite de Cléomène, roi de Sparte, jusqu'au combat donné entre les Romains et les Achéens à la pointe du Péloponnèse, que de lire et d'acheter les ouvrages qui ont été faits sur chacun des événements en particulier ; car, sans compter que ces ouvrages sont en bien plus grand nombre que mes livres, on n'y peut rien apprendre de certain : les faits n'y sont pas rapportés avec les mêmes circonstances ; on n'y dit rien des choses qui se sont faites dans le même temps ; cependant, en les comparant ensemble, il est assez ordinaire de se former une autre manière de voir que lorsqu'on les examine séparément. Une troisième raison, c'est qu'il est impossible même d'y indiquer les choses les plus importantes. Nous l'avons déjà dit, ce qu'il y a de plus nécessaire dans l'histoire, ce sont les choses qui ont suivi les faits, celles qui se sont passées en même temps, et plus encore les causes qui les ont précédés. C'est ainsi que nous savons que la guerre de Philippe a donné occasion à celle d'Antiochus, celle d'Hannibal à celle de Philippe, et celle de Sicile à celle d'Hannibal, et qu'entre ces guerres il y a eu grand nombre de divers événements qui tendaient tous à une même fin. Or, on ne peut apprendre tout cela que dans une histoire générale ; celle des guerres particulières, comme de Persée et de Philippe, nous laisse dans une parfaite ignorance de toutes ces choses ; à moins qu'en lisant de simples descriptions de batailles, on ne croie voir l'économie et la conduite de toute une guerre. Or rien ne serait plus mal fondé. Concluons donc qu'autant il est plus avantageux de savoir que d'écouter, autant mon ouvrage l'emportera sur des histoires particulières. Retournons à notre sujet.
Guerre déclarée. - Hannibal pourvoit à la sûreté de l'Afrique et de l'Espagne. - Précautions qu'il prend avant de se mettre en marche. - Il s'avance vers les Pyrénées. - Digression géographique.
Les ambassadeurs romains laissèrent parler les Carthaginois sans leur rien répondre. Quand ils eurent fini, le plus ancien de l'ambassade, montrant son sein aux Sénateurs, leur dit qu'il y avait apporté pour eux la guerre ou la paix, et qu'ils n'avaient qu'à choisir laquelle des deux ils voulaient qu'il en fît sortir. " Celle qu'il vous plaira ", répliqua le roi des Carthaginois. L'ambassadeur ayant repris qu'il en ferait sortir la guerre, tout le Sénat répondit d'une voix qu'il l'acceptait ; et aussitôt l'assemblée se sépara. Hannibal était alors à Carthagène en quartiers d'hiver. Il commença par renvoyer les Espagnols dans leurs villes. Son dessein était de se gagner par là leur amitié, et de se concilier leurs services pour la suite. Il marqua ensuite à son frère Hasdrubal de quelle manière il fallait qu'il s'y prît pour gouverner l'Espagne, et pour se mettre en garde contre les Romains, en cas que lui Hannibal vînt à s'éloigner. Il prit après cela des mesures pour qu'il n'arrivât aucun trouble dans l'Afrique, faisant passer à cet effet, par une conduite pleine de sagesse, des soldats d'Afrique en Espagne et d'Espagne en Afrique, afin que cette communication des deux peuples serrât, pour ainsi dire, les liens d'une mutuelle fidélité. Ceux d'Espagne qui passèrent en Afrique furent les Thersites, les Mastiens, les Ibères des montagnes et les Olcades ; ce qui faisait en tout douze cents chevaux et treize mille huit cent cinquante fantassins. Il y fit aussi passer des Baléares, peuple ainsi appelé, aussi bien que leur île, parce qu'il se bat avec la fronde. La plupart de ces nations furent placées dans la Métagonie, les autres furent envoyées à Carthage. Il tira des Métagonitains quatre mille hommes de pied, qu'il fit aller à Carthage, pour y tenir lieu d'otages et de troupes auxiliaires.
Il laissa à Hasdrubal son frère, en Espagne, cinquante vaisseaux à cinq rangs, deux à quatre, et cinq à trois. Trente-deux des premiers et les cinq derniers avaient leur équipage. La cavalerie était composée de quatre cent cinquante Libyo-Phéniciens et Africains, et de trois cents Lorgnes, de dix-huit cents hommes tant Numides que Massyliens, Masséliens, Maciens et Mauritaniens, peuples qui habitent vers l'Océan; et l'infanterie consistait en onze mille huit cent cinquante Africains, trois cents Liguriens et cinq cents Baléares. Il laissait outre cela vingt et un éléphants. Je prie que l'on ne soit pas surpris de voir ici un détail plus exact de ce que fit Hannibal en Espagne que dans les auteurs même qui en ont écrit en particulier, et qu'on ne me mette pas pour cela au nombre de ceux qui s'étudient à farder leurs mensonges pour les rendre croyables. Je n'ai fait cette énumération que parce que je l'ai crue très authentique, l'ayant trouvée à Licinium écrite sur une table d'airain par ordre d'Hannibal, pendant qu'il était dans l'Italie. Je ne pouvais suivre de meilleurs mémoires.
Hannibal ayant ainsi pourvu à la sûreté de l'Afrique et de l'Espagne, n'attendit plus que l'arrivée des courriers que les Gaulois lui envoyaient, car il les avait priés de l'informer de la fertilité du pays qui est au pied des Alpes et le long du Pô ; quel était le nombre des habitants ; si c'était des gens belliqueux ; s'il leur restait quelque indignation contre les Romains pour la guerre que ceux-ci leur avaient faite auparavant, et que nous avons rapportée dans le livre précédent, pour disposer le lecteur à entendre ce que nous avions à dire dans la suite. Il comptait beaucoup sur les Gaulois, et se promettait de leurs secours toutes sortes de succès. Pour cela, il dépêcha avec soin à tous les petits rois des Gaules, tant à ceux qui régnaient en deçà qu'à ceux qui demeuraient dans les Alpes mêmes, jugeant bien qu'il ne pouvait porter la guerre en Italie qu'en surmontant toutes les difficultés qu'il y aurait à passer dans les pays dont nous venons de parler, et qu'en faisant entrer les Gaulois dans son entreprise. Enfin les courriers arrivèrent, et lui apprirent quelles étaient les dispositions et l'attente des Gaulois, la hauteur extraordinaire des Alpes, et les fatigues qu'il devait s'attendre à essuyer dans ce passage, qui n'était cependant pas absolument impossible. Le printemps venu, Hannibal fit sortir ses troupes des quartiers d'hiver. Les nouvelles qu'il reçut de Carthage sur ce qui s'y était fait en sa faveur, exaltèrent son courage, et, sûr de la bonne volonté de ses concitoyens, il commença pour lors à exhorter ouvertement les soldats à faire la guerre aux Romains. Il leur représenta de quelle manière les Romains avaient demandé qu'on les leur livrât, lui et tous les officiers de l'armée. Il leur parla avec avantage de la fertilité du pays où ils allaient entrer, de la bonne volonté des Gaulois, et de l'alliance qu'ils devaient faire ensemble. Les troupes lui ayant témoigné qu'elles étaient prêtes à le suivre partout, il loua leur courage, leur annonça le jour du départ, et congédia l'assemblée. Tout cela s'étant fait pendant les quartiers d'hiver, et tout étant réglé pour la sûreté de l'Afrique et de l'Espagne, au jour marqué il se met en marche à la tête de quatre-vingt-deux mille hommes de pied et environ douze mille chevaux. Ayant passé l'Ebre, il soumet à son pouvoir les Ibergètes, les Bargusiens, les Erénésiens, les Andosiens, c'est-à-dire les peuples qui habitent depuis l'Ebre jusqu'aux monts Pyrénées. Après s'être rendu maître en peu de temps de tous ces peuples, avoir pris quelques villes d'assaut, non sans livrer de sanglants combats et perdre beaucoup des siens, il laissa Hannon en deçà de l'Ebre pour y commander, et pour retenir aussi dans le devoir les Bargusiens, dont il se défiait, principalement à cause de l'amitié qu'ils avaient pour les Romains.
Il détacha de son armée dix mille hommes de pied et mille chevaux, qu'il laissa à Hannon, avec les bagages de ceux qui devaient marcher avec lui. Il renvoya un pareil nombre de soldats chacun dans sa patrie, premièrement pour s'y ménager l'amitié des peuples, et en second lieu pour faire espérer aux soldats qu'il gardait et à ceux qui restaient dans l'Espagne, qu'il leur serait aisé d'obtenir leur congé, motif puissant pour les porter à prendre les armes dans la suite, s'il arrivait qu'il eût besoin de leur secours. Son armée se trouvant alors déchargée de ses bagages, et composée de cinquante mille hommes de pied et de neuf mille chevaux, il lui fait prendre sa marche par les monts Pyrénées pour aller passer le Rhône. Cette armée n'était pas à la vérité extrêmement nombreuse, mais c'étaient de bons soldats, des troupes merveilleusement exercées par les guerres continuelles qu'elles avaient faites en Espagne.
Mais, de peur que par l'ignorance des lieux on ait de la peine à suivre le récit que je vais faire, il est à propos que j'indique de quel endroit partit Hannibal, par où il passa, et en quelle partie de l'Italie il arriva. Pour cela il ne faut pas se contenter de nommer par leurs noms les lieux, les fleuves et les villes, comme font quelques historiens, qui s'imaginent que cela suffit pour donner une connaissance distincte des lieux. Quand il s'agit de lieux connus, je conviens que, pour en renouveler le souvenir, c'est un grand secours que d'en voir les noms ; mais quand il, est question de ceux qu'on ne connaît point du tout, il ne sert pas plus de les nommer que si l'on faisait entendre le son d'un instrument ou toute autre chose qui ne signifierait rien ; car, l'esprit n'ayant pas sur quoi s'appuyer, et ne pouvant rapporter ce qu'il entend à rien de connu, il ne lui reste qu'une notion vague et confuse. Il faudrait donc trouver une méthode par laquelle on conduisît le lecteur à la connaissance des choses inconnues, en les rapportant à des idées solides et qui lui seraient familières.. La première, la plus étendue et la plus universelle notion qu'on puisse donner, c'est celle par laquelle on conçoit, pour peu d'intelligence que l'on ait, la division de cet univers en quatre parties, et l'ordre que ces parties gardent entre elles, savoir : l'Orient, le Couchant, le Midi et le Septentrion. Une autre notion, c'est celle par laquelle, plaçant par l'esprit les différents endroits de la terre sous quelqu'une de ces quatre parties, nous rapportons les lieux qui nous sont inconnus à des idées connues familières. Après avoir fait cela pour le monde en général, il n'y a plus qu'à partager de la même manière la terre que nous connaissons. Celle-ci est partagée en trois parties : la première est l'Asie, la seconde L'Afrique, la troisième l'Europe. Ces trois parties se terminent au Tanaïs, au Nil et au détroit des colonnes d'Hercule. L'Asie contient tout le pays qui est entre le Nil et le Tanaïs, et sa situation par rapport à l'univers est entre le levant d'été et le midi. L'Afrique est entre le Nil et les colonnes d'Hercule, dans cette partie de l'univers qui est au midi et au couchant d'hiver jusqu'au couchant équinoxial, qui tombe aux colonnes d'Hercule. Ces deux parties, considérées en général, occupent le côté méridional de la mer Méditerranée, depuis l'orient jusqu'au couchant.
L'Europe, qui leur est opposée, s'étend vers le septentrion, et occupe tout cet espace depuis l'orient jusqu'au couchant. Sa partie la plus considérable est au septentrion entre le Tanaïs et Narbonne, laquelle au couchant n'est pas fort éloignée de Marseille ni des embouchures par lesquelles le Rhône se décharge dans la mer de Sardaigne. C'est à partir de Narbonne et autour du Rhône jusqu'aux monts Pyrénées qu'habitent les Gaulois, depuis la Méditerranée jusqu'à l'Océan. Le reste de l'Europe, depuis ces montagnes jusqu'au couchant et aux colonnes d'Hercule, est borné en partie par notre mer et en partie par la mer extérieure. La partie qui est le long de la Méditerranée jusqu'aux colonnes d'Hercule, s'appelle Ibérie. Le côté qui est sur la mer extérieure ou la grande mer, n'a point encore de nom connu, parce que ce n'est que depuis peu qu'on l'a découvert. Il est occupé par des nations barbares, qui sont en grand nombre, et dont nous parlerons en particulier dans la suite. Or, comme personne jusqu'à nos jours n'a pu distinguer clairement si l'Éthiopie, où l'Asie et l'Afrique se joignent, est un continent qui s'étend vers le midi ou est environnée de la mer, nous ne connaissons rien non plus de l'espace qui est entre le Tanaïs et Narbonne jusqu'au septentrion. Peut-être que dans la suite en multipliant nos investigations nous en apprendrons quelque chose. Mais on peut hardiment assurer que tous ceux qui en parlent ou qui en écrivent aujourd'hui, parlent et écrivent sans savoir, et ne nous débitent que des fables. Voilà ce que j'avais à dire pour rendre ma narration plus claire à ceux qui n'ont aucune connaissance des lieux : ils peuvent maintenant rapporter ce qu'on leur dira aux différentes parties de la terre, en se réglant sur celles de l'univers en général. Car, comme en regardant on a coutume de tourner le visage vers l'endroit qui nous est désigné, de même, en lisant il faut nous transporter en esprit dans tous lieux dont on nous parle. Mais il est temps de reprendre la suite de notre histoire.
Chemin qu'Hannibal eut à faire pour passer de Carthage-la-neuve en Italie. - Les Romains se disposent à porter la guerre en Afrique. - Troubles que leur suscitent les Boïens. - Hannibal arrive au Rhône, et le passe.
Les Carthaginois, dans le temps qu'Hannibal partit, étaient maîtres de toutes les provinces d'Afrique qui sont sur la Méditerranée, depuis les autels des Philéniens, qui sont le long de la grande Syrte, jusqu'aux colonnes d'Hercule, ce qui fait une côte de plus de seize mille stades de longueur. Puis, ayant passé le détroit où sont les colonnes d'Hercule, ils se soumirent toute l'Espagne jusqu'aux rochers où, du côté de notre mer, aboutissent les monts Pyrénées, qui divisent les Ibères d'avec les Gaulois. Or, de ces rochers aux colonnes d'Hercule il y a environ huit mille stades ; car on en compte trois mille depuis les colonnes jusqu'à Carthagène ou la nouvelle Carthage, comme d'autres l'appellent. Depuis cette ville jusqu'à l'Ebre, il y en a deux mille deux cents ; depuis là jusqu'à Emporium, seize cents, et tout autant d'Emporium au passage du Rhône ; car les Romains ont distingué cette route avec soin par des espaces de huit stades. Depuis le passage du Rhône, en allant vers ses sources jusqu'au commencement des Alpes, d'où l'on va en Italie, on compte quatorze cents stades. Les hauteurs des Alpes, après lesquelles on se trouve dans les plaines d'Italie qui sont le long du Pô, s'étendent encore à douze cents stades. Il fallait donc qu'Hannibal traversât environ neuf mille stades pour venir de la nouvelle Carthage en Italie. II avait déjà fait presque la moitié de ce chemin, mais ce qu'il lui en restait à faire était le plus difficile.
Il se préparait à faire passer à son armée les
détroits des monts Pyrénées, où il craignait fort que les Gaulois ne
l'arrêtassent, lorsque les Romains apprirent, par les ambassadeurs envoyés à
Carthage, ce qui s'y était dit et résolu, et qu'Hannibal avait passé l'Ebre
avec son armée. Aussitôt on prit la résolution d'envoyer en Espagne une
armée sous le commandement de Publius Cornelius, et une autre en Afrique,
sous la conduite de Tiberius Sempronius. Pendant que ces deux consuls
levaient des troupes et faisaient les autres préparatifs, on se pressa de
finir ce qui regardait les colonies, qu'on avait auparavant décidé d'envoyer
dans la Gaule Cisalpine. On enferma les villes de murailles, et on donna
ordre à ceux qui devaient y habiter, de s'y rendre dans l'espace de trente
jours. Ces colonies étaient chacune de six mille personnes. Une fut placée
en deçà du Pô, et fut appelée Plaisance, et l'autre au-delà du même fleuve,
et on lui donna le nom de Crémone.
À peine ces colonies furent-elles établies, que les Gaulois appelés Boïens,
qui déjà autrefois avaient cherché à rompre avec les Romains, sans avoir pu
rien exécuter faute d'occasion, apprenant que les Carthaginois approchaient,
et se promettant beaucoup de leur secours, se détachèrent des Romains, et
leur abandonnèrent leurs otages qu'ils avaient donnés après la dernière
guerre. Ils entraînèrent dans leur révolte les Insubriens, qu'un ancien
ressentiment contre les Romains disposait déjà à une sédition, et tous
ensemble ravagèrent le pays que les Romains avaient partagé. Les fuyards
furent poursuivis jusqu'à Mutine, autre colonie des Romains. Mutine
elle-même fut assiégée. Ils y investirent trois Romains distingués qui
avaient été envoyés pour faire le partage des terres, savoir : C. Luctatius,
personnage consulaire, et deux préteurs. Ceux-ci demandèrent à être écoutés,
et les Boïens leur donnèrent audience, mais, au sortir de la conférence, ils
eurent la perfidie de s'en saisir, dans la pensée que, par leur moyen, ils
pourraient recouvrer leurs otages. Sur cette nouvelle, Lucius Manlius, qui
commandait une armée dans le pays, se hâta d'aller au secours. Les Boïens,
le sentant proche, dressèrent des embuscades dans une forêt, et dès que les
Romains y furent entrés, ils fondirent sur eux de tous les côtés, et tuèrent
une grande partie de l'armée romaine. Le reste prit la fuite dès le
commencement du combat. On se rallia, à la vérité, quand on eut gagné les
hauteurs, mais de telle sorte qu'à peine cela pouvait-il passer pour une
honnête retraite. Ces fuyards furent poursuivis par les Boïens, qui les
investirent dans un bourg appelé, Tanès. La nouvelle vint à Rome que la
quatrième armée était enfermée et assiégée par les Boïens : sur-le-champ on
envoya à son secours les troupes qu'on avait levées pour Publius, et on en
donna le commandement à un préteur. On ordonna ensuite à Publius de faire
pour lui de nouvelles levées chez les alliés. Telle était la situation des
affaires dans les Gaules à l'arrivée d'Hannibal, comme nous l'avions déjà
dit dans nos premiers livres.
Au commencement du printemps, les consuls romains, ayant fait tous les préparatifs nécessaires à l'exécution de leurs desseins, se mirent en mer, Publius avec soixante vaisseaux, pour aller en Espagne, et Tiberius Sempronius, avec cent soixante vaisseaux longs à cinq rangs, pour se rendre en Afrique. Celui-ci s'y prit d'abord avec tant d'impétuosité, fit des préparatifs si formidables à Lilybée, assembla de tous côtés des troupes si nombreuses, qu'on eût dit qu'en débarquant, il voulait mettre le siège devant Carthage même. Publius, longeant la côte de Ligurie, arriva le cinquième jour dans le voisinage de Marseille, et, ayant abordé à la première embouchure du Rhône, qu'on appelle l'embouchure de Marseille, il mit ses troupes à terre. Il apprit là qu'Hannibal avait passé les Pyrénées, mais il croyait ce général encore bien éloigné, tant à cause des difficultés que les lieux lui devaient opposer, que du grand nombre des Gaulois au travers desquels il fallait qu'il marchât. Cependant Hannibal, après avoir obtenu des Gaulois, en partie par argent en partie par force, tout ce qu'il voulait, arriva au Rhône avec son armée, ayant à sa droite la mer de Sardaigne. Sur la nouvelle que les ennemis étaient arrivés, Publius, soit que la célébrité de cette marche lui parût incroyable, soit qu'il voulût s'instruire exactement de la vérité de la chose, envoya à la découverte trois cents cavaliers des plus braves, et y joignit, pour les guider et soutenir, les Gaulois qui servaient pour lors à la solde des Marseillais. Pendant ce temps-là, il fit rafraîchir son armée, et délibérait avec les tribuns quels postes on devait occuper, et où il fallait donner bataille aux ennemis.
Hannibal étant arrivé sur les bords du Rhône, à peu près à quatre jours de marche de la mer, fit sur-le-champ ses dispositions pour traverser le fleuve dans un endroit où il n'avait qu'un seul courant. Pour cela il commença par se concilier l'amitié de tous ceux qui habitaient sur les bords, et acheta d'eux tous leurs canots et chaloupes, dont ils ont grand nombre, à cause de leur commerce par mer. Il acheta outre cela tout le bois qui était propre à construire encore de pareils bâtiments, et dont il fit en deux jours une quantité extraordinaire de bateaux, chacun s'efforçant de se mettre en état de n'avoir pas besoin de secours étranger pour passer le fleuve. Tout était déjà préparé, lorsqu'un grand nombre de Barbares s'assembla sur l'autre bord pour s'opposer au passage des Carthaginois. Hannibal, alors faisant réflexion qu'il n'était pas possible d'agir par force contre une si grande multitude d'ennemis, que cependant il ne pouvait rester là sans courir risque d'être enveloppé de tous les côtés, détacha à l'entrée de la troisième nuit une partie de son armée sous le commandement de Hannon, fils du roi Bomilcar, et lui donna pour guides quelques gens du pays. Ce détachement remonta le fleuve jusqu'à environ deux cents stades, où il trouva une petite île qui partageait la rivière en deux. On s'y logea. On y coupa du bois dans une forêt voisine, et, les uns façonnant les pièces nécessaires, les autres les joignant ensemble, en peu de temps ils fabriquèrent autant de radeaux qu'il en fallait pour passer le fleuve, et le passèrent en effet sans que personne s'y opposât. Ils s'emparèrent ensuite d'un poste avantageux, et y restèrent tout ce jour-là pour se délasser et se disposer à exécuter l'ordre qu'Hannibal leur avait donné.
Ce général faisait aussi de son côté tout ce qu'il pouvait pour faire passer le reste de l'armée. Mais rien ne l'embarrassait plus que ses éléphants, qui étaient au nombre de trente-sept. Cependant, à la fin de la cinquième nuit, ceux qui avaient traversé les premiers s'étant avancés sur l'autre bord vers les Barbares, alors Hannibal, dont les soldats étaient prêts, disposa tout pour le passage. Les soldats pesamment armés devaient monter sur les plus grands bateaux, et l'infanterie légère sur les plus petits. Les plus grands étaient au-dessus et les plus petits au dessous, afin que, ceux-là soutenant la violence du courant, ceux-ci en eussent moins à souffrir. On pensa encore à faire suivre les chevaux à la nage, et pour cela un homme, à l'arrière de chaque bateau, en tenait par la bride trois ou quatre de chaque côté. Par ce moyen, dès le premier passage, on en jeta un assez grand nombre sur l'autre bord. à cet aspect, les Barbares sortent en foule et sans ordre de leurs retranchements, persuadés qu'il leur serait aisé d'arrêter les Carthaginois au débarquement. Cependant Hannibal voit sur l'autre bord une fumée s'élever. C'était le signal que devaient donner ceux qui étaient passés les premiers, lorsqu'ils seraient près de l'ennemi. Il ordonne aussitôt que l'on se mette sur la rivière, donnant ordre à ceux qui étaient sur les plus grands bateaux de faire tous leurs efforts pour résister à la rapidité du courant. On vit alors le spectacle du monde le plus effrayant et le plus capable d'inspirer la terreur, car, tandis que d'un côté les soldats embarqués s'encourageaient mutuellement par leurs cris, et luttaient pour ainsi dire contre la violence des flots, et que de l'autre les troupes bordant le fleuve animaient leurs compagnons par leurs clameurs, les Barbares, sur le bord opposé, entonnèrent une chanson guerrière, et défièrent les Carthaginois au combat. Dans ce moment, le détachement de Hannon fondit tout à coup sur les Barbares, qui défendaient le passage du fleuve, et mit le feu à leur camp. Les Barbares confondus de cette attaque imprévue, coururent les uns pour protéger leurs tentes, les autres pour résister aux assaillants. Hannibal, animé par le succès, à mesure que ses gens débarquaient, les rangea en bataille, les exhorta à bien faire, et les mena aux ennemis, qui, épouvantés et déjà mis en désordre par un événement si imprévu, furent tout d'un coup enfoncés et obligés de prendre la fuite.
Discours de Magile, roi gaulois, et d'Hannibal aux Carthaginois. - Combat entre deux partis envoyés à la découverte. - Passage des éléphants. - Extravagance des historiens sur le passage des Alpes par Hannibal.
Hannibal, maître du passage, et en même temps victorieux, pensa aussitôt à faire passer ce qui restait de troupes sur l'autre bord, et campa cette nuit le long du fleuve. Le matin, sur le bruit que la flotte des Romains était arrivée à l'embouchure du Rhône, il détacha cinq cents chevaux numides pour reconnaître où étaient les ennemis, combien ils étaient, et ce qu'ils faisaient. Puis, après avoir donné ses ordres pour le passage des éléphants, il assembla son armée, fit approcher Magile, petit roi qui l'était venu trouver des environs du Pô, et fit expliquer aux soldats par un interprète les résolutions que les Gaulois avaient prises, toutes très propres à donner du cœur et de la confiance aux soldats, car, sans parler de l'impression que devait faire sur eux la présence de gens qui les appelaient à leur secours, et qui leur promettaient de partager avec eux la guerre contre les Romains, il semblait qu'on ne pouvait se défier de la promesse que les Gaulois faisaient de les conduire jusqu'en Italie par des lieux où ils ne manqueraient de rien, et par où leur marche serait courte et sûre. Magile leur faisait encore des descriptions magnifiques de la fertilité et de l'étendue du pays où ils allaient entrer, et vantait surtout la disposition où étaient les peuples de prendre les armes en leur faveur contre les Romains.
Magile retiré, Hannibal s'approcha, et commença par rappeler à ses soldats ce qu'ils avaient fait jusqu'alors. Il dit que, quoiqu'ils se fussent trouvés dans des actions extraordinaires et dans les occasions les plus périlleuses, ils n'avaient jamais manqué de réussir, parce que, dociles à ses conseils, ils n'avaient rien entrepris que sur ses lumières, qu'ils ne craignissent rien pour la suite, qu'après avoir passé le Rhône et s'être acquis des alliés aussi affectionnés que ceux qu'ils voyaient eux-mêmes, ils avaient déjà surmonté les plus grands obstacles, qu'ils ne s'inquiétassent point des détails de l'entreprise, qu'ils n'avaient qu'à s'en reposer sur lui, qu'ils fussent toujours prompts à exécuter ses ordres et qu'ils ne pensassent qu'à faire leur devoir, et à ne point dégénérer de leur première valeur. Toute l'armée applaudit, et témoigna beaucoup d'ardeur. Hannibal la loua de ses bonnes dispositions, fit des vœux aux dieux pour elle, lui donna ordre de se tenir prête à décamper le lendemain matin et congédia l'assemblée.
Sur ces entrefaites arrivent les Numides qui avaient été envoyés à la découverte. La plupart avaient été tués, le reste mis en fuite. A peine sortis du camp, ils étaient tombés dans la marche des coureurs romains, envoyés aussi par Publius pour reconnaître les ennemis, et ces deux corps s'étaient battus avec tant d'opiniâtreté, qu'il périt d'une part environ cent quarante chevaux tant romains que gaulois, et de l'autre plus de deux cents Numides. Après ce combat les Romains en poursuivant s'approchèrent des retranchements des Carthaginois, examinèrent tout de leurs propres yeux, et coururent aussitôt pour informer le consul de l'arrivée des ennemis. Publius, sans perdre de temps, mit tout le bagage sur les vaisseaux, et fit marcher le long du fleuve toute son armée dans le dessein d'attaquer les Carthaginois.
Le lendemain à la pointe du jour, Hannibal posta toute sa cavalerie du côté de la mer comme en réserve, et donna ordre à l'infanterie de se mettre en marche. Pour lui, il attendit que les éléphants et les soldats qui étaient restés sur l'autre bord eussent rejoint. Or voici comme les éléphants passèrent.
Après avoir fait plusieurs radeaux, d'abord on en joignit deux l'un à l'autre, qui faisaient ensemble cinquante pieds de largeur, et on les mit au bord de l'eau, où ils étaient retenus avec force et arrêtés à terre. Au bout qui était hors de l'eau on en attacha deux autres, et l'on poussa cette espèce de pont sur la rivière. Il était à craindre que la rapidité du fleuve n'emportât tout I'ouvrage. Pour prévenir ce malheur, on retint le côté exposé au courant par des cordes attachées aux arbres qui bordaient le rivage. Quand on eut porté ces radeaux à la longueur de deux plèthres (170 pieds), on en construisit deux autres beaucoup plus grands que l'on joignit aux derniers. Ces deux furent liés fortement l'un à l'autre ; mais ils ne le furent pas tellement aux plus petits, qu'il ne fût aisé de les détacher. On avait encore attaché beaucoup de cordes aux petits radeaux, par le moyen desquelles les nacelles destinées à les remorquer pussent les affermir contre l'impétuosité de l'eau, et les amener jusqu'au bord avec les éléphants. Les deux grands radeaux furent ensuite couverts de terre et de gazon, afin que ce pont fût semblable en tout au chemin qu'avaient à faire les éléphants pour en approcher. Sur terre ces animaux s'étaient toujours laissé manier à leurs conducteurs, mais ils n'avaient encore osé mettre les pieds dans l'eau. Pour les y faire entrer, on mit à leur tête deux éléphants femelles, qu'ils suivaient sans hésiter. Ils arrivent sur les derniers radeaux, on coupe les cordes qui tenaient ceux-ci attachés aux deux plus grands, les nacelles remorquent et emportent bientôt les éléphants loin des radeaux qui étaient couverts de terre. D'abord ces animaux effrayés, inquiets, allèrent et vinrent de côté et d'autre. Mais l'eau dont ils se voyaient environnés leur fit peur, et les retint en place. C'est ainsi qu'Hannibal, enjoignant des radeaux deux à deux trouva le secret de faire passer le Rhône à la plupart de ses éléphants. Je dis à la plupart, car ils ne passèrent pas tous de la même façon. Il y en eut qui, au milieu du trajet, tombèrent de frayeur dans la rivière. Mais leur chute ne fut funeste qu'aux conducteurs. Pour eux la force et la longueur de leurs trompes les tira de danger. En élevant ces trompes au-dessus de l'eau, ils respiraient, et éloignaient tout ce qui pouvait leur nuire, et par ce moyen ils vinrent droit au bord, malgré la rapidité du fleuve.
Lorsque les éléphants eurent été transportés de l'autre coté, Hannibal les plaça avec la cavalerie, à l'arrière-garde. Il marcha le long du fleuve, laissant la mer derrière lui, se dirigeant vers l'est, et pour ainsi dire vers l'intérieur de l'Europe. Le Rhône prend sa source au-dessus du golfe Adriatique, inclinant vers l'ouest ; dans cette partie des Alpes qui s'abaisse vers le nord, il coule vers le couchant d'hiver, et se jette dans la mer de Sardaigne. Il suit pendant longtemps une vallée dont le nord est habité par les Gaulois appelés Ardyes tandis que le midi est bordé par cette pente des Alpes qui descendent vers le nord. Les plaines des environs du Pô, dont nous avons déjà beaucoup parlé, sont séparées de cette vallée du Rhône par toute la hauteur des montagnes ci-dessus mentionnées, qui s'étendent depuis Marseille jusqu'au fond du golfe Adriatique. Ce fut en passant ces montagnes qu'Hannibal, venant des bords du Rhône, entra dans l'Italie.
Quelques historiens, pour vouloir étonner leurs lecteurs par des choses prodigieuses, en nous parlant de ces montagnes, tombent, sans y penser, dans deux défauts qui sont très contraires à l'histoire. Ils content de pures fables, et se contredisent. Ils commencent par nous représenter Hannibal comme un capitaine d'une hardiesse et d'une prudence inimitables. Cependant, à en juger par leurs écrits, on ne peut se défendre de lui attribuer la conduite du monde la moins sensée. Lorsqu'engagés dans leurs fables ils sont en peine le trouver un dénouement, ils ont recours aux dieux et aux demi-dieux, artifice indigne de l'histoire, qui doit rouler toute sur des faits réels. Ils nous peignent les Alpes comme si raides et si escarpées, que, loin de pouvoir les faire passer à de la cavalerie, à une armée, à des éléphants, à peine l'infanterie légère en tenterait-elle le passage. Selon ces historiens, les pays d'alentour sont si déserts, que si un dieu ou demi-dieu n'était venu montrer le chemin à Hannibal, sa perte et celle de toute son armée était inévitable. N'est-ce pas là visiblement débiter des fables et se contredire ? Car ce général n'eût-il pas été le plus inconsidéré et le plus étourdi des hommes, s'il se fût mis en marche à la tête d'une armée nombreuse, et sur laquelle il fondait les plus belles espérances, sans savoir ni par où il devait aller, ni la nature des lieux où il passerait, ni les peuples chez lesquels il tomberait ? Il eût été même plus qu'inconsidéré s'il eût tenté une entreprise, qui non seulement n'était pas raisonnable, mais pas même possible. D'ailleurs, conduisant Hannibal avec une armée dans des lieux inconnus, ils lui font faire, dans un temps où il avait tout à espérer, ce que d'autres feraient à peine quand ils auraient tout perdu sans ressources, et qu'ils seraient réduits à la dernière extrémité. Lorsqu'ils nous disent encore que dans ces Alpes ce ne sont que déserts, que rochers escarpés, que chemins impraticables, c'est une fausseté manifeste. Avant qu'Hannibal en approchât, les Gaulois habitant les rives du Rhône avaient passé plus d'une fois ces montagnes, et venaient tout récemment de les passer pour se joindre aux Gaulois des environs du Pô contre les Romains. Et de plus les Alpes même ne sont-elles pas habitées par un peuple très nombreux ? C'était là ce qu'il fallait savoir, au lieu de nous faire descendre du ciel je ne sais quel demi-dieu qui veut bien avoir, la complaisance de servir de guide aux Carthaginois. Semblables aux poètes tragiques qui, pour avoir choisi des sujets faux et extraordinaires, ont besoin pour la catastrophe de leurs pièces de quelque dieu ou de quelque machine, ces historiens emploient aussi des dieux et des demi-dieux, parce qu'ils se sont d'abord engoués de faits qui n'ont ni vérité ni vraisemblance, car comment finir raisonnablement des actions dont les commencements étaient contre la raison? Quoi qu'en disent ces écrivains, Hannibal conduisit cette grande affaire avec beaucoup de prudence. Il s'était informé exactement de la nature et de la situation des lieux où il s'était proposé d'aller. Il savait que les peuples où il devait passer n'attendaient que l'occasion de se révolter contre les Romains. Enfin, pour n'avoir rien à craindre de la difficulté des chemins, il s'y faisait conduire par des gens du pays, qui s'offraient d'autant plus volontiers pour guides, qu'ils avaient les mêmes intérêts et les mêmes espérances. Je parle avec assurance de toutes ces choses, parce que je les ai apprises de témoins contemporains, et que je suis allé moi-même dans les Alpes pour en prendre une exacte connaissance.
Hannibal sur sa route remet sur le trône un petit roi gaulois et en est récompensé. - Les Allobroges lui tendent des pièges à l'entrée des Alpes. - Il leur échappe, mais avec beaucoup de risque et de perte.
Trois jours après le décampement des Carthaginois, le consul romain arriva à l'endroit où les ennemis avaient traversé le fleuve. Sa surprise fut d'autant plus grande qu'il s'était persuadé que jamais ils n'auraient la hardiesse de prendre cette route pour aller en Italie, tant à cause de la multitude des Barbares dont ces régions sont peuplées, que du peu de fonds qu'on peut faire sur leurs promesses. Comme cependant ils l'avaient fait, il retourna au plus vite à ses vaisseaux, et embarqua son armée. Il envoya son frère en Espagne, et revint par mer en Italie pour arriver aux Alpes par la Tyrrhénie avant Hannibal. Celui-ci, après quatre jours de marche, vint près d'un endroit appelé l'Isle, lieu fertile en blés et très peuplé, et à qui l'on a donné ce nom, parce que le Rhône et l'Isère, coulant des deux côtés, l'entourent et la rétrécissent en pointe à leur confluent. Cette île ressemble assez, et pour la grandeur et pour la forme, au Delta d'Egypte, avec cette différence néanmoins, que la mer et les bouches des fleuves forment un des côtés de ce dernier, et qu'un des côtés du premier est fermé par des montagnes d'une approche et d'une entrée difficiles. Nous pourrions dire même qu'elles sont presque inaccessibles.
Hannibal trouva dans cette île deux frères qui, armés l'un contre l'autre, se disputaient le royaume. L'aîné mit Hannibal dans ses intérêts, et le pria de lui aider à se maintenir dans la possession où il était. Le Carthaginois n'hésita point ; il voyait trop combien cela lui serait avantageux. Il forma donc une alliance avec lui, et l'aida à chasser son frère. Il fut bien récompensé du secours qu'il avait donné au vainqueur. On fournit à son armée des vivres et des munitions en abondance. On renouvela ses armes, qui étaient vieilles et usées. La plupart de ses soldats furent vêtus, chaussés, et mis en état de franchir plus aisément les Alpes. Mais le plus grand service qu'il en tira, fut que ce roi forma avec ses troupes l'arrière-garde des Carthaginois, qui n'entraient qu'en tremblant sur les terres des Gaulois nommés Allobroges, et les protégea jusqu'à l'endroit d'où ils devaient pénétrer dans les Alpes. Hannibal, ayant marché pendant dix jours le long du fleuve, et ayant parcouru une distance de huit cents stades, commença la montée des Alpes. C'est alors qu'il fut exposé à de très grands dangers. Tant qu'il fut dans le plat pays, les chefs des Allobroges ne l'inquiétèrent pas dans sa marche, soit qu'ils redoutassent la cavalerie carthaginoise ou que les Barbares, dont elle était accompagnée, les tinssent en respect. Mais quand ceux-ci se furent retirés, et qu'Hannibal commença à entrer dans les détroits des montagnes, alors les Allobroges coururent en grand nombre s'emparer des lieux qui commandaient ceux par où il fallait nécessairement que l'armée d'Hannibal passât. C'en était fait de son armée, si leurs piéges eussent été plus couverts, mais comme ils se cachaient mal ou point du tout s'ils firent grand tort à Hannibal, ils ne s'en firent pas moins à eux-mêmes. Ce général, averti du stratagème des Barbares, campa au pied des montagnes et envoya quelques-uns de ses guides gaulois pour reconnaître la disposition des ennemis. Ils revinrent dire à Hannibal que, pendant le jour, les ennemis gardaient exactement leurs postes, mais que pendant la nuit ils se retiraient dans une ville voisine. Aussitôt le Carthaginois dresse son plan sur ce rapport ; il fait en plein jour avancer son armée près des défilés, et campe assez proche des ennemis. La nuit venue, il donne ordre d'allumer des feux, laisse la plus grande partie de son armée dans le camp, et avec un grand corps d'élite il perce les détroits et occupe les postes que les ennemis avaient abandonnés. Au point du jour les Barbares, se voyant dépostés, quittèrent d'abord leur dessein, mais comme les bêtes de charge et la cavalerie, serrées dans ces détroits, ne suivaient que sur une longue file, ils saisirent cette occasion pour fondre de plusieurs côtés sur cette arrière-garde. Il périt là grand nombre de Carthaginois, beaucoup moins cependant sous les coups des Barbares que par la difficulté des chemins. Ils y perdirent surtout beaucoup de chevaux et des bêtes de charge, qui dans ces défilés et sur ces rochers escarpés se soutenaient à peine et culbutaient au premier choc. Le plus grand désastre vint des chevaux blessés, qui tombaient dans ces sentiers étroits, et qui en roulant poussaient et renversaient les bêtes de charge et tout ce qui marchait derrière.
Hannibal, pour remédier à ce désordre, qui, par la perte de ses munitions, allait l'exposer au risque de ne pas trouver de salut, même dans la fuite, courut au secours des siens à la tête de, ceux qui pendant la nuit s'étaient rendus maîtres des hauteurs, et, tombant d'en haut sur les ennemis, il en tua un grand nombre, mais dans le tumulte et la confusion qu'augmentaient encore le choc et les cris des combattants, il perdit aussi beaucoup de monde. Malgré cela, la plus grande partie des Allobroges fut enfin défaite, et le reste réduit à prendre la fuite. Il fit ensuite passer ces défilés, quoique avec beaucoup de peine, à ce qui lui était resté de chevaux et de bêtes de charge, puis, se faisant suivre de ceux qui lui parurent le moins fatigués du combat, il alla attaquer la ville d'où les ennemis étaient venus fondre sur lui. Elle ne lui coûta pas beaucoup à prendre. Tous les habitants, dans l'espérance du butin qu'ils croyaient faire, l'avaient abandonnée. Il la trouva presque déserte. Cette conquête lui fut d'un grand avantage. Il tira de cette ville quantité de chevaux, de bêtes de charge et de prisonniers, et outre cela, du blé et de la viande pour deux ou trois jours, sans compter que par là il se fit craindre de ces montagnards, et leur ôta l'envie d'interrompre une autre fois sa marche.
Il campa dans cet endroit, et s'y reposa un jour entier. Le lendemain on continua de marcher. Pendant quelques jours la marche fut assez tranquille. Au quatrième voici un nouveau péril qui se présente ! Les peuples qui habitaient sur cette route, inventent une ruse pour le surprendre. Ils viennent au devant de lui, portant à la main des rameaux d'olivier et des couronnes sur la tête. C'est le signal de paix et d'amitié chez ces Barbares, comme le caducée chez les Grecs. Cela parut suspect à Hannibal. Il s'informa exactement quel était leur dessein, quel motif les amenait. Ils répondirent qu'ayant su qu'il avait pris une ville sur leurs voisins, et qu'il avait terrassé tous ceux qui avaient osé, lui tenir tête, ils venaient le prier de ne leur faire point de mal, et lui promettre de ne pas chercher à lui nuire, et, s'il doutait de leur bonne foi, qu'ils étaient prêts à donner des otages.
Hannibal hésita longtemps sur le parti qu'il devait prendre : d'un côté, en acceptant les offres de ces peuples, il y avait lieu d'espérer que cette condescendance les rendrait plus réservés et plus traitables ; de l'autre, en les rejetant, il était immanquable qu'il s'attirerait ces Barbares sur les bras. D'après ces deux raisons, il fit du moins semblant de consentir à les mettre au nombre de ses alliés. Aussitôt on lui amena des otages, on le fournit de bestiaux, on s'abandonna entièrement à lui sans aucune précaution, sans aucune marque de défiance. Hannibal, de son côté, se fiant tellement à leur bonne foi apparente, qu'il les prit pour guides dans les défilés qui restaient à franchir. Ils marchèrent donc à la tête des troupes pendant deux jours. Quand on fut entré dans un vallon, qui de tous côtés était fermé par des rochers inaccessibles, ces perfides, s'étant réunis, vinrent fondre sur l'arrière-garde d'Hannibal. Ce vallon eût été sans doute le tombeau de toute l'armée, si le général carthaginois, à qui il était resté quelque défiance et qui s'était précautionné contre la trahison n'eût mis à la tête les bagages avec la cavalerie, et les hommes pesamment armés à l'arrière-garde. Cette infanterie soutint l'effort des ennemis, et sans elle la perte eût été beaucoup plus grande. Mais, malgré ce secours, il périt là un grand nombre d'hommes, de chevaux et de bêtes de charge, car ces Barbares, avançant sur les hauteurs à mesure que les Carthaginois avançaient dans la vallée, tantôt roulaient et tantôt jetaient de grosses pierres qui répandirent tant de terreur parmi les troupes, qu'Hannibal fut obligé, avec la moitié de ses forces, de passer la nuit dans le voisinage d'un certain rocher blanc, séparé de sa cavalerie et de ses bêtes de somme, les protégeant pendant qu'elles défilaient avec peine au travers du ravin, ce qui dura toute la nuit. Le lendemain, les ennemis s'étant retirés, il rejoignit sa cavalerie et ses bêtes de somme, et s'avança vers la cime des Alpes. Dans cette route, il ne se rencontra plus de Barbares qui l'attaquassent en corps. Quelques pelotons seulement voltigeaient çà et là, et, se présentant tantôt à la queue, tantôt à la tête, enlevaient quelques bagages. Les éléphants lui furent alors d'un grand secours. C'était assez qu'ils parussent pour effrayer les ennemis et les mettre en fuite. Après neuf jours de marche, il arriva enfin au sommet des montagnes. Il y demeura deux jours, tant pour faire reprendre haleine à ceux qui y étaient parvenus heureusement, que pour donner aux traîneurs le temps de rejoindre le gros de l'armée. Pendant ce séjour, on fut agréablement surpris de voir, contre toute espérance, paraître la plupart des chevaux et des bêtes de charge qui sur la route s'étaient débarrassés de leurs fardeaux, et qui, sur les traces de l'armée, étaient venus droit au camp.
Hannibal achève de passer les Alpes. - Difficultés qu'il eut à essuyer. - Pourquoi jusqu'ici Polybe a omis certaines choses qui cependant paraissaient essentielles à l'histoire.
C'était le temps du coucher des Pléiades, et déjà la neige avait couvert le sommet des montagnes. Les soldats, consternés par le souvenir des maux qu'ils avaient soufferts, et ne se figurant qu'avec effroi ceux qu'ils avaient encore à endurer, semblaient perdre courage, Hannibal les assemble, et comme du haut des Alpes, qui semblent être la citadelle de l'Italie, on voit à découvert toutes ces vastes plaines que le Pô arrose de ses eaux, il se servit de ce beau spectacle, unique ressource qui lui restait, pour remettre ses soldats de leur frayeur. En même temps il leur montra du doigt le point où Rome était située, et leur rappela quelle était pour eux la bonne volonté des peuples, qui habitaient le pays qu'ils avaient sous les yeux. Le lendemain il lève le camp, et commence la descente des montagnes. A la vérité, il n'eut point ici d'ennemis à combattre, excepté ceux qui lui faisaient du mal à la dérobée, mais l'escarpement des lieux et la neige lui firent perdre presque autant de monde qu'il en avait perdu en montant. La descente était étroite, raide, et couverte de neige. Pour peu que l'on manquât le vrai chemin, l'on tombait dans des précipices affreux. Cependant le soldat endurci à ces sortes de périls, soutint encore courageusement celui-ci. Toutefois, lorsque les troupes arrivèrent à un certain endroit où il parut impossible aux éléphants ni aux chevaux de charge d'avancer, parce que le terrain déjà très raide dans l'espace de près de trois demi-stades, s'était éboulé davantage depuis très peu de temps, toute l'armée, remplie d'effroi, se livra de nouveau au désespoir. La première pensée qui vint à Hannibal fut de tourner cet endroit difficile, mais, la neige rendant tout autre passage impraticable, il fut obligé d'y renoncer. Ce qui arrivait était en effet une chose très rare et très singulière. Sur la neige de l'hiver précédent il en était tombé de nouvelle. Celle-ci, étant molle et peu épaisse, se laissait aisément pénétrer, mais quand elle eut été foulée, et que l'on atteignit celle de dessous qui était ferme, les pieds ne pouvant s'assurer, le soldat faisait autant de chutes que de pas, comme cela arrive à ceux qui marchent sur un terrain boueux à sa surface. Cet accident en produisait un autre plus fâcheux encore. Quand les soldats étaient tombés et qu'ils voulaient s'aider de leurs genoux ou s'accrocher à quelque chose pour se relever, ils entraînaient avec eux tout ce qu'ils avaient pris pour se retenir. Pour les bêtes de charge, après avoir cassé la glace en se relevant, elles restaient comme glacées elles-mêmes dans les trous qu'elles avaient creusés, sans pouvoir, sous le pesant fardeau qu'elles portaient, vaincre la dureté de la vieille neige. Il fallut donc chercher un autre expédient.
Hannibal prit le parti de camper à l'entrée du
chemin dégradé. On enleva la neige, on se mit à l'ouvrage pour reconstruire
le chemin le long du précipice. Ce travail fut poussé avec tant de vigueur,
qu'au bout du jour où il avait été entrepris, les bêtes de charge et les
chevaux descendirent sans beaucoup de peine. On les envoya aussitôt dans des
pâturages, et l'on établit le camp dans la plaine, où il n'était pas tombé
de neige, Hannibal fit travailler les Numides par détachements à la
construction du chemin, et, après bien des fatigues, on réussit au bout de
trois jours, avec beaucoup de peine, à faire passer les éléphants. Ils
étaient exténués par la faim, car, quoique sur le penchant des Alpes il se
trouve des deux côtés des arbres et des forêts, et que la terre y puisse
être cultivée, il n'en est pas de même de leur cime et des lieux voisins.
Couverts de neige pendant toutes les saisons, comment pourraient-ils rien
produire ? L'armée descendit la dernière, et au troisième jour elle entra
enfin dans la plaine, mais de bien inférieure en nombre à ce qu'elle était
au sortir de l'Espagne. Sur la route elle avait beaucoup perdu de monde,
soit dans les combats qu'il fallut soutenir, soit au passage des rivières.
Les rochers et les défilés des Alpes lui avaient encore fait perdre un grand
nombre de soldats, mais incomparablement plus de chevaux et de bêtes de
charge. Il y avait cinq mois et demi qu'Hannibal était parti de la nouvelle
Carthage, en comptant les quinze jours que lui avait coûtés le passage des
Alpes, lorsqu'il planta ses étendards dans les plaines du Pô et parmi les
Insubriens, sans que la diminution de son année eût ralenti en rien de son
audace. Cependant il ne lui restait plus que douze mille Africains et huit
mille Espagnols d'infanterie, et six mille chevaux. C'est de lui-même que
nous savons cette circonstance, qui a été gravée par son ordre sur une
colonne près du promontoire Lacinium.
Du côté des Romains, Publius Scipion, qui, comme nous l'avons dit plus haut,
avait envoyé en Espagne Cnéus son frère, et lui avait recommandé de tout
tenter pour en chasser Hasdrubal, Scipion, dis-je, débarqua au port de Pise
avec quelques troupes, dont il augmenta le nombre en passant par la
Tyrrhénie, où il prit les légions qui, sous le commandement des préteurs,
avaient été envoyées là pour faire la guerre aux Boïens. Avec cette armée,
il vint aussi camper dans les plaines du Pô, pressé d'un ardent désir d'en
venir aux mains avec le général carthaginois.
Mais laissons pour un moment ces deux chefs d'armée en Italie, où nous les avons amenés, et avant d'entamer le récit des combats qu'ils se sont livrés, justifions en peu de mots le silence que, nous avons gardé jusqu'ici sur certaines choses qui sont du domaine de l'histoire, car on ne manquera pas d'être en peine de savoir pourquoi, après m'être fort étendu sur plusieurs endroits de l'Afrique et de l'Espagne, je n'ai parlé ni du détroit que forment les colonnes d'Hercule, ni de la mer qui est au-delà, ni de ce qu'il y a de particulier sur cette mer, ni des îles Britanniques, ni de la manière de faire l'étain, ni de l'or ni de l'argent que l'Espagne produit, choses, cependant sur lesquelles les auteurs qui en ont écrit fort au long ne sont pas trop d'accord entre eux.
Il est vrai, je n'ai rien dit sur toutes ces matières. Ce n'est pas que je les crusse étrangères à l'histoire, mais deux raisons m'ont détourné d'en parler. Premièrement, une narration interrompue par autant de digressions qu'il se serait présenté de sujets à traiter eût été rebutante, et aurait écarté le lecteur du but que je m'étais proposé. En second lieu, il m'a paru que toutes ces curiosités valaient bien la peine qu'on les traitât exprès et en particulier. Le temps et l'occasion viendront d'en dire tout ce que nous avons pu en découvrir de plus assuré. Que l'on ne soit donc pas surpris dans la suite, si, en parlant de quelques lieux, nous n'entrons pas dans le détail de certaines circonstances. Vouloir que partout et en toute occasion un historien s'arrête sur ces sortes de singularités, c'est ressembler à une espèce de friands qui, portant la main à tous les plats, ne savourent aucun morceau à loisir, et qui, par cette diversité de mets, nuisent plutôt à leur santé, qu'ils ne l'entretiennent et ne la fortifient. Il en est de même de ceux qui n'aiment l'histoire qu'autant qu'elle est parsemée de particularités détachées du sujet principal. Ils n'ont le loisir d'en goûter aucune comme elle doit être goûtée, et il ne leur en reste rien dont ils puissent faire usage.
Il faut cependant convenir que, de toutes les parties de l'histoire, il n'en est point qui ait plus besoin d'être traitée au long et avec quelque exactitude que ces particularités-là mêmes que nous avons cru devoir remettre à un autre temps. Entre plusieurs exemples que je pourrais citer, en voici un qui ne souffre pas de réplique. De tous les historiens qui ont décrit la situation et les propriétés des lieux qui sont aux extrémités de cette terre que nous habitons, il y en a très peu qui ne se soient souvent trompés. Or, on ne doit épargner aucun de ces historiens. Il faut les réfuter tous, non légèrement et en passant, mais en leur opposant des arguments solides et certains. On ferait cependant mal de les reprendre avec mépris et avec hauteur ; il est juste au contraire de les louer, en corrigeant les fautes que le peu de connaissance qu'ils avaient leur a fait commettre. Eux-mêmes, s'ils revenaient au monde, changeraient et redresseraient sur beaucoup de points leurs propres ouvrages. Dans le temps qu'ils vivaient, il était rare de trouver des Grecs qui s'intéressassent beaucoup à l'étude des lieux qui bornent la terre ; il n'était pas même possible d'en acquérir la connaissance. On ne pouvait alors se mettre sur mer sans s'exposer à une infinité de dangers. Les voyages sur terre étaient encore plus périlleux. Quelque nécessité ou quelque inclination qui vous conduisît dans ces lieux, vous n'en reveniez guère plus instruit. Comment examiner tout par ses yeux dans des endroits qui sont tout à fait barbares, où il ne règne qu'une solitude affreuse, où vous ne pouvez tirer aucun éclaircissement de la part de ceux qui les habitent, et dont le langage vous est inconnu ? Je suppose que quelqu'un eût surmonté tous ces obstacles, mais eût-il été assez raisonnable pour ne pas débiter des choses incroyables, pour se renfermer dans l'exacte vérité, pour ne raconter que ce qu'il aurait vu ? On ne serait donc pas équitable de relever avec aigreur des historiens, pour s'être quelquefois trompés ou pour avoir manqué de nous donner, sur les extrémités de la terre, des lumières qu'il n'était pas seulement difficile, mais même impossible qu'ils eussent eux-mêmes. Louons ces auteurs, admirons-les plutôt d'avoir été jusqu'à un certain point, et de nous avoir aidés à faire de nouvelles découvertes. Mais aujourd'hui que par la conquête de l'Asie par Alexandre, et celle de presque tout le reste du monde par les Romains, il n'est point d'endroit dans l'univers où l'on ne puisse aller par mer ou par terre, et que de grands hommes, déchargés du soin des affaires publiques et du commandement des armées, ont employé les moments de leur loisir à ces sortes de recherches, il faut que ce que nous en voulons dire soit beaucoup plus exact et plus assuré. Nous tâcherons aussi de nous acquitter de cette tâche dans cet ouvrage, lorsque l'occasion s'en présentera, et nous prierons alors nos lecteurs curieux de s'instruire, de nous donner toute leur attention. J'ose dire que je m'en suis rendu digne par les peines que je me suis données, et par les dangers. que j'ai courus, en voyageant dans l'Afrique, dans l'Espagne, dans les Gaules, et sur la mer extérieure dont tous ces pays sont environnés, pour corriger les fautes que les anciens avaient faites dans la description de ces lieux, et pour en procurer la connaissance aux Grecs. Mais terminons ici cette digression, et voyons les combats qui se livrent en Italie entre les Romains et les Carthaginois.
Etat de l'armée d'Hannibal après le passage des Alpes. - Prise de Turin. - Sempronius vient au secours de Scipion. -Hannibal dispose ses soldats au combat.
Hannibal, arrivé dans l'Italie avec l'armée que nous avons vue plus haut, campa au pied des Alpes, pour donner quelque repos à ses troupes. Elles en avaient un extrême besoin. Les fatigues qu'elles avaient essuyées à monter et à descendre par des chemins si difficiles, la disette de vivres, un délabrement affreux les rendaient presque méconnaissables. Il y en avait même un grand nombre que la faim et les travaux continuels avaient réduits au désespoir. On n'avait pu transporter entre des rochers autant de vivres qu'il en fallait pour une armée si nombreuse, et la plupart de ceux que l'on y avait transportés y étaient restés avec les bêtes de charge. Aussi, quoique Hannibal, après le passage du Rhône, eût avec lui trente-huit mille hommes de pied et plus de huit mille chevaux, quand il eut passé les monts, il n'avait guère que la moitié de cette armée, et cette moitié était si changée par les fatigues qu'elle avait essuyées, qu'on l'aurait prise pour une troupe de sauvages.
Le premier soin qu'eut alors Hannibal fut de relever leur courage, et de leur fournir de quoi réparer leurs forces et celles des chevaux. Lorsqu'il les vit en bon état, il tâcha d'abord d'engager les peuples du territoire de Turin, peuples situés au pied des Alpes, et qui étaient en guerre avec les Insubriens, à faire alliance avec lui. Ne pouvant par ses exhortations vaincre leur défiance, il alla camper devant la principale de leurs villes, l'emporta en trois jours, et fit passer au fil de l'épée tous ceux qui lui avaient été opposés. Cette expédition jeta une si grande terreur parmi les Barbares voisins, qu'ils vinrent tous d'eux-mêmes se rendre à discrétion. Les autres Gaulois qui habitaient ces plaines auraient bien souhaité se joindre à Hannibal, selon le projet qu'ils en avaient d'abord formé, mais comme les légions romaines étaient déjà sorties du pays, et avaient évité les embuscades qui leur avaient été dressées, ils aimèrent mieux se tenir en repos, et d'ailleurs il y en avait parmi eux qui étaient obligés de prendre les armes pour les Romains. Hannibal alors jugea qu'il n'y avait point de temps à perdre, et qu'il fallait avancer dans le pays, et hasarder quelque exploit qui pût établir la confiance parmi les peuples qui auraient envie de prendre parti en sa faveur. Il était tout occupé de ce projet, lorsqu'il eut avis que Publius avait déjà passé le Pô avec son armée, et qu'il était proche. Il n'y avait que peu de jours qu'il avait laissé ce consul aux bords du Rhône. La route depuis Marseille jusque dans la Thyrrhénie est longue et difficile à tenir, et depuis la mer de Thyrrhénie jusqu'aux Alpes en traversant l'Italie, c'est une marche très longue et très pénible pour une armée. Cependant, comme cette nouvelle se confirmait de plus en plus, il fut étonné que Publius eût entrepris cette route, et l'eût faite avec tant de diligence. Publius fut dans le même étonnement à l'égard d'Hannibal. Il croyait d'abord que ce grand capitaine n'oserait pas tenter le passage des Alpes avec une armée composée de tant de nations différentes ou que, s'il le tentait, il ne manquerait pas d'y périr. Mais quand on lui vint dire qu'Hannibal non seulement était sorti des Alpes sain et sauf, mais assiégeait encore quelques villes d'Italie, il fut extrêmement frappé de la hardiesse et de l'intrépidité de ce général. À Rome, ce fut la même surprise, lorsqu'on y apprit ces nouvelles. A peine avait-on entendu parler de la prise de Sagonte, et envoyé un des consuls en Afrique pour assiéger Carthage, et l'autre en Espagne contre Hannibal, qu'on apprend que ce même Hannibal est dans l'Italie à la tête d'une armée, et qu'il y assiège des villes. L'épouvante fut grande, on envoya sur-le-champ à Lilybée pour dire à Tiberius que les ennemis étaient en Italie, qu'il laissât les affaires dont il était chargé, pour venir au plus tôt au secours de la patrie. Tiberius, sur ces ordres, fit reprendre à sa flotte la route de Rome, et pour les troupes de terre, il ordonna de les mettre en marche, et leur marqua le jour où l'on devait se trouver à Ariminum. C'est une ville située sur la mer Adriatique à l'extrémité des plaines qu'arrose le Pô, du côté du midi. Au milieu de ce soulèvement général et de l'étonnement où jetaient des événements si extraordinaires, on était extrêmement inquiet et attentif sur ce qui en résulterait.
Cependant Hannibal et Publius s'approchaient l'un de l'autre, et tous deux animaient leurs troupes par les plus puissants motifs que la conjoncture présente leur offrait. Voici la manière dont Hannibal s'y prit. Il assembla son armée, et fit amener devant elle tout ce qu'il avait fait de jeunes prisonniers sur les peuples qui l'avaient harcelé dans le passage des Alpes. Pour les rendre propres au dessein qu'il s'était proposé, il les avait chargés de chaînes, leur avait fait souffrir la faim, avait donné ordre qu'on les meurtrît de coups. Dans cet état, il leur présenta les armes que les rois gaulois prennent lorsqu'ils se disposent à un combat singulier. Il fit mettre aussi devant eux des chevaux et des saies très riches, et ensuite il leur demanda qui d'entre eux voulait se battre contre l'autre, à la condition, que le vainqueur emporterait pour prix de la victoire les dépouilles qu'ils voyaient, et que le vaincu serait délivré par la mort des maux qu'il avait à souffrir. Tous ayant élevé la voix et demandé à combattre, il ordonna qu'on tirât au sort, et que ceux sur qui le sort tomberait entrassent en lice. À cet ordre, les jeunes prisonniers lèvent les mains au ciel, et conjurent les dieux de les mettre au nombre des combattants. Quand enfin le sort se fut déclaré autant ceux qui devaient se battre eurent de joie, autant les autres furent consternés. Après le combat, ceux des prisonniers qui n'en avaient été que spectateurs, félicitaient tout autant, le vaincu que le vainqueur, parce qu'au moins la mort avait mis fin aux peines qu'ils étaient contraints de souffrir. Ce spectacle fit aussi la même impression sur la plupart des Carthaginois, qui, comparant l'état du mort avec les maux de ceux qui restaient, portaient compassion à ceux-ci, et croyaient l'autre heureux.
Hannibal, ayant par cet exemple mis son armée dans la disposition qu'il souhaitait, s'avança au milieu de l'assemblée, et dit qu'il leur avait donné ce spectacle afin qu'ayant vu dans ces infortunés prisonniers l'état où ils étaient eux-mêmes réduits, ils jugeassent mieux de ce qu'ils avaient à faire dans les conjonctures présentes, que la fortune leur proposait à peu près un même combat à soutenir, et les mêmes prix à remporter, qu'il fallait ou vaincre ou mourir ou vivre misérablement sous le joug des Romains, que, victorieux, ils emporteraient pour prix, non des chevaux et des saies, mais toutes les richesses de la République romaine, c'est-à-dire tout ce qui était le plus capable de les rendre les plus heureux des hommes, qu'en mourant au champ d'honneur, le pis qui leur pouvait arriver serait de passer, sans avoir rien souffert, de la vie à la mort, en combattant pour la plus belle de toutes les conquêtes, mais que si l'amour de la vie leur faisait tourner le dos à l'ennemi ou commettre quelque autre lâcheté, il n'y avait pas de maux et de peines auxquelles ils ne dussent s'attendre, qu'il n'était personne parmi eux qui, se rappelant le chemin qu'il avait fait depuis Carthage-la-Neuve, les combats où il s'était trouvé dans la route, et les fleuves qu'il avait passés, fût assez stupide pour espérer qu'en fuyant, il reverrait sa patrie, qu'il fallait donc renoncer entièrement à cette espérance, et entrer pour eux-mêmes dans les sentiments où ils étaient tout à l'heure à l'égard des prisonniers, que, comme ils félicitaient également le vainqueur et celui qui était mort les armes à la main, et portaient compassion à celui qui vivait après sa défaite, de même il fallait qu'en combattant, leur premier but fût de vaincre, et s'ils ne pouvaient vaincre, de mourir glorieusement sans aucun retour sur la vie, que, s'ils en venaient aux mains dans cet esprit, il leur répondait de la vie et de la victoire, que jamais armée n'avait manqué d'être victorieuse, lorsque par choix ou par nécessité elle avait pris ce parti, et qu'au contraire des troupes qui, comme les Romains, étaient proche de leur patrie, et avaient, en fuyant, une retraite sûre, ne pouvaient pas manquer de succomber sous l'effort de gens qui n'espéraient rien que de la victoire. Le spectacle et la harangue produisirent tout l'effet qu'Hannibal s'en était proposé. On vit le courage renaître dans le cœur du soldat. Le général, après avoir loué ses troupes de leurs bonnes dispositions, congédia l'assemblée, et donna ordre qu'on se tînt prêt à marcher le lendemain.
Harangue de Scipion. - Bataille du Tessin. - Trahison des Gaulois à l'égard des Romains.
Publius s'était déjà avancé au-delà du Pô, et, pour passer le Tessin, il avait ordonné que l'on y jetât un pont. En attendant qu'il fût achevé, il assembla le reste de ses troupes et les harangua. Il s'étendit d'abord beaucoup sur la grandeur et la majesté de l'empire romain, et sur les exploits de leurs ancêtres. Venant ensuite au sujet pour lequel ils avaient pris les armes, il dit que quand bien même jusqu'à ce jour ils n'auraient jamais essayé leurs forces contre personne, maintenant qu'ils savaient que c'était aux Carthaginois qu'ils avaient affaire, dès lors ils devaient compter sur la victoire, que c'était une chose indigne qu'un peuple vaincu tant de fois par les Romains, contraint de leur payer un tribut servile, et depuis si longtemps assujetti à leur domination, osât se révolter contre ses maîtres. Mais à présent, ajouta-t-il, que nous avons éprouvé qu'il n'ose, pour ainsi dire, nous regarder en face, quelle idée, si nous pensons juste, devons-nous avoir des suites de cette guerre ? La première tentative de la cavalerie numide contre la nôtre, lui a fort mal réussi, elle y a perdu une grande partie de ses soldats, et le reste s'est enfui honteusement jusqu'à son camp. Le général et toute son armée n'ont pas été plus tôt avertis que nous étions proche, qu'ils se sont retirés, et ils l'ont fait de telle façon que c'était autant une fuite qu'une retraite. C'est par crainte que, contre leur dessein, ils ont pris la route des Alpes. Hannibal est dans l'Italie, mais la plus grande partie de son armée est ensevelie sous les neiges des Alpes, et ce qui en est échappé est dans un état à n'en pouvoir attendre aucun service. La plupart des chevaux ont succombé à la longueur et aux fatigues de la marche, et le peu qui en reste ne peut être d'aucun usage. Pour vaincre de tels ennemis vous n'aurez qu'à vous montrer. Et pensez-vous que j'eusse quitté ma flotte, que j'eusse abandonné les affaires d'Espagne où j'avais été envoyé, et que je fusse accouru à vous avec tant de diligence et d'ardeur, si de bonnes raisons ne m'eussent persuadé que le salut de la République dépendait du combat que nous allons livrer, et que la victoire était sûre? Ce discours, soutenu par l'autorité de celui qui le prononçait, et qui d'ailleurs ne contenait rien que de vrai, fit naître dans tous les soldats un ardent désir de combattre. Le consul ayant témoigné combien cette ardeur lui faisait de plaisir, congédia l'assemblée, et avertit qu'on se tînt prêt à marcher au premier ordre.
Le lendemain les deux armées s'avancèrent l'une contre l'autre le long du Tessin, du côté qui regarde les Alpes, les Romains ayant le fleuve à leur gauche, et les Carthaginois à leur droite. Le second jour, les fourrageurs de part et d'autre ayant donné avis que l'ennemi était proche, chacun campa dans l'endroit où il était. Le troisième, Publius avec sa cavalerie, soutenue de troupes armées à la légère, et Hannibal avec sa cavalerie seule, marchèrent chacun de son côté dans la plaine pour reconnaître les forces l'un de l'autre. Quand on vit, à la poussière qui s'élevait, que l'on n'était pas loin, on se mit en bataille. Publius met en avant les vélites avec la cavalerie gauloise, range le reste sur le front, et avance au petit pas. Hannibal vint au devant de lui, ayant au centre l'élite des cavaliers à chevaux bridés, et la cavalerie numide sur les deux ailes, pour envelopper l'ennemi. Les chefs et la cavalerie ne demandant qu'à combattre, on commence à charger. Au premier choc les troupes armées à la légère eurent à peine lancé leurs premiers traits, qu'épouvantées par la cavalerie carthaginoise qui venait sur eux, et craignant d'être foulées aux pieds des chevaux, elles se retirèrent entre les intervalles des turmes, pour se reformer sous leur protection. Les deux corps de bataille s'avancent ensuite, et en viennent aux mains. Le combat se soutient longtemps à forces égales. De part et d'autre beaucoup de cavaliers mirent pied à terre, de sorte que l'action fut d'infanterie comme de cavalerie. Pendant ce temps-là les Numides, tournant les ailes, tombent sur l'infanterie légère qui était derrière les escadrons, la culbutent, prennent à dos la cavalerie elle-même, et la mettent en fuite. Les Romains perdirent beaucoup de monde dans ce combat. La perte fut encore plus grande du côté des Carthaginois. Une partie des premiers s'enfuit en déroute. Le reste se rallia auprès du consul.
Publius décampe aussitôt, traverse les plaines et se hâte d'arriver au pont du Pô, et de le faire passer à son armée, ne se croyant pas en sûreté, blessé dangereusement comme il l'était, dans un pays plat et dans le voisinage d'un ennemi qui lui était de beaucoup supérieur en cavalerie. Hannibal, attendit quelque temps que Publius fît avancer son infanterie, mais voyant qu'il sortait de ses retranchements, il le suivit jusqu'au pont du Pô. Il ne put aller plus loin. Le consul, après avoir passé le pont, en avait fait enlever la plupart des planches. Il fit prisonniers environ six cents hommes, que les Romains avaient postés à la tête du pont pour favoriser la retraite, et sur le rapport qu'ils lui firent que Publius était déjà loin, il rebroussa chemin le long du fleuve, pour trouver un endroit où il pût aisément jeter un pont. Après deux jours de marche, il fit faire un pont de bateaux, et ordonna à Hasdrubal de passer avec l'armée. Il passa lui-même ensuite, et donna audience aux ambassadeurs qui lui étaient venus des lieux voisins, car aussitôt après la journée du Tessin tous les Gaulois du voisinage, suivant leur premier projet, s'empressèrent à l'envi de se joindre à lui, de le fournir de munitions, et de grossir son armée. Tous ces ambassadeurs furent reçus avec beaucoup de politesse et d'amitié.
Quand l'armée eut traversé le Pô, Hannibal, au lieu de le remonter, comme il avait fait auparavant, le descendit dans le dessein. d'atteindre l'ennemi, car Publius avait aussi passé ce fleuve, et, s'étant retranché auprès de Plaisance, qui est une colonie des Romains, il se faisait là panser lui et les autres blessés, sans aucune inquiétude pour ses troupes qu'il croyait avoir mises à couvert de toute insulte. Cependant Hannibal, au bout de deux jours de marche depuis le Pô, arriva sur les ennemis, et le troisième il rangea son armée en bataille sous leurs yeux. Personne ne se présentant, il se retrancha à environ cinquante stades des Romains. Alors les Gaulois qui s'étaient joints à Hannibal, voyant les affaires des Carthaginois sur un si bon pied, complotèrent ensemble de tomber sur les Romains, et, restant dans leurs tentes, ils épiaient le moment de les attaquer. Après avoir soupé, ils se retirèrent dans leurs retranchements, et s'y reposèrent la plus grande partie de la nuit, mais à la petite pointe du jour ils sortirent, au nombre de deux mille hommes de pied et d'environ deux cents chevaux, tous bien armés, et fondirent sur les Romains qui étaient les plus proches du camp. Ils en tuèrent un grand nombre, en blessèrent aussi beaucoup, et apportèrent les têtes de ceux qui étaient morts au général carthaginois.
Hannibal reçut ce présent avec reconnaissance. Il les exhorta à continuer à se signaler, leur promit des récompenses proportionnées à leurs services, et les renvoya dans leurs villes, pour publier parmi leurs concitoyens les avantages qu'il avait jusqu'ici remportés, et pour les porter à faire alliance avec lui. Il n'était pas besoin de les y exhorter. Après l'insulte que ceux-ci venaient de faire aux Romains, il fallait que les autres, bon gré mal gré, se rangeassent du parti d'Hannibal. Ils vinrent en effet s'y ranger, amenant avec eux les Boïens, qui lui livrèrent les trois Romains que la République avait envoyés pour faire le partage des terres, et qu'ils avaient arrêtés contre la foi des traités, comme j'ai rapporté plus haut. Le Carthaginois fut fort sensible à leur volonté. Il leur donna des assurances de l'alliance qu'il faisait avec eux, et leur rendit les trois Romains en les avertissant de les tenir sous bonne garde, pour retirer de Rome, par leur moyen, les otages qu'ils y avaient envoyés, selon ce qu'ils avaient d'abord projeté.
Scipion passa la Trébie, et perd son arrière-garde. - Les Gaulois prennent le parti d'Hannibal. - Mouvements que cette défection cause à Rome. - Hannibal entre par surprise dans Clastidium. - Combat de cavalerie. - Conseil de guerre entre les deux consuls. - Ruse d'Hannibal.
Cette trahison de deux mille Gaulois donna de grandes inquiétudes à Publius, qui craignait avec raison que ces peuples, déjà indisposés contre les Romains, n'en prissent occasion de se déclarer tous en faveur des Carthaginois. Pour aller au devant de cette conspiration, vers les trois heures après minuit, il leva le camp et s'avança vers la Trébie et les hauteurs qui en sont voisines, comptant que, dans un poste si avantageux et au milieu de ses alliés, on n'aurait pas l'audace de venir l'attaquer. Sur l'avis que le consul était décampé, Hannibal envoya à sa poursuite la cavalerie numide, qu'il fit suivre peu après par l'autre cavalerie, qu'il suivait lui-même avec toute l'armée. Les Numides entrèrent dans le camp des Romains, et, le trouvant désert et abandonné, ils y mirent le feu. Ce fut un bonheur pour l'armée romaine, car si les Numides, sans perdre de temps, l'eussent poursuivie et eussent atteint les bagages, en plaine comme ils étaient, ils auraient fort incommodé les Romains, mais, lorsqu'ils les joignirent, la plupart avaient déjà passé la Trébie. Il ne restait plus que l'arrière-garde, dont ils tuèrent une partie, et firent le reste prisonniers.
Publius passa la rivière, et mit son camp auprès des hauteurs ; il se fortifia d'un fossé et d'un retranchement, en attendant les troupes que Sempronius lui amenait. Il prit grand soin de sa blessure, afin de se tenir en état de combattre, si l'occasion s'en présentait. Cependant Hannibal s'approche, et campe à quarante stades du consul. Là les Gaulois, qui habitaient dans ces plaines, partageant avec les Carthaginois les mêmes espérances, leur apportèrent des vivres et munitions en abondance, prêts eux-mêmes à entrer pour leur part dans tous les travaux et tous les périls de cette guerre.
Quand on apprit à Rome l'action qui s'était passée entre la cavalerie, on y fut d'autant plus surpris, que l'on ne s'attendait pas à cette nouvelle, mais, au reste, en trouva des raisons pour ne pas regarder cela comme une entière défaite. Les uns s'en prirent à une trop grande précipitation de la part du consul, les autres, à la perfidie des Gaulois alliés, qui, à dessein, ne s'étaient pas défendus, perfidie qu'ils en soupçonnaient d'après l'infidélité que ces peuples venaient tout récemment de commettre. Mais comme l'infanterie était encore en son entier, on se flattait qu'il n'y avait encore rien à craindre pour le salut de la République. Aussi, lorsque Sempronius traversa Rome avec ses légions, on crut que, dès qu'il serait arrivé au camp, la présence seule d'une si puissante armée mettrait Hannibal en fuite, et terminerait la guerre.
Toutes les troupes s'étant rendues à Ariminum, selon qu'on s'y était engagé par serment, Tiberius, à leur tête, fit diligence pour rejoindre son collègue. Il campa près de lui, fit rafraîchir son armée, qui depuis Lilybée jusqu'à Ariminum, avait marché pendant quarante jours de suite, et donna ordre que l'on disposât tout pour une bataille. Pendant que l'on s'y préparait, il visitait souvent Publius, et se faisait rendre compte de ce qui s'était passé, et ils tenaient conseil ensemble sur ce qu'il y avait à faire. Hannibal, pendant leurs délibérations, trouva moyen d'entrer dans Clastidium, dont le gouverneur pour les Romains lui ouvrit les portes. Maître de la garnison et des magasins, il distribua les vivres à ses soldats, et réunit les prisonniers à ses troupes, sans leur faire aucun mal, afin de donner un exemple de la douceur dont il voulait user, pour que ceux qu'on prendrait dans la suite espérassent trouver leur salut dans sa clémence. Afin de gagner aussi aux Carthaginois tous ceux que les Romains avaient mis dans les emplois publics, il récompensa magnifiquement le traître qui lui avait livré Clastidium. Peu après, ayant découvert que quelques Gaulois d'entre le Pô et la Trébie, qui avaient fait alliance avec lui, continuaient à entretenir des liaisons avec les Romains, comme pour avoir un refuge assuré de quelque côté que la fortune se rangeât, il détacha deux mille hommes de pied et mille chevaux tant gaulois que numides, avec ordre de porter le ravage sur leurs terres. Cet ordre fut exécuté sur-le-champ, et le butin fut grand. Les Gaulois coururent aussitôt aux retranchements des Romains pour demander du secours.
Sempronius, qui attendait depuis longtemps l'occasion d'agir, saisit ce prétexte. Il envoie la plus grande partie de sa cavalerie avec mille archers à pied, qui passent en hâte la Trébie, attaquent ceux qui emportaient le butin, et les obligent à prendre la fuite et à se retirer derrière leurs retranchements. La garde du camp court au secours de ceux qui étaient poursuivis, repousse les Romains, et les contraint à leur tour à fuir vers leur camp. Sempronius alors met en mouvement toute sa cavalerie et ses archers, et les Gaulois sont encore forcés de faire retraite. Hannibal, qui n'était pas prêt à une action générale, et qui d'ailleurs, ne croyait pas qu'un général sage et prudent dût, sans un dessein prémédité, et à toute occasion, hasarder une bataille générale, se contenta d'arrêter la fuite de ses gens, et de leur faire tourner front aux ennemis, leur défendant par ses officiers et par des trompettes de combattre ni de poursuivre. Les Romains s'arrêtèrent pendant quelque temps, mais enfin, ils se retirèrent après avoir perdu quelque peu de leur monde, et en avoir tué un plus grand nombre du côté des Carthaginois.
Sempronius, enorgueilli et triomphant de ce succès, aurait fort souhaité d'en venir à quelque chose de décisif, mais quelque envie qu'il eût de profiter de la blessure de Scipion, pour disposer de tout à son gré, il ne laissa pas que de lui demander son avis, qu'il ne trouva pas conforme au sien. Publius pensait, au contraire, qu'il fallait attendre que les troupes eussent été exercées pendant l'hiver, et que l'on en tirerait plus de services la campagne suivante, que les Gaulois étaient trop légers et trop inconstants pour demeurer unis aux Carthaginois, et que, dès que ceux-ci ne pourraient rien entreprendre, ceux-là ne manqueraient pas de se tourner contre eux. Il espérait, après que sa blessure serait guérie, être de quelque utilité dans une affaire générale. Enfin il le priait instamment de ne pas passer outre. Sempronius ne pouvait s'empêcher de reconnaître que les avis de son collègue étaient justes et sensés, mais la passion de se distinguer et l'assurance qu'il croyait avoir de réussir, l'emportèrent sur la raison et sur la prudence. Il avait résolu, avant que Publius pût se trouver à l'action, et que le temps de créer de nouveaux consuls, qui approchait, fût venu, de finir cette guerre par lui-même, et comme il ne cherchait pas le temps des affaires, mais le sien, il ne pouvait pas manquer de prendre de mauvaises mesures.
Hannibal pensait comme Publius sur la conjoncture présente, mais il en concluait tout le contraire et pressait le temps du combat, premièrement, pour profiter de la disposition où étaient les Gaulois en sa faveur, en second lieu, parce qu'il n'aurait à combattre que contre de nouvelles levées, sans expérience, et enfin pour ne pas laisser à Publius le temps de se trouver à l'action. Mais sa plus forte raison était de faire quelque chose, et de ne pas laisser le temps se perdre inutilement, car rien n'est plus important pour un général qui entre avec une armée dans un pays ennemi et qui entreprend une conquête extraordinaire, que de renouveler par des exploits continuels les espérances de ses alliés. Il ne pensa donc plus qu'à se disposer à une bataille, bien sûr que Sempronius ne manquerait pas de l'accepter.
Il avait reconnu depuis longtemps le terrain qui était entre les deux armées. C'était une plaine rase et découverte, où coulait un ruisseau dont les rives assez hautes étaient encore hérissées de ronces et d'épines fort serrées. Ce ruisseau lui parut propre pour y dresser une embuscade, et en effet il lui était aisé de se cacher. Les Romains étaient bien en garde contre les lieux couverts, parce que c'est ordinairement dans ces sortes d'endroits que les Gaulois se couvrent et se cachent, mais ils ne se défiaient pas d'un terrain plat et ras. Cependant une embuscade y est plus sûre que dans des bois. Outre que l'on y découvre de loin, il s'y rencontre quantité de petites hauteurs derrière lesquelles on est suffisamment à couvert. Il ne faut souvent que de petits bords de ruisseaux, des roseaux, des ronces, quelque sorte d'épines pour cacher non seulement de l'infanterie, mais même de la cavalerie, et il n'est pas besoin pour cela d'une grande habileté. Il n'y a qu'à coucher par terre les armes qui se voient de loin, et à mettre les casques dessous.
Bataille de la Trébie
Le général des Carthaginois tint donc un conseil de guerre, où il fit part à Magon et aux autres officiers du dessein qu'il avait. Chacun y ayant applaudi, aussitôt après le souper de l'armée, il fit appeler Magon son frère, jeune à la vérité, mais vif, ardent et entendu dans le métier, le fit chef de cent chevaux et de cent hommes de pied, et lui ordonna de choisir dans toute l'armée les soldats les plus braves, et de venir le trouver dans sa tente avant la nuit. Quant il les eut exhortés tous à se signaler dans le poste qu'il devait leur assigner, il leur dit de prendre chacun dans leur compagnie neuf d'entre leurs compagnons qu'ils connaissaient les plus braves, et de venir le joindre à certain endroit du camp. Ils y vinrent tous, au nombre de mille chevaux et d'autant d'hommes de pied. Il leur donna des guides, marqua à son frère le moment où il devait fondre sur l'ennemi, et les envoya au lieu qu'il avait choisi pour l'embuscade.
Le lendemain, au point du jour, il assemble la cavalerie numide, gens endurcis à la fatigue. Il l'exhorte à bien faire, promet des gratifications à ceux qui se distingueraient, et leur donne ordre à tous de passer au plus tôt la rivière, d'approcher du camp des ennemis, et de les provoquer par des escarmouches, pour les mettre en mouvement. En cela ses vues étaient de prendre l'ennemi dans un temps où il n'aurait pas encore pris de nourriture et où il ne s'attendrait à rien moins qu'à une bataille. Il convoque ensuite le reste des officiers, les anime au combat, et leur ordonne de prescrire à tous les soldats de prendre leur repas, et de disposer leurs armes et leurs chevaux.
Dès que Sempronius vit la cavalerie numide, il ne manqua pas de mettre en avant la sienne, et de lui donner ordre d'en venir aux mains. Elle fut suivie de six mille hommes armés à la légère. Il sortit enfin lui-même des retranchements avec tout le reste de ses troupes. Il était si fier de la nombreuse armée qu'il commandait, et de l'avantage qu'il avait remporté le jour précédent, qu'il s'imaginait que pour vaincre, il n'avait qu'à se présenter. On était alors en plein hiver, il neigeait ce jour-là même, et faisait un froid glacial, et l'armée romaine s'était mis en marche sans avoir pris aucune nourriture. Les soldats partirent avec empressement et grand désir de combattre, mais quand ils eurent passé la Trébie, enflée ce jour-là par les torrents qui s'y étaient précipités des montagnes voisines pendant le nuit, et où ils avaient de l'eau jusque sous les aisselles, le froid et la faim (car le jour était avancé) les avaient étrangement affaiblis. Les Carthaginois au contraire avaient bu et mangé sous leurs tentes, avaient disposé leurs chevaux, et s'étaient frottés d'huile, et revêtus de leurs armes auprès du feu.
Quand les Romains furent sortis de la rivière, Hannibal, qui attendait ce moment, envoya en avant les soldats armés à la légère et les frondeurs des îles Baléares, au nombre d'environ huit mille hommes, et il les suivit à la tête de toute l'armée. A un mille de son camp, il rangea sur une ligne son infanterie, qui faisait près de vingt mille hommes tant Gaulois qu'Espagnols et Africains. La cavalerie, qui, en comptant les Gaulois alliés, s'élevait à plus de dix mille hommes, fut distribuée sur les ailes, où il plaça aussi les éléphants, partie devant la gauche, partie devant la droite de l'infanterie.
Sempronius, de son côté, rappela sa cavalerie, qui se fatiguait inutilement contre les Numides, cavaliers habiles, accoutumés à fuir en désordre au premier choc, et à revenir à la charge aussi hardiment qu'ils y étaient venus. Son ordonnance fut celle dont les Romains ont coutume de se servir. Il avait à ses ordres seize mille Romains et vingt mille alliés, nombre auquel s'élève une armée complète, lorsqu'il s'agit de quelque grande expédition, et que les deux consuls se trouvent réunis ensemble. Il jeta sur les deux ailes sa cavalerie, qui était de quatre mille chevaux, s'avança fièrement vers l'ennemi, au petit pas, et en ordre de bataille.
Quand on fut en présence, les soldats armés à la légère de part et d'autre engagèrent l'action. Autant cette première charge fut désavantageuse aux Romains, autant fut-elle favorable aux Carthaginois. Du côté des premiers, c'étaient des soldats qui depuis le matin souffraient du froid et de la faim, et dont les traits avaient été lancés pour la plupart dans le combat contre les Numides. Ce qui leur en restait, était si appesanti par l'eau dont ils avaient été trempés, qu'ils ne pouvaient être d'aucun usage. La cavalerie, toute l'armée étaient également hors d'état d'agir. Rien de tout cela ne se trouvait du côté des Carthaginois. Frais, vigoureux, pleins d'ardeur, rien ne les empêchait de faire leur devoir.
Aussi, dès que les soldats armés à la légère se furent retirés par les intervalles, et que l'infanterie pesamment armée en fut venue aux mains, alors la cavalerie carthaginoise, qui surpassait de beaucoup la romaine en nombre et en vigueur, tomba sur celle-ci avec tant de force et d'impétuosité, qu'en un moment elle l'enfonça et la mit en fuite. Les flancs de l'infanterie romaine découverts, les soldats armés à la légère des Carthaginois, et les Numides revinrent à la tête de leurs gens, fondirent sur les flancs des Romains, y mirent le désordre, et empêchèrent qu'ils ne se défendissent contre ceux qui les attaquaient de front. Mais les pesamment armés qui de part et d'autre en étaient aux mains, au centre et dans la première ligne, combattirent plus longtemps de pied ferme et avec un égal avantage. Ce fut aussi le moment où les Numides sortirent de leur embuscade, chargèrent en queue les légions qui combattaient au centre, et y jetèrent une confusion extrême. Les deux ailes attaquées de front par les éléphants, en flanc et à dos par les soldats armés à la légère, furent culbutées dans la rivière. Au corps de bataille, ceux qui formaient la réserve ne purent tenir contre les Numides, qui, fondant sur eux par les derrières, les accablèrent de traits et les renversèrent. Il n'y eut que la première ligne qui se fît ressource de son courage et de la nécessité. Elle perça, non sans un grand courage, à travers les Gaulois et les Africains. Mais après la défaite de ses ailes, voyant qu'elle ne pouvait ni les secourir, ni retourner au camp, dont la cavalerie numide, la rivière et la pluie ne lui permettaient pas de reprendre le chemin, serrée et gardant ses rangs, elle prit la route de Plaisance, où elle se retira sans danger et au nombre au moins de dix mille hommes. La plupart des autres qui restaient, périrent sur les bords de la rivière, écrasés par les éléphants ou par la cavalerie. Ceux qui purent échapper, tant fantassins que cavaliers, se joignirent au corps dont nous venons de parler, et le suivirent à Plaisance. Les Carthaginois poursuivirent l'ennemi jusqu'à la rivière, d'où arrêtés par la rigueur de la saison, ils revinrent à leurs retranchements. La victoire fut complète, et la perte peu considérable. Quelques Espagnols seulement et quelques Africains restèrent sur le champ de bataille, les Gaulois furent les plus maltraités, mais tous souffrirent beaucoup de la pluie et de la neige. Beaucoup d'hommes et de chevaux périrent de froid, et de tous les éléphants on n'en put sauver qu'un seul.
Préparatifs des Romains pour réparer leur perte. - Exploits de Corn. Scipion dans l'Espagne. - Adresse d'Hannibal pour attirer à son parti les Gaulois. - Passage du marais de Clusium.
Sempronius, pour cacher sa honte et sa défaite, envoya à Rome des courriers qui n'y dirent autre chose si ce n'est qu'il s'était livré une bataille, et que sans le mauvais temps, l'armée romaine eût remporté la victoire. D'abord on ne pensa point à se défier de cette nouvelle, mais on apprit bientôt tout le détail de l'action, que les Carthaginois occupaient le camp des Romains, que tous les Gaulois avaient fait alliance avec Hannibal, que les légions avaient fait retraite et s'étaient réfugiées dans les villes, et qu'elles n'avaient de munitions que ce qui leur en venait de la mer par le Pô. On fut extrêmement surpris d'un événement si tragique, et, pour en prévenir les suites, on fit de grands préparatifs pour la campagne suivante. On mit des garnisons dans les places, on envoya des troupes en Sardaigne et en Sicile, on en fit marcher aussi sur Tarente, et dans tous les postes les plus propres à arrêter l'ennemi, enfin on équipa soixante quinquérèmes. On choisit pour consuls Cn. Servilius et Caïus Flaminius, qui firent des levées chez les alliés, et envoyèrent des vivres à Ariminum et dans la Tyrrhénie, où la guerre devait se faire. Ils dépêchèrent aussi vers Hiéron pour lui demander du secours, et ce roi leur fournit cinq cents Crétois et mille soldats à pavois. Enfin il n'eut point de mesure que l'on ne prît, point de mouvement que l'on ne se donnât, car tels sont les Romains en général et en particulier, que, plus ils ont de raisons de craindre, plus ils sont redoutables.
Dans la même campagne, Cn. Cornelius Scipion, à qui Publius son frère avait laissé, comme nous avons déjà dit, le commandement de l'armée navale, étant parti des embouchures du Rhône avec toute sa flotte, et ayant pris terre en Espagne vers Emporium, assiégea, sur la côte jusqu'à l'Ebre, toutes les villes qui refusèrent de se rendre, et traita avec beaucoup de douceur celles qui se soumirent de bon gré. Il veilla à ce qu'il ne leur fût fait aucun tort. Il mit bonne garnison dans les nouvelles conquêtes qu'il avait faites, puis, pénétrant dans les terres à la tête de son armée, qu'il avait déjà grossie de beaucoup d'Espagnols devenus ses alliés à mesure qu'il avançait dans le pays, tantôt il recevait dans son amitié, tantôt il prenait par force les villes qui se rencontraient sur sa route. À Cisse, Hannon, à la tête d'un corps de Carthaginois, vint camper devant lui, Cornelius lui livra bataille, la gagna, et fit un butin très considérable, parce que c'était là qu'avaient laissé leurs équipages tous ceux qui étaient passés en Italie. Outre cela il se fit des alliés de tous les peuples d'en deçà de l'Ebre, et fit prisonniers Hannon même, et Andobale qui commandait les Espagnols. Celui-ci avait une espèce de royaume dans le pays, et avait toujours été fort attaché aux intérêts des Carthaginois.
Sur l'avis qu'Hasdrubal reçut de ce qui était arrivé, il passa l'Ebre et courut au secours de Hannon. Les troupes navales des Romains n'étaient point sur leurs gardes. Elles se tranquillisaient en songeant à l'avantage qu'avait remporté l'armée de terre. Il saisit habilement cette occasion, prend avec lui un détachement d'environ huit mille hommes de pied et mille chevaux. Il surprend ces troupes dispersées de côté et d'autre, en passe un grand nombre au fil de l'épée, et pousse les autres jusqu'à leurs vaisseaux. Il se retira en suite, et, repassant l'Ebre, il prit son quartier d'hiver à la nouvelle Carthage, où il donna tous ses soins à de nouveaux préparatifs, et à la garde des pays d'en deçà du fleuve. Cn. Cornelius, de retour à la flotte, punit selon la sévérité des lois ceux qui avaient négligé le service, puis, ayant réuni les deux armées, celle de mer et celle de terre, il alla prendre ses quartiers à Tarragone. Là, partageant le butin en parties égales aux soldats, il se gagna leur amitié, et leur fit souhaiter avec ardeur que la guerre continuât. Tel était l'état des affaires en Espagne.
Le printemps venu, Flaminius se mit en marche, prit sa route par la Tyrrhénie, et vint camper droit à Arétium, pendant que Servilius alla à Ariminum pour fermer aux ennemis les passages de ce côté-là. Pour Hannibal, qui avait pris ses quartiers d'hiver dans la Gaule Cisalpine, il retenait dans les cachots les prisonniers romains qu'il avait faits dans la dernière bataille, et leur donnait à peine le nécessaire, au lieu qu'il usait de toute la douceur possible à l'égard de ceux qu'il avait pris sur leurs alliés. Il les assembla un jour, et leur dit que ce n'était pas pour leur faire la guerre qu'il était venu, mais pour prendre leur défense contre les Romains, qu'il fallait donc, s'ils entendaient leurs intérêts, qu'ils embrassassent son parti, puisqu'il n'avait passé les Alpes que pour remettre l'Italie en liberté, et les aider à rentrer dans les villes et dans les terres d'où les Romains les avaient chassés. Après ce discours, il les renvoya sans rançon dans leur patrie. C'était une ruse pour détacher des Romains les peuples d'Italie, pour les porter à s'unir avec lui et soulever en sa faveur tous ceux dont les villes ou les ports sont sous la domination romaine.
Ce fut aussi dans ce même quartier d'hiver qu'il s'avisa d'un stratagème vraiment carthaginois. Il était environné de peuples légers et inconstants, et la liaison qu'il avait contractée avec eux était encore toute récente. Il avait à craindre que, changeant à son égard de dispositions, ils ne lui dressassent des pièges et n'attentassent à sa vie. Pour la mettre en sûreté, il fit faire des perruques et des habits pour tous les âges, il prenait tantôt l'un, tantôt l'autre, et se déguisait si souvent, que non seulement ceux qui ne le voyaient qu'en passant mais ses amis mêmes avaient peine à le reconnaître.
Cependant les Gaulois souffraient impatiemment que la guerre se fît dans leur pays. A les entendre, ce n'était que pour se venger des Romains, quoique au fond ce ne fût que par l'envie qu'ils avaient de s'enrichir à leurs dépens. Hannibal s'aperçut de cet empressement, et se hâta de décamper pour le satisfaire. Dès que l'hiver fut passé, il consulta ceux qui connaissaient le mieux le pays, pour savoir quelle route il prendrait pour aller aux ennemis. On lui dit qu'il y en avait deux, une fort longue et connue des Romains, l'autre à travers certains marais, difficile à tenir, mais courte, et par où Flaminius ne l'attendrait pas. Celle-ci se trouva plus conforme à son inclination naturelle, il la préféra. Au bruit qui s'en répandit dans l'armée, chacun fut effrayé. Il n'y eut personne qui ne tremblât à la vue des mauvais chemins et des abîmes où l'on allait se précipiter.
Hannibal, bien informé que les lieux où il devait passer, quoique marécageux, avaient un fond ferme et solide, leva le camp, et forma son avant-garde des Africains, des Espagnols, et de tout ce qu'il avait de meilleures troupes. Il y entremêla le bagage, afin que l'on ne manquât de rien dans la route. Il ne crut pas devoir s'en embarrasser pour la suite, parce que, s'il arrivait qu'il fût vaincu, il n'aurait plus besoin de rien, et que, s'il était victorieux, il aurait tout en abondance. Le corps de bataille était composé de Gaulois, et la cavalerie faisait l'arrière-garde. Il en avait donné la conduite à Magon, avec ordre de faire avancer de gré ou de force les Gaulois, en cas que par lâcheté ils fissent mine de se rebuter et de vouloir rebrousser chemin. Les Espagnols et les Africains traversèrent sans beaucoup de peine. On n'avait point encore marché dans ce marais, il fut assez ferme sous leurs pieds, et puis c'étaient des soldats durs à la fatigue, et accoutumés à ces sortes de travaux. Il n'en fut pas de même quand les Gaulois passèrent. Le marais avait été foulé par ceux qui les avaient précédés. Ils ne pouvaient avancer qu'avec une peine extrême, et, peu faits à ces marches pénibles, ils ne supportaient celle-ci qu'avec la plus vive impatience. Cependant il ne leur était pas possible de retourner en arrière. La cavalerie les poussait sans cesse en avant. Il faut convenir que toute l'armée eut beaucoup à souffrir. Pendant quatre jours et trois nuits elle eut les pieds dans l'eau, sans pouvoir prendre un moment de sommeil. Mais les Gaulois souffrirent plus que tous les autres. La plupart des bêtes de somme moururent dans la boue. Elles ne laissèrent pas, même alors, d'être de quelque utilité. Hors de l'eau, sur les ballots qu'elles portaient, on dormait au moins une partie de la nuit. Quantité de chevaux y perdirent le sabot. Hannibal lui-même, monté sur le seul éléphant qui lui restait, eut toutes les peines du monde à en sortir. Un mal d'yeux qui lui survint le tourmenta beaucoup, et comme la circonstance ne lui permettait pas de s'arrêter pour se guérir, cet accident lui fit perdre un oeil.
Caractère de Flaminius. - Réflexions de Polybe sur l'étude qu'Hannibal en fit. - Bataille de Trasimène.
Après être sorti de ce marais comme par miracle, le général carthaginois campa auprès pour donner quelque relâche à ses troupes, et parce que Flaminius avait établi ses quartiers devant Arétium dans la Tyrrhénie. Là, il s'informa avec soin de la disposition où étaient les Romains, et de la nature du pays qu'il allait traverser pour aller à eux. On lui dit que le pays était bon, et qu'il y avait de quoi faire un riche butin, et à l'égard de Flaminius, que c'était un homme doué d'un grand talent pour s'insinuer dans l'esprit de la populace, mais qui, sans en avoir aucun ni pour le gouvernement ni pour la guerre, se croyait très habile dans l'un et dans l'autre. De là Hannibal conclut que s'il pouvait passer au-delà du camp de ce consul, et porter le ravage dans la campagne sous ses yeux, celui-ci, soit de peur d'encourir les railleries du soldat, soit par chagrin de voir le pays ravagé, ne manquerait pas de sortir de ses retranchements, d'accourir contre lui, de le suivre partout où il le conduirait, et de se hâter de battre l'ennemi par lui-même, avant que son collègue pût partager avec lui la gloire de l'entreprise, tous mouvements dont il voulait tirer avantage pour attaquer le consul.
On doit convenir que toutes ces réflexions étaient dignes d'un général judicieux et expérimenté. C'est être ignorant et aveugle dans la science de commander les armées, que de penser qu'un général ait quelque chose de plus important à faire que de s'appliquer à connaître les inclinations et le caractère de son antagoniste. Comme dans un combat singulier ou de rang contre rang, on ne peut se promettre la victoire, si l'on ne parcourt des yeux tout son adversaire pour découvrir quelle est la partie de son corps la moins couverte. De même, il faut qu'un général cherche attentivement dans celui qui lui est opposé, non quelle est la partie de son corps la moins défendue, mais quel est dans son caractère le faible et le penchant par où l'on peut plus aisément le surprendre. Il est beaucoup de généraux qui, mous, paresseux, sans mouvement et sans action, négligent non seulement les affaires de l'Etat, mais encore les leurs propres. Il en est d'autres tellement passionnés pour le vin, qu'ils ne peuvent se mettre au lit sans en avoir pris avec excès. Quelques-uns se livrent à l'amour des femmes avec tant d'emportement, qu'ils n'ont pas honte de sacrifier à cet infâme plaisir des villes entières, leurs intérêts, leur vie même. D'autres sont lâches et poltrons, défaut déshonorant dans quelque homme que ce soit, mais le plus pernicieux de tous dans un général. Des troupes, sous un tel chef, passent le temps sans rien entreprendre, et l'on ne peut lui en confier le commandement sans s'exposer aux plus grands malheurs. La témérité, une confiance inconsidérée, une colère brutale, la vanité, l'orgueil, sont encore des défauts qui donnent prise à l'ennemi sur un général, et juste sujet à ses amis de s'en défier. Il n'y a point de pièges, point d'embuscades où il ne tombe, point d'hameçons où il ne morde. Si l'on pouvait connaître les faibles d'autrui, et qu'en attaquant ses ennemis on prît leur chef par l'endroit qui prête le plus à la surprise, en très peu de temps on subjuguerait toute la terre. Ôtez d'un vaisseau le pilote qui le gouverne, bientôt le vaisseau et son équipage tomberont sous la puissance des ennemis. Il en est de même d'une armée dont on surprend le général par adresse et par artifice.
C'est ainsi qu'Hannibal prenant
adroitement Flaminius par son faible, l'attira dans ses filets.
à peine eut-il levé son camp
d'autour de Fiésoles et passé un peu au-delà du camp des Romains, qu'il se
mit à dévaster tout. Le consul irrité, hors de lui-même, prit cette conduite
du Carthaginois pour une insulte et un outrage. Quand il vit ensuite la
campagne ravagée et la fumée annonçant de tous côtés la ruine entière de la
contrée, ce triste spectacle le toucha jusqu'à lui faire répandre des
larmes. Alors ce fut en vain que son conseil de guerre lui dit qu'il ne
devait pas se presser de marcher sur les ennemis, qu'il n'était pas à propos
d'en venir si tôt aux mains avec eux, qu'une cavalerie si nombreuse méritait
toute son attention, qu'il ferait mieux d'attendre l'autre consul et
d'attendre jusqu'à ce que les deux armées pussent combattre ensemble. Non
seulement il n'eut aucun égard à ces remontrances, mais il ne pouvait même
supporter ceux qui les lui faisaient. " Que pensent et que disent à présent
nos concitoyens, leur disait-il en voyant les campagnes saccagées presque
jusqu'aux portes de Rome, pendant que, derrière les ennemis, nous demeurons
tranquilles dans notre camp ? " Et sur-le-champ il se met en marche, sans
attendre l'occasion favorable, sans connaître les lieux, emporté par un
violent désir d'attaquer au plus tôt l'ennemi, comme si la victoire eût été
déjà certaine et acquise. Il avait même inspiré une si grande confiance à la
multitude, qu'il avait moins de soldats que de gens qui le suivaient dans
l'espérance du butin, et qui portaient des chaînes, des liens et autres
appareils semblables.
Cependant Hannibal s'avançait toujours vers Rome par la Tyrrhénie, ayant
Cortone et les montagnes voisines à sa gauche et le lac de Trasimène à sa
droite. Pour enflammer de plus en plus la colère de Flaminius, en quelque
endroit qu'il passât, il réduisait tout en cendres. Quand il vit enfin que
ce consul approchait, il reconnut les postes qui pourraient le plus lui
convenir, et se tint prêt à livrer bataille. Sur sa route il trouva un
vallon fort uni, deux chaînes de montagnes le bordaient dans sa longueur. Il
était fermé au fond par une colline escarpée et de difficile accès, et à
l'entrée était un lac entre lequel et le pied des montagnes il y avait un
défilé étroit qui conduisait dans le vallon. Il passa par ce sentier, gagna
la colline du fond, et s'y plaça avec les Espagnols et les Africains ; à
droite, derrière les hauteurs, il plaça les Baléares et les autres gens de
traits. Il posta la cavalerie et les Gaulois derrière les hauteurs de la
gauche, et les étendit de manière que les derniers touchaient au défilé par
lequel on entrait dans le vallon. Il passa une nuit entière à dresser ses
embuscades, après quoi il attendit tranquillement qu'on vînt l'attaquer.
Le consul marchait derrière avec un empressement extrême de rejoindre l'ennemi. Le premier jour, comme il était arrivé tard, il campa auprès du lac, et le lendemain, dès la pointe du jour, il fit entrer son avant-garde dans le vallon. Il s'était élevé ce matin-là un brouillard fort épais. Quand la plus grande partie des troupes romaines fut entrée dans le vallon, et que l'avant-garde toucha presque au quartier d'Hannibal, ce général tout d'un coup donne le signal du combat, l'envoie à ceux qui étaient en embuscade, et fond en même temps de tous côtés sur les Romains. Flaminius et les officiers subalternes, surpris d'une attaque si brusque et si imprévue, ne savent où porter du secours. Enveloppés d'un épais brouillard et pressés de front, sur les derrières et en flanc par l'ennemi qui fondait sur eux d'en haut et de plusieurs endroits, non seulement ils ne pouvaient se porter où leur présence était nécessaire, mais il ne leur était pas même possible d'être instruits de ce qui se passait. La plupart furent tués dans la marche même et avant qu'on eût le temps de les mettre en bataille, trahis pour ainsi dire par la stupidité de leur chef. Pendant que l'on délibérait encore sur ce qu'il y avait à faire, et lorsqu'on s'y attendait le moins, on recevait le coup de la mort. Dans cette confusion, Flaminius abattu, désespéré, fut environné par quelques Gaulois qui le firent expirer sous leurs coups. Près de quinze mille Romains perdirent la vie dans ce vallon, pour n'avoir pu ni agir ni se retirer. Car c'est chez eux une loi inviolable de ne fuir jamais, et de ne jamais quitter son rang. Il n'y en eut pas dont le sort soit plus déplorable que ceux qui furent surpris dans le défilé. Poussés dans le lac, les uns voulant se sauver à la nage avec leurs armes furent suffoqués, les autres, en plus grand nombre, avancèrent dans l'eau jusqu'au cou, mais quand la cavalerie y fut entrée, voyant leur perte inévitable, ils levaient les mains au-dessus du lac, demandaient qu'on leur sauvât la vie, et faisaient pour l'obtenir les prières les plus humbles et les plus touchantes, mais en vain. Les uns furent égorgés par les ennemis, et les autres s'exhortant mutuellement à ne pas survivre à une aussi honteuse défaite, se donnaient la mort à eux-mêmes. De toute l'armée il n'y eut qu'environ six mille hommes qui renversèrent le corps qui les combattait de front. Cette troupe eût été capable d'aider beaucoup à rétablir les affaires, mais elle ne pouvait connaître en quel état elles étaient. Elle poussa toujours en avant, dans l'espérance de rencontrer quelques partis de Carthaginois, jusqu'à ce qu'enfin, sans s'en apercevoir, elle se trouvât sur les hauteurs. De là, comme le brouillard était tombé, voyant leur armée taillée en pièces et l'ennemi maître de la campagne, ils prirent le parti, qui seul leur restait à prendre, de se retirer serrés et en bon ordre à certaine bourgade de la Tyrrhénie. Maharbal eut ordre de les poursuivre, et de prendre avec lui les Espagnols et les gens de trait. Il se mit à leur poursuite, les assiégea et les réduisit à une si grande extrémité, qu'ils mirent bas les armes et se rendirent, sans autre condition, sinon qu'ils auraient la vie sauve. Ainsi finit le combat qui se livra dans la Tyrrhénie entre les Romains et les Carthaginois.
Distinction que fait Hannibal entre les prisonniers romains et ceux d'entre leurs alliés.- Grande consternation à Rome.- Défaite de quatre mille cavaliers romains. - Fabius est fait dictateur.
Quand on eut amené devant Hannibal tous les prisonniers, tant ceux que Maharbal avait forcés de se rendre, que ceux que l'on avait faits dans le vallon, et qui tous ensemble montaient à plus de quinze mille, il dit aux premiers que Maharbal n'avait pas été en droit de traiter avec eux sans l'avoir consulté, et prit de là occasion d'accabler les Romains d'injures et d'opprobres. Il distribua ensuite ces prisonniers entre les rangs de son armée, pour les tenir sous bonne garde. Ceux d'entre les alliés des Romains furent traités avec plus d'indulgence. Il les renvoya tous dans leur patrie sans en rien exiger, leur répétant ce qu'il leur avait déjà dit, qu'il n'était pas venu pour faire la guerre aux Italiens, mais pour les délivrer du joug des Romains. Il fit prendre ensuite du repos à ses troupes et rendit les derniers devoirs aux principaux de son armée, qui, au nombre de trente, étaient restés sur le champ de bataille. De son côté la perte ne fait en tout que de quinze cents hommes, la plupart gaulois. Encouragé par cette victoire, il concerta avec son frère et ses confidents les mesures qu'il avait à prendre pour pousser plus loin ses conquêtes.
À Rome, quand la nouvelle de cette triste journée y eut été répandue, l'infortune était trop grande pour que les magistrats pussent la pallier ou l'adoucir. On assembla le peuple, et on la lui déclara telle qu'elle était. Mais à peine, du haut de la tribune aux harangues, un préteur eut-il prononcé ces quatre mots : " Nous avons été vaincus dans une grande bataille ", que la consternation fut telle, que ceux des auditeurs qui avaient été présents à l'action, crurent le désastre beaucoup plus grand qu'il ne leur avait paru dans le moment même du combat. Cela venait de ce que les Romains n'ayant, depuis un temps immémorial, ni entendu parler de bataille, ni perdu de bataille, ne pouvaient avouer leur défaite sans être touchés jusqu'à l'excès d'un malheur si peu attendu. Il n'y eut que le Sénat qui, malgré ce funeste événement, ne perdît pas de vue son devoir. Il pensa sérieusement à chercher ce que chacun aurait à faire pour arrêter les progrès du vainqueur.
Quelque temps après la bataille,
C. Servilius, qui campait autour d'Ariminum, c'est-à-dire vers la mer
Adriatique, sur les confins de la Gaule Cisalpine et du reste de l'Italie,
assez près des bouches du Pô, C. Servilius, dis-je, averti qu'Hannibal était
entré dans la Tyrrhénie, et qu'il était campé proche de Flaminius, aurait
voulu joindre celui-ci avec toute son armée. Mais comme elle était trop
pesante pour une si longue marche, il détacha quatre mille chevaux sous le
commandement de C. Centenius, avec ordre de prendre les devants, en cas de
besoin de secourir Flaminius. Hannibal n'eut pas plus tôt reçu cet avis,
qu'il envoya au-devant du secours qui arrivait aux Romains, Maharbal avec
les soldats armés à la légère et quelque cavalerie. Au premier choc,
Centenius perdit presque la moitié de ses soldats. Il se retira avec le
reste sur une hauteur, mais Maharbal les y poursuivit, et le lendemain les
fit tous prisonniers. Cette nouvelle vint à Rome trois jours après celle de
la bataille, c'est-à-dire dans un temps où la blessure que la première avait
faite, était encore toute sanglante. Le peuple, le Sénat même en fut
consterné. On laissa là les affaires de l'armée, on ne songea point à créer
de nouveaux consuls, on crut qu'une conjoncture si accablante demandait un
dictateur.
Quoique Hannibal eût lieu de concevoir les plus grandes espérances, il ne
jugea cependant pas à propos d'approcher encore de Rome. Il se contenta de
parcourir la campagne, et de ravager le pays en s'avançant vers Adria. Il
traversa l'Ombrie et le Picénum, et arriva dans le territoire d'Adria après
dix jours de marche. Il fit dans cette route un si grand butin, que l'armée
ne pouvait ni le mener ni le porter. Chemin faisant, il passa au fil de
l'épée une multitude d'habitants. Ennemi implacable des Romains, il avait
ordonné que l'on égorgeât tout ce qu'il s'en rencontrerait en âge de porter
les armes, sans leur faire plus de quartier que l'on n'en fait ordinairement
dans les villes que l'on prend d'assaut. Campé près d'Adria, dans ces
plaines si fertiles en toutes sortes de vivres, il prit grand soin de
refaire son armée, qu'un quartier d'hiver passé dans la Gaule Cisalpine dans
la fange et la saleté, et son passage à travers les marais de Clusium,
avaient mise dans un très mauvais état. Hommes et chevaux, presque tous
étaient couverts d'une espèce de gale qui vient de la faim qu'on a
soufferte. Ils trouvèrent dans ce beau pays de quoi ranimer leurs forces et
leur courage, et la dépouille des vaincus fournit au général autant d'armes
qu'il lui en fallait pour en munir ses Africains. Ce fut aussi en ce
temps-là qu'il envoya par mer à Carthage, pour y faire le récit de ce qu'il
avait fait depuis qu'il était dans l'Italie, car jusqu'alors il ne s'était
point encore approché de la mer. Ces nouvelles firent un plaisir extrême aux
Carthaginois, on s'appliqua plus que jamais aux affaires d'Espagne et
d'Italie, et l'on n'omit rien de ce qui pouvait en accélérer le succès.
Chez les Romains, on élut pour dictateur Quintus Fabius, personnage aussi distingué par sa sagesse que par sa naissance. De notre temps même on appelait les rejetons de cette famille, Maximi, c'est-à-dire très grands, titre glorieux que le premier Fabius leur avait mérité par ses grands exploits. Il est bon de remarquer que la dictature est différente du consulat : le consul n'est accompagné que de douze licteurs, le dictateur en a vingt-quatre à sa suite. Le premier ne peut entreprendre certaines choses sans l'autorité du Sénat. Toute autorité cesse, dès que le dictateur est nommé. De tous les magistrats, il n'y a que les tribuns qui soient alors conservés, comme nous ferons voir plus au long dans un autre endroit. On créa en même temps pour maître général de la cavalerie, Marcus Minucius. Cette sorte d'officier est, à la vérité, au-dessous du dictateur, mais lorsque celui-ci est occupé, l'autre est chargé de remplir ses fonctions, et exerce son autorité.
Hannibal changeait de temps en temps de quartier, sans s'écarter de la mer Adriatique. Il fit laver les chevaux avec du vin vieux, qui se trouvait là en abondance, et les remit en état de servir. Il fit guérir aussi les plaies des soldats qui étaient blessés, il donna aux autres le temps et les moyens de réparer leurs forces ; et quand il les vit tous sains et vigoureux, il se mit en route, et traversa les terres du Pretutium et d'Adria, les pays des Marrucins et des Frentans. Partout où il passait, il pillait, massacrait, réduisait tout en cendres. De là il entra dans l'Apulie, qui est divisée en trois parties, dont chacune a son nom particulier. Les Dauniens en occupent une, et les Messapiens une autre. Il entra dans la Daunie, et commença par ravager Lucérie, colonie romaine. Puis, ayant mis son camp à Hippone, il parcourut sans obstacle le pays des Argypiens et toute la Daunie.
Fabius se borne à la défensive.- Les raisons qu'il avait pour ne rien hasarder. - Caractère opposé de M. Minucius Rufus, maître général de la cavalerie.- Éloge de la Campanie. - Hannibal y porte le ravage.
Pendant qu'Hannibal était dans ces parages, Fabius, créé dictateur, après avoir offert des sacrifices aux dieux, partit de Rome, suivi de Minucius et de quatre légions qu'on avait levées pour lui. Lorsqu'il eut joint sur les frontières de la Daunie les troupes qui étaient venues d'Ariminum au secours de cette province, il ôta à Servilius le commandement de l'armée de terre, et le renvoya bien escorté à Rome, avec ordre, si les Carthaginois remuaient par mer, de courir où son secours serait nécessaire. Ensuite, il se mit en marche avec le général de la cavalerie, et alla camper en un lieu nommé Aigues, à cinquante stades du camp des Carthaginois.
Fabius arrivé, Hannibal, pour jeter l'épouvante dans cette nouvelle armée, sort de son camp, approche des retranchements des Romains, et se met en bataille. Il resta quelque temps en position, mais comme personne ne se présentait, il retourna dans son camp. Car Fabius avait pris la résolution, et rien dans la suite ne fut capable de la lui faire quitter, de ne rien hasarder témérairement, de ne pas courir les risques d'une bataille, et de s'appliquer uniquement à mettre ses troupes à couvert de tout danger. D'abord ce parti ne lui fit pas honneur, il courut des bruits désavantageux sur son compte, on le regarda comme un homme lâche, timide, et qui craignait l'ennemi, mais on ne fut pas longtemps à reconnaître que, dans les circonstances présentes, le parti qu'il avait pris était le plus sage et le plus judicieux que l'on pût prendre. La suite des événements justifia bientôt la solidité de ses réflexions. L'armée carthaginoise était composée de soldats exercés dès leur jeunesse aux travaux et aux périls de la guerre. Elle était commandée par un général nourri et élevé parmi ses soldats, instruit dès l'enfance dans la science des armes. Elle avait déjà gagné plusieurs batailles dans l'Espagne, et battu les Romains et leurs alliés deux fois de suite. C'était avec cela des hommes qui ne pouvant d'ailleurs tirer aucun secours, n'avaient de ressource et d'espérance que dans la victoire. Rien de tout cela ne se trouvait du côté des Romains. Si Fabius eût hasardé une action générale, sa défaite était immanquable. Il fit donc mieux de s'en tenir à l'avantage qu'avaient les Romains sur leurs ennemis, et de régler là-dessus l'état de la guerre. Cet avantage était de recevoir par leurs derrières autant de vivres, de munitions et de troupes qu'ils en auraient besoin, sans crainte que ces secours pussent leur manquer.
Sur ce projet, le dictateur se borna pendant toute la campagne à harceler toujours les ennemis, et à s'emparer des postes qu'il savait être les plus favorables à son dessein. Il ne souffrit pas que les soldats allassent au fourrage. Il les retint toujours réunis et serrés, uniquement attentif à étudier les lieux, le temps et les occasions. Quand quelques fourrageurs du côté des Carthaginois, approchaient de son camp, comme pour l'insulter, il les attaquait. Il en tua ainsi un assez grand nombre. Par ces petits avantages, il diminuait peu à peu l'armée ennemie, et relevait le courage de la sienne, que les pertes précédentes avaient intimidée. Mais on ne put jamais obtenir de lui qu'il marquât le temps et le lieu d'un combat général. Cette conduite ne plaisait pas à Minucius. Bassement populaire, il se pliait aux sentiments du soldat, et décriait le dictateur comme un homme sans courage et sans résolution. On ne pouvait trop tôt lui faire naître l'occasion d'aller à l'ennemi, et de lui donner bataille.
Les Carthaginois, après avoir saccagé la Daunie et passé l'Apennin, s'avancèrent jusque chez les Samnites, pays riche et fertile, qui depuis longtemps jouissait d'une paix profonde, et où les Carthaginois trouvèrent une si grande abondance de vivres, que malgré la consommation et le gaspillage qu'ils en firent, ils ne purent les épuiser. De là, ils firent des incursions sur Bénévent, colonie des Romains, et prirent Venusia, ville bien fortifiée, et où ils firent un butin prodigieux. Les Romains les suivaient toujours à une ou deux journées de distance, sans vouloir ni les joindre ni les combattre. Cette affectation d'éviter le combat sans cesser de tenir la campagne, porta le général carthaginois à se répandre dans les plaines de Capoue. Il se jeta en particulier sur Falerne, persuadé qu'il arriverait une de ces deux choses ou qu'il forcerait les ennemis à combattre ou qu'il ferait voir à tout le monde qu'il était pleinement le maître, et que les Romains lui abandonnaient le plat pays. Après quoi il espérait que les villes épouvantées quitteraient le parti des Romains. Car jusqu'alors, quoiqu'ils eussent été vaincus dans deux batailles, aucune ville d'Italie ne s'était rangée du côté des Carthaginois. Toutes étaient demeurées fidèles, même celles qui avaient le plus souffert, tant les alliés avaient de respect et de vénération pour la République romaine !
Au reste, Hannibal raisonnait sagement. Les plaines les plus estimées de l'Italie, soit pour l'agrément, soit pour la fertilité, sont, sans contredit, celles d'autour de Capoue. On y est voisin de la mer. Le commerce y attire du monde de presque toutes les parties de la terre. C'est là que se trouvent les villes les plus célèbres et les plus belles d'Italie : le long de la côte, Sinuesse, Cumes, Pouzzoles, Naples, Nuceria, dans les terres du côté du septentrion, Calénum, et Téano, à l'orient et au midi, la Daunie et Nole, et au milieu de ce pays, Capoue, la plus riche et la plus magnifique de toutes. Après cela, doit-on s'étonner que les mythologues aient tant célébré ces belles plaines, qu'on appelait aussi champs Phlégréens, autres plaines fameuses, et qui surpassaient en beauté toutes les autres, de sorte qu'il n'est pas surprenant que les dieux en aient, entre eux, disputé la possession ? Mais, outre tous ces avantages, c'est encore un pays très fort, et où il est très difficile d'entrer. D'un côté, il est couvert par la mer, et tout, le reste est fermé par de hautes montagnes, où l'on ne peut pénétrer, en venant des terres, que par trois gorges étroites et presque inaccessibles, l'une du côté des Samnites, l'autre du côté d'Ériban, et la troisième du côté des Hirpiniens. Les Carthaginois, campés dans cette partie de l'Italie, allaient de dessus ce théâtre ou épouvanter tout le monde par une entreprise si hardie et si extraordinaire ou rendre publique et manifeste la lâcheté des Romains, et faire voir qu'ils étaient absolument les maîtres de la campagne.
Sur ces réflexions, Hannibal sortit du Samnium, et, passant le détroit du mont Ériban, vint camper sur l'Athurnus, qui divise la Campanie en deux parties presque égales. Il mit son camp du côté de Rome, et fit porter le ravage par ses fourrageurs dans toute la plaine, sans que personne s'y opposât. Fabius fut surpris de la hardiesse de ce général, mais elle ne fit que l'affermir dans sa première résolution. Minucius, au contraire, et les autres officiers subalternes, croyant avoir surpris l'ennemi en lieu propre à lui donner bataille, étaient d'avis que l'on ne pouvait trop se hâter pour le joindre dans la plaine, et sauver une si grande contrée de la fureur du soldat. Le dictateur fit semblant d'être dans le même dessein, et d'avoir le même empressement, mais, quand il fut à Falerne, content de se faire voir au pied des montagnes et de marcher à côté des ennemis, pour ne pas paraître leur abandonner la campagne, il ne voulut point avancer dans la plaine, et craignit de s'exposer à une bataille rangée, tant pour les raisons que nous avons déjà vues, que parce que les Carthaginois étaient de beaucoup supérieurs en cavalerie.
Après qu'Hannibal eut assez tenté le dictateur et qu'il eut fait un butin immense dans la Campanie, il leva son camp, pour ne point consommer les provisions qu'il avait amassées, et pour les mettre en sûreté dans l'endroit où il prendrait ses quartiers d'hiver. Car ce n'était point assez que son armée, pour le présent, ne manquât de rien, il voulait qu'elle fût toujours dans l'abondance. Il reprit le chemin par lequel il était venu, chemin étroit et où il était très aisé de l'inquiéter. Fabius, sur la nouvelle de sa marche, envoie au devant de lui quatre mille, hommes pour lui couper le passage, avec ordre, si l'occasion s'en présentait, de tirer avantage de l'heureuse situation de leur poste. Il alla lui-même ensuite, avec la plus grande partie de son armée, se placer sur la colline qui commandait les défilés. Les Carthaginois arrivent et campent dans la plaine au pied même des montagnes. Les Romains s'imaginaient emporter d'emblée le butin, et croyaient même qu'aidés du lieu ils pourraient terminer la guerre. Fabius ne pensait plus qu'à voir quels postes il occuperait, par qui et par où il ferait commencer l'attaque.
Stratagème d'Hannibal pour tromper Fabius. - Bataille gagnée en Espagne sur Hasdrubal par Cn. Scipion. - Publius, son frère est envoyé en Espagne. - Les Romains passent l'Ebre pour la première fois.
Tous ces beaux projets devaient être exécutés le lendemain, mais Hannibal, jugeant de ce que les ennemis pouvaient faire en cette occasion, ne leur en donna pas le temps. II fit appeler Hasdrubal, qui avait à ses ordres les pionniers de l'armée, et lui ordonna de ramasser le plus qu'il pourrait de morceaux de bois sec et d'autres matières combustibles, de les lier en faisceaux, d'en faire des torches, de choisir dans tout le butin environ deux mille des plus forts bœufs, et de les conduire à la tête du camp. Cela fait, il dit à cette troupe de manger et de se reposer. Vers la troisième veille de la nuit, il fait sortir du camp les pionniers, et leur ordonne d'attacher les torches aux cornes des bœufs, de les allumer, et de pousser ces animaux à grands coups, jusqu'au sommet d'une montagne qu'il leur montra, et, qui s'élevait entre son camp et les défilés où il devait passer. A la suite des pionniers, il fit marcher les soldats armés à la légère pour leur aider à presser les bœufs, avec ordre, quand ces animaux seraient en train de courir, de se répandre à droite et à gauche, de gagner les hauteurs avec grand bruit, de s'emparer du sommet de la montagne, et de charger les ennemis en cas qu'ils les y rencontrassent. En même temps il s'avance vers les défilés, ayant à son avant-garde l'infanterie pesamment armée, au centre la cavalerie suivie du butin, et à l'arrière-garde les Espagnols et les Gaulois.
À la lueur de ces torches, les Romains qui gardaient les défilés croient qu'Hannibal prend sa route vers les hauteurs, quittent leurs postes et courent pour le prévenir. Arrivés proche des bœufs, ils ne savent que penser de cette manœuvre, ils se forment du péril où ils sont une idée terrible, et attendent de là quelque événement sinistre. Sur la hauteur, il y eut quelque escarmouche entre les Carthaginois et les Romains, mais les bœufs, se jetant entre les uns et les autres, les empêchaient de se joindre, et en attendant le jour on se tint de part et d'autre en repos. Fabius fut surpris de cet événement. Soupçonnant qu'il y avait là quelque ruse de guerre, il ne bougea point de ses retranchements, et attendit le jour, sans se départir de la résolution qu'il avait prise, de ne point s'engager dans une action générale. Cependant Hannibal profite de son stratagème. La garde des défilés n'eut pas plus tôt quitté son poste, qu'il les fit traverser à son armée et au butin. Tout passa sans le moindre obstacle. Au jour, de peur que les Romains, qui étaient sur les hauteurs, ne maltraitassent ses soldats armés à la légère, il les soutint d'un gros d'Espagnols, qui, ayant jeté sur le carreau environ mille Romains, descendirent avec ceux qu'ils étaient allés secourir. Sorti par cette ruse du territoire de Falerne, il campa ensuite paisiblement où il voulut, et n'eut plus d'autre embarras que de chercher où il prendrait ses quartiers d'hiver.
Cet événement répandit la terreur dans toutes les villes d'Italie ; tous les peuples désespéraient de pouvoir jamais se délivrer d'un ennemi si pressant. La multitude s'en prenait à Fabius. Quelle lâcheté, disait-on, de n'avoir point usé d'une occasion si avantageuse ! Tous ces mauvais bruits ne firent aucune impression sur le dictateur. Obligé quelques jours après de retourner à Rome pour quelques sacrifices, il ordonna expressément à Minucius de penser beaucoup moins à remporter quelque avantage sur les Carthaginois, qu'à empêcher qu'ils n'en remportassent sur lui. Mais ce chef fit si peu attention à cet ordre, que, pendant qu'il le recevait, il n'était occupé que de la pensée de combattre. Tel était l'état des affaires en Italie.
En Espagne, Hasdrubal, ayant équipé les trente vaisseaux que son frère lui avait laissés, et en ayant ajouté dix autres, fit partir de la nouvelle Carthage quarante voiles, dont il avait donné le commandement à Hamilcar. Puis ayant fait sortir les troupes de terre des quartiers d'hiver, il se mit à leur tête, et, faisant longer la côte aux vaisseaux, il les suivit de dessus le rivage dans le dessein de joindre les deux armées, lorsqu'on serait proche de l'Ebre. Cnéus, averti de ce projet des Carthaginois, pensa d'abord à aller au devant d'eux par terre, mais quand il sut combien l'armée des ennemis était nombreuse, et les grands préparatifs qu'ils avaient faits, il équipa trente-cinq vaisseaux, qu'il fit monter par les soldats de l'armée de terre qui étaient les plus propres au service de mer ; puis, ayant mis à la voile, après deux jours de navigation depuis Tarragone, il aborda aux environs des embouchures de l'Ebre. Lorsqu'il fut à environ dix milles de l'ennemi, il envoya deux frégates de Marseille à la découverte, car les Marseillais étaient toujours les premiers à s'exposer, et leur intrépidité lui fut d'un grand secours. Personne n'était plus attaché aux intérêts des Romains que ce peuple qui, dans la suite, leur a souvent donné des preuves de son affection, mais qui se signala dans la guerre d'Hannibal. Ces deux frégates rapportèrent que la flotte ennemie était à l'embouchure de l'Ebre. Sur-le-champ, Cnéus fit force de voiles pour la surprendre, mais Hasdrubal, informé depuis longtemps par les sentinelles que les Romains approchaient, rangeait ses troupes en bataille sur le rivage, et donnait ses ordres pour que l'équipage montât sur les vaisseaux. Quand les Romains furent à portée, on sonna la charge, et aussitôt on en vint aux mains. Les Carthaginois soutinrent le choc avec valeur pendant quelque temps, mais ils plièrent bientôt. La vue des troupes qui étaient sur la côte fut beaucoup moins utile aux soldats de l'équipage pour leur inspirer de la hardiesse et de confiance, qu'elle ne leur fut nuisible, en leur faisant espérer que c'était pour eux une retraite aisée, en cas qu'ils eussent le dessous. Après qu'ils eurent perdu deux vaisseaux avec l'équipage, et que quatre autres eurent été désemparés, ils se retirèrent vers la terre. Mais, poursuivis avec chaleur par les Romains, ils s'approchèrent le plus qu'ils purent du rivage, puis, sautant de leurs vaisseaux, il se sauvèrent vers leur armée de terre. Les Romains avancèrent hardiment vers le rivage, et ayant lié à l'arrière de leurs vaisseaux tous les vaisseaux des ennemis qu'ils purent mettre en mouvement, ils mirent à la voile, extrêmement satisfaits d'avoir vaincu du premier choc, de s'être soumis toute la côte de cette mer, et d'avoir gagné vingt-cinq vaisseaux. Depuis cet avantage, les Romains commencèrent à mieux espérer de leurs affaires en Espagne.
Quand on reçut à Carthage la nouvelle de cette défaite, on équipa soixante-dix vaisseaux, car on ne croyait pouvoir rien entreprendre qu'on ne fût maître de la mer. Cette flotte cingla d'abord vers la Sardaigne, et de la Sardaigne elle vint aborder à Pise en Italie, où l'on espérait s'aboucher avec Hannibal. Les Romains vinrent au-devant avec cent vingt vaisseaux longs à cinq rangs, mais les Carthaginois, informés qu'ils étaient en mer, retournèrent à Carthage par la même route. Servilius, amiral de la flotte romaine, les poursuivit pendant quelque temps dans l'espérance de les combattre, mais il avait trop de chemin à faire pour les atteindre. D'abord il alla à Lilybée, de là il passa en Afrique dans l'île de Cercine, d'où, après avoir fait payer contribution aux habitants, il revint sur ses pas, prit en passant l'île de Cossyre, mit garnison dans sa petite ville, et aborda à Lilybée, où ayant mis ses bâtiments en sûreté, il rejoignit peu de temps après l'armée de terre.
Sur la nouvelle de la victoire que Cnéus avait remportée sur mer, le Sénat, persuadé que les affaires d'Espagne méritaient une attention particulière, et qu'il était non seulement utile, mais nécessaire de presser les Carthaginois dans ce pays-là, et d'y allumer la guerre de plus en plus, mit en mer vingt vaisseaux sous la conduite de Publius Scipion, qui avait déjà été choisi pour cette guerre, et lui donna ordre de joindre au plus tôt Cnéus, son frère, pour agir avec lui de concert. Il craignait que les Carthaginois dominant dans ces contrées, et y amassant des munitions et de l'argent en abondance, ne se rendissent maîtres de la mer, et qu'en fournissant de l'argent et des troupes à Hannibal, ils ne l'aidassent à subjuguer l'Italie. C'est pour cela que cette guerre leur parut si importante, qu'ils envoyèrent une flotte et qu'ils en donnèrent le commandement à Publius Scipion, qui, arrivé en Espagne et joint à son frère, rendit de très grands services à la République. Jusqu'alors les Romains n'avaient osé passer l'Ebre. Ils croyaient avoir assez fait de s'être gagné l'alliance et l'amitié des peuples d'en deçà, mais sous Publius ils traversèrent ce fleuve et portèrent leurs armes bien au-delà. Le hasard même sembla pour lors agir de concert avec eux. Ayant effrayé les peuples qui habitaient l'endroit du fleuve qu'ils avaient choisi pour le passer, ils s'avancèrent jusqu'à Sagonte et campèrent à cinq milles de cette ville, proche d'un temple consacré à Vénus, poste également, avantageux, et parce qu'il les mettait hors d'insulte, et parce que la flotte qui les côtoyait leur fournissait commodément tout ce qui leur était nécessaire. Or, voici ce qui arriva dans cet endroit.
Trahison d'Abilyx. - Hannibal lève son camp, et prend ses quartiers d'hiver autour de Gérunium. - Combat où Minucius a l'avantage.
Pendant qu'Hannibal était en marche pour aller en Italie, dans toutes les villes d'Espagne dont il se défiait, il eut la précaution de prendre des otages, et ces otages étaient les enfants des familles les plus distinguées, qu'il avait tous mis comme en dépôt dans Sagonte, tant parce que la ville était fortifiée, qu'à cause de la fidélité des habitants qu'il y avait laissés. Certain Espagnol nommé Abilyx, personnage distingué, et qui se donnait pour l'homme de sa nation le plus dévoué aux intérêts des Carthaginois, jugeant, à la situation des affaires, que les Romains pourraient bien avoir le dessus, conçut un dessein tout à fait digne d'un Espagnol et d'un Barbare : c'était de livrer les otages aux Romains. Il se flattait qu'après leur avoir rendu un si grand service, et leur avoir donné une preuve si éclatante de son affection pour eux, il ne manquerait pas d'en être magnifiquement récompensé.
Ravi et uniquement occupé de ce perfide projet, il va trouver Bostar, qu'Hasdrubal avait envoyé là pour arrêter les Romains au passage de l'Ebre, mais qui n'ayant osé rien hasarder, retiré à Sagonte, s'était campé du côté de la mer, homme simple d'ailleurs et sans détours, naturellement doux, facile, et qui ne se défiait de rien. Le traître tourne la conversation sur les otages, et lui dit qu'après le passage de l'Ebre par les Romains, les Carthaginois ne pouvaient plus par la crainte contenir les Espagnols dans le devoir, que les circonstances actuelles demandaient qu'ils s'étudiassent à se les attacher par l'amitié, que pendant que les Romains étaient devant Sagonte, et qu'ils la serraient de près, s'il en retirait les otages et les rendait à leurs parents et aux villes d'où ils étaient venus, il ferait évanouir les espérances des assiégeants, qui ne cherchaient à retirer ces otages des mains de ceux qui les avaient en leur puissance, que pour les remettre à ceux qui les avaient livrés, que par là il gagnerait aux Carthaginois les cœurs des Espagnols, qui charmés des sages mesures qu'il aurait prises pour la sûreté de ce qu'ils avaient de plus cher, seraient pénétrés de la plus vive reconnaissance, que, s'il voulait le charger de cette commission, il ferait infiniment valoir ce bienfait aux yeux de ses compatriotes, qu'en amenant ces enfants dans leur pays, il concilierait aux Carthaginois l'affection non seulement des parents, mais encore de tout le peuple, à qui il ne manquerait pas de peindre avec les plus vives couleurs la douceur et la générosité dont les Carthaginois usaient envers leurs alliés, que lui Bostar devait s'attendre à une récompense magnifique de la part de ces parents, qui, après avoir contre toute espérance recouvré ce qu'ils aimaient le plus au monde, piqués d'une noble émulation, s'efforceraient de surpasser en générosité celui qui, étant à la tête des affaires, leur aurait procuré cette satisfaction. Abilyx, par ces raisons et d'autres de même force, ayant amené Bostar à son sentiment, convint avec lui du jour où il viendrait prendre les enfants et se retira.
La nuit suivante il entra dans le camp des Romains, où il joignit quelques Espagnols qui servaient dans leur armée et par qui il se fit présenter aux deux généraux. Après un long discours, où il leur fit sentir quels seraient le zèle et l'attachement de la nation espagnole, si par eux elle pouvait recouvrer ses otages, il promit de les leur mettre entre les mains. A cette promesse Publius est transporté de joie, il promet au traître de grands présents, et lui marque le jour, l'heure et le lieu où on l'attendait. Abilyx ensuite prend avec lui quelques amis et retourne vers Bostar. Il en reçoit les otages, sort de Sagonte pendant la nuit pour cacher sa route, passe au-delà du camp des Romains, se rend au lieu dont il était convenu, et livre tous les otages aux deux Scipions. Publius lui fit l'accueil le plus honorable, et le chargea de conduire les enfants chacun dans leur patrie. Il eut cependant la précaution de le faire accompagner par quelques personnes sûres. Dans toutes les villes que parcourait Abilyx, et où il remettait les otages, il élevait jusqu'aux cieux la douceur et la grandeur d'âme des Romains, et opposait à ces belles qualités la défiance et la dureté des Carthaginois, et ajoutant à cela qu'il avait lui-même abandonné leur parti, il entraîna grand nombre d'Espagnols dans celui des Romains. Bostar, pour un homme d'un âge avancé, passa pour avoir donné puérilement dans un piège si grossier, et cette faute le jeta ensuite dans de grands embarras. Les Romains, au contraire, en tirèrent de très grands avantages pour l'exécution de leurs desseins, mais comme la saison était alors avancée, de part et d'autre on distribua les armées dans les quartiers d'hiver.
Laissons là les affaires d'Espagne et retournons à Hannibal.
Ce général, averti par ses espions qu'il y avait quantité de vivres aux environs de Lucérie et de Gérunium, et que cette dernière ville était disposée pour y faire des magasins, choisit là ses quartiers d'hiver, et, passant au-delà du mont Livourne, y conduisit son armée. Arrivé à Gérunium, qui n'est qu'à environ un mille de Lucérie, il tâcha d'abord de gagner les habitants par la douceur, et leur offrit même des gages de la sincérité des promesses qu'il leur faisait, mais n'en étant point écouté, il mit le siège devant la ville. Il s'en vit bientôt ouvrir les portes, et passa tous les assiégés au fil de l'épée. Quant à la plupart des maisons et aux murs, il les laissa dans leur entier, pour en faire des magasins dans ses quartiers d'hiver. Il fit ensuite camper son armée devant la ville, et fortifia le camp d'un fossé et d'un retranchement. De là il envoyait les deux tiers de son armée au fourrage, avec ordre à chacun d'apporter une certaine mesure de blé à ceux qui étaient chargés de le serrer. La troisième partie de ses troupes lui servait pour garder le camp et pour soutenir les fourrageurs en cas qu'ils fussent attaqués. Comme ce pays est tout en plaines, que les fourrageurs étaient sans nombre et que la saison était propre au transport des grains, tous les jours on lui amassait une quantité prodigieuse de blé.
Cependant Minucius, laissé par Fabius à la tête de l'armée romaine, la conduisait toujours de hauteur en hauteur, dans l'espérance de trouver de là quelque occasion de tomber sur celle des Carthaginois, mais, sur l'avis que l'ennemi avait pris Gérunium, qu'il fourrageait le pays et qu'il s'était retranché devant la ville, il quitta les hauteurs et descendit au promontoire d'où l'on va dans la plaine. Arrivé à une colline qui est dans le pays des Larinatiens et que l'on appelle Caléla, il campa autour, résolu d'en venir aux mains à quelque prix que ce fût. A l'approche des Romains, Hannibal laisse aller un tiers de ses troupes au fourrage, et s'avance avec le reste jusqu'à certaine hauteur éloignée d'environ deux milles, et s'y rallie. De là il tenait les ennemis en respect et mettait ses fourrageurs à couvert. La nuit venue, il détacha environ deux mille lanciers pour s'emparer d'une hauteur avantageuse, et qui commandait de près le camp des Romains. Au jour, Minucius les fit attaquer par ses troupes légères. Le combat fui opiniâtre. Les Romains emportèrent la hauteur et y logèrent toute leur armée. Comme les deux camps étaient l'un près de l'autre, Hannibal pendant quelque temps retint auprès de lui la plus grande partie de son armée, mais il fut enfin obligé d'en détacher une partie pour mener paître les bêtes de somme et d'en envoyer une autre au fourrage, toujours attentif à son premier projet, qui était de ne point consommer son butin et de faire de grands amas de vivres, afin que pendant le quartier d'hiver, les hommes, les bêtes de charge, les chevaux surtout ne manquassent de rien, car c'était sur sa cavalerie qu'il fondait principalement ses espérances.
Minucius s'étant aperçu que la plus grande partie de l'armée carthaginoise était répandue dans la campagne, choisit l'heure du jour qui lui parut la plus commode, mit en marche son armée, s'approcha du camp des Carthaginois, rangea en bataille ses soldats pesamment armés, et, partageant par pelotons ses troupes légères et la cavalerie, il les envoya contre les fourrageurs, avec défense d'en faire aucun prisonnier. Hannibal alors se trouva fort embarrassé. Il n'était en état ni d'aller en bataille au devant des ennemis ni de porter du secours à ses fourrageurs. Aussi les Romains détachés en tuèrent-ils un grand nombre, et ceux qui étaient en bataille poussèrent leur mépris pour l'armée carthaginoise, jusqu'à arracher la palissade qui la couvrait, et à l'assiéger presque dans son camp. Hannibal fut surpris de ce revers de fortune, mais il n'en fut point déconcerté. Il repoussa ceux qui approchaient, et défendit du mieux qu'il put ses retranchements. Plus hardi quand Hasdrubal fut venu à son secours avec quatre mille des fourrageurs qui étaient de retour au camp, il avança contre les Romains, mit ses troupes en bataille à la tête du camp, et fit tant qu'il se tira, quoique avec peine, du danger dont il avait été menacé, mais non sans avoir perdu beaucoup de monde à ses retranchements, et un plus grand nombre de ceux qu'il avait envoyés au fourrage.
Après cet exploit, le général romain se retira plein de belles espérances pour l'avenir. Le lendemain les Carthaginois quittèrent leur camp, et Minucius vint l'occuper. Hannibal avait jugé à propos de l'abandonner pour retourner dans son premier camp devant Gérunium, de peur que pendant la nuit les Romains ne s'en rendissent maîtres, et qu'étant dénué de défense, ils ne s'emparassent des vivres et des munitions qu'ils y avaient amassés. Depuis ce temps-là, autant les fourrageurs carthaginois se tinrent sur leurs gardes, autant ceux des Romains allèrent tête levée et avec confiance.
Minucius est fait dictateur comme Fabius, et prend la moitié de l'armée. - Hannibal lui dresse un piège, il y tombe, et, confus de sa défaite, il rend ses troupes à Fabius, et se soumet à ses ordres. - Les deux dictateurs cèdent le commandement à L. Emilius, et à Caïus Terentius Varron.
À Rome, quand on apprit ce qui s'était passé à l'armée d'Italie, et que l'on exagérait bien au-delà du vrai, ce fut une joie qui ne se peut exprimer comme jusqu'alors on n'avait presque tien espéré de cette guerre, on crut que les affaires allaient changer de face. Et d'ailleurs cet avantage fit penser que, si jusqu'à présent les troupes n'avaient rien fait, ce n'était pas qu'elles manquassent de bonne volonté, mais qu'il ne fallait s'en prendre qu'à la timide circonspection et à la prudence excessive du dictateur, sur le compte duquel on ne ménagea plus les termes. Chacun en parla sans façon, comme d'un homme qui par lâcheté n'avait osé rien entreprendre, quelque occasion qui se fût présentée. On conçut au contraire une si grande estime du général de la cavalerie, que l'on fit alors ce qui jamais ne s'était fait à Rome. Dans la persuasion où l'on était qu'il terminerait bientôt la guerre, on le nomma aussi dictateur. Il y eut donc deux dictateurs pour la même expédition, chose auparavant inouïe chez les Romains.
Quand la nouvelle vint à Minucius, et des applaudissements qu'il avait reçus, et de la dignité suprême où il avait été élevé, le désir qu'il avait d'affronter l'ennemi et de le combattre n'eut plus de bornes. Pour Fabius, de retour à l'armée, il reprit ses premières allures. Le dernier avantage remporté sur les Carthaginois, loin de lui faire quitter sa prudente et sage lenteur, ne servit qu'à l'y affermir. Mais il ne put soutenir l'orgueil et la fierté de son collègue. Il se lassa des contradictions qu'il avait à en essuyer, et, rebuté de lui entendre toujours demander une bataille, il lui proposa cette alternative ou de prendre un temps pour commander seul ou de partager les troupes, et de faire de celles qui le suivraient tel usage qu'il jugerait à propos. Minucius choisit de grand cœur le dernier parti. Il prit la moitié de Farinée, se sépara, et campa à environ douze stades de Fabius.
Hannibal, tant par le rapport des prisonniers que par la séparation des deux camps, vit bientôt que les généraux romains ne s'accordaient pas, et que la division venait de l'impétuosité de Minucius, et de la passion qui le possédait de se distinguer. Comme cette disposition ne pouvait lui être que très avantageuse, il concentra toute son attention sur Minucius, et s'appliqua uniquement à chercher les moyens de réprimer son audace et de prévenir ses efforts. Entre son camp et celui de Minucius, il y avait une hauteur d'où l'on pouvait fort incommoder l'ennemi. Il prit la résolution de s'en emparer le premier, mais se doutant que son antagoniste, fier encore de son premier succès, ne manquerait pas de se présenter pour le surprendre, il eut recours à un stratagème. Quoique la plaine, que commandait la colline, fût rase et toute découverte, il avait observé qu'il s'y trouvait quantité de coupures et de cavités où l'on pouvait cacher du monde. Il y cacha cinq cents chevaux et cinq mille fantassins, distribués en pelotons de deux et de trois cents hommes, et, de peur que cette embuscade ne fût découverte le matin par les fourrageurs ennemis, dès la petite pointe du jour il fit occuper la colline par les soldats armés à la légère.
Minucius croit l'occasion belle, il envoie son infanterie légère, et lui donne ordre de disputer ce poste avec vigueur. Il la fait suivre de sa cavalerie, il la suit lui-même avec les légionnaires, et dispose toutes choses comme dans le dernier combat. Le soleil levé, les Romains étaient si occupés de ce qui se passait à la colline, qu'ils ne firent nulle attention à l'embuscade. Hannibal, de son côté, y envoyait aussi continuellement de nouvelles troupes. Il les suivit incontinent avec la cavalerie et le reste de son armée. La cavalerie de part et d'autre ne tarda point à charger. L'infanterie légère des Romains fut enfoncée par la cavalerie carthaginoise, beaucoup supérieure en nombre, et, se réfugiant vers les légionnaires, y jeta le trouble et la confusion. Alors Hannibal donne le signal à ses troupes embusquées. Elles fondent de tous les côtés sur les Romains. Ce ne fut plus seulement leur infanterie légère qui courait risque d'être entièrement défaite, c'était toute leur armée. Fabius vit de son camp le péril où elle était exposée. Il sortit à la tête de ses troupes, et vint en hâte au secours de son collègue. Les Romains déjà en déroute se rassurent, reprennent courage, se rallient et se retirent vers Fabius. Une grande partie de l'infanterie légère périt dans cette action, mais il y périt encore plus de légionnaires, et des plus braves de l'armée. Hannibal se garda bien d'entreprendre un nouveau combat contre des troupes fraîches, et qui venaient en bon ordre. Il cessa de poursuivre, et se retira. Après ce combat, l'armée romaine eut de quoi se convaincre que la vaine confiance de Minucius avait été la cause de son malheur, et qu'elle ne devait son salut qu'à la sage circonspection de son collègue, et l'on sentit aussi à Rome combien la vraie science de commander et une conduite toujours judicieuse l'emportent sur une bravoure téméraire et une folle démangeaison de se signaler. Cet échec fit rentrer les Romains en eux-mêmes. Les deux armées se rejoignirent et ne firent plus qu'un seul camp. On se conduisit d'après les avis et les lumières de Fabius, et l'on exécuta ponctuellement ses ordres. Du côté des Carthaginois, on tira une ligne entre la colline et le camp. On mit sur le sommet une garde que l'on défendit d'un bon retranchement, et l'on ne s'occupa plus que du sein de chercher des quartiers d'hiver.
Au printemps suivant, on élut à Rome pour consuls Lucius Emilius et Caïus Terentius, et les deux dictateurs se démirent de leur charge. Les deux consuls précédents, Cn. Servilius et Marcus Regulus successeur de Flaminius dans cette dignité, envoyés à l'armée par Emilius en qualité de proconsuls, y prirent le commandement, et disposèrent de tout à leur gré. Emilius, ayant tenu conseil avec le Sénat, fit faire de nouvelles levées, pour suppléer à ce qui manquait aux légions, et, en les envoyant à l'armée, il fit défense à Servilius d'engager une action générale, sous quelque prétexte que ce fût, mais il lui ordonna de livrer de petits combats vifs et fréquents, pour exercer les nouvelles troupes et les disposer à une bataille décisive. La République en effet n'avait par le passé souffert de si grandes pertes que parce que l'on avait mené aux combats des gens nouvellement enrôlés, et qui n'étaient ni exercés ni aguerris.
Par ordre encore du Sénat, Lucius Posthumius partit comme préteur avec une légion, pour obliger, par une diversion, les Gaulois, qui s'étaient ligués avec Hannibal, de s'en séparer, et de pourvoir à la sûreté de leur propre pays. On fit aussi revenir en Italie la flotte qui hivernait à Lilybée, et l'on embarqua pour l'Espagne toutes les munitions nécessaires aux armées que les deux Scipions y commandaient. Enfin on donna tous les soins possibles aux préparatifs de la campagne où l'on allait entrer. Servilius suivit exactement les ordres du consul, et c'est ce qui nous dispensera de nous étendre sur ce qu'il a fait, rien de grand ni de mémorable, mais quantité d'escarmouches et de petits combats, où les deux proconsuls se conduisirent avec beaucoup de sagesse et de valeur.
Hannibal s'empare de la citadelle de Cannes et réduit les Romains à la nécessité de combattre. - Préparatifs pour cette bataille. - Harangues de part et d'autre pour disposer les troupes à une action décisive.
Les deux armées passèrent ainsi l'hiver et tout le printemps en présence l'une de l'autre. Le temps de la moisson venu Hannibal décampe de Gérunium, et, pour mettre les ennemis dans la nécessité de combattre, il s'empare de la citadelle de Cannes, où les Romains avaient enfermé les vivres et autres munitions qu'ils avaient apportés de Canusium, et d'où ils tiraient leurs convois. Cette ville avait été entièrement détruite l'année précédente. Hannibal, par la prise de cette place, jeta l'armée romaine dans un embarras très grand. Outre qu'il était maître des vivres, il se voyait dans un poste qui par sa situation commandait sur toute la contrée. Les proconsuls dépêchèrent à Rome courriers sur courriers, et mandèrent que, s'ils approchaient de l'ennemi, il ne leur était plus possible de battre en retraite, que tout le pays était ruiné, que les alliés étaient en suspens, et attendaient avec impatience à quoi l'on se déterminerait, qu'on leur fît savoir au plus tôt ce que l'on jugeait à propos qu'ils fissent. L'avis du Sénat fut de livrer bataille, mais on écrivit à Servilius de suspendre encore, et l'on envoya Emilius pour la donner.
Tout le monde jeta les yeux sur ce consul, personne ne parut plus capable d'exécuter avec succès une si grande entreprise. Une vie constamment vertueuse, et les grands services qu'il avait rendus à la République quelques années auparavant dans la guerre contre les Illyriens, réunirent tous les suffrages en sa faveur. On fit même dans cette occasion ce qui ne s'était pas encore fait, on composa l'armée de huit légions, chacune de cinq mille hommes, sans les alliés.
Car, comme nous l'avons déjà dit, les Romains ne lèvent jamais que quatre légions, dont chacune est d'environ quatre mille hommes et deux cents chevaux. Ce n'est que dans les conjonctures les plus importantes qu'ils y mettent cinq mille des uns et trois cents des autres. Pour les troupes des alliés, leur infanterie est égale à celle des légions, mais il y a trois fois plus de cavalerie. On donne à chaque consul la moitié de ces troupes auxiliaires, et deux légions. On les envoie chacun de leur côté, et la plupart des batailles ne se donnent que par un consul, deux légions et le nombre d'alliés que nous venons de marquer. Il arrive très rarement que l'on se serve de toutes ses forces en même temps et pour la même expédition. Ici les Romains emploient non seulement quatre, mais huit légions. Il fallait qu'ils craignissent extrêmement les suites de cette affaire.
Le Sénat fit sentir à Emilius de quel avantage serait pour la République une victoire complète, et au contraire de combien de malheurs une défaite serait suivie. On l'exhorta de prendre bien son temps pour une action décisive, et de s'y conduire avec cette valeur et cette prudence qu'on admirait en lui, en un mot, d'une manière digne du nom romain. Dès que les consuls furent arrivés au camp, ils firent assembler les troupes, leur déclarèrent les intentions du Sénat, et leur dirent, pour les animer à bien faire, tout ce que les conjonctures présentes leur suggérèrent de plus pressant. Emilius, touché lui-même du malheur de la République, en fit le sujet de sa harangue. Il était important de rassurer les troupes contre les revers qu'elles avaient éprouvés, et de dissiper l'épouvante qu'elles en avaient conçue.
Il dit donc à ses soldats que si dans les combats précédents ils avaient eu le dessous, ils pouvaient par bien des raisons faire voir qu'ils n'en étaient pas responsables, mais que dans la bataille qui s'allait donner, pour peu qu'ils eussent de courage, rien ne pourrait mettre obstacle à la victoire, qu'auparavant deux consuls ne commandaient pas la même armée, que l'on ne s'était servi que de troupes levées depuis peu, sans exercice, sans expérience, et qui en étaient venues aux mains avec l'ennemi sans presque l'avoir vu, que celles qui avaient été battues sur la Trébie, arrivées le soir de la Sicile, avaient été rangées en bataille le lendemain, dès la pointe du jour, qu'à la journée de Trasimène, loin d'avoir vu l'ennemi avant le combat, elles n'avaient pu, à cause du brouillard, l'apercevoir, même en combattant. " Mais aujourd'hui, ajouta-t-il, vous voyez toutes choses dans une situation bien différente. Non seulement les deux consuls de l'année présente marchent à votre tête, et partagent avec vous tous les périls, mais encore les deux de l'année passée ont bien voulu se rendre aux prières que nous leur avons adressées, de demeurer et de combattre avec nous. Vous connaissez les armes des ennemis, leur manière de se former, leur nombre. Depuis deux ans il ne s'est presque point passé de jour que vous n'ayez mesuré vos épées avec les leurs. Des circonstances différentes doivent produire un succès différent. Il serait étrange, que dis-je? il est impossible qu'en combattant à forces égales dans des rencontres particulières, vous ayez été le plus souvent victorieux, et que, supérieurs en nombre de plus de la moitié, vous soyez défaits dans une bataille générale. Romains, il ne vous manque plus pour la victoire que de vouloir vaincre. Mais ce serait vous faire injure que de vous exhorter à le vouloir. Si je parlais à des soldats mercenaires ou à des alliés, qui, obligés, en vertu des traités, de prendre les armes pour une autre puissance, courent tous les risques d'un combat, sans avoir presque rien à en craindre ou à en espérer, ce serait à ces sortes de soldats qu'il faudrait tâcher d'inspirer le désir de vaincre, mais en parlant à des troupes qui, comme vous, vont combattre pour elles-mêmes, pour leur patrie, leurs femmes et leurs enfants, et pour qui une bataille doit avoir des suites si funestes ou si avantageuses, il est inutile de les exhorter, il suffit de les avertir de ce que l'on attend d'elles. Car qui n'aime mieux vaincre ou, si cela ne se peut, mourir du moins les armes à la main, que de vivre et de voir ce qu'il a de plus cher, dans l'infamie et dans l'oppression ? Mais qu'est-il besoin d'un si long discours ? Figurez-vous par vous-mêmes quelle différence il y a entre une victoire et une défaite, les avantages que l'une vous procure, les maux que l'autre entraîne après elle, et pensez, en combattant, qu'il ne s'agit pas ici de la perte des légions, mais de tout l'empire. Si vous êtes vaincus, Rome n'a plus de ressources pour tenir tête à l'ennemi. Ses soins, ses forces, ses espérances, tout est réuni dans votre armée. Faites en sorte que le succès réponde à son attente, et que votre reconnaissance égale les bienfaits que vous en avez reçus. Que toute la terre sache aujourd'hui que si les Romains ont perdu quelques batailles, ce n'est pas qu'ils eussent moins de courage et de valeur que les Carthaginois, mais parce que les conjonctures où l'on se trouvait ne permettaient pas qu'on leur opposât des combattants qui fussent accoutumés aux devoirs et aux périls de la guerre. "
Après cette harangue, Emilius congédia l'assemblée.
Le lendemain, ce consul se mit en marche, pour aller où il avait eu avis que les Romains campaient. Il y arriva le deuxième jour, et mit son camp à environ six milles de celui des Carthaginois. Comme c'était une plaine fort unie et tout ouverte, et que la cavalerie ennemie était de beaucoup supérieure à celle des Romains, il ne jugea pas à propos d'engager le combat dans cet endroit. Il voulait qu'on attirât l'ennemi dans un terrain où l'infanterie pût avoir le plus de part à l'action. Varron, général sans expérience, fut d'un avis contraire. De là, la division parmi les chefs. Rien ne pouvait arriver de plus pernicieux et de plus funeste. Le lendemain, jour où commandait Varron (car c'est l'usage des consuls romains de commander tour à tour), ce consul décampa, et prit la résolution d'avancer plus près des ennemis, quelque chose que pût lui dire son collègue pour l'en détourner.
Hannibal vient au-devant de lui avec ses soldats armés à la légère et sa cavalerie, fond sur les troupes encore en marche, fait une charge furieuse, et jette un grand désordre parmi les Romains. Le consul soutint ce premier choc avec un corps de soldats pesamment armés. Il fit ensuite charger les gens de trait et la cavalerie, et eut soin d'y mêler quelques cohortes de légionnaires. Cette précaution, que les Carthaginois avaient négligé de prendre, lui donna tout l'avantage du combat. La nuit mit fin à cette action, qui ne réussit pas à Hannibal, comme il l'avait espéré.
Le lendemain, Emilius, qui n'était pas d'avis de combattre, et qui cependant ne pouvait, sans péril, retirer de là son armée, en fit camper les deux tiers le long de l'Aufide, seule rivière qui traverse l'Apennin, chaîne de montagnes qui partage toutes les rivières qui arrosent l'Italie, et dont les unes se jettent dans la mer de Toscane, et les autres dans la mer Adriatique. L'Aufide prend sa source du côté de la première, et, passant au travers de l'Apennin, va se jeter dans l'autre. Emilius fit passer le fleuve au reste de l'armée, et la retrancha à l'orient de l'endroit où il l'avait passé, environ à treize cents pas du premier camp et un peu plus loin de celui des ennemis. Par cette disposition, il se mit à portée de soutenir ses fourrageurs, et d'inquiéter ceux des Carthaginois. Hannibal, prévoyant que cette manœuvre mènerait à une bataille générale, jugea prudemment que le dernier échec ne lui permettait pas de hasarder une action décisive, sans avoir relevé le courage de ses troupes. Les ayant donc fait assembler : " Carthaginois, leur dit-il, jetez les yeux sur tout le pays qui vous environne, et dites-moi, si les dieux vous donnaient le choix, ce que vous pourriez souhaiter de plus avantageux, supérieurs en cavalerie comme vous l'êtes, que de disputer l'empire du monde dans un pareil terrain ? " Tous convinrent, et la chose était évidente, qu'ils ne feraient pas un autre choix.
" Rendez donc, continua-t-il, rendez grâces aux dieux d'avoir amené ici les ennemis pour vous faire triompher d'eux. Sachez-moi gré aussi d'avoir réduit les Romains à la nécessité de combattre. Quelque favorable que soit pour nous le champ de bataille, il faut nécessairement qu'ils l'acceptent, ils ne peuvent plus l'éviter. Il ne me conviendrait pas de parler plus longtemps pour vous encourager à faire votre devoir. Cela était bon lorsque vous n'aviez point encore essayé vos forces avec les Romains, et j'eus soin alors de vous montrer, par une foule d'exemples, qu'ils n'étaient pas si formidables que l'on pensait. Mais après trois grandes victoires consécutives, que faut-il, pour exalter votre courage et vous inspirer de la confiance, que le souvenir de vos propres exploits? Par les combats précédents, vous vous êtes rendus maîtres du plat pays et de toutes les richesses qui y étaient. C'est ce que je vous avais promis d'abord et je vous ai tenu parole. Mais dans le combat d'aujourd'hui, il s'agit des villes et des richesses qu'elles contiennent. Si vous êtes vainqueurs, toute l'Italie passe sous le joug : plus de peines, plus de périls pour vous. La victoire vous met en possession de toutes les richesses des Romains, et assujettit toute la terre à votre domination. Combattons donc. Il n'est plus question de parler, il faut agir. J'espère de la protection des dieux, que vous verrez dans peu l'effet de mes promesses. " Ce discours fut accueilli par les applaudissements de toute l'assemblée, et Hannibal, après l'avoir louée de sa bonne volonté, la congédia.
Il campa aussitôt, et se retrancha sur le bord du fleuve où, était le plus grand camp des Romains. Le lendemain, il ordonna aux troupes de se reposer et de se tenir prêtes, et, le jour suivant, il rangea son armée en bataille sur le fleuve, comme s'il eût défié l'ennemi. Mais Emilius sentit le désavantage du terrain, et voyant d'ailleurs que la disette des vivres obligerait bientôt Hannibal à lever le camp, il ne s'ébranla pas, et se contenta de faire bien garder, ses deux camps. Hannibal resta quelque temps en bataille. Comme personne ne se présentait, il fit rentrer l'armée dans ses retranchements, et détacha les Numides contre ceux du plus petit camp, qui venaient à l'Aufide chercher de l'eau. Cette cavalerie passa jusqu'au retranchement même, et empêcha les Romains d'approcher de la rivière. Cela piqua Varron jusqu'au vif. Le soldat, qui n'avait pas moins d'ardeur de combattre, souffrait avec la dernière impatience que l'on différât, car l'homme, une fois déterminé à braver les plus grands périls pour parvenir à ce qu'il souhaite, ne souffre rien avec plus de chagrin que le retard de l'exécution.
Quand le bruit se répandit dans Rome, que les deux armées étaient en présence, et que chaque jour il se faisait des escarmouches, l'inquiétude et la crainte saisirent tous les esprits. Les défaites passées faisaient trembler pour l'avenir, et on prévenait par l'imagination tous les malheurs auxquels on serait exposé si on était vaincu. On n'entendit plus parler que des oracles prononcés sur Rome. Tous les temples, toutes les maisons particulières étaient pleines d'apparitions extraordinaires et de prodiges, pour lesquels on faisait des prières et des sacrifices aux dieux, car dans les calamités publiques, les Romains apportent un soin extrême à calmer la colère des dieux et des hommes, et de toutes les cérémonies prescrites pour ces sortes d'occasions, il n'en est aucune qu'ils refusent d'observer sous aucun prétexte, quelque basse et méprisable qu'elle paraisse.
Bataille de Cannes
Le lendemain, jour où Varron avait le commandement, ce consul, aussitôt que le jour commence à poindre, faisant porter devant lui ses faisceaux, fait sortir à la fois les troupes des deux camps. Il range en bataille celles du plus grand à mesure qu'elles traversent le fleuve. Les troupes du petit camp se joignent et s'alignent à l'autre, de manière que le front de bataille de l'armée soit tourné vers le midi. Il place la cavalerie romaine à l'aile droite, et l'appuie au fleuve même. L'infanterie se déploie près d'elle, sur un front égal, les manipules plus rapprochés l'un de l'autre ou les intervalles plus serrés qu'à l'ordinaire, et les manipules présentant plus de hauteur que de front. La cavalerie des alliés, à l'aile gauche, fermait la ligne, en avant de laquelle étaient postés les soldats légers. Il y avait dans cette armée, en comptant les alliés, quatre-vingt mille hommes de pied et un peu plus de six mille chevaux.
Hannibal, en même temps, fit passer l'Aufide aux frondeurs et aux troupes légères, et les posta devant l'armée. Le reste ayant passé la rivière par deux endroits, sur le bord à l'aile gauche, il mit la cavalerie espagnole et gauloise pour l'opposer à la cavalerie romaine, et ensuite, sur la même ligne, une moitié de l'infanterie africaine pesamment armée, l'infanterie espagnole et gauloise, l'autre moitié de l'infanterie africaine, et enfin la cavalerie numide qui formait l'aile droite. Après qu'il eut ainsi rangé toutes ces troupes sur une seule ligne, il marcha au-devant des ennemis avec l'infanterie espagnole et gauloise, qui se détacha du centre du corps de bataille, et comme elle était jointe en droite ligne avec le reste, en se séparant, elle forma comme le convexe d'un croissant, ce qui ôta au centre beaucoup de sa hauteur, le dessein du général étant de commencer le combat par des Espagnols et les Gaulois, et de les faire soutenir par les Africains.
Cette dernière infanterie était armée à la romaine, ayant été revêtue par Hannibal des armes qu'on avait prises sur les Romains dans les combats précédents. Les Espagnols et les Gaulois avaient le bouclier, mais leurs épées étaient fort différentes. Celle des premiers n'était pas moins propre à frapper d'estoc que de taille, au lieu que celle des Gaulois ne frappe que de taille, et à certaine distance. Ces troupes étaient rangées par sections alternativement, les Gaulois nus, les Espagnols couverts des chemises de lin couleur de pourpre, ce qui fut pour les Romains un spectacle extraordinaire qui les épouvanta. L'armée des Carthaginois était de dix mille chevaux, et d'un peu plus de quarante mille hommes de pied.
Emilius commandait à la droite des Romains, Varron à la gauche. Les deux consuls de l'année précédente, Servilius et Atilius étaient au centre. Du coté des Carthaginois, Hasdrubal avait sous ses ordres la gauche, Hannon la droite et Hannibal ayant avec lui Magon, son frère, s'était réservé le commandement du centre. Ces deux armées n'eurent rien à souffrir du soleil, lorsqu'il fut levé, l'une étant tournée au midi, comme je l'ai remarqué, et l'autre au septentrion.
L'action commença par les troupes légères, qui de part et d'autre étaient devant le front des deux armées. Ce premier choc ne donna aucun avantage à l'un ni à l'autre parti. Mais dès que la cavalerie espagnole et gauloise de la gauche se fut approchée, le combat s'échauffant, les Romains se battirent avec furie, et plutôt en Barbares qu'en Romains, car ce ne fut point tantôt en reculant, tantôt en revenant à la charge selon les lois de leur tactique. A peine en furent-ils venus aux mains, qu'ils sautèrent de cheval, et saisirent chacun son adversaire. Cependant les Carthaginois eurent le dessus. La plupart des Romains demeurèrent sur la place, après s'être défendus avec la dernière valeur. Le reste fut poursuivi le long du fleuve, et taillé en pièces sans pouvoir obtenir de quartier.
L'infanterie pesamment armée prit ensuite la place des troupes légères et en vint aux mains. Les Espagnols et les Gaulois tinrent ferme d'abord et soutinrent le choc avec vigueur, mais ils cédèrent bientôt à la pesanteur des légions, et, ouvrant le croissant, tournèrent le dos et se retirèrent. Les Romains les suivent avec impétuosité, et rompent d'autant plus aisément la ligne gauloise, qu'ils se serraient tous des ailes vers le centre où était le fort du combat, car toute la ligne ne combattit point en même temps, mais ce fut par le centre que commença l'action, parce que les Gaulois étant rangés en forme de croissant, laissèrent les ailes loin derrière eux, et présentèrent le convexe du croissant aux Romains. Ceux-ci suivent donc de près les Gaulois et les Espagnols, et, s'attroupant vers le milieu, à l'endroit où l'ennemi plia, poussèrent si fort en avant, qu'ils touchèrent des deux côtés les Africains pesamment armés. Les Africains de la droite, en faisant la conversion de droite à gauche, se trouvèrent tout le long du flanc de l'ennemi, aussi bien que ceux de la gauche qui la firent de gauche à droite, les circonstances même leur enseignant ce qu'ils avaient à faire. C'est ce qu'Hannibal avait prévu, que les Romains poursuivant les Gaulois ne manqueraient pas d'être enveloppés par les Africains. Les Romains alors, ne pouvant plus garder leurs rangs et leurs files, furent contraints de se défendre homme à homme et par petits corps contre ceux qui les attaquaient de front et de flanc.
Emilius avait échappé au carnage qui s'était fait à l'aile droite au commencement du combat. Voulant, selon la parole qu'il avait donnée, se trouver partout, et voyant que c'était l'infanterie légionnaire qui déciderait du sort de la bataille, il pousse à cheval au travers de la mêlée, écarte, tue tout ce qui se présente, et cherche en même temps à ranimer l'ardeur des soldats romains. Hannibal, qui pendant toute la bataille était resté dans la mêlée, faisait la même chose de son côté.
La cavalerie numide de l'aile droite, sans faire ni souffrir beaucoup, ne laissa pas d'être utile dans cette occasion par sa manière de combattre, car fondant de tous côtés sur les ennemis, elle leur donna assez à faire pour qu'ils n'eussent pas le temps de penser à secourir leurs gens, mais lorsque l'aile gauche, où commandait Hasdrubal, eut mis en déroute toute la cavalerie de l'aile droite des Romains, à un très petit nombre près, et qu'elle se fut jointe aux Numides, la cavalerie auxiliaire n'attendit pas qu'on tombât sur elle, et lâcha pied.
On dit qu'alors Hasdrubal fit une chose qui prouve sa prudence et son habileté, et qui contribua au succès de la bataille. Comme les Numides étaient en grand nombre, et que ces troupes ne sont jamais plus utiles que lorsqu'on fuit devant elles, il leur donna les fuyards à poursuivre, et mena la cavalerie espagnole et gauloise à la charge pour secourir l'infanterie africaine. Il fondit sur les Romains par les derrières, et, faisant charger sa cavalerie en troupes dans la mêlée par plusieurs endroits, il donna de nouvelles forces aux Africains et fit tomber les armes des mains des ennemis. Ce fut alors que L. Emilius, citoyen, qui pendant toute sa vie, ainsi que dans ce dernier combat, avait noblement rempli ses devoirs envers son pays, succomba enfin tout couvert de plaies mortelles.
Les Romains combattaient toujours, et, faisant front à ceux dont ils étaient environnés, ils résistèrent tant qu'ils purent, mais les troupes qui étaient à la circonférence, diminuant de plus en plus, ils furent enfin resserrés dans un cercle plus étroit, et passés tous au fil de l'épée. Atilius et Servilius, deux personnages d'une grande probité, et qui s'étaient signalés dans le combat en vrais Romains, furent aussi tués dans cette occasion.
Pendant le carnage qui se faisait au centre, les Numides poursuivirent les fuyards de l'aile gauche. La plupart furent taillés en pièces, d'autres furent jetés en bas de leurs chevaux ; quelques-uns se sauvèrent à Vénuse, du nombre desquels était Varron, le général romain, cet homme abominable dont la magistrature coûta si cher à sa patrie.
Ainsi finit la bataille de Cannes, bataille où l'on vit de part et d'autre des prodiges de valeur, comme il est aisé de le justifier.
De six mille chevaux dont la cavalerie romaine était composée, il ne se sauva à Vénuse que soixante-dix Romains avec Varron, et de la cavalerie auxiliaire il n'y eut qu'environ trois cents hommes qui se jetèrent dans différentes villes. Dix mille hommes de pied furent à la vérité faits prisonniers, mais ils n'étaient pas au combat. Il ne sortit de la mêlée pour se sauver dans les villes voisines qu'environ trois mille hommes. Tout le reste, au nombre de soixante-dix mille, mourut au champ d'honneur.
Les Carthaginois eurent la principale obligation de cette victoire, aussi bien que des précédentes, à leur cavalerie, et donnèrent par là à tous les peuples qui devaient naître après eux cette leçon éclatante, qu'en temps de guerre il vaut beaucoup mieux avoir moitié moins d'infanterie et être supérieur en cavalerie, que d'avoir des forces en tout égales à celles de son ennemi.
Hannibal perdit dans cette action environ quatre mille Gaulois, quinze cents Espagnols et Africains, et deux cents chevaux.
Je viens de dire que les dix mille hommes faits prisonniers n'étaient pas au combat. C'est que L. Emilius avait laissé dans son camp dix mille hommes de pied, afin que, si Hannibal menait à la bataille toute son armée sans laisser de garde à son camp, ce corps de réserve pût aller se jeter sur le bagage des ennemis ou que, si ce général, prévoyant l'avenir, détachait un corps de troupes pour garder son camp, il eût d'autant moins d'ennemis à combattre. Or, voici comment ces dix mille hommes furent faits prisonniers. Dès le commencement du combat, ils avaient été attaquer les Carthaginois qu'Hannibal avait laissés pour la garde du camp. Ceux-ci se défendirent, quoique avec assez de peine, mais quand la bataille fut entièrement terminée, ce général accourut au secours de ses gens, repoussa les Romains, et les enveloppa dans leur propre camp. Deux mille chevaux qui avaient pris la fuite et s'étaient retirés dans les forteresses répandues dans le pays eurent le même sort. Forcés dans leurs postes par les Numides, ils furent tous emmenés prisonniers.
Après cette victoire, les affaires prirent l'aspect qu'on s'attendait leur voir prendre dans les deux partis. Elle rendit les Carthaginois maîtres de presque toute cette partie de l'Italie qu'on appelle l'ancienne et la grande Grèce. Les Tarentins se rendirent d'abord. Les Argyripains et quelques peuples de la Campanie appelèrent Hannibal chez eux. Tous les autres inclinaient déjà à se livrer aux Carthaginois, qui de leur côté n'espéraient rien moins que de prendre Rome d'emblée. Les Romains ne crurent pas seulement alors avoir perdu sans ressource l'empire d'Italie, ils tremblaient pour eux-mêmes et pour leur patrie, dans la pensée qu'Hannibal viendrait incessamment à Rome. La fortune même sembla en quelque sorte vouloir mettre le comble au malheur des Romains, et disputer à Hannibal la gloire de les détruire. À peine avait-on appris à Rome la défaite de Cannes, qu'on y reçut la nouvelle que le préteur envoyé dans la Gaule Cisalpine y était malheureusement tombé dans une embuscade, et que son armée y avait été tout entière taillée en pièces par les Gaulois.
Tous ces coups n'empêchèrent pas le Sénat de prendre toutes les mesures possibles pour sauver l'Etat. Il releva le courage du peuple, il pourvut à la sûreté de la ville, il délibéra dans la conjoncture présente avec courage et avec fermeté, la suite le fit bien connaître. Quoique alors il fût notoire que les Romains étaient vaincus et obligés de renoncer à la gloire des armées, cependant la forme même du gouvernement, et les sages conseils du Sénat, non seulement les ont remis en possession de l'Italie par la défaite des Carthaginois, mais leur ont encore en peu de temps assujetti toute la terre. C'est pourquoi, lorsque après avoir rapporté dans ce livre-ci toutes les guerres qui se sont faites en Espagne et en Italie pendant la cent quarantième olympiade, et dans le suivant tout ce qui s'est passé en Grèce pendant cette même olympiade, nous serons arrivés à notre époque, nous ferons alors un livre particulier sur la forme du gouvernement romain. C'est un devoir dont je ne puis me dispenser sans ôter à l'histoire une des parties qui lui convient le plus, mais j'y suis encore porté par l'utilité qu'en tireront les personnes constituées en autorité ou pour réformer des Etats déjà établis, ou pour en établir de nouveaux.