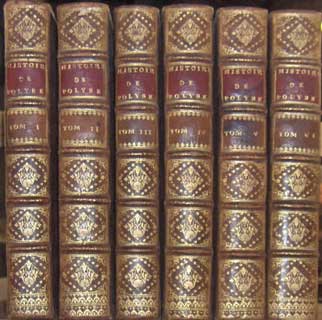
POLYBE
HISTOIRE GÉNÉRALE
TOME PREMIER : LIVRE IΙ.
Traduction française : Pierre WALTZ.
autres traductions : Thuillier - Bouchot
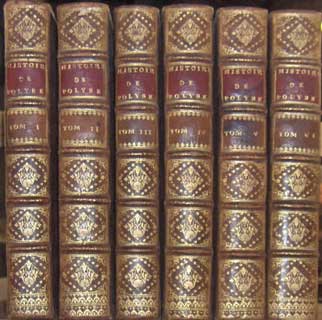
autres traductions : Thuillier - Bouchot
HISTOIRE GÉNÉRALE.
LIVRE II.
.
[2,1] Dans le livre précédent, nous avons vu à quelle époque les Romains, maîtres de l'Italie, commencèrent à étendre leur domination au dehors ; comment ils passèrent en Sicile et pourquoi ils déclarèrent la guerre aux Carthaginois à propos de cette île ; quand ils organisèrent leur première armée navale ; enfin par quelles alternatives passèrent les deux pays au cours de toute cette guerre, qui eut comme conclusion pour Carthage la perte de toutes ses possessions en Sicile et pour Rome la conquête de toute l'île, à l'exception des territoires placés sous l'autorité de Hiéron. J'ai montré ensuite comment le soulèvement des mercenaires alluma la guerre dite d'Afrique ; quels excès furent commis au cours de cette lutte épouvantable et après quelles vicissitudes elle aboutit à la victoire des Carthaginois. Je vais maintenant exposer les événements qui suivirent, mais en me bornant à les passer brièvement en revue, comme je me le suis proposé en commençant. Dès que l'Afrique fut pacifiée, les Carthaginois envoyèrent Hamilcar en Espagne à la tête d'une armée. Il prit avec lui son fils Hannibal, alors âgé de neuf ans, passa les Colonnes d'Hercule et rétablit la domination de son pays dans la péninsule. Il y séjourna environ neuf ans, obtint la soumission d'un grand nombre de tribus indigènes, soit par la force, soit à l'amiable, et trouva une fin digne de ses exploits antérieurs : c'est dans une rencontre avec des troupes très nombreuses et des plus vaillantes qu'il mourut, en accomplissant des prodiges de courage et de valeur. On lui donna pour successeur Hasdrubal, son gendre et le commandant de sa flotte. [2,2] Vers la même époque, les Romains entrèrent en Illyrie ; c'était leur première expédition dans cette partie de l'Europe. Il faut insister sur cet événement et l'examiner avec attention, si l'on veut bien comprendre comment s'est développée et établie la puissance romaine, ce qui fait l'objet de notre étude. Voici quels furent les motifs qui les déterminèrent à cette action. Agron, roi d'Illyrie et fils de Pleuratos, possédait sur terre et sur mer des forces plus considérables que n'en avaient eu tous ses prédécesseurs. Démétrios, père de Philippe {de Macédoine}, avait obtenu de lui à prix d'argent qu'il portât secours aux habitants de Médione, que les Étoliens assiégeaient. N'ayant jamais pu les décider à entrer dans leur confédération, les Étoliens essayaient de prendre leur ville de vive force ; ils avaient fait une levée générale et investi la ville, qui depuis était sans cesse en butte à leurs assauts et aux coups de leurs machines. Les assiégés étaient réduits à la dernière extrêmité et l'on croyait chaque jour qu'ils allaient se rendre, lorsque le stratège des Étoliens, qui voyait arriver la fin de sa magistrature, déclara que, puisqu'il avait eu à supporter toutes les fatigues et tous les dangers du siège, le soin de répartir le butin qu'on ferait en prenant la ville lui revenait de droit, ainsi que l'inscription de son nom sur le trophée qui commémorerait la victoire. Quelques-uns de ses compagnons, et surtout ceux qui aspiraient à sa succession, combattirent sa motion et engagèrent le peuple à ne prendre aucune résolution, à ne pas trancher la question, mais à s'en remettre au sort pour savoir à qui cette distinction devait appartenir. Les Étoliens décidèrent toutefois que le commandant qui s'emparerait de la place partagerait avec son prédécesseur le soin d'administrer le butin et l'honneur d'avoir son nom inscrit sur le monument commémoratif. [2,3] L'élection du nouveau magistrat et son entrée en fonctions devaient légalement avoir lieu le lendemain. Pendant la nuit, cent embarcations, montées par cinq mille Illyriens, vinrent aborder sur le territoire de Médione, dans le voisinage immédiat de la place. Ils débarquèrent vivement et sans bruit au petit jour, se groupèrent en bataillons selon la tactique ordinaire de leur pays et marchèrent sur le camp des Étoliens. Ces derniers furent d'abord déconcertés par la soudaineté et la hardiesse de l'attaque; mais ils avaient depuis longtemps une si bonne opinion d'eux-mêmes et une si grande confiance dans leurs propres forces qu'ils eurent bientôt repris courage. Ils rangèrent devant le camp, en terrain plat, la majeure partie de leur cavalerie et de leurs hoplites ; le reste de la cavalerie et l'infanterie légère eut pour mission d'aller occuper, également en avant du camp, quelques points d'où l'on avait l'avantage de dominer l'adversaire. Les Illyriens coururent sus à ces fantassins, qui, accablés sous le nombre et le poids de l'armée ennemie, lâchèrent pied au premier choc ; quant aux cavaliers qui se trouvaient avec eux, ils furent obligés de se replier sur les hoplites. Les Illyriens occupèrent les hauteurs et, fondant de là sur les Étoliens rangés dans la plaine, les mirent en fuite ; ce succès fut d'ailleurs facilité par la coopération des assiégés, qui avaient fait en même temps une sortie. Beaucoup d'Étoliens furent tués, plus encore faits prisonniers ; ils perdirent en outre leurs armes et tout leur matériel. Après avoir ainsi exécuté les ordres de leur roi, les Illyriens chargèrent sur leurs embarcations les bagages des Étoliens et le reste du butin ; puis ils retournèrent dans leur pays. [2,4] Les habitants de Médione, sauvés contre toute espérance, se réunirent en assemblée, délibérèrent sur diverses questions et notamment sur les noms à inscrire au trophée ; ils adoptèrent, pour leur compte, la mesure qu'avaient décrétée leurs ennemis, d'y graver non seulement le nom du magistrat étolien en charge, mais encore celui des candidats à sa succession. Il semble que le Destin ait voulu, par cet exemple, montrer sa puissance à tous les hommes : la honte que les assiégés craignaient de subir, c'est eux qui aussitôt après l'infligent à leurs adversaires ; et le revers inattendu des Étoliens nous apprend à ne jamais disposer de l'avenir comme s'il était déjà réalisé, à ne pas compter trop fermement sur un résultat qui peut encore nous échapper, à ne pas oublier que nous sommes des hommes et que nous sommes toujours, mais surtout en cas de guerre, exposés à quelque accident imprévu. Le roi Agron, au retour de sa flotte, apprit de ses officiers la nouvelle de la victoire ; tout à la joie d'avoir rabaissé l'immense orgueil des Étoliens, il s'adonna à la boisson et à d'autres plaisirs du même genre, et fut atteint d'une pleurésie qui l'emporta en quelques jours. Sa femme Teuta, qui lui succéda, confia à ses amis la direction des affaires ; mais, avec une présomption toute féminine, elle se laissa enivrer par le triomphe remporté en Étolie et, sans égards pour ses voisins, permit à ses sujets de se livrer partout à la piraterie ; puis elle leva une nouvelle armée navale aussi considérable que la précédente et autorisa ses généraux à porter leurs armes dans n'importe quel pays. [2,5] Les officiers commencèrent par s'attaquer à l'Élide et à la Messénie. Les Illyriens ne cessaient pas d'exercer des ravages dans ces deux contrées : les côtes en étant fort étendues et les grands centres militaires très avant dans l'intérieur, les secours venaient de trop loin et arrivaient trop lentement pour empêcher les descentes des Illyriens ; aussi faisaient-ils de fréquentes incursions et mettaient-ils le pays au pillage sans être inquiétés. Ils abordèrent un jour à Phénice en Épire, pour s'y procurer des vivres ; ils s'abouchèrent avec quelques Gaulois à la solde des Épirotes, qui tenaient garnison au nombre d'environ huit cents, complotèrent avec eux pour se faire livrer la place, débarquèrent et, avec la complicité des Gaulois, s'emparèrent au premier assaut de la ville et de tout ce qui s'y trouvait. A cette nouvelle, les Épirotes accourent en masse au secours de Phénice ; ils arrivent devant la place, campent le long de la rivière qui l'arrose et pour plus de sûreté enlèvent le tablier du pont qui était jeté d'une rive à l'autre. Avertis que cinq mille Illyriens, sous les ordres d'un certain Skerdilaïdas, arrivaient par terre en traversant les défilés d'Antigonée, ils envoient un détachement défendre cette place ; le reste des troupes continuait à couler des jours paisibles, jouissait largement des ressources du pays et négligeait complètement de monter la garde. Les Illyriens, apprenant que les Épirotes avaient divisé leurs forces et que leur camp était mal gardé, se mettent en marche pendant la nuit, jettent quelques planches sur le pont, passent la rivière sans la moindre alerte, occupent une forte position et y restent jusqu'au jour. Quand il paraît, les deux armées se rangent devant la ville ; les Épirotes sont vaincus ; beaucoup d'entre eux sont tués, un plus grand nombre encore faits prisonniers ; les autres s'enfuirent chez les Atintaniens. [2,6] Après cette défaite, ils perdirent tout espoir de se tirer d'affaire par eux-mêmes ; ils envoyèrent alors des ambassades aux Étoliens et aux Achéens, pour les supplier de venir à leur aide. On eut pitié de leur détresse, et une armée de secours s'avança jusqu'à Hélicranon. La garnison de Phénice marcha contre elle sous la conduite de Skerdilaïdas, prit position tout près de l'ennemi et se prépara au combat. Mais le terrain ne s'y prêtait guère ; en outre, il arriva une lettre de Teuta, qui donnait l'ordre de revenir au plus tôt, parce qu'une partie de l'Illyrie faisait défection et passait du côté des Dardaniens. C'est ainsi qu'après avoir dévasté l'Épire les envahisseurs conclurent une trêve avec les Épirotes : ils leur restituèrent, moyennant rançon, les prisonniers de condition libre et la ville qu'ils avaient occupée ; quant aux esclaves, ils les chargèrent sur leurs embarcations, ainsi que le reste du butin ; puis ils s'en retournèrent, les uns par mer, le corps de Skerdilaïdas par terre, en repassant par les défilés d'Antigonée. Cette aventure répandit une terreur extraordinaire parmi les Grecs de la côte : en voyant la place la plus forte et la plus puissante de toute l'Épire emportée d'une façon aussi imprévue, ils ne craignirent plus seulement, comme autrefois, pour leurs campagnes, mais pour eux-mêmes et pour leurs villes. Les Épirotes, délivrés de cette invasion contre toute attente, songèrent si peu à se venger de leurs ennemis ou à témoigner quelque reconnaissance à leurs sauveurs qu'ils envoyèrent une ambassade à Teuta et conclurent une alliance avec les Illyriens, en même temps que les Acarnaniens ; en vertu de ce traité, ils prêtèrent désormais leur appui à l'Illyrie contre l'Achaïe et l'Étolie. De même qu'ils avaient montré une entière incapacité dans la défense de leur pays, ils faisaient preuve d'une ingratitude stupide à l'égard de leurs bienfaiteurs. [2,7] Quand nous tombons, chétifs mortels, dans des malheurs que nous ne pouvions prévoir, ce n'est pas nous qu'on en rend responsables : c'est le hasard, ce sont nos agresseurs ; mais si nous allons nous jeter par sottise dans un danger manifeste, c'est à nous-mêmes que tout le monde imputera notre infortune. Ceux qu'atteint un coup du sort inspirent de la pitié, on leur trouve des excuses, on vient à leur aide ; mais ceux qui ressentent les effets de leur propre imprudence ne s'attirent que le blâme et les critiques sévères des gens sensés. Telle fut la réputation méritée que les Épirotes se firent alors chez les Grecs. Comment pouvait-on, d'abord, ne pas se méfier des Gaulois, dont le fâcheux renom était universel ? Comment ne pas craindre de tenter leur cupidité et leur mauvaise foi en leur confiant la garde d'une ville aussi opulente ? Comment pouvait-on, en particulier, ne pas suspecter les intentions de cette bande de gens qui avaient été chassés de leur pays par leurs compatriotes pour des crimes commis envers leurs amis ou leurs parents? qui, après avoir fait accepter leurs services par les Carthaginois aux prises avec la guerre et ses ennuis, avaient — au nombre de plus de trois mille — saisi l'occasion d'une sédition militaire, éclatant à propos des soldes, pour mettre à sac Agrigente, dont on leur avait confié la garde? qui, chargés de défendre Éryx contre les Romains, avaient tenté vainement de livrer aux assiégeants la ville et ses habitants, puis étaient passés à l'ennemi? qui, abusant de la confiance des Romains, avaient pillé le temple d'Aphrodite Érycine? qui, dès la fin de la première guerre punique, avaient été reconnus par les Romains comme des gens sans aveu, dépouillés immédiatement de leurs armes, embarqués sur des bateaux et expulsés de toute l'Italie? Et c'est de pareils individus que les Épirotes allaient instituer les gardiens de leur république et de leur indépendance? c'est en de telles mains qu'ils remettaient une ville aussi riche ? Comment ne pas les considérer comme les auteurs de leurs propres maux ? Telles sont les réflexions que j'ai cru à propos de faire sur l'aveuglement des Épirotes; leur histoire nous montre qu'il ne faut jamais commettre l'imprudence d'introduire dans une place une garnison trop considérable, surtout si elle est composée de barbares. [2,8] Il y avait longtemps que les Illyriens ne cessaient pas leurs vexations contre les navigateurs italiens ; mais, lorsqu'ils occupèrent Phénice, ce fut en très grand nombre que les marchands italiens furent pillés, égorgés ou emmenés prisonniers par les bâtiments détachés de la flotte illyrienne. Le Sénat ne tint d'abord pas grand compte des plaintes que l'on portait contre ces pirates ; mais, comme elles se faisaient de plus en plus fréquentes, il donna mission à C. et à L. Coruncanius d'aller en Illyrie procéder à une enquête. Au retour de l'expédition d'Épire, Teuta avait vivement admiré l'abondance et la richesse des dépouilles qu'on lui rapportait ; Phénice était en effet, à cette époque, la ville la plus florissante de l'Épire. La reine sentit donc redoubler son ardeur agressive contre les Grecs. Elle fut retenue quelque temps par des troubles intérieurs ; mais dès qu'elle eut soumis ses sujets révoltés, elle mit le siège devant Issa, la seule place qui persistât à ne pas se rendre. C'est dans ces conjonctures qu'arrivèrent les ambassadeurs romains. Teuta leur donna audience, et ils se plaignirent des torts qu'ils avaient subis. La reine les écouta, en affectant un air de fierté et de hauteur, exposer toutes leurs doléances. Quand ils eurent fini, elle répondit qu'elle prendrait ses mesures pour que les Romains n'eussent pas à se plaindre de son gouvernement, mais qu'il n'était pas d'usage, chez les rois d'Illyrie, d'interdire à leurs sujets le métier de corsaire et ses bénéfices. Le plus jeune des deux ambassadeurs, irrité par ses paroles, répliqua avec une liberté louable en soi, mais déplacée dans la circonstance : « Chez nous, Teuta, s'écria-t-il, il existe une fort belle instutition : c'est l'État qui punit les crimes des particuliers et qui vient en aide à leurs victimes ; avec l'aide des dieux, nous mettrons ordre, et sans tarder, à ce que vous réformiez les usages du royaume d'Illyrie. » La reine accueillit cette franche déclaration avec une impatience toute féminine ; elle s'en irrita au point d'oublier le droit des gens, de lancer ses satellites à la poursuite des ambassadeurs qui repartaient et de faire tuer l'auteur de l'offense. La nouvelle de cet attentat indigna les Romains, qui firent aussitôt des préparatifs de guerre, levèrent une armée et équipèrent une flotte. [2,9] Au début du printemps, Teuta fit construire des embarcations en nombre encore plus considérable et envoya de nouveau ses soldats exercer leurs ravages aux dépens des Grecs. Les uns mirent le cap directement sur Corcyre ; les autres vinrent mouiller à Épidamne, sous prétexte de s'approvisionner d'eau et de vivres, mais en réalité pour essayer de surprendre la ville. Les Épidamniens eurent la naïveté de les laisser entrer sans prendre aucune précaution ; ils débarquent, munis de pots, les habits retroussés, comme pour aller puiser de l'eau ; mais dans leurs pots ils avaient des poignards ; ils arrivent aux portes, égorgent les sentinelles et se rendent aisément maîtres de l'entrée. Des renforts leur furent aussitôt envoyés des navires, comme il était convenu, si bien qu'ils purent sans aucune peine occuper la plus grande partie des murailles. Les habitants, pris au dépourvu par la brusquerie de l'attaque, se défendirent toutefois avec une telle vaillance que les Illyriens finirent, après une lutte acharnée, par être obligés de se retirer. La négligence des Épidamniens faillit, dans cette affaire, causer la ruine de leur patrie; mais, grâce à leur courage, la leçon qu'ils en tirèrent pour l'avenir ne leur coûta rien. Quant aux Illyriens, ils se rembarquèrent en toute hâte, rejoignirent ceux qui les avaient devancés et cinglèrent vers Corcyre. Ils débarquèrent à l'improviste et entreprirent d'assiéger la capitale. Les Corcyréens, ne sachant que faire et jugeant leur situation désespérée, implorèrent l'assistance des Achéens et des Étoliens ; leurs envoyés se rencontrèrent avec ceux d'Épidamne et d'Apollonie, qui venaient demander qu'on leur portât secours au plus vite et qu'on ne les laissât pas dépouiller par les Illyriens. Ces suppliques furent accueillies favorablement ; on équipa les dix vaisseaux pontés des Achéens, qui furent prêts au bout de quelques jours, et l'escadre partit pour Corcyre, dont elle espérait faire lever le siège. [2,10] Les Illyriens, à qui les Acarnaniens, conformément à leur traité d'alliance, avaient envoyé sept vaisseaux pontés, se portèrent à la rencontre des Achéens et leur livrèrent bataille près des îles Paxos. Les Acarnaniens et ceux des Achéens qui leur faisaient face se battirent sans résultat et se retirèrent sans autre dommage que quelques hommes blessés. Les Illyriens, eux, avaient attaché leurs bateaux quatre par quatre et engageaient le combat, sans paraître se soucier de leur sécurité, prêtant même le flanc comme à plaisir aux attaques de l'ennemi. Les navires achéens y enfoncèrent leurs éperons et restèrent accrochés, sans pouvoir s'en dégager, à ces embarcations liées ensemble ; voyant leurs adversaires dans cet embarras, les Illyriens sautent alors sur le pont des vaisseaux grecs et s'en rendent maîtres grâce à leur supériorité numérique. Ils s'emparèrent ainsi de quatre vaisseaux à quatre rangs de rames; un autre, à cinq rangs, fut coulé avec tout son équipage; c'était celui que montait Margos de Cérynée, citoyen d'Achaïe qui, jusqu'à cette journée fatale, avait toujours bien rempli ses devoirs envers sa patrie. La division opposée aux Acarnaniens, s'apercevant que les Illyriens avaient l'avantage, se fia à la rapidité de sa course et profita d'un vent favorable pour battre en retraite sans encombre. L'armée illyrienne, encouragée par sa victoire, mena le siège avec une vigueur qui en facilita le succès. Les Corcyréens au contraire en perdirent toute espérance ; ils résistèrent encore quelque temps, puis capitulèrent et reçurent une garnison commandée par Démétrios de Pharos. Après quoi, les Illyriens se retirèrent, retournèrent à Épidamne et en recommencèrent le siège. [2,11] C'est à ce moment que les deux consuls partirent de Rome, l'un, Cn. Fulvius, avec deux cents vaisseaux, l'autre, A. Postumius, à la tête de l'armée de terre. L'intention de Fulvius était de se rendre d'abord à Corcyre, où il espérait arriver avant que la ville se fût rendue ; mais il n'en eut pas le temps ; il se dirigea tout de même vers Corcyre, à la fois pour savoir au juste ce qui s'y était passé et pour éprouver la sincérité des promesses faites par Démétrios. Cet officier, en effet, avait été calomnié auprès de Teuta et craignait sa colère ; aussi s'était-il abouché avec les Romains, s'engageant à leur livrer la place et tout ce qu'il avait à sa disposition. Les Corcyréens furent heureux de voir arriver les Romains ; de connivence avec Démétrios, ils leur livrèrent la garnison illyrienne et, d'un accord unanime, se placèrent sous le protectorat de Rome, persuadés que c'était le seul moyen de n'être plus exposés désormais aux coups de main des Illyriens. Les Romains acceptèrent l'alliance que Corcyre leur offrait et cinglèrent de là vers Apollonie, emmenant avec eux Démétrios, dont on devait prendre l'avis pour la suite des opérations. En même temps, Postumius partait de Brindes et faisait transporter par mer ses troupes, qui comprenaient vingt mille fantassins et environ deux mille cavaliers. Les deux armées abordèrent ensemble à Apollonie ; dont les habitants firent également bon accueil aux Romains et s'en remirent à leur discrétion ; puis ils repartirent aussitôt pour Épidamne, qui, leur disait-on, était assiégée. A la nouvelle de leur approche, les Illyriens lèvent le siège et prennent la fuite en désordre. Les Romains prennent encore Épidamne sous leur tutelle et s'avancent dans l'intérieur de l' Illyrie; en passant, ils soumettent les Ardiéens. Un grand nombre de tribus, entre autres les Parthéniens et les Atintaniens, leur envoyèrent des ambassadeurs pour offrir Ieur soumission, qui fut acceptée. Les Romains marchèrent alors sur Issa, que les Illyriens assiégeaient. Ils arrivent, font lever le siège et prennent également Issa sous leur protection. Puis, en longeant la côte, ils emportèrent de vive force quelques places illyriennes, notamment Nutria, où ils perdirent, outre un assez grand nombre de soldats, plusieurs tribuns et le questeur. Ils s'emparèrent aussi de vingt bateaux chargés de butin. Parmi les assiégeants d'Issa, les uns furent épargnés grâce à l'intervention de Démétrios et demeurèrent dans l'île de Pharos ; tous les autres furent dispersés et s'enfuirent à Arbon. Teuta se sauva avec une poignée d'hommes à Rhizon, petite ville bien fortifiée, éloignée de la mer et arrosée par la rivière du même nom. Après avoir ainsi augmenté la puissance de Démétrios et le nombre de ses sujets, les consuls se retirèrent à Épidamne avec leur flotte et leurs troupes de terre. [2,12] Cn. Fulvius rentra à Rome avec la plus grande partie des deux armées ; Postumius, resté en Illyrie avec quarante bâtiments, fit une levée dans les villes voisines et prit ses quartiers d'hiver, de façon à pouvoir défendre les Ardiéens et les autres peuplades qui s'étaient rangées sous l'autorité de Rome. Au retour du printemps, Teuta, par l'intermédiaire d'une ambassade, fit la paix avec Rome aux conditions suivantes : elle s'engageait à payer le tribut qui lui serait imposé, à céder toute l'Illyrie à l'exception de quelques points, enfin — ce qui était capital pour les Grecs — à ne pas mettre en mer au Sud du Lissos plus de deux bâtiments, d'ailleurs non armés. Le traité conclu, Postumius envoya aux Étoliens et aux Achéens des ambassadeurs, qui leur firent connaître les causes de la guerre et de l'intervention de Rome en Illyrie, les informèrent de tout ce qui s'était passé et leur lurent le texte des conventions passées avec les Illyriens. Ils reçurent chez ces deux peuples un excellent accueil, puis s'en retournèrent à Corcyre. Les clauses du traité délivraient les Grecs d'une grande crainte ; car ce n'était pas de telle ou telle cité, mais de toute la nation que les Illyriens étaient les ennemis. Voilà l'histoire de la première expédition des Romains en Illyrie et dans cette partie de l'Europe ; telle fut l'origine de leurs relations diplomatiques avec la Grèce. Ils eurent bientôt après l'occasion d'envoyer encore des ambassadeurs à Corinthe et à Athènes ; ce fut en cette circonstance que les Corinthiens les admirent pour la première fois à prendre part aux jeux isthmiques. [2,13] Nous avions laissé Hasdrubal, à la même époque, chargé du gouvernement de l'Espagne. Il s'y conduisit avec intelligence et habileté ; parmi les grands services qu'il rendit à sa patrie, l'un des plus importants et des plus précieux fut la fondation de la ville de Carthagène ou Ville-Neuve ; c'est, notamment, une position stratégique de premier ordre pour des opérations à faire soit en Espagne, soit en Afrique; mais je trouverai une meilleure occasion de décrire sa situation et les avantages qu'elle peut offrir pour un pays comme pour l'autre. Quand les Romains virent quelle puissance il avait acquise, ils s'inquiétèrent et se mirent à s'occuper plus activement de l'Espagne ; se reprochant d'être restés comme endormis jusqu'alors et d'avoir laissé Carthage étendre sa domination, ils firent tous leurs efforts pour réparer cette faute. Sur le moment, ils hésitèrent pourtant à parler trop haut ou à déclarer la guerre aux Carthaginois, parce qu'ils redoutaient une invasion des Gaulois, qui menaçait et qu'on attendait presque de jour en jour. Ils trouvèrent qu'il valait mieux flatter et amadouer Hasdrubal, tandis qu'ils attaqueraient les Gaulois et chercheraient à s'en débarrasser ; car il leur serait impossible, pensaient-ils, non seulement d'être maîtres de l'Italie, mais de vivre paisiblement dans leur patrie, tant qu'ils sentiraient ces ennemis prêts à fondre sur eux. Ils envoyèrent donc des ambassadeurs à Hasdrubal et conclurent avec lui une convention, qui, sans faire mention du reste de l'Espagne, interdisait aux Carthaginois de porter leurs armes au delà de l'Èbre. Puis ils partirent en guerre contre les Gaulois d'Italie. [2,14] Il me paraît utile, pour me conformer au plan que je me suis tracé dès le début de mon préambule, de résumer succinctement l'histoire de ce peuple, en remontant jusqu'à l'époque où il s'était emparé des territoires qu'il occupait. Je considère en effet non seulement que ces événements sont dignes d'être connus et retenus, mais que cet exposé est absolument indispensable pour apprendre dans quelle contrée Hannibal osa se lancer et à quels hommes il dut se fier, quand il entreprit de détruire l'empire de Rome. Il faut indiquer d'abord quel était leur pays et comment il est situé par rapport au reste de l'Italie ; on comprendra beaucoup mieux, après cette description, ce qu'il y eut d'extraordinaire dans les actions qui s'y sont déroulées. L'Italie, considérée dans son ensemble, a la forme d'un triangle, dont un côté, tourné vers l'Orient, est baigné par la mer Ionienne et le golfe Adriatique, qui lui fait suite, et l'autre, qui regarde le midi et l'Occident, par la mer de Sicile et la mer Tyrrhénienne. Ces deux lignes se rejoignent pour former le sommet du triangle, c'est-à-dire le promontoire qui termine l'Italie au Sud, le cap Cocynthos, qui sépare la mer Ionienne de la mer de Sicile. Le côté septentrional du triangle, situé vers l'intérièur des terres, est constitué par la chaîne des Alpes, qui s'étend sans interruption depuis Marseille et la rive de la mer de Sardaigne opposée à la nôtre jusqu'au fond du golfe Adriatique ; il n'y a qu'un petit espace que la montagne n'occupe pas, parce qu'elle cesse avant d'atteindre la mer. C'est depuis le pied de ce massif = qu'il faut considérer comme la base du triangle — que se déroule vers le midi la plaine qui occupe toute la partie septentrionale de l'Italie et dont nous avons à parler maintenant. Cette plaine est la plus fertile et la plus vaste qu'il y ait en Europe, à ma connaissance ; le tracé de ses limites constitue encore un triangle, dont le sommet est formé par la jonction des Alpes et de l'Apennin, située non loin de la mer de Sardaigne, au-dessus de Marseille. Du côté du nord, elle est, comme je l'ai déjà dit, bornée par les Alpes sur une étendue de deux mille deux cents stades et, au midi, par l'Apennin sur trois mille six cents. La base du triangle est formée par la côte de l'Adriatique ; la longueur en est, depuis la ville de Séna jusqu'au fond du golfe, de plus de deux mille cinq cents stades ; de sorte que le périmètre tout entier ne mesure pas beaucoup moins de dix mille stades. [2,15] Ce pays est d'une fertilité inimaginable. Il pro- duit des céréales en si grande abondance qu'on y a vu souvent, de notre temps, le médimne sicilien de blé à quatre oboles, le médimne d'orge à deux et le métrète de vin au même prix que le médimne d'orge. Le mil et le millet des oiseaux y poussent avec une abondance tout à fait extraordinaire. Les bois de chênes répandus dans la plaine produisent une quantité de glands dont le fait suivant donnera une idée : quoique la consommation des porcs soit très forte dans toute l'Italie, soit chez les particuliers, soit pour les approvisionnements militaires, c'est cette région qui fournit le plus grand nombre de ces animaux. Combien la vie y est plantureuse et peu coûteuse, voici qui le fera très bien comprendre: dans les auberges, les voyageurs ne demandent pas quel est le prix de chaque plat, mais combien par tête ; et d'ordinaire les hôteliers leur donnent en quantité suffisante tout ce dont ils ont besoin moyennant la moitié d'un as, ce qui fait le quart d'une obole ; il est rare qu'ils prennent davantage. La population est nombreuse, les hommes grands, beaux, braves à la guerre ; mais tout cela, c'est par le récit de leurs actions qu'on le verra le plus clairement. Sur les deux versants des Alpes, dont l'un est tourné vers le Rhône et l'autre vers la plaine en question, il y a des collines et des vallées habitées les unes, au nord, par les Gaulois Transalpins, les autres, du côté de la plaine, par les Taurisques, les Agons et diverses autres tribus barbares. Les Transalpins portent ce nom spécial, non parce qu'ils sont d'une autre race, mais parce qu'ils occupent un pays différent ; "trans", en effet, signifie au delà ; c'est pour cela qu'on appelle Transalpins les Gaulois qui demeurent au delà des Alpes. Quant aux sommets, leur abord difficile et l'abondance des neiges éternelles les rendent absolument inhabitables. [2,16] L'Apennin, depuis son origine, c'est-à-dire depuis sa jonction avec les Alpes, au-dessus de Marseille, est habité par les Ligures, aussi bien sur le flanc qui regarde la mer Tyrrhénienne que sur celui qui fait face à la plaine; leur pays s'étend, sur le versant maritime, jusqu'à Pise, la première ville d'Étrurie du côté de l'Ouest ; sur le versant continental, jusqu'au territoire d'Arrétium. Puis vient l'Étrurie, et ensuite l'Ombrie, qui occupe les deux versants de la chaîne. Au delà, l'Apennin, parvenu à cinq cents stades environ des côtes de l'Adriatique, s'infléchit vers la droite, s'éloigne de la plaine, traverse par le centre tout le reste de l'Italie et vient aboutir à la mer de Sicile ; cette plaine dont il s'écarte s'étend jusqu'à la mer et à la ville de Séna. Le Pô, si souvent chanté par les poètes sous le nom d'Éridan, prend sa source dans les Alpes, à peu près au sommet de notre triangle ; il descend dans la plaine en se dirigeant vers le Midi ; puis, quand il y est parvenu, son cours se détourne vers l'Orient: il la traverse tout entière et va se jeter par deux embouchures dans l'Adriatique ; il divise la plaine en deux parties, dont la plus considérable est celle qui confine aux Alpes et au fond du golfe. Aucun autre fleuve d'Italie ne roule autant d'eau que lui ; cela tient à ce qu'il recueille toutes celles qui coulent des Alpes ou de l'Apennin vers la plaine. Son cours est très abondant et très beau, surtout vers l'époque du lever de Sirius, au moment où la fonte des neiges dans ces montagnes le grossit considérablement. Il est navigable, en remontant par la bouche nommée Olana, jusqu'à près de deux mille stades de la mer. Il n'a d'abord qu'un lit, depuis sa source jusqu'au pays des Trigaboles, où il se divise en deux branches, dont les embouchures s'appellent l'une Padoa, l'autre Olana ; sur cette dernière se trouve un port, le plus sûr de tous les mouillages de l'Adriatique. Le Pô porte, chez les naturels, le nom de Bodincus. Quant à toutes les fables que les Grecs racontent sur ce fleuve, à la légende de Phaéthon et de sa chute, aux larmes des peupliers, aux peuples riverains vêtus de noir qui, dit-on, portent encore le deuil de Phaéthon, à toutes ces histoires tragiques et à d'autres du même genre, je n'en parle pas pour le moment ; une étude approfondie de pareilles questions ne serait pas à sa place dans mon préambule. Plus loin, je retrouverai une meilleure occasion d'y insister comme il convient, ne fût-ce que pour montrer l'ignorance de Timée sur cette contrée. [2,17] Cette plaine était autrefois habitée par les Étrusques, qui à la même époque occupaient également les environs de Capoue et de Noles, qu'on appelle les Champs Phlégréens ; cette région est d'un accès facile pour tous ses voisins, de sorte qu'elle est bien connue et très célèbre pour tous ses avantages. Aussi, quand on étudie l'histoire de l'Étrurie et de son empire, faut-il entendre par là non pas le territoire que les Étrusques occupent actuellement, mais la plaine du Pô avec toutes les ressources qu'elle leur offrait. Les Gaulois, qui étaient leurs voisins, entrèrent en relations avec eux ; séduits par la beauté du pays, ils saisirent un prétexte futile pour envahir brusquement la vallée du Pô avec une armée immense, en chassèrent les Étrusques et s'y établirent à leur place. Les tribus qui se fixèrent le plus près de la source furent celles des Laëns et des Lébéciens, puis celle des Insubres, la plus considérable de toutes, et un peu plus bas les Cénomans ; les bords de l'Adriatique furent colonisés par les Vénètes, nation très ancienne, qui ne se distingue guère des autres peuplades gauloises par les moeurs et le costume, mais qui parle une langue différente ; les auteurs d'histoires dramatiques racontent à leur sujet force légendes merveilleuses. Au delà du Pô, du côté de l'Apennin, on trouve en premier lieu les Anianes, puis les Boïens ; après eux, en allant vers l'Adriatique, les Lingons ; enfin, sur la côte, les Sénons. Telles sont les plus importantes des tribus qui ont occupé la région qui nous intéresse. Ces Gaulois habitaient dans des villages non fortifiés ; ils n'avaient pas le moindre mobilier, couchaient sur des litières et ne mangeaient que de la viande; leur vie était simple: ils ne connaissaient que le guerre et le travail des champs ; en dehors de ces occupations, toutes les sciences, tous les arts leur étaient inconnus. Leurs richesses consistaient uniquement en or et en troupeaux ; c'étaient les seules choses qu'ils pussent facilement transporter avec eux dans toutes leurs pérégrinations, au gré de leur fantaisie ou des circonstances. Rien n'était pour eux aussi important que les clans où ils se groupaient ; car chez eux un homme est puissant et redoutable en proportion du nombre des clients qu'on voit réunis sous son patronat. [2,18] Dès les premiers temps, ils ne se bornèrent pas à établir leur domination sur le pays qu'ils habitaient, mais ils soumirent également beaucoup de leurs voisins, terrorisés par leur humeur belliqueuse. Puis ils vainquirent les Romains et leurs alliés en bataille rangée, les mirent en déroute et les pourchassèrent pendant trois jours jusqu'à Rome, dont ils s'emparèrent à l'exception du Capitole. Mais une diversion — l'invasion de leur territoire par les Vénètes — les obligea à traiter avec les Romains : ils leur rendirent leur ville et retournèrent chez eux. Ils eurent ensuite à lutter contre des ennemis de leur propre race : quelques tribus des Alpes, jalouses de leur prospérité, se coalisèrent contre eux et firent dans leur pays de, fréquentes incursions. Pendant ce temps, les Romains avaient rétabli leur puissance et fait avec les Latins de nouvelles conventions. Trente ans après la prise de Rome, les Gaulois s'avancèrent encore jusqu'à Albe avec une armée considérable ; les Romains, cette fois, n'osèrent pas marcher à leur rencontre, parce que cette attaque soudaine les avait surpris et ne leur avait pas laissé le loisir de convoquer leurs alliés. Douze ans après, nouvelle incursion d'une forte armée gauloise ; mais les Romains s'y attendaient : ils rassemblèrent leurs auxiliaires et marchèrent de bon coeur à l'ennemi, avec le vif désir d'engager un combat général. Les Gaulois, intimidés par leur ardeur et ne pouvant se mettre d'accord, opérèrent, la nuit venue, une retraite qui ressemblait fort à une fuite. Après cette alerte, les Gaulois se tinrent en repos pendant treize ans ; au bout de ce temps, voyant s'accroître la puissance des Romains, ils conclurent avec eux un traité de paix. [2,19] Cette paix fut exactement observée pendant trente ans. Mais à ce moment, les Gaulois Transalpins se préparèrent à prendre les armes contre ceux d'Italie; ces derniers, redoutant le poids de cette guerre, leur firent des présents, invoquèrent leurs liens de parenté; ils parvinrent ainsi à détourner sur les Romains leurs intentions belliqueuses et partirent avec eux en expédition. Ils commencèrent par envahir l'Étrurie, dont les habitants se joignirent à eux, firent un butin considérable sur les terres des Romains et revinrent sans être inquiétés. De retour chez eux, ils ne s'entendirent pas sur le partage des dépouilles, et dans leur querelle la plus grande partie du butin et de l'armée fut détruite. Cette conduite est habituelle aux Gaulois, quand ils viennent de piller leurs voisins, surtout s'ils se sont gorgés à l'excès de vin et de nourriture. Quatre ans s'écoulèrent encore ; puis les Samnites et les Gaulois se liguèrent contre les Romains, leur livrèrent bataille sur le territoire des Camertins et leur tuèrent beaucoup de monde. Piqués par cet échec, les Romains retournèrent à la charge quelques jours plus tard avec toutes leurs légions et atteignirent l'ennemi dans le pays des Sentinates ; les coalisés furent presque tous massacrés ; les survivants durent s'enfuir précipitamment dans leurs pays respectifs. Au bout de dix ans, les Gaulois revinrent encore, avec un fort contingent, assiéger Arrétium ; les Romains vinrent au secours des assiégés et livrèrent bataille devant la place, mais ils furent vaincus et L. Métellus, qui les commandait, périt dans le combat. M. Curius, qui lui succéda, envoya en Gaule redemander les prisonniers; mais, contre le droit des gens, ses ambassasadeurs furent assassinés. Les Romains, indignés, se mettent aussitôt en campagne ; les Sénons se portent à leur rencontre et la bataille s'engage ; les Romains sont vainqueurs, tuent la plupart des ennemis, expulsent les autres et s'emparent de leur pays tout entier. C'est là que les Gaulois avaient établi leur première colonie en Italie, la ville de Séna, ainsi appelée du nom de ses fondateurs ; j'en ai parlé un peu plus haut : elle est située, disais-je, sur les bords de l'Adriatique, à la limite de la plaine du Pô. [2,20] La défaite des Sénons fit craindre aux Boïens le même sort pour eux et pour leur pays ; ils firent chez eux une levée en masse et appelèrent les Étrusques à la rescousse. Ils se concentrèrent près du lac de Vadimon et s'y rangèrent en bataille. Les Étrusques furent presque tous taillés en pièces ; quelques Boïens seulement parvinrent à s'échapper. Néanmoins, l'année suivante, ils reconstituèrent leur ligue, firent prendre les armes même aux tout jeunes gens et attaquèrent encore les Romains ; complètement écrasés, ils durent enfin céder, envoyèrent demander la paix et conclurent un traité avec les Romains. Cela se passait trois ans avant l'invasion de Pyrrhus en Italie, cinq ans avant la déroute des Gaulois à Delphes. La Fortune semblait alors avoir inspiré aux Gaulois une véritable frénésie guerrière. Les Romains retirèrent de ces campagnes deux très grands avantages : en premier lieu, si souvent battus par les Gaulois, ils ne pouvaient voir ou imaginer de dangers plus redoutables que ceux qu'ils avaient courus, et c'est pour cela qu'ils se montrèrent, contre Pyrrhus, si exercés et si aguerris ; en second lieu, après avoir su venir à bout d'adversaires aussi résolus, ils purent, sans en être détournés par aucune préoccupation, faire la guerre d'abord à Pyrrhus, pour la défense de l'Italie, ensuite aux Carthaginois, pour la possession de la Sicile. [2,21] Pendant les quarante-cinq années qui suivirent ces défaites, les Gaulois se tinrent tranquilles et vécurent en paix avec les Romains. Mais quand le temps eut fait disparaître tous les témoins oculaires des désastres, les jeunes gens de la génération suivante, pleins d'une ardeur inconsidérée, et qui n'avaient jamais connu ni éprouvé le moindre malheur ou le moindre revers, recommencèrent à s'agiter, comme il est naturel en pareil cas : ils cherchèrent querelle aux Romains pour le premier motif venu et gagnèrent à leur cause les Gaulois des Alpes. Ces projets se tramèrent d'abord secrètement entre les chefs, à l'insu du peuple ; aussi, quand les Transalpins s'avancèrent avec une armée jusqu'à Ariminum, le peuple boïen, se défiant d'eux, prit les armes à la fois contre ses propres chefs et contre les nouveaux arrivants ; les rois du pays, Atis et Galate, furent massacrés et il y eut une vraie bataille, où les Boïens s'entretuèrent. Les Romains, épouvantés à la nouvelle de l'invasion, s'étaient mis en campagne ; mais quand ils apprirent que l'armée gauloise s'était anéantie de ses propres mains, ils retournèrent chez eux. Cinq ans après cette alerte, sous le consulat de M. Lépidus, les Romains se partagèrent les terres du Picénum, cette partie de la Gaule d'où, après leur victoire, ils avaient chassé les Sénons. Ce fut C. Flaminius qui, pour se concilier la faveur de la plèbe, proposa cette motion; or on peut dire que ce fut la première cause de la corruption des moeurs romaines et aussi celle de la guerre que les Romains eurent plus tard à soutenir contre les Gaulois. Plusieurs de leurs tribus en effet firent cause commune avec les Sénons, principalement les Boïens, qui étaient limitrophes des Romains ; car ce n'était plus, pensaient-ils, pour établir sa suprématie et sa domination que Rome leur faisait la guerre, c'était pour les expulser et les détruire jusqu'au dernier. [2,22] Les plus importantes des tribus gauloises, celles des Insubres et des Boïens, se liguèrent donc aussitôt et envoyèrent chez les Gaulois qui habitaient sur les flancs des Alpes et les bords du Rhône, les Gésates, ainsi appelés parce qu'ils font la guerre moyennant une certaine solde ; c'est ce que signifie proprement leur nom. Ils firent aux rois du pays, Concolitan et Anéroeste, une offre immédiate, celle d'une somme considérable, et une promesse pour l'avenir, celle des richesses immenses que leur livrerait une victoire sur Rome, dont ils faisaient briller aux yeux de ces guerriers la grande prospérité; c'est par ces encouragements qu'ils les incitaient à partir en expédition contre les Romains. Ils n'eurent pas de peine à les décider, en ajoutant à ces considérations l'assurance de leur alliance fidèle et en invoquant le souvenir des exploits de leurs ancêtres : quand ils avaient pris les armes contre les Romains, ils ne les avaient pas seulement vaincus en bataille rangée, mais après leur victoire ils étaient entrés à Rome sans coup férir, s'étaient emparés de tout ce qui s'y trouvait et avaient occupé la ville pendant sept mois, pour la restituer ensuite de leur plein gré aux vaincus, qui leur en avaient été fort reconnaissants, et s'en retourner enfin chez eux sains et saufs, chargés de butin. Ces discours enflammèrent à tel point l'ardeur guerrière des chefs que jamais on ne vit sortir de cette partie de la Gaule une armée plus nombreuse, plus brillante, plus belliqueuse. Les Romains, alors, effrayés et troublés à la fois par les nouvelles qu'ils recevaient et par l'avenir qu'ils appréhendaient, levèrent des troupes, se procurèrent des vivres et des munitions, puis s'avancèrent jusqu'aux frontières, comme si l'ennemi envahissait déjà leur pays, tandis qu'il ne s'était pas encore mis en route. Cette agitation aidait puissamment les Carthaginois à affermir leur domination en Espagne. Les Romains, comme je l'ai dit précédemment, trouvaient plus urgent de faire face au danger le plus pressant et consacraient tous leurs efforts à se débarrasser des Gaulois ; ils ne pouvaient donc s'occuper de ce qui se passait en Espagne. Ils se mirent en sûreté du côté des Carthaginois par leur traité avec Hasdrubal, dont j'ai parlé un peu plus haut, et, dans ces conjonctures, tournèrent tous leurs efforts contre leurs ennemis d'Italie, avec lesquels ils jugeaient nécessaire d'engager une lutte décisive. [2,23] Huit ans après le partage des terres dans le Picénum, les Gaulois Gésates rassemblèrent une armée nombreuse et magnifiquement équipée, franchirent les Alpes et descendirent dans la vallée du Pô. Les Insubres et les Boïens tinrent loyalement leurs engagements ; mais les Vénètes et les Cénomans traitèrent avec les Romains et firent alliance avec eux. Aussi les chefs gaulois furent-ils obligés de laisser dans leur pays une partie de leurs forces, pour la garder contre une attaque qui viendrait de ce côté. Ils partirent eux-mêmes avec le reste de leurs troupes et marchèrent hardiment sur l'Étrurie, à la tête de cinquante mille fantassins et de vingt mille soldats à cheval ou montés sur des chars de guerre. Dès que les Romains surent que les Gaulois avaient passé les Alpes, ils envoyèrent le consul L. Émilius avec une armée à Ariminum, pour barrer la route à l'ennemi s'il voulait entrer par-là. Un des préteurs fut dépêché en Étrurie. Quant à l'autre consul, C. Atilius, il était déjà parti pour la Sardaigne avec ses légions. A Rome, tout le monde tremblait; on se croyait sous le coup du danger le plus grave, le plus redoutable ; c'était d'ailleurs naturel, car la terreur répandue naguère par les Gaulois était encore présente à tous les esprits. Sous l'empire de cette impression, les Romains mobilisent leurs armées, en lèvent de nouvelles, recommandent à leurs alliés de se tenir prêts ; ils font venir de chaque province la liste des hommes en âge de porter les armes, pour bien savoir de quelles forces ils disposaient. Ils accumulèrent des réserves de blé, d'armes et d'autres munitions comme jamais encore on n'en avait vu. De toutes parts, on s'empressa de leur envoyer toutes sortes de secours ; car tous les Italiens étaient épouvantés par l'irruption des Gaulois et ce n'était plus, leur semblait-il, à Rome qu'ils venaient en aide, ce n'était plus pour son hégémonie que la guerre allait se faire ; c'étaient leur propre vie, leur patrie, leur territoire qui étaient en jeu. Delà l'empressement avec lequel ils se conformaient à toutes les instructions qu'on leur donnait. [2,24] Pour que les faits puissent, par eux-mêmes, faire comprendre à quelle puissance Hannibal a osé s'attaquer, quelles étaient les forces des Romains quand il eut l'audace de se dresser contre eux et de poursuivre son entreprise jusqu'à les mettre dans une situation des plus critiques, il faut donner le détail des armements et des troupes dont Rome disposait à l'époque dont nous parlons. Les consuls avaient avec eux quatre légions romaines, composées chacune de cinq mille deux cents fantassins et de trois cents cavaliers ; ils étaient tous les deux accompagnés de troupes auxiliaires, dont le total se montait à trente mille fantassins et deux mille cavaliers. Il y avait en outre quatre mille cavaliers et plus de cinquante mille fantassins fournis par les Sabins et les Étrusques, que le danger avait fait marcher au secours de Rome ; on les dirigea tous sur l'Étrurie, sous le commandement d'un préteur. Les montagnards de l'Apennin, Ombriens et Sarsinates, avaient mis sur pied à peu près vingt mille hommes, les Vénètes et les Cénomans vingt mille également. On les porta sur les frontières de la Gaule, pour faire une incursion sur les terres des Boïens et provoquer par cette diversion le rappel de l'armée déjà entrée en campagne. Telles étaient les troupes préposées à la défense des frontières. A Rome, on tenait prêt, pour parer à l'imprévu, un corps de réserve qui comptait vingt mille fantassins et quinze cents cavaliers romains, trente mille fantassins et deux mille cavaliers auxiliaires. Les rôles qu'on avait fait dresser portaient : chez les Latins, quatre-vingt mille fantassins et cinq mille cavaliers ; chez les Samnites, soixante-dix mille fantassins et sept mille cavaliers ; chez les Japyges et les Messapiens réunis, cinquante mille fantassins et seize mille cavaliers ; chez les Lucaniens, trente mille fantassins et trois mille cavaliers ; chez les Marses, les Marrucins, les Férentiniens et les Vestins, vingt mille fantassins et quatre mille cavaliers. Il y avait encore deux légions composées chacune de quatre mille deux cents fantassins et de deux cents cavaliers, qui tenaient garnison en Sicile et à Tarente. Les levées faites parmi les gens du peuple à Rome et en Campanie donnèrent à peu près deux cent cinquante mille hommes d'infanterie et vingt-trois mille de cavalerie; de sorte que le total des citoyens et des auxiliaires en état de porter les armes était de plus de sept cent mille fantassins et d'environ soixante-dix mille cavaliers. Voilà à quelles forces Hannibal s'attaquait quand il entra en Italie avec moins de vingt mille hommes ; c'est ce que la suite mettra encore mieux en lumière. [2,25] Les Gaulois, parvenus en Étrurie, se mirent à parcourir le pays et à le ravager sans être inquiétés ; ne rencontrant aucun ennemi, ils marchèrent enfin sur Rome. Ils étaient arrivés à Cluses, ville située à trois journées de marche de la capitale, lorsqu'ils apprirent que les troupes romaines envoyées contre eux en Étrurie arrivaient sur leurs derrières et allaient les atteindre. Ils revinrent aussitôt sur leurs pas pour les attaquer. Les deux armées se trouvèrent en présence au coucher du soleil et bivouaquèrent à quelque distance l'une de l'autre. La nuit venue, les Gaulois allumèrent des feux et, laissant derrière eux leur cavalerie, avec l'ordre de suivre leurs traces au petit jour, dès qu'elle aurait été vue par les Romains, battirent en retraite sans bruit jusqu'à Fiésole ; là, ils prirent position pour fondre à l'improviste, dès que leur cavalerie les aurait rejoints, sur les adversaires lancés à leur poursuite. Quand le jour parut, les Romains aperçurent les cavaliers gaulois et, supposant que l'ennemi avait pris la fuite, se précipitèrent après eux dès qu'ils les virent tourner bride. A leur approche, les Gaulois surgirent et tombèrent sur eux. Le combat fut d'abord soutenu, des deux côtés, avec une égale vigueur ; mais les Gaulois, plus vaillants et plus nombreux, finirent par avoir l'avantage ; les Romains perdirent au moins six mille hommes ; les autres s'enfuirent, et la plupart d'entre eux se réfugièrent dans une forte position, où ils s'établirent. Les Gaulois eurent d'abord l'idée d'aller les y assiéger ; mais, épuisés par leur marche de nuit et toutes les fatigues qu'ils avaient supportées, ils eurent la fâcheuse inspiration d'aller se reposer et se refaire, en confiant à une partie de leur cavalerie la mission de monter la garde devant la colline occupée par les fuyards ; ils avaient l'intention de revenir le lendemain les y assiéger, s'ils ne se rendaient pas d'eux-mêmes. [2,26] Cependant L. Émilius, qui avait été envoyé dans la région de l'Adriatique, avait appris que les Gaulois, entrés en Étrurie, approchaient de Rome ; il se hâta de venir à la rescousse et arriva au bon moment. Comme il était campé non loin des positions ennemies, les soldats réfugiés sur la colline aperçurent ses feux, devinèrent de quoi il retournait et, reprenant: courage, envoyèrent de nuit, par la forêt, quelques hommes sans armes informer le consul de ce qui s'était passé. A ce récit, Émilius comprit qu'il n'avait pas de temps à perdre à délibérer : il donna à ses tribuns l'ordre de se mettre en marche au point du jour avec l'infanterie ; lui-même prit la tête avec la cavalerie et marcha droit vers la hauteur en question. Les chefs gaulois, de leur côté, avaient aperçu ses feux pendant la nuit et, conjecturant qu'une armée ennemie était proche, tenaient conseil. Le roi Anéroeste émit cette opinion qu'après avoir fait autant de butin (car ils emmenaient, comme bien on pense, un nombre incalculable de prisonniers, de bestiaux et d'objets divers) il ne fallait pas courir les chances d'un nouveau combat qui remettrait tout en question ; il valait mieux revenir tranquillement dans leur pays ; puis, une fois déchargés et allégés de tout ce qui les encombrait, ils pourraient, si bon leur semblait, recommencer la lutte contre Rome. On se rangea à l'avis d'Anéroeste; la décision fut prise la nuit même, et avant le jour les Gaulois, levant le camp, battaient en retraite le long de la mer à travers l'Étrurie. Bien que l'armée d'Émilius fût grossie des troupes qui avaient trouvé un refuge sur la colline, il ne jugea pas à propos de hasarder une bataille rangée et préféra suivre les ennemis en guettant l'occasion et le lieu favorable pour leur infliger quelque perte ou leur reprendre leur butin. [2,27] Ce fut juste à ce moment que le consul C. Atilius, revenant de Sardaigne avec ses légions, débarqua à Pise et se dirigea de là vers Rome par la route que les ennemis suivaient en sens inverse. Les Gaulois étaient déjà arrivés dans une ville d'Étrurie nommée Télamon ; Ieurs fourrageurs tombèrent sur l'avant-garde d'Atilius et furent faits prisonniers. Interrogés par le consul, ils lui racontèrent tout ce qui s'était passé et l'informèrent de la proximité des deux armées, celle des Gaulois dans le voisinage immédiat, celle d'Émilius sur ses derrières. Vivement ému de ces nouvelles, mais heureux de voir les Gaulois surpris dans leur marche entre les deux armées romaines, Atilius donne à ses tribuns l'ordre de ranger les légions et de marcher à l'ennemi au pas de charge, en avançant de front autant que la nature du terrain le permettrait. Il y avait une hauteur qui dominait la route et au pied de laquelle les Gaulois devaient nécessairement passer ; le consul prit avec lui ses cavaliers et se hâta d'aller occuper le sommet de cette position avantageuse il voulait être le premier à engager le combat, persuadé qu'ainsi c'était surtout à lui que reviendrait l'honneur de la victoire. Les Gaulois, ignorant son arrivée, pensèrent d'abord, en le voyant, que c'était la cavalerie d'Émilius qui les avait tournés pendant la nuit pour occuper la place avant eux ; ils envoyèrent aussitôt leurs cavaliers et quelques soldats armés à la légère, pour déloger les Romains de la colline. Mais bientôt, apprenant par un de leurs prisonniers que c'était à Atilius qu'ils avaient affaire, ils rangèrent au plus vite leur infanterie, de manière à ce qu'elle fît front à la fois des deux côtés, en tête et en queue ; ils adoptèrent cette disposition sur la foi des renseignements qu'on leur donnait et en raison de ce qu'ils constataient par eux-mêmes, pour faire face en même temps aux ennemis qu'ils savaient lancés à leur poursuite et à ceux qu'ils s'attendaient à rencontrer devant eux. [2,28] Émilius avait bien entendu parler du débarquement des légions à Pise, mais il ne les croyait pas encore si près ; ce fut par le combat engagé du côté de la colline qu'il apprit avec certitude l'arrivée d'une armée de secours. Il envoya immédiatement ses cavaliers soutenir ceux qui se battaient sur la hauteur, en même temps qu'il faisait donner son infanterie, rangée selon l'ordre habituel. Les Gaulois avaient placé face au corps d'Émilius, dont ils attendaient l'attaque sur leurs derrières, les Gésates des Alpes et après eux les Insubres ; en tête, ils avaient posté les Taurisques et les Boïens Cispadans, qui tournaient le dos à leurs compagnons d'armes et auraient à soutenir le choc des légions d'Atilius. Les chars de guerre et autres attelages bordaient les deux ailes ; on mit, enfin, tout le butin sur une des montagnes voisines, avec un détachement pour le garder. Cette armée gauloise à deux fronts n'était pas seulement terrible à voir, mais aussi très bien organisée pour l'action. Les Insubres et les Boïens marchaient au combat revêtus de leurs braies et de leurs sayons les plus légers ; les Gésates, avec une vanité téméraire, s'étaient débarrassés de tout vêtement et se présentaient au premier rang, entièrement nus, sans rien porter que leurs armes: ils pensaient être ainsi plus à leur aise, n'ayant plus à craindre d'être accrochés par les buissons et empêchés de faire usage de leurs armes. Le premier engagement eut lieu sur la colline et put être vu par toutes les troupes, parce qu'un très grand nombre de cavaliers des deux partis, accourus de tous côtés, s'y battaient pêle-mêle. C'est là que le consul Atilius trouva la mort, tandis qu'il combattait avec intrépidité ; sa tête fut apportée au roi des Gaulois. Les cavaliers romains n'en luttèrent pas moins vaillamment, si bien qu'ils finirent par l'emporter et par rester maîtres de la position. Ensuite, les troupes de pied s'avancèrent les unes contre les autres ; c'était un spectacle étrange et non moins extraordinaire pour ceux qui se l'imaginent en l'entendant raconter que pour ceux qui y ont assisté. [2,29] D'abord, une bataille rangée entre trois armées à la fois présente évidemment un aspect et un caractère tout à fait exceptionnels. D'autre part, il ne nous est pas plus facile qu'aux témoins oculaires de décider si la position des Gaulois, attaqués à la fois des deux côtés, doit être considérée comme des plus dangereuses ou au contraire des plus favorables: sans doute ils avaient à soutenir une double lutte ; mais les soldats placés dos à dos se préservaient mutuellement d'une attaque en queue ; et surtout, il leur était impossible de reculer, de sorte qu'en cas de défaite il ne leur restait aucun espoir de salut : c'est l'avantage particulier que présente toujours la formation sur deux fronts. Les Romains voyaient l'ennemi pris entre leurs deux armées et cerné de toutes parts ; cela ranimait leur courage ; puis, de nouveau, l'aspect de l'armée gauloise et le bruit qui s'y faisait les glaçaient d'épouvante. Le nombre des cors et des trompettes était incalculable ; en même temps, toute l'armée poussait de telles clameurs que l'on n'entendait plus seulement le son des instruments et les cris des soldats, mais que les lieux environnants, qui en renvoyaient l'écho, semblaient ajouter leur propre voix à ce vacarme. Une chose non moins effrayante, c'étaient l'apparence et les mouvements des hommes nus placés au premier rang : ils étaient tous d'une force et d'une beauté extraordinaires, tous parés de colliers et de bracelets en or ; si bien qu'à leur vue les Romains étaient saisis de frayeur, mais en même temps l'espoir d'un riche butin redoublait leur ardeur belliqueuse. [2,30] Les soldats romains armés de javelots, sortant des rangs selon leur tactique accoutumée, firent pleuvoir une grêle de traits sur les Gaulois ; ceux des dernières lignes n'en souffrirent guère, parce que leurs braies et leurs sayons les protégeaient suffisamment ; mais ceux qui étaient en tête, complètement nus, se trouvèrent exposés sans défense à cette attaque inattendue et à ces coups qu'ils ne pouvaient parer. Leur bouclier n'était pas assez vaste pour les couvrir tout entiers, et leurs corps découverts offraient d'autant plus de prise aux blessures qu'ils étaient plus grands. Il leur était impossible d'atteindre leurs ennemis, tant à cause de la distance qui les en séparait qu'en raison du nombre de traits qui tombaient sur eux ; dans cette situation désespérée, les uns se jetèrent avec une fureur aveugle au milieu des ennemis et se livrèrent volontairement à la mort ; les autres, donnant libre cours à leur frayeur, reculèrent sur leurs compagnons placés derrière eux et mirent le désordre dans leurs rangs. C'est ainsi que la fierté des Gésates fut brisée par les tirailleurs. Dès que ces derniers se replièrent, les Insubres, les Boïens et les Taurisques, attaqués par les cohortes romaines, soutinrent le combat avec intrépidité ; criblés de blessures, ils restaient inébranlables ; leur seule infériorité générale et individuelle consistait dans la qualité de leurs armes : leurs boucliers les protégeaient moins bien et leurs épées, qui ne frappaient que de taille, ne valaient pas celles des Romains. Mais enfin, la cavalerie romaine, descendant de la colline, fondit sur eux de flanc et les chargea vigoureusement ; les fantassins gaulois furent massacrés à leur poste et les cavaliers prirent la fuite. [2,31] Les Gaulois avaient perdu quarante mille hommes et laissaient aux mains de l'ennemi dix mille prisonniers, entre autres le roi Concolitan. Son collègue Anéroeste, échappé avec quelques compagnons, tua de sa propre main tous les membres de sa famille et se suicida. Le consul fit ramasser les dépouilles des Gaulois et les envoya à Rome ; quant à leur butin, il le rendit aux peuples à qui ils l'avaient pris. Ensuite, à la tête de ses légions, il traversa la Ligurie et envahit le pays des Boïens ; il laissa ses soldats assouvir leur soif de pillage, puis au bout de quelques jours il revint à Rome avec son armée. Il fit décorer le Capitole avec les enseignes militaires des Gaulois et avec les colliers d'or qu'ils portaient autour du cou ; le reste des dépouilles et les prisonniers servirent à rehausser l'éclat de son entrée triomphale. C'est ainsi qu'échoua misérablement cette formidable invasion gauloise, qui menaçait des dangers les plus graves et les plus terribles toute l'Italie et surtout Rome. Après leur victoire, les Romains, se croyant en état de chasser complètement les Gaulois de la vallée du Pô, envoyèrent contre eux les deux nouveaux consuls, Q. Fulvius et T. Manlius, avec une armée et un matériel formidables. Leur arrivée inopinée déconcerta les Boïens, qui durent faire leur soumission. Mais des pluies torrentielles se mirent à tomber et une épidémie se déclara dans l'armée, ce qui entrava son action pendant toute la suite de la campagne. [2,32] Les consuls élus l'année suivante, P. Furius et C. Flaminius, entrèrent de nouveau en Gaule par le pays des Anares, situé non loin de Marseille. Après les avoir gagnés à la cause de Rome, ils passèrent sur le territoire des Insubres, vers le confluent du Pô et de d'Adda. Mais ils éprouvèrent de telles pertes, pendant le trajet et l'établissement de leur camp, qu'ils ne purent aller plus loin; ils traitèrent donc avec les habitants et se retirèrent. Après plusieurs jours de marche, ils traversèrent le Clusius et arrivèrent dans le pays des Cénomans, leurs alliés, dont les forces se joignirent à eux; puis ils revinrent, en longeant le pied des Alpes, fondre sur les plaines des Insubres, dont ils incendièrent les récoltes et pillèrent les habitations. Les chefs des Insubres, voyant que rien ne pouvait détourner les Romains de leur résolution, prirent le parti de tenter la fortune et de risquer le tout pour le tout. Ils rassemblèrent donc toutes leurs enseignes ; ils retirèrent même du temple de Minerve celles qui sont en or et qu'ils appellent les Immobiles ; ils firent tous les préparatifs nécessaires, puis vinrent, avec une terrible armée de cinquante mille hommes, camper hardiment en face de l'ennemi. Les Romains, se voyant inférieurs en nombre, songèrent d'abord à utiliser leurs auxiliaires gaulois ; mais ils réfléchirent à l'inconstance qui caractérise cette nation et préférèrent, dans une affaire aussi grave, ne pas avoir recours à de pareils alliés contre des ennemis de même race qu'eux. Ils se décidèrent enfin à rester en deçà de la rivière, tandis qu'ils la faisaient passer aux Cénomans et rompaient les ponts derrière eux ; de la sorte, ils se mettaient à l'abri d'une trahison, en même temps qu'ils s'enlevaient à eux-mêmes tout autre espoir de salut que la victoire, car la rivière à laquelle ils étaient appuyés n'était pas guéable. Après avoir pris ces dispositions, ils se préparèrent au combat. [2,33] Cette bataille est célèbre par l'ingéniosité qu'y déployèrent les Romains. Les tribuns avaient enseigné à leurs hommes la tactique tant collective qu'individuelle qu'il fallait suivre ; ils avaient observé, dans les rencontres précédentes, que l'ardeur et l'impétuosité des Gaulois les rendaient toujours extrêmement redoutables dans le premier choc, tant qu'ils n'étaient pas encore entamés, mais que leurs sabres — comme je l'ai fait remarquer — ne pouvaient frapper que de taille ; d'autre part, au premier coup, ils s'émoussaient et se pliaient, dans leur longueur comme dans leur largeur ; que si on ne laissait pas alors au porteur de l'arme le temps de la planter en terre et de la redresser avec le pied, le second coup était absolument sans effet. Les tribuns firent donc remettre aux soldats des premières lignes les piques des "triarii" placés en arrière, mais en leur recommandant d'être prêts à se servir de leurs épées ; puis le signal du combat fut donné. Les Gaulois, attaqués de front, frappent les piques des Romains avec leurs sabres, ce qui met, dès les premiers coups, leurs armes hors d'usage. Les Romains fondent alors sur eux et engagent un corps à corps ; les Gaulois, ne pouvant avec leurs tranchants émoussés porter leurs coups de taille ordinaires, sont incapables de se défendre ; les Romains, dont les épées étaient pointues et bien affilées, frappent, non de taille, mais d'estoc ; sans relâche, ils criblent de blessures la poitrine et le visage de leurs adversaires et en tuent le plus grand nombre. Ce succès était dû à la prévoyance des tribuns; car le consul Flaminius n'avait pas fait preuve dans ce combat d'une grande sagacité : en rangeant son armée sur la berge sans réserver un espace où ses bataillons pussent reculer, il perdait l'avantage de la tactique particulière aux Romains. Si, au cours de la bataille, ses hommes avaient plié tant soit peu, ils auraient tous été fatalement culbutés dans la rivière, par cette faute de leur général. Grâce à leur valeur, ils remportèrent néanmoins, comme je l'ai dit, une victoire éclatante ; ils firent un butin très abondant et revinrent à Rome, chargés d'innombrables dépouilles. [2,34] L'année suivante, les Gaulois envoyèrent demander la paix, en se soumettant d'avance à toutes les conditions ; mais les nouveaux consuls, M. Claudius et Cn. Cornélius, firent rejeter leurs propositions. Les ennemis, rebutés, résolurent de tenter leur dernière chance ; ils levèrent chez les Gésates du Rhône environ trente mille mercenaires et les tinrent prêts, en attendant un retour offensif des Romains. Au printemps, les consuls marchent, à la tête de leurs légions, sur le pays des Insubres ; ils arrivent à Acerres, localité située entre le Pô et les Alpes, campent devant la place et l'investissent. Les Insubres ne pouvaient lui porter secours, parce que les Romains avaient occupé préalablement les positions favorables ; pour leur faire lever le siège d'Acerres, ils firent passer le Pô à une partie de leurs forces, qu'ils envoyèrent chez les Anares assiéger de leur côté la ville de Clastidium. Dès que les consuls en furent informés, M. Claudius prit avec lui la cavalerie et un détachement d'infanterie pour aller au secours des assiégés. Les Gaulois, à son approche, lèvent le siège, viennent à sa rencontre et se disposent au combat. Chargés vigoureusement par les cavaliers romains, ils tiennent bon tout d'abord ; mais ensuite, enveloppés par l'ennemi, qui les attaque en queue et en flanc, ils se voient perdus et prennent la fuite, sans que l'infanterie ait eu à intervenir. Quelques-uns d'entre eux tombèrent dans le fleuve et se noyèrent, entraînés par le courant ; le plus grand nombre fut massacré. Les Romains s'emparèrent d'Acerres, où ils trouvèrent des approvisionnements abondants ; pendant ce temps, les Gaulois se retiraient à Milan, la capitale des Insubres. Cornélius se précipite sur leurs pas et paraît soudain devant la place. Les Gaulois ne bougent pas tout d'abord ; mais dès qu'il se remet en route vers Acerres, ils font une sortie, fondent sur l'àrrière-garde, en tuent une bonne partie et mettent le reste en fuite. Le consul rappelle alors l'avant-garde, arrête sa marche, la lance contre l'ennemi. Les Romains, à son commandement, se retournent contre les Gaulois, qui les serraient de près, et engagent vigoureusement l'action. Les Gaulois, encouragés par leur premier succès, opposent quelque temps une résistance énergique ; puis ils sont mis en déroute et s'enfuient vers les montagnes. Cornélius les poursuit, ravage la contrée et prend de vive force la place de Milan. [2,35] Après cette défaite, les chefs insubres désespérant de la situation, se rendirent aux Romains à discrétion : la guerre contre les Gaulois était finie. A en juger par le courage et la fureur aveugle des combattants, par la grandeur des batailles, par le nombre des soldats qui y ont péri, il n'y a jamais eu, de mémoire d'homme, une guerre plus considérable ; mais si l'on examine la manière dont elle a été entreprise par les Gaulois et le peu de sagacité qu'ils y ont montré en toutes circonstances, elle est dénuée de toute importance ; cela tient à ce que, je ne dis pas généralement, mais toujours, les Gaulois se laissent gouverner par les impulsions de leurs passions au lieu d'écouter la voix de la raison. En considérant le peu de temps qu'il a fallu pour les chasser de toute la plaine du Pô, à l'exception de quelques points situés au pied même des Alpes, j'ai pensé qu'il ne fallait point passer sous silence leur première invasion, les faits qui l'ont suivie et leur déroute finale. C'est, à mon avis, le devoir de l'historien de transmettre à la postérité ces vicissitudes de la fortune. Si nous laissions nos descendants dans l'ignorance de ces événements, ils pourraient redouter les invasions subites et imprévues des barbares ; mais s'ils savent combien elles sont éphémères et faciles à disperser, ils tiendront tête à ces attaques et tenteront toutes les chances plutôt que de rien céder de ce qui leur appartient. Ceux qui nous ont transmis le souvenir des invasions des Perses en Grèce et des Gaulois à Delphes n'ont pas peu contribué, selon mon opinion, à soutenir les Grecs dans leurs luttes pour l'indépendance. Il n'y a pas d'armements, pas de ressources, pas d'armée qui puissent effrayer un homme qui défend sa patrie, qui puissent l'empêcher de combattre pour elle jusqu'au bout ; il lui suffit d'avoir devant les yeux les actions extraordinaires qui s'accomplirent alors et de se rappeler combien de milliers d'hommes furent vaincus, malgré leur courage et leur équipement formidable, par un parti qui leur opposait la force de son intelligence et de sa raison. Or les Gaulois ont bien souvent répandu la terreur chez les Grecs, non seulement autrefois, mais de nos jours : nouveau motif pour moi de faire un exposé de leur histoire, succinct sans doute, mais qui reprît les faits depuis leur origine. [2,36] Pour en revenir aux Carthaginois, Hasdrubal, leur général, gouvernait l'Espagne depuis huit ans, quand une nuit, dans sa tente, il fut assassiné par un Gaulois, pour des raisons d'ordre privé ; il avait considérablement étendu la domination de Carthage, moins par ses victoires que par ses relations cordiales avec les chefs du pays. L'armée d'Espagne fut alors placée sous les ordres d'Hannibal, qui, bien que fort jeune, avait déjà donné maintes preuves de son intelligence et de son courage. Dès qu'il eut pris le commandement, il fut manifeste qu'il ne songeait qu'à faire la guerre aux Romains ; ce qui devait d'ailleurs arriver fort peu de temps après. A partir de ce moment, ce ne furent plus, entre Carthaginois et Romains, que soupçons réciproques et que contestations. Ceux-là guettaient l'occasion de venger leurs désastres de Sicile ; ceux-ci se tenaient en garde contre les mesures qu'ils voyaient prendre aux autres ; il était évident pour tout observateur perspicace que la guerre ne tarderait pas à éclater entre les deux états. [2,37] C'est à la même époque que les Achéens, le roi Philippe et leurs alliés entreprirent contre les Étoliens la guerre dite "Sociale". Nous voici donc arrivés, par l'exposé chronologique des événements de Sicile, d'Afrique et de ceux qui suivirent, au début de cette guerre sociale et de la seconde guerre punique — qu'on appelle généralement guerre d'Hannibal — ; c'est à cette date que, d'après le plan que j'ai tracé dans mon avant-propos, doit commencer mon histoire; mais il conviendrait de faire une digression pour parler un peu des affaires de la Grèce, de façon à avoir passé tous les pays en revue dans mon préambule et raconté l'histoire de chacun d'eux jusqu'à la même époque, avant de m'engager dans le corps de mon traité. Ce n'est pas, en effet, comme mes prédécesseurs, l'histoire de tel ou tel peuple — des Grecs ou des Perses par exemple — que j'ai entrepris d'écrire, mais celle de toutes les parties connues du monde habité ; pour l'exécution de ce dessein, notre siècle m'a fourni des documents particulièrement importants, dont je parlerai ailleurs plus en détail ; il fallait donc, avant d'entrer dans le coeur de mon sujet, dire quelques mots sur chacun des peuples et des pays les plus célèbres de l'univers. Pour ce qui concerne l'Asie et l'Égypte, je me bornerai à rappeler ce qui s'y est passé depuis la date que je viens d'indiquer : l'histoire des faits antérieurs a souvent été écrite, et tout le monde la connaît d'autre part, il ne s'y est produit de nos jours aucun changement notable, aucun retour imprévu de la fortune, qui nécessite l'exposé de ce qui a précédé. Au contraire, pour l'Achaïe et le royaume de Macédoine, il faut brièvement reprendre les choses de plus loin c'est nécessaire, étant donné d'un côté la destruction complète de la maison royale de Macédoine, de l'autre le prodigieux développement que la confédération achéenne, comme je l'ai dit plus haut, a pris de nos jours grâce à la concorde qui y règne. Bien des gens avaient déjà essayé, au cours des siècles passés, de réaliser cette union entre les cités du Péloponèse mais ils n'avaient pu y arriver, parce qu'ils songeaient moins à défendre la liberté de tous qu'à augmenter leur puissance personnelle ; tandis qu'aujourd'hui cette union est si complète qu'il y a entre les confédérés non seulement alliance et amitié, mais communauté de lois, de mesures, de poids et de monnaies, même magistrats, même assemblée délibérante, même tribunaux ; en un mot, à ceci près que tous les habitants du Péloponnèse ne sont pas renfermés dans les mêmes murailles, ils constituent pour ainsi dire une seule cité ; car à tous les autres points de vue on voit régner entre les divers citoyens ou les diverses villes l'égalité et l'uniformité. [2,38] En premier lieu, il n'est pas sans intérêt de rechercher comment et pourquoi le nom des Achéens est devenu prépondérant dans le Péloponèse. Le peuple qui le porte pour en avoir hérité de ses ancêtres ne se distingue ni par l'étendue de son territoire ni par le nombre de ses villes ni par sa richesse ni par sa valeur ; l'Arcadie et la Laconie sont bien plus vastes et bien plus peuplées, et leurs habitants ne le cèdent, pour la vaillance, à personne parmi les Grecs. D'où vient alors que, comme tous les autres Péloponésiens, ils se font gloire aujourd'hui de ne faire qu'une nation avec l'Achaïe et d'adopter jusqu'au nom d'Achéens? On ne peut évidemment attribuer ce phénomène au hasard ; ce serait une mauvaise explication ; il vaut mieux en rechercher la cause ; car sans cause aucun résultat ne se produit, qu'il nous paraisse logique ou non. La voici, à mon avis : c'est qu'il n'y a aucun état où l'égalité, la liberté, en un mot la démocratie la plus parfaite soient mieux respectées qu'en Achaïe. Quelques peuples du Péloponèse sont venus à elle spontanément ; la plupart furent sollicités et gagnés par persuasion; quelques-uns enfin durent être englobés de force dans l'union, mais furent bientôt fort aises qu'on leur eût fait violence. Car les anciens ne jouissaient d'aucun privilège ; on accordait les mêmes droits à tous ceux qui entraient dans la confédération ; si bien qu'elle parvint rapidement au but qu'elle se proposait, en employant les deux auxiliaires les plus puissants, l'égalité et l'humanité. C'est là qu'il faut voir la principale raison de l'harmonie qui règne entre les Péloponésiens et de la prospérité qui en résulte. Or ces principes politiques et ce régime étaient depuis longtemps en vigueur chez les Achéens ; bien des faits pourraient le prouver ; mais en ce moment nous nous contenterons, pour le démontrer, de prendre un ou deux exemples. [2,39] Quand, dans la partie de l'Italie qu'on appelait alors la Grande-Grèce, les collèges de Pythagoriciens furent incendiés, une très vive agitation se produisit dans toute la région ; c'était naturel, après un attentat qui coûtait la vie aux principaux citoyens de chaque cité ; et l'on ne vit plus, dans les villes grecques de cette contrée, que meurtres, séditions, troubles de toute espèce. De presque toute la Grèce, on envoya des ambassades pour essayer de rétablir la paix ; mais les Achéens furent les seuls à la foi desquels on voulut bien s'en remettre pour porter remède à cette fâcheuse situation. Ce ne fut pas seulement en cette occasion que les cités de la Grande-Grèce montrèrent combien elles appréciaient les institutions des Achéens ; car peu de temps après elles décidèrent de copier exactement leur forme de gouvernement. Les habitants de Crotone, de Sybaris, de Caulonia s'entendirent d'abord pour élever en commun un temple à Zeus Homarios et choisir un endroit où les assemblées se réuniraient pour délibérer, puis ils convinrent d'adopter les lois et coutumes de l'Achaïe et de les appliquer dans l'administration de leur pays. Et ce ne fut pas de leur plein gré qu'ils y renoncèrent ; mais ils y furent contraints par le despotisme de Denys de Syracuse et par le développement de la puissance des peuplades barbares qui les entouraient. Plus tard, quand les Thébains eurent défait les Lacédémoniens à Leuctres et voulurent inopinément établir leur hégémonie sur la Grèce, des différends s'élevèrent dans tous les pays helléniques, mais surtout entre Sparte et Thèbes : l'une ne voulait pas s'avouer vaincue, l'autre se refusait à reconnaître la prétendue victoire de sa rivale. D'un commun accord, on prit les Achéens pour arbitres de la contestation : c'étaient les seuls Grecs à qui l'on consentît à s'adresser, non pas en considération de leurs forces matérielles — l'Achaïe était presque le plus petit état de la Grèce —, mais en raison de leur bonne foi et de leur probité constante ; car à cet égard leur réputation était universelle. Mais ils n'avaient encore que la volonté d'accroître leur puissance ; ils n'avaient pu jusque-là réaliser leurs intentions ni accomplir une action d'éclat qui les y aidât, parce qu'il leur était impossible de trouver un chef qui répondît à ce qu'on attendait de lui ; s'ils en choisissaient un sur qui l'on pût fonder quelque espérance, les Lacédémoniens et surtout la Macédoine étouffaient ses desseins et en empêchaient l'exécution. [2,40] Mais lorsqu'ils eurent enfin trouvé les chefs qu'il leur fallait, on sut aussitôt de quoi ils étaient capables, quand on les vit accomplir cette oeuvre admirable, l'union de tout le Péloponnèse. L'homme qui doit être considéré comme le premier auteur et le promoteur de ce projet, c'est Aratos de Sicyone ; celui qui le prit en main et sut le mener à bonne fin, c'est Philopoemen de Mégalopolis ; ceux qui consolidèrent l'union et lui assurèrent une certaine durée, ce sont Lycortas et ses partisans. Ce que fit chacun de ces personnages, par quels moyens et dans quelles circonstances, c'est ce que j'essaierai de montrer, en n'insistant sur ces divers points qu'autant que mon sujet le comporte. Je ne rappellerai que très brièvement, ici et plus loin, ce qui concerne la politique d'Aratos, parce qu'il a lui-même écrit sa propre histoire dans des mémoires fidèles et véridiques ; mais je traiterai avec plus de précision et de détail ce qui concerne les autres. Pour rendre l'exposition de ces faits plus commode pour moi et leur intelligence plus aisée pour les lecteurs, je ne vois rien de mieux que de prendre comme point de départ l'époque où les Achéens ont entrepris de reconstituer leur confédération démembrée par le roi de Macédoine : c'est à partir de cette date que la puissance achéenne s'est développée, pour en arriver au point où nous l'avons vue de nos jours, comme je l'ai dit un peu plus haut. [2,41] Ce fut dans la cent vingt-quatrième olympiade {284-281 av. J.-Chr.} que les habitants de Patras et de Dymé jetèrent les fondements d'un accord, c'est-à-dire vers le moment où moururent Ptolémée, fils de Lagos, Lysimaque, Séleucos et Ptolémée Céraunos ; c'est en effet vers cette olympiade que prit fin la vie de ces divers personnages. Voici quelle était auparavant la situation chez les Achéens. Le premier roi du pays avait été Tisamène, fils d'Oreste, qui, chassé de Sparte par le retour des Héraclides, s'était rendu maître de l'Achaïe ; ses descendants régnèrent sans interruption jusqu'à Ogygès, dont les fils furent détrônés, parce qu'ils gouvernaient despotiquement et n'observaient pas les lois. Les Achéens établirent alors un régime démocratique, qui subsista, malgré bien des vicissitudes, jusqu'à l'époque de Philippe et d'Alexandre. C'était une confédération de douze cités, qui existent encore, à l'exception d'Olen et d'Hélyce (cette dernière fut engloutie par la mer avant la bataille de Leuctres); ce sont : Patras, Dymé, Phares, Tritée, Léontion, Égion, Égire, Pellène, Bura et Céryneé. Entre le règne d'Alexandre et la cent vingt-quatrième olympiade, de telles divisions s'élevèrent et la situation devint si critique, surtout par le fait des rois de Macédoine, que l'union se disloqua et que chaque cité sacrifia l'intérêt général à des considérations particulières. Voilà comment Démétrios et Cassandre, puis Antigone Gonatas purent établir des garnisons dans quelques villes, tandis que dans d'autres s'élevaient des tyrans ; ce fut en effet Antigone qui provoqua dans presque toutes les cités grecques cet avènement de la tyrannie. Mais aux environs de la cent vingt-quatrième olympiade, comme je le disais tout à l'heure, les Achéens reconstituèrent leur confédération; c'était l'époque de l'invasion de Pyrrhus en Italie. Les seuls qui firent d'abord alliance furent les habitants de Dymé, de Patras, de Tritée et de Phares ; c'est pour cela qu'il ne reste pas le moindre monument de cette première ligue. Cinq ans après, Égion chassa sa garnison et entra dans la fédération ; puis ce fut le tour de Bura, qui massacra son tyran ; en même temps, Cérynée adhérait à la ligue. Iséas, tyran de cette dernière ville, se voyait en effet, après l'expulsion de la garde d'Égion et le meurtre du despote de Bura par Margos et les Achéens, entouré de toutes parts d'ennemis prêts à fondre sur lui ; il se démit alors de son pouvoir, reçut des Achéens l'assurance qu'il aurait la vie sauve et laissa Cérynée se joindre aux autres cités achéennes. [2,42] Si l'on me demande pourquoi je reprends les choses de si haut, c'est, en premier lieu, pour faire savoir quand et comment a été rétabli l'antique régime achéen, et quels ont été les premiers ouvriers de cette restauration ; j'ai voulu, en second lieu, prouver non seulement par mes affirmations, mais par les faits eux-mêmes, à quel point les Achéens sont toujours, en politique, restés fidèles à leurs principes d'égalité, de liberté, d'hostilité irréductible contre quiconque cherche, par ses propres moyens ou avec l'appui d'un roi, à les réduire en servitude. C'est ainsi, c'est en suivant cette ligne de conduite qu'ils sont arrivés à la situation que j'ai dite, soit par eux-mêmes, soit grâce à leurs alliés. Les résultats obtenus dans la suite avec cette aide doivent encore être attribués à leur constitution. Ainsi, ils ont pris part à diverses affaires, notamment aux plus belles entreprises des Romains; et jamais ils n'ont voulu tirer le moindre profit de leur succès ; la seule récompense qu'ils aient souhaitée pour les services qu'ils rendaient à leurs alliés, c'était la liberté de tous et l'union de tout le Péloponnèse. C'est ce qu'on verra plus clairement encore par le récit des événements. [2,43] Pendant vingt-cinq ans, les cités dont nous avons parlé conservèrent la même forme cle gouvernement : ou élisait périodiquement un secrétaire et deux stratèges. Au bout de ce temps, on jugea préférable de n'en nommer qu'un seul et de lui confier le soin de toutes les affaires. Le premier qui exerça cette fonction fut Margos de Cérynée. Quatre ans après, Aratos de Sicyone, âgé de vingt ans, délivra sa patrie de la tyrannie par sa vaillance et son audace, puis il la fit entrer dans la confédération achéenne, dont il admirait depuis longtemps la constitution. Huit ans plus tard, élu stratège pour la seconde fois, il surprit l'Acrocorinthe, où était établi Antigone, et s'en rendit maître ; il soulagea ainsi d'une grande crainte tous les habitants du Péloponnèse, délivra Corinthe et la fit à son tour entrer dans la confédération. La même année, il fit encore la même chose pour Mégare. Cela se passait un an avant la défaite qui fit perdre aux Carthaginois toute la Sicile et qui les obligea à payer un tribut aux Romains. Pendant tout le temps qu'Aratos resta à la tête de l'Achaïe, après avoir en si peu de temps réalisé de si grands progrès, toutes ses pensées, toutes ses démarches tendirent vers un but unique : chasser les Macédoniens du Péloponnèse, renverser les gouvernements monarchiques, défendre la liberté de tous et l'indépendance de la patrie. Tant que vécut Antigone Gonatas, il ne cessa de lutter contre ses intrigues, en même temps que contre l'ambition des Étoliens. Mais il avait besoin de sa plus vigilante activité pour déjouer les manoeuvres impudentes et criminelles d'ennemis coalisés qui n'avaient en vue que la destruction de la république achéenne. [2,44] Après la mort d'Antigone, les Achéens conclurent une alliance avec les Étoliens et les soutinrent énergiquement dans leur lutte contre Démétrios : les rivalités et les haines s'éteignirent momentanément, pour faire place à des sentiments de concorde et d'amitié. Démétrios ne régna que dix ans et mourut vers l'époque de la première expédition des Romains en Illyrie; ce qui fit faire de nouveaux progrès à l'oeuvre que les Achéens ne cessaient de poursuivre. En effet, les tyrans du Péloponèse perdaient tout espoir par la mort de Démétrios, qui les avait pour ainsi dire à ses gages ; d'autre part, ils étaient harcelés par Aratos, qui voulait les détrôner : ceux qui cédaient de bon gré, il les comblait de présents et d'honneurs ; ceux qui résistaient, il les menaçait des pires châtiments et de la vengeance des Achéens. Ils se décidèrent enfin à abdiquer, à rendre la liberté à leurs cités et à entrer dans la confédération achéenne. Du vivant même de Démétrios, Lydiadas de Mégalopolis, qui, en homme sagace et avisé, prévoyait comment les choses allaient tourner, avait spontanément déposé le pouvoir pour adhérer à la confédération. Aristomachos, tyran d'Argos, Xénon d'Hermione et Cléonymos de Phlionte renoncèrent également à la royauté et se joignirent à la république d'Achaïe. [2,45] Ces adhésions ayant considérablement augmenté la puissance des Achéens, les Étoliens, peuple d'un caractère violent et ambitieux, en furent jaloux. De plus, ils avaient autrefois partagé l'Acarnanie avec Alexandre et essayé d'en faire autant pour l'Achaïe avec Antigone Gonatas ; ils crurent qu'ils pourraient cette fois y parvenir ; dans cette espérance, ils eurent l'audace de s'aboucher et de s'allier avec Antigone, alors gouverneur de la Macédoine et tuteur du jeune Philippe, ainsi qu'avec Cléomène, roi de Lacédémone. Ils voyaient Antigone, dont l'autorité était solidement établie en Macédoine, animé d'une haine qu'il ne dissimulait pas contre les Achéens, qui lui avaient enlevé l'Acrocorinthe ; et ils pensaient que, s'ils pouvaient encore gagner les Lacédémoniens à leur cause et exciter chez eux les mêmes sentiments d'inimitié, les Achéens, attaqués à propos et de tous les côtés à la fois, seraient aisément écrasés. Leur plan aurait sans doute réussi, s'ils n'avaient, en élaborant leur projet, oublié de considérer un point fort important : c'est qu'ils allaient trouver dans Aratos un adversaire capable de parer à toutes les difficultés. Aussi, après avoir voulu tout bouleverser et cherché aux Achéens une querelle injuste, échouèrent-ils dans leur entreprise et n'arrivèrent-ils qu'à fortifier la situation d'Aratos et de son pays, qu'il dirigeait en ce moment ; car il contrecarrait et faisait échouer fort habilement tous leurs projets. La suite du récit montrera comment il s'y prit. [2,46] Aratos voyait bien que si les Étoliens éprouvaient quelque honte à déclarer ouvertement la guerre aux Achéens, qui leur avaient si récemment rendu service dans leur campagne contre Démétrios, cela ne les empêchait pas de nouer contre eux des intrigues avec Lacédémone ; ils étaient si jaloux des Achéens que non seulement ils n'avaient élevé aucune protestation lorsque Cléomène s'était emparé par surprise de Tégée, de Mantinée et d'Orchomène, villes alliées aux Étoliens et même admises dans leur confédération, mais ils lui en avaient confirmé la possession. Ce peuple, qui naguère saisissait n'importe quel prétexte pour attaquer par ambition des gens qui n'avaient aucun tort envers lui, il le voyait subir de son plein gré une pareille trahison et abandonner volontairement des places ainsi importantes ; et cela, uniquement pour rendre Cléomène plus redoutable aux Achéens. En présence de cette situation, Aratos et tous les autres magistrats de la république achéenne décidèrent que, sans engager la guerre contre personne, on s'opposerait aux entreprises des Lacédémoniens. Ils demeurèrent d'abord dans ces dispositions ; mais ensuite, quand Cléomène osa construire sur le territoire de Mégalopolis une forteresse qu'il nomma Athénéon et que ses intentions hostiles devinrent ainsi manifestes, ils réunirent une assemblée générale, où il fut décrété que les Lacédémoniens seraient officiellement considérés comme ennemis. Telles furent l'origine de la guerre dite de Cléomène et la date où elle éclata. [2,47] Les Achéens n'opposèrent d'abord que leurs propres forces à celles des Lacédémoniens ; ils trouvaient plus beau de ne devoir qu'à eux-mêmes leur salut et celui de leur patrie ; en même temps, ils ne voulaient pas se montrer ingrats envers Ptolémée, leur bienfaiteur, en allant chercher d'autres appuis. La guerre suivait son cours ; Cléomène, qui avait fait une révolution dans son pays et changé en tyrannie la royauté légitime, poussait les opérations avec autant de hardiesse que d'habileté; Aratos qui, dans sa prévoyance, redoutait l'audace effrénée des Étoliens, pensa qu'il fallait commencer par ruiner leurs entreprises. Il connaissait Antigone pour un homme habile, intelligent et à qui l'on pouvait se fier ; il savait d'autre part que les souverains ne considèrent personne comme leur ennemi naturel, mais qu'ils conforment à leurs intérêts leurs sentiments de haine ou d'amitié ; il résolut donc d'entrer en pourparlers avec le roi de Macédoine et de lui proposer une alliance, en lui montrant l'avantage qu'ils trouveraient à s'unir. Mais il ne jugea pas à propos d'agir au su de tout le monde, et cela pour diverses raisons : d'abord, il devait s'attendre à voir Cléomène et les Étoliens contrarier ses projets; ensuite, il risquait de décourager les Achéens, s'il demandait du secours à leurs ennemis et montrait ainsi le peu de fonds qu'il faisait sur eux. Pour éviter ces inconvénients, il décida de mener ses négociations le plus secrètement possible. Il était donc obligé de dire et de faire au grand jour des choses contraires à ses véritables intentions : en affectant des dispositoins tout opposées, il pensait dissimuler l'intrigue qu'il avait nouée. C'est pour cela que dans ses mémoires certains de ses actes sont passés sous silence. [2,48] Aratos voyait que les Mégalopolitains étaient très éprouvés par la guerre, parce que le voisinage de Lacédémone les exposait plus particulièrement à des attaques de ce côté et que les Achéens, aux prises eux-mêmes avec de graves difficultés, ne pouvaient leur envoyer les secours dont ils auraient eu besoin ; de plus il les savait bien disposés pour la maison royale de Macédoine, en raison des services que leur avait rendus Philippe, fils d'Amyntas. Il en conclut qu'ils ne manqueraient pas d'implorer contre Cléomène l'appui d'Antigone et des Macédoniens. Il communiqua donc secrètement ses projets à Nicophanès et à Cercidas, deux Mégalopolitains avec qui sa famille avait d'anciennes relations d'hospitalité et dont le concours pouvait lui être très précieux. Par leur entremise, il amena facilement les Mégalopolitains à envoyer une ambassade aux Achéens pour les engager à demander du secours à Antigone. Les Mégalopolitains déléguèrent Nicophanès et Cercidas auprès des Achéens, d'où ils devaient se rendre sans désemparer chez Antigone, si la confédération y consentait. Les Achéens autorisant la démarche, Nicophanès et son collègue se transportèrent en hâte à la cour du roi et eurent un entretien avec lui ; ils parlèrent fort peu de leur patrie, juste pour dire en quelques mots l'indispensable, et insistèrent principalement sur la situation générale, d'après les avis et les instructions d'Aratos. [2,49] Conformément à ses indications, ils montrèrent à Antigone quel était le but de l'alliance conclue entre les Étoliens et Cléomène, et quels pouvaient en être les effets. « Sans doute, dirent-ils, elle menace d'abord les Achéens ; mais elle est surtout dirigée contre vous. Il est de toute évidence que les Achéens, attaqués des deux côtés, ne seront pas en état de résister ; mais quand les Étoliens et Cléomène les auront vaincus, il est plus clair encore pour quiconque sait réfléchir qu'ils ne se contenteront pas de ce succès et ne s'en tiendront pas là. Loin de se confiner dans les limites du Péloponèse, l'avidité des Étoliens ne sera pas même satisfaite par la conquête de la Grèce entière. L'ambition de Cléomène paraît se borner, pour le moment, à établir sa domination dans le Péloponèse; mais s'il y parvient il cherchera immédiatement à étendre son autorité sur toute la Grèce. Or il ne peut y arriver que par la ruine de l'empire macédonien. Il faut donc vous tenir sur vos gardes, vous montrer prévoyant, examiner si vous avez plus d'intérêt à disputer l'hégémonie à Cléomène dans le Péloponèse, avec le concours des Achéens et des Béotiens, ou à dédaigner l'alliance d'un peuple aussi puissant et en être réduit à vous battre en Thessalie, pour la défense de votre propre pays, contre les Étoliens et les Béotiens unis aux Achéens et aux Lacédémoniens. Si les Étoliens, en reconnaissance des services que les Achéens leur ont rendus sous Démétrios, persistent dans leur attitude pacifique, les Achéens déclareront la guerre à Cléomène; s'ils sont vainqueurs, ils n'auront besoin du secours de personne ; mais s'ils subissent un échec et que les Étoliens se joignent à leurs ennemis, nous vous demandons de prêter à la situation toute votre attention, de ne pas laisser échapper une telle occasion et de porter secours aux Péloponésiens tandis qu'il sera encore temps de les sauver. Vous pouvez compter, en toute sécurité, sur la fidélité et la reconnaissance des Achéens : en concluant le pacte, Aratos trouvera, nous vous en donnons l'assurance, des garanties qui paraîtront satisfaisantes aux deux parties ; il vous fera connaître également le moment où votre intervention devra se produire. » [2,50] Antigone, en les écoutant, trouva les avis d'Aratos justes et sensés ; il suivit les événements avec beaucoup d'attention et écrivit aux Mégalopolitains qu'il ne manquerait pas de leur porter secours, si les Achéens le voulaient bien. Nicophanès et Cercidas revinrent dans leur pays, remirent la lettre du roi, vantèrent son excellent accueil et ses dispositions favorables. Les Mégalopolitains, rassurés, se rendirent en toute hâte à l'assemblée des Achéens pour les engager à appeler Antigone et à lui confier aussitôt la conduite des opérations. Aratos, qui, de son côté, s'était fait dire par Nicophanès et son compagnon dans quels sentiments était le roi à l'égard des Achéens et de lui-même, était enchanté de voir que sa tentative n'avait pas été vaine et qu'Antigone ne se montrait pas son ennemi irréductible, comme l'espéraient les Étoliens. Il trouvait également très heureuse l'idée des Mégalopolitains, de faire offrir par les Achéens la direction des affaires à Antigone. Il cherchait bien, comme je l'ai dit plus haut, à pouvoir se passer de tout secours ; mais si la nécessité le réduisait à en solliciter, il aimait mieux faire la démarche au nom de toute l'Achaïe qu'en son nom personnel. Si le roi intervenait, s'il battait Cléomène et les Lacédémoniens, n'allait-il pas se retourner ensuite contre la république achéenne ? et tout le monde ne rendrait-il pas Aratos responsable de ce qui pouvait en résulter ? Aratos le craignait d'autant plus qu'Antigone avait une raison de lui en vouloir, puisqu'il était l'auteur de l'affront infligé à la maison régnante de Macédoine par la prise de l'Acrocorinthe. Aussi, dès que les Mégalopolitains furent venus dans l'assemblée générale communiquer aux Achéens la lettre du roi, les assurer de son entière bienveillance et les inviter à l'appeler au plus tôt, Aratos, voyant la foule disposée à adopter leur proposition, s'avança, déclara qu'il se félicitait de la sympathie que le roi, leur témoignait et approuva l'opinion de la majorité ; toutefois, il insista longuement auprès de ses concitoyens pour les engager à tenter d'assurer par eux-mêmes le salut de la patrie, car rien n'était à la fois plus beau et plus avantageux ; même si la fortune leur était contraire, il fallait mettre en oeuvre toutes leurs ressources avant d'avoir recours à l'assistance de leurs alliés. [2,51] Les Achéens se rangèrent à son avis et décidèrent de s'en tenir au statu quo, c'est-à-dire de faire face à eux seuls à la guerre qui les menaçait. Mais Ptolémée, voyant qu'il ne pouvait plus compter sur leur alliance, décida d'envoyer des subsides à Cléomène ; il voulait l'exciter contre Antigone parce qu'il croyait pouvoir faire plus de fonds sur les Lacédémoniens que sur les Achéens pour contrarier les projets des rois de Macédoine. Les Achéens, se heurtant à Cléomène au cours d'une marche, furent vaincus une première fois près du mont Lycée ; puis ils subirent un second échec, en bataille rangée, sur le territoire de Mégalopolis dans un endroit nommé Ladocée, et Lydiadas périt dans ce combat ; enfin ils furent complètement défaits dans un engagement général à Hécatombéon, près de Dymé. Alors, aucun atermoiement n'étant plus possible, ils se virent obligés par ce danger pressant de solliciter unanimement l'aide d'Antigone. Aratos envoya au roi son propre fils pour confirmer les conditions de l'alliance. Une très grave difficulté subsistait : il était peu vraisemblable que le roi vînt au secours des Achéens tant qu'on ne lui aurait pas rendu l'Acrocorinthe et livré la ville de Corinthe pour qu'il en fît sa base d'opérations militaires ; et d'autre part, les Achéens ne pouvaient prendre sur eux de remettre la place aux Macédoniens sans l'assentiment des habitants. Aussi la solution de cette question fut-elle différée, pour qu'on eût le loisir d'examiner les garanties qui devraient être données. [2,52] Cléomène, dont les premiers succès avaient répandu la terreur, avançait hardiment de ville en ville, accueilli de bon gré dans les unes, intimidant les autres par des menaces. Il occupa Caphyes, Pellène, Phénéos, Argos, Phlionte, Cléones, Épidaure, Hermione, Trézène et enfin Corinthe ; puis il vint camper devant Sicyone. Les Achéens furent ainsi tirés d'un très grand embarras : les Corinthiens avaient enjoint aux Achéens et à Aratos qui les commandait de sortir de la ville, tandis qu'ils faisaient savoir à Cléomène qu'il pouvait y entrer. C'était pour les Achéens une occasion et un prétexte excellents ; Aratos s'en saisit et livra à Antigone l'Acrocorinthe qu'il occupait encore. Par là, il faisait disparaître le grief que le roi avait contre lui, lui donnait un gage suffisant de sa fidélité pour l'avenir et surtout lui fournissait une base d'opérations contre les Lacédémoniens. Quand Cléomène eut connaissance du traité conclu entre les Achéens et Antigone, il leva son camp de devant Sicyone, vint s'établir dans l'isthme, fortifia d'un retranchement et d'un fossé l'espace compris entre l'Acrocorinthe et les monts Onéiens : il se considérait déjà comme le maître incontesté de tout le Péloponnèse. Mais Antigone se tenait sur ses gardes et suivait attentivement le cours des événements, selon les conseils d'Aratos ; conjecturant, d'après les nouvelles qu'il recevait, que Cléomène ne tarderait pas à pénétrer jusqu'en Thessalie avec son armée, il rappela à Aratos et aux Achéens leurs engagements, puis marcha sur l'isthme à la tête de ses troupes, en passant par l'île d'Eubée. Les Étoliens, en effet, venaient de se signaler par un nouveau trait : pour empêcher Antigone de porter secours aux Achéens, ils lui avaient interdit de franchir en armes le défilé des Thermopyles ; s'il enfreignait leur défense, ils s'opposeraient de vive force à son passage. Antigone et Cléomène campèrent donc en face l'un de l'autre, le premier voulant entrer dans le Péloponèse, le second s'efforçant de l'en empêcher. [2,53] Les Achéens, malgré les pertes écrasantes qu'ils avaient subies, n'abandonnèrent pas pour cela l'oeuvre entreprise et ne se laissèrent pas décourager. Dès qu'à Argos Aristote se fut soulevé contre les partisans de Cléomène, ils lui vinrent en aide et, sous le commandement de leur stratège Timoxénos, s'emparèrent de la place par surprise. C'est grâce à ce succès, semble-t-il, que la situation se modifia en faveur des Achéens ; car ce fut là ce qui arrêta l'élan de Cléomène et refroidit l'ardeur de ses soldats, comme on le verra par la suite. Il avait beau avoir occupé le premier les positions les plus favorables, disposer d'approvisionnements plus abondants que ceux d'Antigone, être plus hardi et plus ambitieux : néanmoins, dès qu'il apprit qu'Argos était tombée entre les mains des Achéens, il renonça à profiter de tous ces avantages et, pour éviter d'être complètement enveloppé par l'ennemi, il opéra une retraite qui ressemblait fort à une fuite. Il se jeta brusquement sur Argos et essaya de s'en rendre maître ; mais au bout de quelque temps, vaillamment combattu par les Achéens et par les Argiens, qui cherchaient par leur attitude énergique à faire oublier leur défaillance, il fut repoussé et dut abandonner son entreprise. Il se remit alors en route, passa par Mantinée et rentra ainsi à Sparte. [2,54] Antigone entra donc sans coup férir dans le Péloponèse et prit possesion de l'Acrocorinthe ; puis, sans s'y arrêter, il continua son chemin et se rendit à Argos. Il prodigua ses éloges aux habitants, fit rentrer la ville dans son état normal et repartit aussitôt pour l'Arcadie. Il chassa les garnisons de tous les forts que Cléomène avait fait élever sur le territoire d'Égys et de Belmina, les confia à la garde des Mégalopolitains et s'en vint à Égion, où se tenait le conseil des Achéens. Il rendit compte de ce qu'il avait fait, exposa son plan pour l'avenir et fut nommé général en chef des alliés. Il prit alors ses quartiers d'hiver du côté de Sicyone et de Corinthe, et y séjourna quelque temps ; puis, au retour du printemps, il se mit en marche ; en trois jours, son armée arriva sous Tégée, où les Achéens vinrent le rejoindre ; il campa devant la place et y mit le siège. Les Macédoniens en menèrent si vivement toutes les opérations, notamment la construction des galeries souterraines, que les habitants désespérèrent bientôt de la situation et capitulèrent, Antigone laisse une garnison à Tégée et, poursuivant sa route, se dirige vers la Laconie à marche forcée. Il rencontre Cléomène, qui gardait les frontières, et le provoque au combat en lui livrant quelques escarmouches. Mais, apprenant par ses éclaireurs que la garnison d'Orchomène venait au secours de Cléomène, il lève le camp immédiatement, marche rapidement sur Orchomène et emporte la place au premier assaut. Puis il va mettre le siège devant Mantinée, dont les habitants, épouvantés à la vue des Macédoniens, s'empressent de leur rendre la place. Il repart encore pour Hérée et Telphuse, qui lui ouvrent leurs portes de plein gré. Enfin, l'hiver approchant, il retourna à Égion pour assister au conseil des Achéens ; il renvoya tous ses Macédoniens passer la mauvaise saison dans leur pays et resta lui-même chez les Achéens pour délibérer avec eux sur la situation. [2,55] Cependant Cléomène voyait que l'armée macédonienne était licenciée, qu'Antigone n'avait avec lui que ses mercenaires et séjournait à Égion, à trois jours de marche de Mégalopolis ; il savait non seulement que la ville était difficile à garder à cause de son étendue et du petit nombre de ses habitants, mais que ce service était fait négligemment parce qu'Antigone était à proximité et surtout parce que la plupart des citoyens adultes avaient péri dans les batailles du Lycée et de Ladocée. Avec la complicité de quelques Messéniens exilés qui se trouvaient à Mégalopolis, il se glissa de nuit dans la place. Mais quand le jour fut venu, les Mégalopolitains lui opposèrent une résistance si courageuse qu'il fut sur le point non seulement d'être obligé de se retirer, mais même de subir un désastre complet. La même chose lui était déjà arrivée trois mois auparavant, quand il avait réussi à pénétrer dans la ville par le quartier qu'on appelle le Coléos; mais cette fois, comme il avait une armée très nombreuse et qu'il avait occupé les points stratégiques importants, il arriva à ses fins : il chassa les habitants, resta maître de la ville et la saccagea avec un acharnement si féroce qu'on avait perdu toute espérance de jamais pouvoir la relever. Il agit ainsi, je crois, parce que les Mégalopolitains étaient les seuls, avec les habitants de Stymphales, chez qui il n'avait jamais pu, en aucune circonstance, trouver un partisan ou un complice qui trahît sa patrie pour lui. A Clitor, il n'y eut qu'un seul homme, Théarcès, qui ternit par son infamie la réputation qu'avaient ses concitoyens d'être courageux et d'aimer la liberté; aussi les habitants ne sont-ils pas mal fondés à prétendre qu'il n'était pas leur compatriote, mais le bâtard d'un des soldats qu'on leur avait envoyés d'Orchomène. [2,56] Comme pour l'histoire de cette époque il y a des gens qui donnent la préférence au récit de Phylarchos sur celui d'Aratos, avec lequel il présente souvent des divergences et des contradictions, j'ai jugé utile, nécessaire même, de ne pas négliger d'expliquer pour quoi je préfère suivre Aratos dans la relation de la guerre de Cléomène : il ne faut pas laisser les écrits mensongers acquérir la même autorité que les véridiques. C'est au cours de tout son ouvrage que Phylarchos parle souvent à la légère et sans discernement ; mais sur les autres points que celui dont nous nous occupons maintenant, ce n'est pas le moment d'entreprendre une critique ou une enquête générale ; c'est seulement sur ce qui concerne la guerre de Cléomène que doit porter notre examen ; ce sera d'ailleurs tout à fait suffisant pour faire savoir dans quel esprit tout son ouvrage est écrit et combien il était peu fait pour traiter un sujet de ce genre. Pour bien montrer quelle était la cruauté d'Antigone et des Macédoniens comme celle d'Aratos et des Achéens, il déclare qu'après sa soumission Mantinée fut affligée des pires calamités ; que cette ville, la plus ancienne et la plus grande de toute l'Arcadie, subit un traitement si affreux que tous les Grecs en furent émus jusqu'aux larmes. Pour toucher les lecteurs de pitié et de compassion, il met sous leurs yeux des femmes qui s'embrassent, des chevelures éparses, des seins mis à nu ; il leur fait entendre les pleurs et les gémissements des hommes et des femmes, des enfants et des vieux parents qu'on enlève pêle-mêle. Tel est le procédé dont il use dans toute son histoire, pour étaler continuellement à notre vue toutes les atrocités commises. Il faut dédaigner cette méthode pour ce qu'elle a de vulgaire et de puéril ; un ouvrage historique ne doit viser qu'aux qualités propres du genre et, notamment, à l'utilité pratique. Un historien ne doit pas essayer de frapper ses lecteurs en racontant des choses merveilleuses, de reproduire les discours qui ont pu être tenus, d'énumérer toutes les conséquences possibles de chaque événement ; il faut laisser cela aux poètes tragiques ; son rôle, à lui, est de faire une relation fidèle de tout ce qui s'est dit ou fait, quelque ordinaire que cela paraisse. Car le but de l'histoire n'est pas le même que celui de la tragédie ; il en est au contraire fort différent. Le drame cherche à émouvoir les assistants et à charmer leur esprit pour un moment en donnant à ses fictions la plus grande vraisemblance possible; l'histoire s'efforce de faire oeuvre durable en rapportant exactement les actions et toutes les paroles des hommes pour l'instruction et l'édification de ceux qui s'adonnent à cette étude. L'un, qui ne vise qu'à distraire les spectateurs, fait usage du faux, pourvu qu'il soit vraisemblable ; l'autre, dont le but est d'être utile aux lecteurs, s'en tient à la vérité. En outre, Phylarchos nous raconte la plupart des événements sans nous dire quelle en fut la cause ni de quelle manière ils se sont produits; il est cependant nécessaire de le savoir pour pouvoir raisonnablement être ému de pitié ou saisi d'indignation. Qui ne considère comme un spectacle affreux de voir frapper un homme libre ? Et pourtant, si ce traitement n'est que la punition d'un crime, on reconnaît qu'il est mérité ; s'il est destiné à corriger ou à instruire, on ira même jusqu'à féliciter et-à remercier ceux qui l'infligent. Faire périr des citoyens passe pour un forfait monstrueux, digne des pires châtiments; néanmoins, l'homme qui tue un voleur ou un adultère est assuré de l'impunité, celui qui met à mort un traître ou un tyran est comblé d'honneurs et de récompenses. Tant il est vrai qu'on ne doit jamais fonder ses jugements sur les actes eux-mêmes, mais sur leurs causes, sur les intentions de ceux qui agissaient et sur la différence de ces mobiles. [2,57] Pour en revenir aux Mantinéens, ils se séparèrent d'abord volontairement de la confédération achéenne, pour livrer leur patrie aux Étoliens, puis à Cléomène. Ils avaient ainsi changé de camp et s'étaient rattachés à l'empire de Sparte, lorsque, quatre ans avant l'intervention d'Antigone, leur ville avait été reprise par les Achéens, grâce aux habiles manoeuvres d'Aratos. Or en cette circonstance leur trahison fut si loin d'être cruellement punie que cette affaire devint précisement célèbre par le brusque changement qui se manifesta dans les dispositions des deux peuples. Dès la prise de la ville, Aratos donna l'ordre à ses soldats de ne toucher à rien de ce qui ne leur appartenait pas ; puis il assembla les Mantinéens, les exhorta à demeurer chez eux en toute confiance et leur promit qu'ils n'auraient rien à craindre en rentrant dans la confédération des Achéens. Cette solution absolument inespérée changea aussitôt du tout au tout les sentiments des Mantinéens. Ces mêmes Achéens, contre lesquels ils avaient combattu si peu de temps auparavant, par qui ils avaient vu tuer ou blesser grièvement tous les leurs, ils les reçurent chez eux, en firent les hôtes de leur foyer et de leur famille, échangèrent avec eux tous les témoignages possibles d'amitié. Et c'était justice; car je ne sais si jamais personne a rencontré des ennemis plus généreux et s'est tiré d'une situation aussi critique avec moins de mal que n'en éprouvèrent alors les Mantinéens, grâce à l'humanité dont Aratos et les Achéens firent preuve à leur égard. [2,58] Plus tard, craignant les séditions qui menaçaient de s'élever parmi eux et les machinations des Étoliens et des Lacédémoniens, ils demandèrent aux Achéens de leur envoyer des troupes de renfort. On y consentit et on tira au sort trois cents hommes, qui, abandonnant leur patrie et leurs biens, vinrent s'établir à Mantinée pour défendre la vie et la liberté des habitants. On leur adjoignit encore deux cents mercenaires pour les aider à garder la ville. Mais au bout de quelque temps une nouvelle sédition éclata ; les Mantinéens appelèrent les Lacédémoniens, leur livrèrent la place et massacrèrent le détachement achéen qui y était en garnison. C'était là la trahison la plus criminelle qu'on puisse imaginer ; car s'ils faisaient bon marché de la reconnaissance et de la fidélité qu'ils devaient aux Achéens, ils avaient tout au moins le devoir de respecter leur vie et d'accorder un sauf-conduit à tous ceux qui se trouvaient chez eux, comme le droit des gens veut qu'on le fasse même pour des ennemis. Ce fut pour donner à Cléomène et aux Lacédémoniens des gages suffisants de leur bonne volonté que les Mantinéens violèrent les lois universelles de l'humanité et commirent de propos délibéré cet attentat abominable. Tuer de leurs propres mains des hommes qui, maîtres de leur ville, avaient laissé tous leurs torts impunis, des hommes qui étaient là maintenant pour veiller à leur salut et à leur liberté : quelle indignation ne doit pas soulever une telle perfidie ? quel châtiment infliger qui égale un pareil forfait? Ils méritaient, dira-t-on, d'être vendus, une fois pris avec leurs femmes et leurs enfants. Mais les lois de la guerre permettent de traiter ainsi même les vaincus qui ne sont coupables d'aucun crime. C'est une vengeance plus rigoureuse encore qu'on était en droit d'exercer contre les Mantinéens ; de sorte que, même si ce que dit Phylarchos était vrai, leur sort ne devait pas inspirer aux Grecs la moindre pitié : ceux qui les auraient ainsi punis de leur sacrilège auraient droit plutôt à nos félicitations et à nos éloges. Mais en fait, on se borna à mettre leurs biens au pillage et à vendre les personnes libres à l'encan. Malgré cela, Phylarchos, pour introduire du merveilleux dans son récit, invente fable sur fable, et même des fables sans vraisemblance ; son ignorance est telle qu'il est incapable de faire le moindre rapprochement avec les faits contemporains : il ne se demande pas comment il se fait que les mêmes Achéens, s'étant emparés de Tégée à peu près en même temps, n'y firent rien de semblable à ce qu'il rapporte pour Mantinée. Cependant, si la seule cruauté avait inspiré la conduite des Achéens, il est bien probable qu'ils auraient agi de la même manière à l'égard d'une ville conquise dans les mêmes conditions. Si les Mantinéens ont été traités avec une rigueur particulière, c'est évidemment parce que les vainqueurs avaient une raison particulière de se montrer sévères envers eux. [2,59] Phylarchos raconte ensuite comme quoi Aristomachos d'Argos, homme de la plus haute naissance, tyran de son pays, né d'une lignée de tyrans, fut fait prisonnier par Antigone et les Achéens, emmené à Cenchrées et mis à mort au milieu des tortures les plus douloureuses, les plus révoltantes qu'on puisse faire souffrir à un être humain. Usant encore ici de son procédé ordinaire, l'historien imagine que les cris de la victime viennent, pendant la nuit, frapper les oreilles des gens du voisinage: les uns sont glacés d'horreur ; les autres refusent de croire à tant de cruauté; d'autres, indignés, se précipitent vers la maison où il était enfermé. Mais en voilà assez sur ces contes fantastiques ; pour moi, je pense que, même si les Achéens n'avaient aucun grief spécial contre Aristomachos, toute sa conduite et ses crimes envers sa patrie le rendait digne des pires châtiments. Phylarchos essaye vainement de rehausser son personnage, pour faire partager son indignation à ses lecteurs, en rappelant que non seulement Aristomachos était tyran lui-même, mais qu'il était issu de tyrans : c'était l'accusation la plus grave, la plus terrible qu'on pût articuler contre lui. Ce nom seul implique l'idée des plus odieuses scélératesses, il suffit à évoquer l'image de toutes les violences et de tous les crimes qui se puissent commettre sur la terre. Et quand bien même Aristomachos aurait subi réellement le châtiment cruel dont parle notre auteur, il y avait dans son existence un jour qu'aucune peine ne pouvait expier ; c'était celui où, Aratos et les Achéens étant entrés par surprise clans Argos, ayant soutenu une lutte acharnée pour essayer de rendre la liberté aux Argiens, mais ayant fini par être repoussés, parce que les partisans qu'ils avaient en ville avaient eu peur du tyran et n'avaient pas osé prendre les armes pour les soutenir, Aristomachos avait saisi cette occasion et ce prétexte pour accuser certains citoyens de complicité avec les Achéens et pour faire mettre à mort quatre-vingts des notables de la ville qui n'y étaient pour rien. Je passe sur tous ses autres crimes, sur ceux de ses ancêtres : nous n'en finirions pas ! [2,60] En somme, il n'y a pas lieu de crier à l'injustice si Aristomachos a souffert quelques-uns des maux qu'il avait infligés à ses semblables ; il serait bien plus fâcheux qu'il fût mort dans l'impunité, sans en avoir fait l'épreuve à son tour. Il ne faut pas non plus accuser d'inhumanité Antigone et Aratos, pour avoir fait périr dans les supplices le tyran qu'ils avaient pris par la force des armes : ils l'auraient arrêté et frappé en temps de paix, que les esprits droits n'auraient pour eux que de l'estime et des éloges. Que ne méritait-il pas, lui qui venait d'ajouter à la liste de ses forfaits une nouvelle perfidie à l'égard des Achéens? Peu de temps auparavant, réduit à la dernière extrémité par la mort de Démétrios, il s'était démis du pouvoir et avait trouvé auprès des Achéens un accueil d'une douceur et d'une bienveillance inespérées : loin de lui faire payer les crimes qu'il avait commis pendant sa tyrannie, ils l'avaient admis dans leur confédération et lui avaient conféré leur plus haute dignité, en le mettant à la tête de leurs troupes avec le titre de stratège. Mais il oublia aussitôt tous ces bienfaits, et dès qu'il vit briller l'espérance de se rétablir par le moyen de Cléomène, il quitta le parti des Achéens et le fit quitter à sa patrie pour passer à l'ennemi au moment où l'on avait le plus grand besoin de son concours. Quand on l'eut pris, ce n'était pas à Cenchrées, ce n'était pas pendant la nuit qu'on aurait dû le torturer et le tuer, comme Phylarchos le raconte : il fallait le traîner à travers tout le Péloponnèse, pour donner à chacun son châtiment et sa mort en exemple. Mais en réalité, on se contenta de le faire jeter à la mer par les soins des autorités de Cenchrées. [2,61] Notre homme décrit encore avec éloquence et non sans quelque exagération les malheurs des Mantinéens ; il s'imagine évidemment que le devoir des historiens se borne à rapporter les mauvaises actions. Mais la grandeur d'âme dont les Mégalopolitains ont fait preuve à la même époque, il n'en dit pas un mot ; comme si le rôle de l'historien était plutôt d'énumérer les défaillances des hommes que leurs actes justes et beaux ! comme si les lecteurs étaient moins édifiés par le récit des actions louables et vertueuses que par celui des forfaits les plus condamnables ! Comment Cléomène prit Mégalopolis, comment il empêcha que rien fût détruit et envoya aussitôt un courrier à Messène pour demander aux Mégalopolitains de se rallier à sa cause en faveur de la clémence dont il usait envers leur patrie, tout cela, Phylarchos l'a raconté, pour exalter la grandeur d'âme et la modération de Cléomène. Il rappelle également comme quoi les Mégalopolitains ne laissèrent pas lire sa lettre jusqu'au bout et faillirent tuer à coups de pierres les messagers qui l'apportaient ; mais il a négligé un devoir essentiel de l'historien et une tâche qui lui est propre, en ne faisant pas une mention élogieuse de leurs nobles sentiments. L'occasion, pourtant, était belle. On considère comme d'honnêtes gens ceux qui s'engagent seulement à supporter le poids d'une guerre pour venir en aide à leurs amis et à leurs alliés; on comble d'éloges, que dis-je,! d'actions de grâces et de présents ceux qui consentent, pour la même cause, à voir leur pays ravagé, leur ville assiégée ; que doit-on penser, alors, des Mégalopolitains ? Ne méritent-ils pas toute notre estime, tout notre respect ? Ils acceptèrent, d'abord, de voir leur pays envahi par Cléomène ; puis, leur fidélité aux Achéens causa la ruine complète de leur patrie ; enfin, quand l'occasion la plus inespérée se présenta pour eux de la recouvrer saine et sauve, ils aimèrent mieux rester privés de leurs terres, de leurs tombeaux, de leurs sanctuaires, de leur patrie, de leurs biens, en un mot de tout ce que les hommes ont de plus cher, que de trahir la parole donnée à leurs alliés. A-t-on jamais rien vu, pourrait-on rien voir de plus admirable ? Y a-t-il une action sur laquelle un historien soit mieux fondé à arrêter l'esprit de ses lecteurs ? Trouverait-on un meilleur exemple pour nous inciter à tenir nos promesses ou à nous attacher aux causes justes et sûres? Or Phylarchos n'en a pas fait la moindre mention, parce qu'il était incapable, à mon avis, de discerner les actions les plus belles, les plus dignes de retenir l'attention d'un historien. [2,62] Phylarchos déclare ensuite que sur le butin fait à Mégalopolis il revint aux Lacédémoniens six mille talents, dont deux mille furent, suivant l'usage, donnés à Cléomène comme gratification. Qui ne trouverait singulier de le voir ignorer aussi profondément ce que tout le monde sait sur les ressources et les richesses de la Grèce ? Un historien devrait pourtant être bien renseigné à ce sujet. Je ne parle pas des temps où le Péloponèse s'est trouvé complètement ruiné par les rois de Macédoine et surtout par les guerres intestines qui y ont sévi sans interruption, mais de notre époque, où l'union de tous ses peuples a donné à la péninsule une très grande prospérité : eh bien ! même aujourd'hui, on ne tirerait pas une pareille somme de tout ce que possèdent les habitants du Péloponèse, à moins de vendre leur propre personne. Et je ne dis pas cela à la légère, mais en me fondant sur des raisons sérieuses. En voici la preuve. Tout le monde sait que, quand les Athéniens se liguèrent avec les Thébains contre les Lacédémoniens, qu'ils armèrent dix mille hommes et équipèrent cent vaisseaux, ils votèrent, pour subvenir aux frais de la guerre, un impôt proportionnel sur le capital et firent, en conséquence, évaluer toutes les terres de l'Attique, tous les immeubles et, d'une façon générale, tout ce que chacun possédait ; or le total obtenu par l'estimation n'atteignit pas cette somme de six mille talents : il s'en fallait de deux cent cinquante. Il n'y a donc rien que de très vraisemblable dans ce que j'avançais tout à l'heure au sujet du Péloponèse ; et pour Mégalopolis, personne, quelque envie qu'il ait d'exagérer, n'oserait prétendre qu'on ait pu à cette époque en tirer plus de trois cents talents, puisque — c'est un fait bien établi — la plupart des hommes libres et des esclaves s'étaient enfuis à Messène. Autre argument, et celui-ci capital, en faveur de ma thèse : d'après Phylarchos lui-même, la première ville de l'Arcadie pour son importance et sa richesse était Mantinée ; or, quand elle eut capitulé à la suite d'un siège, sans que personne pût s'enfuir ni rien dissimuler de ce qui lui appartenait, le butin que firent alors les vainqueurs, y compris ce que rapporta la vente des prisonniers, ne dépassa pas trois cents talents. [2,63] La suite n'est-elle pas encore plus étrange? Il raconte qu'une dizaine de jours avant la grande bataille Ptolémée avait fait dire à Cléomène qu'il cessait de le ravitailler et qu'il l'engageait à faire la paix avec Antigone ; Cléomène aurait alors décidé de tenter immédiatement les chances d'un combat décisif, avant que ses troupes pussent connaître la nouvelle, parce qu'il ne pourrait certainement pas leur payer leur solde avec ses propres ressources. Mais si, à ce moment, il avait eu à sa disposition six mille talents, il eût été plus riche encore que Ptolémée ! N'en eût-il que trois cents, c'était bien suffisant pour subvenir sans aucune peine aux frais de la guerre contre Antigone! Soutenir en même temps que Cléomène ne pouvait se passer des subsides de Ptolémée et qu'il avait en mains de pareilles richesses, n'est-ce pas l'indice d'une ineptie rare et d'un manque absolu de réflexion? Phylarchos a commis encore bien d'autres bévues du même genre à propos du temps dont nous parlons et dans tout le cours de son histoire ; mais je ne crois pas pouvoir insister davantage là-dessus sans sortir de mon sujet. [2,64] Après la prise de Mégalopolis, tandis qu'Antigone était encore dans ses quartiers d'hiver à Argos, Cléomène profita des premiers beaux jours pour se mettre en marche : il adressa à ses troupes les encouragements de circonstance et envahit le territoire d'Argos. De l'avis de bien des gens, c'était une tentative d'une excessive témérité, parce que tous les passages qui donnent accès dans le pays étaient fortifiés ; mais, à bien considérer les choses, il n'avait rien à craindre et se conduisait en homme avisé. Sachant qu'Antigone avait congédié ses soldats, il voyait bien, d'abord, qu'il pouvait faire son incursion sans danger, puis que, s'il dévastait la contrée jusqu'au pied des murs de la ville, ce spectacle irriterait les Argiens, qui s'en prendraient à Antigone. Si ce dernier, plutôt que de supporter les reproches du peuple, faisait une sortie et se harsardait à combattre avec les troupes qui lui restaient, Cléomène avait tout lieu d'escompter une victoire facile ; s'il s'en tenait à son premier système et demeurait immobile, le roi de Sparte pensait bien pouvoir revenir sans être inquiété d'une expédition qui inspirerait autant de confiance à ses soldats que de terreur à l'ennemi. Ce fut en effet ce qui arriva. Les gens du peuple, voyant leur pays ravagé, allaient, en s'attroupant, invectiver Antigone ; mais, maître de lui comme il convenait à un général et à un roi, il ne voulut pas tenter une entreprise déraisonnable et ne bougea pas. Cléomène fit comme il l'avait projeté : il dévasta la contrée, remplit ses ennemis d'effroi, enhardit et aguerrit ses troupes, puis retourna tranquillement dans son pays. [2,65] Quand l'été fut venu, les Macédoniens et les Achéens sortirent de leurs quartiers d'hiver ; Antigone se mit à leur tête et marcha sur la Laconie avec ses soldats et ses alliés. Il avait, en fait de troupes macédoniennes, une phalange composée de dix mille hommes, un corps d'infanterie légère de trois mille, un escadron de cavalerie de trois cents ; puis venaient mille Agréens et autant de Gaulois, un contingent de mercenaires comprenant trois mille fantassins et trois cents cavaliers, un corps d'infanterie achéenne formé de trois mille hommes d'élite, mille Mégalopolitains armés à la macédonienne et commandés par leur compatriote Cercidas ; comme alliés, deux mille fantassins et deux cents cavaliers béotiens, mille fantassins et cinquante cavaliers épirotes, autant d'Acarnaniens, enfin seize cents Illyriens sous les ordres de Démétrios de Pharos; soit en tout à peu près vingt-huit mille hommes de pied et douze cents à cheval. Cléomène s'attendait à cette invasion ; il faisait garder tous les passages, qu'il avait fortifiés avec des fossés et des abatis d'arbres ; quant. à lui, il campait avec son armée, qui comptait environ vingt mille hommes, à un endroit nommé Sellasie ; d'après ses conjectures, c'était par là que l'ennemi devait essayer d'entrer. Il ne se trompait point. Le défilé où il se trouvait est dominé par deux collines, dont l'une s'appelle l'Évas, l'autre l'Olympe; entre les deux coule une rivière, l'OEnonte, sur le bord de laquelle passe la route qui conduit à Sparte. Cléomène avait fait tracer devant ces deux hauteurs un fossé flanqué d'un retranchement ; il avait posté sur l'Évas les tributaires laconiens et les alliés, sous les ordres de son frère Euclidas ; lui-même s'établit sur l'Olympe avec les Lacédémoniens et les mercenaires. En arrivant, Antigone vit combien la position des Spartiates était forte ; il constata que Cléomène avait fait occuper d'avance chacun des points importants par le corps de troupes le mieux approprié à cette destination et qu'il avait si bien pris ses dispositions que toute son armée avait une attitude analogue à celle des escrimeurs expérimentés quand ils vont engager le combat : il avait tout prévu aussi bien pour l'attaque que pour la parade ; il avait à la fois un ordre de bataille des plus solides et un campement inabordable. Aussi Antigone n'eut-il pas la témérité d'engager la bataille immédiatement. [2,66] Il y avait à quelque distance une rivière nommée le Gorgylos ; Antigone alla se mettre à l'abri derrière la vallée de ce cours d'eau. Il resta là quelques jours à étudier la topographie de la région et le caractère des différents corps de troupes. En même temps, il faisait semblant de méditer quelques entreprises, pour amener les ennemis à découvrir la tactique qu'ils comptaient suivre. Mais comme il ne pouvait surprendre aucun point négligemment gardé ou mal défendu et qu'il trouvait toujours Cléomène prêt à lui tenir tête, il renonça à ce projet. Les deux adversaires résolurent enfin, d'un commun accord, de livrer une bataille qui déciderait du sort de la campagne. C'étaient deux généraux d'une valeur égale que la fortune mettait ainsi aux prises. En face de ceux qui occupaient le mont Évas, Antigone posta les Macédoniens armés de boucliers de bronze et les Illyriens, en faisant alterner les bataillons des deux nations ; ils étaient commandés par Alexandre, fils d'Acmétos, et par Démétrios de Pharos ; derrière eux venaient les Acarnaniens et les Crétois, puis, en dernière ligne, un corps de réserve de deux mille Achéens. Sa cavalerie, dont le chef s'appelait également Alexandre, était opposée à celle de l'ennemi sur les bords de l'Oenonte ; elle était appuyée par mille fantassins achéens et autant de Mégalopolitains. Le roi lui-même, à la tête de ses Macédoniens et des mercenaires, prit position devant le mont Olympe, pour faire face à Cléomène ; il avait placé au premier rang les mercenaires, puis la phalange macédonienne, partagée elle-même en deux tronçons qui venaient l'un derrière l'autre ; le peu de largeur du défilé l'avait obligé à adopter cette disposition. Les Illyriens devaient commencer l'attaque de la colline quand ils verraient un linge levé en l'air du côté de l'Olympe ; car ils étaient allés pendant la nuit s'établir sur les rives du Gorgylos, au pied même du mont Évas; pour les Mégalopolitains et les cavaliers, le signal était une étoffe de pourpre qu'on devait élever à l'endroit où était le roi. [2,67] Quand le moment fut arrivé, que le signal eut été donné aux Illyriens et qu'on eut exhorté ceux qui allaient engager l'action à bien faire leur devoir, ils se montrèrent tous aussitôt et s'élancèrent à l'assaut de la colline. Les soldats armés à la légère, qui avaient d'abord été adjoints à la cavalerie de Cléomène, voyant que les bataillons achéens n'étaient pas protégés sur leurs derrières, vinrent les attaquer en queue; le corps qui montait à l'assaut se trouva alors en très grand danger, pris qu'il était entre Euclidas, qui le dominait et le menaçait de front, et les mercenaires, qui l'avaient tourné et le pressaient vivement. En ces conjonctures, Philopoemen de Mégalopolis comprit la gravité de la situation et prévit ce qui allait en résulter : il voulut en avertir les chefs, mais on ne l'écouta point, parce qu'il n'avait jamais commandé et qu'il était encore tout jeune. Il appela donc ses concitoyens aux armes et se jeta hardiment sur l'ennemi. Aussitôt, les mercenaires qui combattaient en queue le corps en marche, entendant des cris et voyant la cavalerie aux prises avec l'ennemi, cessent leur attaque et reviennent à leur poste primitif pour porter secours aux cavaliers de leur parti. C'est ainsi que les Illyriens, les Macédoniens et leurs compagnons, délivrés de ce souci, purent marcher à l'ennemi vivement et sans crainte. Comme on le vit clairement par la suite, c'est donc à Philopoemen que l'on dut l'avantage remporté sur Euclidas. [2,68] On raconte qu'après la bataille Antigone demanda à Alexandre, commandant de la cavalerie, pourquoi il était entré en ligne avant que le signal fût donné ; l'autre déclara qu'il n'y était pour rien, que c'était contre sa volonté que l'action avait été engagée par un petit jeune homme de Mégalopolis : « Eh bien, lui dit le roi, ce petit jeune homme, en agissant au bon moment, a eu le coup d'oeil d'un grand général, et c'est toi, le général, qui t'es conduit comme un simple petit jeune homme. » Euclidas, voyant les bataillons ennemis monter à l'assaut, ne pensa point à profiter de la supériorité de sa position : il aurait dû s'avancer de loin à leur rencontre, fondre sur eux, rompre leurs rangs, les disperser, puis rétrograder et regagner les hauteurs petit à petit, sans courir aucun risque. Par cette manoeuvre, il aurait jeté la confusion dans l'armée macédonienne, lui aurait fait perdre tout l'avantage qu'elle devait à son armement et à la manière dont elle était rangée, et l'eût facilement mise en fuite grâce à la position si favorable qu'il occupait. Mais il n'en fit rien et, comme si la victoire lui était acquise d'emblée, il agit tout au rebours : il resta sur les sommets où il avait dès l'abord été posté, sans doute pour laisser les ennemis monter le plus haut possible et les obliger à fuir par des pentes extrêmement raides et escarpées. Ce fut naturellement le contraire qui arriva : comme il ne s'était pas réservé d'espace où il pût se replier, l'attaque des bataillons macédoniens qui s'avançaient intacts et en bon ordre le mit dans une situation des plus critiques : il fut réduit à combattre sur la crête même de la montagne, et l'armée ennemie, aussi pesamment armée que solidement organisée, eut bientôt raison de lui: les Illyriens n'eurent pas de peine à occuper le sommet, de sorte que les troupes d'Euclidas, qui, comme je l'ai dit, ne s'étaient pas réservé l'espace nécessaire pour pouvoir se replier et changer de place, furent refoulées et durent prendre la fuite dans les conditions les plus fâcheuses, le long de pentes abruptes et presque impraticables. [2,69] Cependant la cavalerie donnait ; celle des Achéens, et en particulier Philopoemen, se conduisait vaillamment : tous sentaient que du sort de la bataille dépendait leur liberté. Philopoemen eut un cheval tué sous lui ; et, tandis qu'il combattait à pied, il reçut un coup terrible, qui lui traversa les deux cuisses. Du côté de l'Olympe, les deux rois avaient fait engager l'action par les soldats armés à la légère et par les mercenaires, dont ils avaient chacun environ cinq mille. Que l'on combattît par corps ou que la mêlée fut générale, les deux partis se signalaient également par leur ardeur ; car la bataille avait lieu sous les yeux des deux souverains et des deux armées. Homme contre homme, rang contre rang, tous luttaient avec acharnement. Cléomène, voyant son frère en déroute et sa cavalerie, dans la plaine, sur le point de lâcher pied, craignit d'être complètement enveloppé par l'ennemi et se trouva forcé de détruire ses retranchements pour faire sortir de front toutes ses troupes par un seul côté du camp. De part et d'autre, les trompettes donnèrent à l'infanterie légère le signal de laisser libre l'intervalle qui séparait les deux armées; et à grands cris, la lance baissée, les deux phalanges se précipitèrent l'une sur l'autre. La lutte fut ardente: tantôt les Macédoniens reculaient, pressés par la vaillance des Laconiens ; tantôt les Lacédémoniens pliaient sous le poids de l'armée macédonienne. Enfin les soldats d'Antigone, s'avançant en rangs serrés, la lance en avant, fondirent sur les Spartiates avec cette violence qui fait la force particulière de la phalange compacte et les repoussèrent hors de leurs retranchements. Les vaincus s'enfuirent en désordre et furent massacrés. Cléomène, avec quelques cavaliers, réussit à regagner Sparte. Il en repartit la nuit suivante pour Gythion, où depuis longtemps il faisait tenir prêts quelques navires pour parer à toute éventualité, et s'embarqua avec ses amis pour Alexandrie. [2,70] Antigone entra à Sparte sans difficulté. Il traita les habitants avec beaucoup de générosité et d'humanité ; il rétablit l'ancienne constitution ; puis, au bout de quelques jours, il quitta la ville avec son armée, sur la nouvelle que les Illyriens avaient envahi la Macédoine et ravageaient le pays. C'est toujours ainsi que la fortune se plaît à donner un tour inattendu aux événements les plus considérables. Si Cléomène avait retardé la bataille de quelques jours seulement, si après sa déroute il avait séjourné tant soit peu à Sparte pour essayer de se ressaisir, il aurait conservé la royauté. Quant à Antigone, en passant à Tégée, il rétablit là aussi l'ancienne constitution ; puis, deux jours après, il se rendit à Argos, où il arriva juste au moment où l'on célébrait les jeux néméens. Il y reçut, de toute la confédération achéenne et de chaque cité en particulier, tous les honneurs qui pouvaient assurer l'immortalité à son nom et à sa gloire ; puis il revint à marche forcée en Macédoine. Là, il surprit les Illyriens, leur livra bataille et les vainquit ; mais les cris qu'il poussa pendant le combat pour encourager ses soldats provoquèrent un vomissement de sang, qui fut suivi d'une maladie dont il mourut en peu de temps. Les Grecs avaient fondé sur lui les plus belles espérances, non seulement à cause de sa valeur militaire, mais surtout pour la parfaite honnêteté de sa conduite. Il laissa le trône de Macédoine à Philippe, fils de Démétrios. [2,71] Si je me suis étendu aussi longuement sur cette guerre, c'est que l'époque où elle eut lieu touche à celle dont je dois faire l'histoire ; j'ai donc jugé utile, ou plutôt nécessaire, pour suivre le programme que je me suis tracé, de montrer clairement quelle était alors la situation en Macédoine et en Grèce. C'est vers la même date {221 av. J.-Chr.} que, Ptolémée étant mort de maladie, Ptolémée dit Philopator lui succéda et que Séleucos, fils de Callinicos surnommé le Barbu, fut remplacé sur le trône de Syrie par son frère Antiochos. Il arriva à ces rois à peu près la même chose qu'à ceux qui, après la mort d'Alexandre, avaient régné les premiers dans les trois mêmes pays, c'est-à-dire à Séleucos, à Ptolémée et à Lysimaque : ceux-ci étaient tous morts vers la cent vingt-quatrième olympiade, comme je l'ai dit plus haut ; ceux-là moururent tous vers la cent trente-neuvième. Voici donc terminé le préambule et comme l'introduction de tout mon ouvrage : j'ai fait connaître quand, comment et pourquoi les Romains, une fois maîtres de l'Italie, ont commencé à vouloir étendre leurs conquêtes au dehors et osé disputer aux Carthaginois l'empire de la mer ; j'ai montré quelle était alors la situation en Grèce, en Macédoine et aussi à Carthage. Puisque me voici arrivé aux événements où j'avais dès le début l'intention d'en venir, c'est-à-dire aux temps où la Grèce se préparait à entreprendre la guerre sociale, les Romains celle d'Hannibal et les rois d'Asie la campagne de Coelé-Syrie, il faut arrêter ici ce livre, où l'on a vu la fin des événements antérieurs et la mort des souverains qui y avaient pris part.