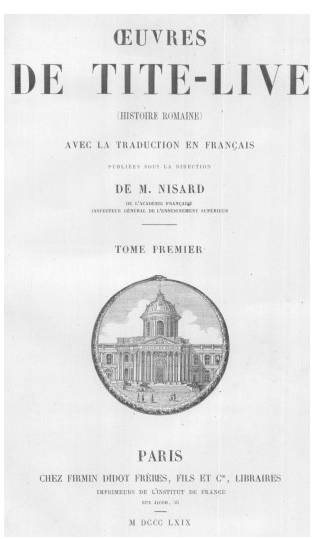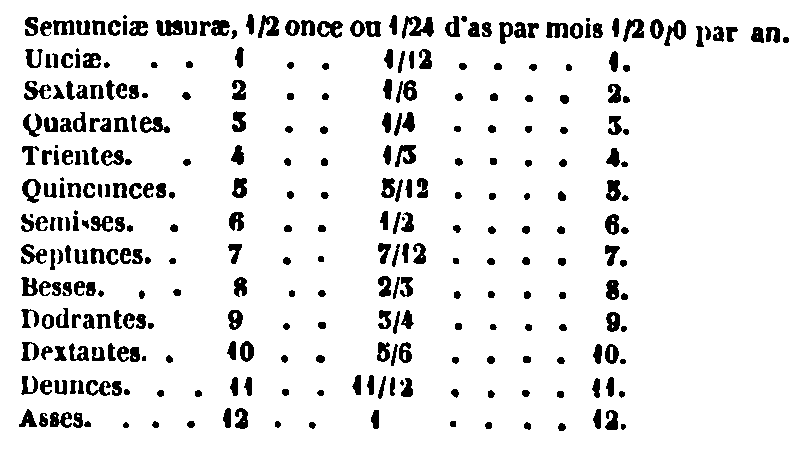|
ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE TITE-LIVE TITE-LIVE Ab Urbe Condita, Livre XXXII
Oeuvres de Tite-Live, t. II, Paris, Firmin Didot, 1864
310 LIVRE SEPTIÈME. SOMMAIRE. — Création de deux nouvelles magistratures, la préture et l'édilité curule. — Rome est malade d'une peste rendue célèbre par la mort de Furius Camille. — En cherchant un remède et un terme à ce mal dans de nouvelles pratiques religieuses, on établit les premiers jeux scéniques. — L. Manlius est assigné par M. Pomponius, tribun du peuple, pour avoir agi dans une levée avec trop de rigueur, et bannit aux champs, sans aucun grief, son fils T. Manlius; mais ce jeune homme, dont le bannissement était un des actes reprochés à son père, vient trouver au lit le tribun, et, le fer à la main, l'oblige à jurer solennellement qu'il ne poursuivra pas son accusation. — La terre s'étant ouverte au sein de la ville, la patrie entière s'épouvante, et l'on jette dans les profondeurs du gouffre toutes les richesses de la cite romaine; Curtius, tout armé et monté sur son cheval, s'y précipite et l'abîme est comblé. — T. Manlius, ce jeune homme qui avait délivré son père des persécutions d'un tribun, descend en combat singulier contre un Gaulois qui défiait les soldats de l'armée romaine, le tue et lui arrache son collier d'or; lui-même il se fait ensuite une parure de ce collier, et en conséquence on le surnomme Torquatus. — On crée deux nouvelles tribus. la Pomptina et la Publilia.—Licinius Stolo est condamné en vertu de sa propre loi, comme possédant plus de cinq cents arpents de terre. — M. Valerius, tribun militaire, provoqué par un Gaulois, le tue, seconde par un corbeau qui, pendant le combat, se perche sur son casque, et, des ongles et du bec, harcèle l'ennemi. Il reçoit pour cela le nom de Corvus, et, pour prix de sa valeur, il est créé consul l'année suivante, à l'âge de vingt-trois ans. — Alliance avec les Carthaginois. — Les Campaniens, attaqués et pressés par les Samnites . demandent contre eux au sénat un secours qu'ils n'obtiennent pas : ils livrent leur file et leur territoire au peuple romain. En conséquence, le peuple romain se décide à défendre par les armes, contre les Samnites, ce pays devenu son bien. — Engagée par A. Cornelius, consul, dans une position défavorable, l'armée se trouve en grand péril; P. Decius Mus, tribun militaire, parvient à la sauver; s'étant emparé d'une colline qui commande la hauteur où sont postes les Samnites, il donne moyen au consul de se retirer dans une position meilleure; pour lui, malgré les ennemis qui l'entourent, il échappe. — Les soldats romains laissés en garnison dans Capoue ayant conspiré pour s'emparer de cette ville, et le complot ayant été découvert, ils quittent, par crainte du supplice, le parti de Rome; mais par ses remontrances, M. Valerius Corvus, dictateur, les fait revenir de leur égarement et les rend à la patrie. — Guerres et succès divers contre les Herniques, les Gaulois, les Tiburtes, les Privernates, les Tarquiniens, les Samnites et les Volsques. I. Cette année sera célèbre par le consulat d'un homme nouveau, célèbre par l'établissement de deux nouvelles magistratures, la préture et l'édilité curule. Les patriciens revendiquèrent ces dignités comme dédommagement de l'un des consulats cédé au peuple. Le peuple donna à L. Sextius le consulat qu'il avait conquis; les patriciens appelèrent à la présure Sp. Furius, fils de M. Camille, et à l'édilité Cn. Quinctius Capitolinus et P. Cornélius Scipion, trois hommes de leur ordre, qu'ils firent nommer par l'influence des tribus de la campagne. A L. Sextius on donna un collègue patrictien, L. Emilius Mamercinus. Au commencement de l'année, le bruit que les Gaulois, récemment dispersés dans l'Apulie, s'étaient ralliés, et la nouvelle d'une défection des Herniques, agitèrent les esprits. Comme on remettait à dessein toute décision, afin de ne pas donner au consul plébéien l'occasion d'agir, il y eut vacance et repos de toute chose comme aux jours de Justitium. Seulement les tribuns ne purent supporter en silence que la noblesse eût à elle, pour un seul consul plébéien, trois magistrats patriciens, siégeant en chaises curules et revêtus de la prétexte, ainsi que 311 des consuls; sans compter le préteur, chef de la justice et collègue des consuls, créé sous les mêmes auspices; de sorte que le sénat eut honte d'exiger que les édiles curules fussent encore choisis parmi les patriciens. On était d'abord convenu de les prendre de deux ans en deux ans au sein du peuple; puis on laissa le choix libre. Quelque temps après, sous le consulat de L. Génucius et de Q. Servilius, tandis que la sédition et la guerre s'étaient apaisées, Rome ne pouvant être en aucun temps exempte d'alarmes et de dangers, une peste violente éclata. Un censeur, un édile curule, et trois tribuns du peuple, dit-on, succombèrent; et parmi les citoyens il y eut, en proportion, autant de victimes. Mais ce qui rendit cette peste mémorable, ce fut la mort de M. Furius, qui, pour être prévue, n'en fut pas moins cruelle. En effet, cet homme était vraiment unique en toute fortune; avant son bannissement, il était le premier dans la paix et dans la guerre ; pendant son exil il s'illustra encore, soit par les regrets de la cité qui, captive, implora de lui sa délivrance, soit par le bonheur qu'il eut de ne se rétablir dans sa patrie que pour la rétablir elle-même. Puis, après avoir joui, pendant vingt-cinq années qu'il vécut encore, d'une gloire qui n'était pas au-dessus de son mérite, il fut digne d'être appelé, après Romulus, le second fondateur de la ville de Rome. Il. Cette année et la suivante, sous le consulat de C. Sulpicius Péticus et de C. Licinius Stolo, la peste continua. Il ne se fit rien de remarquable; seulement, pour demander la paix aux dieux, on célébra, pour la troisième fois depuis la fondation de Rome, un lectisterne. Et comme ni les remèdes humains ni la bonté des dieux ne pouvaient calmer la violence du mal, la superstition s'empara des esprits, et c'est alors, à ce qu'on rapporte, qu'entre autres moyens d'apaiser le courroux céleste, on imagina les jeux scéniques, ce qui fut une nouveauté pour ce peuple guerrier qui n'avait eu jusque là que les jeux du cirque. Au reste, cette innovation, comme presque toutes les autres, fut dans le principe une chose de fort peu d'appareil, et qui on avait même empruntée à l'étranger. Des bateleurs venus d'Étrurie, dansant au son de la flûte, exécutaient, à la mode toscane, des mouvements qui n'étaient pas sans grâce; mais ils n'avaient ni chant, ni paroles, ni gestes. Bientôt nos jeunes gens s'avisèrent de les imiter, tout en se renvoyant en vers grossiers de joyeuses railleries, accompagnées de gestes qui s'accordaient assez à la voix. La chose une fois accueillie se répéta souvent et prit faveur. Comme en langue toscane un bateleur s'appelait hister, on donna le nom d'histrions aux acteurs indigènes, qui déjà ne se lançaient plus comme d'abord ce vers semblable au fescennin, rude et sans art, qu'ils improvisaient tour à tour, mais qui représentaient des satires mélodieuses, avec un chant réglé sur les modulations de la flûte, et que le geste suivait en mesure. Quelques années après, Livius qui, le premier, renonçant à la satire, avait osé s'élever jusqu'à des compositions dramatiques, et qui était, comme tous les auteurs de cette époque, acteur dans ses propres ouvrages, Livius, souvent redemandé, ayant fatigué sa voix, obtint, dit-on, la permission de placer devant le joueur 312 de flûte un jeune esclave qui chanterait pour lui, et il joua avec plus de vigueur et d'expression, n'étant plus gêné par le souci de ménager sa voix. Dès lors l'histrion eut sous la main un chanteur, et dut réserver sa voix pour la déclamation. Depuis que cette loi prévalut dans les représentations, la libre et folâtre gaieté des jeux disparut, et par degrés le divertissement devint un art. Alors la jeunesse, abandonnant le drame aux histrions, reprit l'usage des anciennes bouffonneries, entremêlées de vers, et qui, plus tard, sous le nom d'exodes, empruntèrent leurs sujets aux fables Atellanes. Ce genre d'amusement qu'elle avait reçu des Osques, la jeunesse se l'appropria, et ne souffrit point qu'il fût profané par les histrions. Aussi demeure-t-il établi que les acteurs d'Atellanes ne sont exclus ni de la tribu ni du service militaire, n'étant pas considérés comme de véritables comédiens. Parmi les humbles commencements des autres institutions, j'ai cru pouvoir aussi placer la première origine de ces jeux, afin de montrer combien fut sage en son principe ce divertissement aujourd'hui si follement coûteux, et auquel suffit à peine la richesse des plus opulents royaumes. III. Cependant ces jeux, qui furent d'abord une expiation religieuse, ne guérirent ni les esprits de leurs pieuses terreurs, ni les corps de leurs souffrances. Il y a plus : le Tibre débordé, étant venu un jour inonder le cirque au milieu de la célébration des jeux, qui fut interrompue, on regarda ce malheur comme une preuve de l'aversion et du mépris des dieux pour ces moyens de les fléchir, et les craintes redoublèrent. En conséquence, sous le consulat de Cn. Génucius et de L.Aemilius Mamercinus, élus tous deux pour la seconde fois, les esprits étaient plus tourmentés de la recherche d'un remède expiatoire que les corps de leurs souffrances; les vieillards, dit-on, se rappelèrent enfin qu'autrefois un dictateur, en enfonçant le clou, avait calmé la peste. Le sénat se fit alors un devoir sacré d'ordonner qu'un dictateur serait créé dans le but d'enfoncer le clou; et l'on créa L. Manlius Imperiosus, qui nomma L. Pinarius maître de la cavalerie. Il y a une ancienne loi qui porte écrit en vieilles lettres et en vieux langage : « Que le suprême préteur, aux ides de septembre, plante le clou. » Elle fut attachée à droite dans le temple de Jupiter, très bon, très grand, du côté du sanctuaire de Minerve. Le clou, dans ces temps où l'on connaissait à peine l'écriture, était, dit-on, employé à marquer les années; et la loi fut consacrée dans le sanctuaire de Minerve, parce que Minerve avait inventé les nombres. Les Volsiniens également désignaient le nombre des années par des clous enfoncés dans le temple de Nortia, déesse étrusque ; ainsi l'affirme Cincius, qui a si bien étudié tous les monuments de ce genre. Ce fut le consul M. Horatius qui, conformément à la loi, attacha le clou dans le temple de Jupiter, très bon, très grand, l'année qui suivit l'expulsion des rois; en-suite l'accomplissement de cette cérémonie passa des consuls aux dictateurs, comme revêtus d'une autorité plus grande. Par la suite, cet usage avait été abandonné; mais cette fois on pensa que la chose valait la peine que l'on créât un dictateur, et ce fut L. Manlius. Mais comme s'il eût été appelé là 313 pour gouverner la république, et non pour l'acquitter envers les dieux, désirant porter la guerre aux Herniques, il tourmenta la jeunesse de levées rigoureuses, jusqu'à ce qu'enfin, ayant irrité contre lui tous les tribuns du peuple, soit par force, soit par honte, il abdiqua la dictature. IV. Néanmoins, au commencement de l'année suivante, sous les consuls Q. Servilius Ahala et L. Génucius, Manlius fut cité en jugement par M. Pomponius, tribun dn peuple. La rigueur qu'il avait employée dans les levées, où il allait jusqu'à infliger non pas seulement des amendes, mais des punitions corporelles, tantôt frappant de verges, tantôt condamnant à la prison ceux qui n'avaient pas répondu à l'appel, était odieuse; mais ce qui l'était plus encore, c'était son naturel dur, et le surnom d'Impérieux, mal sonnant pour une cité libre, et que lui avait valu une ostentation de sévérité qu'il exerçait indistinctement sur les étrangers, sur ses proches et même sur son propre sang. Entre autres griefs, le tribun lui reprochait « que son fils, adolescent qui n'avait jamais fait le moindre mal, avait été par lui banni de la ville, du logis, du sein des pénates, prisé du forum, de la lumière, de la société de ses amis, condamné à des travaux serviles, presqu'au fond d'une prison et d'un cachot d'esclaves, où ce jeune homme de si haute naissance, ce fils de dictateur, apprenait, par un supplice de chaque jour, qu'il était né d'un père digne de son surnom. Et quel était son crime? Il s'exprimait avec peine, et sa langue manquait d'agilité. Mais ce vice de la nature, un père, pour peu qu'il y eût en lui quelque chose d'humain, ne devait-il pas le corriger par l'éducation, au lieu de le punir et de le révéler aux autres par ses persécutions? Les brutes elles-mêmes ne chérissent et ne caressent pas moins leurs petits, même quand ils ont quelque défaut. Mais, par Hercule, L. Manlius accroît le mal par le mal; il alourdit encore cet esprit paresseux, et, s'il reste en ce jeune homme un peu de vigueur naturelle, il va l'éteindre dans cette vie sauvage, dans ces habitudes rus-tiques, en le retenant au milieu des troupeaux. » V. Tout le monde, excepté le jeune homme, était irrité par cette accusation. Pour lui, au contraire, affligé d'être un sujet de haine et de poursuites contre son père, et voulant apprendre aux dieux et aux hommes qu'il aimait mieux venir en aide à son père qu'à ses ennemis, il conçut dans son esprit rude et sauvage un projet dont l'exemple n'était pas sans danger dans une ville libre, mais qui mérite des louanges à cause de la piété qui l'inspira. A l'insu de tous, un couteau sous sa robe, il vient un matin à la ville, et de la porte marche droit à la maison du tribun M. Pomponius, où il dit au portier « qu'il a besoin de parler sur l'heure à son maître; qu'il est T. Manlius, fils de Lucius. » Bientôt introduit (car on espérait qu'irrité contre son père, il apportait de nouvelles charges ou des avis sur la conduite do affaire), le salut reçu et rendu : « Il a, dit-il, quelque chose à dire au tribun, sans témoins.» Sur un ordre, tout le monde s'étant éloigné, il tire son couteau, et, se tenant sur le lit, le fer levé, il menace le tribun de le percer sur-le-champ, s'il ne jure dans les termes qu'il lui dictera, « de ne jamais convoquer d'assemblée du peuple pour accu- 314 ser son père.» Le tribun s'effraie : car le fer brillait à ses yeux; il était seul, sans armes, et il voyait devant lui un jeune homme robuste, et ce qui n'était pas moins à craindre, ayant en ses forces une confiance brutale : il répète donc le serment qu'on lui impose; plus tard il déclara que c'était par suite de cette violence qu'il avait renoncé à son entreprise. Et quoique le peuple eût préféré qu'on lui laissât la faculté de prononcer sur le sort d'un accusé si cruel et si arrogant, cependant il ne sut pas mauvais gré au fils de ce qu'il avait osé pour son père, et cette action lui parut d'autant plus louable que toute la dureté paternelle n'avait pu rebuter sa piété. Aussi, non content de renoncer à la poursuite du père, il voulut encore honorer le fils; et comme on avait pour la première fois, cette année, déféré aux suffrages l'élection des tribuns de légions (qui auparavant, ainsi qu'aujourd'hui ceux qu'on appelle Rufuli, étaient choisis par les généraux), T. Manlius obtint la seconde des six places, sans avoir mérité cette faveur par aucun titre civil ou militaire, ayant passé sa jeunesse aux champs et loin de la société des hommes. VI. La même année, on dit qu'un tremblement (le terre, ou quelque autre cause inconnue, fit écrouler le sol au milieu du forum et y ouvrit un vaste gouffre : si bien que les monceaux de terre que chacun y apporta, selon ses forces, ne purent combler cet abîme. Sur un avis des dieux, on se mit à chercher ce qui faisait la principale force du peuple romain ; car c'était là, au dire des devins, ce qu'il fallait sacrifier eu ce lieu, si l'on voulait que la république romaine fût éternelle. Alors M. Curtius, jeune homme qui s'était fort distingué dans la guerre, s'indigna, dit-on, de voir qu'on hésitait, comme si le plus grand bien de Rome n'était pas la valeur et les armes. Ayant obtenu le silence, il se tourne vers les temples des dieux immortels qui dominaient le forum, et, les yeux levés vers le Capitole, les mains tour à tour tendues vers le ciel ou sur les profondeurs de la terre béante, il se dévoue aux dieux mânes ; puis, montant sur un cheval le plus richement équipé qu'il pût, il s'élança tout armé dans le gouffre, où une foule d'hommes et de femmes répandirent sur lui un amas de fruits et d'offrandes expiatoires; et c'est de lui plutôt que de Curtius Mettus, cet antique soldat de T. Tatius, que le lac Curtius aurait tiré son nom. Je n'aurais pas épargné mes peines, si quelque voie pouvait conduire à la vérité; mais il faut aujourd'hui s'en tenir à la tradition, puisque l'ancienneté du fait ne permet pas d'en constater l'authenticité; et d'ailleurs la plus moderne de ces fables donne plus d'éclat au nom du lac. Après l'expiation d'un si grand prodige, et la même année, le sénat s'occupa des Herniques, auxquels il avait, sans succès, envoyé demander raison par les féciaux; il se décida, dès le premier jour, à proposer au peuple de déclarer la guerre à cette nation, et le peuple, en assemblée générale, ordonna la guerre. Le commandement échut par le sort au consul L. Génucius. La cité était dans l'attente : c'était le premier consul plébéien qui eût conduit une guerre sous ses auspices personnels, 315 et l'événement devait la justifier ou la punir de l'admission du peuple aux honneurs. Le destin voulut que Génucius;, marchant précipitamment contre l'ennemi, tombât dans une embuscade : les légions, surprises et attaquées, se dispersèrent, et le consul fut enveloppé par l'ennemi qui le tua sans le connaître. Quand celte nouvelle arriva à Rome, les patriciens, moins affligés de ce désastre que joyeux de l'expédition malheureuse d'un consul plébéien, répétaient de tous côtés avec dédain : « Allez! faites des consuls plébéiens! transmettez les auspices aux profanes ! On a pu, par un plébiscite, déposséder les patriciens de leurs dignités; mais cette loi contre les auspices a-t-elle pu valoir aussi contre les dieux immortels? Ils ont vengé leur divinité, leurs auspices : à peine a-t-on vu les auspices aux mains d'un homme qui n'avait ni le droit ni le pouvoir d'y toucher, que l'armée a péri avec son chef : cet exemple servira de leçon à ceux qui voudraient désormais, dans les comices, confondre tous les droits des familles. » Tels étalent les discours qu'on ne cessait d'entendre dans la curie et dans le forum. Ap. Claudius, qui avait repoussé la loi, accusait alors avec plus d'autorité que jamais le résultat d'une mesure qu'il avait repoussée. Avec l'assentiment des patriciens, le consul Servilius le nomma dictateur; et l'on ordonna une levée et le Justitium. Vll. Avant que le dictateur et les légions nouvelles fussent arrivés en présence des Herniques, le lieutenant C. Sulpicius avait eu l'occasion d'agir contre eux avec succès. Les Herniques, après la mort du consul, s'étaient avancés hardiment vers le camp des Romains avec l'espoir certain de l'emporter; mais, encouragés par le lieutenant, les soldats, qui d'ailleurs étaient pleins d'indignation et de colère, firent une sortie, et les Hlerniques durent renoncer h l'espoir d'approcher des retranchements; ils furent dispersés et obligés de se retirer en désordre. A l'arrivée du dictateur, la nouvelle armée est réunie à l'ancienne, et les forces sont doublées; il assemble les troupes, comble devant elles de louanges le lieutenant et les soldats dont la valeur avait sauvé le camp, et, par ces louanges, en redonnant du coeur à ceux qui les méritent, il inspire aux autres une noble et vive émulation. L'ennemi, de son côté, se prépare avec non moins d'ardeur à la guerre; il se souvient de son premier succès, et, n'ignorant pas que les Romains ont augmenté leurs forces, il augmente aussi les siennes. Tout ce qui a nom Hernique, tout ce qui a l'âge militaire, est armé: huit cohortes, de quatre cents hommes chacune, formant une élite redoutable, sont enrôlées. A cette fleur de la plus belle jeunesse, on assure, par un décret, double paie, et cet espoir ajoute encore à son courage. On les exempte aussi des travaux militaires, afin qu'uniquement réservés pour le combat, ils sachent qu'ils doivent plus que leur simple part d'homme, en efforts et en valeur. Dans l'ordre de bataille on les place en avant et hors des rangs, afin de mettre plus en vue leur courage. Une plaine de deux milles séparait le camp romain des Herniques : ce fut là, à une distance à peu près égale des deux camps, que le combat se livra. D'abord le succès resta douteux; vainement les cavaliers romains avaient-ils essayé à plusieurs reprises, en chargeant 316 la ligue ennemie, de la rompre. Voyant que, dans cette lutte, le résultat ne répondait pas à leurs efforts, les cavaliers consultent le dictateur, et, avec sa permission, quittent leurs chevaux; puis, poussant un grand cri, ils volent devant les enseignes, et recommencent le combat. L'ennemi n'eût pu soutenir leur choc, si les cohortes dont nous avons parlé n'eussent opposé aux nôtres une pareille vigueur de corps et de courage. VIll. Alors l'action s'engage entre les plus braves des deux peuples. Les pertes de part et d'autre, quel que soit le nombre de ceux qui tombent emportés par le sort commun (le la guerre, se multiplient par la qualité des morts : le reste des soldats avait pour ainsi dire délégué le combat à ces braves, et remis sa destinée à leur valeur. Beaucoup sont tués de part et d'autre, et plus encore sont blessés. Enfin, les cavaliers, s'excitant les uns les autres, se demandent « ce qu'ils espèrent encore? A cheval, ils n'ont pu repousser l'ennemi; à pied, ils ne le peuvent pas davantage. Quelle est la troisième espèce de combat qu'ils attendent? A quoi bon s'être jeté fièrement à la tête des enseignes, et combattre en la place des autres? » S'étant animés entre eux par ces paroles, et ayant poussé un nouveau cri, ils se portent en avant; ils commencent par faire perdre pied à l'ennemi, et, après l'avoir contraint à reculer, le mettent en pleine déroute. Il n'est pas facile de dire ce qui, entre des forces si égales, décida la victoire, à moins que la constante fortune des deux peuples n'ait doublé le courage de l'un et diminué celui de l'autre. Le Romain poursuivit jusqu'à leur camp les Herniques fugitifs; mais, comme il était tard, on différa l'assaut. Les sacrifices, longtemps répétés sans succès, avaient empêché le dictateur de donner le signal avant midi; et le combat s'était ainsi prolongé jusqu'à la nuit. Le lendemain on trouva désert le camp des Herniques ; ils avaient disparu en laissant quelques blessés à l'abandon. La troupe des fuyards, peu nombreuse, fut aperçue par les habitants de Siguia, sous les murs de laquelle elle avait passé; ils la dispersèrent et la massacrèrent dans sa fuite à travers la campagne. Cette victoire ne laissa pas que de coûter du sang aux Romains: on perdit un quart de l'armée, et ce qui ne fut pas de moindre dommage, plusieurs cavaliers romains succombèrent. IX. L'année suivante, comme les consuls C. Sulplicius et C. Licinius Calvus avaient mené l'armée contre les Herniques, et que, ne trouvant pas les ennemis en campagne, ils avaient enlevé une des villes de ce peuple nommé Férentinum, à leur retour, Tibur leur ferma ses portes. Ce dernier motif, ajouté à tant d'autres, et après toutes les plaintes que se renvoyaient depuis longtemps les deux peuples, décida Rome à faire demander rai-on par ses féciaux aux Tiburtins, et à leur déclarer la guerre. Il paraît certain que, cette année, T. Quinctius Pennus fut dictateur, et Serv. Cornélius Maluginensis maître de la cavalerie. Selon Macer Licinius, ce ne fut que pour tenir les comices que ce dictateur fut nommé par le consul Licinius, lequel voyant son collègue, au lieu de s'occuper de la guerre, hâter la réunion des comices pour se maintenir au consulat, voulut déjouer une ambition coupa- 317 ble. Mais, en louant un homme de la même famille que lui, Licinius ôte du poids à son témoignage; et, comme je ne trouve aucune mention de ce fait dans nos plus anciennes annales, j'inclinerais plutôt à croire que la guerre des Gaulois fut alors la seule cause du choix d'un dictateur. Il est constant que, cette année, les Gaulois vinrent camper à trois milles de Rome, sur la voie Salaria, au-delà du pont de l'Anio. Le dictateur ayant, à l'approche des Gaulois, proclamé le Justitium, appela au serment toute la jeunesse, sortit de la ville avec une armée nombreuse, et plaça son camp sur la rive citérieure de l'Anita. lin pont séparait les deux armées, et aucune ne l'osait rompre, pour qu'on n'y vit pas un signe de peur. On s'en disputait la possession par de fréquents combats; mais, comme on se battait à forces presque égales, il était difficile de prévoir qui l'emporterait. Alors un Gaulois, d'une stature imposante, s'avance seul sur le pont, et, parlant de toute la puissance de sa voix : « Que le plus brave des Romains, dit-il, vienne ici se mesurer avec moi, et l'événement de notre lutte apprendra lequel des deux peuples vaut le mieux à la guerre. » X. Il y eut un long silence parmi les principaux de la jeunesse romaine: tous craignaient de refuser le combat, mais aucun ne voulait être le premier à en courir la chance si périlleuse. Enfin, T. Manlius, fils de L., qui avait délivré son père des persécutions du tribun, quitte son poste, et s'approchant du dictateur : a Général, lui dit-il, je n'aurais jamais sans ton ordre, combattu hors des rangs, alors même que j'aurais vu la victoire certaine. Si tu le permets, je veux montrer à cette brute, qui parade insolemment devant les enseignes ennemies, que je descends de cette famille qui renversa de la roche Tarpéienne une armée de Gaulois. » Alors le dictateur : « Courage, T. Manlius, lui dit-il; sois dévoué à ta patrie comme tu l'es à ton père. Va, et montre, avec l'aide des dieux, que le nom romain est invincible. » Les amis du jeune homme lui aident à s'armer; il prend un bouclier d'infanterie, et ceint un glaive espagnol, meilleur pour combattre de près. Dès qu'il est armé et équipé, ils le mènent en face du Gaulois, qui dans sa joie stupide (c'est un détail que les anciens ont cru digne de mémoire ), tirait la langue par raillerie. Ensuite ils regagnent leur poste, laissant seuls les deux adversaires qui ont plutôt l'air de se donner en spectacle que de se trouver là par la loi de la guerre, et qui, à en juger par la vue et d'après les apparences, ne semblent pas d'égale force. L'un se présente avec une stature remarquable, revêtu d'habits qui brillent de mille couleurs, et portant des armes peintes et ciselées en or qui le font resplendir : l'autre est de la taille ordinaire du soldat, et ses armes, plus commodes que belles, n'ont qu'un modeste éclat ; il ne chante pas, ne bondit pas, n'agite pas ses armes d'une manière arrogante; mais sou âme, pleine de courage et d'une muette colère, garde tout son effort pour l'épreuve du combat. Quand ils sont en présence entre les deux armées, entourés de tant d'hommes dont la crainte et l'espérance tiennent les coeurs suspendus, le Gaulois, comme une masse prête à tout écraser, tend son bouclier de la main gauche, et, du tran- 318 chant de son épée, frappe avec un grand bruit, mais inutilement, les armes de l'ennemi qui s'avance. Le Romain, l'épée haute et droite, commence par choquer de son bouclier le bas de l'autre bouclier, pénètre de tout son corps sous cet abri qui le préserve des blessures, se glisse entre le corps et l'armure de l'ennemi, lui plonge par deux fois son glaive dans le ventre et dans l'aine, et l'étend sur le sol, dont il couvre un large espace. L'ayant ainsi renversé, il épargna toute injure à son cadavre; mais il lui ôta son collier, qu'il passa, tout mouillé de sang, à son cou. Les Gaulois, non moins effrayés que surpris, demeuraient immobiles. Pour les Romains, ils s'élancent joyeux de leur poste au devant de leur soldat, et le louant, le félicitant, le conduisent au dictateur. Au milieu de leurs chansons naïves et des saillies de leur gaieté militaire, on entendit le surnom de Torquatus ; ce surnom fut plus tard accueilli, et devint le titre honorifique des descendants et de la famille du vainqueur. Le dictateur y ajouta le don d'une couronne d'or, et, devant l'armée assemblée, releva par les plus beaux éloges l'honneur de ce combat. XI. Et, par Hercule, tel fut l'effet de ce combat sur l'événement de toute la guerre, que l'armée gauloise, dès la nuit suivante, abandonnant son camp à la hâte, se retira sur les terres de Tibur; puis, après y avoir fait alliance de guerre avec les Tiburtes, qui la secoururent généreusement de vivres, elle passa dans la Campanie. C'est pour cela que, l'année suivante, tandis que le consul, M. Fabius Ambustus, dirigeait, d'après la loi du sort, la campagne contre les Herniques, son collègue C. Pétéiius Balbus mena, par ordre du peuple, une armée contre les Tiburtes. Les Gaulois accoururent de la Campanie au secours de leurs alliés, et d'affreuses dévastations, évidemment conseillées par les Tiburtes, désolèrent les territoires de Lavicum, de Tusculum et d'Albe. Si l'on n'avait eu d'autre ennemi que les Tiburtes, un consul aurait suffi à la république; mais l'invasion des Gaulois força de créer un dictateur : on créa Q. Servilius Abala, qui nomma T. Quinctius maître de la cavalerie, et qui, avec l'approbation du sénat, fit voeu, si l'issue de cette guerre était heureuse, de célébrer les grands jeux. Le dictateur, pour renfermer les Tiburtes dans leur propre guerre, ordonna au consul de rester avec son armée; puis il appela au serment toute la jeunesse, et nul ne refusa le service. On combattit non loin de la porte Colline, avec toutes les forces de la ville, à la vue des parents, des femmes et des enfants; et ces objets qui, même absents, sont de si puissantes exhortations pour le courage, présents et visibles ce jour-là, parlaient vivement à l'orgueil et à l'affection du soldat. Après un grand carnage de part et d'autre, les Gaulois tournèrent enfin le dos, et s'enfuirent à Tibur, qui était comme l'arsenal de cette guerre gauloise ; mais, dans leur désordre, surpris non loin de Tibur par le consul Pétélius, ifs sont refoulés jusque dans les murs de la ville avec les Tiburtes, sortis pour leur porter secours. Cette guerre fut parfaitement conduite, soit par le dictateur, soit par le consul. De son côté, l'autre consul, Fabius, après quelques légers succès contre les Herniques, finit par les vaincre entièrement 319 dans une seule et mémorable bataille où l'ennemi l'avait attaqué avec toutes ses forces. Le dictateur, après avoir comblé les consuls de louanges dans le sénat et devant le peuple, et leur avoir même attribué une partie de sa gloire, abdiqua la dictature. Pétélius triompha deux fois des Gaulois et des Tiburtes. Pour Fabius, on pensa que c'était assez de lui accorder l'ovation. Les Tiburtes se moquèrent du triomphe de Pétélius : « Où donc leur avait-il livré bataille? Quelques habitants, sortis de la ville pour être témoins de la fuite et de la terreur des Gaulois, voyant que les Romains tombaient aussi sur eux, et massacraient sans distinction tout ce qui se trouvait sur leur chemin, s'étaient réfugiés dans leurs murs. Et c'était l', aux yeux des Romains, un exploit digne du triomphe I Ils ne devaient pas tant se glorifier d'avoir jeté l'alarme aux portes de l'ennemi; ils verraient bientôt une bien autre épouvante aux pieds de leurs murailles. » XII. En conséquence, l'année suivante, sous les consuls M. Popilius Lénas et Cn. Manlius, au moment où la nuit commence à être silencieuse, une armée ennemie, partie de Tibur, arriva devant Rome. Brusquement arrachés au sommeil, les Romains s'effrayèrent de cette subite attaque et de cette alarme nocturne; d'ailleurs un grand nombre ignorait quel était cet ennemi et d'où il venait. Cependant, on crie aux armes, on met de nouvelles gardes aux portes, on renforce les murailles. Mais, lorsque le jour naissant n'eut montré qu'une faible troupe devant les remparts et nul autre ennemi que les Tiburtes, les deux consuls, sortant par les deux portes, attaquent à la fois cette armée qui déjà se préparait à donner l'assaut; et il fut facile de voir qu'elle avait plus compté sur l'occasion que sur son courage, tant elle eut peine h soutenir le premier choc des Romains! Au reste, à vrai dire, cette invasion fut avantageuse aux Romains; une querelle allait s'élever entre les patriciens et le peuple; et la terreur d'une guerre si soudaine l'étouffa. A cette guerre en succéda une autre où l'invasion de l'ennemi fut plus terrible pour la campagne que pour la ville. Les Tarquiniens envahirent le territoire de Rome et le dévastèrent, principalement du côté qui borde l'Étrurie. Comme on leur avait demandé réparation sans l'obtenir, les nouveaux consuls, C. Fabius et C. Plautius, par ordre du peuple, leur déclarèrent la guerre : à Fabius échut cette campagne, à Plautius, celle contre les Herniques. En même temps, le bruit d'une invasion gauloise augmentait de jour en jour. Mais, au milieu de tant d'alarmes, ce fut pour Rome une consolation que d'accorder aux Latins la paix qu'ils demandaient. Aux ternies d'un ancien traité, qui, pendant de longues années, n'avait pas eu d'effet, on reçut d'eux un bon nombre de troupes; secours qui fortifia la puissance romaine et lui rendit plus légère à supporter la nouvelle de l'arrivée des Gaulois, et de leur halte aux environs de Pedum. On nomma dictateur C. Sulpicius; le consul C. Plautius fut mandé pour cette élection; un maître de cavalerie, M. Valérius fut adjoint au dictateur. Ces chefs, à la tête des plus braves soldats, choisis dans les deux armées consulaires, 320 marchèrent contre les Gaulois. La guerre alla plus lentement qu'on ne l'aurait voulu de part et d'autre : d'abord, les Gaulois seuls désiraient le combat; mais bientôt le soldat romain fut plus fougueux que les Gaulois eux-mêmes à demander les armes et la bataille. Le dictateur, voyant que rien ne pressait, refusait de se hasarder contre un ennemi que le temps devait épuiser chaque jour sur cette terre étrangère, où il ne pouvait pas rester sans réserve de vivres, et sans retranchements à l'épreuve; il considérait en outre que, chez ce peuple, les âmes et les corps, dont toute la force était dans le premier élan, devaient s'énerver au moindre délai. Dans cette vue, le dictateur traînait la guerre en longueur, et il avait menacé d'un châtiment sévère le premier qui combattrait sans sou ordre. Les soldats, mécontents de cette défense, murmuraient entre eux dans les postes et les corps-de-garde, censurant le dictateur, et parfois même s'attaquant au sénat tout entier, parce qu'il n'avait pas confié à des consuls la conduite de cette guerre. « On a choisi là, disaient-ils, un fameux général, un chef sans pareil, qui s'imagine qu'il n'a qu'à rester tranquille, et que la victoire va d'elle-même lui tomber du ciel dans les bras! » Ensuite ces propos, et de plus hardis encore, furent répétés publiquement : « Ou ils combattront en dépit du général, ou ils retourneront les rangs serrés à Rome. » Bientôt les centurions se mêlent aux soldats : On ne murmure plus seulement dans quelques groupes isolés, mille discours semblables se confondent sur la place d'armes, devant la tente du dictateur ; la foule croît à chaque instant comme une assemblée solennelle, et de toutes parts on crie : « Il faut aller sur-le-champ vers le dictateur; et Sex. Tullius parlera pour l'armée d'une manière digue de sou courage. » XIII. Pour la septième fois, Tullius commandait le primipile, et il n'y avait pas dans l'armée, parmi ceux du moins qui avaient servi dans l'infanterie, un homme qui fût plus célèbre par ses hauts faits. Suivi d'une troupe de soldats, il marche au tribunal, et comme Sulpicius s'étonnait de voir cette troupe séditieuse, et surtout de voir à sa tête Tullius, un soldat si soumis à la discipline : « Dictateur, dit celui-ci, l'armée entière, persuadée que tu la condamnes comme lâche, et que c'est pour la punir par la honte que tu la tiens désarmée, m'a prié de plaider sa cause devant loi. Certes, alors même qu'on aurait à nous reprocher d'avoir abandonné notre poste, ou tourné le dos à l'ennemi, ou perdu lâchement nos enseignes, il me semble que nous pourrions cependant obtenir de toi, comme une justice, la permission de réparer notre faute par du courage, et d'effacer par une nouvelle gloire le souvenir de cet opprobre. Les mêmes légions qui avaient été battues sur l'Allia, et qui avaient perdu la patrie par leur frayeur, sorties bientôt de Véies, surent la reconquérir par leur valeur; et nous, grâce à la bonté des dieux, à la fortune, h celle du peuple romain, nous avons maintenu intactes la république et notre gloire. Mais, j'ose à peine parler de gloire, lorsque nous nous tenons cachés comme des femmes derrière un retranchement, insultés, outragés de toutes façons par l'ennemi; et lorsque toi, notre général, ce qui est encore plus triste pour nous, tu crois ton armée sans coeur, sans ar- 321 mes, sans bras, et que, même avant de nous éprouver, tu désespères de nous, comme si tu croyais ne commander qu'à des soldats manchots et débiles. Sans cela, en effet, pourquoi un chef vétéran, qui a déployé tant de courage a la guerre, resterait-il assis là, comme on dit, les bras croisés ? Quoi qu'il en soit, il n'est que trop vrai que tu sembles douter de notre bravoure plus que nous de la tienne. Si pourtant ce n'est pas de toi-même que tu agis de la sorte, mais par l'inspiration de ceux qui gouvernent, si c'est quelque complot des patriciens et non la guerre des Gaulois qui nous tient éloignés de la ville et de nos pénates, je te prie de considérer ce que je vais te dire comme le langage, non du soldat au général, mais du peuple aux patriciens, du peuple qui déclare par ma bouche qu'il aura ses desseins comme vous avez les vôtres. Et qui donc trouvera mauvais que nous soyons soldats, non vos esclaves? envolés à la guerre, non en l'exil? tout prêts, si on nous donne le signal, si on nous mène à l'ennemi, à combattre comme il convient à des hommes, à des Romains? mais plus disposés, si on n'a pas besoin de nos armes, à passer notre loisir dans Rome que dans un camp? Voilà ce que nous disons aux patriciens. Toi, général, nous te prions, nous, tes soldats, de nous permettre enfin de combattre. Si nous désirons de vaincre, c'est pour vaincre sous tes ordres, pour te déférer un noble laurier, pour rentrer avec toi triomphants dans la ville, et suivre ton char au temple de Jupiter, très bon, très grand, te glorifiant, te rendant grâces. » Au discours de Tullius succédèrent les prières de la multitude; et de tous cilles on criait au dictateur de donner le signal et de faire prendre les armes. XIV. Le dictateur sentait bien qu'une pareille conduite n'était pas d'un bon exemple, quoique louable en soi; néanmoins il promit de faire ce que les soldats demandaient. Ensuite, prenant à part Tullius, il lui demande ce que cela signifie, et quelle est cette façon d'agir. Tullius supplie instamment le dictateur « De croire qu'il n'a oublié ni la discipline militaire, ni ce qu'il est, ni ce qu'il doit à la majesté du commandement ; il ajoute que d'ordinaire une multitude soulevée se conduit comme ceux qui la dirigent ; et qu'il a consenti à se mettre à leur tête, de peur qu'il ne se trouvât là quelqu'un de ces hommes que les troupes révoltées ont coutume de se donner pour chefs; car, quant à lui, il n'eût jamais rien fait contre le gré de son général. Toutefois il importe que le dictateur prenne garde que l'armée ne lui échappe. On ne peut opposer de nouveaux délais à des esprits si animés; ils choisiront eux-mêmes le lieu et le temps pour combattre, si le général ne le leur donne. » Pendant cet entretien, un Gaulois ayant enlevé des chevaux qui paissaient par hasard hors du retranchement, deux soldats romains les reprirent. Les Gaulois leur lancent des pierres : alors, du camp romain nu cri s'élève; de part et d'autre on accourt, et un véritable combat allait s'engager, si les centurions n'eussent promptement rappelé nos soldats. Cet incident confirmait du reste ce que Tullius avait dit au dictateur : et l'affaire n'admettant plus de re- 322 tard, il fut annoncé que le lendemain on livre rait bataille. Cependant, le dictateur, qui se présentait au combat avec plus de confiance dans le courage que dans les forces de ses troupes, cherchait partout autour de lui quelque moyen de jeter la terreur parmi les ennemis. Son esprit inventif imagine un expédient tout nouveau, qu'ont mis en usage, depuis lors, plusieurs généraux romains et étrangers, quelques-uns même de nos jours. Il fait enlever les bâts aux mulets, en ne leur laissant que des housses pendantes, et les fait monter par des muletiers revêtus d'armures prises à l'ennemi, ou de celles des malades. Après en avoir équipé ainsi mille environ, il leur adjoint cent cavaliers, et leur ordonne de se retirer pendant la nuit sur les hauteurs qui dominent le camp, de se cacher dans les bois, et de ne pas bouger qu'ils n'en aient reçu de lui le signal. Pour lui, au point du jour, il affecta d'étendre sa ligne au pied des montagnes afin que l'ennemi prît position en face de ces hauteurs. A l'aspect de ce vain épouvantail, qui servit plus en quelque sorte le dictateur que ses véritables forces, les chefs gaulois crurent d'abord que les Romains ne descendraient pas dans la plaine; mais, quand ils les virent se mouvoir tout à coup, ils s'élancèrent ardemment au combat, et la lutte s'engagea avant que les chefs eussent donné le signal. XV. Ce fut surtout l'aile droite que les Gaulois assaillirent, et l'on n'aurait pu leur résister, s'il n'y eût eu là le dictateur qui, appelant Sextius Tullius par son nom, lui demanda d'un ton de reproche : « Est-ce ainsi qu'il avait promis que les soldats devaient combattre? Pourquoi ces cris pour réclamer des armes? Pourquoi ces menaces de livrer bataille sans l'ordre du général? Le voici, le général, qui les appelle à haute voix au combat, et qui s'avance armé à la tête des enseignes. Oseront-ils au moins le suivre, eux qui voulaient le conduire; eux si redoutables au camp et si timides dans l'action ! » Ils sentaient qu'ils méritaient ces reproches; aussi se piquèrent-ils d'honneur, et se précipitèrent-ils au-devant des traits ennemis, l'esprit égaré, et ne connaissant plus le péril. Ce premier élan de fureur ébranla les Gaulois; la cavalerie arriva ensuite et les mit en déroute. Le dictateur, voyant l'ennemi battu de ce côté, se porte avec les enseignes à l'aile gauche, où ils se ralliaient en grand nombre, et donne aux Romains placés sur les hauteurs le signal convenu. De ce point un nouveau cri s'élève, et l'on voit une troupe qui s'avance sur les flancs de la montagne, et marelle vers le camp des Gaulois. Ceux-ci, craignant d'être coupés, laissent le combat et regagnent leur camp à la course; mais, ayant rencontré là M. Valérius, maître de la cavalerie, qui, depuis la défaite de l'aile droite, manoeuvrait en avant des retranchements ennemis, ils tournent leur fuite vers les montagnes et les forêts, où plusieurs d'entre eux furent reçus par cette fausse cavalerie et ces muletiers; et de tous ceux que la peur entraîna ainsi dans les bois, il se lit un carnage effroyable, longtemps encore après le combat. Nul autre, depuis M. Furius, ne s'était montré plus digne que C. Sulpicius de triompher des Gaulois; et lui aussi, des dépouilles des Gaulois, il put for- 323 mer un monceau d'or assez considérable, qu'il enferma dans la pierre et consacra au Capitole. Cette même année, la guerre fut aussi conduite, mais avec des chances diverses, par les deux consuls : C. Plautius vainquit et subjugua les Herniques; mais Fabius, son collègue, se présenta sans précaution et sans prudence aux coups des Tarquiniens. Cet échec en lui-même ne fut point grave; mais trois cents soldats romains prisonniers furent immolés par les Tarquiniens; et l'opprobre de ce supplice fit remarquer plus encore la honte du peuple romain. A cet échec se joignit la dévastation du territoire de Rome, par une incursion subite des Privernates, puis des Véliternes. La même année, on créa deux nouvelles tribus, la Pomptina et la Publilia. On célébra aussi les jeux que le dictateur M. Furius avait voués. Enfin, une loi contre la brigue fut, pour la première fois, avec l'approbation du sénat, présentée au peuple par le tribun C. Pétélius. On croyait, par cette loi, réprimer surtout l'ambition des hommes nouveaux, qui avaient l'habitude de courir les foires et les marchés pour solliciter les suffrages. XVI. Les patriciens virent avec moins de satisfaction l'année suivante, sous le consulat de C. Marcius et de Cn. Manlius, la loi que les tridu peuple, M. Duilius et L. Ménius, présentèrent sur l'intérêt à un pour cent : le peuple, au contraire, accueillit et adopta avec empressement cette loi. Outre les nouvelles guerres que l'on avait décidées l'année précédente, une attaque fut résolue contre les Falisques auxquels on reprochait deux choses : d'abord leur jeunesse s'était coalisée avec les Tarquiniens; ensuite ils avaient refusé de rendre à nos féciaux les soldats romains qui s'étaient réfugiés à Faléries, après la perte de la bataille. Cette campagne échut à Cn. Manlius. Pour Marcius, il mena une armée contre les Privernates, sur un territoire qu'une longue paix avait enrichi, et il chargea les soldats de butin. Sa générosité l'augmenta en quelque sorte; il ne voulut rien en retenir pour le trésor, et favorisa ainsi l'accroissement de la fortune privée du soldat. Comme les Privernates avaient fortifié un camp en avant de leurs murailles, et s'y étaient retranchés, il convoqua et rassembla l'armée : « Dès à présent, dit-il, je vous livre en proie le camp de l'ennemi et sa ville, si vous me promettez de vous comporter vaillamment dans l'action, et de n'avoir pas moins de coeur au combat qu'au butin. » Ils demandent le signal à grands cris; pleins d'ardeur et sûrs de vaincre, ils marchent hardiment au combat. Alors, à la tête des enseignes, Sex. Tullius, dont on a déjà parlé, s'écrie : « Vois, général, comme ton armée te tient parole; » et, laissant le javelot, il lire son épée et fond sur l'ennemi. Tous les enseignes suivent Tullius, et, du premier choc, ils enfoncent l'ennemi. Après l'avoir mis en fuite et poursuivi jusqu'à la ville, ils allaient approcher les échelles des murailles, lorsque la place se rendit. Il y eut triomphe sur les Privernates. L'autre consul ne fit rien de mémorable : seulement, ce qui était jusque-là sans exemple, ayant assemblé ses troupes par tribus dans son camp de Sutrium, il leur fit voter une loi qui imposait un vingtième sur le 324 prix des esclaves qu'on affranchirait. Comme cette loi rapportait un revenu assez considérable au trésor qui était embarrassé, le sénat l'approuva. Mais les tribuns du peuple, moins inquiets d'ailleurs de la loi que des suites de cet exemple, prononcèrent la peine capitale contre celui qui convoquerait désormais le peuple hors de la ville; car si on autorisait pareille chose, il n'y avait rien de si funeste au peuple, qu'il ne fût possible d'obtenir des soldats, que leur serment dévouait au consul. La même année, C. Licinius Stolo, à la poursuite de M. Popillius Lénas, fut, aux termes de sa propre loi, condamné à une amende de dix mille as, comme possédant mille arpents de terre avec son fils, qu'il avait fait émanciper pour éluder la loi. XVII. Les nouveaux consuls, M. Fabius Ambustus et M. Popillius Lénas, l'un et l'autre nommés pour la seconde fois, eurent deux guerres à soutenir. L'une, contre les Tiburtes, fut sans reine achevée par Lénas qui, après avoir repoussé l'ennemi dans sa ville, dévasta les campagnes. L'autre consul fut, dans une première rencontre, battu par les Falisques et les Tarquiniens ; les soldats romains avaient été épouvantés à la vue de leurs prêtres, qui s'avancèrent comme des furies, secouant des torches ardentes et des serpents. Non moins troublés que surpris à cet aspect, ils se rejetèrent en désordre dans leurs retranchements ; mais le consul, ainsi que les lieutenants et les tribuns, s'étant pris h rire et à les railler de ce que, semblables à des enfants, ils avaient peur de vains prestiges, la honte leur rendit du coeur et ils se ruèrent aveuglément sur les objets qui les avaient fuir. Ayant donc dissipé ces fantômes, ils s'élancèrent sur le véritable ennemi, enfoncèrent toute sa ligne, prirent le camp dans le jour même, recueillirent un butin immense, et s'en retournèrent vainqueurs, en se moquant, dans leurs plaisanteries soldatesques, el de l'artifice de l'ennemi et de leur propre frayeur. Peu après, toute la ligue des Étrusques se soulève, et, sous la conduite des Tarquiniens et des Falisques, ils s'avancent jusqu'aux Salines. Contre un ennemi si redoutable, on créa. un dictateur, C. Mucius Rutilus, le premier qui fût plébéien, il nomma maître de la cavalerie C. Plautius, plébéien comme lui. Les patriciens trouvèrent indigne que la dictature même appartînt aux deux ordres, et ils s'opposèrent de tous leurs efforts aux mesures et aux préparatifs que le dictateur voulait ordonner pour cette guerre; mais le peuple n'en fut que plus empressé à accorder tout ce qu'il demanda. Il partit de la ville, et, d'une rive du Tibre à l'autre, transportant son armée sur des bateaux partout où l'attirait la marche de l'ennemi, il parvint à exterminer de nombreuses bandes qui, détachées, pillaient çà et là la campagne. Ayant aussi attaqué à l'improviste le camp des Étrusques, il l'enleva; il y fit huit mille prisonniers, tua ou chassa les autres du territoire de Rome, et, sans l'aveu du sénat, par la volonté du peuple, revint triompher. Comme on ne voulait ni d'un dictateur ni d'un consul plébéien pour tenir les comices consulaires, et que l'autre consul, Fabius, était retenu par la guerre, on en vint à un interrègne. Les interrois furent Q. Servilius Ahala, M. Fabius, Cn. Manlius, C. Fabius, C. Sul- 325 picius, L. Emilius, Q. Servilius, M. Fabius Ambustus. Sous le deuxième interrègne, une querelle s'éleva à propos de l'élection de deux consuls patriciens; les tribuns s'y opposaient, et l'interroi Fabius disait « qu'une loi des douze-tables portait que toujours ce que le peuple aurait en dernier lieu décidé, serait le droit et la règle; or, les suffrages étaient aussi une décision du peuple.» L'opposition des tribuns n'ayant abouti qu'à prolonger les comices, on créa consuls deux patriciens, C.Sulpicius Péticus, pour la troisième fois, et M. Valérius Publicola; et le jour même ils entrèrent en fonctions. XVIII. Ainsi, quatre cents ans après la fondation de la ville de Rome, trente-cinq ans après sa délivrance des Gaulois, onze ans après la conquête du consulat par le peuple, deux consuls patriciens, C. Sulpicius Péticus pour la troisième fois, et M. Valérius Publicola, entrèrent ensemble en fonctions à la suite d'un interrègne. Cette année, Empulum fut pris aux Tiburtes dans une expédition peu mémorable. Selon quelques écrivains, cette guerre fut conduite sous les auspices des deux consuls; selon d'autres, le consul Sulpicius ravagea le territoire des Tarquiniens dans le temps que Valérius mena les légions contre les Tiburtes. A Rome les consuls eurent à soutenir contre le peuple et les tribuns une guerre plus rude. Ils pensaient qu'il y aurait plus que du courage, qu'il y aurait un engagement d'honneur à remettre à deux patriciens ce consulat que deux patriciens avaient reçu : on devait ou céder le tout, si le consulat était devenu enfin une magistrature plébéienne, ou conserver l'entière possession de ce qui leur avait été transmis par leurs pères. De son côté, le peuple murmurait : « Pourquoi vivre, pourquoi être compté parmi les citoyens, si le même droit que deux hommes, L. Sextius et C. Licinius, ont acquis par leur courage, tous ensemble ne peuvent le conserver? Mieux vaut subir soit les rois, soit les décemvirs, soit toute autre domination plus triste encore, que de voir deux patriciens consuls, que de souffrir que chacun des deux ordres n'obéit et ne commandât pas à sou tour, et que l'un d'eux, éternellement établi au pouvoir, s'imaginât que le peuple ne naît que pour servir. » Les tribuns ne maquèrent pas de provoquer des mouvements : mais, dans ce soulèvement universel, on distinguait à peine les chefs. Plus d'une fois, on descendit sans résultat au Champ-de-Mars; plusieurs jours de comices se passèrent dans les séditions; enfin, vaincu par la persévérance des consuls, le peuple en eut tant de douleur, que les tribuns, criant : « C'en est fait de la liberté; il faut abandonner et le Champ-de-Mars et la ville même, captive et esclave sous la tyrannie des patriciens, » la multitude affligée les suivit. Les consuls, délaissés par une partie du peuple, n'en continuèrent pas moins les comices dans cette assemblée incomplète. On créa consuls deux patriciens, M. Fabius Ambustus pour la troisième fois, et T. Quinctius. Dans quelques annales, au lieu de T. Quinctius, je trouve pour consul M. Popillius. XIX. Les deux guerres, cette année, furent conduites heureusement. On combattit les Tiburtes de manière à les forcer à se rendre : on prit sur eux 326 la ville de Sassula ; et leurs autres places auraient eu le même sort, si la nation entière, posant les armes, ne se fût remise à la discrétion du consul. On triompha des Tiburtes; toutefois les vainqueurs se montrèrent cléments. Mais on sévit impitoyablement contre les Tarquiniens. Après un long massacre de leurs soldats sur le champ de bataille, on choisit, dans le grand nombre de leurs prisonniers, trois cent cinquante-huit des plus nobles qu'on envoya à Rome, et le reste fut exterminé. Le peuple ne traita pas avec plus de douceur ceux qu'on avait envoyés à Rome; tous furent, au milieu du forum, battus de verges et frappés de la hache : on vengeait ainsi sur l'ennemi les Romains immolés dans le forum de Tarquinies. Le succès de cette guerre décida aussi les Samnites à rechercher l'amitié de Rome ; le sénat fit une réponse favorable à leurs députés, et, par un traité, les admit à son alliance. Le peuple n'était pas aussi heureux au dedans qu'au dehors; car, bien que la réduction de l'intérêt à un pour cent eût allégé l'usure, le capital écrasait encore le pauvre, qui tombait en servitude; jusque là que, ni l'élection de deux consuls patriciens, ni le soin des comices et des affaires publiques, rien ne put distraire le peuple de ses ennuis privés. L'un et l'autre consulat demeura aux patriciens. On créa consuls C. Sulpicius Péticus pour la quatrième fois, M. Valérius Publicola pour la deuxième. La cité s'occupait alors de la guerre d'Étrurie, car le bruit courait que les Cérites, touchés du malheur d'un peuple auquel les unissaient les liens du sang, s'étaient joints aux Tarquiniens; mais des députés latins appelèrent son attention sur les Volsques, qui, disaient-ils, avaient levé et armé des troupes dont ils menaçaient déjà leurs frontières, et qui de là viendraient dévaster le territoire de Rome. Le sénat pensa qu'il fallait se mettre en mesure des deux côtés; il ordonna aux consuls de lever deux armées et de tirer au sort leurs provinces. Mais bientôt l'attention se porta principalement sur la guerre d'Étrurie, en conséquence d'une lettre du consul Sulpicius, à qui était échue la campagne contre Tarquinies, et qui écrivait que le territoire avait été ravagé près des salines romaines, qu'une partie du butin avait été transportée sur les terres des Cérites, et qu'à coup sûr la jeunesse de ce peuple s'était mêlée aux pillards. C'est pourquoi le consul Valérius, parti contre les Volsques et campé déjà sur les terres de Tusculum, fut rappelé par le sénat, qui lui ordonna de nommer un dictateur. Il nomma T. Manlius, fils de L., qui choisit pour maître de la cavalerie A. Cornélius Cossus, et qui, se contentant d'une armée consulaire, déclara de l'aveu du sénat et par la volonté du peuple le guerre aux Cérites. XX. Alors les Cérites, comme si la guerre leur eût paru plus formellement déclarée par les paroles du peuple romain que par leurs propres actes et par ces dévastations qui avaient provoqué Rome, reprirent à considérer cette guerre avec terreur, assurés que leurs forces ne suffiraient point à la lutte. On se repentit du pillage, on maudit les Tarquiniens qui avaient conseillé la défection; nul ne s'arme, ne s'apprête à la guerre; tous veulent à l'envi qu'on envoie des députés demander grâce pour leur faute. 327 Les députés, arrivés dans le sénat, et renvoyés par le sénat devant le peuple, prièrent les dieux dont ils avaient pieusement conservé le culte durant la guerre des Gaulois, d'inspirer aux Romains heureux, en faveur des Cérites, cette pitié que les Cérites n'avaient pas refusée jadis au peuple romain dans sa misère; puis, se tournant vers le temple de Vesta, ils invoquaient la chaste et religieuse hospitalité qu'ils avaient donnée aux Flamines et aux Vestales. « Après tous ces services, comment croire qu'ils soient tout à coup et sans motif devenus ennemis? ou que, s'ils ont agi en ennemis, ils l'aient fait de sang-froid plutôt qu'égarés par le délire, perdant ainsi, par de récents méfaits, le prix d'anciens bienfaits que se rappelaient surtout des coeurs si reconnaissants? Comment croire qu'ils aient choisi pour ennemi le peuple romain, dans le temps qu'il est si florissant et si heureux à la guerre, après l'avoir pris en amitié dans sa détresse? On ne doit point juger comme un acte d'une volonté libre ce qui n'a été que l'effet de la force et de la nécessité. En traversant leur territoire avec une armée redoutable, les Tarquiniens, qui ne leur avaient demandé que le passage, ont entraîné quelques habitants de la campagne, devenus ainsi complices de ce pillage dont on accuse toute la nation. Ceux-là, si l'on veut les avoir, ils sont prêts à les livrer, ou si on exige leur supplice, à les châtier. Mais que Céré, le sanctuaire du peuple romain, l'asile de ses prêtres, la dépositaire des objets sacrés de Rome, soit conservée pure et vierge des outrages do la guerre, elle qui a si bien accueilli les Vestales et entretenu le culte des dieux ! » Le peuple, plus touché des anciens services de cette ville que de sa faute récente, aima mieux oublier l'injure que le bienfait. En conséquence, la paix fut accordée au peuple cérite, et l'on lit mettre dans le sénatus-consulte qu'il y aurait une trêve de cent ans. Les Falisques s'étant rendus coupables du même crime, on tourna contre eux tout l'effort de la guerre; mais l'ennemi ne se montra nulle part. Après avoir parcouru et désolé leur territoire, on n'essaya point d'assiéger leurs places, et l'on ramena les légions à Rome. Le reste de l'année fut employé à réparer les remparts et les tours; on fit aussi la dédicace d'un temple d'Apollon. XXI. Vers la fin de l'année, les débats des patriciens et du peuple interrompirent les comices consulaires; les tribuns, refusant de consentir à la tenue des comices, si les élections n'étaient pas faites conformément à la loi Licinia, et le dictateur, s'opiniâtrant à détruire à jamais le consulat dans la république plutôt que de le partager entre les patriciens et le peuple. Comme ces débats s'étaient prolongés, le terme de la dictature expira, et l'on en revint à l'interrègne. Les interrois trouvèrent le peuple indigné contre les patriciens, et on lutta au milieu des séditions jusqu'au onzième interroi. Les tribuns revendiquaient les privilèges de la loi Licinia. Le peuple était de plus en plus affligé de voir s'aggraver ses dettes, et les ennuis privés se faisaient jour dans les débats publics. Fatigué de ces querelles, le sénat ordonne, pour le bien de la paix, à l'interroi L. Cornélius Scipion, d'observer la loi Licinia dans les comices consulaires. A P. Valérius Publicola on donna pour collègue le plébéien C. Martius Rutilus. Les esprits 328 ainsi disposés à la concorde, les nouveaux consuls essayèrent aussi d'alléger le fardeau de l'usure, qui semblait le seul empêchement à une entière union, et ils firent de l'acquittement des dettes une question d'intérêt public : ils créèrent cinq magistrats, qui furent chargés de cette répartition pécuniaire, et pour cela appelés mensarii. Ils ont mérité, par leur zèle et par leur équité, que leurs noms fussent signalés dans tous les monuments de l'histoire : ce furent C. Duilius, P. Décius Mus, M. Papirius, Q. Publilius et Ti. Émilius. C'était là une de ces opérations difficiles, dans laquelle souvent on mécontente les deux parties, et toujours immanquablement l'une d'elles; mais en usant de ménagements, et par des avances sur les fonds publics plutôt que par des sacrifices, ils réussirent. En effet, plusieurs paiements étaient en retard et embarrassés plus par la négligence que par la gêne réelle des débiteurs : on dressa dans le forum des comptoirs chargés d'argent, et le trésor paya, après avoir pris toutes sûretés pour l'état; ou bien une estimation à juste prix et une cession libéraient le débiteur. Ainsi, sans injustice, sans une seule plainte d'aucune des parties, on acquitta un nombre immense de dettes. Ensuite, sur le bruit d'une coalition des douze peuples de l'Étrurie, une vaine crainte de guerre fit créer un dictateur. On créa dans le camp, où le sénatus-consulte fut envoyé aux consuls, C. Julius, qui s'adjoignit pour maître de la cavalerie L. Emilius. Au reste, tout fut tranquille au dehors. XXII. A Rome, le dictateur ayant cherché à faire nommer consuls deux patriciens, cette tentative amena encore un interrègne. Les deux interrois qui se succédèrent, C. Sulpicius et M. Fabius, obtinrent ce que le dictateur avait tenté sans succès : le peuple, adouci par un service récent, par l'allégement des dettes, souffrit que l'on créât deux consuls patriciens. On créa ce même C. Sulpicius Péticus, qui avait été interroi le premier, et T. Quinctius Pennus : quelques-uns donnent à Quinctius le prénom de Céson, d'autres, celui de Caius. Partis l'un et l'autre pour combattre, Quinctius les Falisques, Sulpicius les Tarquiniens, et n'ayant rencontré l'ennemi en bataille nulle part, ils firent moins la guerre aux hommes qu'aux campagnes, les brûlant et les pillant. Cette destruction, comme un mal rongeur qui les épuisait peu à peu, dompta l'opiniâtreté des deux peuples, de sorte qu'ils demandèrent une trêve aux consuls; et, renvoyés par eux au sénat, ils en obtinrent une de quarante ans. Quand on fut ainsi délivré du soin de deux guerres menaçantes, le repos étant assure de ce côté, comme depuis le paiement des dettes bien des fortunes avaient changé de maître, on jugea le recensement nécessaire. On indiqua les comices pour l'élection des censeurs; mais C. Marcius Rutilus, qui avait été le premier dictateur plébéien et qui aspirait à la censure, ayant déclaré ses prétentions, l'union des deux ordres fut troublée. Il semblait, à vrai dire, n'avoir pas bien choisi son temps; car les deux consuls étaient patriciens et refusaient de tenir compte de sa demande. Toutefois, il parvint à son but à force de persévérance et grâce à l'appui des tribuns, lesquels s'appliquaient de toute leur 329 force à reconquérir le droit qu'ils avaient perdu aux comices consulaires. D'ailleurs cet homme avait assez de grandeur personnelle pour n'être pas au-dessous des plus hautes dignités; enfin, : c'était lui qui avait ouvert aux plébéiens le chemin de la dictature, et par lui qu'ils voulaient arriver au partage de la censure. On ne varia point dans les comices, et Marcius fut créé censeur avec Manlius Cnéus. Cette année eut aussi un dictateur, M. Fabius; non qu'on ne craignît pas une guerre, mais pour entraver l'exécution de la loi Licinia aux comices consulaires. Le maître de cavalerie adjoint au dictateur fut Q. Servilius. Cependant, malgré cette dictature, la ligue patricienne fut aussi impuissante dans les comices consulaires que dans les élections des censeurs. XXIII. L'ordre plébéien donna pour consul M. Popillius Lénas, l'ordre patricien L. Cornélius Scipion. La fortune voulut que ce fût le consul plébéien qui acquit le plus de gloire. En effet, au moment où l'on reçut la nouvelle qu'une immense armée de Gaulois venait de poser son camp sur les terres des Latins, Scipion étant atteint d'une maladie grave, le soin de la guerre fut commis extraordinairement à Popillius. Il enrôle à la hâte une armée, ordonne à toute la jeunesse de se réunir en armes hors de la porte Capène, près du temple de Mars; aux questeurs de tirer du trésor les enseignes et de les apporter au même endroit, et, après avoir complété quatre légions, confie le surplus des soldats au préteur P. Valérius Publicola, conseillant au sénat de lever une autre armée, et de ménager ainsi, contre les chances incertaines de la guerre, une ressource à la république. Pour lui, après avoir suffisamment préparé et disposé toutes choses, il marcha à l'ennemi; mais, voulant en connaître les forces avant d'en venir à une épreuve décisive, il s'empara d'une hauteur aussi rapprochée que possible du camp des Gaulois, et s'y entoura de retranchements. A peine cette nation fougueuse et d'un naturel avide de batailles a-t-elle aperçu de loin les enseignes romaines, qu'elle déploie sa ligne comme pour engager le combat sur l'heure; puis, quand elle voit les Romains, au lieu de descendre dans la plaine, se retirer et se retrancher sur la hauteur, les croyant frappés d'épouvante, et d'ailleurs d'autant plus faciles à vaincre qu'ils étaient plus occupés de leurs travaux, elle fond sur eux avec un cri féroce. Les Romains n'interrompirent pas leurs travaux, dont les triaires étaient chargés, et les hastes et les princes, qui veillaient en avant des travailleurs et les protégeaient de leurs armes, soutinrent l'attaque. Outre leur courage, ils avaient pour eux l'avantage de la postion ; car en plaine, les javelots et les piques retombent le plus souvent à plat et sans portée, taudis qu'ici, lancés d'en haut, ils frappaient d'aplomb et se fixaient. Les Gaulois, accablés de ces traits qui leur perçaient le corps ou qui s'attachaient à leurs boucliers qu'ils rendaient plus pesants, étaient parvenus en courant presque en face des Romains, quand tout coup ils hésitent et s'arrêtent. Ce moment d'incertitude ayant ralenti leur ardeur et accru celle de l'ennemi, ils sont refoulés en arrière, ils roulent les uns sur les autres, et leur déroute est plus meurtrière que le carnage même; car il y en eut plus d'écra- 330 sés par les fuyards, que de tués par le glaive. XXIV. Cependant la victoire n'était point encore assurée aux Romains : d'autres obstacles les attendaient dans la plaine. Le nombre immense des Gaulois les rendent insensibles à cette perte; aussi, de leur multitude vit-on une armée nouvelle qui opposa des troupes fraîches à l'ennemi vainqueur, Le Romain retint son élan et s'arrêta; des soldats fatigués ne pouvaient suffire à ce second combat; et le consul, en se portant sans précaution aux premiers rangs, avait eu l'épaule gauche à demi traversée d'une javeline, et s'était un moment éloigné du champ de bataille. Déjà, avec ces lenteurs, la victoire échappait, lorsque le consul, après avoir bandé sa blessure, revient en tête des enseignes, et s'écrie : « Qu'attendez-vous là, soldats? dit-il ; vous n'avez pas affaire ici à un ennemi latin ou sabin dont vous ferez un allié après l'avoir vaincu. C'est contre des bêtes féroces que nous avons tiré le fer; il faut verser tout leur sang ou leur donner le nôtre. Vous les avez repoussés du camp, culbutés au fond de la vallée, et c'est sur leur cadavres entassés que vous êtes debout. Couvrez la plaine d'autant de morts que vous en avez couvert la montagne. N'espérez pas qu'ils vous fuient si vous restez en place; que les enseignes marchent en avant, et chargeons l'ennemi. » A ces exhortations, ils s'élancent de nouveau et font reculer les premiers manipules gaulois; puis, se formant eu triangle, ils percent le centre de la ligne. Aussitôt, mis en déroute, les Barbares, qui n'avaient ni discipline, ni chefs, tournent leur impétuosité contre les leurs : dispersés dans la campagne, et emportés par leur fuite au delà même de leur camp, ils gagnent le lieu le plus élevé qu'ils rencontrent, le mont Albain, qui domine comme une citadelle une chaîne de coteaux de même hauteur. Le consul ne les poursuivit pas au delà de leur camp, appesanti qu'il était par sa blessure, et ne voulant pas placer une armée fatiguée du combat au pied des hauteurs occupées par l'ennemi; après avoir accordé au soldat le pillage du camp, il ramena dans Rome son armée victorieuse et riche des dépouilles gauloises. La blessure du consul retarda son triomphe, et le même motif obligea le sénat à créer un dictateur pour tenir les comices au défaut des consuls malades. Nommé dictateur, L. Furius Camillus, à qui l'on adjoignit, comme maître de la cavalerie, P. Cornélius Scipion, rendit aux patriciens l'antique possession du consulat, et, créé consul, en mémoire de ce service par la vive reconnaissance des patriciens, il se fit donner pour collègue Ap. Claudius Crassus. XXV. Avant l'entrée en fonctions des nouveaux consuls, Popillius triompha des Gaulois, au grand contentement du peuple. On se demandait tout bas dans la foule, « si personne s'était mal trouvé d'un consul plébéien? » Et en même temps on attaquait le dictateur qui avait obtenu le consulat, en récompense de son mépris pour la loi Licinia, et qui se déshonorait moins d'ailleurs par cet attentat public que par l'ambition qui lui avait inspiré de se proclamer lui-même consul. L'année fut remarquable par le nombre et la variété des événements. Les Gaulois, descendus des monts Al- 331 bains, où ils n'avaient pu supporter les rigueurs de l'hiver, erraient par les plaines et les côtes maritimes, qu'ils dévastaient. La mer était infestée des flottes des Grecs, qui désolaient les rivages d'Antium, le pays Laurentin et les bouches du Tibre; de sorte qu'une fois les brigands de mer en vinrent aux prises avec les brigands de terre. L'issue du combat demeura douteuse, et ils se retirèrent, les Gaulois dans leur camp, les Grecs sur leurs vaisseaux, incertains de part et d'autre s'ils étaient vaincus ou vainqueurs. Rome eut bientôt un plus grand sujet d'alarmes. Les peuples latins tinrent conseil dans le bois Sacré de Férentina, et répondirent sans détour aux Romains, qui leur commandaient de fournir des troupes, « qu'on devait s'abstenir de commander à ceux dont on avait besoin, et que les Latins aimaient mieux prendre les armes pour leur propre liberté que pour accroître la puissance d'autrui. » Ayant déjà à soutenir à la fois deux guerres étrangères, le sénat s'inquiéta de la défection des alliés ; mais, comprenant que la crainte contiendrait ceux que leur foi n'avait pu contenir, il ordonna aux consuls de déployer dans une levée toutes les forces de la république; Rome devait compter sur une armée composée de ses enfants, quand les alliés lui manquaient. On enrôla de toutes parts, non pas seulement la jeunesse de la ville, mais celle des campagnes, et on en forma, dit-on, dix légions, chacune de quatre mille deux cents fantassins et de trois cents cavaliers. Lever aujourd'hui une pareille armée, au premier bruit d'une invasion étrangère, même en réunissant les forces de cette puissance romaine que l'univers contient à peine, ne serait pas chose facile : tant il est vrai que nous n'avons grandi qu'en ce qui nous mine, en richesse et en luxe. Parmi les autres malheurs de cette année, il faut compter la perte du consul Ap. Claudius, qui mourut au milieu des préparatifs de la guerre. Le pouvoir fut remis à Camille; il demeura consul unique. Grâce à son mérite, qu'on n'osa point soumettre à l'autorité dictatoriale, ou à son nom peut-être, qui parut d'heureux augure dans une lutte contre les Gaulois, les patriciens ne jugèrent pas convenable de lui substituer nu dictateur. Ce consul laisse deux légions pour la garde de la ville, partage les huit autres avec le préteur L. Pinarius, et, plein du souvenir de la valeur paternelle, il prend pour lui, sans avoir recours au sort, la guerre des Gaulois, et charge le préteur de défendre la côte maritime, et de repousser les Grecs du littoral. Puis il descendit sur le territoire du Pomptinum; et comme il ne voulait pas combattre en plaine tant qu'il n'y serait point forcé, et qu'il pensait d'ailleurs qu'avec un ennemi qui ne pouvait vivre que de rapines, le meilleur moyen de le réduire était de s'opposer à ses dévastations, il choisit un poste favorable et s'y retrancha. XXVI. Pendant que l'armée passait le temps dans cette position, un Gaulois s'avança, remarquable par sa haute taille et par son armure : il frappa de sa lance son bouclier, et quand il eut obtenu silence, il provoqua, par interprète, un des Romains à combattre avec lui. Il y avait là un tribun des soldats, un jeune homme, M. Valérius, qui, ne s'estimant pas moins digue de cet honneur 332 que T. Manlius, après en avoir demandé la permission au consul, s'avança entre les deux camps avec ses armes. L'intervention des dieux dans cette lutte fit perdre à l'homme une part de sa gloire. En effet, au moment où le Romain venait de commencer la lutte, un corbeau se percha sur son casque, faisant face à l'ennemi, ce que d'abord le tribun vit avec joie comme un augure envoyé du ciel; puis il pria, s'il en était ainsi, le dieu ou la déesse qui lui avait envoyé cet heureux message, de vouloir bien lui être propice. Chose merveilleuse! non seulement l'oiseau demeura au lieu qu'il avait choisi, mais chaque fois que le combat recommençait, se soulevant sur ses ailes, il attaquait du bec et des ongles le visage et les yeux de l'ennemi, jusqu'à ce qu'enfin, effrayé à la vue d'un tel prodige, les yeux et l'esprit troublés tout ensemble, le Gaulois tombe égorgé par Valérius; et alors le corbeau prend son vol vers l'Orient et disparaît. Jusque-là les deux armées étaient restées immobiles ; mais quand le tribun se mit à dépouiller le cadavre de son ennemi mort, les Gaulois ne se tinrent plus à leur poste, et les Romains volèrent plus rapidement encore vers le vainqueur. Là, à la suite d'un conflit autour du cadavre gisant du Gaulois, un combat terrible s'engage. Ce ne sont plus seulement les manipules des postes avancés, ce sont les légions confondues des deux côtés, qui se heurtent. Camille, voyant ses soldats tent fiers de la victoire du tribun, tout joyeux de l'aide et de la protection des dieux, ordonne de marcher au combat; et, montrant le tribun paré de nobles dépouilles : « Imitez-le, soldats, disait-il, et, autour du cadavre de leur chef, couchez à terre ces hordes de Gaulois. » Ni les dieux ni les hommes ne manquèrent à ce combat, et la déroute des Gaulois ne fut pas un instant douteuse, tant l'issue de ce combat singulier avait saisi fortement les esprits dans les deux armées. Le combat ne fut vivement disputé qu'aux premiers postes, dont la rencontre avait entraîné les autres; tout le reste, avant d'arriver à la portée du trait, tourna le dos. D'abord, cette multitude erra dispersée chez les Volsques et sur le territoire de Falerne; ensuite ils gagnèrent l'Apulie et la mer inférieure. Le consul assembla l'armée, fit l'éloge du tribun, et lui donna dix bœufs et une couronne d'or; puis, le sénat lui ayant ordonné de prendre en main la guerre maritime, il réunit son camp à celui du préteur. Mais, voyant que la lâcheté des Grecs, qui refusaient le combat, prolongerait la guerre, sur l'ordre du sénat, il nomma dictateur, pour la tenue des comices, T. Manlius Torquatus. Le dictateur nomma maître de la cavalerie A. Cornélius Cossus, ouvrit les comices, et proclama consul, quoiqu'absent, aux applaudissements du peuple, son rival de gloire, M. Valérius Corvus (car il fut surnommé ainsi désormais ), âgé de vingt-trois ans. On donna pour collègue plébéien à Corvus, M. Popillius Lénas, qui fut ainsi consul pour la quatrième fois. Camille ne fit rien de mémorable contre les Grecs, qui se battaient aussi mal sur terre que les Romains sur mer. Enfin, repoussés de tous côtés, et manquant d'eau ainsi que d'autres choses nécessaires, ils quittèrent l'Italie. A quelle contrée, à quel peuple appartenait cette flotte, je ne saurais le dire; mais, ce qui me parait le plus probable, c'est qu'elle fut 333 envoyée par les tyrans de Sicile; car la Grèce ultérieure, fatiguée à cette époque de guerres intestines, redoutait déjà la puissance macédonienne. XXVII. Les armées licenciées, tandis que nous avions la paix au dehors, et au dedans le repos par le bon accord des deux ordres, comme si c'eût été trop de bonheur, la peste attaqua Rome et força le sénat de commander aux décemvirs de consulter les livres Sibyllins; et, d'après leur avis, on fit un lectisterne. La même année les Antiates établirent une colonie à Satricum, et relevèrent la ville, détruite par les Latins. A Rome, on conclut un traité avec des envoyés de Carthage, qui étaient venus demander alliance et amitié. La même tranquillité continua de régner au dedans et au dehors, sous le consulat de T. Manlius Torquatus et de C. Plautius. On réduisit de moitié l'intérêt fixé à un pour cent, et l'on arrêta que les dettes seraient acquittées en quatre paiements égaux, dont le premier comptant, et le reste dans l'espace de trois ans ; et, bien que cet arrangement fût encore onéreux pour une partie du peuple, le respect de la foi publique eut plus de pouvoir sur le sénat que les malaises particuliers. Ce qui fut surtout un soulagement pour la ville, c'est qu'il y eut sursis aux levées de tribut et de soldats. Trois ans après le rétablissement de Satricum par les Volsques, on reçut du Latium la nouvelle que des députés antiates parcouraient les cités latines pour les soulever : sans attendre que le nombre des ennemis se fût accru, M. Valérius Corvus, élu pour la seconde fois consul avec C. Pétélius, eut ordre de porter la guerre aux Volsques, et marcha sur Satricum, à la tête d'une armée redoutable. Là, les Antiates et les autres Volsques qui se tenaient prêts à agir au premier mouvement de Rome vinrent à sa rencontre; et, entre peuples animés de si vieilles haines, le combat ne se fit pas attendre. Les Volsques, qui étaient plus ardents à guerroyer qu'habiles à la guerre, furent vaincus; ils gagnèrent en déroute les remparts de Satricum ; et, comme ils ne comptaient pas beaucoup sur les murailles de la ville, quand ils la virent entourée de troupes, près d'être escaladée et enlevée, ils se rendirent au nombre de quatre mille soldats, outre une foule d'habitants sans armes. La place fut démolie et brûlée : le temple de Matuta Mère fut seul épargné par le feu. On donna au soldat tout le butin, à l'exception des quatre mille hommes qui s'étaient rendus : le consul les mena enchaînés devant son char de triomphe; puis il les vendit et en rapporta le prix, qui fut considérable, au trésor public. Des écrivains prétendent que tous ces prisonniers n'étalent que des esclaves, et cela rend le fait plus vraisemblable; car on n'eût pas vendu des soldats qui s'étaient rendus. XXVIII. A ces consuls succédèrent M. Fabius Dorso, et Ser. Sulpicius Camérinus. Une invasion soudaine des Aurunces fit craindre, que cet acte d'un seul peuple n'eût été conseillé par toute la confédération latine; et, comme si le Latium eût été déjà en armes, on créa dictateur L. Furius, qui nomma maître de la cavalerie Cn. Manlius Capitolinus. Après avoir proclamé le Justitium, suivant l'usage observé dans les grandes alarmes, on pressa la levée sans exempter per-, sonne; et les légions marchèrent avec la plus 334 grande célérité contre les Aurunces. Les hommes auxquels on avait affaire étaient plutôt des pillards que de véritables ennemis. Une première rencontre décida la victoire. Cependant, comme ils avaient d'eux-mêmes apporté la guerre, et qu'ils n'avaient pas balancé à se présenter au combat, le dictateur, croyant que le secours des dieux ne lui serait pas inutile, avait pendant l'action voué un temple à Junon Moneta : enchaîné par ce voeu, il retourna vainqueur à Rome et abdiqua la dictature. Le sénat ordonna la création de duumvirs pour veiller à ce que ce temple fût digne de la majesté du peuple romain ; on y destina dans la citadelle l'emplacement qu'avait occupé la maison de M. Manlius Capitolinus. Les consuls, profitant, pour combattre les Volsques, de l'armée du dictateur, attaquèrent l'ennemi, qui était sans défiance, et lui enlevèrent Sora. Dans l'année qui suivit celle où il avait été voué, le temple de Moneta fut dédié, sous les consuls C. Martius Rutilus et T. Manlius Torquatus, élus, celui-ci pour la seconde fois, celui-là pour la troisième. Cette dédicace fut accompagnée d'un prodige semblable à l'ancien prodige du mont Albain; car il tomba une pluie de pierres, et la nuit parut voiler la lumière du jour. Après avoir consulté les livres, comme la ville était pleine d'une religieuse terreur, le sénat crut devoir nommer un dictateur pour célébrer les féries. On nomma P. Valérius Publicola, et on lui donna pour mitre de cavalerie Q. Fabius Ambustus. On ne se contenta pas d'envoyer les tribus en supplications solennelles; on y appela aussi les peuples voisins, et l'on assigna le rang et le jour où ils devaient y assister. Il y eut, dit-on, cette année, quelques jugements cruels du peuple contre des usuriers que les édiles avaient cités devant lui. Enfin, il y eut également un interrègne dont on ne sait pas au juste la cause. Il cessa, et ceci pourrait en indiquer le but, par la création de deux consuls patriciens : M. Valérius Corvus, élu pour la troisième fois, et A. Cornélius Cossus. XXIX. Nous allons maintenant raconter des guerres plus importantes, et par les forces de l'ennemi, et par l'éloignement des lieux qui en furent le théâtre, et par le long temps qu'elles durèrent. Cette année, en effet, on eut la guerre avec les Samnites, nation puissante par ses richesses et par ses armes. Après la guerre contre les Samnites, si longtemps incertaine, nous eûmes pour ennemi Pyrrhus, et après Pyrrhus les Carthaginois. Quelles affaires immenses! Que d'extrêmes périls nous avons traversés avant que l'empire ait pu s'élever à cette grandeur qu'il a tant de peine à soutenir! Quant à cette guerre des Romains et des Samnites, jusqu'alors unis d'alliance et d'amitié, elle eut une origine étrangère; elle ne vint pas des Samnites. Ce peuple se sentant le plus fort avait sans motif porté les armes contre les Sidicins, qui, dans leur détresse, obligés de recourir à l'assistance d'une nation plus puissante, s'allièrent aux Campaniens. Les Campaniens apportèrent plutôt un nom que des forces au secours de leurs alliés : énervés par la mollesse, ils furent battus sur les terres des Sidicins par des hommes endurcis au service des armes, et attirèrent sur eux tout l'effort de la guerre; car les Samnites, laissant là les Sidicins, attaquèrent le 335 rempart de leurs voisins, les Campaniens eux-mêmes, conquête qui devait être aussi facile et qui promettait plus de butin et de gloire, s'étant emparés des monts Tifates qui dominent Capoue, et les ayant garnis d'un fort détachement, ils descendirent en bataillon carré dans la plaine qui s'étend entre les villes et les montagnes. Là s'engagea un nouveau combat : les Campaniens y eurent encore le dessous et furent refoulés dans leurs murs. Comme l'élite de leur jeunesse avait succombé, et qu'ils ne voyaient plus d'espoir autour d'eux, ils furent réduits à demander du secours aux Romains. XXX. Leurs députés, introduits dans le sénat, parlèrent à peu près en ces termes : « Le peuple campanien nous a envoyés en députation près de vous, Pères conscrits, afin que nous vous demandions en son nom amitié pour toujours, et pour le moment assistance. Si nous l'avions demandée lorsque nos affaires prospéraient, cette amitié, formée plus vite, eût été serrée de plus faibles liens; car alors nous aurions pensé que nous avions traité avec vous d'égal à égal, et, tout eu demeurant vos amis comme nous le sommes, nous vous aurions été moins soumis et moins dévoués. Maintenant, gagnés par votre commisération, défendus par votre secours dans nos dangers, la reconnaissance du bienfait reçu sera pour nous un devoir, à peine de paraître ingrats et indignes de toute protection divine et humaine. Et, par hercule, si les Samnites sont devenus avant nous vos amis et vos alliés, ce ne sera pas, je pense, une raison pour que vous nous refusiez votre amitié; tout au plus auront-ils sur nous un droit d'ancienneté, un degré d'honneur de plus; car il n'a pas été stipulé dans votre alliance avec les Samnites que vous n'en concluriez pas de nouvelles; et de tout temps le seul désir d'être votre ami a toujours été auprès de vous un titre suffisant à votre amitié. Les Campaniens, quoique notre fortune présente nous empêche de trop nous vanter, ne le cèdent, par l'étendue de leur ville et la fertilité de leurs terres, à aucun peuple hormis à vous seuls, et ils n'ajouteront pas peu, j'imagine, à votre prospérité en faisant amitié avec vous. Que les Èques et les Volsques, éternels ennemis de cette ville, tentent un mouvement, nous serons là sur leurs pas, et ce que vous aurez fait les premiers pour notre salut, nous le ferons à jamais pour votre empire et votre gloire. Toutes ces nations qui nous séparent de vous, une fois domptées, ce qui ne tardera guère, et votre valeur et votre fortune nous en répondent, votre empire s'étendra sans interruption jusqu'à nous. Cruel et déplorable aveu que nous arrache notre fortune! Nous en sommes arrivés là, Pères conscrits, que nous devons, nous Campaniens, appartenir désormais à nos amis ou à nos ennemis. Si vous nous protégez, nous serons à vous; si vous nous délaissez, aux Samnites. C'est donc à vous de voir lequel vous préférez, ou que Capoue et la Campanie entière s'ajoutent à vos forces, ou qu'elles grossissent celles des Samnites. Il est juste, Romains, d'ouvrir à tous un facile accès à votre pitié, à votre protection; mais surtout à ceux-là qui, en portant à d'autres un secours imploré, ont dépassé leurs forces, et en sont venus eux-mêmes à cette extrémité. Si, en apparence nous combattions pour 336 les Sidicins, en réalité c'était pour nous-mêmes nous avions vu un pays voisin menacé de l'infâme brigandage des Samnites, et l'incendie qui aurai dévoré les Sidicins prêt à s'étendre jusqu'à nous Aujourd'hui si les Samnites viennent nous envahir, ce n'est pas de dépit qu'on les ait outragés, c'est de joie qu'on leur ait fourni un prétexte Est-ce que, si leur invasion avait pour motif la vengeance, et non la satisfaction de leur cupidité est-ce que ce serait trop peu encore que d'avoir exterminé nos légions, d'abord dans le pays des Sidicins, puis dans les champs mêmes de la Campanie? Quelle est donc cette colère si acharnée, que le sang de deux armées n'ait pu l'assouvir. Ajoutez à cela la dévastation des campagnes, les butins d'hommes et de troupeaux, les fermes: incendiées et ruinées, tout notre pays ravagé par le fer et le feu. N'était-ce pas assez pour assouvir leur colère? Mais c'est leur cupidité qu'il faut assouvir; c'est elle qui les entraîne à la conquête de Capoue : ils veulent ou détruire cette ville si belle, ou la posséder eux-mêmes. Vous, Romains, rendez-vous-en maîtres par votre générosité, plutôt que de souffrir qu'ils s'en emparent par un crime. Je ne parle pas à un peuple qui se refuse à de justes guerres; mais que vos secours se montrent seulement, et vous n'aurez pas même, je pense, besoin de combattre. Le mépris des Samnites est parvenu jusqu'à nous, mais il n'a pu monter plus haut. L'ombre de votre protection, Romains, suffira pour nous mettre en sûreté; et, désormais, tout ce que nous aurons, tout ce que nous serons, nous le regarderons comme étant à vous. Pour vous sel a labouré le sol de la Campanie, pour vous se peuplera la ville de Capoue ; nous vous honorerons à l'égal de nos fondateurs, de nos pères, de nos dieux immortels. Il n'y aura pas une de vos colonies qui ait pour vous plus d'attachement, plus de fidélité. Faites un signe de tête, Pères conscrits; accordez aux Campaniens votre divine et invincible protection; permettez-leur d'espérer le salut de Capoue. De quel immense concours de citoyens de toutes classes pensez-vous que nous avons été suivis à notre départ? Combien n'y a-t-il pas eu de larmes répandues, et de voeux adressés au Ciel? En quelle anxiété se trouvent à cette heure le sénat et le peuple campaniens, nos femmes et nos enfants? Toute la multitude se tient aux portes de la ville, regardant au loin sur le chemin qui doit nous ramener, et, j'en suis sûr, Pères conscrits, attendant, l'esprit plein d'angoisse, la réponse que vous nous chargerez de leur faire. Un mot de vous peut leur apporter salut, victoire, vie et liberté; mais je tremble d'imaginer ce qu'un autre leur apporterait. Décidez donc si nous devons être vos alliés et vos amis, ou n'être plus. » XXXI. Les députés s'étant retirés, le sénat délibère; et quoiqu'aux yeux d'un grand nombre, cette ville, la plus grande et la plus opulente de l'Italie, avec ses champs si fertiles et voisins de la mer, parût une ressource contre les chances des mauvaises récoltes et le grenier du peuple romain, la bonne foi prévalut sur tant d'avantages, et le consul, au nom du sénat, répondit: Le sénat vous juge dignes, Campaniens, de sa 337 protection; mais il ne doit pas, en formant amitié avec vous, attenter à une amitié, à une alliance plus ancienne. Les Samnites nous sont unis par un traité; les attaquer, ce serait offenser encore plus les dieux que les hommes, et c'est pourquoi nous nous y refusons. Mais, ainsi que la justice et le devoir le commandent, nous enverrons des députés à nos alliés et à nos amis, pour les prier qu'aucune violence ne vous soit faite. a A cela, le chef de la députation, d'après les instructions qu'il avait apportées de sa ville, répliqua : « Puisque vous ne voulez point prendre la juste défense (le nos intérêts contre la violence et l'injustice, vous défendrez au moins les vôtres. En conséquence, peuple Campanien, ville de Capoue, terres, temples des dieux, enfin, toutes les choses divines et humaines, nous vous livrons, nous vous donnons tout, Pères conscrits, à vous et au peuple romain : si désormais on nous outrage, ce salit vos sujets qu'on outragera.» Cela dit, tous, les mains tendus vers les consuls, ils se prosternèrent, pleins de larmes, dans le vestibule de la curie. Les patriciens étaient émus de cet exemple de l'instabilité des destinées humaines, eu voyant un peuple si riche et si puissant, cité pour son faste et pour sa fierté, que ses voisins avaient naguère appelé à leur aide, perdre courage au point de se mettre soi et ses biens au pouvoir d'autrui. On crut dès lors que l'honneur défendait de trahir des gens qui se donnaient, et que les Samnites agiraient contre l'équité, s'ils attaquaient encore un territoire et une ville acquis par cette cession au peuple romain. Il fut donc décidé qu'on enverrait sans délai des députés aux Samnites, avec la commission « d'exposer à ce peuple les prières des Campaniens, la réponse du sénat, fidèle à l'amitié des Samnites, et enfin l'abandon fait à Rome. Ils devaient demander, au nom de l'alliance et de ramille qui existait entre eux, d'épargner les sujets de Rome, de ne plus porter sur un territoire cédé au peuple romain des armes ennemies. Si les voies de douceur avaient peu de succès, ils enjoindraient aux Samnites, par l'ordre exprès du peuple romain et du sénat, de respecter la ville de Capoue et le territoire campanien. » Les députés ayant rempli leur message, le conseil des Samnites répondit fièrement qu'ils poursuivraient la guerre; et même leurs magistrats, sortis de la curie, appelèrent en présence des députés les chefs des cohortes, et leur commandèrent d'aller sans retard ravager les terres de Capoue. XXXII. Des qu'on apprit à Rome l'accueil fait aux députés, le sénat, laissant là tout autre soin, envoya des féciaux demander réparation aux Samnites, et, sur leur refus, leur déclara solennellement la guerre, en décrétant qu'on soumettrait sans délai cette affaire à la sanction du peuple. Sur l'ordre du peuple, les deux consuls, partis de la ville avec deux armées, entrèrent, Valérius dans la Campanie, Cornélius dans le Samnium, et campèrent, l'un près du mont Gaurus, l'autre près de Saticula. Valérius, le premier, rencontra les Samnites ; lesquels avaient prévu que le poids de la guerre pencherait de ce côté : d'ailleurs la colère les animait contre les Campaniens, si 338 empressés à porter ou à demander contre eux des secours. A la vue du camp romain, tous à l'envi demandent fièrement à leur chef le signal du combat, assurant que le Romain aurait à protéger le Campanien le même sort que le Campanien avait eu naguère à secourir le Sidicin. Valérius, après avoir, pendant quelques jours, éprouvé l'ennemi par de légers combats, ordonna le signal de la bataille, et exhorta en peu de mots les soldats : « Une guerre nouvelle, un ennemi nouveau ne doit pas leur inspirer de crainte ; à mesure qu'ils porteront leurs armes plus loin de la ville, ils arriveront à des nations de moins en moins aguerries. Ce n'est pas par les défaites des Sidicins et des Campaniens qu'il faut juger de la valeur des Samnites; quels que fussent ceux qui combattaient, il fallait bien que l'un des deux partis fût vaincu. Pour les Campaniens, c'est à coup sûr leur luxe immodéré, leur dissolution, leur mollesse, plutôt que la vigueur de l'ennemi qui les a vaincus. Qu'est-ce après tout que ces deux succès des Samnites dans l'espace de tant de siècles, en comparaison de tous ces hauts faits du peuple romain, qui compte peut être, depuis la fondation de sa ville, plus de triomphes que d'années? qui tout autour de lui, Sabins, Étrusques, Latins, Herniques, Èques, Volsques, Aurunces, a tout dompté par les armes? qui, après avoir battu les Gaulois dans tant de rencontres, a fini par ne leur laisser de refuge que la mer et leurs vaisseaux? Ils doivent, en allant au combat, avoir foi chacun dans leur gloire militaire, dans leur courage, et envisager aussi sous quels ordres, sous quels auspices la lutte s'engage; si leur chef n'est qu'un brillant discoureur, bon tout au plus à entendre, brave en paroles seulement, et ne connaissant rien à la guerre, ou s'il est homme qui sache manier les armes, marcher en tête des enseignes, se porter bravement au milieu de la mêlée. C'est d'après mes actions, soldats, dit-il, et non d'après mes paroles qu'il faut vous conduire; demandez-moi non des ordres seulement, mais l'exemple. Ce n'est pas par l'intrigue, par les cabales ordinaires aux nobles, c'est par ce bras que j'ai obtenu trois consulats et toute ma gloire. Il fut un temps où l'on aurait pu dire : C'est que tu étais patricien et issu des libérateurs de la patrie, et que ta famille eut le consulat la même année que Rome eut un consul. Aujourd'hui, ouvert sans distinction à nous patriciens et à vous plébéiens, le consulat n'est plus, comme auparavant, le prix de la naissance, mais du mérite ; et c'est pourquoi, soldats, vous pouvez aspirer, vous aussi, aux suprêmes honneurs. Bien que, par la volonté des dieux, vous m'ayez donné le nouveau surnom de Corvus, non, le vieux surnom de ma famille, Publicola, n'est point sorti de ma mémoire. Toujours, en paix comme en guerre, citoyen dans les plus hautes magistratures comme dans les plus humbles, tribun ou consul, et du même coeur en tous mes consulats, j'aime et j'aimai toujours le peuple romain. Maintenant le temps presse; marchez, et avec le secours des dieux, remportez avec moi un premier et complet triomphe sur les Samnites. » XXXIII. Jamais on ne vit général se rendre plus agréable au soldat en partageant avec les plus hum- 339 bles tous les travaux du service. En outre, dans les jeux militaires où des égaux luttent ensemble d'agilité ou de vigueur, doux et facile, et toujours, vainqueur ou vaincu, de l'humeur la plus affable, il ne dédaignait aucun des adversaires qui se présentaient. Il était bienfaisant à propos dans ses actes ; dans ses discours, il ne ménageait pas moins l'indépendance d'autrui que sa propre dignité; et, ce qui plaît surtout au peuple, il exerçait les magistratures du même esprit dont il les sollicitait. Aussi, l'armée entière, avant de sortir du camp, répondit avec une incroyable allégresse aux exhortations de son chef. Ce qui ne s'était jamais vu dans d'autres batailles, le combat s'engagea avec même espoir des deux parts, avec mêmes forces et même confiance en soi, mais sans mépris pour l'ennemi. Les Samnites étaient fiers de leurs derniers exploits et de leur double victoire des jours précédents; les Romains de leurs quatre cents ans de gloire, et de cette victoire qui remontait à l'époque de la fondation de leur ville. Toutefois les deux partis étaient inquiets d'avoir un ennemi nouveau à combattre. La bataille marqua bien l'esprit qui les animait, car on lutta longtemps avant que de part ou d'autre l'armée ne pliât. Enfin, le consul voulant jeter le désordre dans cette armée qu'on ne pouvait repousser par la force, essaya, au moyen d'une charge de cavalerie, de troubler les premiers rangs de l'ennemi. Mais voyant que cette manoeuvre n'avait pas de succès, et que, resserrés dans un étroit espace, les escadrons s'agitaient et tournaient sur eux-mêmes sans pouvoir s'ouvrir un chemin, il revint en tête des légions et, sautant de cheval : « A nous, soldats, dit-il ; à nous autres, fantassins cette affaire est la nôtre. Marchons, et à mesure que vous me verrez avancer et me frayer un chemin par le fer dans les rangs ennemis, à mon exemple renversez tout ce qui se trouvera devant vous. Cette plaine, où se dressent en ce moment tant de lances étincelantes, vous l'allez voir bientôt éclaircie, balayée par le carnage. » Ainsi parle le consul,, et, sur son ordre, les cavaliers, se repliant sur les deux ailes, laissent libre l'accès du centre aux légions. Le premier de tous, le consul fond sur l'ennemi, et tous ceux que le hasard offre à ses coups, il les égorge. Enflammés parce spectacle, nos soldats, à droite, à gauche, chacun devant soi, engagent une lutte mémorable. Les Samnites tiennent ferme, bien qu'ils reçoivent plus de coups qu'ils n'en portent. L'on se battait déjà depuis longtemps, et il y avait eu un massacre atroce autour des enseignes des Samnites, sans que personne eût fui, tant ils avaient à coeur de n'être vaincus que par la mort. Mais les Romains sentant que les forces commencent à leur manquer, et qu'il ne reste guère de jour, emportés par la rage, se ruent sur l'ennemi. Alors on le vit lâcher pied et se disposer à fuir; alors on prit, on tua le Samnite; et peu auraient échappé, si la nuit n'eût mis fin à cette victoire; car ce n'était plus un combat. Les Romains avouaient qu'ils n'avaient jamais eu affaire à un ennemi plus opiniâtre; et les Samnites, quand on leur demandait pour quel motif des courages si obstinés avaient pu se décider à fuir, répondaient: a Qu'ils avaient cru voir la flamme jaillir des yeux des Romains, de leurs visages forcenés, de leurs bouches furieu- 340 ses; que de là surtout était venue leur terreur. » Et cette terreur, ils l'avouèrent, non pas seulement par l'issue du combat, mais aussi par leur retraite nocturne. Le jour suivant, le Romain s'empara du camp déserté par l'ennemi, et toute la multitude des Campaniens y accourut pour lui rendre grâces. XXXIV. Au reste, peu s'en fallut que la joie de cette victoire ne fût corrompue par un immense désastre dans le Samnium. En effet, parti de Saticula, le consul Cornelius avait imprudemment engagé son armée dans un défilé qui s'ouvrait sur une vallée profonde, et occupé tout ' l'entour par l'ennemi : et ce fut seulement quand toute retraite sûre était devenue impossible, qu'il vit l'ennemi sur sa tête. Pendant que les Samnites attendent que toute l'armée soit descendue au fond de la vallée, P. Décius, tribun militaire, aperçoit dans k défilé une colline élevée qui domine le camp ennemi, et dont l'accès, trop rude pour des soldats chargés de bagages, était facile à des troupes légères. En conséquence, s'adressant au consul épouvanté : «Vois-tu, lui dit-il, A. Cornélius, cette éminence au-dessus de l'ennemi? Ce rocher que les Samnites ont eu l'aveuglement de négliger sera le rempart de nos espérances et de notre salut, si nous nous eu emparons sans délai. Donne-moi seulement les princes et les hastats d'une seule légion; lorsqu'avec eux j'aurai gravi le faîte, marche en avant sans rien craindre, et mets-toi en sûreté avec l'avinée; car l'ennemi, sous nos pieds, en butte à tous nos coups, ne pourra remuer sans se perdre. Pour nous, ou la fortune du peuple romain, ou notre courage nous tirera d'affaire. » Comblé d'éloges par le consul qui lui donne les hommes qu'il a demandés, il s'avance avec eux couvert par les broussailles. Il ne fut aperçu de l'ennemi qu'en approchant du lieu qu'il voulait atteindre. La surprise et l'effroi des Samnites, qui tous avaient les yeux tournées sur lui, laissèrent au consul le temps de conduire son armée sur un terrain meilleur; et lui il s'établit au sommet de la colline. Les Samnites, tournant leurs enseignes d'un côté, puis d'un autre, laissent échapper à la fois deux occasions : ils ne peuvent plus poursuivre le consul à moins de s'engager à leur tour dans cette vallée où naguère ils le tenaient exposé à leurs traits, ni faire gravir à leurs troupes cette hauteur que Décius occupe au-dessus d'eux. Mais la colère les entraîne de préférence contre ceux qui leur ont enlevé la chance de la victoire, et ils sont excités par la proximité et le petit nombre de ces ennemis : tantôt ils veulent entourer de tous côtés la colline, pour séparer Décius du consul; tantôt ils imaginent de lui laisser le chemin libre, afin qu'il descende dans la vallée où ils l'accableront. La nuit les surprit dans ces incertitudes. Décius eut d'abord l'espoir qu'ils monteraient vers lui et qu'il pourrait les combattre de son poste élevé; mais bientôt il commença à s'étonner en ne les voyant, ni risquer l'attaque, ni au moins, si le désavantage du lieu les en détournait, s'entourer de retranchements et d'autres ouvrages. Alors, ayant appelé vers lui les centurions : « Quelle ignorance (le la guerre et quelle paresse! Comment de pareilles gens ont-ils pu vaincre les Sidi- 341 cins et les Campaniens? Voyez leurs enseignes : ils vont à droite, à gauche, ils rentrent, ils sortent; et nul ne songe à se mettre à l'oeuvre quand nous pourrions déjà être entourés d'un retranchement. Nous serions aussi insensés qu'eux, si nous restions ici plus de temps qu'il ne nous convient. Venez donc, avec moi, profitons du jour qui nous reste pour reconnaître oit ils ont placé leur poste et si quelque issue nous est ouverte. » Recouvert de la saie du soldat, et ayant fait prendre aux centurions qu'il emmenait avec lui le vêtement des légionnaires, afin que l'ennemi ne s'aperçut pas que le chef faisait une reconnaissance, il observa tout en silence. XXXV. Il place ensuite des sentinelles, et fait donner à tous les autres ce mot d'ordre : « Quand la Trompette aura annoncé la seconde veille, la troupe se réunira en armes et en silence auprès de lui. » Aussitôt que, d'après cet ordre, ils se furent rassemblés sans bruit : « Ce silence, dit-il, soldats, il faut l'observer en m'écoutant, et laisser l'a toute acclamation militaire. Quand je vous aurai développé mon idée, ceux de vous qui l'approuveront passeront sans rien dire à ma droite, et nous suivrons l'avis du côté où sera le plus grand nombre. Maintenant voici mon projet; écoutez : Ce n'est point la fuite qui vous a jetés à cette place où l'ennemi vous enveloppe, et ce n'est pas non plus la lâcheté qui vous y a retenus : c'est par votre courage que vous vous en êtes emparés, c'est par votre courage qu'il en faut sortir. En venant ici, vous avez sauvé une belle armée au peuple romain; en échappant d'ici, vous vous sauverez vous-mêmes. Vous méritez bien, vous qui, peu nombreux, avez si bien secouru tant d'hommes, de n'avoir besoin pour vous du secours de personne. Nous avons affaire à un ennemi qui, pouvant hier anéantir l'armée entière, n'a pas eu l'esprit d'user de la fortune; qui n'a reconnu l'avantage de cette colline qui menace sa tête qu'en la voyant à nous; qui n'a pu, bien quo nous soyons en si petit nombre, avec ses milliers d'hommes nous empêcher de la gravir, ni, quand nous avons été maîtres du poste, profiter de tout lu jour qui lui restait pour nous y enfermer par une tranchée. Quand vous vous êtes ainsi joués de lui, il y voyait clair, il veillait; à cette heure qu'il est endormi, il faut, que dis-je? il est nécessaire que vous le trompiez encore. Car notre situation est telle, que c'est moins un conseil que je vous donne qu'une loi de la nécessité que je vous montre. Il ne s'agit plus en effet de délibérer si nous devons demeurer ou partir, à présent que la fortune ne vous a rien laissé, avec vos armes, qu'un courage qui sait s'en servir, à présent que nous mourrons ici de faim et de soif, si nous craignons le fer plus qu'il ne convient à des hommes, à des Romains. Ainsi, nous n'avons d'autre salut que de nous arracher d'ici, de partir; et il faut que ce soit de jour ou de nuit. Or, ce dei nier parti est le plus sûr : car, si nous attendons le jour, comment espérer que l'ennemi ne nous entourera pas d'un retranchement et d'un fossé continu, lui qui déjà, vous le venez, a de tous côtés investi de soldats la colline? Si donc la nuit peut servir une invasion, et elle le peut, cette heure de la nuit est assurément la plus favorable. Vous voilà rassemblés au signal de la seconde veille, et 342 c'est l'instant où les moi tels sont plongés dans le sommeil le plus profond : marchant à travers ces corps endormis, votre silence leur dérobera votre passage, ou, s'ils s'éveillent, vos cris soudains les frapperont de terreur. Suivez-moi seulement comme vous m'avez suivi déjà; moi je suivrai la fortune qui m'a conduit ici. Allons, que ceux qui voient dans ce projet notre salut s'avancent et passent à ma droite. » XXXVI. Tous y passèrent, et suivirent Décius qui se dirigeait dans les intervalles qui séparent les postes. Ils avaient déjà traversé la moitié du camp, lorsqu'un soldat, en sautant par-dessus les corps des sentinelles couchées et endormies, heurta un bouclier. A ce bruit, une sentinelle s'éveille et pousse son voisin; ils se lèvent, en appellent d'autres, sans savoir si c'est une troupe des leurs ou l'ennemi ; si c'est le détachement qui s'évade ou le consul qui s'empare du camp. Décius, ne pouvant plus feindre, commande aux soldats de pousser des cris, et glace, par la peur, ces ennemis engourdis par le sommeil; ils n'ont plus la force ni de s'armer promptement, ni de résister, ni de poursuivre. Au milieu de l'effroi et du désordre des Samnites, le détachement romain massacre les gardes qu'il rencontre et se sauve vers le camp du consul. Il restait encore un peu de nuit, et ils pouvaient enfin se croire en sûreté, quand Décius : « Courage, soldats romains, dit-il; votre marche à la colline et votre retour seront loués dans tous les siècles. Mais, pour qu'on puisse contempler un si rare courage, il faut la lumière et le jour; il serait indigne de vous, avec tant de gloire, de rentrer au camp à la faveur du silence de la nuit. Demeurons ici tranquilles en attendant le jour. » On obtempère à ce conseil; et, dès que le jour parut, il envoya d'avance au consul un message qui excita au camp une grande joie : une dépêche annonce à l'armée la délivrance et le retour de ceux qui, pour le salut des autres, avaient exposé leur vie à un péril certain Aussitôt chacun à l'envi court à leur rencontre, les loue, les félicite, les appelle séparément et tous ensemble ses sauveurs; on glorifie, on remercie les dieux; on porte au ciel Décius. Décius eut au camp une sorte de triomphe : il s'avance au travers des rangs à la tête de ses soldats en armes, attirant tous les regards, tous les applaudissements de l'armée, qui égalait le tribun au consul. Quand il fut arrivé au prétoire, le consul lit sonner la trompette pour que l'armée s'assemblât, et il commençait un digne éloge de Décius, quand Décius lui-même l'interrompit et l'engagea à dissoudre l'assemblée, en émettant l'avis qu'il fallait laisser là tout autre soin pendant qu'on avait en main l'occasion. Il décida le consul à attaquer les ennemis encore troublés de l'alerte de la nuit, et dispersés par pelotons autour de la colline. « Plusieurs même, ajoutait-il, envoyés à sa poursuite, devaient errer çà et là dans le défilé. » Les légions reçoivent l'ordre de prendre les armes; elles sortent du camp; et comme le terrain, grâce aux éclaireurs, était mieux connu, on les mène par une voie plus ouverte h l'ennemi. Elles l'attaquent à l'improviste ; les soldats samnites, épars de côté et d'autre, et la plupart sans armes, ne peuvent ni se rallier, ni s'armer, ni se réfugier derrière leurs palissades ; effrayés, ils sont 373 refoulés vers leur camp, et le camp lui-même, dont les gardes se troublent, est bientôt pris. Le cri des Romains retentit autour de la colline, et met en fuite tous les détachements qui l'occupent; de sorte qu'un grand nombre céda la place à un ennemi qu'il n'avait pas même vu. Ceux que la peur avait poussés derrière le retranchement ( ils étaient environ trente mille ) furent tous massacrés. Le camp fut livré au pillage. XXXVII. Cela fait, le consul convoqua l'armée; et non seulement il acheva l'éloge commencé de Décius, mais il y ajouta de nouvelles louanges pour ce nouvel exploit; et, outre les présents militaires d'usage, il lui donna une couronne d'or, cent boeufs, et de plus un boeuf d'une blancheur et d'une beauté rares, aux cornes dorées. Aux soldats qui l'avaient accompagné on donna à perpétuité une double ration de blé, et, pour cette fois, un boeuf et deux tuniques à chacun. Après le consul, les légions, voulant aussi récompenser Décius, lui posèrent sur la tète, au milieu des acclamations et des applaudissements, la couronne de gazon, la couronne obsidionale; et une autre couronne, signe d'un semblable honneur, lui fut mise au front par son détachement. Paré de ces insignes, il immola à Mars le boeuf d'une beauté rare, et fit présent des cent boeufs aux soldats qui l'avaient secondé dans cette expédition. Les légions distribuèrent à chacun des mêmes soldats une livre de farine et un sextier de vin : et tous ces divers dons étaient offerts avec une vive allégresse, au milieu des acclamations de l'armée, témoignages de l'assentiment universel. Un troisième combat fut livré près de Suessula, où l'armée des Samnites, battue par M. Valérius, ayant appelé à elle toute la meilleure jeunesse du pas, voulut tenter la fortune dans une dernière affaire. Des courriers de Suessula vinrent tout effrayés à Capoue, d'où l'on expédia promptement des cavaliers au consul Valérius pour implorer du secours. A l'instant on lève les enseignes, on laisse au camp les bagages sous la garde d'un fort détachement, on part, on s'avance à la hâte; et, non loin de l'ennemi, sur un terrain peu étendu, mais qui suffisait à une troupe n'ayant que des chevaux de cavalerie, sans bêtes de charge ni valets, on établit le camp. Les Samnites, pensant qu'on allait livrer combat, se rangent en bataille; mais, comme personne ne va à leur rencontre, ils pottent insolemment leurs enseignes jusqu'au pied du camp ennemi. Dès qu'ils virent le soldat dans les retranchements, et qu'ils surent des éclaireurs qu'ils avaient envoyés de toutes parts combien l'enceinte du camp était étroite, d'où l'on devait conclure combien les ennemis étaient peu nombreux, toute l'armée s'écria qu'il fallait combler les fossés, raser les palissades, et faire irruption dans le camp. Ce coup de main eût terminé la guerre, si les chefs n'eussent contenu l'élan des soldats. Du reste, comme leur multitude, si difficile à nourrir, avait, d'abord dans son séjour à Suessula, puis dans l'attente du combat, épuisé presque toutes leurs ressources, ils avisèrent, tandis que la crainte tenait l'ennemi enfermé, d'envoyer leurs soldats ramasser le blé par la campagne : cependant le Romain qui, pour 344 marcher plus vite, n'avait pris qu'autant de blé qu'il en pouvait porter outre ses armes, finirait par manquer de tout. Le consul, voyant les ennemis dispersés dans la campagne, et leurs postes dégarnis, exhorte en peu de mots ses soldats, et les mène à l'attaque du camp. L'ayant enlevé au premier cri et au premier assaut, et un plus grand nombre d'ennemis ayant été tué dans les tentes qu'aux portes et aux palissades, il commanda qu'on apportât en un monceau les enseignes prises. Laissant ensuite deux légions pour garder et défendre sa conquête, avec l'injonction la plus expresse de s'abstenir du pillage jusqu'à son retour, et, marchant en bon ordre vers les Samnites, dont sa cavalerie, partie devant, avait, comme dans un filet, ramassé toutes les bandes éparses, il en fit un grand carnage : car ils ne savaient plus, dans leur effroi, ni à quel signal ils devaient se réunir, ni s'ils retourneraient au camp ou s'ils fuiraient plus loin. La déroute et l'épouvante furent telles, qu'on rapporta au consul près de quarante mille boucliers, quoique le nombre des tués ne fût pas aussi considérable, et cent soixante-dix enseignes, outre celles qu'on avait prises au camp. On revint ensuite au camp ennemi, et tout le butin en fut livré aux soldats. XXXVIII. Le succès de cette campagne engagea les Falisques, qui n'avaient qu'une trêve, à demander un traité au sénat, et les Latins, qui venaient de lever des troupes contre Rome, à les tourner contre les Péligniens. Le bruit de ces exploits se répandit hors de l'Italie, et les Carthaginois envoyèrent aussi des députés complimenter Rome et lui faire hommage d'une couronne d'or, pour être placée au Capitole dans la chapelle de Jupiter : elle pesait vingt-cinq livres. Les deux consuls triomphèrent des Samnites. Décius les suivait, dans tout l'éclat de sa gloire et de ses récompenses; et, dans les chants grossiers des soldats, le nom du tribun n'était pas moins loué que celui des consuls. On reçut ensuite des députations de Capoue et de Suessula ; et, sur leur prière on leur envoya des troupes en quartier d'hiver, pour repousser les invasions des Samnites. Séjour déjà funeste à la discipline militaire, Capoue, avec tous ses plaisirs, amollit le coeur des soldats et les détourna du souvenir de la patrie : aussi, dans les quartiers d'hiver, forma-t-on le projet d'enlever, par un crime, Capoue aux Campaniens, qui l'avaient enlevée de même à ses antiques possesseurs. « C'est à bon droit, disait-on, que l'on tournera contre eux leur propre exemple. Car, pourquoi ce territoire, le plus fertile de l'Italie, et cette ville, si digne du territoire, appartiendraient-ils aux Campaniens qui ne savent défendre ni leurs personnes ni leurs biens, plutôt qu'à cette armée victorieuse qui a donné sa sueur et son sang pour en chasser les Samnites? Est-il juste que des sujets aient la jouissance d'un pays si fertile et si délicieux, tandis qu'eux, fatigués de la guerre, ils lutteront encore autour de Rome contre un sol aride et empesté, ou dans Rome même, contre un mal obstiné et qui augmente chaque jour, contre l'usure? » Ces projets, agités dans des réunions secrètes et qui n'avaient pas encore transpiré au dehors, furent découverts par le nouveau 345 consul, C. Marcius Rutilus, à qui la province de Campanie était échue au sort, et qui avait laissé Q. Servilius, son collègue, à Rome. Ayant su, par les tribuns, comment tous ces complots s'étaient formés, et instruit par l'âge et l'expérience (car il était consul pour la quatrième lois, et il avait été dictateur et censeur), il pensa que le meilleur parti serait, pour empêcher l'exécution de ce dessein, de laisser aux soldats l'espoir de l'accomplir quand ils voudraient, et d'amortir ainsi leur ardeur. Dans ce but, il répandit le bruit que, l'année suivante, ils passeraient encore l'hiver dans les mêmes garnisons; car ils étaient répartis dans les différentes villes de la Campanie, et de Capoue la conjuration avait gagné l'armée entière. Dès lors plus à l'aise en ses projets, la conspiration se contint pour le moment. XXXIX. Le consul mit ses troupes en campagne, et, n'ayant rien à craindre des Samnites, il résolut de purger son armée par le renvoi des plus turbulents. Il renvoyait les uns comme ayant fini leur temps de service, les autres comme trop âgés ou pas assez robustes, d'autres avec des congés, un à un d'abord, puis par cohortes entières, sous prétexte qu'ils ne devaient pas passer l'hiver loin de leur famille et de leurs affaires. Alléguant aussi les besoins de l'année, il les dirigeait sur divers points : il se débarrassa ainsi d'un grand nombre. Ils arrivaient en foule à Rome, où l'autre consul et le préteur prétextaient différents motifs pour les retenir. Dans le commencement, ignorant qu'on les jouât, ils étaient assez contents de revoir leurs foyers. Mais quand ils s'aperçurent que les premiers partis ne retournaient pas aux enseignes, et qu'on ne renvoyait guère que ceux qui avaient hiverné dans la Campanie, et surtout les chefs de la sédition, ils commencèrent par s'étonner, puis ils craignirent que leurs projets ne fussent découverts : « Maintenant il faudra qu'ils souffrent les enquêtes, les délations, les exécutions secrètes et isolées, enfin la tyrannie insolente et cruelle des consuls et des patriciens. » Tels étaient les bruits répandus dans des réunions secrètes par ceux qui étaient restés au camp, et qui voyaient ce faisceau de leur conjuration dispersé par l'artifice du consul. Une cohorte, qui se trouvait non loin d'Anxur, alla se poster près de Lautules, dans un étroit défilé, entre la mer et les montagnes, afin de recueillir au passage ceux que le consul congédiait, comme on l'a dit plus haut, sous différents prétextes. Déjà la troupe était assez forte par le nombre, et, pour qu'elle eût l'air d'une véritable armée, il ne lui manquait plus qu'un chef. Ils arrivent donc sans ordre et en pillant sur le territoire albain, et s'enferment dans un camp retranché au pied du coteau d'Albe la Longue. Ce travail achevé, ils s'occupent le reste du jour à débattre le choix d'un général : mais ils n'osent se fier à aucun d'entre eux. « Qui pourrait-on appeler de Rome? Qui, patricien ou plébéien, consentirait de lui-même à s'exposer à un si grand péril, ou à prendre en main, sans la trahir, la cause d'une armée qui s'est comportée si follement? » Le lendemain, comme on délibérait encore sur le même sujt, quelques pillards apprirent dans leurs courses, et rapportèrent que T. Quinctius était à cultiver son champ près de Tusculum, et y oubliait la ville et les hon- 346 neurs. Cet homme, de famille patricienne, avait longtemps fait la guerre avec gloire, mais, atteint au pied d'une blessure qui l'avait rendu boiteux et l'avait éloigné du service, il avait pris le parti d'aller vivre aux champs loin de la brigue et du forum. A son nom seul on reconnut l'homme qu'il fallait, et l'on arrêta ne pouvant mieux faire, qu'on l'irait chercher: mais, comme on avait peu d'espoir d'obtenir son consentement, on résolut de l'avoir par la force et par la crainte. En conséquence, dans le silence de la nuit, les soldats chargés de cette mission pénètrent dans la maison où Quinctius dormait d'un profond sommeil; ils le saisissent en lui disant qu'il n y a point de milieu, qu'il acceptera le commandement et l'honneur qu'on lui offre, ou qu'il mourra s'il résiste et refuse de les suivre; et ils l'entraînent au camp. A son arrivée, ils le proclament général, le revêtent des insignes de cette dignité, et, tout effrayé encore d'un événement si peu attendu, lui ordonnent de les conduire à Rome. Ensuite, obéissant à leur seule ardeur, et sans consulter leur chef, ils enlèvent les enseignes, et arrivent en désordre à la huitième borne du chemin qui est aujourd'hui la voie Appienne : ils seraient même allés, sans s'arrêter, jusqu'à la ville, s'ils n'eussent appris qu'on envoyait contre eux une armée, et M. Valérius Corvus, nommé tout exprès dictateur, avec L. Émilius Mamercinus pour maître de cavalerie. XL. Dès qu'on fut en présence, à la vue de ces armes, de ces enseignes connues, le souvenir de la patrie apaisa toutes les colères. Ils n'étaient pas encore de force à verser le sang de leurs concitoyens; ils ne connaissaient que la guerre contre l'étranger, et les dernières fureurs n'allaient pas au delà d'une retraite à main armée. Aussi, de part et d'autre, chefs et soldats cherchaient à se rapprocher pour s'entendre. Quinctius, fatigué de porter les armes, même pour sa patrie, était loin de vouloir s'en servir contre elle. Corvus, qui embrassait dans son amour tous les citoyens, surtout les soldats, et par-dessus tout son armée, s'avança pour parler. Les rebelles le reconnurent, et, aussitôt, non moins touchés de respect que les siens, ils lui prêtèrent silence : « Soldats, dit-il, en partant de la ville, j'ai imploré les dieux immortels, ces dieux de la patrie qui sont les vôtres et les miens; je leur ai demandé avec prières et comme une grâce de m'accorder, non la victoire sur vous, mais la gloire de vous ramener à la concorde. J'ai eu et j'aurai assez souvent l'occasion d'acquérir de l'honneur par la guerre; ici je ne veux conquérir que la paix. Ce voeu que j'adressais humblement aux dieux immortels, il dépend de vous qu'il se réalise; vous n'avez qu'à vous souvenir que ce n'est ni dans le Samnium ni chez les Volsques, mais sur le sol romain que vous êtes campés, que ces collines que vous apercevez sont votre patrie, ces soldats vos concitoyens, que moi enfin je suis votre consul, sous les ordres et les auspices duquel vous avez, l'an passé, deux fois battu les légions samnites, deux fois emporté leur camp d'assaut. Je suis, soldats, M. Valérius Corvus, qui ne vous a fait sentir sa noblesse que par des bienfaits, non par des outrages, qui n'a conseillé contre vous nulle loi despotique, nul sénatus-consulte rigoureux; qui toujours, dans ses divers commandements, a été plus sévère pour lui-même que pour 347 vous. Si pourtant la naissance, si le courage, si la grandeur, si les dignités, ont pu jamais inspirer de l'orgueil à un homme,, j'étais d'un tel sang, j'avais donné de moi de telles preuves, et j'avais obtenu le consulat dans un tel âge, que j'aurais pu, consul à vingt-trois ans, traiter avec fierté, non pas seulement les plébéiens, mais les patriciens eux-mêmes. M'avez-vous vu, consul, agir ou parler plus durement que je n'avais fait tribun? J'ai porté le même esprit dans mes deux autres consulats; je le porterai encore dans cette dictature souveraine, et je n'aurai pas eu pour ces soldats, qui sont les miens et ceux de ma patrie, plus de bienveillance que pour vous-mêmes, vous, j'ai horreur de le dire, nos ennemis. Il faudra donc que vous tiriez l'épée contre moi, avant que je la tire coutre vous. C'est de votre côté que sonnera le signal, de votre côté que partira le cri de guerre et commencera l'attaque, si nous devons combattre. Décidez-vous à faire ce que n'ont point osé vos pères et vos ancêtres, ni ceux qui se retirèrent sur le mont Sacré, ni ceux qui, plus tard, ancrent camper sur l'Aventin. Attendez que, comme autrefois vers Coriolan, les mères et les épouses, les cheveux épars, s'en viennent de la ville au-devant de chacun de vous. Alors, les légions des Volsques, parce qu'elles avaient pour chef un Romain, s'arrêtèrent; et vous, qui êtes tous Romains, vous ne renonceriez pas à cette guerre impie? T. Quinctius, de quelque manière que tu sois ici, de gré ou de force, si le combat s'engage, retire-toi aux derniers rangs : il y aura pour toi plus de gloire à fuir, à tourner le dos devant un citoyen, qu'à combattre contre ta patrie. Si, au contraire, nous traitons de la paix, il sera beau, il sera glorieux à loi de rester aux premiers rangs, afin d'être l'interprète de cette heureuse médiation. Demandez et proposez des choses justes; encore vaudrait-il mieux écouter même des prétentions injustes que de nous entr'égorger dans cette guerre impie.» T. Quinctius, plein de larmes, se tourne vers les siens : « Moi aussi, soldats, dit-il, si je puis vous servir, vous aurez en moi un meilleur chef pour la paix que pour la guerre. Ce n'est pas un VoIsque, un Samnite, mais un Romain que vous venez d'entendre ; c'est votre consul, c'est votre général. Vous avez éprouvé à votre avantage ce que valent ses auspices; prenez garde de vouloir l'éprouver à vos dépens. Pour vous combattre sans pitié, le sénat avait bien d'autres chefs; mais parce que celui-ci devait plus qu'aucun autre ménager en vous ses anciens soldats, et que vous deviez avoir plus de confiance en votre ancien général, le sénat l'a choisi. Ceux mêmes qui peuvent vaincre veulent la paix; pourrions-nous vouloir autre chose? Renonçons à la colère et à l'ambition, ces conseillers trompeurs, et abandonnons-nous, nous et nos intérêts, à une foi si connue. » XLI. Tous l'ayant approuvé à grands cris, T. Quinctius s'avance à la tête des enseignes, et déclare que les soldats sont désormais à la disposition du dictateur : il le conjure de prendre en main la cause de ces malheureux citoyens, et de la défendre avec cette loyauté qu'il avait toujours montrée dans les affaires de la république. « Pour lui, en particulier, il n'a nul souci; il met son espoir dans son innocence. Mais il demande pour les soldats ce que le sénat accorda une fois au 348 peuple et une autre fois aux légions, qu'on ne les inquiète point pour cette défection. » Après avoir comblé d'éloges Quinctius, et commandé aux autres d'avoir bon courage, le dictateur courut à cheval jusqu'à Rome, et, avec l'aveu du sénat, obtint du peuple, au bois Pétiléen, que les soldats ne seraient pas inquiétés pour cette défection. Il demanda aussi en grâce aux Romains que nul, par plaisanterie ou sérieusement, ne leur en fit un reproche. De plus, ou porta une loi sanctionnée par des imprécations pour que le nom d'aucun soldat, une fois inscrit, ne fût rayé que de son consentement; et il fut ajouté à la loi que nul, après avoir été tribun de légion, ne pourrait être chef de centurie. Cet article fut demandé par les conjurés à l'occasion de P. Salonius, qui était alternativement une année tribun de légion, et l'autre année premier centurion, ce qu'on appelle aujourd'hui primipilaire. Les soldats lui en voulaient parce qu'il avait constamment combattu leurs projets de révolte, et fui de Lautules pour n'être pas leur complice. Aussi, par égard pour Salonius, le sénat refusait-il d'accorder cet article ; mais Salonius ayant supplié les Pères conscrits de faire plus d'état de l'union de la cité que de son honneur personnel, il obtint leur sanction. Les troupes demandèrent, avec une égale violence, que l'on réduisît la solde des cavaliers (triple alors de celle de l'infanterie); parce qu'ils avaient été contraires à la conjuration. XLII. Je trouve encore dans quelques historiens que L. Génucius, tribun du peuple, porta une loi contre l'usure; puis que l'on défendit par d'autres plébiscites d'exercer deux fois la même magistrature dans l'espace de dix ans, et de remplir deux magistratures dans la même année ; enfin l'on demanda qu'il pût être créé deux consuls plébéiens. Il parait, d'après toutes ces concessions, si on les fit au peuple, que la révolte avait des forces considérables. Selon d'autres annales, Valérius ne fut pas nommé dictateur, et la conjuration aurait été comprimée par les consuls. Ce ne fut pas non plus avant d'arriver à Rome, mais dans Rome même, que cette multitude de révoltés leva les armes : ce ne fut pas T. Quinctius, dans sa maison de campagne, mais C. Manlius dans sa maison de ville, que les conjurés assaillirent la nuit, et qu'ils saisirent pour s'en faire un chef : de là ils seraient allés à quatre milles de Rome s'établir dans un poste fortifié. De même, ce ne furent point les généraux qui d'abord proposèrent la paix, mais les deux armées qui, soudain venues en présence et prêtes à combattre, se saluèrent; alors les rangs se confondirent, les soldats se prirent les mains et s'embrassèrent en pleurant, et les consuls, voyant que les troupes refusaient de combattre, furent forcés d'aller prier le sénat d'approuver cette réconciliation. Ainsi, le seul fait constant dans les anciens auteurs, c'est qu'une sédition éclata et qu'elle fut apaisée. Le bruit de cette sédition et de la dangereuse guerre entreprise contre les Samnites, détacha quelques peuples de l'alliance de Rome, et, sans parler des Latins, depuis longtemps infidèles aux traités, les Privernates eux-mêmes envahirent subitement dans leur voisinage Norba et Sétia, colonies romaines qu'ils dévastèrent.
Par ces mots du chap. XXI, per omnium annalium
monumenta, il faut probablement entendre toutes les annales que Tite-Live
avait entre les mains. On voit en effet, ch. XVIII et XXII, qu il en a comparé
plusieurs. Il en est de même aux ch. XXVII et XLII. Toutefois, dans ces derniers
passages, il ne mentionne pas toutes les divergences non plus qu'au ch. XVI. Ce
qui le prouve c'est que Deny (Excerpt.. p. 41) rapporte en cet endroit
les libres réponses des députés Privernates. (CI. Tile-Live, VIII CHAP. I. — Novi homines. « On nommait chez les Romains homme nouveau celui dont aucun des ancêtre n'avait été dans les charges curules, appelées ainsi parce parce qu'elles donnaient le droit de se faire porter dans une chaise d'ivoire et de s'y asseoir aux assemblées publiques. Les descendants de ceux qui avaient possédé ces charges étaient censés et appelés nobles, eux, leurs enfants et toute leur postérité, et formaient à Rome ce qu'on appelait la noblesse Ils avaient aussi droit d'images, c'est-à-dire qu'ils exposaient, dans la partie de leur maison la plus apparente, les images, les portraits de ceux de leurs ancêtres qui avaient été dans les charges, et les faisaient porter dans certaines cérémonies publiques, comme aux obsèques de leur proches. Ces charges étaient le consulat, la dictature, et de plus l'édilité curule et la préture. « Ce que je viens de dire aide à entendre ce qu'on lit dans une harangue de Sextius et de Licinius, qu'il ne restait plus au peuple, pour s'égaler aux patriciens, que le consulat, qui le mettait en possession de tout ce qui les distinguait, et le lui rendait commun avec lui, commandement, honneurs, gloire militaire, noblesse. Ceux du peuple devenaient donc nobles par le consulat et par toutes les autres charges curules, mais nobles plébéiens, distingués des patriciens, quoique unis ordinairement avec eux pour les intérêts et la façon dépenser. « (ROLLIN. Hist. rom., liv.VII, § 3. ) CHAP. I. — Praetura. Les fonctions du préteur étaient très importantes; elles consistaient à rendre la justice, et, en l'absence des consuls, à administrer l'état. Il avait la chaise curule, deux licteurs (Piaute. Epdicus, v. 26). et même six, si l'on en croit Polybe (XXXI11, I, 5 ), plusieurs scribes et des appariteurs (accensi). L'épée et la pique étaient posées près de son tribunal quand il jugeait. Cependant quoiqu'il fût chargé de l'administration de la justice, même quand les consuls n'étaient pas absents, ces magistrats conservèrent toujours une haute juridiction ; nous devons à Valère Maxime la connaissance de quelques circonstances où ils réformèrent des sentences du préteur. (Cf. Cic. de Legib., III, 5.) IBID. — Curuli œdilitale. Les édiles curules dont nous avons déjà parlé page 805, col. 2 et suiv., avaient, avec un rang supérieur, les mêmes fonctions à peu prés que les édiles plébéiens. Ils étaient chargés de la police générale de la cité, présidaient spécialement aux grandi jeux, aux approvisionnements de la ville et des armées ainsi qu'aux représentations scéniques, et examinaient les pièces qui devaient être représentées, ce qui faisait d'eux les censeurs de la littérature. Quand les chefs militaires revenaient d'une expédition, ils rendaient compte aux questeurs de l'argent monnayé, au préteur des prisonniers de guerre, et aux édiles curules des grains et des munitions pris à l'ennemi. Il paraît qu'à toutes ces attributions ils réunissaient encore de hautes fonctions judiciaires en matière criminelle ; car nous voyons ( I. VIII, ch. XVIII ) que c'est à l'édile curule Fabius que l'on dénonça les empoisonnements commis par les matrones ; et Pline ( Hist. nat., l. XVIII, ch. VIII) nous apprend qu'une accusation d'enchantement fut portée devant le peuple par Sp. Postumius Albinus, revêtu également de cette magistrature. C'étaient des édiles curules qui étaient chargés de l'instruction des crimes portant atteinte à la chasteté des jeunes gens et des femmes nées libres. Voyez a cet égard Tite-Live, VIII, XXII ; Val.-Maxime, VI, I, n. 7; VIII, I, n. 1; el Plutarque, Vie de Marcellus. L'élection des édiles curules précédait celle des édiles plébéiens, qui se faisait immédiatement après. Plu- 842 tarque nous apprend que Marius ayant échoué dans sa candidature à l'édilité curule, se présenta aussitôt à l'édilité plébéienne, où il échoua encore, et que, sans se laisser abattre par ces deux échecs, éprouvés en un même jour, ce qui n'était encore arrivé à personne avant lui, il alla, quelques jours après, s'offrir aux suffrages du peuple pour la préture. Moins malheureux cette fois, il fut élu, mais son élection ne fut pas exempte du soupçon de brigue. ( Vie de Marius, ch. V. ) CHAP. I. — Verecundia inde imposila est senatui ex patribus jubendi aediles curules ceari. Niebubr, t. III, p. 59; t. V, p. 46 et suiv, de la tr. fr., entre dans beaucoup de détails pour prouver qu'on ne peut voir rien de sérieux dans ce sentiment de délicatesse qui décida les patriciens à partager l'édilité curule avec les plébéiens. Mais tel n'est pas le sens de la phrase de Tite-Live, et Niebuhr ne tient aucun compte de ces mots : non patientibus tacitum tribunis, qui prouvent en effet ce que Niebuhr n'avait pas besoin de deviner, savoir que ce partage de l'édilité curule ne fut qu'une concession forcée de la part des patriciens, qui cédèrent moins à un sentiment d'équité qu'à une réclamation énergique des tribuns. IBID. — Gratia campestri. « Par l'influence des tribus de la campagne. » Nous pensons qu'au lieu d'adopter cette traduction de Dureau de Lamalle, il eût mieux valu s'en tenir à l'explication donnée par Drakenborcb, Crevier et M. Lemaire. Gratia campestris signifie certainement la faveur du Champ-de-Mars, ou des centuries qui s'y réunissaient, comme, dans Valère Maxime, campestris temeritas veut dire les hasards du Champ-de-Mars, les chances des élections. On pourrait citer une foule d'exemples où le mot campestris est employé dans ce sens. D'ailleurs rusticœ tribus est l'expression consacrée pour désigner les tribus de la campagne; campestris tribus n'est pas latin. Quant au mot ceperunt, où Dureau de Lamalle voit l'expression d'une sorte de lutte, il est ici tout à fait synonyme de effecerunt ut ille caperet. Ainsi cette phrase du liv. V, ch. XIII, Licinius ut ceperat haud tumultuose magistratum, exclut toute idée de lutte, et il en est de même de cette autre, du liv. VII, c. XXV, qui legis Liciniœ spretae mercedem consulatum cepisset. Nous traduirions donc ainsi la phrase qui donne lieu à cette note : « Les patriciens, par leur influence dans le Champs-de-Mars, obtinrent la préture pour Sp. Furius Camillus, fils de Marcus, et l'édilité pour Cn. Quinctius Capitolinus, et P. Cornélius Scipion, trois hommes de leur ordre. » Tite Live dit assez clairement que le Spurius Furius Camillus, dont il est ici question, était le fils de Camille le dictateur. Si l'on en doutait cependant, on pourrait recourir à l'autorité de Suidas, qui dit au mot πραίτωρ : πρῶτος στρατηγὸς ἀπεδείχθη Φουριος, παῖς Καμίλλου τοῦ πολλακις μοναρχήσαντος, ὃν πραίτωρα τῇ ἰδίᾳ γνώττῃ οἱ Ῥωμαῖοι ὠνόμασαν. CHAP. I — Ludi quoque scenici. Ce que Tite-Live dit ici des jeux scéniques paraît emprunté aux annales. Déjà Fabius était entré dans quelques détails sur les jeux du cirque (Denvs, Vil, 7l ); et Tite-Live y revient encore après lui, et il donne la raison morale qui l'a engage à le faire. Il n'est pat vrai qu'il soit .sur ce point en dissentiment avec Valéiius Antias (Cf. XXXVI, 56). Car Valerius ne dit pas que les jeux scéniques furent donnés alors pour la première fois, mais que pour la première fois on les ajouta aux jeux de Cybèle. CHAP. II. — Fescennino versu. Les poésies fesceniennes étaient des dialogues en vers grossiers, improvisés le plus souvent à la suite des moissons et des vendanges, et imités, si l'on en croit Horace (Ep. II, I, 139 ), des Étrusques et des Falisques. Elles tiraient leur nom, soit de Fescennia, ville de Campanie (Servius ad Virg., Aen., VII, 695), aujourd'hui Cilta Castellana, soit de Fascinus, dieu des sortilèges, qu'elles avaient, disait-on la vertu de conjurer. ( Festus, au mot fescennini ) Les vers fescennins, suivant Servius, n'avaient d'autre mesure que celle du chant, c'est-à-dire qu'ils étaient rythmiques et non métriques; il ne nous reste d'ailleurs aucun monument qui puisse nous faire connaître quelle était leur forme. On ignore même en quoi ils différaient des vers saturnins qui, avec eux, formaient à cette époque reculée tout le domaine de la poésie italienne. Seulement on sait que les vers fescennins étaient usités dans les fêtes joyeuses, dans les noces, dans les triomphes, et semblaient renfermer une idée de raillerie et de licence, tandis que les vers saturnins paraissent avoir été plu particulièrement destinés aux sujets graves et religieux. La licence qui régnait dans ces poésies était extrême. Aussi fut-on obligé de la réprimer par les peines les plus sévères : une loi des douze tables, appliquée depuis a la scène, et renouvelée par Auguste (Cicér. de Republ., l. IV, ap. Augustin, de Civit. Dei. II, 9 ) condamnait à la peine du fouet ou du bâton les auteurs de vers diffamatoires. Voy. Schœll, Hist. de la lit. Rom., l. 1, p. 73, et M. Magnin, Origines du théâtre moderne, t. I, p. 295. Nous voudrions aussi pouvoir renvoyer nos lecteurs aux travaux de M. Patin, qui, dans ses cours de I832 et 1835, a traité avec autant d érudition que d'ingénieuse critique toutes les questions qui se rattachent aux origines de la poésie latine. IBID. — Saltantes. Voyez l'abbé Dubos : Réflexions critiques sur la poésie et la peinture, IIIe partie, sert. 13. IBID. — Saturas. Ces pièces, ainsi que nous l'apprend Tite-Live, différaient par un peu plus d'art des improvisations fescennines; elles en différaient aussi par une, plus grande étendue. On les appelait satura à cause du mélange de musique, de paroles et de danses qu'elles offraient. C'est ainsi qu'au moyen âge on donna le nom de farces, farcitures. pièces farcies, à certaines compositions ecclésiastiques qui offraient un mélange de plusieurs langues. Satura (satura lanx), signifiait, en langue osque, un plat rempli de toutes sortes de fruits, que l'on offrait chaque année a Cérès et à Bacchus comme les prémices de la récolte, et par suite un mets fait de plusieurs choses, un pot-pourri. Satura lex, dans le droit romain, est une loi qui renferme plusieurs titres. Ces pièces composèrent seules, pendant plus d'un siècle, les jeux scéniques à Rome. Elles sont le véritable drame romain, le drame indigène de l'Italie. Il n'y eut qu'une ressemblance de noms purement fortuite entre elles et le drame satirique des Grecs. La Grèce n'offre même rien qui soit analogue à la satura romaine. ( V. Frid. Stieve, de rei scenicae roman, orig, p. 45. ) Lorsque dans la suite ces drames populaires firent place, sur les théâtres de Rorne, d'une part aux tragédies traduites ou imitées des Grecs, de l'autre à une nouvelle forme du drame indigène, les atellanes, la satura ne périt cependant pas tout à fait. Le nom resta dans la langue, non plus, il est vrai, pour désigner un ouvrage dramatique, mais un poème didactique, mordant et railleur. Telles furent les satires d'Ennius de 843 Lucilius, d'Horace, de Perse et de Juvénal; dam lesquelles on peut du reste remarquer une tendance à retenir à l'ancienne forme dialoguée, qui avait fait, dans l'origine, le caractère essentiel de ce genre de poésie. Quant à la satire varronienne, composition mélangée de prose et de vers, et qui fut imitée par Pétrone, Sénèque, Julien et Marcianus Capella, son nom est romain, et lui vient de sa nature même; mais sa forme a été imitée de Ménippe, et c'est de là que lui est venu le nom de Ménippée, par lequel on la désigne encore. Cicéron (Académiques, l. l, ch. II) met dans la bouche de Varron, lui-même, un aveu de cette imitation. Aucune question peut-être n'a donné lieu à une polémique plus vraie et plus durable que celle de l'origine de la signification du mot satura. Sans entrer dans la discussion, nous nous sommes bornés à présenter l'opinion la plus probable et la plus généralement admise aujourd'hui. On peut la voir appuyée de toutes ses preuves, dans l'ouvrage déjà cité de M. Magnin, pages 50 et suivantes. Ceux de nos lecteurs qui seront curieux de connaître les conjectures émises par les différents critiques qui se sont occupés de cette question, pourront consulter Dacier, Discours sur la Satire, dans les Mémoires de l'Acad. des Inscript, et Belles Lettres, t. II.— Dussaulx, Discours sur les Satiriques Latins, en tête de sa trad. de Juvénal ; — De Guérie, Questions sur Pétrone, deuxième partie, § 2; — M. Théry, de la Satire, en tète de sa trad. de Perse; — et Schœll, Histoire abrégée de la Litt. Rom, t. l, p. 144 et suiv. CHAP II. — Desrripto jam ad tibicinem cantu. On pourrait croire que ces flûtes qui accompagnaient l'acteur ne servaient qu'à le remettre de temps en temps sur le ton, et qu'elles ne jouaient que pour lui rendre à peu près le même service que Gracchus tirait d'un joueur de flûte tandis qu'il haranguait; mais on se désabusera bientôt, pour peu qu'on fasse réflexion à ce que nous disent les anciens de ces accompagnements. Voici un passage de Lucien qui suffît, ce me semble, pour détromper ceux qui seraient la-dessus dans l'erreur. C'est Hermonidès qui parle à son maître Timothée : « Je voudrais, dit-il, le même succès que vous eûtes, lorsqu'à votre arrivée de Béotie vous accompagnâtes de la flûte le comédien qui jouait les fureurs d'Ajax; vous jouâtes mieux de la flûte qu'il ne chanta, et vous l'emportâtes sur lui : après cela il n'y avait personne à qui Timothée, le Thébain, fût inconnu. » L'abbé Vatry, Dissertation sur la récitation des tragédies anciennes, insérée dans les Mémn. de l'Acad. des Inscriptions et Belles-Lettres, t. VIII. IBID. — Livius pos aliquot annos. Andronicus, l'auteur de la première tragédie latine, était né dans la grande Grèce, à Tarente. Lorsque celte ville tomba au pouvoir des Romains, il fut fait prisonnier et devint l'esclave du consul M. Livius Salinator, dont il fut chargé d'instruire les enfants. Ayant été affranchi, il prit le nom de son patron, et s'appela Livius Andronicus. Il florissait immédiatement après la première guerre punique. Sa mort arriva en 554, lorsque Caton n'avait encore que quinze ans. C'est, dit Quintilien ( lnst. Orat., X, 2), le plus ancien des poètes latins, nil in poetis supra Livium Andronicum : et la littérature romaine commença avec lui. Il donna sa première pièce en 514, sous le consulat de C. Claudius Cento et de M. Sempronius Tuditanus, un an avant la naissance d'Ennius, plus de cent soixante ans, avant Aulu-Gelle (XVI!, 21), âpres la mort de Sophocle, et environ cinquante-deux ans après celle de Ménandre. Livius composa, ou plutôt traduisit du grec dix-neuf pièces de théâtre, dont nous avons les titres. D'après ce passage de Tite-Live, on a conjecturé que ces pièces n'étaient pas toutes des tragédies, et que dans le nombre il y avait aussi quelques comédies. Cicéron (Brutus, ch. XVIII), lui attribue une Odyssée latine, et Festus ainsi que Priscien citent quelques vers d'un poème, eu trente-cinq livres au moins, dans lequel il célébrait les exploits des Romains. Les fragments qu'on a pu recueillir de Livius Andironicus s'élèvent à peine à cent cinq vers ou parties de vers. Ils ne peuvent offrir quelque intérêt que sous le rapport philologique. Sa diction était rude, et telle qu'on pouvait l'attendre du premier écrivain qui ait entrepris de composer un ouvrage de longue haleine, dans une langue encore barbare. Au reste, sous le rapport de la composition même, ses ouvrages n'avaient pas grand mérite, si l'on en croit Cicéron, qui dit que ses pièces de théâtre ne valaient pas la peine d'être lues deux fois, et qui compare son Odyssée à ces statues attribuées à Dédale, dont l'ancienneté faisait tout le mérite. CHAP. II. — Venia petita puerum ad canendum... Ce passage a été l'occasion de grandes et nombreuses discussions, qui ne l'ont nullement éclaire!. Schœll (Hist. de la litt. rom., t. I, p. 108 et suiv. ) nous semble avoir assez nettement résumé les opinions les plus probables. « On se demande, dit il. en quoi consiste la faveur accordée a Andronicus. Le grammairien Diomède distingue entre canticum et diverbia: le premier mot signifiait, selon lui, les monologues, parce que ces morceaux étaient chantés au son d'une flûte, tandis que les diverbia étaient les scènes en dialogue, où paraissaient deux ou plusieurs interlocuteurs. Si le passage de Tite-Live doit être interprété d'après cette remarque, Andronicus ne faisait plus, dans les monologues, qu'accompagner de gestes les paroles d'un chanteur placé devant le musicien, c'est-à-dire devant l'hyposcenium, ou ce que nous appelons orchestre, tandis qu'il continuait de parler aussitôt qu'il y avait plusieurs personnages en scène. Il peut paraître surprenant qu'on ait ainsi fait grâce à un acteur favori des morceaux où sans doute son talent pouvait principalement briller, pour ne plus le faire parler que dans les passages où il jouait un rôle secondaire. Mais ce qui doit augmenter notre étonnement c'est l'observation qu'ajouté l'historien, que l'usage introduit pour soulager Andronicus se maintint dès lors sur le théâtre romain. Comment les contemporains de Cicéron et d'Auguste se soumettaient-ils à ce partage de la récitation et du geste, qui n'est pas sans exemple sur la scène moderne, mais qui se prête plutôt à quelques bouffonneries qu'à un jeu noble, senti et brillant? Comment surtout, ni Cicéron, ni Horace, ni Quintilien ne parlent-il jamais d'un usage si bizarre et si contraire au bon goût? Cependant tous les éditeurs de Tite-Live entendent ainsi le passage de cet écrivain, et ne trouvent aucun inconvénient à ce qui nous paraît si choquant. Le célèbre Dubos a bâti, sur cette supposition, son fameux système sur la déclamation notée des anciens, d'après lequel les intonations da l'acteur auraient été prescrites par le compositeur de la musique; système que nous croyons entièrement abandonné aujourd'hui. « Duclos, au contraire, a pensé que si Andronicus fut déchargé de l'obligation de chanter, c'est que ces mor- 844 ceaux étaient accompagnés de danse, et, formant des espèces d'intermèdes, sa voix se trouvait étouffée par les mouvements qu'il était obligé de se donner, et que, du moment qu'il ne chanta plus, il put danser avec plus de liberté et de force. C'est ce que dit Tite-Live : Canticum egisse aliquanto magis vigente molt, quia nihil vocis usus impediebat... Cependant Valère-Maxime semble contredire cette opinion, en disant expressément que dès ce moment cet acteur se contenta de faire les gestes : gesticulatonem tacitus peregit ( l. II, c. IV, n. 4 ) ; mais ce passage ne prouve rien; car il est évident, par l'identité des expressions, que l'auteur avait sous les yeux le même annaliste où Tite-LIve a puisé son récit : il raconte l'événement de la manière dont il l'a entendu; mais comme il n'y voyait pas ce que, selon nous, Tite-Live y avait vu, l'origine de la séparation du chant et de la danse, mais un exemple de la séparation du chant et des gestes, il n'ajoute pas que l'usage introduit pour Andronicus se soit maintenu sur le théâtre romain; il ne le pouvait pas en effet, si, comme nous le croyons, la séparation du chant ou de la déclamation et des gestes n'avait pas lieu sur ce théâtre. « Un passage de Lucien vient a l'appui de cette explication. Autrefois, dit cet écrivain (de Salt., ch. 30), le même arteur chantait et dansait ; mais comme on observa que les mouvements de la danse nuisaient à la voix et empêchaient la respiration, on jugea convenable de partager le chant et la danse. Πάλαι μὲν γὰρ αὐτοὶ καὶ ᾖδον ηαὶ ὠρχοῦντο εἶτ' ἐπειδὴ κινουμένων τὸ ἆσθμα τὴν ᾠδην ἐπευάραττεν, ἄμεινον ἔδοξεν ἄλλους αὐτοῖς ὑπᾴδειν. Ce passage est d'autant plus concluant qu'il provient d'un auteur judicieux, qui, quoique postérieur à Valère-Maxime, mérite beaucoup plus de croyance en matière de goût et de critique. « Il nous paraît que toute difliculté disparaît, et que le passage de Tite-Live s'explique naturellement de la manière que Duclos l'a entendu, pourvu qu'on ne veuille pas donner une trop grande importance à la remarque de Diomède, qui oppose les diverbia aux monologues. On peut, ce me semble, prendre les diverbia pour les paroles en général, qu'elles fussent chantées ou simplement déclamées, en opposition à la partie de la pièce, qui, formant l'intermède, était nécessairement chantée, mais en même temps accompagnée de danse. Une remarque de Donat, sur l'Andrienne de Térence (citée par Doujat, VII, 2) vient à l'appui de l'interprétation que nous donnons au mot diverbia : le scoliaste dit que les comédiens seuls prononçaient let diverbîa. Il les oppose donc à une partie de la pièce étrangère aux comédiens, savoir, aux intermèdes. « Nous avons cru devoir citer en entier ce long extrait de l'histoire de la littérature romaine, parce qu'il nous a semblé résumer, d'une manière complète, la discussion soulevée par le texte de Tite-Live. Nous ajouterons seulement ici que, depuis Schœll, les recherches de la critique n'ont fait que confirmer ses conjectures. Tout le monde admet maintenant que le drame romain se composai! de trois parties, savoir : 1° les cantica, ou airs a une voix, désignés par Schœll, sons le nom d'intermèdes ; 2° les diverbia, ou le dialogue prononcé par les histrions; 3° les choeurs ou chants exécutes par des voix nombreuses, grex ou caterva. Du reste, ces morceaux lyriques ou cantica étaient peu nombreux, et l'on est parvenu à les reconnaître dans ce qui nous reste du théâtre latin; M. God. Aug. Ben. Wolff (de Canticis in Romanor. fabul. scen. Halae, 1825 ) en compte dans Piaute quarante-deux certains, et quatre-vingt-quinze douteux. Dam Térence, il en signale quinze certains et trois douteux. Donat lui-même avait désigné positivement un passage de l'Hécyre (acte V, sc. 2, v. 18 suiv. ) comme étant une monodie ou un canticum. Enfin Cicéron (ad. famil., l. IX. ep. 22 ) nous a conservé quelques mots d'un canticum, joué par Roscius, dans une pièce intitulée le Démiurge, et attribuée à Turpillius par le grammairien Nonius Marcellus. Voyez M. Magnin (Origines du théâtre moderne, t . I . p. 328 et suiv.). et pour des exemples de cet usage de la séparation de la danse et du chant chez d'autres peuples que les Romains, p. 19, 20, 55, 56 et 57 du même ouvrage. « Est-il vrai, dit Voltaire, que chez les Romains un acteur récitait et qu'un autre faisait les gestes ? « Ce n'est point par méprise que l'abbé Dubos imagina cette plaisante façon de déclamer ; Tite-Live, qui ne néglige jamais de nous instruire des mœurs et des usages des Romains, et qui, en cela est plus utile que l'ingénieux et satirique Tacite, Tite-Live, dis-je, nous apprend que Andronicus, s'étant enroué en chantant dans les intermèdes, obtint qu'un autre chantât pour lui tandis qu'il exécuterait la danse, et que de là vint la coutume de partager les intermèdes entre les danseurs et les chanteurs. Dicitur cantum egisse magis vigente motu quum nihil vocis usus impediebat. Il exprima le chant par la danse. Cantum egisse magis vigente motu, avec des mouvements plus vigoureux. « Mais on ne partagea point le récit de la pièce entre un acteur qui n'eût lait que gesticuler et un autre qui n'eût fait que déclamer. La chose aurait été aussi ridicule qu'impraticable. » (Dictionnaire philosophique, au mol CHANT.) CHAP. II — Juventus... more antiquo ridicula jactitare coepit. « La jeunesse romaine laissa le théâtre libre, et ne rapporta pas ses satires pendant que les poètes jouèrent eux-mêmes leurs pièces, car le magistral n'eût pas permis qu'on eût troublé les poètes dans leur art, et interrompu leur action. On avait cette considération pour eux. Mais après qu'ils eurent donné leurs pièces aux histrions, comme on n'avait pas les mêmes égards pour eux, la jeunesse rapporta les satires et s'empara du théâtre dans les intermèdes. On ne s'étonnera point de cette licence quand on se souviendra de ce qui arriva aux comédiens mêmes qui jouaient l'Hécyre de Térence. Aux deux premières représentations ils furent obligés de quitter le théâtre pour faire place à des danseurs de cordes, et ensuite à des gladiateurs; car au milieu de la plus belle pièce, le peuple, toujours ignorant et grossier, demandait souvent des athlètes ou un ours, et il fallait lu lui donner, autrement il devenait un ours lui-même. Cela durait souvent des quatre heures et davantage avant que les comédiens pussent recommencer.» ( DACIER, discours sur la satire.) IBID. — Quae inde exodia postea appellala, consertaque fabellis potissimum atellanis sunt. Suivant Dacier, les exodes et les atellanes auraient constitué deux genres différents de poésies dramatiques; c'est une erreur. Le mot exode ( du grec ἐξοδιον, issue, sortie), ne signifie pis autre chose que la pièce bouffonne destinée à terminer le spectacle; il n'en désigne pas l'espèce, et ne la détermine que par le rang qu'elle occupait dans la représentation. Tite-Live nous apprend ici qu'à cette époque on choisissait de préférence des atellanes, pour ces dernières pièces. Mais dans la suite, ou leur substitua des mimes. (Cic. ad 845 famil. liv. iX, ep. 16) que l'on désigna également par le nom d'exodes. (Schol. ad Juven., Sat. III, v. 175, et M. Magnin, ouv. cité, p. 520.) Les atellanes, ainsi nommées d'Atella, ville des Osques, aujourd'hui Averse ou Saato Arpino. furent, selon toutes probabilités, introduites à Rome, vers l'an 540, environ trente ans après la première représentation, sur le théâtre romain, de pièces empruntées ou imitées des Grecs, à l'époque où la condamnation de Naevius, qui ne fût pas sans doute la seule application de la dure pénalité des douze tables, dut faire renoncer aux farces fescennines et aux saturae, dont les personnalités trop directes faisaient ombrage aux nobles et au sénat. Quant à la langue dans laquelle furent composées les atellanes, il faut pour la déterminer, distinguer deux époques : la première commençant en 540, et finissant à Pomponius Bononiensis, qui vivait du temps de Sylla ; la seconde commençant à Sylla, et s'étendant jusqu'à Jules César. Pendant la première époque, il est à peu près certain que les atellanes furent entièrement composées en langue osque. Celles de la seconde, au contraire, offraient un mélange de cette langue et de latin. C'est ce qui résulte évidemment du témoignage de Strabon (l. V, p. 225. éd. Casaub, et de Cicéron (ad famil., l. VII, ep. 1), enfin, des fragments assez nombreux que les grammairiens nom ont conservés des pièces de cette période. Les atellanes eurent d'abord pour objet la peinture des moeurs des villageois campaniens; plus tard, on y joignit celles des habitants des municipes, et même, si l'on peut tirer cette conséquence de quelques-uns des titres qui sont parvenus jusqu'à nous, les travers de la bourgeoisie romaine y furent plus d'une fois tournés en ridicule. Quelques critiques, entre autres Schœll (Hist. de la litt. rom., t. I, p. 75), M. Arm. Cassan Lettres inéd. de Marc-Aurèle et de Fronton, l. 1, p. 412, notes ) et, d'après lui, M Corpet, dans les notes du Tite-Live de M. Liez, présentent les atellanes comme de petites comédies décentes, où la pudeur des spectateurs était ménagée, et que l'on pouvait comparer aux Proverbes dramatiques de M. Théodore Leclercq. Ce n'est cependant pas là l'idée qu'il est possible de se faire de pièces ayant pour titres Leno, Prostitutum, Porcaria, etc ... titres auxquels répondent d'ailleurs parfaitement, par leur cynisme et leur grossièreté, les fragments que nous a conservés la grammairien Nonius Marcellus. L'obscénité était tellement un des caractères du genre osque, que l'on cherchait, dans le nom de ce peuple, l'étymologie du mot obscène ( Festus, au mot Obscum et Oscos). Il est vrai que Donat se sert, en parlant des atellanes, de l'expression venusta elegantia; mais c'est qu'il les compare aux mimes, dont l'obscénité fut portée, sous les empereurs, à un point presque incroyable. Les atellanes avaient quelque analogie avec les drames satiriques des Grecs. Ces deux espèces de pièces se représentaient, en effet, à la fin des jeux, après les pièces sérieuses, pour essuyer, suivant l'expression du scoliaste de Juvénal (sur la sat. III, v. 176), les larmes qu'avait fait répandre la vue des douleurs tragiques ; et leurs auteurs employaient également des types grotesques et toujours les mêmes, qu'ils mettaient dans toutes sortes de situations. Ces types étaient, pour les atellanes, Maccus au long nez en forme de bec ; Manducus, dont la bouche immense, dit Juvénal, effrayait les enfants ; Bucco, Pappus, Casnar, etc..., personnages dont les analogues se retrouvent encore et dans la comédie italienne, et dans notre théâtre de la Foire. Les principaux auteurs d'atellanes furent Nœvius, Num mius, Pomponius Bononiensis, et Q. Novius. Suivant Nicolas de Damas (cité par Athénée, liv. VI, p. 261), Sylla lui-même aurait aussi composé quelques pièces de ce genre. Nous avons dit qu'au temps de Jules César les mimes remplacèrent les atellanes. C'est à la politique du dictateur que l'on attribue généralement cette révolution; mais, aux motifs qui le firent agir, suivant M. Magnin (ouvrage cité, p. 512), on doit, ce semble, en ajouter un autre, dont la raison se trouve dans le passage même de Tite-Live, qui a donné lieu à cette note. C'est que les auteurs des atellanes étaient citoyens, qu'ils jouissaient de toutes les garanties attachées a ce titre, et qu'il était, par conséquent, plus difficile de réprimer chez eux de simples mais piquantes allusions. Le privilège qu'ils avaient d'ailleurs, suivant Festus (voc. Personata), de ne pouvoir être forcés, comme les autres auteurs, à se démasquer sur la scène, semblait leur assurer en quelque sorte la liberté de tout dire avec impunité. Nous ferons remarquer en terminant que l'épithète fabellœ, appliquée par Tite-Live aux atellanes, est une preuve que ces poèmes avaient en général assez peu d'étendue. Fronton (Epist. ad Marc. Anton., VI, 13) exprime la même idée, en désignant les pièces de Novius, par la jolie expression atellaniolae. CHAP. III. — Clavo dictatore fixo. Pour ce qui se rapporte au clou enfoncé par le dictateur, Tite-Live a consulté plusieurs annales, comme le prouvent les mots ferunt, dicitur. Il emprunte aussi quelques faits à Cincius, qu'il paraît avoir surtout suivi, ici comme dans le chapitre précédent, où il s'étend sur les antiquités plus longuement qu'à l'ordinaire. CHAP. V. — Tribunus militum ad legiones suffragio fieri. Les tribuns des légions, ainsi élus par le peuple, étaient distingués par le nom de comitiati, de ceux qui étaient nommés directement par les consuls. Ceux-ci, suivant Festus, s'appelaient Rufuli, du nom de Rutilius Rufus, auteur du décret qui réglait leurs attributions. De là venaient aussi deux autres dénominations, Rutili et Rutuli, par lesquels on les désigna plus tard. Dans le principe, il n'y avait que trois tribuns par légion ; on en créa quatre quand ces corps devinrent plus nombreux ; il y en avait six au temps dont nous nous occupons, et ce nombre ne fut pas dépassé dans la suite. Or on levait ordinairement quatre légions par année; c'était donc vingt-quatre tribuns qu'il fallait. On voit que le peuple n'avait que le quart des nominations: une loi des tribuns Atilius et Marcius, lui en donna les deux tiers, en 413 (IX, 50); et lorsque le nombre des légions fut porté à huit, un décret du sénat en fit un partage égal entre le peuple et les consuls (XLIV, 50). CHAP. VI. — Tunc M. Curtium juvenem bello egregium... ferunt. Tite-Live rapporte fidèlement d'après les annales (ferunt. dicitur) le récit populaire sur Cur tius que d'autres racontent tout différemment. Denis d'Halyc. (Excerpt., p. 40) donne le même récit, et quelquefois dans les mêmes termes. IBID. — Lacumque Curtium, non ab antiquo illo Titi Tatii milite Curtio Metto, sed ab hoc appellatum, Varron (L. L., liv. VI, ch. XXXII) rapporte une troisième opinion qui avait cours dans son temps sur l'origine du nom du lac Curtius ; « Il lui serait venu, dit-Il, de ce que cet endroit du Forum, ayant été frappé de la foudre, avait été, d'après un sénatus-consulte, 846 entouré d'un mur par le consul Curtius, qui en aurait fait ainsi un Puteal, un Bidental, suivant la double expression d'Horace. Voyez au surplus Plutarque. Romul. 18, p. 116., éd. Reiske: Denys. Ant. Rom., l. II, 42; Pline, Hist. nat.. XV, 18; Zonar.. VII, 25; Oros., III, 5: Augustin., de Civit. Dei, V, 18; Ovid. Fast, VI, v. 403 ; Suid. voc. Λίβερνος ; Festus, au mot Curtius lacus ; Stace, Silv. l, I, 66 ; Val.-Maxime, V, 6, n. 2. CHAP. IX. — Ferentinum. Le nom de cette ville rappelle un fragment du discours de G. Gracchus, de legibus promulgatis, qu'Aulu-Gelle nous a conservé (N. A. I, 3), et qu'il cite comme un exemple de style concis, élégant et simple tout à la fois. IBID. — Per Feciales rebus repititis. Les Féciaux, dit Festus, se nommaient ainsi du verbe facere, faire, parce qu'ils avaient le droit de faire la paix et la guerre. Cincius Alimentus, cité par Tite Live (ch. III de ce livre), et à qui nous avons emprunté (l. VI, note sur le ch. II ) une formule de serment militaire, rapportait dans le même ouvrage, de Re militari ( I. III) une formule de déclaration de guerre par un fécial. C'est encore à Aulu-Gelle ( N. A., XVI, 4 ), que vous devons la connaissance de ce curieux fragment. Le fécial disait, en jetant un javelot sur le territoire ennemi : « QVOD. POPVLVS. HERMVNDVLVS. HOMINES. QVE. POPVLI. HERMVNDVLI. ADVERSVS. POPVLVM. ROMANVM. BELLVM. FECERE. DELIQVERVNT. QVE. QVOD. QUE. POPVLVS. ROMANVS. POPVLO. HERMVNDVLO. MOMINIBUS. QVE. HERMVNDVLIS. BELLVM. JVSSIT. OB. EAM. REM. EGO. POPVLVS. QVE. ROMANVS. POPVLO. HERMVNDVLO. HOMINIBVS. QVE. HERMVNDVLIS. BELLVM. INDICO. FACIO. QVE. » « Parce que le peuple hermundule et les hommes du peuple hermundule ont, au peuple romain, fait guerre et injure, et que le peuple romain, contre le peuple hermudule et les hommes hermundules, a ordonné la guerre; pour cette cause, moi et le peuple romain, au peuple hermundule et aux hommes hermundules, je déclare et fais la guerre. » IBID. — Macer Licinus... sribit... cujus mentionem ejus rei in vetustioribus annalibus nullam inveniam, magis. ut belli gallici causa dictatorem creatum arbitrer, inclinat animus. Tite- Live rejette la narration de Macer, qui prétendait que le dictateur avait été créé pour la tenue des comices. Il n'a donc pas pu le suivre dans les chapitres suivants; et il n'a pas suivi non plus Q. Claudius Quadrigarius, comme le pensent des commentateurs d'après un fragment qui se trouve dans Aulu-Gelle (N. A.. IX, 13, Voyez la note suivante). C'était dans un autre endroit que Claudius avait raconté le fait (Cf. Tite-Live, VI, ch. LXII); et le récit de Tite-Live, beaucoup plus simple, est sans aucun doute puisé à des sources plus anciennes. De plus il n'est pas fait mention d'un interprète comme au chap. VII ; l'adversaire de Manlius n'est pas un chef gaulois, comme on l'a dit, pour rehausser encore la gloire du guerrier romain (Cf. Valère-Maxime, III, 2; Suidas, v. Τορκούατος, etc. ) ; Manlius n'est pas non plus un tribun militaire, comme dans Zonaras et d'autres encore; enfin le tout n'est pas couronné par une victoire du consul Quinctius, comme le racontent des historiens postérieurs à Tite-Live (Appien, Gall., I; Orose, III, 6). IBID. — Gallus processit. Tite-Live, liv. VI, cb. XLII, à l'occasion de ce fait d'armes, a cite les Annales de Q. Claudius Quadrigarius. Le récit de cet historien lui-même, comme nous l'avons dit dans la note précédente, nous a été conservé par Aulu-Gelle (N. A. liv. IX, ch. XIII). « Quum interim Gallus quidam nudus praeter scutum et gladios duos torque atque armillis decoratus processit, qui et uiribus et magnitudine et adulescentia simulque virtute ceteris antistabat. Is maxime proelio commoto atque utrisque summo studio pugnantibus manu significare coepit utrisque, quiescerent. Pugnae facta pausa est. Extemplo silentio facto cum voce maxima conclamat, si quis secum depugnare vellet, uti prodiret.. Nemo audebat propter magnitudinem atque inmanitatem facies. Deinde Gallus inridere coepit atque linguam exsertare. Id subito perdolitum est cuidam Tito Manlio, summo genere gnato, tantum flagitium civitati adcidere, e tanto exercitu neminem prodire. Is, ut dico, processit neque passus est virtutem Romanam ab Gallo turpiter spoliari. Scuto pedestri et gladio Hispanico cinctus contra Gallum constitit. Metu magno ea congressio in ipso ponti utroque exercitu inspectante facta est. Ita, ut ante dixi, constiterunt: Gallus sua disciplina scuto proiecto cantabundus; Manlius animo magis quam arte confisus scuto scutum percussit atque statum Galli conturbavit. Dum se Gallus iterum eodem pacto constituere studet, Manlius iterum scuto scutum percutit atque de loco hominem iterum deiecit; eo pacto ei sub Gallicum gladium successit atque Hispanico pectus hausit; deinde continuo humerum dextrum eodem concessu incidit neque recessit usquam, donec subvertit, ne Gallus impetum icti haberet. . Vbi eum evertit, caput praecidit, torquem detraxit eamque sanguinulentam sibi in collum inponit. Quo ex facto ipse posterique eius Torquati sunt cognominati. » « Cependant un Gaulois s'avance, nu et sans autres armes qu'un bouclier et deux épées, paré seulement d'un collier et de bracelets, par sa force, sa taille, sa jeunesse et sa bravoure, il surpassait tous les autres. Au milieu de la mêlée, au moment de la plus grande chaleur de l'action il se met à faire signe pour que de part et d'autre on suspende le combat. On s'arrête, on fait silence, et aussitôt il crie, d une voix forte, que si quelqu'un veut combattre avec lui, il paraisse. Personne n'osait, vu sa taille et son air féroce. Alors le Gaulois de rire et de tirer la langue. Cependant un Romain d'une grande naissance, nommé T. Manlius, fut tout a coup saisi de honte en voyant un tel affront fait à sa patrie, et que, sur une armée si nombreuse, personne ne sortait des rangs. Il s'avança donc, et ne souffrit pas que la valeur romaine devint honteusement la proie d'un Gaulois. Armé d'un bouclier de fantassin et d'une épée espagnole, il se plaça en face de l'ennemi. La rencontre eut lieu sur la pont même, à la vue et à la grande terreur des deux armées. Le Gaulois, à sa manière, frappe son bouclier en chantant; Manlius, plus confiant en son courage qu'en son adresse, frappe avec le sien celui de son ennemi, qu'il ébranle par ce choc. Tandis que le Gaulois cherche à se remettre, Manlius frappe de nouveau son bouclier du sien, et le force à reculer encore. Alors il se glisse sous son épée gauloise, lui ôte ainsi le moyen de s'en servir, et lui plonge dans la poitrine sa lame espagnole. Puis, d'un revers, il le blesse à l'épaule droite, et ne se retire qu'après l'avoir terrassé. Dès qu'il l'a renversé, il lui coupe la tête, détache le collier, et se le met au cou, tout sanglant. De cette action, lui et ses descendants eurent le surnom de Torquati. » L'épée espagnole était, suivant Polybe, liv. VI. ch. XXIII. une lame courte, solide, à double tranchant, et également propre à frapper et à percer. Celle des Gaulois, au contraire, était longue, sans pointe, et ne pouvait servir 847 qu'a frapper de taille (Tite-Live, liv. XXII, ch. XLVI). C'est ce qui explique comment Manlius, en s'approchant très près de son ennemi, se mit à l'abri de ses coups.Du reste, Suidas (au mot Μάχαιρα) prétend que les Romains ne connurent l'épée espagnole qu'au temps de la seconde guerre punique. Mais Polybe dit le contraire ( liv. II, ch. XXX et XXXIII. Le bouclier des fantassins était de forme ovale et concave, long de quatre pieds et large seulement de deux et demi. Il différait en cela du bouclier des cavaliers qui était rond ( Voy. Lips. mil. rom., III). CHAP. XII . — M. Popillio Lœnate. C'est pendant ce consulat qu'il reçut le surnom de Laenas. Cicéron, de claris orat., c. 14, nous apprend à quelle occasion : « Licet aliquid etiam de M. Popilli ingenio suspicari, qui cum consul esset eodemque tempore sacrificium publicum cum laena faceret, quod erat flamen Carmentalis, plebei contra patres concitatione et seditione nuntiata, ut erat laena amictus ita uenit in contionem seditionemque cum auctoritate tum oratione sedavit. » « Il est permis aussi de croire à M. Popilius quelque génie. Étant consul, et revêtu du manteau des augures, il accomplissait un sacrifice, en sa qualité de Flamine de Carmenta, quand tout à coup on vint lui annoncer que le peuple s'ameutait, et qu'une sédition allait éclater contre les patriciens. Il parait à l'assemblée, et, sans quitter la robe sacerdotale, il apaise la sédition par l'autorité de son caractère et de ses discours. » Trad. de M. de Golbéry. Tite-Live parle en effet, dans ce même chapitre, de la sédition dont il est ici question. Ce vêlement sacerdotal, qu'on appelait laena, était une robe plus ample, plus épaisse ; une sorte de double toge. CHAP. XV. — Profligato dextro cornu. Tite-Live s'est ici trompé, si toutefois on doit lui attribuer cette faute, et non aux copistes de ses ouvrages. Il veut certainement parler de l'aile gauche des Gaulois, qui avait commencé le combat avec tant d'ardeur, en attaquant l'aile droite des Romains. On a vu en effet que le dictateur s'apercevant que les Gaulois commençaient à plier de ce coté, y envoya la cavalerie pour achever de les mettre en déroute, tandis qu'il irait porter du secours à l'aile gauche. Or, il est évident que l'aile gauche des Gaulois était opposée à l'aile droite des Romains, et l'aile gauche des Romains à la droite des Gaulois. CHAP. XVI — Haud aeque laeta patribus insequenti anno.C'est une chose bien remarquable que ces dissensions qui ne cessent de troubler la paix intérieure de la cité. Le peuple n'a pas plutôt obtenu une concession, qu'il travaille a en arracher une autre ; et, de leur coté, les patriciens n'en ont pas plutôt fait une, qu'ils s'efforcent de la retirer (voyez, ch. XVII, fin). On attribue ordinairement à ces dissensions, la perte de la république; « mais on ne voit pas, dit Montesquieu, qu'elles y étaient nécessaires, qu'elles y avaient toujours été, et qu'elles y devaient toujours être. Ce fut uniquement la grandeur de la république qui fit le mal, et qui changea en guerres civiles les tumultes populaires. Il fallait bien qu'il y eût à Rome des divisions ; et ses guerriers si fiers, si audacieux, si terribles au dehors, ne pouvaient pas être bien modérés au dedans. Demander, dans un état libre, des gens hardis dans la guerre et timides dans la paix, c'est vouloir des choses impossibles ; et, pour règle générale, toutes les fois qu'on verra tout le monde tranquille dans un état qui se donne le nom de république, on peut être assuré que la liberté n'y est pas. » (Grandeur et décadence de Rome, c. IX.) Machiavel est ici d'accord avec Montesquieu : « Ceux qui blâment les dissensions continuelles des grands et du peuple, dit-il, me paraissent désapprouver les causes mêmes qui conservèrent la liberté de Rome, et prêter plus d'attention aux cris et aux rumeurs que ces dissensions faisaient naître, qu'aux effets salutaires qu'elles produisaient. Ils ne veulent pas réfléchir qu'il existe dans chaque gouvernement deux sortes d'oppositions, les intérêts du peuple et ceux des grands ; que toutes les lois que l'on fait au profit de la liberté naissent de leur désunion, comme le prouve tout ce qui s'est passé dans Rome, où d'ailleurs, pendant trois cents ans et plus qui s'écoulèrent entre les Tarquins et les Gracques, les discordes civiles produisirent si peu d'exils, et firent couler le sang plus rarement encore.» (discours sur la première décade de Tite-Live, l.1, ch. IV.) «Les législateurs de Rome, ajoute- t-il plus loin, auraient pu parvenir à la rendre aussi paisible que les républiques de Sparte et de Venise, s'ils avaient voulu ou ne point se servir du peuple à la guerre, comme firent les Vénitiens, ou ne point adopter les étrangers comme citoyens, ainsi que firent les Lacédémoniens. Mais ils employèrent, au contraire, ces deux moyens, ce qui accrut la force du peuple et multiplia par conséquent les sources de troubles. Si la république romaine eût été plus paisible, il en serait résulté cet inconvénient, que sa faiblesse en eût été augmentée, et qu'elle se serait elle-même fermé les chemins à la grandeur où elle est parvenue dans la suite. De manière que si Rome eut voulu se préserver des tumultes, elle se ravissait tous les moyens de s'accroître. » (ch. VI.) CHAP. XVI — De uncario fenere. Pour comprendre comment ces mots peuvent signifier l'intérêt à un pour cent par an, il faut se rappeler que l'intérêt se comptai! chez les Romains, comme chez nous, a tant pour cent du capital et que l'usage était de le calculer par mois; que dans les calculs on prenait pour unité la centième partie du capital, et qu'on la désignait, comme toute autre unité, par le mot as ; enfin que le mot uncia signifie le douzième de l'as, et en général de toute autre unité. (Nous avons vu, liv. V, ch. XXIV). ce mot employé pour désigner le douzième de l'arpent : terna jugera et septunces.) Cela posé, il est évident que asses usurae ou fenus ex asse est synonyme de centesima ou de un pour cent, par mois, douze pour cent par an.et que fenus unciarium, unciae usurae signifie le douzième de la centésime, aussi par mois, et par conséquent la centésime entière, ou un pour cent par an, on aura donc :
Quoique la réduction de l'intérêt a un pour cent, dit Tite-Live, eût déjà bien allégé les charges qui pesaient sur les débiteurs, ce taux était encore trop élevé pour ces malheureux qui ne pouvaient payer même le capital ; 848 aussi le verrons-nous bientôt ( ch. XXVII ) abaissé jusqu'à un demi pour cent. On ira même, sur la proposition du tribun !.. Genucius. jusqu'à défendre de prêter à un intérêt quelconque : ne fenerare liceret (ch. XLII ). Le soin de faire exécuter ces lois était confié aux édiles, et surtout aux édiles curules, qui, plus d'une fois, condamnèrent les usuriers à de lourdes amendes. ( Voyez VII, 28; X, 23 ; XXXV, 41). Cependant elles tombèrent bientôt en désuétude ; car elles faisaient tort à tout le monde : aux capitalistes, dont l'avarice ne pouvait s'arranger de prêter sans intérêt, ni même à un demi pour cent, et qui laissaient dormir leurs fonds, et aux emprunteurs, qui ne pouvaient trouver l'argent dont ils avaient besoin. Il y avait d'ailleurs plusieurs moyens de les éluder ; c'était de comprendre l'intérêt dans le capital, ou du le retrancher d'avance de la somme prêtée, ou enfin de mettre la créance sous le nom d'un allié, qui, n'étant pas soumis aux lois romaines, pouvait prêter au taux qu'il voulait. Ces lois eurent donc le sort de toutes les lois répressives de l'usure : elles produisirent l'effet opposé à celui qu'on en attendait. Les capitalistes, forcés de les violer, calculèrent les chances que cette nécessité leur faisait courir, et ils élevèrent en proportion le taux de l'intérêt. Celui de un pour cent par mois, fenus ex asse, finit par devenir légitime. (Cic. ad Att., v, 2l. ) Mais les citoyens les plus vertueux eux-mêmes ne se faisaient pas scrupule de le dépasser de beaucoup. Ainsi nous voyons dans Cicéron ( loc. cit. ) que Scapius, agent de Brutus, prêtait, à la cité de Salamine, à quatre pour cent par mois, quaternis centesimis. Quant à Verres, qui prêtait à deux pour cent par mois, binis centesimis, Cicéron ( Ver ., III, 71) n'en eût pas fait un sujet d'accusation contre lui, .si cet argent, dont il tirait un revenu si considérable, n'eût pas été celui de la république. ( V. Appien, de Bell, civ., I,54; Dion, LXlI, 2; Tacit.. Ann., III, 40; VI, 16 et la note de M. Burnouf sur ce dernier passage. ) Suivant Niebubr ( Hist. rom. t. V, p. 70 et suiv. ), il faudrait voir dans le mot as, non pas la centième partie du capital, comme nous l'avons dit plus haut, mais le capital lui-même; d'où il résulterait que unciae serait le douzième du capital, et fenus unciarum, l'intérêt d'un douzième. Mais un intérêt aussi élevé ne pouvait évidemment se percevoir par mois. Il se calculait donc par années cycliques de dix mois, et faisait, pour l'année civile de douze mois un dixième ou dix pour cent. Ici se présente une petite difficulté que Niebubr n'a pas prévue ; tout se faisait par analogie chez les anciens. Or, si l'année eût été de dix mois, en matière de prêts, il est probable qu'ils eussent aussi adopté le dixième du capital pour le taux de l'argent. Ou ne conçoit pas pourquoi, à celte fraction si bien en rapport avec la division de l'aimée, ils eussent préféré le douzième, qui eut rendu si compliqué les décomptes des intérêts par mois. Mais passons sur cette difficulté; il faudrait encore, pour que l'explication de Niebubr fût admissible, qu'il n'eût été fait mention, dans les auteurs, que des usurae semunciae et unciae. Or il y est souvent question de multiples de l'uncia, et il en est question connue d'intérêts peu élevés. Ainsi Julius Capitolinus (in Anton. Pio, ch. II ) compte le trientarium fenus parmi les taux les plus modiques, minimis usuris; et Perse (Sat. V, v. 149), appelle modeste l'intérêt de cinq onces : nummi, quos hic quincunce modesto nutrieras. Cependant, d'après la conjecture de Niebubr, l'intérêt de quatre onces, trientarium fenus, serait de quarante pour cent, et ce modeste intérêt de cinq onces, modestus quincunx, dont parle Perse, ne serait que de cinquante pour cent ! On voit à quelles absurdes conséquences conduit cette conjecture. CHAP. XVI. — Legem.... de vicesimo eorum qui manu mitterentur, tulit. Cette loi obligeait le maître à verser au trésor public le vingtième du prix que lui avait coûté, ou que valait l'esclave auquel il donnait la liberté. » L'espérance, dit Gibbon, cette unique consolation des malheureux, n'était pas refusé à l'esclave romain. S'il trouvait quelque occasion de se rendre utile ou agréable, il devait naturellement s'attendre qu'après un petit nombre d'années son zèle et sa fidélité seraient récompensés par le présent inestimable de la liberté. Souvent les maîtres n'étaient portés à ces actes de générosité, que par la vanité et l'avarice; aussi les lois crurent-elles plus nécessaire de restreindre que d'encourager une libéralité prodigue et aveugle, qui aurait pu dégénérer en un abus très dangereux (voir Burigny, sur les affranchis romains, dans les Mém. de l'Acad. des Inscript., t. XXXVIII ). Selon la jurisprudence ancienne un esclave n'avait point de patrie; mais, dès qu'il était libre, il était admis dans la société politique dont son patron était membre. En vertu de cette maxime la dignité de citoyen serait devenue le partage d'une vile multitude. On jugea donc à propos d'établir d'utiles restrictions. Hist. de la Décadence et de la Chute de l'empire rom., part. I, chap. II. CHAP. XXIII. — Triarii erant... et ab hastatis principibusque. Il y avait, dans la légion romaine, trois espèces de fantassins; les hastati, les principes et les triarii. Les hastati étaient ainsi appelés, à cause des longues lances, hastae, qu'ils portaient, et qu'ils abandonnèrent dans la suite, comme embarrassantes ( Varr, de Ling. lat., IV, 16 ). Ce corps était compose des soldats les plus jeunes ; il formait la première ligne. La seconde ligne était formée par le corps des principes, entièrement composé d'hommes dans la force de l'âge. Il paraît que dans les premiers temps ils occupaient la première ligne, c'est de la qu'ils avaient pris leur nom. Les triarii, ainsi nommés parce qu'ils étaient places à la troisième ligne, étaient tous de vieux soldats, d'une valeur éprouvée. On les appelait aussi pilani, parce qu'ils étaient armés du pilum, javeline de six pieds de long, terminée par une pointe en acier de dix-huit pouces, et taillée en triangle. Les hastati et les principes, considérés collectivement et par opposition aux triarii, ou pilani, étaient désignes par le nom de antepilani. Voyez, au surplus, Tite-Live qui donne une partie de ces détails, l. VIII, c. 8. Voyez aussi Denys d'Halicarnasse, l. V, 45; Vegèce, de Re militari, II, I ; et Juste-Lipse, de Militia romana, III, 2-7. CHAP. XXIV — M. erat Valerius... adolescens. Aulu-Gelle, Nuits Attiques (IX, 11 ), raconte également les circonstances de ce combat, mais sans citer les écrivains auxquels il les a empruntées. Seulement « il en est peu, dit-il, qui n'aient fait mention de M. Valerius, a cause du secours que lui porta un corbeau. « Cela prouve du moins à quel point cette histoire était populaire à Rome. » L'empereur Auguste, ajoute-t-il en terminant. fit élever, à Corvinus, une statue dans le forum auquel il donna son nom. Sur le casque, l'image d'un corbeau atteste et le combat et la victoire que nous venons de raconter. » 849 CHAP. XXV. — Decem legiones scriptae dicuntur. C'est à des sources récentes, et où les temps étaient confondus, que paraît avoir été emprunté ce dénombrement des troupes. Car l'état des légions que nous indique Tite-Live ne fut pas constitué avant l'année 520 (voyez VIII, 8; ef. Nast., Roem. Kriegsalterth. p. 30; Ruald, ad Plutarch. Romulum) La même observation s'applique au nombre des soldats qui composaient chaque légion, nombre qui est encore beaucoup plus élevé dans Eutrope ( II, 6 ). Tite-Live, en parlant de dix légions, n'est pas, comme on pourrait le croire, en dissentiment avec Polybe, qui atteste qu'à la bataille de Cannes on combattit pour la première fois avec huit légions réunies. En effet, Tite-Live dit plus bas que ces dix légions furent divisées en trois corps d'armée. CHAP. XXVI. — Italiam reliquere, cujus populi... nihil certi est. Plusieurs commentateurs regardent la conjecture de Tite-Live comme fondée. Car si l'un ne peut admettre, avec Sigonius, que cette flotte fut celle du pirate Posthumius, ni celle de Timoléon, qui ne fut maître de Syracuse qu'en 543, av. J.-C., puisque ces événements se passaient en 346, on ne peut refuser son assentiment à l'opinion qui l'attribue à Denys le Jeune. Ce prince, chassé de la Sii'ile par Dion, en 356, s'était retiré avec ses trésors à Locres, d'où il infestait de ses brigandages les côtes de l'Italie. Voyez, à cet égard, Heyne, Opusc. acad., t. II, p. 44, 56, seq., et t. III, p. 57; coll. Strab., VI, p. 397, 398, Diod. de Sic., XIV, 44, 103-107; Elien, Hist. div., VI, 12; IX, 8; Athen.. XII. p. 541, et Plutarque, Timol., p. 242. ch. XIV. Niebuhr ne partage pas celte opinion ; suivant lui, il faut attribuer In ravages exercés cette année par des Grecs, sur les cotes de l'Italie, à quelqu'une des bandes d'aventuriers rassemblées en Phocide par Phalaecus, et conduite au secours de Tarente par le Spartiate Archidamus. IBID. — Inde Apuliam ac mare superum petierunt. C'est la leçon qu'a suivie Crevier ; c'est celle des anciennes éditions, et de quelques manuscrits. Cependant comme le plus grand nombre des manuscrits, et les plus anciennes éditions ont tous mare inferum. Drakenborch, et la plupart de ceux qui sont venus après lui, ont adopté cette dernière leçon, tout en a vouant qu'elle est mauvaise, et qu'on ne peut l'expliquer. En effet, c'est le pays des Volsques, qui touche la mer inférieure, tandis que l'Apulie est située sur les bords de la mer supérieure, ou Adriatique. Drakenborch propose une correction (inde Apuliam ab mari infero petierunt ) que l'on devrait certainement admettre, si l'on n'était autorisé par quelques manuscrits a garder mare superum. Il est inutile de faire remarquer que le traducteur n'a pas suivi le texte adopté dans la présente édition, mais celui de Drakenborch. CHAP. XXVIl.— Cum Carthagiensibus legatis Romae foedus ictum. Tite-Live, d'accord en cela avec Diodore, Orose, etc., donne ce traité comme le premier qui ait été conclu entre les Romains et les Carthaginois. Mais il est formellement contredit par le témoignage positif et irrécusable de Polybe, qui donne le texte et la date d'un premier traité, antérieur à celui-ci de plus de cent cinquante ans, puisqu'il avait été conclu dans l'année même qui suivit l'expulsion des rois. Voici au reste la suite des traités conclus entre les deux peuples, telle que Polybe nous l'a conservée ( III, 22 et suiv. ). Nous rapporterons en même temps les explications si intéressantes de l'historien grec sur ces précieux documents. « Ces traités, dit Polybe, subsistent encore, et sont conserves sur des tables d'airain au temple de Jupiter Capitolin dans les archives des édiles. Il n'est cependant pas étonnant que l'historien Philinus ne les ait pas connus; de notre temps même il y avait de vieux Romains et de vieux Carthaginois qui, quoique fort versés dans les affaires de leur république, n'en avaient aucune connaissance ». (III, 26 ). « Le premier est du temps de Lucius Junius Brutus et de Marcus Horatius, les premiers consuls qui fixent créés après l'expulsion des rois, sous lesquels eut lieu la dédicace du temple de Jupiter Capitolin, vingt-huit ans avant l'invasion de Xerxès dans la Grèce (vers l'an de Rome 245). Le voici tel qu'il m'a été possible de l'expliquer; car la langue latine de ces temps-là est si différente de celle d'aujourd'hui, que les plus habiles ont bien de la peine à entendre certaines choses. » « A ces conditions, il y aura amitié entre les Romains et les alliés des Romains, les Carthaginois et les alliés des Carthaginois. Les Romains et leurs alliés ne navigueront pas au delà du Beau Cap ( promontorium Hermaeum, aujourd'hui cap Bon, ou Ras-Adder), à moins qu'ils n'y soient poussés par la tempête ou par les ennemis. Si quelqu'un est jeté forcément sur ces côtes, il ne lui sera permis de faire aucun trafic ni d'acquérir autre chose que ce qui est nécessaire aux besoins du vaisseau et aux sacrifices. Au bout de cinq jours, tous ceux qui auront pris terre devront remettre à la voile. Les marchands ne pourront faire de marché valable qu'en présence du crieur et du scribe. Les choses vendues d'après ces formalités seront dues au vendeur sur la foi du crédit public : ceci concerne la Libye et la Sardaigne. Un Romain arrivant dans la partie de la Sicile soumise aux Carthaginois, jouira des mêmes droits que ceux-ci. Les Carthaginois n'offenseront pas les habitants d'Ardéa, d'Antium, de Laurentium, de Circée, de Terracine, ni un peuple quelconque des Latins soumis aux Romains, lls s'abstiendront aussi de nuire aux villes des autres Latins, non soumis à Rome ; mais, s'ils les occupent, ils les lui livreront intactes. Ils ne bâtiront aucun fort dans le Latium; et, s'ils entrent en armes dans le pays, ils n'y passeront pat la nuit. » « Ce beau promontoire, ajoute Polybe, c'est celui de Carthage, qui regarde vers le septentrion, et au delà duquel les Carthaginois interdisent aux Romains de naviguer sur de longs vaisseaux vers le midi, de peur que ceux-ci, comme je crois, ne connaissent les campagnes qui sont aux environs de Byzacium et de la petite Syrte, et qu'ils appellent Emporia (les marchés), à cause de leur fertilité. Ils permettent seulement, à ceux que la tempête ou les ennemis y auront poussés, de prendre ce qui sera nécessaire aux sacrifices et aux besoins du vaisseau, pourvu qu'ils partent au bout de cinq jours. Pour ce qui regarde Carthage, toute la contrée qui est en deçà du beau promontoire d'Afrique, la Sardaigne et la Sicile, dont les Carthaginois sont les maîtres, il est permis aux marchands romains d'aller dans tous ces pays, et on leur promet, sous la foi publique, que partout on leur faire bonne justice. « Au reste, dans ce traité on parle de la Sardaigne et de l'Afrique comme de possessions propres aux Carthaginois περὶ ἰδίας) mais à l'égard de la Sicile, on distingue les conventions ne tombant que sur cette partie qui obéit 850 aux Carthaginois. De la part des Romains les conventions qui regardent le pays latin sont conçues de la même manière. Il n'est pas fait mention du reste de l'Italie qui ne leur était pas soumis. • « Il y eut depuis un autre traité, dans lequel les Carthaginois comprirent les Tyriens et les habitants d'Utique, et où l'on ajoute au beau promontoire Mastie et Tarseium, au delà desquels il est défendu aux Romains de piller et de bâtir une ville. Voici ce traité. [C'est celui que Tite-Live, VIII, 27 et Diodore, XVI, 69, placent à l'an de Home 403, sous le consulat de M. Valérius Corvus ei de M. Popilius Laenas, et qu'ils regardent comme le premier conclu entre les Romains et les Carthaginois. ] » Entre les Romains et les alliés des Romains, entre le peuple des Carthaginois, des Tyriens, des Uticéens et leurs alliés, il y aura alliance à ces conditions : que les Romains ne pilleront, ne trafiqueront ni ne bâtiront de ville au delà du beau promontoire, de Mastie et de Tarseium ; que si les Carthaginois prennent, dans le pays latin, quelque ville non soumise aux Romains, ils garderont l'argent et les prisonniers, mais ne retiendront pas la ville; que si des Carthaginois prennent quelque homme faisant partie des peupies qui sont en paix avec les Romains par un traité écrit, sans pourtant leur être soumis, ils ne le feront pas entrer dans les ports des Romains ; que s'il y entre et. qu'il soit pris par un Romain, il sera mis en liberté ; que celte condition sera aussi observée du côté des Romains. Que s'ils font de l'eau ou des provisions dans un pays qui appartient aux Carthaginois, ce ne sera pas pour eux un moyen de faire tort à aucun des peupies qui ont paix et alliance arec les Carthaginois; ... que les Carthaginois seront tenus également à ces conditions. ] Que si cela ne s'observe pas, il ne sera point permis de se faire justice à soi-même; que si quelqu'un le fait, cela sera regardé comme un crime public; que les Romains ne trafiqueront ni ne bâtiront de ville dan» la Sardaigne ni dans l'Afrique;.... [qu'ils ne pourront y entrer] que pour prendre des vivres ou réparer leurs vaisseaux; que s'ils y sont jetés par la tempête, ils en partiront au bout de cinq jours. Qu'à Carthage et dans la partie de la Sicile qui obéit aux Carthaginois, un Romain aura, pour son commerce et ses actions, la même liberté qu'un citoyen ; qu'un Carthaginois aura le même droit à Rome. » « On voit encore dans ce traité que les Carthaginois considèrent l'Afrique et la Sardaigne comme des possessions propres ( ἐξιδιαζόμενοι), et qu'ils ôtent aux Romains tout prétexte d'y mettre le pied ; qu'au contraire pour la Sicile ils ne parlent que de la partie qui leur obéit. Les Romains font la même chose a l'égard du pays latin; ils ne permettent pas aux Carthaginois de nuire aux Antiates, aux Ardéates, aux Circéens, aux Terraciniens, tous habitant les villes maritimes du Latium. « Au temps de l'expédition de Pyrrhus en Italie, avant que les Carthaginois eussent entrepris la guerre de Sicile, il y eut un autre traité où l'on voit les mêmes conventions que dans les précédents [on peut le rapporter à l'année 476 au moment où Pyrrhus fut appelé en Sicile ( voyez Heyne, Dissert. Acad., vol. III ) j; mais on ajoute : « que si les uns ou les autres font alliance par écrit avec Pyrrhus, ils la feront de telle sorte qu'il leur sera permis de se porter mutuellement secours sur le territoire attaque; que, quelque soit celui des deux peuples qui ait besoin de secours, les Carthaginois fourniront les vaisseaux, soit pour les transports des troupes, soit pour le combat; que chaque peuple pourvoient à la solde de ses troupes; que les Carthaginois secourront les Romains, même sur mer s'il en est besoin ; qu'on ne forcera point l'équipage à sortir d'un vaisseau malgré lui. » «i Ces traités furent confirmés par serment. Au premier, les Carthaginois jurèrent par les dieux de leurs pères, et les Romains, par Jupiter Pierre, Δία Λίθον, suivant un ancien usage, et ensuite par Mars et Enyalus. Le serment par Jupiter Pierre se faisait ainsi : celui qui jurait un traité, s'engageait sur la foi publique, puis une pierre en main il prononçait ces paroles : « Si je jure vrai, que tout me soit prospère; si je pense autrement que je ne jure, que tous les autres jouissent tranquillement de leur patrie, de leurs lois, de leurs biens, de leur religion, de leurs tombeaux, et que moi seul je sois rejeté comme je fais maintenant de cette pierre. » En même temps il jetait la pierre. Après la guerre de Sicile il y eut un nouveau traité rapporté par Polybe, au ch. KIII du livre I; c'est le traité entreLutatius et Hamilcar (513 ), modifié quelque temps après, puis renouvelé plus lard avec quelques modifications encore par Asdrubal. C'est sur ce traité et ses modifications que porte le débat élevé au sujet du siège de Sagonte. Voyez Tite-Live, ch. XVIII e XIX. ] Voici les principales conditions de ce traité: « Il y aura alliance entre les Romains et les Carthaginois, aux conditions suivantes, si elles sont ratifiées par le peuple romain. Les Carthaginois se retireront de toute la Sicile; ils ne feront pas la guerre à Hiéron ; ils ne prendront pas les armes contre les Syracusains ni contre leurs alliés. Ils rendront sans rançon tous les prisonniers romains; ils paieront en vingt ans 2,200 talents euboïques. » Ce traité ne fut pas d'abord accepté à Rome; on envoya sur les lieux dix députés pour examiner les affaires de plus près. Ceux-ci ne changèrent rien à l'ensemble, mais ils étendirent un peu plus les conditions. Ils abrégèrent le délai de paiement, ajoutèrent mille talents a là somme ; et exigèrent de plus que les Carthaginois abandonnassent toutes les îles qui sont entre la Sicile et l'Italie. Voici le sommaire du traité modifié ( Poybe, III, ch. XXIII ) : « Les Carthaginois sortiront de la Sicile et de toutes les îles qui sont entre la Sicile et l'Italie. De part et d'autre on ne fera aucun tort aux allies respectif»; on ne commandera rien dans la domination les uns des autres ; on n'y bâtira point publiquement ; on n'y lèvera point de soldats ; on ne recevra pas dans son alliance les alliés de l'autre parti. Les Carthaginois paieront en dix ans deux mille deux cents talents, et mille sur-le-champ. Ils rendront sans rançon tous les prisonniers qu'ils ont faits sur les Romains. » La guerre d'Afrique ( celle des Mercenaires) terminée, les Romains ayant porté un décret pour déclarer la guerre aux Carthaginois, on ajouta ces deux conditions ( Polybe, liv. I, cb. LXXVIII) : « Que les Carthaginois abaodonneront la Sardaigne et qu'il paieront 1,200 talents au delà de la somme fixée précédemment. » Enfin dans le dernier traité, qui fut celui qu'on fit avec Asdrubal en Espagne, on convint de plus, « que les Carthaginois ne feraient plus la guerre au delà de l'Ebre. » CHAP. XXIX. — Ce que Tite-Live raconte de Valerius est emprunté à des auteurs récents, et probablement à Valérius Antias, qu'on reconnaît à la prolixité et à l'exagération du récit, à quelques détails ridicules ( ch. XXXIII), 851 aux éloges prodigués a Corvus, à plusieurs discours, et enfin au nombre des morts si considérablement exagéré. CHAP. XXX. — l.egati in hanc sententiam locuti sunt. Sigonius et tous les commentateurs de Tite-Live ont remarqué que ce discours semblait imité de celui que Thucydide prête aux Corcyréens dans le sénat d'Athènes, Δίκαιον, ὦ Ἀθηναῖοι, κ. τ. λ. (liv I, 32-36). Les circonstances étaient en effet à peu près les mêmes. CHAP. XXXI. — Tum jam fides agri visa, deditos non prodi. « Les Romains, dit Machiavel, cherchèrent toujours à avoir, dans leurs nouvel es conquêtes, quelque ami qui fût comme un degré ou une porte pour y arriver et pour y pénétrer, ou qui leur donnât le moyen de s'y maintenir. C'est ainsi qu'ils se servirent des habitants de Capone pour entrer dans le Samnium ; des Camertins, dans la Toscane; des Mamertins, dans la Sicile; des Sagontins, dans l'Espagne ; de Massinissa, dans l'Afrique ; des Étoliens, dans la Grèce; d'Eumène et de quelques autres princes, dans l'Asie ; des Marseillais et des Éduens, dans la Gaule. Ils ne manquèrent jamais d'appui de cette espèce pour faciliter leurs entreprises, faire de nouvelles conquêtes et y consolider leur puissance. Les peuples qui observeront une conduite semblable, auront moins besoin des faveurs de la fortune que celui qui s'en écarteraient. » (Discours sur la première décade de Tite-Live,l. II, ch. I.) CHAP. XXXV. — Tesseram dari jubet. La tessère était une petite tablette de bois où l'on écrivait le mot d'ordre. Au coucher du soleil, avant de poser les gardes, le tribun la remettait è un soldat, qui en prenait le nom de tesserarius. Il la faisait courir de rang en rang, de manière qu'elle revint avant la nuit au tribun qui l'avait donnée. On se servait surtout de ce moyen de faire connaître à un corps d'armée les ordres des chefs, lorsqu'on était observé par un ennemi, dont un signal donné au moyen de la trompette eût attiré l'attention. Il y avait deux sortes de tesserœ : les unes servaient à l'usage que nous venons d'expliquer; les autres étaient distribuées aux soldats et leur servaient à se reconnaître dans la mêlée. CHAP. XXXVIII. — Capua instrumento omnium voluptatuù delinitos militum animos avertit a memoria patriae. «De toutes les contrées de l'Italie et même de l'univers, dit Florus, liv. I, ch. XVI, la Campanie est la plut belle. Rien de plus doux que son ciel qui la fleurit de deux printemps ; rien de plus fertile que son sol ; Cérès et Bacchus y sèment à l'envie. Rien de plus hospitalier que ses flots; là, les ports célèbres de Caieté, de Misène, les tièdes fontaines de Baïes, le Lucrin et l'Averne où la mer vient se reposer; la, des monts chargés de vignes; le Gaurus, le Falerne, le Massique, et le plus beau de tous, le Vésuve ( qui n'imitait pas encore les feu de l'Etna ); près de la mer Formies, Cumes, Pouzzoles, Naples, Herculanum, Pompéi, et la capitale Capoue, comptée alors avec Rome et Cartilage, comme une des trois grandes cités. » CHAP. XXXIX. — A la fin de ce livre, ch. XXIX et suiv., on reconnaît l'empressement ordinaire de Tite-Live d'arriver au terme du livre qu'il rédige. Ne pouvant concilier les divers récits, il en choisit un, et à la fin il dit quelques mots des autres. La narration de Tite-Live offre des contradictions. Il faut encore la rapporter à Valérius Antias, qui était gentilis de Valérius Corvus. Aussi Valérius Cervus, qui, dans les autres récits ne joue aucun rôle, est dictateur dans celui ci, réconcilie tout, pérore, et sauve la république. Niebuhr ( t. III, p. 85; t. V, p. 99, tr. fr. ) préfère un récit différent, sans toutefois contester la dictature de Valérius qui, entre autres témoignages, a pour elle l'inscription de la statue élevée à ce Romain, inscription que Borgliesi a fait connaître le premier ( Giorn. Arcadico, I). CHAP. XLI. — Approbantis clamore cunctis.... Suivant Niebuhr, dont, il faut bien l'avouer, les opinions ne sont pas toujours des paradoxes, quoique presque toujours elles en aient l'apparence, Tite-Live aurait complètement dénaturé les circonstances de cette sédition, et il en aurait ignoré la véritable cause. Cette cause serait l'excès de misère on étaient tombés les plébéiens, et les dettes dont ils étaient accablés. ( Voyez Appien, Samnit.) Serait-il possible en effet, s'ils n'avaient été excités que par la pensée de s'emparer de Capoue, qu'ils y eussent renoncé tout à coup et se fussent contentés de concessions qui, sans leur apporter aucun avantage réel, ne faisaient que satisfaire de petits intérêts de vanne. Non, sans doute, un tel dénouement est tout a fait invraisemblable. Mais ces concessions elles-mêmes, dont parle Tite-Live, il les a envisagées sous un point de vue trop mesquin: elles avaient une toute autre portée que celle qu'il leur donne. Ainsi, cette loi qui garantissait le service militaire, avait évidemment un double but : celui d'empêcher un consul malveillant d'arracher un débiteur à l'asile que lui offraient les camps, pour le livrer, en le renvoyant à Rome, entre les mains de créanciers impitoyables ; et celui de garantir à chaque citoyen les années de service dont on devait faire preuve pour avoir part aux distributions de terres. Celle qui défendait qu'un même citoyen pût être alternativement tribun légionnaire et centurion, et que Tite-Live dit avoir été faite en haine de Salonius, lui était au contraire favorable. Elle avait pour but de garantir nui plébéiens, une fois arrivés au tribunal, le rang que conférait ce grade, et d'empêcher que l'année suivante l'orgueil patricien ne les rabaissât an rang des centurions, qui n'étaient, après tout, que les premiers des soldats. Quant a la loi qui diminuait la solde des chevaliers, ainsi que celles qui défendaient le prêt a intérêt et le cumul des magistratures, qui voulaient qu'un citoyen ne pût être revêtu de la même magistrature qu'après dix ans d'intervalle, et que l'on pût choisir les deux consuls parmi les plébéiens; c'étaient autant de victoires remportées par le peuple sur les nobles et les riches, et, si l'on en compare l'importance à celle des concessions qu'il obtint sur le mont Sacré, on la trouvera bien supérieure. Il faut donc qu'une sédition qui amena de si grands résultats n'ait pas été, comme le dit Tite-Live, une révolte de quelques soldats, mais bien une véritable sécesssion, comme celle du mont Sacré et de l'Aventin. (V. Appien., loc. cit., — Aurel. Vict., de Vir. illust., cb. XXIX.)
Il y a d'ailleurs dans le récit de
Tite-Live, des invraisemblances si notoires que nous avons cru inutile de les
faire remarquer. Telle est la formation de cette armée, composée de soldats
renvoyés isolément par le consul, et qui devient considérable sans que celle du
consul! en soit sensiblement diminuée.
|