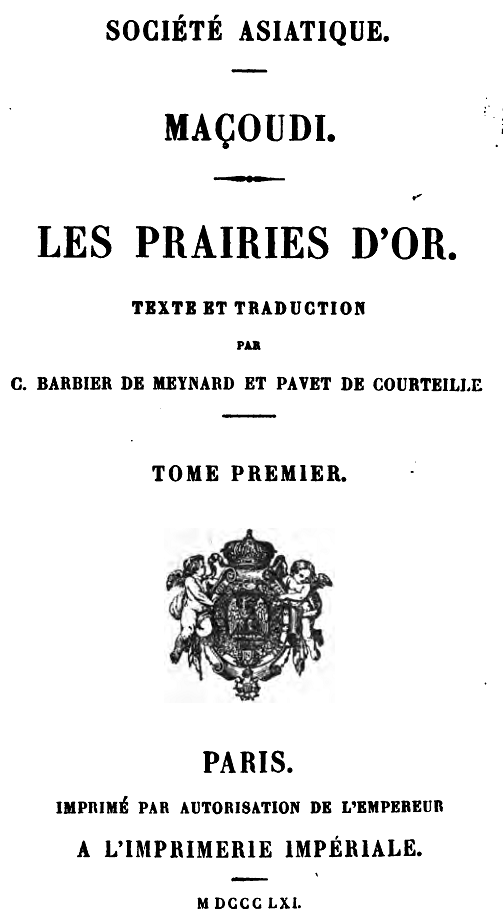
MAÇOUDI.
LES PRAIRIES D'OR. (chapitres V à X)
(chapitres I à IV) - (chapitres XI à XV)
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
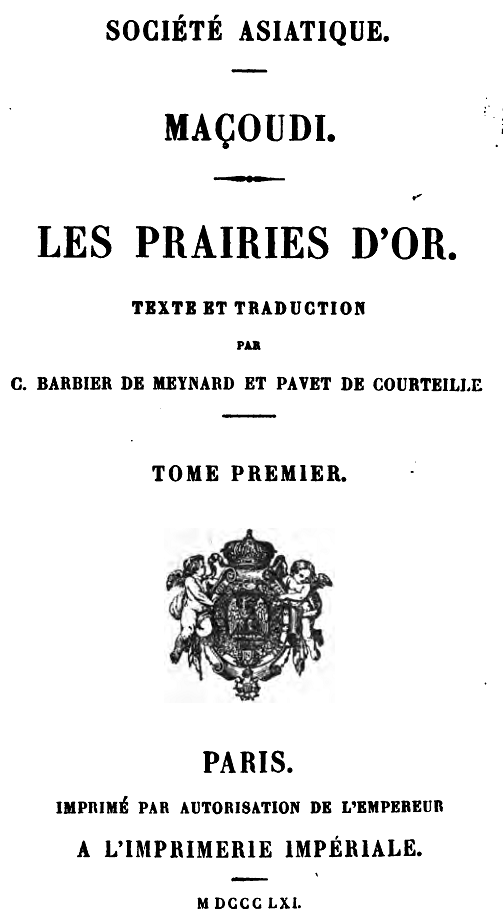
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
TEXTE ET TRADUCTION
PAR
C. BARBIER DE MEYNARD ET PAVET DE COURTEILLE.
TOME PREMIER.
Après la mort de Salomon, Arkhoboam, son fils, régna sur les enfants d'Israël ; mais les tribus, qui lui avaient été toutes soumises, se séparèrent de lui, excepté celles de Juda et de Benjamin. Il mourut après un règne de dix-sept ans. Les dix autres tribus furent gouvernées par Bouriam (Jéroboam), qui eut à soutenir d'importantes guerres et qui adora un veau d'or enrichi de perles. Dieu le fit mourir après un règne de vingt ans. Après lui Abya, fils d'Arkhoboam, fils de Salomon, fut roi pendant trois ans ; puis Ahab, qui régna quarante ans. Youram (Jehoram), qui lui succéda, rétablit le culte des idoles, des statues et des images, et régna un an. Les Israélites furent ensuite gouvernés par une femme de nom d’Ailan (Athalie), qui extermina tous les descendants de David ; un seul enfant échappa au massacre. Le peuple, révolté de la cruauté de cette reine, la tua après un règne de sept ans (mais on n'est pas d'accord sur ce chiffre), et mit à sa place cet enfant, seul rejeton de David. Il monta sur le trône à l'âge de sept ans, et régna quarante, ans, ou moins, selon quelques historiens. Son successeur, Amadia, régna cinquante-deux ans ; le prophète Isaïe (Achaiah), qui vivait à cette époque, eut de fréquents rapports avec ce roi.
Nous avons raconté, dans nos Annales historiques, les guerres qui éclatèrent sous Amadia. Son successeur fut Yokam (Jotam), fils d'Oziah ; il régna dix ans, ou, selon d'autres, seize ans. Après lui Ahar (Ahaz) releva les idoles, et se montra aussi impie que cruel. Un des plus puissants rois du pays de Babel, Falaifas (Teglatpileser), marcha contre lui ; après de longues guerres, le Babylonien fit prisonnier le roi d'Israël et détruisit les villes et les établissements des tribus.
A la même époque, des querelles religieuses s'élevèrent parmi les Juifs et amenèrent le schisme des Samaritains. Ces derniers rejetèrent la prophétie de David et de ses successeurs, soutinrent qu'il n'y avait plus eu de prophète depuis Moïse, et choisirent leur chef parmi les descendants d'Aaron, fils d'Amran ; aujourd'hui (332 de l’hég.) ils habitent des bourgades séparées sur le territoire de la Palestine et du Jourdain, comme Ara, entre Ramlah et Tibériade, et d'autres bourgs, jusqu'à Naplouse, où ils sont en plus grand nombre. Ils ont une montagne qu'ils nomment Tour-Berid, sur laquelle ils prient dans les temps prescrits par leur religion. Ils ont des trompettes d'argent dont ils sonnent aux heures de la prière. Ce sont eux qui disent : « Ne touchez pas. » (Koran, xx, 97.) Ils donnent le nom de Maison sainte (nom de Jérusalem) à Naplouse, ville de Jacob, où se trouvaient ses pâturages. Ils sont divisés en deux sectes, aussi séparées l'une de l'autre qu'elles le sont des Juifs ; l'une s'appelle Kouchan et l'autre Doustan. Une de ces deux sectes soutient l'éternité du monde et d'autres dogmes que nous ne mentionnons pas ici pour éviter les longueurs ; d'ailleurs notre ouvrage est un livre d'histoire, et non un traité d'opinions et de doctrines.
Ahaz avait régné dix-sept ans avant d'être fait prisonnier par le roi de Babel. Durant sa captivité, son fils Hizkiel (Ézéchias) monta sur le trône. Celui-ci fut fidèle au culte du vrai Dieu et fit briser les statues et les idoles. Sons son règne, Sendjarib (Sennachérib), roi de Babel, marcha contre Jérusalem ; il fit longtemps la guerre aux Israélites, perdit une partie de son armée, mais assujettit la plupart des tribus d'Israël.
Hizkiel mourut après un règne de vingt-neuf ans, et son fils Mîcha (Manassé) monta après lui sur le trône. Ce roi, qui persécuta avec rigueur tous ses sujets, fit aussi périr le prophète Isaïe. Dieu dirigea contre lui Constantin, roi de Roum. Manassé alia à sa rencontre avec son armée, mais ses soldats prirent la fuite, et lui-même fut fait prisonnier. Il resta vingt ans dans le pays de Roum, dépouillé de toute sa puissance, puis il fut mis en liberté ; il revint dans ses Etats et mourut après un règne de vingt-cinq ans, ou, selon d'autres, de trente ans.
Son successeur fut Amour (Amon), qui se révolta, renia le vrai Dieu, et rétablit le cuite des idoles. Sa tyrannie étant devenue excessive, Pharaon le boiteux sortit de l'Egypte à la tête de son armée et marcha contre lui. Après avoir répandu des flots de sang, il s'empara d'Amon et le conduisit en Egypte, où ce roi mourut prisonnier. Son règne avait duré cinq ans, mais on n'est pas d'accord à cet égard. Son frère Youfiham, père du prophète Daniel, lui succéda.
Du temps de ce roi vivait Nabuchodonosor (Bokhtuaçar) gouverneur (satrape) de l’Irak et des Arabes pour le roi de Perse, dont Balkh était alors la capitale. Ce chef étranger massacra ou amena captifs dans l'Irak un grand nombre d'Israélites ; il prit le Pentateuque (Tourah), les autres livres des Prophètes et les Chroniques des rois, qui étaient conservés dans le temple de Jérusalem, et les jeta dans un puits ; il s'empara aussi de l'arche sainte et la mit en lieu sûr dans son pays. Le nombre des Israélites qui furent emmenés en captivité s'éleva, dit-on, à dix-huit mille. Le prophète Jérémie vivait à la même époque. Nabuchodonosor, après avoir envahi l'Egypte et tué Pharaon le boiteux, qui régnait alors dans cette contrée, marcha contre l'Occident, fit périr plusieurs rois et conquit un grand nombre de villes.
Le roi de Perse avait épousé une jeune fille juive qui était parmi les captifs, et dont il eut un enfant. Ce roi permit aux Israélites de retourner dans leur pays quelques années après. Rentrés dans leurs foyers, ils furent gouvernés par Zorobabel, fils de Salathiel (Salsal), qui rétablit Jérusalem et tout ce qui avait été ruiné. Les Israélites retirèrent le Pentateuque du puits où il était enfoui ; leur royaume redevint florissant, et ce roi consacra un règne de quarante-six ans à rendre leurs terres à la culture, et à rétablir les prières et les prescriptions qu'ils avaient oubliées pendant leur captivité.
Les Samaritains prétendent que le Pentateuque qui est entre les mains des Juifs n'est pas celui que Moïse leur a apporté ; que celui-là a été brûlé, changé et corrompu, et que l'autre est dû à Zorobabel, qui l'a recueilli de la bouche des Israélites qui l'avaient retenu par cœur. Ils se croient donc les seuls et uniques possesseurs du texte authentique. Ce roi mourut après un règne de quarante-six ans. D'après une autre version, ce fut Nabuchodonosor lui-même qui épousa une fille juive, rétablit les Israélites dans leur pays et les protégea.
Ismaïl, fils d'Abraham, l'ami de Dieu, fut chargé de la garde de la Maison (la Kaaba) après son père. Dieu lui accorda le don de prophétie, et l'envoya chez les Amalécites et les tribus du Yémen pour les détourner de l'idolâtrie. Quelques-uns acceptèrent la foi, mais le plus grand nombre persévéra dans l'infidélité. Ismaïl eut douze fils : Nabet, Kidar, Arbil, Mibsam, Michmâ, Douma, Masa, Haddad, Atima, Yetour, Nafech et Bakedma. Abraham avait désigné comme son successeur son fils Ismaïl ; celui-ci élut à son tour son frère Isaac, ou, selon d'autres, son fils Kidar. Ismail avait cent trente-sept ans quand il mourut, et il fut enterré dans la mosquée el-Haram, à l'endroit où était la pierre noire. Nabet, son fils, garda la maison sainte, comme l'avait fait son père ; on croit même qu'il fut désigné par Ismaïl.
Entre l'époque de Salomon et celle du Messie, vécurent des prophètes et de pieux serviteurs de Dieu ; tels sont Jérémie, Daniel, Ozaïr, que tous n'acceptent pas comme prophète, Job, Isaïe, Ezéchiel, Elias, Elisée (el-Iça), Jonas, Dou'l-kifl, el-Khidr, qui, selon Ibn Ishak, n'est autre que Jérémie, ou, selon d'autres, un pieux serviteur de Dieu, et enfin Zacharie. Ce dernier, fils d'Adak, descendant de David et de la tribu de Juda, épousa Elisabeth (Ichba), fille d'Amran, sœur de Marie (Miriam), fille d'Amran et mère du Messie. Cet Amran, fils de Maran, fils de Yoakim, était aussi de la famille de David. La mère d'Elisabeth et de Marie se nommait Hannah (Anne). Elisabeth donna à Zacharie un fils du nom de Jean (Yahia), qui était donc le fils de la tante maternelle du Messie. Zacharie était charpentier. Les Juifs répondirent le bruit qu'il avait eu un commerce coupable avec Marie, et résolurent de le tuer. Averti de leur projet, Zacharie se réfugia dans le creux d'un arbre ; mais, sur l'indication que leur en donna Iblis, l'ennemi de Dieu, ils abattirent cet arbre et fendirent du même coup le corps de Zacharie.
Elisabeth, fille d'Amran, sœur de Marie, la mère du Messie, ayant mis au monde Jean, fils de Zacharie, s'enfuit avec son enfant en Egypte, pour éviter la colère d'un roi. Devenu homme, Jean fut envoyé par Dieu aux Israélites ; il leur prêcha la loi divine et la soumission aux volontés de Dieu, mais il fut mis à mort par ceux-ci. Après plusieurs événements, les Israélites reçurent de la colère céleste un roi de l'Orient nommé Khardouch (Hérode), qui vengea le sang de Jean, fils de Zacharie, en immolant un grand nombre de coupables, et ce crime ne fut expié qu'après de longues calamités.
Quand Marie, fille d'Amran, eut dix-sept ans, Dieu
lui envoya Gabriel, qui souffla en elle l'esprit, et elle devint
grosse du Messie, Jésus (Iça), fils de Marie. Jésus naquit dans un
village nommé Bethlehem (Beit-laham), à quelques milles de
Jérusalem, le mercredi 24 décembre. Son histoire a été révélée par
Dieu et racontée par l’intermédiaire de son Prophète, dans le Koran
(sur. iii, etc.). Les
chrétiens prétendent que Jésus, le Nazaréen, c'est-à-dire le Messie,
suivit la religion de ses ancêtres, et qu'il étudia, pendant
vingt-neuf ou trente ans, le Pentateuque et les livres anciens dans
une synagogue appelée el-Midras ( ).
Un jour, en lisant le livre d'Isaïe, il y vit ces mots tracés en
caractères de feu : « Tu es mon fils et mon essence, je t'ai élu
pour moi. » (S. Matth. xii,
18 ; cf. Isaïe, xlii,
1.) Il ferma le livre, le remit au serviteur du temple et
sortit en disant : « Maintenant la parole de Dieu s'est accomplie
dans le fils de l'homme. » D'autres disent
aussi que le Messie habitait le bourg de Nazareth
(Naçarah), situé sur le territoire d'el-Ladjoua, dépendant du
district du Jourdain, et que c'est ce qui a valu aux chrétiens le
nom de Nazaréens.
).
Un jour, en lisant le livre d'Isaïe, il y vit ces mots tracés en
caractères de feu : « Tu es mon fils et mon essence, je t'ai élu
pour moi. » (S. Matth. xii,
18 ; cf. Isaïe, xlii,
1.) Il ferma le livre, le remit au serviteur du temple et
sortit en disant : « Maintenant la parole de Dieu s'est accomplie
dans le fils de l'homme. » D'autres disent
aussi que le Messie habitait le bourg de Nazareth
(Naçarah), situé sur le territoire d'el-Ladjoua, dépendant du
district du Jourdain, et que c'est ce qui a valu aux chrétiens le
nom de Nazaréens.
J'ai visité dans ce bourg une église très vénérée par les chrétiens ; elle renferme des ossements humains dans des cercueils de pierre, et il en découle de l'huile épaisse comme un sirop ; les chrétiens croient se sanctifier en la recueillant
Le Messie, en passant devant le lac de Tibériade, y vit quelques pêcheurs qui étaient les fils de Zebeda, et douze foulons ; il les appela vers Dieu et leur dit : « Suivez-moi et vous pécherez des hommes. » Trois de ces pêcheurs, fils de Zebeda, et douze foulons le suivirent. Matthieu (Matta), Jean (Yohanna), Marc (Markoch) et Luc (Louka) sont les quatre apôtres qui ont écrit l'Evangile et raconté l'histoire du Messie, sa naissance, le baptême qu'il reçut de Jean, fils de Zacharie, ou Jean-Baptiste, dans le lac de Tibériade, et, selon d'autres, dans le Jourdain, fleuve qui sort de ce lac et se jette dans le lac Fétide. On trouve aussi dans ce livre le récit des prodiges et les miracles accomplis par le Messie, et le traitement que les Juifs lui infligèrent, enfin son ascension à l'âge de trente-trois ans. L'Evangile fournit en outre de longs détails sur le Messie, Marie, et Joseph le charpentier ; mais nous croyons devoir les passer sous silence, parce que ni Dieu, ni son prophète Mohammed ne les ont rapportés (dans le Koran).
On compte dans l'intervalle (el-fitreh) qui sépare le Messie de Mohammed plusieurs personnages qui ont cru en un Dieu unique et en la résurrection ; mais c'est une question controversée que de savoir s'il y eut ou non des prophètes parmi eux. Un de ceux à qui l'on donne ce nom est Hanzalah fils de Safwan, descendant d'Ismaïl, fils d'Abraham. Il fut envoyé chez les Ashab er-ras (Koran, xxv, 40), qui avaient la même origine, et qui se divisèrent en deux tribus, les Kadman et les Yamen ou Rawil, habitant toutes deux le Yémen. Hanzalah, fils de Safwan, exécuta l'ordre de Dieu et fut tué. Dieu révéla alors à un prophète Israélite, de la tribu de Juda, qu'il enverrait Bokhtnaçar contre ce peuple. En effet, ce roi les attaqua à la tête de son armée. Tel est le sens de cette parole divine, « Mais quand ils ont senti notre force, ils ont cherché à fuir, » et des versets suivants jusqu'aux mots : « Nous les avons rendus semblables au blé moissonné et se desséchant. » (Ibid. xxi, 12-15.) On dit aussi que ce peuple était himiarite, et c'est ce que prouve le passage suivant d'une élégie composée par un poète de cette nation :
Mes yeux répandent des larmes sur le peuple d'er-Ras, sur Rawil et Kadman.
Fuis le courroux d'Abou Dirâ, qui est le châtiment de la tribu de Kahtan.
On croit, sur l'autorité de Wahb, fils de Monabbih, que Dou'l-Karnein, c'est-à-dire Alexandre, vécut après le Messie, dans l'ère de l'intervalle. Il eut un songe dans lequel il lui sembla être assez près du soleil pour en saisir les deux extrémités à l'ouest et à l’est ; il raconta son rêve à son peuple, qui le surnomma Dou'l-Karnein ou le maître des deux cornes. Cependant ce personnage est l'objet de discussions que nous avons insérées dans nos Annales historiques et dans l'Histoire moyenne ; nous donnerons en outre un abrégé de son histoire en parlant des rois grecs et byzantins. (Voy. chap. xxv.)
Le même désaccord existe sur l'époque où vécurent « les hommes de la caverne » (Koran, xviii) ; les uns les placent dans l'ère d'intervalle, les autres sont d'un avis différent.
Nous donnerons aussi un aperçu de leur histoire dans le chapitre consacré aux rois de Roum (ch. xxvii) ; on peut encore consulter notre Histoire moyenne et nos Annales historiques.
Parmi ceux qui vécurent dans l'intervalle, après le Messie, on cite Djordjis (George), qui fut contemporain de quelques apôtres. Envoyé auprès d'un roi de Moçoul pour le convertir au vrai Dieu, il fut mis à mort ; Dieu le ressuscita et lui donna la même mission ; le roi le tua encore, mais Dieu lui rendit la vie et le renvoya auprès du roi. Celui-ci le fit brûler et jeta ses cendres dans le Tigre. Dieu détruisit ensuite ce roi et tous ses partisans. Tel est le récit fait par ceux qui suivent les Écritures et rapporté dans les livres intitulés, De l'Origine et des coutumes, par Wahb, fils de Monabbih, et d'autres auteurs.
Un autre personnage de l'ère d'intervalle est Habib
le charpentier. Il habitait Antioche de Syrie, où régnait un tyran
qui adorait les idoles et les images. Deux disciples du
Messie lui furent envoyés pour le convertir ; mais il
les fit mettre en prison et frapper de verges. Dieu leur donna un
troisième auxiliaire, dont le nom a soulevé des discussions ; le
plus grand nombre des auteurs cite un apôtre nommé Botros
(Petrus) en latin, Siman en arabe, et en syriaque Chimoun
alsefa (![]() ).
).
Plusieurs auteurs cependant, d'accord avec toutes les sectes chrétiennes, disent que ce troisième apôtre était Paul, et que les deux autres qui furent jetés en prison étaient Thomas et Pierre. Ils demeurèrent longtemps auprès de ce roi et prouvèrent leur mission par des miracles, en guérissant des aveugles et des lépreux, et en ressuscitant des morts. Paul, ayant obtenu un libre accès auprès de ce roi et capté sa faveur, fit mettre en liberté ses deux compagnons.
Habib le charpentier vint ensuite et crut aux apôtres en voyant leurs miracles. Dieu a raconté cette histoire dans son livre, au verset : «Nous leur avons envoyé deux hommes, et ils les traitèrent d'imposteurs ; nous leur donnâmes l'appui d'un troisième, etc. » jusqu'aux mots « Un homme vint en toute hâte. » (Kor. xxxvi, 13, 19.) Pierre et Paul périrent à Rome, où ils furent crucifiés la tête en bas, après avoir eu de longs rapports avec le roi et Simon (Sima) le magicien. Quand le christianisme eut triomphé, leurs reliques furent mises dans des châsses de cristal, que l’on conserve dans une église de Rome. En parlant des curiosités de cette ville dans notre Histoire moyenne, nous avons donné ces détails ainsi que l'histoire des disciples du Messie et de leur dispersion en différents pays. Nous reviendrons encore sur ce sujet.
Pendant cette ère d'Intervalle vécurent aussi « les hommes de la fosse, » qui habitaient Nedjran, dans le Yémen, sous le règne de Dou-Nowas, le même qui fit périr Dou-Chenatir. Ce roi, qui professait le judaïsme, apprenant qu'il y avait à Nedjran des sectateurs du Messie, se rendit lui-même dans cette ville, fit creuser des fosses, qu'il remplit de charbons ardents, et ordonna aux habitants d'embrasser le judaïsme ; il relâcha ceux qui obéirent et fit jeter les récalcitrants dans le feu. On amena une femme avec son enfant âgé de sept mois, et elle refusa d'abjurer sa religion. Lorsqu'on l'approcha du feu elle fut saisie d'effroi ; mais Dieu donna la parole à l'enfant, qui s'écria : « Ma mère, persévère dans ta religion, car après ce feu il n'y en aura pas d'autre. » Ils périrent ensemble dans les flammes : c'étaient des croyants monothéistes et non des chrétiens (trinitaires), comme ceux de notre siècle. Un homme de la même nation, nommé Dou Tâleban, alla invoquer le secours de César, roi de Boum (Byzance) ; l'empereur écrivit au Nedjachi (roi d'Abyssinie), dont le pays était plus voisin du Yémen. On trouvera dans nos Annales historiques et dans l'Histoire moyenne le récit de l'invasion et de la conquête du Yémen par les Abyssiniens, jusqu'à l'époque où Seïf Dou Yezen invoqua l'appui de plusieurs rois, et obtint celui d'Anouchirwan ; nous y reviendrons en outre en temps opportun en parlant des Dons et des rois du Yémen (voy. chap. xliii). Dieu a raconté dans son livre l'aventure des hommes du fossé, au verset, «Les hommes du fossé ont été tués, etc. » jusqu'aux mots : « le Puissant, le Glorieux » (Koran, lxxxv, 4, 8).
Parmi les personnages de l'Intervalle on cite encore Khaled, fils de Sinan el-Absi, ou bien Khaled, fils de Sinan, fils de Gert, fils d'Abs, désigné par ces paroles de Mohammed : « C'est un prophète que sa nation a perdu. » Voici son histoire : le culte du feu s'était introduit chez les Arabes, et se propageait à la faveur des troubles religieux, au point que ce peuple était à la veille de se soumettre à l'idolâtrie des Mages. Khaled, un bâton à la main, se jeta dans les flammes en s'écriant : « La voila, la voilà, la route qui conduit vers le Dieu suprême ! Certes, je pénétrerai dans ce brasier ardent et j'en sortirai les vêtements humides de rosée. » En effet, il éteignit le feu. Sur le point de mourir, il dit à ses frères : « Lorsque je serai enterré, un troupeau d'ânes sauvages, conduit par un onagre sans queue, viendra frapper ma tombe de son pied ; dès que vous serez témoins de ce fait, ouvres ma tombe, j'en sortirai et je vous instruirai de tout ce qui existe. » Après que Khaled fut enterré, ses compagnons virent s'accomplir ce qu'il avait prédit, et voulurent exhumer son corps ; mais quelques-uns d'entre eux s'y opposèrent, dans la crainte que les Arabes ne leur reprochassent d'avoir profané le tombeau d'un de leurs morts. Plus tard, la fille de Khaled vint trouver le prophète de Dieu, au moment où il récitait : « Dis, il est le Dieu unique, le Dieu éternel. » (Koran, cxii, 1, 2), et elle s'écria : « Mon père prononçait les mêmes paroles. » Dans le courant de notre récit nous aurons encore l'occasion de revenir sur ce personnage.
Riab ech-Channi, de la tribu d'Abd Kais et de la branche de Chann, vécut aussi dans l'ère d'Intervalle ; il suivait la religion du Messie Jésus, fils de Marie, avant la venue du prophète de Dieu. On entendit, antérieurement à la prédication de l'islam, une voix qui criait dans le ciel : « Les meilleurs des hommes sont au nombre de trois : Riab ech-Channi, Bohaira, le moine, et un autre qui n'est pas encore venu », c'est-à-dire le Prophète. Jamais un des enfants de Riab n'est mort sans que la rosée ait rafraîchi sa tombe.
Citons aussi Açàd Abou Kerb, l'Himiarite, vrai croyant, qui proclama le Prophète sept siècles avant sa venue ; il dit :
J'atteste qu'Ahmed (Mohammed) est l'envoyé de Dieu créateur de la vie ;
Si je pouvais vivre jusqu'à son siècle, je serais son vizir et son cousin.
Ce fut Açâd qui, le premier, revêtit la Kâbah de tapis et d'étoffes précieuses ; c'est ce qui a fait dire à un Hi-miarite :
Nous avons couvert le temple que Dieu a consacré de tapis ornés de broderies et de franges.
Parmi les hommes de l'Intervalle vécut Koss, fils de Saïdah, descendant d'Yad, fils d'Odd, fils de Mâdd, et juge des Arabes. Il croyait en la résurrection, et disait sans cesse :
« Quiconque vit, doit mourir ; celui qui meurt, passe ; tout ce qui doit venir, viendra. » Sa sagesse et sa science sont proverbiales chez les Arabes ; c'est ce qui a fait dire à el-Acha :
Plus sage que Koss, plus fougueux que celui (le lion) qui veille au fond de sa tanière dans le fourré du bois de Haffan.
Lorsque les délégués du peuple d'Yad se rendirent auprès du Prophète, il s'informa de Koss, et dit en apprenant sa mort : « Que Dieu lui fasse miséricorde ! Je crois encore le voir à la foire d'Okaz, monté sur son chameau roux, et disant à la foule : Hommes, réunissez-vous, écoutez et retenez ceci : « Quiconque vit doit mourir ; celui qui meurt, passe, tout ce qui doit venir, viendra. Le ciel est plein d'enseignements et la terre d'exhortations ; voyez la mer se gonfler, les astres disparaître, le firmament s'étendre comme une toiture, et la terre comme un lit. J'en atteste le Dieu de Koss, la-religion de ce Dieu vaut mieux que la vôtre. Pourquoi les hommes partent-ils et ne reviennent-ils plus ? Soit qu'ils obtiennent de rester, soit qu'on les abandonne au sommeil, ils suivent la même route, et ne diffèrent que par leurs actes. Quant aux vers de Koss (ajouta le Prophète), je les ai oubliés. » — Abou Bekr, le juste, se leva et dit : « Envoyé de Dieu, ces vers, je les sais. — Eh bien ! récite-les, dit le Prophète. » Abou Bekr reprit :
Dans ces premières générations qui ont disparu, quelle leçon pour nous !
Quand je vois que tout aboutit sans retour à la mort ;
Que, petits et grands, tout mon peuple suit cette route ;
Que l'absent ne revient plus, et que celui qui demeure passera soudain,
Je suis sûr que, moi aussi, je rejoindrai infailliblement mon peuple.
Le Prophète dit alors : « Que Dieu ait pitié de Koss ! je souhaite que le Seigneur le ressuscite comme une seule nation ! » —-Maçoudi ajoute : On attribue à Koss un grand nombre de poésies, de sentences et d'anecdotes relatives à la médecine, à la divination par le vol des oiseaux et d'autres pronostics, etc. dont nous avons parlé dans nos Annales historiques et dans l'Histoire moyenne.
Un autre personnage de l'ère d’intervalle est Zeïd, fils d'Amr, fils de Nofeïl, le père de Saïd, fils de Zeïd, et l’on des dix (Zeïd), cousin germain d'Omar, fils d’el-Khattab. Ce Zeïd réprouva le culte des idoles, mais son oncle el-Khattab excita contre lui la populace de la Mecque et le leur livra. Cette persécution l'obligea à se réfugier dans une caverne du mont Hira, d'où il se rendait secrètement à la Mecque. Puis il passa en Syrie pour faire des recherches sur la vraie religion, et il y mourut empoisonné par les chrétiens. Ses rapports avec le roi et l'interprète, et avec un des rois Gassanides de Damas, forment un long récit que nous avons rapporté dans nos précédents écrits.
On cite encore Omayah, fils d'Abou's-Salt et-Takefi, poète intelligent, qui faisait le commerce avec la Syrie ; il fréquenta le clergé juif et chrétien, étudia les livres saints et reconnut qu'on prophète serait envoyé aux Arabes. Dans ses poésies, il suit les doctrines de la vraie religion ; il décrit les deux et la terre, le soleil, la Inné, les anges et les prophètes ; il chante la résurrection, le paradis, l'enfer, et célèbre l'unité de Dieu, comme dans ce vers :
Louanges à Dieu, qui n'a pas d'égal ; ne pas proclamer cette vérité, c'est être injuste envers soi-même ;
et dans cet autre, où il parle des élus :
Là plus d'erreur, plus de faute ; le bonheur qui leur est promis est éternel.
L’annonce de l'apparition de notre saint Prophète lui inspira autant de colère que de chagrin ; il se rendit à Médine pour se faire musulman ; mais la jalousie Yen détourna, et il revint à Taïf. Un jour qu'il était à boire avec quelques jeunes gens, un corbeau s'abattit près de lui, croassa trois fois, et s'envola. « Savez-vous ce que dit cet oiseau ? demanda Omayah à ses compagnons. — Non, répondirent-ils. — Il dit qu'Omayah ne boira pas une troisième coupe sans mourir. — Prouvons qu'il a menti, s'écrièrent les jeunes gens. »
Omayah fit promptement remplir les coupes ; à la troisième rasade il tomba et resta longtemps sans connaissance ; pois il revint à lui et dit : « J'obéis, j'obéis, me voici auprès de vous ; moi que la grâce environnait, je ne l’ai pas payée de mes remerciements :
« Situ pardonnes, ô mon Dieu ! puisse ton pardon être complet Est-il un de tes serviteurs qui soit sans tache ? »
Il répéta encore : « Moi que la grâce avait comblé, j'ai négligé d'en témoigner ma reconnaissance, » et il ajouta ces vers :
Jour du jugement, jour terrible, où l’enfant vieillira soudain d'une rapide vieillesse !
Que ne puis-je échanger mon sort contre celui du berger qui fait paître ses chèvres agrestes au sommet des montagnes !
Toute vie, quelle que soit sa durée, aboutit au terme où elle doit finir ?
Pais il rendit le dernier soupir dans un râle suprême. Plusieurs écrivains qui connaissent bien les hommes et les événements du passé, tels que : Ibn Dab, el-Heitem, fils d'Adi ; Abou Mikhnef Lout, fils de Yahia, et Mohammed, fils de Saïb el-Keibi, expliquent de la manière suivante l’habitude qu'avaient les Koraïchites d'inscrire en tête de leurs écrits la formule : En ton nom, ô mon Dieu ! Omayah, fils d'Abou's-Salt et-Takefi fit un voyage en Syrie avec des gens de Takef, de Koreïsch et d'autres tribus. Au retour» leur caravane s'arrêta dans une certaine station pour y prendre les repas du soir, lorsqu’un petit serpent se montra et s'approcha de la troupe ; mais, atteint à la tête par dot gravier qu'on lui jeta, il rebroussa chemin. Le repas terminé, les voyageurs rattachèrent leur bagage sur tes chameaux et quittèrent cette station. Ils n'en étaient qu'à une petite distance, quand une vieille femme, appuyée sur un bâton, apparut sur un tertre de sable et leur dit : « Qui vous a empêchés de donner à manger à l’animal, la pauvre servante qui est venue vous trouver ce soir ? — Qui es-tu toi-même ? lui demandèrent les voyageurs. —Je suis la mère du reptile, veuve depuis des années. Mais vous, par le Dieu qu'on adore, vous serez dispersés sur la terre ! » Puis elle frappa le sol de son bâton, et en souleva la poussière en disant : « Diffère leur retour et dissémine leurs montures. » Aussitôt les chameaux bondirent comme si chacun d'eux portait un diable sur sa bosse ; rien ne put les retenir, et ils se dispersèrent dans la vallée. Noos passâmes toute la nuit (disent ces voyageurs) à les réunir avec la plus grande difficulté, et nous les faisions agenouiller pour les charger, quand la vieille se montra encore, fit le même manège avec son bâton, et répéta les mêmes paroles : « Diffère leur retour et dissémine leurs montures. » Les chameaux rompirent aussitôt leurs freins et s'enfuirent. Après les avoir réunis à grand-peine pour le lendemain, nous les fîmes agenouiller, mais la vieille nous apparut une troisième fois, et, avec une conjuration semblable à celle des deux jours précédents, elle dispersa nos bêtes. Nous veillâmes cette nuit à la clarté de la lune et en désespérant de les retrouver. Nous demandâmes ensuite à Omayah, fils d'Abou’s-Salt : « Que nous disais-tu donc de la science ? » Omayah se rendit sur la colline où la vieille s'était montrée à nous, et descendit de l'autre côté ; il franchit une seconde colline, et aperçut devant lui une église éclairée par des lampes ; sur le seuil était un homme dont la chevelure et la barbe étaient blanches. Je m'arrêtai près de lui, raconte Omayah, il leva la tête et me dit : « Tu es un chef de secte ? — Oui, répondis-je. — Par où ton Seigneur se révèle-t-il à toi ? — Par mon oreille gauche. — Et quel vêtement t'ordonne-t-il ? — Le noir. — Ainsi font les génies, reprit-il, toi tu as failli être prophète ; mais le possesseur de la prophétie recevra l'inspiration par l'oreille droite, et préférera les vêtements blancs. Enfin que désires-tu ? » Je lui racontai mon aventure avec la vieille femme, et il reprit : « Tu dis vrai, toi ; mais elle a menti. C'est une juive, dont le mari est mort depuis longtemps, et elle ne se lassera pas de répéter cette manœuvre pour vous perdre, si elle le peut. — A quel moyen recourir ? demanda Omayah. — Réunissez vos bêtes de somme, ajouta le vieillard, et quand la vieille recommencera ses sortilèges, dites sept fois à haute voix et sept fois à voix basse : « En ton nom, ô mon Dieu ! elle ne pourra plus vous nuire. » Omayah revint auprès de ses compagnons et leur communiqua ce qui lui avait été dit. En effet, la vieille revint et fit comme les jours précédents ; ils répétèrent alors sept fois tout haut et sept fois à demi-voix : « En ton nom, ô mon Dieu ! » et déjouèrent ses enchantements. Voyant que les chameaux demeuraient immobile», elle dit : « Je connais votre chef, le haut de son corps blanchira, et le reste sera noir. » On se mit en marche ; le lendemain matin, on vit que le» joues, le cou et la poitrine d'Omayah étaient blanchis par la lèpre, tandis que la partie inférieure de son corps était noire. Arrivés à la Mecque, ils racontèrent cette aventure, et ce fut alors que les Mecquois adoptèrent la formule en question, jusqu'à la venue de l'Islam. A cette époque elle fut abolie et remplacée par celle-ci : « Au nom du Dieu clément et miséricordieux ! » Les autres récits concernant Omayah se retrouvent dans nos Annales historiques et nos ouvrages précédents.
Un autre personnage de l'Intervalle fut Warakah, fils de Nawfel, fila d'Açad, fils d'Abd el-Ozza, fils de Koçayi, cousin germain de Khadidjah, fille de Khowailed et femme du Prophète. Il avait lu les Écritures, recherché la science et rejeté le culte des idoles. Il annonça à Khadidjah la venue du Prophète dans cette nation, les persécutions et l'incrédulité qui devaient l'accueillir. Plus tard il rencontra le Prophète et lui dit : « Fils de mon frère, persévère dans tes desseins ; j'en atteste celui qui tient rame de Warakah entre ses mains, tu es le prophète de cette nation ; tu seras persécuté, traité de menteur, chassé et combattu. Puissé-je voir ce jour, et Dieu sait si je soutiendrai sa cause. » Cependant la croyance de Warakah a soulevé des doutes ; les uns croient qu'il mourut chrétien avant la venue du Prophète et dans l'impossibilité de se convertir ; d'autres le font mourir musulman, et citent ces vers, qu'il aurait composés en l'honneur du Prophète :
Plein d'indulgence et de pardon, il ne rend jamais le mal qu'on lui fait ; il réprime sa colère et son ressentiment quand on l'insulte.
On cite encore Odaçah, affranchi d'Otbah, fils de Bebiâh et originaire de Ninive. Il vit le Prophète à Taïf, lorsque celui-ci était venu prêcher la foi aux habitants. Odaçah eut de longs démêlés avec eux dans le verger, et périt dans la foi chrétienne, à la bataille de Bedr ; il fut pourtant du nombre de ceux qui annoncèrent la venue du Prophète.
Abou Kaïs Sormah, fils d'Abou Anas, l'Ansarien, de la famille des Benou-Nadjar, vécut aussi dans l'Intervalle. Il s'était adonné à la vie ascétique, avait revêtu le cilice et renié les idoles. Il s'était fait une mosquée de la maison qu'il habitait et personne ne pouvait y pénétrer en état d'impureté légale ; il professait hautement le culte du Dieu d'Abraham. Après l'entrée du Prophète à Médine, il se fit musulman, et se signala par sa piété ; c'est pour lui que fut révélé le verset sur la collation avant le jour : « Mangez et buvez jusqu'à ce qu'à la lueur de l'aurore vous puissiez distinguer un fil blanc d'un fil noir. » (Koran, ii, 183.) On cite ces vers d'Abou Kaïs sur le Prophète :
Il a fait plus de dû pèlerinages à la Mecque, au milieu des Koraïchites. Que n'a-t-il rencontré un ami dévoué ?
Tel est aussi Abou Amir el-Awsi, dont le vrai nom est Abd Amr, fils de Seifi, fils de Noman, de la famille des Béni Amr ben Awf, de la tribu d'Aws ; il est connu aussi sous le nom d’Abou Hanzalah, et le sobriquet de Gaçil el-Melaïkeh. Ce seïd se fit moine au temps du paganisme, et revêtit le cilice. Il eut un long entretien avec le Prophète, après son entrée à Médine ; puis il quitta cette ville avec cinquante jeunes gens, et mourut dans la foi chrétienne, en Syrie.
A la même ère appartient Abd Allah, fils de Djahch el-Açedi, de la famille des Béni Açed ben Khozaimah. Il était marié avec Oumm Habibah, fille d'Abou Soûan ben Harb, avant qu'elle fût unie au Prophète. Abd Allah connaissait les Écritures et inclinait vers le christianisme ; mais après la vocation du Prophète il émigra en Abyssinie avec d'autres musulmans et sa femme Oumm Habibah. Il abandonna l'islam pour se faire chrétien, et mourut dans ce pays. C'est lui qui disait aux musulmans : « Nous avons les yeux ouverts, mais vous, vous remuez à peine vos paupières, » c'est-à-dire, nous voyons clair et vous cherchez la lumière. Cette expression, qu'il employait comme un proverbe, s'applique à un jeune chien qui ouvre les yeux (fakah) après sa naissance, ou qui cherche vainement à les ouvrir (sa’sa’). Après la mort d'Abd Allah, le Nedjachi unit Oumm Habibah au Prophète, avec une dot de quatre cents dinars.
Un des personnages de l'Intervalle fut, enfin, Bohaira le moine. C'était un chrétien zélé, dont le nom, dans les livres chrétiens, est Serdjes (Sergius), et il descendait des Abd el-Kaïs. Lorsque le Prophète, âgé de douze ans, se rendit en Syrie pour une affaire commerciale avec son oncle Abou Taleb, accompagné d'Abou Bekr et de Belal, ils passèrent devant la cellule où vivait Bohaira. Celui-ci reconnut le Prophète à ses traits et à certains signes particuliers, tels que fies livres le lui avaient révélé ; il vit le nuage qui l'ombrageait quand il s'asseyait. Il fit descendre ces voyageurs chez lui, les reçut avec honneur et leur prépara un repas. Il sortit de sa cellule pour reconnaître le sceau de la prophétie entre les épaules du Prophète, posa la main sur ce signe, et crut à sa mission. Il révéla ensuite à Abou Bekr et à Belal ce qui devait arriver à Mohammed, qu'il pria de renoncer à ce voyage, en mettant ses parents en garde contre les tentatives des juifs et des chrétiens. Abou Taleb, l'oncle du Prophète, averti de ce danger, ramena son neveu. C'est à la suite de ce voyage que commence l'histoire du Prophète avec Khadidjah, et que celle-ci fut éclairée par les révélations que Dieu lui envoya, et par la narration qui lui fut faite de ce voyage.
Tel est le récit abrégé de la création du monde jusqu'à l'époque où nous sommes parvenus ; nous n'avons rien pris en dehors des faits révélés par la religion et les livres saints, ou expliqués par les prophètes. Nous allons examiner les origines des royaumes de l’Inde, et étudier rapidement leurs croyances ; puis nous passerons en revue les autres pays, comme nous l'avons fait pour les rois israélites, d'après les sources que nous offraient les Écritures. Puisse Dieu nous venir en aide !
Parmi les hommes d'observation et de science qui ont étudié avec attention la nature de ce monde et son origine, plusieurs s'accordent à dire que l’Inde fut, dans les âges reculés, la portion de la terre où régnaient l'ordre et la sagesse. Lorsque les sociétés et les nations se formèrent, les Indiens cherchèrent à donner de l'unité à leur pays, et à le soumettre à une métropole qui serait le centre de l'autorité. Leurs chefs dirent : « Nous sommes le peuple primitif, en nous est la fin et la limite des choses, le principe et le terme ; le père de l'humanité tire de nous son origine. Ne souffrons donc ni la révolte, ni la désobéissance, ni les mauvais desseins ; marchons contre les rebelles ; réduisons-les, et faisons-leur accepter notre puissance. Pour atteindre ce but, ils se donnèrent un roi, Brahman le Grand, leur puissant monarque et leur chef absolu. La sagesse fleurit sous son règne, et les savants occupèrent le premier rang. On apprit à extraire le fer de la mine, à forger des épées, des poignards et diverses armes de guerre ; on éleva des temples et on les orna de pierreries étincelantes. On y retraça les sphères, les douze signes du zodiaque et les astres. La peinture reproduisit l'image du monde et représenta l'action des astres sur ce monde et la manière dont ils produisent les corps animés, doués ou non d'intelligence. Brahman expliqua aussi la nature du moteur suprême, c'est-à-dire du soleil ; il réunit toutes les preuves de ce système dans un livre destiné à être compris du vulgaire, et communiqua aux intelligences d'élite des vérités d'un ordre plus élevé, en leur montrant une cause première qui donne à tout l'existence, et qui pénètre tout de sa bonté. Les Indiens se soumirent à ce roi, leur pays devint florissant et ils acquirent l'expérience pratique de la vie. Un congrès de sages, réuni par ordre du roi, composa le livre de Sindhind (Siddhanta), ce qui signifie « l'âge des âges. » Ce livre servit de base à la composition de l’Ardjabehd (Aryabhatta) et de l’Almageste ; de même que l'Ardjabehd donna naissance à l'Arkend, et l’Almageste au livre de Ptolémée, et plus tard aux Tables astronomiques. Ils inventèrent aussi les neuf chiffres qui forment le système numérique indien. Brahman définit le premier l'apogée du soleil, et démontra que cet astre reste trois mille ans dans chaque signe du zodiaque, et qu'il parcourt la sphère entière en trente-six mille ans. Aujourd'hui (332 de l'hégire) l'apogée, au dire des Brahmines, est dans le signe des Gémeaux ; mais quand le soleil aura passé dans les signes de l'hémisphère austral, la face de la terre changera, la portion habitée deviendra déserte, et réciproquement ; le nord prendra la place du sud, et le sud celle du nord. Ce roi déposa dans la maison d’or (à Moultan) les calculs relatifs à l'origine des choses et à l'histoire primitive, sur lesquels les Indiens se fondent pour évaluer les ères anciennes, étude qui s'est plus développée chez eux que chez tout autre peuple. Nous ne les suivrons pas dans ces longues théories, parce que notre livre est consacré à l’histoire et non aux recherches philosophiques ; on en trouve d'ailleurs un résumé dans notre Histoire moyenne.
Quelques Indiens croient que le monde se renouvelle à chaque Hazarwan, c'est-à-dire tous les soixante et dix mille ans ; et que, cette période écoulée, les êtres revivent, les générations renaissent, les animaux se raniment, l'eau reprend son cours, la terre se couvre de reptiles, la verdure pare le sol, et un doux zéphyr rafraîchit l'atmosphère. Mais la plupart adoptent des cycles périodiques, point de départ des forces ; ces cycles vont en décroissant, bien qu'ils aient la même force, et qu'ils conservent leur puissance d'action et leur essence. Les Indiens assignent une période et un terme précis à leur développement ; c'est ce qu'ils considèrent comme le cycle principal ou la grande révolution, et ils nomment ce système la vie du monde. Le temps qui s'écoule entre la naissance et la fin de cette période est, selon eux, de trente-six mille ans, multipliés par douze mille, et c'est ce qu'ils appellent Hazarwan, foyer et moteur des forces universelles. Les cycles resserrent ou élargissent tous les principes qu'ils contiennent. Ainsi la durée de la vie est plus grande dans le premier, parce que la circonférence est plus grande, et que les forces ont le champ plus libre ; au contraire elle diminue dans le dernier cycle, parce que ce cycle est plus étroit, et que les périodes antérieures exercent une pression fatale à la vie. En voici la raison : dans la première période, les forces physiques naissent et se développent dans toute leur pureté, attendu que la pureté précède le trouble, et l'unité devance le mélange ; la vie est donc proportionnée à la pureté de son tempérament et à la perfection des forces auxquelles sont soumises la naissance, les transformations, la corruption et la ruine des éléments. De même, à la fin du grand cycle ou de la période principale, la forme s'altère, la vie dépérit, les tempéraments se mélangent, les forces diminuent, les liens se relâchent, et, la matière se trouvant comprimée dans des cercles étroits et renversés, la vie ne peut plus atteindre à son complet développement.
Les Indiens soutiennent, par une foule de preuves et d'arguments, ce système de l'origine des choses que nous venons d'exposer. A cette succession de cycles et de Hazarwans, telle que nous l'avons développée, ils rattachent de mystérieuses subtilités sur l'âme, sur ses rapports avec le monde métaphysique, sa tendance à descendre des hauteurs de son origine, et d'autres théories établies par Brahman au premier âge du monde.
Brahman mourut après un règne de trois cent soixante-six ans. Ses descendants ont conservé jusqu'à nos jours le nom de brahmines ; ils sont honorés par les Indiens comme formant la caste la plus noble et la, plus illustre. Ils ne mangent de la chair d'aucun animal, et ils portent, hommes et femmes, des fils jaunes suspendus autour du cou comme des baudriers d'épée, pour se distinguer des autres castes de l’Inde.
Dans les temps anciens, sous le règne de Brahman, sept des plus sages et des plus considérés d'entre eux s'assemblèrent dans la maison d'or (à Moultan), et se dirent les uns aux autres : « Réunissons nos recherches pour découvrir l'état et le secret du monde, pour savoir d'où nous venons et où nous allons ; si la cause qui nous a tirés du néant est sagesse ou folie ; si le Créateur, qui est l'auteur de notre existence, et qui la développe, en retire un avantage, ou bien s'il écarte un danger de sa personne, en nous faisant disparaître de ce monde. Sachons s'il ressent comme nous des besoins et des privations, ou s'il se suffit sous tous les rapports, et pourquoi, après nous avoir donné l’être et la vie, il nous fait rentrer dans la mort et le néant ? Le premier sage, qui était le plus respecté parmi eux, dit : « Quel est l'homme qui a jamais pu arriver à la science réelle des choses visibles et occultes, en arracher le secret et se reposer sur une conviction certaine ? » Le second sage dit : « Si l'intelligence humaine pouvait embrasser la sagesse divine, ce serait un défaut dans cette sagesse. Non, ce but est hors de notre portée, et notre raison est trop bornée pour l'atteindre. » Le troisième sage dit : « Notre premier devoir, avant de rechercher ce qui est hors de nous, est de nous appliquer à nous connaître nous-mêmes, puisque rien ne nous touche de plus près, et que nous sommes faits pour cette étude comme elle est faite pour nous. » Le quatrième reprit : « Malheur à celui qui se trouve dans une situation ou il ait besoin de se connaître lui-même. De là, dit le cinquième, le devoir pour nous de nous attacher aux sages qui ont la science pour auxiliaire. » Le sixième ajouta : « Celui qui recherche la félicité doit y consacrer tous ses efforts, puisque nous ne pouvons demeurer dans ce monde, et qu'il est certain que nous en sortirons. » Le septième dit enfin : « J'ignore ce que vous voulez dire ; tout ce que je sais, c'est que je suis entré dans ce monde malgré moi, que j'y vis dans la stupeur et que j'en sortirai de force. »
Ces diverses doctrines ont divisé les Indiens de tous les siècles ; chacun a suivi et complété l’une d'elles ; puis les écoles, en se multipliant, ont accru les divergences d'opinions, et l'on ne compte pas moins de soixante et dix sectes dans ce pays.
Abou'l-Kaçem, de Balkh, dans son livre intitulé Sources de questions et de réponses, et el-Haçan, fils de Mouça, en-Noubakhti, dans son ouvrage nommé Livre des opinions et des croyances, parlent l'un et l'autre des sectes et des théories de l’Inde ; des motifs qui portent le peuple à périr dans les flammes, ou à s'infliger toutes sortes de tourments ; mais ils ne disent rien de ce que nous avons rapporté, et passent sous silence tout ce qui précède.
On n'est pas d'accord sur Brahman : les uns prétendent que c'était Adam et un prophète envoyé par Dieu aux Indiens ; les autres ne le considèrent que comme un roi, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Cette dernière opinion est la plus répandue.
A la mort de Brahman, les Indiens témoignèrent la plus vive douleur ; puis ils donnèrent la couronne à son fils aîné, el-Bahboud, déjà désigné par Brahman comme son successeur et son héritier. Fidèle imitateur de son père, il protégea ses sujets, bâtit un grand nombre de temples, honora les sages et les encouragea par des distinctions et des récompenses dans l'étude et la recherche de la sagesse. Il mourut après avoir régné cent ans. C'est à cette époque qu'on inventa le trictrac (nerd) et les règles de ce jeu. C'était une sorte d'emblème des biens de ce monde, qui ne sont pas la récompense de l'intelligence ni du savoir-faire, de même que la richesse n'est pas acquise à l'habileté. On a fait honneur aussi à Ardeschir, fils de Babek, de l'invention et de la découverte de ce jeu, qui lui fut suggéré par le spectacle des vicissitudes et des caprices de la fortune. Il divisa la table, en douze cases, d'après le nombre des mois, et il établit trente chiens (dames), selon les jours du mois. Les deux des représentent la destinée et son action capricieuse sur les hommes. Le joueur, si le sort le favorise, obtient, en jouant, ce qu'il désire ; au contraire, l'homme habile et prudent ne peut réussir à gagner ce qu'une chance heureuse a donné à son adversaire. C'est ainsi que les biens de ce monde sont dus à un hasard fortuné.
Le successeur d'el-Bahboud fut Zaman (Ramah ?), qui régna près de cinquante ans. Les principaux faits de ce règne, et ses guerres avec les rois de Perse et de Chine sont résumés dans nos précédents ouvrages.
Il eut pour successeur Por (Porus), qui livra bataillé à Alexandre et fut tué par ce prince dans un combat singulier ; il avait régné cent quarante ans.
Après lui régna Dabchelim, l'auteur du livre de Kalilah et Dimnah, traduit en arabe par Ibn el-Mokaffa. Sehi, fils de Haroun, a aussi composé pour el-Mamoun un livre intitulé Tâlah et Afrâh, analogue, par son plan et la nature de ses fables, au livre de Kalilah et Dimnah, mais supérieur à celui-ci par l'élégance du style. Le règne de Dabchelim fut de cent dix ans ; mais on n'est pas d'accord à cet égard.
Après lui régna Balhit. On inventa, à cette époque, le jeu d'échecs, auquel ce roi donna la préférence sur le trictrac, en démontrant que l'habileté l'emporte toujours dans ce jeu sur l'ignorance. Il fit des calculs mathématiques sur les échecs, et composa, à ce sujet, un livre nommé Tarak-Djenka, qui est resté populaire chez les Indiens. Il jouait souvent aux échecs avec les sages de sa cour, et ce fut lui qui donna aux pièces des figures d'hommes et d'animaux, leur assigna des grades et des rangs, assimila le roi (Chah) au chef qui dirige, et ainsi de suite des autres pièces. Il fit aussi de ce jeu une sorte d'allégorie des corps élevés, c'est-à-dire des corps célestes, tels que les sept planètes et les douze signes du zodiaque, et consacra chaque pièce à un astre. L'échiquier devint une école de gouvernement et de défense ; c'était lui que l'on consultait en temps de guerre, quand il fallait recourir aux stratagèmes militaires, pour étudier la marche plus ou moins rapide des troupes. Les Indiens donnent un sens mystérieux au redoublement des cases de l'échiquier ; ils établissent un rapport entre cette cause première, qui plane au-dessus des sphères et à laquelle tout aboutit, et la somme du carré de ces cases. Ce nombre est égal à 18, 446, 740, 773, 707, 551, 615, où se trouvent six fois mille après les chiffres de la première série, cinq fois mille après ceux de la seconde, quatre fois mille après ceux de la troisième, trois fois mille après ceux de la quatrième, deux fois mille après ceux de la cinquième, et une fois mille après ceux de la sixième. Les Indiens expliquent par ces calculs la marche du temps et des siècles, les influences supérieures qui s'exercent sur ce monde, et les liens qui les rattachent à rame humaine. Les Grecs, les Romains et d'autres peuples ont des théories et des méthodes particulières sur ce jeu, comme on peut le voir dans les traités des joueurs d'échecs, depuis les plus anciens jusqu'à es-Souli et el-Adli, les deux joueurs les plus habiles de notre époque. Le règne de Balhit, jusqu'à sa mort, dura quatre-vingts ans, ou, selon d'autres manuscrits, cent trente ans.
Korech (Harcha ?), son successeur, abandonnant les doctrines du passé, introduisit dans l'Inde de nouvelles idées religieuses, plus conformes aux besoins de son époque et aux tendances de ses contemporains. Sous son règne vivait Sindbad, auteur du Livre de sept Vizirs, du Maître, du Jeune homme et de la Femme du roi ; c'est le livre intitulé Kitab Sindbad. On composa aussi dans la bibliothèque de Korech un Grand traité de pathologie et de thérapeutique, avec des figures et des dessins de diverses plantes. Ce roi mourut après un règne de cent vingt ans.
A sa mort, la discorde s'éleva parmi les Indiens ; ils se divisèrent en plusieurs nations et tribus, et chaque contrée eut un chef particulier. C’est ainsi que se formèrent les royaumes de Sind, de Kanoudj, de Kachmir ; la ville de Mankir, qui était le grand centre de l'Inde, se soumit à un roi nommé le Balhara, et le nom de ce premier roi est resté à tous ses successeurs qui ont régné dans cette capitale jusqu'à ce jour (332 de l'hégire).
L'Inde est un vaste pays qui s'étend sur la mer, le continent et au milieu des montagnes ; ce royaume est limitrophe de celai de Zabedj, qui est l'empire du Maharadja, roi des îles. Le Zabedj, qui sépare la Chine de l'Inde, est compris dans cette dernière contrée. Du côté des montagnes, l’Inde a pour limite le Khoraçan et le Sind, jusqu'au Tibet
Ces royaumes sont continuellement en guerre, et diffèrent autant par leur langue que par leurs croyances. La plupart de ces peuples croient à la métempsycose ou transmigration des âmes, comme nous l'avons dit un peu plus haut. Mais par leur intelligence, leur gouvernement, leur philosophie, par leur robuste constitution, autant que par la pureté de leur teint, les Indiens diffèrent de toutes les races nègres, telles que les Zendjis, les Demdemès, etc. Galien signale dix propriétés particulières aux noirs, à savoir : les cheveux crépus, les sourcils rares, les narines dilatées, les lèvres épaisses, les dents aiguës, la puanteur de la peau, la noirceur du teint, la longueur des pieds et des mains, le développement des parties génitales et une pétulance excessive. Cet auteur explique cette dernière qualité chez le noir par l'organisation imparfaite de son cerveau, d'où résulte la faiblesse de son intelligence. La vivacité du nègre, l'empire que prend sur lui la joie, et la pétulance extraordinaire qui distingue les Zendjis parmi toutes les races noires, ont inspiré à d'autres auteurs des observations que nous avons insérées dans nos ouvrages précédents.
Yakoub, fils d'Ishak el-Kendi, dans un de ses traités, relatif à l'action des corps élevés et des sphères célestes sur notre monde, ajoute : « Dieu a établi un enchaînement de causes dans toutes les parties de la création ; la cause exerce sur la créature qui la subit une influence qui la rend cause à son tour ; mais cette créature purement subjective ne peut pas réagir sur sa cause ou son agent. Or, l'âme étant la cause et non pas l'effet de la sphère, la sphère ne peut réagir sur l'âme ; mais il est dans la nature de l'âme de suivre le tempérament du corps, tant qu'elle ne rencontre pas d'obstacle, et c'est ce qui a lieu chez les Zendjis. Leur pays étant très chaud, les corps célestes y exercent leur influence et attirent les humeurs dans la partie supérieure du corps. De là les yeux à fleur de tête de ces peuples, leurs lèvres pendantes, leur nez aplati et gros, et le développement de la tête par suite de ce mouvement ascensionnel des humeurs. Le cerveau perd son équilibre, et l'âme ne peut plus exercer sur lui son action complète ; le vague des perceptions et l'absence de tout acte de l'intelligence en sont la conséquence. »
Les anciens comme les modernes ont discuté les causes de la conformation des noirs et de leur position par rapport à la sphère ; on a recherché si l'une des sept planètes, le soleil, la lune ou les cinq autres président à leurs actions, et ont une influence particulière sur leur naissance et leur développement physique. Mais notre ouvrage n'étant pas consacré à ce genre d'études, nous ne pouvons rapporter ce qui a été dit à cet égard ; le lecteur trouvera dans nos Annales historiques les théories et les arguments qui ont été proposés ; il y trouvera encore l'exposé du système de ces astronomes anciens et modernes qui ont placé les nègres sous l’action de Saturne. Telle est aussi l'opinion d'un poète et astrologue musulman contemporain, bien instruit de ce qui concerne les sphères :
Le doyen (de ces astres) est le sublime Saturne, vieillard majestueux, puissant monarque.
Son tempérament est noir et froid ; noir comme l'âme en proie au désespoir.
Son influence s'exerce sur les Zendjis et les esclaves, et aussi sur le plomb et le fer.
Taous el-Yemani, compagnon d'Abdallah, fils d'el-Abbas, ne touchait pas à la chair d'un animai tué par un Zendji, parce que, disait-il, le Zendji est un être hideux. J'ai entendu dire qu'Abou'l-Abbas er-Radi billah, fils d'el-Moktadir, n'acceptait rien de la main d'un noir, parce que c'était un esclave hideux. J'ignore s'il se conformait, en agissant ainsi, à la doctrine de Taous, ou s'il suivait quelque précepte philosophique particulièr. Amr, fils de Bahr el-Djahii a composé un livre Sur la supériorité des noirs, et leur lutte avec la race blanche.
Dans l'Inde un roi ne peut monter sur le trône avant quarante ans révolus ; il ne se montre Au peuple qu'à des époques déterminées, et seulement pour examiner les affaires de l'État ; car, dans leurs idées, un roi porterait atteinte à sa dignité et n'inspirerait plus le même respect s'il se montrait constamment au peuple. Le pouvoir ne se maintient chez eux que par le despotisme et le respect de la hiérarchie politique.
Voici ce que j'ai vu dans le pays de Serendib (Ceylan), île de la mer de l'Inde : quand un roi meurt, on l'expose sur un chariot bas, à petites roues, et destiné à cet usage, de manière à ce que les cheveux traînent par terre. Une femme, un balai à la main, jette de la poussière sur la tête du mort, en criant : « Peuple, voilà votre roi d'hier ! il était votre maître ; ses moindres volontés étaient obéies. Voyez-le maintenant ; il a quitté la terre, et son âme est entre les mains du roi des rois, le vivant, l'éternel, qui ne meurt pas ! Ne cédez donc pas aux illusions de la vie ! » Elle continue ainsi ses exhortations en faveur de la retraite et du détachement des biens de ce monde ; puis, après avoir promené le corps par toutes les rues de la ville, on le coupe en quatre morceaux, on le brûle sur un bûcher fait de bois de sandal, de camphre et d'autres parfums, et enfin on jette ses cendres au vent. Telles sont les cérémonies que presque tous les Indiens observent pour les rois et les grands, et ils croient ainsi suivre le but qu'ils se proposent dans l'avenir.
La royauté appartient exclusivement à la même famille, et ne passe jamais à une autre ; il existe de même une dynastie de vizirs, de kadis et d'autres fonctionnaires, qui tous sont inamovibles.
Les Indiens s'abstiennent de boire du vin, et blâment ceux qui en font usage, non que leur religion le défende, mais dans la crainte qu'il ne trouble leur raison et ne la prive de l'usage de ses facultés. Si un de leurs rois est convaincu d'en avoir bu, il mérite d'être destitué, car il doit lui être impossible de gouverner l'État quand sa raison est obscurcie. Ils aiment le chant et la musique, et ils ont divers instruments d'harmonie qui produisent sur l'homme des effets gradués, depuis le rire jusqu'aux larmes. Souvent ils font boire et danser devant eux des jeunes filles esclaves, afin de s'exciter à la joie par ce spectacle.
Les Indiens ont un grand nombre d'institutions que nous avons décrites, ainsi que leur histoire et leurs usages dans nos Annales historiques et notre Histoire moyenne ; nous n'en donnerons donc ici qu'une esquisse. Voici une anecdote intéressante pour l'étude de l'histoire et des mœurs des anciens rois de l'Inde et des rois de Komar (Comorin). C'est de ce pays qu'on exporte l'aloès, nommé pour cette raison aloès komari. Cette contrée n'est pas : une île, mais elle est située sur le bord de la mer, et couverte de montagnes. Peu de pays dans l'Inde ont une population plus nombreuse ; ses habitants se distinguent par la pureté de leur baleine, parce qu'ils font, comme les musulmans, usage du cure-dent. Ils ont aussi l'adultère en horreur, évitent tout acte impudique, et s'abstiennent de boissons spiritueuses ; dans cette dernière pratique, ils ne font d'ailleurs que se conformer à un usage général dans l'Inde. Leurs troupes se composent surtout d'infanterie, parce que leur pays renferme plus de montagnes et de vallées que de plaines et de plateaux. Il est sur le chemin des États du Maharadja, roi des îles de Zabedj (Java), de Kalah (Malaka ?), de Serendib (Ceylan), etc. On raconte donc qu'un roi jeune et irréfléchi régnait jadis dans le Komar. Un jour il était assis sur son trône, dans un château situé à un jour de marche de la mer, et qui dominait un grand fleuve d'eau douce comme le Tigre et l’Euphrate. Son ministre se tenait devant lui, et ils s'entretenaient du royaume riche et puissant du Maharadja, et du grand nombre d'îles qu'il possédait. Le roi dit alors : « Que je voudrais réaliser le projet que j'ai formé en moi-même ! — Quel est-il, sire ? demanda le vizir, homme sage qui connaissait la légèreté de son maître. — Je voudrais que la tête du Maharadja, roi de Zabedj, fût exposée sur un plat devant moi. » Le vizir, comprenant que la jalousie avait inspiré cette pensée-an roi et l'avait fomentée dans son cœur, lui dit : « Sire, je n'aurais pas cru que le roi s'entretînt dans de pareilles pensées. Jamais nous n'avons eu de différends avec cette nation, ni dans le passé ni aujourd'hui, et elle ne nous a donné aucun sujet de plainte ; en outre, elle habite des îles lointaines, fort éloignées de nos frontières, et elle n'a aucune vue de conquête sur notre pays. (En effet, une distance de dix à vingt jours de navigation sépare le royaume de Komar de celui du Maharadja.). Il vaut donc mieux, sire, ajouta le vizir, que personne n'ait connaissance de ce projet, et que le roi lui-même n'en reparle plus. » Le roi s'irrita et ne tint aucun compte de cet avis. Il fit part de ses desseins à ses généraux et à ses principaux courtisans ; la nouvelle passa de bouche en bouche, et finit par arriver jusqu'au Maharadja. Ce dernier était un prince sage, expérimenté et d'un âge déjà mûr. Il fit venir son vizir, l'informa de ce qu'il avait appris, et ajouta : « Ce que la renommée rapporte de ce fou, le projet que sa jeunesse et son orgueil lui ont inspiré, la publicité de ses paroles, tout nous oblige à sévir contre lui, car l'impunité porterait atteinte à notre dignité et à notre pouvoir. » Il ordonna donc à son vizir de tenir cet entretien secret, d'équiper mille vaisseaux de moyenne force, et de pourvoir chacun de ces vaisseaux des armes et des troupes nécessaires. On fit courir le bruit que le roi voûtait faire une promenade de plaisir dans les îles du royaume ; on écrivit même aux rois de ces îles, qui étaient vassaux du Maharadja, que le monarque allait faire une excursion d'agrément sur leurs terres, et, à cette nouvelle, chaque roi se prépara à bien recevoir le Maharadja. Ces ordres étant bien exécutés, et les armements terminés, le Maharadja s'embarqua et vint aborder avec son armée dans le royaume de Komar. Le roi de Komar ne sut cette expédition qu'en voyant la flotte remonter le fleuve et arriver sous sa capitale. Pris à l'improviste, ses soldats furent défaits, ses généraux faits prisonniers, la ville investie, et le royaume tout entier tomba au pouvoir du Maharadja. Celui-ci fit proclamer l'aman, puis il se plaça sur le trône du roi de Komar, et se fit amener ce roi prisonnier et son vizir. « Qui t'a inspiré, demanda-t-il au roi, un projet si au-dessus de tes forces, un projet dont la réalisation ne t'aurait pas rendu plus heureux, et qui n'a pas même pour excuse la possibilité de l'entreprise ? » Le roi se tut, et le Maharadja ajouta : « Si, au vœu de voir ma tête dans un bassin devant toi tu avais ajouté le désir de t'emparer de mes États et d'y porter la-destruction, j'aurais usé ici de représailles ; mais tu n'as formé précisément qu'un projet, et c'est moi qui le réaliserai à tes dépens. Puis je rentrerai dans mon pays, sans toucher aux biens de tes sujets, petits ou grands. Je veux que tu serves d'exemple à tes successeurs, afin qu'ils ne franchissent pas les limites que la fortune leur a assignées, et qu'ils connaissent le prix de la sécurité. » Puis il lui fit trancher la tête. Il s'adressa ensuite au vizir et lui dit : «Je te remercie, vizir ; je sais les bons conseils que tu donnais à ton maître, qui aurait dû les accepter. Désigne celui que tu crois digne de gouverner après ; cet insensé, et place-le sur le trône. Le Maharadja retourna aussitôt dans ses États, sans que lui ou ses troupes eussent exercé le moindre ravage dans ce pays. Rentré dans son royaume, il s'assit sur son trône, qui dominait l'étang surnommé l’étang des barres d'or, et fit placer devant lui le plat où était posée la tête du roi vaincu. Il assembla tous les grands du royaume, et leur raconta son expédition et le motif qui l'avait rendue nécessaire. Ses sujets répondirent par des acclamations et des vœux.
Sur son ordre, on lava la tête du roi, on l'embauma, et, après l’avoir enfermée dans un vase, on l’envoya à son successeur dans le Komar, avec la lettre suivante : « Notre expédition a été motivée par l'insolence de ton prédécesseur, et par la nécessité de donner une leçon à ses pareils. Maintenant que nous avons atteint notre but, nous croyons devoir te renvoyer cette tête, car nous n'avons aucun intérêt à la garder, et une pareille victoire n'ajoute rien à notre gloire.» Les rois de l'Inde et de la Chine, instruits de ces événements, n'en eurent qu'une plus haute idée du Maharadja, et, depuis lors, les rois de Komar, en se levant le matin, se tournaient vers le pays de Zabedj, et se prosternaient en proclamant avec respect la grandeur du Maharadja.
Nous devons expliquer ce que signifie l'étang des barres d'or. Le palais du Maharadja domine un petit étang, qui communique avec le principal golfe du Zabedj ; le flux amène l'eau de mer dans ce golfe, et le reflux en enlève l'eau douce. Tous les matins, le trésorier du roi arrive porteur d'une barre d'or fondu pesant un certain nombre de livres, dont je ne puis évaluer le poids exact, et la jette dans l'étang en présence du roi. A l'heure du flux, l'eau monte et recouvre cette barre avec celles qui y sont déjà déposées ; mais la marée basse les laisse à découvert, et elles brillent aux rayons du soleil, sous les yeux du roi, qui est assis dans sa salle d'audience, située au-dessus de cet étang. On continue ainsi, pendant toute la durée de son règne, à jeter chaque jour une barre d'or, et personne n'ose y toucher ; mais à la mort du roi, son successeur fait retirer tous ces lingots, sans en laisser un seul. On les compte, on les fond, et on les distribue aux membres de la famille royale, tant aux hommes qu'aux femmes et aux enfants, aux officiers et aux serviteurs, en observant le rang et les prérogatives de chaque classe. Le surplus est distribué aux pauvres et aux infirmes. Le nombre et le poids de ces barres sont inscrits dans un registre, et l’on dit que tel roi a vécu tant d'années, et qu'il a laissé dans l'étang royal tant de barres d'or, pour être distribuées après sa mort entre ses sujets. C'est une gloire, à leurs yeux, d'avoir régné longtemps et d'avoir laissé un grand nombre de ces barres.
Le plus puissant roi qui règne aujourd'hui dans l'Inde est le Balhara, souverain de ta ville d'el-Mankir ; la plupart des chefs de l'Inde tournent leur visage vers lui en priant, et adressent des prières à ses ambassadeurs, quand ils arrivent à leur cour. Les États du Balhara sont entourés par plusieurs principautés. Quelques-uns de ces rois habitent la région des montagnes, loin de la mer ; tels sont le Raya, maître du Kachmir, le roi de Tafen et d'autres chefs indiens. D'autres Etats s'avancent sur la mer et dans le continent. La capitale du Balhara est éloignée de la mer de quatre-vingts parasanges sindi, et chaque parasange vaut huit milles. Ses armées et ses éléphants sont innombrables ; mais presque toutes ses troupes se composent d'infanterie, à cause de la nature du pays. Un de ses voisins, parmi les rois de l'Inde, éloignés de la mer, est le maître de la ville de Kanoudj, le Baourah, titre donné à tous les souverains de ce royaume. Il a de fortes garnisons cantonnées au nord, au sud, à l'ouest et à l’est, parce que chacun de ces côtés est menacé par un voisin belliqueux.
Nous donnerons plus tard de nouvelles notions sur les souverains du Sind, de l'Inde et d'autres rois de la terre, dans le chapitre relatif aux mers, à leurs particularités, aux nations et aux rois qui les environnent, etc. On trouvera aussi ces renseignements dans nos précédents ouvrages. Puisse Dieu nous aider ! en lui seul sont la force et le pouvoir.
Les savants partagent la terre entre les quatre points cardinaux, l’est, l'ouest, le nord et le sud ; ils la divisent aussi en deux parties, celle qui est habitée et celle qui est déserte, cultivée ou inculte. La terre, disent-ils, est ronde, son centre passe par l'axe de la sphère, l'air l'entoure de tous les côtés, et, comparée à la sphère du zodiaque, elle est petite comme un point mathématique. La portion habitée s'étend depuis un groupe de six îles nommées les îles Eternelles (Fortunées), et situées dans l'océan Occidental, jusqu'à l'extrémité de la Chine. Cette étendue correspondant à. douze heures (de la révolution journalière du soleil), ils ont reconnu que le soleil se lève pour les îles Éternelles, situées dans l'océan Occidental, quand il se couche à l'extrémité de la Chine, et qu'il se lève pour cette partie reculée de la terre quand il se couche pour ces îles. Cette portion est la moitié de la circonférence terrestre, et c'est retendue longitudinale qu'ils disent avoir observée. Si on l'évalue en milles employés pour la mesure du globe, on obtient un total de treize mille cinq cents milles.
Leurs recherches sur la latitude de la terre ont prouvé que la portion habitée s'étend, de l’équateur vers le nord, jusqu'à l'Ile de Toulé (Θούλη) dans la (Grande-) Bretagne, où la durée du jour le plus long est de vingt heures. Selon eux, l'équateur passe, entre l'est et l'ouest, par une île située entre l'Inde et l'Abyssinie, et un peu au sud de ces deux contrées. Ce point intermédiaire entre le nord et le midi est coupé par le point intermédiaire entre les îles Éternelles et l'extrémité de la Chine ; c'est ce que l’on nomme la coupole de la terre, déjà connue parce que nous en avons rapporté. On compte environ soixante degrés de latitude de l’équateur à l'île de Toulé : c'est un sixième de la circonférence de la terre. En multipliant ce sixième, qui est la mesure de la latitude, par une moitié qui représente la longitude, on obtient, pour la portion habitée de l'hémisphère septentrional, un douzième de la surface du globe.
Voici la division des sept climats. Premier climat : le pays de Babel, le Khoraçan, el-Ahwaz, Moçoul et le Djebal ; ce climat a pour signes du zodiaque le Bélier et le Sagittaire ; pour planète, Jupiter. Second climat : le Sind, l’Inde et le Soudan ; signe du zodiaque, le Capricorne ; pour planète, Saturne. Troisième climat : la Mecque, Médine, le Yémen, le Taïf, le Hedjaz et les pays intermédiaires ; signe du zodiaque, le Scorpion ; planète, Vénus l'heureuse. Quatrième climat : l’Égypte, l'Ifriqiya, le pays des Berbers, l'Espagne et les provinces comprises dans ces limites ; signe du zodiaque, les Gémeaux ; planète. Mercure. Cinquième climat : la Syrie, le pays de Boum, la Mésopotamie (el-Djezireh) ; signe du zodiaque, le Verseau ; planète, la Lune. Sixième climat : les pays habités par les Turcs, les Khazars, les Deilemiens et les Slaves ; signe du zodiaque, le Cancer ; planète, Mars. Septième climat : le pays de Daïl et la Chine ; signe du-zodiaque, la Balance ; planète, le Soleil.
L'astronome Hoçein, auteur du livre des Tables astronomiques, rapporte, d'après Khaled, fils d'Abd-el-Melik, originaire de Merw, et d'autres, savants qui, par ordre d'el-Mamoun, avaient pris la hauteur du soleil dans la plaine de Sendjar, contrée de Diar-Rebiâh (sud de la Mésopotamie), que la mesure d'un degré terrestre est de cinquante-six milles ; en multipliant ce nombre par trois cent soixante, ils trouvèrent, pour la circonférence du globe, continent et mer, vingt mille cent soixante milles. Cette circonférence de la terre, multipliée par sept, donne cent quarante et un mille cent vingt milles. En divisant ce produit par vingt-deux, on a, pour le diamètre de la terre, six mille quatre cent quatorze milles et demi, plus un vingtième de mille environ. La moitié du diamètre de la terre est donc de trois mille deux cent sept milles, plus seize minutes trente secondes, soit : un quart, plus un quarantième de mille. Le mille vaut quatre mille coudées noires ; on nomme ainsi la coudée établie par el-Mamoun pour la mesure des étoffes, des maisons et l'arpentage ; elle se compose de vingt-quatre doigts. Le philosophe (Ptolémée), dans son livre intitulé Djografia (Γεωγραφία.), décrit la terre, les villes, les montagnes, les mers, les îles, les fleuves et sources qu'elle renferme ; il parle des villes habitées et des pays cultivés, évalue le nombre de ces villes à quatre mille cinq cent trente pour son époque, et les cite par ordre de climats. Il distingue, dans le même ouvrage, les montagnes de la terre par leur couleur rouge, jaune, verte, etc. et en porte le nombre à plus de deux cents ; il mentionne aussi leur hauteur, les mines et les pierres précieuses qu'elles renferment. Ce philosophe compte cinq mers autour du globe, et parle des îles cultivées ou incultes, connues ou inconnues, qui y sont situées. La mer d'Abyssinie, par exemple, renferme, entre autres, un groupe d'un millier d'îles, nommées Dibaihat, qui sont toutes habitées, et à une distance de deux, trois ou plusieurs milles l’une de l'autre. D'après le même auteur, la mer qui baigne l'Egypte et le pays de Roum sort de la mer des idoles de cuivre (Colonnes d'Hercule) ; les grandes sources de la terre, sans tenir compte des petites, sont au nombre de deux cent trente ; deux cent quatre-vingt-dix fleuves coulent sans interruption dans les sept climats ; chaque climat, comme on l'a vu plus haut, a une étendue de neuf mille parasanges carrés ; certaines mers renferment des êtres animés, tandis que d'autres, comme le grand Océan, n'en ont pas. Du reste on trouvera plus loin une description détaillée de chaque mer en particulier. Dans la Géographie (de Ptolémée), ces mers sont enluminées de couleurs variées, et diffèrent par leur étendue et leur aspect. Les unes ont la forme d'un manteau court (taïleçan), les autres celle d'un harnais, ou celle d'un boyau ; d'autres sont triangulaires ; mais leurs noms sont en grec dans cet ouvrage, et, par conséquent, inintelligibles.
Le diamètre de la terre est de deux mille cent parasanges, ce qui donne, en réalité (pour la circonférence, à raison de 7 : 22), six mille six cents parasanges, chaque parasange étant de seize mille coudées. La circonférence du cercle inférieur des astres, c'est-à-dire la sphère de la lune, est de cent vingt-cinq mille six cent soixante parasanges ; le diamètre de la sphère, depuis la limite de la tête du Bélier jusqu'à celle de la tête de la Balance, mesure quarante mille parasanges.
Les sphères (ou cieux) sont au nombre de neuf : la première, qui est aussi la plus petite et la plus rapprochée de la terre, est la sphère de la lune ; la seconde, celle de Mercure ; la troisième, celle de Vénus ; la quatrième, celle du soleil ; la cinquième, celle de Mars ; la sixième, celle de Jupiter ; la septième, celle de Saturne ; la huitième, celle des étoiles fixes, et la neuvième, celle du zodiaque. Toutes ces sphères ont la forme de globes renfermés l'un dans l'autre. Celle du zodiaque est nommée sphère universelle, et sa révolution produit le jour et la nuit ; cardans un jour et une nuit elle entraîne le soleil, la lune et tous les astres de l’est à l'ouest autour de deux pôles immobiles, dont l’un, situé au nord, est le pôle arctique, et l'autre, le pôle austral, ou de Canope. Les signes du zodiaque ne sont autre chose que la sphère universelle, et leurs noms particuliers servent seulement à désigner la place que les étoiles y occupent. La sphère du zodiaque se rétrécit nécessairement vers les pôles, et s'élargit au centre du globe.
La ligne qui coupe ce globe en deux moitiés, de l'est à l'ouest, se nomme ligne équinoxiale, parce que, lorsque le soleil est sur cette ligne, le jour et la nuit sont d'une égale longueur dans tous les pays. La partie de cette sphère qui va du nord au sud est nommée latitude, celle qui se dirige de l'ouest à l’est, longitude. Les sphères sont rondes, elles entourent le monde et tournent autour du centre de la terre, qui se trouve au milieu d'elles, comme le point central de la circonférence. Parmi les neuf sphères, la plus voisine de la terre est celle de la Lune ; au dessus est la sphère de Mercure, puis celle de Vénus, et ensuite celle du soleil, qui est au milieu des sept sphères. Au-dessus de la sphère du soleil est celle de Mars, puis les sphères de Jupiter et de Saturne. Chacune d'elles ne renferme qu'une étoile. Au-dessus de Saturne est la huitième sphère, qui renferme les douze constellations et les autres étoiles. La neuvième sphère est la plus élevée et la plus vaste ; c'est la grande sphère qui enveloppe toutes celles que nous avons nommées, ainsi que les quatre éléments et toute la création. Elle n'a pas d'étoiles, et accomplit tous les jours une révolution de l’est à l'ouest, en entraînant dans sa course circulaire toutes les sphères inférieures. Les sept sphères (des planètes) tournent, au contraire, de l'ouest à l'est. Les anciens prouvent ce système par des arguments qu'il serait trop long de rapporter ici.
Les étoiles ainsi placées et visibles à l'œil comme celles de la huitième sphère, et cette sphère elle-même, tournent sur deux pôles, qui ne sont pas ceux de la sphère générale. Pour prouver la différence du mouvement entre la sphère zodiacale et les autres sphères, on montre que les douze constellations se suivent dans leur marche, sans quitter leur place respective, ni altérer leur mouvement, en se levant ou en se couchant. Chaque planète, au contraire, a son mouvement propre, qui n'est pas celui des autres, et ce mouvement est inégal, plus rapide, et tantôt dans la direction du sud, tantôt dans celle du nord.
Les astronomes, définissent la sphère comme là limite de l'espace qui réunit les éléments supérieurs ou inférieurs. Considérée dans sa nature même, elle est ronde et la plus vaste des sphères, puisqu'elle renferme toutes les autres. Ces planètes ne se meuvent pas dans leur orbite avec la même rapidité. La lune séjourne deux jours et demi dans chaque constellation, et traverse la sphère en un mois ; le soleil demeure un mois dans chaque constellation ; Mercure, quinze jours, Vénus, vingt-cinq jours ; Mars, quarante-cinq jours ; Jupiter, un an ; Saturne, trente mois.
Ptolémée, l'auteur de l'Almageste, évalue la circonférence de la terre, avec ses montagnes et ses mers, à vingt-quatre mille milles, et son diamètre, c'est-à-dire sa largeur et sa profondeur, à sept mille six cent trente-six milles. Pour trouver cette mesure, on a pris l'élévation du pôle arctique dans deux villes situées sous le même méridien, la ville de Tadmor (Palmyre), située dans les plaines qui séparent l'Irak de là Syrie, et la ville de Rakkah. On trouva que cette élévation était à Rakkah 35° 1/3 et à Tadmor 34°, ce qui fait une différence d'un degré et un tiers ; puis on mesura la distance entre ces deux villes, qu'on reconnut égale à soixante-sept milles ; le degré de la sphère qu'on avait observé répondait donc à une superficie terrestre de soixante-sept milles. Or la sphère entière, comme on le démontre par des preuves que nous ne pouvons citer ici, est divisée en trois cent soixante degrés (donc 67 x par 360 = 24.120, mesure de la circonférence terrestre). Cette division leur parut certaine, parce qu'ils trouvèrent que la sphère est partagée en douze portions par les douze signes du zodiaque, et que le soleil, traversant chaque signe en un mois, parcourt toute la sphère en trois cent soixante jours.
La sphère accomplit sa révolution autour de deux pivots ou deux pôles, qu'on peut comparer aux chevilles du charpentier ou du tourneur qui fabrique des boules, des écuelles et d'autres objets en bois. Pour celui qui habite le milieu de la terre, sous l'équateur, les jours et les nuits sont d'une égale longueur pendant toute l'année, et il voit à la fois ces deux axes, c'est-à-dire le pôle boréal et le pôle austral ; tandis que les habitants de l'hémisphère septentrional voient le pôle boréal et la constellation de l’Ourse, mais ne peuvent voir le pôle austral ni les étoiles qui l'avoisinent. Ainsi Canope, qui n'est jamais visible dans le Khoraçan, peut être observé dans l'Irak pendant quelques jours de l'année, et un chameau ne peut voir cette étoile sans mourir, ainsi que nous l'avons rapporté ailleurs avec les raisons par lesquelles on explique cette influence exclusivement fatale à cet animal. Dans les régions méridionales, Canope est visible toute l'année. Les écoles astronomiques sont partagées sur la question de savoir si ces pivots, sur lesquels tourne la sphère, sont immobiles ou doués de mouvement. L'opinion générale est qu'ils sont immobiles, et nous avons donné, dans nos premiers ouvrages, les preuves incontestables de leur immobilité, que l'on considère ou non ces pivots comme étant de la même nature que les sphères elles-mêmes.
La configuration des mers a soulevé aussi des discussions. La plupart des anciens philosophes de l'Inde et des sages de la Grèce, à l'exception de ceux qui adoptent la révélation, soutiennent que la mer suit le mouvement sphérique de la terre, et ils le prouvent par de nombreux arguments. Ainsi, quand on gagne le large, la terre d'abord, puis les montagnes s'effacent graduellement, et leur sommet finit par disparaître ; au contraire, si l'on se rapproche de la côte, ces montagnes reparaissent insensiblement, et, quand on est près du rivage, on peut distinguer la terre et les arbres.
Tel est le cas de la montagne de Donbawend (Demavend), entre Rey et le Tabaristan. On aperçoit de cent parasanges (cinq cents kilomètres) le sommet de cette montagne, qui se perd dans la nue ; une épaisse fumée s'en échappe, et des neiges éternelles le couronnent. De la base sort une grande rivière, dont l'eau sulfureuse est jaune comme l'or ; pour parvenir à la cime de la montagne, il faut monter pendant trois jours et trois nuits ; parvenu là, on trouve un plateau large d'environ mille coudées carrées, bien que, vu d'en bas, il ait une forme conique. Ce plateau est couvert d'un sable rouge, dans lequel le pied enfonce ; les animaux sauvages et l'oiseau lui-même ne peuvent atteindre ce sommet, à cause de son élévation, du vent et du froid rigoureux qui y règnent. On y remarque aussi une trentaine de fissures, d'où s'échappent une épaisse vapeur de soufre et des mugissements semblables au roulement du-tonnerre le plus violent ; ce bruit provient du feu qui s'enflamme. Celui qui expose sa vie pour gravir ce sommet recueille souvent à l'orifice de ces cavernes des morceaux de soufre, jaune comme de l’or, qui servent a-l'alchimie et à d'autres arts. Vues de cette hauteur, les plus hautes montagnes environnantes ressemblent à des collines ou à des mamelons. Le Donbawend est à vingt parasanges environ de la mer du Tabaristan (Caspienne). Les bâtiments qui s'avancent vers le large le perdent complètement de vue ; mais à une distance de cent parasanges, et quand ils se rapprochent des montagnes du Tabaristan, ils voient d'abord une partie de la cime du Donbawend, qui devient de plus en plus apparent à mesure qu'ils s'approchent du rivage. Ce fait prouve, dit-on, la thèse de la sphéricité de la mer.
On peut faire la même observation sur la mer de Roum (Méditerranée), nommée aussi mer de Syrie et d'Egypte, à l'égard du mont el-Akra, dont on ne connaît pas la hauteur, et qui domine le territoire d'Antioche, de Latakieh, de Tripoli, de l'île de Chypre, etc. Il disparaît aux yeux de ceux qui naviguent, parce qu'en avançant en pleine mer ils se trouvent au-dessous de son point de vue. Nous aurons plus tard occasion de reparler du Donbawend, des légendes que racontent les Persans à ce sujet, et de Dohhak surnommé Dou'l' Efwah, qui est enchaîné à la cime de cette montagne (chap. xxi). Le sommet du Donbawend est un des principaux volcans et l’une des merveilles de la terre.
Les dimensions du globe ne sont pas moins controversées ; l'opinion générale admet entre le centre de la terre, et les limites de l'air et du feu (l'atmosphère), une distance de cent soixante-huit mille milles.
La terre est trente-sept fois et une fraction plus grande que la lune ; elle est vingt-trois fois plus grande que Mercure et vingt-quatre fois plus grande que Vénus. Le soleil a cent soixante (six) fois, plus trois huitièmes, la dimension de la terre, et deux mille six cent quarante fois celle de la lune ; la terre n'est donc que le 1/160e du soleil. Le diamètre du soleil est de quarante-deux mille milles. Mars a soixante-trois fois la grandeur de la terre, et un diamètre de huit mille sept cents milles et demi. Jupiter a quatre-vingt-une fois trois quarts la grandeur de la terre, et un diamètre de trente-trois mille deux cent seize milles. Saturne est quatre-vingt-dix-neuf fois et demie plus grand que la terre ; son diamètre est de trente-deux mille sept cent quatre-vingt-six milles. Les étoiles fixes de première grandeur sont au nombre de quinze, et ont chacune quatre-vingt-quatorze fois et demie la dimension de la terre.
Distance des astres à la terre. — La lune, quand elle est le plus rapprochée de la terre, en est éloignée de cent dix-huit mille milles, sa distance extrême est de cent vingt-quatre mille milles. La plus grande distance de Mercure à la terre est de neuf cent mille sept cent trente milles ; celle de Vénus, de quatre millions dix-neuf mille six cents milles ; celle du soleil, de quatre millions huit cent vingt mille milles et demi ; celle de Mars, de trente-trois millions six cent mille milles et une fraction ; celle de Jupiter, d'un peu moins de cinquante-quatre millions cent soixante-six mille milles ; enfin, celle de Saturne, d'un peu moins de soixante-dix-sept millions de milles. Telle est à peu près la distance extrême des étoiles fixes à la terre.
C'est sur la division, les degrés et les mesures que nous venons de mentionner, que sont établis les calculs relatifs au temps et aux éclipses. Plusieurs instruments et astrolabes ont servi à cette étude, et un grand nombre de traités ont été composés dans ce but. Ce sujet est si vaste que nous ne pourrions le traiter, même partiellement, sans entrer dans de longs développements. Bornons-nous donc à ces explications sommaires, qui peuvent faciliter l'étude plus approfondie de ces sciences auxquelles nous avons donné une plus grande place dans nos ouvrages précédents. Le présent livre ne doit présenter que des aperçus et des généralités.
Les Sabéens de Hairan, qui ne sont que les disciples grossiers des Grecs, et la lie des philosophes anciens, ont établi dans leurs temples une hiérarchie de prêtres qui correspond aux neuf sphères ; le plus élevé porte le nom de Ras Koumra (chef des prêtres). Les chrétiens, qui leur ont succédé ont conservé, dans la hiérarchie ecclésiastique l'ordre institué par la secte sabéenne. Ils donnent à ces différents degrés de dignité, le nom d’altaat. La première est celle des as-salat (ostialus, portier) ; la seconde, celle des agsat (lecteur) ; la troisième, celle des youdaqoun (exorciste) ; la quatrième, celle des chemas (acolyte) ; la cinquième, celle des kasis (diacre) ; la sixième, celle des bardout (prêtre) ; la septième, celle des hourasfitos (archipresbyter) ou vicaire de l'évêque ; la huitième est celle d’askaf (episcopus) ; la neuvième, celle de mitran, ce qui veut dire chef de la ville (métropolitain). Enfin au-dessus de tous ces grades est celui de batrik, c'est-à-dire le père des pères (patriarche), ou bien de tous les dignitaires que nous venons d'énumérer, et autres encore qui ont un rang inférieur. Telle est l'opinion des chrétiens instruits relativement à cette hiérarchie ; mais le vulgaire a des traditions différentes à cet égard ; il parle de l'apparition d'un ange, et raconte différentes choses que nous n'avons pas besoin de rapporter. Cette institution existe chez les Melkites, qui sont comme ta colonne et la base du christianisme, tandis que les chrétiens orientaux, c'est-à-dire les Abadites, surnommés Nestoriens et Jacobites, se sont séparés d'eux et ont fait schisme. Il est hors de doute que les chrétiens ont emprunté l'idée première de cette hiérarchie aux Sabéens et que le kasis, le chemas, etc. sont dus à l'influence des Manichéens. Il faut en excepter cependant les Masdekites, les Chemmaïtes, et d'autres sectes. Manès, le fondateur du manichéisme, vécut après le Messie ; il en est de même d'Ibn Daisan et de Markion, chefs des Datsanites (Bardéçanites) et des Markionites ; plus tard les Masdekites et d'autres partisans des doctrines dualistes se séparèrent de ces premières sectes.
On trouvera dans les Annales historiques et l'Histoire moyenne de curieux renseignements sur ces différentes sectes, les contes puérils et les inventions fabriquées par elles. Nous en avons parlé également dans notre ouvrage intitulé Discours sur les bases des croyances, et nous avons réfuté ces opinions et renversé ces théories dans un autre livre, qui a pour titre Explication des principes de la religion. Ici nous ne pouvons traiter ces matières qu'incidemment, et dans le rapide exposé que nous en donnons, nous cherchons à faire l'historique de la secte et de la doctrine, pour que ce livre n'offre pas de lacunes ; mais nous écartons toute espèce d'examen et de controverse.
L'auteur de la Logique (Aristote, Meteorologica, t. I, ch. xiv) dit que les mers se transportent d'un lieu à un autre dans le cours des âges, et la suite des siècles. En effet, toutes les mers ont un mouvement constant ; mais, comparé à la niasse des eaux, à l'étendue de leur surface et à la profondeur de leur lit, ce mouvement est insensible. Cependant il n'y a aucune partie de la terre qui reste éternellement humide ou sèche ; mais elle change et se modifie sous l'action des fleuves, qui tantôt s'y déversent et tantôt s'en retirent. Telle est la cause de la transformation de la mer et du continent ; loin de rester constamment l'un et l'autre dans leur état primitif, le continent vient occuper la place envahie par la mer, et réciproquement. Ces révolutions sont déterminées par le cours des fleuves ; en effet, le lit des fleuves a ses périodes de jeunesse et de déclin, ou de vie et de mort ; il se développe et dépérit comme l'animal et la plante, avec cette différence, toutefois, que dans ceux-ci la croissance et le déclin ne se manifestent pas partiellement, mais que toutes les parties de leur être dépérissent et meurent en même temps. La terre, au contraire, décroît et vieillit successivement sous l'influence de la révolution du soleil.
L'origine des fleuves et des sources a soulevé des discussions. Selon les uns, ils proviennent tous de la grande mer, c'est-à-dire de la mer d'eau douce, qu'il ne faut pas confondre avec l'Océan. D'autres prétendent que l'eau se trouve dans la terre, comme les veines dans le corps. D'autres font le raisonnement suivant : c'est une loi de la nature que l'eau soit toujours de niveau, mais à cause de l'inégalité de la terre, qui est élevée d'un côté et déprimée de l'autre, l'eau s'est retirée dans les bas-fonds. Retenue dans ces profondeurs, elle tend à se répandre au dehors par suite de la compression que la terre exerce sur elle ; des crevasses se forment dans le sol, et livrent passage aux sources et aux fleuves. Souvent aussi l'eau est le produit de l'air renfermé dans les entrailles de la terre ; elle ne doit pas être considérée alors comme un élément, mais seulement comme engendrée par la corruption et les exhalaisons du sol. Nous ne citerons pas toutes les opinions auxquelles ce sujet a donné lieu, car nous cherchons à être bref et concis ; nous renvoyons donc, pour les détails, à nos autres ouvrages.
On a cherché depuis longtemps la source, l'embouchure et l'étendue du parcours des grands fleuves, tels que le Nil, l'Euphrate, le Tigre, le fleuve de Balkh ou Djeïhoun, le Mehran, qui arrose le Sind ; le Gange, fleuve important de l’Inde ; le Sabbato, qui n'est pas moins grand ; le Tanabis (Tanaïs), qui se jette dans la mer Nitas (mer Noire), etc.
J'ai vu dans la Géographie (de Ptolémée) une figure représentant le Nil sortant du pied de la montagne el-Komr. Ses eaux, qui jaillissent d'abord de douze sources, se déversent dans deux lacs semblables aux étangs (de Basrah) ; elles se réunissent au sortir de là, et traversent des régions sablonneuses et des montagnes. Le Nil poursuit sa marche à travers cette partie du Soudan qui avoisine le pays des Zendj et donne naissance à un bras qui va se jeter dans la mer de Zendj. Cette mer baigne l'île de Kanbalou (Madagascar ?), île bien cultivée, et habitée par des musulmans qui parlent la langue des Zendj. Ils s'emparèrent de cette île en faisant captive toute la population zendjite, à l'époque de la conquête de l'île de Crète, dans la Méditerranée, par les musulmans, au commencement de la dynastie abbasside et vers la fin du règne des Omeyades. De cette ville à Oman il y a environ cinq cents parasanges, d'après ce que disent les marias ; mais c'est une simple conjecture et non une évaluation rigoureuse. Plusieurs patrons (nakhoda) de Siraf et d'Oman, qui fréquentent ces parages, disent avoir observé dans cette mer, lors de la crue du Nil, en Egypte, ou peu de temps avant cette époque, un courant d'eau qu'il est difficile de couper, à cause de sa rapidité extrême. Ce courant, qui sort des montagnes du Zendj et s'étend sur un mille de largeur, est formé d'une eau douce et limpide, qui se trouble au moment de la crue du Nil en Egypte et dans le Saïd. On trouve dans cette mer le chouhman, ou crocodile, si commun dans le Nil ; on le nomme aussi el-waral.
El-Djahez prétend que le Mehran (Indus), fleuve du Sind, provient du Nil, et donne comme preuve l'existence des crocodiles dans le Mehran. J'ignore où il a été chercher un pareil argument. Il a avancé cette thèse dans son livre des Grandes villes et des merveilles de la terré. C'est un excellent travail ; mais l'auteur, n'ayant pas navigué, ni assez voyagé pour connaître les royaumes et les cités, ignorait que le Mehran du Sind sort de sources bien connues, situées dans la baute région du Sind, le territoire de Kanoudj, le royaume de Baourah, les pays de Rachmir, de Kandahar et de Tafen, et qu'il entre ensuite dans le Moultan, où il reçoit le nom de Mehran d'or, de même que le mot Moultan signifie la frontière d’or. Ce royaume obéit à un Koraïchite de la famille d'Oçamah, fils de Lowayi, fils de Galib, et c'est le rendez-vous général des caravanes qui se dirigent vers le Khoraçan. Un autre Koraïchite de la branche de Habbar, fils d'el-Aswad, règne dans le pays d'el-Mansourah ; la couronne du Moultan est héréditaire dans la même famille depuis la naissance de l'islamisme. Le Mehran, après avoir traversé le pays d'el-Mansourah, se jette dans la mer de l'Inde, non loin du territoire de Deiboul. Les crocodiles abondent, il est vrai, dans les adjwan ou baies formées par cette mer, telles que la baie de Sindaboura, dans le royaume indien de Baguirah, ou la baie de Zabedj (Java), dans les États du Maharadja, et la baie des Aguiab, dans le voisinage de l'île de Serendib (Ceylan). Les crocodiles vivent surtout dans l'eau douce, et les bras de mer que nous venons de citer dans l'océan Indien sont ordinairement formés d'eau douce, parce qu'ils reçoivent les eaux pluviales.
Revenons maintenant à la description du Nil. Les savants disent qu'il parcourt une étendue de neuf cents, et, selon quelques-uns, de mille parasanges, à travers des contrées cultivées et stériles, habitées ou désertes, jusqu'à ce qu'il arrive à Aswan (Syène), dans la haute Egypte. C'est là que s'arrêtent les navires qui remontent le fleuve depuis Fostat (vieux Caire) ; car, à quelques milles d’Aswan, le Nil traverse des montagnes et des rochers qui rendent la navigation impossible. Ces montagnes forment la ligne de démarcation entre la portion du fleuve parcourue par les bâtiments abyssiniens et celle que fréquentent les musulmans ; c'est ce que l’on désigne sous le nom de cataractes (littéral, les pierres et les rochers). Le Nil arrive à Fostat, après avoir traversé la haute Egypte (Saïd), passé devant la montagne de Tailemoun et franchi l'écluse d'el-Lahoun dans le Faïoum ; cet endroit que le fleuve traverse est nommé l'île de l'habitation de Joseph. Nous parlerons plus bas (chap. xxi) de l'histoire de l'Egypte, de ses districts et des monuments que ce pays doit à Joseph. Le Nil se partage ensuite en plusieurs branches, qui se dirigent sur Tennis, Damiette et Rosette, jusqu'à Alexandrie, et il se décharge dans la Méditerranée ; il forme plusieurs lacs dans ces parages. Cependant le Nil s'est retiré du territoire d'Alexandrie avant la crue de la présente année (332 de l'hégire). Je me trouvais à Antioche et sur les frontières de la Syrie, lorsque je reçus la nouvelle que le fleuve venait d'atteindre dix-huit coudées ; mais je ne pus savoir si l'eau avait pénétré ou non dans le canal d'Alexandrie.
Alexandre, fils de Philippe de Macédoine, bâtit cette ville sur ce bras du Nil ; la plus grande partie du fleuve pénétrait dans ce canal et arrosait les campagnes d'Alexandrie et de Mariout (Maréotis). Le pays de Mariout, en particulier, était cultivé avec le plus grand soin, et offrait une suite non interrompue de jardins jusqu'à Barkah, dans le Maghreb. Les bâtiments qui descendaient le Nil arrivaient jusqu'aux marchés d'Alexandrie, dont les quais étaient formés de dalles et de blocs de marbre. Plus tard des éboulements ont bouché ce canal et empêché l'eau d'y entrer ; d'autres obstacles encore n'ont pas permis, dit-on, de nettoyer le canal et de donner un libre cours à l'eau ; mais nous ne pouvons admettre tous ces détails dans un livre qui n'est qu'un résumé. Depuis lors les habitants boivent de l'eau de puits, car ils sont à une journée environ du fleuve. On trouvera plus bas, dans le chapitre consacré à Alexandrie, d'autres détails sur cette ville et sa fondation (voy. chap. xxiii). Quant au bras du Nil qui, ainsi que nous l'avons dit, se jette dam la mer du Zendj, ce n'est qu'un canal qui sort du bassin supérieur du Zendj et sépare ce pays des frontières habitées par les races abyssiniennes. Sans ce canal, de vastes déserts et les sables mouvants, les hordes turbulentes et innombrables des Zendj auraient chassé les Abyssiniens de leur pays natal.
Le fleuve de Balkh, ou Djeïhoun (Oxus), sort de différentes sources, traverse le pays de Termed, Esferaïn et d'autres parties du Khoraçan, et entre dans le Kharezm. Là il se divise en plusieurs branches, qui arrosent le pays ; le surplus de ses eaux se jette dans le lac (lac d'Aral), sur les bords duquel est le bourg de Djordjanieh, au-dessous de la ville de Kharezm. C'est le plus grand lac de cette contrée, et, au dire de quelques-uns, du monde habité, car il ne faut pas moins d'un mois pour le parcourir en long et en large. Il est navigable, et reçoit le fleuve de Ferganah et de Chach qui traverse le pays de Farab, la ville de Djedis, et qui est accessible aux bâtiments jusqu'à son embouchure. Sur ses bords s'élève une ville turque nommée la Ville-Nouvelle (Yengui-Kent), où vivent plusieurs musulmans. La plupart des Turcs qui habitent cette contrée, tant nomades que citadins, appartiennent à la tribu des Gozz, qui se divisent en trois hordes nommées la grande, la petite et la moyenne. Ils se distinguent des autres Turcs par leur valeur, leurs yeux bridés et l'exiguïté de leur taille. Cependant l'auteur de la Logique (Aristote), dans le quatorzième et le dix-huitième livre de son Traité des animaux, parlant de l'oiseau nommé grue (γέρανος), dit qu'il y a des Turcs d'une stature encore plus petite. On trouvera d'autres détails sur les Turcs dans divers passages de notre livre, et dans le chapitre qui leur est consacré.
La ville de Balkh possède un poste (ribat) nommé el-Akhchéban, et situé à vingt jours de marche environ. En face vivent deux tribus de Turcs infidèles, les Oukhan et les Tibétains, et à leur droite d'autres Turcs nommés Igan. C'est dans le territoire de ceux-ci qu'est la source d'un grand fleuve nommé aussi fleuve d'Igan. Plusieurs personnes instruites prennent ce fleuve pour le commencement du Djeïhoun, ou fleuve de Balkh. Le Djeïhoun a un parcours de cent cinquante parasanges, selon les uns, et de quatre cents parasanges selon ceux qui le confondent avec le fleuve des Turcs ou Igan. Quant aux auteurs qui avancent que le Djeïhoun se jette dans le Mehran (Indus), ils sont dans Terreur.
Nous ne parlerons ni de l'Aracht noir, ni de l'Aracht blanc, sur les bords duquel est le royaume des Keimak-Baigour (Ouigour ?), tribu turque originaire du pays au-delà du fleuve de Balkh ou Djeïhoun. Une autre tribu turque, les Gourites, habitent les bords de ces deux fleuves, qui sont l'objet de récits détaillés. J'ignore et, par conséquent, je ne puis déterminer l'étendue de leur parcours.
Le Gange est un fleuve de l'Inde qui sort des montagnes situées dans la partie la plus reculée de l'Inde, du côté de la Chine, et près du pays habité par la peuplade turque des Tagazgaz. Après un parcours de quatre cents parasanges, il se jette dans la mer Abyssinienne sur la côte de l’Inde.
L'Euphrate prend sa source dans le territoire de Kalikala (Erzeroum), ville frontière de l’Arménie ; il sort des montagnes d'Afradohos, à un jour de marche de cette ville. Il a une étendue de cent parasanges, et traverse le pays de Roum avant d'arriver à Malatiyeh. Un de nos coreligionnaires, qui a été prisonnier chez les chrétiens, m'a assuré que l'Euphrate, dans sa course à travers le pays de Roum, reçoit plusieurs affluents, entre autres un fleuve qui sort du lac el-Marzeboun, le lac le plus vaste de cette contrée ; il est navigable et n'a pas moins d'un mois de navigation en long et en large. L'Euphrate arrive ensuite au pont de Manbedj, après avoir passé sous le château de Somaisat (Samosate), nommé aussi le Château de terre. Il continue sa course vers Balès, et Siffin, signalé par une bataille entre les habitants de l'Irak et de la Syrie ; il passe successivement devant Rakkah, er-Rahbah, Hit et el-Anbar, où il donne naissance à plusieurs canaux, comme le Nehr-Yça, etc. qui coulent du côté de Bagdad et se jettent dans le Tigre. L'Euphrate se dirige ensuite vers le pays de Soura, le château d'Ibn Hobeirah, Koufah, el-Djameeïn, Ahmed-Abad, en-Ners, et et-Tofouf, et se jette enfin dans l'étang qui est entre Basrah et Waçit. Son parcours entier est de cinq cents parasanges, ou davantage, selon d'autres. Le bras principal de l'Euphrate se dirigeait autrefois sur Hirah, où son ancien lit, encore visible aujourd'hui, est nommé el-Atik (l'ancien) ; c'est là qu'eut lieu la fameuse bataille de Kadiçieh, entre les musulmans et Roustem. De Hirah, le fleuve se jetait dans la mer d'Abyssinie, qui recouvrait à cette époque l'emplacement nommé aujourd'hui en-Nedjef ; c'étaient là qu'arrivaient les bâtiments venus de la Chine et de l'Inde, à destination des rois de Hirah.
Plusieurs historiens anciens, parfaitement instruits des Journées des Arabes, tels que Hicham, fils de Mohammed el-Kelbi, Abou Mikhnef Lout, fils de Yahia, et Charki, fils d'el-Kitami, racontent ce qui suit : Khaled, fils d'et-Walid el-Makhzoumi, marcha contre Hirah, sous le règne d'Abou Bekr, après la conquête du Yemamah et la mort du faux prophète des Beni-Hanifah ; mais les habitants se fortifièrent dans le château Blanc, le château de Kadiçieh et celui des Beni-Tâlabah, situés tous trois à trois milles de Koufah, et complètement déserts et ruinés aujourd'hui (332 de l'hégire). Khaled, fils d'el-Walid, voyant que l'ennemi s'était retranché dans ces forteresses, dressa son camp près de Nedjef et marcha en avant, à cheval et accompagné d'un célèbre cavalier arabe, Dirar, fils d'el-Azwar, l'Azdite. Parvenus sous le château des Beni-Tâlabah, ils furent assaillis par des matières enflammées que leur lançaient les chrétiens abbadites, et le cheval de Khaled se mit à fuir. « Que Dieu te protège, dit Dirar à son compagnon, voilà le plus fort de leurs stratagèmes. » Khaled retourna au camp et fit demander aux assiégés de lui envoyer un homme mûri par l'âge et l'expérience, afin qu'il l'interrogeât sur ce qui les concernait. Ils lui députèrent Abd el-Meçih, fils d'Amr, fils de Kaïs, fils de Hayan, fils de Bokaïlah, le Gassanide. Ce Bokaïlah, qui avait construit le château Blanc, devait son surnom à ce qu'étant sorti un jour revêtu d'une étoffe de soie verte, les gens de sa tribu s'écrièrent en le voyant : « En vérité, il ressemble à un petit chou (bokaïlah) ! » C'est Abd el-Meçih qui se rendit auprès du célèbre devin Satih, le Gassanide, pour l'interroger sur les songes des Moubed, sur les secousses du palais ou Eiwan (à Ctésiphon), et sur le sort qui était réservé aux rois sassanides. Ce même Abd el-Meçih, qui se présenta à Khaled, était alors âgé de trois cent cinquante ans. Khaled, en le voyant marcher lentement, lui demanda : « Vieillard, de quel lien descends-tu ?—Des reins de mon père, répondit le cheikh. —D'où viens-tu ? — Du sein de ma mère. — Malheur à toi ! sur quoi es-tu ? (c'est-à-dire, pourquoi es-tu venu ?) —Je suis sur la terre. — Que Dieu te confonde ! où es-tu ? —Dans mes vêtements. — As-tu perdu la tête ? puisses-tu la perdre ! — Certes par Dieu, elle est solidement attachée. — Le fils de combien es-tu ? (c'est-à-dire quel âge as-tu ?) — Le fils d'un seul homme. — Mon Dieu, s'écria Khaled, maudis les gens de ce pays, pour le trouble qu'ils nous causent ! Je lui demande une chose, et il m’en répond une autre. — Non certes, répliqua le vieillard, j'ai répondu avec précision à tes questions. Interroge-moi à ton gré.-— Etes-vous Arabes ou Nabatéens ? demanda Khaled. —- Des Arabes devenus Nabatéens, ou des Nabatéens devenus Arabes. — Que préférez-vous, la paix ou la guerre ? — La paix. — Pourquoi donc ces forteresses ? — Nous les avons bâties pour y enfermer les fous jusqu'à ce qu'un sage vienne les délivrer. — Quel est ton âge ? — Trois cent cinquante ans. — Qu'as-tu vu dans ta vie ? — J'ai vu les vaisseaux arriver jusqu'à nous sur cette hauteur (nedjef) chargés de marchandises du Sind et de l'Inde, et les vagues se briser sur le sol que tu foules à tes pieds. Vois aujourd'hui quel espace nous sépare de la mer ! Je me souviens d'avoir vu une femme de Hirah prendre son panier, le placer sur sa tête, et n'emporter qu'un pain comme provision, parce que, jusqu'à son arrivée en Syrie, elle ne traversait que des villages florissants, des champs bien cultivés, des vergers couverts de fruits et arrosés par des étangs et des canaux d'eau vive. Tu le vois aujourd'hui, ce n'est plus qu'un désert aride. C'est ainsi que Dieu en use avec le monde et ses habitants. » Ces paroles jetèrent Khaled et tous les assistants dans un muet étonnement, car Abd el-Meçih était célèbre parmi les Arabes autant pour son extrême vieillesse, que pour sa sagesse consommée. On prétend qu'il portait sur lui un poison foudroyant, et qu'il le tournait entre ses mains. Khaled lui demanda ce qu'il tenait. C'est un poison, dit-il, qui tue instantanément. — Quel usage veux-tu en faire ? —En venant près de toi j'ai résolu que, si tu prenais une décision favorable à mes compatriotes et à moi, je l'accepterais et j'en remercierais Dieu ; sinon, ne voulant pas rapporter à mes compatriotes la honte et l'affliction, je prendrais ce poison et quitterais ce monde ; je n'ai d'ailleurs que peu de temps à vivre. — Donne-moi ce poison », dit Khaled, puis il le plaça dans la paume de sa main, prononça ces mots : « Au nom de Dieu, par l'aide de Dieu, au nom de Dieu, le maître de la terre et des cieux, par ce saint nom avec lequel rien ne peut nuire ! » et il avala le poison sans hésiter. Il s'évanouit sur-le-champ, et son menton se pencha sur sa poitrine ; puis il revint à lui et reprit ses forces, comme un homme qui a brisé ses chaînes. Le vieillard, qui était Abbadite, c'est-à-dire chrétien nestorien, revint auprès des siens et leur dit : « Peuple, je viens de quitter Satan ; il a avalé un poison qui tue sur l'heure, et il n'en a éprouvé aucun mal. Hâtez-vous donc de conclure la paix et de l'éloigner. Une influence supérieure veille sur cette nation ; sa fortune va s'élever sur les ruines de la famille de Sassan. La croyance qu'elle apporte se répandra sur la terre et changera la face du monde. « Ils firent, en effet, la paix avec Khaled à la condition de payer cent mille drachmes, et de porter le sadj, ou turban (des chrétiens). Après le départ de Khaled, Abd el-Meçih récita ces vers :
Devais-je donc, après le règne des deux Moundir, voir un autre drapeau flotter sur Khawarnak et Sedir,
Et tes cavaliers de toutes les tribus le fuir en redoutant la colère du lion.au rugissement terrible ?
Devais-je, après les exploits des guerriers de Noman, voir les troupeaux brouter entre Marrah et el-Hafirf
Mais la mort d’Abou Kobaïs nous a dispersés comme des brebis dans un jour d'orage.
Nous qui nous partagions librement les tributs de Mâdd, comme les membres d'un chameau immolé,
Nous payons un tribut aussi onéreux que celui de Khosroès, ou des enfants de Koraizah et de Nadir !
Ainsi le veulent les caprices de la fortune ; un jour et le apporte la prospérité, et le lendemain le malheur.
Nous n'avons rapporté ici cette anecdote que comme une preuve évidente de ce que nous avons avancé relativement aux migrations des mers, et au mouvement des cours d'eau et des fleuves, dans la suite des âges. C'est ainsi que, l'eau s'étant retirée de cette localité, la mer a fait place à la terre ferme, et qu'aujourd'hui une distance de plusieurs jours sépare Hirah de la mer. Quiconque a vu et examiné avec soin le Nedjef sera convaincu de l'exactitude de notre assertion.
Il en est de même du Tigre de Basrah (el-Awrah), qui a changé de place, et se trouve aujourd'hui à une grande distance du Tigre. Il était nommé le ravin de Djoukha, et s'étendait depuis Badbin, dans le district de Waçit, jusqu'au territoire de Dour er-Raçebi, près de Sous (Chouster), dans le Khouzistan. Un fait analogue a eu lieu sur la rive orientale de Bagdad, dans une localité nommée Rakkah ech-Chemmaçieh, où le fleuve a quitté brusquement le rivage occidental, les terrains cultivés entre Katrabbol et Bagdad, le bourg d'el-Kobb, el-Bochra, el-Ain et d'autres bourgades qui dépendent de Katrabbol. C'est ce qui a donné lieu à des contestations entre les habitants de cette rive et ceux de la rive orientale qui possèdent Raktah ech-Chemmaçieh. L'affaire fut portée devant le vizir Ali, fils d'Yça ; la décision que rendit alors ce ministre et le fait que nous rapportons sont de notoriété publique à Bagdad.
Si l'eau avance en trente ans d'environ un septième de mille, ce qui fait un mille en deux siècles, lorsque le fleuve s'est retiré de quatre mille coudées hors de son ancien lit, certains territoires deviennent par conséquent arides, et d'autres sont rendus à la culture. Si l'eau rencontre un territoire déprimé d'où elle puisse s'écouler, elle prend un cours plus rapide et plus impétueux, et charrie à de grandes distances les terres qu'elle a rongées. Si elle trouve une vallée étendue, elle la remplit sur son passage, et le courant donne naissance à des lacs, des étangs et des marais. C'est ainsi que certains territoires deviennent incultes et d'autres fertiles. Il suffit d'un peu d'attention pour comprendre ce que nous disons.
Plusieurs historiens, qui ont étudié avec soin les annales du monde et des monarchies, assurent qu'à l'époque où le Prophète envoya un message au roi de Perse, c'est-à-dire l'an 7 de l'hégire, l'Euphrate et le Tigre éprouvèrent une crue excessive, et telle qu'on n'en avait jamais vu. D'énormes fissures sillonnèrent le rivage, plusieurs fleuves sortirent de leur lit, rompirent leurs digues et leurs barrières, et inondèrent les plaines du pays. Ce fut en vain que le roi Eberwiz (Perviz) chercha à contenir les eaux, en relevant les digues et en rétablissant les écluses : le fleuve renversa tous les obstacles et se répandit sur l'emplacement actuel des étangs. Les fermes et les moissons furent submergées ; l'inondation envahit les districts et les cantons (taçoudj) environnants, et tous les efforts tentés pour maîtriser l'élément furent inutiles. Plus tard, pendant que les Persans étaient absorbés par leur lutte contre les Arabes, l'eau étendit ses ravages sans que l’on cherchât à y remédier, et les étangs gagnèrent chaque jour du terrain.
Sous le règne de Moawiah, Abd Allah, fils de Daradj, affranchi du khalife et chargé de percevoir l'impôt de l'Irak, gagna sur les étangs une étendue de terrain dont le produit s'éleva à quinze millions (de drachmes), en faisant couper les roseaux qui couvraient ces étangs et en refoulant l'eau à l'aide de digues et de barrières. Par la suite, Haçan le Nabatéen, affranchi des Beni-Dabbah, sous le khalifat d'el-Walid, dessécha de nouveaux terrains dans les étangs, au profit d'el-Haddjadj. Aujourd'hui le Batiyah, c'est-à-dire le territoire couvert et envahi par l'eau, est évalué à environ cinquante parasanges en long et en large. Le centre de l'étang est occupé par un grand nombre de terres en friche, comme Kâr-el-Djamideh, ville entourée d'eau, et d'autres localités. On remarque dans le fond, lorsque l'eau est claire, des débris de constructions en pierres ou en briques, les unes debout, les autres renversées, mais encore visibles. On peut faire la même observation dans le lac de Tinnis et de Damiette, qui renferme plusieurs villes et fermes, ainsi que nous le disons dans différents passages de ce livre et dans d'autres ouvrages.
Mais revenons au Tigre et décrivons sa source, son parcours et son embouchure. Ce fleuve sort du territoire d'Amid, dans la province de Diarbekr ; mais ses sources sont situées dans le pays de Khilat, en Arménie. Il reçoit différents affluents, tels que la rivière de Sarit et celle de Satidama, qui sort du pays d'Arzen et de Miafarikin. Il reçoit également le Doucha et le Khabour. Celui-ci, venu de l'Arménie, se réunit au Tigre, entre la ville de Baçourin et le tombeau de Sabour, sur le territoire de Bakirda et de Bazibda, province de Moçoul. Ce pays appartient aux Beni-Hamdan, et il en est fait mention dans les vers suivants :
Bakirda et Bazibda, délicieux séjour au printemps et pendant l'été ! l'eau qui l'arrose est pure et fraîche comme celle du Paradis.
Ne pariez plus de Bagdad, de son sol brûlant comme du charbon et de sa chaleur accablante !
Il ne faut pas confondre le Khabour, dont il est question ici, avec un fleuve du même nom qui prend sa source près de la ville de Raçâïn et se décharge dans l'Euphrate, au-dessous de Kirkiçiah. Le Tigre passe ensuite à Moçoul, et en sortant de cette ville, au-dessus de l'endroit nommé Hadit-el-Moçoul, il reçoit le grand Zab, qui vient de l'Arménie ; l'autre Zab, originaire de l'Arménie et de l’Azerbaïdjan, se réunit aussi au Tigre, en amont de la ville d'es-Sinn. Le fleuve continue sa route vers Tekrit, Samarra et Bagdad, en recevant les eaux du Khandak, du Sorat et de Nehr-Yça, canaux qui partent de l'Euphrate pour aboutir au Tigre, comme nous l'avons dit plus haut. Sorti de Bagdad, le Tigre reçoit plusieurs affluents, comme le Dialeb, le Nehr-Bin, le Nehr-Rewan (Nahrouan), non loin de la contrée de Djardjaraia, d'es-Sib et de Nômanieh. Après avoir traversé la ville de Waçit, il se partage en plusieurs fleuves (canaux) qui se dirigent vers l'étang de Basrah ; tels sont le Nehr-Sabès, le Yahoudi, le Chami, ainsi que le bras qui se dirige vers Koutr, et que suivent ordinairement les bâtiments qui, de Bagdad et de Waçit, se rendent à Basrah.
Le parcours entier du Tigre est de trois cents, et, selon d'autres, de quatre cents parasanges. Nous avons passé ici sous silence un grand nombre de fleuves, nous bornant à nommer les plus importants et les plus connus. Nous renvoyons le lecteur, pour de plus amples détails, à nos Annales historiques et à notre Histoire moyenne. Nous aurons encore occasion de revenir sur les fleuves nommés plus haut, et de parler de ceux que nous avons omis.
La province de Basrah possède aussi plusieurs fleuves importants, comme le Nehr-Chirin, le Nehr ed-Deir et le fleuve d'Ibn Omar. Il en est de même de la province d'el-Ahwaz et du pays situé entre elle et le territoire de Basrah et d'Obollah ; ce que nous en avons dit ailleurs nous dispense d'y revenir ici. Par la même raison nous ne parlerons pas de l'extrémité du golfe Persique vers Basrah et Obollah, ni du lieu connu sous le nom de Djerrarah, qui forme une baie non loin d'Obollah ; c'est ce voisinage qui rend salée l'eau de la plupart des rivières de Basrah, En vue de cette baie, on a établi à l'entrée de la rade, près d'Obollah et d'Abbadan, trois échafaudages en bois sur lesquels on allume des feux pendant la nuit. Ils s'élèvent comme trois immenses sièges au milieu de la mer, et préservent les bâtiments venus de l'Oman, de Siraf, etc. de se jeter dans cette baie de Djerrarah et les parages voisins, où ils trouveraient une perte assurée. Toute cette côte est remarquable par le nombre de ses cours d'eau et leur jonction avec la mer. A Dieu seul est la puissance !
On a déterminé les dimensions de la mer de l'Inde, qui n'est autre que la mer d'Abyssinie : sa longueur, de l'ouest à l'est, c'est-à-dire de l'extrémité de l'Abyssinie aux limites de l'Inde et de la Chine, est de huit mille milles ; sa largeur diffère selon les localités, et elle varie entre deux mille sept cents milles et dix-neuf cents milles. On donne encore, relativement à l'étendue de cette mer, différentes évaluations que nous passerons sous silence, parce que, aux yeux des gens du métier, elles ne reposent sur aucune preuve satisfaisante. Quoi qu'il en soit, cette mer est la plus vaste du monde habité.
Elle forme sur les côtes d'Abyssinie un canal qui s'avance dans, la contrée de Berbera, portion du pays habité par les Zendjs et les Abyssins. Ce canal, connu sous le nom de Berberi, a cinq cents milles de longueur, et sa largeur, d'une rive à l'autre, est de cent milles. Il ne faut pas confondre ce territoire de Berbera avec le pays des Berbers, situé dans le pays nommé Ifriqiya, pays bien distinct de celui dont nous parlons, et qui n'a de commun avec lui que le nom. Les pilotes de l'Oman traversent ce canal pour gagner l'île de Kanbalou (Madagascar ?), située dans la mer de Zanguebar, et habitée par une population mélangée de musulmans et de Zendjs idolâtres. Ces mêmes marins de l'Oman prétendent que ce détroit de Berberi, qu'ils désignent par le nom de mer de Berbera et de pays de Djafouna, est d'une étendue plus grande que celle que nous venons d'indiquer ; ils ajoutent que ses vagues ressemblent à de hautes montagnes, et ils les nomment des vagues aveugles, sans doute parce que, après s'être enflées comme d'énormes montagnes, elles se creusent en forme de profondes vallées ; mais elles ne se brisent pas, et ne sont jamais couvertes d'écume, comme on le remarque dans les autres mers. Ils leur donnent aussi le nom de vagues folles. Les marins qui fréquentent ces parages sont des Arabes de l'Oman et de la tribu de Azd ; lorsqu'ils ont gagné le large, et qu'ils montent et descendent au gré de cette mer agitée, ils chantent en cadence le refrain suivant :
Berbera et Djafouna, que vos vagues sont folles !
Djafouna et Berbera, voilà leurs vagues.
Le terme de leur course sur la mer de Zendj est l'île de Kanbalou, dont nous avons déjà parlé, et le pays de Sofalah et des Wakwaks, situé sur les confins du Zanguebar et au fond de ce bras de mer. Les Sirafiens font aussi cette traversée, et j'ai moi-même navigué sur cette mer en partant de Sendjar, capitale de l'Oman, en compagnie de plusieurs nakhoda, ou pilotes sirafiens, entre autres Mohammed, fils de Zeïdboud et Djewner, fils d'Ahmed, surnommé Ibn Sirah ; celui-ci y périt plus tard avec tout son équipage. Ma dernière traversée de l'île de Kanbalou à l'Oman remonte à l’année 304. J'étais à bord d'un bâtiment appartenant à Ahmed et à Abd es-Samed, tous deux frères d'Abd er-Rahim, fils de Djafar le Sirafien, habitant de Mikan, qui est un des quartiers de Siraf, et ces deux mêmes personnages, Ahmed et Abd es-Samed, fils de Djafar, ont péri ensuite corps et biens dans cette mer. Lors de mon dernier voyage, l'émir de l'Oman était Ahmed, fils de Helal, fils d'une sœur d'el-Kaïtal. Certes, j'ai navigué sur bien des mers, la mer de Chine, de Roum, des Khazars, de Kolzoum et du Yémen, j'y ai couru des dangers sans nombre ; mais je n'en connais pas de plus périlleuse que cette mer de Zendj, dont nous venons de parler.
C'est là aussi qu'on rencontre le poisson nommé el-owal (baleine), qui atteint quelquefois une longueur de quatre à cinq cents coudées omari, mesure usitée dans le pays ; mais sa longueur ordinaire est de cent coudées. Souvent, par les temps de calme, il sort hors de l'eau l'extrémité de ses nageoires, qu'on peut comparer à la grande voile d'un navire ; par intervalles, il dresse la tête et lance par ses ouïes une colonne d'eau qui s'élève au-dessus d'une portée de flèche. Les marins, qui nuit et jour redoutent son approche, heurtent des morceaux de bois ou battent le tambour pour le tenir à distance. C'est à l'aide de sa queue et de ses nageoires qu'il saisit et porte à sa gueule les poissons dont il se nourrit ; il la dilate de façon à ce que sa proie tombe au fond de son ventre. Dieu, pour réprimer les excès de ce monstre, dirige contre lui un poisson qui n'a qu'une coudée de long, et qu'on nomme lechk (peut-être la leiche, famille des squales). Celui-ci s'attache à la racine de l'oreille (évent) de la baleine, qui, ne pouvant se débarrasser de son ennemi, plonge à une grande profondeur, se heurte contre le fond et finit par expirer ; on voit alors son cadavre flotter à la surface de l'eau, semblable à une haute montagne. Lorsque le poisson nommé lechk s'attache à un bâtiment, la baleine, malgré sa haute stature, n'ose s'approcher du navire, et prend la fuite à la vue de ce faible ennemi, dont l'attaque est toujours la cause de sa mort.
Il en est de même du crocodile, qui a pour ennemi un petit reptile vivant sur le rivage ou dans les îles du Nil (le nems, ou mangouste). Le crocodile n'ayant pas d'orifice intestinal, ses aliments se convertissent en vers dans son estomac ; lorsque ces animaux le tourmentent, il sort du fleuve et se renverse sur le dos, en tenant sa gueule béante. La Providence lui envoie alors quelques oiseaux aquatiques, comme le taïtawi, le haçani, le chamirek, etc. qui, habitués à le voir dans cette situation, dévorent tous les gros vers qui ont pris naissance dans le corps de cet animal. Le petit reptile, qui se tient en embuscade dans le sable, profite de ce moment pour sauter dans son gosier et s'introduire dans l'intérieur de son corps. En vain le crocodile se heurte contre le sol et regagne le fond du Nil ; son adversaire, maître de la cavité où il s'est logé, lui déchire l'abdomen et sort par cette ouverture ; il arrive souvent que le crocodile se donne volontairement la mort avant d'être délivré du reptile, qui sort ensuite de son corps. Ce reptile, qui n'a guère qu'une coudée de long, ressemble à la belette, et il est pourvu d'un grand nombre de pieds et de griffes.
La mer de Zendj renferme encore plusieurs sortes de poissons, qui présentent les formes les plus variées. Sans la tendance qu'a l'esprit humain à nier ce qu'il ignore, et à rejeter tout ce qui sort du cercle habituel de ses connaissances, nous pourrions parler d'un grand nombre de merveilles qu'offre cette mer, des serpents et des animaux qu'elle renferme, et, en général, de tous les phénomènes que recèlent les mers.
Mais revenons à notre sujet et décrivons les ramifications de la mer d'Abyssinie, ses détroits, les baies et les langues de terre qu'elle forme. Un autre canal, dérivé de la mer d'Abyssinie, pénètre jusqu'à la ville de Kolzoum, sur le territoire égyptien, et à trois jours de Fostat (vieux Caire). Ce canal, qui longe la ville d'Eïlah, le Hedjaz, Djeddah et le Yémen, a une longueur de quatorze cents milles, sur deux cents milles de large dans sa moindre largeur et sept cents milles au point de sa largeur extrême. En face du Hedjaz et de la ville d'Eïlah, sur la rive occidentale de ce golfe, on rencontre le pays d'Allaki, le territoire d'Aïdab, situé dans la haute Egypte et dans le pays des Bedjah ; puis vient le pays des Abyssins et des nègres, jusqu'à l'endroit où le golfe rejoint l'extrémité inférieure du pays des Zendjs, non loin du pays de Sofalab.
Un autre bras de la même mer forme la mer Persique, qui s'étend jusqu'à Obollah, les Barrages et Abbadan, dans la province de Basrah. Ce golfe a quatorze cents milles de long, et à son orifice il n'a pas moins de cinq cents milles de large ; mais en différents endroits ses deux rives ne sont qu'à une distance de cent cinquante milles. La forme de ce golfe est un triangle, dont le sommet est situé à Obollah. A l’est il longe la côte du Fars, depuis la contrée de Dawrak el-Fours, la ville de Mahruban, Siniz où se fabriquent les tissus brochés et autres étoffes nommées sinizi, la ville de Djennaba, qui donne son nom aux étoffes dites djennabi, la ville de Nadjirem, qui dépend de Siraf, et la contrée des Beni-Amarah. On rencontre ensuite la côte du Kerman, ou pays d'Hormuz, ville située en face de Sendjar, dans l'Oman ; en suivant toujours le bord oriental du golfe, on arrive dans le Mekran, habité par les hérétiques nommés Chorat ; ce pays abonde en palmiers. Après Tiz (capitale) du Mekran commence le littoral du Sind, où sont les bouches du Mehran (Indus), principal fleuve de cette contrée, dont nous avons fait mention précédemment. Dans ces parages s'élève la ville de Deïboul ; c'est là que la côte indienne se joint au territoire de Barond, où l'on fabrique les lances dites baroudi ; enfin la côte se prolonge sans interruption, tantôt cultivée, tantôt stérile, jusqu'en Chine. Sur la rive opposée aux côtes du Fars, au Mekran et au Sind, se trouvent le pays d'el-Bahreïn, les îles de Kotor, le littoral des Beni-Djodaïmah, l'Oman, le Mahrah jusqu'au promontoire de Djomhamah, situé dans le pays d'ech-Chihr et d'el-Ahkaf. Le golfe renferme plusieurs îles, telles que l'île de Kharek, nommée aussi pays de Djennaba, parce qu'elle fait partie de ce territoire et qu'elle est à peu de parasanges de Djennaba ; c'est dans cette île que l'on pêche les perles connues sous le nom de khareki. Telle est aussi l'île d'Owal, habitée par les Beni-Maan, les Beni-Mismar et plusieurs autres tribus arabes ; elle n'est qu'à une journée ou même moins des villes d'el-Bahreïn. Sur cette côte, qui prend le nom de côte de Hedjer, s'élèvent les villes de Zareh et d'el-Katif ; à la suite de l'île d'Owal viennent plusieurs autres îles, entre autres celle de Lafet, ou île des Beni-Kawan, qui fut conquise par Amr, fils d'el-Ass, et l'on y voit encore une mosquée qui porte son nom ; cette île est bien peuplée, couverte de villages et de plantations. Dans son voisinage est l'île de Hendjam où les marins font leur approvisionnement d'eau ; non loin de là sont les récifs désignés par le dicton Koçeïr, Owaïr et un troisième (récif) qui n'est pas moins funeste ; et enfin le Dordour (tourbillon) ou Dordour Moçendam, auquel les marins donnent le sobriquet d'Abou-Homaïr (?). Ces écueils sont formés par de sombres rochers, qui se dressent hors de l'eau ; ils ne renferment ni végétation ni être animé, et sont entourés par une mer profonde, dont les vagues furieuses frappent d'épouvanté le navigateur qui s'en approche.
Ces dangereux parages, compris entre l'Oman et Siraf, sont sur la route directe des bâtiments, qui ne peuvent éviter de s'y engager ; les uns y périssent, les autres s'en retirent sains et saufs.
Cette mer ou golfe du Fars, nommée mer Persique, baigne, ainsi qu'on vient de le voir, le Bahreïn, la Perse, Basrah, Oman et le Kerman, jusqu'au promontoire de Djomhamah. Elle est séparée du canal de Kolzoum (mer Rouge) par Eïlah, le Hedjaz et le Yémen, c'est-à-dire par un continent dont la largeur est évaluée à quinze cents milles, et qui est formé par une langue de terre que la mer environne de presque tous les côtés ; nous en avons déjà parlé.
Telle est la configuration des mers qui baignent la Chine, l'Inde, la Perse, Oman, Basrah, le Bahreïn, le Yémen, l'Abyssinie, le Hedjaz, Kolzoum, le Zanguebar et le Sind. Quant aux nombreuses populations qui vivent dans leurs îles ou sur leurs côtes, Dieu seul qui les a créées en connaît le nombre, et pourrait les décrire. Bien que chacune de ces mers soit distinguée par un nom particulier, elles ne forment, en réalité, qu'une seule mer sans aucune interruption. C'est là que sont les fameuses pêcheries de perles ; on tire du littoral la cornaline, le madindj (alamandine), qui est une des variétés du grenat, plusieurs sortes de rubis, le diamant et le corendon. Aux environs de Kalah et de Serirah, on trouve des mines d'or et d'argent ; des mines de fer dans le voisinage du Kerman, et du cuivre dans l'Oman. Ces pays produisent aussi différents parfums, des aromates, de l'ambre, des plantes médicinales et des simples, le bois de teck, un autre bois nommé darzendji (Dracœna ferrea), le jonc et le bambou. Nous aurons encore occasion d'énumérer avec plus de détails les localités qui dépendent de cette mer, et qui produisent des pierres précieuses, des parfums et des étoffes.
Cette mer est donc connue sous le nom collectif de mer d'Abyssinie ; mais ses subdivisions, qui ont des noms particuliers, comme la mer du Fars, la mer du Yémen, de Kolzoum, d'Abyssinie, de Zendj, de Sind, de l'Inde, de Kalah, de Zabedj et de Chine, sont soumises à des vents différents. Ici le vent qui sort du fond même de la mer gonfle et soulève les vagues, comme l'eau d'une chaudière placée sur des matières combustibles. Ailleurs le vent, si redoutable au navigateur, sort du fond et se combine avec la brise de terre. Enfin, en d'autres lieux le vent souffle constamment de terre et ne provient pas du fond sous-marin. Quand nous parlons du vent qui sort des profondeurs de la mer, nous entendons par là les exhalaisons engendrées par la terre, et qui, du fond de l'eau, montent à sa surface. Dieu seul connaît la réalité de ce phénomène !
Tous les marins qui fréquentent ces parages rencontrent ces moussons dont ils connaissent parfaitement les époques. Cette science est chez eux le fruit de l'observation et d'une longue expérience, et ils se la transmettent par l'enseignement et la pratique. Ils se guident d'après certains indices et phénomènes particuliers, pour reconnaître rapproche d'une tempête, les temps de calme et les orages. Ce que nous disons ici à propos de la mer d'Abyssinie est également vrai des marins grecs ou musulmans qui parcourent la Méditerranée, et des Khazars de la mer Caspienne qui font la traversée du Djordjan, du Tabaristan et du Deïlem. Nous donnerons ailleurs de plus grands détails sur la théorie générale des mers, leur description particulière et leur histoire. Puisse Dieu, en qui seul est la force, nous assister dans notre œuvre !