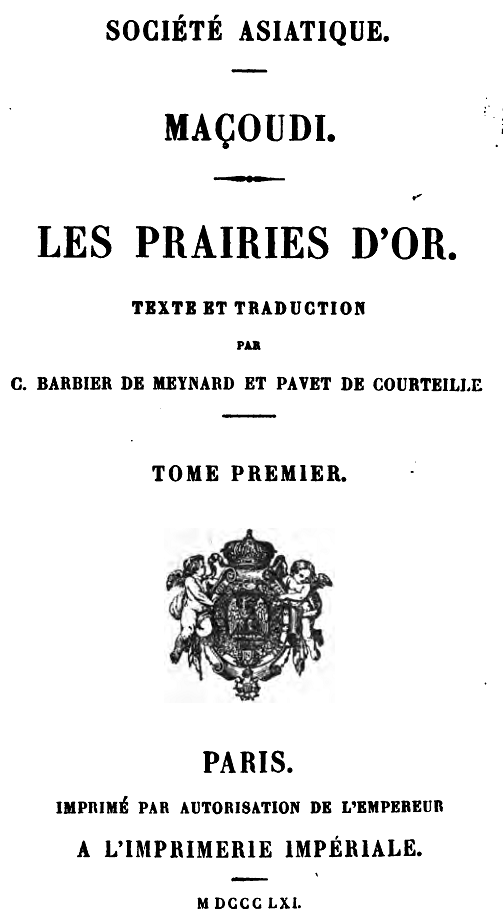
MAÇOUDI.
LES PRAIRIES D'OR. (chapitres XI à XV)
(chapitres V à X) - (chapitre XVI et table)
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
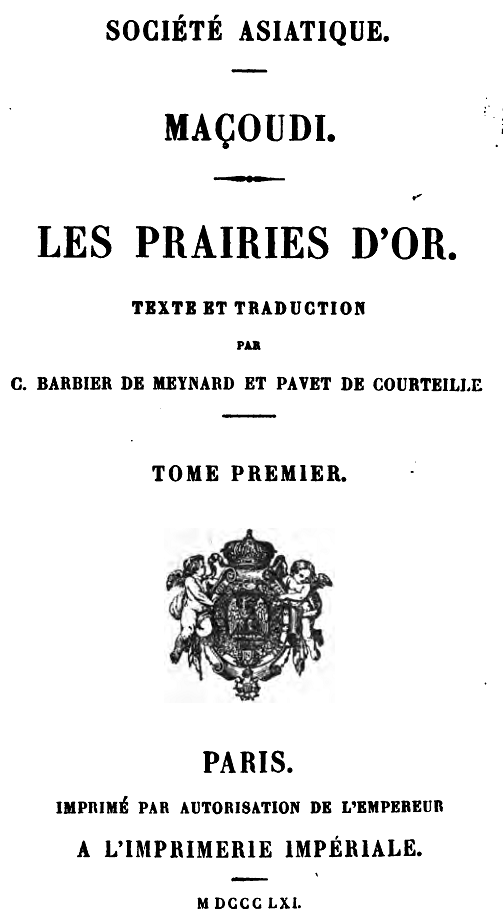
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
TEXTE ET TRADUCTION
PAR
C. BARBIER DE MEYNARD ET PAVET DE COURTEILLE.
TOME PREMIER.
Le flux est la marche naturelle et le cours régulier de l'eau ; le reflux est le mouvement rétrograde de l'eau au rebours de sa marche régulière, et à l'inverse de sa route habituelle. Ce phénomène existe sur la mer d'Abyssinie, autrement dite mer de la Chine, mer de l'Inde, mer de Basrah, mer de Perse, et dont il a été question dans le chapitre précédent. Les mers se présentent, à cet égard, de trois manières différentes : ou le flux et le reflux y règnent très visiblement, ou l'action de la marée est occulte et invisible à l'œil, ou bien encore elle est absolument nulle. Dans les mers qui n'ont point de flux et de reflux, l'absence de ce phénomène est due à trois causes, d'après lesquelles ces mers se subdivisent elles-mêmes en trois autres classes. Premièrement, celles dont les eaux presque toujours stagnantes s'épaississent, s'imprègnent fortement de sel, et sur lesquelles les vents se chargent d'exhalaisons. Tels sont ces amas d'eaux qui, pour plusieurs raisons, forment comme des lacs dans certains endroits : leur baisse, en été, et leur crue, en hiver, dépendent évidemment du tribut plus ou moins considérable qu'y apportent les fleuves et les sources qui s'y jettent. Deuxièmement, celles qui sont trop éloignées du cercle que parcourt la lune dans ses révolutions, pour pouvoir en subir l'influence. Troisièmement enfin, celles dont les côtes sont coupées par de fréquentes interruptions ; leurs eaux, n'étant pas resserrées par des barrières continues pénètrent dans d'autres mers, ne forment plus une masse compacte et unie, et les vents qui viennent de terre, soufflant progressivement, exercent sur elles une influence victorieuse. Ce phénomène se remarque surtout dans les parages où se trouvent des îles.
Les opinions ne sont pas d'accord sur les causes du flux «t du reflux. Les uns l'attribuent à la lune et disent, qu'étant homogène avec l'eau, elle la chauffe et la dilate. Il en est exactement de même, ajoutent-ils, du feu, lorsqu'il chauffe et fait bouillir le contenu d'une chaudière. L'eau, qui n'occupait d'abord que la moitié ou les deux tiers de la chaudière, étant une fois en ébullition, se dilate, s'élève et monte jusqu'à ce qu'elle déborde. Son volume alors a doublé à l'œil, tandis que son poids a diminué ; car c'est une des propriétés de la chaleur de dilater les corps, et une des propriétés du froid de les contracter. Or le fond de la mer étant constamment à une température assez élevée, l'eau douce qui s'y engendre se transforme peu à peu et s'échauffe, comme cela arrive dans les citernes et dans les puits. Cette eau, une fois chauffée, se dilate et augmente de volume, chacune de ses molécules se poussant et se pressant mutuellement ; puis sa nappe s'étend, sort des profondeurs de l'abîme et cherche un lit plus large que le sien. Comme la pleine lune communique à l'air une chaleur excessive, l'augmentation de l'eau devient surtout sensible à cette époque ; c'est ce qu'on appelle la marée du mois. La mer d'Abyssinie, ayant son inclinaison de l’est à l'ouest, se trouve sous le cercle de l'équateur ; les sphères des planètes sont placées au-dessus d'elle, ainsi que les étoiles fixes. Soit donc que les planètes, dans leurs révolutions, se tiennent directement au-dessus de la mer pendant une partie de la nuit, soit qu'elles s'en éloignent en effet, leur déclinaison n'est jamais telle qu'elles ne conservent leur influence sur toute son étendue le jour et la nuit. Il faut noter, en outre, que l'augmentation de l'eau se présente rarement dans les régions correspondantes à cette mer dans l'autre hémisphère ; et dans les fleuves où le flux a lieu d'une manière sensible, on ne le remarque que près des côtes, et à cause des affluents qui s'y déversent.
D'autres disent au contraire : Si la marée était due à une influence semblable à celle du feu, lorsque chauffant le liquide contenu dans une chaudière, il le dilate et augmente son volume ; si l'eau, débordant, abandonnant les profondeurs de la terre et y retournant ensuite, comme poussée par une force irrésistible, se comportait exactement comme l'eau qui, après avoir bouilli et s'être échappée sous l'impulsion incessante des molécules du feu, rentre dans le vaisseau qui la contenait ; ce phénomène devrait surtout se produire sous la chaleur plus puissante du soleil : si le flux était déterminé par le soleil, il devrait commencer avec le lever de cet astre, tandis que le reflux coïnciderait avec son coucher. Ils prétendent donc que le flux et le reflux doivent être attribués aux vapeurs qui s'engendrent dans l'intérieur de la terre, et qui, acquérant sans cesse plus de densité, exercent sur les eaux de cette mer une pression violente, et les chassent devant elles ; ce qui dure jusqu'à ce que ces vapeurs venant à diminuer d'intensité, les eaux rentrent dans leur lit naturel ; et c'est ce qui explique pourquoi te flux et le reflux ont lieu la nuit comme le jour, l'hiver comme l'été, que la lune soit cachée ou visible, au coucher du soleil aussi bien qu'à son lever. Ils ajoutent : L'œil lui-même peut s'assurer de la vérité de cette explication, puisqu'il est manifeste que le reflux n'a jamais atteint son terme quand le flux commence, et que la fin du flux n'est pas accomplie quand le reflux reparaît déjà. C'est que, en effet, les exhalaisons se produisent sans interruption, et qu'à peine dissipées, d'autres s'engendrent à leur place ; et il ne peut en être autrement, puisque toutes les fois que l'eau descend et retourne dans son lit ces vapeurs s'exhalent de la partie de la terre qui est en contact avec l'eau. Ainsi chaque retour de l'eau engendre les exhalaisons, et chaque débordement en produit l'évaporation.
Des hommes religieux soutiennent, au contraire, que, pour toutes ces choses, qui dans la nature n'ont rien d'analogue ni rien de semblable, il faut reconnaître l'action divine, qui montre l'unité et la sagesse de Dieu ; or le flux et le reflux n'ont ni cause ni analogie dans la nature.
D'autres comparent te soulèvement des eaux de la mer à celui de certains tempéraments. Comme vous voyez les tempéraments bilieux, sanguins ou autres s'agiter, puis ensuite se calmer ; de même certaines matières, étendant successivement la nappe des eaux, lui donnent une force qui la fait gonfler ; puis elle se calme peu à peu, et retourne dans son lit.
D'autres encore, n'admettant aucune des explications que nous avons énumérées, prétendent que l'air qui plane sur la mer se transforme continuellement. Cette transformation augmente le volume de l'eau, qui bouillonne et ensuite déborde : c'est ce que l’on appelle le flux. L'eau, à son tour, venant à se transformer par l'évaporation, se change en air, et l'eau retourne dans son lit ; c'est ce que l’on appelle le reflux. Ces deux phénomènes se suivent sans interruption aucune, et tantôt l'eau se transforme en air, et tantôt l'air en eau. Or il est tout naturel que la marée soit plus forte pendant la pleine lune, puisque, à cette époque, tes variations de l'atmosphère sont plus considérables que jamais. Ainsi la lune détermine une marée plus forte, mais non la marée elle-même, puisqu'elle peut bien se montrer pendant que la lune est en décroissance, et que, dans la mer de Perse, le flux et le reflux ont presque toujours lieu vers l'aurore.
Plusieurs des nakhoda, ou patrons de Siraf ou d'Oman, qui naviguent dans ces parages et visitent alternativement tous les endroits habités par les tribus disséminées dans les îles ou sur les côtes voisines, prétendent que le flux et le reflux, dans la plus grande partie de cette mer, se divisent en deux saisons ; l’une d'été, dans la direction du nord-est, durant six mois ; alors la mer hausse dans les régions orientales, en Chine et dans les parages environnants où elle se concentre, pour ainsi dire, à l'exclusion des régions occidentales ; l'autre d'hiver, dans la direction du sud-ouest, durant six autres mois. De sorte qu'au retour de l'été, l'eau qui était très haute dans les régions occidentales vient de nouveau se concentrer dans les parages de la Chine. La mer obéit à l'action des vents. Lorsque le soleil prend sa course vers le nord, un courant d'air s'établit dans la direction du midi, pour des causes que la science explique ; alors l'eau de la mer prend aussi cette direction méridionale ; c'est ainsi que pendant l'été, sous l'influence du veut du nord, la masse des eaux de l'Océan s'accumule et s'élève dans le sud, tandis qu'elle diminue dans les mers septentrion aies. De même, quand le soleil est au midi et que le courant de l'air a lieu du sud au nord, l'eau, suivant cette même direction, quitte les régions méridionales, pour venir affluer dans les régions septentrionales. Or le déplacement des eaux de la mer, dans ces deux directions septentrionale et méridionale, est précisément ce qu'on appelle flux et reflux ; car il est à remarquer que ce qui est flux au sud est reflux au nord, et que ce qui est flux au nord est reflux au sud. Quand la lune vient à se rencontrer avec l’une des planètes pendant l'un de ces déplacements, les deux actions, celle de la chaleur et celle du vent, venant se corroborer mutuellement, le roulement des eaux de la mer sur le côté opposé à celui où se trouve le soleil en devient plus violent. Cette opinion, que la mer subit l'influence du mouvement des vents, est celle d'el-Kendi et d'Ahmed, fils d'et-Taib es-Sarakhsi. Voici ce que j'ai vu dans l'Inde, sur le territoire de la ville de Cambaye, célèbre par ses sandales, nommées sandales de Cambaye, qui y sont d'usage, ainsi que dans les villes voisines, telles que Sendan et Soufareb (Soufalah). J'étais à Cambaye dans l'année 303, alors qu'un brahme nommé Bania y régnait au nom du Balhara, souverain de Mankir. Ce Bania traitait avec la plus grande faveur les musulmans et les sectateurs d'autres religions qui arrivaient dans son pays. La ville de Cambaye est située sur une baie profonde, plus large que le Nil, que le Tigre, ou que l'Euphrate, dont les bords sont parsemés de villes, de métairies, de champs cultivés, de jardins plantés de cocotiers, et où se trouvent des paons, des perroquets et d'autres espèces d'oiseaux de l'Inde qui habitent les parages. Entre la ville et la mer qui forme cette baie il y a un peu moins de deux journées. Cependant le reflux s'y fait sentir avec tant de force, que l'on distingue sans peine le sable qui est au fond, et qu'il ne reste que peu d'eau au milieu même du canal. Je vis un chien couché sur ce sable que l'eau avait laissé à sec, et qui ressemblait à la plaine aride du désert. Tout à coup le flux s'avança de l'ouverture de la baie, pareil à une haute montagne. Le chien, s'apercevant du danger qu'il courait, ramassa toutes ses forces pour gagner la terre ferme ; mais le flot rapide et impétueux l'atteignit dans sa course et le submergea.
Il en est de même de la marée entre Basrah et el-Ahwaz, dans les parages appelés el-Bacian et le territoire de Koundour (Condol). Là on a surnommé ed-Dib « le loup » les mugissements, les bouillonnements et les bruits terribles que fait entendre la mer, et qui effrayent les bateliers. Au surplus, cet endroit est connu de tous ceux qui le traversent pour aller dans le pays de Dawraq et la Perse.
La mer de Roum (Méditerranée) baigne Tarsous, Adanah, Massissah, Antioche, Latakieh, Tripoli, Saida, Sour (Tyr) et d'autres villes de la côte de Syrie, l'Egypte, Alexandrie et la côte du Maghreb. Plusieurs auteurs des Tables, dans leurs ouvrages astronomiques, comme Mohammed fils de Djabir el-Boutani et d'autres, disent que la longueur de cette mer est de cinq mille milles, et que sa largeur varie de huit cents à sept cents et même à six cents milles et moins, selon que la mer est resserrée par le continent ou le continent resserré par la mer. Cette mer commence par un bras qui se détache de l'Océan, et dont la partie la plus étroite est située entre la côte de Tanger et de Ceuta, dans le Maghreb, et la côte d'Espagne. Cet endroit, connu sous le nom de Syta, n'a qu'une largeur d'environ dix milles, qu'il faut traverser pour aller du Maghreb en Espagne et d'Espagne au Maghreb. On le nomme ez-Zokak « le détroit ». Dans la suite de cet ouvrage (quand nous traiterons de l'Egypte) nous parlerons du pont qui reliait les deux côtes d'Europe et d'Afrique, et nous dirons comment il fut submergé. Nous ferons aussi mention du passage qui existe entre l'île de Chypre et le territoire d'el-Arich, et qui était fréquenté par les caravanes.
Au point de jonction de la mer de Roum et de l'Océan se trouvent les phares de cuivre et de pierre bâtis par Hercule le héros ; ils sont couverts de caractères et surmontés de statues qui semblent dire du geste : « Il n'y a ni roule ni voie derrière nous, pour ceux qui, de la mer de Roum, voudraient entrer dans l'Océan. » En effet, aucun navire ne le parcourt ; on n'y trouve pas de terre cultivée et habitée par des êtres raisonnables ; on n'en connaît ni l'étendue ni la fin ; on ignore le but où elle conduit, et on la nomme mer des Ténèbres, mer Verte ou mer Environnante. On a soutenu que ces phares ne s'élevaient pas sur ce détroit, mais sur des îles de la mer Environnante situées près de la côte. C'est une opinion assez généralement répandue, que cette mer est la source de toutes les autres mers. On en raconte des choses merveilleuses, que nous avons rapportées dans notre ouvrage intitulé, les Annales historiques, en parlant de ce qu'ont vu les hommes qui y ont pénétré au risque de leur vie, et dont les uns sont revenus sains et saufs, tandis que les autres ont péri. Ainsi un habitant de l'Espagne nommé Khachkhach, et natif de Cordoue, réunit une troupe déjeunes gens, ses compatriotes, et voyagea avec eux sur l'Océan dans des embarcations qu'il avait équipées. Après une absence assez longue, ils revinrent tous chargés de butin. Au surplus cette histoire est connue de tous les Espagnols.
Entre l'endroit où ce phare est établi et le point où commencent les deux mers, la distance est longue, tant qu'on reste dans ce détroit et qu'on est sous l'influence de son courant, parce que l'eau qui passe de l'Océan à la mer de Roum a un courant sensible et un mouvement considérable.
De la mer de Roum, de Syrie et d'Egypte se détache un canal d'environ cinq cents milles, qui va rejoindre la ville de Rome, et s'appelle dans la langue du pays Adras (Adriatique).
Dans la mer de Roum il y a beaucoup d'îles, comme celle de Chypre, entre la côte de Syrie et celle de Roum, Rhodes en face d'Alexandrie, l'île de Crète et la Sicile. Nous parlerons de cette dernière lorsque nous traiterons de la montagne el-Borkan (l'Etna), qui lance des feux accompagnés de corps et de matières considérables.
Iakoub, fils d'Ishak el-Rendi, el Ahmed, fils de Taib es-Sarakhsi, ne s'accordent pas avec ce que nous avons dit quand ils décrivent la longueur et la largeur de cette mer. Au surplus, nous en parlerons ci-dessous dans cet ouvrage, et nous en donnerons une description d'après l’ordre et la disposition de ce livre.
La mer Nitas s'étend du pays de Lazikah (Laz) jusqu'à Constantinople, sur une longueur de onze cents milles et une largeur qui, à son origine, n'a pas moins de trois cents milles. Elle reçoit les eaux d'un grand fleuve, connu sous le nom de Tanabis (Don), et dont nous avons déjà parlé. Il a sa source dans les régions septentrionales ; ses bords sont habités par de nombreux descendants de Jafet, fils de Noé. Il sort d'un lac considérable situé au nord, et formé par des sources nombreuses et les eaux venant des montagnes. Après avoir coulé l'espace d'environ trois cent mille parasanges, au milieu d'une suite non interrompue de pays cultivés appartenant aux enfants de Jafet, il traverse la mer Mayotis, suivant l'opinion de plusieurs personnes versées dans ces connaissances, puis enfin se décharge dans la mer Nitas. C'est un cours d'eau considérable, dont plusieurs philosophes anciens ont fait mention. On y trouve différentes espèces de minéraux, d'herbes et de drogues. Il y a des personnes qui ne considèrent la mer Mayotis que comme un lac, ne lui donnant en longueur que trois cents milles sur cent milles de largeur.
De la mer Nitas se détache le canal de Constantinople, qui se décharge dans la mer de Roum, après un cours d'environ trois cent cinquante milles. Constantinople est située sur ce canal dont les bords, dans toute leur étendue, sont couverts d'habitations. La ville se trouve sur le côté ouest et fait partie des pays de l'Occident, qui de ce détroit s'étendent jusqu'à ceux de Rome, de l'Espagne et autres. D'après l’opinion des astronomes qui ont dressé des tables, et d'autres savants anciens, la mer des Bulgares, des Russes, des Bedjna ? des Bedjnak (Petchenègues) et des Bedjgourd (Bachkird), dont les trois derniers sont des races turques, est la même que la mer Nitas. Nous reviendrons sur ces peuples, plus bas dans cet ouvrage, s'il plaît à Dieu, à l'endroit où nous croyons devoir les mentionner. Noos énumérerons alors tous leurs établissements, et nous parlerons de celles de ces tribus qui naviguent sur ces mers comme de celles qui n'y naviguent pas. Au surplus, Dieu seul possède la science, et il n'y a de force qu'en lui, l'être suprême et puissant.
La mer des Barbares (Caspienne) qui ont couvert ces parages de leurs établissements, est connue sous le nom de mer de Bab-el-Abwab, mer des Khazars, de Djil (Guilan), de Deïlem, de Djordjan, de Tabaristan. Ses côtes, qui sont occupées par plusieurs tribus turques, se prolongent d'un côté jusqu'au pays de Kharezm et du Khoraçan. Elle a une longueur de huit cents milles, sur une largeur de six cents milles, et représente à peu près un ovale dans le sens de sa longueur.
Nous donnerons ci-dessous, dans cet ouvrage, quelques détails sur les populations qui entourent ces mers si fréquentées. Cette mer, que nous avons nommée mer des Barbares, renferme dans son sein des monstres qu'on appelle tenanin, dont le singulier est tennin.
Il en est de même de la Méditerranée, où les monstres marias sont en grand nombre, surtout dans les parages de Tripoli de Syrie, de Latakieh et de la montagne el-Akra, qui fait partie des dépendances d'Antioche. C'est sous cette montagne que se trouvent les plus grands amas d'eau de toute cette mer ; aussi est-elle appelée par excellence le fondement de la mer. La Méditerranée s'étend jusqu'aux côtes d'Antioche, de Rousis (Rhosus), d'Alexandrie, d'Aias, de Hisn el-Motakkab située au pied du mont Lokkam ; elle baigne la côte de Massissa, où sont les bouches du Djihan, la côte d'Adanah, où se jette le Sihan, et la côte de Tarsous, où se jette l'el-Baredan (Cydnus), appelé aussi fleuve de Tarsous. Le pays qui suit est privé de toute culture et désert ; il forme la limite entre les terres des musulmans et celles des Grecs, du côté de la ville de Kalamieh jusqu'à Chypre, Candie et Karaçia ; puis on rencontre le territoire de Seloukia (Seleucia Trachea) et son grand fleuve (Calycadnus) qui s'y jette dans la mer, et toutes les places fortes du pays de Roum jusqu'au canal de Constantinople. Nous passerons sous silence les nombreux fleuves de cette région qui versent leurs eaux dans la Méditerranée, tels que le fleuve el-Barid, le fleuve el-Açel, etc. Les côtes de cette mer commencent au détroit dont nous avons parlé plus haut, et sur lequel est situé Tanger, dont le territoire se relie au littoral du Maghreb ; puis viennent la région appelée Ifriqiya, es-Sous, Tripoli de Barbarie, Kairowan, la côte de Barkah, er-Rifadeh, Alexandrie, Rosette, Tunis, Damiette, la côte de Syrie et de ses villes frontières, la côte du pays de Roum, s'étendant jusqu'aux terres habitées par les Latins, puis se reliant à la côte d'Espagne, qui vient elle-même aboutir au rivage opposé à Tanger, sur le détroit de Ceuta. Sur toute cette ligne, le continent et le pays habité, soit par des musulmans, soit par des Grecs, ne sont interrompus que par le cours des fleuves, par le canal de Constantinople, dont la largeur est d'environ un mille, et par quelques autres canaux qui, se déchargeant dans la Méditerranée, ne pénètrent pas bien avant dans les terres. Ainsi donc, toutes les contrées riveraines de cette mer forment une suite non interrompue de côtes, se reliant entre elles sans interruption, sauf les échancrures que produisent les fleuves et le canal de Constantinople. La Méditerranée, avec les pays qui l'entourent jusqu'à ce détroit qui sort de l'Océan, et où se trouve le phare, puis la côte de Tanger et celle d'Espagne, ressemble à une coupe dont le détroit serait la poignée. En effet, une coupe figure assez exactement cette mer, qui cependant n'est pas ronde, d'après ce que nous avons dit de sa longueur.
On ne connaît point de monstres marins dans la mer de l’Abyssinie, ni dans les golfes qui en dépendent et que nous avons décrits ; mais ils abondent du côté de l'Océan. Au surplus, les opinions varient sur leur origine et leur nature. Les uns pensent que le tennin est un vent noir qui se forme au fond des eaux, monte vers les couches supérieures de l'atmosphère et s'attache aux nuages, semblable au zoubaak (trombe de terre), qui se soulève sur le sol et fait tournoyer avec lui la poussière et tous les débris de plantes desséchées et arides. Ce vent s'étend sur un plus grand espace à mesure qu'il s'élève dans le» airs, de sorte qu'en voyant ce sombre nuage accompagné d'obscurité et de tempêtes, on a cru que c'était un serpent noir sorti de la mer.
D'autres pensent que le tennin est un reptile qui vit dans les profondeurs de l'Océan ; devenu fort, il fait la guerre aux poissons, et alors Dieu lui envoie les nuages et les anges, qui le font sortir de l'abîme sous la forme d'un serpent noir, brillant et luisant, dont la queue renverse sur son passage les édifices les plus solides, les arbres, même les montagnes, et dont le souffle seul déracine une multitude de troncs vigoureux. Le nuage le jette dans le pays de Yadjoudj et Madjoudj, où il fait pleuvoir sur lui une grêle qui le tue, après quoi sa chair sert de nourriture aux peuplades de Yadjoudj et Madjoudj. Telle est l'opinion qui est attribuée à Ibn Abbas. Il existe encore d'autres opinions sur le tennin. Les historiens et les compilateurs d'anecdotes fournissent à cet égard beaucoup de détails du même genre, que nous nous abstiendrons de mentionner ici. Ainsi les tennins seraient des serpents noirs, vivant d'abord dans les plaines et les montagnes, où les torrents et les pluies, les surprenant, les entraînent dans la mer. Là, nourris des nombreux reptiles qu'elle renferme, leurs corps deviendraient énormes, et leur vie d'une grande durée. Celui de ces serpents qui aurait atteint cinq cents ans serait le maître de tous les autres serpents de la mer, et alors arriverait ce que nous venons de rapporter d'après Ibn Abbas. Enfin il y aurait des tennins noirs et d'autres blancs comme le sont les serpents eux-mêmes.
Les Persans, bien loin de nier l'existence du tennin dans la mer, prétendent qu'il a sept têtes et l'appellent adjduhan. Ils y font souvent allusion dans leurs récits. Dieu seul sait la vérité dans tout cela. Au surplus, comme beaucoup d'esprits rejettent les histoires de ce genre, et que bien des intelligences ne les acceptent pas, nous ne nous risquerons pas à les rapporter. Telle est l'aventure d'Amran, fils de Djabir, qui remonta le Nil jusqu'à sa source et traversa la mer sur le dos d'un animal qu'il tenait fortement par la crinière. C'est un animal marin d'une telle dimension, qu'à le mesurer seulement jusqu'à une petite partie de ses jambes, il dépasse le disque du soleil, depuis le commencement de son lever jusqu'à son coucher. Le monstre avait la gueule ouverte dans la direction du soleil, comme pour l'aspirer. Amran passa la mer en se cramponnant à la crinière de cet animal, tandis qu'il était en mouvement ; il vit ainsi l'eau du Nil venant du paradis et jaillissant de certains châteaux d'or. Après avoir reçu du roi une grappe de raisin, il retourna chez l'homme qui l'avait vu partir, et qui lui avait enseigné comment il devait faire pour remonter à la source du Nil ; mais il le trouva mort. Ensuite Amran, avec sa grappe de raisin, eut affaire au diable. Ce récit, et d'autres plus merveilleux encore inventés après coup, sont dus à l'imagination des traditionnistes. Il en est ainsi d'une prétendue coupole d'or située au milieu de la mer Verte, et portée sur quatre colonnes de rubis vert, rouge, bleu et jaune. De ces quatre colonnes suinte une grande quantité d'eau qui se répand dans la mer Verte, vers les quatre points cardinaux, sans jamais se mêler ni se perdre. Arrivée aux côtés différents du littoral de la mer, cette eau forme le Nil, ailleurs le Sihan, en un troisième lieu le Djihan, et enfin l’Euphrate. Un autre conte du même genre nous représente l'ange chargé de la surveillance des mers, posant le pied sur l'extrémité de la mer de Chine ; l’eau fuit devant lui en bouillonnant, et il en résulte le flux ; lorsque l'ange retire son pied. L’eau, revenant à sa première place et rentrant dans son lit, produit le reflux. C'est exactement comme un vase à moitié rempli d'eau. Si l’on y place la main ou le pied, l’eau monte jusqu'aux bords du vase ; si on les retire, elle rentre dans ses limites. D'autres prétendent que l'ange met seulement le pouce de sa main droite dans la mer pour produire le flux, et qu'il l'en retire pour faire naître le reflux.
Les choses que nous venons de raconter ne sont ni absolument impossibles, ni imposées à notre croyance, mais entrent dans la catégorie de ce qui est possible et admissible. Comme tradition elles proviennent de simples individus, et ne portent pas le caractère de ces histoires qui ont été transmises par une suite non interrompue d'hommes dignes de foi, ni de celles qui se sont répandues sans contestation parmi les musulmans, qui deviennent obligatoires dans la théorie comme dans la pratique, et qu'il n'est pas permis de rejeter. Lorsque des traditions de cette espèce sont accompagnées de preuves qui en démontrent la vérité, on doit les accepter avec soumission, et s'y conformer ; quant aux récits contenus dans l'Écriture et aux règles de conduite qu'ils nous tracent, il faut obéir à ce précepte du Koran (lii, 7) : « Ce que le Prophète vous apporte, acceptez-le ; ce qu'il vous refuse abstenez-vous-en. » Quant aux légendes que nous avons rapportées, quoique dénuées de preuves, nous avons voulu en faire mention afin de bien convaincre le lecteur que dans ce livre, comme dans nos autres écrits, nous avons examiné scrupuleusement les faits que nous avons recueillis, et que les sujets que nous y traitons ne nous sont pas étrangers.
Quant aux mers qui se trouvent sur la partie habitée de ce globe, on fixe généralement leur nombre à quatre ; d'autres en comptent cinq, d'autres six, d'autres, enfin, en reconnaissent jusqu'à sept, toutes bien distinctes les unes des autres et sans communication. Nous citerons d'abord la mer d'Abyssinie, puis la Méditerranée, puis la mer Ni ta s, puis la mer Mayotis, puis la mer des Khazars, puis enfin l'Océan, dont on ne connaît pas les limites, et qui est aussi nommé mer Verte, mer Ténébreuse ou mer Environnante. La mer Nitas communique avec la mer Mayotis, et se joint à la Méditerranée par le canal de Constantinople qui s'y décharge. Comme nous l'avons dit, cette dernière tirant elle-même son origine de la mer Verte, toutes ces mers ne formeraient, suivant cette description, qu'une seule et même masse d'eau, dont toutes les parties se relient entre elles. Toutefois ces mers ni aucun de leurs affluents n'ont de communication avec la mer d'Abyssinie.
Le Nitas et le Mayotis ne doivent être qu'une seule et même mer, quoique le continent les resserre à un certain endroit, et qu'il y ait un canal qui les réunit l'une à l'autre. Si dans l'usage on a appelé Mayotis la portion la plus large de cette mer, celle où l'eau est le plus abondante, et Nitas la partie resserrée et peu profonde, il n'en est pas moins certain que chacune de ces dénominations les désigne toutes deux, et si dans certains passages de ce livre nous disons Mayotis ou Nitas, nous entendrons toujours par là aussi bien la portion large de cette mer que celle qui est étroite.
Bien des personnes ont avancé, mal à propos, que la mer des Khazars communiquait avec la mer Mayotis. Quant à moi, parmi tous les négociants qui avaient parcouru le pays des Khazars ou qui avaient traversé la mer Mayotis et la mer Nitas pour se rendre chez les Russes et les Bulgares, je n'en ai vu aucun qui prétendît que la mer des Khazars communiquât avec l’une de ces mers, ou bien avec l'un de leurs affluents ou des canaux qui les réunissent ; elle n'a de communication qu'avec le fleuve des Khazars, ce dont nous parlerons plus bas, lorsqu'il sera question du mont Kabk (Caucase), de la ville d'el-Bab wel-abwab, du royaume des Khazars, et de la manière dont les Russes, dans le ive siècle (de l'hégire), pénétrèrent avec des vaisseaux dans cette mer. Je sais aussi que la plupart des auteurs anciens ou modernes qui se sont occupés de la description des mers affirment que le canal de Constantinople, qui se détache de la mer Mayotis, communique avec la mer des Khazars ; mais j'ignore comment cela est possible et sur quoi ils fondent cette opinion, si elle est le résultat de leurs propres observations, ou s'ils y ont été conduits par l'induction ou l'analogie. Peut-être aussi ont-ils confondu les Russes et les populations riveraines de la mer Mayotis avec les Khazars. J'ai fait moi-même le voyage par mer d'Abeskoun, port du Djordjan, au pays de Tabaristan et ailleurs, et j'ai interrogé sans cesse à ce sujet tous les négociants un peu intelligents et les patrons de navire : tous m'ont affirmé qu'il est impossible d'arriver dans ces parages autrement que par la mer des Khazars et par la voie que les vaisseaux des Russes ont prise. Ces habitants de ('Azerbaïdjan, d'Erran, de Beilakan, du territoire de Berdah et des autres villes ; ceux du Déilem, du Djebel (Irak persan) et du Tabaristan avaient fui de ce côté, parce que jamais, de mémoire d'homme, dans les temps passés un ennemi ne s'y était présenté, et que rien dans leur histoire ancienne ne le leur rappelait. Ce que nous avançons est connu dans ces contrées et parmi ces peuplades, et d'une notoriété si manifeste, que personne ne songe à la contester. Au surplus, cet événement avait eu lieu dans le temps d'Ibn Abi-es-Sadj.
Dans certains ouvrages attribués à el-Kendi et à son disciple es-Sarakhsi, l'ami d'el-Motaded billah, j'ai lu qu'aux limites de la terre habitée, vers le nord, se trouvait un grand lac situé sous le pôle arctique, et près de ce lac une ville, la dernière des régions connues, et qui s'appelle Toulieh. Il est également fait mention de ce lac dans l'un des traités des Béni Muneddjim.
Dans son traité des mers, des eaux et des montagnes, Ahmed, fils de Taïb es-Sarakhsi, avance, d'après el-Kendi, que la Méditerranée a six mille milles de long à partir de Sour, Tripoli, Antioche, el-Motakkab, la côte de Massissa, de Tarsous, de Kalamiyeh, jusqu'aux phares d'Hercule, et que sa plus grande largeur est de quatre cents milles. Nous avons rapporté en totalité l'opinion des deux écoles, et nous avons fait ressortir la différence qui existe à cet égard entre elles et les auteurs des tables astronomiques, telle que nous l'avons trouvée dans leurs ouvrages ou entendu exposer par leurs partisans. Mais nous laisserons de côté les preuves que chacun donne à l'appui de ses opinions, parce que nous nous sommes fait une loi dans ce livre d'être bref et concis. Il en est autrement pour les explications contradictoires qui ont été données par les anciens, tels que les premiers Grecs et les philosophes des temps passés, sur l'origine et la formation primitive des mers. Bien que nous ayons traité ce sujet avec étendue dans le second des trente livres qui composent nos Annales historiques, où nous avons exposé les différents systèmes, en les rapportant à ceux qui les avaient imaginés, nous ne pouvons pas nous dispenser d'en présenter ici un résumé succinct.
Les uns disent que la mer est un reste de l'humidité primitive, dont la plus grande partie a été desséchée par le feu, et dont le surplus s'est transformé sous l'influence de la chaleur ; d'autres soutiennent que l'humidité primitive tout entière ayant été soumise à l'action dévorante du soleil dans ses révolutions, toutes les parties pures en ont été exprimées, et le reste s'est converti en une matière salée et amère ; d'autres encore pensent que les mers ne sont que des sécrétions, qui découlent de la terre brûlée par la chaleur du soleil accomplissant autour d'elle sa révolution constante. Quelques-uns croient que la mer n'est autre chose que l'humidité primitive dégagée de tout principe terrestre et grossier, exactement comme l'eau douce mélangée avec de la cendre perd sa douceur et conserve un goût salin, même après qu'elle a été filtrée. On a prétendu aussi que dans l'eau les parties douces et salées étaient mélangées, que le soleil volatilisait les parties douces à cause de leur subtilité, soit qu'il les absorbât lui-même, soit qu'une fois parvenues à de hautes régions où le froid les condense et leur donne, pour ainsi dire, une forme, elles se changent une seconde fois et eau. On a avancé que l'eau étant un élément, les molécules qui se trouvent dans l'air et sous l'action du froid ont une saveur douce, tandis que les molécules qui restent à terre contractent une saveur amère, sous l'influence de la chaleur qui les pénètre. Plusieurs savants ont soutenu que la masse d'eau qui s'écoule dans la mer, soit de la surface du sol, soit de ses entrailles, étant une fois arrivée dans ce vaste réservoir, sollicite partout, pour les absorber, les principes salins que la terre décharge sur elle. Les molécules de feu que renferme l'eau, et la chaleur qui la pénètre au sortir de la terre, en dégagent les parties les plus subtiles et les font monter en nuages de vapeurs ; puis ces nuages, selon une loi rigoureuse et constante, retombent sous forme de pluie dont l'eau reprend une saveur amère. La terre lui donnant un goût salé et le feu la dégageant de ses principes doux et subtils, elle revient nécessairement à sa première amertume. Il ne faut donc pas s'étonner si l'eau de la mer conserve toujours le même poids et la même mesure, puisque les parties subtiles que la chaleur lui enlève se changent en rosée et en eau d'où naissent les torrents qui cherchent les rigoles, les étangs, et coulent dans les parties humides de la terre, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin au vaste gouffre de l'Océan. C'est ainsi qu'il ne se perd absolument rien de cette eau, et que les sources sont comme les machines qui, puisant l'eau d'un fleuve, la versent dans une rigole d'où elle s'écoule de nouveau dans ce fleuve. On a comparé ce phénomène à ce qui se passe dans le corps d'un être animé au moment de la nutrition ; sous l'influence de la chaleur, elle attire vers les membres les parties douces des aliments consommés, et laisse les parties lourdes imprégnées de sel et d'amertume, telles que l'urine et la sueur. Ces résidus sans douceur proviennent cependant de matières humides et douces que la chaleur a rendues amères et salées. Si la chaleur interne croissait outre mesure, l'amertume augmenterait en proportion dans la sueur et dans l'urine, parce que tout ce qui a été soumis à l'action de la chaleur devient amer. Cette opinion a été émise par un grand nombre d'auteurs anciens ; mais on peut voir de ses yeux, par expérience, que toutes les matières humides et douées d'une certaine saveur, ayant passé par la cornue et l'alambic, conservent dans leur sublimé la même odeur et la même saveur, comme le vinaigre le vin de dattes, la rosé, le safran, la giroflée, excepté toutefois les matières salées qui changent de goût et d'odeur, surtout lorsqu'on les soumet deux fois à l'opération du feu et de l'alambic. L'auteur de la Logique (Aristote) est entré dans beaucoup de détails à ce sujet. Ainsi, par exemple, il affirme que l'eau salée est plus pesante que l'eau douce, et il en allègue pour preuve que la première est trouble et épaisse, tandis que l'autre est pure et limpide. Il fait encore remarquer que si l'on fait un vase de cire dont on bouche l'orifice, et qu'on le plonge dans la mer, on pourra constater que l'eau qui aura pénétré dans le vase sera douce et légère, tandis que l'eau qui entoure les parois extérieures du vase aura cru en amertume et en salure.
Toute eau courante est un fleuve ; l'endroit d'où jaillit l'eau est une source ; un lieu où se trouve une grande quantité d'eau est une mer.
On a longuement discuté sur la nature des eaux et sur leur composition. Dans le deuxième des trente livres dont se composent nos Annales historiques, nous avons rapporté tout ce qui a été dit sur la mesure et l'étendue des mers, sur l'utilité que présente la salure des eaux de la mer, sur l'existence ou sur le manque de communications entre ces mêmes eaux. Nous avons expliqué pourquoi elles ne subissent ni augmentation ni diminution apparentes, pourquoi le flux et le reflux sont plus sensibles dans la mer d'Abyssinie que partout ailleurs. J'ai remarqué que les navigateurs de Siraf et d'Oman, qui parcourent les mers de la Chine, de l'Inde, de Sind, du Zendj (Zanguebar), du Yémen, de Kolzoum et de l'Abyssinie, n'étaient point généralement d'accord avec les philosophes, dont nous avons retracé les opinions, sur l'étendue et la mesure de ces mers ; ils soutiennent même qu'à certains endroits, l'immensité des eaux n'a pas de limites. J'ai fait la même observation dans la Méditerranée, auprès des nawatieh, ou capitaines des vaisseaux de guerre et de commerce, auprès des officiers et des pilotes, enfin auprès de ceux qui sont préposés dans ces parages à la surveillance de la marine militaire, comme Lawi, surnommé Aboulharis, serviteur de Zorafah et gouverneur, vers l'an 300, de Tripoli de Syrie, sur la côte de Damas. Tous exagèrent la longueur et la largeur de la Méditerranée, le nombre de ses canaux et de ses ramifications. Au surplus, cette vérité m'a été confirmée par Abdallah ben Wezir, gouverneur de la ville de Djebelah, sur la côte de Heras, en Syrie, homme qui passe aujourd'hui, en 332, pour le plus entendu et le plus habile marin de la Méditerranée, puisqu'il n'y a pas un capitaine de bâtiment de guerre ou de commerce, naviguant sur cette mer, qui ne se laisse guider par ses paroles, et qui ne rende hommage à la supériorité de son intelligence, de son habileté, à son jugement sain, à son expérience incontestable. Nous avons parié dans nos ouvrages précédents des merveilles de ces mers, et nous y avons consigné les aventures extraordinaires et périlleuses que les personnes mentionnées plus haut nous avaient racontées comme témoins oculaires ; plus tard nous donnerons encore quelques détails sur ce sujet.
Parlons maintenant des signes indicateurs de la présence de l'eau dans certains endroits. C'est une opinion assez accréditée que partout où croissent des roseaux, des joncs et d'autres plantes flexibles, on n'a qu'à creuser à une profondeur peu considérable pour rencontrer l'eau. Dans toute autre condition il faudrait pénétrer très avant dans la terre pour la trouver. Voici ce que j'ai lu dans le Livre de l'agriculture : « Celui qui veut savoir si l'eau est peu ou très éloignée de la surface du sol, doit creuser la terre à une profondeur de trois à quatre coudées. Il choisira un vase de cuivre ou un bassin d'argile ayant un large orifice, et garnira ses parois intérieures d'une couche de graisse égale partout. Au soleil couché, il prendra de la laine blanche cardée et lavée, et une pierre de la grosseur d'un œuf qu'il enveloppera de cette laine, de manière à lui donner la forme d'une boule. Ensuite il enduira les côtés de cette boule de cire fondue, la fixera au fond du vase qu'il aura graissé avec de l'huile ou tout autre corps gras, puis il descendra le tout dans la fosse ; la laine doit être bien attachée et fortement retenue par la cire, de sorte qu'elle enveloppe hermétiquement la pierre. Alors il jettera de la terre sur ce vase, et l'enfouira à la hauteur d'une, deux, ou plusieurs coudées, et le laissera ainsi pendant toute la nuit ; te lendemain, avant le lever du soleil, il ôtera la terre et enlèvera le vase. Si ses parois intérieures sont parsemées de gouttelettes nombreuses et rapprochées les unes des autres, si la laine est imprégnée d'humidité» il faut en conclure que l'eau n'est pas éloignée. Si les gouttelettes ne sont pas groupées les unes autour des autres, si la laine n'est que médiocrement humectée, c'est une preuve que l'eau n'est ni très près ni très loin ; si les gouttelettes sont dispersées à de rares intervalles, et que la laine soit à peine mouillée, l'eau doit se tenir à une grande distance ; mais s'il n'y a aucune trace d'humidité, soit dans le vase, soit sur la laine, ce serait peine per due que de creuser dans cet endroit pour y chercher de l'eau. » Dans quelques exemplaires du Livre de l'agriculture j'ai trouvé cet autre renseignement sur le même sujet : « Pour savoir si l'eau est à une distance plus ou moins grande, il faut examiner attentivement les fourmilières. Si les fourmis sont grosses, noires, peu agiles, l'eau est d'autant plus proche qu'elles sont plus lourdes à se mouvoir. Si elles sont si légères dans leur course qu'à peine peut-on les atteindre, l'eau doit être à une distance de quarante coudées. Autant dans le premier cas l'eau sera bonne et douce, autant dans le second elle sera pesante et salée. C'est d'après cet indice que se guidera celui qui vent trouver de l'eau. » Nous avons traité cette matière avec étendue dans nos Annales historiques. Nous nous bornerons, dans le présent ouvrage, à mentionner brièvement tout ce qu'il sera indispensable de faire connaître. Après avoir traité des mers en général, nous parlerons, s'il plaît à Dieu, de l'histoire de la Chine, et de tout ce qui concerne ce sujet.
On n'est pas d'accord sur la généalogie et l'origine des habitants de la Chine. Plusieurs disent qu'à l'époque où Phaleg, fils d'Abir, fils d'Arfakhchad fils de Sam, fils de Noé, partagea la terre entre les descendants de Noé, les enfants d'Amour, fils de Soubil, fils de Jafet, fils de Noé, prirent la direction du nord-est. De là une partie d'entre eux, les descendants d'Arou, s'avancèrent vers le nord, où ils se répandirent au loin et fondèrent plusieurs royaumes, tels que le Déilem, le Djil (Guilan), le Teileçan, le Teber, le Moukan, sans compter ceux fondés par les peuplades du Caucase, telles que les Lakz, les Alains, les Khazars, les Abkhazes, les Serirs, les Kosaks, et par les autres nations, dispersées dans ces contrées, jusqu'à Tarrazzobdeh (Trébizonde), les mers Mayotis et Nitas d'un côté, et celle des Khazars de l'autre côté, jusqu'aux Bulgares, et aux peuples qui se sont réunis à eux. D'autres descendants d'Amour traversèrent le fleuve de Balkh (Djeïhoun), et se dirigèrent pour la plupart vers la Chine. Là ils se répartirent entre plusieurs états, et s'établirent dans ces diverses contrées, comme les Khottals, qui habitent Khottolan, Rouçan, el-Ochrousneh et le Sogd, entre Boukhara et Samarkand ; les Ferganides, les habitants de Chach, d'Istidjab et du territoire d'Alfarab. Ceux-ci fondèrent des villes et des bourgs ; d'autres se séparèrent d'eux pour habiter les plaines, comme les Turcs, les Kozlodjs, les Tagazgaz, qui occupent la ville de Kouchan (Kao-tchang), située entre le Khoraçan et la Chine, et qui sont aujourd'hui, en 332, de toutes les races et tribus turques, la plus valeureuse, la plus puissante et la mieux gouvernée. Leurs rois portent le titre d'Irkhan, et seuls entre tous ces peuples ils professent la doctrine de Manès. Parmi les Turcs il y a les Keimaks, les Varsaks, les Bediyehs, les Djariyehs, les Gouzes (Ouzes), qui sont les plus braves de tous, et les Khozlodjs, qui se distinguent par leur beauté, leur haute stature et la perfection de leurs traits. Ces derniers sont répandus sur le territoire de Ferganah, de Chach et des environs. Ils dominaient autrefois sur toutes les autres tribus ; de leur race descendait le Khakan des khakans, qui réunissait sous son empire tous les royaumes des Turcs, et commandait à tous leurs rois.
Parmi ces khakans se trouvèrent Afrasiab le Turc, le conquérant de la Perse, et Chaneh. Aujourd'hui les Turcs n'ont plus de khakan auquel leurs autres rois obéissent, depuis la ruine de la ville d'Amat, dans les déserts de Samarkand. Nous avons raconté dans notre Histoire moyenne dans quelles circonstances cette ville perdit la souveraineté.
Une fraction des descendants d'Amour atteignit les frontières de l’Inde, dont le climat exerça une telle influence sur eux qu'ils n'ont plus la couleur des Turcs, mais plutôt celle des Indiens. Ils habitent soit dans les villes, soit sous la tente. Une autre portion encore alla se fixer dans le Thibet et se donna un roi qui était soumis à l'autorité du khakan ; mais depuis que la suprématie de ce souverain a cessé, comme nous venons de le dire, les habitants du Thibet donnent à leur chef le titre de khakan, en mémoire des anciens rois turcs, qui portaient le titre de Khakan des khakans.
La majorité des descendants d'Amour suivit le littoral de la mer et arriva ainsi jusqu'aux extrémités de la Chine. Là ils se répandirent dans ces contrées, y fondèrent des habitations, cultivèrent la terre, établirent des districts, des chefs-lieux et des villes, et y prirent pour capitale une grande ville qu'ils nommèrent Anmou. De cette capitale à la mer d'Abyssinie ou mer de Chine, sur un parcours de trois mois de distance, on rencontre une suite non interrompue de villes et de pays cultivés. Le premier roi de ce pays qui ait résidé à Anmou fut Nostartas, fils de Baour, fils de Modtedj, fils d'Amour, fils de Jafet, fils de Noé. Durant un règne de plus de trois cents ans, il répartit la population dans ces contrées, creusa des canaux, extermina les bêtes féroces, planta des arbres et rendit général l'usage de se nourrir de fruits. Il eut pour successeur son fils Aoun. Ce prince, voulant témoigner de sa douleur, et rendre hommage à la mémoire de son père, fit placer le corps dans une statue d'or rouge, qu'on posa sur un trône d'or incrusté de pierreries, et qui dominait son propre siège ; lui-même et ses sujets se prosternaient respectueusement malin et soir devant cette image qui renfermait la dépouille mortelle du roi. Après un règne de deux cent cinquante ans, il mourut et laissa l'empire à son fils Aitdoun. Celui-ci enferma aussi le corps de son père dans une statue d'or qu'il plaça sur un trône de même métal, au-dessous du rang qu'occupait son grand-père ; pais il avait coutume de se prosterner d'abord devant ce dernier et ensuite devant son père, et ses sujets l'imitaient. Ce roi gouverna ses sujets avec sagesse, les traita en toutes choses sur le pied de l'égalité, et se montra juste envers tous. Par ses soins la population et la fertilité du pays s'accrurent dans une large proportion. Son règne dura près de deux cents ans ; puis son fils Aitnan lui succéda. Ce prince, se conformant à l'exemple de ses prédécesseurs, enferma le corps de son père dans une statue d'or, et rendit toutes sortes d'hommages à sa mémoire. Pendant son règne, qui fut d'une longue durée, il recula les frontières de son pays jusqu'à celui des Turcs ses cousins. Il vécut quatre cents ans, et ce fut sous lui que les Chinois trouvèrent plusieurs de ces procédés ingénieux qui donnent tant de délicatesse à leurs ouvrages. Son fils Haratan, qui monta sur le trône après lui, fit construire des vaisseaux sur lesquels il embarqua des hommes chargés d'exporter les produits les plus précieux de la Chine dans le Sind, l'Hindoustan, la Babylonie et tous les pays plus ou moins éloignés du littoral de la mer. Ils devaient offrir de sa part aux souverains de ces contrées des présents merveilleux et de la plus grande valeur, et lui rapporter, à leur retour, ce que chaque province renfermerait de plus délicat et de plus rare même, en fait de comestibles, de boissons, d'étoffes et de végétaux. Ils avaient en outre pour commission de s'appliquer à connaître le gouvernement de chaque roi, la religion, les lois et les coutumes de toutes les nations qu'ils visiteraient, et d'inspirer aux étrangers le goût des pierreries, des parfums et des instruments de leur patrie. Les vaisseaux se dispersèrent dans toutes les directions, parcoururent les pays étrangers, et exécutèrent les ordres qui leur avaient été donnés. Partout où ils abordaient, ces envoyés excitaient l'admiration des habitants par la beauté des échantillons qu'ils avaient apportés avec eux. Les princes dont les États étaient baignés par la mer firent aussi construire des vaisseaux qu'ils expédièrent en Chine avec des produits étrangers à ce pays, entrèrent en correspondance avec son roi, et lui adressèrent des cadeaux en retour de ceux qu'ils avaient reçus de lui. C'est ainsi que la Chine devint florissante et que le sceptre se consolida dans les mains de ce souverain. Il mourut après un règne d'environ deux cents ans. Ses sujets, inconsolables de sa perte, portèrent le deuil pendant un mois ; puis ils confièrent leur sort à son fils aîné, qu'ils prirent pour roi. Celui-ci, qui s'appelait Toutal, renferma le corps de son père dans une statue d'or, et suivit, en fidèle imitateur, l'exemple de ses ancêtres. Durant son règne, qui fut prospère, il introduisit dans l'État de sages coutumes, ignorées des premiers rois. Il disait que la seule base de l'empire était l'équité, parce qu'elle est la balance du Créateur, et que l'application à faire le bien ainsi que l'activité incessante faisaient partie de l'équité. Il donna à ses Sujets des distinctions, créa des degrés de noblesse et leur décerna des couronnes d'honneur. Il les classa ainsi suivant leur rang, et leur ouvrit à tous une carrière bien distincte. Comme il se fut mis à la recherche d'un emplacement propre à la construction d'un temple, il trouva un lieu fertile, émaillé de fleurs et bien arrosé, où il jeta les fondements de cet édifice. Il y fit apporter toutes sortes de pierres de différentes couleurs, dont on bâtit le temple au sommet duquel on éleva une coupole garnie de ventilateurs ménagés avec symétrie. On pratiqua des cellules dans la coupole, pour ceux qui voudraient se consacrer entièrement au service de Dieu. Lorsque le tout fut achevé, le roi fit placer au faîte du monument les statues qui renfermaient les corps de ses ancêtres, et dit : « Si je n'agissais pas ainsi, j'enfreindrais les règles de la sagesse, et le temple ne serait d'aucune utilité. » Il ordonna donc de vénérer ces corps placés au sommet de la coupole.
Ayant appelé auprès de lui les principaux personnages de l'État, il leur dit qu'il jugeait indispensable de réunir tous les peuples sous le joug d'une seule et unique croyance qui leur servirait de lien, et garantirait parmi eux l'ordre et la sécurité ; qu'un empire où ne régnaient ni l'ordre ni les lois était exposé à toutes sortes de dommages et menacé d'une ruine prochaine. Il institua donc un code destiné à régir ses sujets, et leur prescrivit comme obligatoires des règles de conduite fondées sur la raison. Il mit en vigueur la peine du talion pour les meurtres » les blessures, et il promulgua des règlements qui déterminaient la légitimité des alliances et fixaient les droits des enfants qui en étaient issus. Parmi les lois qu'il créa, les unes étaient obligatoires, absolues ; on ne pouvait les transgresser sans crime ; les autres étaient surérogatoires et facultatives. Il prescrivit comme un devoir à ses sujets de se mettre en relation avec leur Créateur par des prières qu'ils lui adresseraient à certaines heures du jour et de la nuit, sans toutefois s'incliner ni se prosterner. Il y avait d'autres prières annuelles ou mensuelles, dans lesquelles les inclinations et les prosternations étaient de rigueur. En outre il institua des fêtes solennelles. Il fit des règlements sur la prostitution, et astreignit à payer une taxe les femmes qui vivaient dans le désordre, en leur permettant toutefois de se racheter par le mariage ou par le retour à des mœurs plus régulières. Leurs enfants mâles appartenaient au roi comme soldats ou esclaves, et les filles restaient auprès de leurs mères et se consacraient au même métier. Il ordonna aussi qu'on offrirait des sacrifices dans les temples, et qu'on brûlerait de l'encens en l'honneur des étoiles, en déterminant d'avance à quelles époques, et avec quels parfums et quelles plantes aromatiques on rendrait le culte à chacun des astres. Le règne de ce prince fut heureux ; il mourut, entouré d'une nombreuse postérité, à l'âge d'environ cent cinquante ans. Ses sujets, très affligés de sa perte, placèrent ses restes dans une statue d'or incrustée de pierreries, et bâtirent en son honneur un temple magnifique, au sommet duquel ils mirent sept pierres précieuses différentes, qui représentaient la couleur et la forme du soleil, de la lune et des cinq autres planètes. Le jour de sa mort devint un jour de prières et un anniversaire où l'on se réunissait dans ce temple. Au sommet, en vue de tout le monde, fut fixée une table d'or sur laquelle étaient gravés l'image du défunt et le récit de ses plus belles actions, pour servir de modèle à tous ceux qui, après lui, se chargeraient de gouverner les peuples et de les policer. On grava aussi son image sur les portes de la ville, sur les pièces d'or, sur la menue monnaie de cuivre et de bronze, qui était très abondante, et on l'imprima sur des étoffes.
Le siège du gouvernement chinois fut définitivement fixé à Anmou, grande ville située, comme nous l'avons déjà dit, à plus de trois mois de marche de la mer. Il y a vers le couchant, dans la direction du Thibet, une autre grande ville appelée Med. Ses habitants sont continuellement en guerre avec les Thibétains. Les rois qui succédèrent à Toutal se virent sans cesse dans l'état le plus prospère ; l'abondance et la justice régnèrent dans leur empire, dont la violence était bannie, car ces princes observèrent fidèlement les lois que leur prédécesseur avait prescrites. Dans la guerre ils furent victorieux de leurs ennemis ; la sécurité régna sur leurs frontières, la solde fut régulièrement payée à leurs troupes, et les négociants de tous les pays affluèrent par terre et par mer avec toutes sortes de marchandises.
Le culte des Chinois, c'est-à-dire le culte ancien, n'était autre que le culte samanéen ; il avait beaucoup d'analogie avec les pratiques religieuses des Koraïchites avant l'islamisme, lesquels adoraient les idoles et leur adressaient des prières. Ces prières, il est vrai, étaient adressées d'intention au Créateur lui-même ; les images et les idoles servaient seulement de Kiblah, ou de point vers lequel on se tourne en priant. Mais les ignorants et les gens sans intelligence associaient les idoles à la divinité du Créateur, et les adoraient également. Le culte des idoles était une manière de s'approcher insensiblement de Dieu, et, bien que cette manière de le servir fût une dérogation à la majesté, à la grandeur et à la puissance du Créateur, le culte rendu à ces idoles n'était cependant qu'une marque de soumission et un intermédiaire pour s'élever jusqu'à la divinité. Il en était ainsi en Chine, jusqu'à ce que les théories, les systèmes des sectes dualistes et des innovateurs se fissent jour. Avant cette époque, les croyances et les opinions des Chinois, ainsi que le culte qu'ils rendaient aux idoles, étaient conformes aux idées et aux pratiques religieuses de toutes les classes de la population dans l'Inde. Quelque considérables que fussent les changements qui s'opérèrent dans leur état social, quelque nombreuses que fussent chez eux les discussions soulevées par l'esprit d'investigation, ils se conformèrent toujours dans leurs décisions juridiques aux anciennes lois qu'ils tenaient de la tradition. Leur royaume est contigu à celui des Tagazgaz, qui, comme nous l'avons dit plus haut, sont manichéens et proclament l'existence simultanée des deux principes de la lumière et des ténèbres. Ces peuples vivaient dans la simplicité et dans une foi semblable à celle des races turques, lorsque vint à tomber parmi eux un démon de la secte dualiste, qui, dans un langage plein de séduction, leur fit voir deux principes contraires dans tout ce qui existe au monde : comme la vie et la mort, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, la lumière et l'obscurité, l'union et la séparation, la jonction et la scission, le levant et le couchant, l'être et le néant, la nuit et le jour, etc. Puis il leur parla des incommodités diverses qui atteignent les êtres raisonnables, les animaux, les enfants, les idiots, les fous, et il ajouta que Dieu ne pouvait pas être responsable de ce mal, qu'il y avait là une contradiction choquante avec le bien qui distingue ses œuvres, et qu'il était au-dessus d'une pareille imputation. Par ces subtilités et d'autres semblables, il entraîna les esprits et leur fit adopter ses erreurs. Aussi longtemps que le prince régnant en Chine était samanéen et sacrifiait des animaux, il était en guerre continuelle avec l'Irkhan, roi des Turcs ; mais depuis qu'il est dualiste, ils vivent en bonne intelligence. Malgré la diversité de leurs opinions et de leurs croyances, les rois de la Chine ne cessaient de se conformer aux jugements de la saine raison dans le choix qu'ils faisaient des juges et des gouverneurs, et les grands comme les petits se réglaient d'après les principes de la sagesse.
Les Chinois se divisent en tribus et en branches, comme les Arabes, et leurs généalogies présentent autant de ramifications. Ils en font grand cas et les conservent précieusement dans leur mémoire, au point que quelques-uns remontent par près de cinquante générations jusqu'à Amour. Les gens d'une tribu ne se marient pas entre eux. C'est ainsi qu'un homme de Modar épouserait une femme de Rebiah, ou un homme de Rebiah une femme de Modar, qu'un descendant de Kahlan s'unirait à une femme de Himiar, et un homme de Himiar à une femme de Kahlan. Les Chinois prétendent que le croisement des races donne une progéniture plus saine, un corps plus solide, une vie plus longue, une santé plus robuste et d'autres avantages encore.
La situation de la Chine resta dans un état de prospérité continuelle, grâce aux sages institutions des anciens rois, jusqu'à l'année 264. Depuis cette époque jusqu'à nos jours (332), il y est survenu des événements qui ont troublé l'ordre et renversé l'autorité des lois. Un intrus nommé Yanchou, qui n'était pas de la famille royale, et qui demeurait dans une ville de la Chine, surgit tout à coup. Homme d'une nature perverse, artisan de discorde, il vit la lie de la population et les malfaiteurs se grouper autour de lui, et grâce à l'obscurité de son nom et au peu d'importance de sa personne, ni le roi ni ses ministres ne s'en préoccupèrent. Il en devint plus fort ; sa renommée grandit, et en même temps il redoubla d'arrogance et d'audace. Les malfaiteurs, franchissant les obstacles qui les séparaient de lui, vinrent grossir son armée ; alors il décampa et ravagea par ses incursions les pays cultivés du royaume, jusqu'à ce qu'il établit son camp devant Khankou, ville importante, située sur un fleuve qui est plus considérable, ou du moins aussi important que le Tigre. Ce fleuve se jette dans la mer de Chine, à six ou sept journées de Khankou, et les bâtiments venus de Basrah, de Siraf, d'Oman, des villes de l'Inde, des îles de Zabedj, de Sinf et d'autres royaumes, le remontent avec leurs marchandises et leur cargaison. Le rebelle marcha donc rapidement sur la ville de Khankou, dont la population se composait de musulmans, de chrétiens, de juifs, de mages et de Chinois, et l'assiégea étroitement. Attaqué par l'armée du roi, il la mit en fuite et livra son camp au pillage ; puis se trouvant à la tête de soldats plus nombreux que jamais, il s'empara par force de la place, dont il massacra une quantité prodigieuse d'habitants. On évalue à deux cent mille le nombre des musulmans, chrétiens, juifs et mages qui périrent par le fer ou par l'eau, en fuyant devant l’épée. Cette évaluation peut être parfaitement exacte, attendu que les rois de la Chine font inscrire sur des registres les noms des sujets de leur empire et des individus appartenant aux nations voisines leurs tributaires, et qu'ils chargent des agents de ce recensement, qui doit toujours les tenir au courant de l'état des populations soumises à leur sceptre. L'ennemi coupa les plantations de mûriers qui entouraient la ville de Khankou et qu'on y entretenait avec soin, parce que les feuilles de cet arbre servent de nourriture aux vers qui produisent la soie ; aussi la destruction des mûriers arrêta l'exportation des soies de Chine dans les pays musulmans. Yanchou poursuivit sa marche victorieuse d'une ville à l'autre ; des tribus entières, vouées à la guerre et au pillage, et d'autres qui craignaient la violence des insurgés, se joignirent à lui, et il se dirigea vers Anmou, capitale de l'empire, avec trois cent mille hommes, cavaliers et fantassins. Le roi marcha à sa rencontre avec près de cent mille soldats d'élite qui lui restaient encore. Pendant environ un mois, les chances de la guerre furent égales entre les deux armées, qui eurent tour à tour à supporter des revers. Enfin la fortune se déclara contre le roi, qui fut mis en fuite, et, vivement poursuivi, vint se jeter dans une ville frontière. Le rebelle, maître de l'intérieur de l'empire et de la capitale, fit main basse sur tous les trésors que les anciens rois avaient réservés pour les mauvais jours ; puis il promena la dévastation dans les campagnes, et détruisit les villes par la force. Sachant bien que sa naissance ne lui permettait pas de se soutenir à la tête du gouvernement, il se hâta de ravager toutes les provinces, démettre les fortunes au pillage et de répandre des torrents de sang. De la ville de Med dans laquelle il s'était enfermé et qui était limitrophe du Thibet, le roi écrivit au souverain des Turcs, Irkhan, pour lui demander du secours. Il l'informa de ce qui lui était arrivé, et lui rappela les devoirs qui lient les rois envers les rois, leurs frères, lorsqu'on réclame leur assistance, qu'ils ne peuvent refuser sans manquer à l'une des obligations absolues de leur rang. Irkhan lui envoya son fils avec un secours d'à peu près quatre cent mille fantassins et cavaliers contre Yanchou, dont les progrès devenaient menaçants. Pendant près d'une année, les deux années eurent entre elles des engagements sans résultat décisif, mais très meurtriers. Yanchou disparut enfin, sans que l'on sache positivement s'il périt par l'épée ou s'il se noya. Son fils et ses principaux partisans furent faits prisonniers, et le roi de la Chine retourna-dans sa capitale et reprit les rênes du gouvernement. Ce prince reçut de ses sujets le titre honorifique de Bagbour (Fagfour), c'est-à-dire fils du ciel. Toutefois le titre qui appartient aux souverains de la Chine, et qu'on leur donne toujours en leur pariant, est Tamgama djaban, et non pas Bagbour.
Pendant cette guerre, les gouverneurs de chaque contrée s'étaient rendus indépendants dans leur province, comme les chefs des Satrapies après qu'Alexandre, fils de Philippe de Macédoine, eut tué Dara, fils de Dara, roi de Perse, et comme cela se passe encore aujourd'hui chez nous, en 332.
Le roi de Chine dut se contenter de l'obéissance purement nominale que les gouverneurs lui accordaient, et du titre de roi qu'ils lui donnaient dans leurs lettres ; mais il ne put pas se porter de sa personne dans toutes ses provinces, ni combattre ceux qui s'en étaient rendus maîtres. Il se résigna donc à n'exiger d'eux qu'un simple hommage, et, bien qu'ils ne lui payassent aucun tribut, il les laissa vivre en paix ; il fut même obligé de permettre que chacun de ces nouveaux maîtres attaquât, selon ses forces et son pouvoir, ses voisins. Ainsi l’ordre et l'harmonie qui avaient régné sous les anciens rois cessèrent d'exister.
Les anciens rois avaient un système régulier de gouvernement, et se laissaient guider par la raison dans les jugements équitables qu'ils rendaient. On raconte qu'un marchand de Samarcande, ville de la Transoxiane, ayant quitté son pays avec une riche pacotille, était venu dans lirait. De là il s'était rendu avec ses marchandises à Basrah, où il s'était embarqué pour le pays d'Oman ; puis il était allé par mer à Killah, qui est à peu près à moitié chemin de la Chine. Aujourd'hui cette ville est le rendez-vous général des vaisseaux musulmans de Siraf et d'Oman, qui s'y rencontrent avec les bâtiments de la Chine ; mais il n'en était pas ainsi autrefois. Les navires de la Chine se rendaient alors dans le pays d'Oman, à Siraf, sur la côte de Perse et du Bahreïn, à Obollah et à Basrah, et ceux de ces pays naviguaient à leur tour directement vers la Chine. Ce n'est que depuis qu'on ne peut plus compter sur la justice des gouvernants et sur la droiture de leurs intentions, et que l'état de la Chine est devenu tel que nous l'avons décrit, qu'on se rencontre sur ce point intermédiaire. Ce marchand s'était donc embarqué sur un bâtiment chinois pour aller de Killah au port de Khan-fou. Le roi avait alors, parmi les serviteurs attachés à sa personne, un eunuque en qui il avait confiance. Les Chinois donnent aux eunuques des emplois, comme ceux de receveurs de contributions et autres ; il y en a même qui font châtrer leurs enfants, afin de les faire parvenir aux dignités. L'eunuque du roi alla donc à Khanfou, où il fit appeler en sa présence les marchands, et parmi eus celui de Samarcande. Tous lui présentèrent les marchandises dont il avait besoin. Après avoir mis de côté ce qui pouvait servir au roi, il offrit au Samarkandien un prix dont celui-ci ne se contenta pas ; de là une discussion qui alla assez loin pour que l'eunuque donnât l'ordre d'emprisonner et de maltraiter le marchand. Le Samarkandien, ayant plus de confiance dans la justice du roi, se rendit aussitôt à Anmou, la résidence royale, et se plaça à l'endroit où se mettaient les plaignants. Quiconque avait à se plaindre d'une injustice, qu'il fût ou non d'un pays éloigné, se revêtait d'une sorte de tunique en soie rouge, et se transportait dans un lieu destiné aux plaignants. Là un des grands dignitaires des provinces, commis à cet effet, le transportait par la poste à une distance d'environ un mois. On en agit ainsi avec le marchand, et on le conduisit devant le gouverneur du pays chargé de ces fonctions, qui lui dit : «Tu entreprends là une grave affaire, où tu cours risque de la vie. Considère bien si ta es fondé dans ta plainte, sinon je regarderai tout comme non avenu et te ferai ramener au pays d'où tu viens. » Si le plaignant ainsi apostrophé baissait la voix, si on le voyait se troubler et se rétracter, on lui appliquait cent coups de bâton, et on le ramenait là d'où il était venu ; mais s'il persistait, on le conduisait au château royal, en présence du roi qui entendait sa réclamation. Comme le Samarkandien persévérait dans sa demande, et comme on vit qu'il disait la vérité sans se troubler et sans mentir, on le mena devant le roi, auquel il raconta ce qui lui était arrivé. Lorsque le drogman eut fait comprendre au roi ce dont il était question, ce prince donna des ordres pour que le marchand fût logé dans un des quartiers de la ville et qu'il y fût bien traité. Ensuite il manda auprès de lui le vizir, le maître de la droite et le maître de la gauche. Ces hauts dignitaires, qui connaissaient parfaitement leurs attributions et leurs devoirs, exerçaient leur charge dans les circonstances critiques et en temps de guerre. Le roi leur ordonna d'écrire séparément à leurs représentants à Khanfou ; car chacun d'eux avait un agent dans toutes les provinces. Ils leur écrivirent donc pour leur demander un rapport sur ce qui s'était passé entre le marchand et l'eunuque. Le roi, de son côté, écrivit dans le même sens à son lieutenant. Cependant l'affaire s'était ébruitée dans le pays, en sorte que les lettres apportées par les mulets de la poste confirmèrent la déposition du marchand. Les souverains de la Chine ont sur toutes les routes de leurs provinces des mulets à longue queue pour la poste et le transport des groups d'argent. Le roi fit aussitôt venir l'eunuque, lui ôta tous les biens qu'il tenait de sa munificence, et lui dit : « Tu as nui à un marchand qui venait d'un pays éloigné, et qui, après avoir traversé sans accident bien des royaumes et vécu sous la protection de plusieurs souverains de la mer et du continent, espérait arriver sans encombre dans ce pays, plein de confiance dans ma justice ; mais, grâce à ton iniquité, peu s'en est fallu qu'il n'ait quitté mes Etats en semant partout sur moi le blâme et le reproche. Sans tes services antérieurs, je t'aurais fait mettre à mort ; mais je t'infligerai un châtiment qui, si tu le comprends, est plus sévère que la mort. Je te charge de la garde des sépulcres des anciens rois, parce que tu as été incapable d'administrer les vivants et de remplir la tâche que je t'avais confiée. » Le roi combla ensuite le marchand de bienfaits, le fit retourner à Khanfou, et lui dit : «S'il te plaît de nous céder celles de tes marchandises qui nous conviennent, nous t'en donnerons un bon prix ; sinon, tu es le maître de ta fortune ; séjourne ici tant que tu le voudras, vends à ton gré, et va où il te plaira. » Quant à l'eunuque, il fut préposé à la garde des sépulcres royaux.
Voici encore une anecdote piquante sur les rois de la Chine. A l'époque où se passa à Basrah l'aventure du chef des Zendjs, dont tout le monde a eu connaissance, un Koraïchite noble et riche, descendant de Habbar, fils d'el-Aswad, se rendit à la ville de Siraf. De là il s'embarqua pour les mers de l'Inde, et, après un long voyage par eau et par terre, il arriva enfin à la Chine, et alla à Khanfou. Ensuite la fantaisie lui prit de visiter la résidence royale qui était alors Hamdan, l’une des cités les plus considérables de ces pays. Le Koraïchite se tint longtemps à la porte du palais, en présentant des requêtes dans lesquelles il déclarait qu'il était de la famille du prophète des Arabes. A la fin le roi donna des ordres pour qu'on l'installât dans une maison où il ne manquerait de rien et où l’on pourvoirait à tous ses besoins. Il écrivit ensuite au gouverneur de Khanfou de lui communiquer le résultat de ses recherches et des informations qu'il aurait prises auprès des négociants sur la prétention de cet homme d'être un des parents du prophète des Arabes. Le gouverneur, de Khanfou ayant confirmé par sa dépêche l'assertion du Koraïchite sur sa parenté, le roi l'admit à son audience et lui donna des richesses considérables qu'il rapporta dans l'Irak. Or cet homme était un vieillard intelligent qui racontait que le roi de Chine, après lui avoir accordé une audience, l'avait interrogé sur les Arabes, et sur les moyens par lesquels ils avaient détruit le royaume des Perses ; à quoi il avait répondu : « C'est avec l'assistance du vrai Dieu, tandis que les Perses adoraient, à l'exclusion du créateur, le soleil et la lune, et se prosternaient devant les deux grands luminaires. » Le roi ajouta : « Les Arabes ont conquis le royaume le plus noble, le plus fertile, le plus riche, le plus remarquable par l'intelligence de ses peuples et le plus célèbre. Mais comment classez-vous tous les souverains du monde ? » — « Je n'en sais rien, répondit le Koraïchite. Là-dessus le roi s'adressant à son interprète : « Dis-lui que nous comptons cinq rois ; le plus puissant de tous est celui qui gouverne l'Irak, car il occupe le milieu du monde et les autres puissances l'entourent ; aussi le nommons-nous roi des rois. Après cet empire vient le nôtre ; nous le regardons comme celui des hommes, parce qu'aucun royaume n'est mieux gouverné, ni plus régulièrement administré ; nulle part aussi les sujets ne sont plus obéissants, et voilà pourquoi nous sommes les rois des bommes. Après nous, vient le roi des bêtes féroces ; c'est notre voisin, le roi des Turcs, qui sont parmi les hommes ce que les bêtes féroces sont parmi les animaux. Il est suivi du roi des éléphants, ou celui de l'Inde, que nous reconnaissons comme le roi de la sagesse, parce que la sagesse est originaire de ce pays. Le dernier enfin est le roi de Roum, que nous regardons comme le roi des fantassins, car aucun pays ne possède des hommes d'une taille plus parfaite et d'une figure plus belle. Tels sont les principaux rois ; les autres sont au-dessous d'eux. » Le roi, ajouta le Koraïchite, m'adressa ensuite cette question par son interprète : « Reconnaîtrais-tu ton maître, c'est-à-dire le Prophète, si tu le voyais ? « — « Comment pourrais-je le voir, répondis-je, puisqu'il est avec Dieu ? » — « Je ne parle pas de sa personne, reprit le roi, je parle de son portrait. » — «Très-bien, » dis-je. Le roi fit apporter une cassette qu'on plaça devant lui. Il y prit un cahier, et dit à l'interprète : « Montre-lui son maître. » J'aperçus aussitôt dans le cahier les images des prophètes, et je les saluai à voix basse. Le roi, ne se doutant pas que je les reconnusse, chargea l'interprète de me demander pourquoi je remuais les lèvres. « Je salue les prophètes par une invocation, » ré-pondis-je. — « Comment les reconnais-tu ? » dit-il. — « Par les traits de leur histoire qui sont ici représentés : voici Noé qui se réfugie avec les siens dans un vaisseaux lorsque Dieu, qui avait commandé à l'eau de submerger la terre tout entière, le sauva avec ceux qui l'accompagnaient. » Le roi se mit à rire et dit : « Pour le nom de Noé, tu es dans le vrai ; mais quant au fait de l'inondation de la terre tout entière, nous ne le connaissons pas ; le déluge n'a atteint qu'une partie de la terre et n'est pas arrivé jusqu'à notre pays. Si l'histoire que vous racontez est vraie touchant cette partie du monde, toujours est-il que nous autres habitants de la Chine, de l'Inde, du Sind et d'autres pays encore, nous n'eu avons pas connaissance, et que nos ancêtres ne nous en ont rien légué par tradition ; et cependant, un événement tel que l'inondation de la terre est assez important pour frapper les esprits, se graver dans la mémoire, et pour que les peuples se le transmettent par tradition. » Le Koraïchite ajouta : « Je craignis de le réfuter et d'exposer nos arguments, parce que je savais qu'il les repousserait. Je continuai : « Voilà Moïse et son bâton, avec les enfants d'Israël. » Le roi dit : « Oui, il fut prophète, malgré les limites étroites de son pays et les révoltes de son peuple contre lui. » — «Voilà Jésus, repris-je ; il monte un âne, et les apôtres l'accompagnent. » — « Sa prophétie, dit le roi, dura peu de temps ; elle ne dépassa guère trente mois. » Il passa ainsi en revue tous les prophètes et leur histoire, et dit beaucoup d'autres choses dont nous n'avons rapporté qu'une partie. Ce Koraïchite, qui est connu sous le nom d'Ibn Habbar, prétendait même avoir vu au-dessus de la figure de chaque personnage une longue épigraphe qui contenait une mention de sa généalogie, de son pays, de l'âge qu'il avait atteint et de tout ce qui concernait ses prophéties et sa vie. « A la fin, ajoutait-il, je reconnus la figure de notre prophète Mohammed, monté sur un chameau et entouré de ses compagnons qui portaient à leurs pieds des chaussures dites d'Aden ; faites de peau de chameau, et des cure-dents suspendus à leurs ceintures formées de cordes en filaments de palmier. Je pleurai. Le roi m'en fit demander (à cause par son interprète. « Voilà mon prophète, répondis-je, mon maître et mon cousin Mohammed, fils d'Abd Allah ! » — « Tu dis la vérité, repartit te roi. Il a régné, et sur le plus noble de tous les peuples ; seulement il n'a pas vu de ses yeux l'empire soumis à sa loi ; ce bonheur a été réservé aux khalifes, ses successeurs, qui ont gouverné son peuple après lui. » En examinant les portraits des prophètes, j'en vis plusieurs qui, en joignant l'index avec le pouce en forme d'anneau, semblaient indiquer par la position de leurs mains que la création est comme un cercle ; d'autres tournaient l'index et le pouce vers le ciel, comme s'ils avaient voulu inspirer à la créature la crainte de ce qui est au-dessus d'elle. Le roi m'adressa ensuite des questions sur les khalifes, sur leur costume et sur un grand nombre de leurs institutions. Je lui répondis dans la mesure de tues connaissances. Puis il dit : « Quel âge donnez-vous au monde ? » — « Les opinions diffèrent à ce sujet, répondis-je ; les uns lui donnent six mille ans, les autres plus ou moins. » — « Cette opinion vient-elle de votre prophète ? » reprit-il. — « Oui, » lui dis-je. Il éclata de rire ainsi que son vizir, qui se tenait debout, ce qui prouvait leur incrédulité ; puis il ajouta : « Je ne pense pas que votre prophète ait émis cet avis. » Je revins à la charge et lui dis : « C'est le prophète lui-même. » Je vis alors l'incrédulité se peindre sur sa figure, et il ordonna à son interprète de m'adresser les paroles suivantes : «Fais bien attention à ce que tu dis, car on ne parle aux rois qu'après avoir eu la certitude de ce qu'on avance. Tu as prétendu qu'il existait parmi vous une différence d'opinion à ce sujet : ce désaccord tombe donc sur une parole de votre prophète. Cependant lorsqu'il s'agit de ce que les prophètes ont dit, iï n'est plus permis d'avoir des avis différents ; bien loin de là, tout le monde doit se soumettre sans contestation. Prends donc bien garde de parler de cela ou de choses semblables. » Il m'entretint encore sur d'autres sujets que le temps a effacés de ma mémoire. Il me demanda ensuite : « Pourquoi as-tu abandonné ton pays dont le séjour et la population ont plus d'analogie avec toi que n'en a le nôtre ? » Je lui racontai les événements de Basrah, et comment j'étais arrivé à Siraf. « Là, continuai-je, je désirais te voir, ô roi ! car j'avais entendu parler de l'état prospère de ton royaume, de ta sagesse, de ta justice et de la perfection d'un gouvernement qui régit à la fois tous les sujets. J'ai voulu voir cet empire et le connaître de mes propres yeux. Maintenant, s'il plaît à Dieu, je retournerai dans mon pays, dans le royaume démon cousin ; j'y raconterai ce que j'ai vu de l'état florissant de cet empire, de sa vaste étendue, de l'équité de l'administration, qui s'étend à tous, et de tes grandes qualités, ô excellent prince ! je répéterai chaque belle parole et j'y vanterai chaque bonne action. » Le roi, flatté de ce discours, me fit donner de riches présents et de magnifiques vêtements ; on me conduisit par la poste à Khanfou, et le roi écrivit à son gouverneur de me bien traiter, de me mettre au premier rang parmi les personnages distingués qui l'entouraient, et de me combler de faveurs jusqu'à mon départ. Je restai donc auprès de lui, vivant dans l'abondance et dans les plaisirs jusqu'au moment où je quittai la Chine.
Abou-Zeïd Mohammed, fils de Iezid, originaire de Siraf, cousin de Mezid Mohammed, fils d'Ebred, fils de Bestacha, gouverneur de cette même ville, homme d'expérience et de discernement, causant avec moi, Maçoudi, à Basrah où il était venu se fixer l'an 303, me dit qu'il avait interrogé ce Koraïchite, Ibn Habbar, sur la ville de Hamdan, résidence du roi, sur sa physionomie et son aspect. Ibn Habbar lui avait parlé de l'étendue de cette capitale et du grand nombre de ses habitants, ajoutant qu'elle était divisée en deux parties, séparées par un long et large boulevard. Le roi, son vizir, le grand juge, les troupes, les eunuques et tout ce qui tient au gouvernement occupent la partie de droite située à l'orient ; aucun homme de la basse classe n'habite parmi eux ; on n'y voit pas de marchés, mais les rues sont sillonnées, dans toute leur longueur, de canaux bordés d'arbres plantés avec symétrie, et de vastes maisons. La partie gauche, à l'ouest, est affectée au peuple, aux commerçants, aux magasins d'approvisionnements et aux marchés. A la pointe du jour, je voyais les intendants du roi, ses domestiques, les esclaves et les agents des gouverneurs se rendre, soit à pied, soit à cheval, dans la moitié de la ville où se trouvent les marchés et les négociants ; ils prenaient là les marchandises et les objets dont ils avaient besoin, et s'en retournaient sans plus remettre le pied dans ce quartier jusqu'au lendemain. La Chine est un pays charmant, à la végétation luxuriante, et entrecoupé d'innombrables canaux ; toutefois le palmier ne s'y rencontre pas. Les habitants de cet empire sont, parmi les créatures de Dieu, les plus habiles dans la peinture et dans tous les arts. Aucune autre nation ne pourrait rivaliser avec eux pour quelque ouvrage que ce soit. Lorsqu'un Chinois a fait un travail qu'il croit inimitable» il l'apporte au palais du roi et demande une récompense pour son chef-d'œuvre. Le roi ordonne aussitôt que cet ouvrage reste exposé au palais pendant une année, et si, dans tout ce temps, personne n'y trouve de défaut, le roi accorde à l'auteur une récompense et l'admet au nombre de ses artistes ; mais si l’on découvre un défaut dans l'ouvrage, celui qui l'a fait est renvoyé sans salaire. Un homme avait représenté sur une étoffe de soie un épi avec un moineau perché dessus ; telle était la perfection du travail que l'œil du spectateur s'y trompait forcément. Ce chef-d'œuvre resta longtemps exposé. Un jour un bossu, en passant devant lui, se permit de le critiquer. Introduit auprès du roi, ainsi que l'artiste, on lui demanda sur quoi portaient ses reproches. « Tout le monde sait, répondit-il, qu'un moineau en Rabattant sur un épi le fait plier ; ici le peintre a représenté l'épi droit et nullement penché, bien qu'il ait posé dessus un oiseau. » L'observation fut trouvée juste, et le peintre ne reçut aucune récompense. Par cette coutume et d'autres semblables, ils veulent stimuler le zèle des artistes, les forcer à beaucoup de circonspection et de prudence, et les obliger à réfléchir longuement dans l'exécution des ouvrages qu'ils entreprennent.
Il nous resterait encore beaucoup de renseignements curieux et de choses intéressantes à communiquer sur les Chinois et sur leur pays ; mais nous y reviendrons plus bas dans cet ouvrage, et nous en parlerons en gros, bien que nous ayons déjà traité ce sujet d'une manière très complète dans nos Annales historiques et dans notre Histoire moyenne. Au surplus nous avons consigné surtout dans le présent livre tous les détails que nous avions omis dans ceux que nous venons de citer.