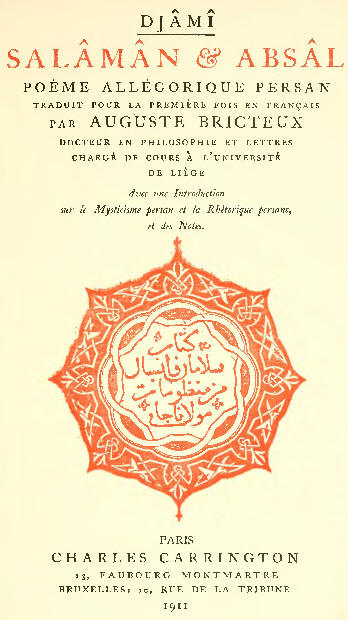
DJAMI
SALÂMÂN ET ABSÂL (partie I - partie II)
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
SALAMAN & ABSAL
CETTE TRADUCTION DE L'IMMORTEL DJÂMÎ,
LA SEULE COMPLÈTE EN LANGUE
EUROPÉENNE, EST DEDIEE À MONSIEUR
GEORGES CLEMENCEAU,
ex-président du conseil, auteur du
"voile du bonheur"
en témoignage
d'admiration.
SALÂMÂN ET ABSÂL
La monotonie infinie de la terre grise et nue sous le ciel bleu : tel est le seul spectacle qui apparaisse durant des heures et des jours entiers aux yeux du voyageur parcourant les immensités désertes du plateau iranien. Devant lui, derrière lui, aussi loin que porte le regard dans cette atmosphère d'une limpidité merveilleuse, rien qui limite l'horizon. A sa droite et à sa gauche, bien loin, des montagnes aux lignes pures, à peine dentelées, bordent la large vallée que ne vivifie aucun fleuve, et où les torrents éphémères du printemps ont bientôt disparu sans laisser de trace. Rien pour distraire le regard ou retenir l'attention, aucun paysage déterminé que l'œil puisse embrasser d'un coup, rien qui empêche l'esprit de se recueillir dans la méditation ou de se perdre dans la rêverie. Mais aussi, quelle joie, quand, après l'interminable étape, la caravane atteint le village ceint de verdure ! Qu'il est doux, alors, d'étendre son tapis dans un jardin touffu, de s'y asseoir en savourant le charme de l'ombre, de la fraîcheur et des parfums ; l'œil se délecte aux mille couleurs vives et brillantes des roses et des tulipes, des basilics et des jasmins, des fruits dorés ou vermeils, l'oreille est caressée du bruit des jets d'eau qui retombent dans les vasques, du murmure des cascatelles et des ruisselets, du ramage de multitudes d'oiseaux. L'art de la Perse, profondément original, est un reflet fidèle des aspects de ce pays où les spectacles de la vie sont aussi simples que ceux de la nature. D'une part comme de l'autre, il n'y a pas de vue d'ensemble, tout l'intérêt réside dans les détails.
En architecture, les seuls monuments dignes d'attention sont les mosquées, toutes semblables pour l'aspect général, avec leur coupole à base étranglée flanquée de deux sveltes minarets, et leur portail monumental orné d'un immense parement rectangulaire. Les dimensions seules varient, sans que les proportions diffèrent sensiblement. Mais en revanche, quelle variété et quelle imagination dans les détails ornementaux, dans le dessin et le coloris des revêtements en faïences émaillées aux teintes exquises et chatoyantes !
Il en est de même en peinture, dans les délicieuses miniatures qui ornent les manuscrits. Les sujets sont toujours les mêmes, nul souci de la perspective, de la subordination de la partie au tout. Tout l'effort porte sur les détails : les jeux d'ombre et de lumière sont habilement rendus ; les moindres éléments du costume sont fignolés avec une minutie à rendre jaloux les peintres de l'école hollandaise.
C'est à la Perse surtout qu'on peut appliquer le mot de Goethe :
Wer den Dichter will verstehen,
Muss in Dichters Lande gehen.
" Celui qui veut comprendre le poète, doit aller dans le pays du poète. " Les caractères, les qualités et les défauts de la nature et de l'art persan se retrouvent dans la riche littérature de l'Iran. Elle aussi est, si l'on peut dire, essentiellement décorative. Les mêmes thèmes reviennent toujours, et les auteurs se soucient peu d'en trouver de nouveaux ; bien au contraire, ils affectent de reprendre les sujets traités par leurs devanciers, pour mieux rivaliser avec eux. Les grandes divisions d'un poème restent toujours les mêmes, et tout l'effort s'acharne aux détails.
On aperçoit aisément les avantages et les inconvénients du procédé. Les poètes de la première époque pouvaient encore réaliser leur idéal sans grande difficulté, et produire des chefs-d'œuvre de grâce et de ciselure, mais plus tard, la tâche se compliquant, il devenait impossible d'atteindre à l'originalité sans que la recherche dégénérât en afféterie et la grâce en mièvrerie. Les concetti et jeux de mots se multiplièrent, on tomba dans le baroque, et les ornements les plus incongrus s'accumulèrent jusqu'à la nausée.
Voilà pour la forme. Quant au fond, la littérature persane, d'un bout à l'autre, est imprégnée de cette philosophie mystique si remarquable appelée soufisme.
L'ouvrage que nous nous proposons de faire connaître à quelques esprits curieux est un poème symbolique, où l'auteur a voulu faire entrer l'exposé complet de la doctrine sourie. Il serait donc impossible d'en pénétrer le sens, et de le lire avec charme et profit, si l'on n'a d'abord une notion suffisante des idées souries. Le mysticisme persan a fait l'objet de nombreux traités, mais la plupart sont en langues étrangères et ne sont guère accessibles qu'aux spécialistes. Je crois donc utile et légitime de faire précéder ma traduction d'un exposé succinct, quoique suffisant, du système soûfî. J'y ajouterai quelques mots de la rhétorique persane que je crois nécessaires à l'appréciation du poème. Cet avant-propos sera, en quelque sorte, une introduction à l'étude de la littérature persane. Je ne suis pas d'avis que les Orientalistes doivent se confiner dans les travaux d'érudition destinés au cercle restreint de leurs confrères. J'estime que c'est un peu leur devoir, et même leur raison d'être, de communiquer au public lettré le résultat de leurs études.
" Derrière le beau, le vrai, le bien, l’humanité a toujours senti, sans la connaître, qu'il existe une réalité souveraine dans laquelle réside l'idéal, c'est-à-dire Dieu, le centre de l'unité mystérieuse et inaccessible vers laquelle converge l'ordre universel. Le sentiment seul peut nous y conduire ; ses aspirations sont légitimes pourvu qu'il ne sorte pas de son domaine avec la prétention de se traduire par des énoncés dogmatiques et a priori dans la région des faits positifs." M. Berthelot : Lettre à E. Renan.
Le soufisme, sous sa forme complète, est un système de philosophie mystique, de panthéisme idéaliste, né en marge de l'Islam, qui a inspiré quelques poètes arabes, dont le fameux Ibn al-Farid, et a envahi complètement la poésie persane, et par suite, toutes les littératures calquées sur celle de l'Iran : les littératures turques (orientale et occidentale) et l'hindoustanie, qui ne sont, pour ainsi dire, que des annexes de la littérature persane.
Un phénomène qui a exercé une si vaste influence présente évidemment le plus grand intérêt, et par bonheur, il n'est pas bien difficile de se faire une idée du soufisme complètement organisé, tel qu'on le trouve, par exemple, dans les œuvres de Djâmî. Mais ce qui est plus ardu, et même impossible dans l'état actuel de la science, c'est d'en étudier la formation étape par étape, et surtout, d'en connaître d'une façon certaine les origines. Nous n'insisterons donc pas sur ce dernier point, qui d'ailleurs ne nous intéresse pas immédiatement et nous ferait dépasser le cadre d'une modeste introduction. Contentons-nous, d'abord, de donner un court aperçu du développement historique du soufisme.
Ce qui domine dans le soufisme, de la première époque surtout, c'est le point de vue mystique, en prenant dans son sens le plus général ce vocable qui a été employé dans des acceptions si diverses, le plus souvent un peu dédaigneuses. Si l'on entend par mysticisme la religion du cœur, l'amour pour la divinité qui entraîne le mépris des biens terrestres et des vanités du monde, on peut dire qu'il y avait déjà un élément de mysticisme au berceau même de l'Islam, et chez son fondateur même.
Mahomet fut, parmi les Arabes, un être d'exception. Chez ses frères de race, le souci brutal et quotidien de ne pas mourir de faim et de soif coupa toujours les ailes à l'idéalisme et imposa toujours le plus grossier matérialisme. Mahomet, né dans la pauvreté, fut d'abord animé par le désir de réagir contre l'orgueil des puissants Qoreïchites, les riches exploitants de la Kaaba, et insista sur les faveurs prodiguées par le Dieu miséricordieux, mais surtout juste et vengeur, à ceux qui avaient vécu sur cette terre dans la pauvreté, l'humilité et l'obéissance.
Plus tard, après la période de souffrance et d'oppression, l'église musulmane devint militante et conquérante. Le pauvre conducteur de chameaux épris d'idéal fut alors un puissant chef politique, un satrape qui ne dédaignait ni les jouissances ni les honneurs. Dès lors, l'esprit de renoncement et d'ascétisme fut banni de l'Islamisme officiel. 1 Le principe de l'obéissance aveugle aux injonctions divines dictées au prophète engendra bientôt un sec et froid formalisme. Puis, après la mort de Mahomet, l'application des méthodes du droit romain aux discussions théologiques donna naissance à une dialectique aride et stérile où le cœur ne trouvait aucun aliment.
Or, l'Islam avait débordé l'aride patrie des Bédouins et avait envahi la Syrie et l'Egypte, terres toujours fécondes en anachorètes. Sous le despotisme impie des Omeyyades, le dogme et le culte extérieur ne suffirent plus aux âmes vraiment religieuses, et bientôt, l'ascétisme et le monachisme condamnés par Mahomet fleurirent dans l'Islam. Sans doute, l'exemple des moines chrétiens ne fut pas sans influence, mais nous ne croyons pas qu'il fût nécessaire pour amener l'éclosion du mysticisme. Ces sentiments de renoncement, d'idéalisme, d'amour de la divinité naissent spontanément à toutes les époques, dans tous les pays, chez les âmes d'élite endolories par les brutalités ambiantes.
On voit employer, dès 777, le nom de soûfî, qui fut porté par Abou Hâchim de Koûfa. Il vient probablement de soûf, "laine," et correspond exactement au terme persan pechmînè poûch. Il fait allusion au froc de laine grossière dont se vêtaient les ascètes en signe de pauvreté volontaire.
Cette première forme du soufisme n'a, comme on le voit, rien de spécifique. C'est simplement ce mysticisme qui naît à côté de toutes les religions, un quiétisme dévot, qui choisit parmi les nombreux attributs de Dieu celui de bonté et y insiste tout particulièrement : ce Dieu si bon doit être aimé pour lui-même, et non pas dans l'espoir des délices du paradis ou par crainte des supplices infernaux. Les premiers soûfîs étendaient le sens du mot islam qui veut dire "abandon à la volonté de Dieu"; ils prétendirent faire du renoncement la première des vertus islamiques. Ces premiers soûfîs n'offusquèrent nullement les théologiens orthodoxes. Loin de là, ils s'attirèrent la vénération des croyants et furent les prototypes de ces " saints " de l'Islam, dont le culte a fini par dénaturer complètement le monothéisme rigoureux prêché par Mahomet. On a dit souvent que ce premier soufisme orthodoxe était " arabe." C'est là un terme vague dont on ne saurait trop se méfier. Sans doute, ses adeptes parlaient arabe et portaient même des noms arabes, mais étaient-ils de race arabe ? C'étaient des fils de la Syrie, pays d'élection de l'ascétisme chrétien comme de l'ascétisme musulman. Quant aux vrais Arabes, de la péninsule, il serait difficile de trouver chez eux des tendances à l'ascétisme et au renoncement.
Pour ce qui est du soufisme complet, organisé, original, il ne fut complètement édifié que beaucoup plus tard, au XIe siècle, et ce fut, sans conteste, une création du génie persan. Sans doute, l'abaissement national, la déchéance de la glorieuse et antique patrie iranienne asservie aux Bédouins grossiers, contribua pour beaucoup au succès d'une doctrine qui détachait du monde et poussait au renoncement. L'incertitude du lendemain, dans ce malheureux Khorassan ravagé périodiquement par les hordes turques, mongoles, afghanes, fit aimer une philosophie qui niait la réalité d'un monde où la vie était si triste. Peu à peu, le soufisme prit une forme qui le mettait en contradiction flagrante avec le dogme islamique. Le Coran voit dans Dieu une espèce de despote oriental, assis loin du monde sur son trône élevé, au sommet de l'empyrée, et ne se montrant jamais à ses fidèles. Le soufisme, tel que nous allons le décrire avec quelque détail, prit en général la forme d'un panthéisme qui faisait de la création une émanation de la divinité, et qui admettait pour l'homme la possibilité d'arriver, par la contemplation, à l'extase et à l'union avec Dieu.
Peut-être certains éléments du système sont-ils nés spontanément. Rien d'étonnant à cela : il est curieux, quand on lit par exemple les admirables Hours with the Mystics de Vaughan, 2 de voir combien le mysticisme, à toutes les époques et chez tous les peuples, engendre les mêmes doctrines, tourne toujours dans le même cercle d'idées assez limité. De là des ressemblances frappantes, des coïncidences parfaites dans les pensées et les expressions, sans qu'on puisse envisager l'hypothèse d'un emprunt.
Quoi qu'il en soit, il est évident que le soufisme prit peu à peu des éléments aux nombreuses doctrines philosophiques et religieuses nées dans l'Asie Centrale. Certains auteurs, caressant une idée aujourd'hui chère à beaucoup de savants, ont voulu voir dans le soufisme un des nombreux produits de la réaction aryenne contre l'esprit sémitique.
Plusieurs ont insisté sur la ressemblance entre le panthéisme soûfî et la philosophie indienne du Védânta. Et, en effet, les analogies sont évidentes, mais elles ne sont guère spécifiques, à part peut-être l'identité des rôles joués par le gourou indien et par le pîr persan ; or, tous deux ressemblent étonnamment au confesseur chrétien, au directeur de conscience. Et il y a, par contre, dans le soufisme, un élément important et caractéristique qui fait complètement défaut dans le morne et froid système hindou. Je veux parler du rôle prépondérant que joue dans le soufisme l’amour : amour de la beauté, amour de la créature, qui sont un acheminement vers l'amour de la divinité. D'ailleurs, comme le fait remarquer justement l'éminent orientaliste anglais E. G. Browne, 3 les relations entre l'Inde et la Perse à l'époque mahométane n'ont commencé que bien tard, alors que l'édifice du soufisme était complètement achevé.
Mais ce qui est frappant, ce qui sautera aux yeux des lecteurs de ce modeste ouvrage, c'est l'identité parfaite, s'étendant jusqu'aux détails et à la terminologie, entre le système soûfî complet et la philosophie néoplatonicienne, qui a tant influé aussi sur la théologie chrétienne des premiers siècles. La philosophie alexandrine a été très bien connue d'assez bonne heure, certainement dès le neuvième siècle de notre ère, dans le monde musulman, et les philosophes arabes n'ont guère étudié Platon, et surtout Aristote — dont se réclament, par exemple, Avicenne et Averroès — qu'à travers les commentaires des néoplatoniciens.
Cette influence néoplatonicienne une fois admise, il resterait à préciser les emprunts, et plusieurs questions accessoires seraient encore à résoudre ? Le soufisme oriental, en se complétant, et en se systématisant au moyen de données empruntées au néoplatonisme, n'a-t-il pas simplement repris au système de Plotin ce que l'Orient lui avait donné ? On n'ignore pas, en effet, que le grand continuateur de Platon voyagea longtemps en Orient et particulièrement en Perse. Et pour remonter jusqu'à Platon lui-même, n'a-t-il pas été chercher jusque dans les croyances orientales des aliments pour son puissant génie ? Et quelle fut l'influence en Orient des derniers Platoniciens de l'Académie, Damascius et ses compagnons, chassés par Justinien en 533, quand il ferma l'école d'Athènes, et réfugiés à la cour du grand roi Sassanide Anoûchîrvân, si accueillant pour les savants du Yoûnân ? Voilà des questions qui attendront longtemps une réponse, si, toutefois, elles ne restent à jamais insolubles 4.
On aurait tort, en somme, de parler, au singulier, de système philosophique du soufisme. Il n'y a pas de système unique, bien déterminé. Rien n'est plus varié, par exemple, que l'attitude des soûfîs à l'égard de la loi religieuse ; nous avons vu les premiers vénérés comme des saints par les musulmans, parce qu'ils mettaient un soin jaloux à observer les prescriptions rituelles ; plus tard, l'audace des soûfîs devint plus grande, mais la plupart, pour être tolérés, durent affecter de se soumettre aux prescriptions du Coran. Ils employèrent dans un sens particulier les expressions courantes du livre saint, et y cherchèrent, et plus encore dans le trésor inépuisable des traditions, des textes à l'appui de leurs doctrines. Ils jouèrent admirablement de la baguette magique de l'interprétation, et rirent dire sans peine à des textes obscurs et ambigus tout ce qu'ils désiraient. Partant de ce principe singulier que la révélation envoyée par Dieu pour instruire les hommes a plusieurs significations cachées sous le sens littéral, ils en arrivèrent, en fin de compte, à attribuer à chaque passage du Coran jusqu'à sept significations différentes. Beaucoup de soûfîs prétendaient, — et sans doute plusieurs étaient sincères — que le soufisme n'était autre chose que la doctrine ésotérique du Mahométisme. Outre ces simples mystiques, et ces soûfîs modérés et opportunistes, il ne manqua point de penseurs audacieux et imprudents, qui, dédaigneux de la haine des théologiens orthodoxes appuyés par le pouvoir civil, et de la fureur de la populace fanatique, tirèrent des principes de leur doctrine, avec une terrible logique, les conclusions les plus radicales, affirmant l'identité du bien et du mal et prétendant être Dieu lui-même. Tel ce fameux Mansoûr el-Hallâdj qui, au milieu de supplices effrayants, hurla jusqu'à son dernier souffle : Ana-l-Haqq " Je suis la Vérité ", c. à. d. "je suis Dieu." (922 de notre ère).
Les premiers écrits soûfiques ne furent, naturellement, que des recueils d'apophtegmes épars et non coordonnés. Le grand philosophe qui chercha à ériger en système complet et harmonieux les doctrines soûfies fut un Persan, al Ghazzâlî, mort en 1111 5 , de Tous, dans le Khorassan, ville natale, aujourd'hui disparue, de tant de grands hommes. Il commença par être un des piliers de l'orthodoxie, un des grands docteurs scolastiques de l'Islam, et composa, d'après les anciennes méthodes, des traités pleins d'érudition. Mais ces travaux arides de forçat du syllogisme ne desséchèrent pas son esprit, ni n'éteignirent dans son cœur la flamme du sentiment vraiment religieux. Tout-à-coup, épris de mysticisme, il se réfugia dans la vie contemplative, et, tel Léon Tolstoï reniant ses grands chefs-d’œuvre, il brûla ce qu'il avait adoré, et vilipenda cette science à laquelle il avait si longtemps consacré ses veilles. Il désavoua les écrits qui l'avaient illustré, et préconisa la religion intérieure. Toutefois, il n'alla pas jusqu'au bout, et arriva au seuil du panthéisme sans y pénétrer. Sans doute, l'œuvre de Ghazzâlî venait à son heure, car ses nouveaux écrits eurent auprès des théologiens orthodoxes le plus grand succès, l'église musulmane adopta les règles religieuses émises par Ghazzâlî, et le grand philosophe du Soufisme, considéré comme un père de l'église islamique, reçut le surnom de Mouhiyyou-d-Dîn, " le Vivificateur de la Religion."
Naturellement, il ne faut pas chercher chez les poètes persans, ou du moins chez la plupart, l'application complète et constante des doctrines soûfies. Ils en mélangent leurs œuvres à des degrés divers. Le plus grand lui-même, le génial et sublime Djelâl ed-Dîn Roûmî (1207-1273), dans ce Meçnevî qui est, pour ainsi dire, le livre sacré du soufisme, descend souvent des sommets du mysticisme panthéiste pour parler le langage courant ; mais il nous paraît abusif de voir, dans les passages où il est vraiment panthéiste, l'exception. D'autres poètes, tels les deux plus célèbres en Europe, Hâfiz et surtout Saadî, ne font au soufisme que des emprunts occasionnels.
Il y a aussi des poètes qui ont composé, dans un but de propagande, des poèmes didactiques et allégoriques sur le soufisme. Parmi les premiers, on peut citer le Goulchen-i Râz ou " Roseraie du Mystère " de Sa'doud-Dîn Mahmoud Chabistarî et les Lawâïh de Djâmî. Parmi les seconds, le Mantiqou-t-Taïr ou " Colloque des Oiseaux " de Férîd Ed-Dîn Attâr, et le poème dont nous offrons au public la première traduction française.
Mais venons-en à l'exposé de la doctrine. Je suivrai surtout l'admirable résumé qu'en donne le regretté Gibb dans sa monumentale History of Ottoman Poetry, (Tome I, pp. 15-21).
Le premier "pilier de l'Islam", c'est-à-dire le dogme essentiel du mahométisme, a pour formule : La ilâha illallâh "Pas de dieu si ce n'est Dieu. " Les soûfîs substituent à cette idée cette autre : " Dieu seul — (qu'ils se plaisent à appeler Haqîqat ou Haqq, "la Vérité") — existe. " Dieu est à la fois l'Etre Absolu, la seule Existence réelle, et comme tel, il ne peut subir aucune limitation. C'est donc, en même temps, le Bien absolu et la Beauté absolue.
Mais comment, dès lors, expliquer la Création ? Pourquoi cet être parfait, et par conséquent exempt de tout besoin, a-t-il engendré ce monde ? Plotin répondait que, parmi les attributs de la perfection, figure celui de produire : " Toutes choses dans la nature imitent le Principe premier en engendrant, pour arriver à la perpétuité et manifester leur bonté. Comment donc celui qui est souverainement parfait, qui est le bien suprême, resterait-il renfermé en lui-même, comme si un sentiment de jalousie l'empêchait de faire part de lui-même, ou comme s'il était impuissant, lui qui est la puissance de toutes choses ? Comment donc serait-il encore principe ? Il faut donc qu'il engendre quelque chose, comme ce qu'il engendre doit engendrer à son tour. " (Ennéades, XIII).
Djâmî, en poète, exprime la même idée sous la forme d'une belle métaphore : Avant que le temps lui-même existât, la Beauté absolue brillait solitaire, sans personne pour l'admirer. Or, un des traits caractéristiques de la beauté, c'est le désir de se révéler, de se manifester. L'univers phénoménal résulte de ce désir. Les soûfîs, pour appuyer cette thèse, ont recours au fameux hadîth ou tradition, d'après lequel Dieu aurait répondu à David qui lui demandait pourquoi il avait créé l'homme : Kountou kanzan makhfiyyan, fa-ahbabtou an ou'rafa, fa-khalaqtou l-khalqa li-oifrafâ. "J'étais un trésor caché, et j'ai désiré être connu ; alors j'ai créé la création afin d'être connu." 6
Comment cette manifestation s'est-elle produite ? Les soûfîs en appellent à l'idée, vraie au fond, que les choses ne peuvent être connues que par leurs contraires. Comment, par exemple, concevoir la lumière, si nous n'avions en même temps la notion de son contraire, l'obscurité ? Comment apprécier la santé, si l'on ne subissait jamais la maladie ? De même pour le plaisir et la douleur, le froid et le chaud. Pour le savant de nos jours, aussi, le mot " froid " n'est-il pas un terme purement empirique et négatif? Or, le contraire de l'Etre Absolu et, par là même, du Bien absolu et du Beau absolu, c'est nécessairement le Non Etre, qui se confond avec le Non Beau, que nous appelons empiriquement le Laid, et le Non Bien, dont l'appellation vulgaire est le Mal. Mais ce Non Etre et ses équivalents ne peuvent avoir d'existence réelle, car toute existence est accaparée par l'être absolu. Le mal n'a donc pas d'existence réelle, ce n'est, comme le Non Etre, qu'une illusion passagère évoquée dans un but déterminé.
Cette théorie a l'avantage d'expliquer à la fois le mystère de la création et le mystère de l'existence du mal, ce grand problème qui torture la pensée humaine et qui est le point faible de tous les systèmes philosophiques et religieux. Mais Plotin et les soûfîs doivent, comme déjà Platon, avoir recours à ce Non Etre ( l adm ou mstî, le un ov grec) qui n'est guère qu'une sorte de diabolus ex machina.
Pour continuer à expliquer cette manifestation, le soufisme, reproduisant toujours les idées néoplatoniciennes, doit encore avoir recours à la métaphore, bel aliment pour la poésie, mais pour la philosophie dangereux expédient :
Quand le Non Etre fut opposé à l'Etre, un reflet du second apparut sur le premier comme dans un miroir. Ce reflet, qui participe à la fois de la nature de l'Etre et du Non Etre, n'est autre chose que l'univers phénoménal, dont nous faisons partie dans notre existence terrestre. Ce monde n'a pas d'existence objective réelle. Une autre métaphore, citée par Browne 7, éclaire encore mieux cette théorie : Quand le soleil se réfléchit dans un lac, son image y apparaît aussi longtemps que brille le soleil, et s'efface aussitôt qu'il disparaît. Cette image dépend uniquement du soleil qui peut la reproduire un nombre infini de fois sans subir la moindre altération. Le lac réfléchit le soleil de la même façon que le Non Etre reflète l'Etre, et l'image qui apparaît dans la nappe liquide est le pendant de l'univers phénoménal.
Cette belle métaphore ne satisfait pas tous les esprits, et les philosophes et les poètes — entre autres Djâmî dans Salâmân et Absâl — conçoivent aussi la création d'une façon absolument conforme à la doctrine de Plotin. De même que le soleil, sans rien perdre de sa puissance, projette au loin sa lumière, de même, Dieu, la Cause première, envoie une série d'émanations où la proportion de divin, de réel, diminue à mesure qu'on s'éloigne du centre. Une cosmogonie détaillée, acceptée par tous les musulmans, soûfîs ou non soûfîs, admet comme première émanation la Première Intelligence ou Intelligence Universelle, ‘aql-i avval ou ‘aql-i koull, qui n'est autre que le Nous de Plotin. De cette Première Intelligence procèdent, par une succession d'émanations dont le détail serait inutile ici, neuf autres intelligences, ainsi que neuf âmes attachées aux neuf sphères. Il y a donc en tout dix intelligences, dont la dernière, attachée à la sphère lunaire et appelée " Intellect Agent " ou " Intelligence Active ", ‘aql-i fa"âl, est suffisamment éloignée du centre divin, suffisamment matérialisée, pour agir sur les quatre éléments, et engendrer ainsi les êtres terrestres.
Le couronnement de la création, c'est l'homme, abrégé de l'univers, microcosme qui résume en lui les attributs de toutes les créatures, qui, en d'autres termes, est le dernier terme de l'évolution des êtres, du moins dans la vie terrestre. Je crois intéressant de citer à ce sujet un passage du Dîvân-i Chams-i Tabrîz de Djelâl ed-Dîn Roûmî :
" Depuis le moment où tu es venu dans le monde de l'existence [actuelle], une échelle est placée afin que tu puisses t'échapper. Tu fus d'abord minéral, puis tu devins végétal, ensuite tu devins animal ; comment peux-tu ignorer cela ? Après cela, tu devins homme, doué de savoir, de raison et de foi. Vois à quelle perfection a atteint ce corps qui n'était qu'une parcelle de poussière. "
Et Roûmî, ne s'arrête pas là, mais poursuit logiquement, d'une façon qui fait penser à Jean Reynaud :
" Après avoir parcouru l'existence humaine, tu deviendras, sans nul doute, un ange, et après ton séjour sur cette terre, ta place est au ciel. Dépasse encore la condition d'ange, pénètre dans cet Océan (c'est-à-dire Dieu), que la goutte qui te constitue devienne une mer équivalente à cent mers d'Oman ".
Les mêmes idées sont exprimées avec non moins d'éloquence dans le Meçnevî 8.
L'homme reflète donc, dans son cœur, tous les attributs divins, le cœur étant pris, comme chez les Anciens, pour le siège des idées et des sentiments. Pour connaître Dieu, l'homme doit donc, par la méditation, étudier son cœur, et se connaître soi-même. C'est le γνῶθι σεαυτόν grec pris dans une acception bien différente. Les soûfîs font ici appel à un hadîth rapporté à Ali, qui aurait dit : Man l ‘arafa nafsahou ‘arafa Rabbahou. " Celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur ".
L'homme a une double nature et participe à la fois de l'Etre et du Non Etre, et par là même, du Bien et du Mal, du Réel et de l'Irréel. La face de l'homme qui procède du Réel est une émanation de la divinité et, à ce point de vue, l'homme est un avec Dieu. La partie divine de l'homme aspire toujours à être réunie à sa source, à retourner vers son origine, car, comme le dit Plotin 9, l'âme est attirée vers ce qui a de l'affinité avec sa propre nature.
Je ne crois pas hors de propos de citer ici un passage splendide de Djelâl ed-Dîn Roûmî, dépeignant cette aspiration de l'âme vers la Perfection infinie :
" Comment l'âme pourrait-elle ne pas prendre son essor, quand de la glorieuse Présence un appel affectueux, doux comme le miel, parvient jusqu'à elle et lui dit : " Elève toi " ? Comment le poisson pourrait-il ne pas bondir immédiatement de la terre sèche dans l'eau, quand le bruit des flots arrive à son oreille de l'océan aux ondes fraîches ? Comment le faucon pourrait-il ne pas s'envoler, oubliant lâchasse, vers le poignet du roi, dès qu'il entend le tambourin, frappé par la baguette, lui donner le signal du retour ? Comment le soûfî pourrait-il ne pas se mettre à danser, tournoyant sur lui-même comme l'atome, au soleil de l'éternité, afin qu'il le délivre de ce monde périssable ? Vole, vole, oiseau vers ton séjour natal, car te voilà échappé de la cage et tes ailes sont déployées. Eloigne-toi de l'eau saumâtre, hâte-toi vers la source de la vie 10...
Mais l'âme est retenue dans ses aspirations par les éléments de Non Etre. Il faut donc tâcher d'éliminer, dans la mesure du possible, cette portion inférieure de notre nature, il faut nous débarrasser de cette " ignorance ", djahl, qui nous fait prendre pour des réalités les illusions éphémères du monde phénoménal. Or, l'illusion suprême, c'est le " moi ", car tout ce qu'il y a en nous d'existence réelle appartient à Dieu. C'est du moi que proviennent tous les bas instincts, les appétits animaux, tous les désirs sensuels. Tâchons donc d'échapper à ce moi, cause de tous nos maux et de toutes nos erreurs. Bannissons l'égoïsme.
Par quel moyen ? Mais, tout naturellement, par l'amour. Nous ne pouvons, bien entendu, atteindre du premier coup à l'Amour suprême, à la passion pour l'Absolu divin. Le premier pas dans l'âpre montée vers cet idéal sublime, c'est tout simplement l'amour humain, sentiment bien naturel à l'homme, l'attrait exercé sur le cœur par la beauté des créatures ; mais ne perdons jamais de vue l'Idéal. L'amour des créatures n'est qu'un moyen, un " pont " qui nous aide à franchir l'abîme entre nous et l'Infini. Que le pèlerin, le sâlik, le marcheur dans la voie spirituelle, ne s'attarde pas sur ce pont, séduit par son charme dangereux. S'il a l'énergie de le franchir, ses yeux vont se dessiller, son cœur illuminé verra Dieu partout, et surtout dans son cœur. Tel est le but suprême, c'est la possession du Bien-Aimé, l'anéantissement en Dieu (fenâ), l'union avec Dieu par l'extase.
Nous le voyons, nous sommes loin du procédé hindou, de cet égoïsme absolu qui consiste à fermer tous ses sens au monde extérieur, et à s'abîmer dans l'inconscience en contemplant son nombril.
Le vrai Soûfî, n'agissant que par amour, ne doit pas aspirer à autre chose qu'à cette Union. Là est le but final du mysticisme passif, que Vaughan a heureusement dénommé " théopathique." 11
Mais le philosophe, comme récompense de son long et douloureux effort, arrive à un résultat qu'il n'avait pas envisagé d'abord. Quand il est favorisé de l'unification avec Dieu, il perçoit immédiatement, sans l'intermédiaire des organes des sens, la véritable nature des choses. Et en fait, quelques soûfîs ont prétendu atteindre à ce pinacle de la théosophie, démêler ainsi, par intuition, par aperception immédiate, les causes et les résultats des phénomènes, et prévoir l'avenir. Mais la plupart ont dédaigné cette vaine science, appelée ma'rifat, et n'ont pas fait part à leurs disciples des révélations ainsi obtenues. Et d'ailleurs, les plus sincères ont déclaré, comme Plotin, que ces visions sublimes ne pouvaient être décrites en langage humain, et qu'on ne pouvait que se borner à en donner, par la métaphore, un bien faible aperçu.
Les soûfîs les plus ambitieux, comme les Néoplatoniciens imposteurs de la dernière époque, ont encore prétendu dépasser le stade théosophique pour atteindre à la théurgie. Ils prétendaient que l'extase les faisait participer, non seulement à la science, mais encore à la puissance divine. Notre Djâmî écrit par exemple : " Les parfaits soûfîs disposent, par l'influence de leurs désirs et par les forces de leurs âmes, des êtres inférieurs, qui sont contraints d'obéir à leur volonté. " Notre auteur se hâte d'ajouter : " Les plus grands personnages d'entre les mystiques ne font point cas de ce dégagement des sens et de cet empire sur les êtres inférieurs." 12
Les extases, dans cette vie, ne sont que des états passagers, qui s'appellent hâl parce qu'ils expriment une " situation " qui n'est pas encore fixe, mais qui cependant renferme un commencement d'habitude, et imprime à l'âme une modification susceptible de devenir, par des actes réitérés, une manière d'être constante et habituelle. Lorsqu'elle est parvenue à ce point, elle prend le nom de maqâm^ " station " ou " degré ". 13
Nous ne donnerons pas l'exposé détaillé de la méthode suivie par les adeptes du soufisme pour atteindre leur but. On trouvera, dans les ouvrages spéciaux, des détails intéressants sur ce chapitre. Contentons-nous de dire qu'il est recommandé aux "pèlerins", aux "marcheurs " (sâlik) dans la voie spirituelle, de pratiquer l'ascétisme, de renoncer aux biens et aux honneurs mondains, de tuer les appétits animaux, la concupiscence, afin de purifier l'âme. Il faut aussi se retirer du monde pour éviter les distractions, et pouvoir réaliser la concentration sur soi-même indispensable aux méditations profondes et à la contemplation. L'examen de conscience est aussi un exercice fortement recommandé aux Soûfîs.
Beaucoup ont gravi sans guide l'ardu sentier du mysticisme, mais la plupart se sont attachés à un saint personnage, le cheïkh ou pîr, sous lequel ils se sont livrés à des exercices réguliers, tels que la danse et les hurlements des derviches. On voit que le soufisme ramène, avec un excès poussé jusqu'à l'extravagance, ce goût des pratiques extérieures qui, au début de l'Islam, avait contribué à l'éclosion du mysticisme en détachant de la religion officielle les âmes vraiment religieuses.
On voit aisément quels sont les beaux et les mauvais côtés du soufisme. Il en est, à cet égard, du mysticisme persan comme de toutes les doctrines philosophiques qui, toutes, reflètent un aspect de la vérité, mais qui tombent toutes dans l'extravagance, si l'on veut, avec cette logique inflexible et redoutable qui est le propre de la manie, les pousser à leurs dernières conséquences. Mais, autant ces excès sont funestes, autant le soufisme modéré peut produire des effets bienfaisants, en élevant l'âme au dessus des passions, en la fortifiant contre les coups de la fortune. On ne peut qu'admirer la haute sagesse, qui inspire les ouvrages de Saadî, et surtout le Pend Nâmé ou " Livre des Conseils ", dans lequel Ferid ed-Dîn Attâr prêche, avec une douceur persuasive, la modération des désirs, l'humilité, la patience, la tolérance, l'amour du prochain. 14
On trouve à plusieurs endroits des œuvres de Saadî le grand précepte qui est le fondement de la morale chrétienne, et sans doute, de toute morale raisonnable et humaine : " Considère comme licite ce qui te plairait s'il t'arrivait à toi-même, " et encore sous la forme négative : " Ce que tu ne trouverais pas bon pour toi-même, ne le trouve pas bon pour les autres. " 15
Et quoi de plus beau que ces dernières instructions de Djelâl ed-Dîn Roûmî, le plus enthousiaste et le plus grand des poètes panthéistes, à son fils : " Mon testament est que tu sois pieux envers Dieu, en particulier comme public, que tu manges peu, que tu dormes peu, que tu parles peu, que tu t'abstiennes de toute vilenie et péché, que tu sois toujours constant dans le jeûne et assidu à tes veilles, que tu fuies de toutes tes forces les appétits charnels, que tu endures patiemment les outrages du monde, que tu évites la société des gens vils et sots, que tu fraies avec les nobles cœurs et les hommes pieux. En vérité, l'homme le meilleur est celui qui fait du bien aux hommes, et le meilleur discours est celui qui guide les hommes dans la bonne voie. Louange à Dieu qui est le seul dieu". Et pourtant, ce même Roûmî, ainsi que Djâmî, affirmait dans ses œuvres l'identité du bien et du mal, qui ne sont tous deux que des manifestations différentes d'un seul et même absolu.
Comme nous l'avons vu, Dieu est pour les soûfîs le seul agent réel, le fâ’il-i haqîqî. Cela revient à l'affirmation du fatalisme. On a beaucoup insisté, à propos de l'Islamisme en général, sur les inconvénients de cette doctrine qui, dit-on, brise le ressort de l'énergie humaine, engendre l'apathie, fige les sociétés qui l'adoptent dans l'immobilité de la mort. Nous ferons d'abord remarquer à ce propos que le prophète, qui n'avait pas la tête métaphysique, n'a pas résolu ce grave problème du libre arbitre. Dans l'Islam, comme dans le Christianisme, il y a des théologiens et des sectes pour et contre le libre arbitre. D'autre part, il nous semble que ces doctrines n'exercent dans la pratique qu'une bien minime influence. Les peuples et les hommes sont fatalistes et indolents par caractère, par sentiment, par hérédité, par suite de l'influence du milieu, quels que soient les dogmes de leur religion. Il n'est pas une communauté religieuse qui proclame le fatalisme avec plus de netteté que certaines sectes chrétiennes dont les adhérents se recrutent parmi les peuples les plus énergiques.
Il est vrai, d'autre part, que nous aurions tort d'identifier la mentalité asiatique avec la nôtre. L'homme d'Orient a une force de caractère inconnue dans nos pays, et pousse, avec une logique rigoureuse, ses principes jusqu'à leurs dernières conséquences pratiques.
Les Soûfîs raisonnables, comme Roûmî, comme Djâmî, disent que l'homme doit plutôt penser au fatalisme pour excuser les péchés d'autrui, mais en revanche être bien pénétré de sa propre responsabilité, se juger sévèrement lui-même et ne pas rejeter la responsabilité de ses fautes sur la Divinité.
Du reste, les doctrines les plus hardies ne peuvent rien avoir de dangereux pour les nobles cœurs, qui jamais ne s'autoriseront d'une théorie quelconque pour manquer à leurs devoirs envers eux-mêmes ou envers leur prochain. Mais, par malheur, les êtres vicieux sont portés à les embrasser avec un enthousiasme hypocrite, afin de s'en prévaloir pour vivre à leur guise et s'abandonner à leurs passions. Les théories les plus audacieuses sont prêchées par des hommes qui, bons eux-mêmes jusqu'à la candeur, croient naïvement à la bonté foncière de la nature humaine.
Heureusement, la plupart des grands soûfîs n'étaient guère propagandistes, et pour parer au danger, se montraient difficiles dans l'admission de leurs disciples. Les adeptes devaient faire preuve de plus grande vertu et peiner longtemps sous la direction de pîrs d'une dignité de vie irréprochable. De là sont nés les ordres de derviches. Malheureusement, peu à peu la discipline s'est relâchée, et les derviches actuels, d'ailleurs inoffensifs, se recrutent surtout parmi les fainéants qui, sans charge de famille ni mission sociale, veulent vivre d'aumônes et ne sont plus que la caricature des nobles soûfîs d'autrefois. De plus, la plupart n'hésitent pas à recourir à l'alcool et aux narcotiques pour provoquer une extase à rebours qui, loin de les élever vers Dieu, les identifie avec la bête.
Enfin, le soufisme, tout en préconisant le mahométisme, admet que toutes les religions renferment une part de vérité. Mais cela revient à afficher pour toutes les croyances un grand dédain, et cet indifférentisme peut produire de funestes effets. Si " les morales puissantes et durables," comme le dit Faguet, 16 "se fondent à l'ordinaire sous forme religieuse," on peut en conclure qu'en déracinant la religion, on tue en même temps la morale qui en tirait sa sève. Le soufisme a fait disparaître tout esprit religieux dans la plupart des esprits cultivés de la Perse moderne, sans le remplacer par rien.
Or, on peut se demander si la morale peut agir sur la plupart des hommes autrement que sous la forme impérative d'un dogme religieux appuyé d'une sanction. Certes, toutes nos sympathies vont aux penseurs indépendants et loyaux, qui après de douloureux combats intérieurs, après des méditations longues et pénibles sur les grands problèmes de la vie et de la mort, les seuls insolubles, dira-ton, mais les seuls aussi dont la solution nous importe, finissent par se faire une conviction propre, ou tout au moins, par se forger un idéal, un espoir, une chimère, conforme aux exigences de leur raison, aux lumières de leur conscience, et surtout, aux aspirations de leur cœur, car c'est lui qui décide en dernier ressort. Mais combien nous trouvons ridicules ou méprisables ces esprits médiocres autant que prétentieux, qui a priori, sans avoir jamais pensé, si même ils en sont capables, rejettent tous les " préjugés, " les " superstitions " dont se sont contentés tant de grands esprits. Les grands soûfîs, comme les grands penseurs de notre époque, comme Taine, comme Renan, comme Herbert Spencer, commençaient par étudier sans dédain les doctrines religieuses et philosophiques, et en arrivaient à cette conclusion que tous ces systèmes nous offrent un reflet de la Vérité Absolue, à jamais inaccessible. " A travers la masse imposante des dogmes, des traditions et des rites, " dit Herbert Spencer," une âme de vérité est toujours visible, soit clairement, soit confusément... S'ils cachent, pour les esprits élevés, la vérité abstraite qu'ils renferment, ils rendent, pour des intellects moins parfaits, cette vérité plus appréciable qu'elle ne le serait autrement. Ils servent à rendre réel et efficace sur les hommes ce qui autrement serait irréel et sans effet. Ou bien encore nous pouvons les appeler les enveloppes protectrices sans lesquelles la vérité qu'elles renferment périrait,... des manifestations de l'Incognoscible." Combien cette tolérance large et compréhensive est plus noble et plus belle, et aussi plus intelligente, que le nihilisme des fanatiques de la négation.
C'est, sans doute, la crainte des abus qui a engagé la plupart des philosophes soûfîs à se soumettre aux prescriptions de la religion courante, afin de ne pas donner un exemple qu'ils croyaient mauvais. Nous inclinons à trouver peu loyale cette attitude, mais pourtant il serait injuste de la qualifier d'hypocrite. Qui oserait appliquer cette épithète injurieuse au grand, noble et digne Hippolyte Taine, qui, tout en professant les doctrines philosophiques les plus radicales, a cependant célébré à maints endroits les bienfaits du christianisme et s'est fait faire des funérailles protestantes? Le même philosophe se plaisait d'ailleurs à répéter souvent: "Je n'aurais dû écrire sur la philosophie qu'en latin, pour les initiés, on risque de faire trop de mal aux autres." Spencer, que nous citions tout à l'heure, écrit aussi : " Prenez garde, en extirpant l'ivraie, de ne pas arracher en même temps le bon grain." Enfin, nous pouvons trouver encore un exemple fameux en Orient, dans Averroès, le grand philosophe arabe qui rechercha sous le fatras des commentaires la pure doctrine d'Aristote, et répudia toutes les formules conciliatrices inventées par Avicenne pour accommoder la philosophie péripatéticienne avec les dogmes islamiques. Ce penseur si hardi affirmait, d'autre part, que la philosophie et la religion sont deux sentiers parallèles qui conduisent au même but. Pour lui, écrit son historien Renan, " la philosophie est le but le plus élevé de la nature humaine ; mais peu d'hommes peuvent y atteindre. La révélation prophétique y supplée pour le vulgaire." Averroès, comme tant d'autres, avait donc peur de bouleverser la conscience populaire avec des doctrines qui dépassent son horizon. Le philosophe français le juge avec indulgence, dans ce passage délicieusement renanien : " Nous nous garderons de lui en faire un reproche. La logique mène aux abîmes. L'inconséquence est un élément essentiel des choses humaines. Qui peut sonder l'indiscernable mystère de sa propre conscience, et, dans le grand chaos de la vie humaine, quelle raison sait au juste où s'arrêtent ses chances de bien voir et son droit d'affirmer ? "
Cette dernière phrase est digne d'être retenue et méditée. Y a-t-il jamais eu un philosophe assez présomptueux pour se persuader qu'il avait vraiment déchiffré l'énigme du monde, et prétendre en imposer la solution à tous ses semblables ? Et tous n'auraient-ils pas mieux fait d'employer souvent, comme le grand Schopenhauer, le mot " probablement " ? Mais ce vocable trouve difficilement sa place dans les catéchismes de toutes couleurs, et répugne aux pontifes de toutes nuances, qui savent que les masses ont soif d'affirmation et transforment en dogmes ce qu'on leur fait croire. Il faut beaucoup d'audace pour détruire un idéal moral ou politique qu'on n'est pas sûr de pouvoir remplacer par un autre meilleur et immédiatement assimilable. Or, il faut la présomption du génie — ou de la sottise — pour avoir cette confiance en soi.
Que les sociétés évoluent, rien de plus évident, mais qu'on ne se laisse pas abuser par les mots. Cette évolution n'est pas homogène. Dans nos pays ultra civilisés de l'Europe Occidentale même, si les couches supérieures — qui, d'ailleurs, ne coïncident pas avec les castes sociales basées sur le rang et la fortune — atteignent à une moralité ou à une intellectualité très élevées, — qui ne vont pas toujours de pair — n'y a-t-il pas, au bas de l'échelle, des masses innombrables qui n'ont pas dépassé le stade du fétichisme le plus grossier ? Le devoir social, bien entendu, est de les relever, et ceux qui parlent de Voltaire en l'ayant lu n'iront pas vilipender après lui le peuple, " la canaille, qui sera toujours la canaille et qui ne sera jamais éclairée." Nous aimons mieux voir nos semblables, de toutes races et de toutes conditions, se hausser vers des conceptions religieuses et philosophiques de plus en plus nobles et pures, mais rien ne peut se faire que progressivement. Il faut de la prudence et des ménagements dans cette montée vers la lumière, de même que l'on ne tire pas brusquement à l'aveuglante clarté du jour les chevaux de mine qui ont passé de longues années dans les ténèbres. Marcelin Berthelot prétendait que la science tend " au nivellement des classes sociales aussi bien que des intelligences." Affirmation purement gratuite, pour ce qui concerne le second point. Nous croyons, au contraire, que la différenciation des aptitudes s'accentue à mesure que nous avançons, et nous soutenons même qu'il faut y voir une des causes de la supériorité de nos sociétés sur celles de l'Orient, où règne l'égalité des intelligences. Mais, d'autre part, cette différenciation est une des principales causes du malaise social, dans une société régie par des lois uniformes.
Ajoutons que les extravagances et les vices des faux soûfîs finirent par faire tomber ce nom dans le discrédit. Beaucoup de vrais soûfîs se défendirent de l'être et il est bien rare, à partir d'une certaine époque, qu'ils emploient ce terme en parlant d'eux-mêmes. Ils s'appellent de préférence "les gens du cœur," les "gens de la vie intérieure" ahl-i dil, sâhib-dil, ahl-i bâtin, ou encore les " gens du mystère, " ahl-i râz.
C'est sans doute aussi pour cela que les Bâbîs, adeptes de cette religion née en Perse vers 1850 et qui a eu un succès si prodigieux, se défendent avec ardeur d'avoir rien de commun avec les soûfîs, alors que, cependant, les ressemblances entre le deux doctrines sont évidentes. Les systèmes soûfîs et la dogmatique béhâïe sont presque identiques. A tel point que l'exposé de la doctrine bâbie sous sa dernière forme, telle que la prêche Abbâs Effendi, pourrait être pris, sans changement appréciable, pour un résumé du système soûfî. 17
Si le soufisme, dans le domaine de la morale pratique, a fait quelque bien, il a aussi causé beaucoup de mal à la Perse, sans qu'il faille toutefois s'en exagérer la portée. Mais, à d'autres égards, cette religion de l'Amour et de la Beauté a alimenté une littérature poétique qui a produit de nombreux chefs-d'œuvre sans analogues dans les autres littératures, et qui s'élève souvent jusqu'au sublime. Au point de vue philosophique, si l'on écarte du panthéisme mystique persan les excès que les plus grands apôtres eux-mêmes réprouvaient, on ne peut s'empêcher d'y voir et d'y admirer une hypothèse grandiose, qui nous montre dans la Nature une émanation de l'Absolu, dont la fin dernière est de retourner, par l'évolution et le progrès, à sa source, la Perfection infinie. Du reste, au pis aller, on peut toujours considérer les systèmes métaphysiques comme des chefs-d'œuvre d'imagination poétique dignes d'exciter notre admiration.
Pour exprimer métaphoriquement les aspirations des pèlerins du soufisme et les ravissements de l'extase, les poètes persans et leurs imitateurs turcs et hindoustanis, comme d'ailleurs les mystiques de tous les temps et de tous les pays, emploient des expressions relatives à l'ivresse produite par le vin, et surtout aux délices de l'amour. Dieu devient l'Amant, le Bien-Aimé, dont la possession produit la volupté suprême. La douleur d'être séparé de la personne aimée est l'image des tourments de l'âme aspirant à retourner à son origine et se débattant contre les attaches charnelles et les passions terrestres. Les coquettes œillades de l'amante, ce sont les éclairs passagers qui, de temps à autre, illuminent l'âme du parfait soûfî et la mettent pour un instant en face de la Réalité Divine. D'après certains auteurs, l'accumulation de ces métaphores aurait donné lieu à une terminologie singulière, très détaillée et systématique. Il y a môme de nombreux ouvrages sur ce sujet, des lexiques où l'on peut apprendre ce que veut dire le poète quand il parle de la bouche, de l'œil, de la lèvre, du grain de beauté de sa bien-aimée. 18 Il n'est guère probable que des poètes aient appliqué méthodiquement ces vocabulaires symboliques.
Une traduction, en prose surtout, ne peut jamais donner qu'une idée très approximative du poème original. C'est déjà vrai quand il s'agit de faire connaître au lecteur français le produit d'un art apparenté au nôtre : le charme du rythme et de la rime disparaît, et que reste-t-il alors, quand il s'agit d'œuvres dont la valeur réside en grande partie dans la musique des vers ? Combien une traduction diminuerait, par exemple, l'impression délicieuse qu'engendre pour nous la lecture d'un sonnet de Heredia. Mais pourtant, quand il s'agit de transposer un poème d'une langue européenne dans une autre, la splendeur des images et des idées subsiste, et même, jusqu'à un certain point, il peut rester un pâle souvenir de la cadence des périodes. Mais quand il s'agit d'un poème oriental, il n'en va pas de même. Nous sommes dans un monde d'idées inconnu pour nous. Nous avons affaire à une esthétique, à une rhétorique toutes différentes des nôtres, et la tâche du traducteur devient tellement épineuse qu'il faut un certain courage pour l'affronter. Voici des exemples des difficultés qui se présentent :
Dans les poèmes persans, le second hémistiche est souvent une répétition du premier en termes différents. Nous avons ici, occasionnellement, le procédé qui est suivi d'un bout à l'autre dans l'épopée finnoise du " Kalévala". En français, une traduction littérale risquerait fort, dans ce cas, de devenir insupportable.
D'autre part, nous considérons, en général, comme un défaut la répétition fréquente d'un même mot à des intervalles rapprochés. Les auteurs persans, au contraire, s'ingénient à épuiser, dans plusieurs vers consécutifs, tous les sens propres et figurés d'un même mot. Et l'on voit ainsi de très longues tirades roulant sur deux ou trois vocables.
Enfin, outre les figures de style usitées chez nous, et que les Persans emploient avec une extrême abondance, leurs poètes en affectionnent quantité d'autres que nous ignorons ou que nous n'employons guère, ou même pour lesquelles nous ne professons que du dédain. Ils les divisent en figures de mots et figures de pensées.
Les secondes nous sont assez familières. Telles l’antithèse. Exemple : " Il vaut mieux mélanger la rudesse et la douceur, comme le saigneur qui est à la fois chirurgien et metteur de baume." L’hyperbole, dont les poètes persans font un usage qui nous paraît abusif, surtout dans les panégyriques. Le lecteur en verra plus loin des exemples édifiants. En voici un, emprunté au Châh-Nâmé, dont cependant, en général, le style est d'une grande sobriété : " Un armée si nombreuse que l'amas des lances fermait le chemin au vent."
D'autres sont plus particulières aux Persans. Tel le dialogue (souâl o djèvâb "question et réponse"), qui produit même sur nous une impression très agréable. Des poèmes entiers, dont beaucoup sont des chefs d'œuvre de grâce, sont bâtis sur ce système. Voici, comme exemple, quelques vers d'un petit poème d'Amîr Mou'izzî :
Je dis : " Donne-moi trois baisers, ô lune qui prend les cœurs."
Elle dit : " A qui au monde la lune a-t-elle jamais donné de baisers ? "
Je dis : " L'éclat de ton visage augmente la nuit."
Elle dit : " C'est la lune des cieux qui, la nuit, donne de l'éclat."
Je dis : " Dans quelque endroit que tu sois, je ne te vois jamais immobile."
Elle dit : " La lune ne reste jamais immobile en un endroit."
Je dis : " Il y a sur tes joues un merveilleux parterre de roses. "
Elle dit : " Ce serait bien étonnant qu'il y eût une roseraie dans la lune'" 19
A noter aussi, parmi les figures du même genre, basées sur le sens des mots, le housn-i ta’lîl " élégante indication de la cause. " Il y en a, dans notre poème, un exemple gracieux et original, dans la description des charmes d'Absâl. (V. vers 429.)
Citons encore le laff o nachr, qui consiste à énumérer dans le second hémistiche des mots qui se rapportent respectivement à ceux énumérés dans le premier hémistiche. On en trouverait aussi des exemples en français. En voici un spécimen extrait du Chah Nâmé : " Ce vaillant héros, avec le glaive et la dague, avec la massue et le lasso, coupa et déchira, brisa et lia aux héros [ennemis] la tête et la poitrine, les pieds et les mains. "
Quant aux jeux de mots, que nous n'apprécions guère, ils pullulent dans la poésie persane. C'est, en somme, affaire de goût. Les classiques grecs et latins les affectionnaient, et on en trouve des multitudes, par exemple, chez Platon et chez Cicéron. Victor Hugo, non plus, n'a jamais eu beaucoup de scrupule à en faire usage. Citons d'abord l'homonymie, parfaite ou approximative, le calembour, en persan tadjnîs. Exemples d'homonymies parfaites (tadjniss-i tâmm). " Puisque Dieu t'a donné (dâd) tout ce pouvoir, pourquoi ne pratiques-tu pas la justice (dâd) ? "
" Autant que possible, ô échanson, ne laisse échapper de ta main, (c'est à dire : de ton pouvoir) à la saison du printemps, ni le bord (lab) de la coupe, ni la rive (lab) du ruisseau, ni la lèvre (lab) de ton amie."
Exemples d'homonymie imparfaite (tadjnîss-i nâqis) :
" Elle (la motte de terre) dit : Je n'étais qu'une argile (guil) sans valeur, mais je suis restée quelque temps à côté de la rose (goul).
Tadjnîss-i zâyid, " homonymie augmentée," où un mot a une syllabe de plus que l'autre au commencement :
" La noblesse de chacun dépend de son mérite (kamâl) et non pas de sa richesse {mai).'"
Tadjnîss-i mouzîl, " homonymie caudée." Ici, un des deux mots a une syllabe de plus que l'autre à la fin :
" Notre loi (âyîn) c'est d'avoir le cœur [pur] comme un miroir (âyîna)"
Tadjnîss-i mourakkab, " homonymie composée ", où l'un des deux homonymes est formé par deux mots, comme par exemple : bâzârî un " marché " et bâ zâri " avec des lamentations ".
On peut rattacher aux jeux de mots les jeux d'écriture, d'une variété infinie, et dont il nous est évidemment impossible de donner une idée au lecteur. Les traits qui constituent les caractères sont identiques, les points diacritiques qui différencient par exemple le b de l’n, du t etc. sont seuls placés différemment.
Le tard o ‘aks consiste en ce que les premiers mots du premier hémistiche sont répétés à la fin du second, et ceux de la fin du second au commencement du premier :
Az lab-i djânân-i man zinda chavad djân-i man,
Zinda chavad djân-i man az lab-i djânân-i man.
" Par la lèvre de ma bien-aimée est vivifiée mon âme, mon âme est vivifiée par la lèvre de ma bien-aimée. "
Dans le raddou-l'adjz ‘ala-s sadr, le premier mot du premier hémistiche est le dernier du second :
Choumâr-i gham-i où nadânam az ânki
Bîroûn choud gham-i où zi-hadd-i choumâr.
"Je ne sais pas évaluer (choumâr) la peine qu'elle me cause, parce que la peine qu'elle me cause dépasse toute évaluation. "
Dans la " chaîne des deux chameaux ", qatarou-lba ‘iraïn, le dernier mot du premier hémistiche devient le premier du second :
Nigah dâr mârâ zi râhi khatâ,
Khatâ dar gouzâr o savâb-am noumâ.
" Garde nous du chemin de l'erreur (khatâ).
L'erreur, oublie-la et montre moi le bon parti. "
II est fait aussi un emploi fréquent de l'anagramme parfait ou imparfait, par exemple entre khâk " terre " et kâkh " balcon ", roûz "jour " et zoûr « violence ", kamar " ceinture " et makr " ruse ". 20
Nous ne citons que les principales figures, celles dont nous pouvons aisément donner une idée. Dans les notes, nous attirerons encore l'attention sur quelques cas particuliers.
Les Persans ont emprunté aux Arabes les procédés et les règles compliquées de leur prosodie, et y ont ajouté beaucoup d'éléments nouveaux.
Le poème de Salâmân et Absâl est, comme tous les romans poétiques persans, un meçnèvî, c'est-à-dire un poème où les vers (misrâ') riment deux à deux, formant ainsi des distiques (bait). Parfois le dernier mot de deux misrâ's consécutifs est le même, et s'appelle rèdîf. Dans ce cas, le mot qui porte la rime précède le rèdîf. Nous en avons un exemple dans le troisième distique ci-dessous.
A l'agrément de la rime, les vers persans joignent celui d'un rythme basé, comme dans la versification latine et grecque, sur la succession régulière des syllabes brèves et longues, les syllabes pouvant, comme dans les deux langues classiques, être longues parce qu'elles renferment une voyelle longue ou bien par position, quand la voyelle brève est suivie de deux consonnes.
Le vers ici employé s'appelle ramal. Le schéma en est le suivant, u désignant une syllabe brève, — une syllabe longue :
— u — — | — u — — | — u —
Je transcris, comme spécimen, le commencement du poème :
Aï ba yâdat tâza djân-i âchiqân,
Z'âb-i loutfat tar zabân-î âchiqân,
Az to bar i âlam fitâdê sâya-î
Khoûbi-roûyân râ chodâ sarmâya-î.
'Achiqân ouftâda-i ân sâya and,
Manda dar sawdâ az an sarmâya and.
Il est à noter que chaque distique a, en général, un sens complet, et que même, le plus souvent, chaque vers forme une proposition.
Pour mieux faire comprendre la métrique du poème, Fitz Gerald a imaginé les deux exemples suivants en latin "monacal" (monkish) et en anglais:
Dum Salaman verba regis cogitat,
Pectus intra de profundis aestuat.
Of Salàmàn and of Absàl hear the song ;
Little wants Man here below, nor little long.
Je reproduis ici, avec quelques additions sans importance, la biographie de Djâmî par Rosenzweig, que Fitz Gerald aussi a mise en tête de son adaptation en vers, et qu'il juge " assez amusante pour en excuser la longueur ".
Notre poète, dont le nom est Noûr ed-Dîn " la Lumière de la Religion " 'Abdou-r-Rahmân " l'Esclave du Miséricordieux ", est né en 817 de l'hégire, correspondant à 141 4 de l'ère chrétienne, à Djâm, petite ville du Khorassan, où avait émigré son père, Mawlânâ Nizâm ed Dîn, homme d'humble naissance provenant de Decht dans le district d'Ispahan. Selon l'usage persan, on ajouta au nom du poète celui de son lieu d'origine ; le mot Djâm, comme nom commun, signifie " coupe, " et Djâmî, dans toutes ses œuvres, joue sur ce double sens. Il a écrit, entre autres, ce quatrain cité par Dawletchâh dans le Tazkiratou-ch Chou'èrâ : " Je suis né à Djâm, et ma plume a été trempée dans la coupe (djâm) du savoir théologique, il faut donc bien que dans un double sens mon surnom (takhallous) soit Djâmî." Plus tard, sa célébrité lui valut les titres pompeux de " Seigneur des Poètes," " Eléphant de la Sagesse" etc., mais sa modestie se contenta toujours du simple nom de Djâmî ; il aimait aussi à se dire " le Vieux de Hérat," où il passa presque toute son existence. La sainteté de sa vie lui a valu le titre de mawlânâ, " Notre Maître."
Dès son enfance, il se distingua par sa piété et son intelligence. En 1419, un saint personnage, Khâdja Mohammed Pârsâ, passait par Djâm. On amena le petit Djâmî, âgé de cinq ans, devant la litière du vénérable cheikh, qui lui donna un bouquet. Djâmî se rappelait encore soixante ans après cet épisode, qui fut pour lui une source de bénédictions.
Djâmî raconte aussi : " Quand Mawlânâ Fakhr ed-Dîn Louristânî descendit un jour chez ma mère, j'étais encore si petit qu'il me prit sur ses genoux, et, traçant avec ses doigts dans l'air les caractères des mots Ali et Omar, il s'amusa à me les entendre épeler. Lui aussi, par sa bonté, jeta dans mon cœur la semence de sa dévotion, qui n'a cessé de croître en moi, et dans laquelle j'espère vivre et mourir. O mon Dieu ! fais moi vivre pauvre (derviche) et mourir derviche, et fais moi retourner à la Vie dans la compagnie des derviches. "
Djâmî alla d'abord à l'école à Hérat, puis à la médressé fondée par Timour à Samarcande. Non seulement, il éclipsa ses condisciples dans les études encyclopédiques qui constituaient, alors comme aujourd'hui, l'éducation persane, mais encore, il embarrassa plusieurs fois les docteurs en logique, astronomie, et théologie, et pourtant, ajoute malicieusement Fitz Gerald, ils l'accueillirent sans rancune en disant : " Voilà une nouvelle lumière ajoutée à notre " voie lactée ", à notre brillante assemblée."
Djâmî aurait continué de séjourner, sans doute, dans la grande cité, mais un songe le fit retourner à Hérat. Le grand maître soûfî qui enseignait là-bas, Mohammed Sanad ed-Dîn Kâchgârî, de l'ordre des derviches Naqchbendîs, lui apparut en songe et lui ordonna de retourner " chez un homme qui satisferait tous ses désirs. " Djâmî regagna donc Hérat, où il vit le cheikh discourant avec ses disciples sur la porte de la grande mosquée. Pendant plusieurs jours, il n'osa pas s'approcher ; mais l'œil du maître était sur lui, le magnétisant et l'attirant de plus en plus, si bien qu'à la fin le cheikh dit à son entourage : " Voici que je viens de prendre un faucon dans mon filet." Ce fut sous la direction de ce pîr que Djâmî commença son noviciat soûfî. Il y apporta une telle ardeur et subit de la part du maître une telle fascination qu'allant, dit-il, par un jour de congé, se promener à la campagne,' un seul vers suffit à le faire revenir sur ses pas ;
" Comment ! je suis ici, et c'est la Rose que tu regardes ? "
Djâmî progressa régulièrement dans la voie spirituelle. Il finit par se retirer dans une solitude si prolongée que, quand il revint parmi les hommes, il avait presque perdu le pouvoir de converser avec eux. Enfin, ayant franchi toutes les étapes, il était dûment autorisé à enseigner comme docteur soûfî, et de jeunes aspirants qui l'avaient vu en songe, comme Kâchgârî lui était apparu à lui-même, le sollicitaient de les mener vers la Vérité. Mais sa modestie le retint, et aussi sa reconnaissance et sa vénération pour son défunt maître, qui l'empêcha de prendre sa place près de la mosquée avant que l'âge eût blanchi ses cheveux.
Entretemps, continue Fitz Gerald, Djâmî était devenu poète, ce qui sans aucun doute, donna l'essor à sa réputation et à sa doctrine bien loin " parmi ces nations pour lesquelles la Poésie est un élément vital de l'air qu'elles respirent. " Le lecteur européen sera peut-être surpris d'apprendre qu'à Chîrâz, où vécurent et moururent Saadî, il y a huit siècles et demi, et Hâfiz, il y en a six, pas un jour ne se passe sans que les mains de pieux admirateurs ne viennent joncher de fleurs leurs tombeaux.
A plusieurs reprises, Djâmî se reproche d'avoir perdu, à ce passe-temps frivole de la poésie, une vie précieuse qu'il aurait dû consacrer à la contemplation : " Mille fois je me suis repenti d'une telle occupation, mais je ne pouvais pas plus l'esquiver qu'on ne peut échapper à la destinée écrite sur le front ". Ce ne sont là que doléances sans portée réelle, et d'autre part, comme il sied à tout poète, Djâmî a conscience de sa valeur et s'écrie ensuite : " Comme poète, j'ai résonné à travers le monde ; le ciel a été rempli de mon chant, et la fiancée du Temps a orné ses oreilles et son cou des perles de mes vers, dont la caravane, à son arrivée, a été saluée gaiement par Hâfiz et Saadî. Les rois de l'Inde et de Roûm m'envoient de flatteuses missives, les maîtres de l'Iraq et de Tèbrîz m'accablent de leurs dons, et que dirai-je de ceux du Khorassan, qui me noient dans un océan de munificence ? "
Ces expressions pompeuses ne font, bien qu'orientales, qu'exprimer la pure vérité. Djâmî fut comblé d'honneurs par les monarques de sa patrie et de l'étranger, au moment même où ils se coupaient réciproquement la gorge. Il eut pour mécènes son propre Sultan, Abou Saïd Gourgânî ; Hassan Beïg de Mésopotamie, " Seigneur de Tèbrîz ", par qui Abou Saïd fut vaincu, détrôné et mis à mort ; Mahomet II, Sultan de Turquie, " Roi de Roûm" qui, à son tour triompha de Hassan en 1473, et enfin, Housseïn Mîrzâ Bâïqarâ (1469-1506) descendant de Timour, qui chassa le souverain que Hassan avait installé à Hérat à la place d'Abou Saïd.
Le poème qui nous occupe est dédié à Hassan, le fameux Ouzoun Hassan, " Hassan le Long ", chef de la tribu turque du " Mouton Blanc " (Aq-Qoyounlou), à qui la république de Venise envoya à plusieurs reprises des ambassadeurs pour briguer son alliance. Voici comment Djâmî entra en relation avec lui : En 877 de l'hégire, soit 1472 de notre ère, notre poète, approchant de la soixantaine, alla en pèlerinage à la Mecque. La vénération qu'inspirait Djâmî fut cause de ce que les divers potentats dont il traversa les territoires firent accompagner d'escortes protectrices la caravane dont il faisait partie.
Djâmî arriva ainsi à Bagdad, où il eut des ennuis par suite de la trahison d'un de ses suivants qu'il avait réprimandé, et qui cita, en les altérant, des vers de Djâmî qui prenaient ainsi un sens injurieux pour Ali, l'imâm bien-aimé des Persans chî'ites. L'affaire transpira jusqu'à Bagdad et fut portée devant un tribunal où siégèrent les deux fils de Hassan Beïg. Djâmî s'en tira victorieusement, et son accusateur, la barbe épilée, fut cloué au pilori sur la place du marché de Bagdad. Mais le poète fut indigné de la stupidité de ceux qui avaient ajouté foi à cette délation.
Après un séjour de quatre mois dans la région de Bagdad, Djâmî traversa, en vingt-deux jours, le désert, et arriva à Médine et à la Mecque.
Puis il reprit le chemin de Hérat, et passa quarante cinq jours à Damas. Il y fut reçu avec grand honneur et en sortit la veille même du jour où les envoyés de Mahomet II arrivaient avec un cadeau de 5000 ducats pour le conduire à Constantinople. A partir d'alors, Mahomet II, qui composa lui-même de nombreux poèmes turcs sous le pseudonyme de 'Avnî, envoya chaque année à son illustre collègue Djâmî une pension de mille florins qui fut continuée par son fils Bajazet (Bâyèzîd) II.
A Tèbrîz, Djâmî fut reçu en audience solennelle par Ouzoun Hassan, qui précisément était en guerre avec Mahomet II, et qui, lui aussi, aurait voulu garderie poète à sa cour. Mais Djâmî avait hâte de revoir les jardins de Hérat, et sa vieille mère. Il rentra dans ses foyers en 1473.
C'est là ce Hassan " beau de caractère comme de nom" — Hassan veut dire " beau " en arabe — qui apparut en songe à Djâmî. Le poème de Salâmân et Absâl est aussi dédié à Ya'qoûb Beïg, qui succéda à son père grâce au meurtre d'un frère aîné.
Hérat avait, depuis le départ de Djâmî, un nouveau prince, Mirzâ Housseïn Bâïqarâ, le dernier des Timourides, qui reçut Djâmî à bras ouverts. Le vizir du nouveau prince, Mîr Ali Chîr Nèvâyî, un des fondateurs de la poésie turque et l'un des principaux poètes qui aient écrit en turc oriental, combla toujours d'égards le grand poète persan, qui d'ailleurs a servi de modèle à tous les poètes turcs de la première époque, jusqu'en 1450.
Djâmî mourut à quatre-vingt-un ans. Beaucoup de ces poètes Soûfîs, atteignirent un âge avancé, ce qui est dû, sans doute, à leur vie frugale et vertueuse.
Le poète, qui avait toujours dédaigné les honneurs et la fortune, et avait toujours vécu en derviche, eut de splendides funérailles aux frais du sultan. Tous les grands de l'état suivirent sa dépouille mortelle, et vingt jours après son inhumation, un panégyrique en vers composé par le vizir fut récité en présence du sultan. Mîr Alî Chîr mit aussi la première pierre du mausolée de Djâmî, édifié dans un jardin proche de F'îdgâh (place où ont lieu les fêtes) de Hérat.
Sa mort fut un deuil public. Djâmî était adoré du peuple, des petits, des humbles qui, chaque jour, se pressaient en foule devant le portail de la grande mosquée de Hérat pour entendre ses douces allocutions. Et sans doute, comme tant d'autres grands philosophes de Perse, jusqu'en notre siècle, 21 Djâmî se contentait de peu pour vivre et distribuait aux pauvres les largesses que lui valait la munificence des souverains.
Djâmî laissa une grande réputation, non seulement comme poète, mais encore comme philosophe et saint personnage, et son tombeau fut le théâtre de plusieurs miracles.
Djâmî passe pour ne jamais avoir eu qu'une seule femme, la petite-fille de son cheikh bien-aimé. Elle lui donna quatre fils, dont les trois premiers moururent en bas-âge. Le dernier, un fruit de sa vieillesse, pour qui il composa plusieurs ouvrages, et entre autres son charmant Bèhâristân, n'atteignit pas non plus l'adolescence, et son père lui survécut.
Le talent poétique se perpétua cependant dans la famille de Djâmî. Son neveu Hâtifî, fils de sa sœur, fut un des principaux poètes persans. Il mourut en 927 de l'hégire (1520 de notre ère).
Djâmî se distingue, comme écrivain, par une fécondité prodigieuse. Chîr Khân Loûdî, d'après Sir Gore Ouseley, lui attribue quatre-vingt-dix-neuf volumes. L'inventaire plus modéré, mais déjà abondant, de Rosenzweig, énumère trente-quatre œuvres en prose et seize en vers. Il y a, parmi les premières, des traités grammaticaux, des commentaires d'ouvrages divers, entre autres de certains passages du Mecnevî de Djelâl ed-Dîn Roûmî, de la Khamriyyé du plus grand des Soûfîs arabes, Ibnou-l-Fârid, de nombreux traités philosophiques, des lettres et un traité d'épistolographie, un autre sur la musique, etc. Cette énumération partielle donne une idée du savoir étendu de Djâmî et de la variété de ses aptitudes. Et l'on pourrait craindre qu'une érudition si copieuse n'ait étouffé en lui l'esprit poétique. Or, c'est comme poète qu'il nous intéresse surtout.
Djâmî est le dernier des grands écrivains Soûfîs et des grands classiques persans. Quand il a paru, le soufisme était complet et systématisé depuis longtemps. Djâmî avait, certes, l'esprit assez vaste pour embrasser magistralement la doctrine dans tous ses détails, et on en trouve dans tous ses écrits en prose des analyses subtiles, dans ses poèmes des exposés grandioses. Comme philosophe, Djâmî a fait preuve d'une audace étonnante. Il a développé, de la façon la plus nette, les conceptions panthéistes, sans reculer devant les dernières conséquences du système. Dès les premiers vers de Salâmân et Absâl, par exemple, il n'hésite pas à implorer de la Divinité une identification avec Elle assez parfaite pour voiler à ses yeux la distinction du bien et du mal (Vers 14).
Le lecteur verra aussi que Djâmî profite noblement de la vénération qu'il inspirait, aux princes comme au vulgaire, pour leur donner, sans détours, des leçons bien senties. On aurait tort de lui reprocher les panégyriques pompeux qu'il adresse à ses protecteurs. Eux-mêmes, sans doute, n'y voyaient guère que des exercices de rhétorique. Les poètes orientaux, comme d'ailleurs les gens de lettres d'Europe jusqu'à une époque toute récente, n'avaient pas à compter pour vivre sur le produit des droits d'auteur. Les écrivains devaient bien faire hommage de leurs œuvres à des princes qui les récompensaient plus ou moins généreusement. Ils devaient briguer la faveur d'un despote à une seule tête, tâche ingrate, certes, mais est-il moins déplaisant de flatter ce monstre à mille têtes qu'on appelle le public ? Et d'ailleurs, une ces dédicaces expédiées, le poète persan pouvait s'abandonner tranquillement à son inspiration dans le reste de l'ouvrage. Et il n'est pas probable que Djâmî ait manqué à ses vœux de pauvreté volontaire, pas plus que ses illustres prédécesseurs Saadî, Hâfiz ou Attâr, qui, loin de mendier les faveurs des princes, ont bien souvent refusé noblement celles qu'on leur offrait, et se sont contentés du strict nécessaire.
Comme poète, la tâche de Djâmî était singulièrement difficile.
Il venait après une pléiade lumineuse de grands esprits qui avaient traité brillamment tous les sujets. Il eut le courage d'aborder tous les genres, en prose comme en vers. Il lui était malaisé de surpasser, dans le genre romanesque, le fameux Nizâmî, dans la poésie mystique et allégorique, Roûmî et Ferîd ed-Dîn Attâr, dans son Gulistan, l'incomparable Saadî. Comme toute l'invention devait porter sur le détail, il était bien difficile à Djâmî d'innover sans chercher ses effets un peu loin, sans tomber dans le baroque, la boursouflure, sans abuser des concetti et des artifices les plus raffinés de la rhétorique. On voit déjà apparaître chez lui ces défauts qui rendent insupportable la lecture de la plupart des poètes persans de l'époque postérieure, soit depuis le commencement du seizième siècle jusqu'à nos jours, à part de rarissimes exceptions comme le délicat Hâtif d'Ispahân (dix-huitième siècle) et Qaânî (dix-neuvième siècle).
Quand même, Djâmî eut assez de mérite pour avoir droit à la gloire. Il est inutile d'insister sur ce sujet. Notre traduction, toute imparfaite qu'elle est, et surtout la charmante transposition en vers anglais de Fitz Gerald, permettront au lecteur de s'en faire une idée. Salâmân et Absâl est loin, pourtant, d'être le chef-d'œuvre de Djâmî. On n'y rencontrera point de superbes tirades mystiques comme il s'en trouve de nombreuses, par exemple, dans Yoûssouf et Zouleïkhâ.
Toutefois, — pour n'attirer l'attention que sur deux ou trois passages, — la description des tentatives de séduction d'Absâl, celle du voyage des deux amoureux dans l'île de Khorrem, le chapitre où Djâmî se lamente sur les inconvénients de la vieillesse, charmeront sans doute le lecteur. Il remarquera aussi la variété de ton qui empêche de trouver fatigante la lecture de ce poème ; Djâmî, à cet égard, joint aux qualités de Djèlâl ed Dîne Roûmî le délicieux humour de Saadî, une douce mélancolie, un naturel plein de grâce dans les endroits où, quittant les sommets mystiques, il redevient lui-même.
Parmi les trente-quatre ouvrages en prose de Djâmî, cités par Rosenzweig, nous signalerons surtout les Nafahâtou-l’Ouns ou " Haleines de l'Intimité [avec Dieu]." Ce grand ouvrage renferme les biographies de six cent quatre soûfîs illustres, précédées d'une étude générale sur les doctrines soûfies et les méthodes suivies par les adeptes du soufisme pour arriver à la perfection. Le texte a été publié par Nassau Lees (1859).
Le texte et la traduction de l'Introduction, ainsi que la biographie de Djouneïd comme spécimen, suivie de la liste des autres biographies, ont été publiés par le génial promoteur de la philologie arabe, Silvestre de Sacy, dans les Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque Royale, (de Paris) vol. XII.
Signalons aussi les Lawâ'ih, exposé systématique, en prose mélangée de vers, de la philosophie soûfîe, ouvrage très condensé et d'une lecture ardue, dont Whinfield a publié le texte et la traduction anglaise.
Rosenzweig cite ensuite seize ouvrages en vers. Les plus célèbres sont les cinq meçnevîs réunis souvent, à l'imitation des cinq poèmes analogues de Nizâmî, sous le nom de Khamsa. On voit clairement que Djâmî a voulu rivaliser avec son illustre devancier. Les titres mêmes de ces cinq poèmes sont les pendants (djavab) de ceux des cinq meçnevîs de Nizâmî, et certains sujets sont les mêmes.
Le poème principal de la Khamsa, qui est en même temps le chef-d'œuvre de Djâmî et un des joyaux de la littérature persane, a pour titre Yoûssouf et Zouleïkhâ (ou, plus exactement, Zalîkhâ). Cet ouvrage, composé en 1483, a été publié, texte et traduction en vers allemands, par Rosenzweig, Vienne 1824. Il a été traduit en vers anglais par Rogers (Londres 1892) et par Ralph. I. H. Griffith (ib. 1881).
Nous serions disposés à le faire connaître également au public lettré de langue française, si la traduction que nous offrons aujourd'hui au public suscite quelque intérêt.
Viennent ensuite:
2) Le Touhfatou-l-Ahrâr, " Cadeau aux hommes libres," traité doctrinal de mysticisme faisant pendant au Makhzanou-l-Asrâr de Nizâmî. Un poème ainsi destiné à rivaliser avec un autre de contenu et de titre analogue s'appelle djavâb, "réponse."
3) Le Soubhatou-l-Abrâr ou " Chapelet des Justes, " du même genre que le précédent, mais moins abstrait.
4) Madjnoûn et Laïla, (écrit en 1484), poème romanesque dont le sujet a tenté de nombreux auteurs orientaux, et qui narre les aventures de deux amants malheureux (Voir note du vers 4). Djâmî le traite avec beaucoup plus d'ampleur que ses devanciers. Ce poème a été traduit en français par Chézy.
5) Enfin le Khirad Nâma-i Iskandarî, dont le contenu ne ressemble guère à celui du poème d'Alexandre de Nizâmî. Ici on trouve l'exposé de discussions entre Alexandre et les sages de la Grèce.
A ce recueil de cinq meçnevîs se sont ajoutés plus tard deux autres de moindre importance : Salsalatou-z-Zahab, " la Chaîne d'Or ", et Salâman et Absâl. Les sept réunis prennent le nom de Haft Aurang, les " Sept Trônes " ou " les Sept Etoiles de la Grande Ourse ".
Ajoutons encore plusieurs divans ou recueils de poèmes lyriques, dont une partie a été traduite en vers allemands par Rückert dans le Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft, et enfin, le Behâristân ou "Jardin Printanier ", délicieux recueil en prose et vers dédié au dernier né de Djâmî, Yoûssouf, où le poète a tâché, non sans succès, de rivaliser avec l'incomparable Goulistân de Saadî. Le Behâristân a été édité et traduit en allemand par Schlechta-Wssehrd, Vienne, 1846 et en anglais par Sir Richard F. Burton, pour le " Kamashastra Society", Benares, (Londres) 1887.
On voit que parmi les nombreux ouvrages de Djâmî, bien peu ont été publiés en Europe, fût-ce même dans le texte, et que presque tous sont inaccessibles au public lettré. Seuls, Madjnoûn et Leïlâ, le début des Nafahâtoul ’Ouns et quelques fragments épars dans les notes du Pend Nâmè d'Attâr édité et traduit par de Sacy, sont à la portée du lecteur français.
Ecrit encore après Yoûssouf et Zouleïkhâ, que Djâmî a terminé à soixante-dix ans, Salâmân et Absâl est une œuvre de l'extrême vieillesse du poète. On ne s'en douterait pas, à en juger par la fraîcheur, la grâce, l'imagination exubérante qui distinguent ces poèmes. On ne peut s'empêcher de se rappeler à ce propos d'autres grands esprits qui, à un âge avancé, ont produit des œuvres qui respirent cette éternelle jeunesse, apanage du génie ; citons au hasard Haydn et ses Saisons, Victor Hugo, Gœthe, Firdaussî dans Yoûssouf et Zalîkhâ, etc.
Le sujet de Salâmân et Absâl n'a pas été traité souvent dans les littératures musulmanes, et pendant longtemps je me suis demandé avec étonnement, si, par un hasard extraordinaire, Djâmî l'aurait créé lui-même. Il n'en est rien. Le même sujet avait tenté Avicenne, et l'origine en très ancienne.
Nous ne connaissons pas directement l'ouvrage d' Avicenne où le philosophe a exploité le mythe de Salâmân et Absâl. Je cite ici Carra de Vaux, Avicenne, pp. 290 et suiv. :
" Le mythe de Salâmân et d'Absâl, que nous allons rapporter, n'est pas directement connu comme étant d'Avicenne ; il est seulement cité en deux endroits des œuvres de cet auteur, et c'est par le commentaire de Nasîr ed-Dîn et-Tousi aux Ichârât, que nous en possédons des versions. Cette histoire revêt des formes très diverses. En la forme que nous allons maintenant reproduire, elle nous est présentée comme traduite du grec par Honéïn fils d'Ishâk, et il y a lieu de croire, en effet, qu'elle est d'origine Alexandrine. "
Avant de reproduire la version de la légende reproduite par Carra de Vaux, et qui se rapproche beaucoup de celle qu'a amplifiée Djâmî dans son poème, je crois expédient de citer d'abord une autre forme de la légende, qui diffère considérablement de celle de Djâmî, et qui est évidemment beaucoup plus ancienne. Je copie textuellement Mehren, Traité d'Avicenne sur le Destin, (traduction publiée dans le Muséon, IV, note de la page 38), à propos du passage suivant d'Avicenne : " Tout le monde n'a pas été doué de la chasteté d' Absâl quand il fut averti par l'éclair de la lumière céleste. "
Mehren écrit donc en note : " Quant à Salamân, ou Salâmân et Absâl, c'est le nom d'une légende mystique, qui a été traitée par Avicenne, et qui se trouve dans l'index de ses écrits, composé par Djouzdjânî, bien que nous l'ayons cherchée en vain dans les manuscrits contenant les traités d'Avicenne, à Leyde et à Londres. C'est au célèbre commentateur des écrits philosophiques Nâssir ed Dîn Thousi que nous devons un examen minutieux de cette légende et de ses diverses variantes ; il se trouve dans son commentaire de l'ouvrage important d'Avicenne, intitulé Al-Ichârât wa-l-Anmâth, etc. " Et quand ton oreille aura été frappée par le récit de l'histoire de Salâmân et Absâl, tu seras convaincu que tous les deux sont des symboles indiquant les divers degrés de l'intellect ; prépare-toi donc à la vraie solution de cette énigme selon tes forces spirituelles. Le fond de la légende, selon ce qu'en dit Avicenne, est celui-ci : Salâmân et Absâl étaient frères germains ; Absâl, le cadet, était l'objet de la passion de la femme de son frère ; pour satisfaire son amour, elle proposa de donner sa sœur en mariage à Absâl, dans le but d'occuper sa place dans la nuit de noces. Mais Absâl, averti par un éclair du ciel au moment suprême, évita ainsi, bien qu'avec peine, de se rendre coupable envers son frère ; c'est la situation à laquelle visent les mots de notre citation donnés dans l'exposé. Absâl représente ici la faculté spéculative de l'homme qui, à la fin, saura dominer les passions sensuelles symbolisées par la femme de Salâmân. En nous contentant ici de cette partie du symbolisme, nous ferons seulement remarquer que cette légende, d'origine grecque selon et-Thousi, et venue par une version de Honaïn bin Ishâq, a reçu un développement très varié (sic), dont le dernier, tout à fait différent de celui que nous avons donné ici selon Avicenne et son commentateur et-Thousî, est dû au célèbre poète persan Djâmî. " Telle est la forme du mythe que nous fait connaître Mehren.
Et en effet, cette forme de la légende diffère complètement de celle adoptée par Djâmî. Seuls, les noms du titre sont les mêmes, et encore désignent-ils ici deux frères, et non pas un jeune prince et sa nourrice, devenue dans la suite son amie, comme le sont, chez Djâmî, Salâmân et Absâl.
L'autre version de la légende, telle que Carra de Vaux nous la fait connaître en l'empruntant à ce même Nassir ed-Dîn et-Thousî, est, par contre, à peu près identique à celle que nous donne le poème de Djâmî. Nous la copions in extenso dans l'excellent ouvrage de Carra de Vaux.
" Il y avait dans les temps anciens, antérieurement au déluge de feu, un roi nommé Hermânos, fils d'Hercule. Ce roi possédait le pays de Roum jusqu'au rivage de la mer, avec le pays de Grèce et la terre d'Egypte. Il avait une science profonde, un pouvoir étendu, et il était versé dans la connaissance des influences astrologiques.
" Parmi les contemporains de ce prince se trouvait un philosophe du nom d'Iklîkoulâs qui possédait toutes les sciences occultes. Ce sage vivait depuis un cycle, retiré dans une grotte appelée Sârikoun. Il déjeunait tous les quarante jours de quelques légumes sauvages, et sa vie atteignait trois cycles. Le roi Hermânos le consultait souvent.
" Un jour, le roi alla se plaindre au sage de manquer de descendant. Ce prince, en effet, n'avait pas de penchant pour les femmes ; il abhorrait leur commerce et refusait de les approcher. Le sage lui conseilla, puisqu'il avait déjà vécu trois générations, de prendre une femme belle et bonne, à un moment où la sphère, à son lever, lui promettrait un enfant mâle. Il refusa. Le sage lui dit alors qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour lui de se procurer un héritier que d'observer un lever astrologique convenable, et au moment que fixeraient les astres, de choisir une mandragore et d'y placer un peu de sa liqueur séminale. Il se chargerait ensuite de soigner cette mandragore et de la transformer en un enfant vivant.
" Ainsi fut-il fait. L'enfant né de la sorte fut appelé Salâmân. On lui chercha une femme pour le nourrir. On en trouva une fort belle, âgée de dix-huit ans, qui s'appelait Absâl. Cette femme prit soin de l'enfant et le roi se réjouit. L'on dit qu'alors Hermânos promit au sage de construire, en témoignage de sa gratitude, deux gigantesques bâtiments, capables de résister aux déluges d'eau et de feu, dans lesquels on enfermerait les secrets des sciences. Ce furent les deux pyramides.
" Quant l'enfant Salâmân fut nourri et qu'il eut grandi, le roi voulut le séparer d'Absâl ; mais l'enfant s'en affligea vivement, et le roi le laissa. Salâmân étant ensuite parvenu à la puberté, l'affection qu'il avait pour sa nourrice Absâl s'accrut et se changea en amour ; et cette passion devint telle que le jeune homme négligea tout à fait le service du roi, pour ne plus s'occuper que d'Absâl.
" Le roi fit venir son fils et lui adressa des remontrances. " Je n'ai que toi au monde, lui dit-il ; sache, ô fils très cher, que les femmes sont artificieuses et instigatrices de mal, et qu'il n'y a nul bien en elles. Ne donne pas place à une femme dans ton cœur ; le pouvoir de ta raison en serait asservi, la lumière de ta vue obscurcie, toute ton existence submergée. Apprends, ô mon fils, qu'il n'y a que deux chemins, l'un qui monte et l'autre qui descend. Nous te disons cela sous une forme sensible afin que tu comprennes. Celui qui ne prend pas le chemin de la justice n'approche pas de sa demeure ; mais l'homme qui suit la voie de l'intelligence, en maîtrisant les forces de son corps qui doivent être ses servantes, s'élève vers le monde de la lumière et approche sans cesse davantage de son véritable séjour. Il n'est pas pour l'homme de demeure plus vile que celle des choses sensibles. Il y a aussi pour lui une résidence moyenne qui est celle des lumières victorieuses qu'il peut encore atteindre, après s'être attardé dans le monde inférieur. Mais sa plus haute demeure est celle où il connaît les essences des êtres, et c'est à celle-là qu'il parvient par la justice et la vérité. Laisse donc là cette misérable Absâl qui ne peut te procurer aucun bien. Reste pur, jusqu'à ce que je te trouve une fiancée du monde supérieur qui t'attirera la grâce de l'Eternel et qui donnera satisfaction au Maître des mondes. "
" Salâmân, emporté par sa passion, ne se rendit pas aux avis du roi. Il alla répéter à Absâl ce que Hermânos lui avait dit, et celle-ci lui conseilla de n'en tenir aucun compte. " Il veut, dit-elle, t’ôter les plaisirs vrais pour des espérances dont la plupart sont trompeuses, te sevrer des joies immédiates pour les biens éloignés. Quant à moi je te suis soumise ; je me plie à tous tes caprices. Si tu as de l'intelligence et de la décision, va dire au roi que tu ne m'abandonneras jamais, et que moi non plus je ne t'abandonnerai pas. "
" Le jeune homme alla rapporter les paroles d'Absâl, non pas au roi lui-même, mais à son vizir, qui les transmit au roi. Celui-ci, rempli de chagrin, rappela son fils et lui fit de nouvelles remontrances. Mais voyant qu'il ne parvenait pas à toucher son âme, il s'avisa d'un compromis. " Fais de ton temps deux parts, lui dit-il, l'une tu la passeras dans le commerce des sages ; pendant l'autre, tu jouiras d'Absâl à ton plaisir. "
" Salâmân consentit, mais pendant toute une moitié du temps, il avait l'esprit occupé de l'autre. Le roi s'en étant aperçu, se décida à consulter les sages sur l'opportunité de faire périr Absâl. C'était le seul moyen qui lui restât de se délivrer d'elle. Les sages blâmèrent ce projet, et le vizir répondit au roi que ce meurtre ébranlerait son trône sans lui ouvrir l'accès dans le chœur des Chérubins.
" L'écho de cette discussion parvint à Salâmân qui s'empressa d'en avertir Absâl ; il cherchèrent ensemble le moyen de déjouer les desseins du roi et de se mettre à l'abri de sa colère. Ils décidèrent de s'enfuir jusqu'au rivage de la mer d'occident et d'habiter là.
" Or le roi possédait, grâce à sa science magique, deux flûtes d'or munies de sept trous correspondant aux sept climats du monde. Lorsqu'il soufflait dans l'un de ces trous, tout ce qui se passait dans un climat lui apparaissait. Il découvrit ainsi le lieu où s'étaient retirés Salâmân et Absâl, et il vit qu'ils étaient dans un très misérable état. Il eut d'abord pitié d'eux, et il leur fit envoyer quelques subsistances. Puis, irrité de nouveau par la force de leur amour, il les fit tourmenter dans leur passion même, par des esprits qui leur infligeaient des désirs qu'ils ne pouvaient satisfaire.
" Salâmân comprit que ces maux lui venaient de son père. Il se leva et il se rendit, accompagné d'Absâl, à la porte du roi pour implorer son pardon. Le roi exigea encore de lui le renvoi d'Absâl, en lui répétant qu'il demeurerait incapable de s'asseoir sur le trône tant qu'il le garderait auprès de lui, parce que cette femme et l'empire le réclameraient chacun tout entier. Absâl serait comme une entrave attachée à ses pieds, qui l'empêcherait d'atteindre aussi le trône céleste des sphères. Et, ayant dit, il les fit attacher tout un jour dans la position indiquée par cette comparaison. Lorsqu'on les délia, la nuit venue, tous deux se prirent par la main et ils allèrent ensemble se jeter dans la mer.
" Cependant Hermânos veillait sur eux ; il commanda à l'esprit des eaux d'épargner Salâmân jusqu'à ce qu'il eût eu le temps d'envoyer des hommes à sa recherche. Quant à Absâl, il la laissa se noyer.
" Lorsque Salâmân eut acquis la certitude de la mort d'Absâl, il fut sur le point d'en mourir de douleur, et il devint comme insensé. Le roi alla consulter le sage Iklîkoulâs, qui exprima le vœu de revoir le jeune homme. Celui-ci étant venu, le sage lui demanda s'il désirait rejoindre Absâl. — Comment ne le désirerais-je pas ? répondit-il. — Viens donc avec moi, dit le sage, dans la grotte de Sârikoun ; nous y prierons quarante jours, après lesquels Absâl retournera à toi. — Ils allèrent ensemble à la grotte. Le sage avait mis à sa promesse trois conditions: que le jeune homme ne lui cacherait rien, qu'il imiterait tout ce qu'il lui verrait faire, sauf un adoucissement qui lui serait accordé pour le jeûne, et qu'il n'aimerait point d'autre femme qu'Absâl toute sa vie durant.
" Ils se mirent à prier Vénus ; et chaque jour, Salâmân voyait la figure d'Absâl, qui s'asseyait près de lui et s'entretenait avec lui, et il rapportait au sage tout ce qu'il avait dit et entendu.
" Mais, au bout de quarante jours, parut une autre figure, étrange et merveilleuse au-delà de toute beauté. C'était la figure de Vénus. Salâmân s'éprit pour elle d'un amour si grand qu'il en oublia l'amour d'Absâl. "Je ne désire plus Absâl, dit-il au sage, je ne veux plus que cette image. — N'as-tu pas promis de n'aimer qu'Absâl ? répliqua le sage ; nous voici près du moment où elle va t'être rendue ; " mais le jeune homme répéta : "Je ne veux plus que cette image.
" Alors le sage conjura l'esprit de cette image qui vint en tout temps visiter Salâmân ; et cela dura tant qu'à la fin le cœur de Salâmân se lassa de cette image même ; et son esprit s'éclaircit et son âme fut purifiée du trouble de la passion.
" Le roi rendit grâces au sage, et Salâmân s'étant assis sur le trône de l'empire, n'eut plus en vue que la sagesse, et il s'acquit une grande gloire. De nombreuses merveilles furent accomplies sous son règne.
" Cette histoire fut écrite sur sept tablettes d'or ; on inscrivit sur sept autres tablettes des invocations aux planètes, et on plaça le tout dans les deux pyramides près des tombeaux des ancêtres de Salâmân. Après que les deux déluges eurent en lieu, celui d'eau et celui de feu, Platon, le sage divin, parut, et il voulut rechercher les ouvrages des sciences cachés dans les pyramides. Il alla les visiter ; mais les rois de ce temps-là ne lui permirent pas de les ouvrir, et il recommanda en mourant cette tâche à son disciple Aristote. Celui-ci, à la faveur des conquêtes d'Alexandre, fit ouvrir les pyramides par un moyen que lui avait indiqué Platon, et Alexandre y étant entré en tira les tables d'or qui renfermaient cette histoire."
M. Carra de Vaux nous donne ensuite l'interprétation de ce mythe fournie par et-Thousî :
" Le roi Hermânos est l'intellect sage ; le sage est ce qui découle sur cet intellect des intelligences supérieures. Salâmân figure l'âme raisonnable, issue de l'intellect agent sans dépendance des choses corporelles. Absâl est l'ensemble des facultés animales. L'amour de Salâmân pour Absâl signifie l'inclination de l'âme aux plaisirs physiques. Leur fuite à la mer d'occident représente la submersion de l'âme dans les choses périssables. Leur châtiment par l'amour non satisfait signifie la persistance des inclinations mauvaises de l'âme, après que les facultés corporelles affaiblies par l'âge se sont relâchées de leurs actes. Le retour de Salâmân chez son père marque le goût de la perfection et le repentir. Le suicide des deux amants dans la mer, c'est la chute du corps et de l'âme dans la mort. Le salut de Salâmân est l'indication de la survivance de l'âme après la mort du corps. L'élévation de son amour jusqu'à Vénus représente la jouissance des perfections intelligibles. L'avènement de Salâmân au trône, c'est l'arrivée de l'âme à la perfection essentielle. Quant aux pyramides subsistant à travers les siècles, elles symbolisent la forme et la matière corporelles. "
Comme le lecteur le verra bientôt, Djâmî n'a fait que reprendre la version de la légende traitée par Avicenne. Il en a supprimé tous les éléments inutiles au but poursuivi, c'est-à-dire à l'exposé allégorique de la philosophie soûfîe; il en a écarté aussi, dans la mesure du possible, les détails invraisemblables et merveilleux : les jeûnes de quarante jours, la longévité extraordinaire du philosophe ; il n'a pas fait mention de la mandragore et s'est contenté de dire que Salâmân avait été conçu " dans un endroit autre que la matrice. " Il n'est plus question des pyramides. Les flûtes d'or sont remplacées par le miroir magique mieux connu des Persans, la mer où veulent se noyer les deux amoureux par le feu dévorant du bûcher. Enfin, dans la version de Djâmî, ce n'est pas Salâmân qui s'éprend le premier d'Absâl, mais c'est la jeune femme, personnification des impulsions charnelles, qui séduit le jeune prince.
On ne peut manquer d'admirer l'habileté avec laquelle Djâmî a su cacher sous les moindres détails de son œuvre une signification philosophique, sans que pourtant on sente l'effort. Si le poème se bornait au récit des aventures des deux jeunes amants, la lecture en serait pleine de charme et ne causerait, certes, pas cette impression d'ennui que provoque si souvent la lecture des poèmes allégoriques.
Le mythe de Salâmân, sans être populaire en Perse comme les histoires de Yoûssouf et Zouleïkhâ, de Madjnoûn et Leïlâ, de Khosrau et Chîrîn, etc., que les caravaniers se racontent maintenant encore pour charmer l'ennui de la route, a été cependant assez connu pour que les noms de Salâmân et Absâl aient été appliqués à des sculptures dans le voisinage de Persépolis. 21
Je ne sache pas que ce sujet ait tenté d'autres poètes persans, mais il a été encore traité en turc par Lâmi'î, mort en 1530 ou 1531, qui d'ailleurs a composé sept romans poétiques en s'astreignant à éviter les sujets trop souvent rebattus. Il a suivi le texte de Djâmî, y compris les petites anecdotes qui n'ont rien à voir avec le récit, et s'est borné à ajouter beaucoup de détails et une surcharge d'ornements qui rendent la lecture de sa version traînante et peu agréable. Von Hammer (Geschichte der Osmanischen Dichtkunst II, p. 21 et 91, 120), donne un résumé avec extraits du poème de Lâmi'î, que Gibb reproduit en Appendice au troisième volume de son History of Ottoman Poetry (pp. 354-357). Cet abrégé permet de voir que Lâmi'î n'a pas apporté à la version de Djâmî de modification importante.
Le texte de Djâmî a été mis à la portée des savants européens par Forbes Falconer, qui en a publié à Londres, en 1850, une édition excellente, basée sur huit manuscrits, imprimée en superbes caractères, qui sont une vraie caresse pour les yeux. Ces huit manuscrits n'offrent pas de leçons bien différentes et paraissent tous copiés sur un même original. M. le Directeur delà Bibliothèque Royale de Berlin a mis à ma disposition, avec son obligeance habituelle, un manuscrit des Haft Aurang que j'ai, sans grand profit, collationné avec le texte de Falconer. L'Institut des Langues Orientales de Saint-Pétersbourg a la chance inestimable de posséder le manuscrit autographe des " œuvres complètes, " Koulliyyât, de Djâmî, décrit dans le catalogue de Rosen, (pp. 215-261). Ce serait rendre un grand service à la science et aux belles lettres que d'en publier une édition.
Falconer doit aussi avoir publié, en 1856, une traduction (en prose ou en vers ?) du poème. Je n'ai jamais eu en main, ni vu figurer dans aucun catalogue, cette traduction.
Enfin, le grand ciseleur de vers anglais, Fitz Gerald (1 809-1 883), à qui son adaptation admirable des quatrains (Roubâ'iyyât) d'Omar Khayyâm a valu une gloire égale à celle des plus grands génies créateurs, a publié une traduction en vers de Salâmân et Absâl.
Ce dernier ouvrage, de couleur bien plus orientale que les quatrains, n'a pas eu, et ne le méritait pas, l'immense succès réservé à ce poème profond où sont exposés, avec, une concision lapidaire, les grands problèmes qui ont toujours tourmenté la pensée humaine.
Fitz Gerald, dans la lettre à son professeur, l'éminent orientaliste Cowell, qui sert de préface à sa traduction de Salâmân et Absâl, déclare "aimer de plus en plus le vieux Djâmî", et considère, avec une impertinence aristocratique, l'œuvre que nous faisons connaître au lecteur français, " comme quelque chose de propre à intéresser le peu de gens qui valent la peine d'être intéressés, (the few that are worth interesting)." Ce que Fitz Gerald nous a donné, ce n'est pas une traduction littérale et complète, mais " une version réduite d'un petit original", (a reduced version of a small original). " Le poète anglais a condensé les endroits où son modèle persan lui paraissait trop diffus, il a supprimé deux ou trois passages parce qu'ils étaient trop " incivils" et auraient pu offusquer la pudibonderie britannique, et pourtant le lecteur pourra se rendre compte qu'il n'ont rien de bien scabreux.
Fitz Gerald a traduit les historiettes singulières, dont beaucoup nous paraissent puériles et qui n'ont aucun lien avec l'action du roman. Cowell croyait qu'on ne pouvait rien en faire, mais Fitz Gerald trouve qu'elles ont leur utilité comme intermèdes divertissants placés entre les petits actes, " by way of Quaint Interlude Music between the little Acts. "
Par contre, il a omis les passages qu'il trouvait trop ennuyeux, par exemple, les nombreux panégyriques, " ces Te Deums à Allah et au Chah Ombre d'Allah ". Qu'on n'oublie pas que, lorsque Djâmî a paru, il y avait cinq cents ans qu'en Perse des milliers de poètes et de poètereaux adressaient à des centaines de rois et de roitelets des panégyriques roulant toujours sur les mêmes thèmes. Rien d'étonnant à ce que notre poète ait dû chercher très loin pour tâcher de dire du nouveau, et recourir aux métaphores les plus alambiquées, aux hyperboles les plus vertigineuses. Ce sont précisément les endroits du poème les plus difficiles à comprendre et à rendre en français. Je n'ai pu passer outre, et maint de ces vers m'a coûté de longues heures de travail, sans grand profit pour moi ni pour le lecteur, qui d'ailleurs sera toujours libre de ne pas s'attarder sur ces élucubrations. Le plus fâcheux est que ces rapsodies ennuyeuses remplissent tout le commencement du poème. Le lecteur ne devra pas se laisser rebuter trop vite.
Il ne me reste plus qu'à remercier ceux qui m'ont aidé et encouragé dans ma tâche, et surtout mes chers maîtres MM. V. Chauvin, professeur à l'Université de Liège, qui a bien voulu me fournir de précieux renseignements bibliographiques, E. I. Orsolle, qui a mis à ma disposition les trésors de sa bibliothèque, et enfin, mon éditeur, M. Carrington, qui n'a rien négligé pour donner à cet ouvrage une parure brillante.
DU PLUS ÉLÉGANT DES POÈTES ET
DU PLUS ONCTUEUX DES ORATEURS
AU NOM DU DIEU CLÉMENT ET MISÉRICORDIEUX !
O Toi dont le souvenir rafraîchit l'âme des amoureux, et dont la faveur, comme une eau limpide, humecte la langue des amants, tu as projeté sur le monde une ombre qui est devenue le fonds même de toute beauté. Les amoureux se pâment devant cette ombre et sont accablés de mélancolie à cause de cette source de beauté.
Tant que n'apparut point chez Le'ïlâ ta beauté secrète, l'amour pour elle n'enflamma point le cœur de Mèdjnoûn. 1 Tant que tu ne donnas point à la lèvre de Chîrîne la douce 2 saveur du sucre, son cœur et celui de son bien-aimé Khosraw ne furent point gonflés de sang. Tant que tu ne donnas point à la joue d'Azrâ la splendeur de l'argent, l'œil de Vâmiq 3 ne versa pas une pluie de vif argent. 4
Tout ce qu'on peut dire de la beauté et de l'amour a son origine en Toi, en Toi seul, et personne d'autre que Toi n'est à la fois amant et bien-aimé. 5 O Toi devant qui la beauté des belles n'est qu'un voile, tu as caché ton visage sous un rideau. Tu donnes à ce rideau un reflet de ta propre beauté, vers laquelle le cœur aspire comme la fiancée encore cachée dans la chambre nuptiale. Ton beau visage s'est tellement confondu avec le rideau qui le cache, qu'on ne sait plus les distinguer l'un de l'autre. Jusques à quand resteras-tu à coqueter derrière ce rideau, cependant que les pauvres humains sont épris de l'image qui s'y reflète ? 6 Il est temps que tu lèves le rideau qui te cache, et que tu exposes, libre de tout voile, ton visage à nos regards, que tu me fasses perdre la conscience de moi-même par la contemplation de tes charmes, que tu me rendes exempt de la distinction du bien et du mal 7 ; que je devienne ainsi ton amant, embrasé d'amour pour toi, l'œil rivé sur toi, oubliant tous les autres.
O Toi qui te manifestes dans les divers aspects de la vérité, c'est Toi seul qui agis dans les créatures. 8 J'ai beau porter partout mes regards du haut de tous les observatoires, je ne vois au monde personne d'autre que toi. C'est toi qui te révèles dans l'aspect extérieur des choses, c'est toi le philosophe subtil caché sous la guenille humaine.
Dans ton sanctuaire, il n'y a pas de place pour la dualité ; il n'y est pas question de " peu " ni de " beaucoup. "
Je te conjure de me délivrer de la dualité et de me donner l'unité, de m'octroyer une place sur les stations 9 de l'unité ; et alors, échappé à la dualité, je m'écrierai comme ce Kourde :
" Est-ce moi que voici, ô Dieu, ou si c'est toi ? Si c'est bien moi, d'où me surgit donc cette science et ce pouvoir ? Et si c'est Toi, d'où provient cette impuissance et cette infirmité ? "
Un Kourde, 11 par suite des vicissitudes embrouillées de la destinée, quitta ses champs et sa montagne pour gagner la ville.
Il vit une cité pleine de clameurs et de bruit, bouillonnant de l'affluence tumultueuse des hommes. Les agités de ce monde, de toutes parts, couraient et se hâtaient à l'encontre l'un de l'autre. Celui-ci, venant du dehors, voulait pénétrer dans la ville, celui-là voulait aller de l'intérieur à l'extérieur. L'un se dirigeait du Sud au Nord, l'autre avait l'intention d'aller vers le Midi.
Le pauvre Kourde, tout effaré par ce brouhaha, fendit la cohue pour se mettre à l'écart. "Si je persiste," se dit-il, "à rester au milieu de la foule, il peut arriver que je me perde. Si je ne m'adapte pas un signe de reconnaissance, comment pourrai-je, alors, me retrouver ? " Or, il tenait, par hasard, une calebasse à la main ; il se l'attacha au pied comme marque distinctive, pensant ainsi qu'il n'aurait qu'à la voir pour se retrouver, s'il s'égarait dans les rues de la ville.
Un malin eut bientôt fait de pénétrer l'idée secrète du Kourde, et il se mit à le suivre jusqu'à ce que le pauvre diable s'endormit dans un coin. Aussitôt, le farceur détacha la calebasse, la lia à son corps et se coucha à côté de l'autre.
Quand le Kourde s'éveilla, il vit la calebasse nouée au pied de son voisin. Aussitôt il l'apostropha : " Hé, lève-toi donc, maladroit ! A cause de toi, me voilà bien embarrassé à mon propre sujet. Est-ce moi ou toi que voici ? Je n’en sais rien au juste. Si c'est moi, comment cette calebasse se trouve-t-elle adaptée à ton pied ? Et si c'est toi, alors, moi, où suis-je et qui suis-je ? Je ne compte pas, que suis-je donc ? " O Dieu, ce misérable Kourde, c'est moi, je suis le plus vil de tous les Kourdes. Donne à ce Kourde un reflet de ton éclat. Fais, dans ta bonté, un clarifiant pour cette lie, afin que désormais, purifié de toute souillure, je devienne une boisson salutaire pour les gens de cœur 12, et que, pareil à la coupe de vin dont je porte le nom, je les comble de joie, tous autant qu'ils sont; et si ce n'est par cruche, que ce soit du moins par coupe 13. Et si cette faveur insigne est trop extraordinaire pour m'être accordée, j'invoquerai l'intercession du maître des deux mondes.
C'est le maître dont les rois, en foule, sont les esclaves. Ils ont suspendu à leurs oreilles l'anneau de son pouvoir dominateur. Les favoris de la fortune 15 ont pour point de mire son visage ; la poussière de son quartier est la Kaaba de leur espoir, son séjour est la Kaaba de tous les initiés 16.
Or, il n'est pas de Kaaba sans son puits de Zemzem 17. Le Zemzem, ce sont ces yeux humides. C'est de cette source que découle l'honneur des parfaits soûfîs 18.
Les soupirs de ceux à qui le mal d'amour pour lui fait verser des pleurs, ce sont les gémissements des poulies de son Zemzem. La Kaaba, avant Lui, n'était remplie que d'idoles de pierre ; son sanctuaire était trop étroit pour les chercheurs de Dieu. Son zèle les démolit, les abattit, les précipita dans le désert du non-être. La grand-route de la religion est devenue libre de pierrailles, une carrière nouvelle est toute grande ouverte devant les chercheurs de Dieu. Le lieu où Ibrahim, l'Ami de Dieu 19, avait mis son pied lui appartient également. Cet endroit a été ennobli par la chance de son arrivée.
Il a gravé sur la pierre 20 le nom de Yamînou-llâh, et a déposé sur la dextre de Dieu le baiser de l'hommage. Bien rares sont ceux qui, en ce monde, ont été l'objet d'un baisemain pareil.
Depuis le commencement de l'éternité 21, il avait en vue la pureté, ses pieux efforts sont l'objet d'actions de grâces dans la plaine et la montagne. C'est lui qui est la préface de l'exemplaire des deux mondes ; tout le reste est dans l'indigence, lui seul est opulent. Nous nous rassasions des mets provenant de la table de sa munificence, nous emportons des reliefs de la subsistance qu'il fait descendre sur nous. Des malheureux, punis de leur impiété par la disette, n'ont d'espoir que dans les faveurs que sa main répand. Pourquoi celui qui recueille les miettes de la table de sa générosité irait-il se préoccuper des horreurs de la famine ?
Dans la terre d'Egypte, une disette rigoureuse surgit, à tel point que tous les habitants, poussés par la terreur, se noyaient dans le Nil. Faute de trouver un moyen de se procurer du pain, les malheureux lançaient dans le fleuve la défroque de l'existence. Le moindre pain avait autant de prix qu'une vie humaine ; " du pain ", gémissaient-ils, et ils donnaient leur vie. Un sage vit un bel esclave qui, avec fierté et coquetterie, retroussait le pan de sa robe. Son visage, loin de ressembler, par suite de la diète forcée, à une lune sur son déclin, rayonnait comme le disque du soleil. Sa physionomie, fraîche et rieuse, respirait la joie de vivre. Il se pavanait de tous côtés, pareil à un arbuste verdoyant.
Le sage l'interpella : " Jusques à quand, beau page, te rengorgeras-tu fièrement en faisant étalage de vanité et de coquetterie? Tout le monde, faute de pain, est accablé et tout éperdu. D'où te vient cette belle insouciance ? " Le jouvenceau répondit : "J'ai au-dessus de moi un maître généreux. Grâce à sa munificence, je suis plongé dans le bien-être. Sa table est couverte de pain, sa maison regorge de blé, le nom même de la disette est inconnu dans son ménage. Comment, dès lors, ne serais-je pas serein et joyeux, étant ainsi à l'abri des outrages de la disette ? "
Sous la courbe de cette coupole aux fondations élevées, quelle est l'occupation du serviteur reconnaissant ? C'est d'être toujours debout en signe de gratitude pour les bienfaits du généreux Maître du monde, et surtout pour une faveur toute particulière due à sa puissance, à savoir : l'existence d'un souverain juste. Le roi juste n'est autre chose que l'Ombre de Dieu, et les créatures trouvent un abri à l'Ombre de Dieu. Tout ce qui fait l'ornement de l'essence même d'un être, a son analogue, aux yeux du sage, dans l'ombre de cet être. Puisque, donc, cette ombre procède de l'original, garde-toi bien de la considérer avec dédain.
L'ombre est le reflet de l'essence de celui qui la projette ; c'est aux qualités de l'original que l'ombre doit sa valeur. Tous les attributs qui dans l'essence sont cachés aux yeux des hommes deviennent, grâce à l'ombre projetée, visibles dans toutes les directions. C'est ainsi que par la pompe des souverains omnipotents se manifeste la splendeur divine " 23.
Et s'il te faut un témoignage à l'appui de cette assertion, tu n'as qu'à jeter un regard sur le chah refuge du monde, sur le souverain dont le sceau domine, à droite et à gauche, l'étendue du royaume de Djèmchîd 24.
Telle est la hauteur de la puissance de Chah Yaaqoûb, que le pinacle des deux est bas en comparaison. La souveraineté de tout ce qui existe, voilà l'étendue de sa carrière. La sphère des cieux est comme une balle sous l'extrémité recourbée de son mail 25. La poussière du sabot de son coursier est baisée par le croissant de la lune 26, et c'est ce qu'indique le dos humblement courbé de cet astre.
Au sommet de cette voûte azurée, à l'abri de tout dommage, sa puissance a atteint son apogée à la suite de cet hommage [rendu par l'astre des nuits].
Sa main a remis à la mode la pratique de la générosité, et a donné un regain de renommée à la munificence de Hâtim 27. Son nom est la préface du livre de l'équité, ses sentences sont pesées dans la balance de la justice. L'éclat de sa justice a emprisonné dans les demeures du non-être les ténèbres de la tyrannie et de l'oppression.
Il est devenu, par l'excellence de son naturel, la célébrité de l'époque. Ce caractère excellent est l'héritage qu'il a reçu de son père 28.
Son père a conduit son escorte au séjour éternel, laissant à son héritier ses brillantes qualités.
Le globe azuré n'est qu'un degré du trône du souverain actuel ; les porte-couronne sont prosternés devant lui. Aucun n'a osé se dérober à cet acte de soumission, et quiconque l'a bravé a payé de sa tête cette insolence. C'est déjà une supériorité que de faire de sa tête la poussière de son chemin, et un honneur que de mettre devant lui le front dans la poussière. Et s'il en est qui aient fait de leur tête la poussière de sa route, cette poussière est devenue le diadème de la tête des cieux. Et toute personne à qui la poussière de son seuil a donné de l'honneur 29, a vu l'honneur des autres devenir, en comparaison, insignifiant comme un petit ruisseau.
Je veux prononcer, des années durant, l'éloge de ce prince, je trouverai du bonheur à me faire son panégyriste.
Mais je coupe court à ce chapitre, j'abrège cette amplification.
Le globe du soleil a surgi au-dessus de l'horizon, et les humains participent à son rayonnement. Il n'est pas au pouvoir d'un atome sans talent ni pouvoir de réciter son panégyrique. Faire son éloge n'est pas à la portée de tout le monde. J'ai cité son nom, et cet éloge suffit.
Un poète s'en fut devant un roi illustre et lui dit : " O toi dont la hautesse est telle que ta tête frotte la voûte céleste, je viens de composer pour toi un panégyrique, j'ai enfilé un joyau brillant comme une perle. Et encore que bien d'autres poètes aient déjà prononcé ton éloge, on a composé bien peu de panégyriques aussi beaux que celui-ci. "
Là-dessus, le poète remit entre les mains du chah un écrit où n'était tracé d'autre mot que le nom du souverain.
Le chah s'écria : " Homme dénué de raison et de bon sens, mieux vaudrait te taire que de réciter un pareil éloge. La teneur de ton œuvre, c'est un simple nom, et rien de plus. La seule mention du nom d'un personnage ne constitue pas son panégyrique. Tu n'as pas célébré ma puissance et mon équité, tu n'as pas même fait allusion à mon trône et à ma couronne. Du moment que mon nom est cité sans l'accompagner d'aucune épithète, ce n'est pas là une façon de composer un panégyrique."
Le poète répondit : " O roi, c'est sous ce nom fortuné que tu as obtenu la renommée par tes qualités. Ces épithètes élogieuses sont toujours suggérées par ton nom, quelle que soit la personne qui le prononce ou qui l'entend. Puisque donc ton nom faisait penser ces qualités, il constitue à lui seul un registre des attributs de la perfection. Bien que ce mot ne soit accompagné d'aucun autre, si je l'appelle ton panégyrique, ce n'est pas mal à propos. "
Le chah est doué d'une supériorité et d'un mérite illimités. Comment les décrire dignement serait-il à la portée du sage ? Il vaut mieux que, dès à présent, je reconnaisse mon impuissance, que je profère hautement l'aveu de mon incapacité.
Aux yeux des gens d'esprit, toute la religion se résume dans ce mot : " Lui ! " 30 Le summum des éloges innombrables adressés à la divinité, consiste à prononcer cette seule syllabe : « Lui ! "
Puisque je ne puis m'acquitter du panégyrique, mieux vaut m'en tenir à la prière. Non pas la prière telle qu'elle est à la portée d'un petit esprit quelconque, une prière restreinte à la gloire et au rang du roi dans ce séjour terrestre. Non, mais bien une prière embrassant toutes les faveurs divines, comme seuls savent en prononcer les gens de cœur. Une prière qui procure à la fois la joie de vivre et la prospérité ici-bas, et les béatitudes de la vie éternelle. Une prière qui dirige le cœur du roi vers la religion, qui lui fasse une loi d'observer les saintes injonctions ; que son occupation constante soit d'accomplir les ordres divins, et que ce soit là, pour lui, la semence des félicités éternelles.
Tant que cette voûte couleur de nénuphar est l'endroit où se reflète le soleil levant, que le trône royal soit illuminé de la présence du chah ! Que son cœur soit initié aux mystères de la religion. Qu'à tout instant il soit favorisé du secours de la Grâce éternelle, afin qu'il devienne digne de la royauté impérissable. Que ceux qui l'aiment soient préservés de tout mal et persévèrent dans la voie de la bienveillance.
Et ces derniers mots s'appliquent surtout à cet homme qui est à la fois l'ami et le collaborateur du monarque, et qui est issu de la même substance que lui. Il a pris place à l'abri de sa prospérité, et comme une ombre, il le suit partout. Partout où est ce soleil-là, se trouve ce rayon. Partout où celui-là montre le chemin, celui-ci ne manque pas de le suivre. Bien qu'il soit né dans le berceau du califat, jamais il n'a fait un pas pour s'opposer au roi son frère. 32 C'est le vice-roi de l'Egypte de la splendeur et de la pompe, et c'est pour cela qu'on l'appela Yoûssouf 33. Ce qui fait la gloire de Yoûssouf, c'est la beauté de son visage ; aussi le monde, comme Zouleïkhâ, en est passionnément épris. Quiconque jette un regard sur sa joue s'écrie aussitôt : " Ce n est pas là un simple mortel. " 34
Bien qu'il soit l'unique frère du chah, il vaut pour le chah autant que cent âmes. C'est pour le souverain non seulement un frère, mais un ami, chose bien rare à notre époque.
Un homme simple dit à un sage : " O toi qui, par ton savoir, passes pour un homme unique aux yeux de tout libre esprit, enlève la pelure de ce subtil problème : Qu'est-ce qui vaut le mieux, d'un frère ou d'un ami ? "
L'autre répondit : " Il n'y a, de l'avis du sage, rien de préférable à un frère qui est en même temps un ami. "
O Dieu, aussi longtemps qu'au sommet de la voûte céleste la séparation des deux Ferqed 35 est impossible, maintiens l'union de ces deux brillantes étoiles, garde-les solidement installées sur le trône de l'honneur.
Voilà plusieurs générations que dans cet antique palais (du monde), la corde de ma poésie est tendue sur le luth de l'éloquence. En tout temps, sans relâche, je joue de nouvelles mélodies tout en célébrant des événements anciens.
La vie s'en est allée, mais ma dernière chanson n'est pas encore venue ; mon âme est usée, et je n'ai pas encore traité mon dernier sujet. Mon dos est devenu courbé comme la lyre, et pourtant je passe encore mes nuits à caresser mon instrument jusqu'au jour. Mon luth est désaccordé, le temps a frappé la main de l'artiste du tremblement de la vieillesse. Comment les mélodies de ce luth pourraient-elles être encore bien rythmées ? Comment les intonations adoptées par le vieil artiste pourraient-elles être conformes à la règle ?
Il est grand temps que je brise bel et bien ce luth 36, et que je le jette au feu pour profiter du moins de son parfum. Autant il est ridicule d'en jouer maladroitement, autant il est agréable d'y mettre le feu, afin que son bois odoriférant exhale ses senteurs, et flatte agréablement l'odorat de la raison et de la religion. Mieux vaut donner du réconfort à l'intellect et à la foi, à présent que ce corps s'achemine vers la décrépitude.
Il y a maintenant des lacunes dans la rangée de mes dents. Comment, dès lors, porter encore la dent sur les comestibles ? En même temps que les incisives sont devenues trop émoussées pour couper, les molaires se sont trouvées incapables de broyer. Il me faut maintenant manger, comme un petit enfant, des aliments mâchés par la dent d'autrui.
Ma taille s'est courbée, j'ai la tête penchée en avant, je m'incline peu à peu vers mon origine. Ma mère, c'est la terre, je suis comme un petit enfant à la mamelle. Rien d'étonnant à ce que les nourrissons éprouvent de l'inclination pour leur mère. Bientôt il arrivera que, me reposant de mes traverses, je tombe, ivre de sommeil, dans le giron de ma mère.
Mes deux yeux ne sont plus bons à rien, et ne sont pas devenus quatre, malgré les verres d'Europe.
Depuis que le rhumatisme est devenu mon inséparable 37, j'ai pris l'habitude de rester assis sur mes genoux. Mon pied est devenu trop faible pour que je puisse me lever, à moins que mon corps ne s'appuie sur mon bras comme sur un pilier.
Ces infirmités sont l'apanage inévitable de la vieillesse. Hélas pour celui qui est accablé par l'âge ! Et pourtant, tous les maux qui assaillent l'organisme par suite de la vieillesse, il n'est pas au pouvoir du médecin d'y remédier.
Un veillard, dont l'âge était de quatre-vingts ans, consulta un médecin au sujet de ses infirmités. " Mes dents, " lui dit-il, " sont devenues trop branlantes pour manger, et ne savent plus s'acquitter convenablement de la mastication. Or, du moment que la bouchée ne s'amollit pas dans ma bouche, la digestion en devient pénible pour mon estomac, et une fois que la digestion est incomplète, comment la nourriture pourrait-elle donner de la force aux membres? Ce serait une grande faveur dont je te serais bien obligé, si tu pouvais rendre à mes dents leur fermeté première. "
Le docte médecin répondit à ce vieillard : " O toi qui as le cœur fendu par les maux de la vieillesse, le remède à la faiblesse de tes quatre-vingts ans, c'est de recouvrer la jeunesse, Or, c'est là chose impossible. Ton râtelier retrouvera toute sa vigueur, si tu peux retourner de quarante ans en arrière. Mais puisque le destin fixé par Dieu ne le permet pas, le mieux est encore de prendre ton parti du mauvais état de ta denture. Et quand le trépas te séparera de ton corps, il te délivrera par le fait même de toute infirmité. "
La faiblesse du grand âge a brisé la vigueur de ma nature, et a fermé à mon esprit la voie de la réflexion. Mon cœur n'entend plus rien à l'art de l'élocution, et mes lèvres sont devenues malhabiles à parler. Il vaut mieux que je cache ma tête dans les replis du silence, et que je dirige mes pas vers les confins de l'oubli.
Ces deux vers du Mèçnèvî de Djèlâl ed-Dîne Roûmî 38 s'appliquent à merveille à ma situation :
" Comment la versification et la rime pourraient-elles venir a moi, " après qu’ont disparu les sources mêmes de la santé ? '
" Je pense à la rime, et mon Bien-aimé me dit : Ne pense à rien d'autre qu'à me contempler. " 39
Or, quel est le bien-aimé ? Celui qui a pour maison les cœurs, et dont toutes les âmes recèlent les secrets 40. Il connaît parfaitement sa maison; il vaut mieux que tu la gardes inoccupée, afin que, lorsqu'il la verra vide d'étrangers 41, il illumine cette maison du reflet de sa beauté. Comment celui qui a la moindre portion de sagesse, pourrait-il approuver une autre idée que celle que j'émets ?
Mais les rois, étant l'ombre de Dieu, ont une bonne part des qualités de son essence. En parlant d'eux, c'est donc Lui que je chante, et en réfléchissant à leurs attributs, je médite en réalité sur les attributs divins.
Nécessairement, malgré la déclaration de mon impuissance, le panégyrique du chah s'est cramponné au pan de ma robe. Mais pour son éloge, dans cet antique séjour, il me faut un vaste champ ouvert devant moi. Je prends pour carrière, à cet effet, ce Mèçnèvî, et je trouve pour chanter son panégyrique, des accents nouveaux. Et sinon, j'avais déjà composé assez de mèçnèvîs, et j'avais renoncé à ce genre. La composition particulière de ce poème est pour Lui, cet ouvrage fera connaître les signes de sa faveur et de sa majesté afin que, lorsque j'aurai le bonheur d'approcher de Dieu, je sois précisément absorbé dans la mention de son nom 42 ; que je célèbre ses éloges dans un langage élégant, que je lui adresse des prières avec des lamentations ; car, puisque je n'ai pas la chance de m'accrocher au pan de sa robe, il faut bien me contenter de parler de Lui.
Un voyageur vit Mèdjnoûn 43 assis tout seul au milieu du désert 44 : se servant de son doigt en guise de roseau, il traçait des caractères sur le sable. L'autre lui dit : " Hé ! insensé, fou d'amour, qu'est-ce que tu écris là ? A qui destines-tu cette épître ? Tu auras beau te donner à la rédiger autant de peine que tu voudras, le grattoir du vent aura bientôt fait de l'effacer. Comment ton écrit pourrait-il subsister sur la tablette du sable afin qu'un autre le lise après toi ? "
Mèdjnoûn répondit: "Je décris les charmes de Leïlâ, je console ainsi mon cœur. J'écris d'abord, en guise de titre, son nom, puis je compose le livre de l'amour et de la fidélité. Je ne possède d'elle rien d'autre que son nom, et c'est grâce à lui que ma valeur infime a gagné en élévation. En attendant que je goûte une gorgée de sa coupe, je pratique avec son nom le jeu d'amour. "
Qu'il est digne de louange, un roi qui, dès l'époque de la jeunesse, participa comme les vieillards, à la pénitence. Bien qu'il eût souillé d'abord ses lèvres de vin, il les lava ensuite par l'eau du repentir.
La coupe de vin, naguère pleine de l'eau de liesse, resta, les lèvres sèches, à l'écart du prince. La cruche, le ventre vide de la liqueur défendue, se confina dans un coin comme les vénérables anachorètes. L'amphore, privée du plaisir d'approcher de son banquet, porta la main à la tête en poussant mille soupirs. Bien que la bouteille eût le col altier par le fait d'appartenir au prince, elle en fut réduite à caresser son propre cou. Quand le vase a-t-il maintenant l'occasion de mesurer du vin ? Désormais, sa seule affaire, c'est de mesurer du vent 46.
Tous les animaux ont des yeux et des oreilles. L'homme seul jouit de la particularité d'être doué de raison et d'intelligence. Le vin est l'ennemi de la raison, ô homme raisonnable ; or, on ne peut qu'éprouver du déplaisir avoir son ami vaincu par son ennemi.
Si la Fortune vendait au prix de deux cents monceaux d'or de titre parfait un demi-grain d'intelligence, le sage ferait encore mieux de se manger le sang toute une vie 47 pour acquérir de quoi acheter ce demi-grain d'intelligence et de raison. Mais qu'il n'aille pas porter à ses lèvres une ou deux gorgées de vin, au risque de gaspiller tout d'un coup le capital de son savoir, de mettre le pied hors des bornes de la sagesse, et d'emmener sa guenille aux confins extrêmes de la démence !
Pendant des générations, tu as bu du vin à en perdre le sentiment, tu as été l'esclave de tes caprices, bons et mauvais. De toute cette beuverie et cette liesse, quel est ton profit, si ce n'est l'échec complet ? Et si tu bois de même cent ans encore, tu finiras par aboutir à une difficulté encore bien plus grande. Rends-toi bien compte des fruits de ton existence passée et juge, d'après cela, de ceux des années à venir.
Il y avait, aux confins de Reï, un ravaudeur dont tout l'idéal se bornait au rapiéçage. Le dos courbé sous le faix de sa famille, il avait une nichée d'enfants en bas âge. Jour et nuit, grâce à son métier, il ajustait des lambeaux à la guenille de ses moyens d'existence.
Or, lorsque mûrissaient les fruits de l'année nouvelle, il mettait son cœur en gage pour en acquérir. Il s'en retournait alors chez lui, et avec cent espèces de ruses, il vidait le contenu de ses poches et du pli de sa tunique pleine de fruits, et jetait bravement le tout devant les siens, pour qu'ils pussent en manger tout leur saoul.
Puis il leur disait : " O miséreux, nés sur le grabat de la peine et du chagrin, s'il vous tombait sous la main cent charges de ces fruits, tous ont le même goût, le même parfum, la même couleur. Renoncez au désir et à l'avidité, inclinez votre nature vers le contentement de peu, car, comme mon argile est écrasée sous le pied de l'indigence, je ne puis en obtenir plus que ceci. "
Le repentir est fragile comme verre, le décret divin est dur comme pierre : or, le verre ne peut supporter de conflit avec la pierre. Du moment que le destin est d'accord avec le repentir, celui-ci a une fondation solide. Mais s'il existe entre les deux une contradiction, il faut bien se résigner à la volonté divine.
C'est le Destin qui donne le repentir, c'est lui également qui le brise et l'annule ; se l'attribuer à soi-même, c'est une coupable erreur.
Si la grâce divine t'accorde le repentir, remercie le Très-Haut ; et sinon, en tant que rebelle envers lui, empresse-toi de lui demander pardon.
La pénitence consiste dans le regret du passé, l'abandon immédiat du péché 49 et la résolution de ne plus s'y adonner à l'avenir 50.
A supposer que ta résolution ne soit pas suivie d'effet, c'est que son libre choix n'était pas en ton pouvoir. Mais ne vas pas sommeiller un moment sans te préoccuper d'y remédier. Si même tu es tombé dans la boue, ne t'y endors pas. Prends le ferme propos de t'abstenir du péché, et d'être éternellement le compagnon inséparable de la pénitence. Il se peut que la grâce divine te ramène dans la bonne voie, et que l'heureuse influence de ta résolution te détourne du péché.
Un buveur s'engagea dans la voie du repentir et, renonçant au péché, prit place à l'abri de la pénitence. Cette conversion lui valut un rang très élevé 51, et le gibier de la sainteté tomba dans son filet.
Un homme clairvoyant lui demanda : " O toi qui as atteint les sommets de la perfection, pendant bien des années tu t'es adonné au vin avec passion ; par suite de quelle circonstance particulière as-tu été l'objet de cette faveur miraculeuse ? 52 "
Le saint homme répondit : " Chaque fois que je portais à mes lèvres une coupe de vin pour y chercher la joie et la liesse, jamais il ne m'est venu à l'esprit que je dusse ensuite prendre en main une seconde coupe. La seule pensée qui me passât par le cœur était d'en bannir cette funeste passion. L'heureux effet de cette résolution m'a valu la grâce divine et a ouvert devant moi les cent portes de la félicité. "
Quand je fus parvenu, la nuit, à cet endroit de mon exorde, je fus surpris par le sommeil au milieu de mes réflexions. Je me vis cheminant sur une route très longue, pure et brillante comme le cœur des vrais soûfîs. Le vent n'y soulevait pas la moindre rafale, et la terre n'en était pas mélangée d'eau : c'était un chemin sans poussière ni boue, et moi, j'y marchais le cœur à l'aise.
Tout-à-coup, le tumulte d'une armée s'avançant derrière moi sur cette route parvint à mon oreille. Les clameurs des tchâouches firent bondir mon cœur hors de sa place, et ravirent à ma tête l'intelligence, et la force à mes pieds.
Je cherchais un moyen d'échapper au danger, quand un palais élevé s'offrit à mes yeux. Je courus en toute hâte y chercher un refuge, afin d'échapper à la brutalité de la soldatesque. Alors, du milieu des rangs sortit le père du roi de l'époque, beau à la fois par le nom (Hassan) 54, les mœurs et le visage, serrant sous sa cuisse un coursier haut comme un ciel, au-dessus duquel la joue du prince brillait comme le soleil et la lune. Un manteau royal couvrait sa poitrine, sa tête était ceinte d'un turban blanc comme le camphre 55. Il tourna les rênes vers moi, souriant et joyeux, et son amabilité ouvrit devant moi la porte de l'aise.
Quand il fut tout près de moi, il mit pied à terre, me baisa la main et m'adressa les questions d'usage 56. Je fus tout ragaillardi des bons offices dont il me combla, tout enchanté des attentions qu'il daigna me prodiguer. Dans sa conversation avec moi, il éparpilla beaucoup de perles, mais il ne m'en est rien resté dans les oreilles.
A la pointe du jour, quand je me levai de ma couche, je sollicitai de mon intelligence l'interprétation de ce songe. Elle répondit : " Cette faveur et ces prévenances de la part du chah font présager qu'il agréera ton poème. Ne reste pas un instant sans l'occuper du sujet que tu traites. Puisque tu l'as entrepris, mène-le à bonne fin. "
Aussitôt que j'eus entendu cette interprétation, je me mis avec ardeur à la rédaction 57 de cet ouvrage, me disant que de la même source d'où était venu ce songe pouvait en sortir aussi l'interprétation.
Un homme au cœur simple, tombé à l'écart de la voie de la raison et de l'intelligence, s'en fut chez un interprète de songes et lui dit : " Je me suis vu en songe, à l'aurore, errant à l'aventure dans un village bouleversé et en ruines. Toute maison que j'apercevais au loin était abattue, privée de ses murailles. Quand je pénétrai dans une de ces masures, mon pied s'enfonça dans un trésor. " L'interprète dit ironiquement au pauvre diable : " O homme de valeur, profite de cette aubaine. Applique à tes pieds des chaussures avec des semelles ferrées 58, fend le rocher et creuse la montagne. Sans relâche, va d'une ruine à l'autre et frappe violemment la terre du pied. Là où ton pied s'enfoncera dans le sol, creuse un sillon avec tes ongles, et quand tu auras, de cette façon, ameubli la terre, je ne doute pas qu'un trésor ne te choie dans la main. "
Plein de foi et de confiance, ce bonhomme naïf s'en alla, et agit selon les instructions de l'interprète. Au premier pas, sans qu'il se fût donné aucune peine, son pied s'enfonça dans un trésor.
En toute chose, il te faut la foi, si tu veux que ta main happe le pan du but que tu poursuis. S'il y a dans ta confiance de l'hésitation, toutes tes recherches n'aboutiront à rien qui vaille.
Il y avait, dans la terre de Grèce, 59 un souverain possesseur, comme Alexandre 60, du diadème et du sceau royal. Or, sous son règne vivait un sage qui avait établi sur des fondements solides l'édifice de la philosophie, à tel point que tous les adeptes de la sagesse, autant qu'il y en avait, étaient ses disciples et avaient formé un cercle autour de lui.
Quand le roi reconnut la supériorité de son génie, il en fit son compagnon inséparable, tant dans les assemblées que dans l'intimité. Le souverain ne faisait pas un demi-pas sans se conformer à ses avis, il ne s'engageait dans aucune entreprise avant d'avoir recours à ses lumières. Il sut si bien profiter de ses conseils dans la conquête de l'univers, qu'il l'asservit tout entier, de Qâf à Qâf 61. Il satisfit ses sujets par sa justice et sa bonté, et consolida ainsi l'édifice de son empire.
Si le roi n'est pas personnellement un sage, ou qu'il n'a pas un sage comme ami et confident 62, le palais de sa puissance a des fondations branlantes, et rarement il arrive que les lois édictées par son ordre produisent de bons effets. Ne sachant pas même ce qui caractérise l'équité et l'injustice, il ne sait distinguer la justice de la tyrannie. Il applique la seconde au lieu de la première, et considère la justice comme une ignominie à l'instar de l'oppression. Le monde est bouleversé par son despotisme, les fontaines de la royauté et de la religion ne sont plus qu'un vain mirage.
Un esprit clairvoyant a bien exprimé cette pensée subtile : " C'est la justice, et non la religion, qui maintient la stabilité du royaume. Mieux vaut avoir pour roi un mécréant qui pratique noblement l'équité, qu'un tyran dévot. 63 "
Dieu dit au prophète David : " Dis à ta nation, ô homme bien inspiré, que quand on mentionnera les souverains de la Perse, on ne cite leurs noms qu'avec éloge. Bien qu'ils eussent pour religion le culte du feu, l'équité et la droiture fut leur loi 65. Des générations durant, le monde leur dut la prospérité, les ténèbres de la tyrannie furent loin de leurs sujets. Leurs serviteurs furent exempts du chagrin de l'oppression, et vécurent en paix à l'abri de leur équité. "
Lorsque, grâce aux stratagèmes de l'illustre philosophe, la domination universelle fut assurée au roi de Grèce, que d'une extrémité à l'autre le sage eut conquis le monde pour son maître et en eut fait un second Alexandre ; alors que, sur toute la face de la terre, il ne restait pas un porte-sceau qui ne fût soumis au sceau du roi, le monarque, une nuit, se mit à réfléchir à sa situation, et s'acquitta des devoirs de la reconnaissance (envers Dieu).
Il trouva que la robe d'honneur 66 de la chance lui allait à merveille ; tous les éléments de fortune qu'il avait cherchés, il les avait trouvés, excepté un enfant, qui, lorsqu'il serait parti, fût son remplaçant dans la gloire et la noblesse.
Dès que cette idée eut surgi dans l'esprit du roi, il s'en ouvrit directement au philosophe : " O toi, " dit-il, " qui fais profession d'être le conseiller royal, et que je félicite des soucis que tu prends, aucun bien n'est plus grand qu'un enfant, il n'est rien d'autre qu'un enfant à quoi l'âme soit vraiment attachée. Un fils ! voilà le suprême désir de l'homme ; c'est par lui que survit son nom. Ton œil, tant que tu vis, est brillant par lui ; c'est par lui qu'après ta mort, ta poussière devient un parterre de roses. C'est lui qui soutient de ta main tes pas chancelants, c'est lui qui te sert de pied si tu es impuissant à te mouvoir. Par son appui, ton dos devient fort 67 ; quand tu le regardes, ta vie retrouve un regain de jeunesse. C'est un fils qui, dans la mêlée du combat, est pour toi tranchant comme un glaive, et qui, tel un nuage, fait pleuvoir des traits sur la tête des ennemis. Quand tes fidèles infligent une défaite à l'ennemi, ton fils combat de toute son âme, les autres avec leur corps. C'est lui qui provoque chez ton adversaire des lamentations 68, et t'assure la victoire. "
Un voyageur en quête d'une aubaine passa la nuit dans la maison d'un Arabe. Il trouva que tous ses fils, grands et petits, portaient des noms de bêtes féroces, tels que Lion et Loup ; tandis que ses serviteurs, sans exception, étaient homonymes du mouton et de l'agneau.
Le voyageur dit à son hôte : " O chef des Arabes, ces noms-là me remplissent d'étonnement. "
Le Bédouin répondit : " Mes enfants, qui font partie de mon armée, ont pour rôle de vaincre l'ennemi; mes serviteurs sont là pour vaquer aux soins domestiques et s'occuper sans cesse de mes hôtes. C'est le lion et le loup qu'il me faut pour triompher de mes adversaires, c'est à eux de montrer de la bravoure en les mettant à mort. Mais pour me servir, j'ai besoin de l'agneau et du mouton, dont l'activité ne peut causer de dommage à personne.
Ce que j'ai dit s'applique à l'enfant vertueux, qui a un bon lien avec son origine ; mais quant à l'enfant pervers et animé de mauvais instincts, et dont le caractère recèle des milliers de traits funestes, il vaut mieux le tenir éloigné de toi et ne concevoir pour lui que de l'aversion.
Noé eut un enfant indigne 69, dont l'âme était pleine d'aveuglement et d'ignorance. Cet ignoble rejeton fut stigmatisé de ce désaveu divin : " Il n'est pas d'entre les tiens ", et il ne trouva pas moyen d'échapper au déluge.
Puisque donc tous les enfants ne sont pas bons, demande à Dieu un descendant pour moi, mais que ce soit un fils tel qu'il ne te faille pas, en fin de compte, implorer de Dieu sa mort.
Un homme mal inspiré, le cœur désolé par le manque de postérité, s'en fut trouver un cheikh, et lui dit : " O cheikh, veuille former un vœu 70 afin que le Créateur m'accorde une grande faveur, qu'il fasse croître un frais cyprès sorti de ma terre et de mon eau, et dont l'existence donne la paix à mon cœur. C'est-à-dire que je voudrais avoir à mon côté un fils dont la beauté illumine mon regard. "
Le cheikh répondit : " Ne te donne pas une peine inutile, remets à Dieu seul le soin de cette affaire. Dans toute chose à laquelle tu appliques ton esprit, la Providence connaît mieux que toi la bonne solution. "
" O cheikh, " insista l'autre, "je suis vraiment obsédé par cette idée. Ne me refuse pas cette grâce. Contribue, par tes prières, à mon bonheur, afin que bientôt s'accomplisse mon plus cher désir. "
Le cheikh, à l'instant, leva les bras pour la prière, et la flèche, lâchée par son pouce, atteignit la cible. La proie obtenue, c'était un fils aux cheveux musqués comme la gazelle de Chine, provenant des chasses du monde invisible 71. Quand le rejeton de la passion et le rameau de la concupiscence eurent poussé en s'alimentant de son limon et de son eau 72, il se mit, avec ses compagnons, à boire du vin, et à s'acharner à l'assouvissement de tous ses désirs. Il s'enivra, s'installa alors sur le bord du toit de sa maison, et compromit la fille de son voisin. Et si le mari de la jeune personne ne s'était enfui devant notre débauché, celui-ci allait le poignarder. On alla rapporter l'aventure au vice-roi, qui conçut de la convoitise pour les écus du père du coupable. 73
Et telle était, nuit et jour, la conduite du jeune homme; ses mœurs libertines devinrent bientôt la fable du quartier et de la ville. Et les conseils n'avaient aucune prise sur lui, les punitions ne produisaient aucun effet.
A la fin, le père, poussé à bout par ce dévergondage, se cramponna derechef au pan de la robe du cheikh : " Personne d'autre que toi, " supplia-t-il, " n'est capable de me secourir. Aie pitié de moi, viens à mon aide. Adresse à Dieu une nouvelle prière en ma faveur, éloigne de ma tête les avanies de cet enfant." Le cheikh répondit : "Ce jour-là, je t'ai bien dit de ne pas insister et de renoncer à tes sollicitations. Demande maintenant pardon à Dieu, car ce mal te suffit dans cette vie et dans l'autre. Quand tu plieras bagage pour émigrer dans l'autre monde, ni fils ni fille ne te serviront à rien 74. Consacre-toi à servir Dieu sans chercher d'autres liens, et quoi qu'il arrive, sois-en content. "
Lorsque le philosophe à l'esprit pénétrant eut entendu l'histoire de l'enfant racontée par le roi de Grèce, il lui dit : " O chah, quiconque n'est pas dominé par la passion doit nécessairement se résigner au manque d'enfants. Or, l'œil de la raison et du savoir est frappé de cécité par la passion : c'est elle qui fait apparaître à nos yeux le div sous l'aspect d'une houri 75. Partout où sévit le tumulte de la passion, il emporte la raison du cœur et de l'œil la lumière. Partout où déborde le torrent de la passion, il démolit la maison du bonheur. La voie de la passion est pleine de la boue et du limon de la calamité, et celui qui tombe dans cette ordure ne se relève plus. Quiconque a bu une seule gorgée du vin de la passion ne verra jamais la face du salut éternel. Un peu de ce vin suffit à avilir l'homme honorable, car le peu de cette boisson funeste entraîne à en prendre beaucoup. Du moment que tu as goûté à la coupe du vin de la volupté, il t'en reste au palais une impression agréable qui devient pour ton nez un licol te tiraillant nuit et jour 76, et tu ne peux plus y échapper, tant que tu n'aventures pas ton âme dans la voie du néant.
Un ignoble individu organisa une fête et y appela de la ville tout ses pareils. Il invita aussi un homme distingué à se déranger pour venir à sa table. L'autre se dit : " C'est un être ignorant et vil ; or, ce sont là deux défauts dont j'ai le cœur fendu. Lorsqu'on se rend chez un pareil goujat, et qu'on mange quelques bouchées de ses mets, longtemps après qu'on a quitté sa table, leur saveur exquise persiste à la racine des dents, et si, ensuite, un autre malotru m'invite, ce goût délicieux me guidera chez lui. Mon nom sera biffé de la liste de gens distingués, et je resterai à perpétuité dans la kyrielle des vilains. "
Les voluptueux ne peuvent se passer de la femme ; or la fréquentation de la femme arrache la racine de la vie.
Qu'est-ce que la femme? Un être incomplet pour la raison et la religion 78. Il n'y a pas dans le monde créature aussi imparfaite. Or, sache que c'est chose incompatible avec le genre de vie des adeptes de la perfection, que d'être, des mois et des années, le jouet d'êtres inférieurs. Aux yeux de l'homme accompli, qui domine les autres par son savoir, le pantin de l'être inférieur est encore plus méprisable que ce dernier.
A la table des largesses de l'homme généreux, il n'y a pas de convive plus ingrat que la femme 79. Tu auras beau lui donner, cent années durant, de l'or et de l'argent, la couvrir de joyaux de la tête aux pieds ; la vêtir d'une robe de brocart de Chouchter 80, illuminer sa maison avec des chandeliers d'or, suspendre à ses oreilles des pendants de rubis et de perles, abriter ses charmes sous des voiles brodés d'or ; couvrir, au déjeuner et au dîner, sa table des mets les plus divers ; lui offrir, pour étancher sa soif, de l'eau de la fontaine de Khizr 81 dans une coupe formée d'une pierre précieuse ; lorsqu'elle désirera des fruits, lui apporter, comme aux rois, des grenades de Yezd et des pommes d'Ispahan 82 ; malgré tous ces bienfaits, vienne une dispute et une crise de nerfs, et tout cela, à ses yeux n'est plus rien, moins que rien.
Elle te dira: "O fondeur d'âmes, diminueur de vies, je n'ai jamais rien vu de plus nul que toi. "
Sa joue a beau être pareille à la tablette de la pureté, les caractères de la fidélité n'y sont pas tracées. Qui au monde a jamais eu à se louer de la fidélité féminine, qui a jamais éprouvé de la part de la femme autre chose que ruse et tromperie 83 ? Pendant des années, elle t'embrassera tendrement ; tourne alors le dos un instant, et elle t'oubliera. Si tu es vieux, il lui faudra un autre amant, un compagnon plus vigoureux que toi. Si un jouvenceau apparaît à ses regards, elle souhaitera qu'il te remplace dans l'amoureux service.
Belqîs et Salomon devisaient ensemble un jour, et échangeaient des confidences. Tous deux étaient bien résolus à dire sincèrement leur pensée, leur cœur était pur de toute ternissure d'amour-propre.
Le premier, Salomon, le roi de la religion, prit la parole : "Bien que j'aie accaparé," dit-il, "le sceau de la royauté 85, ni jour ni nuit, personne ne franchit mon seuil sans que je jette immédiatement sur sa main un regard avide, pour voir quel cadeau qu'il m'apporte 86, afin que sa gloire et sa noblesse augmente à mes yeux. "
Puis ce fut à Belqîs d'exhaler le secret caché au tréfonds de son cœur. Et voici les particularités intéressantes qu'elle dévoila :
" Pas un jeune homme au monde qui passe auprès de moi, sans que mon œil ne le contemple avec désir, et que cette idée ne passe dans mon âme : " Oh ! si je pouvais tenir ce jouvenceau sur mon sein défaillant d'amour ! "
Et voilà ce qu'éprouvent les femmes les meilleures ! Quant à la femme dépravée, mieux vaut ne pas en parler.
Maître Firdaussî, dont tu connais la sagesse, réprouve déjà la femme bonne 87. Comment, dès lors, la mauvaise femme pourrait-elle avoir des mœurs passables ? Aux yeux des braves gens, la femme perverse est digne de malédiction.
Après que le philosophe sage et dévoué eut ainsi flétri devant le monarque la lubricité des femmes, il trouva, grâce à son savoir, un procédé qui frappa de stupéfaction l'esprit des érudits.
Il retira des reins du roi de la liqueur séminale sans provoquer aucune volupté, et la déposa dans un endroit autre que la matrice 88. Après neuf mois, il en sortit un enfant sans la moindre tare ou défaut. Un bouton fleurit sur la souche du rosier royal, un souffle s'exhala du royaume de la conscience 89. Le diadème fut tout fier de ce joyau, le trône devint triomphant de cet heureux événement. L'immensité du monde et l'œil du ciel étaient, avant son apparition, privés respectivement d'habitants et de prunelle 90. Grâce à lui, le premier devint habité, le second fut illuminé.
Lorsqu'on vit que le nouveau-né était exempt de toute imperfection, on prit comme première partie de son nom un fragment du mot Selâmet, qui veut dire : " santé parfaite, " et on tira l'autre moitié du nom du ciel, Asmân, d'où était venu son corps pur de tout défaut ; son nom fut donc Salâmân 91.
Comme il était privé du lait maternel, il fallut bien lui chercher une nourrice 92. Ce fut une femme superbe, belle comme la lune dans son plein ; elle avait moins de vingt ans ; son nom était Absâl. De la tête aux pieds, tous les détails de son corps délicat étaient ravissants et irréprochables. Sur le sommet de sa tête, une raie d'argent séparait en deux moitiés une moisson de cheveux noirs. Une longue tresse pendait derrière sa nuque, et à chaque cheveu étaient accrochées cent calamités 93. Sa taille était un cyprès du jardin des belles proportions, tellement que ses pieds foulaient la couronne des rois. Brillant était son front limpide comme le cristal, sur lequel les sourcils bruns apparaissaient comme de la rouille; quand le porte-miroir en avait nettoyé la rouille, il avait laissé sans y toucher la courbe gracieuse d'un nouti. 94
Son œil était un ivrogne à demi sommeillant, appuyé sur une couche de roses, sous un parasol noir comme le musc. 95
Ses oreilles écouteuses de madrigaux subtils, ornant les deux côtés de son visage, étaient comme des huîtres d'argent destinées à receler les perles du discours.
Sur sa joue était tracée une gracieuse ligne noire de duvet ; l'éclat de l'Egypte de sa beauté était pur comme l'eau du Nil. 96 Bien qu'on eût dessiné cette ligne pour la protéger du mauvais œil, elle causait à l'œil des gens de bien des calamités sans nombre. 97
La rangée de ses dents était un collier de perles d'une belle eau, et l'écrin de ces joyaux superbes était un limpide rubis.
Dans sa bouche se perdrait la route des soucis, il ne pouvait plus être question, [quand on la voyait,] de raison et de réflexion.
De sa lèvre ne sortait d'autre saveur que celle du sucre, à tel point qu'on se demandait : " Quelle est la lèvre elle-même ? Quel est le sucre ? "
Une goutte distillait de la fossette de son menton et y restait suspendue. Des milliers de grâces s'y reflétaient ; ce double menton, les gens experts l'ont appelé ghabghab. Pareille à une poupée d'argent, elle érigeait d'un corps d'argent, un cou délié comme celui d'une amphore. Sur sa poitrine saillaient deux seins pareils à ces bulles limpides que le Zéphyr fait surgir sur la face de l'onde.
Sous sa gorge resplendissait son ventre, ivoire pour la blancheur, doux au toucher comme l'hermine.
La camériste, voyant la grâce de ce ventre, dit : " Ce n'est pas moins délicat que la pétale d'une rose ; " et ce disant, elle fit un geste et y imprima une marque avec le bout du doigt. C'est là ce que les descripteurs ont dénommé nombril (nâf) y un nombril qui faisait se fendre [de jalousie] le cœur de la vessie de musc (nâfa). 98
Quiconque voyait cette taille plus ténue qu'un cheveu, n'avait plus d'autre désir que de l'embrasser.
Plus bas encore, une rondeur pareille à une vraie moisson de blanches églantines, était cachée sous un voile aux regrets indiscrets ?99
Ses deux mains s'étaient partagé le trésor de la grâce. Les manches qui couvraient ses bras étaient comme deux longues bourses remplies d'argent.
Dans sa main était l'apaisement des cœurs meurtris, et par contre, le soufflet arrachant à leur apathie les engourdis. Le désir des gens de cœur était dans sa main, son doigt était la clef de la serrure des cœurs. Sa main faisait saigner le cœur des amoureux, c'était du sang que le henné qui la teignait.
Les bouts de ses doigts, les uns teints, les autres points, étaient, ceux-ci des noisettes fraîches, ceux-là du jujube déli, 100
Ses ongles étaient autant de lunes de dimensions différentes,
loi éclipsées par le henné. Quand la camériste en avait arrangé la forme, elle avait retranché un croissant de l'extrémité de chacune. Une fois qu'il est question de sa jambe et de sa cuisse, il faut absolument retirer la langue contre le palais [et me taire], car je crains que mon discours n'en vienne au point d'être pénible pour ma nature. Il s'agit là d'un secret caché aux non initiés 101, personne au monde n'en est le confident. Pourtant, un larron avait pénétré jusque là, et avait pillé le trésor qui s'y trouvait 102. Il avait fendu cette huître argentée et y avait trouvé la perle de son désir. Or, il vaut mieux repousser du regard de l'acceptation ce qui a été profané par d'autres.
Cet extravagant s'assit au bord de la mer, afin d'y accomplir son ablution pour se rapprocher de Dieu. 11 avait devant les yeux une nappe liquide fourmillant de poissons et de serpents, de milliers de grenouilles et de crocodiles. De toutes parts, des oiseaux aquatiques nageaient ou faisaient le plongeon pour aller chercher leur pâture dans les abîmes de l'Océan.
Il se dit : " Comment pourrais-je utiliser, pour me laver les mains et le visage, une eau où, du matin au soir, pullulent autant d'animaux ? Désormais, je renonce à l'employer pour mes ablutions. Il me faut une eau pareille à celle de Zemzem 103, à laquelle ne peut toucher la main d'un infidèle, car les cœurs purs ne peuvent avoir de contact avec les choses souillées. "
Le chah, donc, choisit Absâl comme nourrice, pour qu'elle prît Salâmân au sort fortuné dans le giron de sa tendresse et qu'elle le nourrît du suc de sa mamelle. Or, lorsque son regard tomba sur Salâmân, elle en fut si émerveillée qu'elle écarquilla les yeux 104. Elle devint passionnément éprise de la grâce de ce bijou d'enfant, et l'enferma dans le berceau d'or comme un joyau dans son écrin. A force de contempler cette joue qui lui enflammait le cœur, elle perdit le sommeil de la nuit et le repos du jour. Sans trêve, tout son zèle était consacré à fermer et à ouvrir le berceau de son nourrisson : tantôt, elle lavait de son corps le musc et l'eau de rose 105, tantôt elle couvrait ses lèvres de sucre de baisers doux comme le miel pur.
Bref, la tendresse pour ce visage arrondi prit tant de place dans son cœur, qu'elle ferma pour le reste de l'univers l'œil de l'amour. Sans aucun doute, si elle l'avait pu, elle aurait placé cette mignonne créature dans son œil en guise de pupille.
Quand, après quelque temps, elle eut sevré son nourrisson, ses occupations se modifièrent. A l'heure du sommeil, elle dressait son lit et brûlait comme une veilleuse à son chevet. A l'aube, quand il s'éveillait, elle le parait comme une poupée d'or. Elle oignait de collyre le narcisse bleu de son œil, et le revêtait d'une robe pimpante. Elle lui mettait coquettement de travers sur la tête le bonnet doré 106, et faisait pendre sur sa poitrine la boucle noire. Avec des agrafes incrustées de rubis et d'or, elle ajustait la ceinture sur sa taille gracile.
Elle se consacra ainsi sans relâche à son service, jusqu'à ce qu'il atteignit quatorze ans, l'âge de l'adolescence. A quatorze ans, il était beau comme une pleine lune dont les jours étaient aussi nombreux que ses années à lui 107. Le degré de sa beauté s'éleva de plus en plus, et la sympathie pour lui prit place dans tous les cœurs. Sa beauté centupla, et les sentiments qu'elle inspirait devinrent cent mille fois plus vifs ; l'affection pour lui agitait cent mille cœurs.
Ce gracieux jouvenceau avait la taille comme une lance, on aurait dit un soleil à la hauteur d'une lance. Quand il redressait sa taille comme une javeline, il frappait tous les cœurs d'une blessure. Et ce soleil, par suite de cette hauteur, brûlait l'âme de tous les mortels.
Son front, c'était la lune dans son plein, dont une moitié était cachée, ayant ainsi fait conjonction avec la lune éclipsée.
Son nez, sous le croissant éclipsé, était un alif au milieu d'une lune blanche comme le camphre 108.
Son œil langoureux était une gazelle chasseresse d'hommes, séjournant au milieu d'un parterre de tulipes.
Par ses joues, il était le souverain du royaume de la beauté, la majesté royale était sa compagne.
Il avait pour sceau royal son rubis flamboyant, dont le chaton protégeait un trésor de perles et de joyaux 109.
Sa pomme fraîche était le fruit du jardin du paradis ; gloire à la main qui avait planté l'arbre ! La fossette de son menton était la source de la grâce, et l'âme des altérés venait se rafraîchir à ses bords. Son cou faisait lever la tête aux belles pareilles à les lunes, le cou des plus altiers était pris dans son lasso.
Les saints personnages, pour éviter tout maléfice, liaient autour de son bras des amulettes de prières.
Son dos était assez puissant pour résister aux plus forts athlètes, sa main dominait le bras des belles au sein d'argent. Suspendus à son bras, à droite et à gauche, étaient des gens dévoués, prêts à exposer leur vie pour lui 110.
Son poignet triomphait de l'argent pur, sa main tordait les bras d'acier. Sa main généreuse renfermait de quoi réparer les maux causés par ses noirs sourcils ; le chaton de la bague qui ornait son doigt était le dernier mot de la beauté.
Tout ce qu'on a dit pour vanter sa beauté a été une perle provenant de la mer des formes extérieures. Mais prête moi maintenant l'oreille de l'âme, et écoute une petite partie de ses qualités intellectuelles.
Grâce à ses heureuses dispositions, il fendait les cheveux dans la dialectique, et sans avoir entendu le mot, il se hâtait d'atteindre la signification. Avant que l'expression ne lui parvînt à l'oreille, la pensée exprimée venait sous le joug de son intelligence. Toute poésie était une perle de la mer de son naturel brillant, toute prose était un fruit du jardin de sa grâce. Le degré de sa poésie était aussi haut que les Pléiades, sa prose était aussi sublime que les deux Ourses. S'agissait-il de traits d'esprit, son rubis était prompt à la riposte ; sa perspicacité était pure comme l'onde pour comprendre les subtilités.
Son écriture était comme le duvet des belles enchanteresses; les calligraphies, rien qu'à la voir, étaient à bout de forces comme les amoureux 111. Quand il prenait la plume au tracé noir comme le musc, la tablette et le roseau lui criaient : "bravo ! "
Son âme était enchantée de toute idée philosophique, sa mémoire retenait les subtilités métaphysiques. Quand il développait les doctrines de la philosophie grecque, les Grecs eux-mêmes applaudissaient à son exposé 112.
La nuit, quand son cœur était libre de tout souci, il jouait avec ses amis aux dés de la liesse. Il arrangeait une salle de festin comme le paradis, et y faisait venir des artistes beaux comme des houris. Quand son cerveau était échauffé par le vin, il ôtait les voiles de la réserve : tantôt, il rivalisait de verve avec les causeurs, tantôt, il tenait tête aux virtuoses en chantant des mélodies. Les accents que modulaient ses douces lèvres faisaient rentrer, comme le Messie, l'âme dans le corps 113. Tantôt, il joutait avec un flûtiste, et sous ses lèvres, le roseau de l'instrument devenait une canne à sucre ; il mélangeait de sucre le son de la flûte, il versait du sucre dans le pan de l'oreille 114. Tantôt, il prenait le luth des mains du harpiste, et en exaspérait le son plaintif. Il versait des noisettes fraîches " 115 sur les cordes sèches, et faisait ainsi jaillir des étincelles du choc de l'humide et du sec. Ou bien encore, prenant sur son sein, comme un bébé, la cithare, il lui arrachait par ses soufflets des gémissements de douleur, et faisait verser des larmes aux hommes faits.
Parfois, il se bornait à triller comme le rossignol ; parfois, il chantait en s'accompagnant.
Tel était, jusqu'à l'aurore, l'emploi de ses nuits, voilà comment il se récréait avec ses compagnons. Puis à l'aurore, quand son corps s'était reposé, il s'acheminait vers l'hippodrome.
1. — Cf. Goldziher, Islam, dans die Orientalischen Religionen, collection " die Kultur der Gegenwart ", Leipzig, Teubner.
2. — 3e édition, Londres, Gibbings, 1891.
3. — Literary History of Persia, I, p. 419.
4. — Browne, op. laud., p. 420.
5. — M. le Bon Carra de Vaux a publié, sur Gazali et sur son illustre prédécesseur Avicenne, deux excellents ouvrages, qui, réunis, forment une excellente introduction à l'étude de la philosophie musulmane — ou, comme on dit souvent " arabe ", sans doute parce que ses traités sont écrits en arabe. —L'auteur y consacre deux longs chapitres aux poètes mystiques arabes et persans postérieurs à Gazali. Paris, Alcan, Avicenne, 1900 ; Gazali, 1902.
6. — Cf. l'excellente édition et traduction d'extraits du Dîvân-i Chams-i Tabrîz de Djèlâl ed-Dîn Roûmî, par Nicholson (Cambridge Univ. Press, 1898), pp. 14-15 : " David dit : « O Seigneur, puisque tu n'as pas besoin de nous, dis donc, quelle sagesse cachée y avait-il à créer les deux mondes ? " Dieu lui répondit : « O homme temporel (par opposition à Dieu qui est en dehors du temps et de l'espace), j'étais un trésor caché ; j'ai cherché à ce que ce trésor de générosité et de bonté fût révélé. J'ai déployé un miroir dont la face est le cœur, et l'envers, le monde...
7. — Op. laud. p. 439.
8. — Voir l'excellente traduction abrégée de Whinfield (Londres, Trübner, 1898), p. 216.
9. — Ennéades, trad. Bouillet, I, p. 100.
10. — Cf. Nicholson, op. laud., pp. 116-117.
11. — Vol. I, pp. 36 sqq.
12. — Extraits d'un traité d'Ibn Khaldoun cités et traduits par l'illustre de Sacy dans les Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque royale, XII, p. 303.
13. — Même ouvrage, p. 291.
14. — De Sacy en a publié une admirable édition avec traduction. Paris, 1819.
15. — Dans les Manzoûmât, édit. Bâcher (Strasbourg, 1879), pp. 19 et 37.
16. — Politiciens et Moralistes au XIXe siècle, vol. I, avant-propos.
17. — Voir Myron Phelps. Abbas Effendi, his Life and Teachings. Londres et New-York (Putnam) 1904, surtout le chap. VII.
18. — Voir par exemple le Goulchan-i Râz, " Roseraie mystique " de Chabistarî, trad. Whinfield (Londres, Trübner, 1880), pp. 70 et suiv.
19. — Traduit sur le texte publié dans Salemann et Joukovsky, Chrestomathie faisant suite à leur Grammaire persane (Porta Linguarum Orientalium, Berlin, 1889), pp. 33-34.
20. — La plupart de ces exemples sont traduits sur le texte donné par Kanga y dans ses excellents Hints on the Study of Persian, Bombay, 1898, pp. 178 et suiv.
21. — A citer, par exemple, Hâdjî Moullâ Hâdî de Sebzèvâr, mort en 1882, cf. Gobineau, Religions et Philosophies de l'Asie Centrale et Aug. Bricteux, Au Pays du Lion et du Soleil, Bruxelles, 1908, pp. 144-145.
20. — Notices of Persian Poets, p. 133.
21. — D'après Hammer. Litteraturgeschichte der Araber, V, 393.
1. — Leïlâ et Madjnoûn. — V. note 43 des vers 190 et suiv.
2. — Chirine. — V. note 176 du vers 857. Il y a ici un jeu de mots sur chîrîne, qui, comme adjectif, signifie " doux ".
3. — Vâm'iq et l Jzrâ. — Voir note 171.
4. — Il y a deux jeux de mots sur ‘azâr "joue " et ‘Azrâ, sur sîm " argent " et sîmâb, proprement " eau d'argent, vif argent, mercure ".
Les vers 1 à 6 développent l'idée que c'est Dieu, en tant que Beauté absolue, qui se manifeste dans la beauté des créatures. Il y a un chant admirable sur la Beauté créatrice dans Youssouf et Zouleïkhâ de Djâmî, édit. Rosenzweig, pp. 16-17. On y trouve les mêmes types de beauté cités.
5. — Personne d'autre que toi n'est à la fois amant et bien-aimé. — Quand un homme est épris de la beauté d'une créature, c'est Dieu qui agit en lui, et la beauté qu'il adore n'est qu'un reflet de la Beauté absolue, c'est-à-dire de Dieu. Donc, en un sens, Dieu se contemple et s'aime lui-même. Les poètes soûfîs expriment encore, comme suit, cette idée sous une forme métaphorique : " De même que l'univers est l'image de l'Etre Absolu, c'est-à-dire de Dieu, réfléchie dans le miroir du Non-être, de même l'homme est l'œil de ce portrait ; et de même que, quand nous regardons dans un miroir, nous apercevons une petite image de nous-même réfléchie dans la pupille, de même l'image de Dieu est réfléchie dans cet œil qu'est l'homme. C'est ainsi que Dieu est révélé à Lui-même et à l'homme, et qu'en outre, l'homme renferme en lui-même l'image de Dieu. " (Gibb, op. laud. I, p. 19), cf. p. 18 de notre introduction.
6. — Jusques à quand... Cf. p. 30.
7. — Que tu me rendes exempt... Cf. pp. 23 et 44.
8. — Dieu est le seul agent réel, fa"âl-i haqîqî, Cf. p. 23.
9. — Stations. J'emploie ici, pour rendre maqâmât, le même mot que de Sacy, op. laud. p. 317 (Cf. introd. p. 21). D'autres traduisent : stades. L’Unité. Il s'agit de l'unification avec Dieu.
10. — Ce petit poème est cité et traduit par Rückert, Grammatik, Rhetorik u. Poesie der Perser. Edit. Pertsch, Gotha, 1874, pp. 72-74.
11. — Kourde. L'auteur prend ici un Kourde comme type de balourdise. Actuellement, les Persans, à l'esprit moqueur et délié, se plaisent plutôt à faire des Turcs les héros d'aventures ridicules. Mais Djâmî était le protégé de princes turcs !
12. — Les gens de cœur, c'est-à-dire : les soûfîs. Cf. introd. p. 29.
13. — Le poète joue ici sur son nom, cf. p. 37. Il y a un passage analogue dans le prologue de Yoûssouf et Zouleïkhâ, éd. Rosenzweig, p. 1 : " Les compagnons ont bu les vins et sont partis, ne laissant après eux que des cruches vides. Je ne vois ni sage ni fou de ce banquet, qui n'ait dans la main une coupe (djâmî) de ce vin-ci. Allons ! Djâmî, laisse là toute fausse honte, apporte ce que tu as, que ce soit vin pur ou lie ! "
14. — Après l'éloge de Dieu vient dans tous les meçnèvis celui du prophète Mahomet, et souvent, quand ils sont d'une certaine longueur, un chapitre sur son ascension.
15. — Les favoris de la fortune. Je traduis ainsi mouqbilân, cf. note 147. Il y a un jeu de mot avec qibla, qui veut dire l'endroit vers lequel se tournent les croyants pour accomplir les actes du culte.
16. — Initiés. Le texte a mahram, " celui qui a accès dans le sanctuaire ".
17. — Kaaba. Bâtiment en forme de " cube " (de là son nom) au centre de la mosquée de la Mecque.
Zemzem. Puits sacré de la Mecque.
18. — L'honneur, en persan âb-roû, proprement l' " eau du visage ". Il y a ici un jeu de mots intraduisible.
Des parfaits soûfîs. Le texte a : des ‘ârif cf. note 175. Le ‘ârif est celui qui possède la ma’rifat, v. introd. pp. 20-21.
19. — Le lieu où Ibrâhîm... Ibrahim, forme arabe du nom d'Abraham, surnommé " l'ami de Dieu ", Khalîlou-llâh. C'est le plus grand prophète après Mahomet (qui se prétendait venu pour restaurer dans toute sa pureté la religion d'Abraham) et Jésus. La pierre, maqâmou Ibrâhîma, est supposée porter l'empreinte du pied d'Ibrâhîm, qui, de là, proclama la nécessité du pèlerinage. (Dozy, Essai sur l'histoire de l'Islamisme, 145).
20. — La pierre. Il s'agit de la pierre noire (al-hadjarou-l-aswadou) placée à un angle de la Ka'ba. Elle passe pour provenir du paradis ; à l'origine, elle était plus blanche que le lait, et ce sont les péchés des hommes qui l'ont rendue noire.
21. — Depuis le commencement de l'éternité. D'après la cosmogonie orthodoxe, " quand Dieu résolut de se manifester par la création du monde, la première chose qu'il appela à l'existence fut un rayonnement glorieux de sa propre lumière. On l'appelle généralement " Lumière de Mahomet " (Noûr-i Mouhammad). Cette lumière brilla sur le front d'Adam et de tous les prophètes subséquents, jusqu'à Mahomet lui-même ". (Gibb, History of Ottoman Poetry, I, 34 et 236.)
22. — Ce chapitre est un hommage au prince Ya'qoûb (cf. p. 41). Djâmî amplifie habilement l'idée qu'un roi est l'ombre de Dieu sur la terre.
23. — Allusions à Dieu, dont l'essence est inconnaissable, mais dont le monde phénoménal est un pâle reflet. Cf. p. 16.
24. — Djemchîd, ou simplement Djèm, roi légendaire.
25. — Les poètes persans empruntent de nombreuses métaphores au jeu de polo ou de mail à cheval. Cf. sur ce jeu la note 116 des vers 514 et suiv.
26. — Le texte a Rakhch, nom du cheval du héros Roustem, l'Hercule persan.
27. — Hâtim ou Hâtam, chef arabe de la tribu des Benou-Taï, type proverbial de la libéralité dans l'Orient musulman. Il y a dans le Goulistan et le Boustan des historiettes relatives à Hâtam, et de nombreux ouvrages sont consacrés à ce Bédouin généreux jusqu'à l'extravagance. (Voir Ethé, Histoire de la Litt. Pers. dans Grundriss der Iranischen Philologie, pp. 319-320.) La plus célèbre est la Rissâlè-ï Hâtimiyyè de Kâchifî, dont la Chrestomathie Persane de Schefer renferme des extraits, I, pp. 1 74 et suiv.
28. — Son père. Il s'agit de la mort d'Ouzoun Hassan, père de Ya'qoûb. Cf. p. 41.
29. — L'honneur se dit en persan âbroû, ce qui veut dire littéralement « eau du visage ", c'est-à-dire " éclat du visage " (cf. en français : un diamant d'une belle eau). Djâmî joue sur le sens littéral des éléments composants du mot. Si même un mot âb, phl. āb, scr. ābhā, signifiant " éclat " a existé d'abord indépendamment de āb " eau ", les Persans ont certainement fini par confondre les deux mots âb.
30. — Lui. L'arabe houwa, hoû pers. în, s'emploient souvent en parlant de Dieu. On le met souvent en tête des lettres, et les derviches crient, tantôt Yâ Haqq " ô [Dieu de] Vérité ", tantôt Yâ Hoû.
31. — Ce panégyrique s'adresse au prince Yoûssouf, frère du chah Ya'qoûb.
32. — Bien qu'il soit né... Le poète fait ici allusion aux luttes fratricides fréquentes autrefois en pays musulman. D'après la loi de l'Islam, le trône passe du souverain au plus âgé de ses oncles ou de ses frères. Naturellement, les princes, inspirés par l'amour paternel, tâchaient de léguer leur pouvoir à un de leurs fils, et, pour cela, se débarrassaient de leurs frères et de leurs oncles. Plus tard, les mœurs se sont " adoucies ", les souverains se sont contentés de les mutiler ou de les aveugler pour les rendre incapables de régner. Plus tard encore, ils se sont bornés à les emprisonner ou à les exiler. Naturellement, les frères et oncles des souverains prenaient souvent l'avance et tâchaient de leur ravir le trône et la vie. Actuellement, ces usages barbares ont disparu. Il est digne de remarque que la dynastie Qâdjâre, actuellement régnante en Perse, n'applique pas la loi musulmane : c'est le fils aîné du chah qui lui succède, pourvu que sa mère soit également princesse du sang.
33. — Le prince s'appelle Youssouf, forme arabe de Joseph. Djâmî compare le prince à son illustre homonyme juif, qui est dans l'Orient musulman le type de la vertu et de la beauté masculine. Dans le Coran, la grande dame qui cherche à séduire Youssouf n'est pas nommée, mais la tradition musulmane l'appelle Zouleïkhâ ou Zalîkhâ (voir la Sourate XII). Le récit des aventures de Youssouf et Zouleïkhâ est le sujet d'innombrables poèmes romanesques, depuis Firdawsî. Voir aussi vers 132 et 134. Cf. introduction, p. 47.
34. — Ce n'est pas là un simple mortel. Ces mots sont en arabe dans le texte : Ma hâdhâ bachar(an). Ils sont empruntés au Coran (XII, 31). 35. — Bien qu'il soit l'unique frère. Cf. note 32.
35. — Farqadân = " les deux Ferqed ". Les Orientaux appellent ainsi les deux étoiles les plus rapprochées du pôle, b et g de la Petite Ourse.
36. — Le mot arabe ‘oûd désigne le bois d'aloès, qui répand, quand on le brûle, une odeur pénétrante. Ce bois est employé aussi à faire des luths. Le mot 'oûd, uni à l'article al : al'oûd, a probablement donné l'espagnol alaud y le provençal laut et le français luth. Cf. Sa'dî, Gulistan, I, 18 : " L'odorat ne sera point flatté du parfum d'un plateau de bois d'aloès. Place-le sur le feu, parce qu'il sentira comme l'ambre. "
37. — Compagnon se dit hamzânoû, de ham qui marque " ensemble, union " (cf. gr. hama, angl. same) et zânoû, genou. Djâmî joue sur le mot zânoû.
38. — Le Meçnevî de Djelâl ed-Dîn Roûmî est le poème soûfî le plus important. Il joue, pour ainsi dire, le rôle de livre sacré du soufisme, et d'ailleurs, tous les lettrés persans l'étudient à fond et en citent souvent des passages. Ce distique est en arabe dans le texte :
La Bien-Aimée à laquelle il est fait allusion, c'est Dieu. Le poète veut dire qu'au lieu d'user sa vie à des passe-temps profanes, comme de faire des vers, il ferait mieux de consacrer ses derniers jours au service de Dieu. Djâmî trouve une excuse dans l'idée, déjà développée plus haut, vv. 70 ss., que les rois sont l'ombre de Dieu, et que les célébrer, c'est en quelque sorte célébrer Dieu lui-même. Cf. n. 42.
39. — Jeu de mots sur dildâr " bien-aimé(e) " et didâr " vue ".
40. — Recèlent les secrets. Le texte a : " sont le magasin des secrets de Lui ", makhzan-i asrâri oû' st. Ces mots, Makhzan-i asrâr, ou plutôt, en arabe, Makhzanou-l-asrâr, sont le titre d'un des grands poèmes de Nizâmî. Cf. p. 47.
41. — Le soûfî doit concentrer sa pensée sur Dieu seul, et oublier tout le reste. Cf. p. 22.
42. — Le poète veut dire que l'éloge du roi, ombre de Dieu, est pour lui une occasion de glorifier les attributs de Dieu même, en attendant l'heureux jour où il pourra, pour l'éternité, s'unir à Lui.
43. — Medjnoûn et Leïlâ (ou, comme les Persans disent souvent par erreur, Leïlî) sont le Roméo et la Juliette de la poésie persane. Leurs aventures ont fait l'objet d'innombrables meçnevis persans et turcs, dont le plus fameux est celui du grand Nizâmî. Résumé de leur histoire dans Gibb, op. cit. II, pp. 175 à 190. Madjnoûn composa de nombreux poèmes où il chantait ses amours. Une collection circule sous son nom. Cf. Gibb, II, p. 178, n. i (de Browne). La traduction de Medjnoûn et Leïlâ de Djâmî par le Comte von Schack, dans Orient u. Occident, Stuttgart, 1890, I, est un chef-d’œuvre de talent et de goût.
44. — Fou d'amour. Madjnoûn est représenté comme devenu fou d'amour et vivant dans le désert au milieu des bêtes fauves qui, loin de lui faire du mal, le protègent contre les intrus. Madjnoûn, comme adjectif, veut dire " fou, possédé d'un djinn ".
45. — Fitz Gerald, comme on le voit, a omis ici plusieurs chapitres longs, difficiles, et, d'ailleurs, d'une lecture extrêmement ingrate.
46. — Le lecteur a ici un beau spécimen de jeu de mots : au lieu de mesurer du " vin ", bâda, le vase en est réduit désormais à mesurer du " vent " bâd. C'est ce qu'on appelle en rhétorique persane un tedjnissi nâqis, cf. introd. p. 34. " Mesurer du vent ", bâd peïmoûden, est une expression idiomatique qui signifie : " s'occuper de choses inutiles ". Même jeu de mots dans Hâfiz, lettre Elif, ode IX, v. 3.
47. — Nous avons ici le cas bien rare d'un distique n'offrant pas un sens complet.
48. — Le poète résume dans ce chapitre la doctrine de la grâce. On voit qu'elle est exposée ici avec la même rigueur que dans le calvinisme. L'homme, s'il est bon, doit rendre grâce à Dieu, et s'il pèche, demander pardon. Cette doctrine était déjà celle de Ghazzâlî (v. p. 13). Cf. Carra de Vaux, Gazali, p. 212. Djâmî ne se sert pas ici du mot propre pour dire la " grâce ", qui est faïz ou faïazân(ou-llâh) et que d'ailleurs il emploie dans d'autres passages. Mais l'idée est claire.
49. — Cf. Carra de Vaux, Gazali, p. 187, où l'auteur traduit un passage de Kochéïri, auteur de l’Epître (Rissâlè) qui est " le plus célèbre ouvrage antérieur à Gazali où l'on puisse trouver une histoire et un exposé complet et systématique de la doctrine du soufisme " :
" Le repentir véritable exige trois choses : le regret de ce qui a précédé, l'abandon actuel du péché et la résolution de ne plus le recommencer à l'avenir. " Il est intéressant de reproduire ici cette sentence arabe (de Sacy, Pend. Nam. p. 224) : " Aucun péché n'est véniel quand on persévère à le commettre ; aucun péché n'est mortel quand on en demande le pardon. "
50. — Je ne comprends pas ici la leçon de Falconer. J'adopte celle du manuscrit de Berlin dont le sens est clair et qui se scande parfaitement.
51. — Un rang. Littéralement : " des stations ", maqâmât. Cf. v. 9 et p. 21.
52. — Faveur miraculeuse. Je traduis ainsi kirâmat. Ce mot signifie proprement " les vertus et les dons extraordinaires par lesquels Dieu honore ses fidèles, à la différence des miracles qu'il opère par les prophètes en preuve de leur mission, et qu'on appelle mou’djizât, et des faveurs extraordinaires qu'il accorde parfois aux méchants, dans sa justice, pour les endurcir dans le mal, et qui sont appelées istidrâdjât ". (de Sacy, Pend Nam. p. 157.)
53. — Il n'y a, pour ainsi dire, pas un meçnevî persan où un chapitre ne soit consacré à un songe du poète.
54. — Il s'agit du fameux Ouzoun Hassan, (cf. p. 40) qui avait donné à Djâmî une escorte protectrice lors de son dangereux pèlerinage à la Mecque. Il mourut (cf. v. 28) avant la publication de Salâmân et Absâl et eut pour successeur son fils Ya'qoûb. (F. G.)
55. — Blanc comme le camphre. Cf. Pend Nameh, p. lvii : " De même que les Orientaux comparent au musc tout ce qui est noir, ils comparent au camphre tout ce qui est blanc. "
56. — Les questions d'usage, " poursich " '. Cela revient à dire " me salua ". Le salut persan consiste à demander des nouvelles de la santé.
57. — Je me mis avec ardeur à la rédaction. — Il y a ici un jeu de mots impossible à rendre en français. Le texte est : Tchoûn qalam bastam miyân tahrtr-ra. Littéralement : " Je me liai la taille comme la plume pour la rédaction. " Se lier la taille, comme le latin accingi ad aliquid, veut dire : se disposer à accomplir une besogne. " Comme la plume ", c'est-à-dire de façon à la rendre mince comme la plume.
58. — Les semelles des souliers persans sont, en effet, souvent renforcées de plaques de fer, et deviennent ainsi des armes dangereuses dans les mains des femmes en guerre avec leurs maris.
59. — La Grèce s'appelle en persan Yoûnân. On reconnaît sans peine dans cette forme le mot Ionie, En effet les Grecs d'Ionie ont été les premiers en rapport avec les Asiatiques, et leur nom figure dans les inscriptions de Darius, sous la forme Taunâ.
60. — Alexandre. — Les Orientaux ne connaissent que peu de chose de l'histoire d' " Iskender ", mais une multitude de légendes se rattachent à son nom. Une grande partie sont passées au Moyen Age dans la littérature occidentale. (Roman d'Alexandre.) Voir sur ce sujet: Bâcher. Nizâmî's Leben u. Werke u. d. Alexanderbuch, Göttingen, 1871.
61. — De Qâf à Qâf. D'après la cosmographie populaire musulmane, qui est basée sur le système de Ptolémée, la terre est plate et entourée d'une octuple ceinture de montagnes appelées Qâf.
62. — Confident. Littéralement " commensal ", nadîm.
63. — Ce passage, entre autres, montre au lecteur que j'avais raison de vanter la hardiesse de Djâmf et l'indépendance de son esprit.
64. — David. Le même fait est raconté dans le Bahâristân de Djâmî (Ed. de Constantinople, p. 23.) J'en traduis le passage suivant : " Dieu inspira ce qui suit à David : " Dis à ton peuple de ne pas dire du mal des souverains de la Perse ‘Adjam) et de ne pas les injurier, car c'est eux qui par leur justice ont rendu le monde florissant (âbâdân) y afin que mes fidèles serviteurs pussent y vivre. " David [Dâoûd] était à la fois roi et prophète. — On voit que âvourdan veut dire ici " mentionner, parler de ".
65. — Eussent..., fut... Pour Dieu, le temps n'existe pas, et il voit tout comme accompli. On le fait donc toujours parler au parfait. On en voit de nombreux exemples dans le Coran. (Ex. v. Gibb, op. laud. p. 34, n. 1.)
66. — La robe d'honneur, Khil’at. Récompense accordée par les souverains musulmans aux gens qu'ils veulent honorer. Cet usage existe encore en Perse, bien que le chah Nassir ed-Dîn ait institué dans son pays les décorations, qui remplissent, à meilleur compte, le même office.
67. — Jeu de mot sur poucht, " dos "(cf. latin post) et " pouchti " appui ".
68. — Jeu de mot sur chîvan " lamentations" et chîva " habitude "
69. — Noé eut un enfant indigne. — Il s'agit d’un fils mécréant, que le Coran ne nomme pas ; il refusa de monter dans l’arche et périt dans les flots du déluge. Coran, sour. XI. Dieu avait promis à Noé de sauver sa famille, Quand Noé fit remarquer à Dieu que ce fils était de sa famille, Dieu répondit : " Il n'est pas de ta famille. Ces mots sont en arabe dans le texte, ils sont extraits du Coran, XI, 48.
70. — Le texte a : " O cheikh, aie pour moi une himmatt. " Ce dernier mot a des sens très divers…….
71. — L'univers se compose du monde visible ('âlam-i chahâdat) et e invisible ('âlam-i ghâïb),' Dans le second existent les idées qui doivent être réalisées dans le monde visible. (Cf. Gibb, op. cit. I, p. 54 sqq.) La proportion des idées réalisées à un moment donné est extrêmement minime, c’est comme " un petit anneau au milieu d’un vaste désert. " (Gibb, ibid., p. 56.)
72. — Eau et limon. Les poètes appellent souvent le corps : " maison d'eau et de terre ". Ex. Nicholson, Diwân Châms i Tabriz, XXXIV, 6 et XXXV, 8.
73. — Le vice-roi conçut de la convoitise pour les écus du père. Cette petite phrase est tout un poème. Elle évoque toutes les beautés de l'administration persane.
74. — Ni fils ni fille ne te serviront à rien. Cf. Pend Nameh d'Attar, éd. de Sacy, p. 223 : " Souviens-toi des leçons de l'Alcoran, qui t'a appris à regarder tes femmes et tes enfants comme des pièges dangereux. " De Sacy rappelle Coran, sour. LXIV, v. 1 5 : " O vous qui avez cru ! vos femmes et vos enfants ne sont pour vous que des ennemis dangereux et contre lesquels vous devez vous tenir sur vos gardes ", et sour. VIII, v. 27 : " Vos richesses et vos enfants ne sont pour vous qu'un sujet de tentation ". Voir aussi Goulistan, 2, 32.
75. — Dîv, forme moderne du mot Zend daêva, démon. (Remarquer que le mot indien correspondant, dêva, veut dire " dieu ". De même l'hébreu Kohen "prêtre ", correspond à l'arabe Kâhin, "sorcier ".)
Les hoûrîs sont les belles vierges aux yeux noirs, toujours jeunes et ardentes, qui peuplent le paradis de Mahomet.
76. — Un licol pour ton nez. — Dans la partie orientale de l'Iran, les chameaux sont conduits au moyen d'une longe qui passe par un trou foré dans une aile du nez.
77. — Blâme des femmes. Dans les littératures musulmanes, comme dans notre littérature médiévale, les diatribes violentes contre le beau sexe sont un des thèmes favoris des auteurs, et l'on irait loin, si l'on voulait citer des passages analogues à celui-ci. Aujourd'hui encore, il serait impossible, je crois, de persuader aucun Persan, même des plus éclairés, qu'une femme peut être vertueuse et fidèle. Pourtant Saadî, avec son bon sens et sa modération habituelle, et quoique lui-même ait eu à souffrir quelque temps du caractère acariâtre d'une Xanthippe (cf. Goulistan, 2, 31), oppose au portrait de la mauvaise femme celui de la bonne.
78. — La femme est un être incomplet pour la raison et pour la religion. — Cf. Audibert, la Femme persane jugée par un Persan (Paris, 1889), pp. 1314 : "A vrai dire, les traditions religieuses nous enseignent qu'il faut éviter les femmes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et n'avoir jamais aucune espèce de confiance en elles. La confiance doit reposer sur un être doué d'intelligence, or Dieu et les Saints Imams (successeurs du Prophète) n'ont-ils pas dit que l'intelligence de la femme était incomplète ? Sa Sainteté, le Commandeur des croyants, Ali, fils d'Abouthaleb (que le salut de Dieu soit avec lui !) a prononcé, de son côté, ces paroles de blâme sur la femme: [Ces paroles sont en arabe dans le texte] " Oh hommes, sachez-le bien, la femme est un être incomplet en matière de religion, d'intelligence, d'héritage. Voici les raisons qui prouvent ces diverses imperfections : d'abord, en ce qui touche la religion, c'est qu'il leur est interdit de prier ou de jeûner aux époques de leurs menstrues. Ensuite, sous le rapport de l'intelligence, c'est que la loi exige le témoignage de deux femmes pour un témoignage d'homme et enfin, en matière de succession, c'est qu'elles ne peuvent être traitées d'une façon égale à l'homme qui, en cas d'héritage, touche toujours le double de la femme. Tenez-vous donc sur vos gardes, vous autres, hommes, en vous abstenant des femmes mauvaises et en fuyant aussi les bonnes. "
P. 94-5 : " des créatures douées à peine de la moitié de l'intelligence de l'homme. " Cf. de Castries. L'Islam, p. 6 : " Ma pensée se reportait à ces temples chrétiens, où le plus souvent les femmes seules sont en prière, et l'indignation me venait contre cette irréligion des hommes d'Occident. "
79. — Fitz Gerald n'a, sans doute, pas compris le mot kâfir ni'mat, qui est évidemment le contraire de ni'mat chinas, " reconnaissant ".
80. — Chouchter ou Chouster. Ville du Khoûzistân, ancienne Susiane.
81. — La fontaine de Khizr. La fontaine de Jouvence, qu'Alexandre avait cherché à découvrir sous la conduite de Khizr, personnage qu'on identifie souvent avec le prophète Elie. Khizr y parvint seul ; Alexandre et son armée, assaillis par un terrible ouragan dans la région des ténèbres, durent s'arrêter peu avant d'y atteindre.
82. — Les grenades de Tezd et les pommes d'Ispahan. — Les Persans ne tarissent pas en détails relatifs à l'excellence des pommes d'Ispahan, très parfumées et qui se conservent très longtemps. Ils disent que tous les fruits d'Ispahan sont très beaux, sauf la grenade, précisément parce qu'elle vient mieux dans les terres pauvres. Les grenades de Yezd sont encore fameuses aujourd'hui.
83. — La fidélité féminine. — Un proverbe persan, souvent cité, dit : " Qui a jamais trouvé (vu) fidèle cheval, femme ou glaive ? " Cf. note 77.
84. — Bilqîs. Nom que les musulmans donnent à la reine de Saba qui vint visiter Salomon (Souleïmân). Cf. Audibert, op. laud., pp. 65-67, et mon livre Au Pays du Lion et du Soleil, p. 127.
85. — Le sceau de la royauté. — Salomon avait un sceau dont dépendait son pouvoir. Il commandait aux hommes, aux génies, au vent. (Coran, sour. XXXVIII.)
86. — Quel cadeau il m'apporte... — Jusqu'à notre époque, en Perse, les cadeaux offerts au souverain ont été pour lui une source considérable de profits, et les charges de gouverneurs ont été accordées toujours pour un an, et au plus offrant, ce qui a été la principale cause des souffrances du peuple et de l'état arriéré du pays, les fonctionnaires, du haut en bas de l'échelle, suivant le même procédé, et n'ayant d'autre objectif que de rentrer dans leur débours et de s'enrichir, tout retombant en fin de compte sur le paysan accablé d'impôts.
87. — Maître Firdawsi. — Le lecteur m'excusera de n'avoir pu retrouver, dans les 60.000 distiques du Chah Nâmè, le passage auquel il est fait allusion ici. Je ferai remarquer que le vieux poète, dans sa grandiose épopée, nous a présenté quelques types de femmes admirables, telle la princesse Manîjè. (Cf. Nöldeke, Das Iranische National-epos, § 38.)
88. — Dans un endroit autre que la matrice. — D'après la forme du mythe adoptée par Avicenne, c'était dans une mandragore. Djâmî a écarté de son poème tous les éléments inutiles au but qu'il poursuivait. Cf. p. 57.
89. — Du royaume de la conscience ou " de la connaissance ", moulk-i âgâhî. Je ne trouve pas ailleurs cette expression qui a sans doute le même sens que ‘âlam-i gheïb vu plus haut : " le monde des idées, des choses intelligibles ". (Cf. Platon).
90. — L'immensité du monde etc. — Il y a ici un exemple de laff nachr : les deux termes mardoum, " habitants ", et mardoumak " pupille, prunelle " correspondant respectivement à guîtî " monde " et tchachmi falak "œil du ciel ". Il y a de plus un jeu de mots roulant sur mardoum et mardoumak. (Voir p. 33.)
91. — Salâmat, asmân. — Nous avons ici un des innombrables exemples d'étymologies populaires comme on en trouve tant également dans Firdawsî, qui fait venir, par exemple: Hoûcheng de hoûch "prudence " et ferheng " intelligence ".
92. — Dans les vers 411 et suiv., nous avons un exemple de description détaillée des charmes d'une belle, sujet qui ne manque dans aucun poème et où les auteurs rivalisent d'ingéniosité. On remarquera qu'ici Djâmî, quoique venant après des milliers d'autres, n'est pas tombé dans trop d'extravagance en cherchant l'originalité. Il y a, naturellement, là-dedans, beaucoup de " clichés " et quelques bizarreries compliquées et à peine intelligibles, mais aussi quelques trouvailles gracieuses. Pourtant, Fitz Gerald supprime cette description.
93. — Cent calamités. — Cliché. Le poète veut dire que la luxuriance de sa chevelure aurait pu rendre malheureux des multitudes d'amoureux.
94. — La comparaison avec les caractères gracieux de l'écriture arabe est un des procédés courants de la poésie persane : le nez est comparé à l’élif (une ligne verticale comme le l latin), le sourcil au noûn (demi circonférence avec un point central) ; on fait souvent allusion au dos courbé du wâw ressemblant à une grosse virgule, etc.
95. — Un ivrogne. — Il y a ici une idée que nous ne pouvons rendre en français : un œil langoureux se dit en persan " œil ivre ", tchachm-i mast. La couche de roses, ce sont les bords des paupières, le parasol, ce sont les cils.
96. — Il y a ici un jeu de mots (calembour) sur nîl " indigo, bleu foncé, noir " et Nîl, " le fleuve Nil ".
97. — Le mot khatt, " trait, écriture ", s'emploie aussi pour désigner le duvet naissant qui orne la joue des belles brunettes et des jeunes garçons. Ce mot khatt désigne aussi (cf. Vullers, Lexicon Persico-Latinum s. v. khatt) un cercle protecteur que les enchanteurs tracent autour d'eux ou d'une autre personne. C'est le khatt-i hissâr, " Circulus, quem incantatores circum se vel alium custodiendi causa scribunt. " Remarquer le jeu de mots sur tchachm-i bad « le mauvais œil " et tchachm-i nîkân, « l'œil des bons ". Sur le mauvais œil, cf. Hocéyne Azâd, l'Aube de l'Espérance, (Paris 1909), pp. 264 sqq.
98. — Ce vers n'est que charabia ; il est écrit uniquement pour amener un jeu de mots entre nâf " nombril " et nâfa " vessie de musc ". Les poètes persans font d'innombrables allusions à cette poche à musc. Ex. Hafiz, I, 2. Ce musc est, d'après les Persans, du sang provenant du nombril de la gazelle.
99. — Jeu de mots sur nasrîn " petite rose blanche aux pétales nombreux, espèce d'églantine ", et sarîn " fesse ".
100. — Les bouts de ses doigts. — Pour les bouts des doigts comparés aux noisettes, cf. v. 508.
101. — Nâ-mahram signifie proprement " celui qui n'est point parent à un degré assez proche pour avoir le droit d'entrer dans l'appartement des femmes. "
102. — Un larron... — N'oublions pas qu'Absâl est engagée comme nourrice.
103. — Zemzem. Cf. note 17.
104. — Passage bien obscur. Le texte est : Z’ân nazar tchâk-ach hadâman oûftâd ; littéralement : " à cause de ce regard, une fente tomba (se produisit) dans son pan. " Cette expression : " une jeune fille a le pan fendu " s'emploie chez les nomades de la Perse pour dire qu'elle est fiancée (cf. Vullers, Lex. Pers.-Lat. II, p. 798 b inf.) mais ce sens ne me paraît guère convenir ici. Le poète veut-il dire que de saisissement elle lacéra sa tunique ?
105. — Musc et eau de rose. Euphémisme ingénieux pour désigner la toilette intime du bébé !
106. — De travers... Maintenant encore, les bébés persans sont coiffés de petits bonnets cylindriques placés coquettement de travers. C'est ainsi aussi que les dandys de Téhéran mettent la koulâh d'astrakan noir qui a remplacé le majestueux turban d'autrefois.
107. — Quatorze ans... Les mois persans sont lunaires, et la lune du quatorze veut dire la lune dans son plein, dans tout son éclat.
108. — Allf. Cf. v. 415, note 94. Camphre, cf. v. 255 et note 55.
109. — Ce rubis, c'est la bouche rouge du prince ; les perles, ce sont ses dents.
110. — Le texte a naqd-i djân dar âstîn, littéralement : " l'argent comptant de leur âme (= de leur vie) dans la manche. " (Cf. Vullers, Lex. II, p. 503 b.)
111. — L'art de la calligraphie est resté en honneur en Perse jusqu'aujourd'hui. C'est un talent difficile à acquérir, et ceux qui s'y distinguent arrivent à la gloire tout comme les savants et les poètes. Il y a ici un jeu de mots sur les deux sens de khatt " écriture ", " duvet des joues". Cf. note 97.
112. Pour les musulmans, la philosophie grecque avait dans le domaine de la raison la même autorité que le Coran dans celui de la révélation.
113. — Les musulmans font souvent allusion au souffle de Jésus, qui guérissait les malades et ressuscitait les morts.
114. — Du sucre dans le pan... Allusion à l'usage oriental de jeter des piécettes d'or et d'argent, des sucreries, des amandes, etc. sur les fiancés, sur les pèlerins au retour de la Mecque, etc. (Cf. Barbier de Meynard, Boustan, p. 253.)
115. — Noisettes = doigts. Cf. note 100.