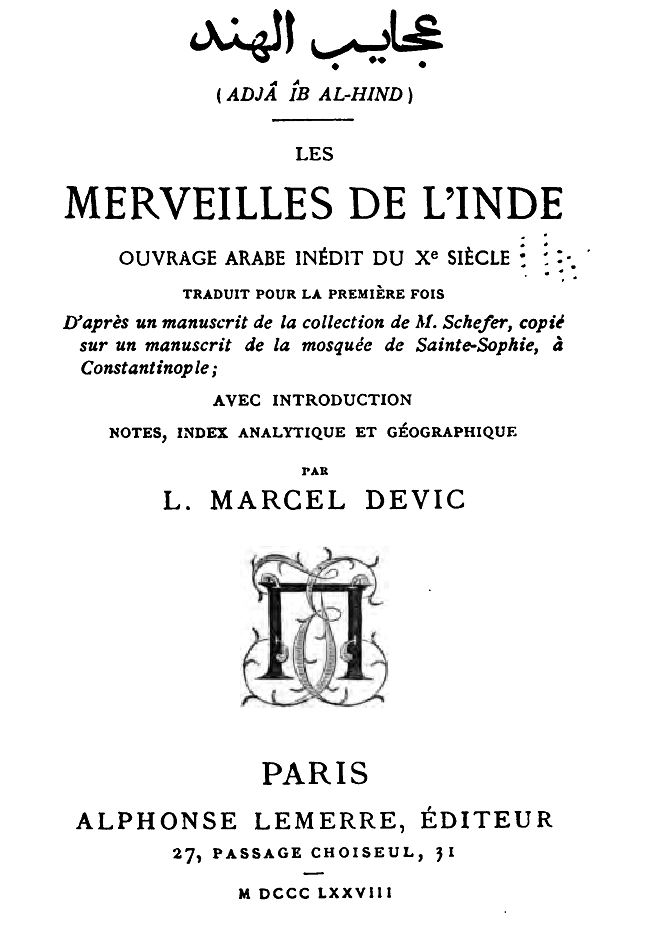
ANONYME
MERVEILLES DE L'INDE : introduction - partie I - partie II
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
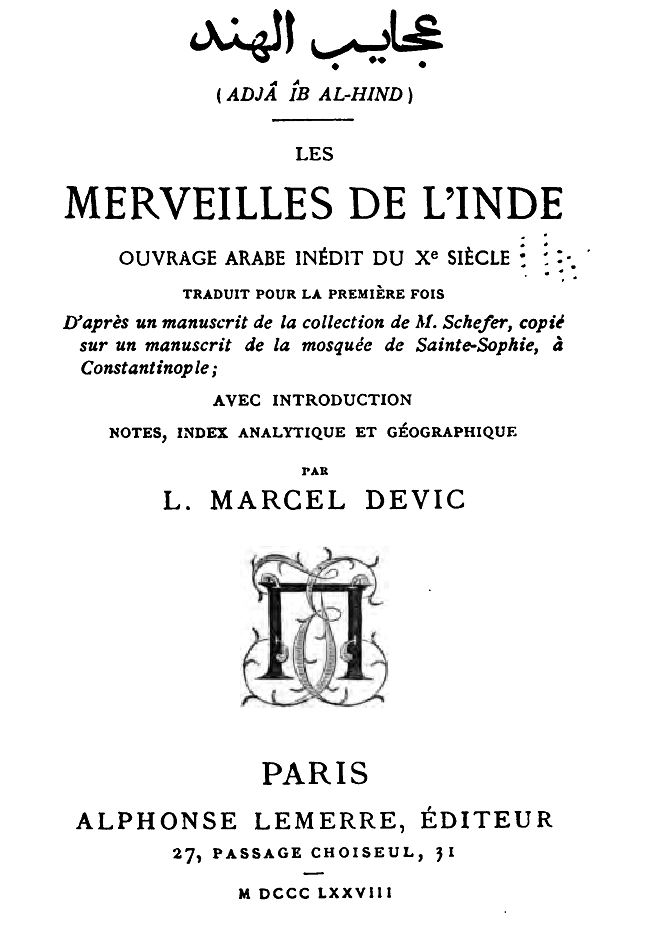
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

LI. Voici un fait bien connu des marins, et je n'ai jamais vu personne qui en contestât l’exactitude.
Un navire allant vers la Chine fit naufrage en pleine mer. Six ou sept personnes échappées à la mort sur des agrès abordèrent au bout de quelques jours sur une île où ils séjournèrent plusieurs mois. Ils y mouraient d'ennui, lorsque, un jour, s'entretenant sur le rivage de la mer, ils virent s'abattre sur le sol un oiseau gros à peu près comme un taureau. « Nous sommes las de l'existence, se dirent-ils. Jetons-nous tous ensemble sur cet oiseau. S'il nous tue avec ses griffes et son bec, ce sera fait de nous; si nous venons à bout de lui, nous regorgerons, nous le ferons cuire et le mangerons. »
Ils vont donc à l’oiseau; les uns se pendent à ses pattes, d'autres à son cou, tandis que les autres le frappent avec des morceaux de bois, et ils font tant qu’ils l'assomment.
Alors frappant deux pierres l’une contre l'autre, ils en fabriquent des couteaux dont ils se servent pour saigner l'oiseau. Puis ils le plument, allument un grand feu, l’y jettent, le retournent de droite et de gauche, jusqu'à ce qu'il soit cuit, s'asseyent à terre et se rassasient de sa chair.
Le soir, ils en mangent encore. Le lendemain matin, étant allés à la mer pour faire leurs ablutions, comme ils se frottaient le corps, voilà que tous leurs poils tombent, si bien qu’il n'en reste pas un sur leur peau, qui devient nette comme celle d'un enfant. Parmi eux étaient trois vieillards qui se trouvèrent pareillement épilés. « C'est la chair de cet oiseau, dirent-ils, qui a fait tomber notre poil. Elle était sans doute empoisonnée. Nous mourrons tous aujourd'hui et verrons la fin de nos peines. » Cependant le soir ils se trouvaient toujours en bonne santé; le lendemain aussi, et les jours suivants. Cinq jours après, leur poil commença à repousser, et, au bout d'un mois, il était entièrement revenu, noir et brillant, ne faisant plus mine de blanchir. Un mois plus tard, ou environ, un navire fut en vue; ils lui firent des signaux, il vint à eux, les recueillit et les sauva. Chacun put regagner son pays et raconter l'aventure. Tel, parmi eux, qu'on avait connu vieillard, revenant avec une barbe noire, était obligé de se faire reconnaître à des marques particulières. Et depuis, leur poil ne blanchit plus.
LII. Un pilote m’a raconté que dans la mer de Samarkand — qui est la mer voisine de Herkend, ainsi nommée, dit-on, parce que le fleuve de Samarkand y a son embouchure, — on voit beaucoup de poissons de l'espèce appelée Fal, qui est le plus grand poisson de l’Océan. Et lui-même en vit un, dont il estima la longueur à deux cents aunes. On l'aperçut de loin, et l’on prit ses nageoires élevées hors de l’eau pour les voiles d'un navire, jusqu'à ce qu'on s'en fût suffisamment rapproché. Il avait sur le dos un amas de pierrailles et de terre, entassées durant la longueur du temps, formant une croûte pétrifiée, si dure que le fer ni rien n'y avait aucune prise. Autour de lui nageaient, à droite, à gauche, devant, derrière, une foule de petits poissons qui ne le quittaient pas. On dit que le mâle et la femelle portent des œufs qui grossissent dans leur ventre; mais ceux du mâle ne produisent rien, et ceux de la femelle donnent naissance aux petits.
LIII. Parmi les merveilles des choses de la mer est un oiseau qu'on trouve dans les parages de Maït, île voisine du Senf et de Sérira.
[88] On dit qu'il se fait un nid à l'entrée de quelque crique, y pond, couve ses œufs quarante jours au bout desquels il les jette à l'eau. Puis il demeure là vingt jours, vivant de poisson. Les vingt jours écoulés, les petits sortent des œufs et viennent rejoindre leurs parents, qui les couvrent de leurs ailes et leur donnent la becquée jusqu'à ce qu'ils aient mis des plumes. Alors les petits vont et viennent, mangent seuls, et les parents les abandonnent. La couvée ne dépasse pas trois petits.Les habitants de cette île Maït disent qu'il n'y aborde point de navire. Le vaisseau qui s'y rend est poussé par un coup de vent terrible; dès qu'il est en face du pays, les passagers se jettent à l'eau sur des morceaux de bois et autres objets capables de les porter; les flots les ballottent et finissent par les pousser au rivage. Quant au navire, les vagues l'emportent, fût-il sur cent ancres; il est jeté sur des bas-fonds et s'y brise. Les ballots de marchandises sont entraînés sur la plage où chacun reprend son bien. Pour s'en retourner, ils refont un navire. Tout ce qu'on transporte dans ce pays est soigneusement enveloppé dans des peaux, afin que l'eau ne puisse l'altérer après le bris du navire.
LIV. Haçan fils d'Omar m'a dit avoir vu à Mansoura des gens du bas Cachemire; leur pays est situé à soixante-dix journées de voyage par terre, de Mansoura. Ils descendent aussi sur le Mihran,
[89] qui coule de Cachemire avec l’abondance du Tigre et de l’Euphrate, au moment de la crue, sur des ballots de costus.[90] Ces ballots pèsent de sept à huit cents mens chacun. Ils sont enveloppés de peaux enduites de goudron, ce qui les rend imperméables à l’eau. De ces ballots réunis et liés ensemble ils forment une sorte de radeau sur lequel ils s'installent eux-mêmes; ils descendent ainsi le Mihran et viennent aborder au port de Mansoura, dans l'espace de quarante jours, sans que le costus ait été atteint par l’eau.LV. Une personne qui a séjourné dans l’Inde m'a dit qu'il y a dans ce pays des charmeurs.
[91] Tel de ces charmeurs va dans la campagne, et voyant des oiseaux au haut des airs, il trace sur la terre un cercle au-dessous d'eux. Les oiseaux continuent à voler au-dessus du cercle, finissent par y tomber et n’en sortent plus. Le charmeur entre dans le cercle et en prend autant qu'il veut, puis met les autres en liberté. De même, apercevant des animaux qui paissent dans la plaine, il les entoure d'une ligne lointaine, tourne autour d'eux, sans qu'aucun puisse s'échapper du cercle, y entre et en prend ce qu'il lui faut.LVI. Quelqu'un qui avait vu des gens de cette espèce à Dadâboura,
[92] m'a dit que tel autre de ces charmeurs va à l'embouchure de la rivière, portant un morceau de bois sur lequel il fait quelque opération magique et qu'il jette ensuite à l'eau. Le bois flotte, s'arrête en un point et ne bouge plus. Le charmeur monte sur un canot, va au point où le bois s'est arrêté, en fait sortir le crocodile et le tue. Cette embouchure de rivière contient en effet beaucoup de crocodiles. On dit que ces animaux n'attaquent jamais les gens dans l'intérieur de la ville; mais un homme qui en sort ne peut mettre le doigt dans l'eau sans être saisi par un d'eux. Les habitants de Sérira prétendent qu'ils ont un talisman contre les crocodiles.LVII. Une personne qui a vu dans l’Inde bien des gens adonnés à la divination, m'a conté qu'un Sirafien voulant partir de Sâmour pour Soubâda
[93] par voie de terre, fit demander au gouverneur un guide pour la route. Le gouverneur lui fournit un de ses bataks ou piétons, avec lequel il partit. Parvenus en vue de Dhimour, ils s'assirent auprès d’un thélah ou étang, dans le voisinage d'un djéram ou jardin, pour manger quelque chose; et parmi ce qu'ils mangèrent, il y avait du riz. Un corbeau vint à coasser. L'Indien dit au Sirafien : « Sais-tu ce que dit le corbeau? — Non, répondit celui-ci. — Il dit : Je mangerai certainement de ce riz que vous mangez. » « Cela me surprit, dit le Sirafien racontant cette histoire, car nous avions achevé le riz et il n'en restait pas un grain. Nous étant levés, nous nous remîmes en route. A peine avions-nous fait deux parasanges que nous rencontrâmes une troupe de cinq Indiens. Le piéton, en les voyant, montra une vive agitation et me dit : « Je vais me battre avec ces gens-là. — Pourquoi? lui demandai-je. — Il y a, dit-il, entre eux et moi une vieille cause d'inimitié. » Il m'avait à peine exprimé son intention, que les Indiens tirèrent leurs khandjars, se jetèrent tous sur lui et le tuèrent. On lui fendit le ventre et ses entrailles sortirent. Pour moi, saisi d'une frayeur qui ne me laissait pas la force de marcher, je tombai presque sans connaissance. « Toi, me dirent-ils, tu n'as rien à craindre. » Et ils me laissèrent là et partirent. Ils venaient de s'éloigner quand un corbeau s'abattit sur le cadavre du piéton, et je ne doutai pas que ce ne fût le même que nous avions déjà entendu. Il se mit à becqueter le riz qui sortait des entrailles de l’homme.LVIII. Parmi les histoires curieuses des marchands, des voyageurs et des personnes qui ont fait fortune sur mer, est celle d’Ishaq, fils du Juif.
[94] C'était un homme qui gagnait sa vie avec les courtiers de commerce à Oman. A la suite d'une altercation avec un Juif, il quitta Oman et s'en alla dans l’Inde. Il ne possédait pour tout bien que deux cents dinars environ. Après une absence de trente ans, pendant laquelle on n’eut de lui aucune nouvelle, il revint à Oman en l’année 300. Je tiens de plusieurs marins de ma connaissance qu'il arrivait de la Chine sur un navire à lui et dont le chargement tout entier lui appartenait. Pour éviter le contrôle des marchandises et le paiement de la dîme, il fit un arrangement avec le gouverneur d’Oman, Ahmed fils de Hélai, moyennant une somme de plus d’un million de dirhems. En une seule fois, il vendit à Ahmed fils de Merwan cent mille mithcals de musc de première qualité, et l’acheteur jugea que c'était tout ce qu'il en avait. Il fit avec le même un marché de quarante mille dinars d'étoffes rayées, puis un autre marché de vingt mille dinars avec une autre personne. Sur la demande d’Ahmed fils de Merwan, Ishaq consentit à une diminution d'un dirhem d'argent par mithcal; et cette remise atteignit cent mille dirhems.Cette prodigieuse fortune fit du bruit dans le pays, et suscita des envieux. Un méchant homme qui n'avait pu obtenir d'Ishaq ce qu'il lui demandait partit pour Bagdad, alla trouver le vizir Ali, fils de Mohammed, fils d'El-Farat, et fit des rapports calomnieux sur le Juif. Le vizir ne l’écouta point. Alors cet homme s'adressa à quelqu'un des familiers du calife Moqtadir Billah, fit le bon apôtre et conta à sa façon l'histoire du Juif. Un homme, disait-il, était parti d'Oman, ne possédant rien ; il était revenu avec un navire chargé de musc pour un million de dinars, d'étoffes de soie et de porcelaines pour une somme égale, de joyaux et de pierreries pour tout autant, sans compter une foule d'objets merveilleux de la Chine. Cet homme, ajoutait-il, était un vieillard sans enfants. Ahmed fils de Hélai avait reçu de lui pour cinq cent mille dinars de marchandises. Tout cela fut rapporté au calife qui trouva la chose fort surprenante, et dépêcha sur-le-champ un de ses eunuques nommé Poivre-Noir, avec trois serviteurs, chargés d'un message pour le gouverneur d'Oman, lui enjoignant de livrer ce Juif à l'eunuque et de lui expédier lui-même un messager. Lorsque l'eunuque fut arrivé à Oman et qu'Ahmed fils de Hélai eut pris connaissance des ordres du calife, il commanda de se saisir du Juif. Mais il fit avertir secrètement les marchands, leur faisant remarquer ce qu'il y avait de menaçant, dans l'arrestation du Juif, pour eux, pour les étrangers ou les habitants qui s'occupaient de négoce, livrés ainsi à l'envie, à la médisance des misérables et des méchants. Là-dessus, les marchés se fermèrent. Des papiers furent signés par les gens de la ville et les étrangers, attestant qu'après l'arrestation du Juif les navires n'aborderaient plus à Oman, que les marchands s'en iraient, qu'ils se donneraient avis les uns aux autres de n'aborder jamais aux rivages de l'Irak, où nul n'était plus en sécurité pour ses biens. On ajoutait qu'Oman était une ville où se trouvaient beaucoup de gros et riches marchands, de tout pays; qu'ils n'avaient d'autre garantie de sécurité que la durée de la justice du calife et de son émir, sa considération pour les marchands et sa protection contre les envieux et les méchants.
Les marchands firent du bruit dans la ville, crièrent contre Ahmed, fils de Hélal, et se mutinèrent ; si bien que l'eunuque Poivre Noir et ses acolytes se disposèrent à repartir et prirent congé du gouverneur.
Ahmed écrivit au calife, faisant le récit des événements, comme quoi les marchands mettaient à quai leurs navires, et rechargeaient leurs marchandises pour les remporter ; comme quoi les commerçants domiciliés dans la ville étaient dans le plus grand trouble et disaient : « Nous allons être privés de tout moyen d'existence, quand les navires n'aborderont plus ici; car Oman est une ville dont les habitants tirent tout de la mer. Les sultans sont un feu qui dévore tout ce qu'il atteint. Nous ne pouvons y résister, et mieux vaut pour nous sortir de devant eux. »
L'eunuque et ses hommes soutirèrent deux mille dinars au Juif et s’en retournèrent. Le Juif indigné se hâta de rassembler tout ce qu'il possédait, fréta un navire et repartit pour la Chine sans laisser un dirhem à Oman. A Sérira, le gouverneur lui demanda une aubaine de vingt mille dinars comme droit de passage, pour lui laisser poursuivre son voyage vers la Chine. Le Juif ne voulut rien donner. Le sahib dépêcha secrètement contre lui des affidés qui le tuèrent. Puis il s'empara de son navire et de ses biens.
Ishaq était demeuré trois ans à Oman. Des personnes qui l'y ont vu m'ont dit que le jour du Mihrdjan
[95] il fit cadeau à Ahmed fils de Hélai d'un vase de Chine noir, fermé d'un couvercle d'or. « Qu'y a-t-il dans ce vase ? demanda Ahmed. — Un plat de Sekbâdj[96] que j'ai préparé pour toi en Chine, dit le Juif. — Du sekbadj cuit en Chine ! Et voilà deux ans de cela ! Il doit être dans un bel état. » Ahmed ôtant le couvercle ouvrit le vase; et voici qu’il y trouva un poisson d'or aux yeux de rubis, entouré de musc de première qualité. Le contenu du vase valait cinquante mille dinars.LIX. Parmi les particularités que le Juif racontait de la Chine, je rapporterai la suivante.
« Je suis allé, disait-il, dans une ville de ce pays, nommée Laouïn.
[97] Pour s'y rendre, il faut franchir des montagnes escarpées; le transport des marchandises se fait à dos de chèvre, car le chemin sur ces hauteurs abruptes ressemble à une série d'escaliers que ces animaux seuls sont en état de monter. Le roi de cette ville était un prince puissant et respecté. Lorsque je me présentai devant lui, il était assis sur un trône d'or, incrusté de rubis, chargé lui-même de bijoux comme une femme. La reine était à ses côtés, encore plus richement parée. Il avait au cou des colliers d'or et d'émeraudes d'un prix inestimable, tels que les rois des rois de l’Orient et de l'Occident n'en possèdent pas de pareils. Près de lui se tenaient environ cinq cents jeunes filles de toutes couleurs, portant des vêtements de soie et des parures. Il me salua : « O Arabe, dit-il, as-tu vu quelque objet plus beau que ceci ? » Il montrait un de ces colliers orné d'incrustations. « Oui, répondis-je. — Comment cela? — J'ai, repris-je, une perle unique que j'ai achetée à grand prix pour t'en faire hommage. — Va vite, dit-il, et me l'apporte. — Je ne suis venu dans cette ville que pour cela, repris-je, et ce soir je. . . . — Non, non, fit-il d'un ton joyeux et satisfait. Tout de suite 1 tout de suite ! » Or, j'en avais dix. Je courus à mon logement ; j'en pris neuf que j'écrasai avec une pierre jusqu'à ce qu'elles fussent réduites en poudre comme de la farine, et j'éparpillai cette poudre à terre. J'enveloppai l'autre dans un foulard, que je doublai plusieurs fois tout autour, et l'ayant noué soigneusement je retournai près du roi. Là je me mis à dénouer et à déplier lentement le foulard ; et le prince s'était approché, et la reine debout me pressait de me hâter. Enfin je mis la perle sous leurs yeux. Le roi s'agenouilla devant elle et la reine en fit autant. Et ils me la payèrent un prix très élevé. »LX. De l'avis commun des marins, la mer de Bérira,
[98] qui a une étendue de sept cents parasanges et se trouve sur la route du pays des Zindjs, est une des mers les plus dangereuses. Il y a d'un seul côté de grandes îles; et l’eau, dit-on, y coule avec un courant très fort. Les vaisseaux la traversent en sept ou huit jours. Lorsqu'un navire tombe dans les parages de Bérira, les noirs émasculent les gens du navire. Lorsque les marchands se rendent à Bérira, chacun d'eux a, suivant ses moyens et sa position, une escorte pour le protéger, de peur qu'un indigène le saisisse et l'émascule. Ces nègres font collection de ce qu'ils enlèvent ainsi aux étrangers. Ils le conservent, et en font parade pour exciter l'envie; car chez eux on connaît la bravoure d'un homme au nombre des étrangers qu'il a ainsi traités.LXI. Parmi les mers difficiles, mauvaises, où la navigation est pénible, et d'où l'on se tire malaisément, est la mer des gobbs de Sérendib qui est longue de trois cents parasanges. Les crocodiles y abondent.
[99] Les rivages sont hantés par les tigres. De grands bateaux y croisent, attaquent les navires, et mangent les gens dont ils s'emparent. Les naturels de ces parages sont les plus méchants des hommes : nulle part on n'en voit de pareils. Triste pays ! Si le navire qui traverse ces mers est saisi par les pirates, les hommes sont pris et mangés; s'il sombre, les crocodiles dévorent les naufragés; s’il fait naufrage proche de terre et que les malheureux atteignent au rivage, ils sont la proie des tigres qui les mettent en pièces en un instant.LXII. En fait de coutumes singulières répandues dans l'Inde, Haçan fils d'Amr m'a appris qu'il avait entendu un cheikh fort instruit, qui avait voyagé dans ce pays, raconter l'histoire suivante.
Un des grands rois de l'Inde était assis, prenant son repas. En face de lui un perroquet se tenait dans sa cage. Le roi lui dit : « Viens manger avec moi. — J'ai peur des chats, répond l'oiseau. — Je serai ton balâoudjer, reprend le roi, c'est-à-dire, en langue indienne, je m'engage à subir le pareil de tout ce qui peut t'arriver. » Et voici comment le vieillard expliquait le sens de cette expression. Les rois de l'Inde ont auprès de leur personne une troupe d'hommes plus ou moins nombreuse suivant leur magnificence et l'éclat de leur pouvoir. Ces hommes disent au roi : « Nous sommes tes balâoudjers. » Il leur fait manger le riz avec lui et leur donne le bétel de sa propre main; chacun d'eux se coupe le petit doigt, qu'il place devant le prince. A partir de ce moment, ils le suivent partout où il va, mangent de ce qu'il mange, boivent de ce qu’il boit. Ils veillent à sa nourriture et prennent soin de tout ce qui le regarde. On n'introduit auprès lui aucune maîtresse, ni fille ni garçon y qu'ils ne l'aient examiné; on n'étend pour le prince aucun tapis qu'ils n'en aient fait l'inspection. Aucune boisson, aucun mets ne lui est servi, qu'ils ne l'aient fait goûter par celui qui l'apporte. Et de même pour toute chose qui peut offrir quelque danger pour le roi. S'il meurt, tous se tuent; s'il se brûle, ils se brûlent; s'il est malade, ils se maltraitent pour souffrir comme lui. Au combat, à l'attaque, ils tournent autour de lui et ne le quittent pas. On n'admet parmi les balâoudjers que des hommes de familles distinguées, beaux, braves et intelligents. Telle est l'explication du mot balâoudjer.
[100]Lors donc que le roi eût dit au perroquet : « Je suis ton balâoudjer, » il mangea un peu de riz de l'oiseau. Et aussitôt celui-ci descendit de sa cage et vint se mettre à table avec le roi. Un chat survint, qui lui trancha la tête. Le roi prit le corps du perroquet, le déposa dans un vase de porcelaine, avec du camphre, des aromates, du bétel, de la chaux et du poivre. Puis il frappa le tambour, et se mit à parcourir la ville et les rangs de l’armée portant ce vase à la main. Depuis lors, chaque jour il continua ce manège, courant le pays avec le vase. Cela dura des années. Enfin les balâoudjers et autres personnages importants du royaume vinrent à lui et lui dirent : « Ta conduite n'est pas convenable, et la chose a duré assez longtemps. Fais ton devoir, sinon nous aviserons à te déposer et à prendre un autre roi. » En effet, quiconque a dit : « Je suis ton balâoudjer » et ne remplit pas les obligations que cela lui impose, devient chez les Hindous bahinda ou ahinda, qui est le nom qu'on donne aux personnes incapables, par faiblesse, impuissance ou bassesse, de remplir leurs obligations. Les rois, pas plus que les autres hommes, n'échappent à cette règle.
Quand le roi vit cela, il creusa une fosse, la remplit de bois d'aloès, de sandal, de salît,
[101] y mit le feu et s'y jeta. Il fut brûlé, et ses balâoudjers s'y jetèrent avec lui et furent pareillement brûlés, au nombre d'environ deux mille. Et tout cela, parce que le roi avait dit à son perroquet : « Je serai ton balâoudjer. »LXIII. Le même m'a conté qu'à Sérendib, les rois et ceux qui les accompagnent se font porter dans le handoul, qui est semblable à une litière, soutenu sur les épaules de quelques piétons. Un serviteur porte à ses côtés un plat d'or contenant des feuilles de bétel et ce dont il a besoin ; accompagné de ses gens, il va en cet équipage partout où il a affaire, mâchant le bétel et crachant dans le crachoir. Lorsqu'il lui prend envie d'uriner, il sort du handoul et pisse dans le chemin, dans la rue, là où il se trouve, toujours marchant, sans s’arrêter ; et après avoir pissé, il rentre son affaire sans l’essuyer.
[102]LXIV. Le même m'a conté encore qu'il avait vu à Sendan
[103] un Hindou passant près d'une maison recevoir sur le corps et sur les vêtements de l'urine qu'on jetait. « Eh ! cria-t-il en s'arrêtant. Est-ce de l'eau qui ait servi à laver les mains ou à rincer la bouche? » Et c'est là pour eux ce qu'il y a de plus sale. On lui répondit : « C'est l'urine d'un enfant qui vient de pisser. — « Kanna », dit-il, c'est-à-dire « fort bien ! » et il continua sa route. Car, pour ces gens-là, l'urine est plus propre que l'eau dont on s'est lavé les mains ou la bouche.LXV. Lorsqu'un habitant de ce pays a satisfait un besoin naturel sérieux, il descend, pour se nettoyer, dans le thaladj, qui est un étang rempli de l'eau qui coule des montagnes et de la plaine en temps de pluie. Son opération terminée, il prend une gorgée de cette eau, qu'il gargouille dans sa bouche, sort de l'étang, et y rejette la gorgée d'eau.
[104]LXVI. Le même Haçan m'a dit, d'après quelqu'un qui était entré à Sérendib et y avait séjourné, que le roi a sur le rivage un bureau d'inspection où l'on frappe les marchandises d'un impôt.
LXVII. Un marin m'a rapporté sur les serpents de Koulam-Méli
[105] des choses vraiment extraordinaires. Il y en a un, nommé le naghéran, qui porte sur la tête une aigrette verte en forme de croix. Ce reptile lève la tête à une aune ou deux du sol, suivant sa taille ; il la gonfle sous ses écailles, jusqu'à lui donner la grosseur de la tête d'un chien. Quand il fuit, on ne peut l'atteindre; lorsqu'il poursuit, rien ne lui échappe. S'il pique, il tue. Il y a à Koulam-Méli un musulman, un saint homme nommé en indien Bensi, qui guérit de la piqûre de ce serpent. Presque tous ceux qu'il soigne en réchappent. Il traite aussi la piqûre d'autres serpents ou vipères. Du reste les enchanteurs ne manquent pas chez les Indiens; mais les enchantements de ce musulman réussissent toujours.« Un jour, me dit ce marin, j'étais avec lui quand on lui amena un homme qui avait été piqué par le naghéran. Il y avait là un Indien renommé pour son savoir magique, qui se mit à faire des charmes pour la guérison du blessé. Et le musulman en fit de son côté pour que l’homme mourût ; et il mourut. »
LXVIII. Dans d'autres circonstances, j'ai vu le musulman guérir plus d'une personne piquée par ce serpent ou tout autre. Il y en a une espèce à Koulam-Méli, qui est petite, qui a deux têtes, l'une bien moins grosse que l'autre. On le nomme batar. Lorsqu'il ouvre la petite bouche, on dirait le bec d'un passereau. S'il pique avec l'une quelconque des deux, c'est l'affaire d'un clin d'œil.
LXIX. Mohammed fils de Bâlichâd m'a dit : « J'ai vu dans un gobb de Sérendib de singulières choses quant aux serpents et aux charmeurs. Lorsqu'un homme est piqué par une vipère ou un serpent, les charmeurs font leur opération sur lui. Si elle ne donne pas de bons résultats, ils placent le malade sur un lit de branchages et l'abandonnent au courant de l'eau dans un fleuve de leur pays qui coule vers la mer, et le long duquel sont établies leurs demeures ou du moins celles de la plupart d'entre eux. Comme chacun sait qu'on ne met sur ce lit de branchages qu'une personne piquée, tout homme versé dans l'art des enchantements retire le lit et fait sur l'homme ses opérations magiques. Si la chose réussit, l'homme se lève et s'en retourne chez lui sur ses jambes. Si elle ne réussit pas, le lit et l’homme sont de nouveau abandonnés au courant. La même cérémonie se répète tout le long du fleuve, jusqu'au bout du pays. Si les enchantements ont été inutiles, le courant emporte le malade jusqu’à la mer, où il se noie, à moins qu'il n'ait pu se relever auparavant. Car il n'est pas d'usage qu'on le laisse à terre, ni que sa famille le prenne pour le soigner. S'il se tire d'affaire, il s'en retourne sur ses jambes; si les enchantements ne lui profitent pas, il disparaît. »
LXX. Mohammed fils de Bâlichâd m'a dit encore : « Je passais un jour près d'un des fleuves des Gobbs qui coulent vers la mer, et dans lesquels le flux et le reflux se font sentir avec une grande force. Le niveau était presque au plus bas et les deux plages restaient à découvert. J'aperçus au ras de l'eau, assise sur le sable, une vieille femme couverte de vêtements très propres. « Que fais-tu là? lui dis-je. — Je suis, répondit-elle, une vieille femme fort âgée. Voilà longtemps que je vis ; j'ai mangé ma part de ce monde, et j'ai besoin de me rapprocher de mon créateur. — Et pourquoi t'asseoir en ce lieu ? — J'attends, dit-elle, que l'eau revienne et m'emporte. » Elle demeura en effet assise au même endroit, jusqu'au retour de la marée qui la saisit et la noya.
LXXI. Un voyageur m'a conté qu'il avait vu dans l'Inde une série de gens venir à l'eau dans l'intention de se noyer.
[106] Ils payaient quelqu'un pour les noyer, de peur que la crainte, le trouble les empêchât d'accomplir eux-mêmes leur suicide. Chacun d'eux donne donc un salaire à une personne qui lui pose la main sur la tête et le maintient sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit mort. Qu'il crie et demande grâce, la personne n'a garde de céder.LXXII. Un voyageur qui a pénétré dans les pays de Sahal, m'a dit qu'il avait vu dans l'île de Baqar, située entre l'île de Sérendib et Mandourin,
[107] qui est une des îles des parages de Séhilan (Ceylan), une énorme idole des Indiens, qui disent que cette idole de l'île de Baqar demeure mille ans dans chacune de ces îles et passe ensuite dans une autre.LXXIII. « A Serira, m'a dit Mohammed fils de Bâlichâd, j'ai vu une femme qui portait une bête à figure humaine, sauf que le visage était noir comme celui des Zindjs, et que les pieds et les mains étaient plus longs que ceux de l’homme. Cet animal avait une longue queue et du poil comme les singes. Il était assis sur les genoux de la femme et se tenait serré contre elle. Je lui demandai : « Qu'est-ce que cela ? » Elle me dit : « Un animal des fourrés et des arbres. » Il poussait de petits cris inintelligibles. Bien qu'il fût voisin du singe, sa figure et sa conformation étaient celles d'un homme. »
LXXIV. Le même m'a appris que, dans l'île de Lâmeri,
[108] il y a des girafes d'une grandeur indescriptible. On rapporte que des naufragés, forcés d'aller des parages de Fansour vers Lâmeri, s'abstenaient de marcher la nuit par crainte des girafes. Car ces bêtes ne se montraient pas le jour. A l'approche de la nuit, ils se réfugiaient sur un grand arbre; et, la nuit venue, ils les entendaient rôder autour d'eux; et le jour ils reconnaissaient les traces de leur passage sur le sable.Il y a aussi dans ces îles une multitude effroyable de fourmis, particulièrement dans l'île de Lâmeri où elles sont énormes.
LXXV. Le même m'a conté qu'il avait entendu dire par un marin qu'à Louloubilenk, qui est une baie de la mer, il y a un peuple mangeur d'hommes. Ces anthropophages ont des queues. Ils demeurent entre la terre de Fansour et la terre de Lâmeri.
Dans l’île d’El-Neyân,
[109] qui est une île de la mer Extérieure, à deux cents parasanges de Fansour, il y a aussi des anthropophages.[110] Ils font collection de crânes et se font gloire du nombre qu'ils en ont pu rassembler. Ils achètent des lingots de cuivre jaune à un prix très élevé, parce que ce métal, dans leur pays, se conserve et dure comme l’or chez nous, tandis que l'or, chez eux, n’a pas plus de durée que le cuivre dans nos pays. Béni soit Dieu le meilleur des créateurs !Au-delà de l'île d'El-Neyân, on trouve trois îles nommées Béraoua dont les habitants sont aussi mangeurs d'hommes ; ils gardent les crânes et les emploient à divers usages.
Tous les peuples qui habitent Fansour, Lâmeri, Kala, Qaqala, Daïfar et autres terres sont anthropophages; mais ils ne mangent que leurs ennemis, par esprit de vengeance et non par besoin de manger. Ils coupent la chair humaine en lanières qu'ils font sécher et préparent de diverses manières.
LXXVI. Le même m’a dit que les insulaires des îles Ladjialous,
[111] groupe nombreux qui s'étend sur une longueur de quatre-vingts parasanges, rejoignent les navires et y font des achats de la main à la main. Si on leur lâche un objet avant de tenir l'échange, ils se sauvent et on ne peut ravoir l'objet.Lorsqu'un navire fait naufrage sur leurs côtes, et qu'un homme ou une femme tombe sur leur rivage, si le naufragé a sauvé quelque chose et qu'il le tienne à la main, ils ne lui prennent rien, car ils n'enlèvent jamais un objet de la main d'une personne tombée chez eux. Ils accueillent l'étranger dans leur logis, le font asseoir, lui donnent à manger de ce qu'ils mangent, et ne mangent eux-mêmes qu'après que leur hôte est rassasié. Ils continuent à le traiter ainsi jusqu'à l'arrivée d'un navire. Alors ils conduisent l'étranger à bord, réclament un salaire et prennent ce qu’on leur donne. Parfois celui que le sort a ainsi jeté chez eux trouve moyen de leur rendre service et avec des bagatelles leur achète de l'ambre (gris) dont il fait provision jusqu'au moment du passage d'un navire. De cette façon, son séjour chez eux lui apporte quelque profit.
LXXVII. Un voyageur qui a pénétré dans les pays de l’Inde m'a conté que, d'après ce qu'il avait ouï dire, les diamants les plus purs, les plus beaux, les plus précieux, se tirent des régions du Cachemire.
[112] Il y a là une gorge entre deux montagnes où brûle constamment un feu qui ne s'éteint ni nuit, ni jour, ni été, ni hiver. Là sont les diamants. Seuls, des Indiens de basse condition «e hasardent dans ces pays dangereux. Réunis en troupe, ils gagnent les abords de la gorge. Ils tuent des brebis maigres et les débitent en morceaux qu'ils jettent dans la gorge au moyen d'une machine de leur fabrication; car maintes raisons leur rendent l’accès de la gorge impossible. C'est d'abord ce feu toujours brûlant; et de plus une multitude indescriptible de vipères et de serpents, telle qu'aucun être vivant n'y peut passer sans périr.Quand ils ont jeté cette viande, voilà que les aigles en grand nombre s'abattent sur cette proie, la saisissent, si elle tombe à distance du feu et l'emportent. Ils suivent l'aigle dans son vol. Parfois quelque diamant tombe du morceau de viande enlevé. Et quand l'aigle s'est abattu en quelque endroit pour la manger, ils y vont et trouvent les diamants. Si la viande tombe dans le feu, elle se brûle; l'aigle qui veut saisir un morceau trop près du feu se brûle pareillement. Quelquefois aussi, par hasard, l'aigle saisit la viande à la volée, avant qu'elle atteigne le sol.
Et voilà comment se prennent les diamants. La plupart des gens qui s'occupent à les chercher périssent par le feu, les vipères ou les serpents. Les rois de ces contrées sont fort amateurs de diamants et recherchent des gens pour ce métier. Ils mettent beaucoup d’ardeur à s'en procurer, à cause du vif éclat de ces gemmes et de leur prix élevé.
LXXVIII. Beloudji m'a fait ce récit. « J'étais, dit-il, à El-Tîr,
[113] où nous étions tombés à un mauvais moment. Laissant le navire et le chargement, nous restions à attendre le temps propice au départ. Un jour nous vîmes venir une femme d'une taille et d'une beauté parfaites avec un vieillard à tête chauve, à barbe blanche, maigre et chétif. « Au nom de Dieu, dit-elle, retenez ce vieillard, qui ne me laisse pas un instant de repos. » Nous lui tînmes compagnie quelque temps, ne cessant de recommander au vieillard de se contenter de satisfaire sa passion deux fois par jour et autant par nuit. Quelques jours après, ils repassèrent, et la femme se plaignit comme la première fois. « Brave homme, dîmes-nous au vieillard, tu es un personnage de rare espèce. » Il nous conta alors son aventure.« J'étais, dit-il, en telle année sur tel navire. Nous fîmes naufrage. Échappé à la mort avec quelques autres sur des débris du bâtiment, nous abordâmes à une île où nous restâmes plusieurs jours sans rien à manger. Nous mourions d'inanition quand un poisson mort rejeté par les flots échoua sur la plage. Mes compagnons n'y voulurent pas toucher, de peur qu'il eût péri par l'effet de quelque poison. Pour moi, la faim me poussa à en manger. « Si je meurs, disais-je, me voilà délivré de ma misérable situation. Si je vis, je me serai rassasié encore une fois. » Je pris donc le poisson, et, malgré les conseils de mes compagnons, je me mis à le manger tout cru. A peine sa chair était descendue dans mon estomac, que je sentis comme un feu s'allumer dans mon épine dorsale, et le familier de mes reins se dressa comme une colonne, s'enfla d'une ardeur libidineuse et ne me laissa point de repos. Tel est mon état depuis ce jour-là. » Or il s'était écoulé des années depuis qu'il avait mangé de ce poisson.
LXXIX. Un voyageur m'a raconté qu'un roi de la Chine l'introduisit dans un jardin à Khanfou. « Ce jardin, dit-il, avait vingt djéribas d'étendue. J'y vis des narcisses, des anémones, des roses et mille espèces de fleurs. Je fus émerveillé de trouver réunies en un seul jardin, en un même moment, toutes les fleurs de la saison. « Comment trouves-tu cela? me dit-il. — Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli, d'aussi charmant, répondis-je.— Tout ce que tu vois, arbres et fleurs, reprit-il, est un ouvrage de soie. » Et je reconnus en effet que ces roses et ces fleurs étaient faites en soie de Chine, tissée, tressée, brodée, travaillée de toute façon; mais si bien qu'à simple vue on ne peut douter que ce soient des arbres et des fleurs.
LXXX. A Andaman-la-Grande est un temple d'or qui renferme un tombeau, objet de vénération pour les habitants; c'est leur grand respect pour ce tombeau qui les a portés à élever au-dessus ce temple d'or. Les habitants des deux îles y viennent en pèlerinage, et ils disent que c’est le tombeau de Salomon fils de David, — que Dieu les bénisse l'un et l'autre ! Ils ajoutent que ce monarque avait prié Dieu de placer son tombeau en un lieu où les hommes de ce temps-là ne pussent aller, et que Dieu, exauçant sa prière, l'avait mis dans leur île. En effet, personne jusqu'ici n'avait abordé à Andaman; personne du moins n'en était revenu. Mais un compagnon qui a fait le voyage des pays de l'or, m'a dit avoir vu à Safir un homme qui disait avoir pris terre à Andaman avec l'équipage d'un navire. Tous furent mangés; lui seul échappa; et c'est par lui qu'on a su ce que nous rapportons.
[114]LXXXI. Bien des marins m'ont parlé de la fameuse perle connue sous le nom de yétima (orpheline), parce qu'elle n'a pas sa pareille au monde. Voici les détails qu'on m'a contés sur son histoire. Il y avait à Oman un homme nommé Mouslim fils de Bêcher. C'était un personnage pieux et de bonne conduite. Il faisait le métier d'équiper des plongeurs pour la pèche des perles. Il possédait quelque fortune; mais ses affaires avec les plongeurs réussirent si peu qu'il dissipa tout son bien et resta un beau jour sans ressources, sans vivres, sans vêtements, sans un objet dont il pût faire argent, sauf un bracelet de cent dinars qu'avait sa femme. « Donne-le moi, dit-il à la femme, pour que j'en emploie la valeur à équiper une nouvelle troupe de plongeurs; peut-être Dieu nous favorisera-t-il de quelque heureuse rencontre. — Allons donc ! dit la femme. Il ne nous reste plus rien pour vivre, nous sommes réduits à la mendicité. Vivons du moins avec le prix de ce bracelet, plutôt que de le perdre dans la mer. »
Mais le mari sut l'amadouer et emporta le bracelet qu'il vendit. Tout l'argent en fut employé à équiper des plongeurs, avec lesquels il s'en alla aux pêcheries. Il avait été convenu que la pêche durerait deux mois, pas davantage. Les hommes, pendant cinquante-neuf jours, plongèrent, tirant des huîtres et les ouvrant, sans rien trouver. Le soixantième jour, ils plongèrent au nom d'Eblis (Satan), — que Dieu maudisse ! — et cette fois ramenèrent une huître qui contenait une perle de grande valeur; peut-être valait-elle tout ce qu'avait possédé Mouslim depuis sa naissance jusqu'à ce jour. « Voilà, lui dirent les pécheurs, ce que nous avons trouvé au nom d'Eblis. » Mouslim prit la perle, la réduisit en poudre et la jeta à la mer. « Eh quoi ! dirent les plongeurs, est-ce ainsi que tu fais? Tu n'as plus rien, tu es réduit au dernier dénuement; il t'échoit une si magnifique perle, qui peut-être valait des milliers de dinars, et tu la mets en poussière ! — Gloire à Dieu ! répliqua-t-il. Me serait-il licite de tirer profit d'un bien obtenu au nom d'Eblis? Dieu ne saurait le bénir. C'est pour m'éprouver qu'il a fait tomber cette perle entre mes mains. Si je l'avais gardée, vous auriez tous suivi l'exemple, en ne plongeant qu'au nom d'Eblis, péché dont le plus grand profit ne peut compenser la gravité. Par le Dieu unique ! quand même j'aurais là toutes les perles de la mer, je n'en voudrais point à ce prix. Allez, plongez encore et dites : Au nom de Dieu et sous sa bénédiction ! »
Les pêcheurs plongèrent donc suivant ses ordres; et la prière du coucher du soleil de ce jour-là, qui était le dernier des soixante, n'était pas faite, qu'ils mirent la main sur deux perles, dont l’une était la yétima et l’autre d'une valeur beaucoup moindre. Mouslim les porta l'une et l'autre au calife Rachid, lui vendit la yétima soixante-dix mille dirhems et la petite trente mille, et retourna à Oman avec cent mille dirhems. Il s'y bâtit une grande maison, acheta des esclaves, acquit des biens-fonds. Sa maison est bien connue à Oman. Et voilà l'histoire de la perle yétima.
LXXXII. Younis fils de Mehran, de Siraf, le marchand, qui a été au Zabedj, m'a dit : « Dans la ville où réside Mahradj,
[115] roi du Zabedj, j'ai vu une quantité innombrable de rues marchandes. Dans celle des Changeurs, j'ai compté jusqu'à huit cents changeurs, outre ceux qui sont établis çà et là dans les autres rues. » Il ajoutait bien d'autres choses sur cette île, ses édifices, la multitude incroyable de ses villes et de ses villages.LXXXIII. Un de nos compagnons m'a conté cette agréable histoire.
« J'étais, dit-il, à bord d'un navire qui s'en allait d'El-Ayla à Biârah,
[116] quand le vent devint si fort et la mer si grosse que nous dépouillâmes nos vêtements et nous nous crûmes perdus. Il y avait avec nous dans le navire une femme qui tenait un petit enfant.Elle était jusqu'alors demeurée fort tranquille. Mais quand l’affaire prit pour nous une tournure sérieuse, au lieu de se troubler, elle se mit en riant à faire danser le marmot. Ce n'était pas pour nous le moment de l'interroger, alors que nous désespérions de sauver notre vie. Mais une fois parvenus dans le chott, à l’abri du danger : « Femme, lui dis-je, qu'est-ce donc qui te poussait, dans le péril mortel où nous étions, à rire en faisant danser l'enfant? Ne craignais-tu pas comme nous la noyade ? — Si vous entendiez mon histoire, répliqua-t-elle, vous seriez surpris et vous comprendriez comment j'étais si tranquille et si peu effrayée de la tempête. — Conte-nous cela, dîmes-nous. — Je suis, dit-elle, d’El-Ayla. Mon père avait un ami parmi les matelots des navires qui font la traversée d'Oman à Basra et de Basra à Oman. Quand son navire venait d'Oman et faisait escale dans notre ville, cet ami descendait chez nous, nous offrait de petits cadeaux et restait jusqu'au départ; et nous lui faisions nous-mêmes des présents suivant nos facultés. C'était un homme de bien. Mon père me donna à lui en mariage. Mon père étant mort au bout de trois ans, mon époux me dit : « Viens que je t'emmène à Oman, où j'ai ma mère et ma famille. » Je le suivis à Oman et y demeurai avec les siens l'espace de quatre ans, lui continuant toujours ses voyages d’allée et venue entre Oman et Basra. Puis il mourut à Oman, cinq mois après la naissance de cet enfant. Quand j'eus passé le terme légal, je m'ennuyai à Oman où je n'étais demeurée qu'à cause de mon mari; et je dis à sa mère et aux siens : « Je veux retourner à El-Ayla, dans ma famille. — Si tu veux rester chez nous, dirent-ils, nous partagerons avec toi; nous n'avons pas d'autre enfant que le tien. » Ils me pressèrent de demeurer, mais je n'y consentis pas. Au moment de partir, j'achetai pour l'enfant un lit solide en bambou, dans lequel je mis des vêtements à lui et à moi, avec diverses provisions, tout cela recouvert, bien arrangé, et l'enfant par dessus.
« Je m'embarquai sur un navire qui allait à Basra. Durant le trajet, une tempête nous assaillit, le navire fut mis en pièces dans l’obscurité de la nuit, les passagers et les matelots dispersés sur les flots ; on ne pouvait se voir les uns les autres. Pour moi, attachée à une planche, je m'y maintins jusqu'au milieu du jour suivant. Un navire qui passait nous aperçut. Le patron recueillit à la surface de la mer une dizaine de naufragés, et moi dans le nombre. Une fois à bord, on nous mit la tête en bas pour nous faire rendre l'eau que nous avions bue, on nous donna une potion, enfin nous fûmes soignés jusqu'au lendemain où nous reprîmes nos esprits. J'avais été si secouée dans cette affaire que le souvenir de mon enfant m'était sorti du cœur, lorsque j'entendis le patron disant : « Voyez si cette femme a du lait, sans quoi l'enfant que nous avons trouvé ne tardera pas à mourir. » Les hommes vinrent à moi et me demandèrent : « As-tu du lait? » Alors je me souvins de mon nourrisson et je répondis : « Oui, j'avais du lait; mais après ce que j'ai éprouvé, je ne sais s'il m'en reste encore. — Vois cet enfant, avant qu'il meure, dirent-ils. Et ils m'apportèrent le berceau avec l'enfant dedans, le tout tel que je l'avais laissé, sans que rien y manquât. A cette vue, je poussai un cri, je tombai la face contre terre et je m'évanouis. On me jeta de l'eau sur le corps, en disant : « Qu'as-tu? » Revenue à moi, je me mis à pleurer en prenant l'enfant sur mon cœur. « Qu'as-tu donc, femme? répétèrent les assistants. — Cet enfant, dis-je, est mon fils. » Le patron s'approcha et me dit : « Cet enfant est à toi? Eh bien ! qu'a-t-il sous lui, dans le berceau ?» Je me mis à leur énumérer pièce à pièce ce qui faisait la couche de l'enfant, et ils sortaient chaque chose l'une après l'autre, tout se trouvant comme si je venais de le placer à l'instant même. Les assistants pleuraient et louaient Dieu et lui rendaient grâces. Après avoir été ainsi submergée dans ces flots, séparée de mon fils, et ensuite miraculeusement réunie à l'enfant, quelle crainte pourrais-je avoir au sein des tempêtes ? Si Dieu a décidé que je serais noyée, à quoi me servirait de m'en préoccuper ? »
LXXXIV. Un marchand de Siraf m'a fait cette histoire : « Je m'en allais d'Oman à Basra. Parmi les passagers était une jeune fille fort jolie, de Mansoura ; et je remarquai qu'un matelot lui faisait des agaceries ; mais il n'en put rien avoir parce qu'elle se tenait dans la cabine. Au voisinage de Hârek, la mer changea, le vent souffla en tempête, et le navire fut brisé. Par chance, je m'accrochai aux agrès; plusieurs autres personnes en avaient déjà fait autant, entre autres la jeune fille de Mansoura et le matelot qui en était épris. Celui-ci commença à entreprendre la jeune fille pour en avoir satisfaction ; elle le repoussait à coups de pied, si bien qu'elle le tint à l'écart tout le reste du jour. Nous montions et descendions toujours au gi:, des flots. Enfin la jeune fille cessa de se défendre; le matelot s'en rendit maître et en fit à sa volonté. Je le voyais faire ; mais nous étions dans l'impossibilité de changer de place, pour lui parler et l'arrêter. D'ailleurs nous n’y pensions guère, nous voyant à deux doigts de la mort. Quand vint le matin, la jeune fille avait disparu. Et ceux qui tombèrent à la mer furent plus nombreux que ceux qui sauvèrent leur vie sur les agrès. »
LXXXV. Le même m'a raconté qu'il y avait à Sihour
[117] un personnage originaire de Siraf, nommé Abbas fils de Mahan, qui était hebermen des musulmans.Un matelot passant à Sihour vit une idole qui représentait une jeune femme d'une extrême beauté. Se croyant inaperçu, il alla vers l’idole et se mit entre ses cuisses. Quelqu'un vint à passer, le matelot eut peur et s’écarta. L'homme, qui l'avait vu, s'approcha de l'idole et aperçut du liquide entre les cuisses. Il mit la main sur le matelot, le conduisit au roi de Sihour, conta l'affaire, et le matelot confessa ce qu'il avait fait. « Qu'en pensez-vous? dit le roi aux personnes qui l'entouraient. — Qu'on le jette aux éléphants, dit l'un, afin qu'il soit foulé sous leurs pieds. — Qu'on le coupe en morceaux, dit un autre. — Non, reprit le roi. N'agissons pas ainsi. C'est un Arabe. Entre les Arabes et nous, il y a des conventions. Que l'un de vous aille trouver Abbas fils de Mahan, hebermen des musulmans, et lui dise : « Quel est chez vous le châtiment d'un homme surpris avec une femme dans une mosquée? Ecoutez sa réponse, et agissez en conséquence. »
« Un des vizirs alla exécuter les ordres du roi. Abbas fils de Mahan, pour faire valoir aux yeux de ces infidèles la grandeur de sa religion, répondit : « En de telles circonstances nous mettons l’homme à mort. » Sur cette réponse, on tua le matelot. Abbas, quand il connut les détails de l’affaire, eut peur que le roi ne le retînt de force dans la ville et s’échappa secrètement de Sihour.
LXXXVI. Darbézin de Siraf, frère de la femme d’Obeïd Allah fils d'Ayyoub, lequel était le grand-père d'Abd-Allah fils de Fadl, le Cadi m’a dit : « J'étais un jour à Khanfou, ville de la Grande-Chine, lorsque . . . . . . . . . . . . les gens s’assirent tout le long du chemin que le chambellan devait suivre, afin de voir le cortège. L’entrée de l’escorte par groupes commença au lever du soleil et ne finit qu'à l’asr (trois heures après midi). Enfin le chambellan entra lui-même. Il avait avec lui cent mille cavaliers.
LXXXVII. Abbas fils de Mahan, sarhin de Sihour, m’a raconté cette singulière aventure qu'il tenait d'un marchand à qui la chose était arrivée.
Ce marchand avait frété un navire pour le voyage de Sindan ou Sihour à Oman. Entre autres objets de vente, il avait remis à son préposé une longue pièce de sadj
[118] portant sa marque, en lui disant : « Vends-la, et avec le prix achète tel et tel objet », dont il lui donnait la note. Le navire partit. « Au bout de deux mois ou davantage, dit le marchand, j’étais assis dans ma maison lorsqu’un homme vint me dire : « Il est arrivé dans le port une longue pièce de bois sur laquelle ton nom est tracé. » Je me lève, je vais au port, plein d'inquiétude, je regarde ; c'était bien ma pièce de sadj. Je demeurai convaincu que mon navire avait été brisé dans la mer ; car la pièce était d'une longueur inusitée, et assurément on n'avait pu, au moment d'une tempête, la tirer du navire pour la jeter à la mer avec d'autres bagages. Ainsi persuadé du naufrage, je reçus à ce sujet des compliments de condoléance, je pris mon parti de la perte du navire et du chargement, et je retournai à mes affaires. Aucun espoir ne me restait, aucune nouvelle ne nous était venue de la mer, lorsque, environ deux mois plus tard, un homme m'arrive, disant: « Ton navire est en vue ». Je cours au port, le navire aborde, mon préposé débarque et vient à moi. Je l'interroge. « Sains et saufs et en bonne santé, dit-il. — N'avez-vous rien perdu? demandai-je, ni rien jeté à la mer? — Nous n'avons pas perdu un cure-dents, » répond le préposé. Je rendis grâces à Dieu et repris : « Qu'as-tu fait de telle pièce de bois? — Je l’ai vendue, dit-il, trente et quelques dinars, et j'en ai employé le prix en achats pour toi. » Sa réponse me surprit fort. Ensuite il me rendit ses comptes, sans oublier le prir de la pièce de bois. « Il faut, lui dis-je, que tu m'avoues la vérité au sujet de cette pièce de sadj, » Et je le pressai jusqu'à ce qu'il me fît le récit suivant : « Nous étions arrivés à Oman et nous avions débarqué sur la plage tout le chargement du navire, quand s'éleva une forte tempête, et les vagues roulèrent les pièces de bois vers la mer, bouleversant le sable du rivage qui recouvrit telle et telle de ces pièces à la volonté de Dieu. Le lendemain, je rassemblai les hommes, nous recherchâmes nos marchandises, et tout fut retrouvé, hormis cette longue pièce de bois. Pensant que le sable l’avait peut-être cachée, je fis creuser tout le long du rivage, mais sans succès. » Et voilà que les flots l'avaient entraînée à la mer et ramenée vers son maître. C'est là une des aventures les plus singulières que j'ai entendues conter en ce genre.LXXXVIII. En l’année 342, un navire appartenant à un marchand de Basra, allait d’Oman à Djedda, lorsqu'il fut assailli par un coup de vent dans les parages de Chedjertan. On jeta à la mer une partie de la cargaison, entre autres cinq ballots de coton halîdj,
[119] et le navire fut sauvé. La même année, un autre navire appartenant au même marchand, partit de Basra pour Aden et Ghalafqa. Aux environs des mêmes parages de Chedjertan, un canot s’étant détaché derrière le navire, emporté par les flots, quelques hommes se jetèrent dans la chaloupe pour le rattraper. Ils coururent après et l'atteignirent dans une petite baie. Et voici que sur le rivage on aperçut cinq ballots de coton halîdj portant la marque du maître du navire. Les ballots furent chargés sur la chaloupe qui regagna son navire. On crut que cela provenait d'un naufrage. Mais on sut plus tard que les ballots faisaient partie de la cargaison jetée par-dessus bord.LXXXIX. On m'a conté qu'une personne digne de foi disait avoir vu dans un pays de l'Inde deux hommes se donner la mort d'une manière étrange. Ils avaient creusé à côté l'un de l'autre deux fosses, et, y étant entrés debout sur leurs pieds, ils avaient rempli l'intérieur de fiente sèche allumée. Pendant que le feu les consumait par le bas du corps, ils jouaient ensemble sur un damier placé entre eux deux, mâchaient le bétel, chantaient, et cela jusqu'au moment où le feu leur atteignit le cœur et les fit mourir. Celui qui m’a répété le fait ne se souvenait pas si le narrateur lui avait dit qu'ils moururent dès le premier jour ou s'ils vécurent jusqu'au lendemain,
XC. Abd-el-Ouahid fils d'Abd-er-Rahman, de Fous (ou Qous), qui était fils du frère d'Abou-Hatim El-Fasoui, et qui avait longtemps parcouru les mers, m'a dit que les Indiens portaient leurs cheveux dressés sur la tête comme des mitres et se servaient de sabres droits. A la suite d'une guerre, les vainqueurs dirent aux vaincus : Nous ne vous épargnerons pas tant que vous n'aurez pas les cheveux rabattus et les sabres recourbés comme les nôtres. » Car la tribu victorieuse portait les cheveux rabattus et se servait de sabres courbes nommés qarâtil.
[120] Et cette coutume dure encore parmi ces tribus.XCI. Ali fils de Mohammed, fils de Sahl, connu sous le nom de Serouber qui avait été à Tâna
[121] et... m'a conté que les habitations sont bâties au bord de l'eau. Les gens, petits et grands, y sont tous héméralopes, parce qu'ils mangent trop de l'‘alîm, c'est-à-dire de mâles de tortue marine. Chacun a une corde attachée à la porte de la maison, allant jusqu'à l’eau où elle est fixée à un pieu. Leur héméralopie commence à l'approche du coucher du soleil. A partir de ce moment, celui d'entre eux qui sort de sa maison pour satisfaire un besoin, saisit la corde, va à l'eau, se purifie et retourne au logis de la même manière. Il en est ainsi jusqu'au lendemain, au grand jour, quand le soleil est déjà haut. Quelquefois un mauvais plaisant, venu dans leur pays, s'amuse à prendre la corde d'une porte pour l'attacher à une autre; l’héméralope descendu à l'eau et revenant trouve son logis occupé; on se fâche, on se querelle : « Que viens-tu faire chez moi? »XCII. Un personnage nommé Abou Taher de Bagdad contait qu'il avait fait le voyage du Zabedj, disant que parmi les villes de l'île de Zabedj, il en est une appelée Merqavend où l'ambre (gris) abonde... Les gens qui n'en savent pas la valeur le vendent à vil prix. Et cet Abou-Taher en avait une certaine quantité qu'il emporta dans le navire, à l’insu du patron.
XCIII. Yézid d'Oman, capitaine d'un des navires qui vont au pays des Zindjs, m’a dit : « J'ai vu dans ce pays deux grandes montagnes, entre lesquelles est un vallon portant les traces du feu, jonché d'os calcinés et de peaux brûlées. Sur les questions que je fis à ce sujet, on me dit qu'à certaines époques, un feu traversait ce vallon ; s'il s'y trouve des brebis ou d'autre bétail à paître, et que les bergers se laissent surprendre par le feu, ils sont tous brûlés. Ce feu arrive à certains jours, coulant comme un torrent. »
XCIV. Dans les pays de l’Inde, il y a des troupes de voleurs qui vont de ville en ville et s'attaquent aux marchands, tant indigènes qu'étrangers. Les brigands saisissent leur homme dans son logis, sur la route, ou même en plein marché. Ils lui mettent le couteau sur la gorge, en disant : « Donne-nous telle ou telle chose, ou tu es mort. » Si quelqu'un approche pour défendre l’homme attaqué, ils le tuent, fût-ce un roi, sauf à se tuer eux-mêmes après cela, s'ils ne peuvent s'échapper. Aussi quand ils attaquent, personne n'ose leur résister ni dire mot, crainte de mort. L'homme saisi les suit et s'arrête où il leur plaît, au marché, chez lui, dans sa boutique, dans son jardin, pour réunir la somme et les objets qu'ils exigent. Pendant ce temps, ils mangent et boivent, toujours leurs couteaux dégainés à la main. Puis le malheureux est encore obligé de leur donner un homme qui porte sa rançon et les accompagne jusqu'à leur demeure, où ils sont hors d’atteinte. Là ils prennent la rançon, argent et effets, et lâchent le porteur.
[122]XCV. Mohammed fils de Mouslim de Siraf, qui était demeuré plus de vingt ans à Tana, avait parcouru la plupart des pays de l’Inde et connaissait admirablement les mœurs et coutumes des habitants, m’a conté qu’un jour douze bandits vinrent à Dhimour et Tana, et se saisirent d’un marchand indien dont le père était fort riche et fort attaché à son fils qui était son unique enfant. Ils le prirent dans son logis et lui demandèrent environ dix mille dinars. Ce n’était qu'une partie de la fortune du père. Le fils lui dépêcha un messager pour l'avertir de l'événement, le prier de le racheter et de lui sauver la vie. Le père vint trouver les brigands, leur parla, leur proposa de réduire leur demande à un millier de dinars. Ils ne voulurent rien entendre et exigèrent la somme entière de dix mille dinars.
Les voyant ainsi résolus, le marchand alla au roi, l’instruisit de l’affaire et lui dit : « C’est une chose intolérable; si ces bandits-là ne sont pas châtiés, personne ne pourra plus séjourner dans votre pays. — Que faire ? dit le roi. Il m'est facile d’en venir à bout; mais si nouç.les attaquons, ils tueront ton fils, et tu n'as que celui-là. — Tant pis ! dit le marchand. Ils demandent une somme énorme; je ne puis me réduire à la pauvreté pour sauver mon fils. Il faut entasser du bois autour de la maison, boucher la porte et y mettre le feu. — Mais, dit le roi, ton fils brûlera aussi, avec toute la maisonnée. — Qu'ils brûlent ! dit le marchand. J'aime mieux cela que de sacrifier tant d’argent. »
Le roi envoya donc des gens pour boucher la porte et mettre le feu à la maison. Tout fut consumé, les brigands, le fils, et tout ce qui était dans le logis.
— On dit que dans l'Inde supérieure, la coutume dure encore de brûler les vieillards, hommes ou femmes.
XCVI. C’était autrefois la coutume chez les rois du Zabedj et des pays de l’or que personne, indigène, étranger ou musulman, ne pût s'asseoir devant eux, autrement qu'en carré, dans la posture nommée Sila.
[123] Quiconque se permettait d'allonger les jambes ou de s'asseoir de toute autre manière, était condamné à une forte amende, calculée d'après sa fortune.Or, il arriva qu'un marin nommé Djéhoud Koutah, homme fort considéré, eut audience d'un de ces rois appelé Bidbana-Kala. Ce marin était un vieillard fort avancé en âge. Il s'assit devant le roi, dans la posture exigée. L'affaire traînait en longueur, le roi ne se prononçait pas. On continuait à causer, quand le vieillard, changeant de sujet, se mit à parler de tout autre chose. « Il y a chez nous, à Oman, dit-il, un poisson nommé Kanâd, qui est long comme cela, » — et il étendit la jambe, marquant le milieu de sa cuisse, —et il y en a d'autres qui sont comme cela » — et il étendit l’autre jambe, montrant de la main le milieu du corps. Le roi dit à son vizir : « Cet homme-là n'est pas sans avoir eu quelque raison pour nous parler de poissons, alors que nous étions à nous entretenir d'un tout autre sujet. Qu'en penses-tu ? — Seigneur, dit le vizir, cet homme est un vieillard avancé en âge, sans force, et qui n'a pu supporter jusqu'à la fin cette posture. Vaincu par la fatigue, il a imaginé ce moyen de se délasser. » Là-dessus, le roi dit : « Il convient que nous dispensions de cette coutume les musulmans étrangers. » Il la supprima donc pour eux. Et depuis lors les musulmans s'asseyent devant les rois comme ils le trouvent commode. Mais tout autre qu'eux doit continuer à s'asseoir suivant le Sila, sous peine de l’amende dont nous avons parlé.
XCVII. Il y a dans l'Inde des dévots et des religieux de bien des espèces, parmi lesquelles sont les Bîkour, originaires de Sérendib. Ces Bikour aiment les musulmans et leur témoignent beaucoup de sympathie. En été, le corps et les pieds nus, ils voilent leur nudité de quelque haillon; c'est parfois un chiffon large de quatre doigts, attaché à la ceinture avec une corde et retombant sur leurs parties naturelles. En hiver, ils se couvrent avec de l’herbe; quelques-uns ont un izar formé de pièces et de morceaux de toute couleur. Ils se souillent le corps avec la cendre des os des Indiens morts qu'on a brûlés. Ils se rasent la tête, arrachent leur barbe et leurs moustaches, mais gardent les poils du pubis et des aisselles. Ils taillent et rognent leurs ongles. Chacun d’eux possède, en guise d'écuelle, la partie supérieure d'un crâne d'homme, dans laquelle il mange et boit en manière de mortification et comme marque d'humilité.
Lorsque la nouvelle de la venue du Prophète — sur qui soient le salut et la bénédiction de Dieu ! — parvint aux peuples et aux souverains de Sérendib, ik députèrent un des leurs chargé d'aller trouver le Prophète et d'apprendre de lui l’objet de sa prédication. Le messager, de ville en ville, arriva à Médine, alors que le Prophète était mort, ainsi qu'Abou-Bekr. Le chef des musulmans était Omar fils d’El-Khattab, qui lui donna toutes les instructions nécessaires. Le messager, s'en retournant, mourut en route dans les parages de Mékran. Il était accompagné d'un jeune serviteur indien, qui put arriver jusqu'à Sérendib et y porter la connaissance de ce qu'il avait appris touchant le Prophète et Abour-Bekr. Il conta ce qu'il avait vu de leur successeur Omar fils d'El-Khattab, comment il se faisait humble, s'habillait de vêtements rapiécés, passait la nuit dans les mosquées. C'est à la suite des récits de ce jeune homme, que les religieux indiens ont adopté leurs habitudes d'humilité et leur coutume de porter des vêtements rapetassés, ainsi que le faisait Omar. C'est de là aussi qu'est venue cette affection, cette sympathie qu'ils témoignent aux musulmans.
Dans la religion des Indiens, le vin est interdit aux hommes, et permis aux femmes. Il y a des Indiens qui en boivent en secret.
XCVIII. L'Inde a des magiciens et des devins dont les pratiques sont bien connues. J'en ai déjà rapporté quelque chose.
Je tiens d'Abou-Youcef fils de Mouslim, qui le tenait d'Abou-Bekr El-Fasoui, à Dhimour, que celui-ci avait entendu Moussa de Sindabour
[124] faire le récit suivant : « J'étais un jour à m'entretenir avec le Sahib de Sindâbour, quand tout à coup il se mit à rire. « Sais-tu, me dit-il, pourquoi j’ai ri ? — Non, répondis-je. — C'est, reprit-il, qu'il y a sur le mur deux lézards, et l’un de ces lézards vient de dire à l’autre : « Voici qu’il nous arrive un hôte étranger. » Je fus surpris de sa folie, et bientôt je songeais a me retirer ; mais il me dit : « Ne t'en va point que tu n'aies vu la fin de l’affaire. » Nous étions donc restés à causer, lorsqu'un de ses serviteurs entra, disant : « Il est arrivé dans le port un vaisseau d'Oman. » Peu d'instants après, vinrent des gens portant des paniers qui contenaient divers objets, des étoffes et de l’eau de rose. Comme on ouvrait un de ceux où était l’eau de rose, voila qu'il en sortit un gros lézard qui grimpa sur le mur, et rejoignit sous mes yeux les deux premiers.XCIX. C'est un adepte de la même science qui enchanta les crocodiles dans le port de Serira, où depuis lors ils ne blessent plus personne. Auparavant, on ne pouvait approcher de l’eau sans être atteint par eux grièvement. Ils y étaient en quantité incroyable. Or, il vint un Indien qui dit au roi de Serira : « Si tu veux, j'enchanterai les crocodiles de telle sorte qu'ils ne feront plus de mal à personne dans le port. — Fais, dit le roi, et je te donnerai telle et telle chose. » Mais cet homme disparut et ne put être retrouvé.
Quelque temps après un autre Indien, verse dans la science des enchantements, de la magie et de la divination, vint s'établir à Serira. S'y étant fait un ami, il lui dit un jour : « Je veux te montrer quelque chose de curieux. — Très bien, » dit l'ami. L’Indien s'assit au bord de l’eau, prononça certaines paroles et puis dit à son compagnon : « Tu peux entrer dans l’eau, sans crainte des crocodiles. Ou si tu veux, fais-y entrer quelqu'un, ou bien j'y entrerai moi-même. — Entre toi-même », dit l’ami. Il entra en effet dans le port, et bientôt son compagnon le suivit. Les crocodiles rodaient autour d'eux sans leur faire aucun mal. Etant ressortis, le devin dit : « Veux-tu que je les délivre de leur enchantement? — Fais, dit l’autre. On jeta un chien à l’eau ; à l’instant les crocodiles le mirent en pièces.
La nouvelle du pouvoir magique de cet homme vint aux oreilles du roi, qui le fit appeler et lui demanda : « Es-tu vraiment capable de faire telle et telle chose ? — Assurément, » dit-il. Aussitôt le roi monta à cheval et gagna le port, faisant conduire avec lui deux hommes auxquels il voulait ôter la vie. « Allons ! fais, » dit le roi. L'Indien prononça son enchantement sur l’eau ; on y poussa l’un des deux hommes ; et les crocodiles vinrent circuler autour de lui sans faire mine de l’attaquer. « Délivre-les», dit le roi. Le devin prononça de nouvelles paroles, et les crocodiles mirent l'homme en pièces. « Voilà qui est bien, dit le roi, et tu as mérité ta récompense. » Il lui donna une bonne somme, le fit revêtir d'un vêtement d'honneur, sans compter les promesses.
Le lendemain, le roi dit au devin : « Je désire te voir recommencer aujourd'hui ce que tu as fait hier. — Bien, » dit-il. Le roi appela un de ses serviteurs, d'une force et d'une hardiesse sans pareilles : « Lorsque je te ferai signe, lui dit-il, frappe à l'instant même le cou de cet enchanteur. » On alla au port. L'Indien fit sa conjuration. On jeta dans l'eau l’autre condamné. Les crocodiles n'y touchèrent pas; on le fit aller et venir d'un coin du port à l'autre, et les crocodiles qui l'entouraient ne lui firent pas une égratignure. Quand le roi connut que l'enchantement s'étendait au port tout entier, il fit à son esclave le signe convenu, et sur-le-champ l'esclave coupa le cou de l'enchanteur. Depuis cela, les crocodiles dans le port de Sérira sont absolument inoffensifs.
C. Chez les Indiens, le vol est chose grave. Si le voleur, de race indienne, est un misérable sans fortune, le roi le fait mourir; s'il a du bien, le roi prend tout ou lui impose une forte amende. Il en est de même pour celui qui sciemment a acheté une chose volée. En général la mort est chez eux le châtiment du vol.
[125]Si le voleur est musulman, il est jugé par-devant l’hebermen des musulmans, qui prononce suivant les lois de l'islam. L'hebermen est comme le cadi en pays musulman; il ne peut être pris que parmi les hommes qui font profession de l’islam.
CI. Raced El-Ghoulam, fils de Bâlîchâd, m'a dit : « Durant une traversée que je fis de Siraf à Basra dans une belle barque, dans le mois de dhou'l-qada de l’année 305, la tempête nous assaillit près de Ras-el-Kamilâ. Nous jetâmes à l’eau une partie du chargement. Les flots s'élevaient si haut qu'ils faisaient ombre au-dessus du bateau, puis ils se brisaient au-dessous. Plusieurs fois mes yeux cherchèrent le ciel sans l'apercevoir, caché qu'il était par les vagues interposées. Elles nous voilaient le jour et nous fûmes pendant quelque temps dans une sorte de crépuscule. »
CII. Le même m'a conté que dans l'Inde, le Sind
[126] et autres pays, les marchands les plus distingués, les femmes les plus haut placées, fût-ce la favorite du roi elle-même, recueillent le fumier des vaches et des buffles. S'il y a quelqu'un pour l'emporter, on le prend. Sinon, on y laisse un signe pour marquer qu'on en a pris possession, en attendant qu'on le fasse prendre.Les Indiens mangent les bêtes mortes (sans qu'elles aient été égorgées), c'est-à-dire qu'ils frappent la tête de l'animal, brebis, oiseau ou autre, jusqu'à ce qu'il meure, et puis ils en font leur nourriture.
On conte qu'un de leurs grands personnages, à Dhimour et Soubada, passant près d'un rat mort, le prit avec la main et le donna à son fils ou à son serviteur qui l'emporta chez lui et le mangea. Car chez eux les rats font partie des animaux qu'on mange.
CIII. J'ai déjà rapporté des choses intéressantes touchant les Dhibadjat-ed-doum.
[127] C'est un groupe d'îles dont la première est voisine des Dhibadjat-el-kastedj, et la dernière proche des îles des Ouaqouaq. Ces Dhibadjat sont, dit-on, au nombre de trente mille, dont douze mille habitées, au dire des marchands. Leur longueur varie d'une demi-parasange à dix parasanges; elles sont distantes l’une de l’autre d'une parasange. Toutes sont sablonneuses.CIV. Quelqu'un m'a dit qu'il avait vu dans une ville de l’Inde un éléphant dressé à faire les commissions de ses maîtres. On lui donne un sac où est mis le ouadà ou argent comptant et la note des choses à acheter pour cette somme. Il va chez le fruitier. Celui-ci, dès qu'il l'aperçoit, abandonne toute autre occupation, laisse là tout acheteur, prend le sac de l'éléphant, compte l'argent qui s'y trouve, regarde ce que porte la note et sert ce qu'il a de meilleur, et à meilleur marché, de l'espèce demandée. Quelquefois le marchand fait erreur en comptant l'argent ; alors l'éléphant brouille les pièces avec sa trompe, et le fruitier recommence son compte. Enfin l'éléphant part avec ses achats. Arrivé au logis, si le maître trouve qu'on l’a mal servi, il le bat. L'éléphant retourne chez le fruitier et bouleverse tout dans sa boutique, et cela, soit qu'on lui ait servi plus qu'il ne fallait, soit qu'on lui ait donné moins que ne comportait la somme.
Ce même éléphant balaie, arrose, écrase le riz avec le pilon qu'il tient avec sa trompe. Il tire l'eau du puits au moyen d'un seau attaché à une corde. Enfin il fait toute espèce de travail. Son maître le monte chaque fois qu'il a une longue course à faire. Un petit garçon le monte aussi et le conduit aux champs. Là l'éléphant arrache de l’herbe et des feuilles d'arbre avec sa trompe; lui et l’enfant mettent cela dans un sac et le rapportent au logis pour sa nourriture.
Un éléphant ainsi dressé se vend à des prix très élevés, dix mille dirhems, dit-on.
CV. Parmi les aventures de mer qui ont fait quelque bruit, voici ce que m'a raconté un marchand :
« Je partis de Siraf, dit-il, en l'année 306, sur un navire qui allait à Dhimour. Avec nous faisaient route un navire d'Abd-Allah fils de Djanid et un navire de Séba.
[128] Les trois navires étaient de très fortes dimensions et bien connus sur la mer; les capitaines jouissaient d'une grande réputation parmi les marins. Le nombre des passagers, marchands, pilotes, matelots et autres personnes, s'élevait à douze cents. Le chargement en provisions et marchandises était d'une valeur incalculable. Au bout de onze jours, nous fûmes en vue des hauteurs de la terre de Sendan, de Tana et de Dhimour. Jamais, dit-on, ce voyage ne s'était fait en aussi peu de temps. Nous nous réjouissions, nous félicitant les uns les autres de cette heureuse traversée. Nous nous croyions hors de tout danger et pensions toucher terre le lendemain matin. On n'avait pas serré les voiles. Tout à coup une tempête s’éleva, accompagnée d'éclairs, de tonnerre et de pluie. « Jetons des bagages à la mer, dirent les pilotes et les matelots. Mais [le patron du navire] Ahmed s'y opposa, disant : « On ne jettera rien, que je n'aie perdu tout espoir et vu notre perte assurée. » Les hommes descendirent pour vider l'eau de la cale des deux côtés. Les deux autres navires étaient dans la même situation que nous, attendant ce que déciderait le patron, pour jeter ou garder les bagages. A la pointe du jour, les marchands dirent à Ahmed : « Décide-toi à jeter les bagages; tu n’en seras pas responsable, car nous voilà sur le point de périr. — Je n'en ferai rien, » dit-il. Pendant cinq jours, nous allâmes sans aggravation. Mais dans la sixième journée, voyant le navire près de sombrer, Ahmed donna l'ordre de jeter le chargement. On ne put rien jeter, la pluie avait accru le poids des sacs et des ballots; ce qui pesait auparavant cinq cent mens en pesait alors quinze cents. Le danger était pressant ; on mit la chaloupe à la mer, et trente-trois hommes y descendirent. On voulait y faire descendre Ahmed; mais il dit ; « Je ne sortirai pas du navire, qui se sauvera plutôt que la chaloupe. S'il doit périr, je périrai avec lui. Que m'importe le salut, après la perte de mon bien. »Le marchand [qui m'a fait ce récit était parmi les gens embarqués dans la chaloupe] : « Nous y passâmes cinq jours, dit-il, sans nourriture ni boisson. La faim, la soif, les souffrances de toute sorte nous enlevaient jusqu'à la force de parler. On commença à se faire entendre par signes qu'il fallait manger un d'entre nous. Or, nous avions dans la chaloupe un jeune garçon de bonne mine, encore enfant, dont le père était resté sur le navire. C’est lui qu'on résolut de manger. Il avait deviné nos projets et je le vis qui regardait vers le ciel et remuait à la dérobée les lèvres et les yeux. Heureusement, nous eûmes à l'heure même connaissance de la terre, et bientôt nous la distinguâmes clairement. La chaloupe, portée au rivage, toucha, s'ouvrit et se remplit d'eau. Nous n'avions pas la force de nous lever ni de remuer. Deux hommes accoururent du rivage. « D'où venez-vous? » dirent-ils. Nous répondons : « De tel navire. Prenez-nous par la main et tirez-nous à terre. » Quand nous fûmes là, à demi morts, un des deux hommes s'en fut. « Où sommes-nous? Dis-je à l'autre. — Cette fumée que tu vois là-bas, dit-il, vient de la terre ferme. Mon compagnon est allé au village. Vous y trouverez des aliments, de l’eau, des vêtements, » Enfin on nous y mena. Quant à ceux qui étaient restés sur les trois navires, pas une âme n’en fut sauvée, hormis les gens partis sur la chaloupe.
CVI. Une chose des plus étonnantes est ce que m'a conté un marin qui avait passé de longues années dans l'Inde. Il tenait cela de la bouche de bien des gens qui avaient pénétré au cœur du pays indien. C'est que, dans les régions du haut Cachemire, en un lieu nommé Ternarayin, se trouvent des jardins ombragés, arrosés par des eaux courantes, où les Djinns
[129] tiennent marché. On entend le bruit de leurs voix, achetant et vendant, sans voir leurs personnes. Et cela existe de temps immémorial. Je demandai à ce marin : « Sais-tu si le marché est continuel ou s'il a lieu à certaines époques? — Je n'ai pas fait, dit-il, de question à ce sujet. »CVII. Un homme qui avait été en Chine, m'a dit avoir vu dans ce pays une pierre qui attirait le plomb à travers les parois d'un vase; placée sous une femme enceinte, elle facilite l'accouchement. Il y a aussi une pierre qui attire le cuivre, une autre qui attire l'or, ainsi que la pierre d'aimant qui attire le fer; enfin une pierre qui éteint le feu et dans laquelle une autre se remue.
Il m'a dit encore qu'il avait vu dans les parages des Gobbs de Sérendib une pierre qu'on avait cassée et d'où sortit un ver qui rampa sur une longueur de dix aunes et puis mourut. Il avait sur la tête et sur la queue une sorte de duvet pareil à celui des jeunes oiseaux.
CVIII. Parmi les merveilles, il y a dans le Yémen une montagne du sommet de laquelle l’eau coule goutte à goutte, se congèle en arrivant à terre et devient l’alun yéménois.
[130]CIX. Diaprés un témoin oculaire, les arbres du Liban, qui sont les cèdres, croissent dans des gorges et des lieux où l’eau coule. Ils n'ont pas de graine. Leur taille ne varie pas depuis qu'ils existent; les personnes à qui ils appartiennent les ont toujours vus les mêmes, du reste parfaitement beaux. On n'en trouve que dans la région comprise entre les frontières de Hacil et les frontières de Haridj, sur un espace d'environ cinquante à cent parasanges.
CX.
[131] Une personne qui avait voyagé dans l'Inde m'a dit qu'elle avait vu à Atakia, non loin de Mankir, ville des pays de l’or, un grand arbre, porté sur un gros tronc, assez semblable au noyer, lequel produit des roses (ou des feuilles) rouges où on lit en caractères blancs : « Il n'y a de Dieu que Dieu, Mohammed est le prophète de Dieu. »CXI.
[132] Dans la mer de Senf est une île, où les crabes qui y tombent deviennent pierres. C'est cette pierre connue à Alep, dans l’Irak et partout, qui entre dans la composition du collyre pour les taies des yeux. Les pêcheurs nomment ces crabes : crabes de rivière.CXII. On m'a conté qu'à... se trouve une fontaine vénérée, que recouvre une grande pierre d'émeraude soutenue par quatre idoles d'or. Lorsque le soleil s'élève au-dessus de la pierre, l’eau de la fontaine devient toute verte.
Un roi du voisinage, nommé Abar, fit une irruption dans ce pays pour s'emparer de la pierre. Mais les habitants sont invincibles; plusieurs fois attaqués, ils ont toujours gardé leur indépendance. Un de leurs rois voulut aussi prendre la pierre, mais il se présenta à lui un nègre qui le repoussa, ou quelque chose comme cela.
CXIII. D'après ce que m'a dit un de mes compagnons, il y a dans la région des Gobbs de Sérendib un oiseau qui fait ses petits sur le rivage de la mer. Dès lors, les vents cessent de souffler pendant quatorze jours.
CXIV. Mohammed d'Oman m'a dit : « J'ai vu à Beriyin (?) ville de l'Inde un jeune Indien saisi pour vol ou tout autre crime. Le roi avait donné l’ordre de l’écorcher vif. Pendant qu'on l'écorchait, ce jeune homme parlait, chantait et restait impassible, jusqu'au moment où on atteignit le nombril. Et quand on eut tranché cette partie, il expira. »
CXV Le même m'a conté que dans une des îles du Ouaqouaq il y a un oiseau dont le plumage a du rouge, du blanc, du vert et du bleu comme le pivert. On le nomme semendel.
[133] Il peut entrer dans le feu sans se brûler, demeurer longtemps sans manger autre chose que de la terre. Pendant qu'il couve ses œufs, il ne boit pas jusqu'à leur éclosion. Lorsque les petits sont nés, il les abandonne quelque temps et n'en approche point ; mouches et moucherons tournent autour des petits; quand leurs plumes ont poussé et qu'ils commencent à marcher, alors il leur témoigne de l'affection.Dans ces îles du Ouaqouaq, il y a aussi un animal, semblable au lièvre, qui change de sexe, est tantôt mâle et tantôt femelle. C'est du moins ce que disent les gens de Sérendib, d'après ce que m’en a rapporté mon narrateur qui le tenait d'un Indien; et je ne sais qu'en dire. Ils prétendent que le lièvre change aussi de sexe. Mais à mon sens, c'est une rêverie sans fondement. Dieu seul connaît la vérité.
CXVI. Une personne qui avait parcouru les mers m'a dit avoir vu à Sofala des Zindjs une bête de la taille du lézard, à peu près de sa couleur et de sa forme. Le mâle a deux pénis et la femelle deux vagins. Leur morsure est inguérissable; la plaie qu'ils font reste toujours ouverte et ne se cicatrise pas. Cette bête fréquente surtout les plantations de cannes à sucre et de dourah.
Mais ce qui pullule dans ce pays, ce sont les serpents et les vipères. Quelquefois le passant est attaqué par trois ou quatre à la fois qui le mettent en pièces. S'il en repousse un, en voilà deux qui reviennent.
CXVII. Djafar fils de Rachid, connu sous le nom d’Ibn Lakis, navigateur renommé des pays de l'or, m'a rapporté qu'un serpent vint une fois dans la baie de Dhimour et avala un crocodile énorme. A la nouvelle de ce fait, le Sahib de Dhimour expédia une troupe pour s'emparer du serpent. Trois mille braves se réunirent contre le monstre, vinrent à bout de s'en emparer et lui mirent une corde au cou. Des preneurs de serpents arrivèrent et lui arrachèrent les dents, puis l’enchaînèrent. Il avait une blessure de la tête aux oreilles. On le mesura et on le trouva long de quarante coudées. Les gens le portèrent sur le cou ; il pesait des milliers de livres. Cela s'est passé en l’année 340.
CXVIII. Une personne qui a pénétré chez les Ouaqouaq m'a décrit l'ampleur de leurs villes et de leurs îles. Par cette expression ampleur, je n'entends pas dire que leurs villes soient vastes, mais les habitants sont nombreux. Ils ont de la ressemblance avec les Turcs.
[134] Dans leurs arts, ce sont les plus industrieux des hommes. Quant aux mœurs, ils sont traîtres, rusés, menteurs, les plus vils et les plus méchants qu'on puisse trouver.Ibn-Lakis m'a rapporté à leur sujet des choses extraordinaires... Une fois on les attaqua avec un millier de barques ; c'était en l’année 334. Le combat fut très vif, mais on ne put rien contre eux... Ibn-Lakis dit que les îles du Ouaquaq sont en face de la Chine.
CXIX. Sérira est située à l'extrémité de l'île de Lâmeri, à cent vingt zama de Kala. L'estuaire de Sérira pénètre, dit-on, de cinquante parasanges dans l’île. C'est un fleuve plus large que le Tigre à Basra, avec un courant d’eau douce tout aussi considérable. Il n'y a point d'estuaire plus long dans toute l'île. Le aux s'y fait sentir de douze en douze heures. On y trouve des crocodiles; mais ceux qui sont dans la partie qui avoisine les habitations, ne font aucun mal, ayant été enchantés, comme nous l'avons dit, tandis que les parties situées en dehors des constructions sont inabordables, à cause de ces animaux. Quelques maisons sont bâties sur terre; mais la plupart flottent sur l’eau, soutenues sur des pièces de bois reliées ensemble, en forme de colliers, et d'une durée indéfinie. Ils font cela par crainte du feu ; car leurs habitations, construites en bois, sont fort sujettes à l’incendie ; que le feu prenne quelque part, tout brûle. Placées sur l’eau, les maisons sont mieux protégées ; si le feu se déclare en un point, chaque propriétaire peut couper ses amarres, déloger et s'aller fixer ailleurs, loin de l'incendie. Lorsqu'il se déplaît quelque part, il peut de même changer de quartier. Ces habitations dans la baie sont rangées comme des embarcations. L'eau, entre les habitations, est très fraîche, et c'est de l’eau douce, venant des hauteurs pour couler dans l'estuaire et gagner la mer, de la même manière que le Tigre.
Le même m’a appris qu'il avait ouï dire par un capitaine que souvent les navires partis pour Sofala des Zindjs abordent sur une côte qu'habitent des noirs anthropophages. C’est par accident que cela arrive; les vents et les courants font dériver le navire et l'entraînent dans ces parages, malgré les efforts du capitaine. Un espace d’environ quinze cents parasanges sépare Qabila de ces nègres mangeurs d'hommes. Dieu est le plus savant ! Quant au lieu où se rendent les navires, il est à mille ou tout au moins à huit cents parasanges au-delà de Qabila, et c'est un voyage de quarante-deux zama environ.
CXX. Ibn-Lakis m'a dit que se trouvant à Sofala chez un des rois des Zindjs, survint un homme qui dit au roi : « Un oiseau de telle espèce — Ibn-Lakis avait oublié le nom — s'est abattu dans tel bois ; il avait saisi et mis en pièces un éléphant, qu'il était en train de dévorer lorsqu'on l'a capturé. » Le roi des Zindjs se leva et se rendit au bois avec nombre de gens parmi lesquels j'étais moi-même, dit Ibn-Lakis. A notre arrivée, l’oiseau se débattait sur le sol, et l'éléphant, dont il avait mangé un quart, gisait à terre. Le roi ordonna de prendre les plumes des ailes; et des grandes, il y en avait douze, six à chaque aile. On prit encore d'autres plumes, le bec, une partie des griffes et un peu des entrailles. Une de ces plumes avait une contenance de deux outres d'eau. Ou disait que c'était un oiseau du pays, qui, passant dans le bois, avait vu l'éléphant, l’avait saisi dans ses serres, emporté dans l’air et rejeté sur le sol, puis s’était abattu sur l'animal pour s'en repaître. Des gens qui se trouvaient en ce lieu l'avaient attaqué à coups de flèches empoisonnées, de façon qu'ils ravalent renversé et tué.
CXXI. Entre Thabia et l’île de Ghilémi se trouve une petite mer nommée mer de Saifou dont la traversée demande six jours. Tout navire qui la traverse doit se tenir par trente brasses d'eau ; s'il vient à vingt brasses, il enfonce, parce que le fond de cette mer est une vase fine où se perdent les navires qui y tombent ; et rarement on en réchappe.
CXXII. Parmi les îles remarquables, il n'y en a point dans la mer de pareille à l'île de Sérendib, aussi nommée Séhilan. Elle a cent parasanges de longueur, trois cent parasanges de tour. On y pêche des perles d'une belle eau, mais petites ; les grosses quand on en rencontre, sont mauvaises. Il y a une montagne nommée Hacin, montagne des jargons et des diamants. C'est là, dit-on, que descendit Adam, et on y voit la trace de son pied, longue de soixante-dix coudées. Ce sont les habitants qui disent que c'est la trace du pied d'Adam, et que le saint patriarche avait placé un pied là et l'autre dans la mer. On y trouve une terre rouge qui est le sénadidj dont on se sert pour polir le cristal de roche et le verre. L'écorce de ses arbres donne une cannelle excellente, la célèbre cannelle de Séhilan. L'herbe de cette île est rouge, et sert à la teinture des étoffes et des fils de coton ; c'est une teinture supérieure à celle du baqqam, du safran, du carthame et à toute autre teinture rouge. Il s'y trouve encore bien d'autres plantes remarquables qu'il serait trop long de détailler. On assure que l’île de Sérendib renferme environ cent mille bourgs.
[135]CXXIII. On m'a raconté qu'un homme de Basra disait.... qu'étant parti de Basra pour le Zabedj.... [et son navire ayant fait naufrage, lui seul] se sauva et fut porté sur une île. « Je m'avançai dans l’île, dit l'homme, et je montai sur un grand arbre, où je passai la nuit, caché dans les feuilles. Le matin, je vis venir un troupeau d'environ deux cents brebis, grosses comme des veaux, conduites par un homme d'un aspect extraordinaire, gros, long, large, d'une figure hideuse, tenant en main un bâton avec lequel il chassait le troupeau devant lui. Il s'assit un instant au bord de la mer, tandis que les brebis paissaient parmi les arbres. Puis il se coucha, la figure contre terre et dormit jusque vers le milieu du jour. Alors s'étant levé, il entra dans l’eau et fit ses ablutions, puis ressortit. Il était nu, n'ayant sur lui qu'une feuille assez semblable à une feuille de bananier, mais un peu plus large, attachée à sa ceinture. S'emparant d'une brebis, il la retint par une jambe, prit son pis dans la bouche et téta jusqu'à ce qu'il en eut épuisé le lait. Il fit de même avec plusieurs autres brebis. Après quoi, il se coucha sur le dos à l'ombre d'un arbre. Il était ainsi, les yeux sur les branches, quand un oiseau vint justement se poser sur l'arbre où je me tenais caché. L'homme saisit une grosse pierre qu'il lança contre l'oiseau, et ne le manqua pas ; l'oiseau tomba de branche en branche et s'arrêta tout près de moi. Le berger [m'aperçut et] me fit de la main signe de descendre. J'obéis, plein de terreur, sans force, à demi mort de peur et d'inanition. Il prit l'oiseau et le jeta contre terre. Je calculai que cet oiseau pouvait peser environ cent livres. L'homme le pluma encore vivant, puis avec une pierre pesant vingt livres il le tua en lui frappant la tête; il continua à le frapper à coups redoublés jusqu'à le réduire en pâte, et enfin se mit à y mordre à belles dents, comme le lion dévore sa proie. Il le mangea jusqu'au dernier lambeau et n'en laissa que les os. Le soleil commençant à pâlir, il se leva, prit son bâton et chassa le troupeau devant lui, après avoir poussé un cri si effrayant que je crus mourir de peur. Les brebis rassemblées, il les conduisit à une mare d'eau douce qui était dans l'île, où elles s'abreuvèrent, où il but aussi, et où je bus moi-même, non sans songer que ma mort était sans doute prochaine. Il nous poussa de nouveau devant lui, jusqu'à une sorte d'enclos formé de troncs d'arbres entrecroisés, et muni d'une espèce de porte. J'y entrai avec le troupeau. Au milieu s'élevait une hutte de poutres solides, haute d'une vingtaine de coudées. Son premier acte fut de prendre une brebis des plus petites et des plus maigres du troupeau, à laquelle il brisa la tête avec une pierre. Ayant allumé du feu, il dépeça la brebis des ongles et des dents, à la façon des lions, et en jeta les morceaux dans le feu, encore couverts de la peau et de la laine. Quant aux entrailles, il les dévora toutes crues. Puis il alla de brebis en brebis buvant leur lait. Enfin il prit une des plus grosses, l'embrassa par le milieu du corps et en fit à son plaisir. La brebis criait. Il en saisit une autre et agit de même. Enfin il prit quelque chose au-dessus de sa tête, dont il but, et finalement il s'endormit, ronflant comme un taureau.
« Au milieu de la nuit, je me hasardai à ramper à petits pas vers le foyer pour y ramasser les restes de viande et les manger, afin de retenir un dernier souffle de vie. Je tremblais d'effaroucher les brebis, de l'éveiller, et d'être par lui traité comme l'oiseau ou la brebis. Je demeurai étendu à terre jusqu’au lendemain. Dès le matin, il descendit de sa couche, poussa devant lui les brebis, et moi avec elles. Il m'adressa la parole dans un langage que je ne comprenais pas. Je lui parlai dans les diverses langues que je connaissais, mais il ne put m'entendre. J'étais fort maigre, ce fut sans doute la cause de son retard à me manger. Pendant dix jours, je vécus avec lui de cette vie toujours pareille. Il ne se passait pas de jour qu'il né prît un oiseau ou deux, et s'il n'en avait pas de quoi se rassasier il mangeait une brebis. Je l'aidais à allumer le feu, à ramasser le bois; je le servais, non sans chercher quelque artifice pour lui échapper. Cela dura encore deux mois, et j’avais pris bonne mine. Je vis sur son visage des marques de satisfaction et je compris qu'il avait décidé de me manger. Je m'étais aperçu qu'il cueillait les fruits de certains arbres qui croissaient dans l’île, qu'il les faisait macérer dans l'eau, clarifiait le liquide et en buvait. Après quoi il restait ivre toute la nuit, au point de perdre toute connaissance. J'avais vu aussi dans cette île des oiseaux grands comme des éléphants et des buffles, les uns plus, les autres moins. Il arrivait parfois qu'ils dévoraient quelqu'une des brebis; et c'est pour cette raison que l'homme et le troupeau passaient la nuit dans cette espèce de forteresse qu’il s'était arrangé avec les grands arbres. Ces oiseaux n'osaient y descendre de peur d’être pris dans les arbres.
« Une nuit donc, après avoir attendu qu’il se fût enivré et endormi, je m'aidai.des branches d'un des arbres pour sortir de l'enclos, et je marchai devant moi vers une plaine que j'avais aperçue du haut de l’arbre. Je ne fis halte qu'au matin où la crainte m’obligea à monter sur un autre arbre au gros tronc. Je m'étais muni d'une trique pour le frapper s'il m'atteignait : ou je le repousserai, pensais-je, ou bien il me tuera; nul ne peut échapper à son destin. Je passai la journée sur mon arbre et ne le vis point. J'avais emporté un morceau de viande que je mangeai vers le soir. Puis étant descendu, je me remis à marcher toute la nuit, et aux premières lueurs du jour j'avais atteint une plaine où les arbres étaient clairsemés. Je m'avançai et n’y vis que des oiseaux et des bêtes sauvages d'espèces inconnues, ainsi que des serpents. Il y avait aussi de l’eau douce. Je m'arrêtai pour cueillir des bananes et d'autres fruits, je mangeai et je bus. Les grands oiseaux allaient et venaient dans la plaine. J'en guettai un. Après avoir préparé des fibres d'écorce en guise de corde, je saisis le moment où l'oiseau s'était abattu pour paître. Venant par derrière lui, je me suspendis à une de ses jambes et m'y attachai. L'oiseau ayant terminé son repas et bu, s'éleva dans les airs, décrivit un cercle, et je pus voir la mer. J'étais résigné à la mort. Il s'abattit sur une montagne, sans sortir de l'île. M'étant détaché de sa jambe, malgré l'état de faiblesse où j'étais, je me hâtai de m'éloigner de peur qu'il ne me fît un mauvais parti, et je descendis la pente de la montagne. Le sommet d'un arbre fut mon refuge jusqu'au matin suivant. J'aperçus une colonne de fumée, et sachant qu'il n'y a pas de fumée sans feu, je me dirigeai de ce côté. Je n'avais pas fait une longue marche qu'une troupe d'hommes m'aborda. Ils me prirent, en m'adressant des paroles inintelligibles pour moi, et me conduisirent à un village. Là ils m'enfermèrent dans une maison où se trouvaient déjà huit autres prisonniers. Mes compagnons de captivité m'interrogèrent, je leur contai mes aventures. A leur tour, ils me contèrent qu’ils étaient à bord de tel navire allant du Senf au Zabedj, qu'assaillis par la tempête, ils s'étaient sauvés au nombre de vingt sur la chaloupe et avaient abordé dans cette île. Les indigènes s'étaient emparés d’eux, les avaient tirés au sort et en avaient déjà mangé bon nombre jusqu'à ce jour. Hélas! je dus reconnaître que j’étais en plus grand danger ici qu'auprès du monstrueux berger. Je m'affligeai avec eux y mais j’étais résigné à mon destin et la mort me semblait légère. Nous pleurions les uns sur les autres. Le lendemain on nous porta du sésame ou quelque grain qui y ressemblait, ainsi que des bananes, du beurre et du miel. Ils mirent tout cela devant nous. « Voilà, me dirent les prisonniers, notre nourriture depuis que nous sommes tombés entre leurs mains. » Chacun mangea de quoi se soutenir. Puis les anthropophages survinrent, nous examinèrent un à un et choisirent celui qui leur parut être dans le meilleur état d'embonpoint. Nous lui fîmes nos adieux, en pleurant les uns sur les autres. Ils le tirèrent au milieu du logis, l'oignirent de beurre de la tête aux pieds, et le firent asseoir au soleil l'espace de deux heures. Alors s'étant rassemblés autour de lui, ils regorgèrent, le coupèrent en morceaux sous nos yeux, le firent rôtir et le mangèrent. Une partie fut mise en ragoût, une autre partie mangée crue avec du sel. Après ce repas, ils burent une boisson qui les enivra, et ils s'endormirent. «Allons, dis-je à mes compagnons d'infortune, venez, que nous les mettions à mort pendant qu'ils sont plongés dans l’ivresse. Puis nous marcherons droit devant nous. Si nous échappons, gloire à Dieu ! si nous périssons, mieux vaut mourir que de rester dans cette affreuse situation. Si les gens du pays nous rattrapent, nous ne mourrons jamais qu'une fois. » Mes paroles ne purent les décider et la nuit vint sans qu'on eût pris un parti. Nos maîtres nous portèrent à manger suivant la coutume. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours s'écoulèrent sans amener aucun changement dans notre état. Le cinquième jour, ils prirent encore un de nous et le traitèrent comme le précédent. Cette fois, quand ils se furent enivrés et endormis, nous allâmes à eux et nous les égorgeâmes tous. Chacun de nous se munit d'un couteau, d'un peu de miel, de beurre et de sésame, et lorsque la nuit enveloppa la terre de ses ténèbres, nous nous échappâmes de la maison, dont nous avions étudié les abords durant le jour. Nous nous mîmes en marche, tâchant de gagner le rivage de la mer sur un point éloigné du village. Arrivés dans un bois, nous nous réfugiâmes sur des arbres, de peur d'être découverts. Nous étions sept ou huit. Le jour passa, la nuit revint et ses ombres nous permirent de continuer notre marche, dirigés par les étoiles, le long du rivage. Enfin nous nous sentîmes hors de l'atteinte de ces anthropophages : nous allions, nous nous reposions, mangeant des bananes et d'autres fruits du pays, jusqu'à ce que nous parvînmes dans une sorte de bois clair où abondait une eau douce excellente. Nous résolûmes de demeurer là, jusqu'à ce qu'un navire nous sauvât, ou que nous terminions notre vie. Trois moururent; nous n'étions plus que quatre. Un jour que nous allions le long de la plage, voici que nous aperçûmes une chaloupe en mauvais état, jetée par les flots sur le rivage, et dans laquelle gisaient plusieurs cadavres en décomposition. Elle était enfoncée dans la vase, battue par les vagues et fort avariée. Nous enlevâmes les cadavres pour les jeter à la mer et nettoyâmes la chaloupe. L'île fournissait une argile qui nous s’vit en guise de poix pour calfater l'embarcation. Nous fîmes un mât, des cordages avec des fibres de cocotier, des voiles avec des feuilles. La cale fut remplie de cocos, de fruits divers et d'une provision d'eau douce. Un ou deux parmi nous connaissaient la navigation, et quinze jours de voyage nous conduisirent à un village du Senf, après bien des souffrances. De là nous gagnâmes les Indes où, sur le récit de nos aventures, on nous fournit le nécessaire. Et nous étant séparés, chacun prit son chemin à sa volonté. Pour moi, je ne retournai à Basra qu'après une absence de quarante années entières. »
A cette époque, la plupart des gens de sa famille étaient morts. Son père avait laissé un fils. On refusa de le reconnaître. Lorsqu'on avait cessé d'avoir de ses nouvelles, ses biens avaient été partagés. Il n'en put rien recueillir, se trouva fort misérable et vécut jusqu'à sa mort dans un état précaire.
CXXIV. Un marin m'a rapporté qu'il avait fait la traversée de Sérira au Senf dans un sambouq. « Nous avions parcouru, dit-il, un espace de cinquante zama, lorsqu'une tempête fondit sur notre embarcation. On sacrifia une partie du chargement. La tempête dura plusieurs jours, et le vent devint si terrible qu'il n'y eut plus moyen de gouverner. Voyant notre perte imminente, nous voulûmes nous jeter à la mer et nous sauver dans une île voisine. Les ancres mouillées, nous nous croyions perdus, quand la tempête s'apaisa. Bientôt nous aperçûmes dans l'île une troupe de gens, et nous attendions que quelqu'un d'entre eux vînt à nous. Mais aucun ne bougea. Nous leur fîmes des signes qu'ils ne comprirent pas. Nous ne savions où nous étions, persuadés d'ailleurs que, si nous descendions à terre, ils nous feraient un mauvais accueil, et qu'il y avait plus loin une autre troupe qui tomberait sur nous, sans que nous pussions leur résister. Nous passâmes ainsi quatre jours, sans oser débarquer et sans qu'aucun indigène vînt à nous. Le cinquième jour, nous nous décidâmes pourtant, parce qu’il fallait renouveler notre provision d'eau et nous informer du chemin. Trente des nôtres allèrent à terre avec des armes, dans la chaloupe et les canots. A notre approche les gens prirent la fuite; un seul resta sur le rivage. Il nous adressa la parole dans une langue étrangère. Un des nôtres put le comprendre. « Cette île, dit-il, fait partie du Ouaqouaq; elle est située à trois cents parasanges de toute autre terre. Les habitants n'y sont qu'au nombre de quarante. » Interrogé sur la route à suivre pour gagner le Senf, il nous donna les indications nécessaires. Ayant fait de l'eau, nous remîmes à la voile vers le Senf, suivant ses instructions, et nous y abordâmes sains et saufs, après un voyage de quinze zama.
Ici finit le Livre des Merveilles de l’Inde.
Que la paix soit avec nous! Que Dieu nous ait en affection! quel excellent protecteur!
Gloire à Dieu y maître des mondes.
[88] Le lieu de Mâït, (Mâbit ou Mafit) est mentionné par Ibn-Khordadbeh comme point de départ de son itinéraire de la Chine. (Page 66 du texte arabe, p. 288 de la traduction de M. Barbier de Meynard.)
Sérira était aussi un port de relâche pour les navires allant de l'Inde à la Chine. Aboulféda (texte arabe, p. 368) dit que la ville était située sur un fleuve, dans une île (ou presqu'île) du même nom. Massoudi donne Sérira comme une île située à environ quatre cents parasanges du continent, parfaitement cultivée, et appartenant au Maharadja, ou chef de l'empire malais. (Voy. les Prairies d'or, I, p. 343.) Notre auteur dit lui-même un peu plus loin (Ch. IX) que Sérira se trouve à l'extrémité de l’île de Lâmeri, par conséquent vers les côtes de Sumatra.
[89] Le Mihran est l'Indus. Al-Biruni fait remarquer que certain écrivain, « dans la simplicité de son cœur et à cause de son peu de connaissance du cours des rivières et. de la configuration des mers, n a regardé ce fleuve comme un des bras du Nil, parce qu'on y trouve des crocodiles, comme dans celui-ci. On sait, dit M. Reinaud. qu'Alexandre le Grand, eut un instant la même idée. Si alors, comme dans les siècles postérieurs, certains affluents de l’Indus portaient le nom de Nil-ab (à cause de l’indigo), cultivé sur leurs bords ou de la couleur bleue de leurs eaux), la confusion s'expliquerait plus aisément par la similitude des appellations. Pour le mot men.
[90] « On trouve dans le commerce trois espèces de racines sous le nom de costus. Non seulement on ignore quelles sont les plantes auxquelles on doit les rapporter, mais on doute encore que les costus des modernes soient les mêmes que ceux des anciens. » (Dictionn. d’histoire natur. de Déterville, VIII, p. 156.)
[91] « Et si leur convient aussi donner aux hommes qui enchantent les grands poissons que il ne facent mal aux nommes qui vont soubs l'eau, pour trouver les perles, le xxe de tout ce que il prennent. Et nomment ces nommes qui enchantent ces poissons abrivaman, et leur enchantement dure celui jour seulement. Et sachiez aussi que ces Abrivaman savent enchanter les bestes et les oiseaux et toutes choses qui ont âmes. » (Marco Polo, édit. Pauthier, p. 607-608.)
[92] Au lieu de Dadanoura ou Dadâboura, je pense qu'il faut lire Sindaboura, qui en diffère à peine dans l'écriture arabe. (Voy. plus loin la note sur Sindabour.)
[93] Le récit fait voir que Samour et Soubâda ou plutôt Soubâra ne peuvent être fort éloignés de Dîmour, ville située aux environs de remplacement actuel de Bombay. Al-Biruni dit que Soubâra est à six parasanges de Sendân et à cinq parasanges de Tâna. (Fragm. relat. à l’Inde, p. 13 1). C’est sans doute la Soupara de Ptolémée, et l’Ouppara du Périple de la mer Erythrée. Les Arabes ont plus tard confondu ce nom avec celui de Sofala, appelant cette ville Sofala de l’Inde, et la véritable Sofala Sofala des Zindjs. M. Reinaud pense que Soubâra est l’antique Ophir des livres saints. (Voy. Mém. sur l’Inde, p. 221.)
Les mots batak, thélah (ou théladj) et djéram sont des termes malabares que l'auteur arabe prend soin d'expliquer.
Dîmour, qu'il faut assurément identifier au pays nommé ailleurs Sîhour (XCI, XCIII) était, dans les premiers siècles de l'hégire, une place de commerce très importante de l'Inde. Al-Biruni la nomme Djîmour; Massoudi et Ibn-Haukal Séîmour. Dès le ixe siècle, on y comptait dix mille musulmans établis arec leur famille. Ces étrangers avaient. comme on le voit au paragraphe XCI, leur juge spécial pris parmi leurs coreligionnaires. (Voy. l’Introduction à la Géogr. d’Aboulféda, p. cccxlix. On peut voir aussi la Géographie d’Edrici, trad. Jaubert, I, p. 172.)
[94] On trouve dans un passage d'Al-Biruni sur l’Inde la contrepartie de l’aventure du marchand Ishak. L'écrivain rapporte qu'un marchand de légumes de la ville de Balabhi (dans le Guzarate) était devenu si opulent qu'il achetait toutes les propriétés à vendre dans le pays. Le souverain voulut avoir part aux richesses de son sujet, et demanda une somme que le marchand lui refusa. Puis celui-ci craignant les suites du ressentiment du prince, se réfugia chez un roi voisin, y acquit à force d'or une flotte et une armée nombreuses, revint à Balabhi, surprit la ville, s'empara du roi et le mit à mort. (Voy. Mém. sur l’Inde, p. 104.)
[95] Le mihrdjan, dans le calendrier persan, correspond à l'équinoxe d'automne. On peut voir dans d'Herbelot (Biblioth. orientale), aux mots Naurouze et Féridoun, à quelle occasion, suivant la légende, fut établi ce jour de fête.
[96] Sekbâdj ou sikbâdj est la forme arabe du mot persan sikbah, mot formé de sik vinaigre, et bâh, bouillon, bouillie. Le sikbâdj est un ragoût fait de viande, de farine et de vinaigre. M. Barbier de Meynard traduisant une anecdote de Massoudi où le sikbâdj joue le principal rôle, explique ce mot par « vinaigrette de viande hachée et assaisonnée de miel ». (Voy. les Prairies d’or, VII, 220.) Freytag indique aussi le miel comme partie intégrante de ce mets. Castelli, Meninski, Richardson sont muets là-dessus, et peut-être ont-ils raison.
[97] Louïn ou Laouïn est sans doute identique à Louqîn, ville dont il est question dans une relation arabe du xe siècle (voir Reinaud, Introd. à la Géogr. d'Aboulféda, p. cdxvi), et aussi dans le Livre des Routes d'Ibn-Khordadbeh (p. 66 du texte arabe). On trouve aussi ce nom sous la forme alouqîn, qu'on peut lire el-waqîn, en prenant al pour l'article arabe. Ibn-Khordadbeh dit que cette ville est le premier point de relâche en Chine (trad. Barbier de Meynard, p. 292) ; il ajoute qu'on peut aller de ce port important à Khanfou en quatre journées par mer et vingt journées par terre. (Ibid.)
[98] Au lieu de Bérira, il faut lire Berbéra. La mer de Berbéra est le golfe d'Aden, en tout ou en partie. Voici, d'après la traduction de M. Reinaud, ce qu'en disait Aboulféda : « Le canal Berbéri est un bras de mer qui se détache de la mer de l'Inde, au midi de la montagne du Mandeb et du pays de Habesch (Abyssiniej, et qui se prolonge à l’occident jusqu'à la ville de Berbéra dans le pays des Zendj... La longueur de cette mer, de l'est à l'ouest, est d'environ cinq cents milles. On raconte au sujet des vagues de cette mer des choses extraordinaires. Le shérif Edrisi rapporte que les flots s'y élèvent comme de hautes montagnes sans se briser. Il ajoute que c'est par cette mer que l’on se rend à l'île de Canbalou, île occupée par les Zendjs, et où se trouvent des Musulmans. » (P. 30 et 31.)
A l'époque d'Aboulféda (xive siècle), les habitants de Berbéra avaient beaucoup perdu de la sauvagerie que leur attribue notre auteur. « La plupart des habitants, dit le célèbre géographe, ont embrassé l'islamisme; c'est pour cela qu'on ne trouve plus dans les pays musulmans d'esclave appartenant à cette peuplade. » (P. 232.) L'île de Canbalou paraît être Madagascar, dont les habitants étaient déjà musulmans dès le xiiie siècle, comme le témoigne Marco Polo : « Les naturels (de Madagascar) sont sarrasins et adorent Mahomet. » (Edit. Charton, p. 415.).
Trois siècles avant Aboulféda, Massoudi donne sur la mer de Berberi des détails semblables à ceux qu'on vient de lire. (Les Prairies d'or, I, 231, 232.) Déjà à cette époque les habitants de Canbalou avaient embrassé l'islamisme. Au sujet des vagues terribles de cette mer, « vagues qui ressemblent à de hautes montagnes, puis se creusent en profondes vallées et ne se brisent pas, » Massoudi rapporte un refrain que chantaient les marins arabes en abordant ces parages :
« Berbéra, Djafouna, que vos vagues sont folles !
« Djafouna, Berbéra, leurs vagues, les voilà ! »
[99] Il est fait plusieurs fois mention du crocodile dans ces historiettes. Nous pensons qu'en plusieurs passages il faudrait lire requin. Les Arabes n’ont pour ainsi dire pas de mot pour désigner ce squale, et le Dictionnaire français-arabe d’Ellious Bocthor en est réduit à traduire requin par kelb bahri « chien marin ».
[100] « Lorsqu'un roi vient à mourir dans l’Inde ou qu’il est tué, beaucoup de personnes se brûlent volontairement. On appelle ces victimes belandjeriyeh, au singulier belandjer, comme qui dirait « amis sincères » du défunt, mourant de sa mort et vivant de sa vie. » (Massoudi, les Prairies d’or, trad. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille, tome II, p. 87.) L’Adjaïb-al-Hind écrit balâoudjer, balâoudjeriya.
[101] Par salît il faut entendre de l'huile. Le mot se dit de l'huile d'olive, de l'huile de sésame, etc.
[102] D'après les prescriptions de la loi musulmane, « on est obligé pour lâcher de l’eau de s'accroupir comme les femmes, de peur qu'il ne tombe quelque goutte d'urine dans les chausses. Pour éviter ce péché, ils expriment avec grand soin le canal par où elle a passé et en essuient le bout contre la muraille ; on voit en plusieurs endroits (à Constantinople) des pierres toutes usées par ces frottements. Quelquefois les Chrétiens pour se divertir frottent ces pierres avec le fruit du Poivre d’Inde, avec de la racine du Pied-de-veau ou de quelques autres plantes brûlantes, en sorte qu'il survient souvent une inflammation à ceux qui viennent s'y essuyer. » (Tournefort, Voyage du Levant, II, p. 335.)
[103] Sendan, ville de la côte occidentale de l'Inde. D'après un géographe cité par Aboulféda (page 159 du texte arabe), elle était a quinze parasanges de Mansoura (du Sind). On y trouvait le costus, la canne, le bambou, était un des lieux de relâche les plus célèbres.
[104] Au sujet des ablutions qui, chez les musulmans, doivent suivre l'acte naturel dont il est ici question, voici ce que rapporte le même voyageur :
« Quand les Turcs vont à la garde-robe chez eux ou à la campagne, ils font provision de deux grands mouchoirs qu'ils portent à leur ceinture, ou qu'ils mettent sur les épaules comme les maîtres d'hôtel font la serviette : dans cet équipage ils portent à la main un pot plein d'eau qui leur sert pour faire le tahârat, c'est-à-dire pour se laver et relaver le fondement avec le doigt. Le Grand Seigneur lui-même ne saurait s'en dispenser, et c'est la première instruction que son gouverneur lui donne; il est à présumer qu'après cette opération les Turcs se lavent et s’essuient souvent le bout des doigts. Ce n'est pas là le seul inconvénient, il peut survenir bien des choses qui rendent cette ablution inutile, et qui obligent à la recommencer de nouveau, par exemple, si on laisse échapper quelque vent ; mais le malheur est bien plus grand si on a le cours de ventre, auquel cas cette ablution qui doit être souvent réitérée, devient une cérémonie très fatigante. J'ai ouï dire à des Turcs qu'une des principales raisons qui les empêchait de voyager en pays de chrétienté, c'était de ne pouvoir pas faire de pareilles fonctions assez à leur aise... Au défaut d'eau, ils peuvent se servir de sable, de poussière, ou de quelques plantes propres pour se nettoyer. Le chapitre que Rabelais a fait et qui porte un assez plaisant titre (liv. Ier, chap. xiii), leur serait d'un grand secours si on le traduisait en leur langue. » (Voyage du Levant, tome II, 336, 337.)
[105] Koulam-Méli (ou Koulam-Malay) est un port de la côte du Malabar, un peu au nord du cap Comorin. Il est mentionné dans la Relation de Soleïman : « D'Oman, les navires mettent à la voile pour l’Inde et se dirigent vers Koulam-Malay ; la distance est d'an mois de marche avec un vent modéré. A Koulam-Malay il y a un péage qui sert pour la contrée et où les navires chinois acquittent les droits. On y trouve de l'eau douce fournie par des puits. » (Edit. Charton, p. 105.) Koulam, en langue tamoule, signifie bassin, étang. Marco Polo mentionne la même ville sous le nom de Coillon.
[106] Lorsqu’une personne avance en âge, soit homme soit femme et que ses sens s’appesantissent, elle prie quelqu'un de sa famille de la jeter dans le feu ou de la noyer dans l'eau, tant les Indiens sont persuadés qu'ils reviendront sur la terre. » (Relation d'Abou-Zeïd Haçan, ubi supra, p. 143.)
Mon manuscrit arabe écrit le nom du lieu où s'accomplissent ces suicides sans aucun point diacritique, ce qui en rend la lecture absolument incertaine. On pourrait lire Kastanâb.
[107] Le Mandoûrîn ou Mendourîn ici nommé est vraisemblablement identique à Mendoûrafin, pays situé, dit Massoudi (I, p. 304) vis-à-vis de Sérendib. L'auteur des Prairies d’or n’en dit rien de plus et renvoie à un autre de ses ouvrages, qui malheureusement ne nous est point parvenu.
[108] Lameri ou Lâmiri (dans Marco Polo, Lanbri, Lambris, Labrin) est une région de Sumatra, ainsi que Fansour (dans Marco Polo Fansur, Fandur). La Chronique malaise déjà citée conte la conversion à l'islamisme des habitants de Fasouri et de Lamiri. (Voy. Chedjarat Malayou, texte malais, p. 109 et suiv.)
Il est difficile de comprendre par ce récit si les régions ainsi nommées font partie de la grande terre de Sumatra ou forment des îles séparées.
La qualification d'île que leur donnent quelques écrits arabes ne peut trancher la difficulté; car le mot djézira se dit également d'une presqu'île et d'une île.
Aboulféda dit que « la ville de Fansour, située dans l’île de Djâoua (c'est-à-dire Sumatra, et non Java) produit le camphre appelé Fansouri. » (Texte arabe de MM. Reinaud et de Slane, p. 369.)
Dans la Relation du Frère Oderic de Frioul, écrite en latin en 1330 et traduite vingt ans plus tard par un moine de Saint-Bertin, il est aussi parlé de Lâmeri, que l'auteur appelle Lamory :
« De ceste contrée m'en alay vers midy par la mer d'Océane cinquante jours en une isle qui a nom Lamory... Ceste terre est très bonne, car il y a grant plante (abondance) de chars (chair), de blés, de riz et de clous de girofle, et de tous autres biens. Les gens y sont très mauvais et très cruelz. Ilz mengent char humaine. Les marchans des estrangés pays y apportent les enfans pour vendre. Et quant ces gens cy es ont achetez, ils les tuent et mengent. Plusieurs autres choses treuve on en ceste isle, lesquelz je ne n’escriprai point cy. » (Voy. Louis de Backer, L'extrême Orient au moyen âge, p. 105.)
La girafe n'existe pas dans les contrées de l’archipel malais dont il est ici question. D'ailleurs, au xe siècle, les Arabes connaissaient assez la girafe pour ne la point regarder comme un animal redoutable. Massoudi (les Prairies d’or, III, p. 3 et 4) en donne une description assez exacte. « On n'est pas d'accord sur son origine, dit-il ; les uns la considèrent comme une espèce de chameau; d'autres disent qu'elle provient de l'accouplement du chameau et de la panthère (à cause de sa robe tachetée) ; d'autres enfin pensent que c'est une espèce particulière et distincte, comme le cheval, l'âne, le bœuf, et non le produit d'un croisement. » L'auteur arabe ajoute qu'une longue notice sur la girafe se trouve dans le grand ouvrage d'Aristote sur les animaux (ibid., p. 5), et, plus loin, que la girafe est remarquable par sa douceur.
Il est question dans Marco Polo des prétendus hommes à queue de cette région: « Il y a en ce pays (Lanbri) une autre merveille : en tout le royaume sont des hommes qui ont une queue de plus d'une paume ; ils sont tous velus et forment la majeure partie des habitants; ils demeurent dans les montagnes et non dans la cité ; leur queue est grosse comme celle d'un chien.» (Edit. Charton, p. 390.) Il s'agit sans doute ici de singes anthropomorphes. Chez les Malais, l'expression orang-houtan, littéralement « homme des bois » s applique également aux sauvages et aux singes.
[109] L'île Néyân, située quelque part dans l’archipel de la Sonde, doit être cherchée, d'après M. Maury, à la pointe d'Achen ou parmi les îles qui longent la côte nord-ouest de Sumatra. Voici ce qu'en dit le marchand Soleïman : « Ces Iles (de la Sonde) ont dans leurs dépendances d'autres îles, parmi lesquelles est celle d'Al-Neyan. Elles abondent en or, et les habitants se nourrissent du fruit du cocotier. Ils s'en servent dans la préparation de leurs mets et ils se frottent le corps avec son huile. Quand un d'eux veut se marier, il ne trouve de femme qu'autant qu'il a entre les mains le crâne d'un de leurs ennemis ; s il a tué deux ennemis, il peut épouser deux femmes ; s’il en a tué cinquante, il peut épouser cinquante femmes, suivant le nombre des crânes. L'origine de cet usage vient de ce que les habitants de ces îles sont entourés d'ennemis; celui onc qui se montre le plus hardi dans les combats est le plus estimé de tous. » (Voy. Les Deux Mahométans, p. 100, 101.)
[110] Marco Polo accuse aussi d'anthropophagie les habitants de Sumatra : « Quand aucuns d'eux est malade, n'envoient querre leurs enchanteurs. Et ceux leur demandent si le malade doit guérir ou non de celle maladie. Et se il doit mourir, si comme ils devinent, si envoient querre hommes qui sont juges, à mettre à mort ces malades qui sont jugiés par enchanteurs qui doivent mourir ; et viennent, et mettent au malade tant de robes sur la bouche qu'ils l’éteignent. Et quand il est mors, si le font cuire ; si s'assamblent tous les parens au mort et le menguent. Et si vous di que ils succent les os si bien qu’il mourraient par deffaulte de mangier. Hz dient que la mort de ces vers rame du mort en seroit chargiée; si que pour ce ils menguent tout... Et sachiez que, se ils prenaient aucun autre homme qui ne fut de leur contrée et ne se peust racheter par monnaie, il l’occiraient et le mengeraient maintenant. Si que ce est une moult mauvaise coutume et moult périlleuse. » (Edit. Pauthier, p. 675, 676.)
Oderic de Frioul, dans le passage suivant, a tout l’air d'avoir copié Marco Polo :
« De ceste isle m'en alay vers midy jusques à une isle qui a nom Dondim. En ceste isle a les plus merveilleuses gens et la plus mauvaise qui soit ou monde. Ilz menguent char crue, et toutes manières de autres ordures treuve on en eulz et toutes manières de crualitez. Car li père mengue le filz et le filz le père, ly marys sa femme et la femme son mary. Et se le père ou la mère de aulcuns est malades, li filz s'en va à un astronomien, c'est-à-dire au prestre de leur loy et lui dist : Sire, alez à nostre dieu et lui demandez et sachiés se mon père ou ma mère eschappera de ceste maladie. Dont vont ensamble cilz prestres et cilz filz à leur idole qui est d'or ou d'argent, et luy font oroison et luy demandent se le malade mourra de la maladie ou non. Ly diables respont par la bouche de Tydole selonc la demande. S'il respont que ly pères ne mourra point, ly filz prent songneusement garde jusques à tant qu’il sera garis. Et se ly dyables respont que il doibt mourir, ly prestres vient au malade et lui met une paume sur la bouche et le estaint et le tue. Le père mort vient ly filz et le coppe par pièches; puis mande tous ses amis et les héraux de la contrée et le menguent à grant joie et à grant feste et chantent et ballent à grant solemniptez. Tous les parens et amis du mort qui à le mengier ne sont point appeliez en sont moult honteux et se tiennent à moult vilennez et vergondez de cest affaire.
Moult les reprenoye en disant que c'estoit à contraire à toute raison du monde, car chien ne loups ne mengeroient pas de leur semblable se on leur donnoit. Comment donc ont gens raisonnables couraige de ce faire. Ilz respondoient : Nous le faisons affin que li vers ne les mengue. Car si les vers rongeoient sa char, son ame en souffriroit trop grant paine. » (Relation d'Oderic de Frioul. Voy. L. de Backer, L’extrême Orient au moyen âge, p. 112.)
[111] Les îles de Ladjialous, ou, comme on lit dans d'autres ouvrages arabes , Likbalous, Lengbalous, Lengalous, Lendjebalous , sont situées, au dire d'Ibn Khordadbeh (trad. Barbier de Meynard, p. 288), à dix ou quinze journées de navigation de Sérendib (Ceylan), à six joumées de Kalat (côte occidentale de la presqu'île de Malaka); ces indications s'accordent assez bien avec l’opinion de Rienzi, de M. Maury et des géographes qui assimilent ce groupe d'îles à l’archipel de Nicobar.
« Toutes les personnes qui voyagent sur mer, dit Al-Biruni, savent que les habitants de Lankabalous sont sauvages et même anthropophages. »
Des voyageurs modernes ont encore accusé les indigènes de Nicobar d'aimer la chair humaine. Rienzi combat cette accusation, qui ne lui paraît aucunement fondée.
[112] On connaît les aventures de Sindbad dans la vallée aux diamants (2e voyage, 73e nuit dans les Mille et une Nuits, de Galland). Marco Polo donne sur la manière dont on recueille les diamants des détails parmi lesquels on retrouve des particularités tout à fait pareilles à celles que relate notre auteur : « En ce royaume (de Mutfili, Matsuli-Patam ) on trouve les diamants de la manière que je vais vous le dire : Sachez donc qu'en ce pays il y a plusieurs montagnes où l’on ramasse les diamants : quand il a plu. l'eau descend des montagnes par de grands ruisseaux ou bien entre dans de grandes cavernes ; or, quand la pluie a cessé et que l’eau a disparu, on va chercher dans ces ruisseaux qu’elle avait formés et on y trouve beaucoup de diamants. Et l’été, quand il ne tombe pas une goutte d'eau, on en recueille dans les montagnes; mais il y fait une si grande chaleur qu'à peine peut-on l'endurer. En outre, il y a une grande multitude de serpents, grands et gros, en sorte qu'on ne peut y aller sans danger ; cependant on explore ces montagnes tant qu'on peut et on y trouve de belles et grosses pierres. Les serpents sont si venimeux et si méchants que les naturels n'osent aller dans les cavernes où ils se tiennent ; mais ils ont un autre moyen de prendre des diamants. Il y a, dans leur pays, de grandes rallées et des précipices si escarpés que nul ne peut y aller ; mais voici ce qu'ils font : ils prennent plusieurs morceaux de viande et les lancent dans ces précipices; cette chair tombe sur des diamants qui s'y attachent. Or dans les montagnes vivent des aigles blancs qui font la chasse aux serpents, quand ces aigles aperçoivent la viande au fond des précipices, ils fondent dessus et l'emportent; mais les hommes, qui ont suivi les mouvements de l'aigle, dès qu’ils le voient posé et occupé à manger la viande, se mettent à pousser de grands cris; l'aigle épouvanté s'envole sans emporter sa proie, de peur d'être surpris par les hommes; alors ceux-ci arrivent, prennent la viande et ramassent les diamants qui y sont attachés. Souvent aussi, quand l'aigle a mangé les morceaux de viande, il rejette les diamants avec ses ordures, de sorte qu'on en retrouve dans leur fiente. Ce sont là les trois manières dont les naturels recueillent les diamants. Et sachez qu'il n'y a au monde que ce royaume où l'on trouve des diamants; il y en a là beaucoup et de beaux, car les plus beaux ne viennent pas chez nous chrétiens, mais ils sont portés au grand khan et aux rois et barons de ces pays ; car tous ces princes ont de grands trésors et achètent toutes les pierres précieuses. » (Edit. Charton, p. 398.)
[113] Au lieu de El-Tîr, que porte mon manuscrit, je pense qu'il faut lire El-Tîz, en mettant sur le ra final un point qui le transforme en z. Tîz était la principale ville du Mekran, région méridionale et maritime du Beloutchistan actuel, la Têsa ou Teîsa de Ptolémée. On remarquera que le conteur de l'historiette est appelé Beloudji.
[114] L'anthropophagie des habitants d'Andaman est signalée dans la relation de Soleïman : « Au-delà sont deux îles séparées par la mer Andaman. Les habitants de ces îles mangent les hommes vivants ; leur teint est noir, leurs cheveux sont crépus, leur visage et leurs yeux ont quelque chose d'effrayant. Ils n'ont pas de barques, et, s'ils en avaient, ils mangeraient tous les hommes qui passent dans leur voisinage. » Massoudi (tome Ier, 339) dit aussi qu'ils dévorent les cadavres que la mer jette sur leurs côtes, et traitent de même les équipages que le hasard fait tomber entre leurs mains. Il paraît que la population actuelle des îles Andaman, ou Endamen, diffère peu, comme aspect et comme mœurs, de celle que l'auteur arabe décrivait il y a près de mille ans.
Marco Polo parle d'une île d'Angaman, dont « les naturels sont moult cruels et mangent tous les nommes qu'ils peuvent prendre, pourvu qu’ils ne soient pas de leur race ». Mais il y a, ce semble, quelque difficulté à assimiler cette Angaman « île bien grande » avec une quelconque des Andaman.
[115] Mahradj est l’expression indienne ...—._ radia « grand roi ». Galland écrit « le roi Mihrage ».
[116] Les deux villes d’Ayla et de Biârah, ici nommées, sont évidemment situées dans le golfe Persique ou sur le Chatt-el-Arab. Il a été ci-dessus question d'une autre Ayla bien connue, bâtie au fond du golfe Elanitique.
[117] Sîhour doit être identifié à Dîmour. Dans l'écriture arabe, ces deux mots offrent assez peu de différence à l’œil pour qu'un copiste les puisse confondre aisément.
Le mot que je transcris ici et plus loin par hebermen est fort mal écrit dans mon manuscrit arabe. Ma transcription est une simple conjecture. Ce pourrait être le mot que les divers manuscrits de Marco Polo écrivent abraiaman, abraiamin, abrainian, braianian, abrajoni, et qui paraît être une corruption de brahmane. Dans notre texte, ce terme signifie évidemment le chef, le juge, le syndic des marchands arabes établis dans le pays. Plus loin (CVI) l'auteur explique lui-même que ce personnage remplit les mêmes fonctions que le cadi en pays musulman. Dans l'historiette LXXXVII on lit sarhîn, mot qui, dans récriture arabe, n'offre pas une très grande différence avec brahman.
[118] Le sâdj, en sanscrit sâka, est le bois de teck.
[119] Dans une anecdote précédente, dont je n'ai pas inséré ici la traduction, faute de l'avoir bien comprise, on trouve le passage suivant : « Je me sauvai et parvins au Chatt-el-Arab, c'est-à-dire Chedjer-Nâr.». lut sultan de l'Oman prit six cent mille dinars pour la dîme des marchandises qui étaient dans mon navire. » Ce nom Chedjer-Nâr paraît identique au Chedjer-Tan ou Chedjer-el-Ban dont il est ici question. Le heu ainsi désigné est évidemment situé sur quelque côte du golfe Persique. Chedjer en arabe signifie arbre , et le géographe Edrici cite plusieurs localités de la Péninsule arabique ainsi appelées.
Le coton halîdj est le coton nettoyé, ce que le commerce appelait autrefois coton en rame. (Voy. l'article Rame dans mon Dictionn. étymol. des mots d’orig. orient.)
[120] Qâratil est le pluriel arabe d'un mot qartal, que Massoudi explique par séif ma'oudj « sabre recourbé » (les Prairies d’or, tome III, p. 9). Les éléphants de guerre du prince de Mansoura avaient la trompe armée d'un sabre de cette espèce, avec lequel l'animal perçait ou tranchait tout ce qui se présentait devant lui.
[121] « Tâna, dit Marco Polo, est un royaume vers l’Occident (de la presqu'île indienne) moult grand et bon. Ils ont un roi particulier et ne payent tribut à .personne; ils sont idolâtres et ont un langage particulier... De ce royaume sortent maints corsaires qui vont par la mer faisant grand maux aux marchands, et cela de la volonté même du roi, car il est convenu avec eux qu'ils lui donneraient tous les chevaux qu'ils prendraient; et ils en prennent souvent... Les chevaux donc sont pour le roi ; l'or, l'argent, les pierres précieuses et les autres marchandises pour les corsaires. Or c'est là une mauvaise chose et qui n'est pas juste. » (Edit. Charton, p. 409.)
Tâna est marquée par Al-Biruni comme étant à cinq parasanges de Soubara. Dans son édition du Livre des routes, d'Ibn-Khordadbeh, M. Barbier de Meynard lit Bâna (Baneh). Jaubert lit aussi Bâna dans sa traduction d'Edrici (tome Ier, p. 179).
Le mot tâna, dans les langues de l'archipel indien, signifie « terre ».
La situation de Tâna est parfaitement déterminée; la ville était bâtie sur la côte occidentale de l'île de Salcette.
[122] Le même fait et dans des termes presque identiques est rapporté par Abou-Zeïd-Haçan : « Autrefois il n'était pas rare, dans cette île (Sérendib), de voir un homme du pays s'avancer dans le marché, tenant à la main un kris, c'est-à-dire un khandjar particulier au pays, d'une fabrication admirable et parfaitement aiguisé. Cet homme s'attaquait au marchand le plus considérable qui se trouvât sur son passage; il le prenait à la gorge, faisait briller le khandjar devant ses yeux ; puis il le tirait hors de la ville. Tout cela se passait au milieu de la foule des assistants, et cependant il n'était au pouvoir de personne de réprimer cet excès ; car si on essayait d'arracher le marchand à cet homme, il tuait le marchand, puis il Se tuait lui-même. Quand le voleur avait tiré le marchand hors de la ville, il lui proposait de se racheter; quelqu'un venait avec une forte somme d'argent, et le marchand était mis en liberté. Cela dura pendant un certain temps. Mais, à la fin, le trône échut à un prince qui ordonna de saisir, n’importe
£ar quel moyen, tout Indien qui aurait une telle audace. L'ordre fut exécuté. A la vérité l'Indien tua le marchand et se tua lui-même; ce cas se reproduisit plusieurs fois, et un grand nombre d'indigènes et de marchands arabes trouvèrent ainsi la mort. Mais on finit par se lasser; ce genre d'attaque cessa, et les marchands n'eurent plus à craindre pour leur personne. (Les Deux Mahométans, Ed. Charton, p. 143.)
Le même écrivain arabe, pour montrer le peu de cas que certains Indiens font de leur propre vie et leur dédain de la souffrance physique, rapporte qu'un jour un montagnard faisant plier la tête d'un bambou jusqu'à terre y attacha solidement ses cheveux, prit son khandjar et dit aux assistants : « Je vais me couper la tête avec ce khandjar. Lorsqu'elle sera séparée du tronc, lâchez le bambou à l'instant même. Au moment qu'il reprendra sa position primitive, entraînant ma tête avec lui, vous me verrez rire, et vous entendrez un petit bruit que je ferai en riant. » « Ce récit, ajoute Abou-Zeïd-Haçan, nous a été fait par un homme dont le témoignage ne peut être révoqué en doute. La chose est d'ailleurs connue de tout le monde, d'autant plus que la partie de l'Inde où le fait s'est passé est assez rapprochée du pays des Arabes et que nous avons continuellement des nouvelles de cette contrée. »
« Me trouvant à Salmour (côte de Malabar), dit Massoudi, je fus témoin du fait suivant. Un jeune homme du pays venait d'accomplir les tournées que j'ai décrites plus haut à travers toutes les places de la ville. Lorsqu'il fut arrivé près du bûcher, il prit son poignard et le plaça sur sa poitrine qu'il fendit. Puis, introduisant sa mam gauche dans la plaie, il saisit son foie, en tira un bout, tout en causant avec ceux qui l'entouraient, le coupa avec le poignard, le donna à l'un de ses frères, comme pour témoigner hautement de son mépris de la mort et du plaisir qu'il ressentait à quitter la vie, et se précipita dans le feu. » (Les Prairies d’or, trad. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille, II, p. 86.)
A Java, où des missionnaires de l'Inde avaient depuis longtemps acclimaté les doctrines brahmaniques, Ibn-Batouta rencontra des hommes qui ne méprisaient pas moins l'existence. « J'ai vu, dit-il, pendant l'audience du sultan, un homme qui tenait à la main une sorte de serpette. Il la plaça sur son propre cou et se mit à parler longtemps dans une langue que je ne compris point. Après cela, il saisit la serpette avec les deux mains à la fois et se coupa la gorge. Sa tête tomba à terre, tant l'arme était bien affilée et tant il y mit de force. » (Tome IV, p. 246.)
Les Hindous de notre siècle ont donné lieu à des observations du même genre. « Si l'on a l'air de vouloir attaquer un Bhât chargé d'une somme d'argent, dit M. Xavier Raimond, il annonce qu'il va commettre le Trâga. Si la menace ne suffit pas, il s'apprête alors à la mettre à exécution. Il se plonge d'abord un poignard dans les flancs, et ensuite dans le cœur, si on continue à résister... Les Brahmanes ont une coutume à peu près semblable. Ils viennent s'asseoir à la porte d'un homme, un poignard ou du poison à la main et ils annoncent qu'ils vont se tuer s'il n'accède pas à leurs demandes. » (L’Inde, p. 255.) Quelques pages plus loin le même écrivain ajoute : « Leur mépris de la mort est une chose incroyable, rapprochée surtout de la timidité qu'ils montrent ordinairement quand il s'agit de lutter contre des maux presque légers. Lorsque son sort lui semble résolu, le dernier des Hindous l’attend et s'y soumet avec un sang-froid qui exciterait l'admiration en Europe ; il cause presque gaiement avec ses amis, et il attend rapproche de la mort sans que sa sérénité en soit aucunement troublée. »
[123] Sila est un mot des langues malaise et javanaise qui marque une façon particulière de s'asseoir, les jambes croisées sous soi. C'est le sanscrit cil, méditer dans la posture qu'on donne au Bouddha.
[124] Sindâbour, d'après Aboulféda (texte arabe, p. 359), était sur une baie de la mer Verte (mer d'Oman), à trois journées de voyage de Tana; là finissait le Guzerate et commençait le Manîbâr (Malabar). Les ports de relâche Sendân, Sîhour, Sindâbour paraissent avoir été relativement peu distants les uns des autres, dans les parages de Bombay. Massoudi (Prairies d'or, t. I, 207) cite la Baie de Sindâboura, comme un des habitats du crocodile.
[125] « Dans l'Inde comme dans la Chine, la filouterie, pour un objet léger ou considérable, est un cas de mort. » (Relation de Soleïman, Les Deux Mahométans, édit. Charton, p. 118.) Chez les musulmans, la peine pour le vol ne va pas au-delà de l'amputation de la main droite ou de cette main et du pied gauche.
Voici quelques anecdotes, empruntées au voyageur Ibn Batouta, qui montrent que de son temps (xive siècle) les Indiens ne s'étaient pas relâchés de leur rigueur à l'égard des voleurs.
« Je n'ai pas vu de chemin plus sûr que celui-là (côte malabare) ; car les Hindous tuent l'homme qui a dérobe une noix. Aussi quand quelque fruit tombe par terre, personne ne le ramasse jusqu'à ce que le propriétaire le prenne. On m'a raconté que plusieurs Hindous passèrent par ce chemin et qu'un d'eux ramassa une noix. Le gouverneur, ayant appris cela, ordonna d'enfoncer en terre un pieu, d'en tailler l'extrémité supérieure, de fixer celle-ci dans une tablette de bois, de sorte qu'une portion dépassât au-dessus de la planche. Le coupable fut étendu sur cette dernière et fiché sur le pieu, qui lui entra dans le ventre et lui sortit par le dos; il fut laissé dans cette posture pour servir d'exemple aux spectateurs. Sur ce chemin, il y a beaucoup de pieux semblables à celui-là, afin que les passants les voient et en tirent un avertissement. » (Trad. Defrémery et Sanguinetti, tome IV, p. 74.)
« On m'a raconté que le souverain de Caoulem (Koulam) monta un jour à cheval pour se promener hors de la ville. Or son chemin passait entre des jardins, et il avait avec lui le mari de sa fille, qui était un fils de roi. Ce personnage ramassa une mangue qui était tombée hors d'un des jardins. Le sultan avait les yeux sur lui ; il ordonna à l’instant de lui fendre le ventre et de partager son corps en deux ; une moitié fut mise sur une croix, à droite du chemin, et l'autre à gauche. La mangue fut divisée en deux moitiés, dont chacune fut placée au-dessus d'une portion du cadavre. Ce dernier fut laissé là pour servir d'exemple aux regardants. » (Ibid. p. 102.)
« Parmi les événements analogues qui arrivèrent à Calicut, se trouve le suivant : Le neveu du lieutenant du souverain prit par force une épée qui appartenait à un marchand musulman. Celui-ci se plaignit a l'oncle du coupable, et en reçut la promesse qu'il s occuperait de son affaire. Là-dessus le dignitaire s'assit à la porte de sa maison. Tout à coup, il aperçoit son neveu portant au côté cette épée; il l’appelle et lui dit : « Ceci est le sabre du musulman. — Oui, répond le neveu. — Le lui as-tu acheté ? reprend son oncle. — Non, » répliqua le jeune homme. Alors le vice-roi dit à ses satellites : « Saisissez-le. » Puis il ordonna de lui couper le col avec cette même épée. » (Ibid., p. 102, 103.)
[126] Au lieu de Djend, que porte ma copie arabe, je lis Sind; l'expression Hind et Sind est très ordinaire chez les écrivains orientaux pour désigner les Indes.
[127] Les îles Dhibadjat sont les îles Maldives et les Laquedives. Ce nom, qui a la forme d'un pluriel persan de dhibah, vient sans doute de l'indien dib, diba, dhuipa, île, mot qui entre aussi dans la composition des noms des Maldives, des Laquedives, de Sérendib, etc. Dhibadjat signifierait donc « les îles, l'archipel ». Le doum est un cocotier. Le premier groupe dont parle notre auteur est donc « l'archipel des cocotiers », celui qu'Al-Biruni appelle Divah-Kouzah, îles des cauris: les cauris sont, comme on sait, des coquillages servant de monnaie, qu'on recueille sur les branches des cocotiers placées sous l’eau prés du rivage. Quant au mot kastedj ou koustoudj, il se dit des fibres du cocotier dont on fait du fil et des cordages: l'archipel du Kastedj est le Divah-Kanbar d'Albirouni, kanbar, d'après le savant arabe, signifiant « le fil obtenu des fibres du cocotier et avec lequel on coud les navires ». La relation d'Al-Biruni ne sépare pas les Dhibadjat en deux archipels, mais en deux classes d'Iles dénommées suivant la nature de leur principal produit. (Voir la traduction de M. Reinaud dans ses Fragments arabes et persans relatifs à l'Inde, p. 124 du tirage à part.)
[128] Sebâ paraît être ici un nom de lieu. J’ignore quelle en serait la situation. Ce ne peut être Saba d'Arabie, si ce nom, comme l'indique Aboulféda, s'applique à l'antique ville de Mareb, qui est profondément enfoncée dans les terres.
[129] Les Djinns sont des démons, des génies généralement malfaisants. Dans beaucoup de localités, des cours d'eau souterrains, par les bruits sourds qu'ils font entendre, ont donné naissance à des croyances du même genre que celle qui est ici relatée.
[130] « Parmi les transformations de l’eau les plus singulières . on cite la montagne du Yémen, du sein de laquelle jaillit une source, qui se répand sur ses parois et se solidifie, avant d'arriver à terre. Elle forme un beau cristal blanc nommé yémany. »
(Ibn-Khordadbeh, Le Livre des Routes et des Provinces, trad. Barbier de Meynard. Journ. asiat., 1865, tome Ier, 522.)
[131] (CX.) Ibn-Batouta a vu, vers l’année 1343, l'arbre dont il est ici question ou un arbre analogue. « Je vis que la mosquée (à Deh Fattan, côte malabare) était située près d'un arbre verdoyant et beau, dont les feuilles ressemblaient à celles d’un figuier, sauf qu'elles étaient lisses. Il était entouré d'une muraille et avait près de lui une niche ou oratoire, où je fis une prière de deux génuflexions. Le nom de cet arbre, chez les gens du pays, était « l'arbre du témoignage ». On m'a rapporté en cet endroit que tous les ans, quand arrivait l'automne, il tombait de cet arbre une feuille, dont la couleur avait déjà passé au jaune, puis au rouge. Sur cette feuille était écrite, avec le roseau de la puissance divine, l'inscription suivante : « Il n'y a de dieu que Dieu, et Mohammed est l'envoyé de Dieu. » Le jurisconsulte Houçaïn et plusieurs hommes dignes de foi me racontèrent qu’ils avaient vu cette feuille et lu l'inscription qui s'y trouvait. Houçaïn ajouta que, quand venait le moment de sa chute, les hommes dignes de confiance, parmi les musulmans et les idolâtres, s'asseyaient sous l'arbre. Lorsque la feuille était tombée, les musulmans en prenaient la moitié, l'autre était déposée dans le trésor du sultan infidèle. Les habitants s'en servent pour chercher à guérir les malades. » (Tome IV, p. 85, 86.)
Le célèbre voyageur ajoute qu'un souverain non musulman fit arracher l'arbre par la racine, mais qu'il repoussa et redevint aussi beau qu'auparavant.
Le fait relaté n'est pas aussi incroyable qu'il peut le sembler au premier abord. L'écriture arabe est telle qu'en supposant des stries entrecroisées sur la feuille desséchée, il n'est pas impossible d'y déchiffrer à peu près ce qu'on voudra, avec un peu de bonne volonté.
Quant à la ville de Mnkir ou de Mânekir, elle est citée par Massoudi (les Prairies d’or, tome Ier, p. 162) comme étant la capitale da Malva, à l’orient du Guzarate. La ville, dit-il, était située à quatre-vingts parasanges indiennes de la mer. Reinaud (Mém. sur l’Inde, p. 144) pense que Mânekîr ou Mânakir est une altération de la dénomination sanscrite maha-nagara, la grande ville, et que ce mot servait à désigner Dhar, ville très considérable de la contrée. « C'est peut-être, ajoute le savant orientaliste, le même mot dont les écrivains grecs ont fait Minnagara, et qui paraît avoir été appliqué a plusieurs cités à la fois. » D'après les écrivains orientaux, Mânekîr était le siège du gouvernement du roi Porus, vaincu par Alexandre le Grand. (Voy. Massoudi, II, 260.)
[132] (CXI.) — « On fait encore mention d'un animal de mer qui ressemble à l’écrevisse; quand cet animal sort de la mer, il se convertit en pierre : on ajoute que cette pierre fournit un collyre pour un certain mal d’yeux. (Relation de Soleïman, édit. Charton, p. 128.)
« Il y a aussi dans ces parages (mer de Chine) une espèce d'écrevisses longues environ aune coudée ou d’un empan; elles sortent de l’eau et se meuvent rapidement ; mais elles n'ont pas plus tôt touché h cessant, elles se changent la composition des collyres et des remèdes qui sur les yeux. Ce fait est d'une notoriété incontestable. » (Massoudi, les Prairies d’or, tome I, p. 345.)
[133] Semendel ou Semendoul est le nom arabe et persan de la salamandre, animal fantastique sur la nature duquel les Orientaux ne s'accordent guère ; les uns en font un quadrupède, d'autres un oiseau, d'autres enfin un reptile, tous lui attribuant d'ailleurs la faculté de vivre dans le feu sans se brûler. Marco Polo désigne par ce nom l'amiante. (Il donne sur l'extraction de cette matière incombustible des détails d'une grande exactitude. Voy. édit. Charton, p. 300.)
On trouve dans l'archipel indien un oiseau nommé bendoul; avec la particule si qui se place devant les noms propres de cens ou d'animaux, on aurait si-bendoul. Mais je n’ai pu découvrir sur cet oiseau aucun renseignement propre à confirmer ou à repousser l'idée d'une assimilation avec la légendaire salamandre.
[134] « Ils ont de la ressemblance avec les Turks. » n faut probablement entendre cette comparaison comme dans ce passage d'Al-Biruni : « Le pays à droite se nomme Tilout ; les habitants sont extrêmement noirs, le nez camus, comme les Turks. Ce peuple s'étend jusqu'aux montagnes de Camrou, qui se prolongent jusqu’à la mer. » (Voy. Reinaud, Fragm. relat. à l'Inde, p. 105.)
[135] D'Herbelot, à l'article Sérandib (p. 806 de sa bibliothèque orientale), fait remarquer que « les géographes orientaux ne font aucune mention de l’arbre de cannelle, qui ne croît que dans cette isle, soit qu'il ne s'y trouvast pas encore de leur temps et qu'il y ait été transporté d'ailleurs, comme de la Chine, ce qui a fait donner a cet arbre le nom de dar Tchin en Orient, mot qui signifie bois de la Chine, ou qu'il faille entendre cet arbre sous le nom de Nargil... »
Y aurait-il ici, dans notre manuscrit arabe, une interpolation ? c'est fort possible; les copistes introduisent parfois dans le corps d'un ouvrage des notes marginales qui n'en faisaient aucunement partie.
Le baqqam est le bois de brésil ou sappan.