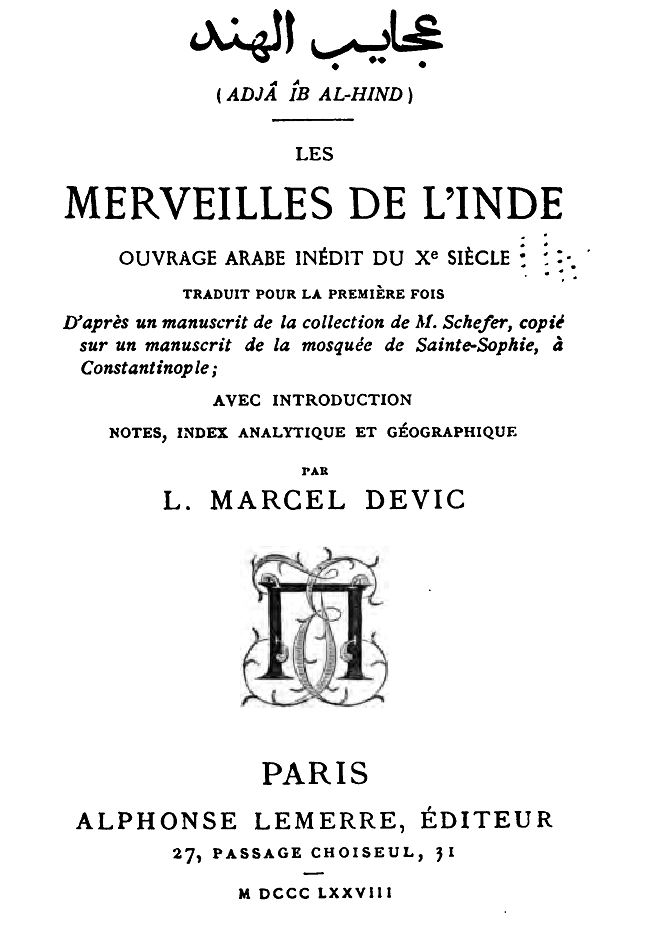
ANONYME
MERVEILLES DE L'INDE : introduction
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
Le petit livre que nous offrons ici au lecteur est un recueil fort ancien d'anecdotes et de menus faits relatifs aux mers de l'Inde et de la Chine et aux régions qu'elles baignent. On y trouve de la géographie, de l'histoire naturelle, de la fantaisie, du merveilleux, des récits de tempêtes et de naufrages, des scènes d'anthropophagie, et — disons-le tout de suite comme avertissement aux personnes faciles à effaroucher— plusieurs traits de mœurs orientales, contés avec une franchise un peu crue. De ce bizarre fouillis, le lecteur saura dégager de précieuses indications sur la navigation et le commerce des musulmans au xe siècle de notre ère, et des renseignements géographiques qu'apprécieront surtout ceux qui se sont occupés de l'état de l'Inde et des îles Malaises à une époque pour laquelle les documents sont rares et incertains.
L'ouvrage est absolument inédit. Non seulement il n'en existe aucune traduction en langue européenne, mais on peut dire que le texte même, dont nos bibliothèques publiques ne possèdent aucune copie, avait échappé jusqu'à ce jour à la curiosité de nos orientalistes. J'ai été sans doute le premier à en signaler l’existence, en décembre 1872, par quelques extraits relatifs aux oiseaux gigantesques, publiés dans les Comptes rendus de l’Académie des sciences, ou communiqués au savant zoologiste Bianconi, de Bologne, qui les a utilisés dans ses recherches sur le Rokh et l’Æpiornis (1874). J'en avais eu connaissance par M. Schefer, président de l’Ecole des langues orientales, qui voulut bien m'en confier une copie faite pour lui à Constantinople sur un manuscrit appartenant à la bibliothèque de la mosquée de Sainte-Sophie. Cette copie, d'une bonne écriture, mais souvent fort incorrecte, illisible même par endroits, et présentant plus d'une lacune, est la seule que j'ai eue à ma disposition, tant pour préparer une édition du texte arabe, destinée à l'Ecole des langues, que pour mon travail de traducteur, double labeur fort ingrat, mais auquel le grand nombre des difficultés à vaincre attachait un attrait bien connu des travailleurs. Ces difficultés, je ne me flatte pas, tant s'en faut, de les avoir levées toutes. Après nous, si l'on juge que l'œuvre en vaille la peine, d'autres viendront et feront mieux.
La copie mise à ma disposition ne porte ni date ni nom d'auteur. Après une invocation religieuse, pareille à celles qu'on trouve en tête de tous les ouvrages musulmans, et que ma traduction a notablement écourtée, après trois lignes simulant une préface, la série des anecdotes commence et dure sans ordre, sans plan, jusqu'à la dernière, qui pourrait tout aussi bien commencer le recueil. Avons-nous là l'ouvrage complet ? Cela se peut, comme il pourrait se faire que ce n'en fût qu'un court fragment. Toute base manque pour se former là-dessus une opinion de quelque valeur. La même raison nous engage à renoncer, jusqu'à nouvel ordre, à toute conjecture sur le nom de l’auteur. Mais un fait que, pour un livre de ce genre, il importait bien plus de rechercher, c'est l’époque approximative de sa composition. Tel détail, digne d'attention chez un écrivain de tel siècle, perdrait tout intérêt relevé dans un ouvrage postérieur de cent ans ou plus.
Cette époque est facile à fixer, grâce aux dates éparpillées dans ce livre, et dont voici le tableau dans l’ordre chronologique : 288, 300, 305, 306, 310, 317, 325, 332, 334, 339, 340, 342. Toutes ces dates correspondent à des faits dont l'écrivain, ou ses interlocuteurs, ont été témoins. La plus ancienne, on le voit, est de l'année 288, la plus récente de 342. Je dois ajouter que ma copie arabe fournit (dans l'anecdote XXXIX de la traduction) une date de beaucoup postérieure, 390. Mais il y a là une erreur de copiste qui saute aux yeux. Comment l'auteur eût-il pu recueillir des récits de faits séparés par plus d'un siècle d'intervalle de la bouche de gens contemporains de ces faits ? Et d'ailleurs, nous trouvons, quelques pages avant l’anecdote XXVII, une date précise, personnelle à l’écrivain , qui ne peut laisser aucun doute à ce sujet : « J'interrogeai, dit-il, le capitaine Ismaïlouïa, en l'année 339, sur cette histoire qu'on m'avait déjà racontée. » L'homme qui dès l'année 339 colligeait déjà ses historiettes, n'a guère pu y introduire la narration d'un fait arrivé cinquante-et-un ans plus tard et qui même, à l'heure où on le lui rapporte, est déjà vieux d'un certain nombre d'années. A la fausse date 390 il faut donc substituer une date beaucoup moins récente, probablement comprise entre les limites ci-dessus marquées, 288-342. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on s'écartera bien peu de la vérité en fixant l’époque rédaction de notre livre vers le milieu du ive siècle de l’hégire, c'est-à-dire dans la seconde moitié du xe siècle de notre ère, aux environs de l’année 960.
A cette époque, les Arabes avaient déjà, comme on le verra plus loin, un certain nombre d'ouvrages où notre auteur eût pu puiser maints renseignements du genre de ceux qu'il donne. Mais il ne semble pas en avoir eu connaissance et ne parle jamais de ses lectures. Toutes les anecdotes ici racontées sont données comme des récits oralement recueillis; le narrateur même est presque toujours expressément nommé, soit que l'histoire lui appartienne en propre, soit que lui-même la tienne d'une autre bouche. Ces narrateurs sont des marins, pilotes ou capitaines, tous gens peu lettrés, qui parlent de visu ou de auditu. Quelques-uns, au dire de l'auteur, avaient acquis une grande célébrité par leurs voyages au pays de l’or, par leurs longues navigations sur l'océan indien, dans l'archipel malais, dans les mers de la Chine ; tel avait séjourné chez les nègres de l'africaine Sofala, tel autre pouvait décrire les merveilles de la chinoise Khanfou. Sous les noms musulmans de ces marins, il n'est pas facile de découvrir leur véritable nationalité; quelques-uns cependant, comme Bâlichâd, Châdân, Dârbezîn, trahissent une origine persane. Six ou sept narrateurs accolent à leur nom l'épithète de Sîrâfi, marquant par là que Siraf est leur patrie ou celle de leur famille. Un est de Basra, un autre de Bagdad, un troisième d'Oman. Pour le plus grand nombre, rien ne permet d'établir le lieu qui les a vus naître.
Aussi bien, ce détail offrirait-il peu d'intérêt, s'il n'était curieux de noter les pays où se recrutaient ces habiles pilotes, ces hardis nakhodas, ou capitaines de navires, dont la science nautique maintenait de si actives relations entre tous les points du littoral asiatique. Leur histoire, si quelqu'un pouvait la conter, serait assurément pour nous bien curieuse. Elle offrirait peut-être plus d'aventures extraordinaires que les voyages de Cook, plus de douloureuses angoisses, plus de souffrances, de péripéties, d'effroyables tempêtes, de catastrophes mortelles que les traversées d'Anson, de Behring, de Lapeyrouse. Rien n'y manquerait, pas même les scènes d'anthropophagie où le navigateur, comme Marion, devient la proie de peuplades cannibales, ni celles où le navire, comme le radeau de la Méduse , fournit à la fois les victimes et les bourreaux.
Le célèbre Vénitien qui le premier, au moyen âge, porta en Europe des notions authentiques sur la Chine et l'extrême Orient, Marco Polo, relate un trait bien caractéristique des mœurs de l'Inde. « Dans ces pays, dit-il, celui qui boit du vin est incapable de servir de caution ou de témoin, non plus que celui qui navigue sur mer; car ils disent qu'il faut être désespéré pour aller sur mer, et c’est pour cela qu’ils récusent le témoignage des navigateurs. » Dans le même ordre d'idées, certains docteurs musulmans, des plus autorisés et des plus graves, affirment qu'un nomme de bon sens ne peut jamais songer à se mettre en mer, et que toute personne qui s'embarque devrait être privée de ses droits civils.
Si l'on réfléchit aux périlleuses incertitudes de la navigation au long cours à une époque où la boussole n'existait pas; où les rares cartes n'étaient, pour les contrées un peu lointaines, que des croquis informes et fourmillant de grossières erreurs ; si l’on songe au peu de ressources d'un art nautique en progrès, il est vrai, mais encore bien imparfait, on comprendra que le paisible citadin pût aisément suspecter de folie l'homme que l'appât du gain entraînait sur ces vastes océans si féconds en naufrages. Combien de navires étaient partis de Colzoum (Suez), d'Aden, d'Oman, sur la côte arabique, de Basra, de Siraf, de Tiz, sur le littoral persan, qui n’étaient jamais rentrés au port, et dont toute trace avait à jamais disparu ! Combien en avaient vus les habitants du Guzarate, de Koulam, de Tana, de Sérendib, arriver dans leurs baies, désemparés, sans mâts, sans voiles, les ancres rompues, le gouvernail en pièces et, chose plus dure encore, après avoir jeté à la mer toute la cargaison, dont la vente était le seul but de leur périlleux voyage !
Ces mésaventures abondent dans le présent recueil : un bâtiment coule à fond en pleine mer, un autre est submergé en vue du port ; tel échoue et se brise sur les écueils, tel autre est frappé par la corne d'un narval. Ici, de tout un nombreux équipage naufragé, six ou sept hommes seulement se sauvent par des moyens miraculeux, après avoir souffert mille morts; là, un seul échappe aux flots pour tomber entre les mains d'un monstre à face humaine, d'un Polyphème qui l'engraisse pour le dévorer. Mais quoi ! le navire qui parvient à regagner le port avec une petite part de ses marchandises, réalise un gain de dix et vingt pour un; les esclaves, les épices, les parfums, les étoffes, les armes donnent de tels bénéfices que la certitude de s'enrichir par un double échange fait braver les écueils, les tempêtes, les monstres marins et les nègres mangeurs d'hommes.
L'auteur des Merveilles de l'Inde ne semble avoir eu pour les aventures maritimes, non plus que terrestres, qu'un goût tout platonique. Il ne dit point : « J'ai vu », mais toujours : « On m'a raconté. » Si les Arabes avaient connu la poésie latine, nous pourrions nous le figurer murmurant les vers de Tibulle :
Quam juvat immites ventos audire cubantem!
ou récitant le Suave mari magno, de Lucrèce :
Il est doux, quand les vents troublent au loin les ondes,
De contempler du bord sur les vagues profondes
Un naufrage imminent.[1]
C'était sans doute un homme paisible, aimant à l'heure de la digestion les causeries entre compagnons de table, avec les petites émotions d'un récit dramatique ou plaisant, incapables de troubler les fonctions importantes de l'estomac; un esprit curieux, non pas à la façon de l'illustre Al-Biruni, cherchant de ville en ville, au milieu des guerres de l'invasion musulmane, à pénétrer les mystères de l'histoire et des sciences de l'Inde ; encore moins à la façon de l'infatigable voyageur Ibn-Batouta courant du Maroc à la Perse, de l'Arabie à Ceylan, de Delhi aux Maldives, laissant des épouses légitimes éparpillées aux quatre coins de l'horizon, tantôt chef d'ambassade princière et tantôt mendiant, toujours avide de voir de ses propres yeux des mœurs et des contrées nouvelles. Son ardeur de connaître est plus calme et ne dépasse pas le seuil de la porte de «a maison ou des maisons amies. Il interroge, écoute les réponses, en prend note, et, rentré chez lui, couche cela sur son carnet, sans ordre préconçu, les faits succédant aux faits, au hasard de la conversation du jour. A-t-on parlé des poissons monstrueux des mers de l’Inde? voici trois, quatre pages sur les poissons. A-t-il été question des singes? voilà dix anecdotes sur les singes. Un pilote, revenant du Malabar, B-t-il compté merveilles des enchanteurs de l'Inde? le carnet s'accroît d'une série de faits sur les charmeurs d'oiseaux et de crocodiles.
Toutefois les conteurs ne sont pas les premiers bavards venus. Ce sont, nous l'avons dit, des capitaines au long cours, des pilotes expérimentés, dont les récits méritent foi. Quand ils affirment : « J'ai vu, » ils ont vu... ou cru voir. S'ils disent, eux aussi : « On m'a conté, » l'affaire devient plus douteuse. Sur le nombre, d'ailleurs, il s'en trouve toujours quelqu'un plus désireux d'émerveiller que d'instruire. De là certaines aventures extraordinaires, vieilles comme le monde, transmises parmi les marins, de génération en génération, et toujours contées comme datant de la veille ou de l'avant-veille. Notre auteur en a, sans réflexions, noté sa petite part, petite, disons-nous, si on veut comparer son recueil à d'autres œuvres du même genre, assez communes chez les Arabes, où la masse du merveilleux laisse à peine soupçonner quelques linéaments de la réalité. C'est en toute sincérité qu'il eût pu terminer son livre par ces paroles d'un de ses contemporains, Abou-Zeïd Haçan, dont il va être question : « Voilà ce que j'ai entendu raconter de plus intéressant dans ce moment-ci, au milieu des nombreux récits auxquels donnent lieu les voyages maritimes ; je me suis abstenu de rien reproduire des récits mensongers que font les marins, et auxquels les marins eux-mêmes n'ajoutent pas foi : il vaut mieux se borner aux relations fidèles, bien que courtes. »
A l’époque où s'écrivaient ces lignes, il y avait déjà plus de trois cents ans que l’islamisme s'était rué à la conquête du monde. Toutes les relations commerciales entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie occidentale d'une part, l'Inde et la Chine d'autre part, étaient tombées entre les mains des musulmans. Mais ces deux immenses régions de l'Orient gardaient encore presque tous leurs mystères. Aussi recherchait-on avidement les descriptions, les récits de toute sorte relatifs à des contrées réputées les plus étranges et les plus riches de l'univers. Le nombre et la valeur des documents augmentaient peu à peu, depuis un petit nombre d'années. La Grèce ancienne n'avait pas su grand-chose de la Chine ; de l'Inde elle gardait traditionnellement une admiration légendaire qu'aucune connaissance bien certaine ne lui eût permis de justifier. L'expédition de l'aventureux Macédonien, vainqueur de Porus, et la navigation de Néarque ajoutèrent peu à la somme des notions acquises et déjà résumées dans Hérodote et Ctésias. Sur l'intérieur de la vaste presqu'île, et même sur ses côtes, on n'eut, pendant de longs siècles après, que de vagues renseignements souvent absurdes ou contradictoires. Faute de documents nouveaux, on se répète, on se copie. De rares voyageurs se hasardent, à de longs intervalles, en ces lointaines contrées. Les traditions chrétiennes parlent de saint Thomas l'apôtre, qui s'en alla prêcher l'Evangile dans l'Inde, convertit le roi Gondaphoros et finalement gagna la palme du martyre sur la côte de Cororandel. Presque à ma même époque le fameux thaumaturge Apollonius de Thyane franchissait l’Indokhouch, traversait l’Indus et pénétrait, dit son biographe Philostrate, jusqu'aux bords du Gange.
Un ou deux siècles après, le Périple de la mer Erythrée nous présente un exemple intéressant de navigation au long cours, si cette expression peut convenir à des voyages durant lesquels les bâtiments longeaient les côtes et tremblaient toujours de les perdre de vue. Parti de la mer Rouge, le navire, à sa sortie du détroit de Bab el-Mandeb, côtoie le littoral arabe, le golfe Persique, la Perse et gagne la côte indienne en passant aux bouches de l’Indus. Au vie siècle, Cosmas, marchand d'Alexandrie, navigua de sa personne jusqu'à Ceylan et mérita le surnom d'Indicopleustes, navigateur dans l'Inde. Devenu moine sur ses vieux jours, il composa, en grec, des livres de cosmographie et décrivit les particularités des pays qu'il avait visités.
L'histoire ne nous a transmis ni l'œuvre ni le nom d'aucun Romain qui, pendant l'empire, ait abordé les régions de l'Asie orientale. Pourtant, les annales chinoises font mention, paraît-il, d'un ambassadeur envoyé par l'empereur Marc-Aurèle au souverain du Céleste-Empire'; elles précisent même en disant que le voyage eut lieu par mer. Mais les auteurs latins ou grecs ne font aucune allusion à ce fait si curieux, dont M. Reinaud à cru cependant trouver la confirmation dans un passage de Pausanias.
Une ambassade plus certaine est celle qu'un roi de Taprobane, au rapport de Pline, envoya jusqu'à Rome. Par les détails que donne l'écrivain latin, on voit qu'à cette époque les navires égyptiens partis de la mer Rouge se rencontraient à Ceylan avec les bâtiments venus de Chine, et dans les ports de cette grande île s'opérait l’échange des productions de l’Occident et de l’Orient. A la même époque, il n'est pas douteux que des caravanes se rendaient aussi par terre des limites de l’empire romain aux frontières de l'empire chinois, en traversant la Tartarie ; Ptolémée donne l'itinéraire suivi au ier siècle de notre ère.
Les Chinois ne venaient peut-être pas jusqu'aux limites occidentales de l'Asie, bien que Maçoudi assure qu'autrefois (c'est-à-dire antérieurement au ive siècle de l'hégire), les navires de la Chine se rendaient dans le pays d'Oman et dans les ports du golfe Persique; en tout cas, ces hardis navigateurs fréquentaient déjà les mers de l'Inde, et leurs vaisseaux touchaient non seulement à l'île de Ceylan, comme on vient de le voir, mais encore aux ports du Malabar, et jusqu'aux bouches du Sind. Là, de temps immémorial, se tenaient tapies des flottilles de pirates dont la présence seule suffirait à prouver l'activité du commerce qui régnait sur ces côtes ; et, quand les bonnes occasions manquaient à ces brigands de la mer, on avait vu leurs embarcations, cousues avec des fibres de palmier, se hasarder jusque sur les rivages de l'Arabie et faire, même au temps des califes, des descentes d'une audace inouïe au fond du golfe Persique, sur les bords mêmes du Tigre.
A diverses reprises, des envoyés du Fils du Ciel vinrent de la Chine à l'Inde dans un but assez singulier. Il s'agissait d'y rechercher une herbe merveilleuse, la panacée universelle, l'élixir de longue vie de ce temps ; cette herbe qui guérissait toutes les maladies et donnait l'immortalité, se trouvait, disait-on, sur le sommet d'une montagne entre le Gange, l’Indus et les deux mers. Nous ne saurions dire si quelques-uns des messagers furent assez heureux pour découvrir cette autre pierre philosophale ; mais il paraît que, sous prétexte de procurer l'immortalité à leurs souverains, maints serviteurs des empereurs chinois les empoisonnèrent bel et bien.
La vaste littérature du Céleste-Empire contient peut-être d'intéressants détails sur la navigation chinoise aux parages de l'Inde. Les sinologues nous le diront un jour. Déjà, nous leur devons la connaissance de deux relations qui, depuis leur passage en notre langue, ont été annotées, commentées, étudiées, analysées par tous nos amateurs de géographie rétrospective. L'une et l'autre sont dues au zèle religieux de moines bouddhistes que le désir de remonter aux sources primitives de leur croyance poussa vers les rives du Gange et vers l'île sacrée de Ceylan. Le premier se nommait Fa-Hian, et voyageait vers la fin du ive siècle ; l'autre, nommé Hiouen-Thsang, parcourut la presqu'île entre les années 628 et 645. La relation de celui-ci nous montre les marchands indiens formant des espèces de colonies dans les principaux marchés persans ou arabes ; des monastères bouddhiques et brahmaniques établis dans la ville qu'il nomme Sourasthana et qu'il désigne comme la capitale de la Perse : faits à noter, car l'Hindou est peu migrateur de son naturel ; il hait la navigation et vraisemblablement les pirates du Sind n'étaient point de sa race. On cite, comme un fait remarquable, rétablissement sur les bords de l'Euphrate d'un petit groupe d'Hindous qui s'y était fixé sous le règne de Vagarchag Ier, au iie siècle de notre ère ; cinq ou six cents ans plus tard, au temps de l’évêque arménien Zénob qui nous en a conservé le souvenir, leurs descendants gardaient encore les mœurs et la religion de l’Inde. Mais il faut dire que cet embryon de colonie était dû à l’exil forcé de quelques familles fuyant la tyrannie de leur souverain.
Au contraire, les Arabes et les Persans étaient d'humeur à courir d'un bout du monde à l'autre. Depuis la décadence de l’empire romain, ils étaient restés les seuls intermédiaires commerciaux entre le bassin méditerranéen et l’Orient tout entier.
C'est à peu près au moment où le Chinois Hiouen-Thsang achevait son pèlerinage au pays de Bouddha, que les musulmans firent leur première apparition sur les frontières de l'Inde. Dès la seizième année de l'hégire, en 687, sous le califat d'Omar, les sectateurs du Prophète envahissaient la vallée de l'Indus. L'Oman vit de bonne heure s'équiper des flottes chargées d'aventuriers qui, sous couleur de religion, couraient à la conquête et au pillage de contrées opulentes. Au début les califes, redoutant de trop éparpiller les forces peu compactes qu'ils avaient si rapidement acquises, refusaient leur approbation à ces projets d'expéditions lointaines; mais l'ardeur des chefs de bande, surexcitée par l'enthousiasme de succès constants, empêchait d'obéir aux conseils d'une prudence timide. Toutefois ces incursions multipliées où les missionnaires de l'islam présentaient leur Coran entre l'épée qui égorge et la torche qui incendie, ces expéditions sans cesse renouvelées, mais d'abord irrégulières comme des razzias au désert, ne devaient pas de longtemps entamer les vastes profondeurs de la Péninsule, qui continua à cacher ses secrets à l'historien et au philosophe. Â la fin du xe siècle, un géographe arabe. Ibn-Haukal, après avoir énuméré les villes de la vallée du Sind et des côtes occidentales qu'il avait pu visiter, termine en disant : « Voila les villes que je connais. L'Inde en renferme beaucoup d'autres dans l'intérieur des terres ; mais elles sont entourées de déserts: les marchands indigènes peuvent seuls y pénétrer, tant ces régions sont isolées de toute communication avec les contrées voisines, tant elles offrent de dangers à quiconque voudrait s'y frayer une route. »
Mais déjà Ceylan, le Malabar et plusieurs villes du littoral en remontant vers l’Indus, avaient reçu, sinon de vraies colonies, tout au moins des comptoirs considérables de marchands musulmans. Beladori, historien arabe qui écrivait son Livre des conquêtes des pays vers le milieu du ixe siècle, nous montre ses coreligionnaires établis à demeure fixe, cent cinquante ans auparavant, dans l’île du Rubis, c'est-a-dire à Ceylan. Ils y devaient être nombreux, puisque, à la suite de je ne sais quel événement, les chefs de famille étant morts, le roi de l'île nolisa un bâtiment pour renvoyer leurs femmes et leurs filles chez leurs parents du continent, traversée d'ailleurs funeste pour ces infortunées qui devinrent la croie des pirates de l'Indus.
L'activité croissante des relations commerciales dut alors engager les savants et les voyageurs à écrire maints ouvrages sur la navigation es mers orientales. Quiconque s'embarquait pour ces pays extraordinaires, quiconque avait là-bas un fils, un frère, un parent, un ami, souhaitait sans doute d'être bien renseigné sur le climat, les mœurs, les productions, les charmes et les dangers d'un monde tout nouveau. Le ixe et le xe siècle virent naitre, en effet, bien des livres de valeur très diverse sur l’Inde, la Chine et l'archipel Malais qui sépare leurs eaux.
Voici d'abord la très curieuse relation d'un marchand arabe nommé Soleïman, écrite en 851 (237 de l'hégire), où l'on peut suivre assez exactement l’itinéraire des navires qui s'en allaient d'Oman ou du golfe Persique jusqu'à la grande ville de Khamou, à peu de distance des parages aujourd'hui si animés où s'élève Shanghai. Nous donnons dans les notes quelques extraits de ce précieux document, que l’abbé Renaudot fit le premier connaître en 1718, et dont M. Reinaud publia une édition nouvelle en 1845, avec d'utiles éclaircissements. Dans les deux éditions on trouve, joint à la relation de Soleïman, l'ouvrage d'un savant amateur de géographie, Abou-Zeïd-Haçan, de Siraf, qui fut peut-être le premier éditeur de Soleïman. Abou Zeïd, reproduisant la relation, l'augmente de renseignements nombreux sur les mêmes régions, puisés dans ses entretiens avec des personnes qui ont couru le monde, ou empruntés à des ouvrages que la main du temps n'a pas laissés venir jusqu'à nous.
Mais avant cette sorte de supplément à la relation du marchand-voyageur, nous devons, dans l'ordre chronologique, mentionner l'ouvrage d'un écrivain qui s'est occupé aussi, quelques années plus tôt, quoique subsidiairement, des pays dont il est ici question. C'est le Livre des routes et des provinces d'Ibn-Khordadbeh, qui fut chef des postes sous le calife Mou’tamid (256 à 279 de l'hégire, 870 à 892 de notre ère). Ce fonctionnaire, d'origine persane, a écrit en langue arabe plusieurs ouvrages dont les titres seuls nous sont parvenus, étrangers d'ailleurs pour la plupart au sujet qui nous occupe. Peut-être cependant, dans son livre des Beautés des concerts, donnait-il quelques détails sur les facultés musicales des Hindous ; ceux-ci devaient avoir une véritable supériorité en cet ordre de talents, si l’on en juge d'après une anecdote rapportée par Fauteur persan du Modjmel' el-Tevârik. Cet historien raconte que le fameux roi de Perse Bahram-Gour, trouvant que ses sujets ne montraient pas assez de gaîté dans leurs réjouissances, se fit envoyer par le roi de l’Inde douze mille joueurs d'instruments, hommes ou femmes, auxquels Bahram attribua un salaire pour donner gratis des concerts aux pauvres. Peut-être encore, dans son Art du cuisinier, Ibn-Khordadbeh s’expliquait-il sur l'origine des épices et sur les régions lointaines qui fournissaient les plus recherchées. Le Livre des routes, qui seul nous est resté, est un recueil bien sec d'itinéraires, assez pauvre de renseignements en ce qui concerne les pays situés à l’orient de la Perse. L'auteur avait peu voyagé hors de sa patrie, si même il l'avait jamais quittée. La partie qui nous intéresse le plus ici est celle qui donne la description des lies de l'archipel malais, d'après les récits des navigateurs qui poussaient leurs courses jusqu'à la mer de Chine. Nous y trouvons aussi un chapitre, intéressant pour l'histoire du commerce, sur l'itinéraire suivi par les marchands juifs qui gagnaient l'Orient.
« Ces marchands, dit l'auteur, parlent le persan, le romain (grec et latin), l’arabe, les langues franque, espagnole et slave. Ils voyagent de l'Occident en Orient et de l'Orient en Occident, tantôt par terre, tantôt par mer. Ils apportent de l’Occident des eunuques, des esclaves femelles, des garçons, de la soie, des pelleteries et des épées. Ils s'embarquent dans le pays des Francs, sur la mer Occidentale et se dirigent vers Farama (près des ruines de l'ancienne Péluse) ; là ils chargent leurs marchandises sur le dos de bêtes de somme, et se rendent par terre à Kolzoum (Suez), à cinq journées de marche, sur une distance de 20 parasanges. Ils s'embarquent sur la mer Orientale (la mer Rouge) et se rendent de Kolzoum à El-Djâr et à Djedda; puis ils vont dans le Sind, l'Inde et la Chine. A leur retour, ils se chargent de musc, d'aloès, de camphre, de cannelle et des autres productions des contrées orientales, et reviennent à Kolzoum, puis à Farama, où ils s'embarquent de nouveau sur la mer Occidentale. Quelques-uns font voile pour Constantinople, afin d'y vendre leurs marchandises; d'autres se rendant dans le pays des Francs. » (Trad. de M. Reinaud, revue par M. Barbier de Meynard.)
Dans l'intervalle écoulé entre l'époque où Soleïman rédigeait sa relation et celle où Abou Zeïd y joignait le fruit de ses propres recherches, la Chine vit brusquement se rompre les relations si actives qu'elle entretenait avec l'Inde et les musulmans. En 878, la révolte d'un chef, qui fut d'abord triomphant, causa une perturbation générale. « Les vainqueurs, dit Abou Zeïd, ne craignirent pas de maltraiter les marchands qui étaient venus commercer dans le pays. Bientôt l'on ne garda pas même des ménagements pour les patrons des navires arabes, et les maîtres de bâtiments marchands furent en butte à des prétentions injustes ; on s'empara de leurs richesses, et on se permit à leur égard des actes contraires à tout ce qui avait été pratiqué jusque-là. Dès ce moment, le Dieu Très-Haut retira ses bénédictions du pays tout entier; le commerce maritime ne fut plus praticable, et la désolation se fit sentir jusque sur les patrons des navires et les agents affaires de Siraf et de l’Oman. »
Ceci fera comprendre ce que dit l’auteur de l’Adjâîb-al-Hind des difficultés qui rendaient si rares à son époque les voyages à la Chine. Les Arabes et les Persans avaient alors renoncé, ou peu s'en faut, à dépasser la presqu'île de Malaca; on trouvera cependant plusieurs traits du présent recueil relatifs au Senf et au Ouâq-Ouâq, régions qu'il faut assurément placer entre Siam et le Tonkin.
Contemporain d'Abou-Zeïd, Maçoudi, de Bagdad, le grand voyageur de son siècle, passa sa vie presque entière à courir d'une extrémité à l'autre du vaste empire musulman. Successivement il visita la Perse, l'Inde, Ceylan, la Transoxiane, l'Arménie, les bords de la Caspienne, l'Egypte, l'Afrique septentrionale, l'Espagne, les possessions encore assez étendues de l'empire grec, la Palestine et l'Arabie. Il navigua, semble-t-il, sur les mers de la Malaisie et de la Chine, longea d'autre part la côte orientale d'Afrique et toucha à une grande île nommée Cambalou, que l'on croit être Madagascar.
Instruit, observateur, curieux de ce qui touche à la géographie, aux mœurs, aux croyances, aux traditions historiques des peuples qu'il visite, Massoudi donne sur l'Inde des notions plus précises qu'aucun écrivain antérieur; il fait des mers orientales, depuis le golfe Persique jusqu'à la Chine, un tableau plus étendu que celui de Soleïman, dont la relation ne lui avait pas été inutile. Massoudi mourut en 345 de l'hégire (956 J.-C). Le principal ouvrage qui nous reste de lui est intitulé les Prairies d'or; nous en devons une belle édition, accompagnée d'une élégante traduction française, à MM. Pavet de Courteille et Barbier de Meynard. On lui attribue la rédaction d'un livre bien moins important, intitulé le Livre des merveilles, qui existe en manuscrit à la Bibliothèque nationale. « On y remarque, dit M. Reinaud, une suite de récits sur les différentes parties dont se compose l'univers, et sur la manière dont, suivant les idées romanesques des musulmans, elles ont été successivement formées. Vient ensuite un tableau des mers orientales, ainsi que des côtes qu'elles baignent et des îles qui y sont contenues. Cette partie, comme le reste du volume, est surchargée de tables, et montre que l'auteur, conformément au titre dont il avait fait choix, avait pris à tâche de recueillir ce qui était le plus propre à frapper les imaginations. » Cette analyse sommaire nous fait regretter de n'avoir pu comparer le Livre des merveilles avec celui des Merveilles de l’Inde que nous publions ; cette comparaison nous eût fourni, sans doute plus d’un trait de ressemblance intéressant à noter.
Nous voici parvenus à l'époque où ce dernier ouvrage fut probablement composé. Nous ne dirons rien des voyageurs et des géographes arabes des temps postérieurs, si fertiles pourtant en grands écrivains. Nous en avons plus haut nommé deux en passant : Al-Biruni, celui de tous les auteurs musulmans du moyen âge qui a le plus parfaitement connu la péninsule indienne, et Ibn-Batouta qui, au xive siècle, a visité l’Inde et la Malaisie. Peut-être cependant convient-il de citer, comme à peu près contemporains de l'auteur de l’Adjâîb, deux géographes voyageurs, animés du même esprit de recherche et de curiosité que Maçoudi, et dont les relations peuvent être utilement consultées pour l’étude des connaissances des musulmans aux environs de l’an 1000. L'un est Istakhri, auteur d'un Livre des climats ; l’autre Ibn Haukal, dont l'ouvrage, intitulé Livre des voies et des provinces, ne manque pas de prétentions au beau style.
A ces noms enfin, on pourrait joindre ceux de quelques autres auteurs arabes qui ont écrit sur l'Asie orientale antérieurement au xe siècle, comme Djeïhâni, Qodama, Miçar-Abou-Dolaf, etc., dont les relations ont été mises à profit par les écrivains postérieurs, Yaqout, Edrici, Cazouini, Aboulféda.
Bornons-nous à rappeler, pour finir, un ouvrage sans aucune prétention scientifique, mais oui, malgré sa forme romanesque, a mérité d’attirer l’attention de nos érudits. Nous voulons parler des fameux voyages de Sindbad, popularisés chez nous par l’agréable traduction de Galland (dans les Mille et une nuits). On trouvera parmi les notes qui terminent notre volume, l’indication de plusieurs passages dont l’analogie avec certains récits de l’Adjâîb-al-Hind n'eût pas manqué de frapper le lecteur, quand même nous eussions négligé de l'avertir.
Après ce coup d'œil sommaire sur la littérature géographique relative à l'Asie orientale, antérieurement à la rédaction des Merveilles de l'Inde, il me reste, pour achever, à dire un mot sur mon travail. Pour ce qui est de la traduction, je l'ai faite aussi fidèle qu'il était en mon pouvoir, laissant seulement de côté deux ou trois passages que l’incorrection du manuscrit arabe ne m'a pas permis d'entendre suffisamment. Quant aux notes, rejetées à la fin du volume, elles m'ont coûté plus de temps et de recherches que ne semblerait en mériter un ouvrage d'apparences si modestes. J'ai cru particulièrement utile de fixer avec exactitude les noms de lieux souvent écrits dans le texte arabe avec beaucoup de négligence. Les nombreuses publications de M. Reinaud sur l’histoire et la géographie de l’Inde ; le Massoudi et l’Ibn-Khordadbeh de M. Barbier de Meynard; l’Ibn Batouta, de MM. Sanguinetti et Defrémery; le Marco-Polo de M. Pauthier; la collection des Voyageurs anciens et modernes, de M. Ed. Charton, etc., etc., m'ont fourni des éclaircissements et des points nombreux de comparaison.
Pour obéir aux habitudes typographiques de notre éditeur, on n'a point marqué dans le texte les renvois aux notes. Le lecteur est prié de s'y reporter par le numéro des pages.
Les notes sont suivies de trois tables. La première est une table analytique-index des matières par ordre alphabétique ; la seconde un index de tous les noms de lieux cités, avec les numéros des paragraphes où ils figurent et ceux des notes qui s'y rapportent; la dernière marque la suite des historiettes ; chaque numéro est accompagné d'un titre qu'il a fallu ajouter, car le texte arabe n'en présentait d'aucune sorte.
Je ne puis, en terminant, me défendre de remercier M. Carrière, secrétaire de l'école des langues orientales, de la bienveillance empressée avec laquelle il a mis à ma disposition les ressources déjà considérables de la bibliothèque de cette école. Il y a peu d'années cette bibliothèque n'existait que de nom. Grâce au profond savoir bibliographique de M. Carrière, et grâce aussi à ses qualités spéciales d'organisateur, c'est aujourd'hui un véritable trésor pour celui qui a des recherches à faire relativement à l'histoire, à la géographie, aux littératures d'une partie quelconque de l'Orient.
Marcel Devic.
Abel Rémusat. Foe-Koue-Ki, ou Relation des royaumes bouddhiques, voyage exécuté par Chy Fa-hian, traduit du chinois. Ouvrage revu, complété et augmenté d'éclaircissements nouveaux, par Klaproth et Landresse. Paris, 1836, in-8.
Stanislas Julien. Histoire de la vie de Hiouenthsang et de ses voyages dans l’Inde depuis l’an 629 jusqu’en 645, par Hoeï-li et Yen-thsong, suivie de documents et d’éclaircissements géographiques tirés de la relation originale de Hiouen-thsang, traduite du chinois. Paris, 185’, in-8.
Bernard de Montfaucon. Cosmae Aegyptii monachi christiana topographia. Texte grec accompagné d'une traduction latine. Paris, 1706. (Voir plus loin Ed. Charton.)
Renaudot. Anciennes relations des Indes et de la Chine, de deux voyageurs mahométans qui y allèrent dans le neuvième siècle de notre ère, Paris, 1718, in-8.
Reinaud. Relation des voyages faits par les Arabes et les Persans dans l'Inde et la Chine, dans le IXe siècle de l’ère chrétienne, texte arabe et traduction, avec introduction et notes. Paris, 1845, 2 vol. in-8.
— Fragments arabes et persans inédits relatifs à l’Inde, antérieurement au xie siècle de l’ère chrétienne. Paris, 1845, in-8. (Extrait du Journal Asiatique, 1844 et 1845.)
— Géographie d’Aboulféda, traduite de l'arabe en français. (Le tome ! est entièrement formé d'une Introduction générale à la Géographie des Orientaux), Paris, 1848, in-4.
Le texte arabe, publié par MM. Reinaud et de Slane, forme à part 1 volume in-4. Paris, 1840.
— Mémoire géographique, historique et scientifique sur l’Inde, antérieurement au milieu du xie siècle de l'ère chrétienne, d’aprés les écrivains arabes, persans et chinois. Paris, 1849, in-4. (Extrait des Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, tome XVIII, 2» partie.)
— Mémoire sur le commencement et la fin du royaume de la Mésène et de la Kharacène, et sur l’époque de la rédaction du Périple de la mer Erythrée, d’après les témoignages grecs, latins, arabes, persans, indiens et chinois. Paris, 1861, in-8. (Extrait du Journal Asiatique.)
— Relations de l'empire romain avec l'Asie Orientale, pendant les cinq premiers siècles de l’ère chrétienne, d'après les témoignages latins, grecs, arabes, persans, indiens et chinois. Paris, 1863, in-8. (Journal Asiatique,)
Robertson. An historical disquisition conceming the knowledge which the ancients had of India, Basil, 1792, in-8.
Dubois. Mœurs et cérémonies des peuples de l’Inde. Paris, 1825, 2 vol. in-8.
W. Vincent, The commerce and navigation of the ancients in the indian ocean. London, 1807, 2 vol. in-4.
Pauthier. Le Livre de Marco Polo, citoyen de Venise, rédigé en français sous sa dictée en 1298, par Rusticien de Pise, Paris, 1865, 2 vol. in-8.
Edouard Charton. Voyageurs anciens et modernes, ou Choix des relations de voyages les plus intéressantes et les plus instructives depuis le ve siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au xixe siècle, Paris, 1854, 4 vol. in-4. (Dans le ier : les relations de Ctésias, de Néarque et de Fa-hian ; dans le 2e : celles de Cosmas Indicopleustes, des Deux Mahométans et de Marco-Polo).
Gildemeister. Scriptorum arabum de rebus indicis loci et opuscula. Bonn., 1858, in-8.
Alfred Maury. Examen de la route que suivaient, au ixe siècle de notre ère, les Arabes et les Persans pour aller en Chine, d'après la relation arabe traduite successivement par Renaudot et M. Reinaud. (Dans le Bulletin de la société de géographie, avril 1846.)
Langlès. Les Voyages de Sindbad, texte arabe et traduction. (A la fin de la Grammaire arabe de Savary. Paris, 1813, in-4.)
W. Ouseley. The oriental geography of Ebn Haukal, an arabian traveller of the tenth century. (Trad.). London, 1800, in-4.
Am. Jaubert. Géographie d'Edrisi, traduite de l'arabe en français, d'après deux manuscrits de la bibliothèque du roi, et accompagnée de notes. Paris, 1836, 2 vol. in-4.
De Beauvoir-Priaux. The indian travels of Appollonius of Tyana and the indian embassies to Rome from Augustus to Justinian. London, 1873, in-12.
Barbier de Meynard. Le livre des routes et des provinces, par Ibn-Khordadbeh,[2] texte arabe, traduction et notes. Paris, 1865, in-8. (Journal Asiatique,)
— Les Prairies d'or, de Massoudi. Texte arabe et traduction. Paris, 1861-1877, 9 vol. in-8.
Defrémery et Simonetti, Voyages d'Ibn-Batoutah, texte arabe et traduction. Paris, 1858, 4 vol. in-8.
A.-F. Mehren. Manuel de la Cosmographie du moyen âge, traduit de l’arabe « Nokhbet ed-dahr fi-adjaib-il-birr wal-bahr » de Shems ed-Din Abou Abdallah Mohammed de Damas (Dimichki), et accompagné d'éclaircissements. Copenhague, 1874, in-8.
Louis de Backer. L’Extrême Orient au moyen âge, d'après les manuscrits d'un flamand de Belgique, moine de Saint-Bertin à Saint-Omer, et d'un prince d'Arménie, moine de Prémontré à Poitiers. Paris, 1877, in-8.