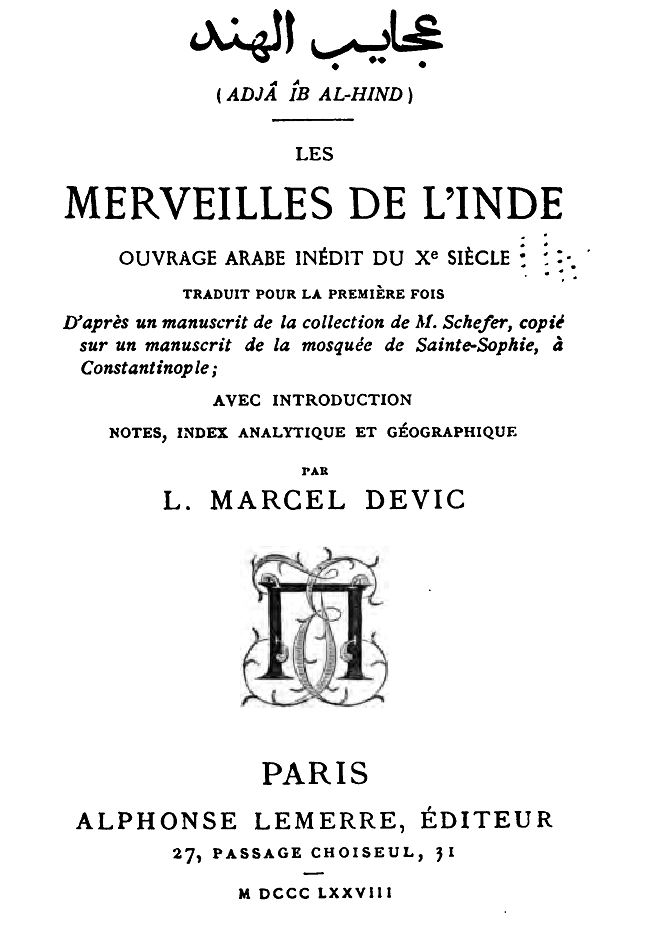
ANONYME
MERVEILLES DE L'INDE : introduction - partie I - partie II
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
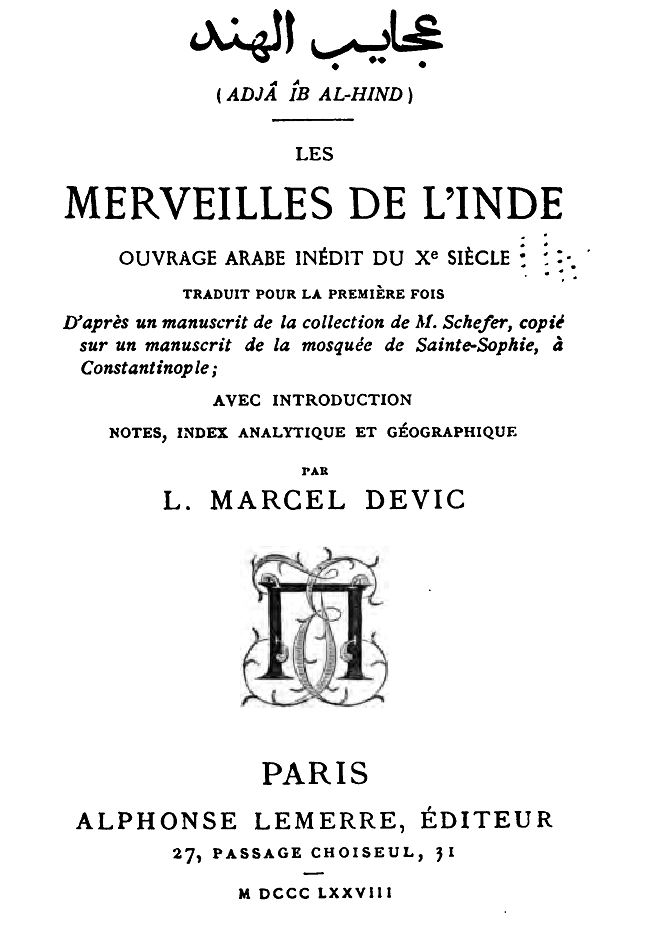
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

Gloire à Dieu, à qui appartiennent la gloire et l’éclat, la bienfaisance et la libéralité, créateur des peuples et des nations, nécessaire à tous et n'ayant besoin de personne. Il a envoyé son prophète Mohammed pour enseigner à toutes les créatures la vraie direction et la religion de la vérité. Que le salut de Dieu soit sur lui et sur sa famille, tant que brillera l’éclair, tant que le soleil surgira du Levant.
Dieu a partagé les merveilles de sa création en dix parts, neuf au pilier du Levant, une aux trois autres piliers, qui sont le Couchant, le Nord et le Sud. Des neuf parts attribuées au Levant, huit appartiennent à l’Inde et à la Chine, une seule au reste de l’Orient.
I. Des choses de l'Inde, voici ce que nous a raconté Abou-Mohammed el-Hocéïn fils d’Amr, fils de Hamouïa, fils de Haram, fils de Hamouïa, homme de mer à Basra.
[3]« J’étais, dit-il, à Mansoura
[4] dans l’année 288. Un vieillard de cette ville, personnage digne de foi, m'apprit qu'en 270 le roi du Râ,[5] nommé Mahrouk fils de Raïq, le plus puissant des rois de l'Inde, dans la région située entre le haut et le bas Cachemire, écrivit au sahib[6] de Mansoura, Abd-Allah, fils d'Omar, fils d'Abd-el-Aziz,[7] pour lui demander une traduction des lois de l’Islam en langue indienne.« Abd-Allah fit part de la demande à un homme qui se trouvait alors à Mansoura, personnage originaire de l'Iraq, esprit supérieur, d'une belle intelligence, poète, qui avait été élevé dans l'Inde et en connaissait les diverses langues. Cet homme mit en vers tout ce qui était nécessaire pour la connaissance de la religion, et son travail fut envoyé au ix)i« Le prince trouva cela admirable et pria Abd-Allah de lui envoyer l'auteur. L’homme se rendit donc auprès du roi et y demeura trois ans, puis il revint à Mansoura « Le sahib le questionna sur le souverain du Râ. « Je l'ai quitté, dit l'homme, alors qu'il était déjà musulman de cœur et de bouche. Mais la crainte d’être dépossédé de son pouvoir l'empêchait de professer ouvertement l’islam. Il me demanda de lui traduire le Coran en indien. Ce que je fis. J'en étais à la sourate Ya-Sin,
[8] et je lui traduisais la parole de Dieu : « Qui rend la vie aux os cariés? Réponds : Celui qui les a produits une première fois. » Il était pour lors assis sur un trône d'or incrusté de pierres précieuses et de perles d'une valeur incomparable. « Redis-moi cela, » dit-il. Je le répétai. Aussitôt il descendit de son trône et fit quelques pas sur la terre qui avait été arrosée d'eau et qui était humide. Puis il appuya sa joue sur le sol et pleura, de sorte que son visage fut souillé de boue. « Oui, me dit-il, c'est lui le Maître qu'on doit adorer, le premier, l’antique, celui qui n'a point de semblable! » Il s'était fait faire un cabinet particulier et s'y retirait sous prétexte d'affaires importantes, mais en réalité pour prier secrètement, sans que personne en sût rien. En trois ans il me gratifia de six cents mannas[9] d'or. »II. Le même m'a raconté que les habitants du haut Cachemire ont chaque année un jour de fête où ils se réunissent ; et leur khatîb
[10] y tenant à la main un vase de terre crue, monte à la tribune, récite la prière et dit : « Voyez ce vase[11] de terre si fragile; on l'a soigné, il s’est conservé. Soignez de même vos âmes et vos biens, et conservez-les. » On assure que ce vase est vieux de quatre mille ans.III. Je tiens d'Abou Abd-Allah Mohammed, fils de Bâlichâd, fils de Haram, fils de Hamouïa, de Siraf,
[12] lequel fut en son temps un des notables capitaines de navire qui vont au pays de l’or, le plus instruit parmi les créatures de Dieu en fait des choses de la mer, habile marin s’il en fût, je tiens de lui, dis-je, qu'il y a dans les gobbs[13] de Sérendib, en un pays nommé Abrir-le-grand, trente marchés et plus, dont chacun a bien un demi-mille de long. On y trouve de riches étoffes, des vêtements de haut prix. La ville est à cheval sur un grand fleuve qui coule dans la mer des gobbs.Or, non loin de la ville est une montagne du pied de laquelle s'échappe une source; et sur le flanc de la montagne est un arbre énorme de bronze, hérissé d'épines pareilles à de grosses aiguilles ou à des brochettes. Et en face de l’arbre se dresse une grande idole, sous la figure d'un Noir, dont les yeux sont des topazes. Chaque année, les gens du pays célèbrent un jour de fête auprès de cette idole. Ils y vont, montent sur la montagne, et quiconque désire plaire à son Seigneur, boit, chante, se prosterne plusieurs fois devant l'idole, puis s'élance du haut de la montagne sur l’arbre de bronze dont les épines le mettent en pièces.
[14] Il en est qui se jettent la tête première contre un rocher par dessus lequel coule l’eau de la fontaine, au-dessous de l’idole noire; le malheureux est écrasé sur la pierre, et de cette eau passe dans le feu de l’enfer.IV. Le même m'a assuré qu'à Fetouh,
[15] dans l’Inde, il y a des femmes qui prennent une noix faufel[16] entre leurs grandes lèvres et la cassent par la force dont elles serrent.V. Il m'a conté aussi que Mardouïa fils de Zérâïkht, un des marins de la Chine et des pays de l'or, racontait que, naviguant un jour dans les parages de l’île du Rîh,
[17] il passa entre deux pointes élevées au-dessus de la mer, qu'il prit pour les sommets de deux montagnes sous-marines. Et quand il les eut dépassées, elles plongèrent dans l’eau, et Mardouïa reconnut que c'était les deux pinces d'un crabe.Là-dessus je dis à Abou Mohammed : « D'où tiens-tu cette histoire? » — « Je l'ai entendue de mes oreilles, répondit-il. C'est une chose bien extraordinaire, et je ne sais qu'en dire, si ce n'est que le crabe atteint dans la mer des grosseurs prodigieuses.
[18] »VI. Un autre marin des pays de l’or, Ismail fils d'Ibrahim fils de Mardas, généralement connu sous le nom d’Ismaïlouïa, gendre d’Achkatin, me disait que durant un de ses voyages aux pays de l’or, un accident arrive au navire l'obligea à gagner la terre dans le voisinage de Lâmeri.
[19] Voulant faire halte il fit jeter la grande ancre; mais le navire, sans qu'on sut pourquoi, continua sa marche. Le capitaine dit au plongeur : « Descends le long du câble de l’ancre et vols ce qui se passe. » Et le plongeur s'apprêtant à descendre regarda sous l’eau ; et voici que l'ancre était entre les pinces d'un crabe qui jouait avec l’instrument et entrainait le navire. Les matelots poussèrent des cris, lancèrent des pierres à l'eau. On retira l’ancre pour la jeter en un autre endroit. Or son poids s'élevait à six cents mannas et plus.VII. D'après le récit que m'en a fait Abou Mohammed el-Hasan fils d'Amr, un capitaine de navire lui raconta qu'étant parti pour le Zâbedj,
[20] sur un navire à lui appartenant, le vent les poussa vers les iles du Ouâq-ouâq[21] où ils durent s'arrêter non loin d'une bourgade. A leur vue, les habitants prirent la fuite dans la campagne, emportant tout ce qu'ils purent de leurs biens. Les gens du navire, qui ne connaissaient pas le pays et qui ignoraient la cause de la fuite des naturels, furent d'avis d'aborder à terre. Le navire demeura là deux jours sans que personne vînt à eux ou fit mine d'entamer quelque rapport. Enfin un matelot, qui connaissait la langue des Ouâqouâquis, fut débarqué et se risqua à traverser la bourgade pour gagner la campagne. Il découvrit un homme caché sur un arbre, lui parla, lui fit des amitiés, lui offrit des dattes qu'il avait et le questionna sur la population du pays, lui promettant sécurité et récompense, s'il montrait de la franchise.L'homme répondit qu'en apercevant le navire, les gens de la bourgade avaient cru qu'on voulait les attaquer et qu'ils s'étaient sauvés avec leurs biens. Il consentit à suivre le matelot au navire. On lui donna trois compagnons, chargés pour le roi du pays d'un beau message, assurant toute sécurité au roi et à son monde, et lui portant aussi un cadeau composé de deux vêtements, de quelques dattes et de diverses bagatelles.
Le prince rassuré revint avec tous ses gens. On demeura avec eux, et on commença un commerce d'échange avec tout ce dont le navire était chargé.
Le vingtième jour n'était pas encore écoulé, quand survint une autre peuplade avec son chef pour attaquer la première. « Sachez, dit le roi de la bourgade, que ceux-là viennent pour s'emparer de force de ce qui est à moi, non à eux. Ils s'imaginent que j'ai acquis toute la cargaison du navire. C’est pourquoi prêtez-nous votre secours pour les écarter et de vous et de nous. »
« Dès l'aurore, dit le narrateur, la troupe étrangère vint pour commencer l'attaque à la porte de la ville. Et le roi sortit à leur rencontre avec son monde, soutenu par tout ce que le navire put fournir d'hommes en état de combattre et de marchands disposés à la bataille. Le combat s'était engagé, lorsqu'un matelot originaire de l'Irac, tira de son coin une feuille de papier sur laquelle était écrit un compte à lui, la développa toute grande, et l'éleva de la main vers le ciel, en prononçant des paroles à haute voix.
« Aussitôt que les agresseurs virent la chose, ils cessèrent immédiatement leur attaque. Quelques-uns vinrent au matelot et lui dirent : « Par grâce, arrête ! nous allons partir, nous ne toucherons à rien. » Et tous se disaient les uns aux autres : « Cessons, cessons le combat. Nos ennemis ont élevé leur affaire vers le roi du ciel. Nous serions vaincus, écrasés. » Et ils s'humiliaient devant le matelot, jusqu'à ce qu'il eût remis la feuille dans son coin. Alors ils se retirèrent, vérifiant cette parole de Dieu... (?)
« Ainsi débarrassés d’eux, continue le narrateur, nous revînmes à nos affaires accoutumées de ventes et d'achats. Nous demandâmes à acheter des esclaves, et nous réussîmes si bien, avec des pagnes, des dattes et des bagatelles données en échange, que le navire fut bientôt chargé de cent têtes d’esclaves grands ou petits.
« Au bout de quatre mois, le moment du départ approchant, ceux que nous avions achetés nous dirent : « Vous avez beau nous réduire en esclavage et nous séparer de nos familles, soyez assurés que nous les rejoindrons. » On les avait conduits sur le navire, les uns attachés, les autres enfermés et sans liens. Cinq hommes de l'équipage restaient à bord pour s'occuper de leur nourriture et veiller sur le navire. Les autres étaient à terre. Or, une nuit, les captifs se jetèrent sur les hommes de garde, les lièrent de cordes, levèrent l’ancre, mirent à la voile et volèrent le navire. Au matin, il avait disparu, et nous fûmes obligés de reconnaître qu'il ne nous restait d'autre ressource que ce qu'il pouvait y avoir encore de bon ou de mauvais dans la bourgade, après toutes nos prises des jours précédents. On ne put avoir aucune nouvelle du navire. Il nous fallut séjourner là bien des mois, jusqu'à ce que, ayant construit une belle chaloupe capable de nous porter, nous nous embarquâmes pour le retour. »
VIII. Ahmed, fils d'Ali, fils de Mounir, le capitaine, natif de Siraf, qui fut aussi un de ces illustres marins qui ont parcouru les mers et acquis gloire et renom, m'a raconte qu'un respectable personnage de l’Inde lui avait fait le récit suivant. Un navire fit naufrage dans les parages de Sérendib.
[22] Une partie des gens se sauva sur la chaloupe et vint aborder à une ile voisine de l’Inde. Ils y séjournèrent quelque temps. Beaucoup moururent et enfin ils furent réduits au nombre de sept. Dans cet intervalle, ils avaient vu un oiseau énorme s'abattre sur l’île et paître, puis, vers le soir, s’envoler, sans qu'ils pussent savoir où il se transportait.[23] Cela leur fit concevoir un dessein, qui fut que chacun deux, l’un après l’autre, s’attachât aux pattes de l'oiseau et se laissât emporter, tant ils étaient dévorés d'ennui et se voyaient hors d'état d'échapper à la mort. L'oiseau seul pouvait les tirer de là. S'il les jetait dans le voisinage d'un pays habite, leurs désirs étaient remplis; s'il les tuait, ce n'était guères changer de condition.Un des naufragés se cacha donc parmi les arbres. L’oiseau vint à son ordinaire pour paître. Un peu avant l'instant de son départ, l’homme se glissa doucement vers lui, fut assez adroit pour lui saisir les pattes et s'y attacher avec des écorces fibreuses. L'oiseau s'envola et l’emporta au haut des airs. L'homme se maintenait, les jambes croisées sur les pattes de l’oiseau. Celui-ci franchit un bras de mer, et vint s'abattre sur une montagne au coucher du soleil. L'homme se délia et tomba à terre, à demi-mort de fatigue, d'épuisement et de frayeur. Il demeura sans mouvement jusqu'au lendemain au lever du soleil. Alors il se leva, regarda autour de lui et découvrit un berger à qui il demanda en langue indienne le nom du pays. Le berger lui nomma une ville de l’Inde et lui donna à boire du lait. Enfin l’homme gagna la ville.
Quant aux six autres naufragés, l'oiseau les transporta successivement de la même façon, et tous se retrouvèrent enfin réunis dans cette ville. De là, ils gagnèrent un port où ils purent s'embarquer, et étant retournés dans leur patrie ils racontèrent l’étrange histoire de leur naufrage et de l’oiseau. Quant à la distance franchie par l’oiseau entre l’île et la montagne où il les jeta, elle fut évaluée à plus de deux cents parasanges.
[24]IX. En fait d'animaux gigantesques, Aboul’ Haçan Mohammed, fils d'Ahmed, fils d'Amr, de Siraf, m'a raconté qu’il vit à Oman,
[25] en l'année 300, un poisson que les flots avaient jeté et laissé sur la plage. On s'en empara et on le traîna à quelque distance. L'Emir Ahmed, fils de Hélal,[26] y vint à cheval avec ses troupes, au milieu d'un concours de gens accourus aussi pour voir le monstre. Telle était sa grandeur que le cavalier entrait à cheval par la mâchoire et sortait du côté opposé. L'ayant mesuré, on trouva que sa longueur dépassait deux cents aunes[27] et son épaisseur, de bas en haut, cinquante. On en tira de l'huile dont il fut vendu, suivant ce qu’on a rapporté, pour une somme de dix à vingt mille dirhems.[28]Le capitaine de navire Ismaïlouïa m’a dit que ce poisson abonde dans la mer des Zindj
[29] et dans l'océan de Herkend.[30] On le nomme Ouak. Il se plaît à défoncer les navires. Quand les navigateurs en font la rencontre, ils cherchent à l'effrayer par des cris, par le bruit des tambours et de pièces de bois choquées les unes contre les autres. Chaque fois qu'il souffle l’eau, on voit s'élever une colonne comme un phare, et de loin on dirait les voiles d'un navire.[31] Quand il joue avec sa queue et ses nageoires, on croit voir encore la voilure d'une grande embarcation.X. J'ai ouï dire par un Irakien qu'il avait vu dans le Yémen, chez un de ses amis, la tête d’un poisson dont la chair avait disparu et dont les os restaient intacts; il avait pu entrer par un des creux des yeux et sortir de l'autre côté, debout, sans baisser la tête. En l’année 310, la mâchoire d'un de ces poissons fut portée d'Oman au Khalife Moqtadir.
[32] On en avait tiré cinq cents jarres d'huile ou plus.XI. Suivant le récit que m'a fait Abou Mohammed el-Haçan fils d'Amr, un marin racontait devant lui qu'étant sur un bâtiment qui allait d'Aden à Djedda,
[33] un poisson frappa si violemment la coque du navire que chacun resta persuadé qu'il y avait percé un trou. Cependant les matelots descendus dans la cale n'y trouvèrent pas plus d'eau qu'à l'ordinaire, et demeurèrent surpris qu'un tel coup n'eût pas laissé de traces. Or, étant arrivés à Djedda, le navire déchargé et tiré à terre, on reconnut que la tête du poisson était restée prise dans les flancs du navire, bouchant parfaitement le trou qu'elle avait fait. L'animal, après le choc, n'avait pu retirer sa tête qui s'était détachée du corps et demeurait en place.[34]XII. Le même m'a dit avoir vu souvent qu'un poisson pris étant ouvert, on trouvait des poissons dans son ventre, et dans le ventre de ceux-ci d'autres poissons. Cela vient de ce que des poissons mangent des poissons qui en ont mangé d'autres.
[35]XIII. Entre autres singularités, Mohammed, fils de Bâlichâd, fils de Haram, m’a raconté qu'il se trouvait à Siraf en un moment où l'on s'inquiétait beaucoup d'un navire parti depuis quelque temps pour Basra et dont on n'avait pas de nouvelles. Il y avait eu des naufrages, et chacun se préoccupait des nouvelles de mer. Ce navire portait beaucoup de monde, marins et autres, et une riche cargaison. Or une femme qui avait acheté du poisson, trouva, en le vidant, dans le ventre de l'un d'eux, un anneau servant de cachet. Elle regarde et reconnaît le cachet de son frère, qui était embarqué, lui aussi, sur le susdit navire. Elle pousse un cri de désespoir. La nouvelle se répand, et bientôt chaque maison dont quelque membre, ami, proche ou parent, était sur le navire, devient un théâtre de lamentations. Ce fut seulement bien des jours après qu'on eut la nouvelle que le navire avait fait naufrage et que personne ne s'en était sauvé.
XIV. Un pilote m'a raconté que, dans les parages du Yémen, son navire fut suivi durant un jour et deux nuits par un poisson qui raccompagnait exactement sans le devancer ni rester en arrière. On évalua la longueur de la route faite ensemble à plus de cent soixante-dix parasanges. Ce poisson était aussi long que le navire, lequel avait cinquante aunes, à l’aune usuelle, comptée depuis le creux de l’aisselle jusqu'au bout du doigt médian.
Je lui demandai quelle était la raison qui poussait ces animaux à suivre ainsi les navires et à lutter de vitesse avec eux. « La raison, dit-il, n'est pas la même pour tous. Il y en a qui suivent les navires dans l’espoir qu'il en tombera quelque chose dont ils feront leur profit. Ils ont auparavant fait la rencontre de quelque navire naufragé où ils ont trouvé à se repaître ; tout bâtiment qu'ils aperçoivent leur donne l'espoir d'un semblable régal. La poursuite des navires devient pour eux une habitude. D'autres, voyant un navire, s'en émerveillent et le prennent pour un animal qui nage partie dans l'air partie dans l'eau. Ils luttent de vitesse avec lui, par bonne amitié et camaraderie, jusqu'à ce qu'ils se lassent et l'abandonnent. Car les animaux n'ont pas tous la constance de l'âne. Tel autre s'obstine dans la lutte avec le navire; se sentant fatigué, vaincu, dépassé par cet être inconnu, de colère il prend son élan et se rue sur lui d'un bond. Si le navire échappe au choc... sinon, implorons la miséricorde de Dieu. Quelquefois le poisson irrité s'acharne, frappe le navire coup sur coup jusqu'à ce qu'il l’ait renversé. Quelques-uns s'effraient à la vue du navire et prennent la fuite. Enfin leurs habitudes diffèrent avec les régions marines où ils séjournent, suivant qu’ils se trouvent proche des rivages habités, sur le passage des voyageurs et des pécheurs, ou bien dans les mers lointaines, inexplorées, dans les profondeurs de l'océan, à distance des continents et des îles. Le monde des abîmes sous-marins est véritablement un autre monde. » Béni soit Dieu, l'admirable créateur !
XV. Voici ce qui m'a été conté relativement à l’île des femmes par le nakhoda
[36] Abou'z-Zeher el-Barkhati, un des personnages importants de Siraf. Il avait été adorateur du feu, suivant la religion de l’Inde. Sa parole était fort écoutée, chacun lui confiait volontiers et ses biens et ses enfants. Il finit par embrasser l’islamisme, fut très bon musulman et accomplit le pèlerinage. Il était parti, me dit-il, sur un grand navire à lui appartenant, emmenant une foule de commerçants de tout pays. Parvenus dans la mer de Malayou,[37] ils approchaient des parages de la Chine et en distinguaient déjà quelque sommet de montagne, quand tout à coup un vent terrible s’éleva soufflant à l’opposé de la direction du navire, avec une telle violence qu'il n'était pas possible de lui résister, et l'agitation des flots leur ôta tout moyen de gouverner. Ce vent les entraîna dans la direction de Canope. Or quiconque est poussé dans cette mer à tel point que Canope se trouve à son zénith, celui-là doit perdre tout espoir de retour. Il est rejeté dans une masse d’eau qui coule vers le midi; à mesure que le navire avance, les flots s'élèvent derrière lui, de notre côté, et devant lui Ponde s’abaisse. Alors, quel que soit le vent, violent ou paisible, tout retour lui est fermé; le courant l'entraîne dans l'immensité de l'Océan.Quand les gens du navire s'aperçurent qu'ils marchaient vers Canope, quand la nuit les eut envahis, et qu'ils se virent dans des ténèbres profondes, hors d'état de se diriger, ils désespérèrent de leur salut. La puissance des vagues tantôt les élevait jusqu’aux nues, tantôt les plongeait dans les abîmes. Toute la nuit, ils demeurèrent ainsi dans un brouillard épais, sur une poix liquide.
[38] Et quand revint l'aurore, ils ne s'en apercevaient point, à cause des ténèbres qui les environnaient, et du brouillard qui rejoignait la surface de la mer, et de la violence du vent et du trouble de leurs esprits. Dans cette nuit si longue, sans espoir de salut, livrés en proie à la violence de la tempête, dans la mer bouillonnante, battus par des vagues effroyables, sur leur navire bondissant, plongeant, ébranlé, gémissant, les passagers se firent leurs adieux, et chacun de son côté invoqua la puissance de l'objet de ses adorations; car il se trouvait parmi eux des gens de la Chine, de l'Inde, de la Perse et des iles. Puis ils se résignèrent à la mort.Deux jours et deux nuits s'écoulèrent ainsi, sans qu’ils pussent distinguer la nuit du jour. Vers le milieu de la troisième nuit, ils virent devant eux l'horizon illuminé d'un feu extraordinaire. Une nouvelle peur les saisit ; et s'adressant au capitaine : « Ne vois-tu pas, dirent-ils, ce feu effrayant qui remplit l'horizon et vers lequel nous sommes entraînés. Voilà qu'il nous entoure, et nous aimons mieux être noyés que brûlés. Au nom de la divinité que tu adores, fais chavirer le navire avec nos personnes au sein de cet abîme, au milieu de ces ténèbres, où chacun de nous périra du moins sans apercevoir les souffrances de ses compagnons. Fais et tu es d'avance pardonné pour ce qui nous arrivera. Durant ces nuits et ces jours derniers, ne sommes-nous pas morts déjà de mille et mille morts. Et ne vaut-il pas mieux bien mourir en une fois ? »
Le capitaine répondit : « Sachez que les voyageurs et les commerçants sont exposés, à des dangers terribles, plus terribles que ceux qui vous effraient en ce moment. Et nous, membres de la confrérie des pilotes, nous sommes tenus à des devoirs; nous avons fait serment de ne jamais laisser perdre un navire, tant que le terme fatal n'est pas venu pour lui. Nous ne les abandonnons qu'avec notre propre vie. Prenez patience, confiezvous à la volonté du souverain des vents et de la mer qui les change tous deux comme il lui plaît. »
Voyant que le capitaine se refusait à leurs désirs, ils se mirent à sangloter, à pousser des gémissements, et chacun regrettait la tranquillité passée. En vain le capitaine dit au crieur de transmettre ses ordres à l'équipage pour les manœuvres que nécessitait la situation du navire ; le bruit de la mer, le tumulte des vagues entrechoquées, le mugissement des vents dans les voiles et les cordages, et aussi les lamentations des hommes, empêchèrent l'équipage d'entendre. Et le navire faillit périr faute d'être gouverné. Pourtant il continua sa marche, sans changement dans la mer ni le vent.
Il se trouvait dans le navire un musulman d'un âge respectable, natif de Cadix, en Espagne, qui, dans la presse des hommes, au moment de l'embarquement, s'était glissé à bord, durant la nuit du départ, sans que le capitaine l'aperçût. Il s'était ensuite tenu caché dans un coin retiré du navire, de peur d'être injurié et maltraité s'il se montrait. Mais lorsqu'il vit la situation du navire, les dangers qu'on courait, et la conduite des hommes qui conspirait avec le bouleversement des flots contre leur propre vie, il n'hésita plus à sortir de sa cachette, advienne que pourra de sa propre personne. Il s'avança donc vers les gens du navire et leur dit : « Que se passe-t-il? Est-ce que le navire s'est ouvert?» On lui répondit : « Non. — Le gouvernail s'est-il cassé ? — Non. — Est-ce que la mer vous envahit ? — Non. — Qu'y a-t-il donc ? » — « Vraiment, répondirent-ils, tu parles comme si tu n'étais pas avec nous sur ce navire. Ne vois-tu pas l'agitation terrible de la mer, et ses vagues, et l'obscurité qui nous environne, ne laissant apercevoir ni soleil ni lune ni étoiles pour guider notre marche ? Voilà que nous sommes entrés sous Canope, livrés à la merci des vents et des flots. Et le plus terrible encore, c’est ce feu là-bas vers lequel nous courons et qui déjà remplit l'horizon. Nous aimerions mieux périr noyés que brûlés, et nous avons prié le capitaine de renverser le navire dans la mer, au milieu des ténèbres qui nous cacheraient les uns aux autres, afin de mourir dans l'eau et non dans le feu, sans ajouter à nos souffrances celle de voir brûler nos compagnons.
L'homme reprit ; « Conduisez-moi au capitaine. » Amené devant lui, il le salua en langue indienne. Le capitaine surpris de voir cet inconnu lui rendit son salut et lui demanda : « Qui donc es-tu parmi les marchands ou les gens de leur suite? Nous ne te reconnaissons pas comme une des personnes embarquées avec nous. » L'homme répondit : « Je ne fais partie ni des marchands ni de leur suite. » — Qui donc t'a fait embarquer? reprit le capitaine. — C’est moi, dit-il, qui me suis glissé dans la foule, au moment du départ, et je m'étais réfugié dans un coin écarté du navire. — Comment te nourrissais-tu ? — Du plat de riz au beurre que le banian
[39] du navire plaçait chaque jour dans mon voisinage pour les anges du bord. »Tout cela surprit fort le capitaine. Et les gens du navire, distraits par cette aventure, firent trêve à leurs cris de terreur; l'équipage se mit à son devoir ; à la voix du crieur, les voiles et les agrès furent mis en état, le vaisseau se trouva de nouveau gouverné. « Capitaine, dit l'homme de Cadix, d'où venaient les pleurs et les lamentations de tout ce monde ? — Eh ! répliqua le chef, ne vois-tu pas ce qu'il y a de terrible pour eux dans cette mer, ce vent, ces ténèbres, et plus encore dans ce feu qui remplit l'horizon et vers lequel nous pousse la tempête? Pour moi, je navigue dans ces mers depuis mon enfance, alors que je suivais mon père qui toute sa vie les a traversées; me voici laissant déjà derrière moi ma quatre-vingtième année, et jamais je n’ai ouï dire que quelqu'un eût vu ce que nous voyons ni mentionné rien de pareil. — Rassure-toi, dit l'étranger. Avec la grâce de Dieu vous vous sauverez. Là-bas est une île entourée de montagnes sur lesquelles se brisent les flots de l'Océan. On y voit durant la nuit un feu prodigieux qui effraie l'ignorant. Au lever du soleil cette vision disparaît et s'en va en eau. Ce feu s'aperçoit du pays d'Andalous,
[40] j'y suis passé une fois et voici la seconde. »Aux paroles de l'étranger, la joie se répandit dans le navire, les inquiétudes se calmèrent, la frayeur s'évanouit; on mangea, on but. Et voilà que le vent mollit et la mer devint calme; et ils approchèrent de l'île avec le lever du soleil. Le ciel s'étant éclairci, ils aperçurent la terre dont l'aspect les remplit de joie. Le navire aborde, tout le monde veut débarquer, ils se jettent sur le sable, se roulent passionnément sur cette terre bien-aimée, et pas une âme ne reste sur le navire.
Pendant ces transports, tout à coup de l'intérieur de l'île arrive une cohue de femmes dont Dieu seul pourrait compter le nombre. Elles tombent sur les hommes, mille femmes ou plus pour chaque homme. Elles les entraînent vers les montagnes, elles en font l’instrument de leurs plaisirs. C'est entre elles une lutte sans cesse renouvelée, et l’homme appartient à la plus forte. Les hommes mouraient d'épuisement l'un après l’autre; et chaque fois qu’il en mourait un, elles tombaient encore sur lui à l’envi. Un seul survécut, ce fut l’espagnol qu'une femme seule avait emporté.
[41] Il resta caché dans le voisinage de la mer, et tous les jours cette femme lui portait à manger. Enfin le vent tourna et commença à souffler dans la direction du pays de l'Inde, d’où le navire était parti. L'homme prit le canot appelé felou et le munit pendant la nuit d’eau et de provisions. La femme voyant son dessein le conduisit en un endroit où, ayant écarté la terre, elle mit à découvert une mine de poudre d'or. Elle et lui en chargèrent le canot, autant qu'il en put recevoir. Puis ils s'embarquèrent tous deux, et après dix jours de navigation parvinrent au port d'où venait le navire.La femme demeura avec l'espagnol, apprit sa langue, se fit musulmane et lui donna plusieurs enfants. Questionnée sur cette ile et ces femmes qui y vivaient hors de la société des hommes, elle parla ainsi : « Nous venons d’un pays plein de grandes villes dont les plus rapprochées de l’île en sont à trois jours et trois nuits de navigation. Les habitants de ce pays, tant rois que sujets, adorent tous ce feu qui, la nuit, brille dans l’île. Ils nomment l'île maison du soleil, parce que cet astre se lève à son extrémité orientale et se couche à son côté occidental ; et suivant leur croyance, il passe la nuit dans cette île. Le matin, à l’aurore, le feu nocturne s'éteint, s'évanouit, et aussitôt le soleil se lève : Le voilà ! le voilà ! disent-ils, et ils l’adorent, se prosternent de tous côtés et lui adressent leurs prières. Ils agissent de même quand le soleil se couche et que le feu paraît.
« Il faut savoir que, par la volonté de Dieu, les femmes dans ce pays accouchent la première fois d’un garçon, la seconde fois de deux filles, et continuent de même en alternant, le reste de leur vie. Il arriva donc que dans nos pays les hommes furent rares, et les femmes devenues plus nombreuses voulurent les dominer. Alors les hommes en embarquèrent des milliers et les allèrent Jeter sur cette île disant à leur Dieu, le soleil : « C'est à toi qu'appartient de droit ce que tu as créé; pour nous, nous n'avons plus sur elles aucun pouvoir. »
« Les femmes furent ainsi laissées dans l’île, où elles meurent les unes après les autres. Et depuis notre débarquement, aucun homme n'était passé parmi nous avant votre arrivée. Car notre île est située dans la vaste mer, sous Canope; et nul voyageur ne peut s'y rendre et repartir ; nul n'ose abandonner le rivage et la terre ferme, de peur d'être englouti par l’Océan. Ainsi l'a voulu le Tout-Puissant. » Béni soit Dieu, le meilleur des créateurs.
XVI. Le capitaine Abou'z-zahrâ el-Barkhati, m'a fait le récit suivant qu'il tenait de son oncle maternel nommé Ibn-Enchartou. Le père de cet oncle disait :
« Je partis sur un grand navire à moi, nous dirigeant vers l'île de Qaiçour.
[42] Le vent nous poussa vers une région marine où nous demeurâmes trente-trois jours dans un calme plat, sans un souffle de vent, tranquilles sur la face de la mer; et nos ancres ne trouvaient pas de fond à mille brasses de profondeur. Mais un courant nous entraînait sans que nous nous en doutions, jusqu'au moment où il nous amena parmi des îles. Nous gouvernâmes sur une de ces îles. Le long du rivage des femmes nageaient, criaient, jouaient. Nous leur faisons des signes d'amitié, en nous dirigeant vers elles. Mais à notre approche elles se sauvent dans l’île. Bientôt vinrent à nous des insulaires, hommes et femmes, qui paraissaient fort intelligents, mais dont la langue nous était inconnue. Nous nous exprimons par signes et ils nous répondent de même. Nous les comprenons et ils nous comprennent : « Avez-vous des aliments à nous vendre ? — Oui. » Et ils nous apportent en abondance du riz, des poules, des brebis, du miel, du beurre, des fruits et autres comestibles. Nous les payons avec du fer, du cuivre, du koheul,[43] des verroteries, des vêtements. Nous leur fîmes encore signe : « Avez-vous quelque objet de commerce ? — Nous avons des esclaves. — Fort bien. Amenez-les. « Et ils nous présentèrent les plus beaux esclaves que nous eussions vus de notre vie, et les plus gais; ils chantaient, jouaient, folâtraient, plaisantaient entre eux. Leur corps était d'une grande pureté de forme, et doux comme de la crème; si légers, si vifs qu'ils semblaient à chaque instant tout prêts à s'envoler. Seulement leur tête était petite, et sous leurs flancs on voyait des espèces d'ailes ou de nageoires comme en a la tortue. « Qu'est-ce là? dîmes-nous aux insulaires. — Ne vous en inquiétez pas, répliquèrent-ils en riant. Les gens de l'île sont ainsi faits. » Et ils montraient le ciel, pour dire : « C'est Dieu qui nous a créés avec cette conformation. » Sans nous en préoccuper davantage, nous pensâmes que la chose importait peu et que ces esclaves faisaient parfaitement notre affaire. Aussi en achetâmes-nous, chacun suivant nos facultés. Le navire fut vidé de marchandises et rempli d’esclaves et de provisions. A peine en avions-nous acheté quelques-uns qu'ils nous en amenaient d’autres plus beaux encore ; si bien que le bâtiment se trouva plein de créatures telles que les yeux n’ont jamais admiré rien de plus beau ni de plus gracieux. Vraiment il y avait là de quoi nous enrichir, nous et nos arrière-neveux.Le temps du départ arriva, le vent souffla des îles vers notre pays. Nos affaires étaient terminées, et les insulaires nous dirent : « Vous nous reviendrez plus tard, s’il plaît à Dieu ! » C’était bien notre désir. Et notre capitaine aussi désirait revenir, mais seul avec son navire, libre de marchands. Et il passa la nuit avec ses hommes à étudier les étoiles, à reconnaître la place des constellations, à s'orienter pour fixer dans sa mémoire le chemin de l’aller et du retour.
Nous étions tous ravis, pénétrés de la plus vive joie. On mit à la voile au point du jour, on s'éloigna de l’île par un vent favorable. Quand l'île eût disparu à nos yeux, voilà que plusieurs de nos esclaves commencèrent à se lamenter, et leurs lamentations nous ennuyaient. Mais d'autres esclaves allant à eux : « Pourquoi gémir, dirent-ils. Allons ! amusons-nous, dansons, chantons. » Et toute la troupe se mit à danser, à chanter en riant. Cela nous fit plaisir. « Voilà, dîmes-nous, qui vaut mieux que des gémissements. » Puis, sans songer à eux davantage, nous nous occupâmes chacun de nos affaires. Profitant de notre inattention, les esclaves choisirent le moment propice, et d'un bond s'élancèrent par-dessus bord comme un vol de sauterelles. Et le navire, poussé par une forte brise courait avec la rapidité de l'éclair sur des flots pareils à des montagnes; les fuyards étaient dans la mer éloignés de nous d'une parasange avant que nous nous fussions rendu compte de leur escapade; et nous les entendions qui riaient, chantaient, battaient des mains. Nous comprîmes qu'ils se sentaient fort en état de lutter contre la houle de la mer, et ne pouvant retourner en arrière nous perdîmes tout espoir de les reprendre.
« De toute la cargaison il ne resta qu'une jeune esclave appartenant à mon père, alors enfermée dans une grande cabine. Mon père descendant à la cabine trouva la jeune fille qui cherchait à se frayer une issue pour se jeter à la mer. Il la saisit et l'attacha.
« Le voyage achevé, de retour dans l’Inde, nous vendîmes les approvisionnements qui nous étaient restés; et après le partage, chacun se trouva avoir décuplé son capital. Le bruit de nos aventures nous amena un homme très âgé originaire de ces îles. Il avait été pris jeune et était depuis demeuré dans l’Inde. Ce vieillard nous dit: « Les îles où le hasard vous a jetés se nomment les îles du Poisson. C’est mon pays. Chez nous les hommes se sont jadis accouplés avec les femelles des animaux marins, et les femmes se sont livrées aux mâles. De ces unions naquirent des êtres participant de la nature de leur père et de leur mère. Ces êtres se sont croisés entre eux. Il y a longtemps que les choses sont ainsi; et nous sommes devenus capables de séjourner longuement tant sur terre que dans la mer, tenant de l’homme et du poisson. »
« Pour revenir à l’esclave de mon père, il en eut six enfants, et je suis le sixième. Il la garda dix-huit ans, toujours attachée; car le vieillard des îles lui avait dit : « Si tu la mets en liberté, elle se jettera à la mer et sera perdue pour toi. L'eau a pour nous un attrait invincible. » Et nous, nous blâmions inconsidérément notre père de tenir notre mère attachée. Lui mort, notre premier soin fut de la délivrer de ses liens, par respect, par piété filiale. Elle s'élança au dehors comme une jument effarouchée et nous courûmes après elle sans réussir à la rejoindre. Quelqu'un qui la croisa dans sa fuite lui dit : « Tu t’en vas, abandonnant tes fils et tes filles ? » Elle répondit : « Enchartou » c'est à dire « que puis-je leur faire ? « Et elle se jeta dans la mer comme le plus vigoureux des poissons. » Gloire au Créateur !
XVII. En fait de poissons, Abou’l-Haçan fils d’'Amr rapporte : « J'ai vu une côte de poisson que nous avait apportée un patron de navire. On en avait coupé un morceau de cinq aunes environ, et on l'avait jeté en guise de pont sur un ruisseau à la porte d'un jardin que nous avions à Djézira.
[44] Le reste était long de vingt aunes. »Il y a dans la mer une espèce de poisson auquel les autres ne peuvent résister. Il a une trompe faite comme une scie dentelée des deux côtés.
[45] Lorsqu'il en frappe un poisson, il le coupe en deux. Dans les parages qu'il fréquente, les riverains s'emparent des trompes de ceux qu'ils rencontrent morts ou qu’ils ont capturés, et ils s'en font, pour leurs combats, des armes plus terribles que les sabres.XVIII. Un marin des ports de l’Irak m’a dit qu’il avait entendu raconter ceci par un vieux capitaine de navire. En partant de Siraf, il avait dans son bateau un homme qui durant la traversée se prit de querelle mal à propos avec un passager, l’injuria, et dépassa les bornes de la bienséance. Le passager ne répliqua rien, parce qu'il était étranger, sans personne pour le soutenir, et que son agresseur avait été embarqué avec eux par faveur, sur sa propre intercession. Celui-ci était sur le pont. Or, trois minutes à peine après l’altercation, un kaba'da s'élança de la mer, frappa avec la tête le corps de l'homme et s'échappa du côté opposé.
[46] On ensevelit l’homme et on jeta son corps à la mer.XIX. J'ai aussi entendu conter sur les tortues des choses bien curieuses et que l’esprit a de la peine à croire. Voici ce que je tiens d'Abou Mohammed el-Haçan fils d'Amr. Il avait entendu un vieux marin raconter qu'un navire parti de l'Inde ayant éprouvé quelque avarie aborda à un petit îlot entièrement dépourvu d'eau et de bois, mais où la nécessité les contraignit de s’arrêter. On y débarqua le chargement du navire et où y demeura le temps nécessaire pour réparer l’avarie. Puis les ballots furent reportés à bord pour se remettre en route. Sur ces entrefaites arriva la fête du Naurouze
[47] (nouvel an), et, pour la célébrer, les passagers portèrent sur l’îlot ce qu'ils purent trouver dans le navire de menu bois, de feuilles de palmier, de chiffons, et ils y mirent le feu. Soudain l’ilot s’agita, trembla sous leurs pieds. N’étant pas éloignés de l'eau, ils s'y jetèrent et s’accrochèrent aux embarcations.[48] A l'instant l'îlot s'enfonça dans les flots, produisant un tel remous qu'ils faillirent tous se noyer et ne se sauvèrent qu'à grand-peine, en proie à la plus vive frayeur.Or l’îlot n'était qu'une tortue endormie à fleur d'eau; réveillée par la brûlure du feu, elle s'était enfuie.
[49]Je demandai à mon narrateur comment cela se faisait. « La tortue, me dit-il, a chaque année une période de jours où elle remonte à la surface de l'eau pour se délasser de son long séjour dans les cavernes des mers, parmi les gorges et défilés sous-marins, où croissent des arbres effrayants, des plantes prodigieuses, bien plus extraordinaires que nos arbres et nos plantes terrestres. Elle vient donc à fleur d'eau, et y passe des journées, privée de sentiment, comme un homme ivre. Lorsqu'elle a repris connaissance, elle plonge. Et quand le mâle s'unit à la femelle, cette union se fait toujours à la surface de la mer. »
XX. Un vieux marin racontait à Aboul Haçan fils d’Amr, qui me l’a rapporté, que, naviguant dans les gobbs (de Sérendib), il avait été l’hôte d'un roi de ces régions. « On nous servit, disait-il, des mets que nous mangions. Et parmi ces mets, se trouva une sauce dans laquelle nageaient des morceaux de viande cuite, des têtes, des mains, des pieds tout à fait pareils à des têtes, des mains et des pieds de jeunes garçons. Cela me souleva le cœur, et je cessai de manger, quoique j'eusse montré jusque-là fort bon appétit. Le roi s'en aperçut, mais ne dit mot. Le lendemain quand j'allai lui faire visite, il donna un ordre à ses gens qui apportèrent un poisson ; et si je ne lui avais vu tous les mouvements et les écailles d'un poisson, j'aurais été persuadé qu'il était fils d'Adam. « Voilà, me dit le roi, ce dont hier tu avais répugnance de manger; c’est le meilleur de nos poissons, le plus agréable au goût, le plus facile à digérer, le moins capable de faire mal. » Depuis, je ne fis point difficulté d'en manger. »
XXI. Quelqu'un qui avait voyagé dans le Zéïla
[50] et le pays des Abyssins, m'a dit qu'on trouve dans la mer de Habach un poisson qui a toute la figure des fils d'Adam, le corps, les mains, les pieds. Les pécheurs qui s'en vont au loin, les malheureux qui courent chercher fortune dans les régions inexplorées, sur des rivages déserts, parmi les îles et les montagnes où ils ne rencontrent jamais âme vivante, découvrent parfois cette espèce de poisson à face humaine. Ils s'accouplent aux femelles. Et de là naissent des êtres ressemblant à l’homme, qui vivent dans l'eau et dans l’air. C'est ainsi que l’homme en s'unissant à la panthère, à l’hyène et autres animaux terrestres, a donné naissance au singe, aux nisânis et autres êtres qui lui ressemblent. C’est ainsi que l'union des porcs et des buffles a produit l’éléphant, celle des chiens et des chèvres le sanglier, celle de l'âne et de la jument le mulet. Et si nous voulions dire tout ce qui a trait aux diverses sortes d'accouplements, il y aurait de quoi lasser le lecteur, et cela nous écarterait de notre sujet, les merveilles particulières de l'Inde.Le poisson nommé zhaloum a, dit-on, la figure d'un homme, des organes sexuels pareils aux nôtres, tant mâles que femelles. On le pêche. Sa peau, plus épaisse, que la peau de l'éléphant, se tanne et s'emploie pour faire des chaussures.
[51]On assure que tout oiseau qui vole dans l'air, à la surface de la terre, a son pareil dans la mer, parmi les poissons. Pour moi, j'ai vu dans le golfe d’Ayla,
[52] en Syrie, un petit poisson qui a les couleurs du pivert, qui voltige sans cesse dans l’eau et hors de l'eau.XXII. Parmi les choses extraordinaires de la mer de Fars, quelquefois la nuit, quand les vagues sont agitées et s'entrechoquent, on voit les flots étinceler, et le navigateur jurerait qu'il s'avance sur une mer de feu.
[53]XXIII. Il y a aussi, dit-on, dans la mer, des serpents monstrueux, effrayants nommés tannin.
[54] Au milieu de l’hiver, quand les nuages rasent la surface de l'eau, ce tannin sort de la mer, entre dans la nue, encore chaud de la chaleur du liquide; car l’eau de la mer est chaude en cette saison. Saisi par le froid du nuage, il y reste emprisonné; et les vents venant à souffler à la surface de l’eau, le nuage monte et entraîne le tannin. Il voyage d'un point de l'horizon à l'autre, et quand la vapeur du nuage s'est dissipée en atomes, dispersés, éparpillés par le vent, le tannin que rien ne soutient plus tombe tantôt sur terre et tantôt dans la mer. Lorsque Dieu veut mal à un peuple, il fait tomber le tannin sur son territoire. Le monstre dévore leurs chameaux, leurs chevaux, leurs vaches, leurs brebis; il y demeure jusqu’à ce qu'il ne trouve plus rien à manger et qu'il périsse, ou que Dieu les en débarrasse. Des marins, des voyageurs, des marchands, des capitaines m'ont raconté qu'ils l’avaient vu plus d'une fois, passant sur leurs têtes, noir, allonge dans les nuages; parfois sa queue pendait dans l’air; s'il en sentait la fraicheur, il se repliait dans la nue et disparaissait aux regards. Béni soit Dieu, le plus parfait des créateurs !XXIV. Abou'zahrâ el-Barkhati, m'a appris diverses particularités touchant les serpents de l’Inde. Un médecin indien, habitant de Sérendib, lui avait dit qu'il existe dans l’Inde trois mille et cent vingt espèces de serpents. La pire espèce est sur la terre de Taka. Lorsque le vent souffle de ces parages, il tue tout ce qu’il atteint, oiseaux, quadruples, reptiles, à trois parasanges à la ronde. Aussi cette terre n'est-elle habitue qu'une partie de l’année. Tant que les vents soufflent de la mer, les gens y demeurent. Dès qu'il commence à souffler de terre, du canton des serpents, ils s'appellent les uns les autres, se sauvent sur leurs embarcations et s'en vont parmi les lies de la mer. Quand ces vents ont cesse, ils se rassemblent, reviennent, débarquent, labourent la terre, ensemencent, ou bien ils exploitent les mines, car la terre de Taka est riche en mines d'or et d’argent
XXV. Un capitaine de navire raconte que les vents l’ayant jeté dans une bale, il descendit à terre avec ses gens et s'avança dans un fourré marécageux où gisaient des troncs d'arbre séculaires, renversés, entassés les uns sur les autres. Il rôda de côte et d'autre, cherchant de quoi faire un mat pour son navire. Son choix tomba sur un tronc magnifique, parfaitement droit et lisse, d’une belle grosseur; d'autres arbres étaient jetés dessus pêle-mêle, comme si sa chute remontait à bien des années. L'ayant mesuré, on le trouva plus long qu'il n'était nécessaire. On prit une scie pour en couper une longueur de cinquante coudées, suivant le besoin du moment. Mais à peine la scie commençait son œuvre et entamait le tronc, que celui-ci remua et se mit à ramper. C’était un serpent. Les marins se hâtèrent de courir au rivage, de se jeter à l’eau et de regagner le navire, ce qu’ils purent faire sans autre accident.
XXVI. Mohammed fils de Bâlichad m’a raconté que, faisant une traversée de l’Inde à la Chine et passant par une de ces mers, l’heure de la première prière étant venue, il descendit au cabinet pour faire ses ablutions. Mais ayant jeté les yeux sur la mer, il se releva soudain, saisi de terreur, et remonta sans plus songer aux ablutions. « Hommes, commanda-t-il, détachez les voiles ! » On obéit. « Jetez à la mer, continua-t-il, tout ce qui est sur le navire ». Il descendit proche de l’eau, et de la voix d'un homme plein d'effroi : « Marchands, dit-il, qu'aimez-vous mieux, vos biens que vous avez mille moyens de remplacer, ou votre vie dont rien ne peut réparer la perte ? » « Eh quoi ! dirent les marchands. Qu'arrive-t-il pour que tu nous tiennes un pareil discours ? Le vent est doux, la mer est calme, et nous voguons en paix sous la protection du souverain des mondes. — Marchands, répliqua-t-il, soyez tous témoins les uns contre les autres, et que les hommes de l’équipage soient témoins contre vous : je vous ai donné conseil avant l'heure fatale, et vous ne l’avez pas accepté. Pour moi, je vous abandonne à la grâce de Dieu. »
En même temps il ordonna au patron de la chaloupe de la lui amener. Il y descendit, fit descendre avec lui de l'eau et des provisions et s’éloigna. Les marchands le voyant partir, lui crièrent: « Reviens, nous ferons tout ce que tu commanderas. » Il répondit : « J'en jure par Dieu, je ne reviendrai pas que vous n'ayez jeté par-dessus bord, de votre plein gré, de vos propres mains, tout ce que vous avez. »
Les marchands n’hésitèrent plus; tout fut jeté à la mer, objets de prix et choses de peu de valeur. Il ne resta à bord que les hommes, l’eau et les provisions de bouche. Et lui, revenant et remontant sur le navire, leur dit : « Ah ! si vous saviez ce qui nous attend cette nuit !... Croyez-moi, purifiez vos âmes, priez, repentez-vous des fautes passées » implorez le pardon du Seigneur. « Et chacun fit comme il disait. Et quand la nuit fut venue, voilà que Dieu, ouvrant les portes du ciel, livra passage à un vent qui remplit tout l’intervalle du ciel à la terre, soulevant les flots de la mer jusqu'aux nues et les laissant retomber sur la terre. La tempête enleva bien des navires en pleine mer et le long des côtes; peu de personnes furent sauvées.
Quant à ce navire, qui, par une inspiration de Dieu, s'était allégé en rejetant toute sa cargaison, soulevé par la mer bouillonnante, il montait à la pointe des vagues et restait à flot. Les passagers récitaient des versets du Coran, priaient, invoquaient Dieu. Durant trois jours et trois nuits, nul ne put boire ni manger.
Le quatrième jour. Dieu fit signe aux vents et à la mer : les vents s'apaisèrent, la mer se calma. Il dissipa la tempête, ainsi que nous savons que sa puissance sait le faire. Les matelots mirent la chaloupe à la mer; munie de rameurs, elle marcha en avant, remorquant le navire un jour et une nuit. Ils atteignirent ainsi une île, où les flots avaient charrié les débris de navire, les agrès, les ballots entraînés de tous pays par la tempête. Ayant jeté l'ancre en ce lieu, ils y trouvèrent même tout ce qu'avait perdu leur propre vaisseau. Tout cela fut recueilli et remis en place. Et parmi les marchandises que l'eau n'avait point avarices, ils choisirent et emportèrent ce qui leur plut. Enfin, après avoir donné la sépulture aux cadavres des noyés, le vent soufflant favorable au départ, ils firent de l’eau et se remirent en route pour leur pays, où ils parvinrent sains et saufs après un voyage sans accidents. Les marchandises recueillies décuplèrent leurs capitaux, et ce voyage leur procura richesse et bonheur. Gloire à Dieu, maitre des mondes !
XXVII. Un vieux marin m’a rapporté que les habitants d’une grande bourgade du Dhaïf
[55] furent contraints d'émigrer à cause d'un serpent qui était dans leur voisinage, qui dévorait leur bétail, leurs chevaux et les gens eux-mêmes. Ils abandonnèrent la ville, et, depuis, personne n'y est retourné.XXVIII. D'après un récit que m'a fait Abou Mohammed, fils d'El-Haçan, fils d'Amr, un capitaine de navire, poussé par un coup de vent très vif fut heureux d'apercevoir une crique où il se réfugia. Il y passa le jour et la nuit. Dans la matinée du lendemain, voici qu'en face d'eux, sur un des côtés de la crique, s'avance un serpent gigantesque, effrayant, d’une grandeur qui échappe à tome comparaison. Le monstre descend dans l’eau, franchit la crique, monte la rive opposée et disparait avec la rapidité de l’éclair. Un peu avant la nuit, l'animal revint et traversa lentement la crique. Retenus par les mauvais temps, les voyageurs virent pendant cinq jours consécutifs le même spectacle se renouveler, la bête passant le matin et retournant dans l'après-midi. Le sixième jour, le capitaine dit à ses hommes : « Descendez à terre et voyez où va ce serpent. » Une partie de l’équipage débarqua donc, quand le serpent fut revenu, et s'avança d’un mille environ dans le pays. Ils arrivèrent ainsi dans un fourre humide et marécageux, et voici que le fourré était jonché de défenses d’éléphants grandes et petites.
[56] On se hâta d’en porter la nouvelle au capitaine. Prenant du monde avec lui, le capitaine courut au lieu indiqué et revint avec une charge d'ivoire. Pendant plusieurs jours les gens du navire ne cessèrent de transporter ainsi de l'ivoire du marécage au vaisseau, profitant de l’intervalle entre le retour du serpent et son départ du lendemain. Ce qu’ils en recueillirent dépasse toute croyance. Ils faisaient de la place dans le navire en jetant à l’eau les objets de moindre valeur et d'une vente moins assurée. Ils ne quittèrent la crique qu’au bout de vingt jours. Ce serpent, paraît-il, dévorait les éléphants et laissait là leurs défenses.J'interrogeais un jour le capitaine Ismaïlouïa sur cette histoire qu’on m'avait racontée. C'était en l'année 339. « J'en ai entendu parler, me dit-il. Elle est parfaitement authentique. Il y a aussi dans la mer diverses sortes de serpents, mais dans l'eau ils ne font pas grand mal. Les plus redoutables sont ceux qui habitent les montagnes, les défilés, les régions arides, loin de l'eau. Dans les montagnes d’Oman, il y en a qui tuent instantanément. Dans le pays situé entre Sahari,
[57] qui est le port d'Oman, et les montagnes du Nahmad (?) se trouve un endroit où personne ne passe ; on le nomme Vallon des Serpents. Il y a là, dit-on, des serpents, longs d'un pan ou moins encore, qui se replient, joignant la tête et la queue, et d’un bond s'élancent sur les cavaliers; leur piqûre tue à l'instant; leur haleine aveugle et donne aussi la mort. Lorsqu’un voyageur se hasarde par là, ils viennent sur lui en foule et ne le manquent pas, tout le long du chemin. C'est pourquoi la traversée de cette région a été abandonnée.XXIX. Un vieux routier, qui avait passé par Marekin, ville située à une parasange des côtes du pays d'Adémiyoun, m’a dit que les montagnes y sont infestées de serpents gris ou tachetés : si un de ces serpents aperçoit un homme avant que l’homme l’aperçoive, le serpent meurt; si l’homme aperçoit le serpent avant d'en être vu, c'est l’homme qui meurt; et s'ils s'aperçoivent simultanément, ils meurent tous deux. C'est le plus mauvais de tous les serpents.
XXX. Suivant ce que m'a conté Mohammed fils de Bâlichâd, dans les parages du Ouâqouâq, les scorpions volent comme des moineaux ; lorsqu'ils piquent un homme, son corps se gonfle, il tombe malade, sa peau s'en va en lambeaux, et il meurt.
XXXI. Ismaïlouïa m'a raconté, et plusieurs marins avec lui, qu'il partit d'Oman sur son navire, pour aller à Kabila, dans l'année 310. Une tempête le poussa vers Sofala des Zindjs.
[58] « Voyant la côte où nous étions, dit le capitaine, et reconnaissant que nous étions tombés chez les nègres mangeurs d’hommes, sûrs de périr, nous faisons nos ablutions, et tournant nos cœurs vers Dieu, nous récitons les uns pour les autres la prière de la mort. Les canots des nègres nous entourent, on nous amène au port, nous jetons l’ancre et descendons à terre. Ils nous conduisent à leur roi. C'était un jeune nègre, beau et bien fait. Il nous demande qui nous sommes, où nous allons. Nous répondons que son pays est le but de notre voyage.« Vous mentez, dit-il. Ce n’est pas chez nous que vous prétendiez aborder. Les vents seuls vous ont, malgré vous, poussés sur nos rivages. » Et quand nous eûmes confessé qu'il disait vrai : « Débarquez vos marchandises, dit-il, vendez et achetez. Vous n'avez rien à craindre. »
« Nous mettons à terre nos ballots, et commençons notre commerce, commerce excellent pour nous, sans nulle entrave, sans droits à payer. Nous lui fîmes quelques présents auxquels il répondit par des dons d'égale valeur ou plus riches encore. Notre séjour fut de plusieurs mois. Le moment du départ étant venu, nous lui demandâmes la permission de partir, qu'il nous accorda aussitôt. On chargea les marchandises achetées, on termina les affaires. Tout étant réglé, le roi instruit de notre intention de remettre à la voile, nous accompagna au rivage avec quelques-uns des siens, descendit dans les embarcations et vint avec nous jusqu'au navire. Il monta même à bord avec sept de ses compagnons.
« Lorsque je les vis là, je me dis en moi-même : « Ce jeune roi, sur le marché d'Oman, vaudrait bien à l’enchère trente dinars, et ses sept compagnons cent soixante dinars. Leurs vêtements n'ont pas une valeur inférieure à vingt dinars. Tout compte fait, ce serait pour nous un bénéfice de trois mille dirhems au moins, sans aucune peine. » Sur ces réflexions, je donnai les ordres à l’équipage : on tendit les voiles, on leva l'ancre. Cependant le roi nous faisait mille amitiés, nous engageant à revenir plus tard et nous promettant bon accueil à notre retour. Quand il vit les voiles gonflées par le vent et le navire déjà en marche, il changea de visage : « Vous partez, dit-il. Eh bien ! je vous fais mes adieux. » Et il voulut descendre dans ses canots amarrés à bord. Mais nous coupâmes les cordes, en lui disant : « Tu resteras avec nous, nous t’emmenons dans notre pays. Là nous te récompenserons de tes bienfaits envers nous. »
— « Etrangers, dit-il, quand vous êtes tombés sur nos plages, mes gens voulaient vous manger et piller vos biens, comme ils l’ont déjà fait à l’égard d’autres que vous. Mais je vous ai protégés, je n’ai rien exigé de vous. Comme marque de ma bienveillance, je suis venu vous faire mes adieux jusque dans votre navire. Traitez-moi donc comme la justice l’exige, en me rendant à mon pays. »
« Mais on ne prêta aucune attention à ses paroles; on n'en tint aucun compte. Et le vent ayant fraîchi, la côte ne tarda pas à disparaître à nos yeux, puis la nuit nous enveloppa de ses voiles et nous entrâmes dans la haute mer.
« Le jour revint; le roi et ses compagnons furent joints aux autres esclaves dont le nombre atteignait environ deux cents têtes ; il ne fut point traité autrement que ses compagnons de captivité. Le roi ne dit mot et n'ouvrit point la bouche. Il fit comme si nous lui étions inconnus et que nous ne le connussions pas. Arrivés à Oman, les esclaves furent vendus et le roi avec eux.
« Or, quelques années après, naviguant d'Oman vers Kabila, le vent nous conduisit encore vers les rivages de Sofala des Zindjs, et nous abordâmes précisément au même endroit. Les nègres nous aperçurent, leurs canots nous entourèrent et nous nous reconnûmes les uns les autres. Bien assurés de périr cette fois, la terreur nous fermait à tous la bouche. Nous fîmes silencieusement nos ablutions, nous récitâmes la prière de la mort, nous nous dîmes adieu. Les nègres nous prirent, nous amenèrent à la demeure du roi et nous firent entrer. Jugez de notre surprise : C’était ce même roi, que nous avions connu, assis sur son siège, comme si nous venions de le quitter. Prosternés devant lui, abattus, nous n’avions plus la force de nous relever. « Ah ! ah ! dit-il, ce sont mes anciens camarades. » Aucun de nous ne fut capable de répondre. Nous tremblions de tous nos membres. Il reprit : « Allons ! levez la tête, je vous donne l’aman
[59] pour vous et vos biens. » Quelques-uns relevèrent la tête, d’autres n'en eurent pas la force, accablés par la honte. Et lui se montra doux et gracieux jusqu'à ce que nous eussions tous levé la tête, mais sans oser le regarder en face, tant nous étions émus de remords et de crainte. Lorsque, rassurés par son aman, nous eûmes enfin repris nos sens : « Ah ! traîtres ! dit-il. Comment m'avez-vous traité après ce que j'avais fait pour vous ! » Et chacun de nous s'écria : « Grâce, ô roi, fais-nous grâce. — Je vous fais grâce, dit-il. Reprenez, comme l'autre fois, vos affaires d'achats et de ventes. Commercez en toute liberté. » Nous ne pouvions en croire nos oreilles ; nous craignions que ce ne fût une fourberie pour nous faire débarquer nos marchandises. Nous les débarquâmes cependant, et vînmes lui offrir un présent d'une valeur incomparable. Mais il le refusa en disant : « Vous n'êtes pas dignes que j'accepte de vous un présent. Je ne souillerai pas mon bien avec ce qui viendrait de vous. »« Après cela, nous fîmes tranquillement nos affaires. Le temps du départ étant venu, nous demandâmes la permission d’embarquer. Il nous l’accorda. Au moment de partir, j'allai lui en donner la nouvelle. « Allez, dit-il, sous la protection de Dieu ! — O roi, repris-je, tu nous avais comblé de tes bontés, et nous fûmes ingrats et traîtres envers toi. Mais comment fis-tu pour te sauver et retourner dans ton pays ? »
« Il répondit :
« Après que vous m'eûtes vendu à Oman, mon acheteur m'emmena dans une ville nommée Basra (et il en fit la description). J'y appris la prière, le jeûne, quelques parties du Coran. Mon maître me vendit à un autre qui m'emmena au pays du roi des Arabes, nommé Bagdad (et il nous décrivit Bagdad). J'appris dans cette ville à parler correctement. Je complétai ma connaissance du Coran et je priai avec les hommes dans les mosquées. Je vis le calife qui se nomme El-Moqtadir. J'étais à Bagdad depuis un an et plus, lorsqu'il y vint une troupe de gens du Khoraçan, montés sur des chameaux. Voyant une grande foule, je demandai où allait tout ce monde. On me dit : à la Mecque. — Qu'est-ce que la Mecque? demandai-je. — C’est là, me répondit-on, qu'est la Maison sacrée de Dieu où les musulmans font le pèlerinage. Et on m'apprit l'histoire du Temple. Je me dis que je ferais bien de suivre la caravane. Mon maître, à qui je fis part de tout cela, ne voulut ni s'en aller avec eux ni me laisser partir. Mais je trouvai moyen d'échapper à sa surveillance et de me mêler à la foule des pèlerins. En route, je me fis leur serviteur; on me donna à manger, et on me procura les deux vêtements nécessaires pour l’ihram.
[60] Enfin, avec leurs instructions, j'accomplis toutes les cérémonies du pèlerinage.« N'osant revenir à Bagdad, par crainte que mon maître m'ôtât la vie, je me joignis à une autre caravane qui s'en allait au Caire. J'offris mes services aux voyageurs, qui me portaient sur leurs chameaux et me faisaient part de leurs provisions. Arrivé au Caire, je vis ce grand fleuve qui s'appelle le Nil. Je demandai : « D'où vient-il ? » On me répondit : « Il prend sa source au pays des Zindjs. — De quel côté? — Du côté d'une grande ville nommée Assouan,
[61] sur les frontières de la terre des Noirs. »Ainsi renseigné, je suivis les rives du Nil, passant d'une ville à l'autre, demandant l’aumône qu'on ne me refusait pas. Je tombai pourtant sur une troupe de noirs qui me firent mauvais accueil. Ils m'attachèrent, me chargeant parmi les serviteurs d'un fardeau plus lourd que je ne pouvais le porter. Je pris la fuite et tombai entre les mains d'une autre troupe qui me prit et me vendit. Je m'échappai de nouveau, et continuai de cette façon, jusqu'à ce que, après maintes pareilles aventures, je me trouvai enfin dans un pays qui touchait aux frontières du pays des Zindjs. Là, je pris un déguisement; de toutes les terreurs que j'avais éprouvées depuis mon départ du Caire, aucune n'égalait celle que je ressentais en approchant de mon pays. Car, me disais-je, un nouveau roi m'a sans doute remplacé sur le trône et dans le commandement de l'armée. Reprendre le pouvoir n'est pas chose facile. Que je me fasse connaître ou qu'on me reconnaisse, me voilà pris, conduit au nouveau roi et tué sur-le-champ. Ou bien quelqu'un de ses affidés prendra ma tête pour gagner sa faveur. « En proie à la plus mortelle frayeur, je m'avançais durant la nuit et restais caché pendant le jour. Parvenu à la mer, je m'embarquai sur un navire; et après avoir touché en divers points, je fus débarqué une nuit sur le rivage de mon pays. Je questionnai une vieille femme : « Le roi qui gouverne ici, lui dis-je, est-ce un roi juste ? — Mon fils, répondit-elle, nous n'avons d'autre roi que Dieu. » Et la bonne femme me raconta l'histoire de l’enlèvement du roi. Et moi je feignais à son récit le plus vif étonnement, comme s'il ne se fût point agi de ma propre personne et d'événements que je connaissais si bien. « Les habitants du royaume, dit-elle, sont convenus de ne point prendre d'autre roi qu'ils n'aient des nouvelles sûres du premier. Car les devins leur ont appris qu'il est vivant, sain et sauf sur la terre des Arabes. » Le jour arrivé, j'entrai dans la ville et me dirigeai vers mon palais. J'y trouvai ma famille telle que je l'avais laissée, mais plongée dans l'affliction. Mes gens écoutèrent le récit de mon histoire qui les surprit et les combla de joie. Ils embrassèrent, comme moi, la religion de l'Islam. Je rentrai ainsi en possession de ma souveraineté, un mois avant votre venue. Et me voilà joyeux et satisfait de la grâce que Dieu nous a accordée à moi et aux miens, de connaître les préceptes de l'islam, la vraie foi, la prière, le jeûne, le pèlerinage, ce qui est permis et ce qui est défendu; car nul autre dans le pays des Zindjs n'a obtenu semblable faveur. Et si je vous ai pardonné, c'est que vous êtes la première cause de la pureté de ma religion. Mais il me reste sur la conscience une chose dont je prie Dieu de m'ôter le péché. — Qu'est-ce donc, ô roi, lui demandai-je. — C’est, dit-il, que j’ai quitté mon maître en partant de Bagdad sans sa permission, et que je ne suis pas retourné vers lui. Si je rencontrais un honnête homme, je le prierais d'emporter à mon maître le prix de mon rachat. S’il y avait parmi vous un homme de bien, si vous étiez des gens probes, je vous donnerais la somme, pour la lui remettre, une somme dix fois égale à celle qu'il a payée, pour le dédommager du retard. Mais vous n'êtes que des traîtres et des fourbes. »
Nous lui fîmes nos adieux : « Allez, dit-il, et si vous nous revenez, je ne vous traiterai pas autrement que je l'ai fait. Vous aurez le meilleur accueil. Et les musulmans sauront qu'ils peuvent venir à nous, comme à des frères, musulmans comme eux. Quant à vous accompagner à votre navire, j’ai des raisons pour m'en abstenir.» Là-dessus nous partîmes.
XXXII. Pour ce qui est des devins, on dit qu'au pays des Zindjs, il y en a de fort habiles dans l'an divinatoire. Ismaïlouïa m'a conté qu'un capitaine de navire lui fit le récit suivant: « J'étais chez les Zindjs en l’année 332. Un devin de ce pays me dit : « Combien êtes-vous de navires? — Seize, dis-je. — Eh bien! répliqua-t-il, quinze d'entre eux rentreront à Oman sains et saufs. Le seizième fera naufrage; il ne s'en sauvera que trois personnes qui regagneront leur pays après bien des désagréments. »
« Or les seize navires mirent le même jour à la voile. Le mien était à l'arrière et je hâtais la marche pour rejoindre les autres. Le troisième jour, une masse parut devant nous, comme une sorte d'îlot noir. Pressé d'arriver je ne fis point larguer convenablement les voiles, car la navigation est très pénible dans cette mer, et nous fûmes portés à l’improviste vers cette masse, qui nous choqua violemment. C'était un monstre marin. D'un coup de queue il brisa le navire. Nous échappâmes au naufrage, deux compagnons et moi, dans un canot, et la mer nous jeta dans une des îles Dibadjat, où nous fûmes retenus un an; nous n'en sortîmes et ne parvînmes à regagner Oman, qu'après avoir éprouvé bien des peines. Quant aux quinze autres navires, ils étaient tous rentrés au port sains et saufs par la permission du Très-Haut. »
XXXIII. El-Haçan fils d'Amr et d'autres personnages qui avaient voyagé dans l'Inde m’ont rapporté des choses bien extraordinaires, au sujet des oiseaux de ce pays, du Zabedj, de Qomâr,
[62] du Senf[63] et autres régions des parages de l’Inde. « La plus grande plume que j'aie vue, dit Aboul-Abbas de Siraf, avait un tuyau long de deux aunes environ, capable, semblait-il, de contenir une outre d’eau.[64] » « J’ai vu dans l’Inde, me dit le capitaine Ismaïlouïa, chez un des principaux marchands, un tuyau de plume qui était près de sa maison, et dans lequel on versait de l’eau ainsi que dans un grand vase. » Comme je témoignais quelque surprise : « Ne sois pas étonné, me dit-il, car un marin du pays des Zindjs m’a conté qu’il avait vu chez le roi de Sira un tuyau de plume qui contenait vingt-cinq outres d'eau. »XXXIV. Abou'l-Haçan Ali, fils de Châdân, de Siraf, m’a dit qu'une personne de Chiraz
[65] lui avait raconté qu'un village voisin de cette ville était devenu désert par le fait d’un oiseau. « Je lui demandai, dit Abou'l Haçan, comment un oiseau avait pu faire disparaître la population. Il me répondit :« Suivant ce que j'en ai su, un oiseau gigantesque s’abattit sur le toit d'une maison du village, creva le toit et tomba à l’intérieur. Les personnes qui étaient là s'enfuirent en poussant des cris d’effroi. Les gens du village s’étant rassemblés entrèrent dans le logis et trouvèrent cet oiseau qui remplissait la maison. Ne pouvant autrement s’en emparer, ils l’assommèrent à force de coups. L’animal était naturellement lourd et ne pouvait s’envoler. On le saigna, on le dépeça et on en partagea la chair entre les hommes. Il y en eut soixante-dix rotls environ pour chacun; sans compter une portion de cent rotls qu'on mit à part pour le ouakil du village.
[66] C'était sur la maison même du ouakil que l'oiseau était tombé. Mais il était pour lors absent avec trois autres personnes pour le service du Sahib du bourg. Les gens du village firent cuire la chair de l’oiseau dans la journée et la mangèrent avec leur famille et leurs enfants. Le lendemain matin, tous étaient fort malades. Le ouakil revenant apprit ce qui s'était passé. Lui et ses compagnons refusèrent de toucher à la viande. Quant à ceux qui en avaient mangé, tous moururent successivement, dans l'espace de quatre à cinq jours, et il n'en resta pas un. Le village resta désert, le ouakil s'en alla, et personne n'y est retourné. Il nous a paru vraisemblable que cet oiseau était un oiseau de l'Inde qui avait dévoré quelque bête venimeuse, dont le poison avait infecté son sang. Fort affaibli, il avait dû voler dans l'air, jusqu'à l'heure où les forces lui manquant, il était tombé sur ce toit. »XXXV. Maint patron de navire m'a raconté qu'il avait ouï dire qu'à Sofala des Zindjs il y a des oiseaux qui saisissent une bête du bec ou des griffes, remportent dans les airs, la laissent choir à terre pour la tuer et la briser, puis s'abattent dessus et la dévorent. Dans ce même pays des Zindjs, il y a, dit-on, un oiseau qui se jette sur les grosses tortues, les saisit, les enlève en l’air et les rejette sur quelque roche où elles se brisent. Il redescend alors et les mange. Et on assure qu'il en mange jusqu'à cinq et six dans un jour, s'il les trouve. Du reste cet oiseau fuit la vue de l'homme qui l’effraie, tant les hommes de ce pays sont horriblement conformés.
XXXVI. Dans les hautes régions du pays des Zindjs, on trouve des mines d'or, extrêmement abondantes. Les hommes, m'a dit le capitaine Ismaïlouïa, y creusent le sol pour chercher l’or. Et quelquefois leur travail les amène dans un terrain excavé comme les fourmilières. Aussitôt il en sort une nuée de fourmis grosses comme des chats qui les dévorent et les mettent en pièces.
[67] Dans l’année 307, l’émir d'Oman, Ahmed fils de Hélai, parmi les objets qu'il portait en présent au calife Moqtadir, avait une fourmi noire, de la grosseur d'un chat, enfermée dans une cage de fer, attachée avec une chaîne. Elle mourut en route, dans les parages de Dhou-Djabala. On l’embauma, et elle parvint en bon état à Bagdad, où le calife et les habitants purent la voir. Ceux qui l’avaient apportée disaient qu’on lui donnait à manger chaque jour, matin et soir, deux mannas de viande coupée en morceaux.XXXVII. Mohammed fils de Bâlichâd m'a dit, d'après ce qu'il avait appris de gens qui avaient abordé au pays des Ouâqouâq, qu'on y trouve un grand arbre aux feuilles rondes, avec des tiges qui portent un fruit analogue à la courge, mais plus grand et offrant quelque apparence d'une figure humaine. Quand le vent l'agite, il en sort une voix. L'intérieur est gonflé d'air. Si on le détache de l'arbre, il s'en échappe aussitôt du vent, et ce n'est plus qu'une peau. Un matelot voyant ces fruits, qui lui plaisaient, en coupa un pour l'emporter; mais il se dégonfla à l'instant, et ce qui resta entre les mains de l’homme, n'avait pas plus de valeur qu'un corbeau crevé.
XXXVIII. J'ai questionné Mohammed fils de Bâlichâd sur les singes et ce qu'on en rapporte; et il m'a raconté bien des choses à ce sujet. Entre autres, il m'a dit que du côté de Sanfin, dans la vallée de Lâmeri et dans celle de Qâqala,
[68] habitent des singes d'une taille extraordinaire, partagés en troupes dont chacune a son chef, qui est le plus grand de la troupe. De temps en temps, ils sortent des bois, viennent sur les chemins et lieux de passage, arrêtent les voyageurs et ne leur permettent de continuer leur route qu'en abandonnant quelque pièce de bétail, brebis, vache ou autres aliments.[69]« J'ai ouï dire à maintes personnes, disait encore Mohammed fils de Bâlichâd, qu'étant en voyage avec une caravane, une troupe de singes les avait arrêtés, que ces animaux avaient mis leurs outres en pièces, alors qu'ils se trouvaient fort éloignés de toute aiguade; que les voyageurs avaient enfin donné quelque chose aux singes, qui pour lors les laissèrent passer. Et par le manque d'eau, la plupart des voyageurs périrent; un petit nombre seulement put gagner l’aiguade prochaine. »
XXXIX. Le même m'a raconté l'aventure d'un matelot embarqué sur un navire à lui, qui fit en l'année 390
[70] le voyage de Qâqala. Parvenus heureusement au but de leur course, ils débarquèrent leurs marchandises et en transportèrent une partie vers un pays distant de la côte de sept jours de marche environ. Tirant le navire à sec dans une petite baie, ils le mirent à l'abri de la mer, l’entourèrent de pièces de bois et l’étayèrent.« Cela fait, dit le matelot, ils me laissèrent comme gardien, avec des provisions en quantité suffisante et partirent tous pour la ville où ils restèrent à leurs ventes et à leurs achats. Après leur départ, il vint une troupe de singes qui rôdèrent autour du navire, cherchant à y monter. Je les chassai à coups de pierres. Une grosse guenon réussit à atteindre le navire. Je la repoussai et la crus partie. Mais elle trompa mon attention, et grimpant d’un autre côté arriva jusqu'à moi. Je prenais mon repas en ce moment : je lui jetai un morceau de pain qu'elle mangea. Elle resta là quelque temps, puis descendit et disparut à mes yeux. Le soir, je la vis revenir portant dans sa bouche un régime d'une vingtaine de bananes. Elle cria et je l’aidai à monter. Elle posa devant moi les bananes, mangea et ne me quitta pas. Les jours suivants, elle s'en allait de même et revenait, rapportant des bananes et d'autres fruits cueillis dans la forêt. Elle passait la nuit dans le navire, à mon côté. Elle éveilla mes désirs, et je satisfis ma passion avec elle. A peine trois mois s’étaient ainsi écoulés, que je la vis s’alourdir; sa marche devint pesante, et le développement de son ventre me fit comprendre qu'elle était grosse de mes œuvres. J'en éprouvai un chagrin extrême, en songeant quelle serait ma honte lorsque reviendraient nos gens et qu’ils verraient l'affaire. Cette crainte me porta à prendre la fuite. Prenant le canot du navire, j'y plaçai un mât, des voiles, une ancre; j'y mis des outres d'eau, des provisions, mes vêtements et tout ce qui m'appartenait. Puis, saisissant l'heure où la guenon était absente, je m'embarquai et pris la mer à tous risques, abandonnant le navire à sa solitude. Une navigation pénible de vingt et quelques zâmas,
[71] durant lesquels je faillis périr, m'amena sur la côte d'une des îles Armanan. J'y séjournai quelque temps pour me réconforter, prendre du repos et faire provision d'eau douce, de fruits, de bananes. Je n'y vis personne, sauf des pécheurs qui descendaient parmi les arbres. Embarqué de nouveau, je naviguai sans direction, sans savoir où j'allais, pendant soixante-dix jours environ, et je tombai sur une île nommée Bedfarkalah. Un peu plus tard j'atteignis Kalah,[72] et quelque temps après je rencontrai le patron de mon navire et plusieurs des personnes qui y avaient été embarquées. Ils m'apprirent qu'étant retournés à la baie, ils avaient trouvé dans le navire une guenon qui avait mis au monde un singe ou deux à face humaine, la poitrine sans poils, les oreilles plus courtes que le commun des singes. Ils n'avaient pas manqué de supposer que le matelot était le père des petits singes[73] et qu’il s'était sauvé avec le canot, car rien autre chose ne manquait dans le navire que le canot et son appareil. Cependant quelques-uns inclinaient à penser que la guenon avait tué le matelot et que le canot avait été volé par un passant ou un pécheur. La chose demeurait incertaine. Du reste, ils s'étaient débarrassés de la mère et des petits.[74] »Le matelot qui m'a fait ce récit, ajouta Mohammed fils de Bâlichâd, avait la vue très faible, et il attribuait cette incommodité à ses relations avec la guenon, incommodité accrue encore par son long séjour sur la mer.
XL. Un marin m'a raconté qu'un navire qui faisait le trajet d’Oman à Senf se perdit en mer. Une dizaine d’hommes seulement se sauvèrent dans la chaloupe, et le vent les porta sur une île qui leur était absolument inconnue. Jetés sur le rivage, ils y demeurèrent le reste du jour, dans l’accablement où les mettaient les terreurs et les souffrances qu'ils avaient éprouvées. Enfin reprenant courage ils parvinrent à tirer la chaloupe sur la plage et y passèrent la nuit.
Le matin, s'étant avancés dans l’île, ils y trouvèrent de l’eau douce en abondance, un sol frais et ombragé, des arbres touffus charges de fruits, des bananes en abondance, des Cannes à sucre. Ils n'y virent point trace d'hommes. Après avoir à discrétion mangé de ces fruits et bu de cette eau, ils revinrent à la chaloupe, la tirèrent loin de la mer et l’étayèrent avec des pièces de bois. A l’aide de feuilles de bananier et d'autres arbres, ils lui firent un abri contre le soleil, et s'arrangèrent pour eux-mêmes un lieu de repos à son côté.
Cinq ou six jours après, voici venir une troupe de singes qui s'avancent précédé par un des leurs, gros et grand. Ils s'arrêtent en face de la chaloupe. Les gens effrayés s'y refugient. Mais les singes ne leur disent rien. Le chef de ces animaux prend place, les expédie à droite et à gauche comme un général d'armée. Puis ils reviennent à lui, se font des signes, comme gens qui se racontent quelque chose, et, le soir venu, ils se retirent.
Les naufragés étaient en grand émoi, craignant d'être tués par les singes. Toute la nuit ils révèrent à des moyens de salut : dénués de provision, ignorant la route à suivre, leur situation était détestable, et ils ne voyaient aucun moyen de s'en tirer.
Le matin, un singe vint seul roder autour d'eux, s'en alla, revint avec un compagnon qui faisait signe en montrant quelque chose. « Je suivis les singes, dit l’homme qui a fait ce récit au marin de qui je le tiens, jusqu’à ce que je les vis entrer dans le fourré. Là je m'arrêtai, n'osant ailer plus loin, et je retournai vers mes compagnons, Le lendemain, la troupe entière revint comme la première fois. Le chef s'assit non loin de la chaloupe et expédia ses camarades de la même manière. Bientôt après, deux singes revinrent, portant chacun un morceau d'or très pur qu'ils jetèrent devant nous. Puis se rassemblant tous, ils se firent des signes et disparurent. Descendant à terre nous ramassâmes l'or. Il était d'une pureté parfaite, formant comme de grosses racines. La joie que cet or nous causa nous fit presque oublier les désagréments de notre situation.
« Le matin, un singe revint encore tourner autour de la chaloupe. Lorsqu’il s'en retourna, je le suivis à travers l’épaisseur du bois. En sortant du fourré, je me vis dans une plaine dont le sol était noir et sablonneux. Le singe, devant moi, se mit à creuser la terre. Je m'arrêtai et me mis à creuser comme lui; et voila que je trouvai des racines d'or entrecroisées comme les mailles d'un filet, et je ne cessai d'en arracher jusqu'à ce que mes doigts furent en sang. Ramassant ce que j’avais enlevé, je l’emportai et retournai sur mes pas. L’épaisseur du fourré fut cause que je m’égarai. Je grimpai sur un arbre où je passai la nuit. Au jour, les singes se montrèrent; quand ils m’eurent devancé je les suivis jusqu’au moment où de loin j'aperçus la mer. Alors, caché dans les branches d’un arbre, j’attendis leur départ qui eut lieu à la nuit, je redescendis, et pus rejoindre mes compagnons. Ils m’accueillirent avec des larmes de joie : « Nous ne doutions pas, dirent-ils, que tu n'eusses péri. » Je leur contai mon expédition et jetai l'or devant eux.
Ce nous fut une nouvelle cause de douleur et de regret, de songer qu'au moment où nous acquérions la richesse nous n’avions aucun moyen d'emporter notre trésor. La chaloupe trop petite risquerait d'être submergée si nous la chargions d'or; et d'ailleurs, quelle direction prendre ? Malgré tout, nous fûmes tous d'avis d'aller à la plaine, d'arracher l'or et de le transporter près de la chaloupe, nous confiant pour l'avenir à la volonté de Dieu. C'est pourquoi, profitant des jours où les singes ne venaient points nous allions dès le matin à cette plaine, et nous rapportions le soir l'or recueilli. Le précieux métal était enfoui près de la chaloupe dans un trou creusé à ce dessein.
Cela dura toute une année, au bout de laquelle nous avions réuni une masse d'or extraordinaire, et d'une valeur qu'on n'aurait pu dire. Pendant ce temps, les singes continuaient leur manège, venant un jour, ne venant pas le lendemain. Et nous avions pour vivre les fruits et l’eau de l’île.
Telle était notre situation lorsque nous arriva un navire qui s'en allait vers Oman ou Siraf. Il avait essuyé un coup de vent; la mer l’avait envahi. L'équipage avait jeté tout le chargement à l’eau; la plupart des hommes étaient morts successivement des souffrances qu'ils éprouvaient. A la vue de l’île, les survivants voulurent y aborder; ils n'en eurent pas la force et demeurèrent inertes. Cependant leurs yeux fixés vers la terre nous aperçurent avec notre chaloupe. Quelques-uns d'entre eux se jetèrent à l'eau avec des cordes, s'efforçant de nous rejoindre. Et nous, voyant cela, nous nous jetâmes aussi dans la mer avec des cordes, et les ayant atteints nous attachâmes nos cordes aux leurs. Quand nous les eûmes fixées à terre, deux d'entre nous allèrent au navire; ils y trouvèrent le capitaine, les matelots et les marchands à demi-morts d'épuisement, succombant aux souffrances que leur avait infligées l'état de la mer, et à la fatigue causée par la nécessité de vider l’eau tandis qu'ils étaient en pleine mer. « Amenez-nous à terre, dirent-ils à nos compagnons, et prenez tout ce qui nous reste d'effets et de marchandises. — Tirez-nous à terre, dit aussi le patron, et prenez le navire pour vous en toute propriété. « Les nôtres répondirent : « Nous n’acceptons pas cela. Mais nous vous mènerons à terre et vous nous céderez la moitié du navire. » Tous répliquèrent : « De grand cœur ! » Les conventions furent faites en présence de tous. « Nous demandons une chose, dirent les nôtres. — Quoi ? — C'est que nous chargerons la moitié du navire de ce qui nous appartient, sans que personne ait rien à y voir, ni puisse nous faire aucune difficulté. — C'est convenu. — Bien entendu, reprirent les nôtres, que le chargement ne pourra ni endommager ni faire submerger le navire. — C'est fort bien, dirent-ils ; et nous prenons Dieu à témoin que nous devons à vous seuls le salut de tout ce que nous avons arraché aux fureurs de cette mer. »
Nos compagnons revinrent à terre. En ce moment arrivèrent les singes, qui, nous voyant tirer sur le câble pour amener le navire, à la plage, s'empressèrent de tirer avec nous; et le navire aborda en un instant. Les malheureux s'élancèrent vers la terre, comme un amoureux vers l'objet de sa passion, tant la mer les avait maltraités.
Le matin venu, nous leur montrâmes l’endroit où nous cueillions des fruits. Ils mangèrent et burent et reprirent leurs esprits. Le jour suivant, les singes étant revenus avec de l’or, nous le donnâmes à ces gens-là, car nous en avions assez. Nous nous mîmes à charger de notre or la moitié du navire qui nous avait été accordée. Le patron chargea aussi d’or l'autre moitié pour lui et les marchands. On s'approvisionna de ce que l'île pouvait fournir. Et quand vint à souffler un vent favorable, nous partîmes, et nous arrivâmes aux pays de l'Inde. Le partage fait, chacun prit ce qui lui revenait, et la part de chacun fut d'un million cent quarante quatre mille mithcals.
[75] Depuis ce jour nous avons renoncé à la navigation. »Et voilà ce que j'ai entendu raconter de plus surprenant au sujet des singes.
XLI. Une personne m'a dit avoir vu dans un bourg, chez un marchand, un singe qui le servait : il balayait la maison, ouvrait la porte aux visiteurs, la refermait, allumait le feu sous la marmite, y soufflait pour l'enflammer, ajoutait le bois nécessaire, chassait les mouches de la table, éventait son maître avec un éventail.
XLII. Un forgeron de Thafa, ville du Yémen, avait un singe qui menait son soufflet tout le long du jour. Ce singe l’a ainsi servi cinq années durant.
[76] J’ai fait là plusieurs voyages et j'ai vu l’animal chez lui.XLIII. On m'a fait encore l’histoire d’un autre singe, qui vivait dans la maison d’un habitant du Yémen. Cet homme acheta un jour de la viande, la porta au logis et la commit par signes à la garde du singe. Survint un milan qui déroba la viande aux yeux du singe stupéfait. Dans la cour du logis était un arbre. Le singe y grimpe, monte au plus haut, et là dresse ses fesses vers le ciel, penchant sa tête en bas, les deux mains appliquées de part et d'autre des fesses. Le milan croit voir un autre morceau de la viande volée. Il fond dessus. Mais le singe le happe des deux mains, le retient, descend et l'enferme sous un cuvier par-dessus lequel il a soin de poser un corps lourd. A son retour, le maître ne voyant plus la viande s'avance vers le singe pour le corriger. Celui-ci marche droit au cuvier et en tire le milan. Le maître comprit l'aventure. Il prit le milan, le pluma et le cloua à l'arbre.
XLIV. Il y a encore d'autres histoires de singes fort amusantes. En voici une.
Un homme d'Ispahan, vieillard qui avait beaucoup voyagé, rapporte qu'il allait à Bagdad avec une nombreuse caravane, dont faisait aussi partie un jeune homme vigoureux et ardent comme un mulet. Le vieillard, attentif à ses bagages, veillait la nuit, et ne dormait que pendant la marche, sur son chameau. Un soir qu'il veillait ainsi à son ordinaire, il vit le jeune homme qui se dirigeait vers un des chameliers endormi, le prenait par derrière et s'apprêtait à lui faire des sottises. Le chamelier s'éveillant se mit fort en colère et lui donna une frottée comme un tanneur travaillant le cuir. Le jeune homme regagna sa place, en chancelant sous l’effet des coups de poing et des soufflets qu'il avait reçus. Il resta tranquille jusqu'à ce qu'il se sentît remis. Puis voyant le chamelier reprendre son somme, il revint à lui et recommença ses tentatives. Le chamelier réveillé se fâcha plus fort et l'étrilla de plus belle, si bien que le garçon s'en retourna à demi-mort. Une troisième fois la fièvre reprit le jeune homme qui revint encore au chamelier. Celui-ci le mit dans un tel état qu'il eut grand-peine à regagner son coin, en se traînant à terre de droite et de gauche, pendant que le chamelier lui disait : « Par Dieu ! si tu reviens encore, je jure que je te percerai le ventre. »
« Après avoir été témoin de ces différentes scènes, dit le vieillard, je trouvai que le chamelier n'avait pas tort; mais il m'eût été pénible de voir tuer ce jeune homme. Quand celui-ci eut repris ses sens, je l’appelai et lui dis : « Mon fils, comment peux-tu agir ainsi que je te l’ai vu faire cette nuit. Tu as échappé à ce chamelier ; mais prends garde qu’il ne te tue, et sois plus réservé. — Oncle, dit-il, il y a par Dieu ! bien des nuits que la violence de mes désirs et le feu qui me brûle m'empêchent de fermer l’œil. Quand la chose en est là, les mauvais traitements de cet homme sont faciles à supporter à côté de ce que j'endure. — Mon fils, repris-je, nous ne sommes plus bien loin de Bagdad, la cité de la Paix, et nous entrerons bientôt dans une ville où tu trouveras de quoi calmer ton ardeur. » Je ne cessai de lui parler ainsi et de le retenir, par commisération, durant le reste du voyage. Arrivés à Bagdad, je fus pris à son sujet d'une vive inquiétude. Qui sait, me disais-je, s'il ne va pas jeter les yeux sur quelque personne de la maison du calife ou des vizirs, et se ruer sur elle comme sur le chamelier ? Ce serait pour lui la mort. Cette pensée fit que je ne l’abandonnai point. Ayant fait choix d'un logis, je l’y emmenai avec moi; et, mes bagages une fois en sûreté, je ne vis rien de plus pressé que de le conduire chez une entremetteuse qui ne manquerait pas de lui procurer une femme propre à calmer la vivacité de ses désirs.
« A peine avions-nous passé la première rue que mon jeune homme s'arrêta : « Oncle, dit-il, je viens d'apercevoir à l'instant à cette fenêtre un visage beau comme le soleil. Il me le faut. » Je le détournai d'une pareille idée. Mais il s’assit par terre et déclara qu'il mourrait là. « Je l'ai gardé dans le désert, pensai-je; l’abandonnerai-je ici, dans une ville de perdition comme Bagdad ? »
« Ne pouvant lui ôter son idée de la tête, je regardai dans la rue et vis une maison dont l’apparence témoignait qu'elle était à des gens du bas peuple. Je heurte à la porte« Une vieille femme paraît. Je lui demande à qui appartient cette maison où mon compagnon a vu un visage féminin. « C'est, dit-elle, la demeure du vizir un tel, et la jeune dame est sa femme. — Mon fils, dis-je au jeune homme, renonce à ton dessein et viens avec moi, que je te montre les filles de Bagdad. Tu en verras de plus belles que celle-ci. — Je jure par Dieu, répliqua-t-il, que je mourrai ou ne m'en irai point sans avoir été reçu auprès d'elle. »
La vieille prenant la parole : « Jeune homme, dit-elle, si je te conduis au but de tes désirs, que me donneras-tu? » Il tira promptement la bourse qu'il portait à la ceinture et compta dix pièces d'or à la vieille. Celle-ci fort satisfaite s'enveloppa du vêtement d'extérieur, sortit de sa maison et vint frapper à la porte du vizir. L'huissier lui ouvrit. Elle entra. Bientôt elle revint, disant : « J'ai arrangé ton affaire et fait les conditions.
— Quelles sont-elles? dit le jeune homme.
— Cinquante mithcals pour elle, cinq pour la maison, cinq pour l’huissier. » Il paya les soixante mithcals. La vieille rentra chez le vizir, revint et dit : « Va, entre au bain, change d'habits, et dans l'intervalle entre la prière du coucher du soleil et la prière du soir, tiens-toi à ma porte que voilà jusqu’à ce qu'on puisse t'introduire. »
Le jeune homme alla au bain, fit sa toilette et vint à l'heure dite se camper à la porte de la vieille. L'huissier sortit et lui livra passage. Il pénétra dans un salon bien meublé. On lui servit des mets excellents, il mangea; puis on lui offrit à boire et il but. Après cela il se dirigea vers le lit et la dame en fit autant. Tous deux avaient quitté leurs vêtements, lorsqu'un singe sortit de derrière un rideau, vint au jeune homme, l’égratigna et le blessa aux cuisses et aux endroits sensibles ; de sorte que son sang coulait de toute part, et il remit ses vêtements. Alourdi par l’ivresse, il s’endormit tout habillé. A la pointe du jour, l’huissier le réveilla et lui dit : « Va-t-en, avant que la lumière laisse distinguer les visages. » Il sortit, en proie au plus vif chagrin.
Cependant le vieillard, quand il vit le jour paraître, se dit : « Il faut que j'aille voir ce qu'est devenu mon jeune homme, s'il a obtenu ce qu'il désirait et si l'affaire a eu une heureuse conclusion. » Il le trouva assis à la porte de la vieille, la tête enfoncée dans le collet de son vêtement. Il le questionna. Le jeune homme lui conta son aventure. Il appela la vieille et lui dit la chose. La vieille entra chez la dame pour savoir la cause du mécompte. « Sache, dit la dame, que nous avions oublié un point, le papier du maître du logis et son droit de revient; c'est une feuille contenant une livre de sucreries. Mais si le jeune homme veut recommencer, nous ne lui demanderons que la moitié de ce que nous avons pris hier. »
Sur le rapport de la vieille, le jeune homme donna donc trente dinars et reçut la recommandation expresse d'apporter, en venant le soir à l'heure dite, un papier contenant une livre de sucreries pour le singe, maître de la maison. Au lieu d'un, le jeune homme se munit de plusieurs. On le laissa passer, il entra, fut servi comme la veille, mangea et but. Quand il voulut avoir satisfaction avec la dame, le singe s’élança vers lui ; mais le jeune homme lui jeta un paquet de sucreries, et le singe le prit et regagna son poste.
Son affaire achevée, le jeune homme s'apprêtait à recommencer, quand le singe revint; un second paquet de sucreries le fit repartir. Cela se produisit nombre de fois, tant qu’enfin le jeune homme fatigué se laissa gagner par le sommeil. Alors le singe vint à lui, le réveilla, le tira vers la dame, en mettant un doigt dans sa main fermée. La morale de cette histoire c’est que les cadeaux faits aux serviteurs terminent heureusement les affaires en dépit du nez des maîtres. Le geste du singe signifiait : « Fais, jeune homme, fais ! » Et vraiment, il ne lui laissa pas un instant de repos, l’excitant toujours à s'occuper de la dame, jusqu'au matin que ce garçon sortit et retourna à ses affaires.
XLV. Parmi les histoires des marins et des capitaines, voici ce qu’on raconte du capitaine Abhara. Il était originaire de Caraman. Il fut d’abord berger et garda les brebis dans quelque village de cette contrée. Puis il se fit pécheur, ensuite matelot sur les navires qui fréquentaient les mers de l'Inde. Plus tard il s'embarqua sur un navire chinois. Enfin il devint capitaine, traversa la mer en tout sens et fit sept fois le voyage de la Chine. Personne avant lui n'avait achevé cette traversée sans accident. Qu'on pût arriver en Chine sans périr en route, c'était déjà merveille; mais qu'on en revînt sain et sauf, c'était chose inouïe; et je n'ai pas ouï dire que personne autre que lui ait achevé les deux voyages d'aller et de retour sans mésaventure.
Une fois, son navire ayant fait naufrage], il se mit sur son matyâl (?)
[77] avec une outre d'eau et resta plusieurs jours en mer. Voici ce que rapporte là-dessus le capitaine Chahriari, un des marins des mers de la Chine :« J'allais, dit-il, de Siraf à la Chine. Parvenu entre le Senf et la côte chinoise, dans le voisinage de Sandal-Foulat,
[78] qui est un cap dans la mer de Chine, le vent tomba tout à fait et nous eûmes calme plat. Ayant mouillé les ancres nous demeurâmes en place deux jours. Le troisième jour, nous aperçûmes de loin un objet sur la mer. Je fis mettre à l'eau le canot, et quatre matelots y descendirent avec ordre d'aller reconnaître cette masse noire. Ils allèrent et revinrent. « Eh bien? leur dis-je. — C'est le capitaine Abhara, répondirent-ils, monté sur son matyal avec une outre d'eau. — Pourquoi, repris-je, ne l’avez-vous pas emmené? — Nous avons voulu le faire, dirent-ils; mais il nous a répliqué : Je ne monterai sur votre navire qu'à la condition d'en être Je capitaine et de le gouverner; et je prendrai pour mon salaire mille dinars en marchandises au cours de Siraf. »Ces paroles nous frappèrent. Accompagné de quelques matelots, j'allai à lui et je le vis sur l’eau, montant et descendant au caprice des vagues. Nous le saluons et le supplions de venir avec nous. « Votre situation, dit-il, est pire que la mienne, et je cours moins de dangers que vous. Je monterai à bord, si vous me donnez mille dinars de marchandises au cours de Siraf, et si vous m'abandonnez le gouvernement du navire. » Nous dîmes : « Le navire contient beaucoup de marchandises et d'objets de valeur, avec un grand nombre de gens. Il ne sera pas mauvais que nous ayons les bons conseils d'Abhara au prix de mille dinars. »
Il nous suivit donc et monta à bord avec son outre et le canot. A peine arrivé : « Donnez-moi, dit-il, les mille dinars de marchandises. » On les lui donna. Les ayant mises en sûreté, il dit au capitaine : « Retire-toi ! » Et le capitaine se retira, lui cédant sa place. A l'œuvre maintenant, reprit-il, et n'encourons pas de blâme par le retard. — Que faut-il faire ? dîmes-nous. — Jetez à la mer tout ce qui est lourd. » On le jeta, et le navire fut débarrassé de la moitié de son chargement, ou plus. « Coupez le grand mât ! » continuât-il. Le grand mât fut coupé et jeté à la mer.
Le matin venu, il dit : « Coupez le câble de la grande ancre. » On le coupa et l'ancre resta dans l’eau. Il fit encore jeter successivement d'autres ancres ; six furent ainsi abandonnées. Le troisième jour, un nuage extraordinaire s'éleva, puis se dispersa dans la mer, et la tempête nous assaillit. Sans la précaution que nous avions prise d'alléger le navire et de couper le mât, nous aurions été submergés dès la première vague qui nous enleva. La tempête dura sans intervalle trois jours et trois nuits. Le navire montait et descendait, sans voiles et sans ancre, entraîné nous ne savions où. Le jour suivant, le vent diminua, puis s'apaisa tout à fait, et à la fin de cette journée la mer était redevenue calme. Dès le matin du cinquième jour, la mer était bonne, le vent favorable. Nous dressâmes un nouveau mât, nous tendîmes des voiles et le navire marcha, sauvé par Dieu. Nous arrivâmes au pays chinois. Là le navire fut réparé, et un mât refait à la place de celui qu'on avait jeté à la mer. Après avoir séjourné le temps nécessaire pour nos ventes et nos achats, nous remîmes à la voile, reprenant la route de Siraf.
Quand nous fûmes, suivant notre estime, vers l’endroit où avait été recueilli Abhara, nous eûmes connaissance d’une île. « Jetez l’ancre, dit Abhara. » Cela fait, on mit la chaloupe à la mer, cinq hommes y descendirent. « Allez vers cette élévation, dit-il, et prenez l'ancre que vous y trouverez. » Les matelots en effet trouvèrent l’ancre et la prirent.
Deux fois encore Abhara donna pareil ordre, et trois des six ancres auparavant abandonnées furent ainsi recouvrées.
Après quoi le navire reprit sa marche.
Nous questionnâmes Abhara sur l’aventure de ces ancres. « Lorsque je vous ai rencontrés, dit-il, nous étions au trentième jour (de la lune), au moment de la haute mer, et votre navire flottait au-dessus de cette île. Je vous ai fait jeter le plus lourd de vos bagages. Puis songeant que nous pouvions à la rigueur nous passer d'ancres en Chine, et que les marchandises restantes valaient à poids égal beaucoup plus que ces ancres, je vous les ai fait jeter aussi parce qu'il fallait absolument alléger le navire. Trois des six sont restées sur les hauteurs de cette île, sauvées pour nous, trois sont allées dans les profondeurs. — Comment, lui dit-on, as-tu pu prévoir cet abaissement de l’eau et cette tempête? — Moi et d'autres, dit-il, nous avons déjà traversé cette mer; et nous avons observé qu'à chaque trentième jour (de la lune) elle baisse d’une façon extraordinaire, au point de laisser ces hauteurs à découvert; et en même temps s'élève une violente tempête qui surgit du fond des eaux. Le navire que je montais a fait naufrage sur un de ces sommets, l’eau s'étant retirée pendant que nous passions de nuit au-dessus de l'île, et je me suis sauvé sur ce matyâl. Si vous étiez restés une heure de plus au lieu où je vous ai rencontrés avant la tempête, votre navire échouait et se brisait. »
Cet Abhara avait fait bien des voyages et avait eu bien des aventures. Celle-là est une des plus singulières.
XLVI. Un marin m'a appris qu'entre Khanfou,
[79] bourg de la Petite Chine, et Khamdan, bourg de la Grande Chine, qui est la plus remarquable des deux Chines, on trouve un fleuve puissant plus large que le Tigre à Basra; et en certains lieux des rives de ce fleuve il y a des montagnes d'aimant. C'est pourquoi l'on ne peut y naviguer avec des navires contenant du fer, que ces montagnes attireraient. Les cavaliers qui les parcourent ne ferrent pas leurs montures; leurs selles n’ont aucun ferrement; leurs étriers et les mors des chevaux sont en bois.XLVII. Je tiens d'un pilote nommé Imran fils du Boiteux, qu'étant sortis d'Oman sur un navire accompagné de plusieurs autres qui se rendaient à Djidda, en l’année 325, ils furent assaillis par une violente tempête et forcés de jeter à l’eau une partie du chargement. « Plusieurs navires, dit-il, restèrent en arrière, les autres continuèrent leur voyage» Arrivés entre Kamran
[80] et .... (?) nous essuyâmes un coup de vent effroyable qui brisa nos ancres, nous força à quitter l’ancrage et nous emporta. Il y avait avec nous plusieurs navires d'Aden,[81] de Ghalafqa[82] et d'Athar, entre autres une djabala de Ghalafqa, toute neuve, magnifique. Je la vis, poussée par les vents et par les vagues, jetée sur une montagne dans la mer et envahie par les flots. Elle chavira et ceux qui la montaient périrent tous sans exception.XLVIII. Parmi les histoires singulières de marins, voici ce que m'a raconté, au sujet de Merdabchah, un des capitaines de navires qui vont aux pays du poivre et autres lieux. Ce Merdabchah avait atteint soixante-dix ans sans avoir d'enfants. Il lui en naquit un qu'il nomma El-Merzeban. Cet enfant devint l'objet de sa plus vive affection; il remmenait avec lui dans son navire avec la mère. Un jour qu'il naviguait dans la mer de Barnan
[83] pour atteindre Koulam,[84] il demanda l’enfant à la mère qui était dans la cabine. Elle te lui mit entre les bras; et il s’amusa à le balancer, à le faire sauter, jusqu'au coucher du soleil. En ce moment, le vent se mit à souffler avec violence et un des mâts se fendit. Il voulut rendre l'enfant à la mère, mais dans sa précipitation il le laissa tomber dans l’eau sans s'en apercevoir. Le vent soufflait en tempête; il lui fallut s'occuper du gouvernement du navire jusqu'à l'heure de la prière du matin. A l'aube, la mer redevenue calme et le navire en paix, il s'assit et redemanda son fils. « Mais, dit la mère, tu l'as depuis le commencement de la nuit. » A ces paroles, le vieillard s'arrache la barbe et se frappe la tête ; il cherche dans tout le navire. Le timonier lui dit : « Sache que depuis la chute du jour le gouvernail est lourd sous ma main. Regardes-y. » On y regarde, et voici que sur la figure du gouvernail on découvre une masse qui ne bougeait pas. C'était l'enfant; un homme descend aussitôt et remonte l'enfant qui n'avait aucun mal. Il le donne à la mère qui présente le sein au nourrisson, et le nourrisson tête paisiblement. Il avait alors quinze mois.« J'ai connu ce fils, ce Merzeban, m'a dit Ismaïlouïa, alors qu'il était âgé de soixante-dix ans et plus. Il avait été jusqu'à treize fois devant le cadi d'Oman pour affaire d'argent, dans une seule journée. C'était, m'a-t-on dit, le moins juste des capitaines. Dans son navire, il traitait les marchands comme ne les traitent point des hommes fidèles aux conventions. »
XLIX. Bien des gens m'ont parlé de Saïd le Vannier, surnommé le Juste, et raconté l'origine de la fortune de ses enfants. Tous les récits concordaient à ce que je vais dire. Saïd était un saint homme, habitant d'Aden, qui tressait les paniers et les ouvrages en feuilles de palmier. Fort assidu à la mosquée, il y faisait toutes les prières. Il avait trois fils qui menaient une vie à peu près semblable à la sienne.
Un marin de ses amis ayant équipé un navire pour Kalah, et étant au moment du départ vint le trouver et lui dit : « Je te prie de me donner une commission. » Saïd acheta une cruche verte d'un demi-dirhem et un dâneq
[85] de sel qu'il mit dans la cruche. « Voilà, dit-il, la marchandise. — Et que t’achèterai-je ? demanda le marin. — Achète-moi une bénédiction y comme disent les gens. »Le navire partit, arriva à Kalah, vendit son chargement; et le patron ne se souvint plus de la cruche. Cependant un jour, alors que le rechargement était déjà achevé et le départ imminent, le capitaine vit sur le marché de Kalah un homme qui tenait un poisson au bout d'une corde, criant : « Qui veut acheter une bénédiction ?» Ce mot lui rappela la cruche de Saïd. « Qu’est-ce que cela, dit-il à l’homme au poisson. — C'est, répondit l'homme, une espèce de poisson que les pêcheurs appellent bénédiction. — Ma foi ! pensa le marin, c'est peut-être là précisément ce que mon ami Saïd a voulu dire. » Et il acheta le poisson au prix de deux oques pesant de sel. Faisant attendre le vendeur, il dépêcha au navire un de ses gens qui rapporta la cruche intacte. Il donna à l'homme le poids convenu de sel et fit emporter le poisson en son logis. On apprêta le poisson pour le saler avec le reste du sel. En ôtant les entrailles, on y trouva quelque chose de dur qui, fendu, se trouva être une coquille d'huître contenant une grosse perle. « Voilà un don que Dieu envoie à Saïd », s'écria le capitaine. Le poisson salé et la perle mise à part, on appareilla et le navire parvint à Aden sans accident. Le capitaine donna la perle à Saïd, qui vécut fort peu de temps après l'avoir reçue. Après sa mort, son plus jeune fils la prit et s'en vint à Sarra-man-râ
[86] trouver le calife qui était alors El-Motamed. Il la lui vendit au prix de cent mille dirhems. Elle valait plus du double.« On m'a assuré qu'un roi de l'Inde fit faire l'image de Mohammed fils de Bâlichâd, comme étant un marin distingué et dont le nom a couru sur la mer. Et c'est, dit-on, leur coutume de faire l'image des personnes illustres et qui s'élèvent au-dessus des autres hommes.
[87] »L. Un Sirafien raconte que dans une traversée de Siraf à Kalah, son navire sombra en pleine mer, et lui-même parvint à se sauver sur une pièce de bois. Il demeura en mer plus de dix jours, puis fut poussé sur une île riche en arbres, en fruits, en bananes. Après y avoir demeuré quelque temps, vivant des fruits et de l’eau douce qu'il y trouvait, il s’ennuya et se mit à marcher droit devant lui pendant plusieurs jours. Cela le conduisit dans une région cultivée, où se trouvaient des plantations de dourah, de riz et autres végétaux utiles. Apercevant une hutte, il s'en approcha et vit un réservoir d'eau qui était vide. Fatigué, il entra dans la hutte, pour se reposer. Il y dormait, lorsque arriva un homme qui conduisait deux taureaux chargés de douze outres pleines d'eau. L'homme prit les outres et les vida dans le réservoir; puis il s'assit afin de prendre un instant de repos. Le voyageur se leva pour boire de cette eau. Il examina le réservoir et le trouva poli comme une lame d'épée; ce n'était ni de la poterie ni du verre. Il questionna là-dessus l’homme aux taureaux, qui lui dit : « C’est un tuyau de plume d’oiseau. » Il n’y croyait pas; mais l’homme, allant au réservoir, le frotta en dehors et en dedans, et le voyageur vit qu'il avait de la transparence et portait sur les deux côtés des traces de barbes de plume. Cet homme ajouta qu'il y avait des oiseaux dont les plumes étaient encore beaucoup plus grandes.
[3] Basra, que nous nommons généralement Bassora, port autrefois extrêmement florissant sur le Chatt-el-Arab.
[4] Il y a eu en Orient plusieurs villes du nom de Mansoura : Mansoura d'Egypte, Mansoura de l'Irak, Mansoura du Yémen, sans compter deux autres bourgs du même nom dans la Perse. Dans ce paragraphe et le paragraphe LV, et s'agit évidemment de Mansoura du Sind, ville fondée par les Arabes sur les bords de l'Indus, dès les premiers temps de la conquête. Les changements constants que subit le cours de l'Indus sont cause que nos géographes ont quelque peine à fixer la position exacte de cette ville. L'opinion la mieux appuyée est celle de D'Anville, qui place Mansoura au nord-est de Halder-Abad. Elle fut la capitale d'une principauté musulmane, qui paraît avoir été renversée dès le xie siècle par les peuplades sauvages des bouches de l'Indus.
Sur les diverses localités du nom de Mansoura, on peut voir la Géographie d’Aboulféda, texte arabe, publié par MM. Reinaud et de Slane, p. 346.
[5] Le Râ est le Raya de Massoudi. En décrivant les régions de l'Inde, dont « le plus puissant roi porte le nom de Balhara », l'écrivain arabe ajoute : « Les états du Balhara sont entourés par plusieurs principautés. Quelques-uns de ces rois habitent la région des montagnes, loin de la mer, tels sont le Raya, maître du Kachmir, etc. » (Les Prairies d’or, trad. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille, tome I, p. 177.)
Raya doit être la transcription arabe du titre hindou radja, roi; au lieu de « roi au Râ », il faudrait donc lire « le roi radja ».
[6] Le titre de sahib, mot dont le sens propre est « compagnon », correspond à ceux de gouverneur, préfet, lieutenant du souverain.
[7] Il est question d'Omar fils d'Abd-el-Aziz dans le Livre des Conquêtes des Pays de Beladori. C'était un Arabe de la tribu des Coréichites, qui, après avoir assassiné le gouverneur de Mansoura, se rendit maître de la principauté ; et l'historien Ibn-Haukal, qui visitait la vallée de l'Indus, quelques années plus tard, ait que la famille de cet Omar avait de son temps le gouvernement de Mansoura.
[8] Ya, sin, sont deux lettres de l'alphabet arabe I, 8, qui forment le titre de la sourate ou chapitre 36e du Coran. Le passage cité ici se trouve aux versets 78 et 79 (p. 374 de l’édition Redslob).
[9] Men, mena, manna, mesure de poids qui représente la mine des Grecs. Chez les Orientaux, sa valeur ordinaire paraît être de deux livres; mais elle a beaucoup varié suivant les époques et suivant les pays.
[10] Le khatîb est « parmy les mahométans, celuy qui tient dans les mosquées la place que les curez tiennent dans les paroisses parmy les Chrétiens; parce qu'outre qu'il fait la prière à leur tête, il leur fait encore des sermons et des prônes, en les avertissant de leurs devoirs, et souvent en leur annonçant ce que le Prince veut leur foire sçavoir comme à ses sujets. » (D'Herbelot, Bibliothèque orientale, p. 991.)
[11] Dans ce vase tant de fois séculaire, on peut voir une allusion au fameux pot de Foe (Bouddha), dont il est question dans le voyage du Chinois Fa-hian, au commencement du Ve siècle de notre ère. (Voy, cette relation dans les Voyageurs anciens et modernes de M. Charton, tome I, p. 386.)
[12] Siraf, port sur la côte orientale du golfe Persique. Les Orientaux, très ingénieux en explications étymologiques, disent que son ancien nom était Chirab, venant du persan chîr, lait et ab, eau, parce que l'un des anciens rois de la Perse, Keï-Kaous, après avoir été frappé du tonnerre, se rétablit en ce lieu au moyen de lait et d'eau. La ville, jadis fort commerçante, n'existe plus depuis plusieurs siècles. (Voy. D'Herbelot, Biblioth. orient., p. 814).
D'après le grand Dictionnaire géographique de Yakout, qui emprunte, dit-il , le fait à l’Avesta, l'accident de Keï-Kaous provenait de ce que ce prince avait voulu s'élever jusqu'au ciel. « Lorsqu'il se fut dérobé aux regards des hommes, Dieu ordonna aux vents de ne plus le soutenir; Keï-Kaous tomba, etc. » (Trad. Barbier de Meynard, p. 331.)
[13] Un gobb, dit le savant écrivain arabe Al-Biruni, est comme une encoignure et un détour que fait la mer en pénétrant dans le continent; les navires n'y sont pas sans péril, particulièrement à l’égard du flux et du reflux. (Trad. par M. Reinaud, dans ses Fragments arabes et persans relatifs à l’Inde, p. 119). « En face de l’île de Sérendib (Ceylan). il y a de vastes gobb, mot par lequel on désigne une vallée, quand elle est la fois longue et large et qu'elle débouche dans la mer. Les navigateurs emploient pour traverser le gobb appelé gobb de Sérendib deux mois et même davantage, passant à travers des bois et des jardins... C'est à l’embouchure de ce gobb que commence la mer de Herkend. » (Relation d'Abou Zeïd, Les Deux Mahométans, édit. Charton, p. 144.)
[14] « On dit que les Indiens qui veulent mourir dans le Gange se rendent à un certain endroit de la partie supérieure de son cours. Là sont des montagnes escarpées et des arbres dépouillés de leurs feuilles. Tout auprès se tiennent des hommes qui font profession de prêcher le renoncement au monde et les avantages d'une autre vie. Des pointes de fer et des épées sont dressées sur les arbres et sur des pieux destinés à cet objet. Les Indiens, venus des provinces les plus éloignées, écoutent les discours des prédicateurs placés sur le bord du fleuve ; puis ils se précipitent du haut des montagnes sur les arbres et sur les pointes de fer, et retombent en lambeaux dans le fleuve ». (Massoudi, les Prairies d'or; voy. Mém. sur l'Inde, p. 230.)
Edrici rapporte un fait semblable, relativement à la Chine : « Le Khamdan chinois est un grand fleuve dont les bords sont très peuplés. L'auteur du Livre des Merveilles rapporte qu'on y voit un arbre de fer nommé en indien bârchoûl, que cet arbre dont le diamètre est d'une coudée est fixé au milieu du fleuve à une hauteur d'environ dix coudées au-dessus des eaux et terminé vers son sommet par trois pointes aiguës. Cet auteur ajoute qu'un homme se tient assis dans le voisinage tenant un livre à la main et récitant les paroles suivantes : « Fleuve béni, sentier du paradis, d'où ta source découle et vers lequel tu diriges les hommes ! heureux celui qui, monté sur la cime de cet arbre, se précipitera dans tes eaux. Alors un ou plusieurs des assistants, émus par ces paroles, montent sur l'arbre et se précipitent dans le fleuve, accompagnés des vœux et des prières de la foule ». (Géographie d’Edrici, trad. Jaubert, I, p. 196.)
[15] Le nom écrit fetouh dans notre manuscrit peut devenir par de simples changements de points qannoudj. qui est la fameuse ville de Canoge, sur la rive occidentale du Gange, au confluent de ce neuve et de la Djomna. « La grande importance de Canoge eut lieu dans les ive, ve et vie siècles de notre ère, au temps où les princes Sassanides régnaient en Perse. Ces princes, dont les états touchaient à l’Inde, eurent plus d'une fois des rapports indispensables avec les souverains de Canote. Aussi le nom de cette cité se répandit dans l’Asie occidentale, et quand les Arabes parurent sur la scène, bien qu'elle eût perdu de son influence, elle continua à jouir d'une grande célébrité ». (Reinaud, Introduction à la Géogr. d’Aboulféda, p. cccxxxvi.)
[16] La noix faufel est la noix d'arec, qui dans l’Inde atteint la grosseur d'un œuf de poule.
[17] Au lieu de Raîh ou de Rîh, qui signifie « vent », on pourrait lire : Zîh, Zeneh, Zenedj, Zebedj, etc., etc. Peut-être la vraie leçon est-elle Zabedj ; voir plus loin la note 19 relative à la contrée de ce nom.
[18] En 1867, M. Emile Blanchard présentait à l'Académie des sciences un crabe monstrueux, pareil de forme à ceux de nos côtes, mais dont les bras avaient un mètre vingt centimètres de longueur, ce qui donnait pour l'envergure totale de l'animal environ deux mètres et demi. Il venait des mers du Japon. D'autres voyageurs affirment avoir vu, dans les mêmes parages, des crabes dont les bras dépassaient deux mètres de long, supposant ainsi une envergure de quatre mètres et plus. « A cette occasion, M. Blanchard fait remarquer que la taille des animaux marins, tels que crabes, homards, moules, etc., que l'on pêche sur nos côtes, est bien plus petite que celle des individus qui vivent dans les parages où la pêche ne s'exerce pas. Le savant naturaliste pense que l'homme, qui, en définitive, recherche ces animaux pour sa nourriture, détruit les conditions favorables à leur accroissement, et ramène ces êtres à la taille que nous leur connaissons, et qui est bien inférieure à celle qu'ils pourraient acquérir dans des mers peu explorées. En effet,, selon M. Blanchard, pour les crustacés du moins, la croissance ne s'arrête pas à l'âge adulte, mais elle continue indéfiniment. Si le crustacé habite des parages dont les eaux ne soient pas troublées et où la pêche ne s'exerce pas, il vit très longtemps et peut atteindre de monstrueuses proportions ». (L. Figuier, Année scientifique, 1867, p. 330.)
[19] Sur Lâmeri, voir la note plus loin.
[20] La contrée nommée Zâbedj a des limites difficiles à définir. Vers l’époque à laquelle nous ramène notre livre. L'empire du Zabedj, dont le souverain portait le titre de Maharadja, grand roi , comprenait la majeure partie de la Malaisie. avec la presqu'île de Malaka. « Les îles de la partie de la mer de l'Inde qui est tournée vers l'Orient, et qui se rapproche de la Chine, dit Al-Biruni, sont les îles du Zâbedj. Les Indiens les nomment Sourendîb, c'est-à-dire « îles d'or. » (Fragm. relat. à l’Inde, p. 123.) Il faut donc comprendre, sous le nom général de Zâbedj : Sumatra, Java, Bornéo et la multitude d'îles, grandes et petites, qui avoisinent ces grandes terres.
Le marchand Soleïman, et surtout son continuateur Abou-Zeïd, donnent des détails étendus sur l'empire du Zâbedj et les splendeurs de sa capitale. « L'île où réside le maharadja est extrêmement fertile, et les habitations s'y succèdent sans interruption. Un homme dont la parole mérite toute croyance a affirmé que lorsque les coqs, comme dans nos contrées, chantent le matin pour annoncer l'approche du jour, ils se répondent les uns aux autres sur une étendue de cent parasanges et au-delà. Cela tient à la suite non interrompue des villages et à leur succession régulière. En effet, il n’y a pas de terres désertes dans cette île, il n'y a pas d'habitations en ruines. » On conte que chaque jour l’intendant du roi lui présentait un lingot d'or, en forme de brique, d'un poids déterminé, que la brique était jetée dans un étang attenant au palais; que toutes ces briques successivement entassées restaient sous l'eau jusqu'à la mort du prince; qu'alors on les retirait pour les fondre et en faire la distribution aux princes de la famille royale et aux principaux fonctionnaires. (Voy. la relation des Deux Musulmans, édit. Charton, p. 130, 131.)
[21] Le ouaq-ouaq est une région assez mal définie, mais qui paraît appartenir aux parages des îles malaises. Il en est parlé dans le premier voyage de Sindbad (édit. Langlès, p. 474), dans le Livre des Routes et des Provinces d'Ibn-Khordadbeh, dans Al-Biruni, etc. « Le pays des Ouâq-Ouâq, dit Ibn-Khordadbeh, est si riche en mines d'or, que les habitants fabriquent avec ce métal les chaînes de leurs chiens et les colliers de leurs singes. Ils livrent au commerce des tuniques brochées d'or ». (Trad. Barbier de Meynard, p. 293.) Al-Biruni combat une opinion reçue de son temps, à savoir que le nom de Ouâq-Ouâq proviendrait « d'un arbre dont le fruit aurait la forme d'une tête humaine poussant un cri ». (Fragm. relat. à l'Inde, p. 124) Du reste, le savant écrivain arabe s'abstient de fournir une autre explication. Les Malais, encore aujourd'hui, appellent aouq-aouq une espèce de singe (le gibbon wouwou des naturalistes) assez répandue dans la Malaisie. Peut-être est-ce là la véritable origine de Ouâq-Ouâq. Ibn-Batouta, dans sa traversée de Java à la Chine, toucha à une terre qu'il nomme Taouâlici. Ce qu'il dit des habitants, dont la figure « ressemble le plus possible à celle des Turcs », s'accorderait assez bien avec ce qui est rapporté plus loin sur les gens du Ouâq-Ouâq. (Tome IV, 249.) Massoudi contemporain de notre auteur, croit que le pays des Ôuâq-Ouâq est situé dans le voisinage de Sofala des Zindj, ce qui peut s'expliquer par l’opinion alors fort répandue d'une union existant entre le Zâbedj et la pointe méridionale de l'Afrique. Du reste, le voyageur Cameron, qui vient de traverser l'Afrique , de Zanzibar à l’Atlantique, parle aussi d'une tribu nègre portant ce même nom.
[22] Le nom de Sérendib, donné par les Arabes à l’île de Ceylan, est une altération de sinhala-diba, formé de deux mots indigènes : sinhala « qui a des lions » (en sanscrit sinha, lion) et diba, douipa « île ». Séhîlan, Ceylan sont aussi des altérations de Sinhala. On trouve de nombreux et très curieux détails sur cette grande île chez tous les anciens voyageurs en Orient : le Chinois Fa-hian, l'Alexandrin Cosmas Indicopleustes, les Arabes Soleïman et Abou-Zeïd-Haçan, l'Italien Marco Polo, le moine chrétien Oderic de Frioul, etc., etc. Elle était surtout fameuse par ses pierres précieuses ; aussi l'appelle-t-on l’île du Rubis, l’île des Joyaux, l’île des Pierreries, l’île de l'Hyacinthe, etc. Les musulmans racontent qu'Adam, après sa chute, fut relégué à Sérendib. Il portait avec Im du froment et trente rameaux détachés des arbres du Paradis terrestre; de là sont venus : la pêche, l'abricot, la datte, la grenade, la banane, l'amande, la pistache, la jujube, la cerise, le raisin, l'orange, la poire, la figue, le melon, etc. Adam était vêtu à son arrivée de feuilles qui, s'étant desséchées, furent entraînées par les vents; de la viennent les parfums et les aromates de l'Inde. (Voy. Massoudi, les Prairies d'or, I, p. 61, 62.)
[23] Beaucoup d'écrivains anciens et modernes ont rapporté des faits ou des traditions relatives à des oiseaux gigantesques des mers de l'Inde, le pheng des Japonais, le rokh des Arabes, le simourgh des Persans, gryphon des Grecs. On trouvera là-dessus des renseignements nombreux et intéressants dans les travaux publiés par un savant naturaliste italien, M. Giuseppe Bianconi, de Bologne, notamment dans le fascicule intitulé Osservazioni addizionali intorno alla brevità del femore di Aepiornis, 1874, p. 175 et suiv. ; et dans le mémoire Intorno a due vertebre di Aepiornis, 1874, p. 193 et suiv. Ces travaux contiennent la traduction en italien de plusieurs passages du présent ouvrage, que je lui avais communiqués.
Marco Polo, dans son chapitre « de l'île de Madagascar », parle du rokh par ouï-dire : « En ces autres îles qui se trouvent plus au midi et où les navires ne vont pas volontiers, il y a des griffons qui apparaissent à diverses saisons de l’année ; mais ils ne sont point faits comme on le croit généralement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas moitié lions, moitié oiseaux; mais ceux qui en ont vu m'ont dit qu'Us étaient tout semblables à l'aigle, seulement démesurément grands, et si forts et si puissants qu'ils prennent un éléphant et l'enlèvent de terre, puis le laissent retomber, de sorte que l'éléphant est tout brisé, et alors le griffon fond sur lui et s'en repaît. Ceux qui l'ont vu disent qu'il a trente pas d'envergure et que les plumes de ses ailes sont longues de douze pas; sa grosseur est analogue à sa grandeur... Ceux de cette île l'appellent roc et ne lui connaissent pas d’autre nom ; mais c'est nous qui, à cause de la grandeur du roc, avons pensé que c'était le même que le griffon ». (Edit. Charton, p. 413.)
Les personnes curieuses de connaître la part de vérité cachée sous les exagérations des conteurs orientaux trouveront les indications nécessaires dans les travaux précités de M. Bianconi.
Le rokh, comme on sait, joue un rôle considérable dans divers contes des Mille et une Nuits. Comme nos sept naufragés, le fameux Sindbad est transporté par un oiseau gigantesque : « Le soleil approchait du couchant, et les ténèbres se répandaient dans l'espace ; un immense nuage paraît, |e le considère. C'était un oiseau. Alors je me souvins de ce que les marins nous ont raconté du rokh, oiseau qui a la dimension d'un nuage... Le volatile s'abattit... Une de ses serres, semblable à un grand harpon de fer, se trouva devant moi. Je déliai mon turban de dessus ma tête; je m'attachai fortement à un des bouts, et j'attachai l'autre bout à la serre, en disant : Peut-être que cet oiseau me tirera de cette île et me transportera dans un lieu habité. A l’apparition de l'aurore, le rokh se dresse, s'élance dans l'espace; j'étais fortement lié à sa serre, et j'avais avec moi le sac aux provisions, il s'éleva dans le vide tellement qi je pensai qu'il allait se clouer au ciel; mais baissant la tête, il regagna la terre. Je ne m'étais pas reconnu, que je me trouvai sur le sol. » (Trad. de Langlès, dans la Grammaire arabe de Savary, p. 480, 481.)
[24] La parasange des Arabes est la même que celle des Grecs, qui eux-mêmes l'avaient empruntée à l’Orient. Chez les Romains elle valait trois milles, le mille trois mille coudées, la coudée trente-deux doigts. Chez les Arabes, qui prenaient la coudée de vingt-quatre doigts seulement, le mille contenait quatre mille coudées, ou mille brasses de quatre coudées chacune. En somme, pour les uns et pour les autres, le mille est de 96.000 doigts, et la parasange de 388.000 doigts. Quant au doigt, sa valeur est donnée par « l'espace qu'occuperaient six grains d'orge de grandeur moyenne, posés l’un contre l’autre ». Enfin le grain d'orge correspond à sept poils de mulet places côte à côte. (Voy. Aboulféda, Prolégomènes, p. 18 de la traduct. Reinaud.)
Pour les géographes, la parasange correspond à la lieue de 25 au degré; car on évaluait les 360 degrés de la circonférence du globe, à l’équateur, à 9.000 parasanges.
[25] La ville ou la contrée d'Oman, dont il est souvent question dans ce livre, est le pays de la côte orientale arabique qui porte encore ce nom. Les anciens ont connu une autre Oman ou Omana, signalée dans le Périple de la mer Erythrée, port de relâche, rendez-vous des négociants de l’Inde, d'Obollah, de la côte de l'Arabie méridionale et de la mer Rouge. Charles Müller place cette Oman sur la côte méridionale de la Perse, aux environs de Tiz (Béloutchistan). M. Reinaud croit qu'il faut en reporter l'emplacement jusqu'à l'entrée du golfe Persique, aux environs d'Ormuz. (Voy. son Mém. sur la Mésène et la Kharacène, dans le Journ. asiat. de 1861, p. 75 du tirage à part.) Voy. plus loin la note 56.
[26] « Ma dernière traversée de l'île de Kanbalou à l'Oman remonte à l'année 304... L'émir de l'Oman était alors Ahmed fils de Helâl, fils d'une sœur d'El-Qaïtâl ». (Massoudi, les Prairies d’or, tome I, p. 234.)
[27] La mesure de longueur que nous traduisons par aune est définie par l'auteur lui-même (p. 15), comme se comptant depuis le creux de l'aisselle jusqu'à l'extrémité du doigt médius.
[28] Le dirhem (qui étymologiquement représente la drachme des Grecs) était une monnaie d'argent dont on peut évaluer approximativement la valeur, variable suivant les époques et les pays, à 0 fr. 70 de notre monnaie. Quinze dirhems correspondaient à un dinar (le δηνάριον des Grecs), pièce d'or, qu'on peut compter par conséquent pour une dizaine de francs.
[29] Sous le nom de Zindj, les Arabes entendent les nègres de la côte orientale d'Afrique appelée de leur nom Zaneuebar (Bar est un mot de l'Inde désignant à la fois, dit Soleïman, un royaume et une côte). Pour certains géographes du temps, la côte africaine devait dans sa partie la plus méridionale rejoindre les régions de l'Inde. C'est ce qui explique la confusion, fréquente chez les écrivains orientaux, du pays de Qamar (montagnes de la Lune) avec une région du même nom, Qamâr ou Qomâr, située vers le Zâbedj. On peut voir d'intéressants détails sur les Zindj dans les Prairies d'or, de Massoudi, tome III, p. 5 et suiv.
[30] Notre auteur, ou son copiste, écrit mer de Samarkand. (Voy. le § LIII.) Le vrai nom, tel qu'on le lit chez tous les écrivains arabes de l'époque (Soleïman, Abou-Zeïd, Ibn-Khordadbeh, Massoudi, Ibn-Haukal, Al-Biruni, etc.), est mer de Herkend. C'est la portion de l'Océan indien comprise entre Ceylan et la pointe nord de Sumatra, c'est-à-dire correspondant à une partie de ce que nous appelons aujourd'hui le golfe du Bengale.
[31] Comparez ce passage de la Relation de Soleïman :
« Ils y remarquèrent (dans la mer située entre l'Inde et le Sind) un poisson (sur le dos duquel il s'élevait quelque chose de) semblable à une voile de navire. Quelquefois ce poisson levait la tête et offrait une masse énorme. Quand il rendait de l'eau par la bouche, on voyait, pour ainsi dire, s'élever un haut minaret. Au moment où la mer était tranquille, lorsque les poissons se ramassaient sur un même point, il les enlevait avec sa queue; ensuite il ouvrait la bouche, et l'on voyait les poissons se précipiter dans son ventre et disparaître comme au fond d'un puits. Les vaisseaux qui naviguent dans cette mer redoutent beaucoup ce poisson. La nuit, les équipages font sonner des cloches semblables aux cloches des chrétiens ; c'est afin d'empêcher ce poisson de s'appuyer sur le navire et de le submerger ». (Trad. de M. Reinaud, dans les Voyageurs anciens et modernes, de M. Charton, tome II, p. 97.)
L'auteur arabe parle aussitôt après d'un autre grand poisson, long de vingt coudées, qu'il nomme el-oual. C'est évidemment le même nom que el-ouak, les deux lettres l et k sont aisément confondues dans l'écriture arabe. Voy. plus loin (LIII) un autre récit concernant le fal, autre variante du mot oual.
« La grande mer orientale recèle dans ses flots un poisson long de 100 à 200 coudées; les marins le redoutent, et, pour l'éloigner, ils choquent des morceaux de bois l'un contre l'autre.» (Ibn-Khordadbeh, le Livre des routes, trad. Barbier de Meynard, Journ. asiat. 1865, I, 282.)
Dans l'analyse que nous a donnée Arrien (Historia Indica) de la relation du voyage fait, en 326 av. J.-C., par Néarque, chef de la flotte d'Alexandre, il est aussi question des monstres marins qui fréquentaient la mer des Indes. Les matelots effrayés à la vue des colonnes d'eau que d'énormes cétacés faisaient jaillir devant eux, se mettent, sur le conseil de leur capitaine, à crier à tue-tête, à sonner de la trompette, à frapper l'eau de leurs rames, pour écarter ces voisins incommodes. « Les baleines effrayées, qu'on voyait déjà près de la proue des navires, plongent dans la profondeur de la mer, et bientôt reparaissent à la poupe, lançant de nouveau de longs jets d'eau dans les airs. Alors les matelots, se voyant sauvés, poussent de grands applaudissements et louent l’audace et la prudence de Néarque. »
Quelques siècles plus tard, les navigateurs imaginèrent de munir leurs bâtiments d'une grosse cloche que le mouvement des vagues mettait en branle, de manière à effrayer les géants de la mer (djibbar, d'où notre terme jubarte) dont on redoutait l'abordage.
Massoudi (les Prairies d’or, I, 234) parle du monstre marin el-oual à peu près dans les mêmes termes que Soleïman, dont il a vraisemblablement copié la relation.
[32] Moqtadir-Billah, 18e calife abbasside de Bagdad, régna de 295 à 320 de l'hégire (908 à 932 de notre ère).
[33] Djidda ou Djedda est, comme on sait, le port de la Mecque : « ville florissante, disait Aboulféda, à quarante milles de la cité sainte, où débarquent les pèlerins venant de la côte opposée. »
[34] Il est sans doute ici question d'un narval, poisson qui porte à l’extrémité de la mâchoire supérieure une dent en forme de corne, dont la longueur dépasse parfois 3 mètres. Dans les mers polaires où le narval est aujourd'hui relégué, cette corne lui sert à percer la glace pour venir respirer a la surface de l’eau.
L'aventure rapportée par notre auteur rappelle un accident arrivé, si je ne me trompe, au capitaine Cook : son vaisseau, entraîné par la tempête sur des roches aigues, fut percé de part en part ; mais la pointe de rocher resta prise ans le trou qu’elle avait fait et préserva le navire de la submersion.
[35] « Cette mer renferme un autre poisson que nous pêchâmes ; sa longueur était de vingt coudées. Nous lui ouvrîmes le ventre, et nous en tirâmes un poisson de la même espèce; puis, ouvrant le ventre de celui-ci, nous y trouvâmes un troisième poisson du même genre. Tous ces poissons étaient en vie et se remuaient; ils se ressemblaient pour la figure les uns aux autres. » (Relation de Soleïman, ubi supra, p. 97.)
[36] Nâkhoda est un mot persan, en usage encore dans les mers de l’Inde, et signifiant capitaine de navire, chef d'une embarcation. Il est formé au mot khodâ ou khoudâ, maître, et de nâ, reste d’un mot signifiant navire, et proche parent du latin navis et du grec naus, Les Persans aujourd'hui jouent sur ce mot : nâkhodâ, nâkhodâ « marin, athée » ; car nâ est une particule négative et khodâ signifie Dieu.
[37] Le manuscrit arabe porte « mer de Malâtou » ; mais nous pensons que les deux points qui dans l’écriture arabe surmontent le t doivent être placés dessous, ce pour en faire un y; et nous lisons ainsi : mer Malâyou, mer malaise.
[38] Comparez ce passage de la Topographie chrétienne du voyageur alexandrin Cosmas Indicopleustes, mort vers 550. « Plus loin l’Océan a des vagues énormes et est couvert d'épaisses vapeurs qui obscurcissent les rayons du soleil, et de plus son immensité est effrayante. J'en parle par expérience, car j'ai navigué, pour faire le commerce, dans les trois golfes Romain, Arabique et Persique. Un jour que nous naviguions vers l'Inde intérieure, arrives presque à la Barbarie, au-delà du pays des Zindjs, c'est ainsi qu'on appelle l’entrée de l’Océan, comme nous arrivions à droite... nous éprouvâmes un grand changement dans la température. Tons furent saisis de crainte; les matelots et les passagers les plus expérimentés disaient que nous approchions de l’Océan, et tous criaient au pilote : « Retourne à gauche vers le golfe, de peur qu'emportés par le courant vers l’Océan nous ne périssions. Car l’Océan en entrant dans le golfe soulevait de vastes flots, et la vague nous entraînait vers la pleine mer. C'était là un horrible spectacle et qui nous glaçait de terreur. » (Voyag. anc. et mod., II, p. 12.)
« La mer environnante, l’Océan des Grecs pour la partie orientale, dit Al-Biruni, sépare la partie de la terre qui est habitée des terres qui se trouvent peut-être de l’un et de l’autre côté, au-delà de la mer, que ces terres, qui sont entourées d’eau, soient habitées ou ne le soient pas. On ne navigue pas sur cette mer à cause de l’obscurité de l’air, de l’épaisseur de l’eau. de la confusion des routes et à cause des nombreuses chances qui existent de s'égarer, sans compter le peu d'avantages qu'on retirerait d’un voyage aussi lointain. (Trad. de M. Reinaud, Fragments relatifs à l'Inde, p. 95.)
[39] Banian. « Tribu des Indiens qui tient le second rang entre les quatre qui partagent cette nation, et qui s'adonne particulièrement au négoce. » (D'Herbelot, Bibliothèque orientale.)
[40] « Le mot Andalos, tel qu'il est employé par les écrivains arabes a varié d'acception suivant les temps et les lieux. En général, il a servi à designer les contrées du sud-ouest de l’Europe, occupées jadis par les musulmans; or, les musulmans ont été maîtres à une certaine époque, non seulement de l'Espagne, mais d'une partie de la France et de l'Italie; à une autre époque, ils ont été réduits à la province de Grenade. » (Reinaud, Géogr. d'Aboulf. Trad. I, p. 334, note i.) L'Andalousie actuelle ne comprend donc qu'une faible partie de l’Andalous des Arabes au xe siècle.
[41] Ce conte de matelot semble comme un ressouvenir de la légende rapportée par Néarque touchant une île de la mer indienne nommée Nosala, consacrée au soleil et où nul mortel n'osait aborder. On lui dit que cette île avait été habitée par une Néréide; lorsqu'un homme tombait sur ses rivages, la Néréide en faisait son amant, puis le changeait en poisson et le jetait à la mer. Le soleil rendit plus tard la forme humaine à ces poissons, et de là vint la race des Ichthyophages.
[42] Notre manuscrit porte Qîcour ou Qaiçour; mais il est probable qu'il faut lire Fansour, ainsi qu'aux paragraphes LXXIII, LXXV.
[43] Le coheul est une poudre noire que les femmes de l'Orient emploient comme cosmétique. (Voy. le mot alcool dans mon Dictionnaire étymologique des mots français d'origine orientale.)
[44] Le nom de djézira, qui signifie île ou presqu’île, s'est naturellement appliqué à un grand nombre de régions. Ici il est sans doute question d'une ville nommée Djézirat-ibn-Omar « l'île du fils d'Omar », ainsi appelée parce qu'elle avait été bâtie par les descendants du calife Omar dans une île du Tigre, au-dessus de Mossoul. (Voy. D'Herbelot, Bibliothèque orientale, p. 384.)
[45] Le poisson-scie (squalus pristis), répandu dans toutes les mers, est vulgairement connu sous les noms d'épée de mer, espadon dentelé, héron de mer. C'est un animal très agressif et qui s'attaque particulièrement à la baleine et aux autres cétacés.
[46] J'ignore à quelle bête marine cette histoire (XVIII) fait allusion. Mais voici un fait du même genre, plus singulier encore, qui est rapporté dans le recueil e chroniques en langue malaise, connu sous le nom de Chedjarat-malayou « l'arbre malais ». Le lecteur me saura gré de lui donner en entier cette bizarre historiette que je traduis sur le texte publié par M. Dulaurier, p. 131 et suiv. « Quelque temps après arrivèrent des Toudaks qui assaillirent Singapoura; ils sautaient jusqu'à terre, et parmi les gens qui étaient sur le rivage, beaucoup mouraient atteints par ces Toudaks. S'ils frappaient à la poitrine, ils la traversaient jusqu'au dos; s'ils frappaient au cou ou aux reins, ils les perçaient d'outre en outre. On ne pouvait rester debout sur le rivage ; bien du monde mourut tué par eux.
« Padouka Sri Maharadja s'empressa de monter sur un éléphant et sortit du palais, suivi par les ministres, les eunuques et tous les officiers. Arrivé au rivage, le prince fut stupéfait de voir l'œuvre de ces Toudaks. Toute personne atteinte par leurs bonds était perdue sans ressource. Sous leurs piqûres, le nombre des morts s'accroissait à chaque instant. Le prince ordonna que les hommes (rangés l'un contre l'autre) fissent un rempart de leurs jambes. Mais dans leurs bonds, les Toudaks réussissaient à traverser cette barrière. Ils arrivaient comme la pluie, et les gens mouraient, mouraient toujours.
« Sur ces entrefaites, un jeune garçon dit : « Pourquoi faire ainsi un rempart de nos jambes? c'est là un artifice bien à notre détriment. Ne vaudrait-il pas mieux faire un rempart de troncs de bananiers? » Lorsque Padouka Sri Maharadja entendit les paroles de l'enfant : « Il a parfaitement raison », dit-il. Et il ordonna aux hommes de construire une barrière de troncs de bananiers. Quand les Toudaks arrivaient en bondissant, leur museau s enfonçait dans ces troncs, et les hommes se hâtaient de les percer. Il périt ainsi de ces Toudaks un nombre inimaginable ; leurs cadavres formaient des monceaux sur le rivage, et toute la population du pays de Singapour ne put suffire à les manger. Et les Toudaks cessèrent leurs sauts.
« On conte que par la force du saut les Toudaks étaient arrivés jusqu'à l'éléphant du prince et avaient déchiré la manche de son badjou (vêtement de dessus), sur quoi on a fait la chanson : «
« Le badjou du roi a été déchiré par le bondissement des Toudaks ;
« Cela n'est pas allé plus loin, grâce à l'intelligence d'un enfant.
« Pendant que Padouka Sri Maharadja s'en retournait, les grands lui dirent : « Seigneur, cet enfant si jeune encore a déjà bien de l'esprit. Que sera-ce, lorsqu'il aura grandi ! Il convient de s'en débarrasser. » C'est pourquoi on trouva juste que le roi donnât l'ordre de le tuer. »
[47] Naurouze est un mot persan qui signifie « nouveau jour » et qui désigne le premier jour de l'année. C'était, chez les anciens habitants de la Perse, un jour de fête qui s'est maintenu après leur conversion au mahométisme. Il correspond au commencement du printemps.
[48] Le mot que nous traduisons ici par ce terme vague « embarcation », et ailleurs, par « chaloupe, canot » est dans notre manuscrit arabe doûbedj ou doûnedj, au pluriel douâbidj ou douânidj. Cette expression manque dans tous les dictionnaires orientaux que nous avons pu consulter. Mais elle est certainement identique à un terme doûndj qu'on trouve dans Edrici : « (Chaque marchand est accompagné d'un plongeur qu'il a loué et toute la flottille sort de la ville (de Bahreïn) au nombre de plus de deux cents doundj. La doundj est une sorte de baraque ordinaire construite avec un entrepont que les marchands divisent en cabines au nombre de cinq ou six. » (Géographie d'Edrici, trad. Jaubert, Ier vol.)
[49] On trouve le récit d'une aventure analogue dans les Mille et une Nuits (premier voyage de Sindbad, 70e et 71e nuits dans Galland) : « Un jour nous découvrîmes une île charmante dont le sol semblait couvert d'un épais tapis de verdure odoriférante. Le capitaine ayant fait carguer les voiles, tous les marchands descendirent du bâtiment, se répandirent sur cette prairie et se mirent à boire, à manger, à se reposer. Tout a coup l'île éprouve un tremblement et est agitée. Un crieur proclame : « Voyageurs, garde à vous, vite au vaisseau, sinon vous êtes tous perdus. Hâtez-vous, cherchez votre sûreté; l'île sur laquelle vous vous trouvez est un poisson. » Tout le monde courut vers le bâtiment; les uns se jetèrent à la nage et y arrivèrent, le reste se noya. » (Trad. de Langlés, addit. à la Grammaire arabe de Savary.)
Bougainville plaisante l'erreur inverse d'un matelot de la Boudeuse, qui, en novembre 1767, prit une pointe de terre pour un souffleur.
[50] Zéila est encore aujourd'hui un port de la côte d'Adèle en dehors du détroit de Bab-el-Mandeb. Voici ce qu'en disait Aboulféda au xive siècle : « Zéila est une des villes célèbres de l’Habach (Abyssinie), située au fond d'une baie, dans une plaine. La chaleur y est extrême... On n'y connaît ni jardins ni fruits... On y pêche des perles. » (Page 161 du texte arabe.)
[51] Les nesnâs ou nisânis sont des êtres mythologiques assez voisins de l'homme, à l'existence desquels croyaient fermement les Orientaux. On peut les comparer aux satyres des Grecs et des Romains. Massoudi a écrit quelques pages sur ces monstres à face humaine. Voici une anecdote qu’il rapporte à leur sujet : Des gens sont à la chasse des nesnas. Ils en rencontrent un et l'égorgent. D'autres étaient cachés, que personne ne voyait. Mais un d'eux voyant son camarade mort s'écrie : « Dieu soit béni ! comme son sang est rouge ! » Il est égorgé à son tour. Un troisième, caché dans le feuillage d’un arbre, dit : « Il mangeait une baie de sumac. » Les chasseurs s'en emparent et le tuent, en disant : « S'il avait gardé le silence, on n'aurait pas su le dénicher. » — « Moi je ne parlerai pas », dit un autre nesnas . du haut de son arbre. — « Encore un y disent les chasseurs, prenons-le. » Et il fut pris. Un cinquième nesnas murmura : « Ma langue, prends garde à toi ! » Nouvelle victime. (Voy. les Prairies d'or, tome IV, p. 14.) C'est le cas d'appliquer le proverbe oriental : « La parole est d'argent, mais le silence est d'or. » Le zhaloum est évidemment un phoque.
[52] Ayla est l’Elana des anciens, l’Elath de la Bible, aujourd'hui Araba, au fond du golfe de même nom, autrefois golfe Elanitique, dans la mer Rouge. C'était, dit Aboulféda, la ville habitée par les Juifs que Dieu changea en singes et en porcs. (Coran, chap. II, vers. 61.) Voy. Géogr. d'Aboulféda, publiée par MM. Reinaud et de Slane, p. 86 du texte arabe.
[53] Le phénomène bien connu de la phosphorescence de la mer est dû à la présence, à la partie supérieure de l'eau, de certains infusoires qui couvrent parfois des étendues extrêmement considérables. On l’a observé dans toutes les régions du globe, mais plus particulièrement dans les parages de la mer des Indes, où il acquiert une intensité vraiment extraordinaire.
[54] Massoudi signale la présence d'un monstre marin appelé tennin (au pluriel tenânin) dans la mer des Barbares ou mer Caspienne. Il ne donne aucun détail sur la forme ni les mœurs de cet animal, ni sur ses qualités malfaisantes. (Voy. les Prairies d’or, tome I, p. 263.) Mais un peu plus loin (p. 266), il ajoute : « Les uns pensent que le tennin est un vent noir qui se forme au fond des eaux, monte vers les couches supérieures de l'atmosphère et s'attache aux nuages... de sorte qu'en voyant ce nuage accompagné d'obscurité et de tempêtes, on a cru que c'était un serpent noir sorti de la mer. D'autres pensent que le tennin est un reptile qui vit dans les profondeurs de l'Océan, devenu fort, il fait la guerre aux poissons, et alors Dieu lui envoie les nuages et les anges, qui le font sortir de l'abîme sous la forme d'un serpent noir, brillant et luisant, dont la queue renverse sur son passage les édifices les plus solides, les arbres, même les montagnes, et dont le souffle seul déracine une foule de troncs vigoureux... Les Persans, bien loin de nier l'existence du tennin, disent qu'il a sept têtes, et l'appellent adjdouhân. Ils y font souvent allusion dans leurs récits. Dieu seul sait la vérité dans tout cela. » (Trad. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille.) « Plusieurs personnes, dit encore le même auteur, m'ont assuré avoir vu courir dans l'air, rapides comme l’éclair, des serpents blancs qui souvent se précipitaient sur la terre et y exterminaient les animaux. Il n'est pas rare non plus d’entendre dans le silence de la nuit un bruit semblable au frôlement d’une étoffe neuve et qui provient du vol de ces serpents à travers les airs ; les gens simples et ignorants l'attribuent aux sorcières qui traversent l'espace avec des ailes de roseau. (Ibid., tome II, p. 31.) Visiblement le tannin ou tennin n'est qu'une personnification du cyclone ou de la trombe marine.
[55] Il faut probablement lire Senf (ou Sinf) au lieu de Daïf qui, dans récriture arabe, n'en diffère que par quelques points facilement déplacés on négligés dans les manuscrits. Pour le Senf, voy. note 62.
[56] Cette histoire rappelle celle du cimetière des éléphants dans les Mille et une Nuits (septième voyage de Sindbad).
Quant aux serpents mangeurs d'éléphants , il en est question dans maint ouvrage arabe des plus sérieux. « Dans les montagnes du Zendj (Zabedj ?), dit Ibn-Khordadbeh, il y a d’énormes serpents qui dévorent les hommes et les buffles ; on en trouve oui dévorent des éléphants. » (Le Livre des routes, trad. Barbier de Meynard, Journ. asiat., 1865, I, p. 287). Cet ouvrage a été écrit vers le milieu du ixe siècle de notre ère.
Au sujet des serpents, je citerai un passage qu'Aboulféda emprunte à une relation plus ancienne. Un navire ayant fait naufrage sur la côte africaine de l'Atlantique, les marins se sauvèrent sur la chaloupe. Comme ils approchaient d'une montagne luisante (le cap Blanc), des indigènes les invitèrent à s'en tenir écartés ; un peu plus tard, s'informant du motif de cette recommandation, ils apprirent que « toute cette montagne est une masse de serpents meurtriers; l'étranger prend cette masse pour une roche aux couleurs luisantes; séduit par son éclat, il s'en approche, et il est dévoré par les serpents. » (Voy. la trad. de M. Reinaud, p. 21 5, 316.)
[57] Sahari ou plutôt Sahar ou Sohar avait été la capitale du pays d'Oman. Au temps d'Aboulféda, c'est-à-dire au commencement du xive siècle, cette ville était déjà en ruines. Oman seule était en prospérité. (Voy. p. 98 du texte arabe.) La ville d'Oman, dit M. Reinaud, paraît désigner Mascate, qui est citée par le géographe d’Edrici sous son véritable nom. (Ibid. trad., p. 136, note.) Cf. aussi ce passage de la relation de Soleïman : « Nous nous rendîmes au lieu nommé Sahar d'Oman ; ensuite nous nous approvisionnâmes d'eau douce à Mascate, à un puits qui se trouve là. » (Edit. Charton, p. 105.)
[58] La côte de Sofâla paraît être le point extrême de l’Afrique australe visité par les navigateurs arabes. On la nomme Sofâla des Zindjs pour la distinguer d'une autre Sofâla ou Soufâra (c'est-à-dire Soubâra), port de relâche dans la mer des Indes, dit Aboulféda (p. 359 du texte arabe), lieu où l’on pêche les perles, à cinq journées de marche de Sendân. En arabe, Sofâla , comme le fait remarquer d'Herbelot (Bibl. orient., p. 815), signifie un lieu bas et creux. D'après Massoudi (Les Prairies d’or, I, 332), c'est un bas-fond, une colline sous-marine, cause fréquente de la perte des navires. Voici le passage du géographe arabe, cité plus haut, sur Sofala des Zindjs, d’après la traduction de M. Reinaud (I, 222) : « La situation de Sofala est dans le pays des Zendjs. Suivant l'auteur du Canoun, les hommes qui l'habitent sont musulmans. Ibn Sayd dit que leurs principaux moyens d'existence reposent sur l'extraction de l'or et du fer et que leurs vêtements sont en peau de léopard. Au rapport de Massoudi, les chevaux ne se perpétuent pas dans le pays des Zendjs, de sorte que les guerriers marchent tous à pied ou combattent sur des œufs. »
[59] « Je vous donne l’aman », c'est-à-dire « je vous fais grâce, je vous assure ma protection ».
[60] L’ihram est l'ensemble des cérémonies du pèlerinage.
[61] Assouan ou Ossouan (suivant la prononciation indiquée par Ibn-Khallikan) est la Syène des Grecs, Souan des Egyptiens, près des cataractes du Nil.
[62] Qomâr, d'après Aboulféda, est une île des régions de la Chine, qui produit l'aloès qomari. « Le pays de Qomâr, dit Massoudi, n’est pas une île ; mais il est situé sur le bord de la mer et couvert de montagnes; peu de pays dans l'Inde ont une population plus nombreuse. » (Les Prairies d’or, tome I, p. 170.) C était une dépendance de l'empire malais du Zabedj. Son nom paraît être le même que celui du cap Comorin. Comari, dit Marco Polo, est une contrée de l'Inde pas très civilisée, mais au contraire assez sauvage. » (Edit. Charton, p. 405.) D'autre part Qomar, Qamar ou Qpmr s'est dit des îles Comores entre le Zanguebar et Madagascar.
[63] Le Senf ou Sinf correspond aux côtes méridionales et orientales de la Cochinchme et doit être assimilé au Ciamba, Ziamba de Marco Polo, et à la Tsiampa, Champa, Siampa des cartes modernes, dans la région sud-est de la péninsule cambodgienne. (Voy. le Marco Polo de M. Charton, p. 386, note 2.)
[64] L'outre (girba) est ainsi définie par Bruce: « Une girba est une peau de bœuf coupée carrément, et dont on fait une outre bien cousue par une double couture, presque semblable à la couture des ballons anglais, de manière qu'elle ne laisse point échapper l'eau. Il y a au haut de la girba une ouverture semblable au trou qui est au-dessus d’n baril: tout autour de ce trou, le cuir est plissé et prolongé d'environ quatre travers de doigt, et quand la girba est pleine, on noue bien fort ce cuir avec de la ficelle. Ces girbas contiennent environ deux cent quarante pintes chacune, et deux girbas font la charge d'un chameau. » (Voyage en Nubie et en Abyssinie, édit. Panckouke, tome IV, p. 384.) Cette mesure est un peu forte pour les tuyaux de plume de notre conteur, qui, malgré sa tendance à l'exagération, a sans doute en vue des outres de dimensions beaucoup inférieures.
[65] Chiraz est une ville de Perse bien connue, nia donné le jour a deux poètes illustres, Saadi et Hafiz, au xiiie siècle de notre ère, le géographe arabe Yaqout en fait une description peu flatteuse, d’après un écrivain antérieur (Dict. géog. de la Perse, par Barbier de Meynard) : « Ses rues, dit-il, sont étroites et ses fenêtres trop rapprochées du sol; elle est aussi sale qu'elle est étroite et resserrée. La licence et le désordre y règnent sans cesse ; les docteurs et les gens de lettres n'y jouissent d'aucune considération... La violence et l'injustice pèsent sur le peuple; le sang y coule sans cesse ; la concussion et la corruption la plus effrénée existent dans toutes les classes. Les immondices qui couvrent ses rues ne laissent pas les hommes les plus purs et les plus pieux exempts de souillure, et on est suffoqué par les miasmes pestilentiels qui se répandent partout. Les habitants sont inexcusables de ne pas creuser des fosses et des égouts, de ne pas nettoyer leurs rues et les toits de leurs maisons, car l'air de la contrée est pur, l'eau est douce et le sol très fertile. Les canaux s'y croisent en tous sens ; mais la négligence du peuple les laisse se remplir d'ordures. »
[66] Les musulmans ne peuvent manger la chair d'un animal qui n'a pas été saigné. C'est ce qui explique pourquoi on égorge l'oiseau après l'avoir assommé. De même, dans le récit LII, des naufragés se font, à défaut d'autres instruments tranchants, des couteaux de pierre pour saigner l'oiseau qu'ils ont abattu. Toute bête terrestre qui n'a pas été saignée est une « charogne » dont il est expressément interdit de se nourrir.
Le rotl correspond à la livre. C'est de ce mot arabe que vient le portugais arratel.
Le ouakîl est le curateur, l'intendant, le mandataire du gouverneur (sâhib).
[67] Cette fable de fourmis féroces, grosses comme des chats, est bien ancienne. Hérodote parlant des Indiens du Nord, dit qu'il y a, aux environs de leurs pays, des endroits que le sable rend inhabitables : « On trouve dans ces déserts et parmi ces sables des fourmis plus petites qu'un chien, mais plus grandes qu'un renard. On en peut juger par celles qui se voient dans la ménagerie du roi de Perse, et qui viennent de ce pays où elles ont été prises à a chasse. Ces fourmis ont la forme de celles qu'on voit en Grèce; elles se pratiquent sous terre un logement. Pour le faire, elles poussent en haut la terre de la même manière que nos fourmis ordinaires, et le sable qu'elles élèvent est rempli d'or. On envoie les Indiens ramasser ce sable dans les déserts. »
L'auteur de la chronique malaise intitulée Chedjarat Malayou rapporte une anecdote où la comparaison de notre écrivain arabe est reproduite : « Un jour, Marah Silou alla chasser (dans l'île de Sumatra). Son chien, nommé Si-Pasey, se mit à aboyer, et Marah Silou vit que Si-Pasey aboyait sur un monticule où était une fourmi grosse comme un chat. Marah Silou prit la fourmi et la mangea. » (Texte malais publié par M. Dulaurier, p. 108.)
Massoudi, qui en fait de monstres n'est pas très crédule, ne cite « les fourmis grosses comme des loups ou des chiens» que pour dire qu'il n'en parlera pas. (Voy. Les Prairies d'or, IV, 02.)
L'origine probable de ces fables est due sans doute à l'existence d un insecte de mœurs très analogues à celles de la fourmi, le termes bellicosus, dont la femelle atteint parfois un décimètre et demi de longueur. On peut voir ce que j'ai dit à ce sujet dans le Journal de la Jeunesse (ann. 1874., II, p. 155 et suiv.); mais, dans le passage d'Hérodote, il s'agit assurément d'un animal tout autre que le termite ou la fourmi. S'il avait voulu parler d'un insecte, l'auteur grec ne l'eût point comparé au chien et au renard.
[68] Qâqala est un port de l'île de Java, si du moins on doit, comme je le pense, l'assimiler à la ville mentionnée sous ce nom par Ibn-Batouta, qui y séjourna au milieu du xive siècle. MM. Defrémery et Sanguinetti prononcent Kakoulah. (Voyag. d'Ibn-Batouta, IV, 240, 242 et suiv.)
[69] « Le nombre prodigieux de singes qu'on voit à la Côte-d'Or et en Guinée y rend aussi les voyages fort dangereux par terre. Ils attaquent un passant quand ils le voient seul, et le forcent à se réfugier dans l'eau qu'ils craignent beaucoup. » (Voyage de Dampier, dans la collect. de F. B., tome IV, p. 168, note.)
Al-Biruni, l'écrivain arabe qui a le mieux connu et décrit la presqu’île indienne, dit que sur le continent en face de Sérendib, à seize parasanges de la côte, est une chaîne de montagnes appelée Montagnes des Singes. « Chaque jour, dit-il, le roi des singes sort avec quelques bandes de ses sujets. Les singes ont des lieux de rendez-vous. Les habitants ont soin de préparer pour eux du riz bouilli qu'ils apportent sur des feuilles d'arbre. Quand les singes ont mangé, ils s'en retournent dans leurs bois. Si on négligeait de leur préparer à manger, cette négligence serait la ruine du pays, tant ils sont nombreux et méchants. Les habitants croient que ces singes formaient jadis un peuple d'hommes, à présent métamorphosés, et qu'ils prêtèrent un secours actif à Rama, dans la guerre contre les démons. « (Voy. Reinaud, Fragments relatifs à l'Inde, p. 122.)
[70] Pour la date 390 qui figure dans l'anecdote XXXIX, et qui est certainement fautive, voyez ce que nous avons dit dans la Préface.
[71] Le zâm ou zâma (pluriel azouâm) correspond, comme mesure de temps, à la 8e partie du jour de 24 heures, c'est-à-dire à un intervalle de 3 heures. C'est aussi une division du cercle, employée par les navigateurs dans la mesure de la hauteur du pôle. Il est alors un 8e de l’Isba' ou doigt, qui, d'après la note de M. Maury, insérée dans l’Introduction à la Géographie d'Aboulféda, par M. Reinaud, peut être évalué à 1 degré 36 minutes, ce qui donne au zâm une valeur de 12 minutes de cercle.
[72] Kalah ou Kala. d'après Walckenaer, était située dans la presqu'île de Malaka, vis-à-vis l'île de Sumatra. Ibn Khordadbeh nous apprend que, de son temps (ixe siècle de notre ère), le commerce tirait de Kalah le plomb, dit el-qâ’li, c’est-à-dire l’étain, qui est encore une des productions de la presqu'île. Abou-Zeïd fournit la même indication. Aboulféda dit que « dans l’île (ou presqu'île) de Kala est une ville habitée par des Musulmans, des Indiens et des Persans; elle contient des mines de plomb (étain), le bambou et l'arbre à camphre ». (P. 375 du texte arabe.)
[73] Les naturalistes modernes ne sont pas tous convaincus de l'impossibilité d'un croisement fécond entre l'homme et certaines espèces de singe. Car, dans le Dictionnaire d'Histoire naturelle de Déterville, publié en 1819, on lit les passages suivants, signés par Virey: « Si l’on suppose que la grossesse des femelles des orangs-outangs jusqu'à six ou sept mois, comme on le rapporte de celle des gibbons, il serait peut-être possible d'obtenir des individus métis ou hommes-singes, surtout en choisissant les races humaines les plus analogues aux orangs-outangs. De tels métis seraient bien curieux sans doute, et l'étude de leur intelligence ferait faire de grandes découvertes en métaphysique et dans la science de l’homme. » (Tome XXXI, p. 268.) « Qui sait jusqu'à quel point nous nous rapprochons, par les facultés corporelles, de la nature des singes ? Combien de négresses surprises par une troupe lubrique de satyres, dans les forêts d Afrique, ont pu engendrer des monstres ? Combien même de femelles de singes, Messalines sauvages, se sont volontairement prostituées à l’ardeur des Africains ? On ignore tout ce qui se passe en amour dans ces vieilles forêts, où la chaleur du climat, la vie brute des habitants, la solitude et les délires des passions, sans lois, sans religion, sans mœurs, peuvent faire tout oser; et ces êtres dégradés, ces monstres mi-partie hommes et singes, confinés dans quelque désert ignoré, dérobés à la société humaine par la honte ou bien immolés par la crainte du déshonneur, nous demeureront longtemps inconnus. » (Ibid., p. 265.)
On sait que certaines espèces de singes recherchent les femmes avec autant d'ardeur que leurs propres femelles. « Des gens dignes de foi, dit Ibn-Batouta, m'ont rapporté gue, quand un de ces singes (de Ceylan) s'est emparé d'une jeune fille, celle-ci ne peut se dérober à sa lubricité. Un habitant de l'île m'a raconté qu'il y avait chez lui un singe, aucune de ses filles entra dans une chambre et que l'animal l’y suivit. Elle cria contre lui, mais il lui fit violence. Nous accourûmes près d'elle, continuait ce personnage, nous vîmes le singe qui la tenait embrassée, et nous le tuâmes. » (IV, p. 177.)
[74] Nous pourrions relever chez les écrivains orientaux bien des détails curieux sur des faits de bestialité. On pensera ce qu'on voudra du récit suivant, emprunté à un ouvrage persan du xie siècle qui est lui-même une traduction du sanscrit :
« Pan, fils de Four (Porus) roi des rois de l'Inde, était un grand ami de la chasse; toute la nuit, il marchait pour chercher le gibier. Or, une troupe de brahmanes et d'anachorètes avaient établi leur demeure sur une montagne; parmi eux était un anachorète qui, par sa sainteté, avait acquis la faveur de voir tous ses vœux exaucés. Un jour cet anachorète vit deux gazelles s'accoupler; la concupiscence s'empara de lui. mais il réfléchit que si sa passion se révélait au dehors, il serait déshonoré. En conséquence, il adressa au Dieu Très-Haut une prière pour obtenir d'être métamorphosé momentanément en gazelle, et de pouvoir trouver une compagne, après quoi il redeviendrait nomme sans que son secret eût été dévoilé. Ce qu'il avait demandé eut lieu. L'anachorète devint gazelle : et, ayant trouvé une compagne, il se retira pendant la nuit avec elle, et ils eurent commerce ensemble.
« Par hasard. Pan arriva au moment même dans cet endroit. Au bruit que faisait ce couple, il tira une flèche au milieu de l'obscurité; et, comme en ce moment l’anachorète était accroupi, le trait l'atteignit au ventre. L'anachorète tomba, et. reprenant sa figure, il se roula tout ensanglanté. En même temps, il proféra ce vœu : « O mon Dieu ! puisqu'un homme m'a ainsi empêché de satisfaire ma passion, la première fois que la passion s'emparera de lui, fais-le mourir aussi ! » Pan s'approcha dans le même instant. A ce spectacle, il fut tout surpris et adressa quelques questions à l'anachorète. Celui-ci, qui respirait à peine, lui raconta son aventure. Pan reprit : « J'ignorais cela. » Et il demanda pardon. « Je te pardonne, dit l'anachorète, mais voilà le « vœu que j'ai proféré. Disant ces mots, il expira. »
Si le lecteur est curieux de connaître l'effet du vœu de l'homme-gazelle, à la piété de qui Dieu ne savait rien refuser, voici en abrégé la conclusion du pieux récit. Pan est couché; deux de ses femmes le veillent, Madri et Counti. Counti éprouve des désirs ; Pan ne résiste pas. « Mais au moment ou son amour était excité et où il allait se satisfaire, il rendit l'âme. » (Fragm. relat. à l'Inde, p. 32 du tirage à part.)
[75] Le mithcal ou mescal correspond à l'once.
[76] Massoudi parlant des singes fait la réflexion suivante : « Il n'y a pas au monde d'espèce de singes plus intelligente, mais en même temps plus malicieuse que celle des singes du Yémen. » (Les Prairies d’or, II, 51.)
[77] Matyâl. J'ignore la signification exacte de ce mot qui ne se trouve point dans les dictionnaires arabes, persans, malais, ni hindoustanis. Il semble désigner ici une petite embarcation.
[78] Sandal-Foulat est le lieu nommé Sender Foulat dans la relation du marchand Soleïman : « Sender Foulat, dit-il, est le nom d'une île; il s'y trouve de l'eau douce. De là les navires entrent dans la mer appelée Sandjiy puis ils franchissent les portes de la Chine. » (Les Deux Mahom., p. 106.) M. Amaury place Sender-Foulat sur la côte de Cochinchine, vers le cap Varela, à Ong-Ro, au sud de ce cap.
On sait que dans les langues de cette région maritime le mot poulaw, poulo signifie île. Sandal-Foulat, à mon sens, signifierait « l’île du Sandal ou Santal ». Les Arabes n'ayant pas de p remplacent cette lettre soit par un b, soit par un f.
[79] Khanfou, située vers l'embouchure du Kiang, joue un grand rôle, au commencement du moyen âge, dans les relations commerciales entre les musulmans et la Chine. Elle servait de port à une ville très considérable, Hang-tcheou-fou, située sur le même fleuve à quelques journées de marche dans l’intérieur des terres. Les étrangers devaient s'y trouver en très f’rand nombre dès le IXe siècle de notre ère, s'il est vrai, comme le rapporte Abou-Zeïd-Haçan, que, lors d'une guerre civile qui éclata en l’année 264 de l'hégire (878 de notre ère), cent vingt mille musulmans, juifs, chrétiens et mages forent massacrés dans cette ville où ils s'étaient établis. Quatre siècles plus tard, Marco Polo, qui parlait de visu, cite la ville maritime de Ganfu comme possédant « un très bon port où arrivent de grandissimes navires et une foule de marchandises de l'Inde et des autres pays ». (Edit. Charton, p. 373.)
Khamdan ou Khomdan était au ixe siècle la capitale de l'empire chinois. Tchan-ngan, sur le Ouéi, affluent du fleuve Jaune, plus tard nommée Singanfou. (Relation d'Abou-Zeïd-Haçan, édit. Charton, p. 121.)
[80] Kamran ou Kamerân est une île de la mer Rouge, peu éloignée de la côte du Yémen. « Cette île est habitée, dit la géographie d'Aboulféda, et elle avoisine le port de Zébîd. » (Page 155 du texte arabe, édit. Reinaud et de Slane.)
[81] Aden, sur la côte arabe, à l'entrée de la mer Rouge, n'a cessé d'être depuis bien des siècles un port important pour les relations commerciales entre le bassin méditerranéen. l'Afrique équatoriale et australe, la Perse, l'Inde et la Chine.
[82] Ghalafqa, Galefca ou Ghelafeca était le port de Zébid, dans le Yémen. Il a été comblé par les sables. Voy. Aboulféda, p. 89 et 155.)
[83] Je conjecture, puisqu'il s'agit ici, d'un voyageur aux « pays du poivre » que Bârnân (ou Bârnâi) est Bornéo. Quelques anciens géographes appellent cette grande île Brunaï, et l'une des principales villes porte encore le nom de Varouni.
[84] Koulam ou Koulam-méli a été longtemps un des ports les plus importants du sud de la presqu'île indienne. Ibn-Batouta, qui traversait cette région vers le milieu du xive siècle, dit qu'il faut dix jours de marche pour aller de Calicut à Koulam, qui est une des plus belles villes du Malabar, dont les marchés sont magnifiques et les négociants très riches. « C'est la ville du Malabar la plus rapprochée de la Chine, et là se rendent la plupart des trafiquants de ce pays. » (Edit. Defrémery, tome IV, p. 100).
[85] Le dâneq, en persan dank, est la sixième du dirhem, soit environ 12 centimes de notre monnaie.
[86] Samarra ou Sara-man-râ ou Sorr-man-ra, ainsi nommée, dit-on, par les premiers califes abbassides qui l'habitèrent, de trois mots arabes signifiant « joie de qui la voit. » (Voy. Massoudi, les Prairies d’or, tome III, p. 141), est une localité peu éloignée de Bagdad.
Le calife Motamed Billah, dont il est ici question, régna de 870 à 892.
[87] Reinaud. dans son Mémoire sur l'Inde, rapporte un fait qui a trait à cette coutume. Au commencement au viiie siècle, une armée musulmane s'avança le long de la mer vers l’embouchure de l’Indus, sous les ordres de Mohammed, fils de Cassem. Ce général fut partout victorieux. « Telle fut l'impression que Mohammed et quelques-uns de ses compagnons firent sur les indigènes, qu'on voulut avoir leur représentation dans la contrée : ce qui s'exécuta probablement au moyen de sculptures sur le rocher, telles que celles qu'on voit à Bamyam et ailleurs. » (P. 187.)