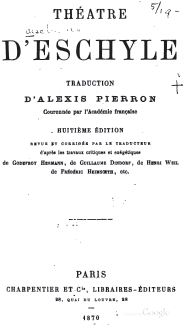
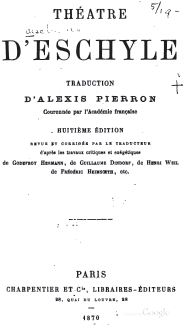
THÉÂTRE
D'ESCHYLE
TRADUCTION
D'ALEXIS PIERRON
Couronnée par l'Académie française
. HUITIÈME ÉDITION
REVUE ET CORRIGÉE PAR LE TRADUCTEUR
d'après les travaux critiques et exégétiques
de GODEPROY HERMANN, de GUILLAUME DINDORF, de HENRI WEIL de FREDERIC HEIMSOETH, etc.
-------------------------
PARIS
CHARPENTIER ET Cie, LIBRAIRES-ÉDITEURS
28, QUAI DU LOUVRE, 28
1870
A MONSIEUR MILFAUT
inspecteur honoraire de l'Université
C'est vous qui m'avez donné, il y a trente ans, l'idée de traduire Eschyle, et c'est à vous qu'à été dédiée, en 1841, cette copie de l'antique. Je renouvelle aujourd'hui la dédicace, et avec les mêmes sentiments que jadis, c'est-à-dire une parfaite estime pour le sage et une profonde affection pour l'homme de cœur et l'ami.
A. PIERRON
1er novembre 1869
AVANT-PROPOS DE LA HUITIÈME ÉDITION.
La traduction d'Eschyle, dont on publie aujourd'hui la huitième édition, a paru pour la première fois dans le courant de l'année 1844. En 1842, l'Académie française, sur la proposition spontanée de Victor Cousin, examina cet ouvrage, que je n'avais pas même songé à présenter au concours, et elle l'honora d'un de ses prix. Dès 1845, la première édition, bien que tirée à très grand nombre, était déjà épuisée.. On a donc imprimé de nouveau. En 1849, on a imprimé une troisième fois. Mais ces trois éditions ne différaient entre elles que par des détails typographiques. La quatrième, celle de 1854, était bien réellement, comme l'indiquait son titre, une édition revue, corrigée, augmentée. Les additions étaient considérables. J'avais mis, au bas des pages, un commentaire assez étendu, où les principales difficultés du texte étaient discutées, sinon toujours résolues. J'avais remanié et complété les arguments des pièces. J'avais transformé le morceau littéraire qui était en tête de la traduction ; j'en avais agrandi le cadre ; j'y avais fait entrer en substance des chapitres entiers de mon Histoire de la Littérature grecque : c'était dès lors une véritable Introduction au théâtre d'Eschyle. Quant à la révision et à la correction proprement dites, celles de la traduction, j'avais repassé lentement, péniblement, sur mes premières traces. De même que dix ans auparavant, je n'avais négligé l'aide d'aucun livre à moi connu. Tout ce qu'on avait publié, de 1844 à 1854, sur le texte d'Eschyle, je l'avais mis à contribution : recensions nouvelles, commentaires nouveaux, dissertations philologiques, éludes historiques et littéraires, etc,
iv Je n'ai point eu à me repentir du long et consciencieux effort par lequel je m'étais satisfait moi-même en mettant mon ouvrage, comme on dit, au niveau des progrès de la science. La quatrième édition a dû être suivie d'une cinquième, puis d'une sixième, puis d'une septième; et on en demande aujourd'hui une autre encore, qui, selon toute vraisemblance, ne sera pas la dernière. J'aurais pu laisser les choses en l'état, et reproduire, comme en 1858, 1864 et 1865, sauf d'insignifiantes corrections, la minute de 1854. Mais j'ai cru que le temps était venu de faire, sur cette minute, le même travail que j'avais fait, en 1854, sur la minute primitive. Une traduction n'est jamais qu'un essai et une ébauche. Elle approche plus ou moins d'une sorte de perfection, elle n'est jamais parfaite, elle ne peut pas l'être. Il n'y a point de traduction définitive. C'est donc un devoir pour le traducteur, tant qu'il est vivant et voyant, comme on dit à l'antique, de revenir sur sa copie et de faire profiter le lecteur de toutes les améliorations qu'un certain laps d'années a rendues nécessaires, ou seulement désirables.
On a publié depuis 1854, sur le texte d'Eschyle, des travaux de premier ordre, et même supérieurs, selon moi, à tout ce qui avait jamais été fait en ce genre durant trois siècles. Je suis sûr que ce jugement ne sera contredit par aucun des hellénistes qui ont en main, par exemple, l'édition posthume de Godefroi Hermann (1852), la cinquième édition de Guillaume Dindorf (1865), l'édition de Henri Weil (1858-1867) et les trois ouvrages allemands de Frédéric Heimsœth : Restauration des pièces d Eschyle (1864); Tradition indirecte du texte d'Eschyle (1862); Études critiques sur les tragiques grecs (1865). On trouvera à chaque instant, dans mes notes, le témoignage de ce que je dois à ces éminents philologues. J'ai fait des changements en grand nombre, comme je le devais; mais on me rendra cette justice que je n'ai rien touché que là où les maîtres de la critique avaient fait l'évidence. J'ai rejeté bien souvent leurs leçons ou leurs interprétations, soit pour adopter celles de contemporains moins renommés, soit pour maintenir celles des vieux éditeurs et des vieux exégètes, mes aides d'autrefois. J'espère, en tous cas, que les curieux qui auraient la fantaisie de comparer cette édition avec celle de 1854 et les suivantes, reconnaîtront que la traduction n'a pas médiocrement gagné à être revissée, d'un bout à l'autre, sur les documents fournis par G. Hermann et ses dignes émules. J'ajoute que le commentaire v a été considérablement augmenté, et que l'Introduction a été enrichie de deux chapitres, les deux derniers.
Eschyle est un auteur qu'on n'explique point dans les lycées de France, et qui même ne figure pas toujours sur le programme de notre licence ès lettres. Une traduction française d'Eschyle n'a donc pas de public spécial ; elle ne s'adresse qu'au monde habituel des lecteurs cultivés. J'étais bien convaincu, quand j'imprimais pour la première fois la mienne, qu'elle n'irait pas à la deuxième, ni surtout à la troisième édition; et voilà que sept éditions, c'est-à-dire plus de vingt mille exemplaires, n'ont pas épuisé son succès. Cette obstination des lettrés en sa faveur s'explique peut-être par ce mot de Cousin à la commission des prix de l'Académie, le jour où il lui proposa d'admettre mon travail à l'examen : Aeschyleum sapit. C'est la saveur eschyléenne qui aura plu. C'est elle qui a fait à la traduction cette fortune extraordinaire dont je n'ai pas été le dernier à m'ébahir.
A. PlERRON.
Paris, le 1er novembre 1869.
--------------------
CHAPITRE PREMIER.
VIE D'ESCHYLE.
Patrie d'Eschyle. — Sa famille. — Eschyle soldat. — Date de sa naissance. — Ses succès au théâtre. — Son départ pour la Sicile. — Motifs allégués par les anciens. — Conjectures sur le même sujet. — Eschyle et Hiéron. — Mort d'Eschyle.
« Ô Cérès, toi qui as nourri mon âme, fais que je sois digne de tes mystères! » C'est par cette invocation pieuse que débute Eschyle, dans les Grenouilles d'Aristophane, lorsqu'il s'apprête à répondre aux insolentes attaques d'Euripide, et à défendre sa royauté tragique menacée. Ces simples paroles, et à cette place, disent admirablement et le caractère religieux du poète, et l'éducation qu'il avait reçue des siens, et même le lieu de sa naissance.
Eschyle était d'Éleusis en Attique. Il est vrai que lui-même, dans son épitaphe, que nous a conservée un biographe anonyme, il s'est donné le titre d'Athénien, et qu'il est quelquefois nommé ainsi par les anciens auteurs. Mais Éleusis était un de ces dêmes ou bourgs, comme nous transcrivons le mot grec, dont se composait le peuple athénien : l'Attique tout entière était athénienne, et non point seulement la ville d'Athènes.
Je lis quelque part qu'Eschyle était originaire d'Athènes. Il n'y a là qu'une interprétation erronée de ce que dit le biographe anonyme : « Eschyle le tragique était Athénien de nation (01). »
vii Corsini fait naître le poète à Décélie (02), alléguant, à l'appui de son opinion, deux passages de Plutarque, où Amynias, frère d'Eschyle, est appelé Décélien. Mais, quand même Amynias serait né à Décélie, il ne s'ensuivrait pas qu'Eschyle ne fût point né à Éleusis. Et rien ne saurait, sur une pareille question, ébranler l'autorité du témoignage unanime des anciens.
Le père d'Eschyle se nommait Euphorion, et non point Sophile, comme l'a cru sans raison Corsini (03) : Sophile était la père de Sophocle. Il y a eu confusion de noms dans la mémoire du rédacteur des Fastes attiques.
Cynégire et Amynias, les deux frères d'Eschyle, ont laissé dans l'histoire une trace qui ne périra pas. Hérodote raconte (04) qu'à Marathon, comme les Perses se jetaient précipitamment sur leur flotte, Cynégire, entraîné par son ardeur, saisit la poupe d'un des navires pour l'arrêter, qu'il eut le bras coupé, et qu'il fut achevé par les ennemis. Cynégire, selon Justin (5), eut les deux bras coupés l'un après l'autre; et, saisissant avec ses dents la poupe du vaisseau, il ne lâcha prise que lorsque, d'un coup de bâche, un soldat perse lui eut tranché la tête. C'était assez, pour la gloire de Cynégire, que sa valeur eût été. distinguée dans un combat où tout fut héroïque, et qu'il eût donné sa vie à son pays : le simple récit d'Hérodote n'avait pas besoin des ornements dont l'a gâté un historien rhéteur.
C'est à Salamine et à Platées qu'on trouve Amynias (6) le plus jeune des trois frères (7). A Salamine, il remporta le prix de la valeur entre tous les Athéniens, comme la ville d'Égine entre toutes les villes de la Grèce (8).
Pour Eschyle, il combattit et à Marathon, et à Salamine, et à Platées : là, digne frère de Cynégire; ici, d'Amynias. A Marathon, il fut blessé; et lui-même, avec une fierté naïve et sublime, il a rendu témoignage à l'héroïsme qu'il avait déployé dans cette grande journée. Car elle est de lui, cette épitaphe viii qu'on lisait en Sicile sur son tombeau : « Ce monument couvre Eschyle, fils d'Euphorion. Né Athénien, il mourut dans les fécondes plaines de Géla. Le bois tant renommé de Marathon et le Mède à la longue chevelure diront s'il fut brave : ils l'ont bien vu! » Ce qu'un poète eût vanté dans Eschyle avant tout, c'eût été son génie dramatique. Lui seul il a pu faire l'épitaphe du soldat, et passer le poète sous silence (9).
Je me figure que, dans les mystères de Cérès, le plus sacré parmi les articles du symbole des initiés, c'était un serment qu'ils faisaient de défendre, jusqu'à la dernière goutte de leur sang, le territoire de la patrie. Cérès, Déméter (10), comme parlaient les Grecs, c'est la Terre-Mère ; c'est la mère qui avait enfanté, d'après une antique tradition, les premiers habitants de l'Attique. Aux yeux des Eupatrides, ces autochtones, ces fils des fiis de la Terre, verser son sang pour le pays, c'était, dans toute la force du terme, accomplir un devoir filial ; et Eschyle et ses frères étaient des Eupatrides. Les premières leçons de la famille avaient dû être pour eux des leçons de patriotisme; et les premières leçons de la religion avaient fait germer ces heureuses semences. Qu'est-ce donc, si vous ajoutez aux traditions de la race cet enseignement des mystères, si profond et si humain, et les dogmes de la philosophie pythagoricienne, forte et saine nourriture qu'Euphorion, suivant d'assurés témoignages, avait aussi offerte à l'âme de ses fils (11)?
La Chronique de Paros, ou, comme on l'appelle vulgairement, les marbres d'Arundel, fixe l'époque précise de la naissance d'Eschyle ; car elle dit en quelle année il mourut, et à quel âge. Eschyle naquit dans la dernière année de la LXIIIe olympiade, c'est-à-dire en l'an 525 avant notre ère. Ainsi se justifie une assertion de Suidas, attaquée par quelques critiques et défendue par Casaubon (12) : à la bataille de Marathon, Eschyle, d'après le calcul de Suidas, avait trente-cinq ans.
Depuis longtemps déjà, à cet âge, Eschyle était célèbre à titre de poète tragique. Il était tout jeune encore, qu'un jour, ix à ce que l'on contait (13), il s'endormit dans la campagne, comme on lui avait donné des raisins à garder. Bacchus lui apparut, et lui commanda d'écrire une tragédie. Je n'ai pas besoin de rappeler que la tragédie était, chez les Grecs, une portion du culte même de Bacchus. C'est cette innocente allégorie qui aura donné lieu à l'histoire absurde de l'ivrognerie d'Eschyle, et de son habitude de s'enivrer toujours avant d'écrire. Il est à peine croyable que des auteurs qu'on appelle graves répètent encore cette ridicule et étrange ineptie.
Quoiqu'il en soit, Eschyle, avant l'âge de trente ans, avait déjà lutté, dans le concours des tragédies, contre un poète fameux alors, mais oublié depuis, Pratinas (14); et tout semble prouver qu'il n'avait pas eu le dessous. Cette première victoire fut suivie, durant le cours de sa carrière dramatique, de douze autres victoires. Or les poètes, en ce temps-là, présentaient au concours quatre pièces, une tétralogie, comme on disait, à savoir : trois tragédies sur des sujets ou isolés et complètement divers, ou tirés de la même légende, et qui se faisaient suite les uns aux autres; enfin un drame satyrique, une de ces comédies bouffonnes où les satyres formaient le chœur, et qui était comme la petite pièce du spectacle. Il n'y a donc pas à se lamenter bien fort, ainsi que l'ont fait quelques modernes, sur l'injustice des Athéniens envers leur grand poète. Cinquante-deux pièces d'Eschyle ont été couronnées. Je ne puis pas croire que le mot d'Eschyle, qui est dans Athénée (15), soit une récrimination contre ses concitoyens : « Je consacre mes tragédies au temps. » J'aime mieux n'y voir que l'expression sentie et profonde du juste orgueil d'un homme qui a conscience de son génie, et qui compte sur l'immortalité; quelque chose comme ce legs d'un monument à toujours, que Thucydide adresse si fièrement au monde (16).
Le biographe anonyme raconte qu'Eschyle, trois ans avant sa mort, s'expatria d'Athènes, et qu'il se retira en Sicile, auprès d'Hiéron, roi de Syracuse. Il y a ici une difficulté chronologique qui a échappé aux commentateurs, et dont je ne m'étais aperçu non plus jadis que tous mes devanciers. En l'an 459 ou 458 avant notre ère, Hiéron était mort déjà depuis x longtemps,; son successeur mêmeavait disparu, Il est certain qu'alors le poète quitta l'Attique pour la Sicile ; mais, ce qui est évident, c'est qu'Eschyle ne put y être attiré par Hiéron. D'ailleurs, il ne fixa même pas son séjour à Syracuse. Géla fut sa patrie d'adoption : c'est à Géla qu'il passa ses trois dernières années; c'est à Géla qu'il mourut et qu'on lui éleva un tombeau. Voyez plus haut son épitaphe.
Les anciens ont expliqué de diverses façons un exil plus ou moins volontaire. Le biographe anonyme dit qu'un prix avait été proposé pour une élégie en l'honneur des morts de Marathon : Eschyle fut un des concurrents., mais Simonide fut vainqueur. Le vaincu, dépité contre les Athéniens, se serait vengé d'eux en les privant et de sa personne et des œuvres que leur promettait encore «a puissante maturité. Je remarquerai seulement que Simonide est mort en l'an 469, ou, au plus tard, en 463, et que sa victoire poétique sur Eschyle est antérieure de douze ou quinze ans, et peut-être davantage, au départ d'Eschyle. Il faut avouer que le dépit littéraire de son rival aurait attendu bien longtemps avant d'éclater.
D'après une autre tradition, mentionnée aussi par le biographe, et que Plutarque a recueillie, il s'agissait d'une défaite dramatique; et le vainqueur d'Eschyle avait été le jeune Sophocle. Plutarque entre, à ce sujet, dans quelques détails (17). Cimon avait découvert, dans l'île de Scyros, les ossements de Thésée, et il les avait rapportés à Athènes. La représentation des tragédies nouvelles fit partie des fêtes de la translation. C'était la première fois que Sophocle apportait ses tragédies au concours, et il luttait contre Eschyle. L'archonte Aphepsion devait, suivant l'usage., tirer au sort les noms des juges; mais, Cimon ayant paru dans le théâtre avec les autres généraux, Aphepsion les retint, leur fit prêter le serment, les obligea de s'asseoir et de porter la sentence. Ils décidèrent en faveur de Sophocle. Remarquons que ceci dut se passer dans la quatrième année de la LXXVIIe olympiade, en l'an 469. Même difficulté, par conséquent, qu'au sujet de la victoire de Simonide; même inconcevable sommeil du dépit d'Eschyle. J'ajoute qu'en l'an 469, Eschyle, âgé de cinquante-six ans, avait fait déjà représenter bien des tragédies, et qu'il n'en était pas à son premier échec dramatique. Le poète qui s'était vu préférer plus d'une fois Phrynichus, Pratinas, Choerilus, d'autres xi encore sans doute, n'avait plus, j'imagine, la vive susceptibilité qu'on lui attribue. Le potier porté envie au potier, et le poète au poète. Le mot fameux d'Hésiode (18) est vrai particulièrement, je le sais, des vieux poètes à l'endroit des jeunes, qui le leur rendent souvent en mépris : les poètes sont, par excellence, la race irritable. Mais les vieux poètes malveillants (19) sont ceux qui ne vivent que par leurs poésies, et qui ne comptent que sur leur talent littéraire pour ne point mourir dans les siècles futurs; tandis qu'Eschyle ne voulait être que le vaillant soldat de Marathon et de Salamine, le frère d'Amytiias et de Cynégire.
Un tout autre motif, s'il faut s'en rapporter à Suidas, avait causé le départ d'Eschyle. Il avait fui d'Athènes parce que, dans la représentation d'une de ses pièces, l'amphithéâtre s'était écroulé. C'est ainsi qu'il faut entendre les paroles du lexicographe (20), nonobstant l'interprétation de Stanley (21), lequel veut qu'elles expriment une défaite dramatique, la défaite d'Eschyle par Sophocle. Le savant Auguste Bœckh (22) a montré, par Suidas lui-même, qu'il s'agit de bancs brisés, et que l'expression doit s'entendre au propre, comme dans le passage relatif à Pratinas, où Suidas la répète, et, cette fois, avec un commentaire qui ne laisse plus aucune place au doute (23). Le poète dramatique, à Athènes, était aussi le directeur de la représentation; il ordonnait tout aux frais du chorège; il jouait lui-même quelquefois un rôle dans ses pièces. Responsable des plaisirs du public, il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'on eût mis Eschyle en cause, si le fait dont parle Suidas n'est pas controuvé : Athènes a vu bien d'autres procès, et de bien plus iniques. Il aurait fui, soit pour obéir à la condamnation, soit pour s'y soustraire. Mais l'autorité de Suidas, compilateur sans critique, ne suffît pas, à elle seule, pour bien constater l'authenticité d'un fait.
Il y a une dernière tradition qui n'est pas non plus sans vraisemblance. Eschyle, d'après Élien (24), aurait été accusé d'impiété. L'helléniste anglais Musgrave pense que cette ac- xii cusation fut portée à l'occasion des Euménides (25). On cherche en vain, dans cette tragédie si profondément religieuse, les traces de l'hétérodoxie qu'y a vue Musgrave. Sophocle eut dû encourir les mêmes accusations pour l'Œdipe à Colone; et pourtant le peuple athénien a applaudi, chez Sophocle, ces impiétés prétendues, qu'il aurait, dit-on, condamnées dans Eschyle. Ajoutez que, de toutes les tragédies d'Eschyle, la plus athénienne, si j'ose ainsi parler, ce sont les Euménides : elles le sont plus que les Perses même. Dans les Perses, le poète loue ses concitoyens surtout de leur bravoure : c'est leur humanité, leur piété, leur justice, ce sont leurs institutions, qu'il vante dans les Euménides. Si Eschyle a jamais été accusé d'impiété, c'est une autre pièce, c'est toute autre cause qui a dû servir de prétexte à l'accusation.
Il est donc impossible d'établir avec quelque certitude le motif qui détermina Eschyle à quitter Athènes. Le seul point hors de doute, c'est que la vanité littéraire n'y fut pour rien. Non seulement il y avait longtemps que la victoire de Simonide et celle de Sophocle étaient oubliées, mais Eschyle avait amplement réparé ses défaites par de nombreux et magnifiques triomphes. En 459, quelques mois à peine avant son départ, il faisait jouer son chef-d'œuvre, l'Orestie, et les Athéniens lui décernaient avec acclamation le prix des tragédies nouvelles. L'enthousiasme des Siciliens pour la poésie dramatique et leur admiration pour le génie d'Eschyle suffisent peut-être à l'explication et du départ du poète, et de son séjour dans un pays où tous lui étaient sympathiques. Les habitants de Géla, suivant le biographe anonyme, le comblèrent d'honneurs. S'il m'était permis de hasarder une conjecture, je dirais qu'il fut appelé en Sicile par les habitants de Géla. Leur magnificence et leur générosité l'auraient attiré et captivé, comme l'eussent fait la magnificence et la générosité d'Hiéron même, comme la magnificence et la générosité d'Hiéron avaient jadis attiré et captivé Pindare.
Une autre conjecture, que je propose avec quelque confiance, c'est qu'Eschyle n'en était pas alors à son premier voyage en Sicile. Le biographe n'aurait donc d'autre tort que d'avoir confondu mal à propos deux époques différentes. Il dit que le poêle se rendit auprès d'Hiéron dans le temps que le roi de Syracuse fondait ou plutôt rebâtissait la ville d'Etna. xiii Ceci est parfaitement d'accord avec un fait considérable de la vie littéraire d'Eschyle. Eschyle a composé une tragédie, ou même, suivant quelques-uns, une trilogie complète, intitulée Etna ou les Femmes etnéennes. On conviendra qu'un pareil sujet ne pouvait guère avoir d'intérêt qu'en Sicile, et pour des Siciliens. Est-ce à Athènes qu'Eschyle l'a conçu? N'est-ce pas plutôt à Etna même, en face de l'œuvre d'Hiéron, et piqué d'émulation par les chants de Pindare, qui était aussi près du roi, et qui célébrait les splendeurs de la cité renaissante? Il reste peu de chose de l'Etna ; mais, autant qu'il est permis d'en juger et par ces vers et par une note de Macrobe (26), Eschyle rattachait les destinées prospères de la ville et du fondateur à la protection de certains dieux indigènes nommés Paliques, deux frères, les Dioscures de la Sicile. La nymphe Thalie, fille de Vulcain, avait cédé aux désirs de Jupiter. Pour échapper, elle et les fruits qu'elle portait dans son sein, à la jalousie et à la vengeance de Junon, elle souhaita que la terre s'entr'ouvrlt et la tint cachée jusqu'au jour où finirait sa grossesse. Son vœu fut exaucé. Au jour fixé, les enfants sortirent de la terre. Ils parurent à la lumière, ou, comme dit Eschyle, ils y revinrent. De là le nom des deux frères (27). Écoutons le poète :
PREMIER PERSONNAGE.
« Quel nom les mortels vont-ils donc leur donner ?
DEUXIÈME PERSONNAGE.
Jupiter veut qu'on les appelle les Paliques vénérables.
PREMIER PERSONNAGE.
Ce nom de Paliques leur convient en effet.
DEUXIÈME PERSONNAGE.
Oui : ils reviennent des ténèbres à la lumière du jour. »
Le récit qu'on a fait de la mort d'Eschyle est connu de tout le monde, grâce aux vers de La Fontaine sur la destinée (28) :
Même précaution nuisit au poète Eschyle.
Quelque devin le menaça,
dit-on,
De la chute d'une maison.
Aussitôt il quitta la ville,
xiv Mit son lit en plein champ, loin des toits, sous
les cieux.
Un aigle,
qui portait en l'air une tortue,
Passa par là, vit l'homme, et, sur
sa tête nue,
Qui parut un morceau de rocher à ses yeux,
Etant de cheveux dépourvue,
Laissa tomber sa proie, afin de la
casser :
Le pauvre Eschyle ainsi sut ses jours avancer.
Ces dernière vers sent presque les propres paroles de Valère Maxime (29). Le biographe ne parle pas de la chute d'une maison. L'oracle aurait dit à Eschyle : Un trait lancé du ciel te tuera. J'ignore si les aigles font leur mets de la chair des tortues, et s'ils ont l'art de briser d'aussi dures écailles. Pline l'affirme (30); mais; comme il allègue pour preuve la mort d'Eschyle, on peut douter qu'il ait par lui-même vérifié le fait : post hoc, ergo propter hoc. Tout ce récit a bien l'air d'un de ces contes à dormir debout comme on en a tant fait en Grèce sur la vie mal connue des anciens poètes.
Eschyle mourut à Géla, en Sicile, à l'âge de soixante-neuf ans, dans la quatrième année de la LXXXe olympiade, en l'an 456 avant notre ère, et son tombeau fut orné de l'inscription que j'ai rapportée. Pendant longtemps ce tombeau fut, pour les poètes dramatiques, l'objet d'un culte religieux. On venait de bien loin y respirer, pour ainsi dire, l'air du génie. Mais il ne paraît point, hélas! que tant de visiteurs en aient jamais rien emporté, sinon peut-être des intentions magnifiques. Sophocle était déjà Sophocle; Euripide n'a jamais rien demandé, ce semble, à la mémoire d'un homme dont il méprisait les œuvres (31); et la mollesse d'Agathon ne s'inspirait guère de l'énergique et enthousiaste poésie d'Eschyle.
LA TRAGÉDIE AVANT ESCHYLE.
Une Assertion de Quintilien. — La tragédie-dithyrambe. — Innovations do Thespis. — Phrynichus. — Chœrilus et Pratinas; le drame satyrique, — Appareil scénique. — Concours dramatique. — Description du théâtre. Forme extérieure de la tragédie grecque. — Rôle du chœur. — Nombre des choreutes. — Accompagnement musical. — Répétitions dramatiques.
Les Athéniens appelaient Eschyle le père de la tragédie (32). Quintilien, qui parle quelquefois à la légère, interprète à sa façon ce titre d'honneur ; « Eschyle, le premier, dit-il (33), mit des tragédies au jour. » Ce n'est pas la seule erreur grave qu'on pourrait relever dans son livre. S'il eût consulté plus attentivement ses souvenirs, il aurait au moins tenu compte de ces vieux chants tragiques qui plaisaient tant aux vieillards des Guêpes d'Aristophane. Ἀρχαιομελησιδωνοφρυνιχήματα (34), cet étrange vers ïambique, ce mot aux proportions gigantesques, suffirait à lui seul pour attester, aujourd'hui même encore, l'impression profonde de Phrynichus sur ses contemporains. Et Phrynichus avait précédé Eschyle : il était à son déclin quand Eschyle parut; et, sans remonter jusqu'aux temps héroïques, jusqu'à ce Théomis qui fut, suivant un scholiaste (35) l'inventeur de la tragédie, ni même jusqu'à Minos et Auléas, les continuateurs, dit-on, de l'œuvre de Théomis, nous sommes en droit d'affirmer qu'à la fin du νιe siècle avant notre ère, que, dès avant Phrynichus, la poésie dramatique avait déjà une assez longue existence.
C'est vers l'époque où Pisistrate préparait ses entreprises contre la liberté de ses concitoyens, que la tragédie naquit dans Athènes. Je distingue : il s'agit non pas du mot, mais de xvi la chose. Thespis est le créateur de la tragédie ; mais le mot tragédie était en usage longtemps avant Thespis. Ce qu'on nommait souvent ainsi, c'était le dithyrambe, le chant en l'honneur de Bacchus. Ce chant, tantôt triste et plaintif, tantôt vif et joyeux, libre dans son allure, dégagé de presque toutes les entraves métriques, était une sorte d'épopée, où se déroulait le récit des aventures du dieu. Le chœur qui l'exécutait dansait, en chantant, une ronde continue autour de l'autel de Bacchus. Sur cet autel on immolait un bouc; et le nom de la victime, τράγος, fait comprendre comment le chant du sacrifice a pu prendre celui de tragédie (τραγῳδία, de τράγου ᾠδη, chant du bouc), et pourquoi tels poètes dithyrambiques, antérieurs à Thespis, sont cités comme auteurs de tragédies. Suivant quelques-uns, le mot tragédie vient de ce que les chanteurs du dithyrambe se déguisaient en satyres, avec des jambes et des barbes de bouc, pour figurer le cortège habituel de Bacchus. Cette opinion peut jusqu'à un certain point se soutenir, mais non pas celle qu'a versifiée Boileau, d'après Horace, qu'un bouc était le prix de celui qui avait le mieux chanté. Le prix du dithyrambe était un bœuf (36), qu'on décernait, non pas au meilleur choreute, mais au poète qui avait composé le chant, la musique et la danse, et qui en avait dirigé l'exécution. Virgile pourtant aurait dû faire réfléchir Boileau, et lui signaler la méprise d'Horace. Il s'agit quelque part, dans les Géorgiques (37), de la victime de Bacchus; et c'est au sacrifice du bouc que Virgile rapporte l'origine et des représentations dramatiques et de ces concours où les enfants de Thésée, comme il dit, proposaient des prix aux talents. Mais les critiques, jusqu'à présent, n'ont pas même fait attention à cet important témoignage.
C'est du dithyrambe que sortit la tragédie proprement dite; ou. si l'on veut, la tragédie, d'abord purement lyrique, se transforma en drame, et finit par dépouiller presque complètement son premier caractère.
La légende de Bacchus avait fourni, durant de longues années, aux poètes dithyrambiques une matière abondante et variée. A la fin, les poètes pourtant se fatiguèrent de répéter ce qu'on avait redit cent fois avant eux : aux louanges de Bacchus ils ajoutèrent celles de quelques autres dieux, ou même de cer- xvii tains héros des vieux âges. Il ne leur fallut que du talent pour se faire pardonner cette audace. A Sicyone, ce fut mieux encore. On ne se contenta pas de faire à Bacchus sa place plus petite; on l'évinça absolument du dithyrambe, et Adraste, le héros national des Sicyoniens, eut seul les honneurs du chant tragique et de l'antique ronde. La première fois qu'un poète en usa ainsi, les assistants étonnés s'écrièrent : « Quel rapport ceci a-t-il avec Bacchus (38)? » Épigène de Sicyone, l'auteur de cette innovation, est nommé par quelques-uns le père de la tragédie. En réalité, Épigène ne fut qu'un poète lyrique. Il n'y eut drame que le jour eu un personnage de la ronde se sépara dos choreutes, monta sur une estrade, et répondit au chœur par ses chants. Cette révolution décisive, Épigène ne l'accomplit pas; et les poètes dithyrambiques, après lui, ou se bornèrent à suivre ses exemples, ou même revinrent aux traditions des premiers temps; Il est possible toutefois que tel ou tel des nombreux poètes que compte Suidas entre Épigène et Thespis (39), ait tenté à son tour de se frayer des voies, nouvelles. Supposez un des serviteurs d'Adraste racontant les douleurs de son maître, Adraste lui-même exhalant ses plaintes, et voilà un .monologue à côté du chant : c'est presque déjà du dialogue; c'est presque déjà du drame.
Quand Selon revint de ses voyages, Thespis, du dème d'Icare, représentait des drames véritables, « En ce temps-là, dit Plutarque (40), Thespis commençait à changer la tragédie; et la nouveauté du spectacle attirait la foule, n'y ayant point encore de concours où les poètes vinssent se disputer le prix. Salon, naturellement curieux, et qui, dans sa vieillesse, se livrait davantage aux passe-temps et aux jeux, et même à la bonne chère et à la musique, alla entendre Thespis, lequel, suivant l'usage des anciens poètes, jouait lui-même ses pièces. Après le spectacle, il appela Thespis et lui demanda s'il n'avait pas honte de faire si publiquement de si énormes mensonges. Thespis répondit qu'il n'y avait point de mal à ses paroles ni à sa conduite, puisque ce n'était qu'un jeu. Oui, dit Solon en frappant avec force la terre de son bâton; mais si nous souffrons, si nous approuvons le jeu, nous trouverons la réalité dans nos contrats. »
xviii Voici quelles étaient les innovations poétiques dont s'était scandalisé le vieux législateur. Thespis avait imaginé de prendre pour sujet de poème une portion bornée de la légende de Bacchus, l'histoire de Penthée par exemple, et de la mettre, non plus en récit, mais en action. Le chœur chantait et dansait encore, mais non d'une façon continue. De temps en temps, un personnage s'en détachait et parlait seul, soit pour répondre aux paroles du chœur, soit pour raconter ses pensées, soit pour provoquer le chœur à de nouveaux chants. Au reste, la partie purement lyrique, dans les compositions de Thespis, était de beaucoup la plus considérable. Le sujet dramatique, l'épisode, comme on disait, avait fort peu de développement ; et l'acteur, le répondant, suivant l'acception du terme grec (41), s'adressait au chœur en vers dont la forme et le caractère tenaient de bien près encore aux mètres lyriques. Thespis se servait, dans le dialogue, du tétramètre trochaïque, et non de l'ïambe.
Il paraît que Thespis se passa quelquefois de prendre ses sujets dans la légende de Bacchus. Parmi les titres des pièces que lui attribuent les anciens, il y a une Alceste. Je ne m'étonne pas que Thespis, une fois en possession de l'art merveilleux de captiver les hommes, s'en soit servi de diverses façons, librement, résolument, sans aucun regard aux circonstances où l'avait découvert son génie. Peu lui importait, pourvu qu'il intéressât ses spectateurs au dévouement de la femme d'Admète, que tel censeur morose rappelât le chœur à ses devoirs traditionnels, et répétât le mot des Sicyoniehs : « Quel rapport ceci a-t-il avec Bacchus? »
Diogène de Laërte dit que Thespis n'employa qu'un seul acteur; cela signifie un seul acteur à la fois sur la scène : on voit en effet, dans Aristote, qu'Eschyle porta le nombre des acteurs d'un à deux, Sophocle de deux à trois : or il n'y a pas, dans Eschyle, de pièce à deux acteurs seulement; mais, la plupart du temps (Aristote exagère en faisant entendre toujours), il n'en paraît que deux dialoguant sur le théâtre. La tragédie des Suppliantes peut donner une idée des pièces de Thespis : sauf un seul dialogue, il n'y a jamais qu'un acteur parlant en scène avec les filles de Danaüs.
Tout le monde a répété, d'après Horace, l'historiette du tombereau où Thespis promenait ses acteurs : « Thespis, dit-on, xix inventa la muse tragique, genre auparavant inconnu; et il voiture sur des chariots ses poèmes, que chantaient et jouaient des hommes au visage barbouillé de lie (42). » Pourtant, sur ce point, Horace s'est manifestement trompé. Il a confondu Thespis avec Susarion, l'inventeur de la comédie. C'est de Susarion que d'autres anciens racontent la chose. La tragédie, dès le temps même du simple dithyrambe, se représentait auprès de l'autel de Bacchus. Les acteurs de Thespis n'improvisaient pas; et un chariot ambulant ne peut être un théâtre que pour des improvisateurs. Horace, qui parlait tout à l'heure des poèmes de Thespis, a pu les lire comme d'autres Romains ; « Les Romains, dit-il (43), dans le repos qui suivit les guerres Puniques, se mirent à s'enquérir des beautés de Sophocle, et de Thespis, et d'Eschyle, » On conteste, et avec raison peut-être, l'authenticité des fragments qui restent des pièces de Thespis. Mais je ne puis me faire à l'idée d'une Alceste représentée sur une charrette roulante par des vendangeurs avinée.
Phrynichus introduisit, dit-on, le premier les rôles de femme au théâtre : il faudrait pour cela que Thespis n'eût point fait d'Alceste (44), Il inventa, selon Suidas, le tétramètre trochaïque : il faudrait que ce mètre ne se trouvât point chez des poètes antérieurs; or Archiloque l'avait employé. Phrynichus ne quitta pas les voies de Thespis, pour ce qui est de la forme de la tragédie. Mais il fut le premier qui mit sur la scène un sujet contemporain. Hérodote raconte qu'il fut traduit en jugement pour avoir représenté, dans sa Prise de, Milet, l'humiliation des Grecs et le triomphe des Barbares, Et peut-être n'est-ce pas la seule fois que Phrynichus déserta les chemins battus de la mythologie et de l'histoire héroïque. Voici en effet ce que dit l'argument, la didascalie grecque, qui précède les Perses d'Eschyle :: « Glaucus (45), dans son écrit sur les pièces d'Eschyle, prétend que les Perses sont imités des Phéniciennes de Phrynichus. Il cite le commencement du drame de Phrynichus, qui est tel : Vous voyez, des Perses qui xx sont partis jadis, etc. Seulement, chez Phrynichus, il y a, au début, un eunuque qui annonce la défaite de Xerxès, et qui dispose des sièges pour les gouverneurs de l'empire ; tandis que c'est par un chœur de vieillards que se fait l'exposition dans les Perses. »
Il ne faut pas se dissimuler tout ce qu'il y a d'étrange dans le fait attesté par Glaucus, malgré ce qu'on sait des poètes de la Grèce, qui aimaient à refaire ce qui avait été fait avant eux. Les Perses d'Eschyle ne sont pas une imitation : ce souffle guerrier, ces inspirations patriotiques, ce sont les souvenirs vivants d'un des vainqueurs de Salamine et de Platées ; ce ne sont point des réminiscences littéraires. Peut-être les deux poètes ont-ils traité en même temps le même sujet; peut-être Eschyle aura-t-il voulu faire oublier la pièce de Phrynichus; enfin la citation faite par Glaucus pourrait bien avoir été tirée, non pas du poème original de Phrynichus, mais de quelque contrefaçon des Perses d'Eschyle, recommandée par son auteur du nom d'un poète tragique antérieur à Eschyle lui-même.
Entre Phrynichus et Eschyle, on cite quelques noms : ainsi Chœrilus l'Athénien, pour lequel un théâtre de bois fut élevé dans Athènes; ainsi Pratinas, Dorien du Péloponnèse, qui vint lutter au théâtre contre Phrynichus, et qu'Eschyle trouva en possession de la faveur publique. Pratinas est regardé comme l'inventeur du drame satyrique, de ce drame demi-sérieux, demi-bouffon, dont le chœur était toujours composé d'une troupe de satyres (46). La tragédie, au moins dans les pièces tirées de la légende de Bacchus, avait d'abord souffert tous les tons, comme autrefois le dithyrambe, suivant le caractère tantôt triste, tantôt gai, des aventures attribuées au dieu, et suivant la nature des personnages dont Bacchus était entouré. Mais elle se maintint, depuis l'invention de Pratinas, dans la région des nobles sentiments des grandes catastrophes, et elle s'appropria ce style héroïque qui n'excluait ni la simplicité du langage, ni même la plus aimable et la plus touchante naïveté. Les plaisanteries, les quolibets, les danses plus ou moins égrillardes, furent dévolus aux satyres du drame, qui s'en acquittèrent à merveille. Nous possédons un drame satyrique, le Cyclope d'Euripide, qui donne une idée du genre; et Horace, dans l'Art poétique, expose les préceptes qui s'y rapportent, et décrit en ces termes le style qui sied aux rustiques xxi compagnons de Bacchus : « Pour moi, chers Pisons, ce que j'aimerais, si j'écrivais un drame satyrique, ce ne serait pas une diction uniquement brute et triviale; et je ne m'efforcerais pas de m'éloigner de la couleur tragique au point qu'il n'y eût aucune différence entre les propos d'un Dave ou d'une effrontée Pythias escamotant l'argent du benêt Simon, et le langage de Silène, serviteur et nourricier d'un dieu (47). » On ne sait pas si les œuvres de Pratinas se distinguaient par des qualités éminentes. Quant à Chœrilus, il passe pour avoir excellé dans le drame satyrique. On dit toutefois que Sophocle lui reprochait de n'avoir rien perfectionné, et de n'avoir pas même soutenu la tragédie à la hauteur où l'avait portée Phrynicus son devancier.
Horace, qui admet la tradition vulgaire sur Thespis, et qui passe sous silence les autres poètes tragiques antérieurs à Eschyle, rapporte à Eschyle seul et l'invention du théâtre et celte de l'appareil scénique : « Après lui, Eschyle imagina le masque et le majestueux manteau; il dressa la scène sur des tréteaux peu élevés, et il enseigna à parler noblement et à marcher avec le cothurne (48). » Mais la nécessité d'une estrade est telle, pour qui se veut donner en spectacle, qu'il est impossible, témoignages historiques mis à part, qu'on ait attendu jusqu'au temps d'Eschyle avant d'en avoir l'idée. De deux choses l'une : ou il n'y a point eu de Pratinas, de Chœrilus, de Phrynichus, ou, tel quel, ils avaient déjà un théâtre. J'en dirai autant du costume et de l'appareil scénique. Eschyle a pu perfectionner, et il l'a fait sans nul doute, durant sa longue carrière, les moyens d'agir par les yeux sur l'esprit des spectateurs; mais il est permis de ne pas croire qu'Eschyle ait le premier songé à distinguer les acteurs d'avec le public auquel ils s'adressaient. On n'imagine pas aisément un Darius ou un Xerxès sous la figure et dans le costume habituel de Phrynichus. Vrais ou faux, conventionnels ou non, il fallait bien que certains insignes distinguassent aux yeux le personnage.
Le masque répondait à un double besoin : c'était la représentation traditionnelle ou idéale du personnage en scène ; c'était aussi un moyen physique de se renforcer la voix, de se mieux faire entendre à tout un peuple assemblé. Le cothurne, brodequin à semelles très épaisses, empêchait que l'acteur, à xxii distance immense où il se trouvait des derniers rangs de l'amphithéâtre, n'offrit qu'un chétif et ridicule aspect. Ces deux inventions, qui, sur nos théâtres, paraîtraient des monstruosités, étaient, j'ose l'affirmer, d'une absolue nécessité sur le théâtre d'Athènes.
On est en droit de pousser les conjectures plus loin encore. Il n'y a aucune témérité à dire que l'appareil scénique était connu en Grèce avant Eschyle, avant Phrynichus, avant Thespis même. Les Grecs faisaient, de tout temps, figurer des dieux en personne dans certaines cérémonies religieuses : ainsi quand un jeune homme de Delphes jouait le rôle d'Apollon qui tue le serpent; ainsi quand, à Samos, on célébrait le mariage de Jupiter et de Junon ; ainsi quand Cérès, à Éleusis, allait s'enquérant des nouvelles de sa fille. Nul doute que ces dieux ne se montrassent à la foule, le visage couvert d'un masque, le pied chaussé du cothurne, et dans le costume traditionnel dont la statuaire revêtait leurs images. Il n'a donc pas fallu un génie bien inventif pour imaginer les moyens de donner aux personnages de la scène quelque chose de cette majesté extérieure qui distinguait, selon l'opinion populaire, les dieux et les héros.
Quant au chant et à la danse, j'ose affirmer que, plus les poètes tragiques s'éloignèrent de la forme du dithyrambe, plus ils affaiblirent l'élément musical et chorégraphique de la tragédie, et que Thespis lui-même, comparé aux poètes dithyrambiques, marqua le premier degré de cette décadence. Qu'on se figure,en effet, ce que devait être le vrai chœur tragique, le chœur du dithyrambe, quand on y voyait Bacchus menant la troupe avinée des satyres, des évants et des ménades. Les vers suivants, d'une des pièces perdues d'Eschyle, intitulée les Édons, ne sont qu'un trait de la description du cortège de Bacchus : « L'un, tenant dans ses mains des bombyces, ouvrage du tour, exécute, par le mouvement des doigts, un air dont l'accent animé excite la fureur; l'autre fait résonner des cymbales d'airain... Un chant de joie retentit : comme la voix des taureaux, on entend mugir des sons effrayants, qui partent d'une cause invisible; et le bruit du tambour, semblable à un souterrain tonnerre, roule en répandant le trouble et la terreur. » Le progrès, s'il y en eut, ne fut point un accroissement de passion et d'enthousiasme. Si les danses du chœur gagnèrent en décence et en grâce, et si la musique revêtit une infinie variété de formes et s'appropria tous les xxiii modes de la mélodie, il n'est pas moins vrai que ce qui resta du dithyrambe, dans la poésie dramatique, n'eut plus ni la même puissance que jadis sur les âmes, ni cet entraînement sympathique qui transformait en une sorte de délire les sentiments de la foule assemblée pour entendre célébrer Bacchus.
Quoi qu'il en soit, c'est aux travaux, c'est aux succès de Thespis, de Phrynichus, de Chœrilus, de Pratinas, que l'art dramatique dut l'importante place qu'il occupa, dès avant la fin du vie siècle, dans la vie publique des Athéniens. Pisistrate et ses fils ne jugèrent pas comme Solon des inventions de Thespis. Ils les favorisèrent; ils encouragèrent, autant qu'il était en eux, les successeurs de Thespis à s'avancer plus loin dans la voie. On ignore l'époque précise où furent établie les concours dramatiques, qui se renouvelaient chaque année aux fêtes de Bacchus, aux Lénéennes, surtout aux grandes Dionysiaques. Mais ces concours existaient déjà quand Eschyle n'était pas encore né, et ils éclipsaient l'éclat même des concours lyriques. Un des archontes, celui dont le nom désignait légalement la date do l'année, l'archonte éponyme, choisissait parmi les compétiteurs les trois poètes dont les ouvrages lui paraissaient le plus dignes d'être représentés; et il donnait à chacun d'eux un chœur, selon l'expression consacrée, c'est-à-dire qu'il les autorisait à faire apprendre leurs vers aux acteurs, et à disposer, pour la représentation, d'une troupe dont le chorège, qui était quelque citoyen opulent, fournissait l'habillement et l'entretien. Chaque poète présentait au concours quatre pièces, trois tragédies et un drame satyrique, autrement dit une tétralogie. Vers le milieu du Ve siècle, la tétralogie ne fut plus exigée : les poètes luttèrent pièce contre pièce, surtout depuis l'introduction de la comédie dans les concoure ; et l'archonte put donner un chœur à plus de trois poètes à la fois. Au siècle de Ménandre et de Philémon, il en choisissait jusqu'à cinq, du moins pour le concours des comédies.
Dans les premiers temps, c'était le peuple lui-même qui décidait, par acclamation, du mérite respectif des trois compétiteurs. Plus tard, on institua un tribunal de cinq juges, tirés au sorti qui assistaient aux représentations, et qui prononçaient l'arrêt en plein théâtre, après avoir invoque les dieux. Le nom du vainqueur était inscrit sur les monuments publics, entre celui du chorège et celui de l'archonte; les noms des xxiv deux autres poètes ne figuraient que sur les registres du concours, et selon l'ordre assigné par les juges.
Ce n'est qu'assez tard, et quand Périclès dota Athènes de ces monuments dont les débris font encore aujourd'hui l'admiration du monde, que le théâtre de Bacchus fut construit en matériaux durables, et avec une magnificence digne, de la ville des arts. Mais, dès l'époque de Chœrilus, et avant les débuts d'Eschyle, il y avait, à Athènes, un théâtre de bois, de vastes dimensions, disposé d'après les règles les plus savantes de l'acoustique, suffisant à tous les besoins essentiels, et où pouvaient s'asseoir à l'aise des milliers de spectateurs. Les femmes, les enfants, les esclaves même, assistaient à la représentation des tragédies et des drames satyriques; et si, comme ou le croit, il leur fut interdit plus lard d'assister aux représentations comiques, durant la période de la Comédie ancienne, on ne les priva jamais des enseignements qui sortent de la tragédie, cette rhétorique, comme dit Platon, à l'usage des enfants et des femmes, des hommes libres et des esclaves (49). Les pièces qu'on donnait au théâtre de bois étaient les mêmes que celles qu'on joua depuis dans le théâtre de pierre ; c'est le même système dramatique et lyrique qui se maintint jusqu'à l'extinction de l'art en Grèce : il est donc fort probable que tout était ordonné, dans le théâtre de bois même, comme dans les édifices -plus solides qui furent construits plus tard. Voici quelles étaient les dispositions générales des théâtres grecs, autant qu'on en peut juger et par les débris de quelques-uns et par les descriptions un peu obscures que nous font les anciens.
Le théâtre était entièrement découvert, et les représentations se donnaient en plein jour. La scène, ou, comme on disait plus exactement, le logeum, le parloir, était une longue plate-forme, qui n'avait qu'une médiocre largeur, et qui présentait un parallélogramme régulier. Les gradins occupés par les spectateurs décrivaient un demi-cercle, et le banc inférieur était au niveau du logeum. L'espace vide entre le logeum et l'amphithéâtre, c'est-à-dire l'orchestre, ou la place de danse, s'enfonçait un peu au-dessous, et ne contenait pas de spectateurs. C'était comme une dépendance ou un prolongement de la scène, car le chœur y faisait ses évolutions. Au point central d'où partaient les rayons cru demi-cercle, en avant du logeum et à l'extrémité d'une ligne qui aurait partagé le paral- xxv lélogramme en deux portions égales, s'élevait la thymèle, ou, suivant la force du mot, l'autel du sacrifice; tradition manifeste du vieux temps de la tragédie-dithyrambe. Peut-être continua-t-on, durant de longues années, d'immoler à Bacchus le bouc accoutumé, surtout dans la représentation des pièces tirées de la légende du dieu; mais, à la fin, la thymèle, tout en conservant son nom et sa signification symbolique, avait cessé d'être employée à cet usage, et elle servait uniquement de place de repos aux personnages du chœur. Les simples choreutes restaient debout ou assis sur les degrés de l'autel, lorsqu'ils ne chantaient pas ; et de là ils regardaient l'action à laquelle ils étaient intéressée. Le coryphée, littéralement le capitaine, le chef de la troupe chorale, se tenait sur la partie la plus élevée de la thymèle, observant ce qui se passait sur toute l'étendue de la scène, prenant la parole quand il fallait qu'il se mêlât au dialogue, et donnant à ses subordonnés le signal qui réglait leurs chants toi leurs danses.
Les décorations de la scène représentaient, d'ordinaire, la façade d'un palais ou d'un temple, et, dans une perspective plus éloignée, les tours de quelque ville, une échappée sur la campagne, des montagnes, des arbres, une grève au bord de la mer. D'une tragédie à une autre, et même d'une tragédie à un drame satyrique, la décoration principale restait, à peu de chose près, ce qu'on l'avait vue auparavant, parce que le lieu de la scène était toujours en plein air, et, par conséquent, dans des conditions analogues, sinon identiques. On se contentait de retrancher tel ou tel objet, d'en ajouter quelque autre, un tombeau par exemple, et d'ouvrir, au besoin, la porte du temple ou celle du palais, s'il était nécessaire de voir ce qui se passait à l'intérieur. Les décorations latérales, dressées sur des échafaudages à trois faces et tournant sur pivot, pouvaient changer à vue et présenter incontinent leurs tableaux les plus appropriés aux lieux décrits ou simplement nommés dans les vers du poète.
Les machinistes anciens obtenaient, par des moyens plus ou moins savants, des résultats frappants et presque merveilleux. ils imitaient la foudre et les éclairs, l'incendie ou l'écroulement des maisons; ils faisaient descendre du ciel certains personnages, sur des chars ailés, sur des gryphons, sur toute sorte de montures fantastiques. On voyait, dans le Prométhée enchaîné, le chœur des Océanides arriver, selon son expression, par la route des oiseaux, et porté tout entier sur un char vo- xxvi lant. On voyait leur père, le vieil Océan, à cheval sur un dragon ailé. Mais les comédies d'Aristophane supposent presque des prodiges. Les imaginations les plus étranges, des choses à peine possibles aujourd'hui sur notre scène, y sont à chaque instant données comme des réalités que les spectateurs avaient sous les yeux : des hommes, par exemple, déguisés en guêpes, en grenouilles, en oiseaux, en nuées, jouant ces rôles sur la scène, ou planant au-dessus de la tête des personnages empruntés à notre humanité vulgaire.
Le spectacle était continu, depuis un bout de la pièce jusqu'à l'autre, et quelquefois d'un bout à l'autre de la trilogie, ou même de la tétralogie; carie drame satyrique n'était, dans certains cas, qu'un prolongement et une conclusion de la fable déroulée à travers les trois compositions tragiques. Les Grecs ignorèrent toujours ce que nous entendons par actes et entr'actes ; et, comme on ne voit d'ailleurs, dans les pièces, la mention d'aucun préparatif qu'il fût nécessaire de cacher, le rideau, si l'on s'en servait dans les temps anciens, n'avait d'autre usage que de fermer la scène en attendant le commencement du spectacle, ou durant les intervalles d'une pièce à une autre pièce.
La tragédie, ainsi que le drame satyrique et plus tard la comédie, avait pourtant des parties distinctes; et les auteurs anciens nous citent quelquefois les noms de monodies, de stasima, de commata, d'exodes, et d'autres plus ou moins utiles à retenir. Sans entrer dans aucune discussion à ce sujet, je dirai que la tragédie antique se montre à nous comme un ensemble de chants lyriques et de dialogues, étroitement unis les uns aux autres, mais différant profondément et par le caractère et par les rythmes. Les successeurs de Thespis avaient adopté pour le dialogue, et en général pour tout ce qui concernait l'épisode ou le sujet dramatique, le vers ïambique trimètre, qui se rapprochait, plus que tout autre, de la simplicité du langage courant, et qui était capable, comme dit Horace (50) de dominer les tumultes populaires. C'est en ïambes que parlaient les héros, soit entre eux, soit avec le chœur; et le chœur leur répondait dans le même mètre. Quand le chœur se séparait en deux moitiés, pour délibérer sur quelque question perplexe, et qu'il s'associait ainsi, quoique indirectement, à l'action dramatique, il se servait aussi du mètre approprié à xxvii l'action, comme Horace caractérise encore le vers iambique (51). Le vers trochaïque tétramètre ne paraissait que dans les circonstances où le dialogue prenait une couleur plus vive, une véhémence inaccoutumée, et qui sentait non plus seulement l'action, la marche régulière, mais la marche rapide, la course enfin, suivant la signification du mot même de trochée.
Les chants par lesquels préludait le chœur dans les intermèdes étaient en mètres anapestiques ; et souvent les anapestes, comme on nommait le prélude, étaient d'une longueur considérable. Puis venait le chant chorique proprement dit. C'était une ode véritable, une ode à la façon de celles de Pindare, une ode avec strophes, antistrophes et épodes. Les vers de ce chant n'étaient pas des vers dans le sens ordinaire du mot; ils ne se scandaient pas par pieds; c'étaient, sauf de rares exceptions, des rythmes qui n'avaient rien de fixe, et que réglaient uniquement les lois de l'accompagnement musical. La strophe, c'est-à-dire le tour, était la portion du chant que le chœur exécutait dans sa première évolution ; l'antistrophe, ou le retour, celle qu'il exécutait en revenant au point de départ ; l'épode (52) se chantait au repos, devant la thymèle. Puis après, le chœur reprenait son mouvement de strophe, pour retourner en antistrophe et s'arrêter de nouveau en épode ; et ainsi de suite jusqu'à la fin du chant.
Il y a, dans le chapitre quatrième de la Poétique d'Aristote, quelques mots que je traduis littéralement : « Eschyle, le premier, diminua les choses du chœur (53). » Il s'agit là, selon certains critiques, du nombre des personnages du chœur, qui aurait été réduit de cinquante à quinze, en vertu d'une loi. C'est à propos des Euménides que la loi aurait été portée ; et c'est Eschyle qui, le premier, s'y serait soumis.
Cette interprétation est loin d'être aussi satisfaisante qu'elle
le paraiî au premier abord.
C'est chez le lexicographe Pollux que nous apprenons qu'une loi sur
le nombre des personnages du chœur fut portée à l'occasion des
Euménides (54). Il conte, en effet, qu'à l'instant où les Furies
parurent sur la scène, avec leurs masques où la pâleur était peinte,
avec leurs torches à la main et leurs serments entrelacés sur la
tête; que, quand elles formèrent, après
xxviii la fuite d'Oreste, leurs danses infernales, et
qu'elles poussèrent leurs cris sauvages, l'effroi s'empara de toutes
les âmes, des femmes avortèrent, des enfants expirèrent dans les
convulsions. On peut admettre, avec Auguste Bœckh (55), l'authenticité de
cette histoire; on peut, avec des savants dont l'autorité est d'un
grand poids, la rejeter comme une de ces exagérations dont ne se
faisaient pas faute les écrivains des bas siècles, et ne pas refuser
d'admettre que les femmes et les enfants assistaient à la
représentation des tragédies (56). Mais qu'une loi comme celle dont
parle Pollux ait été portée, et surtout qu'elle ait été mise à
exécution, c'est ce qui me parait presque impossible. En tous cas,
Eschyle n'a pas obéi à cette absurde loi ; et, par conséquent, ce
n'est point par là qu'il a mérité ce qu'Aristote aurait dit de lui.
Il n'a point obéi à la loi, parce que les Euménides sont une des
dernières tragédies qu'il ait composées, et que les seules qu'on
puisse avec quelque probabilité placer à la suite, ce sont les trois
pièces qui formaient la trilogie dont faisaient partie les
Suppliantes. Or, dans les Suppliantes, le chœur avait certainement
cinquante personnages, les cinquante filles de Danaüs : je .ne
parle pas de leurs suivantes, elles ne comptent pas dans le chœur. Bœckh a épuisé, pour prouver le contraire, toutes les ressources de
son esprit, toute la subtilité de ses arguments (57); mais on peut
affirmer que ni lui ni son ami Conrad Schneider, dont il invoque le
témoignage, n'ont jamais persuadé à un homme de bon sens qu'Eschyle
n'avait mis sur la scène, dans les Suppliantes, que quinze Danaïdes.
C'est faire injure à la fois et au poète et à ses auditeurs. Eschyle
appelle Égyptus le père aux cinquante fils (58). Ces cinquante amants
poursuivent les filles de leur oncle ; chacun d'eux a sa fiancée :
tous les mythologues l'ont dit, tous les poètes l'ont chante, tout
le monde le sait dans la Grèce; et voilà un poète qui leur enlève,
de sa pleine et privée autorité, les deux tiers et plus de leurs
amantes ! et voilà un public qui contemple de sang-, froid une telle
impertinence, qui y applaudit, qui même a
xxix
forcé le poète à cet inconcevable mensonge ! Mais alors comment, à
ce compte, Eschyle s'en était-il tiré dans les Danaïdes, où sans
doute Égyptus, le père aux cinquante fils, avait vu leur hymen, et
où les filles de Danaus étaient en présence de leurs cinquante époux
? il faut avouer que si la haute critique, comme l'appelle Bœckh,
est une bien belle chose, c'est aussi quelquefois une chose bien
étrange.(59).
Il n'est pas moins inadmissible que le chœur, avant la promulgation de la loi, ait toujours, été de cinquante personnes. Il est impossible que, dans le Prométhée, le char ailé qui apporte à travers les airs le chœur tout entier en ait contenu, je ne dis pas cinquante, mais même quinze ; tandis que, dans les Sept contre Thèbes, le nombre cinquante n'a pas dû suffire pour représenter toutes les femmes et toutes les jeunes filles de la cité. Remarquons, en passant, que la scène où se jouaient les tragédies d'Eschyle n'avait rien dé commun avec ces étroites cages où nous voyons quelques malheureux figurants représenter à nos yeux tout un peuple, toute une armée, et où chacun d'eux, pour les besoins du service, doit toujours se tenir prêt à dire : Je m'appelle légion. L'étendue de la scène était proportionnée à l'étendue de l'amphithéâtre; et l'amphithéâtre pouvait contenir une portion considérable de la population d'Athènes.
Je ne dis rien des Perses ni de l'Agamemnon. On peut, sans nul inconvénient, admettre que le nombre cinquante convenait à merveille au chœur de la première pièce, et que le chœur de la seconde se composait de quinze vieillards seulement, comme l'indique un vieux scholiaste (60), et comme tous les critiques le pensent aujourd'hui.
Je reviens à la phrase d'Aristote. Ce que l'auteur de la Poétique a voulu dire, c'est qu'Eschyle réduisit les déveîoppements lyriques du chœur; et, pour qui connaît l'histoire de la tragédie, rien ne paraît plus probable, Et môme une expres- xxx sion de Philoslrate, « Eschyle réduisit la longueur des monodies (61), » n'est pas autre chose que la glose du mot d'Aristote. Il est vrai que le chœur, dans les Choéphores, joue un rôle considérable ; que, dans les Euménides, il forme le personnage principal; qu'il est tout, ou presque tout, dans les Suppliantes. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il n'a jamais que le développement que comporte la conception même du sujet; c'est qu'il n'est jamais un hors-d'œuvre, et qu'il est tellement engagé dans les liens de la fable, qu'on ne saurait l'arracher de l'action sans en détruire l'économie tout entière.
Il serait intéressant peut-être de chercher quelle était la nature des accompagnements affectés aux diverses parties du poème dramatique; ou quelle sorte de ressemblance une tragédie antique pouvait avoir avec un opéra moderne; ou si les personnages en scène se bornaient à une déclamation accentuée ; ou enfin si la paraloge et la paracataloge, comme on nommait la manière de dire les ïambes, étaient quelque chose d'analogue à notre récitatif. Mais il me suffit de remarquer que la musique était toujours d'une extrême simplicité, même dans les morceaux lyriques, et que jamais le poète ne disparaissait devant le musicien. Il faut dire que le musicien, c'était le poète lui-même, au moins pour l'ordinaire. Quand le chœur chantait, ce n'étaient pas seulement des sons qu'il faisait entendre : les paroles étaient nettes et articulées, et le poète arrivait tout entier aux oreilles des auditeurs et à leur âme. Les instruments à vent et les instruments à cordes respectaient sa pensée, et ils ne retentissaient avec éclat qu'au moment où le chœur se taisait, ou quand le chœur passait du chant à la danse.
Le coryphée, qui dirigeait tous les mouvements du chœur, qui parlait au nom de tous, qui entonnait le chant, et dont les choreutes imitaient les intonations et même les gestes; cet homme, qui était à la fois chef d'orchestre, maître de ballet et premier chanteur, ne pouvait être qu'un artiste consommé dans la pratique de l'art musical et chorégraphique. Mais les simples choreutes n'étaient bien souvent que des chanteurs et des danseurs d'occasion, des jeunes gens de famille pour qui c'était une récréation agréable de chanter de beaux vers, et de déployer, dans les danses, leur souplesse et leur grâce. Ceux qui jouaient les grands rôles dramatiques étaient aussi xxxi des artistes dans toute la force du mot, et quelques-uns même se sont fait un nom célèbre ; mais les rôles secondaires se donnaient, peu s'en faut, au premier venu. Le poète, selon ses moyens, se réservait à lui-même le rôle le plus à sa guise et, au besoin, celui de quelque personnage muet. Il paraissait sur la scène, soit à un titre soit à un autre, afin de surveiller ainsi de plus près l'exécution de ses ordres, et d'assurer, autant qu'il était en lui, le succès de la représentation.
Les poètes dramatiques n'étaient nullement tenus de figurer en personne sur le théâtre. Ils finirent même par s'en dispenser tout à fait, et ils laissèrent toute la besogne à ceux dont c'était le métier, à ceux qu'on nommait les hommes de la scène, les hommes de Bacchus, les artistes de Bacchus. Quant aux répétitions, c'était tout autre chose. L'archonte éponyme, en accordant un chœur, imposait au poète de sérieux devoirs. Il s'agissait de faire comprendre aux artistes ce qu'on exigeait d'eux ; de les initier profondément au sens des compositions nouvelles qu'ils allaient eux-mêmes interpréter à la foule; de leur donner ces leçons sans lesquelles l'œuvre la plus parfaite courait le risque de rester lettre morte et pour eux et surtout pour les spectateurs. Le poète seul était capable de pareils soins. C'était lui qui réglait et disposait souverainement toutes choses; c'était lui qui enseignait, selon le terme consacré (διδάσκειν), sa pièce ou ses pièces aux artistes que le chorège mettait à sa disposition. Ce mot d'enseignement n'avait rien d'exagéré, si l'on songe à tout ce qu'il fallait dépenser de temps, de patience et de peine, afin de préparer dignement une solennité qui ne perdit jamais complètement son caractère religieux, et qui n'était pas, pour les compétiteurs, une affaire de lucre simplement, ou même de gloriole littéraire.
Ce qui résulte de cette longue discussion, que j'aurais voulu pouvoir abréger, et qui eût demandé bien d'autres développements encore, c'est qu'Eschyle n'a rien eu, ou presque rien, à inventer dans son art. Quand Eschyle parut, il y avait longtemps déjà que la tragédie était constituée. Le théâtre était construit; l'appareil scénique existait; les mètres poétiques étaient fixés; les concours dramatiques avaient tout leur éclat, et ils conviaient périodiquement la vive et intelligente population de l'Attique aux fêtes de l'esprit et du génie. Le drame satyrique même n'était plus à naître. Ne disons donc pas, avec Quintilien, qu'Eschyle, le premier, a mis des tragédies au jour. Eschyle n'est pas l'inventeur de la tragédie. Non xxxii certes ! mais il a donné à la tragédie le souffle divin, la vie et la durée immortelles; et c'était là la grande, la véritable, l'unique invention. Il y avait longtemps aussi qu'on représentait des tragédies sur notre théâtre, quand la merveille du Cid a paru : c'était après Jodelle, Garnier, Hardy, Tristan, Mairet, Rotrou même; et pourtant Corneille est le père de la tragédie française. Voilà dans quel sens Eschyle est le père de la tragédie antique. Et voilà aussi comment W. Schlegel a pu dire que la tragédie sortit, armée de toutes pièces, du cerveau d'Eschyle, de même que Pallas s'était élancée de la tête de Jupiter.
GÉNIE D'ESCHYLE.
Admiration des Athéniens pour Eschyle. — Erreurs des Français sur Eschyle. — Style d'Eschyle. — Art d'Eschyle. — Elévation morale d'Eschyle. — Eschyle poète lyrique. — Drames satyriques d'Eschyle. — Caractère des tragédies d'Eschyle. — Comparaison d'Eschyle avec Sophocle et Euripide. — Qualités dramatiques d'Eschyle. — Jugement d'Aristophane sur Eschyle.
Eschyle vivant avait eu, dans ses contemporains, des admirateurs dignes de lui ; Eschyle mort fut presque un dieu pour les Athéniens. Un siècle plus tôt, ils lui auraient élevé des temples, comme Smyrne jadis en avait élevé à Homère. Ils prouvèrent du moins, par de signalés témoignages, leur enthousiasme et leurs regrets. Ils lui rendirent le plus grand honneur qu'on pût faire à un poète dramatique : ils voulurent que ses tragédies reparussent dans ces concours où déjà tant d'entre elles avaient triomphé; et il arriva plus d'une fois qu'elles triomphèrent de nouveau (63). « Ma poésie n'est point morte avec moi, » s'écrie fièrement Eschyle, dans les Grenouilles d'Aristophane (64). Cette vie nouvelle, cette personnalité, si j'ose ainsi dire, la poésie d'Eschyle l'eut seule en partage. Ni celle de Sophocle ni celle d'Euripide ne jouirent de ce beau privilège. Eschyle fut l'objet d'une éclatante et unique exception. Il resta, pour les Athéniens, le poète national par excellence ; et aucune renommée ne balança jamais, dans leur estime, le souvenir de l'homme qui avait chanté Salamine et l'Aréopage.
Tous les autres honneurs qui furent d'ailleurs décernés à Sophocle et à Euripide, on les accorda également à leur devancier. Pausanias put voir encore, dans le théâtre d'Athènes, le xxxiv portrait d'Eschyle à côté de ceux d'Euripide et de Sophocle (65). Eschyle avait aussi, comme ses deux illustres rivaux, une statue de bronze dans Athènes. C'est Lycurgue, le célèbre orateur, qui avait proposé le décret d'érection. Sur la proposition du même citoyen, l'État avait fait les frais d'une copie complète et authentique des œuvres des trois grands tragiques. Le greffier de la république en avait la garde. C'est sur l'exemplaire officiel que les acteurs collationnaient leur texte Su rectifiaient les erreurs de leur mémoire, avant la représentation; et cette opération préliminaire était obligatoire (66).
Ce n'est pas tout. Les représentations du théâtre étaient rares ; les livres étaient chers et peu répandus : la Grèce ingénieuse trouva moyen de satisfaire à souhait son besoin poétique. Eschyle eut ses rhapsodes comme Homère : ils chantaient, une branche de myrte à la main (67).
Les modernes n'ont rien compris, pendant bien longtemps, à l'admiration des anciens pour Eschyle. Je parle surtout des Français, et des Français du dernier siècle. Au xviie siècle, Eschyle était à peu près inconnu. Saumaise l'avait déclare inintelligible (68), lui pourtant que n'effrayaient pas les choses obscures et épineuses. Racine n'appréciait guère d'Eschyle que quelques scènes, les premières des Choéphores (69). Au xviiie siècle, Eschyle ne fut plus inconnu, mais mal connu. Un homme qui avait de l'esprit et quelque littérature, et qui lisait les poètes dramatiques delà Grèce dans leur langue» ou à peu près, se crut appelé par la Providence divine à en répandre la connaissance et le goût. Il dévoua à cette grande, œuvre tous ses loisirs, tout son savoir, tout son esprit; il xxxv lima avec soin toutes les parties de son travail, et il produisit, au bout de longues années, un des plus mauvais livres qu'on ait jamais publiés. L'auteur se nomme Brumoy, et son ouvrage est le Théâtre des Grecs. L'intention de Brumoy était excellente, le résultat fut désastreux. On le prit au mot : on accepta pour théâtre des Grecs le Théâtre des Grecs (70) du jésuite Brumoy ; et l'on conclut que Crébillon était un bien autre génie que ces Eschyle, ces Sophocle, ces Euripide, tant vantés, et que les tragédies de Guimond ou de Lafosse étaient la véritable fleur et le parfum de la poésie dramatique. Aux yeux des critiques d'alors, la tragédie antique, c'est quelque chose qui n'existe pas, ou qui existe à peine, ça et là, chez Sophocle et chez Euripide. Quant à Eschyle, on a des mots tout faits : Absurde ! Monstrueux! et ces mots dispensent de toute autre raison. Rien n'est plus mérité, je l'avoue, que de telles épithètes, si vous cherchez Eschyle, comme faisait la paresse ignorante de nos pères, dans les fantastiques et ridicules analyses de Brumoy. Je renvoie particulièrement le lecteur à celle des Euménides : c'est le chef-d'œuvre du genre ; c'est une bouffonnerie dont il est impossible de se faire une idée.
Si par hasard, en ce temps-là, un homme de bon sens essayait, tant bien que mal, de traduire Eschyle et de ramener l'opinion égarée, on criait bien vite: Au traducteur ! c'est-à-dire, dans l'opinion du siècle : Au sot dupé qui allèche les autres ! C'est ce qui est arrivé à Lefranc de Pompignan. Il faut voir comme certain critique le malmène à propos d'Eschyle. Si Diderot signalait la puissance dramatique dont le poète avait fait preuve dans les Euménides, on ne voyait là qu'un paradoxe de plus, à côté de tant d'autres paradoxes. Si Barthélémy parlait autrement que tout le monde, évidemment c'était son métier. Il avait pris, disait-on, l'engagement de ne point penser : il colligeait, il compilait les sottises des anciens.
La gloire n'a jamais tort. Ce mot de Cousin sur Abélard s'est aussi vérifié en ce qui concerne Eschyle. On a retrouvé les titres du poète à l'estime de la postérité : il suffisait, en effet* de le lire lui-même. A la place de cette pâle et infidèle image qu'on appelle la traduction de Pompignan, nous avons eu la traduction de La porte du Theil, qui est encore, malgré ses défauts bien connus, une des meilleures copies que nous xxxvi possédions de l'antiquité grecque. l'Agamemnon de Lemercier appela l'attention sur le vieux chef-d'œuvre où l'on avait su puiser tant d'inspirations pleines de puissance et de vie. Il y eut enfin des critiques qui avaient autre chose que de l'esprit, et qui avaient étudie les tragiques de la Grèce. Schlegel, le célèbre historien de l'art dramatique, a parlé d Eschyle dans un style digne du poète : c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans son livre. Lemercier, devenu critique, a jugé son noble modèle en homme compétent et en artiste passionné. M. Villemain dit quelque part un mot profond sur la délicatesse et la pudeur de l'art antique; et c'est Eschyle, c'est ce barbare, cet écrivain si longtemps conspué, qui fournit l'exemple. D'autres, moine célèbres, ont travaillé, dans la mesure de leurs forces, à cette œuvre de justice; et la réhabilitation du poète est complète aujourd'hui. J'ai tâché aussi d'y être pour quelque chose, et j'entends dire depuis longues années que mes efforts n'ont pas été tout à fait vains.
Le temps n'est donc plus, grâce à Dieu, où l'on pouvait impunément parler de la barbarie du style d'un tel poète, et comparer sa langue à celle des Jodolle et des Garnier, nos anciens tragiques. Contemporain de Pindare et de Simonide, héritier de cinq siècles de poésie, Eschyle est digne et de ses devanciers et des poètes qu'il avait sous les yeux; il est digne surtout de cet incomparable Homère, qu'il appelait son modèle. Il disait modestement que ses tragédies n'étaient que les reliefs des festins d'Homère (71). Ce ne sont pas seulement les reliefs de ces antiques et splendides festins qu'il a eus en partage : la table d'Eschyle, si j'ose continuer la figure, n'a. rien à envier, pour le choix et pour l'abondance, à celle des plus opulents et des plus délicate. Je ne prétends pas dire qu'Eschyle soit la perfection même. Il n'est-pas difficile de relever, dans ses œuvres, des bizarreries plus ou moins choquantes, des comparaisons fausses, des images outrées, des expressions que n'avouerait pas un goût sévère. Mais ces défauts sont plus rares que certains ne le crient, et rachetés par combien de qualités! Ne vous arrêtez point à compter les taches du visage; contemplez la figure entière dans son ensemble et dans sa majesté. L'Eschyle qui apparaîtra à vos yeux, c'est un génie de premier ordre, un esprit vaste et élevé, un admirable artisan de style.
xxxvii L'art, chez lui, n'était pas un pur instinct; il y avait mieux que ce démon qu'on nous peint quelquefois soufflant aux bons jours des choses merveilleuses à l'oreille des poètes inspirés. C'était un homme sérieux et grave, un penseur taciturne. Tous les mots qu'on a conservés de lui portent l'empreinte d'une réflexion profonde. Je ne crois donc guère que Sophocle ait jamais dit, comme on le lui fait dire : « Eschyle fait ce qui est bien, mais sans le savoir. » Si Sophocle parlait de la sorte, il le faut taxer de prévention et d'injustice. Qu'on en juge sur une preuve décisive. Un jour Cynégire et Amynias pressaient leur frère de composer un nouveau péan : « Non, répondit Eschyle; l'hymne de Tynnichus est excellent. Je craindrais qu'il n'en fût du mien comme des nouvelles statues comparées aux anciennes : celles-ci, avec toute leur simplicité, sont tenues pour divines; les nouvelles, travaillées avec tant de soin, sont admirées il est vrai, mais il y en a bien peu qui produisent l'impression de la divinité. « Est-ce là le langage d'un homme qui ne fait bien que par hasard? Quel poète s'est jamais fait une idée plus claire et plus haute des conditions essentielles de la vraie beauté?
L'étude attentive delà composition dramatique des tragédies d'Eschyle, de l'ordonnance des scènes, du rapport des personnages entre eux, des caractères du dialogue et de la diction, a prouvé que s'il y avait un reproche à faire au poète, ce n'est pas d'avoir manqué d'art, c'est d'avoir poussé l'art jusqu'à l'excès Tout semble réglé, chez lui, par une loi de rigoureuse symétrie. Partout, ou presque partout, chaque chose a son pendant : images, pensées, tableaux. Cela est particulièrement manifeste dans les dialogues monostiques ; mais il y a un très-grand nombre de passages où la correspondance, comme dit AI. Paul Mesnard, est mise en relief par la similitude des tours, souvent même des mots. Le même critique a signalé la frappante ressemblance qu'il y a entre la scène de l'Agamemnon où Clytemnestre, debout près des deux victimes, justifie sa vengeance, et la scène des Choéphores où Oreste, près de deux cadavres aussi, rappelle le crime de sa mère, et témoigne de la justice du coup qui l'a frappée, elle et le complice du forfait. M. Henri Weil, le savant éditeur d'Eschyle, a même construit tout un système sur les procédés de l'art du poète (72).
xxxviii. Qu'on adopte ou qu'on rejette le système, il reste toujours qu'Eschyle a été le plus conscient des artistes : « Il y a, dit Otfried Millier, de nombreuses scènes où le vers répond au vers, comme le coup au coup. Il y en a d'autres où deux vers, et quelquefois davantage, sont opposés les. uns aux autres de la même manière. Des scènes entières même, dans lesquelles le dialogue est mêlé aux chants lyriques, nous offrent les mêmes contrastes symétriques que les strophes et les antistrophes (73). » Rien de plus vrai que ces remarques de l'éminent historien des lettres grecques. Voyez par exemple, dans les Choéphores, la scène qui suit la reconnaissance d'Electre et d'Oreste, et où se prépare le complot contre Égisthe et Clytemnestre. Les gémissements et les paroles de vengeance se succèdent et se répondent, tantôt entre Electre et le chœur, tantôt entre Electre et Oreste, en couplets alternés avec une régularité absolument incontestable. Mais il y a bien d'autres scènes qui confirment le dire d'Otfried Müller.
Certes, la poésie d'Eschyle ne ressemble pas toujours à ce que nous sommes habitués à admirer; mais elle n'est pas plus mauvaise, tant s'en faut, parce qu'elle déborde, et de toutes parts, hors des cadres étroits où les faiseurs de poétiques prétendent enserrer le génie. Il y a au moins une chose qu'on ne contestera pas, c'est la valeur morale du poète. Ses drames n'étaient pas simplement une récréation pour les yeux, ni même pour l'esprit : élever, épurer, fortifier l'âme, voilà le but que sans cesse il se propose. Le sens de ses compositions est quelquefois sublime ; l'inspiration qui y vit d'un bout à l'autre est toute patriotique et religieuse; et les grandes vérités n'ont jamais eu d'interprète plus convaincu qu'Eschyle, ni plus digne : c'est le prêtre du devoir, si je l'ose ainsi dire; c'est le héraut de la vertu. Sa morale n'est point cette petite morale que prêchent quelques habiles, et qui se réduit au savoir-faire. Ce n'est pas non plus cette morale un peu trop molle et facile, qui sied aux hommes faibles de cœur : Eschyle est souvent dur et impitoyable comme le Destin. Mais sa grande âme est partout; partout éclate, énergique et impérissable, ce sentiment, si effacé, si obscur chez Euripide et chez tant d'autres poètes, qui n'étaient point d'Athènes, hélas l ni du siècle de Périclès; je veux dire le sentiment de ce qui est bien et de ce qui est mal : nul homme peut-être, à coup xxxix sûr nul poète au monde, ne l'a porté en lui, marqué d'aussi resplendissants caractères.
Quelques-uns borneraient volontiers la gloire littéraire d'Eschyle à l'enthousiasme lyrique, à l'énergie, à la noblesse et à la pompe du style, à l'originalité de la diction. Sans doute, Eschyle est poète lyrique avant tout ; et l'on sent circuler encore, à travers sa tragédie, le souffle de l'antique dithyrambe. Mais Eschyle n'est pas tout entier dans les chants qu'il prête à ses chœurs; et ces chants eux-mêmes sont autre chose que de pures fantaisies poétiques. Les chœurs d'Eschyle font partie essentielle du drame : c'est à eux que s'applique à la lettre la définition d'Horace (74); ils jouent réellement un rôle de personnage, et jamais ils ne disent rien qui n'ait trait au dessein de la pièce et ne cadre exactement avec l'action. Ajoutez que le poète lyrique ne se tient pas toujours dans les régions sublimes, et qu'il trace quelquefois des tableaux d'une fraîcheur et d'une naïveté exquises, et comparables aux plus charmantes productions d'Anacréon ou de Sappho. J'en appelle, sur ce point, à ceux qui ont lu les chants des Océanides et les consolations qu'elles adressent à Prométhée. Il n'est pas jusqu'à l'Agamemnon, où l'on ne trouve des merveilles de sentiment et de grâce : ainsi la description des chagrins de Ménélas, après la fuite de son épouse ; ainsi ce portrait d'Hélène, à son entrée dans Ilion : a Ame sereine comme le. calme des mers; beauté qui ornait la plus riche parure; doux yeux qui perçaient à l'égal d'un trait; fleur d'amour fatale au cœur (75). »
Mais le poète dramatique ne le cède ni en puissance ni en génie au poète lyrique. Et non-seulement Eschyle a excellé dans la tragédie, mais il a excellé dans le drame satyrique même. Au dire des anciens, les drames satyriques d'Eschyle remportaient et sur ceux de Sophocle et sur ceux d'Euripide. Nous ne pouvons nous faire qu'une idée fort imparfaite de l'espèce de verve comique qu'un homme de la trempe d'Eschyle avait pu déployer dans ces ouvrages. Mais une chose dont nous pouvons juger encore aujourd'hui, c'est que sa muse ne croyait pas déroger, en quittant le ton grave et l'accent passionné, pour rire un instant avec les satyres et égayer le bon Bacchus. Je n'en veux d'autre preuve que ce fragment des Argiens, où xl l'on voit déjà comme un avant-goût des grotesques inventions des Eupolis et des Aristophane : « C'est lui qui se servit contre moi d'une arme ridicule. Il me lance un fétide pot de nuit, et il m'atteint. Au choc, le vase se brise en éclats sur ma tète, exhalant une odeur qui n'était pas celle des vases à parfums. »
Je ne me dissimule pas tout ce qu'il faut d'étude et de bonne volonté pour se mettre en état de dignement apprécier les tragédies d'Eschyle. Ces antiques monuments ne sont pas de ceux qu'on peut mesurer du premier coup d'œil. Il faut y entrer résolument, les contempler dans toutes leurs parties, se familiariser avec eux, s'accoutumer peu à peu à ce qu'ils offrent d'abord d'insolite ou d'étrange. C'est quand on y a vécu, c'est quand on en a pénétré les profondeurs, qu'on est en droit de dire: « J'en connais les proportions ; » de s'établir en juge, de porter une sentence équitable. Les traductions sont des guides plus ou moins fidèles, qui dirigent les pas du visiteur, qui l'empochent de s'égarer. Mais ne les prenons pas pour autre chose. La meilleure traduction d'Eschyle, c'est encore très-peu Eschyle. Si exacte qu'on la suppose, Eschyle ne s'y montre toujours que sous les traits les plus grossiers de sa physionomie. Ne jugeons pas les poêles sur les traductions, surtout les poêles grecs, surtout Eschyle. Faisons-nous Athéniens; lisons Eschyle même, je dis le texte original ; secouons notre paresse ; ne nous en tenons ni aux à peu près,, ni aux opinions vulgaires ; et Eschyle sera bientôt vengé des ridicules sottises qu'ont écrites à son intention tant de gens qui n'avaient pas même essayé de déchiffrer le premier mot de son théâtre.
Ce n'est pas tout. Il y a des souvenirs qui troubleraient nos jugements, et qu'il faut écarter d'une main ferme et impitoyable. Oublions les tragédies de nos poètes; oublions même qu'il y a eu un Sophocle et un Euripide. Ne comparons Eschyle à personne: il n'a rien de commun avec tout ce que nous connaissons ; il ne ressemble à rien qu'à lui-même. Ne cherchons dans ses tragédies que ce qui s'y trouve, que ce qu'y a voulu mettre le poète : autrement nous irions errant de préjugés en préjugés, de déceptions en déceptions. Eschyle occupe dans l'histoire de l'art une place isolée, et qui n'est qu'à lui. Ses tragédies sont d'un genre qui ne s'est jamais reproduit sur aucune scène : c'est ce qu'Aristote appelle la tragédie simple. L'action, le drame, ce qui fait chez nous toute la tragédie, existe à peine dans Eschyle. Ce qu'on y voit, d'ordinaire, c'est une situation presque fixe, presque immobile, un xli tableau toujours le même, mais où la gradation de la peinture remplace la progression dramatique et les péripéties. Les personnages sont les personnages de ce moment donné ; ce ne sont pas, à proprement parler, des caractères, ou plutôt ce sont des caractères infiniment moins complexes que ce que nous nommons ainsi: chaque rôle n'est qu'un sentiment unique, qu'une idée, qu'une passion, celle que commande l'unique conjoncture. C'est l'unité absolue, si j'ose ainsi dire; ce sont des lignes parallèles, selon l'heureuse expression de Népomucène Lemercier ; mais la grandeur de ces lignes et leur harmonie sévère sont d'un immense et saisissant effet.
Lisez Eschyle, et vous conviendrez que l'absence de mouvement dramatique et de péripéties n'ôte pas tant qu'on l'imagine à l'intérêt du spectacle et à l'émotion du spectateur. C'est dire qu'Eschyle a eu le don de poésie en un degré extraordinaire. En effet, ces grands récits qu'il met dans la bouche des personnages ne sont guère moins propres à frapper les esprits que ne ferait la vue même des choses. Je l'ai dit ailleurs, à propos des Perses ; je puis bien ici le répéter encore, en étendant le mot à tout Eschyle : cette poésie est une perpétuelle hypotypose; c'est un tableau qui vit; c'est quelquefois une vie si réelle et si puissante, qu'on a vu de ses yeux ce que l'esprit seul vient de concevoir. On oserait presque s'écrier : « J'étais là I » Oui, nous connaissons les sept chefs, aussi bien que s'ils avaient paru sur la scène ; oui, nous avons vu Clytemnestre égorger Agamemnon: oui, nous étions avec le soldat-poète sur cette flotte qui sauva, à Salamine, la Grèce et peut-être le monde.
Le mot qu'on attribue à Sophocle sur Eschyle sert à faire comprendre, sinon ce que fut Eschyle, au moins ce que fut Sophocle. Personne n'a jamais su plus parfaitement que lui ce qu'il faisait. Sophocle est l'artiste par excellence, l'artiste habile entre tous à préparer l'effet qu'il veut produire, à disposer les moyens en vue de la fin. Il échappe absolument au blâme ; il n'a pas même ces instants de sommeil qu'Horace pardonne à Homère. Mais Sophocle n'a rien de l'audace d'Eschyle ; s'il atteint quelquefois au sublime, le sublime n'est pas son élément ordinaire. Ses héros sont encore de vrais héros; mais ils n'ont plus rien de titanique ni de gigantesque. La diction de Sophocle est loin de ressembler à ce le des prosateurs, infiniment moins pourtant que celle d'Eschyle. Ce ne sont plus les impétueux élans du dithyrambe, les tours extraordinaires, xlii les mots volumineux. Sophocle réduit à un rôle moral le chœur tragique, qui est souvent, dans Eschyle, le principal personnage. C'est encore, si l'on veut, une sorte de personnage, mais conseillant, dissuadant, plutôt qu'agissant ; mais représentant, pour ainsi dire, la conscience publique/et répondant à ce qui se passe dans l'âme môme des spectateurs. On voit si j'avais quelque raison de recommander qu'on ne comparât point Eschyle à Sophocle.
Que dirai-je donc d'Euripide? Le chœur ne figure, dans les tragédies d'Euripide, que par manière d'acquit, pour ainsi dire : non-seulement il n'y remplit aucun rôle, ni essentiel ni secondaire, mais il y est un véritable hors-d'œuvre, ou, si l'on veut, un simple remplissage d'intermèdes. Le style du poète, dans les chœurs mêmes, se sent à peine de l'enthousiasme lyrique : à peine y trouve-t-on quelque chose de cette ampleur de phrase et de cette majesté de ton qui distingue encore les chœurs de Sophocle. Dans le dialogue, Euripide ne diffère de la prose que par le choix exquis et la position des mots, et par leurs combinaisons métriques. Ses qualités dramatiques sont l'antipode, si j'ose dire, de celles d'Eschyle. Il a songé à émouvoir et à dominer les âmes, non à les purifier et à les instruire. C'est le peintre des passions humaines. Nul n'a jamais produit sur la scène, avec des traits plus vifs et plus poignants, les séductions du désir, le trouble des sens, l'anéantissement de la volonté, les ivresses de bonheur suivies du repentir et du désespoir ; en un mot, l'effrayante image de la raison abattue et détruite par le malheur. C'est le plus tragique des poètes, comme le caractérise Aristote.
Est-ce donc à dire qu'il faille borner la gloire d'Eschyle à cette puissance lyrique dont j'ai parlé, et à ces tableaux admirables où revit l'action qu'il n'a pas mise en scène? Quelques-uns ne feraient pas de difficulté d'en tomber d'accord ; mais la vérité me force bien de combattre une telle opinion. Eschyle a excellé dans le dialogue; et ses personnages, dans plus d'une circonstance, se donnent la réplique avec une verve et un entrain qu'on a pu égaler, mais non surpasser jamais. L'unique supériorité dé Sophocle, c'est d'avoir fait un habile usage du troisième interlocuteur, qu'on voit à peine figurer dans Eschyle. Pour le dialogue à deux, il n'existe rien de plus vif, ni même de plus dramatique, que maint passage d'Eschyle que je pourrais citer : je renvoie notamment le lecteur à la scène où le poète a mis en présence Prométhée et Mercure. Les critiques xliii anciens prétendent qu'Eschyle fut le premier qui introduisit dans la tragédie le deuxième interlocuteur; c'est-à-dire qu'avant lui, tout se passait entre le chœur et un seul personnage, et qu'il n'y avait pas de dialogue de deux personnages entre eux. Mais il ne nous importe guère que ce soit Eschyle, ou Phrynichus, ou tout autre, qui ait inventé le dialogue véritable : il nous suffît qu'Eschyle y ait excellé.
Il y a une autre partie de la perfection dramatique, et la plus importante peut-être, qui n'a pas manqué non plus à Eschyle : c'est l'art d'exposer le sujet. Il délègue quelquefois ce soin au chœur lui-même, qui s'en acquitte à merveille; mais il sait aussi mettre en action ses personnages dès le début, et entamer par le vif, avec un rare bonheur, toutes les émotions de notre âme. Sophocle lui-même n'a rien qu'on puisse comparer, pour la terreur et l'intérêt, à l'exposition du Prométhée.
Je n'ai guère fait qu'effleurer les questions que soulève le nom d'Eschyle ; pourtant je m'arrête. Traducteur, c'est-à-dire suspect, à mes impressions personnelles j'aime mieux substituer quelques mots du critique des critiques. Je laisse parler l'homme devant qui n'avaient trouvé grâce ni le génie politique, ni la valeur militaire, ni la vertu même : Aristophane.
On connaît le sujet des Grenouilles. Eschyle, Sophocle et Euripide sont morts ; Agathon a quitté Athènes. Dégoûté des mauvaises tragédies qu'on jouait dans ses fêtes, Bacchus va aux enfers chercher un poète digne de lui. Il part, travesti en Hercule, la massue sur l'épaule, drapé dans la peau du lion ; mais il n'a d'Hercule que la vaine apparence. Un esclave le suit, monté sur un âne : c'est l'homme aux bons mots, aux plaisantes saillies, une sorte de Sancho Pança, bien gourmand et bien poltron. Le dieu, après diverses aventures, traverse le Styx dans la barque de Caron, accompagné du coassement harmonieux des grenouilles. Il arrive : les enfers étaient en révolution. Euripide y disputait le trône de la tragédie, occupé depuis longtemps par Eschyle. Eschyle défendait avec une vigueur invincible sa domination menacée. Bacchus assiste en juge à ce grand débat. Il fait exposer aux deux parties tous leurs arguments, et, sur l'invitation de Pluton, il prononce la sentence. C'est à Eschyle que Bacchus décerne l'empire ; c'est lui qu'il emmène sur la terre. Euripide n'a pas même la satisfaction de remplir aux enfers l'interrègne : pendant l'absence d'Eschyle, le sceptre tragique reste aux mains de Sophocle, Le chœur xliv de la comédie, non plus les grenouilles, mais les ombres des initiés des mystères d'Eleusis, caractérise en traits admirables les deux rivaux qui vont entrer en lutte :
« Oui, le poète au frémissant langage sentira dans son cœur une vive colère, quand il verra son rival au babil rapide aiguiser ses dents. Alors, saisi d'une fureur terrible, il roulera çà et là les yeux. Et ce sera une guerre acharnée: d'un côté, les mots au panache flottant ; de l'autre, les vaines subtilités du bel esprit, les bribes misérables; ici, un assaillant décidé; là, un génie inventeur, et ce style qu'emportent des coursiers. Celui-ci, agitant sur sa tête sa chevelure hérissée et fronçant son sourcil redoutable, poussera des rugissements : il tirera de sa poitrine", avec le souffle d'un géant, des expressions solidement charpentées comme le pont d'un navire; tandis que celui-là, habile artisan de paroles, langue souple et déliée, éplucheur de vers, rongera le frein de l'envie, disséquera les phrases de son rival, et mettra en pièces le produit d'une inspiration puissante (76).»
Eschyle est là tout entier, tout vivant. Voilà le soldat de Marathon, avec son âme irascible; voilà son sourcil olympien, son épaisse crinière: vous apercevez le lion; vous vous apprêtez à l'entendre rugir. Essayez, si vous le pouvez, après Aristophane, de parler du style des poètes antiques, et de dire quel fut celui d'Eschyle. Voici quelques mots empruntés au rôle d'Eschyle lui-même :
« Oui, ce sont là les sujets que doivent traiter les poètes. Vois, en effet, quels services ont rendus, dès l'origine, les poètes illustres. Orphée a enseigné les saints mystères et l'horreur du meurtre; Musée, les remèdes des maladies et les oracles ; Hésiode, l'agriculture, le temps des récoltes et des semailles. Et ce divin Homère, d'où lui est venu tant d'honneur et de gloire, si ce n'est d'avoir enseigné des choses utiles : l'art des batailles, la valeur militaire et le métier des armes (77) ?
« Mais il en a formé bien d'autres, et de braves; et, dans ce nombre, Lamachus le héros. C'est d'après Homère que j'ai représenté les exploits des Patrocle et dos Teucer au cœur de lion, pour inspirer à chaque citoyen le désir de s'égaler à ces grands hommes, dès que retentira le son de la trompette. Mais, xlv certes, je ne mettais en scène ni des Phèdres prostituées ni des Sthénobées ; et je ne sais si j'ai jamais représenté une femme amoureuse (78). »
PIÈCES D'ESCHYLE.
Fécondité d'Eschyle. — Trilogies et tétralogies. — Les Myrmydons. — Trois fragments. — Diversité des pièces d'Eschyle. — Dates des tragédies qui nous restent — Authenticité du texte. — Des prétendus remaniements commandés par les Athéniens. — Conclusion.
Eschyle a été d'une fécondité merveilleuse. Le nombre des pièces dont on connaît les titres est très-considérable, et peut-être n'a-t-on pas les titres de toutes les pièces que le poète avait composées. II est vrai que la même pièce est citée quelquefois sous divers titres. Les éditeurs comptent quatre-vingts pièces environ, tragédies ou drames sa lyriques. C'est le chiffre moyen entre l'estimation la plus haute et l'estimation la plus basse. Les cent titres et plus, relevés par Meursius, ne permettent guère de descendre, tout compensé, au-dessous de quatre-vingts pièces. Ajoutons que, si le biographe anonyme n'en attribue à Eschyle que soixante-quinze, Suidas dit qu'Eschyle avait laissé quatre-vingt-dix tragédies.
Le biographe prétend que, sur les soixante-quinze pièces, il y avait soixante-dix tragédies, et seulement cinq drames satyriques. Cette assertion est parfaitement erronée, et elle ne saurait soutenir le moindre examen. Outre les Hérauts, Circè, Cercyon, le Lion, Protée, qui étaient certainement des drames satyriques, et qu'on nomme toujours comme tels, il en faut compter plusieurs autres encore, soit d'après de sûrs témoignages, soit d'après la nature même des fragments qu'on en a conservés. Tels sont Prométhée allumeur du feu, Sisyphe transfuge, Amymone, Glaucus marin, le Sphinx, les Argiens, etc. Le fragment des Argiens que j'ai cité plus haut ne souffre guère de réplique.
Quand Eschyle présentait une tétralogie au concours, il ne s'astreignait pas toujours à donner trois tragédies formant xvii entre elles un tout dramatique, ni surtout quatre pièces tirées de la même légende. Bien souvent, les quatre pièces n'avaient aucun rapport les unes avec les autres. L'examen des débris de son théâtre ne laisse aucun doute à ce sujet. Nous en avons d'ailleurs une preuve directe dans la didascalie des Perses : les trois pièces jouées le même jour que les Perses n'avaient rien de commun avec l'invasion des Mèdes; et l'on verra, dans l'argument? que j'ai mis en tête de la tragédie qui nous reste, s'il est possible d'établir la moindre apparence de lien dramatique entre elles. Ce qu'Eschyle a fait ce jour-là, il avait dû le faire déjà plus d'une fois auparavant, et il a dû le faire plus d'une fois depuis.
Nous ne savons pas combien Eschyle avait composé de trilogies proprement dites; mais il n'est pas téméraire d'avancer que la moitié environ de ses pièces formaient des groupes du genre de l'Orestie. Il y a des trilogies dont nous avons les titres généraux; il y en a dont l'existence n'est que probable; il y en a enfin qui sont plus ou moins conjecturales. Le Prométhée enchaîné, d'après l'opinion de la plupart des critiques, était la seconde pièce d'une trilogie, dont la première pièce était intitulée Prométhée porteur du feu, et la troisième, Prométhée délivré. Les Sept contre Thèbes faisaient également partie d'une trilogie. On le conjecturait jadis; c'est un point hors de doute aujourd'hui. Une didascalie, récemment découverte, nous apprend qu'on avait représenté les Sept contre Thèbes après deux autres tragédies intitulées, l'une Laïus, et l'autre, Œdipe; mais on ignore si la trilogie avait un titre général. La légende des Labdacides semble avoir fourni au génie d'Eschyle le sujet de plusieurs autres tragédies; mais les titres de ces tragédies n'indiquent pas clairement s'il y avait une autre trilogie que celle dont faisaient partie les Sept contre Thèbes. Les Suppliantes étaient la seconde pièce d'une trilogie intitulée la Danaïde, dont la première pièce se nommait les Égyptiens, et la troisième, les Danaïdes. Ainsi, sans sortir des pièces que nous possédons, voilà déjà trois ou peut-être même quatre trilogies : la Danaïde, l'Orestie, la trilogie ou les trilogies thébaines.
La légende de Bacchus avait été largement exploitée par Eschyle, comme par les premiers poètes tragiques. Il est certain qu'Eschyle en avait tiré une trilogie intitulée la Lycurgie. Les titres particuliers des trois tragédies étaient : les Édons, les Bassarides, les Jeunes Hommes. On conjecture xlviii que trois autres tragédies, empruntées à la même légende, Sémélé ou les Hydrophores, Penthée ou les Bacchantes, et les Cardeuses de laine, formaient également une trilogie, et même que cette trilogie se nommait Penthée, je dirais plutôt la Penthéide.
Quelques-uns croient, mais sans beaucoup de fondement, que la Niobé du poète était, comme les Sept, comme les Suppliantes, une portion de trilogie. Bien ne prouve que les deux tragédies qu'on rattache à celle-là, savoir les Nourrices et les Gens du cortège, aient eu le moindre rapport avec la légende de Niobé. La trilogie intitulée Athamas se composait, selon les critiques, des trois tragédies suivantes : les Faiseurs de filets ou les Tireurs de filets, Athamas, les Théores ou les Isthmiastes. On réunit, sous le titre de Perséide, trois pièces qui embrassaient, à ce qu'on suppose, les principaux faits de la légende de Persée : Danaé, les Phorcydes, Polydecte. La tragédie intitulée Etna était, dit-on, la troisième pièce d'une trilogie intitulée elle-même Etna, ou les Femmes elnéennes; les deux autres pièces étaient Alcmène et les Héraclides, et la légende des Paliques se rattachait par quelque point à la légende d'Hercule. Il est douteux que l'Iphigénie d'Eschyle doive compter, comme le veulent certains critiques, pour la première, ou la seconde, ou la troisième pièce d'une trilogie, dont les deux autres pièces auraient été les Faiseuses de lit et les Prêtresses. Non-seulement on ignore comment les trois pièces se suivaient, mais on ne sait pas même ce qu'étaient ni ces Prêtresses, ni ces Faiseuses de lit, ni comment de pareils titres peuvent avoir eu rapport à l'histoire de la fille d'Agamemnon. Quelques-uns donnent le nom d'Iliade tragique à une trilogie dont Achille était le héros, et dont l'existence est incontestable. Les trois tragédies portaient les titres suivants : les Myrmidons, les Néréides, les Phrygiens. On suppose que la tragédie intitulée Psychostasie, c'est-à-dire la Pesée des âmes, faisait partie d'une trilogie, et que cette trilogie portait le nom d'Éthiopide. Mais ce n'est là qu'une simple conjecture : c'est à peine s'il est prouvé qu'Eschyle avait fait une tragédie de Memnon; et la troisième pièce de la prétendue trilogie sur le fils de l'Aurore n'est pas, même connue. Il est possible qu'on lien dramatique ait uni entre elles les trois tragédies dont Ajax et Teucer étaient les héros, et qu'on range dans cet ordre : le Jugement des armes, les Femmes thraces, les Salaminiennes.
xlix Les drames satyriques étaient quelquefois tirés de la même légende que la trilogie, et certains groupes dramatiques d'Eschyle étaient des tétralogies, dans le sens le plus strict du terme. Telle était la tétralogie dont l'Orestie était la principale portion : Protée, le drame satyrique qui suivait l'Orestie, était emprunté, comme tout le reste, à la légende des Atrides. Telle était la tétralogie dont faisaient partie les Sept contre Thèbes; seulement le Sphinx, qui suivait la trilogie, faisait rétrograder l'action jusqu'au temps de la première ou de la seconde tragédie. Telle était la tétralogie terminée par le drame satyrique intitulé Lycurgue : la Lycurgie se prenait tantôt pour la trilogie tragique, tantôt pour la tétralogie entière. Il y avait probablement d'autres tétralogies dans le même cas que la Lycurgie, que la tétralogie thébaine, que la tétralogie sur les Atrides.
Les fragments des pièces perdues ne sont ni très-nombreux ni très-importants. Le plus considérable de tous ne nous a pas . même été conservé dans la langue originale. C'est un passage du Prométhée délivré. Il n'existe qu'en latin. Tout le monde a lu les beaux vers où Cicéron, dans les Tusculanes (79), a transcrit Eschyle avec une énergie et une verve dignes d'Eschyle lui-même. Cette plainte de Prométhée est une des merveilles de la poésie latine.
Il n'y a guère qu'une seule des tragédies perdues, les Myrmidons, qui offre une suite de fragments ayant quelque intérêt dramatique. C'est là qu'on peut se faire une idée de la façon dont Eschyle imitait Homère. Le caractère d'Achille, dans les Myrmidons, était absolument conforme à l'image que nous formons du héros d'après l'Iliade. On va en juger par la mise en ordre et la transcription des fragments de la tragédie.
Hector attaque le camp des Grecs. Les compagnons d'Achille, réduits à l'inaction par leur roi, viennent lui faire des remontrances : « Tu vois ce qui se passe, illustre Achille; tu vois les souffrances des enfants de Danaus, détruits par la lance ; tu les as trahis, en restant sous ta tente (80). » Les Myrmidons n'obtiennent rien. Vaines également sont les prières des chefs de l'année: «Pourquoi donc, Achille de Phthie, quand tu entends le lugubre fracas du carnage, ne viens-tu point à l notre secours (81) ? » Antilochus, l'intime ami d'Achille, perd à son tour son temps et ses paroles. Achille est fier de résister aux reproches mêmes d'un ami : « Tu prétends, Antilochus, que c'est pure obstination : obstination, soit; il me plaît d'être obstiné. Qu'on m'appelle obstiné, pourvu que j'en fasse à ma tête; je m'y résous sans peine, peu m'importe le nom d'obstiné. Ma conduite est d'un homme de cœur; l'obstination est le partage des sots; tu me reproches sans raison un défaut, et tu me fais tort d'une vertu (82). »
Pendant qu'Achille s'applaudit de son inflexibilité, le feu est lancé sur les vaisseaux. Dans l'Iliade, c'est le navire de Protésilas qui brûle le premier. Dans les Myrmidons, c'était celui de Nestor, auquel Eschyle donnait l'épithète de décembole, dont le sens n'est point encore fixé. L'incendie détruit les ornements du navire, parmi lesquels était une figure représentant un hippalectryon, monstre formé de la réunion du cheval et du coq : « Puis après, le fauve hippalectryon se fond en gouttes, cette œuvre savante, formée de couleurs disposées avec art (83).»
Quelques indications de scholiastes et de grammairiens prouvent que tout se passait, jusqu'à la mort de Patrocle, chez le poète dramatique comme chez Homère. A la nouvelle de la catastrophe, l'Achille des Myrmidons s'écriait : « Des armes ! il me faut des armes (84) ! » mais, comme l'Achille de l'Iliade, il exprimait sa douleur avec une extrême énergie. Antilochus essaye d'apporter des consolations à l'affligé, de l'amener du moins à un peu de résignation: « C'est le propre des hommes vertueux et sages de ne pas s'irriter, dans le malheur, contre les dieux (85). » Mais Achille ne veut pas être consolé: « Oui, j'aime mon chagrin ; il n'a rien qui doive me le faire haïr (86). »
Antilochus pleure avec son ami ; alors l'âme d'Achille se détend ; l'attendrissement lait déjà place à la violence : « C'est moins sur le mort qu'il faut gémir, Antilochus, que sur celui qui vit. Tout est perdu pour moi (87). » On connaît l'ingénieux apologue de l'oiseau blessé d'une flèche. Achille, privé de ses li armes par sa faute, s'appliquait cet apologue à lui-même : « Tu sais ce que coûtent les Libyens dans leurs fables. L'aigle, blessé de la flèche lancée par un arc, disait, en voyant l'agencement du trait empenné : Elles ne viennent point d'autres ailes, mais des nôtres mêmes, ces plumes meurtrières (88). »
Il est probable que la pièce finissait par une scène entre Achille et sa mère. Thétis, par ses caresses et ses discours, rendait le calme à son fils ; puis elle le quittait pour aller chez Vulcain chercher l'armure avec laquelle Achille devait affronter et vaincre le vainqueur de Patrocle.
Les citations d'Eschyle, dans les écrits des auteurs anciens, ne sont presque jamais que des singularités mythologiques, géographiques, grammaticales ; et c'est là ce qui explique et leur extrême brièveté et la médiocrité de leur importance littéraire. Ce que j'ai traduit des Édons et des Argiens semble assez peu de chose ; et pourtant on chercherait en vain, dans toute la collection des fragments d'Eschyle, quelque chose d'aussi important pour nos études. Cependant il y a tel fragment qui nous intéresse, ou comme témoignage des pensées familières au poète, ou comme curiosité plus ou moins piquante. Ainsi ce tableau de la nature, dans les Danaïdes : α Le ciel aime à pénétrer la terre ; la terre, à son tour, désire cet hymen. La pluie qui tombe du ciel bienfaisant a fécondé la terre, et celle-ci enfante aux mortels les puissants troupeaux et les moissons de Cérès. C'est à ces noces humides que les arbres doivent leur beauté et la maturité de leurs fruits ; et tous ces effets viennent de moi (89). » Ainsi ce passage d'une pièce inconnue : « D'un pied agile le mal fond sur les mortels, et le crime sur celui qui transgresse la justice... Tu vois la justice muette, invisible à celui qui dort, ou qui marche, ou qui reste assis. Elle suit obliquement notre piste, et quelquefois tarde à nous atteindre. La nuit ne suffit point pour voiler nos forfaits. Songe, dans tous tes actes, qu'il y a des dieux qui te voient (90). » Mais il n'y a pas de fragment d'Eschyle qui puisse nous intéresser, nous autres Français, autant que ces paroles de Prométhée à Hercule, dans le Prométhée délivré : « Puis tu arriveras vers l'intrépide armée des Liguriens. Là, sache-le bien, le combat, malgré ta bravoure, ne te fera point défaut. Les lii destins ont décidé que les traits mêmes te manqueraient dans cette lutte ; et, quant à ramasser sur le sol aucune pierre, tu ne le pourras, car toute la contrée n'est qu'une terre molle. Mais Jupiter verra ton embarras, et il en aura pitié. Il étendra sous ses pieds une nue, et une grêle de cailloux ronds couvrira la terre. Ensuite, à l'aide de ces armes, tu frapperas les ennemis, tu mettras sans peine en déroute l'armée ligurienne (91). » Il s'agit là évidemment de la Crau. Eschyle versifie quelque mythe apporté à Athènes par les Phocéens de Marseille. « Ainsi, comme dit J.-J. Ampère, la Gaule a fait son apparition dans la poésie des Hellènes avant d'arriver à leur histoire. »
Eschyle a pris partout les sujets de ses tragédies. Les titres que j'ai plus haut transcrits en sont une preuve encore parlante ; et les sept pièces qui nous restent suffiraient, à elles seules, pour témoigner de la variété des inventions du poète. Le Prométhée enchaîné est emprunté aux traditions de la mythologie primitive ; il s'agit, dans les Suppliantes, d'une époque moins divine, mais qui n'est point encore repolie héroïque ; les Sept contre Thèbes appartiennent à ce qu'on nomme le cycle thébain ; l'Orestie, c'est-à-dire Agamemnon, les Choéphores et les Euménides, au grand cycle troyen ; les Perses étaient de l'histoire contemporaine.
Voici l'ordre dans lequel on range habituellement les sept tragédies :
1° Prométhée enchaîné ;
2° Les Sept contre Thèbes ;
3° Les Perses ;
4° Agamemnon;
5° Les Choéphores ;
6° Les Euménides ;
7° Les Suppliantes.
Cet ordre, qui est celui des manuscrits, ne représente pas exactement celui de la composition. Nous en pouvions douter autrefois ; mais la chose n'est plus permise aujourd'hui. Il n'y a nul inconvénient à laisser en tête le Prométhée enchaîné : la date de cette pièce est inconnue; on sait seulement qu'il ne faut pas la faire remonter au delà de l'an 479 avant notre ère. C'est par erreur qu'on a dit le Prométhée enchaîné postérieur liii aux Perses. Il s'agit bien d'un Prométhée représenté le même jour que les Perses, et après les Perses; mais cette pièce, nommée la quatrième dans la didascalie, ce Prométhée n'était pas le Prométhée enchaîné : c'était un drame satyrique. Les Perses sont de l'an 473, et les Sept contre Thèbes de l'an 468 seulement : il faut donc intervertir les rangs de ces deux tragédies ; et c'est ce que nous faisons ici, depuis que nous connaissons leurs dates respectives. Les quatre autres tragédies sont, chronologiquement, à leur place. Nous avons la date précise de l'Orestie; et tout semble prouver que les Suppliantes ont été composées en Sicile. A en juger par la manière dont le poète parle des Argiens, et par l'éloge qu'il fait de leurs vertus et de leur humanité, il n'y a guère de doute que la pièce ne soit postérieure au traité d'alliance conclu entre Athènes et Argos, vers la fin de la LXXIXe olympiade, l'an 461 avant notre ère. Eschyle, suivant quelques-uns, fait aussi allusion, dans les Suppliantes, à la guerre que les Athéniens, vers le même temps, avaient entreprise contre l'Egypte. Enfin on y a trouvé des expressions empruntées au dialecte de la Sicile, et qui semblent témoigner du lieu où habitait le poète : c'est là le sicélisme d'Eschyle, dont il est fait mention quelquefois dans les auteurs (92). J'ai restitué à la trilogie, Agamemnon, les Choéphores et les Euménides, son nom authentique, l'Orestie : j'ai cru qu'il n'était pas sans importance de marquer ainsi, même aux yeux, l'unité de cette vaste composition tragique.
La philologie moderne a soulevé, à propos d'Eschyle même, une question dont nous devons, en finissant, dire quelques mots.
Bœckh, dans le même livre que j'ai déjà plus d'une fois cité, remarque avec raison que la représentation d'une tragédie est pour le texte une source de corruption, et que la loi de Lycurgue prouve que les poètes dramatiques de la Grèce n'avaient pas échappé, tant s'en faut, à un inconvénient dont les poètes modernes sont souvent les victimes. Changements d'expressions, interversions, suppressions, interpolations, c'étaient là d'inévitables fruits ou de l'incurie des acteurs, ou souvent encore de leur présomption littéraire. Les poètes refont souvent eux-mêmes, pour une cause ou pour une autre, leurs propres ouvrages : ainsi l'Andrienne et la Périnthienne de liv Ménaodre étaient, au fond, la môme comédie. Il pouvait donc y avoir, authentiques et autographes, deux et môme plusieurs exemplaires différents de la même pièce. Eschyle a été, sons tous ces rapports, dans les mêmes conditions que les autres poètes dramatiques. De plus, les magistrats chargèrent des poètes de corriger, de façonner au goût du temps les pièces d'Eschyle, après la mort de l'auteur ; et, refondues, remaniées, retaillées ainsi, on vit ces tragédies remporter dans les concours tragiques de nouvelles victoires. On n'eut pas à chercher bien loin les correcteurs : on les trouva dans la famille même d'Eschyle, qui abondait effectivement en poètes dramatiques. Bœckh relève le nom de ses poètes, avec leurs titres et qualités (93). C'étaient :
1° Euphorion et Bion, fils d'Eschyle;
2° Philoclès Philopeïthis, son neveu, le même qui, au grand scandale des gens de goût, vit une de ses propres tragédies triompher de l'Œdipe-Roi de Sophocle ;
3° Morsimus, fils de Philoclès, mauvais poète tragique de l'aveu de tout le monde ;
4° Mélanthius, frère de Morsimus ;
5° Astydamas, fils de Morsimus, poëte tragique d'une prodigieuse fécondité ;
6° Un autre Philoclès et un autre Astydamas.
Enfin, dans les siècles de la décadence, il courait des opuscules, des poèmes, des tragédies, faussement attribués à des philosophes, à des historiens, à des poètes fameux. On trouve, dans Justin le Martyr, sous le nom d'Eschyle, des vers qui ne sont pas d'Eschyle.
Telles sont à peu près les remarques qu'a suggérées à Bœckh l'examen de cette question: «Avons-nous, oui ou non, le texte authentique et réel d'Eschyle? » Observons qu'il n'y a rien là qui puisse infirmer l'authenticité du texte que nous possédons. Ce texte nous vient, comme presque tous les textes des anciens poètes, et par une série de vicissitudes plus ou moins heureuses, des critiques alexandrins. Les Alexandrins n'ont pas fait autre chose que de transcrire l'exemplaire officiel du greffier d'Athènes. Ptolémée Évergète l'emprunta même ; et, tel était le prix qu'il y attachait, qu'il laissa aux Athéniens les quinze talents déposés par lui en gage, et qu'il lv garda le manuscrit (94) : procédé peu loyal, on en doit convenir, mais contre lequel il n'y avait alors, pour Athènes, à peu près nul recours.
Resterait à savoir si l'exemplaire officiel était lui-même une copie authentique. Il faut bien le croire. Lycurgue n'avait pas fait sa loi, ce semble, dans l'intérêt des fantaisies eschyléennes des Morsimus et des Astydamas. Il y a plus : tout ce travail de la famille tragique n'est qu'une supposition gratuite. Philostrate n'a jamais dit, comme on le lui fait dire, que les pièces d'Eschyle aient été rajeunies, avant de reparaître sur le théâtre. Je vais transcrire ses propres paroles, dont j'ai déjà donné plus haut le véritable sens : « Les Athéniens l'appelèrent, tout mort qu'il était, aux fêtes de Bacchus; car, sur leur décret, les pièces d'Eschyle furent de nouveau représentées, et elles remportèrent la victoire de nouveau (95). » Je sais que Quintilien affirme positivement le fait même que je nie ; mars il suffit de voir à quel propos et en quels termes il l'affirme, pour estimer à sa juste valeur ce prétendu témoignage. Après avoir caractérisé à sa manière les défauts d'Eschyle, il ajoute : « C'est pourquoi les Athéniens permirent à des poëtes postérieurs de rapporter ses pièces au concours, après les avoir corrigées ; et beaucoup d'entre eux furent ainsi couronnés (96). » Donc, selon Quintilien, les Athéniens se sont un jour imaginé de faire regratter les monuments de la muse d'Eschyle, parce qu'ils les trouvaient imparfaits ; et, non-seulement ils ont eu cette idée, mais les monuments, après le regrattage, leur ont semblé si beaux, qu'ifs n'ont pas cru pouvoir moins faire que de décerner aux correcteurs la couronne tragique. Les Athéniens, à ce compte, ne mériteraient guère leur réputation de peuple intelligent et spirituel entre tous. Mais l'absurdité de la conduite que Quintilien leur prête est une preuve suffisante qu'ils n'en ont point usé ainsi, lis n'ont pas plus songé à faire remanier le Prométhée ou les Perses, que nous ne songeons à perfectionner le Cid ou la Mort de Pompée. Les traces de ces corrections prétendues n'apparaissent nulle part dans les œuvres lvi d'Eschyle. D'ailleurs, l'esprit se refuse absolument à comprendre en quoi ces corrections auraient pu consister pour être, je ne dis pas un litre de haute estime à leurs auteurs, mais autre chose que des dégradations, des profanations abominables. Eschyle partout, Eschyle toujours, voilà ce qu'on trouve, du premier au dernier vers, et dans le Prométhée et dans les Perses, et dans les Sept contre Thèbes, et dans l'Orestie, et dans les Suppliantes. Si les tragédies du poète ont reparu dans les concours, et si elles y ont conquis de nouvelles victoires, c'est Eschyle mort qui a triomphé : les Astydamas n'y ont été pour rien, non plus que les Morsimus et les Philoclès;. Euphorion et Bion n'y ont pris d'autre part que la joie de bons fils à l'idée de la gloire paternelle ; et le peuple athénien ne leur avait point commandé de perpétrer un crime insensé, un véritable parricide.
TRAVAUX DE LA CRITIQUE.
Débris des travaux alexandrins. — Le Mediceus. — Imperfection de ce manuscrit. — Le scholiaste du Mediceus. — Les autres manuscrits d'Eschyle. — L'édition princeps. — Édition de Turnèbe. — L'exemplaire de Bosius. — Édition de Robortello. — Scholies de Robortello. — Édition de Pierre Victorius et Henri Estienne. — L'exemplaire de Tanneguy Le Pèvre. — Édition de Canter. — L'Agamemnon de Casaubon. — Édition de Stanley et autres éditions. — Édition de Boissonade. — Édition d'Ahrens. — Édition posthume de Hermann. — Édition de Weil. — Cinquième édition de G. Dindorf. — Corrections de Heimsœth. — Dissertation de Ch. Prince sur les Perses. — Révision de ma traduction. — Les traducteurs français : Pompignan, La Porte du Theil, Biard, Puech, Ad. Bouillet» Paul Mesnard, Léon Halévy. — Imitations de Dumas.
Le texte des tragédies d'Eschyle, comme celui de tous les chefs-d'œuvre de l'antiquité grecque, avait été l'objet de grands travaux chez les Alexandrins du Musée. Aristophane de Byzance et Aristarque avaient certainement donné des recensions de ce texte, et écrit des commentaires où en étaient élucidées les principales difficultés. D'autres après eux discutèrent à leur tour les problèmes philologiques et littéraires soulevés par ces illustres maîtres; et ce n'est point exagérer que de compter par centaines les volumes d'observations critiques accumulés sur Eschyle, durant les siècles florissants de l'école d'Alexandrie. Celte bibliothèque eschyléenne a péri à peu près tout entière. Ce qui en reste ne se compose que de débris, mutilés, déformés, gâtés de toute façon par l'ignorance byzantine. Mais il y a dans ces débris une foule de matériaux précieux, qu'on a peu à peu débrouillés et mis en lumière, et qui ont fourni presque tout ce que nous savons sur la vie et les ouvrages d'Eschyle; et c'est par les scholies et les gloses, autant et plus que par les manuscrits eux-mêmes, qu'on est venu à bout de constituer un texte d'Eschyle, sinon parfait, du moins suivi et intelligible.
Le plus ancien des manuscrits d'Eschyle aujourd'hui con- lviii nus est à Florence. C'est celui qu'on nomme Mediceus, et qu'on devrait appeler Laurentianus, car il appartient de temps immémorial à la bibliothèque Laurentienne. Il ne parait pas antérieur aux premières années du xie siècle. Il est en vélin, et d'une belle écriture cursive. Les tragédies d'Eschyle y sont précédées des tragédies de Sophocle, et suivies des Argonautiques d'Apollonius de Rhodes. C'est le seul manuscrit où l'on trouve les sept tragédies d'Eschyle : encore manque-t-il une très-grande partie de l'Agamemnon, ainsi que les premiers vers des Choéphores. Les feuillets manquants avaient déjà été arrachés, quand le volume arriva de Byzance en Italie; car le Camaldule Ambroise, qui l'eut alors entre les mains, dit qu'il ne contient que six tragédies d'Eschyle. Ambroise prenait pour une seule pièce Agamemnon et les Choéphores (97).
Le texte d'Eschyle, dans le Mediceus, est extrêmement corrompu, souvent même tout à fait barbare. Il est évident que le scribe n'était qu'un calligraphe inintelligent, et qui s'inquiétait peu d'accumuler bévues sur bévues, dès que ces non-sens étaient libellés en beau caractère. Mais la nature môme des altérations qu'il fait subir aux mots, aux syllabes ou aux lettres, prouve que sa copie est la transcription d'un manuscrit en onciales. Ce manuscrit en onciales était beaucoup plus correct que le Mediceus; et ses leçons, que la critique restitue sans trop de peine, sont la base principale sur laquelle ont édifié la plupart des éditeurs d'Eschyle.
Les scholies qui accompagnent le Mediceus, et toutes les additions et corrections mises après coup au manuscrit, témoignent de la science et de la capacité d'un grammairien qui connaît les bonnes sources, qui choisit bien les interprétations, qui a lui-même des idées, qui entend son poète, et qui en parle pertinemment; et c'est la main du grammairien en personne, et non celle d'un ignorant copiste, qui a consigné ces notes aux marges du Mediceus. Cette seconde main n'est pas beaucoup moins ancienne que la première, et date par conséquent d'une époque où les bibliothèques de Byzance n'avaient pas encore subi les ravages de la barbarie latine. Le scholiaste a eu sous les yeux des livres qui, deux ou trois siècles plus tard, n'existaient certainement plus.
lix D'après une opinion généralement admise aujourd'hui, tous les manuscrits d'Eschyle dérivent du Mediceus, soit comme copies directes, soit comme copies de ses copies. Cette opinion est très-vivement contestée par Frédéric Heimsœth; et je crois avoir démontré, pour ma part, qu'un des nôtres, le Parisinus L, ne provient point du Mediceus. Mais les manuscrits qui ne proviennent point du Mediceus sont toujours les frères du Mediceus : ils sortent de la même source que lui, et ils sont, comme lui, une image plus ou moins fidèle du manuscrit en onciales dont la critique, avant toute autre œuvre, restitue et interroge les leçons. On trouvera un peu plus loin, comme appendice à cette Introduction, ma dissertation sur le Parisinus L d'Eschyle.
La plupart des manuscrits d'Eschyle répandus dans les bibliothèques de l'Europe ne contiennent que trois tragédies, le Prométhée enchaîné, les Sept contre Thèbes, les Perses. Il ne faut pas s'en étonner. Ces trois tragédies ont été jusqu'à la fin des livres d'étude dans les écoles byzantines. C'est ce qui explique pourquoi le texte en est beaucoup mieux conservé que celui de l'Orestie et des Suppliantes, et pourquoi on a, sur ce texte, tant de scholies de tout âge et de toute qualité, tandis qu'on est réduit, pour l'Agamemnon, à une pénurie véritable.
Eschyle a été imprimé pour la première fois à Venise, dans la maison d'Aide Manuce, mais en 1518, trois ans après la mort de Manuce. François d'Asola, qui dirigeait alors la maison, a laissé évidemment, quoi qu'il en dise, le soin de cette édition à quelque subalterne. Elle est tout à fait mauvaise. Robortello n'exagère rien quand il dit qu'on n'a pris d'autre soin pour elle que de lui donner un aspect agréable à l'œil. Il est évident que François d'Asola n'avait pas même lu la copie sur laquelle on a imprimé. Son scribe ne s'était point aperçu des lacunes du Mediceus, et lui avait fourni, sous le titre l'Agamemnon, un monstre hybride composé d'un quart environ de l'Agamemnon véritable, et des Choéphores presque entières. Il donne ce monstre tel quel, et constate, par son titre même, qu'il ne reconnaît que six tragédies d'Eschyle. Jamais plus étrange bévue n'a été commise par aucun éditeur; mais il y a une chose plus étrange encore, c'est que Turnèbe ait reproduit l'Aldine, en 1552, avec son titre, avec son Agamemnon ! II.est pourtant certain que Turnèbe n'avait pas fait simplement fonction d'imprimeur royal : il avait personnelle- lx ment manié le texte, puisqu'il y avait fait ça et là des corrections, soit d'après un manuscrit des trois premières pièces qu'on lui avait prêté, soit d'après les scholies, soit surtout d'après ses propres conjectures.
La Bibliothèque impériale possède plusieurs exemplaires de l'Eschyle de Turnèbe. Il y a un de ces exemplaires qui offre quelque intérêt, à cause des notes manuscrites qu'il porte à la marge. Ces notes sont de la main de Siméon du Bois, célèbre, sous le nom de Bosius, parmi les érudits du xvie siècle. Bosius propose des corrections et des explications; souvent il traduit le texte, et son latin est aussi expressif qu'élégant; il a même mis en latin un quart de la tragédie des Perses. Mais je dois dire que Bosius, en général, ne s'exerce que sur les premières scènes de chaque tragédie, et même qu'il a entièrement négligé les Euménides. Je remarque d'ailleurs qu'il n'est pas allé assez loin, dans le prétendu Agamemnon de Turnèbe, pour s'apercevoir de l'incohérence, et qu'il est mort, selon toute vraisemblance, sans se douter que son Eschyle contînt les Choéphores.
Robortello est le premier éditeur d'Eschyle qui ait séparé les Choéphores de l'Agamemnon, et qui ait compté sept tragédies. Mais il ne faut pas dire, comme font quelques-uns, que c'est lui qui a le premier donné les sept tragédies entières. Il n'a rien donné de plus que ses devanciers; mais il arrête l'Agamemnon là où commence une autre pièce. Une note, p. 148, indique pourquoi: «La dernière partie de cette tragédie fait défaut. Car ce qui suit appartient évidemment aux Choéphores, dont le début manque lui-même.» Au reste, Robortello avait eu à sa disposition plusieurs manuscrits estimables, et il avait corrigé une grande partie des fautes laissées par Asola dans l'Aldine. Son édition, Venise, 1552, in-8°, a paru quelques mois seulement après celle de Turnèbe. Le même Robortello, au commencement de cette même année, avait publié, à Venise aussi, un petit volume de scholies d'Eschyle; mais il y avait laissé les scholies des Choéphores mêlées à celles de l'Agamemnon; et quand il mettait, dans son titre, Scholia in Aeschyli tragœdias omnes, il entendait encore, comme tout le monde, six tragédies, et non sept. C'est dire qu'il n'avait pas fait une étude bien sérieuse du texte des scholies, avant de le livrer aux typographes. Il en a d'ailleurs médiocrement soigné la correction matérielle.
La meilleure des éditions d'Eschyle publiées au xvie siècle est lxi celle de Pierre Victorius et Henri Estienne, Paris, 1537, in-4°. On peut même la considérer comme la vraie édition princeps, car c'est la première où l'Agamemnon se lise entier (98). Victorius, qui était Italien et vivait en Italie, avait préparé son texte d'après le Mediceus, et d'après deux autres manuscrits plus récents, mais qui l'un et l'autre contenaient l'Agamemnon. Il avait mis au bas des pages les scholies de Robortello, mais considérablement augmentées, et surtout bien plus correctes et bien plus intelligibles. A la suite du texte et des scholies, il avait ajouté un opuscule grec d'une dizain« de pages, sur les mètres d'Eschyle. Le nom de Pierre Victorius figure seul au titre de l'édition; mais Henri Estienne ne s'est pas borné à imprimer, avec toute la perfection dont il était capable, le travail que lui avait envoyé son ami : il y a joint un commentaire latin, où il propose ses explications et ses conjectures, et où il cite un grand nombre de variantes. Ces variantes, dont il n'indique jamais l'origine spéciale, sont toutes tirées des manuscrits d'Eschyle qu'il avait vus à Venise, à Florence, à Rome et à Naples. Il dit lui-même en avoir compulsé quinze, mais dont la plupart ne contenaient que les trois premières tragédies.
L'édition de Pierre Victorius et Henri Estienne a été reproduite dans le premier volume de la Collection des poètes grecs imprimée à Genève (Coloniae Allobrogum) en 1614, pages 598 et suivantes.
C'est dans la préface de Victorius que j'ai trouvé ce qu'on a jamais écrit de plus sensé, de plus précis et de plus vrai sur le style du poète : « Et n'allez pas vous figurer qu'Eschyle soit tout entier dans les grandes conceptions dramatiques, et qu'il n'ait eu aucun souci de la perfection littéraire. Sa diction, admirablement travaillée, a tout l'art et tout le poli qu'on peut souhaiter, et ne manque même ni de fleurs charmantes ni de grâces exquises (99). » Voilà ce qu'on imprimait à Paris, au lxii temps où les études grecques y étaient florissantes. Nous ne sommes donc pas des novateurs, nous qui voyons dans Eschyle un des plus merveilleux écrivains qu'il y ait eu : nous avons simplement renoué la bonne tradition française.
La Bibliothèque impériale possède l'exemplaire de l'édition de Victorius et Estienne, dont se servait Tanneguy Le Fèvre, l'illustre père de Mme Dacier. Les marges du livre sont couvertes de corrections et d'observations manuscrites, mais seulement dans les trois premières tragédies. Les pages des quatre autres tragédies semblent sortir de dessous la presse. Il est évident qu'on n'expliquait, à l'Académie de Saumur, ni l'Orestie ni les Suppliantes, et que le grand helléniste n'a jamais pris ces quatre pièces pour l'objet de ses études et de ses leçons. Les notes de Le Fèvre sont remarquables par la netteté, la précision, le bon sens. On y rencontre, même encore aujourd'hui, des idées ou des renseignements qui n'ont pas perdu, après deux siècles, toute valeur et tout à-propos.
L'édition de Canter, Anvers 1580, est une reproduction du texte de Pierre Victorius, dédiée à Victorius lui-même. Canter fait des améliorations de détail, mais beaucoup moins que ne l'annonce son titre. Le principal mérite de l'éditeur belge, c'est d'avoir connu la métrique des chœurs, .et d'avoir régulièrement déterminé les diverses parties de chaque chant lyrique. Le petit volume de Canter, qui fait honneur aux presses de Christophe Plantin, a conservé une certaine réputation, mais bibliographique autant que philologique.
Isaac Casaubon nous apprend, par deux notes de son Strabon (p. 18 et 104), qu'il a beaucoup travaillé sur Eschyle, et qu'il se propose de donner une édition nouvelle du poète avec un commentaire. Ni cette édition ni ce commentaire n'ont jamais paru. Stanley, qui mentionne les deux notes, dit que Casaubon n'avait fait qu'une vaine promesse, ou que, s'il avait réellement préparé une édition et un commentaire d'Eschyle, son ouvrage a péri. Casaubon n'avait dit que la pure vérité. Nous en avons à Paris une preuve parlante : c'est le manuscrit 2791 de la Bibliothèque impériale. Ce manuscrit est une portion du travail de Casaubon sur Eschyle. Il contient l'Agamemnon entier, texte et commentaire, le tout de la main lxiii même de Casaubon, comme en témoigne le Catalogue : « ipsius Casauboni manu anno 1610 exaratus. » C'est un volume in-4° de plus de cent pages, d'une écriture très-nette et très-serrée. Imprimé comme l'Agamemnon de Blomfîeld, il fournirait la matière d'un in-8° aussi considérable pour le moins que celui, de l'éditeur anglais. La date est mentionnée dans le titre ; une note, au bas de la page 96, indique même quel jour de l'année 1610 Casaubon avait achevé l'œuvre. C'était le 24 février (5e Kalendas Martii), très-peu de mois par conséquent avant que Casaubon quittât Paris et la France.
Il n'est guère vraisemblable que le philologue eût commencé son travail par l'Agamemnon, et l'Agamemnon n'était venu sans doute qu'à son rang, après les trois premières tragédies. Il ne reste aucune trace du Prométhée de Casaubon, ni de ses Sept contre Thèbes, ni de ses Perses ; mais on les retrouvera peut-être quelque jour. En revanche, je suis convaincu que Casaubon n'avait rien écrit sur les Choéphores, sur les Euménides, sur les Suppliantes. L'existence de son Agamemnon parmi les livres de la bibliothèque dont la mort de son protecteur Henri IV lui ôta le gouvernement, semble déposer de quelque violence par laquelle il aurait été dépouillé de tout ou partie de ses papiers. N'eût-il perdu que la pièce que nous possédons, il a dû sentir son ardeur s'éteindre, et il a renoncé à l'achèvement de son entreprise. Les quatre années qu'il a survécu à son passage en Angleterre lui auraient suffi, et au delà, pour satisfaire à l'attente du public lettré; mais on s'explique très-bien qu'il se soit occupé, de 1610 à 1614, d'autre chose que de ce qu'il avait promis dans son Strabon.
Quoi qu'il en soit, on ne saurait trop déplorer que Casaubon n'ait point publié d'Eschyle. La philologie eschylienne eût fait, avec ce ferme et sagace esprit, un pas de géant, un des plus grands qu'elle ait jamais faits. J'en juge par notre Agamemnon. Stanley et ses successeurs, dans leurs corrections les plus approuvées, dans leurs conjectures les plus plausibles, dans leurs plus savantes interprétations, n'ont fait, la plupart du temps, que retrouver ce que Casaubon avait écrit depuis le commencement du xviie siècle. Tout le monde peut s'en assurer en lisant, dans les Notices et extraits (T. I, p. 324-340), l'étude critique de Vauvilliers sur le manuscrit 2791.
Il est étrange que personne, au xviie siècle, n'ait eu l'idée d'imprimer ce chef-d'œuvre philologique. Ce qui est lxiv plus étrange encore, c'est que pas un éditeur d'Eschyle, même depuis la notice de Vauvilliers, n'ait jamais cité Casaubon, ni pour son texte de la grande tragédie, ni pour l'admirable commentaire dont ce texte est accompagné.
L'édition de Thomas Stanley (1663, in-folio), ou, comme on l'appelle ordinairement, l'édition de Londres, est tout à la fois et un excellent Variorum, et une œuvre personnelle par laquelle Stanley a beaucoup ajouté à ce qu'avaient fait ses prédécesseurs. C'est Stanley qui a fondé la vulgate d'Eschyle. C'est le texte de Stanley qu'ont adopté presque tous les éditeurs, jusqu'au milieu de notre siècle. L'édition si estimée, dite de Glascow (1746, in-4), n'est qu'une réimpression du texte de Stanley. On en peut dire autant des deux éditions de Porson (1795 et 1797) ; et la Porte du Theil (1794-1795), dans son titre même, dit qu'il se conforme en général au texte de Stanley : ad Londinensis quidem editionis fidem ; et il répète la même chose dans son Avertissement de l'auteur. Malgré les attaques de Corneille de Pauw contre Stanley ; malgré les ingénieuses conjectures de Schiitz et les témérités de Bothe, c'est encore à Stanley qu'en sont revenus Butler, Blomfield, Wellauer et d'autres, sauf les passages que Stanley avait crus désespérés, et auxquels la critique essayait d'appliquer ses remèdes.
Stanley a mis une traduction latine en regard de son texte. Cette traduction, qu'il a faite lui-même, est un des grands mérites de l'édition de Londres; et Stanley a bien raison de se féliciter d'avoir donné au lecteur un secours plus intelligent et plus efficace que celui qu'offraient les informes versions jusque-là publiées.
Les scholies, dans l'édition de Londres, sont au bas des pages. Le traité grec sur les mètres d'Eschyle est imprimé à la suite du texte et de la traduction latine. Puis viennent les fragments de tragédies perdues ; puis vient le commentaire de Stanley et sur les sept tragédies subsistantes et sur les fragments. Le volume se termine par une réimpression des imitations poétiques de Canter et de Hugo Grotius. Les préfaces des éditeurs qui avaient précédé Stanley sont aussi reproduites, mais on tête du volume, après une courte préface de Stanley lui-même.
Le commentaire de Stanley sur Eschyle est d'une étendue considérable. Il remplit près de deux cents pages in-folio à deux colonnes. C'est un ouvrage qui fait le plus grand honneur à l'érudition de Stanley, à ses aptitudes philologiques, à son lxxv goût littéraire, à la netteté de ses idées et de son style. Le savant anglais se rencontre fort souvent avec Casaubon ; il y a même telle de ces rencontres qu'on pourrait qualifier do coïncidence merveilleuse. C'est dire que Stanley compte à juste titre parmi les plus éminents philologues.
Je n'entre dans aucun détail sur les imitateurs, les continuateurs ou les contradicteurs de Stanley, depuis 1663 jusqu'au milieu de notre siècle. Leurs ouvrages sont entre les mains de tous ceux qui font du texte d'Eschyle une étude un peu sérieuse. Je me contenterai de recommander particulièrement les commentaires d'Abresch, de Schütz, de Blomfield, et surtout l'excellent Lexicon Aschyleum de Wellauer. Il y a pourtant deux éditions, antérieures à 1851, date de ma révision première, sur lesquelles il convient que je dise quelques mots.
Presque tous les Français qui écrivent sur Eschyle et citent le texte du poète se réfèrent invariablement ou à l'Eschyle du Boissonade, ou à celui de la Collection Didot. Je ne m'en étonne point, puisque ces deux éditions ont été publiées en France, et qu'elles sont plus répandus chez nous que celles qui viennent d'Allemagne ou d'Angleterre.
L'édition de Boissonade (Paris, 1825, deux volumes in-32) est d'un charmant formai, d'une impression élégante et soignée; mais je cherche en vain quels sont ses autres mérites. Boissonade change assez souvent la vulgate, mais presque toujours sans aucune nécessité constatée, et par simple caprice. Rarement il a raison contre le texte traditionnel ; dans plus d'un passage, il l'a empiré d'une façon déplorable. Les notes sont, comme les corrections, des fantaisies de bel-esprit. Elles sont d'ordinaire à côté du sujet. Les meilleures n'ont presque aucune utilité pratique. Elles ne valent que pour les amateurs d'aménités littéraires, auxquels l'auteur les a manifestement destinées. Personne n'était plus capable que Bcissonade de faire sur Eschyle un excellent commentaire ; mais cet excellent commentaire, il ne l'a point fait : à peine a-t-il montré par-ci par-là, dans quelque note plus topique que les autres, le spécimen des bonnes choses qu'on était en droit d'attendre de lui. Il est vrai que le commentaire de Boissonade porte seulement le titre de notulœ, et qu'attacher à des notules une importance sérieuse, c'est se duper volontairement soi-même,
C'est en 1842 qu'a paru le volume de la Collection Didot où se trouvent Eschyle et Sophocle. L'Eschyle, texte et traduction latine, a été donné par un professeur du Gymnase de lxvi Cobourg, E. A. I. Ahrens. J'ai étudié à fond ce travail, lors de ma première révision; et les notes qui le concernent, dans mon commentaire, datent de 1851. Aujourd'hui l'opinion des hellénistes est faite sur les imperfections du travail d'Ahrens. Aussi n'ai-je nullement à me repentir d'avoir témoigné à mainte reprise, il y a dix-huit ans, contre l'enthousiasme des admirateurs du philologue de Cobourg. Je ne parle pas des grossières fautes typographiques qui déparent et le grec et le latin : Ahrens n'en est point responsable, mais Dübner son ami, le directeur et le correcteur de la Collection pour laquelle Ahrens a fait son Eschyle.
Les travaux critiques et exégétiques dont il me reste à parler sont d'un tout autre ordre que cette production avortée. Le premier en date, c'est l'édition posthume de Godefroi Hermann, Leipzig 1852, deux volumes in-8°. Cette édition, préparée par cinquante ans d'études, de méditations et d'essais, allait être mise sous presse, quand une mort imprévue enleva le grand philologue. Hermann, à sa mort, en-1848, était déjà plein de jouis; mais il avait conservé toutes les facultés, toute l'activité de son âge mûr ; et cette dernière œuvre est entièrement digne de lui. Maurice Haupt, le disciple, l'ami et le gendre de Hermann, a transmis au monde savant le legs de son père d'adoption, avec une conscience, un scrupule et un soin au- dessus de tout éloge. Sauf la rédaction imparfaite d'un trop grand nombre de notes, le livre est tel certainement que l'eût donné Hermannn lui-même. Le principal intérêt de cette édition n'est pas tant dans le texte que dans le commentaire. Hermann est très-systématique ; ses corrections, et surtout ses remaniements, sont bien loin d'avoir rallié tous les suffrages ; mais personne n'a plus profondément pénétré au sein des difficultés philologiques, et n'a plus magistralement réformé une foule d'erreurs à quoi nous avions foi jadis. Enfin son appareil critique est très-abondant, composé de matériaux de premier choix et de provenance bien constatée ; et c'est dans les secours excellents qu'il nous fournit, que nous trouvons souvent les meilleures raisons de rejeter ses hypothèses et ses conjectures.
M. Henri Weil, professeur à la Faculté des lettres de Besançon, a publié successivement à Giessen, de 1858 à 1857, toutes les tragédies d'Eschyle, en commençant par la trilogie, et en continuant par les Sept contre Thèbes, Prométhée enchaîné, les Suppliantes, enfin les Perses. Chacune de lxvii ces tragédies est précédée d'une préface, et accompagnée d'un commentaire, et des appendices complètent les explications. M. Weil, au moins à partir des Choéphores, applique au dialogue d'Eschyle une loi de symétrie et d'antithèse presque semblable à celle qui régit la partie lyrique de tout drame grec. Les vers, selon lui, forment des groupes qui se correspondent et se combinent à la manière des strophes et des antistrophes; et, là où l'on voit quelque groupe isolé, c'est toujours un équivalent ou des proodes lyriques, ou des mésodes, ou des épodes. Je n'adopte ce système, quant à moi, que d'une façon très-générale ; et je ne crois pas qu'il faille supposer, aussi souvent que le fait M. Weil, des transpositions ou des lacunes. Mais je dois dire que M. Weil n'abuse pas du principe de symétrie autant qu'on pourrait le craindre. Il ne suppose, d'ordinaire, une altération dans le texte que là où le sens est troublé, que là où manque la liaison des idées. Quoi qu'il en soit, les résultats auxquels aboutit la critique de M. Weil sont en général des plus heureux, souvent même des plus incontestables. Bien des leçons mal constituées ont pris, grâce à elle, leur forme définitive; bien des endroits désespérés sont passés à l'état de convalescence, et plusieurs sont même arrivés à complète ou du moins très-passable guérison. En un mot, l'Eschyle de M. Weil est un des plus puissants et des plus beaux efforts de la science jointe au goût, pour la restauration et l'interprétation des textes de la poésie antique. La cinquième édition de Guillaume Dindorf est une recension nouvelle, d'après le Mediceus plus exactement collationné, d'après Hermann aussi et d'après Weil ; elle contient surtout les résultats de la critique de Dindorf lui-même. Dindorf a souvent de très-bonnes idées ; mais souvent aussi il donne beaucoup trop à l'imagination et au caprice, et ses remaniements ne sont pas toujours fort plausibles. Un autre défaut grave, c'est le scepticisme excessif de l'éditeur. Dans beaucoup de passages, il transcrit purement et simplement la leçon du Mediceus, si absurde qu'elle soit, déclarant par là ces passages absolument inguérissables. Que peut-on faire, par exemple, d'un mot comme ἐνδακοσάχ, qu'il nous jette au vers 897 des Suppliantes ? Il semble que le premier devoir d'un éditeur, c'est de fournir un texte intelligible. Et notez qu'ici il n'y a dispute, entre les critiques, que sur la manière d'habiller en grec ἐνδακοσάχ, et non pas sur l'idée, qui, d'après le contexte, est évidemment celle de morsure. Dindorf aurait dû lviii admettre, au moins à titre provisoire, une des trois ou quatre corrections entre lesquelles se partagent les savants. M. Weil laisse quelquefois dans son texte ou des vides ou de fausses leçons; mais il a un commentaire où il dit pourquoi, el où l'on trouve les remèdes rejetés par lui. D'ailleurs ces cas, chez M. Weil, sont fort rares. Dindorf, au contraire, se plait à multiplier, sous les pas du lecteur, les encombres et les fondrières. Il est vrai que son édition a été faite en vue des études allemandes, et que ce qui nous choque, nous autres Français, sert précisément de matière à ces discussions philologiques qu'on aime au delà du Rhin, et qui y tiennent lieu de tout ce que nous appelons littérature.
Frédéric Heimsreth, l'éminent professeur de l'université de Bonn, est un adversaire déclaré de la méthode éphectique de Dindorf; et personne n'a foi plus que lui à la possibilité d'une parfaite restauration des pièces d'Eschyle. Les admirables résultats auxquels ont abouti déjà ses travaux prouvent que cette foi repose sur autre chose que des chimères. C'est par centaines qu'il a restitué les leçons du poète; et ces restitutions ont quelquefois un caractère de parfaite évidence. M. Weil, dans la recension des dernières pièces, en a adopté un grand nombre; et c'est encore d'après Heimsœth qu'il corrige le plus souvent, dans ses Addenda de la fin, certaines leçons de la trilogie.
C'est dans les gloses et les scholies qui accompagnent la plupart des manuscrits d'Eschyle que Heimsœth cherche les moyens de remonter à un texte plus ancien et plus satisfaisant que In texte offert par les manuscrits eux-mêmes. Il est certain que ces gloses et ces scholies n'ont souvent aucun rapport avec les mots qu'elles sont censées interpréter. Il arrive même quelquefois que la scholie porte en tête le mot expliqué, et que ce mot, plus ou moins bien écrit, est tout différent de celui du texte. On ne s'étonne point de cette bizarrerie, quand on sait que les scribes byzantins n'étaient que des machines écrivantes : ils copiaient ce qu'on leur donnait à copier, sans s'inquiéter de la discordance des choses venues de source diverse; et comprendre ce qu'ils copiaient, c'était certes le moindre de leurs soucis. Heimsœth appelle tradition indirecte du texte d'Eschyle les documents fournis par les scholies et les gloses. C'est sur les manuscrits d'Allemagne seulement qu'il a recueilli de quoi remplir plusieurs volumes de critique. Il se propose de continuer la moisson en Italie, en France et ailleurs.
lxix On objecte à la méthode de Heimsœth que la tradition, sous la forme où il nous la montre, ne peut être fixée en leçons précises qu'après le plus sévère contrôle; qu'une leçon relativement plus ancienne n'est pas, ipso facto, une leçon antique, ni surtout une leçon authentique; enfin qu'on, doit toujours se tenir eu garde contre les séductions du paradoxe. C'est dire que Heimsœth n'est pas impeccable; mais comment nier qu'il ait augmenté, dans une considérable proportion, nos ressources philologiques, et que la mine qu'il a ouverte ne puisse produire de nouveaux trésors? Soyons reconnaissants des biens que nous devons à sa patience acharnée, à sa merveilleuse pénétration, et même quelquefois à son esprit d'aventure (100). Qu'importe que sa logique nous soit souvent importune. Rien ne nous force à le suivre. Prenons les faits, acceptons l'évidence, laissons le douteux. N'avons-nous pas avec lui, comme avec tous ceux qui nous proposent des idées, le bénéfice d'inventaire?
Parmi les travaux partiels dont je me suis aidé pour ma révision, il y en a un qui est écrit en français, et qui faisait grand honneur à la science et au talent de son auteur : ce sont les Éludes critiques cl exégétiques sur les Perses d'Eschyle (101), par un professeur de l'Académie de Neuchâtel en Suisse, feu Charles Prince. M. Prince rejette toutes les corrections cl toutes les explications dont son esprit n'est pas satisfait; mais il en propose d'autres à la place, et généralement fort plausibles, sinon toujours d'une rigoureuse évidence. Ce qui me plaît surtout en lui, c'est qu'il n'a pas la passion des remaniements, et que changer une lettre, une syllabe, un mot à peine, c'est tout ce qu'il lui faut pour résoudre les problèmes qu'il se pose. Ses explications nouvelles, dans les passages où l'interprétation d'aucun de ses devanciers ne lui paraissait avoir fait la lumière sont d'une finesse un peu subtile parfois, mais elles ne sont jamais arbitraires ni paradoxales. C'est du contexte qu'il les tire, de la suite des idées, du rapport des phrases entre elles, surtout de l'examen approfondi des conjonctions, des particules, de tout ce qui nuance et diversifie la diction du poète. Une des plus heureuses corrections proposées par M. Prince est lxx celle qui nous permet de repousser l'explication de πλαγατοῖς ἐν διπλάκεσσι donnée par Hermann (dans leurs larges robes ballollées ça et là), et de maintenir le sens traditionnel : parmi les flottants débris de nos vaisseaux. Il suffit de rétablir à leur place respective les deux premières syllabes du mot dont une erreur du scribe a fait διπλάκεσσι, et d'écrire, πλακίδεσσι. En effet, πλακίς est une planche, un madrier, et ici, par conséquent, un débris de navire.
Les seuls changements do texte dont un traducteur ait à tenir compte sont ceux qui affectent le sens. Tout ce qui ne touche qu'à l'orthographe des mots, qu'à leur disposition dans la phrase, tout ce qui ne concerne que l'accentuation, la versification, les rapports métriques, il ne s'en informe qu'à titre de philologue et de curieux. Aussi n'y a-t-il rien de comparable entre la besogne que je viens d'avoir à faire et l'énorme labeur auquel j'aurais été condamné, s'il m'eût fallu constituer un texte continu, et prendre parti entre des idées souvent divergentes, quelquefois même contradictoires. Ma traduction, malgré les modifications qu'elle a subies à deux reprises, a toujours pour base le texte de la Vulgate; et j'engage ceux qui veulent s'en servir pour étudier Eschyle en grec, à prendre, de préférence aux éditions récentes, quelqu'une des reproductions de Stanley. Mes notes l'avertiront des progrès opérés par la critique. Il ira ensuite à Dindorf, à Weil, à Hermann, à qui il lui plaira. Mais c'est par la Vulgate qu'il marchera le mieux durant le premier voyage. Au second voyage, il n'aura plus besoin de moi pour guide.
La première traduction française d'Eschyle, celle de Lefranc de Pompignan, n'a paru qu'en 1770. C'est un ouvrage d'une extrême médiocrité. Il est probable que le traducteur n'avait pas beaucoup étudié le texte; en tous cas il ne l'entend guère, et ne donne même qu'un à peu près de ce que lui fournissait la version latine. Mais La Porte du Theil publia, en 1770 même, le spécimen d'une traduction d'Eschyle bien autrement exacte et d'un style bien autrement énergique que celle de Pompignan. On n'eut d'abord de lui que les Choéphores. Lu traduction entière parut seulement en 1780, dans les deux premiers volumes du nouveau Théâtre des Grecs. Mais La Porte du Theil ne reconnaît, comme expression de sa vraie pensée, que l'édition de l'an III (I794-I795). En 1770, dit-il, ses Choéphores eussent été bien plus littéralement conformes à l'original, s'il n'eût craint d'effaroucher des lecteurs accou- lxxi tumés à trouver, dans les traductions des autours anciens, plus d'élégance que de fidélité. En 1783, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, l'impression s'était faite pendant son absence; une main étrangère avait abusé du manuscrit à son insu; et la traduction avait subi tant et de si forts changements, qu'elle était devenue, pour ainsi dire, méconnaissable à ses propres yeux.
Dans l'édition de l'an III, le français est en regard du grec; et le
traducteur a raison de se vanter qu'on peut, au premier coup d'œil,
s'assurer du degré où il porte son exactitude. La traduction est
remarquable par la force et la précision du style. Elle laisse à
désirer pour l'éclat et la grâce. Les tours manquent de facilité; la
langue est lourde, on ne sent pas assez la poésie. N'importe; c'est
une œuvre do premier ordre. Songeons que La Porte du Theil n'a point
eu de modèle. Il ne doit rien à personne; et nous, qui sommes venus
après lui, que ne lui devons-nous pas? C'est par lui que nous avons
appris qu'une copie de la poésie dramatique des Grecs pouvait être
belle, sans être pourtant une belle infidèle. Quant à moi, je ne
regrette qu'une seule chose, c'est que les changements opérés depuis
soixante-quinze ans dans le texte d'Eschyle aient réduit La Porte du
Theil à l'état de vieillerie; qu'on ne puisse le réimprimer tel quel
; qu'à le réimprimer corrigé et rajeuni, on lui ôte sa sève, sa
verdeur, presque tout son mérite (102).
Entre La Porte du Teil et moi, je ne connais que deux
intermédiaires: la traduction en vers par Biard, 1837, in-8°, qui
n'est que La Porte du Theil plus ou moins mal rimé; et la traduction
en vers par Puech, essai plus sérieux et plus heureux aussi, mais
qui s'est borné aux Choéphores et au Prométhée. Le
premier volume du livre de M. Patin où sont traduits, avec tant de
conscience et de soin, un grand nombre de passages d'Eschyle, est
postérieur à ma publication de 1841.
Il n'a paru en France, depuis 1841, qu'une seule traduction complète d'Eschyle, celle de M. Ad. Bouillet. Elle est de 1865 (103). M. Bouillet explique, dans son introduction, comment s'est fait peu à peu cet ouvrage, et comment, grâce au patronage de lxxii M. Duruy, d'excellents éditeurs se sont chargés d'en faire jouir le public. Il explique comment et pourquoi sa copie est la seule qui rende exactement les traits de l'original. C'est d'abord parce qu'il écrit toujours Zeus, Cypris, Arès, Hadès, Poseïdon, etc., et non pas Jupiter, Vénus, Mars, Pluton, Neptune, etc. C'est ensuite parce qu'il a pris ses locutions de toute main, sans s'arrêter aux habitudes classiques, sans s'inquiéter des pruderies de la décence moderne. C'est enfin parce qu'il a détraqué les tours habituels de notre idiome, pour rendre ce qu'il appelle le décousu et le heurté du style de son auteur, surtout pour atteindre à la liberté de construction que permettent les langues antiques. Voici ce qu'il dit lui-même de la façon dont il mit en pratique sa méthode, une fois pris le parti d'absolue fidélité : « Je ne reculai plus, dès lors, devant les violences de constructions un peu convulsives, et j'essayai d'inversionner, autant que le permettait le génie de notre langue, et que l'exigeait la fidélité au mouvement même de la pensée que je traduisais. Le mot mis à sa place me paraissait ainsi mieux conserver sa valeur réelle, et le rythme de ma phrase mieux répondre à celui de mon auteur, surtout dans la partie lyrique des chœurs. J'y trouvais d'ailleurs plus de commodité à me tenir sur le texte. »
M. Bouillet dit qu'il a passé une dizaine d'années à faire, refaire, remanier, corriger et polir sa traduction.Jle ne doute aucunement du prodigieux labeur qu'il a dû s'imposer. Jugez- en plutôt par la merveilleuse transformation qu'a subie, sous la main du traducteur, la première phrase du Prométhée délivré, c'est-à-dire deux des vers les plus nets, les plus précis, les plus simples, les plus élégants d'Eschyle : « Du monde, c'est là où tout finit, à l'entrée des steppes de Scythie, à cet escarpement désert, où jamais le pied ne se pose. Nous y sommes enfin arrivés. » Pour aboutir à un tel résultat, il a fallu des heures, des jours, une semaine peut-être. Or tout, dans la traduction de M. Douillet, est ainsi désarticulé et déformé, sauf quelques dialogues monostiques, où il s'est assujetti aux vers blancs, et condamné par conséquent à une sorte d'élégance, en somme, son Eschyle est absolument illisible. Cette opinion n'est pas uniquement la mienne: c'est celle du critique même qui a parlé avec le plus de sympathie de l'énorme effort littéraire de M. Bouillet, de la patience du traducteur et de sa conscience. Le public est, dit-on, du même avis.
J'ai eu sous les yeux la nouvelle traduction, durant tout le lxxiii temps que j'ai travaillé à la révision de la mienne. Je supposais que cette œuvre avait du moins une certaine valeur philologique, et que j'y trouverais plus d'une fois, là où j'avais erré, des moyens de me remettre sur la voie. Je n'y ai rien trouve à mon usage. M. Bouillet ne connaît qu'Ahrens. Toutes les fois qu'il donne un sens différent de celui que j'avais adopté jadis, c'est toujours d'après le texte d'Ahrens, d'après la version ou la paraphrase d'Ahrens. C'est dire combien il a entassé de contre-sens, ou tout au moins de faux sens, dont l'eût préservé la connaissance des travaux critiques et exégétiques publiés depuis l'Eschyle-Didot. Il n'y a guère de page, chez M. Bouillet, où je n'aie noté sur mon exemplaire deux ou trois erreurs puisées aux eaux malsaines d'Ahrens. Telles pages des Choéphores m'en ont fourni jusqu'à huit, dix et douze. M. Douillet dit d'Eschyle : « C'est un sombre et âpre visionnaire. » II applique à la poésie d'Eschyle ce que M. Taine dit des poètes barbares de l'Angleterre, chez qui tout est passion et fureur, et dont l'imagination en délire ne marche que par sauts et par bonds. On ne doit donc pas s'étonner de la peine qu'il s'est donnée pour être lui-même désordonné dans son style, pour se faire barbare, pour parler une langue do l'autre monde; mais je suis émerveillé vraiment et de son absolue indifférence en matière de philologie, et de sa foi naïve aux perfections du travail d'Ahrens.
Peu de temps avant la publication faite par M. Bouillet, M. Paul Mesnard nous avait donné une traduction de l'Orestie en vers français (104). Cette traduction est excellente. Il est difficile de pousser plus loin l'exactitude, avec les entraves de notre prosodie; et pourtant l'on ne sent nulle part la gêne et l'embarras. Je ne dis pas que la poésie de M. Mesnard soit d'un bout à l'autre l'équivalent parfait de la poésie d'Eschyle : elle en est du moins une vive et chaude image. Tous ceux qui ont lu les beaux vers de M. Mesnard rendent justice à son talent; mais je ne trouve pas que les littérateurs qui ont parlé de son œuvre l'aient estimée à toute sa valeur. Si M. Paul Mesnard, au lieu d'être un homme modeste, tout entier aux livres et à ses chères études, avait appartenu par quelque fil au monde bruyant qui dispense la renommée, on citerait aujourd'hui son lxxiv Orestie comme une merveille; peut-être même aurait-elle eu l'honneur d'être jouée sur un théâtre. N'importe ! elle restera, pour les amis de l'antiquité, un de ces rares modèles qui montrent la parfaite union de la science philologique avec les facultés de l'artiste en rythmes et le goût de l'écrivain. Je ne connais qu'une seule copie de poète ancien, où l'original revive ainsi tout palpitant, tout rayonnant, presque identique à lui-même : c'est la Pharsale française de M. J. Demogeot; encore une œuvre qui n'a d'autre tort que de n'être pas née hors du monde classique et universitaire.
II y a, dans la Grèce tragique de M. Léon Halévy, une traduction des Euménides en vers français. C'est un travail estimable. Seulement il ne faut pas lire M. Halévy après M. Mesnard, ni surtout le confronter trop rigoureusement avec le Titan même : je veux dire, mettre ses vers en regard du texte qu'ils sont censés reproduire. L'image est terne, blafarde, sans contours nets, faiblement et incomplètement venue. Je n'ai point à parler des nombreux passages que Dumas, dans son Orestie, a empruntés à l'Orestie d'Eschyle. La poésie eschyléenne du célèbre dramaturge, quoi qu'en aient dit tant de feuilletonistes, n'est pas beaucoup au-dessus du néant. C'est ma prose plaquée de rimes, et rien de plus. Dumas n'est, dans ces que pour des platitudes et des chevilles.
APPENDICE.
Notice critique sur le PARISINUS L D'ESCHYLE, manuscrit de la
Bibliothèque impériale (105).
Les douze manuscrits parisiens d'Eschyle. — Le numéro
2886, ou Parisinus L. — Description de ce manuscrit. — Date
du Parisinus L. — Son histoire. — Qu'il n'est point de la
main de Jean Lascarrs.. — Collation de Peter Needham. — Plagiat
d'Antony Askew. — Triomphe du plagiaire. — Hypothèse de G. Hermann
et hypothèse de Maurice Haupt. — Présomptions défavorables à
l'hypothèse de Haupt. — Confrontation du Mediceus et du Parisinus L.
— Les blancs du texte, dans le Parisinus L. — Les autres
lacunes. — Solution des difficultés. — Rejet de l'hypothèse de Haupt.
— Conclusion.
La Bibliothèque impériale possède un assez grand nombre de manuscrits d'Eschyle. D'après l'article Aeschylus dans la table du Catalogue imprimé, elle en possède jusqu'à douze. Ce sont les numéros 39, 2782 A, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2884 et 2886. Mais il faut s'entendre sur le sens de cette expression : manuscrits d'Eschyle. La plupart des nôtres ne contiennent que trois des tragédies du poète : Prométhée enchaîné, les Sept contre Thèbes, les Perses. Les numéros 2782 A et 2884 n'en contiennent que deux chacun : Prométhée enchaîné, les Sept contre Thèbes. Il n'y en a qu'une dans le numéro 2790 Prométhée enchaîné. Il n'y en a qu'une non plus dans le numéro 2791 : Agamemnon. Le numéro 39 ne contient pas même une tragédie entière : on ne trouve d'Eschyle, dans ce manuscrit, qu'un simple fragment du Prométhée enchaîné, perdu, pour ainsi dire, au milieu d'une trentaine d'ouvrages divers.
lxxvi Le moins incomplet de nos manuscrits d'Eschyle n'a ni Agamemnon ni les Choéphores. Il porte le numéro 2886. C'est celui que Godefroi Hermann, dans son édition posthume, nomme Parisinus et Parisinus L : Parisinus, lorsque ce manuscrit est le seul des Parisiens qui contienne la pièce, comme c'est le cas pour les Euménides et les Suppliantes ; Parisinus L, quand les variantes d'autres Parisiens sont citées concurremment avec les siennes. Cette désignation, L, a été empruntée par Hermann à Wellauer, qui appelle le même manuscrit Regius L. La lettre L, étant la douzième de l'alphabet, convient parfaitement au numéro 2886, le douzième et dernier dans l'ordre des chiffres. Mais c'est par un pur effet du hasard que Wellauer était tombé juste. Il ne connaissait ni le nombre exact de nos manuscrits d'Eschyle, ni leurs vrais numéros. Il prenait même son L dans le sens de dixième, car il n'a point d'I ni de J dans sa nomenclature.
C'est en 1740, date du Catalogue imprimé, que le Parisinus L
a reçu le numéro 2886. Auparavant, dans la classification de 1682,
il se nommait 3321. Auparavant encore, dans la classification de
1620, il s'était nommé 1997. Enfin, au xvie siècle, on l'avait coté
 cccxxi (1821). Tous ces numéros
sont restés visibles sur la première page écrite.
cccxxi (1821). Tous ces numéros
sont restés visibles sur la première page écrite.
Le volume, couvert d'une reliure fort moderne, est assez gros, de très-petit format, et de papier ordinaire. Il a 601 feuillets, ou 602 pages, sans compter le feuillet du titre, qui n'est point chiffré (106). Chaque page est de vingt vers seulement. L'écriture est très-nette, mais trop courte. D'ailleurs l'exécution laisse à désirer. Le calligraphe fait ses groupes de lettres sans se préoccuper ni du commencement ni de la fin des mots. Il ne met point les iota souscrits. Il a une ponctuation tantôt excessive, tantôt insuffisante. Il coiffe ses t et ses u, comme faisaient les derniers Byzantins, de ce tréma parasite qu'avaient jadis imaginé les scribes d'Alexandrie.
La première moitié du volume est remplie par quatre tragédies de Sophocle : Œdipe à Colone, Antigone, les Trachiniennes, Philoctète. C'est là ce qui explique la place du manuscrit dans l'économie du Catalogue imprimé : il compte comme manuscrit de Sophocle. Le reste du volume est consacré à Eschyle.
lxxvii Les deux parties du manuscrit n'ont pas toujours été réunies sous la même couverture. C'est ce qui est manifeste par les chiffres grecs que portent chacun des quaternions ou cahiers de quatre feuillets. Ces chiffres ne se continuent point de Sophocle à Eschyle, elles quaternions d'Eschyle ont leur numération propre depuis α', c'est-à-dire 1, jusqu'à ιη, c'est-à- dire 18 (107). A la fin du deuxième quaternion de Sophocle, un feuillet a été oublié dans le numérotage en chiffres arabes. Ainsi le feuillet 159, qui est resté en blanc, devrait être numéroté 160, et le texte d'Eschyle, qui commence au feuillet 160, devrait ne commencer qu'au feuillet 161. On peut s'assurer d'ailleurs que le feuillet 159, c'est-à-dire 160, est le dernier du vingtième et dernier quaternion de Sophocle, et non pas le premier du premier quaternion d'Eschyle.
Quoi qu'il en soit, voici l'ordre des matières, dans la deuxième partie du manuscrit:
Vie d'Eschyle, f. 160. Argument du Prométhée enchaîné, f. 161, verso. Prométhée enchaîné, f. 162, verso. Argument des Sept contre Thèbes, f. 190. Les Sept contre Thèbes, f. 192, medio recto. Argument des Perses, f. 219. Les Perses, f. 220. Argument des Euménides, f. 248. Les Euménides, f. 248, medio recto. Les Suppliantes (point d'Argument], f. 274, verso.
Le Parisinus L est un texte pur et simple. Il n'a ni scholies aux marges, ni gloses interlinéaires. Je ne compte pas quelques variantes ou quelques corrections, consignées çà et là par une seconde main, et qui ne sont que des emprunts faits aux textes imprimés.
On ignore absolument l'âge exact du manuscrit 2886. Une note assez récente, sous le titre, est ainsi conçue : « xvie siècle peut-être. » Cette note, qui est de Gail, n'est autre chose que la traduction en français de ce qu'on lit, dans le Catalogue imprimé, à la fin de l'article sur le numéro 2886 : « Sœculo decimo sexto exaratusvidetur (108). » Ce qui est certain, c'est que, si le manuscrit est du xvi" siècle, il est des premières années de ce siècle, et non point des dernières. Mais il est probablement de la fin du xve siècle.
Ce manuscrit provient de la Collection de Catherine de Mé- lxxviii dicis. L'inventaire de cette Collection, dressé en 1589, à la mort de la reine, existe à la Bibliothèque impériale. Or on y lit, à l'article intitulé Graeca, fol. 469, verso : « CIII. Sophocles Œdipus in Coloneo Antigone Thrasiniœ Philocteten Aeschili, Prometheus postea Thebais, etc. » Quelque barbare que soit la transcription des titres, il est impossible de ne pas reconnaître, dans cette mention, notre manuscrit 2886.
Avant d'appartenir à Catherine de Médicis, le manuscrit avait dû faire partie de la bibliothèque du maréchal Strozzi, confisquée par Catherine; car il est décrit de la façon la plus nette dans le Catalogue des livres du cardinal Nicolas Ridolfi, et Strozzi avait acheté, en 1550, les livres de ce cardinal. Le catalogue de Ridolfi est à la Bibliothèque impériale, et l'on peut y constater, fol. 23, r., n° 10, la mention du Sophocle-Eschyle, aujourd'hui 2886. Le maréchal Strozzi était proche parent de la reine Catherine; mais ce n'est point à titre d'héritière du maréchal que la reine s'empara de ses livres, c'est au nom de droits antérieurs. La bibliothèque de Ridolfi n'était, selon elle, qu'un démembrement de celle des Médicis, et n'avait pu être légitimement aliénée par les héritiers du cardinal. Nicolas Ridolfi était neveu de Léon X, par conséquent Médicis de mère; mais rien ne prouve qu'il n'eût pas créé lui-même sa bibliothèque, et de ses propres deniers. N'importe ; Catherine rentra dans ce qu'elle appelait son bien, et elle le garda jusqu'à sa mort (109).
Ridolfi avait acheté ou reçu en don, de Janus ou Jean Las- caris, ambassadeur de France à Rome sous Paul III, le manuscrit de Sophocle et Eschyle. Ce qui est certain, c'est que le volume porte, au-dessus du titre, le monogramme de Jean Lascaris, un grand lamda surmonté d'un petit sigma : Λς. Il avait donc appartenu primitivement à Jean Lascaris. Il passe même pour être de la main de ce Grec illustre. Tous les éditeurs d'Eschyle qui ont parlé de notre principal manuscrit du poète ont unanimement affirmé qu'il avait été écrit par Jean Lascaris. Schiitz (t. I, p. vi) : «.Mstusin charta eleganter exaratus olim manu Jani Lascaris. » Vellauer (t. I, p. x) : « Reg. L. Chartaceus, manu Jani Lascaris exaratus. » Maurice Haupt, Préface de l'édition posthume de Hermann, p. vii : « P. sive Par. L. Codex bibliothecae Parisiensis 2886, charta- lxxix ceus, Jani Lascaris manu scriptus. » Weil (t. I, section m, p. 4) : « Parisiensis 2886, Jani Lascaris manu scriptus. » Je pourrais citer d'autres échos de la tradition, mais les plus considérables suffisent.
Cette tradition repose uniquement sur l'existence du monogramme de Jean Lascaris au-dessus du titre; mais ce monogramme équivaut simplement à ex libris Jani Lascaris. Il se trouve en effet sur notre n° 2322 et sur notre n° 2442 deux manuscrits qui n'ont rien de commun avec le Sophocle-Eschyle. Remarquez d'ailleurs que Jean Lascaris n'est point nommé dans l'article 2886 du Catalogue des manuscrits, imprimé en 1740. Enfin on connaît, ou l'on croit connaître, par notre n° 2741, l'écriture de Jean Lascaris; et cette écriture diffère de celle du n° 2886. M. Emmanuel Miller, l'éminent paléographe, ne voit la main de Lascaris que dans les rares corrections consignées çà et là aux marges du texte de Sophocle et de celui d'Eschyle (110). Effaçons donc pour jamais le nom de Lascaris dans les notices du Parisinus L, et ne répétons plus un dire en contradiction formelle avec les faits.
C'est il y a cent et quelques années que ce manuscrit a commencé à être cité par les philologues; mais la collation où ils puisent leurs variantes du Parisinus L est antérieure à 1740. Elle a été faite dans un temps où le manuscrit portait encore te numéro 3521. Il y avait alors, en Angleterre, un amateur passionné d'Eschyle, nommé Peter Needham. C'est pour lui que le Parisinus L a été collationné, on ne sait par qui. Needham se proposait sans doute de faire une édition d'Eschyle, car il s'était procuré non-seulement les variantes du Parisinus L, mais celles de cinq autres Parisiens, celles mêmes du Mediceus de Florence. Il avait de plus recueilli les variantes des principales éditions. Toutes ces leçons qu'il avait amassées, il les a transcrites de sa main, et avec l'indication de leur origine, à la marge d'un exemplaire de l'Eschyle de Stanley. Ce volume est conservé dans la bibliothèque de l'université de Cambridge (111).
lxxx Peter Meedham n'a jamais rien publié. Ce n'est qu'après sa mort qu'on a commencé à connaître ses collations. John Burton est le premier philologue qui en ait donné un spécimen, dans sa Pentalogie. Cette Pentalogie est un choix de pièces empruntées aux trois tragiques grecs, choix imprimé pour la première fois en 1758. Eschyle n'y figure que par les Sept contre Thèbes. Aussi Burton ne cite-t-il que les variantes de cette tragédie. Elles lui avaient été communiquées par Anthony Askew, et Anthony Askew avait oublié de lui dire qu'elles venaient de Peter Needham. Burton, qui croyait que les collations de Needham étaient l'œuvre d'Askew lui-même, ne manqua pas de faire honneur à son ami en le présentant comme un des hommes qui avaient le mieux mérité d'Eschyle. Askew ne réclama point. Il laissa toute sa vie les philologues répéter ces expressions que nous avons si souvent rencontrées dans les livres : collationes Askewianœ, codices ab Askewio collati. Or il ne s'était jamais donné d'autre peine que de copier les annotations de toute sorte qu'il avait trouvées à la marge du Stanley de Needham (112). Il n'y a aucun doute possible sur le plagiat. L'exemplaire d'Eschyle à la marge duquel il avait fait sa transcription est aujourd'hui à côté de celui de Needham, dans la bibliothèque de l'université de Cambridge; et tout le monde peut s'assurer de visu que Blomfield n'a point calomnié Askew en l'accusant de s'être fait une réputation usurpée (113).
Non-seulement Askew était un plagiaire, mais c'était un plagiaire inintelligent. Il lui est arrivé plus d'une fois de ne pas même comprendre ce que Needham avait voulu dire. Voici un remarquable exemple de ses méprises. Needham enregistre, comme je l'ai dit, les variantes des éditions, en même temps que celles des manuscrits. De là ses formules Col. et Col. et St., pour désigner les leçons de l'édition de Genève (Coloniœ Allobrogum), reproduction de celle de Henri Estienne, ou plu- lxxxi tôt de Pierre Victorius. Col. et St. est devenu, chez Askew, collatio per Stephanum facta (114).
Rien n'était plus grossier que la supercherie d'Askew. Il eût suffi à Burton, pour s'en apercevoir, d'ouvrir le Catalogue imprimé des manuscrits du Roi. Depuis près de vingt ans, quand il citait des Colbertins d'après Askew, il n'y avait plus de Colbertins ; et pas un des quatre Royaux d'Askew n'avait conservé son numéro du temps de Needham. Mais Burton ne pensa point au Catalogue; et, ce qui est bien plus extraordinaire encore, c'est que personne, un siècle entier durant, n'y pensa plus que lui. Maurice Haupt est le premier qui ait donné les vrais numéros de quelques-uns de nos manuscrits d'Eschyle, et notamment celui du Parisinus L. Ahrens, dans sa Préface, désigne encore le Parisinus L par le n° 3521. Si Blomfleld s'est aperçu du plagiat d'Askew et l'a dénoncé au monde, c'est uniquement parce qu'il a eu sous les yeux le Stanley de Needham et celui d'Askew, et qu'il en a comparé les annotations.
Askew réussit au delà même de son espérance. Schüitz, pour désigner les quatre Royaux cités par Burton, n'imagina rien de mieux que de leur forger des noms avec le nom même d'Askew. Voilà comment nous avons des manuscrits d'Eschyle qui s'appellent, chez les éditeurs, Askewianus A, Askewianus B, Askewianus C, Askewianus D. Voilà aussi comment, depuis la collation de plusieurs Parisiens par Brunck et par Vauvilliers, la description de nos manuscrits d'Eschyle est devenue, dans les préfaces des éditeurs, un chaos inextricable. Tel des manuscrits collationnés par Brunck ou par Vauvilliers était de ceux qui avaient été déjà collationnés avant 1740 pour Needham. Mais Brunck et Vauvilliers donnent les numéros vé- lxxxii ritables, ceux du Catalogue imprimé; et le même manuscrit, désigné par Askew sous un numéro, par Brunck ou Vauvilliers sous un autre numéro, compte deux fois, et passe pour deux manuscrits différents. Notre 2787, par exemple, le 3320 de Needham et d'Askew, est une première unité comme Askewianus A, et une seconde unité comme Regius В. Maurice Haupt lui-même, en dépit de toute sa bonne volonté et de tous ses efforts, n'est point parvenu à débrouiller la confusion.
Quoi qu'il en soit, le Parisinus L d'Eschyle a longtemps porté le nom à Askewianus D, et peut-être le porte-t-il encore dans l'habitude de quelques savants. Pendant longtemps aussi, les éditeurs n'ont cité que ses variantes des Sept contre Thèbes (115). C'est par Samuel Butler, de 1809 à 1815, qu'on a connu toutes les leçons du Parisinus L recueillies par Needham. Butler avait en main la copie askewienne des collations de Needham, et il s'en est servi, dans son édition, pour toutes les tragédies du poète. Seulement il avait pris, comme jadis Burton, la copie pour un original; et les collations de Needham sont, chez lui aussi, des collations askewiennes. Il ne s'est douté de son erreur que lorsqu'elle a été publiquement signalée par Blomfleld ; mais on ne voit pas qu'il l'ait jamais confessée (116).
Le Parisinus L n'est point un des deux manuscrits dont s'est servi Branck en 1779 pour corriger le texte du Prométhée et des Sept contre Thèbes ; il n'est pas non plus un des cinq dont Vauvilliers, en 1787, a donné les notices et relevé les variantes (117). Depuis l'helléniste quelconque dont Needham avait employé les yeux et la main, personne, absolument personne, n'a jamais fait une étude sérieuse du Parisinus L. On pourrait croire, d'après une phrase de G. Hermann, que ce manuscrit a été collationné une seconde fois, au commencement de notre siècle. Mais la phrase de Hermann ne concerne que la tragédie des Suppliantes (118). Le prétendu collateur s'était contenté de lxxxiii jeter un coup d'œil sur les Suppliantes et les Euménides, et d'en extraire quelques leçons. Il n'a même jamais su quel était exactement le numéro du manuscrit d'où il avait tiré ces variantes (119). Immanuel Bekker a eu la curiosité de parcourir une heure ou deux le texte du Parisinus L; mais ce qu'il en a cité est fort peu de chose. William Linvvood s'est fait envoyer par M. Hase le vrai texte du Parisinus L, pour quelques passages des Euménides; mais M. Hase ne s'est occupé que des passages au sujet desquels il avait été consulté par Linwood (120). Ainsi tout ce qu'on sait du Parisinus L, ou presque tout ce qu'on en sait, provient d'une source unique, la collation antérieure à 1740.
Le collateur de Needham a fait mollement sa besogne; et sa liste des variantes du Parisinus L est extrêmement incomplète. Ce travail avait d'ailleurs le défaut radical de toutes ces collations pour lesquelles on paye des manœuvres plus ou moins habiles. Ce sont précisément les particularités essentielle si les faits vraiment caractéristiques, que le délégué du savant anglais ne signale point. Ce qu'il donne comme provenant du manuscrit 3321 se trouve en effet dans le Parisinus L; mais il y a dans le Parisinus L des milliers de choses qu'un philologue eût notées, et qu'il n'a point aperçues, ou qu'il a négligées comme insignifiantes. Le Parisinus L est donc très-mal connu, ou, pour me servir d'un terme plus juste, très-imparfaitement connu.
Les leçons du Parisinus L sont souvent identiques à celles du Mediceus de Florence. Cependant l'Askewianus D, chez les éditeurs, a souvent aussi des leçons qui lui sont propres. De là un problème que Hermann et Haupt se sont posé, et qu'ils n'ont pas résolu tous les deux de la même façon : « Le Parisinus L est-il ou n'est-il pas une copie du Mediceus? » On lxxxiv comprendra l'importance du problème dès que j'en aurai mis l'énoncé sous une autre forme : « Le Parisinus L n'a-t-il d'autre valeur que celle d'un apographe, ou bien est-il un témoin per se des textes antiques? » Dans la première hypothèse, la science n'a pas même à s'occuper de lui. Dans la seconde hypothèse, le Parisinus L est un véritable instrument critique, el ce manuscrit doit être classé parmi les plus précieux que nous possédions.
Hermann pense que le Parisinus L n'est point une copie du Mediceus, mais qu'il provient du même original que le Mediceus. Cet original était écrit en onciales, ou, comme s'exprime Hermann, en lettres carrées. Ainsi, dans l'opinion de Hermann, le Parisinus L est pour nous, au même titre que le Mediceus, une image d'après nature du manuscrit en onciales depuis des siècles perdu (121).
Maurice Haupt, l'éditeur de l'Eschyle posthume de Hermann, croit qu'il y a plus de vraisemblance à considérer le Parisinus L comme une copie du Mediceus. Les différences entre le Mediceus et le Parisinus L ne sont, suivant lui, ni très-nombreuses ni très-graves. Il les explique en supposant que le calligraphe du Parisinus L a eu tantôt des fantaisies savantes, tantôt des distractions. Les leçons propres au Parisinus L ne sont, dans cette hypothèse, que des corrections ou des inadvertances (122).
Si Haupt avait tenu en main le manuscrit pendant une heure seulement, il aurait cherché, à coup sûr, quelque autre explication. La sienne ne se conçoit que si le Parisinus L est tout entier dans la collation de Needham : et encore! Mais il n'y est pas à moitié, il y est à peine. Les différences entre le Mediceus et le Parisinus L sont extrêmement nombreuses. J'en ai compté jusqu'à cent cinquante et plus par millier de vers. Beaucoup de ces différences sont graves et tout à fait irréductibles aux deux catégories de Haupt. Enfin le calligraphe du Parisinus L n'est à aucun degré l'homme que Haupt se lxxxv figure. Ce calligraphe est un copiste très-soigneux, très-scrupuleux, et qui se préoccupe uniquement de reproduire son original avec exactitude. Même les leçons les plus inintelligibles et les plus absurdes, il les transcrit toiles qu'elles; même les corrections les plus faciles à faire, il ne les fait point. Il pousse la religion de l'exactitude jusqu'à laisser des blancs dans le texte, là où l'original n'était plus lisible, et là même où le moindre effort de correction, pour parler comme Haupt, aurait réussi à combler les lacunes.
Si nous entrons dans le détail, l'hypothèse de Haupt s'écroule, on peut dire, de tous les côtés. On en jugera par le petit tableau, où je mets en regard quelques-unes des leçons appartenant aux cinq pièces qui sont communes au Mediceus et au Parisinus L.
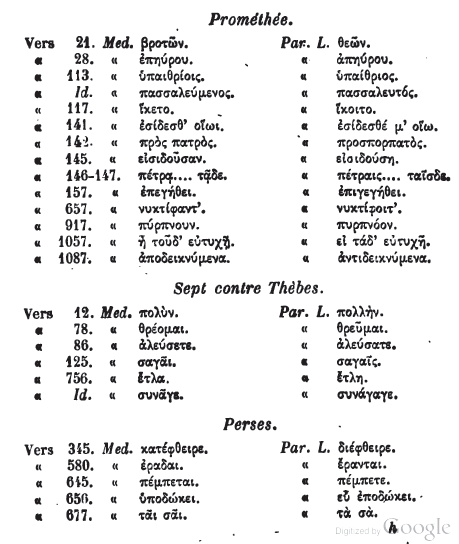
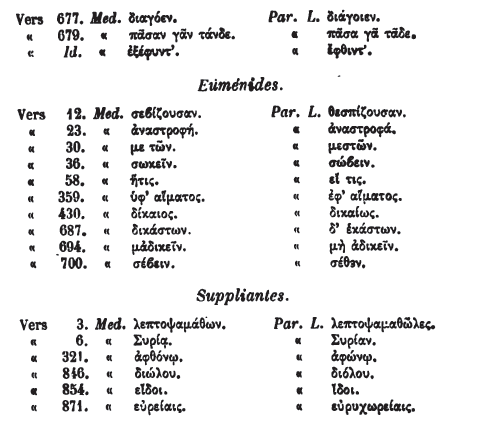
lxxxvi Il y a certainement, parmi les leçons que je viens de comparer, des différences qu'on pourrait regarder ou comme des fautes d'inadvertance ou comme des corrections; mais c'est le petit nombre. Les autres, c'est-à-dire presque toutes, prouvent que le calligraphe du Parisinus L n'a point copié le Mediceus.
Mais les blancs du texte, dans le Parisinus L, sont une preuve bien plus parlante encore. Ces vides ne s'expliquent que si le calligraphe du Parisinus L a eu sous les yeux; un texte parfois illisible. Or le texte du Mediceus, même aujourd'hui, est parfaitement lisible d'un bout à l'autre. Qu'était-ce donc il y a trois cent cinquante ou quatre cents ans? Les endroits les moins nets ou les plus effacés n'offrent aucune difficulté sérieuse ; et il n'y a pas un des blancs du Parisinus L qui corresponde à un endroit du Mediceus usé ou mal écrit. Voici l'indication des blancs immédiatement visibles, et celle des mots ou des syllabes que le calligraphe aurait certainement copiés, s'il avait fait, ainsi qu'on le prétend, une transcription du Mediceus ;
lxxxvii. Suppliantes, vers 194, blanc entre γοεδ et καὶ : νάὰ (γοεδνὰ καὶ). 230, blanc entre δικάζει et λόγος; : τἀμπλακήμαθ', ὡς. 270, blanc entre iποτ' et ηὔρετ' : ἀντίμισθον. 321, blanc entre τοῦδ' et τοὔνομ' : ἄνοιγε. 786, blanc entre μ' et οἴχομαι : ειλον (εἷλον). 800, blanc entre δ' et ἕλωρα : ἔπειθ'. 823 , blanc entre ταλάντου et ἄνευ : τί δ'. 830, blanc entre πράξ et πόνων : ενα (πρόξενα). 843, blanc entre ει et πούρυτον : θ' ἀνὰ. 848 , blanc avant τάπιτα ἠσυδουπία.
On comprend très-bien que le scribe du Parisinus L n'ait pas essayé de combler par ses inventions propres les lacunes de l'original ; car la plupart des mots fournis par le Mediceus n'étaient pas faciles à deviner, surtout quand les phrases mutilées n'avaient plus aucun sens. Mais il est fort remarquable que γοεδ, tout au moins, n'ait pas tenté sa science; car γοεδνά se présentait de lui-même. Le blanc qui remplace la syllabe si facile à rétablir nous édifie, ce me semble, et sur le caractère réservé du copiste, et sur son exacte méthode de transcription.
Outre les blancs visibles à l'œil, il y a dans le Parisinus L des lacunes dont on ne s'aperçoit que par la confrontation du manuscrit avec les textes imprimés. Ainsi les vers des Perses 552-562 manquent. Ainsi le vers 279 des Sept contre Thèbes manque pareillement. Souvent enfin on ne sait qui parle, le nom du personnage n'étant pas toujours indiqué à côté du premier vers qu'il prononce.
Les omissions répétées du nom de l'interlocuteur ne s'expliquent pas très-bien par l'hypothèse des inadvertances. Le Mediceus, comme on peut le voir chez Dindorf, indique exactement ce qui appartient à chaque personnage. Comment croire, par exemple, qu'un homme entendant tant soit peu le grec ait commis toute une série d'inadvertances, en transcrivant les vers 836-901 ? Il n'y a pas un mot dans le Parisinus L qui fasse comprendre que cette scène est un dialogue. Mais, si les indications manquaient dans l'original, on n'a pas de peine à s'expliquer que le copiste n'ait point osé prendre sur lui de marquer les coupures et de déterminer en arbitre souverain ce qui appartient proprement au chœur, ce qui appartient proprement aux filles de Danaüs.
L'absence du vers 279 des Sept contre Thèbes pourrait être un fait d'inadvertance. Mais ce vers, qui est dans le Mediceus, manque dans la plupart des manuscrits d'Eschyle. Ce n'est donc point forcer l'induction que de conclure qu'il manquait lxxxviii dans le texte copié par le scribe du Parisinus L; par conséquent, que ce n'est pas le Mediceus qu'a copié ce calligraphe.
Le trait vraiment décisif, c'est l'absence des vers 552-562 dans la tragédie des Perses. Ξέρξης δ' ἀπώλεσεν τοτοῖ, c'est-à- dire le vers 551, y est immédiatement suivi de διὰ δ' Ἰαόνων χέρας, c'est.-à-dire du vers 563. De cette façon, le développement des idées se trouve interrompu, et les deux vers contigus ne forment point une phrase. Les onze vers qui manquent dans le Parisinus L sont dans le Mediceus. Tout le monde peut s'en assurer en ouvrant, à la page Lxiv, la Préface de Dindorf. Ils font partie du spécimen des leçons du Mediceus imprimé à cette page. Mais ce que Dindorf a oublié de dire, c'est que le Mediceus n'a les vers 552-562 qu'écrits de seconde main, et à la marge. C'est par Maurice Haupt que nous connaissons cette particularité (123). Mais la seconde main avait fait son office à la marge du Mediceus, et depuis plusieurs siècles déjà, quand le calligraphe du Parisinus L faisait sa copie des Perses. Supposer que celui-ci ait eu sous les yeux les onze vers indispensables, et qu'il les ait omis de propos délibéré, c'est lui prêter une incontestable ineptie. On ne se résigne aux non-sens que dans les cas de force majeure. Le calligraphe du Parisinus L a fait ici ce qu'il devait faire plus loin pour les mots ou effacés ou illisibles des Suppliantes, Il a subi une nécessité. Il copiait un texte où les vers des Perses 552-562 n'étaient pas. J'ajoute, en passant, que la façon dont il s'est résigné au non-sens de la juxtaposition du vers 551 et du vers 562 achève de mettre en lumière sa conscience et son exactitude. S'il avait eu le moins du monde ce goût de correction que lui prête Maurice Haupt, il avait trop peu à faire pour ne pas ramener à une construction régulière, sinon à une pensée nette, les deux morceaux de phrase Approchée par le hasard. On lirait après Ξέρξης δ' ἀπώλεσεν τοτοῖ, dans le Parisinus L, Ἰαόνων διὰ χέαρς, et non point διὰ δ' Ἰαόνων χέρας.
Le Parisinus L a été copié sur un manuscrit fort vieux et
fort usé certainement dans quelques-unes de ses parties. Il a été
copié sur un texte où manquaient onze vers des Perses.
lxxxix Ce qui me fait
croire que ce vieux manuscrit est celui-là même sur lequel a été
copié le Mediceus, c'est que les différences entre le
Mediceus et le Parisinus L s'évanouissent pour ainsi dire
d'elles-mêmes, dès qu'on écrit en onciales, à côté l'une de l'autre,
les deux leçons en apparence diverses. Il suffit de supposer le K ou
le B mal fait, pour qu'il y ait identité entre
 et
et
 . Il suffit que le Θ et l'O de
ἀφθόνῳ se touchent pour qu'on soit exposé à lire
. Il suffit que le Θ et l'O de
ἀφθόνῳ se touchent pour qu'on soit exposé à lire
 au lieu de
au lieu de
 . La ressemblance du sigma lunaire
el du Θ fait comprendre l'hésitation du lecteur entre
. La ressemblance du sigma lunaire
el du Θ fait comprendre l'hésitation du lecteur entre
 et
et
 , pour peu que les premières
lettres du mot soient ou mal formées ou altérées par le temps.
L'iota, dans le manuscrit en onciales, était généralement adscrit,
et non point souscrit ni supprimé. On voit cela à certaines leçons
du Mediceus, telles que σαγαῖ, ταῖ, σαῖ, elc. Il est certain
d'ailleurs que les consonnes finales n'étaient souvent indiquées que
par un simple trait. Ne nous étonnons donc point que les
terminaisons en ᾳ du Mediceus correspondent, dans le
Parisinus L, à des terminaisons en αις. Rien de plus simple
surtout que la métamorphose de σαγαῖ en σαγαίς (124).
Son accent seul, s'il n'était pas nettement tracé, a pu être pris
pour l'équivalent du sigma, de même que l'équivalent du sigma a pu
être pris pour un circonflexe. C'est par l'iota adscrit qu'on
s'explique l'identité pour l'œil de πᾶσαν γᾶν τᾶνδε et de πᾷσα γᾶ
τᾶδε, celle de Συρίᾳ et Συρίαν, et d'autres analogues. Ceux qui
savent que les prépositions de deux syllabes s'écrivaient de temps
immémorial en abrégé, et qu'un simple trait en haut de la ligne
tenait à chaque instant lieu d'une lettre ou d'une syllabe qui
aurait dû être répétée, trouveront peu extraordinaire la confusion
de ἀποδεικνύμενα et de ἀντιδεικνύμενα, de ἐπεγήθει et de ἐπιγήθει,
de συνᾶγε et de συνάγαγε, etc.
, pour peu que les premières
lettres du mot soient ou mal formées ou altérées par le temps.
L'iota, dans le manuscrit en onciales, était généralement adscrit,
et non point souscrit ni supprimé. On voit cela à certaines leçons
du Mediceus, telles que σαγαῖ, ταῖ, σαῖ, elc. Il est certain
d'ailleurs que les consonnes finales n'étaient souvent indiquées que
par un simple trait. Ne nous étonnons donc point que les
terminaisons en ᾳ du Mediceus correspondent, dans le
Parisinus L, à des terminaisons en αις. Rien de plus simple
surtout que la métamorphose de σαγαῖ en σαγαίς (124).
Son accent seul, s'il n'était pas nettement tracé, a pu être pris
pour l'équivalent du sigma, de même que l'équivalent du sigma a pu
être pris pour un circonflexe. C'est par l'iota adscrit qu'on
s'explique l'identité pour l'œil de πᾶσαν γᾶν τᾶνδε et de πᾷσα γᾶ
τᾶδε, celle de Συρίᾳ et Συρίαν, et d'autres analogues. Ceux qui
savent que les prépositions de deux syllabes s'écrivaient de temps
immémorial en abrégé, et qu'un simple trait en haut de la ligne
tenait à chaque instant lieu d'une lettre ou d'une syllabe qui
aurait dû être répétée, trouveront peu extraordinaire la confusion
de ἀποδεικνύμενα et de ἀντιδεικνύμενα, de ἐπεγήθει et de ἐπιγήθει,
de συνᾶγε et de συνάγαγε, etc.
On trouve fort extraordinaire peut-être une énorme différence comme celle de βροτῶν et de θεών au vers 21 du Prométhée. Mais cette différence n'est énorme que si les deux mots sont écrits en toutes lettres; et on les écrivait en abrégé, au moyen de sigles faciles à confondre. Les mots qui reviennent souvent dans une langue finissent d'ordinaire par se résumer xc en formules très-courtes. Les Grecs eux-mêmes ont eu, comme les Romains, certaines habitudes en ce genre, qu'il faut avoir toujours présentes à l'esprit quand on discute sur les textes. C'est un fait que βρώτος, comme ἄνθρωπος, n'était ordinairement qu'indiqué. De même οὐρανος, πατήρ, etc.
Je n'affirme point que toutes les difficultés d'une confrontation
complète du Mediceus et du Parisinus L se puissent
ramener à de simples questions de lecture. Il faudrait, pour que la
démonstration fût sans réplique, qu'on possédât un relevé exact de
toutes les variantes du Parisinus L, jusqu'aux plus imperceptibles,
et qu'il n'y en eût pas une qui ne s'expliquât comme nous venons
d'expliquer les principales, et comme s'expliqueraient toutes les
autres que j'ai transcrites. Mais tout ce qu'on pourrait
légitimement conclure de telle ou telle difficulté insoluble, c'est
qu'entre le manuscrit en onciales et le Parisinus L il y
avait eu un intermédiaire, une première copie ayant subi des
corrections. Cette première copie n'existe point. Jusqu'à ce qu'on
retrouve cette copie, ou jusqu'à ce qu'on retrouve le manuscrit en
onciales lui-même, le Pari- sinus L est rétabli dans ses droits.
L'hypothèse de Hermann se prête également aux deux cas : copie
directe, copie de copie. Je crois à la copie directe. Mais, de toute
façon, il faut rayer de la liste des axiomes la proposition jadis
avancée par Burgess, le deuxième éditeur de la Pentalogie de
Burton, et répétée naguère par Guillaume Dindorf et par d'autres:
«Que tous les manuscrits d'Eschyle dérivent du Mediceus (125).
» Le Parisinus L ne dérive point du Mediceus.
(01) Αἰσχύλος ὁ τραγικὸς γένος μὲν ἦν Ἀθηναῖος
(02) Fasti Attici, olympiade LXXIII.
(03) Corsini, loc. cit.
(04) Livre vi, chapitre 114.
(5) Justin, livre ii, chapitre 9.
(6) Diodore de Sicile, livre xi, chapitre 87; Élien, Var. hist,, livre v, chapitre 19. Le biographe anonyme l'appelle Ἀμεινίας. Cette confusion de l'υ avec ει est, comme on sait, très fréquente dans les manuscrits.
(7) Le biographe anonyme.
(8) Diodore de Sicile, loc. cit.
(9) Cette remarque a été faite par Pausanias et par Athénée; et Bayle relève avec raison les erreurs de Romulus Amaséus au sujet de cette épitaphe. Article Eschyle, note 1
(10) Δημήτηρ, c'est-à-dire γῆ μήτηρ. On trouve dans Eschyle même, δᾶ, poétique et dorien, pour γῆ.
(11) Cicéron, Tusculanes, livre ΙΙ, chapitre 10.
(12) De satyrica Poesi, i, 5.
(13) Pausanias, Attic., 21, attribue ce récit à Eschyle, mais sans dire à quelle source il vient de le puiser lui-même.
(14) Suidas, au mot Pratinas
(15) Athénée, Souper des sophistes, νiii, 59
(16) Thucydide, livre I chapitre 22.
(17) Plutarque, Vie de Cimon.
(18) Hésiode, Oeuvres et Jours, vers 25, 26.
(19) Térence, Andrienne, prologue, vers 6, 7.
(20) Διὰ τὸ πεσεῖν τὰ ἴκρια.
(21) Commentaire sur la vie anonyme d*Eschyle.
(22) Grœcœ tragœdiœ principum, etc. Heidelberg, 1808, in-8°, page 38.
(23) Τὰ ἴκρια ἐφ' ὧν ἐστήκεσαν οἱ θεαταί. Au mot Pratinas.
(24) Var. hist., y, 19.
(25) Chronol. scenic, t. iii de l'édition d'Euripide.
(26) Saturnales, chapitre v, livre 19, à propos du vers de l'Énéide ix, 515.
(27) Παλικοί, de πάλιν ἱκνέομαι (poétiquement ἵκω), revenir.
(28) La Fontaine, Fables, liv. viii, fable 10.
(29) Livre ix, chapitre 12.
(30) Histoire naturelle, livre x, chapitre 3.
(31) Voyez les Grenouilles d'Aristophane; voyez aussi l'Électre d'Euripide. La reconnaissance d'Oreste et de sa sœur contient implicitement la plus vive critique et la plusd outrée du passage analogue des Choéphores.
(32) Philostrate, Vie d'Apollonius de Tyane, vi, 11.
(33) Quintilien, Institution oratoire, x, 1.
(34) Aristophane, Guêpes, vers 920.
(35) Apud Stanl. de Vit. Aeschyl.
(36) Pindare, Olympiques, ode xiii, épode 1..
(37) Voyez livre ii, vers 380-381
(38) Cette expression passa en proverbe, pour dire : A la question! .
(39) Suidas, au mot Thespis, dit que Thespis était le seizième à partir d'Épigène
(40) Plutarque, Vie de Solon, chapitre 29.
(41) Ὑποκριτής, de ὑποκρίνομαι, répondre.
(42) Horace, Art poétique, vers 275 et suivants.
(43) Horace. Épîtres, livre II, 1, vers 162, 168. .
(44) C'est en effet l'opinion de quelques critiques. Mais ce que je dis d'Alceste, on peut, à coup sur, l'affirmer de certaines histoires de la légende de Bacchus, où les rôles de femme étaient absolument nécessaires, et qui avaient été représentées sur la scène avant le temps de Phrynichus.
(45) Ce Glaucus était un critique alexandrin.
(46) Voyez Suidas, au mot Pratinas.
(47) Horace, Art poétique, vers 284 et suivants.
(48) Horace, Art poétique, vers 278 et suivants.
(49) Platon, Gorgias, page 522 des Œuvres.
(50) Horace, Art poétique, vers,31, 32.
(51) Horace, loc. cit..
(52) Ce mot signifie, littéralement, surchant.
(53) Πρῶτος Αἰσχύλος τὰ τοῦ χοροῦ ἠλάττωσε
(54) Pollux, Onomasticon, ιν, 15.
(55). Bœckh, Grœc. tragœg. princip., îv, page 85 et suivantes.
(56) Bœckh le démontre par le passage du Gorgias ou la tragédie est appelée une rhétorique à l'usage des enfants et des femmes, des hommes libres et des esclaves, et par d'autres passages analogues des Lois, II, p. 658, et VII, page 817 des Œuvres de Platon.
(57) Voyez son chapitre vi, page 57 et suivantes.
(58) Πεντηκοστόπαις. Suppliantes, vers 321.
(59) Ce qu'on vient de lire a été écrit il y a trente ans. Aujourd'hui encore, comme il y a trente ans, je reste convaincu que Boeckh n'avait pas raison Mais je dois dire que son opinion a été adoptée, dans ces derniers temps par des hommes de grand savoir, et de ceux qui ont le mieux mérité d'Eschyle. Ce paradoxe semble même devenu une vérité pour certains littérateurs. Je suis donc réduit à confesser que l'opinion de Bœckh n'est pus une pure absurdité. Et pourtant, qu'on dise ce qu'on voudra, cinquante n'est pas quinze.
(60) Sur le vers 580 des Chevaliers d'Aristophane
(61) Vie d'Apollonius de Tyane, vi, 11,
(63) Philostrate, Vie d'Apollonius de Tyane, vi, 11.
(64) Aristophane, Grenouilles, vers 898.
(65) Pausanias, Attique, 21. C'est par erreur qu'on a fait dire à Pausanias qu'Eschyle avait été peint dans le tableau de Marathon. Il dit seulement que le portrait d'Eschyle était d'une époque postérieure à celle du tableau de Marathon.
(66) Pseudo-Plutarque, Vie des dix orateurs, page 481. F. Le passage est: obscur, et les expressions du biographe sont presque contradictoires. Il semble dire qu'il n'était pas permis de représenter les pièces des grands tragiques. Et puis, il y a un certain mot παραναγινώσκειν, dont le sens est loin d'être clair. L'interprétation que je donne de ce passage, et qui me paraît la seule plausible, n'exige aucune altération dans le texte. Je la dois à mon ami M. Emile Egger, aujourd'hui membre de l'Institut.
(67) Le scholiaste d'Aristophane, sur le vers 1864 des Nuées.
(68) Unus ejus Agamemnon obscuritate superat quantum est librorum sacrorum eum suis Hebraïsmis el Syrianismis et tota Hellenistica supellectile vel farraginei De Hellenistica, pag. 87 epist dedic.
(69) Cela est visible à l'examen de l'exemplaire d'Eschyle dont il se servait, et sur lequel il a écrit en marge quelques notes.
(70) Paris, 1780 , 8 vol. in-4°, réimprimés plusieurs fois. Espérons, pour l'honneur de notre pays, que l'édition de 1820 sera la dernière.
(71) Athénée, Souper des Sophistes, viii, 83.
(72) Voyez plus loin ce qui concerne l'édition de M. Weil.
(73) Histoire de la littérature grecque, chapitre xxii, § 15.
(74) Art poétique, vers 193 et suivants.
(75) Eschyle, Agamemnon, vers 740 et suivants.
(76) Aristophane, Grenouilles, vers 814 et suivants.
(77) Aristophane, Grenouilles, vers 1030 et suivants.
(78) Aristophane, Grenouilles, vers 1039 et suivants. On a remarqué, à propos de ce passage, que l'Agamemnon avait pour sujet l'amour adultère de Clytemoestre. C'est une erreur. Il s'agit, dans l'Agamemnon, de la vengeance du meurtre d'Iphigénie, réellement immolée à Aulis, d'après la tradition qu'Eschyle a préférée et qu'il a transmise à Lucrèce.
(79) Tusculanes, II, x, 13.
(80) Scholies d'Aristophane, Grenouilles, vers 1023.
(81) Scholies d'Aristophane, Grenouilles, vers 1295.
(82) Imitation des Myrmidons d'Eschyle, par Attius.
(83) Scholies d'Aristophane, la Paix, vers 1177.
(84 Scholies d'Aristophane, Oiseaux, vers 1420.
(85) Plutarque, Consolation à Apollonius, xxix.
(86) Suidas, au mot ἀβδέλυκτα.
(87) . Scholies d'Aristophane, l'Assemblée des femmes, vers 892.
(88) Scholies d'Aristophane, Oiseaux, vers 508.
(89) Athénée, Souper des sophistes, xiii, page 600.
(90) Théophile à Antolycus, II, 54, page 256, édition de Wolf.
(91) Strabon, Géographie, livre iv, page 183.
(92) Voyez Bœckh, Grœc. trag. princ,, page 54.
(93) Voyez aussi la Bibliothèque grecque de Fabricius, tome ii, édition de Harles.
(94) Galien, in Hippocr. Epidem., iii, comm. ii, tome v, page 412, édition de Bâle. Voyez, sur ce passage, Nissen, de Lycurgi orat. Vita, page 86, etc.; Petersen, de Vita et Fabulis Aeschyli, page 79 et suivantes; Boeckh, à la page 13 de son ouvrage.
(95) Philostrate, Vie d'Apollonius de Tyane, vi, II. Toute la difficulté consiste à savoir ce que signifient les mots ἐκ καινῆς.
(96) Quintilien, Institution oratoire, livre x, chapitre 1.
(97) Voyez le texte de la lettre d'Ambroise, avec les notes de Guillaume Dindorf, Préface de la cinquième édition de Leipzig, page iii-v. Cette lettre est antérieure à l'an 1439, date de la mort d'Ambroise.
(98) Voici le titre complet : ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ Ζ, Προμηθεὺς δεσμώτης, Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβαις, Πέρσαι, Ἀγαμέμνων, Χοηφόροι, Εὐμενίδες, Ἱκετίδες. Aescylli tragoediae VII. Quae cum omnes multo quam antea castigatiores eduntur, tum vero una, quae mutila et decurtata prius erat, integra nunc profertur. Scholia in easdem, plurimis in locis locupletata, et in pene infinitis emendata. Petri Victorii cura et diligentia. — Je n'ai pas besoin de rappeler le nom italien de l'éditeur: Pietro Vettori.
(99) « Ñeque tamen ille unquam, dum servit amplitudini ejus poematis, nitorem atque elegantiam sermonis neglexit. Aspersa est enim oratio ipsiuss uavissimis quibusdam quasi floribus, qui exornant eam magnopere, et undique concinnam ac politam reddunt. » Cela est peu traduisible en français ; mais j'en ai donné, sinon la lettre, du moins l'exact équivalent
(100) Heismoeth place lui-même l'audace parmi les qualité nécessaires au critique. Son dernier écrit est intitulé : De necessaria in re critica vigilantia, perseverantia atque audacia. 1839.
(101) Neuchâtel, Paris et Berlin, 1868, in-8°. M. Pronce est mort presque aussitôt après avoir publié son ouvrage.
(102) . Les deux volumes de l'an III devaient être suivis de plusieurs volumes de notes et de dissertations; mais ces annexes n'ont jamais paru. On sait pourtant que la copie était prête, qu'on en a même imprimé plus de trois cents pages.
(103) Les tragédies d'Eschyle, traduites en français par Ad. Bouillet. Paris, Hachette et Cie.
(104) L'Orestie, trilogie tragique d'Eschyle, traduite en vers, par Paul Mesnard. Paris, 1863, in-8°. La traduction est précédée d'une Introduction très-étendue et très-remarquable.
(105) Cette dissertation a été imprimée en 1869, dans l'Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques. Je la donne aujourd'hui plus correcte et plus complète, grâce surtout aux observations dont elle a été l'objet de la part de M. Emmanuel Miller, membre de l'Institut. Voyez la Revue archéologique du mois de juillet 1809, p. 50-53.
(106) Je donne les chiffres qu'on lit dans le livre. En réalité, il y a 302 feuillets ou 604 pages, sans compter le feuillet du titre. Voyez un peu plus loin,
(107) Les deux derniers feuillets du dix-huitième quaternion sont restés en blanc, et ils ne portent point de chiffres arabes.
(108). Voyez le tome II du Catalogue, page 566.
(109) Voyez la Revue archéologique du mois de juillet 1869, p. 52 et 53, et surtout les articles consacrés, dans le Journal des Savants de 1868, à la Poliorcétique des Grecs de M. Wescher, par M. Emmanuel Miller, membre de l'Institut, p. 8 et 9 du tirage à part.
(110) Voyez la Revue archéologique, juillet 1869, p. 53. Dans le Catalogue des manuscrits, le n° 2741 lui-même n'est attribué que très-dubitativement à Jean Lascaris : « Is codex Jani Lascaris, et fartasse ipsius manu scriptus, sub finem sœculi decimi quinti exaratus videtur. » II porte, sur le premier feuillet, le nom de Lascaris en toutes lettres, et non pas simplement son monogramme. Ce manuscrit est une copie de l'Anthologie, avec des scholies à la marge.
(111). Blomfield, Préface du Prométhée, page vi : « Septem codicum collationes hinc illinc a Petro Needharao conquisitas, adscripserat ille margini exemplaris editionis Stanleianœ, quod nunc in bibliotheca Acadeniiœ Cantabrigiensis servtur..
(112) Blomfield, Préface du Prométhée, page vi : « Has omnes Askevius (sic), qua erat fide, usque ad ipsa Needhami verba et symbolum, in suum Aeschyli exemplar transtulit.
(113) Blomfield, Préface du Prométhée, page ix : « Cod. reg. P., quorum collationes in Bibl. Acad. Cantabr. asservantur duobus libris, quorum marginibus adscriptae fuerant a Petro Needhamo, et postea ab Antonio Askevio."
(114) Blomfield, Préface des Sept contre Thèbes, page vii : «Occurrunt quidem in margine libri Needhamiani, de quo in Prafatione ad Promethea mentio facta est, litterae Col., id est editio Aeschyli, Coloniae in Corpore Poetarum data. Porro haec editio textum Henrici Stephani repraesentat; unde factum est, ut Needhamus sœpe varietates hunc in modum designarit : Col. & St. Sed quum haud valde eleganter exaratum sit compendium illud &, sed magis ad formam literœ p, Askevius, Needhami scrinia compilans, has notas facete interpretatus est, collationem per Stephanum factam... Quippe uno exemplo monstrare volui, quali fuerit in hujusmodi rebus peritia Askevius, de eruditionis fama, malis artibus comparata, dudum depelli cœptus. » Cette condamnation d'Askew par un savant anglais, par un évêque, par le plus bienveillant et le plus évangélique des hommes, nous met bien à l'aise pour qualifier comme il convient les procédés du pseudo-philologue.
(115) Voyez Schütz, éd. de 1809, t. I, p. vi, art. Codices ab Askewio collati.
(116) Blomfleld, Préface des Sept contre Thèbes, page vii: «Paulo longius progressus est Butlerus, qui has ipsas varietates collationes Askevianas vocat. Quem errorem, haud sane gravem, a me obiter notari œquo animo feret viе eruditus, laboris sui laude minime fraudandus, etc. »
(117) Le travail do Vauvilliers est imprimé dans le tome premier des Notices et Extraits publiés par l'Académie des inscriptions, pages 324-340.
(118) Adnotationes ad Supplices, page 3 du tome II do l'édition posthume : « Parisinus a Wellauero littera L notatus, quem et Antonius Askewius et Godofredus Faehsius contulerunt. » Il est bien étrange que Hermann , tant d'années après la protestation de Blomfield, dise encore Askew, comme Schûtz et Wellauer. On pardonne à l'éditeur de l'Eschyle-Didot son ab Askewio collatus, à propos du soi-disant 3521 : ni lui ni son correcteur n'allaient au fond des choses ; mais un homme comme Hermann; la science et la conscience même !.
(119) Haupt, Préface, page vii: « Qui hunc librum Parisinum iterum, sed non ea qua par erat diligentia, excussit Godofredus Fœhsius, falsus est quum quse in Sylloge lectionum, anno 1813 edita, p. 158 et 164, ex Eumenidibus et Supplicibus attulit, ea tribuit codici Parisino, 2782. »
(120) Haupt, ibid. : « Nonnulla inde excerpsit Immanuel. Bekkems ; in Eumenidibus de aliquot versuum scriptura Gulielmum Liuwoodium certiorem fecit Carolus Bencdictus Hasius.
(121) Hermann, Annotationes ad Supplices, page 3 : « Codex Mediceus, ut multis indiciis cognoscitur, descriptus est ex libro litteris quadratis scripto; quod non obliviscendum est recte eo uti volentibus... Parisinus fontem habuit illum antiaquum librum, ex quo descriptus est Mediceus. »
(122) Haupt, Préface, page vii : « Nescio tamen an probabilius suspicemur ab ipso Mediceo codice origmem ejus repetendam esse; a quo codice non videtur ita discrepare, ut dissimilitudo non posait orta esse ex describentis negligentia iit aliquo etiam emendandi conatu. »
(123) Préface, p. viii: « Persarum versus 547-558, in Mediceo, a manu secunda in margine adscripti sunt, omissi in Par. L. » Haupt compte d'après les chiffres de Hermann. Mais le vers 562 est 557 chez Hermann, et non 53j8. Haupt ne savait probablement pas que διὰ δ' Ἰαόνων χέρας. est dans le Parisinus L. La lacune véritable est de onze vers, et non de douze.
(124) Voyez les fac-similé du Palimpseste syriaque d'Homère, publié par Cureton. Nous supposons un manuscrit en vraies onciales, et non pas en écriture hybride comme ceux du viiie ou du ixe siècle. Nous augmentons donc les difficultés.
(125) Dindorf, Préface de la cinquième édition, page vi : « Ex codice Mediceo derivata sunt quotquot ad hunc usque diem innotuerunt harum tragœdiarum apographa. » Le Parisinus L n'est peut-être pas le seul des manuscrits d'Eschyle qui ne rentre point dans cette formule. Le manuscrit de Wolflenbüttel, ce fameux Guelferbylanus des anciens éditeurs, pourrait bien avoir réellement l'importance qu'on lui attribuait autrefois. Heimsœth est de cet avis, et Heirnsœth me paraît avoir raison.