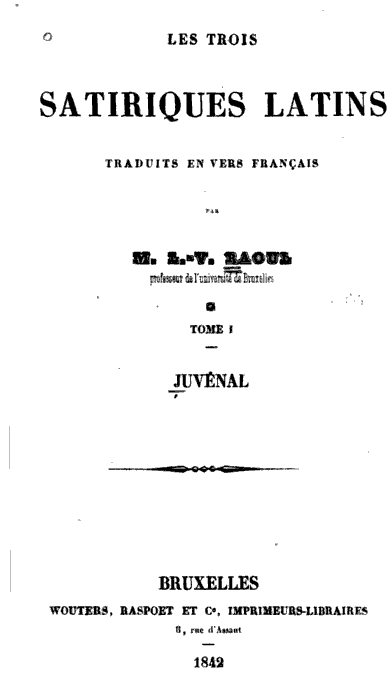|
JUVÉNAL
SATIRE I Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
SATURA I / SATIRE I.(Traduction de L. V. Raoul, 1812)autre traduction
|
VIE DE JUVÉNAL.
Juvénal originaire d’Aquinum au pays des Volsques, eut pour père, d’autres disent pour protecteur, un riche affranchi, et se livra, jusqu’à l’âge d’environ quarante ans, à la rhétorique et à l’art déclamatoire, non point qu’il se destinât à l’école ou au barreau, mais par goût et par prédilection. On convient assez généralement que, sans jouir d’une grande fortune, il vécut au moins dans cette heureuse médiocrité à laquelle les gens de lettres devraient borner leurs vœux. Ce fut sous Domitien qu’il commença à cultiver la poésie. Il débuta par quelques vers satiriques contre l’histrion Pâris, favori de l’empereur, et contre un poète protégé par cet histrion. Cependant il se garda bien, pour le moment, de donner la moindre publicité à ses premiers essais, et se contenta de poursuivre, en silence, sa dangereuse carrière. Ce n’est que longtemps après qu’il osa, en présence d’un petit nombre d’amis, hasarder la lecture de quelques fragments de son ouvrage. Adrien venait de prendre les rênes de l’empire: Rome avait respiré sous Nerva, et recouvré, sous Trajan, une partie de son ancienne gloire : on commençait à s’expliquer plus librement sur les règnes cruels de Néron et de Domitien. Dans ces circonstances, Juvénal ne craint plus de suivre l’impulsion donnée aux esprits: il la seconde au contraire, ou plutôt il la dirige. Ses Satires sont lues publiquement, applaudies avec transport, recueillies avec avidité. Malheureusement les traits qu’il avait lancés contre l’histrion Pâris, s’appliquaient ou paraissaient s’appliquer non moins directement à un autre affranchi, alors en faveur à la cour d’Adrien. L’histoire ne le nomme pas. On suppose que ce pouvait être Antinoüs. Quoiqu’il en soit, Juvénal fut soupçonné d’avoir à dessein, en parlant du temps passé, fait allusion au temps présent, et l’empereur, sous prétexte de l’élever à un emploi honorable, l’envoya, à l’âge de quatre-vingts ans, commander une cohorte en Egypte. Il y mourut bientôt de dégoûts et d’ennuis. Cette promotion d’un poète aussi âgé à un commandement militaire, était une espèce de plaisanterie plus que satirique par laquelle l’empereur se vengeait du fameux vers: Praefectos Pelopea facit, Philomela Tribunos. Selon Dodwel, la satire où Juvénal raconte la querelle sanglante suscitée par la superstition, entre les peuplas de Tentyre et d’Ombos, fut écrite dans le lieu même de son exil. Selon Saumaise, le poète ne rapporte cette aventure que comme un fait dont il avait pu être témoin dans un voyage précédent. Ceux qui prétendent que c’est sous Domitien que Juvénal fut exilé, se trompent. Domitien se serait vengé plus cruellement de l’injure qu’on eût osé faire à son favori: d’ailleurs, nous trouverons plus d’une fois, en éclaircissant le texte de notre auteur, l’occasion de démontrer que cette assertion mt fausse.
PRÉFACE.
On parle peu de Juvénal; on le connaît moins encore; et, sous le rapport même de la satire, Horace lui est préféré par le grand nombre. La raison en est facile à donner. Une suite de tableaux odieux; des vices effroyables dont on prendrait les peintures, toutes fidèles qu’elles sont, pour autant d’hyperboles outrées; des maximes austères exprimées sans ménagement; des locutions énergiques et concises; des allusions fréquentes à des usages oubliés; par-dessus tout cela, le caractère du commun des hommes naturellement enclins à préférer le badinage élégant d’un écrivain enjoué, au ton brusque et chagrin d’un moraliste sévère, toutes ces causes, sans nuire au mérite réel des satires de Juvénal, ont dû contribuer à en rendre la lecture plus difficile et plus rare. Celles d’Horace, par des raisons contraires, n’ont pu manquer de se concilier un plus grand nombre de lecteurs et de partisans. Aussi, dans cc genre même, auquel il ne doit peut-être que la moindre partie de sa gloire, a-t-il été presque de tout temps l’objet d’une prédilection, je ne dirai pas aveugle, mais du moins excessive à quelques égards. Toujours envisagé sous le rapport le plus favorable, toujours applaudi des uns par sentiment, des autres par convention, il n’a cessé à aucune époque de réunir tous les suffrages; recherché après sa mort des savants et des gens du monde, comme il l’avait été pendant sa vie, de Brutus et d’Auguste. C’est en vain que dans l’espace de dix-huit siècles, quelques voix se sont élevées en faveur de Juvénal; on ne les a pas entendues. Aujourd’hui même on tenterait peut-être vainement de réclamer pour lui une place à côté de son heureux devancier. La palme tout entière est dévolue au poète de Tivoli, et tant que les voix se compteront au lieu de se peser, il en restera seul en possession. Ce n’est pas que, dans ces derniers temps, on n’ait renouvelé la question de la prééminence entre ces deux grands satiriques. Dusaulx, dans la préface qu’il a mise en tête de sa traduction, La Harpe, dans son Cours de littérature, se sont déclarés avec un grand appareil d’arguments, l’un pour l’ennemi de Domitien, l’autre pour le favori d’Auguste. Il serait difficile, en reprenant la discussion sur les mêmes bases, de rien ajouter à ce qu’ils ont dit; mais ont-ils envisagé la question comme ils devaient le faire? et faut-il de toute nécessité se prononcer pour Horace contre Juvénal, ou pour Juvénal contre Horace? Non. Ces deux poètes, pour me servir des expressions de Dusaulx lui-même, se sont partagé le vaste champ de la satire, et fidèle au but qu’il se proposait, chacun d’eux, non moins inspiré par les circonstances que par son caractère particulier, a fourni sa carrière avec le même succès, quoiqu’avec des moyens quelquefois diamétralement opposés. La satire, en effet, dont le but est de montrer la difformité du mal moral, se partage, ainsi que le mal moral lui-même, en deux grandes divisions, suivant qu’elle attaque les erreurs on les vices, les défauts ou les crimes des hommes. Se propose-t-elle de n’attaquer que leurs défauts et leurs erreurs? elle est vive, enjouée, gracieuse. Prétend-elle signaler leurs vices et poursuivre leurs crimes?, elle est grave, sérieuse, éloquente. Horace la considère sous le premier point de vue: Juvénal sous le second: de là leur manière différente : de là l’impossibilité de les assujettir à un parallèle rigoureux. L’un, dans son style badin et familier, effleurant les préceptes de la philosophie, se contenta d’attaquer de légers travers ou d’absurdes préjugés et croit suffisant, pour les détruire, de les tourner en ridicule. L’autre, prenant un ton plus grave, et se proposant surtout de corriger les mœurs, s’attache à la poursuite du vice, et dans sa noble indignation, ne trouve pas de remède trop violent contre cette gangrène de la société. Le premier, dont l’unique objet est de plaire, discute en riant et se joue autour du cœur. Le second, qui ne veut qu’émouvoir, déclame avec force et pénètre au fond de l’âme. Horace jette le sel à pleines mains; Juvénal répand le fiel à torrent. L’un, enfin, est toujours calme, toujours égal; l’autre toujours ardent, toujours emporté. Auquel donnerons-nous la préférence? ni à l’un ni à l’autre. Nous n’examinons point ici leur mérite sous le rapport des sujets qu’ils ont traités; nous n’examinons point lequel s’est proposé un but plus moral ou plus utile; enfin, ce ne sont pas les genres, mais les styles, les moyens d’exécution que nous voulons comparer. Or, sous ce point de vue, nous n’apercevons aucun motif de préférence. Des genres opposés ne comportaient pas les mêmes moyens, et il serait aussi injuste d’exiger de Juvénal les grâces et la légèreté d’Horace, qu’il le serait d’exiger d’Horace le ton mâle et sublime de Juvénal. Pourvu que le style d’un écrivain soit en harmonie avec son sujet; pourvu que, dans son genre, il approche autant qu’il est possible de la perfection, on n’a point de reproche à lui faire; on n’a que des éloges à lui donner. Anacréon marche l’égal de Pindare; l’Arioste ne le cède pas à Milton, et le Lutrin se place à côté de la Henriade. Considérons donc la question sous ce rapport, et voyons comment nos deux satiriques ont exécuté chacun le plan qu’ils se sont fait. La tâche particulière que je me suis imposée de traduire Juvénal, indique assez que je ne le regarde pas comme un auteur médiocre. Je reconnais ses défauts; j’avoue une partie des reproches qu’on lui fait; moi-même j’oserai lui en adresser quelques-uns; mais si j’en use aussi librement avec un auteur que je révère, je demanderai au moins la permission de lui rendre justice et de faire ressortir, autant qu’il est en moi, les bonnes qualités qui le distinguent. La première de toutes, celle qui le caractérise éminemment, c’est l’énergie avec laquelle il retrace le tableau des mœurs romaines, à l’époque détestable où il écrit. Rien n’est oublié. La scélératesse des tyrans, l’abjection du sénat, la bassesse des grands, l’insolence des affranchis, la prostitution des nobles, la débauche des femmes, la dépravation enfin qui avait infecté les premiers ordres comme les dernières classes de la société; toutes ces horreurs, toutes ces turpitudes sont représentées avec une force, une véhémence qui n’appartiennent qu’au génie. Ce ne sont point les bons mots, les sarcasmes d’un poète qui s’égaye et qui veut amuser; c’est le cri de l’indignation; c’est l’accent de la vérité; c’est la poésie armée du flambeau de l’histoire. On reproche à Juvénal de la monotonie et de l’exagération; on lui reproche cette teinte mélancolique et sombre qui domine dans ses écrits; mais, pour commencer par ce dernier reproche, pouvait-il, ainsi que Tacite, ne point donner à ses ouvrages la couleur du sujet? Pouvait-il n’employer que l’arme fragile du ridicule, que les traits délicats d’un ingénieux badinage, quand tous les freins étaient brisés, tous les nœuds rompus, toutes les lois muettes ou foulées aux pieds? Quand la morale était méconnue, la nature outragée, la vertu proscrite, la délation en crédit, l’univers dans la stupeur? quand Rome n’offrait plus, aux regards des amis de la liberté, qu’un tyran, des esclaves, des histrions et des bourreaux? Certes, à une pareille époque, La plaisanterie eût été de mauvaise grâce; on accorde mal les superficielles combinaisons de l’esprit avec les impressions profondes du sentiment, et le rire est plus que déplacé sur des ruines et au pied des échafauds. Au reste, Juvénal n’avait que des monstres à peindre, et son histoire satirique a tout l’intérêt que le sujet comporte, l’intérêt de la haine. Où sont les personnages qu’il attaque et qu’on est tenté de plaindre? Où sont les victimes qu’il immole et qu’on peut s’empêcher de haïr? L’homme est naturellement ennemi de toute espèce d’injustice et de tyrannie. Il s’indigne à l’aspect du vice honoré, du crime sous le dais; et plus est grand le pouvoir qui l’opprime, plus s’accroît et s’exaspère sa secrète indignation. Il s’irrite alors de sa faiblesse; il s’irrite de ne pouvoir abaisser ce patricien superbe, humilier cet affranchi insolent, attaquer ce préteur vénal, démasquer ce censeur hypocrite; et la haine, concentrée par l’impuissance, brûle de se dilater et d’éclater. Eh bien! ce que le faible n’ose entreprendre, le satirique le fait pour lui; il résiste à l’oppression, il répare l’injure, il venge l’humanité; la puissance elle-même est citée au tribunal de l’opinion publique, et longtemps encore après que les coupables ne sont plus, leur châtiment, consigné dans d’immortels ouvrages, retombe sur leurs imitateurs et console la postérité. Telles sont les fonctions sublimes du moraliste et de l’historien; telles sont celles que Juvénal remplit avec la plus noble indépendance. Qu’on ne dise pas que la dépravation générale ne lui offre qu’une suite de tableaux, tous empreints du même cachet, tous calqués sur le même modèle. Les vices qu’il attaque, quoique portés à un égal excès, ne sont les mêmes ni dans leur espèce ni dans leurs résultats; ils se présentent sous mille formes variées, et l’auteur, sans dénaturer sa manière, sait fondre son style selon ces nuances diverses. Il se garderait bien d’être toujours également élevé. Il sait du langage pompeux de Sophocle, redescendre quelquefois au style familier d’Aristophane; mais alors même il a encore son type particulier, son caractère original. Le conseil de Domitien, assemblé pour un turbot, est un chef-d’œuvre de comédie politique; rien n’est plus gai, plus habilement dialogué que la scène du patron distribuant la sportule à ses clients; le tableau des Grecs domiciliés à Rome est d’une vérité frappante, et Boileau, toujours moins énergique que son modèle, est loin encore d’en approcher pour la vivacité du coloris et la ressemblance des traits, dans la peinture du caractère de quelques femmes. Il est vrai que Juvénal pousse l’hyperbole beaucoup trop loin dans cette satire, et que son fiel a trop d’amertume; mais, à une époque si différente des beaux jours de Louis XIV, du temps d’une Hippia et d’une Messaline, quand la cause du ridicule était si odieuse, le rire pouvait-il n’être pas amer? Que le philosophe homme du monde, que le poète épicurien, à l’aspect des folies, des vices même de la société, se contente de badiner avec grâce et de sourire avec finesse : le satirique austère, le zélateur ardent de la vertu ne peut rire que de mépris, et son rire est encore plus formidable que sa colère. Qu’on ne s’attende donc pas à trouver dans Juvénal, un grand nombre de ces traits déliés, de ces railleries délicates qui font le charme des satires d’Horace. Ce n’est point par la finesse des caractères, c’est par leur grandeur qu’il se distingue. Il s’élève trop haut, il peint trop largement pour s’arrêter à des beautés de détail, à des nuances imperceptibles qui échappent au génie. Quel est l’orateur enflammé qui, ayant à invectiver contre un lâche brigand, à tonner contre un infâme scélérat, s’amuse à cadencer ses mots, à peser ses syllabes? Ce qu’on trouve dans Juvénal, ce sont des mœurs affreuses, des actions horribles qui, pour avoir été retracées cent fois, n’en sont ni moins étranges ni moins incroyables, et c’est à cela peut-être qu’il faut attribuer cet autre reproche, qu’on lui fait encore assez légèrement, de ne savoir pas se circonscrire dans les bornes de la vraisemblance, quand il est démontré par Tacite et par Suétone, qu’il n’a pas même dit toute la vérité. Ces peintures effroyables, toutes révoltantes qu’elles paraissent d’abord, ne laissent pas que d’être instructives, et d’avoir leur utilité. La morale, comme la physique, a ses monstres qu’il est bon de connaître, et il n’en est pas qui prêtent à la méditation autant que ceux de l’époque de Domitien. Parmi les réflexions nombreuses que fait naître cette affreuse époque, il en est une que nous ne passerons pas sous silence, parce qu’elle est consolante pour l’humanité: c’est qu’il est faux que les générations aillent en dépérissant, et qu’à des pères corrompus succèdent toujours des enfants plus dépravés. L’histoire et le bon sens réfutent cette assertion hasardée par Horace, et que tant d’autres ont répétée. La raison au contraire doit tendre à se perfectionner, et se perfectionne en effet avec le temps. La morale s’épure, l’ordre social s’améliore, et nos vices modernes les plus effrénés auraient à peine été des vices du temps de Tibère et de Néron. Passons maintenant à Horace, et considérons-le sous les mêmes rapports que Juvénal, en nous rappelant toujours, dans ce parallèle, que ce n’est pas du genre qu’il s’agit, mais de l’exécution. D’abord le poète de Tivoli ne s’attache pas, comme le satirique d’Aquinum, à peindre les mœurs de son siècle; celles qu’il nous retrace sont de tous les temps et de tous les hommes; elles n’appartiennent pas aux Romains plus qu’aux Grecs, aux anciens plus qu’aux modernes, et, sous cc point de vue, il serait difficile, en le lisant, de reconnaître à quelle époque il a vécu. La sienne, cependant, ouvrait une vaste carrière au génie satirique. Rome venait de changer de constitution. A une démocratie insensée avait succédé une aristocratie illusoire; à celle-ci une monarchie absolue, et, parmi les phénomènes politiques que présentait cette révolution, ce n’était pas un spectacle sans intérêt que de voir le despotisme affecter les formes républicaines, se revêtir des titres anciens, et pour envahir plus sûrement les choses, montrer pour les noms un respect plus religieux. Que l’ami de Mécène ait craint de se compromettre avec la politique; qu’après avoir défendu jusqu’au dernier moment le fantôme de la liberté romaine, il ait compris que l’empire avait besoin d’un maître; qu’il ait cru de son devoir de louer, dans Auguste, un prince dont il avait éprouvé la bienfaisance, que Rome adorait, qui avait calmé les fureurs civiles, donné la paix à l’univers, et par des qualités réelles, effacé jusqu’au souvenir des premières années de son règne, nous n’irons point avec Dusaulx lui reprocher sa prudence et lui faire un crime de n’avoir pas été ingrat; mais sans porter sur le trône des regards indiscrets, sans chercher à s’immiscer dans les affaires du gouvernement, que de portraits originaux, que de caricatures burlesques n’offrait point à son pinceau le spectacle de Rome et de la cour; l’attachement à l’ancien ordre de choses, et la manie de figurer dans le nouveau; les courtisans, les parvenus, les favoris; l’air d’importance et de mystère; l’orgueil, la dissimulation, la flatterie; les amis de César et de Caton, d’Auguste et de Brutus; tous les contrastes enfin d’un gouvernement qui avait rassemblé et confondu tant d’extrêmes? De tous ces ridicules, Horace n’en saisit aucun; il semble craindre de rien dire qui puisse rappeler les événements ou les hommes de son siècle; il se jette dans les thèses générales de la philosophie, et n’attaque tout le monde que pour ne choquer personne. Tant mieux, dira-t-on; l’intérêt qui résulte de ce plan, est plus universel et plus durable. Les mœurs particulières s’effacent et s’oublient; les mœurs générales ne périssent qu’avec la nature dont elles dérivent. On est homme avant d’être Romain ou Belge, et la physionomie des nations n’est qu’une modification variable de ce caractère indélébile qui constitue l’essence de l’espèce humaine. Cette théorie est vraie, et nous l’admettons avec plaisir, pourvu que l’on convienne qu’un ouvrage composé sur ce plan , pour être utile et devenir clanique, doit se distinguer par la multiplicité, la variété, le choix des sujets, et n’offrir que des cadres d’un goût exquis et d’une ,exécution parfaite. L’idée de donner un traité complet des passions et des vices, était à peu près celle de Théophraste dans ses Caractères, espèce de satire dont il ne nous reste qu’un fragment qui a fourni à La Bruyère le modèle d’un des meilleurs ouvrages de la littérature française. Le plan d’Horace est loin d’être aussi bien entendu, aussi bien ordonné. Une seule de ses satires, celle du Fâcheux, rappelle le genre du philosophe grec; c’est un caractère parfaitement saisi, parfaitement dessiné, et dont Molière, ce grand peintre des mœurs, n’a pas manqué d’enrichir la scène. Dans ses autres compositions (je ne parle point de ses épures) le poète de Vénuse n’attaque guère que des vices communs et journaliers, l’avarice, l’ambition, l’art de surprendre des testaments, la vanité de quelques magistrats subalternes, le côté ridicule des philosophies épicurienne et stoïcienne; et rien de neuf, rien d’extraordinaire n’éveille l’attention et ne pique la curiosité. Ces observations, qui sembleraient annoncer qu’Horace pouvait composer sur un dessin plus vaste, ne touchent pas même à sa gloire. Qu’importe, comme nous l’avons dit, dans quel genre il s’est exercé, pourvu qu’il ait excellé dans ce genre? qu’importe qu’il n’ait attaqué que des vices ordinaires, que de défauts communs à tous les hommes, pourvu qu’il ait su rajeunir ces matières rebattues, et prêter à des lieux communs le charme de la nouveauté? Sans doute, à mérite égal, de deux ouvrages de même espèce ou d’espèce analogue, celui-là se recommande davantage, qui présente un sujet plus neuf et plus Intéressant; mais s’ensuit-il que le beau, quel qu’il soit, puisse n’être pas accueilli avec distinction? et la gloire d’un auteur, au lieu de s’augmenter par l’importance de son sujet, n’est-elle pas au contraire en proportion même du peu de ressource qu’il y trouve? Plus une matière est usée, plus il faut de talent pour la traiter avec grâce. C’est alors que le poète a besoin d’appeler à son secours tous les trésors, tous les prestiges de l’imagination, de l’esprit et du goût; c’est alors qu’il doit briller par l’invention du dessin, parla disposition des parties, par l’évidence des preuves, par la délicatesse des pensées, par l’heureux choix des expressions; et que, pour dire des choses déjà dites cent fois, il a besoin de les refondre, de les repolir, de les créer en quelque sorte de nouveau. Or, ce talent précieux, Horace le possède au plus haut degré, et Juvénal ici ne peut soutenir le parallèle. Ce n’est pas que celui-ci ait à se plaindre de la part qui lui est échue. Tout en convenant que son genre de satire est le plus facile des deux; que la peinture des grands désordres .est une source abondante d’idées fortes et sublimes; que c’est aux Catilina, aux Verrès que l’éloquence romaine a dû ses plus fameuses harangues et qu’enfin les règnes atroces de Néron et de Domitien offraient naturellement à Juvénal toutes ces belles formes d’indignation qui caractérisent sa manière, tout en convenant, dis-je, de ces avantages qu’il doit à son sujet, nous ferons remarquer en lui une foule d’autres qualités qui tiennent bien moins aux circonstances qu’à la trempe particulière de son génie; je veux parler de cette unité à laquelle il se montre si fidèle dans toutes ses compositions; de cette abondance de preuves et d’exemples; de ce mouvement, de cette chaleur perpétuelle, de ces caractères profondément gravés, de ces morceaux éloquents, de ces dialogues vifs et animés, de ce style, enfla, toujours plein et nombreux qui le mettent, parmi les poètes moralistes, au même rang que Tacite parmi les historiens philosophes. Nous avouerons, cependant, qu’une qualité importante lui manque quelquefois; c’est le goût. On lui reproche avec raison des expressions néologiques, de la redondance, des parenthèses trop fréquentes et trop longues, il ne sait pas, comme Horace, ne dire jamais que ce qu’il faut, et le dire toujours de la manière la plus convenable; il n’a pas l’art des transitions, et ce n’est pas un défaut qui doive nous étonner en lui. Le goût, loin d’être la qualité essentielle de ses satires, était, pour ainsi dire, incompatible avec l’ardeur de son caractère et la vigueur de son style. Le goût est naturellement timide et mesuré; il craint plus de trop dire que de ne pas dire assez; il préfère un défaut de moins à une beauté de plus, tandis que le génie plus impétueux dédaigne ou n’aperçoit pas de trop minutieuses perfections. Il n’en est pas de même d’Horace. Le goût domine et devait dominer dans ses écrits: cette qualité était propre et nécessaire à son genre: aussi en possède-t-il tous les dons, le naturel, la facilité, la simplicité, la légèreté, la grâce: c’est le goût qui lui dicta tous ses vers, qui dessine tous ses portraits, qui embellit ses moindres détails. Quel poète, dit La Harpe, a jamais mieux connu le langage qui convient à la raison? Il ne prêche point la vérité, il la fait sentir il ne commande pas la sagesse, il la fait aimer. Le plus grand inconvénient de la morale, c’est l’ennui, et il a tout ce qu’il faut pour y échapper: une variété de tons inépuisable, des épisodes de toute espèce, des dialogues, des fictions, des apologues, des peintures de caractères, et l’usage le plus adroit de cette forme dramatique toujours si heureuse dans les écrits où elle peut entrer, et dont, à son exemple, Voltaire, parmi les modernes, a le mieux senti les avantages. Il y aurait une autre manière d’apprécier les qualités relatives de nos deux auteurs : ce serait de les comparer dans des pièces de même titre ou de genre approchant, par exemple dans leurs satires sur la Noblesse, ou dans la description qu’ils ont faite, l’un des embarras de Rome, l’autre de ces mêmes embarras opposés aux avantages de la vie champêtre. Cet examen aurait peut-être le mérite de concilier les deux partis, en les faisant triompher tour à tour, et l’on se convaincrait, par là, d’une vérité qui fait la base de ce discours; savoir, qu’Horace et Juvénal ont excellé chacun dans le genre qu’ils ont choisi, et qu’il serait injuste de ne couronner l’un qu’en dépouillant le front de l’autre. En effet, si Juvénal, dans la satire de la Noblesse, qui est d’un genre plus grave, a une chaleur, une force, une sublimité à laquelle Horace est loin d’atteindre, Horace dans son double tableau des intrigues de la ville et des plaisirs de la campagne, a une grâce, un abandon, une douceur de style dont Juvénal n’approche point dans la description des embarras de Rome. En résumant ce qui vient d’être dit, nous verrons que c’est l’indignation qui inspire les vers de Juvénal, et l’enjouement qui dicte ceux d’Horace; que le premier s’est attaché à poursuivre le vice, le second à tourner les travers en ridicule; que l’un est l’historien des mœurs de son temps, l’autre le peintre des mœurs de tous les siècles. Nous verrons que si Juvénal a plus de verve, Horace a plus de goût; que si les sujets du premier sont plus neufs, plus intéressants et par conséquent plus propres à la haute poésie, ceux du second, par cela même qu’ils sont plus communs et plus journaliers, lui supposent un génie plus souple, et des ressources plus variées dans l’esprit, pour arriver à la perfection. Nous verrons, enfin, qu’Horace a pris le ton qui convenait à la cour brillante et polie d’Auguste; Juvénal, l’accent que devait inspirer la sombre tyrannie de Domitien, et, au lieu d’épouser des systèmes, d’admettre des goûts exclusifs, de nous laisser conduire par les préjugés de l’école et du monde, nous lirons tour à tour ces deux illustres satiriques, l’un, dans les moments d’heureuse inspiration, quand nous voudrons apprendre à jouir de la vie, à mépriser les revers, à nous moquer un peu de nos ridicules ennemis; l’autre, dans les instants de mélancolie et d’humeur, quand nous aurons besoin, pour mieux goûter la vertu, de nous exciter contre le vice, ou bien que nous voudrons chercher dans la dépravation des temps anciens, des moyens de patience ou d’excuse pour les désordres du temps présent. Nous aurions voulu épargner à des moralistes si célèbres, un reproche que la vérité nous arrache, et que nous devons au respect des mœurs. Ils se sont trop livrés l’un et l’autre à une indécence de style, à un désordre d’imagination que ne saurait excuser la morale la plus indulgente. Juvénal, il est vrai, même dans ses plus grands écarts, ne respire que la vertu, et ne peint la débauche que pour la rendre odieuse; mais ce n’est point en style de prostituée que doit s’exprimer la pudeur, et l’on fuit un effronté qui prêche la modestie. Horace n’est point excusable; ce n’est point comme Juvénal un déclamateur ardent qui a vu la corruption parvenue au dernier période; qui n’écrit que pour des cœurs dégradés, que pour des âmes pétries de boue et de sang, et que le désir d’être utile à des malades désespérés, engage à tremper ses mains dans des ulcères; c’est un poète aimable qui s’est chargé de dicter à la fois les régies de la sage et du goût, et qui écrit au milieu d’une cour spirituelle et galante, pour des esprits cultivés et délicats. S’il offense la pudeur, ce n’est point, comme son rival, dans l’emportement d’une sainte colère, dans le transport d’une vertueuse indignation: c’est de sang-froid, par système ou par dérèglement d’esprit; et ces mêmes excès qui, dans la bouche de Névolus, font frémir la nature, et dégoûtent encore plus qu’ils ne révoltent, il n’en rougit pas; il les avoue pour son compte, et peu s’en faut que ses crayons légers et délicats n’en effacent toute la difformité. Voilà, à ce qu’il me semble, sous quels points de vue différents il faut considérer Horace et Juvénal, pour tenir la balance égale entre eux, et c’est ce que n’ont fait ni Dussault, ni La Harpe, ni aucun autre en France.
L. V. Raoul Boileau Juvénal, élevé dans les cris de l’école, Poussa jusqu’à l’excès sa mordante hyperbole. Ses ouvrages, tout pleins d’affreuses vérités, Etincellent pourtant de sublimes beautés. Soit que sur un édit arrivé de Caprée, Il brise de Séjan la statue adorée; Soit qu’il fasse au conseil courir les sénateurs, D’un tyran soupçonneux, pâles adulateurs; Ou que poussant à bout la luxure latine, Aux portefaix de Rome il vende Messaline; Ses écrits pleins de feu partout brillent aux yeux.
André Chénier Que la satire est faible écrite au sein des cours!
D’un siècle
corrompu la publique impudence,
|