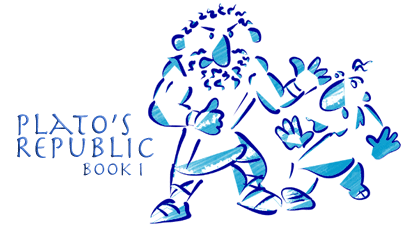|
ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE PLATON
PLATON OEUVRES COMPLÈTES LA RÉPUBLIOUE LIVRE I texte grec (attention il renvoie à la traduction de Cousin)
SOCRATE ( 327) J'étais descendu hier au Pirée avec Glaucon, fils a d'Ariston, pour prier la déesse (01) et voir, en même temps, de quelle manière on célébrerait la fête qui avait lieu pour la première fois. La pompe des habitants du lieu me parut belle, encore que non moins distinguée fût celle que les Thraces conduisaient. Après avoir fait nos prières et vu la cérémonie, nous revenions vers la ville (327 b) lorsque, nous ayant aperçus de loin sur le chemin du retour, Polémarque, fils de Céphale, ordonna à son petit esclave de courir après nous et de nous prier de l'attendre. L'enfant, tirant mon manteau par derrière : « Polémarque, dit-il, vous prie de l'attendre. » Je me retournai et lui demandai où était son maître : « Il vient derrière moi, dit-il, attendez-le. - Mais nous l'attendrons, dit Glaucon. »(337 c) Et peu après Polémarque arriva accompagné d'Adimante, frère de Glaucon, de Nicératos, fils de Nicias et de quelques autres qui revenaient de la pompe. Alors Polémarque dit : Vous m'avez l'air, Socrate, de vous en aller et de vous diriger vers la ville. Tu ne conjectures pas mal, en effet, répondis-je. Eh bien ! reprit-il, vois-tu combien nous sommes ? Comment ne le verrais-je pas ? (337 d) Ou bien donc, poursuivit-il, vous serez les plus forts, ou vous resterez ici. N'y a-t-il pas, dis-je, une autre possibilité : vous persuader qu'il faut nous laisser partir ? Est-ce que vous pourriez, répondit-il, persuader des gens qui n'écoutent pas ? Nullement, dit Glaucon. Donc, rendez-vous compte que nous ne vous écouterons pas.
(328)
Alors Adimante : Ne savez-vous pas, dit-il, qu'une course aux flambeaux aura
lieu ce soir, à cheval, en l'honneur de la déesse? Oui, reprit Polémarque, et en outre on célébrera une fête de nuit qui vaut la peine d'être vue ; nous sortirons après dîner pour assister à cette fête. Nous y rencontrerons plusieurs jeunes gens et nous causerons. (328 b) Mais restez et n'agissez pas autrement. Et Glaucon : Il semble, dit-il, que nous devons rester. Mais s'il le semble, répondis-je, c'est ainsi qu'il faut faire. Nous allâmes donc chez Polémarque et là nous trouvâmes Lysias (02) et Euthydème, ses frères, Thrasymaque (03) de Chalcédoine. Charmantide de Paeanée, et Clitophon, fils d'Aristonyme (04). (328 c) Il y avait aussi, à l'intérieur, le père de Polémarque, Céphale. Et il me sembla très vieux, car depuis longtemps je ne l'avais vu. Il était assis sur un siège à coussin, et portait une couronne sur la tête, car il venait de procéder à un sacrifice dans la cour. Nous nous assîmes donc près de lui, sur des sièges qui se trouvaient là, disposés en cercle. Dès qu'il me vit, Céphale me salua et me dit : Tu ne descends guère au Pirée, Socrate, pour nous rendre visite. Tu le devrais cependant ; car si j'avais encore la force d'aller aisément à la ville, tu n'aurais pas besoin de venir ici : (328 d) nous-mêmes irions chez toi. Mais maintenant, c'est à toi de venir ici plus souvent. Sache bien que pour moi, d'autant les plaisirs du corps se flétrissent, d'autant augmentent le désir et le plaisir de la conversation. N'agis donc pas autrement : réunis-toi à ces jeunes gens et viens ici comme chez des amis très intimes. Moi aussi, répondis-je, ô Céphale, je me plais à converser avec les vieillards ; (328 e) car je crois qu'il faut s'informer auprès d'eux, comme auprès de gens qui nous ont devancés sur une route que nous devrons peut-être aussi parcourir, de ce qu'elle est âpre et difficile, ou bien commode et aisée. Et certes j'aurais plaisir à savoir ce que t'en semble, puisque tu es déjà parvenu à ce point de l'âge que les poètes appellent « le seuil de la vieillesse (05) ». Est-ce un moment difficile de la vie, ou quel message nous en donnes-tu ? (329) Par Zeus, reprit-il, je te dirai, Socrate, ce que m'en semble. Souvent, en effet, nous nous rencontrons entre gens du même âge, justifiant le vieux proverbe (06) ; or, la plupart de nous, dans ces rencontres, se lamentent, regrettent les plaisirs de la jeunesse et, se rappelant ceux de l'amour, du vin, de la bonne chère et les autres semblables, ils s'affligent comme gens privés de biens considérables, qui alors vivaient bien et maintenant ne vivent même plus. Quelques-uns se plaignent des outrages (329 b) auxquels l'âge les expose de la part de leurs proches, et, à ce propos, ils accusent avec véhémence la vieillesse d'être pour eux la cause de tant de maux. Mais à mon avis, Socrate, ils n'allèguent pas la véritable cause, car, si c'était la vieillesse, moi aussi j'en ressentirais les effets, et tous ceux qui sont parvenus à ce point de l'âge (07). Or, j'ai rencontré des vieillards qui ne l'éprouvent point ainsi ; un jour même je me trouvai près du poète Sophocle que quelqu'un interrogeait : « (329 c) Comment, Sophocle, lui disait-on, te comportes-tu à l'égard de l'amour ? Es-tu encore capable de posséder une femme ? » Et lui : « Silence ! ami », répondit-il, « c'est avec la plus grande satisfaction que je l'ai fui, comme délivré d'un maître rageur et sauvage ». Il me parut bien dire alors, et non moins aujourd'hui. De toutes façons, en effet, à l'égard des sens, la vieillesse apporte beaucoup de paix et de liberté. Car, lorsque les désirs se calment et se détendent, le mot de (329 d) Sophocle se réalise pleinement : on est délivré de maîtres innombrables et furieux. Quant aux regrets, aux ennuis domestiques, ils n'ont qu'une cause, Socrate, non pas la vieillesse, mais le caractère des hommes. S'ils sont rangés et d'humeur facile, la vieillesse leur est modérément pénible. Sinon, et vieillesse et jeunesse, ô Socrate, leur sont ensemble difficiles. (329 e) Et moi, charmé de ses paroles et désireux de l'entendre encore, je le provoquai et lui dis : J'imagine, Céphale, que la plupart des auditeurs, quand tu parles de la sorte, ne t'approuvent pas et pensent que tu supportes aisément la vieillesse, non pas grâce à ton caractère, mais grâce à tes abondantes richesses ; aux riches, en effet, on dit qu'il est de nombreuses consolations. Tu dis vrai, répondit-il, ils ne m'approuvent pas. Et ils ont un peu raison, mais non cependant autant qu'ils le pensent. (330) La réponse de Thémistocle est bonne, qui, au Sériphien qui l'injuriait et l'accusait de ne point devoir sa réputation à lui-même mais à sa patrie, répliqua : « Si j'étais Sériphien, je ne serais pas devenu célèbre, mais toi non plus si tu étais Athénien (08). » La même remarque s'applique à ceux qui ne sont point riches et supportent péniblement le grand âge, car ni le sage n'endure avec une parfaite aisance la vieillesse qu'accompagne la pauvreté, ni l'insensé, s'étant enrichi, ne se met d'accord avec lui-même. Mais, Céphale, repris-je, de ce que tu possèdes, as-tu reçu en héritage ou acquis toi-même la plus grande part ? (330 b) Ce que j'ai acquis, Socrate ? En fait de richesses j'ai tenu le milieu entre mon aïeul et mon père. Mon aïeul, dont je porte le nom, ayant hérité d'une fortune à peu près égale à celle que je possède maintenant, la multiplia, mais Lysanias, mon père, la ramena un peu au-dessous de son niveau actuel. Pour moi, je me contente de laisser à ces jeunes gens non pas moins, mais un peu plus que je n'ai reçu. Je t'ai posé cette question, dis-je, parce que tu m'as semblé ne pas aimer excessivement les richesses ; (330 c) c'est ainsi que font, pour la plupart, ceux qui ne les ont point acquises eux-mêmes. Mais ceux qui les ont acquises se chérissent deux fois plus que les autres. Car, de même que les poètes chérissent leurs poèmes et les pères leurs enfants, ainsi les hommes d'affaires s'attachent à leur fortune, parce qu'elle est leur ouvrage, et en raison de son utilité, comme les autres hommes. Aussi sont-ils d'un commerce difficile, ne consentant à louer rien d'autre que l'argent. C'est vrai, avoua-t-il. Parfaitement, repris-je. Mais dis-moi encore ceci : (330 d) de quel bien suprême penses-tu que la possession d'une grosse fortune t'ait procuré la jouissance ? C'est ce que, peut-être, répondit-il, je ne persuaderai pas à beaucoup de gens si je le dis. Sache bien, en effet, Socrate, que lorsqu'un homme est près de penser à sa mort, crainte et souci l'assaillent à propos de choses qui, auparavant, ne le troublaient pas. Ce que l'on raconte sur l'Hadès et les châtiments qu'y doit recevoir celui qui en ce monde a commis l'injustice, ces fables, dont il a ri jusque-là, tourmentent alors son âme : il redoute qu'elles ne soient vraies. (330 e) Et - soit à cause de la faiblesse de l'âge, soit parce qu'étant plus près des choses de l'au-delà il les voit mieux - son esprit s'emplit de défiance et de frayeur (09) ; il réfléchit, examine s'il s'est rendu coupable d'injustice à l'égard de quelqu'un. Et celui qui trouve en sa vie beaucoup d'iniquités, éveillé fréquemment au milieu de ses nuits, comme les enfants, a peur, et vit dans une triste attente. (331) Mais près de celui qui se sait innocent veille toujours une agréable espérance, bienfaisante nourrice de la vieillesse, pour parler comme Pindare. Car avec bonheur, Socrate, ce poète a dit de l'homme ayant mené une vie juste et pieuse que douce à son coeur et nourrice de ses vieux ans, l'accompagne l'espérance, qui gouverne l'âme changeante des mortels (10). Et cela est dit merveilleusement bien. A cet égard je considère la possession des richesses comme très précieuse, non pas pour tout homme, mais pour le sage et l'ordonné. (331 b) Car à éviter que, contraint, l'on trompe ou l'on mente, et que, devant des sacrifices à un dieu ou de l'argent à un homme, l'on passe ensuite dans l'autre monde avec crainte, à éviter cela la possession des richesses contribue pour une grande part. Elle a aussi beaucoup d'autres avantages. Mais si nous les opposons un à un, je soutiens, Socrate, que, pour l'homme sensé, c'est là que réside la plus grande utilité de l'argent. Tes propos sont pleins de beauté, Céphale, repris-je. (331 c) Mais cette vertu même, la justice, affirmerons-nous simplement qu'elle consiste à dire la vérité et à rendre ce que l'on a reçu de quelqu'un, ou bien qu'agir de la sorte est parfois juste, parfois injuste ? Je l'explique ainsi : tout le monde convient que si l'on reçoit des armes d'un ami sain d'esprit qui, devenu fou, les redemande, on ne doit pas les lui rendre, et que celui qui les rendrait ne serait pas juste, non plus que celui qui voudrait dire toute la vérité à un homme dans cet état. (331 d) C'est exact, dit-il. Donc, cette définition n'est pas celle de la justice: dire la vérité et rendre ce que l'on a reçu. Mais si, Socrate, intervint Polémarque, du moins s'il faut en croire Simonide. Bien, bien ! dit Céphale ; je vous abandonne la discussion car il est déjà temps que je m'occupe du sacrifice (11). Ne suis-je pas ton héritier ? lui demanda Polémarque. Sans doute, répondit-il en riant ; et il s'en alla à son sacrifice. (331 e) Dis-nous donc, repris-je, toi, l'héritier du discours, ce que Simonide affirme, et que tu approuves, au sujet de la justice (12). C'est qu'il est juste, dit-il, de rendre ce que l'on doit à chacun; en quoi il me paraît avoir raison. Certes, repris-je, il n'est pas facile de refuser créance à Simonide - homme, en effet, sage et divin - cependant, ce qu'il veut dire, toi, Polémarque, tu le sais peut-être, mais moi je l'ignore ; car il est évident qu'il n'affirme pas ce que nous disions tout à l'heure : qu'on doive rendre un dépôt à quelqu'un qui le réclame n'ayant plus sa raison. (332) Pourtant, ce qu'on vous a confié est dû, n'est-ce pas ? Oui. Et il ne faut, en aucune façon, le rendre quand celui qui le redemande n'est pas sain d'esprit ? C'est vrai, avoua-t-il. Autre chose donc que cela, comme il semble, entend Simonide, quand il dit qu'il est juste de rendre ce qu'on doit. Autre chose, assurément, par Zeus, répondit-il ; car, il pense qu'on doit faire du bien aux amis, mais non pas du mal. Je comprends, dis-je - que ce n'est point rendre à quelqu'un ce qu'on lui doit que de lui remettre l'or qu'il nous a confié, si la restitution et la reprise se font à son (332 b) préjudice, et si celui qui reprend et celui qui restitue sont amis - N'est-ce pas ainsi que, d'après toi, l'entend Simonide ? Parfaitement. Mais quoi ? Aux ennemis faut-il rendre ce qu'on se trouve leur devoir ? Certainement, dit-il, ce qui leur est dû ; et leur est dû, je pense, ce qui convient d'ennemi à ennemi, à savoir du mal. Par énigmes donc, repris-je, à la manière des poètes, Simonide paraît avoir défini la justice. (332 c) Car il estimait juste, semble-t-il, de rendre à chacun ce qui convient, mais il nommait cela qui est dû. Eh bien ! qu'en penses-tu? dit-il. Par Zeus ! répondis-je, si quelqu'un lui avait demandé : « Simonide, à qui et qu'est-ce que donne, de dû et de convenable, l'art appelé médecine ? », que crois-tu qu'il aurait répondu? Evidemment, dit-il, qu'il donne au corps les remèdes, les aliments et les boissons. Et à quoi, et qu'est-ce que donne, de dû et de convenable, l'art de la cuisine? (332 d) Aux mets les assaisonnements. Soit. Or donc à qui et qu'est-ce que donne l'art que nous appellerons justice ? S'il faut, Socrate, répondit-il, nous accorder avec nos dires précédents, elle distribue aux amis et aux ennemis bienfaits et dommages. Donc, faire à ses amis du bien, à ses ennemis du mal, voilà ce que Simonide entend par justice? Il me le semble. Or, qui est le plus capable de faire du bien à ses amis souffrants, et du mal à ses ennemis, sous le rapport de la maladie et de la santé ? Le médecin. (332 e) Et à des navigateurs, en ce qui concerne le péril de la mer ? Le pilote. Mais que dirons-nous du juste ? En quelle occasion et pour quelle oeuvre est-il surtout capable de rendre service à ses amis et de nuire à ses ennemis ? A la guerre, pour combattre les uns et s'allier aux autres, il me semble. Bon. Mais à ceux qui ne souffrent point, mon cher Polémarque, le médecin est inutile. C'est vrai. Et à ceux qui ne naviguent point le pilote. Oui. Est-ce, de même, qu'à ceux qui ne font point la guerre le juste serait inutile ? Point du tout, à mon avis. ! (333) Alors la justice est utile même en temps de paix ? Elle est utile. Et aussi l'agriculture, n'est-ce pas ? Oui. Pour se procurer les fruits de la terre ? Oui. Et aussi l'art du cordonnier ? Oui. Pour se procurer des chaussures, diras-tu, je pense. Sans doute. Mais quoi ? la justice, pour quel usage ou la possession de quel objet diras-tu qu'elle est utile en temps de paix ? Pour les conventions commerciales, Socrate. Par conventions commerciales entends-tu les associations ou autre chose ? Les associations certainement. (333 b) Est-ce donc que le juste sera un bon et utile associé pour disposer les pions au trictrac, ou bien celui qui connaît le jeu ? Celui qui connaît le jeu. Et pour poser des briques et des pierres, le juste est-il plus utile et meilleur associé que le maçon ? Nullement. Mais en quelle association le juste est-il meilleur associé que le maçon et le cithariste, comme le cithariste l'est par rapport au juste en l'art des sons ? Dans les affaires d'argent, ce me semble. Excepté peut-être, Polémarque, pour faire usage de l'argent ; quand il faut, par exemple, à fonds communs, acheter ou vendre un cheval, je crois qu'alors c'est le (333 c) maquignon, n'est-ce pas ? Il le semble. Et lorsqu'il s'agit d'un vaisseau, c'est le constructeur ou le pilote ? Apparemment. Dans lequel de ces cas, donc, où il faut user d'argent ou d'or en commun, le juste est-il plus utile associé que les autres ? Dans le cas d'un dépôt qu'on veut en sûreté, Socrate. N'est-ce pas dire : lorsqu'on ne se sert point de l'argent et qu'on le laisse oisif ? Sans doute. Quand donc l'argent reste inutile, c'est alors qu'à son égard la justice est utile ? (333 d) Je le crains. Et quand il faut garder une serpette, la justice est utile tant au point de vue commun que particulier ; mais quand il faut s'en servir c'est l'art de cultiver la vigne ? Il le semble. Tu affirmeras donc que s'il s'agit de garder un bouclier et une lyre, et de ne point s'en servir, la justice est utile, mais que s'il s'agit de s'en servir, c'est l'art de l'hoplite et du musicien. Nécessairement. Et, à l'égard de toutes les autres choses, la justice est inutile à chacune quand elle sert, utile quand elle ne sert pas ? Je le crains. (333 e) Ce n'est donc, mon ami, rien de bien important que la justice, si son usage ne s'étend qu'à des choses inutiles. Mais examinons ceci : l'homme le plus adroit à porter des coups, dans un combat, un pugilat ou quelque autre lutte, n'est-il pas aussi le plus adroit à les parer ? Sans doute. Et celui qui est habile à se préserver d'une maladie, n'est-il pas aussi le plus habile à la donner en secret ? Il me le semble. (334) Mais n'est-il pas bon gardien d'une armée celui qui dérobe aux ennemis leurs secrets, leurs projets et tout e qui les concerne ? Sans doute. Donc, l'habile gardien d'une chose en est aussi le voleur habile (13). Apparemment. Si donc le juste est habile à garder de l'argent, il st aussi habile à le dérober. C'est là, du moins, dit-il, le sens du raisonnement. Ainsi le juste vient de nous apparaître comme une sorte de de voleur, et tu m'as l'air d'avoir appris cela dans Homère. (334 b) Ce poète, en effet, chérit l'aïeul maternel d'Ulysse, Autolycos, et il dit qu'il surpassait tous les humains tans l'habitude du vol et du parjure (14). Par conséquent, il semble que la justice, selon toi, selon Homère et selon Simonide, soit un certain art de dérober, en faveur, toutefois, de ses amis, et au détriment de ses ennemis. Ne l'entendais-tu pas de la sorte ? Non, par Zeus, répondit-il ; je ne sais pas ce que je disais; cependant il me semble encore que la justice consiste à rendre service à ses amis et à nuire à ses ennemis. (334 c) Mais qui traites-tu d'amis (15) ceux qui paraissent honnêtes à chacun ou ceux qui le sont, même s'ils ne le paraissent pas, et ainsi pour les ennemis ? Il est naturel, dit-il, d'aimer ceux que l'on croit honnêtes et de haïr ceux que l'on croit méchants. Mais les hommes ne se trompent-ils pas à ce sujet, de sorte que beaucoup de gens leur semblent honnêtes ne l'étant pas, et inversement ? Ils se trompent. Pour ceux-là donc, les bons sont des ennemis et les méchants des amis ? Sans doute. Et néanmoins ils estiment juste de rendre service aux méchants et de nuire aux bons ? (334 d) Il le semble. Cependant les bons sont justes et incapables de commettre l'injustice ? C'est vrai. Selon ton raisonnement il est donc juste de faire du mal à ceux qui ne commettent point l'injustice. Nullement, dit-il, Socrate, car le raisonnement semble mauvais. Alors, repris-je, aux méchants il est juste de nuire, et aux bons de rendre service ? Cette conclusion me paraît plus belle que la précédente. Pour beaucoup de gens, donc, Polémarque, qui se sont trompés sur les hommes, la justice consistera à nuire aux amis - car ils ont pour amis des méchants - (334 e) et rendre service aux ennemis - qui sont bons en effet. Et ainsi nous affirmerons le contraire de ce que nous faisions dire à Simonide. Assurément, dit-il, cela se présente ainsi. Mais corrigeons ; nous risquons en effet de n'avoir pas exactement défini l'ami et l'ennemi. Comment les avons-nous définis, Polémarque ? Celui qui paraît honnête, celui-là est un ami. Et maintenant, repris-je, comment corrigeons-nous ? Celui qui paraît, répondit-il, et qui est honnête est un ami (335) ; celui qui paraît mais n'est pas honnête, paraît mais n'est pas un ami ; et au sujet de l'ennemi la définition est la même. Ami donc, comme il semble par ce raisonnement, sera l'homme bon, et ennemi le méchant ? Oui. Tu nous ordonnes donc d'ajouter à ce que nous disions d'abord sur la justice, à savoir qu'il est juste de faire du bien à son ami et du mal à son ennemi ; maintenant, outre cela, il faut dire qu'il est juste de faire du bien à l'ami bon et du mal à l'ennemi méchant ? (335 b) Parfaitement, dit-il, cela me semble ainsi bien exprimé. Est-ce donc le fait du juste, repris-je, de faire du mal à qui que ce soit ? Sans doute, répondit-il, il faut faire du mal aux méchants qui sont nos ennemis. Mais les chevaux à qui l'on fait du mal deviennent-ils meilleurs ou pires ? Pires. Relativement à la vertu des chiens ou à celle des chevaux ? A celle des chevaux. Et les chiens à qui l'on fait du mal ne deviennent-ils pas pires, relativement à la vertu des chiens et non à celle des chevaux ? Il y a nécessité. (335 c) Mais les hommes, camarade, à qui l'on fait du mal, ne dirons-nous pas de même qu'ils deviennent pires, relativement à la vertu humaine ? Absolument. Or la justice n'est-elle pas vertu humaine ? A cela aussi il y a nécessité. Donc, mon ami, ceux d'entre les hommes à qui l'on fait du mal deviennent nécessairement pires. Il le semble. Mais, par son art, le musicien peut-il rendre ignorant en musique ? Impossible. Et, par l'art équestre, l'écuyer rendre impropre à monter à cheval ? Cela n'est pas. Par la justice, donc, le juste peut-il rendre quelqu'un injuste ; ou, en un mot, par la vertu les bons peuvent-ils rendre les autres méchants ? (335 d) Cela ne se peut. Car ce n'est point le fait de la chaleur, je pense, de refroidir, mais de son contraire. Oui. Ni de la sécheresse de mouiller, mais de son contraire. Sans doute. Ni de l'homme bon de nuire, mais de son contraire. Il le semble. Mais le juste est bon ? Sans doute. Par conséquent ce n'est pas le fait du juste de nuire, Polémarque, ni à un ami ni à personne d'autre, mais c'est le fait de son contraire, de l'injuste. Je crois que tu dis parfaitement la vérité, Socrate, avoua-t-il. (335 e) Si donc quelqu'un affirme que la justice consiste à rendre à chacun ce qu'on lui doit, et s'il entend par là que l'homme juste doit préjudice à ses ennemis et service à ses amis, il n'est point sage celui qui tient de tels propos. Car il ne dit pas la vérité : en aucun cas en effet et à personne il ne nous est apparu juste de faire du mal. J'en conviens, dit-il. Nous combattrons donc, repris-je, en commun, toi et moi, celui qui prêterait une pareille maxime à Simonide, à Bias, à Pittacos ou à quelque autre des hommes sages et divins. Je suis prêt, s'écria-t-il, à m'associer au combat. (336) Mais sais-tu, poursuivis-je, de qui me semble cette assertion : qu'il est juste de rendre service à ses amis et de nuire à ses ennemis? De qui? demanda-t-il. Je pense qu'elle est de Périandre (16), de Perdiccas (17), de Xerxès, d'Isménias (18) le Thébain ou de quelque autre homme riche se croyant très puissant. C'est tout à fait vrai, dit-il. Bon, repris-je; mais puisque ni la justice ni le juste ne nous ont paru consister en cela, de quelle autre façon pourrait-on les définir ?
(336b)
Or, Thrasymaque, à plusieurs reprises, pendant que nous parlions, avait tenté
de prendre part à l'entretien, mais il en avait été empêché par ses voisins
qui voulaient nous entendre jusqu'au bout. A la pause que nous fîmes, comme je
venais de prononcer ces paroles, il ne se contint plus; s'étant ramassé sur
lui-même, tel une bête fauve, il s'élança (19)
vers nous comme pour nous déchirer. L'écoutant, je fus frappé de stupeur, et, jetant les yeux sur lui, je me sentis gagné par la crainte ; je crois même que si je ne l'avais regardé avant qu'il ne me regardât, je fusse devenu muet (20). Mais lorsque la discussion commença à l'irriter je le regardai le premier, (336e) de sorte que je fus capable de répondre et lui dis en tremblant un peu : Thrasymaque, ne te fâche pas contre nous ; car si nous avons commis une erreur dans notre examen, moi et ce jeune homme-ci, tu sais bien que nous l'avons commise involontairement. En effet, si nous cherchions de l'or, nous ne serions point disposés à nous incliner l'un devant l'autre, et à gâter nos chances de découverte ; n'imagine donc pas que, cherchant la justice, chose plus précieuse que de grandes quantités d'or, nous nous fassions sottement des concessions mutuelles, au lieu de nous appliquer de notre mieux, à la découvrir. N'imagine point cela, mon ami. Mais la tâche, je crois, est au dessus de nos forces. Nous prendre en pitié est donc bien plus naturel pour vous, les habiles, que de nous témoigner de l'irritation. (337)A ces mots il éclata d'un rire sardonique : O Héraclès ! s'écria-t-il, la voilà bien l'ironie habituelle de Socrate ! Je le savais et je l'avais prédit à ces jeunes gens que tu ne voudrais pas répondre, que tu simulerais l'ignorance, que tu ferais tout plutôt que de répondre aux questions que l'on te poserait ! Tu es un homme subtil, Thrasymaque, répondis-je ; tu savais donc bien que si tu demandais à quelqu'un quels sont les facteurs de douze et que tu le prévinsses : (337b) « Garde-toi, ami, de me dire que douze vaut deux fois six, ou trois fois quatre, ou six fois deux, ou quatre fois trois, parce que je n'admettrai pas un tel bavardage », tu savais bien, dis-je, que personne ne répondrait à une question ainsi posée. Mais s'il te disait : « Thrasymaque, comment l'entends-tu ? que je ne réponde rien de ce que tu as énoncé d'avance ? Est-ce que, homme étonnant, si la vraie réponse est une de celles-là je ne dois pas la faire, mais dire autre chose que la vérité ? (337c) Ou bien comment l'entends-tu ? », que répondrais-tu à cela ? Bon ! dit-il ; comme ceci est semblable à cela ! Rien ne l'empêche, repris-je; et même si ce n'était point semblable, mais que cela parût tel à la personne interrogée, penses-tu qu'elle répondrait moins ce qui lui paraît vrai, que nous le lui défendions ou non ? Est-ce donc, demanda-t-il, que tu agiras de la sorte, toi aussi ? Feras-tu quelqu'une des réponses que j'ai interdites ? Je ne serais pas étonné, répondis-je, si, après examen, je prenais ce parti, (337d) Mais quoi ! dit-il, si je montre qu'il y a, sur la justice, une réponse différente de toutes celles-là et meilleure qu'elles, à quoi te condamnes-tu ? A quoi d'autre, repris-je, que ce qui convient à l'ignorant ? Or, il lui convient d'être instruit par celui qui sait ; je me condamne donc à cela. Tu es charmant en effet, dit-il ; mais outre la peine d'apprendre, tu verseras (21) aussi de l'argent. Certainement, quand j'en aurai, répondis-je. Mais nous en avons, dit Glaucon. S'il ne tient qu'à l'argent, Thasymaque, parle : nous paierons tous pour Socrate. (337e) Je vois parfaitement, reprit-il ; pour que Socrate se livre à son occupation habituelle, ne réponde pas lui-même, et, après qu'un autre a répondu, s'empare de l'argument et le réfute ! Comment, dis-je, homme excellent, répondrait-on, d'abord quand on ne sait pas et avoue ne pas savoir, quand ensuite, si l'on a une opinion sur le sujet, on se voit interdit de dire ce qu'on pense par un personnage dont l'autorité n'est point médiocre? (338) C'est plutôt à toi de parler puisque tu prétends savoir et avoir quelque chose à dire. N'agis donc pas autrement : fais-moi le plaisir de répondre, et ne mets pas de parcimonie à instruire Glaucon et les autres.
Quand j'eus dit ces mots, Glaucon et les autres le prièrent de ne point agir
autrement. Thrasymaque, on le voyait bien, avait envie de parler pour se
distinguer, pensant avoir une très belle réponse à faire ; mais il se donnait
l'air d'insister pour que je fusse le répondant. Tu dis avec raison, repris-je, que je m'instruis auprès des autres, mais tu prétends à tort que je ne les paie pas de retour. Je paie, en effet, dans la mesure où je le peux. Or je ne peux que louer, car je n'ai point de richesses. Mais de quel coeur je le fais, quand on me semble bien dire, tu l'apprendras aussitôt que tu m'auras répondu ; car je pense que tu parleras bien. (338c)
Ecoute donc, dit-il. J'affirme que le juste n'est autre chose que l'avantageux
au plus fort. Eh bien ! qu'attends-tu pour me louer ? Tu t'y refuseras ! Permets
que je comprenne d'abord ce que tu dis ; car, pour le moment, je ne saisis pas
encore. Tu prétends que l'avantageux au plus fort est le juste. Mais cela,
Thrasymaque, comment l'entends-tu ? Tu ne l'entends pas, en effet, de la façon
suivante : Si Polydamas (22), le lutteur au
pancrace, est plus fort que nous, et que la viande de boeuf soit avantageuse à
l'entretien de ses forces, tu ne dis pas que, pour nous aussi, plus faibles que
lui, cette nourriture soit avantageuse et, ensemble, (338d)
juste ? Nullement, homme excellent, repris-je ; mais exprime-toi plus clairement. Eh bien ! ne sais-tu pas que, parmi les cités, les unes sont tyranniques, les autres démocratiques, les autres aristocratiques ? Comment ne le saurais-je pas? Or l'élément le plus fort, dans chaque cité, est le gouvernement ? Sans doute. Et chaque gouvernement établit les lois pour son propre avantage : la démocratie des lois démocratiques, la tyrannie des lois tyranniques et les autres de même ; ces lois établies, ils déclarent juste, pour les gouvernés, leur propre avantage, et punissent celui qui le transgresse comme violateur de la loi et coupable d'injustice. Voici donc, homme excellent, ce que j'affirme : dans toutes (339) les cités le juste est une même chose : l'avantageux au gouvernement constitué; or celui-ci est le plus fort, d'où il suit, pour tout homme qui raisonne bien, que partout le juste est une même chose : l'avantageux au plus fort. Maintenant, repris-je, j'ai compris ce que tu dis; est-ce vrai ou non ? je tâcherai de l'étudier. Donc toi aussi, Thrasymaque, tu as répondu que l'avantageux était le juste - après m'avoir défendu de faire cette réponse (339b) ajoutant pourtant : l'avantageux « au plus fort ». Petite addition, peut-être? dit-il. Il n'est pas encore évident qu'elle soit grande ; mais il est évident qu'il faut examiner si tu dis vrai. Je reconnais avec toi que le juste est quelque chose d'avantageux ; mais tu ajoutes à la définition, et tu affirmes que c'est l'avantageux au plus fort ; pour moi, je l'ignore : il faut l'examiner. Examine, dit-il. Je le ferai, poursuivis-je. Et dis-moi : ne prétends-tu pas qu'il est juste d'obéir aux gouvernants ? Je le prétends. (339c) Mais les gouvernants sont-ils infaillibles, dans chaque cité, ou susceptibles de se tromper ? Certainement, répondit-il, ils sont susceptibles de se tromper. Donc, quand ils entreprennent d'établir des lois, ils en font de bonnes et de mauvaises? Je le pense. Est-ce que les bonnes sont celles qui instituent ce qui leur est avantageux, et les mauvaises ce qui leur est désavantageux ? Ou bien comment dis-tu ? Ainsi. Mais ce qu'ils ont institué doit être fait par les gouvernés, et en cela consiste la justice? Certes. Donc, non seulement il est juste, selon toi de faire (339d) ce qui est à l'avantage du plus fort, mais encore le contraire, ce qui est à son désavantage. Que dis-tu là ? s'écria-t-il. Ce que tu dis toi-même, il me semble ; mais examinons-le mieux. N'avons-nous pas reconnu que, parfois, les gouvernants se trompaient sur leur plus grand bien, en prescrivant certaines choses aux gouvernés? et que, d'autre part, il était juste que les gouvernés fissent ce que leur prescrivaient les gouvernants ? Ne l'avons-nous pas reconnu ? Je le crois, avoua-t-il. Crois donc aussi, repris-je, que tu as reconnu juste (339e) de faire ce qui est désavantageux aux gouvernants et aux plus forts, lorsque les gouvernants donnent involontairement des ordres qui leur sont préjudiciables ; car tu prétends qu'il est juste que les gouvernés fassent te qu'ordonnent les gouvernants. Alors, très sage Thrasymaque, ne s'ensuit-il pas nécessairement qu'il est juste de faire le contraire de ce que tu dis ? On ordonne, en effet, au plus faible de faire ce qui est désavantageux au plus fort. Oui, par Zeus, Socrate, c'est très clair, dit Polémarque. (340) Si du moins tu témoignes pour lui, intervint Clitophon. Et qu'a-t-on besoin de témoin ? reprit-il. Thrasymaque, en effet, reconnaît lui-même que parfois les gouvernants donnent des ordres qui leur sont préjudiciables, et qu'il est juste que les gouvernés les exécutent. En fait, Polémarque, exécuter les ordres donnés par les gouvernants est ce que Thrasymaque a posé comme juste. En fait, Clitophon, il a posé comme juste l'avantageux au plus fort. Ayant posé ces deux principes, il a, d'autre (340b) part, reconnu que parfois les plus forts donnaient aux plus faibles et aux gouvernés des ordres qui leur étaient préjudiciables à eux-mêmes. De ces aveux il résulte que le juste n'est pas plus l'avantage du plus fort que son désavantage. Mais, reprit Clitophon, il a défini avantageux au plus fort ce que le plus fort croit être à son avantage ; cela il faut que le plus faible le fasse, et c'est cela que Thrasymaque a posé comme juste. Il ne s'est pas, s'écria Polémarque, exprimé de la sorte !(340c) Il n'importe, Polémarque, dis-je ; mais si maintenant Thrasymaque s'exprime ainsi, admettons que c'est ainsi qu'il l'entend. Et dis-moi, Thrasymaque : entendais-tu par juste ce qui semble avantageux au plus fort, que cela lui donne avantage ou non ? Dirons-nous que tu t'exprimes ainsi ? Point du tout, répondit-il ; penses-tu que j'appelle celui qui se trompe le plus fort, au moment où il se trompe ? Je le pensais, dis-je, quand tu reconnaissais que les (340d) gouvernants ne sont pas infaillibles, mais qu'ils peuvent se tromper. Tu es un sycophante, Socrate, dans la discussion, reprit-il ; appelles-tu médecin celui qui se trompe à l'égard des malades, au moment même et en tant qu'il se trompe ? ou calculateur celui qui commet une erreur dans un calcul, au moment même où il commet cette erreur ? Non ; c'est par façon de parler, je pense, que nous disons : le médecin s'est trompé, le calculateur, le scribe se sont trompés. Mais je crois qu'aucun d'eux, dans la mesure où il est ce que nous l'appelons, ne se trompe jamais ; de sorte que, pour parler avec précision, puisque tu veux être précis, nul artisan ne se trompe. Celui qui se (340e) trompe, le fait quand sa science l'abandonne, dans le moment où il n'est plus artisan ; ainsi, artisan, sage ou gouvernant, personne ne se trompe dans l'exercice même de ces fonctions, quoique tout le monde dise que le médecin s'est trompé, que le gouvernant s'est trompé. Admets donc que je t'aie répondu tout à l'heure en ce sens ; mais, à le dire de la façon la plus précise, le gouvernant, en tant que gouvernant, (341) ne se trompe pas, ne commet pas d'erreur en érigeant en loi son plus grand bien, qui doit être réalisé par le gouverné. Ainsi donc, comme au début, j'affirme que la justice consiste à faire ce qui est à l'avantage du plus fort. Soit, dis-je, Thrasymaque ; te semblé-je un sycophante? Parfaitement, répondit-il. Penses-tu que, de dessein prémédité, pour te nuire dans la discussion, je t'aie interrogé comme je l'ai fait ? J'en suis sûr, dit-il. Mais tu n'y gagneras rien, car tu ne pourras te cacher pour me nuire, ni, ouvertement, m'avoir (341b) par la violence dans la dispute. Je n'essaierai pas non plus, repris-je, homme bien-heureux ! Mais afin que rien de tel ne se reproduise, marque nettement si tu entends au sens vulgaire ou au sens précis, dont tu viens de parler, les mots de gouvernant, de plus fort, pour l'avantage de qui il sera juste que le plus faible agisse. J'entends le gouvernant au sens précis du mot, répondit-il. Pour cela, essaie de me nuire ou de me calomnier, si tu peux - je ne demande pas de quartier. Mais tu n'en es pas capable ! (341c) Imagines-tu que je sois fou au point d'essayer de tondre un lion ou de calomnier Thrasymaque ? Tu viens pourtant de le tenter, bien que nul en cela aussi ! Assez de tels propos ! m'écriai-je. Mais dis-moi : le médecin au sens précis du terme, dont tu parlais tout à l'heure, a-t-il pour objet de gagner de l'argent ou de soigner les malades? Et parle-moi du vrai médecin. Il a pour objet, répondit-il, de soigner les malades. Et le pilote ? le vrai pilote, est-il chef des matelots ou matelot ? Chef des matelots. (341d) Je ne pense pas qu'on doive tenir compte du fait qu'il navigue sur une nef pour l'appeler matelot ; car ce n'est point parce qu'il navigue qu'on l'appelle pilote, mais à cause de son art et du commandement qu'il exerce sur les matelots. C'est vrai, avoua-t-il. Donc, pour le malade et le matelot il existe quelque chose d'avantageux ? Sans doute. Et l'art, poursuivis-je, n'a-t-il pas pour but de chercher et de procurer à chacun ce qui lui est avantageux ? C'est cela, dit-il. Mais pour chaque art est-il un autre avantage que d'être aussi parfait que possible (23).? (341e) Quel est le sens de ta question ?
Celui-ci dis-je. Si tu me demandais s'il suffit au corps d'être corps, ou s'il
a besoin d'autre chose, je te répondrais : « Certainement il a besoin d'autre
chose. C'est pourquoi l'art médical a été inventé parce que le corps est
défectueux et qu'il ne lui suffit pas d'être ce qu'il est. Aussi, pour lui
procurer l'avantageux, l'art s'est organisé. » Te semblé-je, dis-je, en ces
paroles, avoir raison ou non ?
(342) Mais quoi , la médecine même est-elle défectueuse ? en général un art réclame-t-il une certaine vertu - comme les yeux la vue, ou les oreilles l'ouïe, à cause de quoi ces organes ont besoin d'un art qui examine et leur procure l'avantageux pour voir et pour entendre? Et dans cet art même y a-t-il quelque défaut ? Chaque art réclame-t-il un autre art qui examine ce qui lui est avantageux, celui-ci à son tour un autre semblable, et ainsi à l'infini ? Ou bien examine-t-il lui-même ce (342b) qui lui est avantageux ? Ou bien n'a-t-il besoin ni de lui-même ni d'un autre pour remédier à son imperfection (24) ? Car aucun art n'a trace de défaut ni d'imperfecfection, et ne doit chercher d'autre avantage que celui du sujet auquel il s'applique lui-même, lorsque véritable, étant exempt de mal et pur, aussi longtemps qu'il reste rigoureusement et entièrement conforme à sa nature. Examine en prenant les mots dans ce sens précis dont tu parlais. Est-ce ainsi ou autrement ? Ce me semble ainsi, dit-il. (342c) Donc, repris-je, la médecine n'a pas en vue son propre avantage, mais celui du corps. Oui, reconnut-il. Ni l'art hippique son propre avantage, mais celui des chevaux ; ni, en général, tout art son propre avantage - car il n'a besoin de rien - mais celui du sujet auquel il s'applique. Ce me semble ainsi, dit-il. Mais, Thrasymaque, les arts gouvernent et dominent le sujet sur lequel ils s'exercent. Il eut bien de la peine à m'accorder ce point. Donc, aucune science n'a en vue ni ne prescrit l'avantage du plus fort, mais celui du plus faible, du sujet (342d) gouverné par elle. Il m'accorda aussi ce point à la fin, mais après avoir tenté de le contester ; quand il eut cédé : Ainsi, dis-je, le médecin, dans la mesure où il est médecin, n'a en vue ni n'ordonne son propre avantage, mais celui du malade ? Nous avons en effet reconnu que le médecin, au sens précis du mot, gouverne les corps et n'est point homme d'affaires (25). Ne l'avons-nous pas reconnu ? Il en convint. Et le pilote, au sens précis, gouverne les matelots, mais n'est pas matelot ? (342e) Nous l'avons reconnu. Par conséquent, un tel pilote, un tel chef, n'aura point en vue et ne prescrira point son propre avantage, mais celui du matelot, du sujet qu'il gouverne. Il en convint avec peine. Ainsi donc, Thrasymaque, poursuivis-je, aucun chef, quelle que soit la nature de son autorité, dans la mesure où il est chef, ne se propose et n'ordonne son propre avantage, mais celui du sujet qu'il gouverne et pour qui il exerce son art; c'est en vue de ce qui est avantageux et convenable à ce sujet qu'il dit tout ce qu'il dit et fait tout ce qu'il fait. Nous en étions à ce point de la discussion, et il était 343 clair pour tous que la définition de la justice avait été retournée, lorsque Thrasymaque, au lieu de répondre : Dis-moi, Socrate, s'écria-t-il, as-tu une nourrice ? Quoi? répliquai-je, ne vaudrait-il pas mieux répondre que de poser de telles questions ? C'est que, reprit-il, elle te néglige et ne te mouche pas quand tu en as besoin, puisque tu n'as pas appris d'elle à distinguer moutons et berger. Pourquoi dis-tu cela? demandai-je. (343b) Parce que tu t'imagines que les bergers et les bouviers se proposent le bien de leurs moutons et de leurs boeufs, et les engraissent et les soignent en vue d'autre chose que le bien de leurs maîtres et le leur propre. Et, de même, tu crois que les chefs des cités, ceux qui sont vraiment chefs, regardent leurs sujets autrement qu'on regarde ses moutons, et qu'ils se proposent un autre but, jour et nuit, que de tirer d'eux un profit personnel. Tu es allé (343c) si loin dans la connaissance du juste et de la justice, de l'injuste et de l'injustice, que tu ignores que le juste, en réalité, est un bien étranger (26), l'avantage du plus fort et de celui qui gouverne, et le préjudice propre de celui qui obéit et qui sert ; que l'injustice est le contraire et qu'elle commande aux simples d'esprit et aux justes ; que les sujets travaillent à l'avantage du plus fort et (343d) font son bonheur en le servant, mais le leur de nulle manière. Voici, ô très simple Socrate, comment il faut l'envisager : l'homme juste est partout inférieur à l'injuste. D'abord dans le commerce, quand ils s'associent l'un à l'autre, tu ne trouveras jamais, à la dissolution de la société, que le juste ait gagné, mais qu'il a perdu ; ensuite, dans les affaires publiques, quand il faut payer des contributions, le juste verse plus que ses égaux, l'injuste moins; quand, au contraire, il s'agit de recevoir, l'un ne (343e) touche rien, l'autre beaucoup. Et lorsque l'un et l'autre occupent quelque charge, il advient au juste, si même il n'a pas d'autre dommage, de laisser par négligence péricliter ses affaires domestiques, et de ne tirer de la chose publique aucun profit, à cause de sa justice. En outre, il encourt la haine de ses parents et de ses connaissances, en refusant de les servir au détriment de la justice; pour l'injuste, c'est tout le contraire. Car j'entends par (344) là celui dont je parlais tout à l'heure, celui qui est capable de l'emporter hautement sur les autres; examine-le donc si tu veux discerner combien, dans le particulier, l'injustice est plus avantageuse que la justice. Mais tu le comprendras de la manière la plus facile si tu vas jusqu'à la plus parfaite injustice, celle qui porte au comble du bonheur l'homme qui la commet, et ceux qui la subissent et ne veulent point la commettre, au comble du malheur. Cette injustice est la tyrannie qui, par fraude et par violence, s'empare du bien d'autrui : sacré, profane, particulier, public, et non pas en détail, mais tout d'une fois. Pour chacun de ces délits, l'homme qui se laisse (344b) prendre est puni et couvert des pires flétrissures - on traite, en effet, ces gens qui opèrent en détail, de sacrilèges, trafiquants d'esclaves, perceurs de murailles, spoliateurs, voleurs, suivant l'injustice commise. Mais lorsqu'un homme, en plus de la fortune des citoyens, s'empare de leur personne et les asservit, au lieu de recevoir ces noms honteux il est appelé heureux et fortuné, non seulement par les citoyens, mais encore par tous ceux (344c) qui apprennent qu'il a commis l'injustice dans toute son étendue ; car ils ne craignent pas de commettre l'injustice ceux qui la blâment : ils craignent de la souffrir. Ainsi, Socrate, l'injustice poussée à un degré suffisant est plus forte, plus libre, plus digne d'un maître que la justice, et, comme je le disais au début, le juste consiste dans l'avantage du plus fort, et l'injuste est à soi-même avantage et profit (27). Ayant ainsi parlé, Thrasymaque pensait à s'en aller, d après avoir, comme un baigneur, inondé nos oreilles de son impétueux et abondant discours. Mais les assistants ne lui le permirent pas et le forcèrent de rester pour rendre compte de ses paroles. Moi-même l'en priai avec instance et lui dis : O divin Thrasymaque, après nous avoir lancé un pareil discours tu songes à t'en aller, avant d'avoir montré suffisamment ou appris si la chose est telle ou différente? Penses-tu que ce soit une petite entreprise de définir la règle de vie que chacun de nous (344e) doit suivre pour vivre de la façon la plus profitable ? Pensé-je, dit Thrasymaque, qu'il en soit autrement ? Tu en as l'air, repris-je - ou bien tu ne te soucies point de nous et tu n'as cure que nous menions une vie pire ou meilleure, dans l'ignorance de ce-que tu prétends savoir. Mais, mon bon, prends la peine de nous instruire (345) aussi : tu ne feras pas un mauvais placement en nous obligeant, nombreux comme nous sommes. Car, pour te dire ma pensée, je ne suis pas convaincu, et je ne crois pas que l'injustice soit plus profitable que la justice, même si l'on a liberté de la commettre et si l'on n'est pas empêché de faire ce que l'on veut. Qu'un homme, mon bon, soit injuste et qu'il ait pouvoir de pratiquer l'injustice par fraude ou à force ouverte : je ne suis point pour cela persuadé qu'il en tire plus de profit que de la justice. (345b) Peut-être est-ce aussi le sentiment de quelque autre d'entre nous, et non pas seulement le mien ; persuade-nous donc, homme divin, de manière satisfaisante, que nous avons tort de préférer la justice à l'injustice. Et comment te persuaderai-je si je ne l'ai fait par ce que je viens de dire ? Que ferai-je encore ? Faut-il que je prenne mes arguments et te les enfonce dans la tête ? Par Zeus ! m'écriai-je, halte-là ! Mais d'abord, tiens-toi dans les positions prises, ou, si tu en changes, fais-le clairement et ne nous trompe pas. Maintenant, tu vois, (345c) Thrasymaque - pour revenir à ce que nous avons dit - qu'après avoir donné la définition du vrai médecin tu n'as pas cru devoir garder rigoureusement celle du vrai berger. Tu penses qu'en tant que berger il engraisse ses moutons non pas en vue de leur plus grand bien, mais, comme un gourmand qui veut donner un festin, en vue de la bonne chère, ou comme un commerçant, (345d) en vue de la vente, et non comme un berger. Mais l'art du berger ne se propose que de pourvoir au plus grand bien du sujet auquel il s'applique - puisqu'il est lui-même suffisamment pourvu des qualités qui assurent son excellence, tant qu'il reste conforme à sa nature d'art pastoral. Par la même raison je croyais tout à l'heure que nous étions forcés de convenir que tout gouvernement, en tant que gouvernement, se propose uniquement le plus grand bien du sujet qu'il gouverne et dont il a charge, qu'il s'agisse d'une cité ou d'un particulier. Mais (345e) toi, penses-tu que les chefs des cités, ceux qui gouvernent vraiment, le fassent de bon gré ? Si je le pense ? Par Zeus, j'en suis sûr ! Mais quoi ! Thrasymaque, repris-je, les autres charges, n'as-tu pas remarqué que personne ne consent à les exercer pour elles-mêmes, que l'on demande au contraire une rétribution, parce que ce n'est pas à vous que profite leur exercice, mais aux gouvernés? Puis, réponds à ceci : (346) ne dit-on pas toujours qu'un art se distingue d'un autre en ce qu'il a un pouvoir différent ? Et, bienheureux homme, ne réponds pas contre ton opinion, afin que nous avancions un peu ! Mais c'est en cela, dit-il, qu'il se distingue. Et chacun ne nous procure-t-il pas un certain bénéfice particulier et non commun à tous, comme la médecine la santé, le pilotage la sécurité dans la navigation, et ainsi des autres ? Sans doute. Et l'art du mercenaire le salaire ? car c'est là son pouvoir propre. Confonds-tu ensemble la médecine et (346b) le pilotage ? Ou, à définir les mots avec rigueur, comme tu l'as proposé, si quelqu'un acquiert la santé en gouvernant un vaisseau, parce qu'il lui est avantageux de naviguer sur mer, appelleras-tu pour cela son art médecine ? Certes non, répondit-il. Ni, je pense, l'art du mercenaire, si quelqu'un acquiert la santé en l'exerçant. Certes non. Mais quoi ! appelleras-tu la médecine art du mercenaire parce que le médecin, en guérissant, gagne salaire? Non, dit-il. (346c) N'avons-nous pas reconnu que chaque art procure un bénéfice particulier ? Soit, concéda-t-il. Si donc tous les artisans bénéficient en commun d'un certain profit, il est évident qu'ils ajoutent à leur art un élément commun dont ils tirent profit ? Il le semble, dit-il. Et nous disons que les artisans gagnent salaire parce qu'ils ajoutent à leur art celui du mercenaire. Il en convint avec peine. (346d) Ce n'est donc pas de l'art qu'il exerce que chacun retire ce profit qui consiste à recevoir un salaire ; mais, à l'examiner avec rigueur, la médecine crée la santé, et l'art du mercenaire donne le salaire, l'architecture édifie la maison, et l'art du mercenaire, qui l'accompagne, donne le salaire, et ainsi de tous les autres arts : chacun travaille à l'oeuvre qui lui est propre et profite au sujet auquel il s'applique. Mais, si le salaire ne s'y ajoutait pas, est-ce que l'artisan profiterait de son art ? Il ne le semble pas, dit-il. (346e) Et cesse-t-il d'être utile quand il travaille gratuitement ? Non, à mon avis. Dès lors, Thrasymaque, il est évident qu'aucun art ni aucun commandement ne pourvoit à son propre bénéfice, mais, comme nous le disions il y a un moment, assure et prescrit celui du gouverné, ayant en vue l'avantage du plus faible et non celui du plus fort. C'est pourquoi, mon cher Thrasymaque, je disais tout à l'heure que personne ne consent de bon gré à gouverner et à guérir les maux d'autrui, mais qu'on demande salaire, (347) parce que celui qui veut convenablement exercer son art ne fait et ne prescrit, dans la mesure où il prescrit selon cet art, que le bien du gouverné ; pour ces raisons, il faut donner un salaire à ceux qui consentent à gouverner, soit argent, soit honneur, soit châtiment s'ils refusent (28). Comment dis-tu cela, Socrate ? demanda Glaucon ; je connais en effet les deux salaires, mais j'ignore ce que tu entends par châtiment donné en guise de salaire. Tu ne connais donc point le salaire des meilleurs, ce (347b) pour quoi les plus vertueux gouvernent, quand ils se résignent à le faire. Ne sais-tu pas que l'amour de l'honneur et de l'argent passe pour chose honteuse et l'est en effet ? Je le sais, dit-il. A cause de cela, repris-je, les gens de bien ne veulent gouverner ni pour les richesses ni pour l'honneur ; car ils ne veulent point être traités de mercenaires en exigeant ouvertement le salaire de leur fonction, ni de voleurs en tirant de cette fonction des profits secrets ; ils n'agissent pas non plus pour l'honneur : car ils ne sont point ambitieux. Il faut donc qu'il y ait contrainte et châtiment (347c) pour qu'ils consentent à gouverner - c'est pourquoi prendre le pouvoir de son plein gré, sans que la nécessité vous y contraigne, risque d'être taxé de honte - et le plus grand châtiment consiste à être gouverné par un plus méchant que soi, quand on ne veut pas gouverner soi-même ; dans cette crainte me semblent agir, lorsqu'ils gouvernent, les honnêtes gens, et alors ils vont au pouvoir non comme vers un bien, pour jouir de lui, mais comme vers une tâche nécessaire, qu'ils ne peuvent confier à de (347d) meilleurs qu'eux, ni à des égaux. Si une cité d'hommes bons venait à l'existence (29), il semble qu'on y lutterait pour échapper au pouvoir comme maintenant on lutte pour l'obtenir, et là il deviendrait clair que le véritable gouvernant n'est point fait, en réalité, pour chercher son propre avantage, mais celui du gouverné ; de sorte que tout homme sensé choisirait plutôt d'être obligé par un autre que de se donner peine à obliger autrui (30). Je n'accorde donc nullement à Thrasymaque que la (347e) justice soit l'intérêt du plus fort. Mais nous reviendrons sur ce point une autre fois; j'attache une bien plus grande importance à ce que dit maintenant Thrasymaque, que la vie de l'homme injuste est supérieure à celle du juste. Quel parti prends-tu, Glaucon ? demandai-je. Laquelle de ces assertions te semble la plus vraie ? La vie du juste, répondit-il, me semble plus profitable. As-tu entendu l'énumération que Thrasymaque vient (348) de faire, des biens attachés à la vie de l'injuste ? J'ai entendu, mais je ne suis pas persuadé. Alors veux-tu que nous le persuadions, si nous pouvons en trouver le moyen, qu'il n'est pas dans le vrai? Comment ne le voudrais-je pas? dit-il. Si donc, repris-je, tendant nos forces contre lui et opposant discours à discours, nous énumérons les biens que procure la justice, qu'il réplique à son tour, et nous de nouveau, il faudra compter et mesurer les avantages (348b) cités de part et d'autre en chaque discours (31), et nous aurons besoin de juges pour décider ; si, au contraire, comme tout à l'heure, nous débattons la question jusqu'à mutuel accord, nous serons nous-mêmes ensemble juges et avocats. C'est vrai, dit-il. Laquelle de ces deux méthodes préfères-tu ? La seconde. Or çà, donc, Thrasymaque, reprenons au début et réponds-moi. Tu prétends que la parfaite injustice est plus profitable que la parfaite justice ? (348c) Certainement, répondit-il, et j'ai dit pour quelles raisons. Fort bien, mais à leur sujet comment entends-tu ceci : appelles-tu l'une vertu et l'autre vice ? Sans doute. Et c'est la justice que tu nommes vertu et l'injustice vice ? Il y a apparence, très charmant homme, quand je dis que l'injustice est profitable et que la justice ne l'est pas ! Quoi donc alors ? Le contraire, dit-il (32). La justice est un vice ? (348d) Non, mais une très noble simplicité de caractère. Alors l'injustice est méchanceté de caractère? Non pas, elle est prudence. Est-ce, Thrasymaque, que les injustes te semblent sages et bons ? Oui, répondit-il, ceux qui sont capables de commettre l'injustice avec perfection et de se soumettre villes et peuples. Tu crois peut-être que je parle des coupeurs de bourse ? De telles pratiques sont sans doute profitables, tant qu'elles ne sont pas découvertes ; mais elles ne méritent point mention à côté de celles que je viens d'indiquer. Je conçois bien ta pensée, mais ce qui m'étonne c'est (348e) que tu classes l'injustice avec la vertu et la sagesse, et la justice avec leurs contraires. Néanmoins, c'est bien ainsi que je les classe. Cela s'aggrave, camarade, repris-je, et il n'est pas facile de savoir ce qu'on peut dire. Si, en effet, tu posais que l'injustice profite, tout en convenant, comme certains autres, qu'elle est vice et chose honteuse, nous pourrions te répondre en invoquant les notions courantes sur le sujet; mais évidemment tu diras qu'elle est belle et forte, et tu lui donneras tous les attributs que nous (349) donnions à la justice, puisque tu as osé la classer avec la vertu et la sagesse. Tu devines très bien, dit-il. Je ne dois pourtant pas me refuser à poursuivre cet examen tant que j'aurai lieu de croire que tu parles sérieusement. Car il me semble réellement, Thrasymaque, que ce n'est point raillerie de ta part, et que tu exprimes ta véritable opinion. Que t'importe, répliqua-t-il, que ce soit mon opinion ou non? Réfute-moi seulement. Il ne m'importe en effet, avouai-je. Mais tâche de (349b) répondre encore à ceci : l'homme juste te paraît-il vouloir l'emporter en quelque chose sur l'homme juste ? Nullement, dit-il, car il ne serait pas poli et simple comme il est. Quoi! pas même dans une action juste ? Pas même en cela. Mais prétendrait-il l'emporter sur l'homme injuste, et penserait-il ou non le faire justement ? Il le penserait, répondit-il, et le prétendrait, mais ne le pourrait point. Ce n'est pas là ma question : je te demande si le juste n'aurait ni la prétention ni la volonté de l'emporter (349c) sur le juste, mais seulement sur l'injuste. C'est ainsi, dit-il. Et l'injuste prétendrait l'emporter sur le juste et sur l'action juste ? Comment ne le voudrait-il pas, lui qui prétend l'emporter sur tous ? Ainsi donc il l'emportera sur l'homme et sur l'action injustes, et luttera pour l'emporter sur tous ? C'est cela. Disons-le donc ainsi, repris-je : le juste ne l'emporte pas sur son semblable, mais sur son contraire ; l'injuste (349d) l'emporte sur son semblable et sur son contraire. Excellemment exprimé, dit-il. Mais, poursuivis-je, l'injuste est sage et bon, tandis que le juste n'est ni l'un ni l'autre? Excellent aussi, dit-il. Par conséquent l'injuste ressemble au sage et au bon, et le juste ne leur ressemble pas ? Comment en serait-il autrement ? Étant ce qu'il est il ressemble à ses pareils, et l'autre ne leur ressemble pas. Très bien. Chacun est donc tel que ceux auxquels il ressemble ? Qui peut en douter ? demanda-t-il. Soit, Thrasymaque ; maintenant ne dis-tu pas d'un (349e) homme qu'il est musicien, d'un autre qu'il ne l'est pas ? Si. Lequel des deux est sage, et lequel ne l'est pas ? Le musicien assurément est sage et l'autre ne l'est pas. Et l'un n'est-il pas bon dans les choses où il est sage, l'autre mauvais dans les choses où il ne l'est pas ? Si. Mais à l'égard du médecin n'est-ce pas ainsi ? C'est ainsi. Maintenant, crois-tu, excellent homme, qu'un musicien qui accorde sa lyre veuille, en tendant ou détendant les cordes, l'emporter sur un musicien, ou prétende avoir avantage sur lui ? Non, je ne le crois pas. Mais sur un homme ignorant la musique voudra-t-il l'emporter ? Oui, nécessairement. Et le médecin? en prescrivant nourriture et boisson (350) voudra-t-il l'emporter sur un médecin ou sur la pratique médicale ? Certes non. Et sur un homme ignorant en médecine ? Oui. Mais vois, au sujet de la science et de l'ignorance en général, si un savant, quel qu'il soit, te semble vouloir l'emporter, en ses actes ou en ses paroles, sur un autre savant, et ne pas agir comme son semblable dans le même cas. Peut-être est-ce nécessaire, avoua-t-il, qu'il en soit ainsi. Mais l'ignorant, ne voudra-t-il pas l'emporter semblablement sur le savant et sur l'ignorant ? (350b) Peut-être. Or le savant est sage ? Oui. Et le sage est bon ? Oui. Donc l'homme sage et bon ne voudra pas l'emporter sur son semblable, mais sur celui qui ne lui ressemble pas, sur son contraire. Apparemment, dit-il. Tandis que l'homme méchant et ignorant voudra l'emporter sur son semblable et sur son contraire. On peut le croire. Mais, Thrasymaque, poursuivis-je, notre homme injuste ne l'emporte-t-il pas sur son contraire et son semblable ? Ne l'as-tu pas dit ? Si, répondit-il. Et n'est-il pas vrai que le juste ne l'emportera pas sur (350c) son semblable, mais sur son contraire? Si. Le juste, dis-je, ressemble donc à l'homme sage et bon, et l'injuste à l'homme méchant et ignorant. Il y a chance. Mais nous avons reconnu que chacun d'eux est tel que celui à qui il ressemble. Nous l'avons reconnu en effet. Le juste se révèle donc à nous bon et sage, et l'injuste ignorant et méchant. Thrasymaque convint de tout cela, non pas aussi aisément (350d) que je le rapporte, mais malgré lui et avec peine. Il suait merveilleusement, d'autant plus qu'il faisait très chaud - et c'est alors que pour la première fois je vis Thrasymaque rougir ! Lors donc que nous fûmes convenus que la justice est vertu et sagesse et l'injustice vice et ignorance : Soit ! repris-je, tenons cela pour établi ; mais nous avons dit que l'injustice a aussi la force en partage. Ne t'en souviens-tu pas, Thrasymaque ? Je m'en souviens, dit-il, mais ce que tu viens d'affirmer ne me plaît pas, et j'ai de quoi y répondre. Seulement je (350e) sais bien que si je prends la parole tu diras que je fais une harangue. Laisse-moi donc parler à ma guise, ou, si tu veux interroger, interroge ; et moi, comme on en use avec les vieilles femmes qui font des contes, je te dirai « soit ! », et de la tête je t'approuverai ou te désapprouverai. Du moins, demandai-je, ne réponds nullement contre ton opinion. Je ferai ce qui te plaira puisque tu ne me laisses pas parler. Que veux-tu davantage? Rien, par Zeus, repris-je, fais comme tu l'entendras; je vais t'interroger. Interroge. Je te poserai donc la même question que tout à l'heure, (351) afin de reprendre la suite de la discussion : qu'est la justice par rapport à l'injustice? Il a été dit, en effet que l'injustice est plus forte et plus puissante que la justice; mais maintenant, si la justice est sagesse et vertu, il apparaîtra aisément, je pense, qu'elle est plus forte que l'injustice, puisque l'injustice est ignorance. Personne ne peut encore l'ignorer. Pourtant ce n'est pas envisager la chose, mais du point de vue suivant : n'existe-t-il pas, dis-moi, de cité injuste qui tente d'asservir ou (351b) qui ait asservi injustement d'autres cités, tenant un grand nombre d'entre elles en esclavage ? Assurément, répondit-il. Et c'est ainsi qu'agira la meilleure cité, la plus parfaitement injuste. Je sais que c'était là ta thèse. Mais à ce propos je considère ce point : est-ce qu'une cité qui se rend maîtresse d'une autre cité le pourra faire sans la justice, ou sera obligée d'y avoir recours ? Si, comme tu le disais tout à l'heure, la justice est (351c) sagesse, elle y aura recours; mais s'il en est comme je le disais, elle emploiera l'injustice. Je suis charmé, Thrasymaque, que tu ne te contentes pas d'approuver ou de désapprouver d'un signe de tête, et que tu répondes si bien. C'est, dit-il, pour te faire plaisir. Très gentil de ta part. Mais fais-moi la grâce de répondre encore à ceci : crois-tu qu'une cité, une armée, une bande de brigands ou de voleurs, ou toute autre société qui poursuit en commun un but injuste, pourrait mener à bien quelque entreprise si ses membres violaient entre eux les règles de la justice ? Certes non, avoua-t-il. (351d) Mais s'ils les observaient ? Cela n'irait-il pas mieux ? Certainement. En effet, Thrasymaque, l'injustice fait naître entre les hommes des dissensions, des haines et des luttes, tandis que la justice entretient la concorde et l'amitié (33). N'est-ce pas? Que cela soit ! dit-il, afin que je n'aie point de différend avec toi. Tu te conduis fort bien, excellent homme. Mais réponds à cette question : si c'est le propre de l'injustice d'engendrer la haine partout où elle se trouve, apparaissant chez des hommes libres ou des esclaves, ne fera-t-elle pas qu'ils se haïssent, se querellent entre eux, et soient impuissants à rien entreprendre en commun? (351e) Sans doute. Mais si elle apparaît en deux hommes ? Ne seront-ils pas divisés, haineux, ennemis l'un de l'autre et des justes? Ils le seront, dit-il. Et si, merveilleux ami, l'injustice apparaît chez un seul homme, perdra-t-elle son pouvoir ou le gardera-t-elle intact ? Qu'elle le garde intact ! concéda-t-il. Donc, ne semble-t-elle pas posséder le pouvoir, en quelque sujet qu'elle apparaisse, cité, tribu, armée ou (352) société quelconque, de rendre d'abord ce sujet incapable d'agir en accord avec lui-même, à cause des dissensions et des différends qu'elle excite, ensuite de le faire l'ennemi de lui-même, de son contraire et du juste ? Sans doute. Et chez un seul homme, j'imagine qu'elle produira ces mêmes effets, qu'il est dans sa nature de produire; d'abord elle le rendra incapable d'agir, excitant en lui la sédition et la discorde; ensuite elle en fera l'ennemi de lui-même et celui des justes. N'est-ce pas? Oui. Mais, mon cher, les dieux ne sont-ils pas justes? (352b) Soit ! dit-il. Donc, des dieux aussi l'injuste sera l'ennemi, Thrasymaque, et le juste l'ami. Régale-toi sans crainte de tes discours : je ne te contredirai pas, afin de ne pas m'attirer le ressentiment de la compagnie. Eh bien, allons ! repris-je, rassasie-moi de la suite du festin en continuant à répondre. Nous venons de voir que les hommes justes sont plus sages, meilleurs et plus puissants dans l'action que les hommes injustes, et que ceux-ci sont incapables d'agir de concert - et quand (352c) nous disons qu'ils ont parfois mené vigoureusement une affaire en commun, ce n'est, d'aucune manière, la vérité, car ils ne se seraient pas épargnés les uns les autres s'ils eussent été tout à fait injustes; aussi bien est-il évident qu'il y avait en eux une certaine justice qui les a empêchés de se nuire mutuellement, dans le temps qu'ils nuisaient à leurs victimes, et qui leur a permis de faire ce qu'ils ont fait ; se lançant dans leurs injustes entreprises, ils n'étaient qu'à demi pervertis par l'injustice, puisque les méchants achevés et les parfaits injustes sont aussi parfaitement incapables de rien faire. Voilà comment (352d) je le comprends, et non comme tu le posais au début. Maintenant il nous faut examiner si la vie du juste est meilleure et plus heureuse que celle de l'injuste : question que nous avions remise à un examen ultérieur. Or cela est, ce me semble, évident d'après ce que nous avons dit. Cependant nous devons mieux examiner la chose, car la discussion ne porte pas ici sur une bagatelle, mais sur la manière dont il faut régler notre vie. Examine donc, dit-il. Je vais le faire, répondis-je. Et dis-moi : le cheval te paraît-il avoir une fonction ? Oui. (352e) Or, poserais-tu comme fonction du cheval, ou de n'importe quel autre sujet, ce qu'on ne peut faire que par lui, ou ce qu'on fait le mieux avec lui ? Je ne comprends pas, dit-il. Expliquons-nous : vois-tu par autre chose que par les yeux ? Certes non. Et entends-tu par autre chose que par les oreilles ? Nullement. Nous pouvons par conséquent dire justement que ce sont là les fonctions de ces organes. Sans doute. Mais quoi ! ne pourrais-tu pas tailler un sarment de (353) vigne avec un couteau, un tranchet, et beaucoup d'autres instruments? Pourquoi pas? Mais avec aucun, je pense, aussi bien qu'avec une serpette qui est faite pour cela. C'est vrai. Donc, ne poserons-nous pas que c'est là sa fonction? Nous le poserons certainement. Maintenant, je pense, tu comprends mieux ce que je disais tout à l'heure quand je te demandais si la fonction d'une chose n'est pas ce qu'elle seule peut faire, ou ce qu'elle fait mieux que les autres. Je comprends, dit-il, et il me semble que c'est bien (353b) là la fonction de chaque chose. Bon, repris-je. Mais n'y a-t-il pas aussi une vertu en chaque chose à qui une fonction est assignée ? Revenons à nos exemples précédents : les yeux, disons-nous, ont une fonction ? Ils en ont une. Ils ont donc aussi une vertu ? Ils ont aussi une vertu.Mais quoi ! les oreilles, avons-nous dit, ont une fonction ? Oui. Et donc une vertu aussi ? Une vertu aussi. Mais à propos de toute chose n'en est-il pas de même ? Il en est de même. Eh bien ! les yeux pourraient-ils jamais bien remplir (353c) leur fonction s'ils n'avaient pas la vertu qui leur est propre, ou si, au lieu de cette vertu, ils avaient le vice contraire ? Comment le pourraient-ils ? Tu veux dire probablement la cécité à la place de la vue? Quelle est leur vertu, peu importe ; je ne te le demande pas encore, mais seulement si chaque chose s'acquitte bien de sa fonction par sa vertu propre, et mal par le vice contraire. C'est comme tu dis, avoua-t-il. Ainsi donc, les oreilles, privées de leur vertu propre, rempliront mal leur fonction ? Sans doute. (353d) Ce principe s'applique-t-il à toutes les autres choses? Il me le semble. Or çà, donc, examine maintenant ceci : l'âme n'a-t-elle pas une fonction que rien d'autre qu'elle ne pourrait remplir, comme de surveiller, commander, délibérer et le reste (34) ? Peut-on attribuer ces fonctions à autre chose qu'à l'âme, et n'avons-nous pas le droit de dire qu'elles lui sont propres ? On ne peut les attribuer à aucune autre chose. Et la vie ? ne dirons-nous pas qu'elle est une fonction de l'âme ? Assurément, répondit-il. Donc, nous affirmerons que l'âme aussi a sa vertu propre (35)? Nous l'affirmerons. Or, Thrasymaque, est-ce que l'âme s'acquittera jamais (353e) bien de ces fonctions si elle est privée de sa vertu propre? ou bien est-ce impossible ? C'est impossible. Par conséquent, il y a nécessité qu'une âme mauvaise commande et surveille mal, et que l'âme bonne fasse bien tout cela. Il y a nécessité. Or, ne sommes-nous pas tombés d'accord que la justice est une vertu, et l'injustice un vice de l'âme ? Nous en sommes tombés d'accord, en effet. Donc l'âme juste et l'homme juste vivront bien, et l'injuste mal ? Il le semble, dit-il, d'après ton raisonnement. Mais certes, celui qui vit bien est heureux et fortuné, (354) et celui qui vit mal le contraire. Qui en doute? Ainsi le juste est heureux, et l'injuste malheureux. Soit ! concéda-t-il. Et cela ne profite pas d'être malheureux, mais d'être heureux. Sans doute. Jamais, par suite, divin Thrasymaque, l'injustice n'est plus profitable que la justice. Que cela, Socrate, dit-il, soit ton festin des Bendidées ! Je l'ai eu grâce à toi, Thrasymaque, puisque tu t'es adouci et que tu as cessé de te montrer rude à mon égard. (354b) Cependant je ne me suis pas bien régalé : par ma faute et non par la tienne. Il me semble que j'ai fait comme les gourmands, qui se jettent avidement sur le plat qu'on leur présente, avant d'avoir suffisamment goûté du précédent; de même, avant d'avoir trouvé ce que nous cherchions au début, la nature de la justice, je me suis lancé dans une digression pour examiner si elle est vice et ignorance ou sagesse et vertu; un autre propos étant survenu ensuite, à savoir si l'injustice est plus avantageuse que la justice, je n'ai pu m'empêcher d'aller de l'une à l'autre, en sorte que le résultat de notre conversation est que je ne sais rien ; car, ne sachant pas ce qu'est la justice, encore moins saurai-je si elle est vertu ou non, et si celui qui la possède est heureux ou malheureux (36). (01) Il s'agit probablement, comme en témoigne un autre passage du premier livre (354 a) de la déesse que les Thraces honoraient sous le nom de Bendis, et dont le culte venait d'être importé à Athènes. Toutefois, certains commentateurs ont émis une hypothèse différente : " Alii - écrit Schneider - Minervam intelligunt quae vulgo ² yeñw appellabatur ; neque mihi videtur Socrates in ista Panathenaeorum propinquitate de Minerva veneranda cogitare non potuisse : sed quod simpliciter t¯n ¥ort®n dicit, numina diversa statuere non sinit. » Selon Foucart (Des associations religieuses chez les Grecs, p. 131) le culte de Bendis avait été introduit en Attique par les marchands thraces, très nombreux au Pirée.(02) C'est le célèbre orateur de ce nom. Son père, Céphale, n'était pas Athénien de naissance. Riche fabricant d'armes syracusain venu se fixer au Pirée sur le conseil de Périclès, il appartenait à cette classe d'hommes de négoce qui cherchent un titre de noblesse dans la culture de la philosophie et des belles-lettres. Après sa mort ses fils furent victimes de la tyrannie des Trente. On sait que Lysias parvint à s'enfuir, mais Polémarque fut condamné à boire la ciguë (404 av. J.-C.). (03) Sur le sophiste Thrasymaque voy. notre Introduction, et cf. Phèdre 260 c, 266 c, 267 c-d et 269 d. (04) Sur Clitophon voy. l'Introduction. On ne sait rien de Charmantide qui n'est cité dans aucun autre endroit des Dialogues. (05) Expression empruntée à Homère (Iliade, XXII, 60, XXIV, 487) et à Hésiode (Les Travaux et les Jours, 331). (06) Ce vieux proverbe est le suivant d'après le Scoliaste : κολοιὸς ποτὶ κολοιὸν ἰζάνει : le geai perche auprès du geai. Cf. Phèdre 240 c : ἥλιξ ἥλιξα τέρπει. (07) Cicéron a imité ce passage dans le De Senectute, III, 7, 8.. (08) L'anecdote est rapportée de façon quelque peu différente par Hérodote (VIII, 125). (09) Nous suivons la ponctuation de l'édition Burnet: καὶ αὐτός--ἤτοι ὑπὸ τῆς τοῦ γήρως ἀσθενείας ἢ καὶ ὥσπερ ἤδη ἐγγυτέρω ὢν τῶν ἐκεῖ μᾶλλόν τι καθορᾷ αὐτά--ὑποψίας δ' οὖν καὶ δείματος μεστὸς γίγνεται κτλ (10) Voy. Bergk : Poet. Lyr. Gr. 4, I, p. 452. (11) Le personnage de Céphale éclaire d'une sereine lumière toute cette première partie du dialogue. Ce sage vieillard a exprimé, sur la justice, l'opinion des honnêtes gens, en des termes où transparaît la simplicité de son âme, embellie de hautes préoccupations par les approches de la mort. Mais il ne se mêlera pas à la discussion, car, dit Cicéron (Ep. ad Att., IV, 16, 3) « credo Platonem vix putasse satis consonum fore, si hominem id aetatis in tam longo sermone diutius retinuisset » . On saisit là une des délicatesses de l'art de Platon. (12) L'étude des poètes faisait le fond de la première éducation chez les Grecs. Elle avait pour but non seulement la formation du goût, mais encore la formation morale. L'opinion que Platon prête à Simonide était, en réalité, communément admise. A travers le vieux poète ce sont ici les contemporains du philosophe qui sont visés. Dans son édition de la République (tome I, p. 12 n.) J. Adam cite à ce sujet de nombreuses références. On pourrait les résumer dans ce témoignage de Xénophon (Hiéron, II, 2) : καὶ μὴν πλείστου γε δοκεῖ ἀνὴρ ἐπαίνου ἄξιος εἶναι, ὃς ἄν φθάνῃ τοὺς μὲν πολεμίους κακῶς ποιῶν, τοὺς δὲ φίλους εὐεργετῶν. »(13) C'est fine opinion souvent exprimée par Socrate que la connaissance d'un objet implique la connaissance de son con-traire (cf. Phèdre, 97 d). Ici cette opinion prend un tour sophistique bien fait pour confondre un disciple des Sophistes. (14) Odyssée, XIX, 394
μετ' Αὐτόλυκον τε καὶ υἷας « De cet Autolycos sa mère était la fille, et ce héros passait pour le plus grand voleur et le meilleur parjure. » (V. Bérard, tom. III, p. 84.) (15) « Le même mode de raisonnement se retrouve en 339 b et suiv. - Cf. aussi Hipp. Majeur, 284 d. » (Adam.) (16) Tyran de Corinthe, compté généralement parmi les Sept Sages. Platon toutefois ne le mentionne pas dans sa liste du Protagoras, 843 a. Il cite à sa place Chilon de Lacédémone. (17) Il s'agit de Perdiccas II, père d'Archelatis (cf. Gorgias, 471 b) (18) Puissant citoyen de Thèbes. Platon indique l'origine de sa fortune dans le Ménon 90 a. (19) ἧκεν ἐφ' ἡμᾶς ὡς διαρπασόμενος- J. Adam remarque très justement (tom. I, p. 23, n.) que ἧκεν n'est pas, comme l'ont cru certains traducteurs, le parfait de ἥκω, mais l'aoriste 1 de ἵημι. L'expression ἧκεν ἐφ' ἡμᾶς serait trop faible entre συστρέψας ἑαυτὸν θηρίον et ὡς διαρπασόμενος.(20) C'était une opinion populaire chez les Anciens que le regard du loup rendait muet. Pour éviter ce malheur il fallait regarder le loup avant d'en être regardé. Cf. Théocrite, XIV, 22, et Virgile, Eglogues, IX, 53-54 :
....vox quoque Moerim (21) καὶ ἀπότεισον ἀργύριον. - Littéralement : « Tu allongeras de l'argent (au sens populaire de l'expression française). » Sur les sentiments intéressés de Thrasymaque cf. Phèdre 266 c.(22) Polydamas, athlète de taille gigantesque, fut vainqueur aux Jeux Olympiques en 408 av. J.-C. Pausanias (VI, 5) rapporte quelques-unes de ses merveilleuses prouesses. (23) ἄρ' οὖν καὶ ἑκάστῃ τῶν τεχνῶν ἔστι τι συμφέρον ἄλ λο ἢ ὅτι μάμιστα τελέαν εἶναι - Cette phrase ne s'accorde guère avec le contexte, à moins de l'interpréter dans un sens très large. Nous devons supposer, dit Adam (tom. I, p. 35 n.), qu'elle équivaut à ceci : « Aucun art n'a d'avantage propre, à moins qu'on appelle avantage sa perfection. » Par la suite, en effet, elle est expliquée en ce sens : aucun art n'a besoin de vertu supplémentaire, puisque, en tant qu'art, il est lui-même parfait. Le Ms. de Florence et le Monac. q portent des additions marginales qui lèvent la difficulté: ἄρ' οὖν καὶ ἑκάστῃ τῶν τεχνῶν ἔστι τι συμφέρον ἄλλο [οὗ προσδεῖται] ἢ [ἐξαρκεῖ αὐτὴ αὑτῇ, ὥστε] τελέαν εἶναι; Quellequ'e n soit l'authenticité, il est permis de remarquer avec Schneider : « Platonem non solum potuisse, sed etiam debuisse vel haec ipsa vel consimilia scribere. » (24) Un art quelconque est comparé à un organe. Pour qu'il remplisse sa fonction faut-il qu'il ait une certaine vertu, comparable à la faculté de l'organe ? Et, de même que cette faculté demande un art spécial pour s'exercer, de même la vertu de l'art a-t-elle besoin d'un second art qui assure son exercice ? C'est à une réponse négative que Socrate amène son interlocuteur par ces questions. (25) Cf. Aristote, Polit., A, 9. 1258 a : « Il n'appartient pas au courage de procurer des richesses, mais une mâle assurance, ni à l'art du stratège ou du médecin d'enrichir, mais à l'un de donner la victoire, à l'autre la santé. Et cependant on fait de tous ces arts une affaire d'argent, comme si c'était là leur fin propre et que tout en eux dût viser à atteindre cette fin. » (26) Cf. Aristote, Eth. à Nicom., V, 3. 1130 a : « Pour la même raison la justice, seule entre les vertus, parait être un bien étranger, parce que relatif à un autre; c'est en effet l'intérêt d'un autre qu'elle assure, soit chef, soit associé.» (27) Tout le discours de Thrasymaque est une parodie du langage des sophistes. Il n'est guère possible au traducteur d'en rendre le caractère. (28) Cf. liv. VII, 519 d et suiv. (29) Première mention de la cité idéale dont le plan sera tracé dans les cinquième, sixième et septième livres. (30) Cette idée qui de prime abord semble égoïste est expliquée en 520 d. (31) «Etablir alternativement des listes d'avantages était la méthode bien connue de la Fable. Voy. le livre II (361 d, 362 c-e, 365 a) ; comp. le Choix d'Héraclès (Xénoph. Mém., II, 1) et la discussion entre le Juste et l'Injuste dans les Nuées d'Aristophane. » (Pr. Bosanquet : A Companion to Plato's Republic for English readers, London, 4th imp., p. 58.) (32) Cette notion de la justice rappelle celle de la vertu que Calliclès développe dans le Gorgias, 491 e et suiv. (33) Cf. liv. IV, 433 a - 434 e. (34) Cf. Phédon, 105 c. - La définition de la fonction de l'âme est ici complète et précédée de celle de fonction en général. Par contre, dans le Phédon, nous trouvons cette même définition sans commentaire. « Nous avons, écrit W. Lutoslawski (The Origin and Growth of Plato's Logic, ch. VI, p. 275), d'une part une induction élémentaire, et d'autre part le résultat de cette induction cité comme vérité évidente. En pareil cas l'explication la plus longue peut être considérée comme la première. Lutoslawski se sert de cet argument, entre autres, pour établir que le livre A de la République est antérieur au Phédon. Par ailleurs, le passage 353 e paraît être un développement de ce qui, dans le Gorgias, 506 e, est appelé l'ordre de l'âme. Il s'ensuit, selon le même auteur, que le premier livre de la République doit être placé, dans l'ordre chronologique, entre le Gorgias - auquel il ressemble par bien des points - et le Phédon qui dénote un enrichissement sensible des théories platoniciennes. (Voy. l'Introduction.) (35) «La notion de l'existence d'un pouvoir particulier de l'âme est ici introduite en connexion avec la remarque que chaque espèce de perception dépend d'une faculté spéciale, ayant pour fin une activité déterminée, qui ne peut s'exercer autrement que par l'organe du sens correspondant... C'est là un clair exposé de la théorie connue aujourd'hui sous le nom de loi des énergies spécifiques des sens. Mais Platon n'accorda aucune importance spéciale à cette remarque ; il la prit simplement comme analogie pour établir sa théorie générale des facultés humaines (Lutoslawski, op. cit., p. 276). (36) Cette conclusion négative rappelle celles des premiers dialogues, et notamment du Charmide. Elle laisse cependant entrevoir que la question, mal posée, sera reprise et examinée logiquement dans la suite; on s'efforcera alors de définir l'essence de la justice avant de rechercher ses attributs. Ainsi, le premier livre tout entier n'est qu'une sorte de prélude, qui sert à poser le problème dans ses termes les plus familiers, et à indiquer les solutions courantes qu'il reçoit.
|