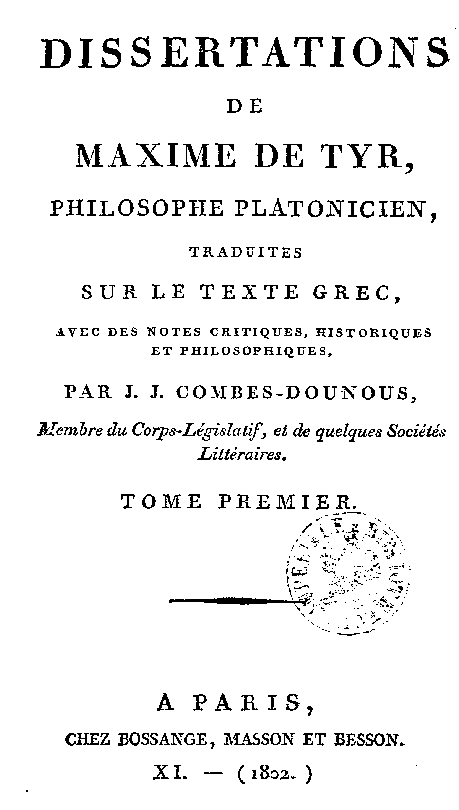|
DISSERTATIONS
DE MAXIME DE TYR.
DISSERTATION I.
La volupté (1) est un bien; mais elle n'est pas un bien solide. « Il est difficile, comme dit le proverbe des anciens (2), il est difficile d'être homme de bien ». Est-il donc difficile à un cheval et à un lévrier (3), de réunir les qualités qui constituent un bon cheval ou un bon lévrier, chacun dans son espèce ? Ou bien le lévrier et le cheval réunissent-ils sans peine les qualités qui constituent un bon cheval et un bon lévrier, pourvu que le cheval soit habilement dressé au manège, et que le lévrier soit habilement dressé à la chasse : et l'homme, est-il le seul de tous les animaux qui n'acquiert qu'avec beaucoup de peine, de difficulté, et d'incertitude, les bonnes qualités qui le constituent; et n'a-t-on encore inventé aucun art par le secours duquel on puisse lui en assurer l'acquisition ? Si cela est ainsi, ne dédaignera-t-il point les sophistes? Ne leur ôtera-t-il pas ainsi tout sujet de discourir, de controverser, de discuter? Trompé dans ce qu'il attendait de l'art oratoire, et frappé du peu de solidité de ses principes, ne renoncera-t-il pas à l'espérance de remplir sa destination, de pourvoir à sa sûreté dans l'occasion à l'aide de cet art-là? Ne sera-t-il point insouciant pour tout ce qui concerne l'instruction ? N'éprouvera-t-il point ce qu'éprouvent les malheureux qui s'embarquent pour la première fois, et qui, pour peu qu'ils soient assaillis, par la tempête, effrayés de la nouveauté du spectacle, abandonnent le gouvernail ; et sans songer aux ressources de la manœuvre qui pourrait les sauver, se précipitent eux-mêmes dans les flots, et périssent avant qui, le vaisseau soit englouti (4) ? Car telle me paraît être la condition de tous ceux qui ayant embrassé la profession de la philosophie, et ballottés entre les divers systèmes dans lesquels elle se partage, ne supportent point cet état de fluctuation et de tourmente auquel leur âme est en proie ; et cessent de croire que la raison soit destinée à les diriger vers un port sûr, et à les y fixer un jour. II. Ignorez-vous donc que les opinions et les passions des hommes, les causes qui les produisent, les sources d'où elles tirent leur origine, les principes qui les règlent et leur donnent une direction salutaire, sujets quotidiens des méditations et des discours des philosophes, ne sont une chose ni circonscrite, ni simple, ni semblable à ces fleuves qui vont en droite ligne, au courant desquels on peut abandonner un vaisseau avec la confiance qu'il fera toujours bonne route. C'est une mer étendue et profonde. On est plus exposé à s'y égarer, que sur les mers de Sicile ou d'Égypte. A la vérité, il est un art de se diriger sur cette mer à l'aide de la connaissance des astres et du gisement des côtes ; mais il en est de cet art-là, comme de celui des pilotes. Chacun désire le savoir, mais le plus grand nombre ne parviennent pas à le savoir bien. Aussi se trompent-ils sur la véritable direction des ports, et sont-ils jetés tantôt contre des rochers périlleux, tantôt sur des bas-fonds, tantôt chez les Sirènes, tantôt chez les Lotophages (5), tantôt chez d'autres peuples ou assez pervers pour méconnaître les lois de l'hospitalité, ou assez ignorants pour n'avoir des Dieux aucune notion, ou corrompus d'ailleurs par tous les genres de voluptés. Tandis, au contraire, que les pilotes habiles, et sûrs de ne point manquer le lieu où ils veulent arriver, se dirigent en droite ligne vers les meilleurs ports, « où l'on n'a besoin ni de câbles, ni de cordages, ni d'ancres (6). », Mais quel est donc ce pilote ? Où est celui auquel nous devons nous adresser et nous confier ? Ah, mon ami ! ne me le demandez point encore, avant que d'avoir passé en revue et examiné les autres pilotes, et principalement celui qui, abandonné aux délices et à la volupté, dirige le vaisseau dont le coup d'œil est le plus agréable à le contempler du rivage, mais qui est en effet le moins propre à la navigation, vaisseau sujet à toute sorte d'accidents, d'une mauvaise manœuvre, tout défectueux dans ses agrès, sans force pour résister à la tourmente, et livré à toutes les fureurs des vagues (7). III. Puisque nos idées ont pris, sans savoir comment, la tournure d'une allégorie maritime, ne nous en départons point, avant qu'elle ait achevé de nous montrer notre sujet dans toute sa vérité, en assimilant la philosophie d'Épicure au vaisseau du Roi Aëte (8). Ce n'est point une fable que je vais raconter. Il n'y a pas longtemps que fut entrepris par mer le trajet de l'Égypte dans la Troade, par un Roi d'une de ces nations barbares qui habitent au-dessus de la Phénicie, peuples qui n'ont aucune connaissance en navigation, qui ne rendent aucun culte ni à Jupiter, ni aux autres Dieux. Décidé à s'embarquer, ce Prince impie, qui n'avait jamais navigué, se fit construire un grand vaisseau assez vaste pour y réunir tout l'attirail de ses jouissances. Dans une partie de ce vaisseau s'élevait un des plus beaux palais, orné de l'ameublement le plus riche. De ce palais on sortait dans un grand jardin (9), où étaient plantés, des pruniers, des poiriers, des pommiers, et des vignes. Dans une autre partie du vaisseau étaient les bains et le gymnase. Ailleurs étaient le laboratoire des aliments, et le logement des individus attachés à ce service. D'un autre côté étaient les petits appartements et les boudoirs des courtisanes. Plus loin les salles à manger, et tous les accessoires de la mollesse nécessaires aux habitants d'une ville adonnée au luxe. L'extérieur du vaisseau était plaqué d'or et d'argent, et émaillé des couleurs les plus variées. Ce vaisseau ressemblait parfaitement à un homme sans courage, auquel on aurait mis des armes d'or à la main. Les Égyptiens admiraient la beauté de ce spectacle. Ils convoitaient le bonheur de celui qui devait monter ce vaisseau. Chacun d'eux aurait désiré d'en être le pilote. Enfin le moment du départ arrive. Cet immense, ce magnifique vaisseau s'ébranle. Il quitte le port. On eût dit d'une ville flottante (10). Avec lui se mirent en marche les autres vaisseaux de transport construits et disposés à l'ordinaire pour le service auquel ils sont appropriés. Pendant que les vents furent favorables, les plaisirs régnèrent sur le vaisseau du Roi (11). Les parfums s'en exhalèrent de tous les côtés. « Autour de lui retentissaient les sons des flûtes et des hautbois, ainsi que les chants d'allégresse des navigateurs (12) ». Mais aussitôt qu'une rapide tempête eut pris dans les airs la place de la sérénité, et que les vents, pères des naufrages, se déchaînèrent avec beaucoup d'impétuosité, on reconnut alors à quoi servent les raffinements de la volupté, et quelle est l'utilité de la navigation. Tous les autres vaisseaux calèrent leurs voiles, luttèrent contre la tempête, soutinrent la fureur des vents, et échappèrent à tous les dangers. Tandis que le malheureux vaisseau du Roi fut ballotté dans les flots, comme l'est un homme d'une grande taille, à qui le vin a fait perdre la tête, et qui dans son allure se jette tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. Le pilote ne trouva dans son art aucun moyen qu'il pût mettre en oeuvre. La consternation et l'effroi se répandirent dans la foule des personnages perdus de luxe et de mollesse qui l'environnaient. La tempête mit en pièces tonte cette pompe, toute cette magnificence. « Elle couvrit les rivages de leurs immenses débris (13) ». Le palais, les ameublements, les bains, tout fut fracassé. On eût cru voir à la côte les ruines d'une ville entière ; « tandis que les infortunées victimes de ce naufrage flottaient au gré des vagues ; semblables à ces oiseaux de mer qui se font un jeu de se balancer ainsi sur les flots (14) ». Telle fut la catastrophe de ce Prince destitué de bon sens. C'est ainsi que périt ce vaisseau qui n'était pas susceptible de naviguer. Tel fut le résultat d'un luxe hors de saison (15). IV. Mais revenons au fond du sujet qui nous a donné occasion d'emprunter cette allégorie. Il y est en effet question, non d'une courte navigation, ni d'un voyage de quelques jours, dont nous ayons à supporter les fatigues. Mais de toute la durée de la vie, gouvernée par des voluptés non moins périlleuses que celles dont nous venons d'offrir le tableau. Qu'on ne se mette pas en frais pour nous persuader que la volupté est un bien. Mais qu'on s'efforce de nous persuader, si on le peut, qu'elle est un bien solide (16), et non sujet aux vicissitudes. Nous consacrerons toute notre vie à la volupté. Nous dirons adieu à la vertu, si l'on nous démontre que la volupté est stable et non mêlée de douleur, que la volupté n'est point sujette au repentir, que la volupté est digne d'éloges. Mais comment démontrera-t-on cela de la volupté ? On ne le démontrera pas plus que de la douleur. Car la nature n'a point voulu que l'homme éprouvât ces deux genres de sensations, sans mélange, sans promiscuité réciproque. Elle a au contraire partout allié les éléments de la douleur aux éléments de la volupté. Elle en a fait une amalgame. Il est donc de toute nécessité que celui qui éprouve la sensation de l'une, éprouve la sensation de l'autre. Elles naissent l'une de l'autre ; elles se suivent réciproquement. Elles se succèdent, elles se remplacent, elles se correspondent tour à tour. Continuellement flottante entre ce flux et reflux, comment l'âme serait-elle jamais dans un état exempt de douleur, lorsqu'elle ne jouit que de biens qui doivent bientôt lui être enlevés (17). Aussi me défié je de la mer, quoiqu'elle ne soit point agitée par les vents, quoiqu'elle présente l'aspect de la tranquillité. Je crains cette trompeuse apparence. Si l'on veut que je me confie à cette sérénité ; que l'on me conduise dans une mer pacifique, « où la tourmente n'exerce point ses fureurs, dans une mer inaccessible aux orages, sous un ciel pur et sans tempêtes (18) ». Telles sont les impressions dont rame a reçu la susceptibilité en partage. Tant qu'elle sera destituée de pilote, tant qu'elle manquera de l'art nécessaire pour se diriger, elle aura. beau voir la tranquillité sur les flots, elle ne sera point rassurée contre la crainte de la tempête ; et si la tempête l'agite, elle désirera la tranquillité. Car lorsque l'homme a de la propension à la volupté, et qu'il répugne à la douleur (19), sa vie est pleine d'incertitude, de terreurs paniques, de perplexités. La mobilité de la mer n'est qu'une faible image de la sienne. V. Voyez-vous les amants de Pénélope, comme ils se vautrent dans toutes les voluptés de la jeunesse, comme ils se gorgent de chèvres grasses, et de tendres chevreaux, comme ils charment leurs oreilles par le son des flûtes, comme ils se noient dans le vin, comme ils se plaisent à lancer le disque et à fendre l'air du javelot. A l'aspect de ces voluptés, qui ne les croirait heureux ? Mais voici le langage du devin, de celui dont la science plonge dans l'avenir : «Ah, malheureux ! quels sont donc les maux auxquels vous êtes en proie ? Une sombre nuit vous environne (20) ». Les malheurs approchent, ils sont déjà là. Les malheurs marchaient à la suite de cet Alexandre (21) qui vint dans le Péloponnèse enlever cette beauté rare dans la possession de laquelle il se promettait tant de volupté. Une flotte grecque fut soudain équipée pour voler sur ses traces, et cette flotte traînait après elle des maux infinis, prêts à fondre sur le ravisseur, et à exterminer sa patrie. Nous ne parlerons pas de cet Assyrien (22) qui fut dévoré en un moment par le feu, avec ses trésors et ses courtisanes. Nous ne parlerons pas non plus de ce Polycrate d'Ionie, qui finit par une mort ignominieuse (23). Sybaris aussi était pleine de voluptés. Mais ces voluptés périrent, avec les hommes efféminés qui en faisaient leurs délices (24). Les Syracusains également s'abandonnèrent à la volupté. Mais les malheurs qui furent les fruits de leur mollesse les en corrigèrent (25). Il n'en fut pas de même des Corinthiens (26). Si la volupté est un bien, elle n'est pas un bien solide (27). UN discours précédent, dont nous n'admettons pas la doctrine (28), avait pour objet de nous persuader que la volupté mériterait la préférence, si son alliance avec la stabilité était praticable. C'est le discours d'un sophiste, adroitement combiné pour nous induire en erreur. Il s'agissait de rechercher la nature de la volupté, jusqu'à quel point elle devait être mise au rang soit des biens, soit des maux. Or, il a dissimulé le véritable état de la question ; et regardant comme décidé que la volupté est un bien, il a recherché si elle est un bien solide. Mais quelle opinion avoir d'un bien essentiellement ondoyant (29) et variable ? Car de même, à mon avis, que prétendre que la terre n'est point stable et immobile, c'est dire, qu'elle n'existe pas (30) ; que soutenir que le soleil ne se meut point, ne roule point autour de la terre, c'est détruire son existence : de même, avancer que le bien n'est pas une chose fixe et permanente, c'est anéantir son essence. Car il n'en est pas du bien, comme de la beauté du corps, qui croît et se développe avec les années. Sous quel point de vue envisagera-t-on donc la volupté, si l'on accorde qu'elle est un bien, et si l'on nie qu'elle soit un bien solide ? Car s'il est de nécessité que ce qui est bien soit par cela même solide, le défaut de solidité rend la volupté incompatible avec le bien. Or, quelle est celle de ces opinions qui a le plus de droits à l'assentiment ? Celle qui prétend que la volupté est un bien, quoiqu'elle ne soit pas un bien solide ; ou celle qui soutient que la volupté n'est point un bien, si en même temps elle n'est pas solide ? Quant à nous, nous pensons que c'est la seconde. Car il vaut mieux nier qu'il y ait de la volupté dans un bien qui a d'ailleurs la solidité pour apanage, que d'admettre qu'il y ait du bien dans une volupté, de laquelle la solidité est séparée. II. Puis donc que le bien n'est pas absolument inséparable de la volupté, mais qu'il l'est de la stabilité, et que la volupté n'est point inséparable du bien, et qu'elle l'est de l'instabilité, il faut de deux choses l'une, ou que ceux qui s'attachent à la volupté négligent le bien, ou que ceux qui s'adonnent au bien, ne recherchent point la volupté. Or, je ne pense pas que rien de ce qui n'est pas bien, mérite d'être recherché. Mais sous des apparences extérieures de bien, ce qui n'est pas bien est recherché comme tel ; de même qu'auprès de ceux qui manient de l'argent, on fait passer des pièces fausses, non parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles cachent leur fausseté sous une extérieure ressemblance avec les pièces d'aloi. Or, en ce qui concerne les espèces monétaires, les essayeurs ont un art à l'aide duquel ils distinguent les mauvaises pièces des bonnes; et en ce qui concerne la dispensation des biens qui nous sont appropriés, nous avons la raison qui nous sert à discerner entre les biens, ceux qui n'en ont que la trompeuse apparence. Néanmoins, semblables à ces caissiers qui manient les espèces sans nulle notion de ce qui en constitue le bon aloi, nous ne nous apercevons point que nous ne grossissons notre trésor que de faux biens. III. Qui donc nous servira de guide dans cette recherche ? Comment opérerons-nous ce discernement? Le voici. Si quelqu'un entreprenait d'ôter un bœuf de sa charrue, et un cheval de son char, et que changeant le rôle de l'un et de l'autre, on attelât le bœuf au char, et le cheval à la charrue, ne serait-ce point renverser l'ordre de la nature, faire un outrage à chacun de ces animaux, montrer qu'on ignore à quoi les arts les appliquent l'un et l'autre, et les employer à un service aussi stérile que ridicule ? Et si l'on faisait quelque chose encore plus dénué de bon sens. Si l'on ôtait aux oiseaux leurs ailes, et qu'on voulût en faire des animaux pédestres ; si au contraire en donnant des ailes à l'homme, on le mettait à même de prendre son essor vers les régions éthérées, et de les fendre comme un oiseau, ne serait-ce pas la plus ridicule des métamorphoses, puisque la mythologie elle-même n'a pas permis à Dédale d'employer impunément un art aussi insensé, et qu'elle a précipité son fils, malgré ses ailes, du haut des airs dans les flots (31) ? On raconte qu'un jeune Carthaginois (32) prit à la chasse un lionceau à peine sevré (33), qu'il l'apprivoisa en le nourrissant avec d'autres aliments que ceux qui lui étaient naturels, et que par ce moyen il fit disparaître toute sa férocité, de manière qu'il le conduisait dans la ville chargé de fardeaux comme une bête de somme (34). Mais les Carthaginois, indignés de ce renversement de l'ordre de la nature, condamnèrent le jeune homme à la mort, sous prétexte que quoique encore dans une condition privée, il décelait du penchant pour la tyrannie. IV. De même donc que la nature a donné comme moyen de conservation et de salut, au cheval la course, au bœuf le labour, à l'oiseau les ailes, au lion la force, et aux autres animaux autre chose ; de même sans doute l'espèce humaine a reçu de la nature une faculté salutaire et conservatrice. Mais cette faculté doit être différente de chacune de celles des autres animaux, si l'homme rie doit trouver son salut et sa conservation, ni dans la force comme les lions, ni dans la course comme les chevaux, ni porter les fardeaux comme l'âne, ni labourer comme le bœuf, ni voler comme les oiseaux, ni nager comme les poissons. Il est une fonction qui lui est propre et particulière ; c'est de distinguer l'objet final de son existence (35). C'est cela même. Les facultés ont été distribuées aux animaux chacune à chacun, selon l'usage auquel ces facultés étaient destinées pour leur conservation. Ce qu'ils avaient à faire pour leur conservation a été proportionné à leurs facultés, et les organes de ces facultés ont été proportionnés aux fonctions qu'ils devaient remplir, et aux résultats conservateurs qu'ils devaient produire. En un mot, le bien de chaque animal dépend des procédés propres à l'espèce à laquelle il appartient : les procédés dépendent de la nécessité de l'usage; l'usage dépend de la facilité attachée aux facultés, les facultés dépendent de l'aptitude des organes, et les organes des variétés de la nature. Car la nature est très variée, et de là vient, qu'elle a muni, qu'elle a pourvu les animaux de chaque espèce pour défendre et conserver leur vie, les uns d'une sorte d'arme, les autres d'une autre. Elle leur a donné tantôt des ongles crochus, tantôt des dents affilées, tantôt des cornes robustes, tantôt de la vitesse, tantôt de l'intrépidité, tantôt du venin. Elle n'a au contraire fourni à l'homme aucune de ces ressources. Elle l'a fait nu, délicat, sans défense extérieure contre les impressions de l'air, dénué de vigueur, lent à la course, incapable de voler, inhabile à la nage. Mais elle a infusé dans sa substance pour veiller à sa conservation une invisible étincelle que l'homme appelle intelligence, qui fait seule tout ce qu'il faut pour le conserver, qui pourvoit à tous ses besoins, qui remédie à tous les maux qui l'atteignent ou qui le menacent, qui lui tient lieu de tout ce que les autres animaux ont reçu pour la même fin, qui lui donne l'empire sur tous les êtres qui l'environnent, qui les soumet tous aux résultats de sa raison et à ses lois. V. Interrogez-moi maintenant sur le compte de l'homme. Comment nous y prendrons-nous pour rechercher en quoi consiste son bien Nous répondrons ce que nous avons répondu du lion, des oiseaux, et des autres animaux. Cherchez le bien de l'homme dans les choses qui constituent les fonctions qui lui sont propres. Mais où trouverons-nous ces fonctions ? Là où en est l'organe. Mais où trouverons-nous cet organe ? Là où est ce qui conduit l'homme à sa véritable fin. Partons de là : or, qu'est-ce qui conduit l'homme à sa véritable fin ? La volupté ? Mais vous parlez là d'une chose commune, appropriée à toutes les espèces d'êtres, et dont par cette raison je n'admets point la prérogative. Le bœuf, l'âne, le pourceau, le singe, ont chacun leur volupté. Voyez dans quelle classe vous rangez l'espèce humaine. Voyez quels associés vous lui donnez sous ce rapport-là. Mais si la volupté est le principe conservateur, cherchez après elle quel est son organe. Vous y trouverez une singulière variété. Et ces organes, hors les yeux et les oreilles, ne méritent que le mépris. Mais si nous allons plus avant, et que nous jetions nos regards sur les routes de la volupté, voyez quels sont les organes, chargés des honneurs de notre conservation. Avons-nous trouvé les organes, considérons les fonctions. Ce sont un palais qui dévore (36), des yeux brillants qui s'amortissent, des oreilles que le charme entraîne. Ce sont toutes les jouissances des Apicius, ce sont toutes les lubricités des Sardanapales (37). En trouvant les fonctions, vous avez trouvé le bien. Et ce serait là, conserver ! Et ce serait là, être heureux ! La Volupté est un bien, mais elle n'est pas un bien solide. ÉSOPE, le Phrygien, a écrit des Fables où il fait converser les bêtes entre elles. Quelquefois dans le même dialogue on voit figurer des arbres, des poissons, et des hommes. Mais dans ces discours sont enlacés des traits succincts de bon sens, où quelque vérité est enveloppée. Voici une de ces Fables. Un lion poursuit une biche. Celle-ci se sauve en fuyant, et se cachant dans l'épaisseur d'un hallier. Le lion, qui a plus de force que la biche, mais moins de vitesse, arrive auprès du hallier, et demande à un berger s'il n'a point vu une biche se cacher dans les environs. Le berger répond qu'il n'a rien vu ; et tout en faisant cette réponse, il indique de la main le hallier au lion. Celui-ci s'y jette, et la malheureuse biche est sa proie. Un renard, car chez Ésope les renards montrent beaucoup de sagesse, s'adresse au berger et lui dit : « Comme tu es à la fois lâche et méchant : lâche envers les lions, et méchant envers les biches (38) ». II. Il me paraît qu'Épicure pourrait faire usage de cet apologue Phrygien contre le détracteur de la volupté, qui dans ses discours parle en homme, mais dans ses affections indique la volupté comme de la main. Où est l'homme assez ennemi de lui-même pour écarter spontanément la seule des choses humaines, qui a pour lui de si puissants attraits ? Car toutes les autres choses auxquelles l'homme s'attache, ou il les recherche lorsqu'il en a fait l'expérience, ou il les estime, lorsqu'il les a mises à l'épreuve, ou il croit à leur mérite, lorsque la raison lui en a fait connaître le prix, ou il en fait l'objet de son affection, lorsqu'elles ont soutenu la pierre de touche du temps. Tandis que la volupté n'entre point dans le creuset de la raison. Elle est plus ancienne que tous les arts. Elle anticipe sur l'expérience. Elle n'attend pas l'épreuve du temps. Le goût qu'elle inspire, est l'ouvrage même de la nature. Ce goût naît et commence avec la vie. Il est comme une sentinelle placée autour de l'être vivant pour le conserver (39). Ôtez la volupté, vous ôtez l'existence à l'être qui vient de la recevoir. Car ce n'est qu'à la longue que l'homme, à l'aide du jeu insensible et réciproque des sensations et de l'expérience, développe eu lui-même la science, la raison et l'intelligence (cette faculté à laquelle on attache tant d'intérêt) et qu'il augmente leur intensité. Tandis que du moment où il vient au monde, il apprend de la nature et de lui-même tout ce qu'il doit savoir de la volupté (40). Autant il est l'ami de la volupté, autant il est l'ennemi de la douleur. La volupté tend à le conserver ; et la douleur tend à le détruire. III. La volupté une chose méprisable Mais notre amour pour elle ne serait point inné. Elle ne serait point dans tous les temps l'agent fondamental de notre conservation. Quant à ces sujets de déclamation que les Sophistes ont accumulés contre elle, le luxe de Sardanapale, les délices de la Médie, la mollesse de l'Ionie, la somptuosité de table de la Sicile, les mœurs efféminées de Sybaris, les courtisanes de Corinthe, et autres tableaux de même nature ; ce ne sont point là les oeuvres de la volupté. Ce sont les oeuvres des arts et de l'industrie humaine, lorsque dans la succession des temps l'opulence et la profusion des biens eurent porté l'homme à sortir des limites naturelles de la volupté. De même donc que nul ne s'avise de faire la guerre à la raison, en l'accusant de n'être point une chose belle de sa nature, sous prétexte qu'il est des individus qui en appliquent l'usage à des choses qui ne sont point belles de leur nature ; de même il ne faut point faire le procès à la volupté, mais à ceux qui en abusent. L'âme de l'homme étant susceptible de ces deux choses, la volupté et la raison, si la volupté se mêle à la raison sans rien ôter aux besoins de la nature auxquels elle tient, elle donne à ces derniers tout l'attrait dont ils sont capables. Mais si la raison s'allie à la volupté, et que l'opulence fasse sortir cette dernière de ses limites naturelles, elle ôte aux besoins de la nature ce que la nature avait attaché de plaisir à les satisfaire (41). IV. Mais, dira-t-on, la volupté n'est pas uniquement propre à l'homme. Elle lui est commune avec tous les autres animaux. Vous n'aimez donc pas que la nature l'ait regardée comme la dépositaire la plus fidèle de la conservation de tout ce qui vient à la vie. Ou bien, êtes-vous choqué de la promiscuité (42) de ses fonctions ? O l'étrange espèce de cupidité Vous n'aimez donc pas la lumière du soleil, parce qu'elle est commune à tous les êtres qui ont des yeux. Il fallait donc que l'homme eût exclusivement le don de la vue ; à défaut, vous n'accorderez point que la lumière soit un bien pour lui ; non plus que l'air, que tous les corps respirent, et qui, par cette respiration, entretient leur existence ; non plus que le cristal des fontaines (43) ; non plus que les fruits de la terre. Poussons plus avant dans le cercle des choses nécessaires. Elles sont toutes communes à tous les êtres. Nulle n'est exclusivement propre à nul d'entre eux. Plaçons donc la volupté dans ce cercle, comme un bien commun chargé de la conservation de tous les êtres sensibles. V. Mais puisque la vertu est intéressée dans cette dissertation sur la volupté, à Dieu ne plaise que nous nous permettions contre la vertu aucune agression. On peut d'ailleurs discourir sur la volupté sans amertume et sans fiel. Nous dirons seulement, que séparer la volupté de la vertu, c'est rendre cette dernière impossible. Ôtez la volupté attachée aux belles actions, elles ne seront plus recherchées. Celui qui travaille pour la vertu travaille spontanément. Il travaille par amour pour une volupté présente ou attendue. De même que dans les comptoirs, nul « de ceux à qui les Dieux n'ont point ôté le bon sens (44) », n'échange sciemment un talent contre une drachme, ni de l'or contre de l'airain, et qu'il faut, au contraire, quoique une sorte d'égalité doive régner dans cet échange, que chacune des deux parties, entre lesquelles l'échange a lieu, y trouvent respectivement leur avantage ; de même, sans doute, en ce qui concerne les divers genres de travaux, nul ne s'y livre par affection intrinsèque pour le travail. Car ce serait l'affection du monde la plus malentendue. Mais chacun a pour but d'échanger le travail du moment contre du beau, pour parler le langage vulgaire ; et contre de la volupté, pour parler le langage de la vérité. Or, dire du beau, c'est dire de la volupté. Car le beau ne serait point beau, si la volupté n'était pas un des éléments les plus intimement inhérents à son essence. VI. Quant à moi, je tiens aussi pour cette opinion contraire à l'autre; et ce qui prouve, à mon sens, que la volupté est de toutes les choses celle qu'on désire le plus (45), c'est qu'on ne craint pas de s'exposer pour elle à des fatigues, à des blessures, à la mort, et à toute sorte de maux. Car, quoiqu'on fasse varier les noms qu'on donne aux causes de ces effets divers, et qu'on appelle le sentiment qui fait courir Achille à la mort, pour venger la mort de Patrocle, amitié ; la passion. qui porte Agamemnon à supporter de longues veilles, à être toujours le premier rendu au Conseil, à jouer le premier rôle dans toutes les opérations militaires, autour de l'Empire ; l'ardeur qui pousse Hector à être continuellement à la tête des Troyens, à figurer dans la première ligne des combattants, à faire des actions de courage, amour de la Patrie ; tout cela n'est que donner des noms différents à la volupté. Car, de même que dans les maladies du corps, les malades souffrent le fer et le feu, la faim et la soif, supportent sans répugnance les choses les moins supportables de leur nature, et cela dans l'espérance de recouvrer leur santé (46) ; et qu'ôter la perspective du bien qu'on espère, c'est anéantir le courage qui fait braver le mal présent : de même dans les actions humaines, il se fait un échange de peines et de travaux pour de la volupté. Cet échange, on l'appelle Vertu. A la bonne heure ; je passe cette expression, mais je demande : « L'âme se porterait-elle vers la vertu, abstraction faite de l'affection qu'elle a pour elle » ? Car admettre l'affection, c'est admettre la volupté. VII. Qu'on change les dénominations ; que la volupté soit appelée la joie, peu m'importe la multiplicité des noms. Je vois la chose (47) ; je reconnais la volupté. Pensez-vous qu'Hercule, qui entreprit de si nombreux et admirables travaux, qui s'endurcit aux fatigues, qui se familiarisa avec les périls, qui livra des combats aux bêtes féroces, qui extermina partout les tyrans (48) sur son passage, qui se fit un plaisir de détruire les brigands, qui répandit la sécurité sur ses traces, qui signala son courage sur le mont Oeta, qui s'étendit lui-même sur le bûcher destiné à le réduire en cendres ; pensez-vous qu'il eût un autre motif que celui de ces sublimes, de ces admirables, de ces pures voluptés, dont il savourait les unes au milieu même de ses labeurs, dont les autres devaient l'en récompenser un jour. Pensez-vous qu'il se soit spontanément dévoué à de si grandes choses ? Mais votre attention ne se fixe que sur le côté pénible et périlleux des travaux d'Hercule, sans considérer les voluptés qui les accompagnaient, d'après les affections dont il était susceptible Hercule trouvait de la volupté à faire ces grandes choses ; et il ne les faisait que par cette raison. Il ne les aurait point faites, s'il n'avait point dû y trouver de la volupté. Bacchus aussi trouvait de la volupté au milieu de ses fêtes, au milieu de ses bacchanales nocturnes, au milieu des danses, des airs de flûte, des chansons dont elles se composaient. Tel était le genre des voluptés de Bacchus, au milieu de ses mystiques orgies. VIII. Mais pourquoi parler de Bacchus et d'Hercule? Ils appartiennent à la mythologie, aux teins héroïques. Adressons-nous à Socrate. « O Socrate, vous êtes éperdument amoureux d'Alcibiade, après Alcibiade, de Phèdre, après Phèdre, de Charmide. Vous êtes éperdument amoureux, ô Socrate ; et il n'est point dans toute l'Attique de beau garçon que vous ne connaissiez. Allons, confessez-nous la cause de cet amour, et ne craignez pas qu'il y ait à cet aveu aucune infamie. Il est possible, en amour, d'allier la pudeur avec la volupté, comme il est possible d'unir la douleur à une passion impudique. Mais, si vous séparez la volupté de l'amour, si vous n'aimez que sous le rapport de l'âme, sans aimer sous le rapport du corps, aurez-vous de l'amour pour Théoetète ? Non, car il est camus. Aurez-vous de l'amour pour Choerephon ? Non, car il a une figure cadavéreuse. Aurez-vous de l'amour pour Aristodème ? Non, car il est tout disgracié de la nature. Qui donc aimerez-vous ? Celui qui se distingue par sa chevelure ; qui, à la fleur de l'âge, étale toutes les grâces de l'élégance, tous les charmes de la beauté. Votre vertu me répond, d'ailleurs, que cet amour est exempt de toute souillure. Mais votre âme me répond aussi que vous alliez la volupté à l'amour ». Car je ne doute pas non plus des impressions de volupté que l'action de la chaleur produit sur le corps, que la lumière du soleil produit sur la vue, que le son des flûtes produit sur l'ouïe, que les leçons des Muses produisent sur Hésiode, que les inspirations de Calliope produisent sur Homère, que la lecture d'Homère produit sur Platon, en donnant de l'élévation, de la grandeur à son âme. Toutes ces choses, les yeux, les oreilles, les corps, les esprits, sont entraînés par l'attrait de la volupté. IX. Ce fut aussi la volupté qui conduisit Diogène dans un tonneau. Que la vertu ait également contribué à l'y conduire, à la bonne heure. Mais pourquoi regarderait-on la volupté comme inconciliable avec la sagesse ? Diogène se trouvait aussi bien dans son tonneau, que Xerxès à Babylone. Il était aussi content de son pain sec, que Smindyride de la chère la plus raffinée. Il avait autant de plaisir à boire I'eau de la première fontaine qui lui tombait sons la main, que Cambyse en pouvait avoir en buvant exclusivement de l'eau du Choaspe (49). II se délectait de l'aspect du soleil, autant que Sardanapale du spectacle de sa magnificence. Il aimait autant son bâton, qu'Alexandre pouvait aimer sa lance. II se complaisait dans sa besace, autant que Crésus dans ses trésors. Et si l'on compare voluptés à voluptés, celles de Diogène l'emportent sur celles des autres. Car la vie des personnages que je viens de nommer paraît bien n'être qu'un tissu de voluptés. Mais les filaments de la douleur y sont partout enlacés. Xerxès vaincu s'abandonne au désespoir : Cambyse blessé pousse des gémissements : Sardanapale pleure au milieu de son palais en flamme : Smindyride est inconsolable d'avoir été éconduit (50) : Crésus prisonnier ne fait plus que verser des larmes : Alexandre tombe dans la langueur lorsqu'il ne voit plus de nations à combattre : tandis que les voluptés de Diogène sont inaccessibles à la désolation, aux gémissements, aux larmes, à la douleur. Mais ces voluptés de Diogène on les appelle des privations. On juge donc de Diogène par soi-même. Jugement insensé ! A vivre comme il vivait, on se croirait très à plaindre. Diogène, au contraire, y trouvait sa volupté. J'oserai même dire davantage, que nul n'a mieux entendu que Diogène l'amour de la volupté. Il ne fut point chargé d'un ménage. L'économie domestique a ses peines. Il ne s'immisça point dans les fonctions publiques. C'est une chose fertile en désagréments. II ne s'engagea point dans les liens du mariage. Il savait des nouvelles de Xantippe (51). II ne s'exposa point à avoir des enfants à élever. Il connaissait l'histoire de Clinias (52). Mais. exempt d'inconvénients de tout genre, d'asservissement, de sollicitude, de crainte, de douleur, il était dans tous les lieux de la terre, comme dans une maison identique. Seul entre les hommes, il sut s'assurer des voluptés autour desquelles il n'eut pas besoin d'élever des rem-parts pour les défendre contre les atteintes des vicissitudes humaines. X. Quittons Diogène ; passons aux Législateurs, et considérons les corps politiques. Ne pensez pas. d'ailleurs que je me dirige vers Sybaris, que je rappelle ni les Syracusains, que leur mollesse a rendus célèbres, ni les Corinthiens adonnés à toutes les voluptés, ni les habitants de Chio, renommés pour leur opulence, ni ceux de Lesbos, qu'on vante comme les premiers buveurs, ni ceux de Milet, fameux pour la richesse de leurs vêtements. Je ne m'occupe que des peuples qui ont tenu le premier rang sous le rapport politique, des Athéniens et des Spartiates. Chez ces derniers, je vois des flagellations, des blessures, les pénibles exercices de la chasse, de la course, la frugalité dans les repas, la mise la plus grossière. Mais je vois la volupté attachée à toutes ces choses. A merveille Lycurgue, tu compenses de médiocres peines par de grandes voluptés. Tu donnes peu, et tu recueilles beaucoup. Tu imposes des travaux éphémères, et tu en fais résulter des voluptés continues, Mais, dira-t-on, en quoi consistaient donc les voluptés des Spartiates ? Elles consistaient à n'avoir point de murailles autour de leur ville, voir la sécurité régner autour d'elle, à ne pas craindre qu'une flamme ennemie vint dévorer ses maisons, à la défendre de l'aspect d'hostiles phalanges, et de boucliers étrangers, à la maintenir inaccessible aux cris de douleur et aux violences que produit la guerre. Or, qu'y a-t-il de plus cruel que la crainte, de plus accablant que la servitude, de plus révoltant que la nécessité ? En éloignant toutes ces choses de ta Cité, tu as mis à la place des voluptés en grand nombre. Les nourrissons de ces voluptés furent Léonidas, Othryade, Callicratidas (53). Mais ces Spartiates sont morts; - ouï, mais ils sont morts avec gloire ; - et pour quels motifs ? - pour ces voluptés. On mutile le corps dans ses membres pour la conservation du tout. Or, Léonidas était à Sparte, ce qu'un membre est au corps ; et il mourut pour elle. II en fut de même d'Othryade et de Callicratidas. Ainsi, du sacrifice de quelques membres d'une médiocre importance résultait le salut des voluptés de tous les citoyens. Que dirons-nous des Athéniens ? Dans l'Attique on ne voyait que fêtes, qu'expansion de joie, d'allégresse. Chaque saison de l'année avait chez eux son apanage de voluptés. An printemps, c'étaient les fêtes de Bacchus; en automne, celles des Déesses Eleusines. Les autres Dieux avaient distribué dans les autres saisons, les Panathénées, les Skirophories, les Aloes, les Apatouries (54). Tandis qu'une partie des citoyens d'Athènes livre des batailles navales, le reste célèbre des fêtes dans les Cités de l'Attique. Tandis que les uns sont en campagne sur le continent, les autres prennent leurs ébats au milieu des bacchanales. Mais la guerre elle-même, la chose du monde la moins agréable, n'est pas sans avoir ses voluptés. On y entend la trompette tyrrhénienne qui donne le signal de se ranger en bataille, la flûte qui bat la cadence pour les rameurs, les hymnes guerrières qui sonnent la charge. Vous voyez combien sont nombreux les divers genres de volupté.
NOTES.
(1)
Il faut entendre ce mot dans le sens de généralité et d'abstraction
didactique que lui donnent les anciens philosophes, et le regarder comme
synonyme de toutes les jouissances physiques en général, ou de chacune en
particulier.
Paris, le 11 pluviôse an IX. (31 janvier 1801. ) NOTES.
(27)
Heinsius traite d'inepte le titre de cette Dissertation. Selon lui, elle devait
être intitulée à peu près ainsi : « La volupté n'est pas la véritable fin
de l'homme ». Ce titre lui conviendrait mieux en effet. Paris, le 22 pluviôse an IX. (11 février 1801.) NOTES
Paris, le 2 germinal an IX. (23 mars 1801.) |