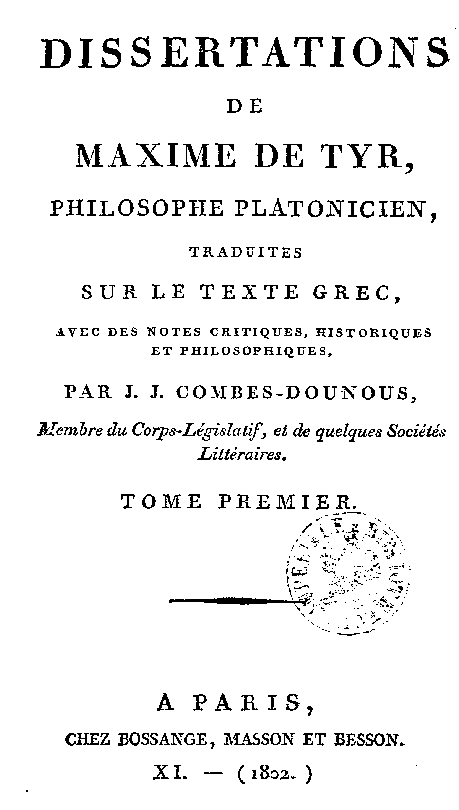|
MAXIME DE TYR
DISSERTATIONS
PRÉFACE DU
TRADUCTEUR.
ENTRE les divers systèmes de la philosophie des Anciens, il n'en est point qui approche plus de la vraie sagesse, que celui de Socrate et de Platon. Il n'en est point qui, par le développement des principes de la droite raison, et des notions des lumières naturelles, ait mieux posé les véritables bases de la morale, ait mieux démontré l'existence et l'unité de DIEU.
Tel est le motif fondamental de la prédilection qu'a obtenue, et qu'obtiendra,
dans tous les siècles, la philosophie de Platon, chez tous les hommes amis des
lettres et des connaissances solides. II est difficile d'étudier cette
philosophie, sans se passionner pour elle. Il est impossible de s'y
affectionner, sans regretter que les monuments qui la recèlent, écrits dans
une langue savante, soient inaccessibles au plus grand nombre des lecteurs.
J'avoue que je n'ai pu me défendre de ce sentiment de regret, en lisant les
Dissertations du philosophe Platonicien dont j'ai osé entreprendre une
traduction nouvelle. Partageant l'admiration qu'il a inspirée aux amateurs du
Platonisme, j'ai désiré de pouvoir le lire plus à mon aise, et sans éprouver
la fatigue de cette contention d'esprit qu'exigent toujours les originaux des
langues mortes. J'ai dû faire entrer dans cette considération l'intérêt de
ceux qui se plaisent à cultiver le même genre de connaissances, et céder
alors aux encouragements qu'ont daigné me donner quelques amis des lettres
anciennes, et notamment les deux savants Hellénistes qui ont annoncé, l'année
dernière, ma traduction d'Alcinoüs ; l'un, dans le quatrième numéro de la
Bibliothèque-Française, et l'autre, dans le Magasin-Encyclopédique de
brumaire an 9, n°. 11. Le premier, le Cit. Sainte-Croix, m'a fait l'honneur de
me « croire très capable de donner une bonne traduction de tous les Discours
de Maxime de Tyr ». Le second, le Cit. Marron, après avoir dit que Maxime de
Tyr avait été assez négligemment traduit par Formey, a fut espérer que la
nouvelle Traduction que j'en préparais serait plus élégante et plus exacte.
Je serai trop heureux, si le Public et les Critiques qui me jugeront, pensent
que j'ai fait un peu mieux que les deux Traducteurs qui m'ont précédé. Or, c'est peut-être aujourd'hui, plus que jamais, le moment de fixer l'attention des hommes sur ces deux bases de toute organisation sociale, sur ces deux pivots de tout bonheur public et privé. Placés entre les plus formidables ennemis de l'espèce humaine, l'Athéisme prétendu philosophique, et le Fanatisme religieux, dont l'un travaille à inoculer de toutes parts sa pestilentielle doctrine, tandis que l'autre s'efforce de rétablir sourdement cet épouvantable empire qui a coûté au Monde tant de calamités, tant de catastrophes, et tant de sang, il nous importe d'arrêter la marche, et de barrer les progrès de ces deux fléaux de la terre. « Philanthropes, Philosophes, amis de la liberté, zélateurs de la propagation des lumières et des succès de la raison, unissez-vous; liguez-vous ; confédérez-vous ; formez une sainte coalition pour le bonheur de l'humanité. Empêchez les modernes Diagoras de la philosophie d'accréditer ce funeste système, qui tend à rompre la chaîne d'or par l'intermédiaire de laquelle, selon la brillante allégorie de l'Épique Grec, la Terre est suspendue au trône de l'Éternel ; à saper les mœurs publiques et les mœurs privées dans leur base ; à détruire tous les liens de la sociabilité ; à ôter aux tyrans armés du pouvoir le seul frein capable de suppléer à l'impuissance des lois, et aux infortunés jouets de leurs iniquités et de leurs caprices l'unique consolation qui puisse leur faire préférer les conseils de la résignation aux impulsions du désespoir. Mais, en même temps, opposez tous vos efforts aux modernes Diagoras du Sacerdoce ; empêchez, s'il est possible, le retour de cet autre système, non moins funeste, non moins ennemi des mœurs, non moins destructeur des fins sociales, qui n'a que trop longtemps comprimé la raison humaine sous le poids de la plus honteuse servitude, et de l'abrutissement le plus absolu, et qui, entre les mains de ses hypocrites et fanatiques Coryphées, ne semble propre qu'à faire dégénérer ce qui devrait être un Pacte entre Dieu et l'Homme, en un Pacte entre l'Homme et les Esprits Infernaux. Ce but salutaire, vous ne le remplirez, ce résultat philanthropique, vous ne l'obtiendrez qu'en élevant autour de ces vérités éternelles, qui sont empreintes en caractères ineffaçables dans l'imposant aspect du firmament et dans la conscience de l'homme, cette masse de principes lumineux contre laquelle viennent se briser toutes les tentatives de l'Athéisme, et tous les efforts de la Superstition. Ce n'est qu'en répandant, qu'en mettant à la portée de tous les esprits raisonnables et de bonne foi les productions de la vraie, de la saine philosophie, les ouvrages qui, comme les Dissertations de Maxime de Tyr, rattachent les principes élémentaires de la morale, à la doctrine de l'existence et de l'unité de Dieu, que vous défendrez la Raison des pièges, des entreprises de ses deux antagonistes ; et que, trompant les vœux qu'ils forment, et brisant les ressorts qu'ils ne cessent de mettre en oeuvre pour la faire rétrograder, vous assurerez sa marche, vous protégerez ses progrès, jusqu'au moment où l'universalité de l'espèce humaine ne connaîtra plus d'autre empire que le sien ». Revenons. Afin de laisser le moins possible à désirer, sur le compte de l'Orateur philosophe, que j'offre aux amis de la philosophie et de l'art oratoire, je dirai d'abord ce qu'on peut savoir de plus certain touchant sa personne. Je parlerai ensuite des diverses éditions qui ont été faites de son ouvrage, ainsi que de ses versions latines, et des manuscrits de la Bibliothèque nationale qui le concernent. Je passerai de là aux traductions françaises qui en ont été publiées, la première, en 1617, par Guillebert, Bibliothécaire d'un Conseiller au ci-devant Parlement de Rouen ; la seconde, en 1764, par Formey, membre de l'Académie de Berlin. Je finirai par quelques observations sur le caractère particulier des Dissertations de Maxime de Tyr, et sur les principes que j'ai cru devoir suivre en le traduisant. I Maxime de Tyr, ainsi que l'indique l'espèce de surnom avec lequel son nom est venu jusqu'à nous, était originaire de cette célèbre ville de l'antiquité, qui était la métropole de la Phénicie, dans un temps où les Phénicien s’étaient eux-mêmes, si l'on peut s'exprimer ainsi, les Métropolitains du Monde. On ignore à quel âge, et par quelle raison il en sortit, pour venir s'établir dans la Grèce, où il paraît, comme nous le dirons bientôt, qu'il passa la plus grande partie de sa vie. Le plus ancien des livres où se trouve mentionné notre Auteur, sous sa propre dénomination, c'est la Chronique d'Eusèbe de Césarée, ouvrage si précieux pour nous guider au travers des ténèbres chronologiques de l'Antiquité. Entre la neuvième et la dixième année du règne de Marc-Antonin, époque correspondante à la 231e. Olympiade, et à l'an 170 de l'Ère chrétienne, Eusèbe s'exprime ainsi : « Alors florissaient Arrien le philosophe, de Nicomédie, Maxime de Tyr; Apollonius le Stoïcien, de Chalcis, Basilide, de Scythopolis, qui furent les instituteurs de l’'Empereur Verissimus (1) ». Nous remarquerons, en passant, que c'est sous ce nom de Verissimus que Marc-Antonin fut connu dans sa jeunesse, pendant qu'il vécut à la cour d'Adrien, et jusqu'à l'âge de quinze ans qu'il prit la robe virile. Syncelle, Auteur Grec du huitième siècle, n'a fait que copier dans sa Chronographie, p.351, le passage d'Eusèbe, si ce n'est qu'il ne parle point d'Arrien le philosophe ; et qu'à la marge de l'exemplaire de cet Auteur, déposé à la Bibliothèque nationale, on lit le mot Platonicien, qui se rapporte à Maxime de Tyr. C'est sur la foi de ces deux passages, et principalement de celui de la Chronique d'Eusèbe, que le savant Joseph Scaliger (2), dans ses annotations sur cet ouvrage de l'Evêque de Césarée, a pensé que Maxime de Tyr avait été du nombre des instituteurs de Marc- Antonin. Il paraît que Marc-Antonin lui même a contribué à induire ce docte critique en erreur. En effet, dans le premier livre de ses réflexions morales, cet Empereur paye un juste tribut d'éloges aux grands hommes qui avaient coopéré à son éducation ; et il dit du dernier d'entre eux ; « Maximus (3) m'a fait voir qu'il faut être le maître de soi-même, et ne se laisser jamais emporter à ses passions; conserver du courage dans les maladies et dans tous les accidents de la vie les plus fâcheux ». A la fin de ce même livre, Marc-Antonin remercie les Dieux de ce qu'il « a connu Apollonius, Rusticus et Maximus ». Quoique ce Prince philosophe ne distingue nullement, dans aucun de ces deux passages, le Maximus dont il parle ; le passage d'Eusèbe rapproché de ceux des Réflexions morales de Marc-Antonin, a paru si péremptoire à Scaliger, qu'il ne s'est pas même défié de son opinion. Entraînés par son autorité, ou trompés comme lui, un grand nombre de modernes ont propagé cette erreur. On la retrouve, en effet, dans l'ouvrage curieux de Jonsius, qui a pour titre, De Scriptoribus Historiae philosophicae, lib. III, cap. 9 ; dans l'Histoire ecclésiastique de J. Capelle ; dans la première annotation de Daniel Heinsius, sur le titre de l'ouvrage de notre Auteur ; dans le second volume de l'Histoire des Empereurs par Tillemont ; dans l'ouvrage de Gaspar Barthius, intitulé, Adversariorum commentariorurn, lib. 1, cap. 9 ; dans l'Histoire des Empereurs par Crevier; et dans le Dictionnaire des Hommes Illustres, à l'article Maxime de Tyr. Qu'un érudit, comme Scaliger, qui n'avait pas toujours le temps nécessaire pour consulter tous les monuments de l'Antiquité propres à constater un point de fait, s'en soit trop légèrement rapporté à une identité de nom ; c'est une inadvertance qui lui doit être pardonnée. Mais il faut montrer de la sévérité à Fédéric Morel, an sujet de l'étrange bévue où il est tombé, touchant notre philosophe. Morel, savant homme d'ailleurs, Imprimeur célèbre, et à qui les Lettres anciennes ont, à ce titre, de grandes obligations, en imprimant son Libanius, a mis à la tête des Oraisons de ce Rhéteur, ce qu'on appelle, en style classique, des arguments, c'est-à-dire, des espèces d'abrégés, de sommaires ; et, dans un de ces arguments, il a confondu notre Maxime de Tyr avec un Maximus, précepteur de l'Empereur Julien, ce Prince illustre, que les philosophes modernes ont vengé de l'ignominie qu'avaient voulu répandre sur lui les coryphées du fanatisme, en le surnommant l'Apostat. Cet anachronisme est d'autant plus grave, que le règne d'Antonin-le-Pieux, sous lequel est placé notre Auteur, dans la Chronique d'Eusèbe, est séparé du règne de Julien par un intervalle de deux siècles ; et que Suidas a fait deux articles bien distincts, et bien séparés, de ces deux Maximus. En effet, Suidas dit de l'un qu'il était de Tyr, de l'autre qu'il était de l'Épire, ou de Byzance ; de ce dernier, qu'il fut le précepteur de Julien, et du premier, qu'il vint à Rome sous le règne de Commode. Cet anachronisme une fois admis, Fédéric Morel est tombé dans une autre méprise, au sujet de notre Auteur. Libanius, dans la dix-neuvième de ses Oraisons, parle d'un sophiste de Tyr, qui prononça l'Oraison funèbre d'un sophiste d'Antioche, nommé Pâris. Libanius fait d'ailleurs un grand éloge de ce Rhéteur Tyrien ; car il compare les effets de son éloquence à Neptune, faisant tout céder à la puissance des flots. Fédéric Morel a pensé que ce sophiste pouvait être Maxime de Tyr. Loin donc de propager les erreurs de Scaliger et de Morel, je vais démontrer, sans m'étendre davantage sur les inadvertances de ce dernier érudit, que notre philosophe n'a point été du nombre des instituteurs de Marc-Antonin, et qu'il n'est point le Maxime dont cet Empereur fait mention dans ses Réflexions morales. Et d'abord, je remarque qu'à la manière dont Marc-Antonin s'énonce sur le compte de ce Maxime, au genre d'obligation qu'il dit lui avoir, il désigne formellement un philosophe Stoïcien, et non pas un Platonicien. « Maximus, dit-il, m'a fait voir qu'il faut être maître de soi-même, et ne se laisser jamais emporter à ses passions : conserver du courage dans les maladies, et dans tous les accidents fâcheux de la vie. Il n'admirait jamais rien (4), il n'était jamais surpris ni étonné de rien ». Or, n'est-ce pas là le langage de cette philosophie qui faisait consister le bonheur du Sage selon ses principes, dans une parfaite impassibilité, dans cette situation de l'aime si bien exprimée par les mots techniques qu'elle a spécialement consacrés à cet effet, savoir, l'apathie, l'ataraxie, dans leur acception étymologique (05). Ajoutons qu'un peu plus bas, Marc-Antonin, que les Stoïciens ont d'ailleurs toujours compté parmi leurs premiers coryphées, rend grâces aux Dieux de lui avoir fait connaître « Apollonius, Rusticus et Maximus » ; accolant ainsi les trois Stoïciens, dont les leçons lui avaient été si utiles. Or, si l'on doutait qu'Apollonius et Rusticus fussent eux-mêmes des Stoïciens, la conviction devrait résulter du genre d'instruction que Marc-Antonin, qui leur paye le même tribut de reconnaissance qu'à Maximus, reconnaît, dans son ouvrage, avoir reçu de ces deux philosophes. Nous ferons remarquer, de plus, que le premier, Apollonius, est nominativement signalé comme Stoïcien par le passage de la Chronique d'Eusèbe, que nous avons cité plus haut; que l'historien Julius-Capitolinus, dont nous invoquerons tout-à-l'heure le témoignage touchant Maximus, dit formellement, comme la Chronique d'Eusèbe, que cet Apollonius était Stoïcien : usus est Apollonio, Chalcedonico, Stoico philosopho. Nous remarquerons ensuite que le second, Rusticus, outre qu'il est également qualifié de Stoïcien par le même historien latin, serait d'ailleurs suffisamment caractérisé comme tel par Marc-Antonin lui-même, qui nous apprend que Rusticus lui donna et lui fit connaître le Bréviaire des Stoïciens, c'est-à-dire, le célèbre Manuel d'Épictète. Qu'on ne pense pas, au surplus, qu'il fût aisé, dans ces temps-là, comme il pourrait l'être aujourd'hui, de confondre un Stoïcien avec un Platonicien. Le Portique et l'Académie avaient sans doute plusieurs points de contact, beaucoup de principes identiques ; mais ils avaient aussi leurs principes de dissentiment, et leurs points de divergence. Marc-Antonin doit donc être d'autant moins présumé capable d'avoir confondu un Platonicien avec un Stoïcien, que, Stoïcien lui-même, il connaissait, autant que personne, la différence qui existe entre l'un et l'autre ; et qu'à peu près de son temps, un philosophe nommé Taurus, avec lequel Aulu-Gelle, l'intéressant Auteur des Nuits Attiques, eut d'étroites liaisons, avait publié un Traité ex professo sur cette matière, ainsi que ce dernier nous l'apprend, dans le chap. 5. du douzième livre de son ouvrage.
Avec un peu de réflexion sur ces passages de Marc-Antonin, le docte Scaliger
n'aurait donc point confondu le Stoïcien Maximus avec notre philosophe ; et
cette erreur, dans laquelle un défaut de ponctuation, si ordinaire dans les
manuscrits grecs, l'a peut-être induit, lorsqu'il a consulté celui de la
Chronique d'Eusèbe.
Arrianus philosophus Nicomediensis agnoscitur, et Maximus Tyrius. Or, quand bien même nous serions réduits à ces lumières, sur ce point de critique, il ne serai plus permis de partager l'erreur de Scaliger, et de penser que Maxime de Tyr ait été un des instituteurs de Marc-Antonin. Mais nous avons encore une considération du plus grand poids. Si Maxime de Tyr eût été attaché, en qualité d'instituteur, à Marc-Antonin, il aurait passé un certain nombre d'années auprès de son disciple, soit à Rome, soit dans les diverses provinces de l'Empire Romain, où ce Prince porta ses pas. Notre philosophe aurait acquis auprès de son élève, quelque connaissance de l'Histoire romaine, et des Auteurs Latins ; et, dans ses Dissertations, où il a répandu d'ailleurs une érudition assez variée, il aurait eu tant d'occasions d'en citer quelques traits, qu'il n'y aurait point résisté. Au lieu qu'étalant une profonde connaissance de l'Histoire grecque, et des Auteurs de tout genre célèbres, de son temps, en cette langue, il n'a pas écrit un seul mot d'où l'on puisse induire péremptoirement qu'il ait su qu'il y avait des Romains et des Auteurs Latins au monde (6). Ajoutons à tout cela le témoignage d'un écrivain du troisième siècle, qui nous a transmis avec assez de détail la vie de Marc-Antonin, et qu'il est étonnant que Scaliger n'ait pas consulté. Julius-Capitolinus nous apprend, avec beaucoup de précision, les noms des grands hommes qui donnèrent des leçons à cet Empereur. Or, le Maximus dont Marc-Antonin fait mention dans ses Réflexions morales, on le retrouve dans Julius-Capitolinus, avec le prénom de Claudius, qui indique que ce philosophe était Romain d'origine, et avec l'épithète caractéristique de Stoïcien. Audivit, dit l’historien, et Sextum Chaeronensem Plutarchi nepotem, Junium Rusticum, Claudium Maximum, et Cimeam Catulum, Stoicos. Il n'est donc pas possible de confondre ce Claudius Maximus, Stoïcien, vrai instituteur de Marc-Antonin, avec notre Maxime de Tyr Platonicien ; et dès que ce dernier n'est point nommé dans le nombre des philosophes à qui Marc-Antonin offre dans le premier livre de ses Réflexions morales, un si honorable tribut de reconnaissance ; dès que Julius Capitolinus, dont la précision sur ce point ne laisse rien à désirer, ne l'a point compris dans le nombre des instituteurs de ce Prince, il faut tenir pour constant que Marc-Antonin n'a point été disciple de notre philosophe. Cette opinion a été embrassée par Méric Casaubon, et par Thomas Gataker, dans les annotations dont ils ont enrichi le texte des Réflexions morales de cet Empereur ; elle l'a été par le savant Fabricius, à qui je reconnais devoir tous les matériaux dont j'ai fait usage dans la discussion de ce point de critique ; et il ne me semble plus permis d'en avoir une autre. Si Maxime de Tyr ne doit point être compté parmi les instituteurs de Marc-Antonin, doit-on du moins regarder comme certain qu'il soit venu à Rome, sous le règne de ce Prince, et précisément l'an 146 de l'ère chrétienne, comme l'ont dit les Auteurs de notre Dictionnaire des Hommes Illustres ? Cette nouvelle question serait bientôt décidée, si nous nous en rapportions à ce même Scaliger, que nous venons de convaincre de légèreté et d'inadvertance. En effet, dans l'annotation qu'il a appliquée au passage de la Chronique d'Eusèbe, dont nous avons parlé plus haut, il dit, « que Maxime de Tyr vint à Rome pour la première fois la neuvième année du règne de Marc-Antonin ; Il ajoute que c'est là qu'il composa ses Dissertations ; qu'il fit deux voyages à Rome ; que ce fut durant le premier que ses Dissertations furent composées ; et que c'est par cette raison que Maxime de Tyr lui-même les appelle Dissertations du premier voyage à Rome ».
Mais, si Scaliger s'est trompé encore ici, touchant le prétendu premier voyage
de Maxime de Tyr à Rome, ainsi que sur l'époque et le lieu de la composition
de ses discours, pourquoi craindrions-nous de relever encore cette erreur ? A la vérité, Suidas, à qui nous devons la connaissance de cette circonstance particulière de la vie de notre Auteur, se sert dune expression qui annonce que Maxime de Tyr ne se contenta pas de faire à Rome un voyage de curiosité, et par conséquent de peu de durée. Le verbe grec de Suidas signifie qu'il y fit quelque séjour. Mais il n'en dit pas davantage ; et, en parlant de ses Dissertations qu'il embrasse sous l'expression générale de Recherches philosophiques, il ne nous apprend ni les lieux où Maxime de Tyr les a composées, ni ceux où il les a prononcées. Nous avons déjà observé que dans les quarante-une Dissertations de notre Auteur, il n'y a pas un passage, pas un mot, d'où l'on puisse induire péremptoirement, ni qu'il ait été à Rome, ni qu'il y ait composé ses discours, ni qu'il ait eu la moindre connaissance de l'Histoire romaine ou des Auteurs Latins. Loin donc d'embrasser l'opinion de Scaliger, et celle des Auteurs du Dictionnaire des Hommes Illustres, il faut s'en tenir littéralement au texte de Suidas. D'ailleurs, les ouvrages de notre philosophe n'offrent que peu de renseignements relatifs au détails de sa vie privée. Dans sa huitième Dissertation, section VIII, il nous apprend qu'il avait voyagé dans l'Arabie. « Les Arabes, dit-il, adorent je ne sais quoi. Mais j'ai vu l'objet de leur culte, c'était une pierre carrée ». Ce passage est précis. Maxime de Tyr avait donc été en Arabie. Dans la même Dissertation, même section, il nous apprend également qu'il avait passé par la Phrygie. « Les Phrygiens, dit-il, qui habitent Celoene, rendent leurs hommages à deux fleuves que j'ai vus, le Marsyas et le Méandre ». Il avait donc porté ses pas dans la Phrygie. Dans la septième Dissertation, sect. VI, il s'exprime ainsi : « Car, si les Dieux faisaient que quelqu'un de ceux qui m'écoutent, se lançât, à côté de moi, dans la même carrière, et que, dans la même arène, il vint se couvrir de la même poussière, et se livrer aux mêmes efforts, c'est alors que j'acquerrais de la gloire, que je ceindrais mon front de couronnes ; c'est alors que je serais proclamé avec honneur dans toute la Grèce ». Or, ce passage prouve évidemment qu'au moins cette Dissertation a été prononcée dans quelque Cité de la Grèce ; et, s'il était permis de se livrer à des conjectures, plusieurs probabilités concourraient, ici, pour démontrer que Maxime de Tyr a vécu, et dû vivre, ainsi que le pense Davies, dans les villes grecques. D'abord, la matière de ses ouvrages. Ils roulent tous sur des questions relatives à la philosophie de Platon. En second lieu, la langue dans laquelle ils sont écrits. En troisième lieu, le silence profond sur tout ce qui peut appartenir aux Romains. En quatrième lieu, le lan-gage de Maxime de Tyr dans sa Dissertation septième, dont nous venons de citer le passage, qui paraît prouver que c'était dans les villes grecques qu'il renfermait les limites de sa réputation et de sa gloire. Daniel Heinsius a conjecturé, d'ailleurs, que Maxime de Tyr avait distribué, selon l'ancienne méthode de Platon et de quelques-uns de ses disciples, ses Dissertations en dix tétralogies, ce qui en embrassait quarante, et que la Dissertation de laquelle j'ai emprunté le passage que je viens d'alléguer, n'était que le préambule, et comme le Discours préliminaire des quarante autres (7): conjecture, qui, comme on voit, appuierait beaucoup celle que je présente. J'ajoute à tout cela, l'intérêt même de Maxime de Tyr, qui a dû préférer naturellement les contrées où son talent personnel se trouvait mieux dans son élément. Quoi qu'il en soit, ce que l'on peut dire de certain sur les détails biographiques personnels à notre Auteur, se réduit à ce peu de mots : Qu'il était originaire de Tyr ; qu'il avait de la réputation comme philosophe, dès la neuvième année du règne de Marc-Antonin ; qu'il passa quelque temps à Rome sous le règne de Commode ; que, dans ses voyages, il parcourut l'Arabie et la Phrygie, et qu'il prononça publiquement la septième de ses Dissertations dans une des villes de la Grèce. II. Je vais m'occuper à présent des versions latines qui ont été faites de notre Auteur, de ses diverses éditions, et des manuscrits de son ouvrage qui existent actuellement à la bibliothèque nationale. Le premier manuscrit de Maxime de Tyr que nous connaissions, fut apporté de Constantinople à Florence, par le célèbre André-Jean Lascaris, qui, postérieurement à la prise de cette capitale de l'Empire Grec par les Ottomans, vint chercher un asile dans la maison de Laurent de Médicis, qu'on a distingué par le surnom de père des Lettres. On sait que cet illustre Florentin fit faire, deux fois, à Lascaris le voyage de Constantinople, pour y recueillir ceux des Auteurs Grecs qu'il jugerait les plus propres à orner sa bibliothèque ; et Maxime de Tyr eut l'honneur d'entrer dans cette précieuse collection. (8). Sous les auspices de son Mécène, et pour ses talents personnels, Lascaris fut recherché, à Florence, de tous ceux qui avaient du goût pour les Lettres anciennes. De ce nombre fut le Prélat de cette métropole, qui en occupait alors le siège archiépiscopal, Cosme Pacci, neveu de Laurent de Médicis. Ce Prélat, disciple de Lascaris, fit assez de progrès dans la langue grecque, pour en entendre, et même eu apprécier jusqu'à certain point les écrivains ; et, encouragé par son maître, il entreprit et exécuta la première version latine qui ait été faite de notre Auteur. Il la dédia au Pape Jules second. Mais il mourut avant de la publier. Pierre Pacci, son frère, la fit paraître, à Rome, chez Jacques Mazochius, en 1517, in-folio. Saint-Rhénan en donna, deux ans après, en 1519, une seconde édition, également in in-folio ; et y ajouta une lettre de sa façon, adressée à Jean Grolier, secrétaire du Roi, dans laquelle il annonça qu'il avait fait quelques corrections au latin de l'Archevêque de Florence. Albert Picte en donna, à Paris, en 1554, une troisième édition, avec de nouvelles corrections, et dans un format au-dessous de l'in-folio. Jusque-là, par une singularité assez remarquable, il existait trois éditions de la version latine d'un Auteur grec, dont l'original n'avait point encore vu le jour. La première édition du texte grec fut l'ouvrage de cet Henry-Étienne, célèbre Imprimeur, et plus célèbre Helléniste encore, dont les travaux firent faire tant de progrès à cette langue savante. Il l'exécuta, à l'aide de deux manuscrits qu'il tenait, le premier d'Arnaud Arlénius, et le second, moins correct que l'autre, de Jean Stracélius. Henry-Etienne ajouta à son édition un petit nombre de ces doctes annotations destinées à réparer les inadvertances et les bévues commises par les copistes, dans un temps où il n'existait pas d'autre moyen de multiplier les monuments de l'esprit humain. Il imprima séparément la version latine de Pacci, à laquelle il fit aussi quelques corrections rapides, pendant que l'ouvrage était sous presse, et qu'on lui en présentait les épreuves. Cette édition, la première qui ait réuni le grec et le latin, fut mise sous le format in-8°, et parut, en 1557. La version de Pacci, quoique fidèle en général, péchait par ce ton de rudesse et d'aspérité inévitable peut-être dans les premiers jours de la renaissance des Lettres. Daniel Heinsius avait trop de goût, pour ne pas remarquer ce défaut. Son amour pour la philosophie de Platon, et son affection pour Maxime-de Tyr en particulier, l'engagèrent à en entreprendre unenouvelle version, à laquelle on ne peut reprocher que ces légères négligences,
quas aut incuria futile Pour nous servir du. langage d'Horace. L'édition grecque d'Henry-Étienne lui servit de guide (10). Il puisa des secours, pour la pureté du texte, dans un manuscrit de la bibliothèque de l'Électeur Palatin, et dans des annotations particulières qu'un érudit de ses amis, Sixtus Arcérius, lui envoya. Le célèbre Isaac Casaubon s'était chargé de lui procurer une copie du manuscrit de notre Bibliothèque Nationale. Mais il en fut de cette copie, comme d'un siége de Malte, que Vertot avait demandé. Elle n'arriva qu'au moment où l'impression s'achevait. Heinsius en tira néanmoins quelque parti. Elle lui servit à augmenter, et à rendre plus importantes, les annotations dont il a enrichi les deux éditions qu'il a données de notre Auteur. La première eut lieu in-8°. en 1607. Dans cette édition, il suivit l'exemple d'Henry-Étienne. Il imprima le texte, séparément de sa version. Dans la seconde, qui parut sous le même format, sept ans après, il fit imprimer le latin, page à page, é regione du grec (11). En 1630, un éditeur, que Fabricius ne nomme pas, publia, à Lyon, chez Claude Loriot, un nouveau Maxime de Tyr, grec et latin, in-8°., sans annotations. Celles d'Henry-Étienne et de Daniel Heinsius furent regardées par l'éditeur comme inutiles, attendu le soin qu'il avait eu, dit-il, de corriger le texte, selon que les conjectures des deux critiques que nous venons de nommer, lui avaient paru judicieuses et admissibles. En 1677, il en parut une autre édition in-12,à Oxford, dans le même genre que celle de Lyon, grec et latin purement et simplement, sans annotations. En 1703, Jean Ravies, préfet du collège de Cambridge, fit imprimer, dans cette ville, un nouveau Maxime de Tyr, grec et latin. Il se servit de la version de Daniel Heinsius; et il donna, de son chef, des corrections et de courtes notes, placées au bas de chaque page. Leclerc, dans le tome XI de sa Bibliothèque choisie, se répand en justes éloges sur cette édition. Davies y joignit un index des Auteurs cités par Maxime de Tyr, et une table des matières. Jaloux de perfectionner un travail qu'il ne regardait que comme une ébauche, ce savant critique prit le meilleur parti, en pareil cas, Heinsius lui avait donné l'éveil sur le mérite du manuscrit de notre Bibliothèque Nationale, en parlant de la copie que Casaubon lui en avait envoyée. Davies vint donc à Paris vérifier lui-même ce manuscrit, et y collationner le texte de son Auteur. En Angleterre, dans la bibliothèque du Comte d'Oxford, était un autre manuscrit non moins précieux, que Davies nomme Manuscriptum Harleianum. Ces deux monuments littéraires, recommandables par le talent des copistes dont ils sont l'ouvrage, aidèrent à Davies à rectifier un assez grand nombre de leçons, dont l'imperfection était échappée à Henry-Etienne et à Daniel Heinsius. Ils lui servirent, en même-temps, à justifier plusieurs des savantes conjectures de ces deux critiques. D'un autre côté, le manuscrit de la Bibliothèque Nationale lui présenta les quarante et une Dissertations de notre Auteur rangées, dans un ordre nouveau ; et il crut devoir préférer cet ordre à celui qui avait été suivi dans les éditions précédentes. Quoique ce nouveau travail fût terminé, au commencement de 1728, excepté la préface, qui ne se trouva pas achevée, à sa mort, en 1732, cette nouvelle édition ne fut donnée qu'en 1740, par Jean Ward. Cet éditeur nous apprend que pendant qu'on faisait celle de 1703. Jerome Markland avait mis quelque chose du sien ; qu'au moment où celle-ci allait paraître, ce docte critique avait offert de donner plus d'étendue à ses annotations, offre qui fut acceptée ; et certes, je dois saisir, ici, l'occasion de dire que de tous les Hellénistes qui ont travaillé sur Maxime de Tyr, Jérome Markland n'est pas celui à qui ce texte a les moindres obligations. Quelque nombreuses qu'eussent été, à cette époque, les éditions de notre Auteur, un Imprimeur Allemand, nommé George, en entreprit une nouvelle, en 1774. Au texte grec, à la version latine d'Heinsius, aux annotations réunies de Davies et de Markland, il joignit quelques annotations nouvelles. Elles sont de ce savant Helléniste Allemand, à qui nous devons, entre autres choses recommandables, une précieuse édition des Orateurs Grecs ; elles sont de Jean-Jacques Reiske, pour qui ce travail sur Maxime de Tyr fut le chant du cygne ; car il mourut dans la même année. Cette édition de 1774 est la dernière. C'est celle sur laquelle j'ai travaillé. Quant aux manuscrits de notre Auteur qui existent à la Bibliothèque Nationale, il en est deux qui contiennent l'ouvrage entier de Maxime de Tyr. Le premier, sous le n°.1962, petit in-folio, en parchemin, est écrit d'un caractère très net, et très facile à lire. A la tête du volume, est, sur une feuille volante, une notice manuscrite en latin, de la main de Boivin, ancien garde des Manuscrits, à la marge de laquelle on apprend que ce manuscrit a été copié, dans le courant du dixième siècle. Sur la première page, employée à présenter les divers titres des Dissertations de notre Auteur, se montre, en effet, une espèce de millésime, en chiffres romains, qui exprime 954, et qui est, probablement, la vraie date du manuscrit. Quoi qu'il en soit de cette conjecture, il paraît d'ailleurs qu'elle concorde avec l'opinion de Boivin, qui l'a peut-être fondée sur la nature du caractère graphique du manuscrit. Ce qui est très constant, et me fait agréablement saisir l'occasion de rendre hommage au Citoyen Duteil, garde actuel des Manuscrits, à qui je dois ce renseignement ; c'est qu'il existe, dans la Bibliothèque, des manuscrits qui portent explicitement la date du dixième siècle, et dont le caractère graphique est exactement le même que celui du manuscrit en question. C'est, au reste, celui dont Isaac Casaubon envoya à Daniel Heinsius la copie dont nous avons parlé, et celui également sur la foi duquel Davies a si considérablement amélioré le texte de notre philosophe, et qu'il distingue par l'épithète de Regium. Les Dissertations de Maxime de Tyr ont, dans ce manuscrit, l'ordre que leur a donné l'Éditeur Anglais que je viens de nommer. Les sept premières y portent ce titre, Dissertations de Maxime de Tyr, Philosophe Platonicien, écrites ou prononcées à Rome lors de son premier voyage ; car le verbe ellypsé peut être aussi bien l'un que l'autre de ces deux-là. On retrouve le même titre, à la fin de la septième de ces Dissertations. A la marge, à côté de ce titre, on en lit un nouveau, qui est celui-ci, Ouvrages philosophiques de Maxime. C'est par ces mêmes mots que se termine le manuscrit, sauf qu'au lieu de Maxime tout court, on y lit Maxime de Tyr. J'ajoute ce que Davies n'a point remarqué, et ce que j'ai déjà dit, savoir, qu'à ce nouveau titre commence un nouvel ordre arithmétique des discours de notre philosophe. D'ailleurs, ce manuscrit paraît être l'ouvrage de quelque homme lettré, versé dans les matières analogues à celles qui sont traitées par notre Auteur ; et la preuve en est, à mon avis, dans des notes marginales qui se réfèrent au texte, et qui sont évidemment de la même main, et de la même encre, que le corps du manuscrit.
Le second des manuscrits de la Bibliothèque, contenant les quarante et une
Dissertations de Maxime de Tyr, est un des fruits de nos dernières victoires en
Italie. Il est du nombre de ces monuments, qui, sortis de la Bibliothèque du
Vatican, sont venus augmenter les richesses de la nôtre. Le caractère écrit
sur ce qu'on appelle papier coton (12), est très
net et assez facile à déchiffrer. Mais j'en crois la lecture moins aisée que
celle du premier, parce que j'ai remarqué que le copiste s'était permis, de
temps en temps, des abréviations de mots, autres que ce qu'on nomme proprement
des ligatures. Il faut aussi que le manuscrit sur lequel il a fait sa copie, ait
eu quelque défaut, au moins à la première page, car, à la quinzième ligne,
il a laissé une lacune de quelques mots. Les marges offrent une multitude de
notes qui paraissent appartenir à plus d'une main ; car elles n'offrent ni le
même caractère graphique, ni la même encre. Au surplus, son titre est, comme
celui du premier, Dissertations de Maxime de Tyr, écrites ou prononcées à
Rome lors de son premier voyage. Comme dans l'autre, ce premier titre est
remplacé, au commencement de la huitième Dissertation, par celui que nous
avons déjà vu, Ouvrages philosophiques de Maxime de Tyr, qui reparaît à la
fin de la dernière. Mais, dans celui-ci, on ne retrouve point le nouvel ordre
arithmétique qui existe dans le premier. III. Me voici arrivé aux Traductions Françaises, qui ont été faites des ouvrages de notre Philosophe. Fédéric Morel, ce célèbre Imprimeur dont j'ai déjà eu occasion de parler, a été le premier qui ait entrepris de faire lire Maxime de Tyr dans notre langue. En 1596, il fit imprimer, à Paris, in 8°. la Traduction isolée d'une des Dissertations de notre Auteur, sous le titre de Plaidoyer pour les gendarmes contre les laboureurs (13). Cette Traduction, dont l'indication existe dans le répertoire de la Bibliothèque Nationale, ne se trouve pourtant pas dans la Bibliothèque. En 1607, le même Traducteur fit imprimer, à Paris, chez Pierre Bresche, la Traduction de deux autres Dissertations de notre Auteur, savoir, celle qui est intitulée, suivant le style de Morel, Touchant l'allégresse et gaîté de l'esprit, avec le remède de fâcherie (14) ; et la seconde, Touchant ceux qui ont le mieux discouru de Dieu, les poètes ou les philosophes (15). Ces deux Dissertations sont réunies dans un petit in-douze de trente-six pages. L'épître dédicataire que Morel mit à la tête de cet essai, annonce qu'il avait l'intention de traduire le reste. Mais il n'en traduisit pas davantage. D'ailleurs, la fidélité avec laquelle il m'a paru avoir constamment rendu le sens du texte, l'élégance et la nettetéde son style, eu égard au temps où il écrivait, m'ont fait regretter qu'il n'ait pas exécuté en entier son entreprise. En 1617, Guillebert, Bibliothécaire, à ce qu'il paraît, de Robert Leroux, Conseiller au Parlement de Rouen, donna, dans cette ville, chez Jean Osmont, Imprimeur du Palais, une Traduction complète des quarante-un Discours de Maxime de Tyr, « profondément doctes », dit-il, « grandement éloquents, de nouveau mis en français ». Ces dernières expressions semblent dire que lorsque Guillebert publia sa Traduction complète, il en existait une autre complète également. Mais, outre qu'on n 'en connaît point de telle, il est remarquable que Guillebert ne dit pas un mot de relatif à une Traduction antérieure à la sienne, ni dans son épître dédicatoire adressée à Robert Leroux, ni dans son avis au Lecteur. Il est possible que ce Traducteur, ou son Libraire, trompé par l'annonce de Morel, ait pensé que ce dernier avait traduit en entier Maxime de Tyr, quoiqu'il n'en eût réellement traduit qu'une très petite partie. Au surplus, cette erreur paraît avoir été partagée par Fabricius, qui, dans sa Bibliothèque grecque, attribue à Morel une Traduction complète de notre Philosophe; à moins qu'il n'ait ignoré que celle dont il a fait mention, appartenait, non à Morel dont il parle, mais à Guillebert dont il ne parle pas. Ce qui me ferait pencher pour cette dernière opinion, c'est que le Bibliographe Allemand dit formellement qu'elle parut, à Rouen, en 1617 ; circonstances que la Traduction de Guillebert réunit. D'un autre côté, Guillebert m'a paru inférieur à Morel, sous le rapport de l'exactitude et de la fidélité. J'ai comparé les deux versions phrase à phrase ; et, soit que Morel se piquât de traduire plus littéralement que Guillebert, soit qu'il fût plus fort dans l'intelligence du texte, ce que je croirais volontiers, le premier m'a semblé plus correct et plus près de l'original que l'autre. J'ajouterai qu'en 1617, notre langue n'avait point encore reçu l'élégance et le poli que lui donnèrent, un demi-siècle après, les grands Écrivains, contemporains de Louis XIV (16).Depuis Guillebert, qui exécuta le premier une Traduction complète de Maxime de Tyr, cet orateur philosophe a été entièrement négligé par les Littérateurs Français. Il a fallu qu'un Littérateur étranger soit descendu dans l'arène, pour les faire rougir de leur négligence, et qu'en 1764, il ait publié in-douze, à Leyde, chez Luchtmans, une Traduction française des Discours philosophiques de Maxime de Tyr. C'est de Formey que je veux parler. Philosophie, théologie, morale, littérature, tout était du ressort de cet infatigable Secrétaire de l'Académie de Berlin. Il a laissé, dit-on, plus de cent volumes ; mais l'espèce d'oubli où paraissent déjà tombés la plupart des ouvrages de cet Écrivain, justifie cet excellent mot de Voltaire, « Qu'il est difficile d'aller à la postérité avec un gros bagage ». D'un autre côté, le Législateur de notre Parnasse l'a dit :
« Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin, et l'on peut remarquer, sur cet oracle (17), qu'il « est plus sûr que celui de Calchas ». Or, il ne faut être ni bien versé dans la langue française, ni un puriste consommé, pour apercevoir que Formey, au moins dans sa Traduction de Maxime de Tyr, a écrit en Français, comme un français qui ne serait jamais sorti de France, écrirait en allemand. Cet Ouvrage se ressent beaucoup de la négligence avec laquelle devait nécessairement travailler un homme qui donnait à sa plume une si grande fécondité. Dans les notes, dont j'ai cru, pour l'intérêt commun de l'Ouvrage et du Lecteur, devoir augmenter mon travail, j'ai dû relever, selon les occasions, plusieurs des inexactitudes de Formey. En traduisant autrement que lui, il m'a bien fallu, de temps en temps, donner la raison de la différence. Ceux qui prendront la peine de conférer ma Traduction avec la sienne, jugeront que j'en ai usé avec quelque discrétion. Car je ne me suis point attaché à tout ce qui aurait pu fournir matière à des observations critiques, soit sous le rapport du style, soit sous le rapport de la fidélité de la Traduction. A la vérité, quand j'ai rencontré les étranges bévues où il s'est quelquefois laissé tomber, j'avoue que j'ai mis en problème s'il savait le premier mot de la langue grecque. Du moins ne m'a-t-il pas été permis de douter qu'en traduisant Maxime de Tyr, il n'a fait que suivre la version latine d'Heinsius, sans jamais jeter les yeux sur le texte grec, lorsque j'ai vu que dans la première phrase de la Dissertation vingt-quatrième, qui est chez lui la neuvième, il a pris le mignon, le ganymède d'un Corinthien pour son propre fils ; lorsque j'ai vu que, dans la vingt-huitième, qui est chez lui la dix-huitième, section 7, au lieu de traduire : « Parlez-moi de cette guerre, et laissez-là la guerre des Mèdes » ; il a traduit : « Décrivez-moi cette guerre, et laissez-là le médecin »; lorsque j'ai vu que, dans la vingt-neuvième, qui est chez lui la trente-cinquième, section 7, il a pris les habitants de la Béotie pour les peupliers de la Béotie (18); lorsqu'enfin il est tombé dans beaucoup d'autres inadvertances de la même force, que la plus légère attention au texte grec lui aurait fait éviter. Je ne dirai rien de l'arbitraire qu'il a mis dans l'ordre où il a rangé les quarante et une Dissertations de notre Auteur. J'ai cru, pour les mêmes raisons qui ont déterminé Davies et Markland, devoir suivre l'ordre par eux adopté dans leurs éditions. La commodité des Lecteurs, et surtout des Hellénistes qui voudront conférer la Traduction française avec la version latine, ou le texte grec des dernières éditions, a été mon second motif. Je ne parlerai pas non plus du défaut presque absolu de notes, qui, dans le travail de Formey, rend Maxime de Tyr souvent obscur, et quelquefois inintelligible, pour ceux des Lecteurs qui ne sont pas familiers, jusqu'à un certain point, avec l'Antiquité. Il m'a paru important de faire tout le contraire, et de répandre des notes critiques, historiques, philosophiques, partout où le texte de notre Auteur semblait l'exiger. Je n'ai pas craint, comme Formey, de trop grossir le volume ; et je n'ai eu garde d'attendre, comme lui, pour suppléer à ce défaut, une seconde édition (19). IV.
Je me hâte de
payer à cet Écrivain, le tribut d'éloges qu'il mérite sous un autre rapport,
et de le louer au sujet de la justesse avec laquelle il a parlé de l'ensemble
de l'ouvrage de Maxime de Tyr. Il a judicieusement remarqué que son érudition
est assez peu étendue, eu égard à la féconde variété des matières qu'il
traite, et qu'elle ne sort guère. du cercle étroit de quelques Auteurs
illustres de l'Antiquité, dont notre philosophe paraît avoir fait une étude
favorite et exclusive, tels qu'Homère, Hérodote et Platon; que ce défaut l'a
fait tomber dans un autre, celui des répétitions. Elles sont fréquentes, en
effet, dans les Dissertations de notre philosophe ; mais la diversité des
applications auxquelles il a, le plus souvent, l'adresse de faire servir les
traits d'emprunt dont il fait usage, atteste l'étendue de son esprit et les
ressources de son génie. Formey a eu raison encore d'observer que Maxime de Tyr
n'est point exempt de ces subtilités métaphysiques, de ces sophistiqueries
nébuleuses, de ces creuses argumentations qui ont trop longtemps formé le
rayon dominant dans l'auréole philosophique, et à la suite desquelles la
Raison va se perdre, comme dans le vague des espaces imaginaires. Au surplus, les Dissertations de notre Auteur roulent généralement sur les sujets qui faisaient le plus communément la matière des méditations des philosophes de l'Antiquité, et spécialement de ceux de l'École de Platon. Ces sujets, pour la plupart métaphysiques, sont traités avec ce mélange de subtilité logique, de précision didactique et de clinquant oratoire qui paraît avoir été le type des Écrivains de ce temps-là, de ceux principalement qui, comme Maxime de Tyr, mariaient les contemplations philosophiques à l'art des Rhéteurs. Ce genre n'est peut-être pas le plus propre à intéresser aujourd'hui le grand nombre des Lecteurs ; et ce n'est guère que parmi ceux qui joignent à l'amour de l'Antiquité le goût et l'habitude des méditations solides et philosophiques, qu'il peut espérer d'être honorablement accueilli. Mais ce qui semble devoir étendre l'intérêt en faveur de Maxime de Tyr, c'est le jour qu'il a répandu sur les hautes questions de la philosophie, auxquelles s'attachent d'une manière si immédiate les sollicitudes de la droite raison, et le bonheur de l'espèce humaine, savoir, celle de l'existence et de l'unité de Dieu, celle des notions élémentaires de la religion naturelle, et des principes fondamentaux de la morale. Notre philosophe, ainsi que nous l'avons dit, en commençant, présente, sous ces importants rapports, des idées et des développements qui ne peuvent manquer de lui conquérir l'estime des amis de la vraie religion et des mœurs ; et, si l'Archevêque de Florence, qui en fit la première Traduction, ne le jugea pas indigne de paraître sous les auspices d'un Pontife Romain, et d'entrer dans sa bibliothèque (20), Maxime de Tyr doit s'attendre à être bien accueilli de tous ceux qui aiment à réunir dans une même lecture les lumières solides et les agréments de l'érudition. C'est ce qui a fait dire à Markland, dans le dernier alinéa de sa préface : Utilissimum, et saepe repetita lectione dignum hunc Auctorem existimo ; et qui lui a fait regretter que l'Antiquité ne nous eût pas transmis un plus grand nombre d'écrivains du même mérite : Utinarn multo,plures hujusce generis antiquos scriptores haberemus ! Je n'ai plus qu'un mot à dire, et c'est sur les principes que j'ai suivis en traduisant. Tantôt Maxime de Tyr emploie la sèche précision du genre didactique, tantôt il se livre au luxe de l'élocution oratoire. J'ai dû me conformer à cette variété ; et je l'ai fait, en me tenant toujours aussi près de la lettre de l'original que le comportait le génie des deux langues. Littéral jusqu'à la rigueur, en tout ce qui était dogmatique, je me suis affranchi de la gêne de ces entraves dans les développements oratoires. Le devoir d'un Traducteur, qui veut être fidèle, est de calquer, si l'on peut s'exprimer ainsi, la pensée de son original, et non pas son langage. Or, la meilleure manière de faire entendre ce qu'a pensé l'Auteur qu'on traduit, c'est quelquefois de s'exprimer autrement que lui. Je n'ai pas poussé cette liberté aussi loin que plusieurs traducteurs, dont les travaux jouissent d'ailleurs d'une réputation distinguée. Mais je lui ai donné ce degré de latitude sans lequel je ne pense pas qu'un Traducteur puisse remplir sa première tâche. Quand je n'ai pu rendre mot à mot, j'ai appelé à mon secours les équivalents les plus approximatifs. Il m'eût été bien plus commode de suivre l'exemple de d'Olivet, qui dit quelque part, « Je me contente d'énoncer clairement la proposition, sans appuyer sur chaque mot du texte : notre langue n'ayant pas les quatre synonymes qui sont ici dans le latin (21) ». J'ai quelquefois osé entreprendre d'éclaircir le texte par des développements, en guise de commentaires. Mais je ne l'ai jamais fait qu'avec beaucoup de discrétion, et que presque en tremblant. Je ne me sentais pas assez foncé dans le Platonisme pour me jeter dans des détails qui auraient exigé la tête ou d'un Proclus, ou d'un Plotin. Si donc il m'est échappé, à cet égard, quelque incongruité, de quoi je ne réponds pas, je sollicite d'avance l'indulgence des Proclus qui me feront l'honneur de me lire. D'un autre côté, lorsque les idées de Maxime de Tyr m'ont paru s'éloigner plus ou moins du sens littéral, et devoir être prises dans un sens figuré et allégorique, je me suis rarement permis d'y toucher. Car circonscrit dans les fonctions d'un Traducteur, il ne n'aurait pas convenu d'affecter celles d'un interprète. D'ailleurs, on doit avoir assez bonne opinion. de son lecteur, pour lui laisser quelque chose à faire ; et peut-être ceux qui me liront, jugeront-ils, sur beaucoup de notes, que ce qu'ils auraient fait, vaudrait mieux que ce que j'ai fait moi-même. Peut-être aussi trouvera-t-on, en beaucoup d'endroits, que j'aurais pu, s'il est permis de se servir de cette figure, habiller un peu plus Maxime de Tyr à la française, et écarter quelques longueurs de phrase, quelques aspérités de style qui pourront m'être reprochées. Certes, je n'aurais pas demandé mieux. Mon travail en aurait été plus facile. Car les morceaux sur lesquels tombera ce reproche, seront probablement ceux qui m'ont, en effet, le plus coûté. Mais je prie le lecteur de vouloir bien considérer, que c'est au sens de son original qu'un Traducteur doit s'attacher essentiellement ; que cet intérêt doit l'emporter sur tout autre ; et qu'ici, c'est un Auteur Grec qui doit s'exprimer dans ce qui est didactique, en termes, et même en tours les plus équivalents que possible à ceux de sa langue. Les amateurs de l'Antique trouveraient, d'ailleurs, mauvais, et avec raison, que, sous prétexte d'une élégance déplacée, la loi du costume fût méconnue jusqu'à certain point ; et de même qu'ils pardonneraient peut-être plus volontiers aux Apelles et aux Zeuxis modernes quelque inexactitude, quelque incorrection de dessin dans les tableaux de Socrate ou de Philoctète, qu'ils ne leur pardonneraient de substituer notre vêtement et notre chaussure, à la chlamyde, et au brodequin ; de même ils aimeront mieux retrouver, dans le profil de Maxime de Tyr, quelques - uns des-traits caractéristiques de sa physionomie, que de le voir entièrement défiguré, à force d'enluminure. Paris, le 7 frimaire an X. (28 novembre 1801.)
(1) M. Antoninus, principio, avi sui nomen habuit, et Catilii Severi materni proavi. Post excessum vero patris, ab Adriano Annius Verissimus vocatus est. Post virilem autem togam, Annius Verus. Lampridius ne dit point, comme l'Auteur que je viens de citer, que Marc-Antonin dût son nom de Verissimus à Adrien. Il dit formellement que ce fut d'abord son vrai nom. Aliud est quum pronomen adsciscitur, aliud quum ipsum nomen imponitur. Nam Pius rerum nomen Antonini habuit, cognomen Pii. Marcus verum nomen Verissimi habuit ; sed hoc sublato atque abolito, non praenomen Antonini, sed nomen accepit. Il prit, en effet, le nom d'Antoninus-Pius, qui l'adopta. (2) Ex istis etiam Marci Magister Apollonius Chalcidensis, ut vidimus; et Maximus Tyrius, ut ipse Marcus testatur in vita sua. (3) Je me sers de l'estimable traduction de Dacier.
(4) Nil admirari, prope res est una, Numici, (5) Le premier de ces mots signifie proprement, l'absence de la souffrance et de la douleur, et le second, l'absence du chagrin, de l'inquiétude. (6) Une seule fois, Maxime de Tyr paraît avoir emprunté quelque chose aux Auteurs Latins. C'est au commencement de sa Dissertation XXIe. Ce qu'il dit de la bizarrerie qui fait que l'homme se plaint de la situation où il est, et qu'il loue la situation opposée où il n'est pas, semble copié des premiers vers du premier Discours d'Horace, Qui fit Maecenas, etc. Le tableau du poète et du philosophe se ressemblent, en effet, à un point qui fait présumer que celui-ci est calqué sur celui-là. C'est l'opinion de Hensius et de Davies, ainsi qu'on le verra plus bas, dans la note 4 de la XXIe Dissertation. Mais fût-il aussi vrai, qu'il peut ne pas l'être, que Maxime de Tyr eût mis le poète Latin à contribution, ce serait pousser la conséquence un peu loin, que d'en conclure que Maxime de Tyr eût été l'un des Instituteurs de Marc-Antonin. Sous le règne de cet Empereur, un siècle et demi après le règne d'Auguste, Horace devait être entre les mains de tous les Grecs amateurs de la belle littérature, comme Pindare était dans celles des Romains du même goût ; et Maxime de Tyr a bien pu, sur ce pied-là, sans venir même à Rome, faire connaissance avec l'ami de Mécène. Quoi qu'il en soit, ce qui n'est probablement qu'une fortuite coïncidence, ne doit pas suffire peur faire regarder comme constant que Maxime de Tyr ait copié les écrivains de Rome ; et après tout, il n'est pas plus impossible qu'il se soit rencontré avec Horace sur le chemin de l'imagination, qu'il ne l'a été Leibnitz et à Newton de se rencontrer, comme on le dit, sur le chemin de l’infini. (7) Formey a pris à la lettre cette conjecture d'Heinsius ; et en conséquence, il a mis cette Dissertation à la tête de toutes le autres. - Voy. sa Préface, pag. 16 et 17 (8) On verra, par le long détail des nombreuses éditions de Maxime de Tyr, à quel point les ouvrages de ce philosophe ont été estimés, depuis la renaissance des Lettres, par les hommes doctes capables de l'apprécier. Plusieurs d'entre eux se sont fait honneur de l'enrichir de Scholies et de Commentaires. Je peux citer, entre autres, Paul Léopard, humaniste, professeur en grec, à Bergues-Saint-Vinox, mort en 1567. Il a laissé des remarques critiques divisées en vingt livres, et Maxime de Tyr est du nombre des Auteurs de l'Antiquité, auxquels ce doctes Aristarque a consacré ses veilles. Théodore Canterus, savant Hollandais, mort très jeune en 1575, qui a laissé des observations sur Maxime de Tyr. André Schott, professeur en grec à Anvers, mort en 1629, qui a fait de savantes notes sur plusieurs Auteurs, tant Grecs que Latins, parmi lesquels se trouve notre philosophe. (9) Art. poetica. (10) In graeca editione Stephanum secuti sumus dit-il, dans son Avis au Lecteur. (11) In bibliotheca Hulsiana, tom. III, part. I, pag. 195, n°. 3431, citatur editio cum notis Heinsii, Lugduni Batavorum., 1694, in-8°. (12) Les curieux qui désireront des détails sur l'origine ; la composition et l'usage de ce papier, peuvent consulter la Paléographie grecque de Monfaucon, liv. I, chap. 2. (13) Elle est la 29e. de la dernière édition. (14) C'est la 34e. de la dernière édition. (15) C'est la 10e. de la dernière édition. (16) Fabricius nous apprend qu'un Italien, Pierre de Bardi, Comte de Verne, et membre de l'Académie de Florence, donna à Venise, en 1642, une traduction italienne de Maxime de Tyr. Harles, le savant éditeur de la dernière édition de Fabricius, nous apprend aussi qu'un Allemand, nommé Chr. Tob. Damm, a donné de notre Auteur une traduction allemande, qui a été imprimée à Berlin, en 1704, la même année que Formey, dont je vais parler, faisait imprimer la sienne, à Leyde. Reiske parle de cette traduction dans la Préface qu'il a mise à la tête de l'édition de notre Auteur, donnée à Leipsick, en 1774 ; et, s'il faut l'en croire, elle est peu littérale, quoique suffisante, d'ailleurs, pour donner une idée des principes philosophiques et du genre d'écrire de Maxime de Tyr. (17) Art poétique de Boileau, chant I. (18) Si Formey eût jeté les yeux sur la Table des Matières de l'édition de Markland, il eût vu sous le mot Beotia, que cette contrée populis ( arboribus puta) abundat (19) Voy. la Préface de Formrey, pag. 15. (20) Itaque laudibus caeteris omissis, si quaeres Pontifex Maxime, quid me praecipue praeter haec omnia impulerit ut philosophi hujus semones, tibi, ac bibliothecae tuae, conciliarent, probasse me scito in primis piam in eis Sapientiam, utpoté Platonis Academiac alumnam, ac Perfectionis pedisse quam Christianae ; dignam profecto quae a sacerdote christiano peregré reverso, pro peregrinationis indicio, ad sacerdotum Parentem dono referretur. Cosm. Paccii, praefat. juxta finem (21) Dans sa traduction des Entretiens de Cicéron sur la Nature des Dieux, tome II, édit. de Barbon, 1765, page 9. |