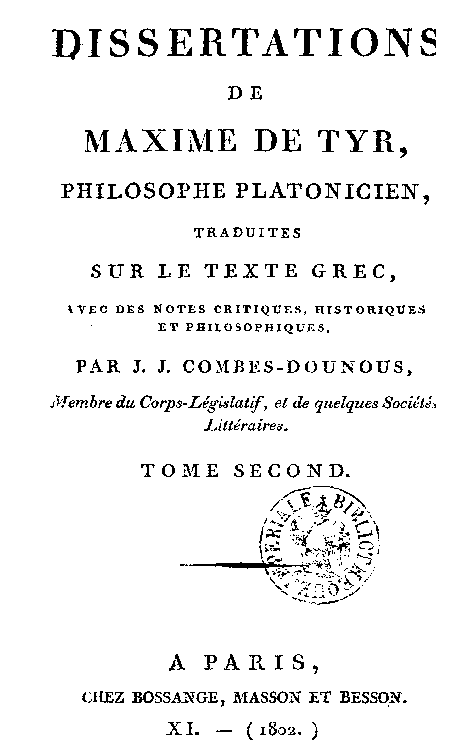|
MAXIME DE TYR
DISSERTATIONS
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
MAXIME DE TYR
MAXIME DE TYR
DISSERTATION XXXIII.Si la vertu est un art (01) ?
Est-il quelqu'un qui pût supporter d'entendre dire à un philosophe que la vertu est toute autre chose qu'un art ? Car, à peine il existerait un art au monde, si la vertu n'en était point un. A moins qu'on ne veuille entendre, qu'une charrue, un bouclier, un vaisseau, une muraille, sont l'ouvrage d'un art; et que ce qui fait usage de ces choses-là, ce qui les dirige, ce qui les approprie chacune à des besoins particuliers, et ce qui retire de chacune d'elles des services subordonnés à une fin commune, nous ne le regardions, comme n'étant point un art. Ce serait, sans doute une merveille, et plus qu'une merveille, si ce que le potier, ce que le forgeron, ce que le charpentier, apprennent, était un art ; et que la chose qu'apprend le philosophe, laquelle a la vertu pour objet, ne fût point un art, mais une instruction acquise sans aucun art (02). II. Bon ; c'est cela : il n'y a là ni absurdité, ni ineptie. Cet art, je le loue; mais voyons en quoi vous en faites consister l'objet capital. Le potier qui apprend à faire des pots, dites-vous, apprend un art; de même que le forgeron qui apprend à forger des boucliers ; et de même que le charpentier qui apprend la charpente. A la bonne heure ; je vous accorde que chacun de ces ouvriers apprend ce qu'il apprend à faire, mais non que la fin de l'art soit pour eux d'apprendre cet art, l'un par les leçons de l'autre. Car l'action d'enseigner ne produit que la succession, la transmission du savoir. Mais l'emploi des arts n'est pas de produire un art par un autre. C'est de produire un pot, par le potier, le son de la flûte par celui qui joue de cet instrument, la victoire par le Général. Or, chacune de ces choses est autre chose que l'art, elle est la fin de l'art, mais non point l'art. Ce n'est pas que, dans ce qui n'est point art, existe, par cela même, l'abstraction de l'art. Car l'abstraction de l'art n'est que l'action à ôter l'art des choses où l'art est nécessaire. Or, ce qui est produit par l'art, n'est point l'art lui-même; c'est autre chose que l'art (03). III. Pensez-vous m'entendre assez clairement, ou faut-il que je vous parle avec plus d'évidence encore ? Il est un art que vous appelez la médecine; il en st un autre que vous appelez la sculpture. Or, la fin de chacun de ces arts n'est point, de celui de la médecine, la médecine, de celui de la sculpture, la sculpture. Mais une statue est la fin de la sculpture, et la santé est la fin de la médecine. Quoi donc! Pensez-vous que la vertu soit autre chose que la santé et la bonne complexion de l'âme? Examinons la chose sous ce point de vue. Eu égard à ces trois objets, l'âme, le corps, et la pierre, supposons trois arts qui leur soient appropriés. Ces objets ne sont d'abord qu'une matière brute et sans ornement. Mais chacun des arts qui donne à chacun de ces objets la forme qui lui est propre, environne la pierre de modifications et de contours qui produisent la ressemblance d'une figure; établit dans le corps une combinaison, un équilibre d'humeurs, d'où résulte la santé ; et dans l'âme une symétrie, un accord d'affections bien ordonnées, en quoi consiste la beauté de la vertu : et, si vous donniez à quelqu'une de ces choses le nom d'art, attribuant la dénomination d'agent à ce qui n'est tout bonnement (04) que le sujet de l'action, ce serait tout comme si vous donniez le nom de soleil à la masse de lumière qui sort de cet astre, laquelle est autre chose que le soleil ; qui est produite, à la vérité, par le soleil (05), mais qui n'est pas le soleil lui-même. IV. D'ailleurs, examinons le sujet de cette Dissertation sous son double point de vue. Recherchons ce que c'est que l'art, ce que c'est que la vertu. Penserons-nous que l'art soit autre chose que la raison qui tend à son but, tantôt en produisant, par le travail des mains, un corps que nous appelons ouvrage; c'est ainsi qu'une maison est l’ouvrage d'un architecte, qu'un navire est l’ouvrage d'un constructeur de vaisseau, un tableau l’ouvrage d'un peintre. Tantôt en produisant une action, non sans l'intermédiaire des corps, comme la victoire de la part d'une armée, la santé de la part de la médecine, et la justice de la part de la politique : tantôt, et c'est la troisième espèce d'art (06), en exerçant, sans l'intervention des corps, l'empire qu'elle a sur elle-même; agissant sur elle-même, comme dans l'art de la géométrie, dans celui de l'arithmétique, dans tous ceux qui n'ont qu'un objet intellectuel, et qui ne sont d'aucune des deux précédentes espèces? Soit: mais, ces trois espèces d'art étant posées, dans laquelle classerons-nous la vertu, si elle est un art? Dans celle des arts mécaniques? Vous ne le direz point, Balancerez-vous entre la classe des arts pratiques et celle des arts théoriques (07) ? Quant à moi, je n'exclus la vertu ni de l'une ni de l'autre. Mais, les entremêlant toutes les deux, et y ajoutant quelque chose, je dis que ce qui est composé de diverses choses est autre chose que chacune des choses dont il est composé. De même que si quelqu'un disait que le corps de l'homme est on feu, ou terre, ou air, ou eau ; certes, je dirais, moi, qu'il n'est ni feu, ni terre, ni air, ni eau ; car ce qui est le résultat du mélange de plusieurs éléments, n'est point chacun des éléments qui le constituent. V. Dans quel sens est-il donc vrai que la vertu, qui participe à la pratique et à la théorie, n'est point un art ? Suivez la démonstration que j'en vais donner. Ce n'est pas, d'ailleurs, de mon chef que je vais parler. C'est l'opinion de l'Académie que je vais énoncer, opinion émanée de l'Ecole, des Pénates de Platon ; et qu'Aristote même a admise. Je remonterai même plus haut ; car je crois qu'elle est venue d'Italie à Athènes ; et que quelques Pythagoriciens ont transporté cette précieuse doctrine (08) dans l'ancienne Grèce. Voici donc comment je m'explique. L'âme humaine a été, de tout temps, divisée en deux parties ; l'une la raison, et l'autre les passions. Lorsque chacune de ces parties est mal constituée (09), et que ses mouvements ne sont pas bien ordonnés, cette manière d'être est désignée par un mot seul, collectif, et très déshonorant, savoir, la méchanceté. L'origine et la source de ce déshonneur, de cette turpitude, est dans l'action de ces deux parties, lorsqu'elles refluent l'une contre l'autre ; lorsqu'elles surnagent l’une sûr l'autre; lorsque les affections en incandescence inondent l'âme (10), et qu'elles troublent la fécondation et le développement des germes de la raison : de même qu'en hiver les fleuves franchissent les limites qui leur ont été assignées, se répandent dans les champs labourés ou plantés par les agriculteurs, et les dégradent par leurs irruptions, ou par le gravois qu'ils déposent. C'est ainsi que les excès des passions jettent l'âme hors des bornes de la raison, et suscitent en elle les opinions fausses, vicieuses et contraires à sa nature. Il en est comme des ivrognes (11). L'excès du boire excite les humeurs internes, comme des reptiles que l'on chasse de leur trou ; l'entendement en est suffoqué, et réduit à ne faire plus entendre que les sons inarticulés de ces brutes. VI. Voulez-vous une image encore plus sensible? Nous comparerons cet état de désordre de l'âme à une ochlocratie (12). Lorsque tout ce qu'il y a de gens de mérite dans un corps social, est courbé sous le joug de la force et de la servitude ; lorsque tout ce qu'il y a, au contraire, de forcené, s'empare de l'autorité publique, avec une audace et une confiance qui ne doutent de rien, il faut, de toute nécessité, que, dans un tel corps social, règnent une grande diversité d'opinions, un grand conflit de vues, une étonnante variété d'affections , un contraste prodigieux d'intérêts, beaucoup d'intempérance dans les jouissances physiques, une violence sans frein dans les inimitiés, une frénésie sans mesure dans l'ambition, beaucoup d'imprévoyance dans les succès, et une fureur inexorable dans les revers (13). Lorsque Périclès se retire des affaires, lorsque Aristide est envoyé en exil, lorsque Socrate est condamné à la mort, lorsque Nicias est obligé de prendre le commandement, lorsque Cléon veut envahir Sphactérie, Thrasylle l'Ionie, Alcibiade la Sicile, lorsque tout autre chef veut entreprendre toute autre expédition, sur terre ou sur mer, et qu'il est appuyé par une populace oisive, factieuse, mercenaire, qui se jette dans tous les partis, il est impossible qu'un pareil ordre de choses n'amène pas la servitude, les calamités, la tyrannie, et toutes les horreurs de cette nature. L'âme aussi a ses séditieux, ses démagogues, sa populace effrénée, ses Alcibiades, ses Cléons, qui ne lui permettent point de surmonter sa timidité, de demeurer ferme, et de ne céder qu'à la voix intérieure de la raison, et de la loi naturelle. Tel est le tableau du désordre politique, au-dedans de l'homme. VII. Il en est de la vertu, au sujet de laquelle on a tant écrit, comme de la politique de Lacédémone, où tout ce qui est populace obéit, et où le petit nombre des gens de mérite commande. Car ceux-ci conservent; le reste est conservé. Ceux-ci ordonnent ; et le reste exécute. Le résultat de ce double rôle est la liberté. Chacun a besoin de l'autre : ceux qui commandent, de ceux qui sont commandes (14) ; et ceux qui sont commandés, de ceux qui commandent. Telle est la condition d'une âme bien organisée. La raison conserve, et les passions laissent conserver. La raison règle la mesure ; et les passions la laissent régler. Le résultat de ce double rôle est le bonheur (15). Mettons, à présent, toute la classe des arts théoriques en rapport avec la raison, et qu'elle les coordonne avec les passions. Appelons ensuite sagesse ce qui est science, et vertu ce qui est le produit de la science. Si, après cela nous transposons les noms, et que nous appelions la science, vertu, je demanderai, et cette dernière, d'où vient-elle-? Car la science ne peut point être ce qui tire d'elle son origine. Appellerez-vous la science, l'art des arts? Ce n'est qu'un mot. L'appellerez-vous la science des sciences ? Je vous entends; et j'adopte votre expression, pourvu que vous m'accordiez une seule chose de bien légère importance, savoir, que vous appellerez simplement art ce qui est vraiment art, et simplement science ce qui est vraiment science (16). Séparez bien ces deux choses; et je suis de votre avis. Mais, si vous conservez le mot de science, et qu'après avoir fait abstraction des passions dans les éléments de ce mot, vous fassiez repasser les attributs de ces dernières dans la dénomination de la science, c'est tout comme si quelqu'un conservait le nom d'art à l'art de Phidias, et qu'ensuite ayant fait abstraction de la matière, il donnât à l’art le nom de cette même matière. Voulez-vous que la science ait l'empire des bonnes mœurs ? Non (17). Que cet empire appartienne à la raison. Voulez-vous qu'il appartienne à la raison (18)? A la bonne heure : « que celui-là seul règne, à qui le fils du vieux Saturne a donné le sceptre (19)? » Mais sur qui régnera-t-il ? Quels sujets lui assignerez-vous, pour exécuter ses ordres? Où sont les agents que vous voulez qu'il mette en œuvre ? Le corps ? Prenez garde à ce que vous faites. Vous franchissez l'ordre des grades, entre celui qui commande, et celui qui obéit, depuis le Général en chef jusqu'aux goujats de l'armée. Ne la voyez-vous point cette gradation ? D'abord le Général en chef; ensuite les chefs de corps ; ensuite les officiers subalternes; ensuite les soldats pesamment armés; ensuite les troupes légères ; ensuite les archers. Les fonctions du service passent insensiblement du tout à chacune des parties, des plus braves aux plus lâches. VIII. Mais je vois que vous êtes prêt à (20) me répondre que Dieu régit l'univers avec une perfection qui tient, à la fois, de l’art et de la science. A la bonne heure. En conclurez-vous que la science n'est autre chose que la vertu ? Car, si vous appelez la science de Dieu, vertu, je ne chicanerai point sur le mot. Il n'en est point de Dieu, comme de l'homme ; son âme n'a point deux parties, dont l'une commande et l'autre obéisse. L'âme de Dieu est simple dans son essence, comme l’entendement, comme la science, comme la raison. Mais, si dans le mélange de deux choses, dont l'une vaut mieux que l'autre, vous appliquez à celle à qui le premier rang appartient, la dénomination de sa subalterne ; je vous le passe, eu égard au mot, mais non pas en ce qui concerne la chose. Appelez la science, vertu, tant qu'il vous plaira, mais n'appelez point la vertu, science. Ce serait, par Jupiter, mentir aux hommes, et les induire en erreur (21), que de leur faire croire que les objets de l'instruction théorique, que les connaissances spécialement appropriées à l'âme, les conduisent à la vertu. Certes, ils seraient dignes d'une bien haute recommandation, les sophistes, ces hommes qui savent beaucoup, qui parlent beaucoup, qui peuvent enseigner beaucoup, qui tiennent boutique de savoir, et le vendent au premier venu. La vertu aurait donc aussi son marché, et l'on en ferait trafic, (comme d'une marchandise). IX. Mais, si, d'un côté, les préceptes sont évidents, et à la portée de tout le monde, si les maîtres et les écoles abondent de toutes parts ; et que, de l'autre, les leçons de la morale trouvent les chemins intérieurs, qui les conduisent à l'âme, encombrés de passions revêches et brutales, de penchants pervers, d'habitudes iniques, de monstrueux désirs, et de pernicieux principes, il faut considérer que l'âme a besoin, avant tout, d'un bon naturel, comme un mur, qu'on veut élever, a besoin d'un fondement. Il faut ensuite que ce naturel soit entretenu par une éducation, par de» habitudes, qui donnent à l'âme, pour tous les genres de bien, un goût qui s'accommode à toutes les circonstances, à toutes les périodes de la vie. A cela il faut encore ajouter l’art de maintenir invariablement les passions dans les bornes de la modération. C'est ainsi que l'âme devient heureuse, que les mœurs deviennent saines, que les opinions deviennent droites, et que de cette combinaison résulte l'harmonie morale. Ce qui accomplit la loi de Dieu, ce qui fait l'homme de bien, c'est que les passions se laissent conduire par la raison, qu'elles cèdent volontiers l'empire à la science. Car le vice n'a point une origine spontanée (22). Il la doit aux illusions (23) de la volupté.
NOTES.
(01) Plusieurs philosophes prétendaient que les Vertus étaient des arts, ou des sciences. Voyez Aristote dans ses Ethiques, liv. VI, chap. 13. Le sixième des traités des Œuvres morales de Plutarque roule sur cette question, « Que la vertu se peut enseigner », et ce philosophe n’était pas moins décidé en faveur de l'affirmative de cette question que Maxime de Tyr. Bien plus, il pensait que la vertu dépendent tellement de l'éducation, que l'abstraction de celle-ci emportait l'exclusion de l'autre. « O bonnes gens », dit-il, au commencement de son traité, pourquoi est-ce qu'en niant que la bonté se puisse enseigner, nous nions quand et quand qu'elle puisse être ? Car s'il est vrai que son apprentissage soit sa génération, en niant qu'elle se puisse apprendre, nous affermons aussi qu'elle ne peut donc estre ». (Je me suis servi de la version d'Amyot). Helvétius aurait-il emprunté, de cette opinion de Plutarque, son principe, « Que la bonté ou la méchanceté est dans l'homme un accident : le produit de ses lois bonnes ou mauvaises? » (De l'Esprit, sect. V, chap. 3). Quant à moi, j'aimerais mieux le sens moral de Shaftsbury. Quoi qu'il en soit, n'est-il pas singulier que, la morale étant la chose du monde la plus importante pour l'homme, il n'y ait jamais eu dans aucun établissement d'instruction publique, chez nous, une école où cette science ait été spécialement enseignée? Me dira-t-on qu'on aurait craint en cela d'empiéter sur l'apanage des prêtres ? Quel dommage, en effet ; ils ont rendu nos mœurs si pures, et ils ont tant multiplié le nombre des gens de bien ! (02) Dans le traité de Plutarque, que nous venons de citer, est une comparaison dans le même genre. Mais elle paraît plus frappante, parce que les termes sont plus rapprochés les uns des autres, « Ainsi on ne pourra mettre la main au plat honnêtement, ni prendre la coupe de bonne grâce, qui ne l'aura appris de jeunesse, ni se garder » D’estre goulu, ou friand, ou gourmand, » Ni l’esclater de rire véhément, » Ni mettre un pied, en croix, par dessus l’autre, comme dit Aristophane, dans la comédie des Nuées y et cependant il sera bien possible qu'une personne sache comment il se faut gouverner en mariage, au maniement de la chose publique, vivre parmi les hommes, exercer un Magistrat, sans avoir premièrement appris comme il s'y faut comporter les uns avec les autres » ? Version d'Amyot. (03)Ce passage de Maxime de Tyr est assez difficile à comprendre. Il exige toute la contention d'esprit dont on peut être capable. Encore est-il aisé de se perdre au milieu de ces abstractions. Au demeurant, on voit qu'il sent, ici, lui-même la difficulté qu'on a de l'entendre, puisque dans la section suivante, il tâche de s'expliquer plus clairement. (04) Scaliger a très heureusement substitué, ici, à ὑπὸ φιλίας, tout-à-fait insignifiant, ὑπ ἀφελείας, qui s'adapte bien avec la pensée de notre auteur. (05) Cette incise n'est point dans le texte d'Heinsius, par une raison toute naturelle, c'est qu'il n'a point lu dans son original ποόημα ἡλεοῦ deux mots que les annotateurs Anglais ont rétablis dans le texte grec, sur la foi des manuscrits. L'Archevêque de Florence dut les trouver dans son manuscrit, puisqu'il traduisit, quœ quidem (lux) diversa a sole est, opus solis, minime tamen ipse sol. (06) Telle était la distribution et la classification des Arts, selon les idées de Platon. Voyez la note suivante. (07) Les Anciens distribuaient en trois classes les Arts et les Sciences, en mécaniques, en pratiques, et en théoriques ; l'Architecture, l'Art de construire les vaisseaux, et tous les autres Arts dont les ouvrages frappaient la vue, étaient de la première classe ; l'Art de jouer des divers instruments de musique, de la flûte, de la cithare, et autres Arts analogues, dont le résultat ne tombait point sous le sens des yeux, étaient de la seconde classe ; la Géométrie, la science de l'Harmonie, l'Astronomie, et autres sciences du domaine de l'entendement, composaient la troisième classe. Telle est la distribution consignée dans un passage de Diogène Laërce liv. III. 84. (08) Le texte porte littéralement, cette belle marchandise. J'avoue que je n'ai point osé admettre cette métaphore, qui, dans notre langue, n’aurait pas eu la grâce qu'elle a dans le texte grec. (09) « Voici en quoi consiste le bon état de l'âme. Une de ses parties est la raison, l'autre, l'appétit irascible, et la troisième, l'appétit concupiscible. La raison a l'empire de l'intelligence, l’appétit irascible, celui des aversions, et l'appétit concupiscible, celui des désirs. Lorsque ces trois parties n'ont qu'un même but, et qu'il y a de la concordance entre elles, alors l'unanimité, la vertu, existent dans l'âme, mais lorsqu'elles sont en état de discorde et de guerre, c'est alors la méchanceté qui existe ». Tel est le langage du Pythagoricien Théagès, dans le premier Discours de Stobée. (10) Heinsius a suivi la leçon vulgaire, et a lu ἐπικαύση. J'ai mieux aimé, avec Markland, lire ἐπικλαύση, et par les mêmes raisons que lui. Il est évident que le dernier mot s'adapte mieux à la marche du trope de notre Auteur. Et, à propos de cette correction, ce docte critique l'applique, en même temps, à un passage du dernier chapitre du Traité du Sublime de Longin, dont voici, à-peu-près, le sens : « Au surplus, constitués (sous le rapport moral) comme nous le sommes, ne nous vaut-il pas mieux avoir des maîtres que d'être libres ? Car, si l'on ôtait toute entrave à nos passions ; semblables à ces forcenés, qui, délivrés de leurs chaînes se jettent sur tout ce qui se présente, elles rempliraient l'univers d'un déluge de calamités ». Pensée remarquable, et bien propre à fixer la méditation de ces songes creux politiques, qui croient possible chez des Nations corrompues par tous les vices de la civilisation, ce qui ne serait praticable qu'avec des hommes faits pour la République de Platon, ou pour l'Utopie de Morus ! (11)Voyez ci-dessus Dissert. XVI, sect. 9, où notre Auteur emploie la même comparaison. (12) C'est la pensée de Sophocle, dans son Ajax, vers 158 et suiv.
Καίτοι σμικροὶ μεγάλων χωρὶς (13) Il paraît que tous les manuscrits s'accordent à répéter ici le mot liberté, que Maxime de Tyr a placé plus haut, « A la bonne heure, dit Markland, dans une analogie fondée sur des données prises dans l'ordre politique. Mais, ici, où l'analogie semble se renfermer dans la sphère philosophique, il est naturel de penser que Maxime de Tyr se sera servi du mot de la chose, qui est l'objet fondamental dans cette sphère; savoir, le bonheur; comme il a employé celui qui joue le même rôle dans l'ordre politique ; savoir, la liberté. D'ailleurs, en terminant cette Dissertation, et en résumant tous ses développements, il parle du bonheur de l'âme, et non pas de sa liberté. » Ces considérations m'ont décidé pour la conjecture de Markland. (14) Reiske a judicieusement aperçu que le texte était corrompu en cet endroit; et il l'a très heureusement corrigé. Il est étonnant que, ni Davies, ni Markland, n'aient point été arrêtés parle galimatias de ce passage. (15) Reiske pense, ici, que la particule négative est échappée aux copistes. Cela m'a paru évident, et j'ai traduit en conséquence. (16) Markland conjecture ici, quelque corruption. Cette idée peut paraître hasardée, puisqu'on tire du texte, tel qu'il est, le sens qu'il imagine, avec raison, être celui de Maxime de Tyr. En ôtant à la science l'empire des bonnes mœurs, pour ne l'attribuer qu'à la raison, notre Auteur se montre assez fidèle à la doctrine de Platon, son maître qui niait que la vertu pût être enseignée. L'annotateur Anglais remarque, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de subtilité dans ce qui précède; et il doute d'avoir bien saisi Maxime de Tyr. Il faut, en effet, une prodigieuse contention d'esprit, et une grande habitude des méditations métaphysiques, pour suivre les philosophes de l'antiquité, dans les espaces imaginaires de l'entendement où ils se jettent quelquefois. (17) Iliade, chant second, vers 205. (18) Lisez ci-dessous la note. (19) Les manuscrits ne sont pas d'accord sur la véritable leçon de ce passage. J'ai cru devoir lire, en corrigeant la leçon de ceux que Davies a consultés, τὶ οὖν οὐκ ἄλλο ἡ ἐπιστήμη ἢ ἀρετή. (20) L'original porte à la lettre, je vois que vous avez à la main de quoi me répondre, etc.. (21) Maxime de Tyr a raison de prendre, ici, le nom de Jupiter à témoin. Les Platoniciens avaient une si haute opinion de la vérité, ils en regardaient la science comme si étroitement liée avec le bonheur de l'homme, « qu'à leurs yeux, c’était un moindre crime de tuer quelqu'un, sans le vouloir, que de le tromper sur le sujet du Beau, du Bon, du Juste et de l’Honnête ». Aussi Socrate, près de traiter une matière importante, et sur laquelle il est de la dernière conséquence de ne pas se tromper, invoque-t-il Adrastée, (la Divinité chargée de punir les crimes involontaires) et la conjure-t-il de ne pas lui imputer l'erreur où il n'est pas impossible qu'il tombe, quelque bonne foi qu'il mette à découvrir la vérité. Voyez la République de Platon, liv. V, au commencement. (22) Cette doctrine, comme on voit, n'est pas celle du péché originel. (23) Selon les philosophes, les hommes ne sont vicieux, que parce qu'ils sont ignorants ; et ils en concluent que l'ignorance détruit la spontanéité, dans l'origine du vice. « Si quelqu'un, dit Alcinoüs, dans le chap. iii de son Introduction à la philosophie de Platon, Si quelqu'un se laisse aller a la méchanceté, ce ne sera pas vers le mal, qu'il croira se porter, mais vers le bien ; et, si quelqu'un tombe dans le mal, à bon escient, c'est une erreur, c'est-à-dire, que d'un petit mal, il croyait en retirer un grand bien. Or, c'est en cela qu'il agit involontairement. Car il est impossible de désirer le mal, en tant que mal, sans en espérer du bien, ou sans avoir pour but d'éviter un plus grand mal ». Voyez les grandes Morales d'Aristote, liv. III, chap. I; Arrien sur Epictète, liv. I. chap. 26; Sénèque, de la Colère, liv. I, n° 14 ; et de la Constance du Sage, chap. 9.
Paris, le 16 brumaire an IX. (7 novembre 1801.)
|