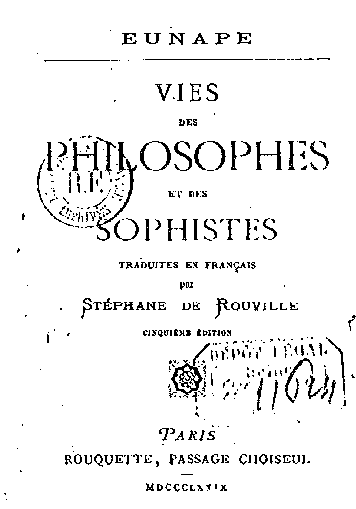|
ALLER à LA TABLE DES MATIÈRES D'EUNAPE
EUNAPE
VIES DES PHILOSOPHES
ET DES SOPHISTES
INTRODUCTION
LE sage Xénophon est le seul homme, parmi tous les philosophes, qui ait manifesté sa doctrine aussi bien dans ses actes que dans ses écrits. En effet, si d'un côté, ses traités et ses ouvrages ont eu pour objets la morale et la vertu ; de l'autre, il s'est placé au premier rang par ses exploits, au point que son exemple a produit des généraux remarquables. Et certes, si Xénophon (1) n’eût pas existé, Alexandre n'aurait pas été surnommé le Grand. Le même philosophe est d'avis que l'on doit rapporter jusqu'aux moindres faits des grands hommes. Pour moi, ce ne sont pas leurs actions secondaires, mais leurs travaux les plus importants que j'ai dessein de faire connaître. Car, si l'on juge digne de mémoire les enfantillages mêmes de la vertu, il serait vraiment impie de passer sous silence ses plus sérieux efforts. Le présent livre s'adresse donc à ceux qui voudront bien le lire, non comme un traité complet embrassant l'ensemble du sujet, - car il était impossible de recueillir minutieusement tout les détails, - ni comme une oeuvre critique, distinguant les uns des autres les meilleurs philosophes et les rhéteurs les plus recommandables : c'est simplement un exposé de ce qui fut habituel à chacun d'eux. Quant à décider à qui appartient la première place, parmi ceux, dont il est question dans ce recueil ; le soin en est laissé à qui voudra le faire, d'après les données qu'il y trouvera : telle est, du moins, l'intention de l'auteur. Celui-ci a mis la main sur des documents réputés exacts ; grâce à eux, s'il s'écarte de la vérité, il pourra ou rejeter la faute sur autrui, comme fait le bon disciple qui est tombé sur de mauvais maîtres, ou bien accuser à son tour avec juste raison, en s'appuyant sur des autorités dignes de respect et en présentant un travail net et irréprochable, comme celui d'un écrivain qui a pris pour guides ceux qu'il devait prendre. Du reste, pour ne rien dire de plus, ceux qui ont traité ce sujet sont rares, il n'en existe même qu un très petit nombre ; le lecteur ne saurait donc être privé ni de ce qui a été écrit par les auteurs précédents, ni de ce qu'a fourni jusqu'aujourd'hui la tradition orale. Aussi, une part convenable sera-t-elle faite, à ces deux sources d'informations ; et, de cette manière, les renseignements déjà écrits conserveront toute leur autorité, tandis que les traditions orales, toujours ébranlés et transformés par l'effet du temps, seront coordonnées et confirmées par l'écriture qui leur assurera la stabilité et la durée. De ceux qui ont recueilli l'histoire de la philosophie. L’HISTOIRE de la philosophie et les vies des philosophes ont été recueillies par Porphyre et Sition (2). Mais le premier a cru devoir s'arrêter à Platon et à son époque, quant au second, il est allé plus loin, bien qu'il soit antérieur à Porphyre. Cependant, l'histoire des philosophes et des sophistes, dont la vie a rempli l'intervalle, manquait du développement exigé par la grandeur et la variété du sujet. Il y a aussi Philostrate de Lemnos (3) qui a esquissé, en courant et avec une forme assez agréable, les vies des meilleurs sophistes. Mais, en général, personne n'a écrit avec exactitude sur le compte des philosophes : parmi eux, je citerai l'Égyptien Ammonius (4), le précepteur du divin Plutarque ; Plutarque lui-même, le charme et la grâce de toute philosophie ; Euphrate d'Egypte (5), Dion de Bithynie (6), surnommé Chrysostome, c'est-à-dire Bouche d'Or ; Apollonius de Tyane (7), qui n'est déjà plus un philosophe, mais qui tient en quelque sorte le milieu entre les Dieux et les mortels, car, disciple de la doctrine pythagoricienne, il en accrut encore la force et le divin caractère. Philostrate de Lemnos a écrit sur lui un livre complet qu'il a intitulé : Vie d'Apollonius ; et qu'il eût mieux fait d'appeler : Séjour d'un dieu parmi les hommes. Carnéade (8) appartient également à cette époque : ce n'est pas un des moins célèbres parmi les Cyniques, si l'on doit tenir quelque compte de cette secte. Parmi ses représentants, il y avait Musonius, Démétrius, Ménippe (9), et d'autres en plus grand nombre ; mais ceux-ci étaient les plus illustres. De tous ces grands hommes, on ne saurait trouver de biographies certaines et exactes, puisque personne n'en a fait, que je sache. Leurs ouvrages, toutefois, ont suffi et suffisent encore à en tenir lieu ; car ils sont remplis d'une telle érudition et d'une telle science d'observation, - pour ce qui regarde la morale et la vertu ainsi que les diverses catégories de la nature des choses, - qu'ils dissipent comme un brouillard l'ignorance de ceux qui peuvent en faire leur étude. Le divin Plutarque, lui, a semé de côté et d'autre, dans ses livres, des données sur sa propre vie et sur celle de son maître ; il a mentionné également la mort d'Ammonius à Athènes ; mais il n'a pas réuni ces renseignements épars en une biographie. Cependant, le plus beau de ses ouvrages est le recueil désigné sous le titre de Vies parallèles des hommes illustres. S'il s'est borné à disséminer, dans chacun de ses livres, ce qui le concerne particulièrement et ce qui a rapport à son maître ; c'est qu'il a voulu que le lecteur en cherchant avec soin, en suivant la trace de tout ce qu'il rencontrerait, en recueillant avec précaution les moindres parcelles de documents, pût se rendre compte de la plupart des actes de la vie de l'un et de l'autre. Lucien de Samosate (10), cet auteur qui travaillait avec tant de sérieux à exciter le rire, a écrit la vie de Démonax (11), un philosophe de son temps : c'est un des sujets qu'il a traités gravement, et il n'en existe guère beaucoup de lui. Je rappelle ces différents travaux, tout en sachant bien que, dans la quantité, il y en a quelques-uns qui peut-être nous ont échappé, mais qu'il en est aussi d'autres qui n'ont pu se soustraire à nos investigations. Après avoir appliqué le plus grand soin et la plus scrupuleuse attention à constituer une histoire suivie et exactement déterminée des hommes, qui se sont illustrés dans la philosophie et dans l'art oratoire, j'en suis à chercher encore la satisfaction de mes désirs, et j'éprouve quelque chose de pareil à ce que ressentent les amoureux brûlant d'une flamme insensée. Ceux-ci, en effet, lorsqu'ils voient leur bien-aimée et que sa délicieuse beauté leur apparaît, baissent les yeux, ne pouvant soutenir l'éclat de ce qu'ils avaient tant désiré et comme inondés de sa lumière. Mais, s'ils aperçoivent son brodequin, son bandeau, ou une de ses boucles d'oreilles, moins intimidés par l'aspect de ces objets, ils se laissent aller à toute leur passion et se consument dans cette contemplation : il leur est plus facile alors de supporter la vue de ces symboles de la beauté que celle de la beauté elle-même, et ils s'en contentent. C'est avec le même enthousiasme que je me suis jeté dans le genre d'écrits que je présente ici, pour que le silence et l'envie n'obscurcissent point tout ce que j'ai appris, soit par la tradition, soit par la lecture, soit par le récit de mes contemporains. En agissant ainsi, j'ai élevé autant qu'il m'a été possible, sinon un temple à la Vérité, au moins un vestibule, afin de la transmettre à ceux qui, plus tard, voudront la connaître ou se sentiront, la force de suivre le chemin de la Vertu. L'enchaînement des siècles a subi une sorte de rupture et de solution de continuité, en raison des malheurs publics. Aussi, la troisième génération des philosophes n'a-t-elle paru qu'au temps de Claude et de Néron : la seconde, qui remplit le monde de sa célébrité, étant celle qui vint après Platon (12). Quant à ces malheureux Empereurs, qui, tous ensemble, occupent à peine l'espace d'une année, ce serait faire un vain étalage de zèle que de les compter ; ce sont les Galba, les Vitellius, les Othon ; mais, après ceux-là, Vespasien, Titus et leurs successeurs arrivèrent à l'empire. A prendre donc les choses en bloc, rapidement et d’une manière sommaire, on peut dire que l'époque des plus grands philosophes s'étend jusqu'à Sévère (13). Certes, il est heureux pour les rois, et l'histoire le démontre bien, que les moments où la vertu domine soient aussi ceux où la fortune est le plus favorable. Mais c'est assez ; et personne ne trouvera mauvais, nous osons l'espérer, que nous ayons disposé les temps, de façon à pouvoir en tirer les meilleures inductions et à donner à notre travail un point de départ convenable. PLOTIN LE philosophe Plotin était Égyptien. A ce renseignement, j'ajouterai le nom de sa ville natale, qui fut Lycopolis (14). Il est étonnant que le divin philosophe Porphyre n'ait point consigné ce fait, lui qui affirme avoir été son disciple et avoir passé avec lui la totalité ou du moins la majeure partie de son existence. Les autels de Plotin fument encore, et ses livres (15) préférés à ceux des Platoniciens sont entre les mains non seulement des savants, mais de la foule elle-même qui, pour peu qu'elle goûte à cet enseignement, s'empresse d'y conformer sa conduite. Porphyre a raconté sa vie avec de tels détails qu'il serait impossible d'y rien ajouter (16). Il paraît même avoir commenté plusieurs de ses ouvrages. Mais personne, que je sache, n'a encore écrit la vie de Porphyre lui-même. Voici, pour moi, ce que j'ai appris, à cet égard ; par les documents que m'ont fourni mes lectures. PORPHYRE PORPHYRE eut pour patrie la ville de Tyr, la première des cités de l'antique Phénicie, et ses ancêtres ne furent point dépourvus d'illustration. Il reçut une éducation, en rapport avec la condition de sa famille ; et il obtint des progrès si rapides, il y mit tellement du sien qu'étant devenu le disciple de Longin (17), il fit, en très peu de temps, le plus grand honneur à son maître. Longin, à cette époque, était une sorte de bibliothèque vivante et de musée ambulant, et l'on s'en remettait à lui du soin de juger les anciens. Plusieurs autres, avant lui, avaient exercé une pareille autorité de critique ; mais le plus célèbre de tous avait été Denys de Carie. Porphyre s'était d'abord appelé, dans la capitale de la Syrie, Malchus, ce qui veut dire roi (18). Longin le nomma ensuite Porphyre, empruntant cette dénomination au vêtement qui est le signe extérieur de la royauté (19). Porphyre fut initié par Longin aux plus hautes études et s'éleva, comme lui, au sommet des connaissances humaines, pour tout ce qui touche à la grammaire et à la rhétorique. Toutefois, il ne se contenta pas de cela et pénétra jusqu'aux plus profonds arcanes de la philosophie. Quant à Longin, il fut de beaucoup le premier de ses contemporains ; il circule de lui de nombreux ouvrages (20), qui, tous excitent une juste admiration. Si l’on hasardait une critique contre, quelque auteur ancien, cette opinion n'arrivait à prévaloir, que si elle était pleinement confirmée par le jugement de Longin. C'est ainsi qu'avait été conduite la première éducation de Porphyre ; et, déjà, il attirait à lui les regards de tous. Alors, il eut le désir d'aller à. Rome, et de captiver par l'ascendant de sa science l'attention de la grande ville. Dès qu'il y fut arrivé, et qu'il se fut fait admettre dans la familiarité de l'illustre Plotin, il laissa de côté tous les autres et s'attacha uniquement à lui : se gorgeant, comme il le dit lui-même de savoir, sans parvenir à s'en rassasier et dévorant les paroles du maître qui semblaient couler d'une source divine, il put durant un certain temps supporter cet enseignement. Mais, ensuite, vaincu par la grandeur d'une telle doctrine, il prit en haine l'enveloppe charnelle de l'homme et l'humanité. Il fit bientôt voile pour la Sicile, traversa le détroit, tout près de Charybde, là où la tradition place le passage d'Ulysse, et il ne lui fut plus possible de soutenir la vue d'une ville, ni d'entendre la voix des mortels. Il se désintéressa ainsi de toute espèce de douleur et de plaisir. Puis, s'étant rendu à Lilybée (21), l'un des trois promontoires de la Sicile et celui qui regarde l'Afrique, il demeura là, gémissant et se macérant, sans prendre même de nourriture, et fuyant l'approche de ses semblables. La surveillance du grand Plotin ne fut pas en défaut dans cette occasion : il se mit à chercher le jeune fugitif, suivit ses traces, et le trouva dans cet état de mélancolie contemplative ; il n'épargna pas les paroles les plus propres à retenir cette âme sur le point de prendre son vol hors du corps, et rendit enfin à celui-ci les forces nécessaires pour le rattacher à la vie. Porphyre, rappelé à l'existence, se releva et consigna plus tard, dans le recueil de ses oeuvres, les paroles qui lui furent dites alors. Les philosophes, ordinairement ont coutume. d'envelopper d'obscurité leurs secrets, comme les poètes cachent les leurs, sous le voile des mythes ; Porphyre, lui, grand partisan du remède de la clarté dont il avait fait l'essai, vulgarisa la doctrine dans le commentaire qu'il en écrivit. De retour à Rome, il s'attacha à l'étude de l'éloquence et se produisit en public dans le but d'exposer ses principes. Au forum et dans la foule, on rapportait à Plotin toute la gloire de Porphyre. Mais si Plotin, par l'essence divine de son âme, par le caractère obscur et un peu énigmatique de ses discours, en imposait à la multitude, celle-ci le comprenait difficilement. Porphyre, au contraire, pareil à une chaîne d'Hermès (22) rattachant les hommes au ciel, expliquait tout, grâce à la variété de ses connaissances, avec clarté, et de façon se faire entendre admirablement. On peut en juger, quand il raconte, dans un écrit, qui vraisemblablement date de sa jeunesse, qu'il reçut un oracle tout à fait au-dessus de la portée du vulgaire ; il le transcrit dans ce même ouvrage, et il se donne beaucoup de peine pour démontrer avec quel soin l'on doit aborder un sujet semblable. Il ajoute même, à ce propos, qu'il fit sortir et chassa du bain un démon, que les gens du pays appelaient Causathan. Ses condisciples les plus remarquables furent, toujours d'après son autorité, Origène (23) Amérius (24) et Aquilinus, dont on a conservé les écrits ; mais ces ouvrages ne jouissent guère de beaucoup d'estime, pare qu'ils sont totalement dépourvus de grâces ; toutefois, la doctrine en est belle et ne manque pas de développements. Porphyre, d'ailleurs, accorde des éloges à ces écrivains pour leur habileté ; et, certes, il ne pouvait y avoir de meilleur juge que lui des charmes du style ; puisqu'il les possédait au plus haut degré. A lui seul, il fit donc paraître toute la gloire de son maître et en devint comme le héraut, car il ne laissa aucune partie de la science sans l'aborder. Il y a certainement lieu d'être frappé d'admiration et de se demander de quel côté il se porta avec le plus de talent : si ce fut vers les matières qui constituent l'art oratoire, ou vers les règles minutieuses de la grammaire, s'il s'adonna de préférence à tout ce qui dépend des nombres, ou à la géométrie, ou à la musique. Quant à sa philosophie, elle n'est pas accessible à la raison humaine, et on ne saurait en exprimer les principes dans le langage ordinaire. Laissons alors tout ce qui tient à la physique et à la théurgie dans le domaine des initiations ou des mystères et disons que cet homme fut comme un composé et un résumé de toutes les vertus ; à ce point qu'on ne sait vraiment, en y regardant de très près, ce que l'on doit louer le plus en lui, de la beauté de son élocution, de la pureté de son enseignement ou de la force de sa dialectique. On est fondé à croire qu'il se maria ; l’on possède, en effet, un livre adressé à sa femme Marcella (25) qu'il épousa, dit-il lui-même, alors qu'elle était mère de cinq enfants, non point dans l'intention d'en avoir d'autres, mais pour faire l'éducation de ceux qui existaient déjà ; car Marcella était la veuve d'un de ses amis à qui ces enfants devaient le jour. Porphyre semble être parvenu à une vieillesse avancée ; aussi, rencontre-t-on, dans plusieurs de ses ouvrages (26), des théories opposées à celles qui se trouvent déduites dans ses premières productions ; tout ce qu'on peut inférer de là, c'est que le progrès de l'âge l'amena à modifier ses sentiments. Il passa, dit-on, son existence à Rome. A cette époque, les maîtres de l'éloquence d'Athènes étaient Paulus (27) et le Syrien Andromachus. La vie de Porphyre se prolongea jusqu'aux temps de Gallien et de Claude, de Tacite, d'Aurélien et de Probus (28). C'est sous ces princes que vécut aussi Dexippe (29), auteur d'une Histoire, en forme de chronique, homme doué d'un mérite supérieur dans toutes les branches de la science, et d'une puissante faculté de raisonnement. CHAPITRE IV JAMBLIQUE APRÈS Porphyre et Plotin, le plus renommé entre les philosophes est Jamblique, qui était d'une naissance illustre et dont les ancêtres avaient été puissants et riches. Sa patrie fut Chalcis (30), ville de la Coelé-Syrie (31). Il s'attacha d'abord à Anatolius, dont la place est marquée immédiatement après Porphyre ; il fit dès lors de si grands progrès, qu'il parvint bientôt au sommet de la philosophie. Ensuite, il quitta Anatolius pour suivre Porphyre, à qui il ne fut certes inférieur en rien, si ce n'est pour l'arrangement des mots et la puissance du style. Ses discours, en effet, ne sont imprégnés ni du charme ni de la grâce qu'on rencontre chez Porphyre : ils ne brillent ni par la transparence ni par la pureté. Cependant, ils ne sont pas tout à fait obscurs, et les fautes de langage n'y sont point générales. Mais, comme le disait Platon en parlant de Xénocrate (32), Jamblique n'a pas sacrifié aux Grâces, chéries de Mercure. Aussi, loin de s'emparer de son lecteur et de l'inviter à lire ses écrits, semble-t-il le repousser et lui écorcher les oreilles. Il pratiqua la justice, et, pour cela, sut se concilier la bienveillance des, dieux, à tel point que ses disciples formaient une véritable multitude et que, de toutes parts, on accourait vers lui dans le désir de s'instruire. Il est bien difficile de jugez ce qu'il y eut de mieux dans cette foule. On peut distinguer cependant le Syrien Sopater, qui se montra fort habile à parler et à écrire, Edésius et Eustathe de Cappadoce, les Grecs Théodore et Euphrasius, qui, eux, excellèrent dans la vertu. Il y en eut encore une grande quantité d'autres, qui ne furent guère beaucoup au-dessous de ceux-là dans l'art de bien dire; aussi on s'étonne que le maître ait pu suffire à tant de disciples ; il est vrai qu'il se prodiguait entièrement à eux. En effet, il faisait peu de choses par lui-même en dehors de ses compagnons et de ses élèves ; de plus, il avait une profonde vénération pour la Divinité. Il passait là plus grande partie de son temps dans la société de ses amis, et sa vie était frugale et antique. Mais la conversation qu'il tenait à table charmait si bien ses convives qu'il semblait les abreuver de nectar. Les disciples, se trouvant sans cesse avec le maître, jouissaient de sa vue sans pouvoir jamais s'en rassasier ; ils l'importunaient continuellement ; et faisant porter la parole par les principaux d'entre eux, ils lui disaient : « Pourquoi donc, ô divin maître, gardes-tu pour toi certains secrets, et ne nous fais-tu pas participer à toute la perfection de ta sagesse ? Le bruit est venu jusqu'à nous par tes esclaves, qu'en priant les dieux tu parais t'élever du sol à plus de dix coudés, et que ton corps ainsi que ton vêtement prennent une belle couleur d'or. Puis, quand tu as cessé de prier, ton corps redevient ce qu'il était avant, et, redescendant sur terre, tu reprends alors tes entretiens avec nous. » Quoique peu rieur, Jamblique ne put s'empêcher de rire à ces paroles. « Celui qui vous a trompés, leur dit-il, ne manquait point d'esprit. Car, en vérité, il n'en est pas ainsi. Mais, à l'avenir, rien ne sera fait en dehors de vous. » C'est ce qui eut lieu, en effet ; et celui qui écrit ces lignes le tient de son maître, Chrysanthe de Sardes. Celui-ci fut le disciple d'Edésius qui, lui-même, avait été au nombre des premiers auditeurs de Jamblique et l'un de ceux qui lui parlèrent, comme il vient d'être rapporté. Edésius, à ce propos, disait que c'était là évidemment, de grandes preuves de la divinité de Jamblique. Une autre fois, le soleil paraissait vers les limites de la constellation du Lion, lorsque celle-ci se lève en compagnie du signe céleste Appelé le Chien. C'était le temps du sacrifice. On l'avait préparé dans une des propriétés suburbaines du maître. Tout s'était bien passé, et la petite troupe s'en retournait vers la ville lentement et à loisir, en causant ; car il s'était élevé une discussion sur les dieux, tout à fait en harmonie avec le sacrifice qu'on venait de célébrer. Au milieu du discours, Jamblique eut subitement l'esprit distrait ; la voix lui manqua, ses yeux demeurèrent figés sur le sol ; et, après un certain temps, les relevant sur ses compagnons, il leur cria : « Prenons une autre route, car on vient d'apporter là, un cadavre. » Ayant ainsi parlé, il alla par un chemin qui paraissait plus net. Il fut suivi par quelques-uns de ses disciples, à qui il sembla honteux d'abandonner leur maître. Mais la plupart, et les plus obstinés de ses compagnons, parmi lesquels se trouvait Edésius, restèrent où ils étaient, attribuant la chose à quelque jonglerie, et cherchant la preuve, comme des chiens qui flairent une piste. Quelques moments après, apparurent ceux qui venaient d'ensevelir le mort. Mais cela ne suffit point à nos incrédules, et ils demandèrent à ces gens-là s'ils étaient passés par cette route. « Il le fallait bien, répondirent-ils, puisqu'il n'y en a pas d'autre. » Ils furent bientôt en état dé rendre témoignage d'un fait plus divin que celui-là. Car, à ce sujet, ils importunaient souvent le philosophe, en disant que le prodige auquel ils avaient assisté était trop peu de chose ; qu'il pouvait, à la rigueur, provenir d'une finesse d'odorat toute particulière, et qu'ils voulaient maintenant faire l'épreuve de quelque merveille plus grande. « Cela ne dépend pas de moi, leur dit-il ; il faut que l'occasion se présente. » Quelque temps après, ils se rendirent tous à Gadara (33). Ce sont des bains chauds de Syrie cette station thermale est la seconde en importance après celle de Baies (34), sur le territoire de l'Empire romain, et on ne peut lui en comparer aucune autre. C'est, d'ailleurs, à Gadara qu'on va passer l'été. Jamblique était donc en train de se baigner là, et ses compagnons en faisaient autant, Ils revinrent à la charge au sujet des prodiges. Jamblique se mit à sourire. « Ces révélations, dit-il, ne sont guère conformes aux devoirs de la piété ; cependant, pour vous faire plaisir, je passerai là-dessus. » Il y avait deux sources chaudes, moins importantes que les autres, mais d'un aspect beaucoup plus gracieux. Le maître commanda alors à ses disciples de s'informer, auprès des gens du pays, du nom que l'on donnait de temps immémorial à ces deux fontaines. Lorsqu'ils eurent obéi : « Vous n'avez plus, dirent-ils, aucun prétexte à mettre en avant ; »L'une de ces sources s'appelle Éros (35) et la voisine, Antéros (36). » Jamblique, qui se trouvait assis sur le bord d'une des fontaines, à l'endroit où l'eau commence à se déverser, effleura l'onde de la main, et, murmurant quelques paroles, fit sortir aussitôt du fond de la source un petit enfant. Il était blanc, d'une taille bien proportionnée ; et sa chevelure, aux reflets dorés, couvrait de son rayonnement son dos et sa poitrine. On aurait juré qu'il se baignait là ou qu'il venait de s'y baigner. Les disciples étaient frappés d'étonnement. « Allons à l'autre fontaine », dit Jamblique; et, se levant, il marcha devant eux, plongé dans la méditation. Arrivé prés de la source, il refit ce qu'il avait fait près de la première, et en tira un autre Amour, entièrement semblable au précédent, si ce n'est que, ses cheveux, qui flottaient aussi sui son cou, étaient noirs et comme brûlés par le soleil. Les deux enfants se mirent à entourer Jamblique de leurs bras et s'attachèrent à lui, comme s'il eût été véritablement leur père. Celui-ci, les ayant remis chacun dans la source d'où il avait été tiré, sortit enfin du bain, au milieu des marques de vénération de ses disciples, qui, dès lors, cessèrent de vouloir rien approfondir; entraînés par tout ce qu'ils voyaient, comme par des attaches mystérieuses, ils crurent tout aveuglément. On colportait sur lui bien d'autres histoires plus incroyables encore et plus merveilleuses ; mais je n'ai voulu en consigner aucune ici, persuadé qu'il est dangereux et même impie d'introduire des récits altérés et sans consistance dans un ouvrage sérieux et solide. Je ne suis pas même sans quelque inquiétude, relativement à ce que je rapporte ici, puisque je ne parle que par ouï-dire. Toutefois, je ne fais que suivre là le témoignage d'hommes qui, se défiant des autres, ont subi uniquement l'influence de leurs sensations visuelles. Quoi qu'il en soit, aucun des compagnons de Jamblique, à ce que je puis savoir, n'a rien écrit là-dessus ; et si j'en ai parlé personnellement, c'est avec réserve ; car Edésius a pris soin de oire remarquer qu'il n'a rien écrit lui-même à ce sujet, et que nul autre n'a osé le faire. En même temps que Jamblique, vivait Alypius (37), consommé dans la dialectique. La taille de ce dernier était tout à fait exiguë et son corps dépassait à peine la longueur d'une coudée ; aussi, à voir le peu d'apparence de sa personne, on l'eut pris volontiers pour une âme, une pure intelligente. Chez lui, la partie de l'être soumise à la corruption né s'était point développée, et la partie la plus semblable à la Divinité avait presque tout absorbé. Le grand Platon dit qu'au rebours de ce qui se passe sur la terre, les corps divins sont entourés de leurs âmes : Alypius, lui, avait en quelque sorte pénétré dans la sienne, au point qu'il semblait contenu et possédé par elle, comme par une puissance supérieure. Alypius eut beaucoup de disciples ; mais son enseignement ne dépassait guère les bornes de la conversation intime : personne n'avait entre les mains un livre de lui. Aussi, les auditeurs accouraient-ils avec le plus vif empressement vers Jamblique, comme pour puiser à une source dont les eaux débordaient et ne se renfermaient point dans les limites étroites de leur lit. La gloire des deux philosophes se répandit de plus en plus, et il leur arriva un jour, de se trouver face-à face, comme deux astres, et d'être entourés d'un concours d'auditeurs tel, qu'on eût cru voir une vaste académie. Jamblique se tenait sur la réserve, aimant mieux se laisser interroger que déposer des questions. Alypius, contre toute attente, ne souleva pas le moindre sujet de discussion purement philosophique ; mais, se mettant à la portée de l'assemblée, il s'adressa en ces termes à Jamblique : « Dis-moi, philosophe, le riche est-il, oui ou non, injustice, ou héritier de l'injuste? Car il n'y a pas de milieu. » Jamblique ne put supporter le coup qui lui était porté : « Cette manière de discuter, dit-il, n'est point la nôtre, ô le plus extraordinaire des hommes ! nous ne nous occupons pas des avantages extérieurs que chacun peut posséder, mais des qualités essentielles de l'âme et des vertus qui conviennent au philosophe. » Ayant ainsi parlé, il se leva ; et l'assemblée, se dispersa aussitôt. Jamblique, après cela, étant redevenu maître de lui-même, admira la pénétration d'Alypius. Il le vit souvent en particulier, et fut tellement émerveillé de la précision et de la profondeur de s'on jugement, que, lorsqu'il fut mort, il se fit l'historien de sa vie (38). Celui qui écrit ces lignes a eu connaissance de cette biographie : elle présente une certaine obscurité de forme et semble couverte d'un nuage épais ; non que les faits manquent de clarté, mais on y trouve une longue dissertation didactique sur Alypius, et il n'y est question nullement de discussions qui aient vraiment raison d'être. Le livre parle de voyages à Rome dont on ne voit point la cause, et la grandeur d’âme d'Alypius n'en ressort pas suffisamment. Il constate bien qu'un grand nombre d'hommes ont passé pour être les admirateurs du philosophe, mais il ne signale point les paroles ou les actions d'éclat qui lui ont valu cette admiration. L'illustre Jamblique paraît être tombé dans la même faute que les peintres qui, faisant les portraits de personnes à la fleur de l'âge, et voulant ajouter à leur oeuvre quelque charme tiré de leur imagination, compromettent ainsi toute la ressemblance, et s'écartent également de leur modèle et de la beauté idéale. De même, Jamblique, dont le but était de louer Alypius, en disant la vérité, s’amuse à nous apprendre quel était de son temps la grandeur des châtiments et des tortures en usage dans les tribunaux, et cela, sans avoir la possibilité ni l'intention de nous faire connaître les causes ou les raisons politiques d'un tel état de choses : aussi, a-t-il confondu tous les traits de la vie d'Alypius. C'est au point que les yeux les plus exercés n'y peuvent découvrir qu'avec peine pourquoi il admire tant ce philosophe, et encore moins pourquoi il vénère d'une manière si extraordinaire sa constance, son impassibilité en présence du danger, la promptitude et la concision de ses réponses. Alypius, dont nous venons de parler, était d'Alexandrie il s'éteignit dans cette ville, à un âge avancé. Après lui, mourut Jamblique, à qui l'on doit, assurément, d'avoir vu se multiplier, pour ainsi dire, les racines et les sources de la philosophie. L'auteur de cet écrit, lui, a eu le bonheur de profiter de cet enseignement. Plus tard, d'autres disciples, précédemment cités, se sont dispersés sur toute la surface de l'Empire romain : l'un d'eux fut Edésius, qui s'établit à Pergame 390 de Mysie. ÉDÉSIUS L'ÉCOLE de Jamblique et son groupe d'élèves passèrent à Edésius de Cappadoce. L'origine de sa famille était des plus illustres, mais sa fortune ne répondait point à sa naissance ; aussi, son père l'avait-il envoyé de Cappadoce en Grèce pour y apprendre quelque état lucratif. Au retour du jeune homme, le père l'accueillit comme s'il allait trouver en son fils un trésor. Mais, quand il vit qu'il s'était adonné à l'étude de la philosophie, il le chassa de la maison ainsi qu'un être inutile, en le poursuivant de ces paroles : « A quoi sert la philosophie? » « A beaucoup de choses, mon père, » répliqua Edésius, en se prosternant devant lui. A ces mots, son père le rappela, émerveillé de tant de vertu. Dès lors, Edésius se donna tout entier à l'étude, qu'il avait un moment interrompue. Et le père, plein de joie et d'enthousiasme, reconduisit son fils avec la fierté d'un homme qui aurait engendré un dieu et non un mortel. Notre philosophe ne tarda pas à laisser derrière lui tous ceux dont le nom était le plus célèbre, à cette époque, et dont il avait été l'auditeur ; l'expérience lui fournit un bagage philosophique considérable, et il eut peu de chemin à faire, de Cappadoce en Syrie, pour aller rejoindre l'illustre Jamblique. Aussitôt qu'il eut vu l'homme et qu'il l'eut entendu parler, il demeura suspendu à ses lèvres, ne pouvant se rassasier de l'écouter. Ce fut au point qu'Edésius finit par n'être pas de beaucoup inférieur à Jamblique, excepté toutefois en ce qui touche à l'inspiration divine, dont ce dernier était véritablement animé. Nous n'avons, à ce sujet, aucune donnée ; il se peut, cependant, qu'Edésius lui-même ait joui de ce privilège sans pouvoir le manifester ; car, à ce moment-là, régnait Constantin (40), qui détruisait les temples les plus fameux de l'univers, et faisait élever des édifices pour le culte des chrétiens. Peut-être donc, le groupe choisi de ses disciples se trouvait-il obligé d'observer un silence plein de mystère et de garder une réserve digne d'un hiérophante (41). En effet, celui qui écrit ces lignes fut, dès l'enfance, l'élève de Chrysanthe ; et ce fut seulement vers sa vingtième année qu'on le jugea en état de participer à l'enseignement de vérités plus hautes, tant on a persisté, jusqu'à notre époque, à considérer la philosophie de Jamblique comme une grande chose. Lorsque le maître eut dépouillé l'enveloppe mortelle, ses disciples se dispersèrent de différents côtés ; mais où peut dire qu'aucun d'eux ne demeura privé de renommée, ni ne resta inconnu. Sopater, le plus éloquent de tous, avait trop d'élévation dans le caractère et trop de grandeur d'âme pour supporter de vivre ainsi parmi les autres hommes : d'une course rapide, il alla droit à la cour du prince, comme pour dompter la jactance et l'entraînement de Constantin et les soumettre à la raison. Là, il parvint bientôt à un tel degré de réputation et d'influence, que l'empereur, séduit par son prestige, le fit asseoir publiquement à sa droite. On n'avait, certaine'ment, jamais entendu ni vu pareille chose. Aussi, les courtisans crevaient de jalousie l'aspect de cette philosophie, dont l'enseignement s'introduisait sur le tard à la cour ; ils cherchèrent donc l'occasion de faire comme les Cercopes (42) et de surprendre, non seulement Hercule endormi, mais encore cette absurde Fortune, tout éveillée qu'elle était. Ils firent, alors, des assemblées secrètes ; et il n'est pas de machination perfide dont ils s'abstinrent. A Athènes, du temps de l'antique et grand Socrate, aucun citoyen, bien qu'on fût en république, n'eût osé porter une accusation contre celui que tous les Athéniens considéraient comme la statue vivante de la sagesse ; du moins, il eût fallu pour cela qu'il fût dans cet état d'ivresse et de folie dont la fête de Bacchus (43) et les veilles extraordinaires étaient l'occasion, et qu'il se trouvât ainsi excité au rire, à l'injure, à ces mouvements licencieux et pleins de périls, qui ont été imagines pour la perte de l'humanité. Aristophane (44) le premier, voulant provoquer l'hilarité chez des spectateurs dont l'esprit était corrompu, introduisit sur la scène des chants destinés à régler le pas des danseurs, et réussit à enlever tous les suffrages du théâtre par son audace ; car, à côté d'un personnage dont la sagesse était si grande, il ne craignit pas de montrer, comme par dérision, des sauts de puce ; il représenta même des formes et des costumes de nuées ; il prodigua, enfin, tout ce que le délire de la Comédie a coutume de forger pour exciter le rire. Mais il arriva, alors, que quelques hommes (45),voyant le théâtre incliner à ne plus être qu'un lieu de plaisir, eurent l'idée d'une accusation et commirent l'impiété de la porter contre cet homme, dont le meurtre fut un malheur pour le peuple tout entier. Il est en effet à remarquer, si l'on veut bien se rendre compte des temps, que, du moment où Socrate eut disparu victime de la violence, les Athéniens ne firent plus rien de glorieux : la République tomba en décadence, et toute la Grèce se perdit avec elle (46). On peut juger de même, à l'époque de Sopater, du complot ourdi contre lui. Voici ce qui se passa : Constantinople, c'est-à-dire l'antique Byzance, faisait pour les Athéniens, autrefois, le transport des blés, et ce qu'on amenait de là dépasse toute croyance. Mais, de nos jours, ni les nombreux navires qui arrivent de l'Egypte ni ceux qui viennent de l'Asie entière, de la Syrie et de la Phénicie, ni même les vivres fournis par les autres provinces, dans la proportion du tribut imposé à chacune d'elles, ne peuvent emplir et rassasier la populace ivre que Constantin a transportée à Byzance, après avoir vidé les villes de leurs habitants : véritable ramassis de misérables, dont il s'est entouré pour obtenir au théâtre des applaudissements; car il était friand des louanges que lui décernaient des ivrognes chancelants, et il aimait volontiers à s'entendre acclamer par des imbéciles qui, même, écorchaient son nom. Or, la position de Byzance est telle, qu'il est impossible aux vaisseaux d'y aborder, à moins que le vent du sud ne souffle fortement et sans mélange. Un jour, il ne souffla pas; ce qui arrive souvent par suite de la nature des saisons. Le peuple, alors, s'assembla au théâtre, épuisé par la faim ; et il ne se trouva plus de gens ivres pour hurler des vivats : l'Empereur fut consterné. Les envieux qui, depuis longtemps, épiaient une occasion, pensèrent, cette fois, en Avoir trouvé une magnifique ; « Sopater s'écrièrent-ils, Sopater que tu combles d'honneurs, a enchaîné les vents par la vertu extraordinaire de sa science, dont toi-même tu fais sans cesse l'éloge et grâce à laquelle encore il est assis à tes côtés, sur le trône impérial. » Le crédule Constantin entend cela, il est persuadé ; il ordonne de mettre à mort le philosophe. Et les calomniateurs eurent soin que l'exécution fût accomplie plus vite que la parole. Mais le véritable auteur de tout le mal fut Ablabius, préfet du prétoire, qui, voyant sa réputation éclipsée par celle de Sopater, séchait de jalousie. Comme je rédige, ainsi que je l'ai déjà dit, ces biographies d'hommes que leur science universelle a illustrés, d'après ce que j'ai pu conserver des traditions qui sont parvenues à ma connaissance, il ne me sera pas difficile de dire aussi, en courant, quelques mots de ceux qui se sont montrés leurs ennemis. Ablalius donc, qui avait tout préparé pour le meurtre de Sopater, était, d'une naissance fort obscure ; et l'origine de ses parents était bien au-dessous de la médiocrité, même de l'abjection. Voici, du reste, ce qu'on raconte de lui, et qui n'a été contredit par per-sonne : Un Égyptien, de ceux qui s'adonnent à la science appelée mathématique (47) était arrivé en ville. Les Egyptiens ont la réputation de se conduire d'une façon peu bienséante, quand ils sont en voyage ; et cela donne naturellement à penser qu'ils sont mal élevés chez eux. Aussi, notre homme se précipite-t-il dans la meilleure auberge de la ville, en criant qu'il est à jeun, qu'il a fait une longue route et qu'il meurt de soif. Là, il demande du vin doux et aromatisé, et met argent sur table. A cette vue, celle qui tenait l'auberge se prépare à remplir son office et se trémousse en conscience. Mais elle était en même temps habile dans l'art de délivrer les femmes en mal d'enfant. Elle venait donc de placer la coupe devant l'Egyptien et était occupée à verser le vin aromatisé, lorsqu'une voisine, accourant, lui glisse ces mots à l'oreille : « Ton amie et ta parente, - ce qui était vrai, - est dans les douleurs; et sa vie se trouve en danger, si tu ne viens vite. » A peine a-t-elle entendu, qu'avant même d'avoir ajouté l'eau chaude dans la coupe, elle plante là l'Égyptien ébahi. Elle court opérer la délivrance, achève tout ce qui doit se faire dans les accouchements, et reparaît promptement devant son hôte, après s'être lavé les mains. Elle le trouva furieux et bouillonnant de colère. Alors, elle lui expliqua la cause qui l'avait ainsi retardée. Des qu'il l'eut apprise, le brave Égyptien, s'avisant de l'heure, se montre plus pressé de la soif de dévoiler ses inspirations divines que de celle qui lui desséchait le gosier ; et, d'un ton superbe : « Va, dit-il, ô femme, et annonce à cette accouchée que peu s'en faut qu'elle n'ait enfanté un empereur. » Après cette révélation, il ingurgita, sans sourciller, le contenu de l'ample coupe et laissa son nom à l'aubergiste, pour qu'elle sût bien qui il était. L'enfant qu'on avait mis au monde ce jour-là était Ablabius. Il devint si bien le jouet de la Fortune, qui bouleverse toutes choses, qu'il fut plus puissant que l'Empereur, puisqu'il parvint à faire périr Sopater, en fournissant au peuple indiscipliné, qui était alors le véritable souverain, un prétexte encore plus futile que celui qui avait amené la mort de Socrate. Constantin, toutefois, fut puni de l'influence qu'il avait accordée à Ablabius, et sa fin a été racontée dans l'histoire qui le concerne. Quant à Ablabius, le prince lui laissa son fils Constance, qui avait régné conjointement avec lui, et qui hérita du pouvoir de son père avec ses frères Constant et Constantin II. Il a été parlé, du reste, de tout cela en détail, dans ce qui a été écrit sur le divin Julien. Constance, ayant dont succédé à l'empire et s'étant rendu maître de tout ce qui lui était échu par le sort, c'est-à-dire de tous les pays de l'orient à partir de l'Illyrie, dépouilla aussitôt Ablabius de son autorité et s'entoura d'autres favoris. Ablabius se réfugia alors en Bithynie, dans une propriété qu'il s'était fait construire depuis longtemps et qui était toute remplie de retraites et de délices vraiment royales. Il vécut là dans l'abondance, et tout le monde s'étonnait qu'il eût dédaigné de se faire empereur. Mais Constance lui envoya, de la ville qui avait reçu le nom de son père, des hommes en grand nombre, armés d'épées, et dont les premiers, qui se présenteraient, avaient mission de lui remettre une lettre. Ils se prosternèrent devant lui, selon la coutume qu'ont les Romains de fléchir le genou devant un empereur, pour lui offrir une missive. Ablabius reçut la lettre avec une contenance majestueuse, et comme un homme dégagé de toute crainte, il osa même réclamer de ses visiteurs la pourpre, en les regardant d'un oeil sévère et en prenant devant eux un air formidable. Ils lui dirent qu'ils avaient pour toute mission de lui remettre la lettre, mais que les gens chargés du reste étaient à la porte Ablabius, ivre d'orgueil et gonflé d'insolence, les fit appeler aussitôt. Ceux-ci furent introduits. Ils étaient nombreux et portaient tous des épées. Au lieu d'une robe de pourpre, ils lui donnèrent la mort pourprée et le coupèrent en morceaux, comme le boucher dépèce les viandes, qui doivent être servies dans les festins. Telle fut l'expiation que les mânes de Sopater reçurent d'Ablabius, qui, jusque-là, avait été heureux en tout. Les choses ayant été ainsi réglées par la Providence, qui n'abandonne pas le soin des destinées humaines, le plus illustre des philosophes vivants était Édésius. Il eut d'abord recours à la divination, du moyen d'une oraison dans laquelle il avait la plus grande foi, et dont l'effet se révélait par une vision nocturne. Le dieu descendit à sa prière et lui rendit son oracle en vers hexamètres. Edésius, les paupières à peine ouvertes, et encore tout saisi de crainte, se rappelait bien le sens des paroles qui lui avaient été dites. Mais la forme sublime et céleste des vers avait fui de sa mémoire et lui échappait. Il appelle son esclave et lui fait apporter de quoi se laver les yeux et le visage. Tout à coup, le serviteur lui dit : « Vois donc, le dessus de ta main gauche est rempli de caractères. » Édésius regarde et reconnaît l'empreinte divine. Il adore sa propre main avec les lettres qu'elle porte, et lit l'oracle qui s'y trouve inscrit. Le voici :
La parque, en ce moment, tient les fils de ta vie En présence de cet oracle, Edésius choisit, comme cela devait être, la voie la meilleure. Il avait en vue une petite campagne, où il comptait mener la vie d'un chevrier ou d'un bouvier. Il y alla. Mais, par un effet de la renommée qu'il avait précédemment acquise ; soit projet ne put demeurer caché à ceux qui avaient besoin d'éloquence et d'enseignement ils le suivirent à la piste, et, hurlant comme des chiens devant sa porte, ils le menacèrent de le déchirer s'il persistait réserver tant de science pour les montagnes, les rochers et les arbres, comme s'il n'était pas né parmi les hommes et ne savait rien de l'humanité. Forcé par la violence de ces discours et de ces actions de rentrer dans la vie sociale, il s'abandonna alors au pire des deux partis et quitta la Cappadoce, laissant le soin des intérêts qu'il avait à Eustathe, qui était un peu son parent. Pour lui, il se dirigea vers l'Asie qui, tout entière, lui tendait les bras. Il s'établit dans l'antique Pergame (48), et là, il fut constamment visité par les Grecs et par les gens du pays ; et sa gloire s'éleva jusqu'aux astres. Mais laissons cela, et occupons-nous d'Eustathe ; car je regarderais comme une impiété de passer sous silence ce que je sais de vrai sur lui. De l'aveu de tout le monde, il paraissait et était en effet un homme excellent, très habile dans l'art de parler, et dont la langue et les lèvres exerçaient une séduction, voisine de la magie. La douceur, la suavité florissaient dans ses discours ; elles se répandaient avec tant de grâce que ceux qui écoutaient sa voix et ses paroles, s'abandonnant eux-mêmes comme s'ils eussent goûté du lotus (49), étaient suspendus à sa bouche et à tout ce qu'elle proférait. De telles merveilles ne différaient guère de celles que produisait la voix enchanteresse des Sirènes. Aussi l'Empereur, bien qu'attaché à la doctrine des Chrétiens, l'appela-t-il à son secours, au milieu des circonstances troublées qui l'entouraient. Le roi des Perses (50), en effet, menaçait l'empire de grands malheurs. Déjà, il assiégeait Antioche (51) et faisait pleuvoir les traits, jusque dans la ville. Il s'était emparé, par un coup de main imprévu et subit, de la citadelle qui dominait le théâtre et, de là, les flèches atteignaient les spectateurs et en tuaient un grand nombre. Dans une pareille situation, tout le monde était tellement abattu et découragé que l'on n'hésita point à approcher de l'oreille de l'Empereur un sectateur de l'Hellénisme (52) quoique les princes précédents eussent la coutume de destiner aux ambassades ceux qui s'étaient illustrés dans l'armée, soit comme préfets des camps, soit pour avoir exercé quelque autre commandement. Mais, en ce montent, et devant l'impérieuse nécessité, Eustathe parut à chacun le plus habile de tous, et on le désigna d'un commun accord. Il fut donc appelé, au nom de l'Empereur, et se présenta aussitôt. Le charme de sa parole fut tel, que ceux qui avaient conseillé de lui confier, l'ambassade reçurent du prince les plus grands honneurs ; et furent l'objet de toute sa bienveillance. Quelques-uns d'entre eux accompagnèrent spontanément Eustathe dans sa mission, afin d'expérimenter, de plus près, s'il aurait aussi l'habileté de séduire les Barbares. Dès qu'ils furent arrivés dans le pays des Perses, bien que la renommée dépeignit Sapor comme un despote sauvage, et qu'il le fut en effet, Eustathe cependant, en vertu du caractère public que lui donnait son ambassade, eut accès auprès du prince. Celui-ci admira en même temps la fierté et la douceur de son regard, que ne purent troubler les divers moyens, mis en oeuvre, pour le frapper de crainte. Et, lorsque le Roi entendit le philosophe parler avec aisance et sans se montrer intimidé, et qu'il vit la convenance et la facilité avec lesquelles ses arguments se déroulaient, il mit fin, à l'audience, et Eustathe sortit, sûr d'avoir captivé ce prince par son éloquence. Aussitôt après, Sapor le fit inviter à sa table par les gardes de sa chambre, Eustathe se tendit à cette invitation, charmé de découvrir dans le caractère du Roi une propension naturelle à la vertu : il prit donc part au festin. Admis à s'asseoir à la table royale, il subjugua tellement son hôte, par la force de ses discours, qu'il s'en fallut de peu que le Roi des Perses ne se dépouillât de sa haute tiare, de ses vêtements de pourpre et de ses ornements incrustés de pierres précieuses, pour les échanger contre le manteau d'Eustathe ; tant était vif l'emportement avec lequel celui-ci s'était élevé contre les biens de la fortune et les parures mondaines, tant il avait flétri la démence de ceux qui n'aiment que leur corps ! Mais il en fut empêché par les mages (53), qui se trouvaient autour de lui, et qui, prétendant qu'Eustathe n'était qu'un pur jongleur, conseillaient au Roi de demander à l'Empereur des Romains pourquoi, possédant en abondance tant d'hommes considérables, il en envoyait qui ne différaient en rien d'esclaves enrichis, Cela n'empêcha pas Eustathe de réussir dans sa mission ; et le succès dépassa même tout ce qu'on avait espéré. Quant au philosophe lui-même, ce qui intéresse notre histoire c'est de savoir que la Grèce, tout entière, souhaitait de le voir et demandait aux dieux sa venue. Les prophéties étaient d'accord sur ce point avec les hommes habiles dans ces sortes de choses. Il n'en fut pas ainsi cependant, car il ne fit point ce voyage. Les Grecs, alors, lui envoyèrent une ambassade, composée des savants les plus distingués : ils devaient demander au grand Eustathe pour quoi l'événement ne répondait pas à de tels pronostics. Le philosophe, après avoir écouté les hommes dont la réputation était la plus répandue dans la matière, examina la chose de plus haut ; il pesa, la valeur de leurs témoignages, et rechercha la grandeur, la couleur et la forme des signes. Puis, souriant aux envoyés, comme il avait coutume de le faire quand il découvrait la vérités - car le mensonge n'est pas moins éloigné du langage des dieux que de ceux qui les fréquentent, - il leur dit : « Ces signes n'annonçaient point ma venue. » Et il ajouta, avec trop d'orgueil, selon moi, pour un mortel : « Les prodiges qui sont apparus étalent sans conséquence, et vraiment au-dessous de mon mérite. » Eustathe qui était déjà lui-même un si grand philosophe, avait pris pour femme Sosipatra qui, par la supériorité de sa sagesse, fit paraître son propre mari en quelque sorte petit et de peu de valeur, à côté d'elle. Il convient ici, dans la revue que je passe des philosophes, de parler en détail de cette femme, dont la gloire se répandit partout. Sosipatra était née en Asie, aux environs d'Éphèse dans la plaine que traverse le Caystre et à laquelle il a donné son nom. Ses parents, ainsi que sa famille, étaient heureux et riches. Dès sa plus tendre enfance, tout sembla lui sourire ; et sa jeunesse brilla entièrement de l'éclat de le beauté et de la pudeur. Elle était arrivée à l'âge de cinq ans, lorsque deux vieillards qui l'un, et l'autre avaient dépassé le temps de la vigueur corporelle, bien que le premier fût plus âgé que le second, portant de vastes besaces et le dos couvert de peaux, se présentèrent dans une propriété appartenant aux parents de Sosipatra et demandèrent au fermier de leur confier le soin des vignes ; c'était un travail facile pour eux. On les accepta. Le récolte fut si abondante, entre leurs mains, qu'elle surpassa toute espérance. Le propriétaire arriva, sur ces entrefaites, et amena la petite Sosipatra. L'étonnement était sans bornes et l'on en venait soupçonner quelque prodige divin. Le maître, alors, invita à sa table les deux vieillards, les traita avec la plus grande libéralité, et reprocha aux paysans qui cultivaient d'ordinaire son bien de ne point obtenir les mêmes résultats. Les vieillards, après avoir joui de l'hospitalité et de là table à la mode grecque, séduits et captivés par l'exquise beauté et le charme de la petite Sosipatra, s'exprimèrent en ces termes : « Nous avons par devers nous bien d'autre secrets et bien d'autres mystères ; et cette abondance de raisin, dont tu t'émerveilles si fort, n'est qu'une plaisanterie et un jeu facile pour notre puissance. Mais, si tu veux que nous te payions le prix de ton festin et de ton hospitalité, non en argent ni en remerciements fugitifs et périssables, mais par un don qui te sera plus précieux que toi-même et que ta propre vie, par un don céleste et s'étendant jusqu'aux astres, confie-nous, comme à ses nourriciers et à ses véritables pères, ta chère Sosipatra ; et, d'ici à cinq ans, ne crains rien pour cette enfant, ne redoute point pour elle la mort et garde ta tranquillité et ta constance. Aie soin de ne pas fouler le sol de ce domaine jusqu'à ce que les révolutions solaires étant accomplies, la cinquième année se trouve achevée. Pendant ce temps, la richesse naîtra spontanément pour toi de cette terre et se multipliera ; et ta fille s'élèvera non pas seulement à la condition d'une femme ou d'un être humain : tu pourras concevoir de cette enfant de plus hautes espérances. Si tu as bon courage, accueille à bras ouverts ce que nous te disons ; si tu conserves quelques soupçons, admets que nous n'avons rien dit. » A ce discours, le père frappé d'épouvante et retenant sa langue, prend l'enfant par la main, l'abandonne aux deux étrangers, et, appelant le fermier : « Donne à ces vieillards, lui dit- il, tout ce qu'ils te demanderont, et ne témoigne aucune espèce de curiosité. » Ayant ainsi parlé, avant que l'aurore parut, il partit comme s'il s'exilait de sa fille et de son bien. Qu'étaient donc ceux qui avaient reçu l'entant ? Des héros, des génies, des êtres d'une nature plus divine encore ? Dans quels mystères l'instruisirent-ils ? C'est ce que personne ne sut jamais. A quelle divinité la consacrèrent-ils ? toujours impossible de le connaître, à ceux-mêmes qui en avaient le plus d'envie. Le temps était venu, cependant, où tous les comptes des revenus du domaine devaient être rendus. Le père de l'enfant se présenta : il ne reconnut point sa fille dont la taille avait grandi ; sa beauté lui sembla toute changée, et Sosipatra, elle-même, eut d'abord peine à reconnaître son père, qui se prosternait devant elle, la prenant pour quelque autre. Enfin, la table ayant été dressée, ses instituteurs parurent. Ils dirent au père : « Interroge la jeune fille sur ce que bon te semblera. » Celle-ci, prenant la parole : « Demande-moi, père, dit-elle, ce qui, t'est arrivé pendant le chemin. » Le père lui donna licence de parler. Sa fortune lui permettait de voyager dans une voiture à quatre roues ; et, avec de pareils véhicules, on est exposé à divers accidents. Sosipatra lui rapporta toutes ses paroles, toutes ses menaces, toutes les péripéties de la route, comme si elle eût été assise à côté de lui dans la voiture, L'admiration du père fut telle, que ce n'était pas de l'admiration, mais de la stupeur, et qu'il fut persuadé que sa fille était une déesse (54). Tombant aux pieds des deux hommes, il les supplie de lui apprendre qui ils étaient. Ceux-ci, avec peine et en hésitant, -la Divinité le voulait ainsi sans doute, - avouèrent qu'ils n'étaient pas étrangers à la science appelée chaldaïque ; mais ils ne dirent cela que comme par énigme, et en tenant le visage baissé vers la terre. Le père de Sosipatra, embrassant de nouveau leurs genoux, les conjura de se regarder comme les maîtres du domaine, de conserver sa fille sous leur autorité et d'achever son initiation. Les deux vieillards firent un signe de consentement et n'ajoutèrent pas une parole. Satisfait de ce qu'il considérait comme une promesse ou un oracle, le père sentit son courage se raffermir, bien qu'il ignorât au fond ce qu'il en était. En lui-même, il exaltait Homère, qui a chanté ainsi ce prodige divin :
Les Dieux, s'assimilant à des hôtes divers, Il croyait bien, en effet, avoir eu pour hôtes des Dieux, revêtus de la forme humaine. L'esprit plein de ce sujet, il fut saisi par le sommeil. Pendant ce temps-là, les vieillards, ayant quitté la table et prenant avec eux l'enfant, lui remettent, d'un air bienveillant et sérieux, la robe qui faisait partie du vêtement dans lequel elle avait été initiée ; ils y joignent quelques autres objets, puis, donnent à Sosipatra, pour le cacheter, le coffret qui contenait tout cela, après y avoir renfermé de plus un certain nombre de livres. Elle obéit, car elle n'avait pas moins de tendresse pour ses instituteurs que pour son père. Le jour étant venu ; et les portes ayant été, ouvertes, les travailleurs se rendirent à leur ouvrage ; et ceux-ci sortirent avec les autres, selon leur coutume. L'enfant courut à son père pour lui donner la bonne nouvelle : un des serviteurs portait le coffret. Le père, ayant demandé l'argent qu'il y avait, selon l'occurrence, et s'étant informé près de ses fermiers de tout ce qui était nécessaire, fit appeler les deux vieillards. On ne les put trouver nulle part. Alors, il dit à Sosipatra : « Qu'est-ce là, mon enfant ? » Celle-ci, après s'être un instant recueillie : « Maintenant, dit-elle, je comprends leurs paroles ; car, lorsqu'en pleurant ils me mirent ces objets dans la main, ils me dirent : Vois, mon enfant, nous allons vers l'Océan qui est au Couchant, et nous reviendrons bientôt. » Cela démontrait le plus clairement du monde que ces deux hommes, qui étaient ainsi apparus, étaient des génies. Et, en effet, de quelque côté qu'ils se soient dirigés, il est certain qu'on ne les revit plus. Le père, emmenant sa fille initiée et chastement inspirée du souffle divin, la laissa vivre dès lors à sa guise, et ne se mêla en rien de ce qui la regardait : toutefois, il lui voyait avec peine garder un silence obstiné. Elle était déjà arrivée à la fleur de la jeunesse, n'ayant pas eu d'autres maîtres et citant sans cesse, non seulement les oeuvres des poètes, mais aussi celles des philosophes et des orateurs. Tout ce que les autres apprennent, à force de travail et de torture d'esprit, et ne savent même qu'imparfaitement et d'une manière obscure, elle le comprenait, elle, comme en se jouant et le mettait en lumière facilement et sans effort. Enfin, elle résolut de se marier. Assurément, il était hors de toute contestation que, parmi tous les hommes, Eustathe se trouvait le seul digne d'un tel hymen. Elle le choisit. Mais, avant, elle parla elle-même en ces termes à Eustathe et ceux qui étaient présents : « Écoute, Eustathe, et que les assistants me servent de témoins. J'enfanterai de toi trois enfants, qui seront malheureux en tout ce qui paraît précieux aux mortels, mais dont aucun, ne manquera des biens célestes. Tu m'auras déjà. abandonnée pour une position vraiment belle et digne de toi ; mais, moi, j'en aurai peut-être une meilleure. Tu iras, en effet, te réunir au choeur des bienheureux dont la Lune est la demeure (55), et, dans cinq ans d'ici, - selon ce que je lis sur ton visage, - tu cesseras d'adorer ici-bas les Dieux et de philosopher : ta sortie de ce séjour sublunaire sera, d'ailleurs, une transition douce et facile. Je voudrais aussi parler de ce qui me concerne. » A ces mots, elle suspendit un instant son discours : « Mais, dit-elle en reprenant, ma divinité particulière me le défend. » S'étant ainsi exprimée, elle devint la femme d'Eustathe, conformément à la volonté des Parques et les paroles qu'elle avait prononcées concordèrent entièrement avec les immuables destinées, car les faits se produisirent avec la même exactitude que s'ils avaient précédé ses prédictions. A propos de ces événements, il est nécessaire d'ajouter que Sosipatra, après la mort d'Eustathe, retourna dans ses terres et se fixa en Asie, près de l'antique Pergame. Là, le grand Edésius l'entoura de ses soins et de son affection ; il éleva même ses enfants. Sosipatra, alors, dressa en quelque sorte, dans sa propre maison, une chaire rivale de la sienne ; après avoir entendu Edésius, les disciples affluaient chez elle : et il n'était aucun d'eux qui n'aimât et n'admirât la logique serrée d'Edésius et qui ne se prosternât, plein de vénération, devant l'enthousiasme de Sosipatra. Philométor, cousin de cette femme illustre, vaincu par sa beauté et par son éloquence, en vint à l'aimer et à la trouver la plus divine de toutes les femmes : cette passion le dominait et s'imposait violemment à lui. Il s'y livrait tout entier, et Sosipatra, de son côté, partageait ses sentiments. Elle s'adressa alors à Maxime, un des familiers les plus intimes d'Edésius et presque son parent : «Apprends, lui dit-elle, Maxime, pour m' éviter quelque embarras, à quel mal je suis en proie. » « - De quel mal voulez-vous parler ? demanda Maxime. » « - Voici, lui répondit-elle. Si Philométor est présent, c'est Philométor, et il ne diffère en rien de la plupart des hommes : mais, si je le vois s'en aller, je sens, au moment de son départ, quelque chose qui me mord, pour ainsi dire, et me tord le dedans du coeur. Il faut absolument, ajouta-t-elle, que tu travailles à me soulager et que tu me donnes une preuve de ton pieux dévouement. » Maxime sortit tout fier, et se regardant déjà comme le familier des Dieux, parce qu'il avait reçu d'une telle femme une telle confidence. Philométor, cependant, poursuivait son dessein. Mais Maxime s'y opposait : sa science, dans l'art des sacrifices, lui faisait connaître les moyens qu'employait Philométor, et il en mettait de plus forts et de plus puissants en usage, pour détruire l'effet de ceux-là. Ces opérations terminées, Maxime courut aussitôt vers Sosipatra, et la conjura de veiller avec le plus grand soin, pour voir si, dans l'avenir, elle retomberait en proie au même mal. Mais elle lui dit qu'elle ne souffrait plus ; elle lui détailla alors toutes ses prières, toutes ses pratiques, en précisant l'heure où il les avait accomplies, comme si elle eût été présente, et lui énuméra tous les signes qui s'étaient montrés à lui. A cette révélation, Maxime, frappé de stupeur, tombe sur le sol et proclame hautement que Sosipatra est une déesse. « Lève-toi, dit-elle, mon fils ; les Dieux t'aiment, puisque tes regarde sont tournés vers eux et que tu ne les abaisses oint vers les biens terrestres et périssables. » Maxime, ayant entendu ces paroles, sortit de la maison, plus orgueilleux que jamais d'avoir fait l'expérience certaine de la divinité de Sosipatra. A la porte, il rencontra Philométor qui entrait, rayonnant, avec de nombreux compagnons. Et, l'interpellant de loin, en enflant sa voix. « Ami Philométor, lui dit-il, au nom de tes dieux protecteurs, cesse donc de brûler du bois. C'est bien inutile. » Il faisait, ainsi, allusion aux maléfices dont il le savait coutumier. Philométor crut alors que Maxime était un dieu et se tint sur une extrême réserve. Il renonça à son dessein et fut le premier à rire de l'entreprise qu'il avait conçue. Des lors, Sosipatra vit Philométor sans contrainte, et même avec une distinction marquée, admirant, à son tour, celui qui l'avait tant admirée. Un jour que tous ses disciples étaient réunis autour d'elle, et que Philométor était absent, il se trouvait, en effet, à la campagne, - le sujet de la discussion roulait sur l'âme. Un grand nombre d'arguments s'étaient déjà produits, quand Sosipatra prit la parole, et se mit à les réfuter, l'un après l'autre, par ses démonstrations. Elle en vint, ensuite, à traiter du dernier voyage de l'âme, de la partie qui est en elle sujette au châtiment, et de celle qui est immortelle. Puis, tout à coup, au milieu de son enthousiasme et d'une sorte de fureur bachique, comme si la parole lui manquait, elle se fut, et, après un peu de temps, s'ecria : « Qu'est cela ? Mon cousin Philométor se trouve traîné par son char. Le mauvais état de la route l'a fait verser, et il risque fort d'avoir les jambes cassées. Mais ses domestiques l'ont retiré sain et sauf, à part quelques blessures sans gravité, aux coudes et aux mains. On le porte en litière, et il pousse des gémissements. » Telles étaient ses paroles; et il en était vraiment ainsi. C'est pourquoi, tous, étaient persuadés que Sosipatra avait le don d'ubiquité (56) et se trouvait présente à tous les événements, comme les philosophes l'affirment des Dieux. Elle mourut, laissant trois enfants. Il n'est aucun besoin de donner ici les noms de deux d'entre eux. Mais Antonin, lui, se montra digne de ses parents. Il fixa sa résidence à l'embouchure de la branche Canopique (57) du Nil, se livra tout entier aux pratiques qui s'accomplissaient dans ces parages et força la Renommée à justifier la prédiction de sa mère. La jeunesse, soucieuse de la santé de son âme et réellement curieuse de philosophie, se pressait autour de lui ; aussi, le temple était-il plein d'adolescents, occupés aux choses sacrées. Il ne se donnait pas comme un être au-dessus de l'humanité, il passait volontiers sa vie au milieu des hommes; et il disait souvent à ses disciples qu'après lui il n'y aurait plus de temple, et que le grand, le vénérable sanctuaire de Sarapis (58) serait changé en un hideux amas de ruines que rongerait le ténébreux oubli, tyran fantastique et odieux, auquel sont soumises les plus belles choses de la terre. Le temps, qui dévoile tout, vérifia ces prédictions, et leur donna force d'oracle. De cette école, - car je n'ai pas le projet d'écrire ce qu'on appelle les Orientales (59) d'Hésiode, - descendirent des courants qui, comme des émanations d'astres, se dispersèrent bientôt et se répartirent sur quelques autres espèces de philosophes, pour qui l'affinité de doctrines fut une source de gain. La plupart furent pour suivis devant les tribunaux, comme Socrate au portique du Roi, à Athènes, tant ils méprisaient les richesses et haïssaient l'or. Toute leur philosophie consistait en un manteau, dans le souvenir de Sosipatra, et dans le nom d'Eustathe qu'ils avaient toujours à la bouche ; en fait de choses qui se voient, ils portaient des sacs bourrés de petits livres, qui auraient pu être la charge de plusieurs chameaux. Ils savaient par coeur ces livres, qui n'avaient de rapport avec aucun des anciens philosophes, et qui étaient ou des testaments ou des copies de testaments, des contrats, des actes de vente, enfin tout ce qu'une vie misérable et plongée dans l'erreur ou le désordre trouve digne d'intérêt. De ce côté, là, non plus, les prophéties de Sosipatra ne furent point démenties par l'événement. Mais je n'ai nul besoin d'écrire ici le nom de ces hommes ; car mon ouvrage n'est pas fait en vue des fripons, il a été composé pour la gloire des honnêtes gens. Donc, un seul des fils de Sosipatra, nomme Antonin, celui dont j'ai fait mention brièvement plus haut, séjourna à Alexandrie. Puis saisi de respect et d'admiration pour l'embouchure de la branche Canopique du Nil, il se dévoua et se consacra aux divinités de ce lieu et à leurs mystères sacrés. Il parvint très rapidement à s'identifier avec l'essence divine ; méprisant le corps et se dégageant du souci de toutes les voluptés qui s`y rapportent, et embrassant la sagesse avec une ardeur inconnue au plus grand nombre. C'est pourquoi je crois devoir parler de lui, un peu plus en détail. Il ne se livra sans doute à aucun acte théurgique et en opposition avec le sentiment public, peut-être parce qu'il soupçonnait que le penchant de l'Empereur l'entraînait d'un autre côté ; mais tout le monde admirait sa fermeté, son inflexibilité, sa constance. Aussi, voyait-il affluer vers lui, par la voie de la mer, tous ceux qui venaient alors étudier à Alexandrie. Cette ville, à cause du temple de Sarapis, était devenue comme un monde sacré vers lequel, de toutes parts, se précipitait une multitude semblable à un peuple. Après avoir rendu hommage à la Divinité, on courait chez Antonin, les uns par terre et à pied, les autres en bateau sur les eaux du fleuve, se laissant ainsi conduire avec une sorte de volupté vers une occupation sérieuse. Admis à l'honneur de son audience, ceux-ci, lui proposant un problème de logique, remportaient sur l'heure une abondante moisson de sagesse platonicienne ; ceux-là, abordant des questions d'un ordre plus divin, ne trouvaient en lui qu'une statue. En effet, il ne leur répondait rien, mais les yeux fixes et levés vers le ciel, il demeurait muet et inexorable ; et personne ne le vit, sur de pareils sujets, entrer facilement en conversation avec les hommes. Cependant, ce qu'il y avait de divin en lui ne tarda pas à se manifester. Car, à peine eût-il quitté ce monde, que le culte des divinités alexandrines et du Sarapéum cessa ; non seulement le culte, mais les édifices où il se pratiquait, et tout ce qui s'y rattachait, eurent le sort que les fables poétiques attribuent à la victoire des Géants. Il en fut ainsi des temples de Canope, grâce à Théodose alors empereur, à Théophile patriarche des maudits, et à un certain Eurymédon qui, en ce temps-là, Régnait sur les Géants, orgueilleux éternels ; grâce aussi à Evétius, préfet de la ville, et à Romanus, commandant les légions d'Égypte. Les soldats, rassemblant toutes leurs colères contre des pierres et contre l'oeuvre de ceux qui les avaient taillées, se ruèrent bravement sur ces objets inertes ; eux, qui eussent été in-capables de soutenir le fracas d'une bataille, dévastèrent le Sarapéum, firent la guerre aux offrandes, et remportèrent une victoire sans combat, sur des ennemis absents. Dans leur lutte contre les statues et les sanctuaires, ils poussèrent l'héroïsme jusqu'à ne point se contenter de les vaincre, ils les volèrent ; et, pour cela, ils firent une convention militaire, afin de mettre à l'abri celui qui aurait dérobé quel-que chose. Il n'y eut que les fondements du Sarapéum qu'ils n'emportèrent point, à cause de la masse énorme des pierres, qu'il n'était pas facile de remuer. Mais, après avoir tout bouleversé et tout saccagé, ces foudres de guerre, montrant leurs mains, pures il est vrai de sang, mais souillées de rapines, se proclamèrent les vainqueurs des Dieux, et se firent gloire de leurs sacrilèges et de leur impiété. Ensuite, ils introduisirent dans les lieux sacrés de ces gens appelés moines (60) qui, tout en ayant la forme humaine, menaient la vie, des animaux et se livraient ouvertement à toutes sortes d'excès que je n'oserais rapporter (61). Mais, en revanche, ils regardaient comme un acte de piété de profaner les choses divines. A cette époque, du reste, tout homme affublé d'une robe noire, et qui ne craignait pas d'affecter en public un maintien peu décent, avait permission d'exercer une autorité tyrannique. C'est à ce haut point de vertu que l'humanité en était arrivée. Mais j'ai déjà parlé de ces gens-là dans mon Histoire générale (62). Ces moines furent donc établis à Canope et là, ils substituèrent à des divinités accessibles à l'intelligence un culte d'esclaves, et encore d'esclaves méprisables, auquel ils soumirent les hommes. Recueillant, en effet, les ossements et les têtes des misérables que leurs nombreux crimes avaient fait condamner par la justice de la cité, ils les présentaient comme des dieux, se roulaient convulsivement sur ces restes immondes, et s'imaginaient que le contact impur de ces sépulcres les rendaient meilleurs. On les appelait martyrs, diacres, arbitres des prières auprès de la Divinité, quand ils n'avaient été que des esclaves infidèles, sans cesse roués de cous de fouet, et portant sur leur corps les marques infamantes que leur avait values leur perversité. Et la terre souffre de pareils Dieux ! Cela porta au comble la réputation de haute prévoyance dont avait joui Antonin ; car il avait dit à tout le monde que les temples deviendraient des tombeaux. De même, l'illustre Jamblique, comme nous l'avons consigné dans l'histoire de sa Vie (63), voyant un Égyptien évoquer Apollon et celui-ci, par son apparition, frapper de stupeur les assistants, s'était écrié : « Cessez de vous émerveiller, mes amis ; ce n'est que le spectre d'un gladiateur. » Tant est profonde la différence qui existe entre la vue de l'esprit, et les images trompeuses que reflètent les yeux du corps ! Jamblique, lui, voyait les maux présents, tandis qu'Antonin prévoyait les maux à venir : cela suffit à établir la supériorité de ce dernier. La fin de sa vie fut paisible, et arriva pour lui à l'extrémité d'une vieillesse exempte de maladie (64). Mais ce qui attrista tous les hommes intelligents, ce fut la ruine des temples qu'il avait prédite. MAXIME NOUS avons précédemment fait mention de Maxime, et celui qui écrit ces lignes n'est pas sans avoir vu le personnage. Mais j'étais jeune et il était déjà vieux, quand je le rencontrai et que j'entendis sa voix, comme, on aurait pu entendre celle de la Minerve on de l'Apollon d'Homère. La pupille de ses yeux était pleine de vivacité, il avait la barbe blanche, et son regard traduisait tous les mouvements de son âme. Rien d'harmonieux comme toute sa personne, soit qu'il vous écoutât, soit qu'il vous contemplât, son attitude, dans, l'un et l'autre cas, frappait son interlocuteur, qui ne pouvait supporter ni la mobilité de ses yeux ni le flux de ses discours. Aucun homme d'ailleurs, parmi les plus expérimentés et les plus habiles de ceux qui conversaient avec lui, n'osait le contredire ; ils s'abandonnaient tranquillement à lui, suspendus à ses paroles, comme si elles eussent été prononcées du haut d'un trépied : tant était grand le charme qui résidait sur ses lèvres. Il était d'une bonne naissance ; fort riche, et eut des frères, à qui il ne permit point de prendre le premier rang, parce qu'il l'occupait lui-même. C'étaient Claudien (65), qui s'établit à Alexandrie et y enseigna, et Nymphidianus (66) qui professa avec éclat à Smyrne. Maxime fut un de ceux qui se pénétrèrent le plus de la philosophie d'Édésius. Aussi, on le jugea digne d'être choisi pour devenir le maître de l'empereur Julien. Celui-ci, dans la Vie duquel nous avons parlé plus complètement de ces choses, fut dépouillé de tout par Constance. Mais, la famille impériale étant venue à s'éteindre, Julien resta seul, méprisé à cause de sa jeunesse et de la douceur de son caractère. Il fut alors abandonné aux eunuques du palais, dont la mission était de le surveiller; et on leur adjoignit des gardiens, chargés de maintenir le jeune prince dans la foi chrétienne. C'est dans une telle situation que Julien montra la grandeur de sa nature, Il travailla. si bien que toutes ses lectures se gravaient dans sa mémoire ; et ce fut au point que ses maîtres s'indignaient de la brièveté forcée de leurs leçons et du peu qu'il leur restait a enseigner à l'enfant. Lorsqu'ils n'eurent plus rien à lut faire connaître et que Julien n'eut plus rien à apprendre d'eux, il demanda à son cousin (67) la permission d'étudier l'éloquence et la philosophie. Celui-ci, grâce à Dieu, y consentit, aimant mieux le voir se plonger dans les livres et vivre de loisir que songer à sa naissance et à l'Empire. Ainsi autorisé et ayant des richesses immenses à sa disposition, Julien, entouré d'une pompe et d'une escorte royales, se mit à voyager de tous côtés, en passant par les en droits qui lui convenaient le mieux. Il se rendit à Pergame, sur le bruit que faisait la sagesse d'Edésius. Or, celui-ci était déjà arrivé à une extrême vieillesse, et avait le corps très affaibli. Ses principaux familiers étaient Maxime, dont nous nous occupons en ce moment, Chrysanthe de Sardes, Priscus le Thesprote ou le Molosse, Eusèbe de Myndes en Carie. Admis dans l'intimité d'Edésius, Julien, dont le jeune âge possédait toute la gravité de la vieillesse, fut vivement frappé de la vigueur et du caractère divin que présentait l'âme du philosophe, et ne songea plus à s'éloigner. Pareil à ceux dont parle la fable et qu'un certain serpent a mordus, il ouvrit la bouche toute grande et voulut boire à longs traits la science. Dans cette intention, il envoya à Edésius des présents vraiment royaux. Mais celui-ci ne les accepta point, et, ayant fait venir le jeune homme, il lui dit : « La nature de mon âme ne t'est pas inconnue, puisque tu as tant de fois entendu mon enseignement. Mais tu vois dans quel état est le corps qui lui sert d'organe : tous ses éléments constitutifs se dissolvent et retournent à leur source, Donc, si tu veux obtenir un résultat, aimable enfant de la philosophie, - comme je le reconnais à des signes certains qui me font lire en ton âme, - va trouver ceux qui sont mes véritables fils, et enivre-toi auprès d'eux, à satiété, de toute sagesse et de toute science. Une fois initié aux mystères, tu rougiras entièrement d'être homme et d'en porter le nom. J'aurais voulu que Maxime fût ici ; mais il a été envoyé à Éphèse (68). Je t'aurais adressé avec la même confiance à Priscus ; mais, lui aussi, est en voyage et navigue vers la Grèce. Il ne reste de mes disciples qu'Eusèbe et Chrysanthe ; quand tu te seras fait leur auditeur, tu n'auras plus envie de tourmenter ma vieillesse. » Après avoir entendu ces paroles, Julien n'abandonna pas complètement Edésius, mais il s'attacha pour la plus grande partie du temps à Eusèbe et à Chrysanthe. Ce dernier, d'ailleurs, était en pleine conformité de sentiments avec Maxime, au sujet de l'inspiration divine et de l'enthousiasme religieux ; il ne lui cédait que sur le terrain de l'enseignement, étant pour tout le reste d'un génie égal au sien. Eusèbe, en présence de Maxime, se récusait pour l'exacte division des parties du discours, pour le mécanisme de la dialectique et de la subtilité de l'argumentation, mais, si Maxime venait à disparaître comme la lumière du soleil, Eusèbe devenait une étoile qui scintillait, tant il y avait de facilité et de grâce dans son éloquence. Une fois, Chrysanthe, qui se trouvait là, ne lui épargnait ni les louanges ni les signes d'approbation, et Julien écoutait avec vénération les paroles du maître. Mais Eusèbe ajouta, à la fin de son exégèse (69), qu'il ne fallait tenir compte que de ce qui existe réellement et que les fourberies, qui trompent et égarent les sens, sont l'oeuvre de jongleurs, qui se détournent de la bonne voie pour recourir à des, moyens matériels, et se livrent à des fureurs condamnées par la raison. Le divin Julien, qui avait entendu souvent cette conclusion, en forme d'épiphonème (70), prit alors Chrysanthe à part, et lui adressa ces mots: « Si tu as quelque souci de la vérité, mon cher Chrysanthe, dis-moi donc ce que signifie cet épilogue de l'exégèse. » Celui-ci, soupirant profondément et avec un air de modestie: « Tu feras sagement, répondit-il, de demander cela, non moi, mais à Eusèbe. » Julien, ne manqua pas de suivre ce conseil, et crut voir un dieu dans celui qui le lui avait donné. A une nouvelle réunion, Eusèbe reprit son thème favori et Julien, s'enhardissant, lui demanda où il voulait en venir avec cette continuelle péroraison. Alors Eusèbe, déployant toute son éloquence et lâchant la bride à son extrême facilité de parole : « Maxime, dit-il, est un de mes condisciples les plus anciens et les plus instruits. Mais la grandeur de son caractère et la supériorité de son talent oratoire lui faisaient mépriser les démonstrations probantes et le poussaient à se jeter tête baissée dans des folies. Dernièrement, il nous convoqua, nous tous qui étions avec lui, dans le temple d'Hécate (71) ; et il se trouva avoir ainsi rassemblé de nombreux témoins de son extravagance. En effet, quand tout le monde fut arrivé et eut adoré la déesse, asseyez-vous, nous dit-il, ô mes bien chers compagnons ; voyez ce qui va se produire et à quel point je suis supérieur au vulgaire. Après qu'il eut parlé de la sorte, nous nous assîmes tous à terre ; puis, il fit brûler un grain d'encens, murmura entre ses dents je ne sais quel hymne, et poussa si loin ses momeries que la statue d'Hécate commença à sourire et finit même par rire aux éclats. Nous nous troublâmes à cette vue. Que personne ne s'émeuve de cela, s'écria-t-il ; car, à l'instant, les lampes que la déesse tient à la main vont s'allumer. Et, avant qu'il eut cessé de parler, nous les vîmes briller d'une lueur éclatante. Pour nous, après avoir témoigné tout notre étonnement à ce magicien de théâtre, nous nous retirâmes. Garde-toi, à mon exemple, d'admirer rien de semblable, et examine toute chose extraordinaire à la lumière pure de la raison. » Le divin Julien, satisfait de ce qu'il venait d'entendre, lui dit alors « Adieu, va retrouver tes livres. Tu m'as révélé ce que je cherchais. » Ayant ainsi parlé, il embrassa Chrysanthe et prit le chemin d'Éphèse. Il y rencontra Maxime, s'attacha fortement à lui et s'imprégna profondément de toute sa doctrine. Mais Maxime lui conseilla d'appeler auprès de lui le divin Chrysanthe ; ce qu'il fit ; et tous deux eurent peine à suffire à la vaste capacité du jeune prince pour l'étude. Quand tout alla bien de ce côté, Julien, apprenant qu'il y avait quelque chose de plus à découvrir, en Grèce, auprès de l'hiérophante des deux Déesses (72), y courut aussitôt. Il ne m'est point permis de dire le nom de l'hiérophante qui était en fonctions à cette époque ; car c'est lui qui m'a initié. Il descendait des Eumolpides (73), et c'était lui qui avait prédit, en ma présence, la ruine des temples et la perte de toute la Grèce. Il avait, en outre, déclaré publiquement qu'après sa mort son successeur ne pourrait pas d'abord monter sur le trône des hiérophantes, parce qu'il serait voué à des dieux étrangers et qu'il aurait juré par des serments solennels de ne pas présider à d'autres mystères ; mais que, cependant, il y présiderait enfin ; bien qu'il ne fût point d'Athènes. Son esprit prophétique allait si loin qu'il annonça que, de son vivant même, il verrait les temples renversés et saccagés ; qu'il serait abreuvé de mépris par l'excès de l'orgueil humain ; que le culte des deux Déesses périrait avant lui ; qu'il serait dépouillé de son saint ministère, et qu'il n'aurait ni le titre ni la longue existence d'un hiérophante. C'est ce qui arriva. Car on vit en même temps paraître le Thespien, père de l'initiation mithriaque (74) et se produire des calamités sans nombre et inexplicables, dont j'ai raconté une partie dans les longs développements de mon Histoire : s'il plaît à Dieu, je dirai ici le reste. Il s'agit de l'invasion des Barbares, sous la conduite d'Alaric (75), lorsqu'ils franchirent les Thermopyles (76), aussi aisément que s'ils traversaient un stade ou une plaine ouverte à la course des chevaux. Ces portes de la Grèce furent livrées par l'impiété de ces hommes vêtus de robes sombres (77), qui pénétrèrent sans obstacles avec le flot de l'invasion, et par suite le de la violation de la loi et de la rupture du lien qui rattachait tout à l'autorité des hiérophantes. Mais cela n'arriva que plus tard, et nous avons poussé trop loin l'anticipation de notre récit. Julien donc, après avoir été admis dans la familiarité du plus divin des hiérophantes, et s'y être rassasié de toute science, fut brusquement rappelé par Constance, pour être associé à l'Empire en qualité de César. Maxime était alors en Grèce, Edésius était déjà mort ; et Julien savait, comme on dit, sur le bout du doigt, toute la philosophie. Le jeune prince dut obéir, non à son penchant, mais à la nécessité. Envoyé avec le titre de César en Gaule, - non pas tant pour y régner que pour y périr dans la pourpre,- il évita le péril contre toute attente, grâce à la Providence divine ; cachant à tout le monde qu'il honorait les Dieux et triomphant de tout le monde parce qu'il les honorait. Il franchit le Rhin, défit et subjugua toutes les tribus barbares qui habitent sur ses bords, et échappa enfin à tous les pièges, à toutes les machinations qui furent dressées contre lui, ainsi que je l'ai écrit dans son Histoire. Il avait fait venir de Grèce l'hiérophante ; et, ayant avec lui seul tout préparé dans le secret, il se mit en devoir de purifier le monde de la tyrannie de Constance. Il eut pour coopérateurs Oribase de Pergame et Evhémère, homme originaire de la Lybie, que les Romains nomment, dans leur langue, Afrique. Mais, encore une fois, tout cela a été consigné avec la plus grande exactitude dans les livres qui concernent Julien. Le tyrannie de Constance une fois détruite, il renvoya en Grèce l'hiérophante, comme un dieu qui lui serait apparu et lui eût accordé tout ce qu'il souhaitait; il le combla de présents royaux et lui donna une garde pour la protection des sanctuaires de la Grèce. Bientôt après; il manda Maxime et Chrysanthe. La lettre (78) qui les appelait était conçue dans les mêmes termes pour tous les deux, Mais ils crurent bon d'avoir recours aux Dieux. Ces hommes énergiques et expérimentés, mettant en commun leur expérience, aiguisant et combinant la sagacité et la perspicacité de leur esprit, découvrirent alors des signes étranges en même temps qu'effrayants. Tous deux les considéraient ensemble. Chrysanthe, le premier, frappé de terreur et d'épouvante à cette vision, mordit sa langue et dit : « O mon cher Maxime, non seulement je dois rester ici ; mais il faut encore chercher une retraite. » Maxime, essayant de se rassurer lui-même, lui répondit « O Chrysanthe, tu me parais avoir oublié la doctrine dont nous avons été imbus, et d'après laquelle les Grecs illustres et ceux qui ont appris ces choses de doivent point se rendre aux premiers indices qu'ils rencontrent, mais faire violence à la nature du dieu, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé le signe qui peut remédier à tout. » « Tu as vraisemblablement, reprit Chrysanthe l'habileté et l'audace qu'il faut pour tenter cela ; mais moi, je ne voudrais pas lutter contre de pareils pronostics. » Et, en parlant ainsi, il se retira. Maxime persista, et essaya de tous les moyens jusqu'à ce qu'il eût obtenu ce qu'il voulait et ce qu'il désirait. Quant à Chrysanthe, il demeurait plus immobile qu'une statue, ne démordant point de l'idée qu'il avait arrêtée dans son esprit, dès le commencement. Maxime, cependant, voyait accourir vers lui, en Asie, tous ceux qui étaient dans les magistratures ou qui les avaient remplie, et l'élite des sénateurs,. La foule obstruait les chemins où devait passer le philosophe, en s'agitant et, en criant, comme le peuple a coutume de le faire lorsqu'il veut flatter quelqu'un. Les femmes, de leur côté affluaient à la porte de l'épouse de Maxime, pour le féliciter de son bonheur ; et la supplier de se souvenir aussi d'elles. Car, en fait de philosophie, Maxime, si on le comparait à sa femme, n'en était guère qu'eux premiers éléments. Ainsi adoré par toute, l'Asie, il vivait dans l'intimité de l'Empereur.
Pour Chrysanthe, il resta décidément chez lui ; une divinité lui avait dit en
songe, comme il me l'a répété dans la suite
C'est entouré d'une telle pompe que Maxime arriva à Constantinople, où bientôt
il brilla du plus vif éclat. L'Empereur et les princes ne le quittaient ni jour
ni nuit, tant ils étaient disposés à rapporter aux Dieux tout le bonheur du
temps présent. Mais l'Empereur ignorait ce qui se passait. Sur ces entrefaites et par suite d'une pression du prince sur le philosophe tous deux se résolurent à faire venir Priscus ; et Maxime insista, de son côté, pour que Chrysanthe lui fût adjoint. L'un et l'autre furent donc appelés, Priscus de Grèce, et Chrysanthe de Sardes en Lydie. Le divin Julien était tellement attaché à Chrysanthe, qu'il écrivit aux deux philosophes comme à des amis, et les supplia, comme on supplie les Dieux, de venir et de se réunir à lui. Ayant appris en outre que Chrysanthe avait une femme, nommée Mélite, cousine de l'auteur de ce livre, et pour laquelle il professait une admiration extraordinaire, Julien, de lui-même et sans que personne en sût rien, lui écrivit de sa propre main une lettre dans laquelle, avec une grande variété d'expressions, il la priait de persuader à son mari de ne point se refuser à ce voyage. Puis, il demanda la lettre destinée à Chrysanthe, y inséra celle-ci, les cacheta toutes deux de son sceau et les fit porter par un seul et même courrier, à qui il adressa de vive voix toutes les recommandations qu'il crut utiles, Pour fléchir aisément le grand coeur d'Eacide Priscus vint et garda une attitude modeste. Il ne manqua pourtant pas non plus de flatteurs, mais il demeura inébranlable ; et, loin d'être ébloui par l'éclat de la cour, il s'efforça de rabaisser le faste impérial et de ramener toutes choses à un état plus conforme à la philosophie. Chrysanthe, lui, ne se laisse point prendre à ces pièges et à ces machinations ; il consulta les Dieux, dont la volonté est immuable, et il s'y soumit. Il écrivit donc à l'Empereur que c'était uniquement pour lui qu'il restait en Lydie, et que les immortels le lui avaient ordonné. Julien comprit alors, l'insuccès de l'appel qu'il avait adressé à Chrysanthe, et il le nomma, - en lui associant sa femme, - souverain pontife de Lydie, avec la faculté de choisir les autres ministres du culte ; cela fait, il partit pour la guerre de Perse. Maxime et Priscus le suivaient ; quelques autres s'adjoignirent à eux, ne servant d'ailleurs qu'à faire nombre et présentant le spectacle d'une tourbe d'hommes, occupés à se louer eux-mêmes et gonflés d'orgueil, parce que l'Empereur s'était déclaré heureux de les avoir rencontrés. Mais, après que les choses, du faîte de si grandes et de si brillantes espérances, furent tombées dans un état d'horrible confusion et de ruine complète, - comme il a été dit dans l'histoire détaillée de Julien, après que Jovien (80) eut, pendant la courte durée de son règne, continué d'honorer les mêmes hommes, après que ce prince eut si rapidement et d'une manière si foudroyante suivi dans la tombe celui qui l'avait précédé sur le trône (la plupart du moins le crurent ainsi), Valentinien et Valens (81) arrivèrent au pouvoir. On s'empara alors de Maxime et de Priscus, mais d'une façon toute différente de celle dont Julien se les était attachés. Quand ce prince les avait fait venir, son appel avait été solennel et était pour eux le brillant prélude des plus grands honneurs ; mais, cette fois, toutes les espérances étaient remplacées par l'évidence du danger: l'humiliation de la chute se lisait profonde et indubitable sur leurs visages. Priscus, toutefois, ne subit aucun mauvais traitement : une déclaration publique le reconnut homme de bien, et il retourna en Grèce vers l'époque où, encore enfant, celui qui écrit ceci allait bientôt être compté parmi lés éphèbes (82) et commençait à étudier.
Quant à Maxime, de nombreuses clameurs s'élevaient contre lui en public, dans
les théâtres, et en particulier devant l'Empereur et tout le monde était étonné
qu'il pût supporter tant de malheurs. Cependant il fut cruellement puni, et on
lui infligea une amende telle qu'aucun philosophe n'entendit jamais parler d'une
pareille somme : mais on s'imaginait que tout lui appartenait et l'on se
repentait même de l'avoir taxé à trop peu de chose. Il fut envoyé en Asie, pour
y payer cet argent. Son admirable femme était présente et fondait en larmes. Comme cela ne finissait point, et, qu'au contraire le supplice s'accroissait : « Va, dit-il, chère épouse, achète du poison, donne-le moi et délivre-moi. » Elle en acheta, en effet, et l'apporta. Il le lui demandait pour le boire ; mais elle voulut l'avaler avant lui, et elle tomba foudroyée. Ses parents l'ensevelirent. Pour Maxime, il n'avait pu prendre le breuvage. Ici, il n'y a point d'éloquence, il n'y a point de louanges, dans toutes celles qu'a imaginées la nation des poètes, qui soient à la hauteur, de ce que fit Cléarque. Ce Cléarque appartenait â une riche famille de Thesprotie (84) et jouissait d'un renom éminemment illustre. Les choses étant venues à changer, Valentinien se retira en Occident, tandis que l'empereur Valens, exposé aux plus grands périls, luttait non pour l'Empire mais pour le salut de sa propre vie. Procope, en effet, s'était soulevé avec des forces considérables et le bloquait étroitement de tous côtés, pour l'amener à une capitulation. Cléarque avait alors le commandement de toute l'Asie depuis l'Hellespont par les frontières de Lydie et de Pisidie jusqu'à la Pamphylie. Il s'appliquait aux affaires avec beaucoup de bonne volonté, et était des premiers à exposer sa personne aux dangers ; mais il s'était mis en opposition directe avec le préfet du prétoire, au point que l'Empereur ne pouvait ignorer leur rivalité. Ce préfet était un certain Salutius, qui avait fait sa fortune sous le règne de Julien. Cléarque lui reprochait son inertie, qui venait de sa vieillesse, et l'appelait Nicias (85). Toute son occupation en effet, au milieu de pareilles circonstances, était de planter des arbres et de fortifier son âme par la lecture et l'étude de l'histoire. Cependant les événements tournèrent bien. Cléarque obtint la faveur de Valens qui, loin de le destituer de son com mandement, lui en confia un plus important, et le créa proconsul de la province que l'on nomme aujourd'hui proprement l'Asie. Elle s'étend à partir de Pergame, le long des côtes, et embrasse toute la portion continentale jus-qu'à la Carie; le Tmolus (86) lui sert de limite du côté de la Lydie. C'est la plus brillante des provinces : elle n'est pas ordinairement soumise au préfet du prétoire. A présent, les troubles récents ont tout bouleversé et mis la confusion partout. Mais, alors, Cléarque reçut. la province d'Asie dans un état florissant. Il trouva là Maxime, que l'on appliquait à la question et qui n'en pouvait plus. Nous voici arrivés à cette action divine, et dont on ne saurait véritablement rapporter le bienfait inespéré qu'à un dieu : tous les soldats qui faisaient l'office de bourreaux infatigables se virent contraints de fuir devant une force supérieure ; Cléarque délivra Maxime de ses liens, fit soigner ses blessures, le reçut à sa table, et conquit auprès de l'Empereur une telle liberté d'allure, que ce prince changea d'avis et accorda à Cléarque tout ce que celui-ci sut lui persuader. Salutius fut révoqué de sa charge, et Auxonius préposé aux affaires du prétoire. Quant aux soldats qui s'étaient faits tortionnaires et tous ceux qui dans ces temps malheureux, s'étaient rendus coupables de rapines et d'outrages, Cléarque traita les uns de la même façon, et fit rendre gorge aux autres. Aussi, n'y avait-il qu'un mot dans toutes les bouches : Cléarque est un second Julien pour Maxime. Ce philosophe fit ensuite quelques conférences publiques ; mais il n'était pas né pour les succès du théâtre et il en tira peu de gloire. Il rentra bientôt dans sa sphère et se borna aux leçons de l'école. Il recouvra la majeure partie des biens qui lui avaient été enlevés ; ce qui fait qu'il devint extrêmement riche, et se retrouva comme il était récemment encore, sous le règne de Julien. Il se rendit alors en grand appareil à Constantinople ; et là, il fut de nouveau l'objet du respect de tous, grâce au relèvement de sa fortune. Quant à la magie, dont il était soupçonné, il s'efforça d'en démontrer l'innocence ; et cela même accrut son prestige. Toutefois, ce regain de gloire, qui lui arrivait, lui valut une recrudescence de l'envie la plus basse. Les courtisans, ayant formé une conjuration et prétextant un oracle vulgaire (il n'est pas donné au premier venu de comprendre à quoi je fais ici allusion), produisirent un autre oracle, beaucoup moins clair, qu'ils attribuèrent à Maxime en l'accusant, sans avouer leurs intentions, d'en être l'auteur, et en exigeant des éclaircissements. C'était, alors, une opinion reçue que Maxime connaissait seul les secrets des Dieux, tandis qu'ils demeuraient cachés aux autres mortels. Maxime, apportant toute son attention à la chose et pesant toutes les paroles, reconnut bien vite ce que recouvraient les discours de ses ennemis et en était la vérité. Il dévoila donc ce qui était plus exact que toutes les prophéties, à savoir, qu'ils voulaient perdre le prophète, c'est-à-dire lui-même. Et non seulement il révéla les noms de tous ceux qui étaient complices de la conjuration, mais, de plus, il fit connaître les innocents qui étaient voués à une mort injuste. Arrachant enfin tous les voiles, il fit cette déclaration : « Après le supplice commun, appliqué sous des formes diverses à tant d'infortunés, après le massacre dont nous serons nous-mêmes victimes, l'Empereur périra d'une mort extraordinaire, et il ne sera honoré ni de la sépulture, ni d'un tombeau digne de lui. « Il en fut ainsi, en effet, et je l'ai raconté dans mon Histoire générale (87). Les conjurés furent aussitôt saisis, conduits au supplice et égorgés, comme des poulets dans une fête, pour un banquet populaire. Mais Maxime fut arrêté également et mené à Antioche, où se trouvait l'Empereur. Toutefois, ses ennemis, rougissant de se souiller du meurtre d'un homme qui avait si bien prédit ce qui arrivait, qui d'avance avait flétri les coupables et avait tout annoncé avec la dernière exactitude, ses ennemis, dis-je, agirent comme s'ils avaient voulu frapper un dieu incarné dans Maxime. Ils firent venir, en même temps que lui, en Asie, un certain Festus, esprit sanguinaire et digne d'un boucher, jugeant sans doute qu'un tel personnage convenait à la province. Celui-ci, dès qu'il fut arrivé, exécuta la besogne qu'on lui commandait et y ajouta même du sien, lâchant la bride à ses instincts de bête fauve et à la rage de son âme. Après avoir égorgé un nombre considérable de coupables et d'innocents, il couronna tant de meurtres par celui du grand Maxime. Ainsi se vérifia la prophétie, et il en fut de même du reste. Car l'Empereur, dans une grande bataille contre les Scythes, disparut d'une façon si étrange qu'on ne retrouva pas seulement un de ses os, pour l'ensevelir. Mais le sort fit encore quelque chose de plus singulier . Ce Festus (je parle avec certitude, ayant été témoin de l'événement), dépossédé de sa charge, alla trouver le nouvel empereur Théodose ; après quoi, il retourna en Asie, où il avait fait un mariage conforme à sa haute position. Là, pour faire parade de l'absolution qu'avaient obtenue ses crimes, il étala un luxe prodigieux, et donna un grand festin aux fonctionnaires et à la noblesse. C'était le troisième jour des calendes de janvier, selon la manière des Romains de compter les mois. 'Tous avaient accepté l'invitation de Festus et se prosternaient devant lui. Il s'était rendu au temple de Némésis (88) bien qu'il n'eût guère l'habitude d'honorer les Dieux, puisque c'était pour les punir de leur piété qu'il avait mis à mort toutes ses victimes. Il était allé, néanmoins, au temple ; et, de retour, il raconta en pleurant à ses convives la vision qu'il y avait eue.
Voici ce que c'était : il lui avait semblé voir Maxime lui jeter un noeud
coulant et l'entraîner dans les Enfers, pour y plaider sa cause devant Pluton.
Tous le assistants, bien que frappés de terreur, en repassant dans leur esprit
l'existence de cet homme, essuyèrent à l'envi ses larmes et lui conseillèrent
d'adresser ses voeux aux deux Déesses (89). Mais, comme il sortait, ses deux pieds ayant trébuché, il tomba sur le dos et demeura sans voix. Porté dans sa maison, il y expira aussitôt. Cette mort parut être la meilleure action de la Providence. PRISCUS J'ai eu précédemment l'occasion de parler avec détail de Priscus et de son origine ; voici, de plus, quelques particularités sur son caractère. Il était prudent et dissimulé à l'excès, d'une mémoire dont rien n'approche : il avait l'esprit meublé de toutes les opinions des anciens, et les citait sans cesse. Il était très beau et une haute taille ; la peine qu'il avait à s'engager dans une dispute l'eût fait prendre pour un ignorant : c'est qu'il gardait la science comme un trésor. Aussi, traitait-il de prodigues ceux qui manifestent à tous propos leurs sentiments. Selon ce qu'il disait, la discussion a moins pour effet d'affaiblir le vaincu, que d'émouvoir et de pousser à bout, en blessant son amour-propre, celui qui lutte contre la toute puissance de la vérité : c'est vouloir faire de lui un ennemi de la raison en même temps que de la philosophie. Voilà pour quel motif il se contenait le plus souvent. Ses manières étaient graves et solennelles; et, non seulement il les conserva dans ses relations avec ses amis et ses familiers, mais cet air de dignité l'accompagna toujours, depuis sa jeunesse jusque dans sa vieillesse. Chrysanthe disait à celui qui écrit cet ouvrage que le caractère d'Edésius était sociable et populaire, et qu'après les luttes littéraires ce philosophe allait se promener dans Pergame (90), escorté de ses principaux interlocuteurs. Le maître s'efforçait. d'inspirer ainsi le sentiment de la concorde et l'amour de l'humanité à ceux de ses disciples qu'il voyait enclins à l'invective et disposés à soutenir leurs opinions avec un orgueil intraitable. Quant à ceux qui essayaient de s'élever sur des ailes plus grandes et plus fragiles que celles d'Icare (91), il ne les précipitait pas dans la mer, mais il les ramenait sut terre et parmi les hommes. Le même philosophe qui donnait un tel enseignement s'arrêtait volontiers, quand il rencontrait une marchande de légumes, lui faisait suspendre sa marche et se mettait à causer avec elle; parlant du prix de sa marchandise, du gain qu'elle rapportait à sa boutique, et discourant aussi sur les procédés de culture de légumes. Il en faisait autant chez le tisserand, chez le forgeron, chez le charpentier. Telle était la manière d'être qu'apprenaient de lui ses disciples les plus attentifs, et, en première ligne, Chrysanthe et tous ceux qui, dans l'école, se rapprochaient de Chrysanthe. Seul, Priscus n'épargnait point le maître lors même qu'il était présent : il lui reprochait de trahir la dignité dé la philosophie et de débiter de beaux discours, excellents pour l'éducation de l'âme, mais dont il ne tenait aucun compte dans la pratique de la vie. Tel qu'il était toutefois, Priscus, même après le règne de Julien demeura à l'abri de toute persécution; faisant tête aux nombreuses innovations des petits jeunes gens qui se lançaient dans la philosophie avec toute l'extravagance de véritables Corybantes (92), gardant en dépit de tout la gravité de son caractère, et riant de la faiblesse humaine. Il acheva ainsi dans les temples de la Grèce sa longue vieillesse, et mourut à plus de quatre-vingt-dix ans, à une époque où tant de jeunes gens étaient conduits au suicide par le chagrin, où tant d'autres étaient tués par les Barbares. Parmi ces victimes, on peut citer Protérius, de l'île de Céphalénie, qui, de l'aveu de tous, était un honnête homme. L'auteur de ce récit a également connu Hilaire, Bithynien de naissance, mais qui avait vieilli à Athènes et qui, outre une instruction distinguée en diverses branches d'études, avait poussé si loin la philosophie de la peinture qu'il semblait, grâce à lui, qu'Euphranor (93) fût encore vivant. La beauté de ses tableaux m'avait inspiré pour lui une admiration et une affection extraordinaires. Eh bien Hilaire aussi fut de ceux qui ne purent échapper au malheur commun : saisi en dehors d'Athènes (il habitait près de Corinthe), il fut massacré par les Barbares (94), en même temps que ses esclaves.
Mais cela, s'il plaît à Dieu, sera consigné dans mon ouvrage historique, où je
parlerai avec plus de détail, non de chaque personnage en particulier, mais
des événements publics. JULIEN Le sophiste Julien de Cappadoce fleurit au temps d'Edésius, et fut en quelque sorte le Roi d'Athènes. Car la jeunesse entière affluait de fous côtés vers lui, pleine d'admiration pour son talent oratoire et pour son grand caractère. La même époque vit quelques autres hommes, enflammés de l'amour du bien, rivaliser de gloire avec lui. Tels furent Apsinès de Lacédémone, qui eut une certaine réputation d'orateur, Epagathus, et toute une série dont on pourrait citer les noms. Mais Julien les surpassait tous par la grandeur de sa nature, et ceux qui lui étaient inférieurs l'étaient de beaucoup. Ses nombreux disciples, qui lui vinrent de partout, pour ainsi dire, et qui se dispersèrent de toutes parts, excitèrent l'admiration dans tous Les lieux où ils s'établirent. L'élite de ces hommes s'appelait le divin Prohérésius., Héphestion, Epiphanius de Syrie, Diophante l'Arabe. Il est bon de ne pas oublier Tuscianus (95), qui fut admis dans la familiarité de Julien, et dont j'ai fait mention dans l'histoire de l'empereur du même nom. L'auteur a vu à Athènes la maison du philosophe, petite sans doute et de peu de prix; mais toute pleine du souffle de Mercure (96) et des Muses, au point de ne différer en rien d'un véritable sanctuaire. Julien la laissa en héritage à Prohérésius. On y voyait les portraits de ceux de ses disciples qu'il avait le plus appréciés; on y trouvait également un hémicycle en pierre lisse, imité des hémicycles publics, mais plus petit et proportionné à la maison. Telle était alors, en effet, à Athènes, la division qui existait parmi les citoyens et les jeunes gens, - division que la ville semblait entretenir dans ses murs à l'instar des anciennes guerres civiles, que nul sophiste n'eût osé aller dans l'assemblée et y exposer publiquement ses doctrines; ils se contentaient de parler, en baissant la voix, dans les amphithéâtres particuliers et enseignaient ainsi la jeunesse, non au péril de leur vie, mais en combattant seulement pour des applaudissements et pour le succès de leur éloquence. Bien des choses ont été couvertes par le silence; aussi, est-il nécessaire de réunir et de coordonner, dans cet écrit, les témoignages de toute la science et de toute la sagesse de notre philosophe. Dans le cours des dissensions civiles auxquelles nous venons de faire allusion, les plus hardis des disciples d'Apsinès portèrent une main violente sur ceux de Julien; et les gens qui s'étaient ainsi comportés avec une brutalité toute lacédémonienne ne craignirent pas d'appeler en justice, comme s'ils avaient été lésés en quelque chose, les victimes mêmes de leurs sévices qu'ils avaient mises en danger de mort. L'affaire fut déférée au proconsul, qui fit montre d'une sévérité excessive, et ne chercha qu'a inspirer la terreur. Il ordonna de saisir et d'enchaîner le maître et tous ceux qui se trouvaient compris dans l'accusation, comme coupables de meurtre. Ce proconsul, pourtant, ne paraissait pas trop ignorant pour un Romain, et ne semblait point avoir été élevé d’une manière trop sauvage et trop étrangère aux arts libéraux. Julien comparut donc devant lui, cité de la façon que nous venons de voir; Apsinès comparut également, mais sans avoir été appelé et pour prêter son appui à l'accusation. Les débats commencèrent et l'on donna carrière aux poursuivants. Le chef de la bande indisciplinée de Sparte se trouvait être un Athénien du nom de Thémistocle, qui était la cause de tout le mal. Turbulent et présomptueux, il déshonorait le titre qu'il portait. Dès le début, le proconsul regardant de travers Apsinès, lui dit : « Qui t'a fait venir ? » celui-ci répondit « L'inquiétude que j'éprouvais pour mes enfants. » Le Magistrat dissimula sa pensée sous le silence; alors, on introduisit les battus chargés de chaînes, le maître avec eux, la chevelure longue et le corps en un triste état, au point d'inspirer la pitié à leur juge lui-même. La parole ayant été donnée aux accusateurs, Apsinès se mit à plaider. Mais le proconsul l'interrompant : « Les Romains, dit-il, ne l'entendent pas ainsi ! celui qui est demandeur pour la première accusation doit être défendeur pour la seconde. » La rapidité inattendue de cette procédure avait empêché toute préparation. Thémistocle, qui avait porté l'accusation, se trouvant forcé de parler, changea de couleur, se mordit les lèvres, ne sachant quel parti prendre, et se tourna vers ses compagnons pour leur demander à l'oreille ce qu'il fallait faire. Ils n'étaient venus que pour crier et vociférer, pendant le plaidoyer du maître. Il y avait donc, d'une part, un grand silence, et, de l'autre, un grand tumulte le silence régnait dans tout le tribunal, le tumulte parmi les poursuivants. Julien, alors, éleva la voix sur un ton lamentable : « Qu'il me soit, au moins, permis de parler ? » Mais le proconsul s'écria : « La parole ne sera donnée à aucun des maîtres qui sont venus, après s'être préparés, et aucun des disciples n'aura la permission d'applaudir celui qui parlera. Vous allez voir à l'instant ce qu'est la justice chez les Romains. Que Thémistocle soutienne donc son accusation, et que la défense soit présente par celui que tu désigneras, comme le plus digne de remplir cette mission. » Là-dessus, l'accusation resta muette et Thémistocle devint la honte de son nom. Alors, on donna l'ordre d'élever la voix au plus capable de porter la parole, contre le premier chef d'accusation, et le sophiste Julien s'exprima en ces termes. « ô proconsul, grâce à ton sens exquis de la justice; Pythagore (97) Apsinès a appris tardivement, mais bien à propos, à se taire; lui qui, tu le vois toi-même, a enseigné depuis si longtemps à ses disciples l'art d'imiter Pythagore et de garder le silence. Mais, si tu veux que nous nous défendions, ordonne d'abord que l'on détache les chaînes d'un de mes compagnons, de Prohérésius, et tu verras s'il a été élevé dans l'atticisme ou dans le pythagorisme. » Le proconsul accorda avec bienveillance ce qu'on lui demandait, ainsi que je l'ai appris de Tuscianus qui assistait au jugement; et un des accusés, Prohérésius, délivré de ses liens, s'avança. Le maître lui cria d'une voix pleine et vibrante, comme celle dont se servent ceux qui appellent et excitent au combat les athlètes : « Allons, Prohérésius, courage; c'est maintenant le moment de parler. » Il commença alors son exorde, dont Tuscianus n'avait pas retenu les termes, il se souvenait seulement du sens. Il appuya d'abord sur la pitié que devait inspirer ce que lui et les siens avaient souffert, et mêla à ce début quelque éloge de son maître. Dans la suite du discours, il glissa une phrase de reproche à l'adresse du proconsul; et dans laquelle il démontrait la précipitation dont il avait fait preuve, en soumettant à un pareil traitement des gens qui n'étaient convaincus d'aucun crime. Le magistrat baissa la tête; son esprit était saisi en même temps de la profondeur des paroles, de la facilité et de l'éclat de la diction. Tous auraient voulu applaudir; mais ils étaient frappés de stupeur, comme en présence d'un prodige. envoyé par Jupiter, et il régnait un silence tout rempli de mystère. Prohérésius, ensuite, entama la seconde partie de son exorde et commença en ces termes, que Tuscianus avait conservés dans sa mémoire : « S'il est permis de commettre toutes les injustices, de porter des accusations, et d'obtenir créance préalablement à toute justification, soit; que cette ville devienne la proie de Thémistocle! » À ces mots, le proconsul s'élança de son siège; et, secouant son vêtement de pourpre, ce que les Romains appellent une toge, ce juge grave et inexorable applaudit comme un jeune homme l'éloquence de Prohérésius. Apsinès applaudit aussi, bien malgré lui : mais qui peut résister à la force de la nécessité? Le maître Julien, se contentait de pleurer. Le proconsul ordonna aux accusés de sortir; puis, il prit à part d'abord le maître de L'accusateur tout seul, ensuite Thémistocle et les Lacédémoniens, et leur rappela les flagellations en usage à Sparte, en y joignant le souvenir de celles qui étaient pratiquées par les Athéniens. Quant à Julien, il mourut plein de gloire au milieu de ses disciples, à Athènes, et laissa à ses compagnons le sujet d'une grande lutte; pour son éloge funèbre.
(1) On sait que cet
auteur fut à la fois général, philosophe et historien.
|