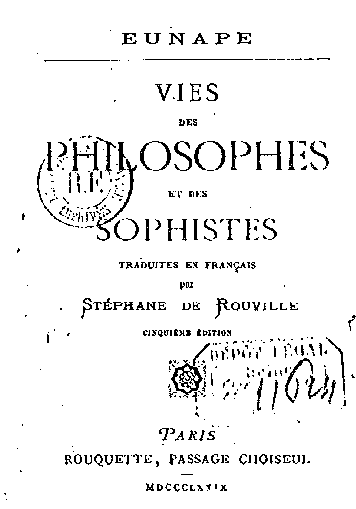|
ALLER à LA TABLE DES MATIÈRES DE EUNAPE EUNAPE
VIES DES PHILOSOPHES ET DES
SOPHISTES
CHAPITRE IX PROHÉRÉSIUS J'ai suffisamment parlé de Prohérésius dans ce qui précède, et j'ai donné sur lui de nombreux détails, dans mes Mémoires historiques. Néanmoins, le moment est venu de traiter ce sujet avec une exactitude plus scrupuleuse encore, pour moi qui ai connu l'homme à fond et qui ai été admis à jouir de sa conversation et de sa familiarité. Quelque grandes, quelque célestes que soient ces faveurs inénarrables, lorsqu'elles viennent d'un maître tel que lui, elles sont certainement bien au-dessous de l'amitié qu'il témoigna à l’auteur de ce livre. Celui qui écrit ces lignes était passé d'Asie en Europe et était arrivé à Athènes, ayant environ seize ans, Prohérésius avait atteint, comme il le disait lui-même, sa quatre-vingt septième année. À cet âge, il avait encore une chevelure très abondante et frisée, toute argentée d'une grande quantité de cheveux blancs; qui la faisaient ressembler à l'écume de la mer. Il avait une telle vigueur d'éloquence, son corps fatigué était si merveilleusement soutenu par la jeunesse de son âme, que j'en vins à le croire exempt de la vieillesse et de la mort, et que je m'attachai à lui comme à un dieu qui, spontanément et sans effort, serait descendu sur la terre. J'avais abordé an Pirée, vers la première veille de la nuit, avec une fièvre violente qui m'était survenue pendant la traversée. Plusieurs personnes qui m'étaient attachées par les liens de la parenté avaient fait aussi le voyage avec moi. À l'heure où noue arrivâmes; avant de remplir les formalités habituelles le patron du navire qui appartenait à des gens d'Athènes, se tendit aussitôt dans cette Ville. À l'endroit où l'on débarquait, stationnaient toujours en grand nombre les partisans déclarés de chaque école. Les autres passagers s'étaient mis en marche. Pour moi qui étais incapable de mettre pied à terre, on me soutint à tour de rôle, et je fus ainsi porte à la ville. Il était minuit, moment où le soleil rend les ténèbres plus profondes, en se trouvant le plus au Midi. L'astre était entré dans le signe de la Balance, et les veillées devenaient plus longues. Le patron du vaisseau avait été anciennement l'hôte de Prohérésius : il heurta donc à la porte de sa maison, et y introduisit une telle foule d'étudiants qu'à chaque fois que des rixes s'élevaient, à propos de tel ou tel jeune homme, tous les nouveaux venus paraissaient devoir remplir l'école du philosophe. Parmi ceux-là, les uns l'emportaient par la force du corps, les autres, étaient supérieurs par leur richesse, le reste se trouvait dans des conditions moyennes. Quant à moi, tristement disposé, j'avais pour tout bien les livres des anciens dans la mémoire et sur les lèvres. Ce fut bientôt une allégresse complète par toute la maison, des allées et venues d'hommes et aussi de femmes : les uns riaient, les autres échangeaient des plaisanteries. En raison de l'heure, Prohérésius avait fait venir deux de ses propres parents, pour recevoir les arrivants. Lui-même était originaire d'Arménie, de la partie extrême qui touche à ta frontière persane. Quant a ses parents, ils s'appelaient Anatole et Maxime. Ils reçurent les hôtes, les présentèrent aux voisins et les menèrent au bain, avec un certain apparat. Aussi, la jeunesse du quartier ne leur ménageait ni les rires ni les quolibets. Après le bain, tout le monde se retira; mais moi, sous l'influente croissante de mon mal, je me consumais, n'ayant vu ni, Prohérésius ni Athènes, et croyant avoir rêvé de tout ce qui faisait l'objet de mes désirs. Mes compatriotes et les Lydiens étaient fort inquiets; et, cédant à la coutume générale de montrer une complaisance exagérée pour les jeunes gens de mon âge, ils imaginèrent une foule de choses énormes qu'ils grossirent en récits prodigieux, si bien qu'un deuil extraordinaire se répandit dans la ville, comme s'il se fût agi d'une grande calamité. Un certain Eschine, qui n'était pas Athénien, mais dont le patrie était Chio, et qui avait sur la conscience la mort de beaucoup de gens, non seulement de ceux qu'il avait promis de guérir, mais même de ceux qu'il n'avait fait que voir, pénétra dans le cercle des amis qui m'entouraient en pleurant, et se mit à crier, comme je le sus plus tard : « Laissez-moi, du moins, donner une potion à un mort. » On permit donc à Eschine de tuer celui que l'on considérait comme perdu. Il m'ouvrit la bouche avec quelques instruments, et y versa un breuvage dont il déclara dans la suite la composition, et de l'efficacité duquel, longtemps après, la Divinité rendit témoignage. À peine l'eus-je absorbé, que mes entrailles furent abondamment soulagées. Je revis la lumière et je reconnus les gens de la maison. Eschine, par cette seule cure, ensevelit la mémoire de ses erreurs passées, et vit se prosterner devant lui celui qu'il avait sauvé et ceux qui se réjouissaient de sa guérison. Après un tel succès, Eschine, honoré par tous à l'égal d'un dieu, retourna à Chio : il avait eu soin, auparavant, de me donner un remède puissant, pour me fortifier, et, dès lors, une solide amitié unit le sauveur et celui qu'il avait sauvé. Le divin Prohérésius, qui ne m'avait jamais vu, avait cependant versé déjà des larmes sur moi. Lorsqu'il apprit ma guérison, non moins inespérée qu'incroyable, ii convoqua les meilleurs et les plus généreux de ses disciples, ceux dont on louait surtout la force corporelle, et il leur dit : « J'ai éprouvé quelque chose, à propos de cet enfant qui vient d'être sauvé; je ne l'avais a jamais vu, mais j'ai souffert, en apprenant qu'il était perdu. Si vous voulez me faire plaisir, allez le purifier au bain public : épargnez-lui toute raillerie et toute taquinerie, et traitez-le aussi délicatement que s'il était mon fils. » Il en fut ainsi, et cela sera raconté avec plus détails, dans les Annales relatives à l'époque de Prohérésius. Toutefois, l'écrivain qui trace ces lignes, persuadé que tout ce qui tient à ce grand homme n'arrive que grâce à la Providence divine, ne sera pas entraîné, par son amour pour le maître, à dire quoi que ce soit de contraire à la vérité; car la parole de Platon est certaine, à savoir; que la vérité est la source de tout bien, pour les dieux et pour les hommes. Prohérésius avait, pour en revenir à ce sujet, une telle beauté physique, même dans sa vieillesse, que je doute si quelque autre, étant jeune, avait pu être aussi beau et que j'admire la puissance, d'une beauté qui s'étendait dans un corps si grand, à la forme exquise des moindres détails. Sa taille, en effet, était d'une élévation telle qu'on ne pourrait y croire, à peine même faire une idée. Elle atteignait jusqu'à neuf pieds, lorsqu'il se tenait debout : aussi, avait-il l'air d'un colosse, et, fut-il regardé comme dépassant la taille des hommes les plus grands de son temps. Sa destinée le fit sortir jeune de l'Arménie et le transporta à Antioche (1). Il ne pouvait songer à se rendre tout, de suite à Athènes, car il était affligé d'une extrême pauvreté : bien né d'ailleurs, il était malheureux de ce côté, Il s'attacha donc aux leçons d'Ulpien (2) qui était sans rival dans Antioche pour l'éloquence, s'exerça à la tribune, et se trouva bientôt au premier rang. Il demeura longtemps auprès d'Ulpien; puis, s'étant rendu enfin à Athènes, il se pénétra avec ardeur de l'enseignement de Julien; et, là aussi, il devint le premier. Héphestion l'avait suivi, et tous deux, s'aimaient avec passion, rivalisant de pauvreté et d'éloquence. Ils n'avaient pour eux deux qu'un vêtement et qu'un petit manteau, avec trois ou quatre couvertures, auxquelles le temps avait fait perdre la couleur et l'épaisseur primitives. Il leur restait pour toute ressource d'être un seul homme en deux personnes, comme Géryon (3), dont parle la fable, mais qui avait trois corps; de même, ils étaient à la fois deux et un. En effet, quand Prohérésius paraissait en public, Héphestion ne se montrait pas et demeurait enveloppé dans les couvertures, s'exerçant à l'éloquence. Prohérésius, à son tour, en faisait autant, quand Héphestion sortait; tant était grand le dénudent auquel ils étaient en proie. Julien, cependant, avait dans son âme une préférence pour Prohérésius : il l'écoutait de toutes ses oreilles, et admirait la grandeur dé son caractère. Après la mort de ce philosophe, Athènes se passionna pour savoir à qui serait donnée sa succession dans le privilège d'enseigner l'éloquence, et il se présenta tant de gens, pour obtenir cette première place parmi les sophistes, que le dénombrement en serait fastidieux. Tous les suffrages s'accordèrent pour désigner Prohérésius, Héphestion, Epiphanius et Diophante; on leur adjoignit Sopolis, comme par surprise et par suite d'une négligence dans le calcul des votes, et un certain Parnasius, d'une façon moins honorable encore. Car, en vertu d'une loi faite par les Romains, il devait y avoir à Athènes un grand nombre de professeurs et un grand nombre d'auditeurs. Après les élections, les maîtres les moins recommandables n'en eurent guère que le titre, et leur influence, ne s'étendit pas au delà des bancs et de la tribune où ils parlaient : on vit aussitôt la ville se partager entre les plus éminents ; et non seulement la ville, mais tous les peuples soumis aux Romains, si bien que la division ne se mit point entre eux pour l'éloquence, mais pour la question de savoir à laquelle des diverses nations s'adresserait la parole de chacun d'eux. C'est ainsi que l'Orient échut comme récompense et sans contestation à Epiphanius, l'Arabie à Diophante. Héphestion par respect pour Prohérésius, quitta Athènes et la société des mortels. Le Pont et les provinces limitrophes envoyèrent leurs élèves à Prohérésius, témoignant ainsi leur admiration pour le génie d'un homme qui était, en quelque sorte, leur compatriote, Il s'y joignit toute la Bithynie et l'Hellespont, tout le territoire au-dessus de la Lydie, s'étendent par ce que l'on appelle aujourd'hui l'Asie vers la Carie et la Lycie, avec la Pamphylie et le Taurus pour limites. De plus, toute l'Égypte lui vint comme un héritage naturel du Royaume de l'éloquence, avec tout ce qui se prolonge au delà de l'Égypte vers la Libye sans bornes connues, et tant que le sol s'y trouve habité. Je parle là en général; car, pour descendre dans le détail, il y avait biens de temps en temps, parmi un certain nombre de jeunes gens, quelques dissidences; et l'on passait de l'un à l'autre professeur, selon que l'on avait été déçu, au commencement, dans le choix qu'on avait fait. La grandeur du caractère de Prohérésius fut cause d'un violent soulèvement de la jeunesse; et telle fut la force du parti suscité par tous ses rivaux réunis, qu'ils réussirent à le faire bannir d'Athènes, après avoir corrompu le proconsul : c'est de cette manière qu'ils restèrent maîtres du terrain pour la Royauté de l'Éloquence. Prohérésius, pendant son exil, tomba comme Pisistrate (4) dans une misère profonde, puis rentra dans son pays. Les adversaires de ce philosophe avaient profité de leurs richesses; lui, était seulement tout à son éloquence, comme le Mercure d'Homère qui introduisit Priam dans la tente d'Achille, au milieu de ses ennemis mêmes (5). Prohérésius, toutefois, eut cette bonne fortune qu'un nouveau proconsul fut placé à la tête de la province et que ce magistrat, informé par la renommée, s'indigna de ce qui était arrivé. Avec l'autorisation de l'Empereur, l'ostracisme qui avait frappé Prohérésius fut annulé pst un vote nouveau, et le philosophe put retourner à Athènes. Ses ennemis, s'agitant derechef comme des serpents et se roulant sur eux-mêmes, se redressèrent ensuite contre lui et préparèrent, en vue de l'avenir, de nouvelles machinations. Pendant qu'ils étaient absorbés par ces complots, ceux qui travaillaient au retour du maître prirent les devants, et Prohérésius arriva. Je le sais, car les moindres circonstances de l'affaire m'ont été contées par un témoin oculaire, le Lydien Tuscianus, qui aurait pu être Prohérésius, si Prohérésius n'avait pas existé.
En reparaissant ainsi, notre philosophe trouva, comme un autre Ulysse, après une
longue Absence, quelques-uns de ses compagnons, parmi lesquels Tuscianus, tous
sains de corps et d'esprit, et le regardant avec un étonnement que justifiait
l'étrangeté de l'événement. Leur rencontre le remplit de bonnes espérances. «
Attendez, leur dit-il, le proconsul. » Les sophistes manifestèrent de la répugnance pour ce mode de procéder 'et Aristide, après beaucoup de réflexion et avec un grand embarras, - car il leur était impossible de rien répondre d'approprié, - finit par dire qu'ils n'étaient point du nombre de ceux qui vomissent la parole, mais de ceux qui la travaillent minutieusement. Élevant la voix pour la seconde fois, le proconsul s'écria : « Parle, Prohérésius. » Celui-ci, de sa place, comme pour préluder au combat, prononça quelques paroles qui n'étaient pas sans grâce; puis, haussant le ton de son improvisation, il se leva plein d'assurance pour commencer la lutte. En ce moment, le proconsul était prêt à proposer un argument. Mais Prohérésius, voyant la multitude de ses ennemis, le petit nombre de ses amis, qui même cherchaient à se dissimuler, sentit, non sans raison, son courage l'abandonner. Toutefois, un génie s'agitant en sa faveur et le secondant, il se met à parcourir du regard le cercle des assistants, et il découvre, cachés au dernier rang de l'amphithéâtre, deux hommes rompus à l'art oratoire, qui avaient été la cause de ses malheurs, et il s'écrie : « Grands Dieux ! voici des hommes sages et excellents ! C'est à ceux-là, proconsul, que a tu dois ordonner de me proposer un argument. Peut-être, alors, reconnaîtront-ils à a quel point ils ont été impies. » Les deux personnages; ayant entendu ces paroles, tachaient de se perdre dans la foule des spectateurs et s'empressaient déjà de disparaître. Mais le proconsul envoya quelques soldats qui les amenèrent au milieu de la salle; et, leur ayant adressé une sorte d'exhortation, il leur dit de proposer ce qu'on appelle l'argument. Ceux-ci, après une courte délibération et un colloque de quelques instants, choisirent le sujet le plus difficile, le plus insignifiant, le plus absurde et le moins propre à la pompe oratoire. Prohérésius les regarda de travers; et, se tournant vers le proconsul : « Je te supplie; lui dit-il, de m'accorder ce que je te demanderai de juste, avant d'engager l'action. » Le proconsul ayant répondu qui rien de juste ne lui serait refusé : « Je demande, dit Prohérésius, qu'on me donne deux sténographes (6) et qu'on place, au milieu de l'amphithéâtre, ceux qui chaque jour recueillent les paroles de Thémis (07), afin qu'aujourd'hui ils prêtent leur concours aux miennes. » Le proconsul ayant autorisé les plus habiles d'entre les sténographes à se présenter, ceux-ci s'établirent de chaque côté, prêts à écrire. Nul ne savait comment tout cela allait finir. « Je vais encore demander, dit Prohérésius, quelque chose de plus difficile. » Ayant reçu l'ordre d'indiquer ce qu'il voulait : « C'est, dit-il, que personne ne m'applaudisse. » Le proconsul enjoignit à tous, sous les peines les plus sévères, de se conformer à cette volonté de l'orateur. Alors, celui-cl commença de faire couler de ses lèvres un fleuve d'éloquence, en terminant chaque période d'une façon éclatante. L'assemblée, qui gardait par force un silence pythagoricien, emportée par l'admiration, haletait et mugissait. Cependant le discours suivait ses développements; et l'orateur s'élevait au-dessus dé toute éloquence, et de toute attente humaine. Il passa bientôt la seconde partie de la thèse, et se mit en devoir de remplir les conditions du sujet. Mais, tout à coup, cédant à une sorte d'enthousiasme et d'exaltation, il 'abandonne le reste comme impossible à défendre, et se lance dans la démonstration de la thèse opposée. Les sténographes avaient peine à le suivre, l'assemblée éprouvait de plus en plus de difficulté à se taire, et le torrent de la parole coulait sans cesse. Tournant alors le visage vers les sténographes : « Regardez avec le plus grand soin, s'écrie Prohérésius, si je me souviens bien de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. » Et, sans se tromper d'un mot, il répéta son discours. Dès lors, ni le proconsul ne put garder la loi qu'il avait faite lui-même, ni l'assemblée laisser encore arrêter par ses menaces. Tous les assistants se mirent à embrasser la poitrine du sophiste, comme ils eussent fait à la statue d'une divinité, lui baisant les uns les pieds, les autres les mains, ceux-ci le proclamant dieu, ceux-là le comparant à Mercure, qui préside à l'éloquence. De leur côté, ses adversaires succombant sous le poids de leur jalousie, gisaient à terre, pour ainsi dire; et quoique écrasés de la sorte, ne pouvaient s'empêcher de le louer. Le proconsul le reconduisit hors de l'amphithéâtre, avec ses gardes et toute sa suite. Après cela, personne n'osa plus parler contre Prohérésius: tous, comme frappés de la foudre, lui cédèrent la palme. Avec le temps, cependant, ses ennemis, comme les têtes de l'Hydre (8), repoussèrent; ils revinrent à leur naturel primitif et se rassemblèrent de nouveau. Ils eurent des festins somptueux, avec de jolies petites servantes qui attirèrent alors, dans leurs filets, quelques-uns des beaux jeunes gens d'Athènes. En cela, ils suivaient l'exemple des rois qui, vaincus en bataille rangée, réduits aux abois, poussés aux dernières extrémités, ont recours aux troupes légères, aux frondeurs, à la masse sans valeur des, auxiliaires, qu'ils avaient méprisés dans le commencement, mais que la nécessité leur fait estimer ensuite. Ainsi, les ennemis de Prohérésius, épouvantés, avaient cherché un secours indispensable; ils, dressaient, il est vrai, des pièges honteux mais ils échappaient néanmoins à tout reproche, s'il est permis d'être en paix avec sa conscience, en faisant le mal dans son propre intérêt. Ils avaient donc recruté un grand nombre de partisans, et leurs manoeuvres avaient le succès qu'ils avaient prévu. Mais l'influence qu'exerçait Prohérésius, était une sorte de royauté et la vertu de ses discours faisait merveille. Tous les hommes d'intelligence s'attachaient à lui; et, parmi les autres, ceux qui suivaient son enseignement y gagnaient de devenir intelligents aussi. Vers ce temps, la cour impériale mit en relief un homme, épris de gloire et d'éloquence. Il était de Béryte et s'appelait Anatolius. Ses envieux lui avaient donné le surnom d'Azutrion, dont je laisse à l'engeance effrontée des gens de théâtre le soin d'apprendre la signification. Passionné, comme je viens de le dire, pour la gloire et pour l'éloquence, Anatolius obtint l'une et posséda l'autre. Il parvint aussi au sommet de la science que l'on nomme jurisprudence : n'avait-il pas pour patrie Béryte (9), qui est comme la mère nourrice, au sein de laquelle on va puiser les études de cette nature? Il se rendit à Rome, y fit provision de sagesse, et y acquit une éloquence à laquelle ne manquaient ni l'élévation ni la solidité. Il sut promptement faire son chemin à la cour, et ne tarda point à y briller au premier rang. Il fut revêtu de tous les honneurs, se distingua dans la plupart des charges qu'il remplit, à la grande admiration de ses ennemis eux-mêmes, et fut enfin promu au fonctions de préfet du prétoire, qui, en réalité, sont l'Empire sans la pourpre. La Fortune lui avait donné toutes les satisfactions qu'il avait ambitionnées et dont il était digne. Il avait reçu, en effet, sous son autorité la préfecture, d'Illyrie. Et, comme il était attaché au culte ancien et qu'il inclinait fortement vers l'Hellénisme, - bien qu'en général les esprits penchassent alors du côté opposé,- il aurait pu visiter les parties principales de son gouvernement et administrer chacune d'elles, selon sa volonté. Mais, possédé comme d'une sublime folie de voir la Grèce, de recueillir et de coordonner par la perception les idées qui sont le fond de l'éloquence; et de repaître ses yeux du spectacle que l'imagination se forge d'après les fantômes de l'antiquité, il se dirigea en toute hâte vers ce pays. Il envoya d'abord aux sophistes un problème, à le solution duquel il ordonna à tous de travailler. La Grèce était saisie d'admiration, en présence de cet homme, de sa réputation ; de sagesse et de savoir, d'inflexibilité et d'incorruptibilité. Les Sophistes cependant s'exerçaient de leur mieux, et, chaque jour, se dressaient de mutuelles embûches. Enfin, car la nécessité l'exigeait, ils se réunirent; et, après avoir échangé de nombreux arguments pour et contre, en vue de ce qu'ils appellent la position du problème, chose des plus ridicules que je connaisse, ils commencèrent à disputer les uns avec les autres, chacun par amour-propre soutenant son opinion personnelle et la défendant avec obstination, auprès de ses jeunes élèves.
La descente d'Anatolius, en Grèce, devenait un événement plus redoutable que la
fameuse expédition des Perses tant célébrée; le danger était imminent, non pour
les Grecs, mais pour les sophistes. Aussi tous ces gens-là, parmi lesquels se
trouvait le sophiste Hïmérius (10) de Bithynie, que
je n'ai connu que par ses écrits, se donnaient-ils un mal énorme et
s'imposaient-ils un travail considérable pour établir le problème, chacun selon
la façon dont il le comprenait. Anatolius l'honora alors d'une façon toute particulière, et jugea les autres à peine dignes de s'asseoir â sa table. Car Anatolius était du nombre des sophistes qui aiment la bonne chère et les festins, et les repas qu'il donnait ne manquaient ni des charmes de la conversation ni de ceux de la science. Tout cela remonte à un temps déjà éloigné. Mais l'auteur de ce livre a pu compléter très exactement ce que la tradition lui avait appris. Anatolius professa aussi une grande admiration pour Milésius, qui était de Smyrne dans l'Ionie, et que la nature avait merveilleusement doué, mais qui se jeta dans une vie de paresse et de désoeuvrement, s'attacha aux sacrifices, négligea le mariage, et se donna tout entier à la poésie et à la musique, particulièrement à tout ce qui, dans la poésie, obtient l'approbation des Grâces, Il séduisit tellement Anatolius que celui-ci le surnomma la Muse. Il appelait les questions du sophiste Epiphanius des diérèses (11), pour se moquer de la minutie et de l'exactitude poussée l'excès du professeur. Raillant les dissidences de tous, au sujet de la position du problème; il disait : « Si les sophistes avaient été plus de treize, ils eussent bientôt trouvé d'autres démonstrations, pour envisager sous des formes multiples une seule et même question. » Prohérésius était le seul de tous qu'il admirait sans réserve. Peu de temps auparavant, notre philosophe avait été appelé dans les Gaules par l'empereur Constant (12). Il fit à ce point la conquête de César que celui-ci l'admit à sa table, parmi les personnages les plus considérables. Les hommes de ce pays et de cette époque ne pouvaient pénétrer la profondeur de son éloquence, ni admirer les beautés mystérieuses de son âme. Leur enthousiasme se rabattait donc sur ce qu'ils voyaient et sur ce qui frappait leurs regards; et ils étaient en extase devant la beauté de son corps et la hauteur de sa taille, le considérant avec stupeur comme quelque statue colossale tant, chez lui, tout cela était au-dessus de l'humain. La force, dont ils lui voyaient faire preuve, leur faisait supposer qu'il était insensible à tout, et véritablement de fer : il n'avait, en effet, qu'un léger manteau, allait nu-pieds et faisait volontiers ses délices de l'hiver gaulois, buvant presque le Rhin glacé. Toute sa vie, d'ailleurs, il ne connut l'usage d'aucune boisson chaude. Constant l'envoya dans la grande Rome, désireux de montrer à quels hommes il commandait. Mais les Romains n'avaient rien à admirer, tant, chez eux aussi, tout dépassait la nature humaine. Cependant, ils distinguèrent en lui des mérites variés, obtinrent ses louanges, et, en reconnaissance, lui élevèrent une statue d'airain de grandeur naturelle, avec cette inscription
AU ROI DE L'ELOQUENCE, Lorsque Prohérésius fut sur le point de retourner à Athènes, l'Empereur l'autorisa à lui demander un présent. Celui-ci, ne voulant pas déroger à la grandeur de son caractère, demanda des îles qui devaient payer à Athènes un tribut de blé. Il en désigna plusieurs et non pas les plus petites. L'Empereur les lui donna, et y ajouta même une des plus hautes dignités: il lui confia ce qu'on appelait la préfecture des camps, afin que personne rie pût reprocher au philosophe d'avoir obtenu de si grandes richesses aux dépens de l'État. Mais le soin de confirmer ce privilège appartenait ait préfet du prétoire, et il venait justement d'arriver de la Gaule. À la suite des combats d'éloquence dont j'ai parlé plus haut, Prohérésius alla donc trouver Anatolius et sollicita de lui la confirmation de la faveur impériale. Il ne se borna pas à invoquer l'appui de ses patrons, il fit encore appel à presque tous ceux qui, en Grèce, avaient quelque instruction. Son retour, du reste, en avait amené à Athènes une nombreuse affluence. Comme le théâtre était plein et que Prohérésius réclamait l'intervention de ses patrons, le préfet, devançant l'attente de tous les assistants et voulant éprouver la force, d'improvisation du philosophe, lui dit : « Parle, Prohérésius, car il serait honteux, qu'en ta présence un autre prit la parole et louât l'Empereur. » Mais, Prohérésius, comme un cheval appelé à entrer dans la carrière, commença à discourir sur le présent que lui avait fait César, et introduisit dans sa harangue Célée, Triptolème (13), et la venue de Cérès apportant le don des moissons. Puis, il rattacha à son récit celui de la faveur impériale et arriva promptement à célébrer l'antique splendeur et la munificence du bienfait accordé, Enfin, l'enthousiasme débordait de ses lèvres et il montra tout son art dans la manière dont il traita son sujet. La grandeur du présent fit bien voir, d'ailleurs, le prix qu'on attribuait à son éloquence. Après ces événements, il épousa une femme de la ville de Tralles, en Asie: elle se nommait Amphiclée. Il eut d'elle deux petites filles, dont l'âge différait seulement du temps nécessaire pour la gestation. Elles étaient arrivées à cette époque de la vie où un enfant est une chose pleine de charmes et une source de félicité pour le père, dont l'âme est doucement ébranlée par les plus délicieuses émotions du plaisir, lorsque toutes les deux, dans l'espace de quelques jours, furent enlevées par la mort à leurs parents. Prohérésius en pensa perdre le sentiment et la raison. La muse de Milésius put, seule, remédier à ce mal se parant de grâces harmonieuses et multipliant les séductions de ses chants, elle rappela le malheureux père à lui-même. Plus tard, les Romains ayant demandé à Prohérésius de leur envoyer un de ses disciples particuliers, il leur adressa Eusèbe, qui était d'Alexandrie et dont le caractère devait s'harmoniser parfaitement avec une ville comme Rome : il avait, en effet, l'habitude de la flatterie et savait faire le chien couchant auprès des grands. Aussi, à Athènes, il était considéré comme un factieux. Mais Prohérésius avait voulu grandir sa propre réputation par l'envoi d'un homme rompu aux petites intrigues de la politique; car, en ce qui touche l'éloquence d'Eusèbe, il suffira de dire qu'il était Égyptien, Les gens de ce pays sont devenus, il est vrai, fous de poésie, mais le sérieux Mercure les a abandonnés. Eusèbe eut pour rival Musonius, son élève dans l'art des sophistes, dont j'ai parlé longuement, à un autre point de vue, dans mes Annales. Lorsque Musonius se leva pour prendre la parole contre son maître, sachant à qui il avait affaire, il se lança du premier coup dans la politique. Mais, sous le règne de Julien, il fut exclu de sa chaire, parce qu'il passait pour être chrétien. C'est lui qui, voyant l'hiérophante, comme un véritable trépied delphique, exposé aux questions de tous ceux qui demandaient à savoir l'avenir, surprit au moyen d'une ruse extraordinaire la connaissance de ce qui allait se passer. L'Empereur, à ce moment, faisait arpenter les terres des Hellénisants en vue de l'assiette des impôts, afin qu'ils ne fussent pas trop grevés. Prohérésius pria Musonius de s’informer auprès des Dieux si cette générosité serait durable. Celui-ci s'y étant refusé, il sut alors ce qui allait arriver et fut plus tranquille. C'est vers ce temps que l'auteur de cet ouvrage, âgé de seize ans environ, débarqua à Athènes et prit rang parmi les disciples de Prohérésius. Il fut aimé par lui, comme s'il eût été véritablement son fils. Cinq ans plus tard, j'allais faire voile pour l'Égypte, lorsque mes parents me rappelèrent et me contraignirent de retourner en Lydie, pour y professer l'art des sophistes, ainsi que' tout le monde m'y conviait. Prohérésius, lui, quitta la terre peu de jours après. On peut dire que ce grand homme avait rempli l'univers de la renommée de son éloquence et de celle de ses disciples. ÉPIPHANIUS C'était un Syrien, très habile dans l'art de discerner les questions, mais qui manquait d'énergie dans la parole. Cependant, il exerça en même temps que Prohérésius et parvint à avoir beaucoup de réputation. C'est que la nature humaine n'aime point à concentrer son admiration sur un seul objet : portée à la jalousie, elle en devient esclave et se plaît souvent à opposer le premier venu aux grandes personnalités et aux génies supérieurs, en vertu du principe des contraires qu'elle emprunte à la physique. Èpiphanius mourut d'une hémorragie, sans être parvenu à une vieillesse avancée. Son épouse, qui était la plus belle des femmes de son temps, périt victime de la même maladie. Ils n'avaient pas eu d'enfants. Je n'ai point connu Épiphanius; il était mort longtemps avant mon voyage en Grèce (14) DIOPHANTE DIOPHANTE était né en Arabie et sut conquérir sa place parmi les maîtres de l'art. Le même esprit de dénigrement, naturel, aux hommes, l'opposa a Prohérésius, comme si l'on eût voulu mettre Callimaque (15) en face d'Homère. Mais Prohérésius ne fit qu'en rire et trouva, dans cette opinion, un sujet de conversation sur ce qu'est l'humanité. J'ai connu Diophante et j'ai souvent assisté à ses leçons publiques. Je n'ai pas cru devoir ici consigner rien de ce qu'il dit et que j'ai retenu; car ce livre est consacré à la mémoire des hommes illustres et ne saurait devenir une moquerie. On dit, toutefois, qu'il prononça une oraison funèbre en l'honneur de Prohérésius, qui mourut avant lui, et qu'il s'exprima à peu prés en ces termes, à propos de Salamine (16) et des guerres médiques : « O Marathon et Salamine ! c'est maintenant que le silence est sur vous. Quelle trompette de vos trophées vous avez perdue! » Diophante (17) laissa deux fils qui se plongèrent dans le luxe, et ne songèrent qu'à s'enrichir. SOPOLIS J'AI maintes fois entendu Sopolis. Il s'efforçait de ramener l'éloquence à son caractère antique et essayait d'atteindre à la saine culture de la Muse. Mais il frappa souvent à la porte, et ne réussit que rarement à l'ouvrir. Si, de temps à autre, elle tournait tant soit peu sur ses gonds, un faible et léger souffle de l'esprit divin se glissait alors par la fente et tout l'auditoire était enthousiasmé, ne pouvant supporter même cette goutte de rosée, prise à la source de Castalie (18). Sopolis eut un fils qui, dit-on, monta aussi en chaire. HIMERIUS LA Bithynie donna naissance à ce sophiste (19), inconnu à l'auteur de ce livre, bien qu'il ait vécu à la même époque. Il se rendit auprès de l'empereur Julien pour faire ses preuves devant lui, avec l'espoir d'être bien vu de ce prince, qui nourrissait alors un certain ressentiment contre Prohérésius (20). Julien ayant quitté ce monde, Himérius continua ses pérégrinations. Mais, après la mort de Prohérésius, il alla à Athènes. Sa parole était facile et harmonieuse; quant à sa construction oratoire, elle a un certain éclat et un retentissement vraiment digne de la tribune politique; et même, de loin en loin. il s'élève au niveau du divin Aristide (21). Frappé, dans une extrême vieillesse, d'une attaque d'épilepsie, il mourut, laissant une fille. PARNASIUS A cette même époque, Parnasius occupait aussi une chaire d'enseignement. Il serait facile de compter ses éléves. Néanmoins, il n'est pas sans avoir eu une certain réputation (22). LIBANIUS LIBANIUS naquit à Antioche, la première des villes de la Célésyrie (23) fondée par le célèbre Séleucus Nicator (24). Il descendait d'une famille noble et était compté parmi les principaux de la cité. Jeune encore et ne dépendant que de lui-même, par suite de la mort de ses parents, il se rendit à Athènes. Mais il ne voulut ni s'attacher à Epiphanius, bien qu'il fût son compatriote et qu'il jouît d'une grande réputation, ni suivre les leçons de Prohérésius, craignant de demeurer trop obscur au milieu d'un nombre si considérable de disciples et d'être effacé par la gloire de tels maîtres, Pris au piège par les Diophantéiens, il s'attacha à Diophante. Mais, comme le racontent des gens qui connaissaient parfaitement l'homme, il s'aperçut bientôt du tour qu'on lui avait joué; alors, il fréquenta le moins possible l'école et les réunions, et se garda bien d'importuner le professeur. Il s'adonna à l'étude de la déclamation, prit pour modèle l'ancienne forme de débit et y habitua sa respiration et sa parole. Ceux qui lancent souvent le javelot visent juste et atteignent parfois le but, et la continuité de l'exercice, en assouplissant leurs organes, les rend la plupart du temps habiles, mais non point savants. De même Libanius, consacrant tout son zèle et toute son étude à l'imitation, s'attacha et se frotta, pour ainsi dire, aux Maîtres les plus illustres de l'antiquité; il suivit ceux qu'il fallait suivre, marcha sur les traces des meilleurs modèles et recueillit sur cette route les fruits qu'il était en droit d'attendre. Plein de confiance dans son talent de parole, et se persuadant qu'il pouvait être mis en parallèle avec les orateurs les plus fiers du rang qu'ils occupaient dans leur art, il résolut de ne pas rester caché dans une petite ville et de ne point tomber au même degré de mépris qu'elle : il se rendit donc à Constantinople, qui, récemment agrandie et devenue florissante, avait besoin d'hommes pour l'illustrer par leurs écrits et leurs discours. Il ne tarda guère à y briller, grâce à l'excellence et à l'agrément de ses leçons, ainsi qu'au charme qu'il déploya dans ses développements oratoires. Victime, à propos de ses jeunes élèves, d'une calomnie qu'il ne me convient pas de rapporter ici, où je ne m'occupe que des choses dignes d'être transmises à la mémoire, il dut quitter Constantinople et alla s'établir à Nicomédie (25). Mais le bruit accusateur l'avait suivi et avait même couru plus vite que lui; bientôt expulsé de là aussi (26), il retourna après quelque temps dans sa patrie et dans sa ville natale; où il acheva sa vie qui fut très longue. J'ai fait mention de lui, comme il convenait, dans les livres consacrés à Julien; néanmoins j'aborderai ici les détails qui le concernent. Aucun de ceux qui ont approché Libanius, et qui ont été admis dans son intimité, n'a été exempt en quelque sorte de ses morsures (27). Il est vrai qu'il connaissait de prime abord le caractère de chacun, et se rendait de suite compte si son âme était portée vers le bien ou vers le mal. Il était si habile à exprimer et à représenter le naturel de tout le monde; qu'à côté de lui le polype n'est qu'une plaisanterie : en un mot, il n'était pas un de ses compagnons qui ne crût voir un autre lui-même. Ceux qui en avaient fait l'expérience, le comparaient à un tableau ou à une représentation de toutes sortes de moeurs et de caractères variés; et l'on n'a jamais pu discerner, dans le conflit d'un si grand nombre de natures diverses, quelle était celle qu'il préférait. Dans des rôles tout à fait opposés, il recevait les éloges de gens qui suivaient un genre de vie contraire, et chacun croyait avoir réussi à se faire approuver de lui : tant sa personnalité était multiple et inconstante. Il n'eut aucun souci du mariage; toutefois, il vécut avec une femme qui n'était point de même condition que lui. Sa parole, dans les déclamations oratoires, était dépourvue de toute vigueur, pour ainsi dire morte, et sans souffle; et il paraît bien n'avoir pas eu de maître : car il ignorait la plupart des choses les plus élémentaires, en fait d'art oratoire, et ce que savent les enfants mêmes. Mais, dans le genre épistolaire et dans les autres formes de l'éloquence, il s'anime suffisamment et s'élève à la hauteur des modèles de l'antiquité. Ses écrits sont pleins de grâce et de verve comique, l'élégance est de tous côtés répandue dans ses discours; et la douceur, le charme qu'en général les Syro-Phéniciens possèdent dans la conversation courante, se trouvent être, chez lui, le fruit de l'éducation. Ce sont ces qualités que les Attiques appellent la raillerie fine et l'esprit de la ville. Libanius les a cultivées, comme la partie la plus importante de l'art. II s'est laissé complètement entraîner à tirer de la Comédie ancienne la forme de son éloquence, qui consiste particulièrement dans ces bagatelles de la porte (28), propres à séduire les oreilles. On rencontre dans ses productions une surabondance d'érudition et de lecture, avec des expressions beaucoup trop recherchées. Il se serait bien gardé de passer sous silence les Arbres d'Eupolis (29), Laïspodias et Damasias, s'il avait su de quels noms on les appelle aujourd'hui. Lorsqu'il se trouve un mot extraordinaire et que son antiquité a laissé dans l'oubli, il le nettoie ainsi qu'un vieil ex-voto, il le met en évidence, le pare, lui donne de la valeur, et l'établit en quelque sorte sur un fondement nouveau; il le fait alors suivre de pensées appropriées, comme on voit de jeunes servantes et des femmes de chambre marcher derrière une maîtresse récemment enrichie, et sur la personne de qui elles ont effacé les traces de la vieillesse. De pareilles qualités ont fait admirer Libanius par le divin Julien (30), et tout le monde a partagé cette admiration pour la grâce de son éloquence. Il reste de lui un grand nombre de livres (31); et tout homme intelligent, qui les lira, se pénétrera de cette grâce. Libanius était capable aussi de se mêler des choses de la politique; et, outre l'art oratoire, il était de force à essayer et à mener facilement à bonne fin des oeuvres, destinées aux plaisirs du théâtre. Les Empereurs qui se succédèrent après Julien, lui offrirent les plus hautes dignités: ils voulurent même lui donner le titre purement honorifique de préfet du palais; mais il refusa, disant qu'il trouvait plus grand d'être sophiste (32). Et ce n'est pas un mince sujet de louange, pour lui, qu'un homme, qui était loin de dédaigner, la gloire, ne se soit laissé captiver que par l'art oratoire, et n'ait considéré toute autre renommée que comme une chose vulgaire et de mauvais goût. Il mourut dans une vieillesse très avancée, laissant à tous le sentiment d'une profonde admiration pour lui. Celui qui écrit ces lignes ne l'a point connu personnellement, la malignité de la Fortune l'ayant retenu d'un autre côté, par divers empêchements. ACACIUS Césarée de Palestine (33) donna le jour à Acacius, qui fut contemporain de Libanius. C'était un orateur plein de la vigueur et da souffle des sophistes, s'il en fût jamais, et sa diction sonore rappelait la manière des anciens. Élevé en compagnie de Libanius, il rivalisa avec lui pour le premier rang, et l'emporta de beaucoup. Libanius écrivit un petit traité sur les Dons naturels (34), qu'il dédia tout entier à Acacius, et dans lequel il attribue clairement sa défaite à la nature supérieure du génie de celui-ci : il s'y rend à lui-même le témoignage qu'il a toujours su mettre en place et employer exactement chaque expression. Il feint sans doute d'ignorer qu'Homère ne s'est point uniquement préoccupé de la métrique, mais aussi de, l'euphonie et de l'harmonie, et que Phidias (35) ne s'est pas borné davantage à modeler un doigt ou un pied pour tendre sa Déesse (36) digne de toutes les louanges, mais qu'il a cherché surtout à forcer l'admiration, sans, qu'on pût facilement trouver et discerner la cause qui entraînait les juges de son oeuvre à l'admirer. C'est ainsi que, dans les corps dont la beauté excite l'amour, tous n'admirent point la même chose, et que celui qui est pris ne sait pas par quoi il a été pris. Acacius, après s'être élevé aux plus hautes régions de l'art et s'être acquis une renommée considérable, qui l'eut placé au-dessus de Libanius, mourut jeune encore. Les connaisseurs l'estimèrent autant que s'il était arrivé à la vieillesse. NYMPHIDIANUS NYMPHIDIANUS était de Smyrne (37). Il eut pour frères le philosophe Maxime et Claudien (38), qui se distingua également dans la philosophie. Il n'eut part ni aux études ni à la vie athéniennes; mais il avait des dispositions naturelles pour l'art oratoire; et, à ce titre, il mérite d'avoir un nom parmi les sophistes. L'empereur Julien lui confia la responsabilité du langage impérial, en le chargeant de la rédaction de toutes les lettres qui devaient être écrites en grec. Il excellait surtout dans ce que l'on appelle les déclamations et les dissertations; mais il ne réussissait pas aussi bien dans les exordes et dans la dialectique. La mort l'atteignit dans la vieillesse, après son frère Maxime (39). ZÉNON PLUSIEURS médecins fleurirent à cette époque. Parmi eux, il faut citer d'abord Zénon de Chypre (40), dont l'enseignement fut extraordinairement célèbre et qui vécut jusqu'au temps de Julien le sophiste, puis les successeurs de Zénon (41), contemporains de Prohérésius. Zénon, lui, cultiva également l'art oratoire et la médecine (42). Des disciples illustres qu'il laissa, les uns choisirent l'une des deux carrières, les autres les embrassèrent toutes deux. Chacun d'eux se distingua, du reste, dans la route qu'il avait choisie. MAGNUS MAGNUS naquit à Antioche, dans la ville de ce nom, qui est située au delà de l'Euphrate et qu'on appelle maintenant Nisibis (43). II fut le disciple de Zénon et joignit à ses dispositions naturelles pour la parole le secours des préceptes d'Aristote (44). Il contraignit les médecins à renoncer à l'art oratoire, mais il ne paraît pas avoir été aussi habile à guérir qu'à parler. Les anciens disent qu'Archidamus, à qui l'on demandait si Périclès était le plus fort répondit : « Quand j'ai terrassé Périclès, il prétend qu'il n'est point sous moi, et il parvient à faire croire qu'il est le vainqueur (45) » De même, Magnus soutenait que ceux qui avaient été guéris par d'autres que lui étaient encore malades. Et, quand les gens qui avaient recouvré la santé et qui se portaient à merveille rendaient grâces à ceux qui les avaient soignés, Magnus, à force de parler et d’interroger, fermait la bouche aux médecins. On institua pour lui une école publique à Alexandrie, et tout le monde faisait la traversée et se pressait autour de lui, soit pour l'admirer seulement, soit pour recueillir quelque fruit de ses excellentes leçons. Personne n'y perdit jamais sa peine : car les uns, au sortir de là, pouvaient tirer parti de leur parole, les autres étaient en mesure de faire alors et de produire quelque chose par leurs propres ressources. ORIBASE PERGAME (46) donna le jour à Oribase; et cela contribua à sa gloire, comme il arrive pour ceux qui sont nés à Athènes et qui s'illustrent dans l'éloquence : l'opinion communément répandue veut, en effet, que la Muse soit attique et que l'éloquence soit un don du terroir. Bien né du côté paternel et du côté maternel, il se fit remarquer dès l'enfance, et eut sa part de toutes les connaissances qui mènent à la vertu et qui, la rendent achevée. En avançant dans la jeunesse, il devint l'auditeur du grand Zénon et le condisciple de Magnus. Mais il ne tarda pas à abandonner ce dernier à le lutte qu'il soutenait pour l'expression de ses pensées, lutte où il était lui-mime d'une force remarquable; et, s'élevant au faite de l'art médical, il imita le dieu de ses pères (47) autant qu'il est possible à un homme de s'approcher de la divinité par l'imitation. Dès sa première jeunesse, il était en possession d'une grande renommée; aussi, Julien, devenu César, s'empara-t-il de lui en quelque sorte, pour lui faire exercer son art auprès de sa personne (48), Oribase, d'ailleurs, était doué de tant d'autres mérites qu'il avait même contribué à élever Julien à l'Empire. Mais j'ai parlé de ces faits avec plus de détails dans les Annales (49).Cependant, comme dit le proverbe, il n'y a pas d'alouette sans huppe; et Oribase ne pouvait échapper à l'envie. Offusqués de l'éclat de sa gloire, les successeurs de Julien le dépouillèrent de ses biens; ils songeaient même à lui ôter la vie : mais ils reculèrent devant ce crime, et cherchèrent un moyen détourné de faire ce qu'ils avaient honte d'accomplir ouvertement. Ils l'exilèrent parmi les Barbares; comme les Athéniens frappaient d'ostracisme ceux dont la vertu se faisait remarquer par une trop haute supériorité. Mais la loi de la République se bornait prononcer l'exil sans y rien ajouter, tandis que les Empereurs, en bannissant Oribase, le livrèrent en outre aux plus cruels des Barbares qu'ils rendirent ainsi les exécuteurs de leurs propres desseins. Jeté sur une terre ennemie, Oribase y montra toute la grandeur de la vertu que ne bornent point les lieux, que ne circonscrit point telle ou telle demeure, mais qui donne le spectacle consolant de la constance et de la fermeté basées sur sa propre énergie, en quelque endroit qu'elle se produise, comme il arrive pour les nombres et pour les vérités mathématiques. Dès le début, Oribase jouit d'une grande réputation auprès des chefs Barbares, il compta bientôt parmi les personnages les plus considérables : et, de même qu'il eût été honoré dans l'Empire romain, il le fut par les Barbares qui l'adorèrent comme un dieu, parce qu'il sauvait les uns de maladies invétérées et qu'il rappelait les autres des portes de la mort. Ainsi, ce qu'on avait appelé son malheur fut pour lui la source de toute félicité, au point que les Empereurs renoncèrent à lutter contre un homme dont la vertu éclatait partout, et lui permirent de rentrer dans sa patrie. Oribase, autorisé à revenir d'exil, n'ayant pour tout bien que la possession de lui-même et montrant ses vertus pour toute richesse, épousa une femme des plus distinguées par la fortune et par la naissance; il eut d'elle quatre enfants, qui vivent encore : que les Dieux les conservent à Oribase lui-même, au moment où j'écris, est parmi les hommes : puisse-t-il aussi y demeurer longtemps! Quant à son ancienne fortune, le Trésor public la lui rendit; les Empereurs qui suivirent ayant rapporté, comme injuste, le décret de confiscation. Tel est maintenant l'état des choses. Il n'appartient vraiment qu'a un homme versé dans la philosophie de fréquenter Oribase, pour savoir ce qu'on doit le plus admirer en lui; tant il y a de charme dans ses relations et d'harmonie dans ses discours (50). IONICUS IONICUS était de Sardes (51). Son père exerça la médecine avec éclat. Il suivit l'enseignement de Zénon, parvint au premier rang dans son art et fut admiré d'Oribase, Il acquit Une grande habitude des termes et des principes de la médecine, se montra plus habile encore dans l'application de chacun d'eux et se distingua particulièrement dans la science des membres du corps, et dans la recherche de tout ce qui caractérise la nature humaine. Il était parfaitement au courant de la préparation et de l'analyse des remèdes, et n’ignorait aucun des onguents ou des emplâtres que les praticiens les plus versés dans leur art appliquent sur les ulcères, soit pour arrêter la suppuration, soit pour détourner l'inflammation. Il était extraordinairement inventif et consommé dans l'art de faire la ligature d'un membre souffrant, et d'opérer convenablement les amputations. Il connaissait les noms et la pratique de tout cela, au point que les hommes les plus éminents s'extasiaient de l'exactitude qu'il apportait à la thérapeutique, et déclaraient ouvertement qu'en fréquentant Ionicus, ils apprenaient par la mise en oeuvre tout ce qu'ont dit les anciens médecins, et pouvaient ainsi en faire usage, comme il arrive pour les mots qui demeurent inconnus, tant que l'écriture ne les a pas fixés. Telle était la valeur d'Ionicus, au point de vue de la science médicale, Il était, de plus, d'une force remarquable dans toutes les branches de la philosophie et de la divination, tant de celle qui, confinant à la médecine, sert de diagnostic pour les maladies des hommes, que de celle qui, passant de la philosophie à la frénésie, fait cesser le mal en répandant son influence chez ceux qui peuvent la recevoir et la conserver. Il approfondit aussi l'étude de la rhétorique et de tout ce qui constitue l'art de la discussion, et ne fut pas non plus étranger à la poésie (52). Il est mort peu de temps avant que ceci fût écrit, laissant deux fils, dignes de considération et de mémoire. Vers la même époque, Théon (53) acquit aussi en Gaule une grande renommée. Mais revenons maintenant aux philosophes, dont nos digressions nous ont éloigné. CHRYSANTHE C'EST sur le conseil de Chrysanthe que ce travail a été entrepris. L'auteur, en effet, depuis son enfance, a été son élève, et Chrysanthe a observé jusqu'à la fin, comme une loi, la bienveillance qu'il lui avait vouée. Cela, néanmoins, ne me fera rien dire par complaisance; car le Maître estimait par-dessus tout la vérité, et c'est la première chose qu'il m'a enseigné à respecter. Je ne corromprai donc pas le présent qu'il m'a fait, modérant seulement mon enthousiasme en parlant de lui, et maintenant mes éloges au-dessous de ses mérites, ainsi que nous en sommes convenus. Chrysanthe appartenait à l'ordre des sénateurs; et sa naissance lui assurait une place parmi les personnages les plus considérables. Il avait pour aïeul Innocent, homme qui avait acquis de grandes richesses en même temps qu'une réputation supérieure à celle d'un simple particulier, et à qui les Empereurs d'alors avaient confié la mission de rédiger les lois. Il reste de lui plusieurs livres (54), dont les uns sont écrits dans la langue des Romains et les autres en grec, et qui témoignent de son esprit de recherche et de la profondeur de ses connaissances : ces ouvrages renferment tout ce qui est nécessaire à ceux qui ont le goût de pareils sujets. Pour Chrysante lui-même, il perdit son père de bonne heure. Pris d'une véritable passion pour la philosophie, grâce à la nature divine de son caractère, il se rendit aussitôt à Pergame auprès du grand Edésius. Là, altéré de savoir, il rencontra le Maître au moment le plus brillant de son enseignement : il se présenta devant lui la bouche béante et se gorgeant, pour ainsi dire, d'une science qui n'avait rien de vulgaire, ne se dérobant à aucune leçon et ne se montrant inférieurs personne en assiduité. Il avait d'ailleurs un corps infatigable, une santé de fer, et l'habitude de tous les genres d'exercice. Il se pénétra d'abord suffisamment de la doctrine de Platon et de celle d'Aristote, appliqua son esprit à toutes les formes de la philosophie, les analysa et les résume entièrement. Puis, l'éloquence n'eut bientôt plus de secrets pour lui : il acquit dans cet art de la force et de la vigueur; un usage continuel, forma et prépara son jugement; il devint, enfin, assez sûr de lui pour se risquer à se produire, avec quelque chance de succès, pouvant également parler ou se taire, et capable de remporter un triomphe, pour peu qu'on l'y poussât, grâce à la pompe de son langage. Ce fut alors qu'il se tourna vers la connaissance des Dieux et la doctrine dont le système est dû à Pythagore et à des disciples, tels que l'antique Archytas (55), Apollonius de Tyane et ses adorateurs, personnages vraiment divins, bien qu'ils n'ignorassent pas qu'ils avaient un corps et qu'ils étaient des hommes. Chrysanthe, ayant donc suivi cette route sans laisser la moindre occasion de s'instruire, prit les principes mêmes pour guides et parvint, grâce à la perfection de son âme, comme dit Platon, à un tel degré d'élévation et de sublimité qu'il atteignit le faîte de toute espèce de science et réussit dans la prévision de toutes choses. Aussi, a-t-on soutenu qu'il était plus habile à prévoir l'avenir qu'à le prédire; tant il savait discerner et embrasser tout, comme s'il eût toujours été en présence des Dieux et en rapports constants avec eux. Après avoir employé à ces études un temps assez long et avoir beaucoup travaillé avec Maxime, il rompit l'association. Maxime avait en effet dans le caractère, quelque chose d'envieux et d'opiniâtre qui le portait à lutter contre les présages envoyés par les Dieux : il voulait toujours demander et pour ainsi dire, en extorquer d'autres. Tout au contraire, Chrysanthe, dès les premiers signes qui lui apparaissaient, cherchait insensiblement et comme par un mouvement indirect à ébranler, en quelque sorte, ce qui s'était produit, s'il y réussissait, il constatait sa victoire ; s'il échouait, il se résignait à mettre la sagesse humaine en harmonie avec le phénomène divin. Ainsi, lorsque l'empereur Julien les appela tous ces deux par une seule et même lettre et que les soldats, qui avaient été envoyés pour leur faire honneur, joignirent à cette démonstration la persuasion toute thessalienne de la nécessité, il parut opportun de consulter les Dieux à ce sujet, Or, la Divinité, - autant qu'un simple mortel et un vulgaire artisan pouvait juger des présages, - ayant positivement déconseillé le voyage, Maxime s'entêta à poursuivre les sacrifices; et, même après leur accomplissements il ne cessa de pleurer et de gémir, suppliant les Dieux de lui donner d'autres signes et de changer le destin. En vain Chrysanthe combattit, à l'aide d arguments multipliés, son obstination et son erreur; il finit par substituer sa volonté aux manifestations divines; et il y vit ce qu'il souhaitait, au lieu de former son opinion d'après ces phénomènes. Il choisit alors cette voie et entreprit un voyage qui devait être le commencement de tous ses malheurs, tandis que Chrysanthe resta chez lui. Cette hésitation affligea d'abord l'Empereur, et il en soupçonna bien un peu la véritable cause. Il pensa, en effet, que Chrysanthe n'eût pas refusé de répondre à son appel, s'il n'eût prévu quelque difficulté dans l'avenir. Il lui écrivit donc pour l'appeler de nouveau, et ses exhortations ne s'adressèrent point à lui seul : il engagea par lettre la femme de Chrysanthe à s'efforcer de persuader son mari. Celui-ci eut derechef recours aux Dieux, et les Dieux ne cessèrent pas de lui faire la même réponse. Cette situation se prolongeant, l'Empereur partit pour l'Asie (56)... Chrysanthe ayant reçu le grand pontificat de toute la région et se rendant parfaitement compte de ce qui levait arriver, ne fit point peser lourdement sur les populations le joug de son autorité; il ne releva point les temples comme tous ses pareils le faisaient, avec une ardeur et un enthousiasme exagérés, et n'inquiéta nullement les Chrétiens. Telle était même la simplicité de sort caractère qu'en Lydie peu s'en fallut qu'on ignorât le rétablissement des sacrifices. Il en résulta que, les choses ayant tourné autrement qu'elles n'avaient commencé, rien ne parut avoir été innové et que l'on ne s'aperçut d'aucun changement considérable et profond. Au contraire, tout reprit son niveau et rentra dans le calme; et Chrysanthe seul était un objet d'admiration, alors que tous s'agitaient comme dans un tourbillon, les uns se laissant abattre inopinément, les autres se relevant de leur premier abaissement. On admirait Chrysanthe, non seulement pour son habileté à prévoir l'avenir, mais aussi pour son adresse a se servir de ce qu'il connaissait. Toute sa manière d'être était telle qu'on pouvait croire que le Socrate de Platon renaissait en lui, ou qu'un sentiment d'émulation et d'imitation l'avait fait, dès l'enfance, se conformer à un si beau modèle. Ses discours respiraient, en effet, la simplicité, la sincérité, je ne sais quoi d'inénarrable; et l'auditeur était séduit par le charme de ses paroles. Il avait pour tous un abord bienveillant; et chacun, en le quittant, s'en allait persuadé qu'il agissait ainsi par le seul désir de plaire. Les vers les plus beaux et les plus doux s'insinuent agréablement et paisiblement dans toutes les oreilles, et exercent leur influence sur les être même dépourvus de raison, comme on le raconte à propos d'Orphée (57); ainsi l'éloquence de Chrysanthe charmait tout le inonde par son harmonie, et savait s'adapter et se plier à toutes les variétés de caractères. Il se laissait entraîner difficilement dans les discussions et dans les querelles, parce qu'il l'avait compris à quel point les hommes s'aigrissent dans de telles occurrences. On ne l'aurait pas aisément entendu faire montre de son savoir, ni en prendre prétexte pour se gonfler d'orgueil et se prévaloir devant les autres. Au contraire, il approuvait ce qu'ils disaient, eussent-ils parlé à tort et à travers; il louait même les opinions erronées comme s'il n'en eût pas écouté le moindre mot, et semblait disposé à être de l'avis de tout le monde, pour ne chagriner personne. Si, cependant, quelque débat venait à être soulevé par un des princes de la science, il se décidait à de mêler quelque peu à la discussion ; alors, tout était plein de silence, comme si l'on eût été dans un désert : personne ne se sentait capable d'affronter ses questions, ses définitions, ses citations. Chacun reculait et se gardait de le contredire ; pour ne point être convaincu publiquement d'erreur. Ceux qui le connaissaient imparfaitement et qui n'avalent pas pénétré les profondeurs de son âme, l'accusaient de manquer de logique et se bornaient à louer sa douceur. Mais, lorsqu'ils l'entendaient discuter, et s'entourer de raisons et d'arguments, ils le trouvaient un tout autre homme que celui qu'ils s'étaient figuré; tant il devenait différent de lui-même dans la chaleur du débat, les cheveux hérissés et ses yeux interprétant les soulèvements intérieurs de son âme passionnée par la doctrine. Il 'parvint à une vieillesse avancée et ne s'occupa toute sa vie, parmi les choses qui intéressent les hommes, que d'économie domestique, d'agriculture, et de ce que l'on peut acquérir de bien sans injustice. Il supportait la pauvreté plus facilement que d'autres ne supportent la richesse. Sa nourriture était la première venue. Il ne mangeait jamais de viande de porc, et fort peu des autres viandes. Il honorait la Divinité d'un culte assidu, ne quittait pas la lecture des anciens, et ne faisait aucune différence entre la jeunesse et la vieillesse ; car, après avoir dépassé les quatre-vingts ans, il écrivit de sa main autant de livres que d'autres, dans leur jeune âge, parviennent à peine en lire (58). Aussi, l'extrémité de ses doigts était-elle recourbée par le travail et l'usage incessant qu'il en faisait pour écrire. Quand le moment d'interrompre l'étude était venu, il se levait et allait se récréer dans les endroits publics, prenant avec lui l'auteur de ce récit, et faisant lentement de longues promenades. Auprès de lui, on ne s'apercevait point de la fatigue du chemin, tant on était charmé par sa conversation. Ill faisait te moins possible usage des bains; et, cependant, il avait toujours l'air de s'être récemment baigné. Lorsqu'il se trouvait au milieu des grands, la franchise sans bornes avec laquelle il se comportait à leur égard ne doit pas être mise sur le compte de la forfanterie ni de l'orgueil : il faut y voir seulement la simplicité d'un homme qui ignorait ce qu'est la puissance; tant il parlait avec la civilité ordinaire dont on use envers tout le monde. Il m'avait élevé, dès ma première jeunesse; lorsqu'il vint à Athènes, il ne me témoigna pas moins d'amitié : sa bienveillance, au contraire, s'accrut pour moi de jour en jour; et ce fut bientôt à un tel point, qu'après avoir consacré les heures matinales à des exercices oratoires avec les autres et avoir donné des leçons a ceux qui en avaient besoin, je me hâtais à midi de retourner auprès de mon premier maître, pour, m'instruire encore dans les choses divines et la philosophie. Ce n'était pas une fatigue, pour lui, de se retrouver avec le disciple dont il se savait chéri; et, pour moi, qui recevais son enseignement, c'était véritablement une fête. Cependant, la propagande des Chrétiens triomphait et, envahissait tout. Après un assez long temps, il vint de Rome en Asie un préfet nommé Justus, déjà d'un certain âge; excellent homme d'ailleurs, qui n'avait point renié les croyances d'autrefois et celles de ses pères, mais qui, plein de zèle pour cette bienheureuse et salutaire façon de vivre, était demeuré attaché aux sacrifices, ne jurait que par la divination, et était tout fier d'aimer ces pratiques et de les avoir maintenues. Etant venu de Constantinople en Asie, et ayant pris pour chef du peuple un certain Hilaire tout disposé à entrer dans ses vues, il releva à la hâte les autels à Sardes (59) où il n'y en avait plus, et fit travailler aux ruines des temples, là où il put en trouver, afin de les restaurer. ll célébra ensuite des sacrifices publics, et convoqua de toutes parts ceux qui s'étaient acquis une réputation dans l'enseignement de la doctrine. Ceux-ci arrivèrent encore plus vite qu'on ne les avait, appelés, pleins d'admiration pour Justus et persuadés que le moment était venu, pour eux, de faire leurs preuves. Un certain nombre d'entre eux, qui n'avaient pas moins de confiance dans la flatterie que dans leur savoir, espéraient en même temps retirer de leurs adulations, soit des honneurs, soit de la gloire, soit de l'argent. On avait donc annoncé un sacrifice public; tous étaient présents, et j'y étais aussi. Justus, après s'être recueilli, fixant ses regards sur la victime et considérant la situation où elle se trouvait, demanda aux assistants : « Que signifie la manière dont la victime est tombée? » Les flatteurs ne pouvaient contenir leur enthousiasme, en voyant qu'il tirait des présages de la position même de la victime, et n'accordaient qu'à lui la palme de ce genre de divination. Les hommes graves se caressaient la barbe du bout des doigts, se composaient un visage sévère; secouaient lentement et lourdement la tête, regardant la victime et disant, les uns une chose, les autres une autre. Justus, qui avait peine à s'empêcher de rire, se tournant vers Chrysanthe, s'écria : « Et toi, que dis-tu, vieillard? » Chrysanthe, sans se troubler, répondit qu'il condamnait les opinions de tous. « Si tu veux, ajouta-t-il, que, moi aussi, j'exprime un avis sur ce sujet, dis-moi d'abord si vraiment tu possèdes le don de la divination; de quelle nature est celle-cl, quelle en est la forme, en quoi consiste l'interrogation et quelle méthode on doit y appliquer. Si tu me donnes ces renseignements, je te dirai à quel point de l'avenir se rapporte le phénomène actuel. Si, au préalable, tu ne m'éclaires pas là-dessus, il ne saurait me convenir, lorsque les Dieux nous donnent des signes qui présagent l'avenir, de répondre à ta question, en rattachant à ce qui a été ce qui doit être. Il y aurait, en effet, de la sorte, deux questions; et, qu'il s'agisse de deux ou de plusieurs, personne ne peut y répondre en même temps : car la controverse sur des sujets définis exige plus d'un argument. » Alors, Justus s'écria qu'il venait d'apprendre là ce dont il ne s'était jamais douté auparavant; et, de ce moment, il ne cessa de consulter Chrysanthe en particulier et de puiser à cette véritable source de science. A la même époque, quelques autres personnages, renommés pour leur sagesse, vinrent converser avec notre philosophe dont la gloire les attirait ; mais ils ne tardèrent pas à acquérir la conviction qu'ils étaient bien loin d'une habileté comme la sienne, et ils s'éloignèrent. C'est ce qui arriva à Hellespoptius de Gaule, homme qui excellait en toutes choses, et qui eût été le premier de tous, si Chrysanthe n'avait point existé. Hellespoptius était tellement épris de la science, qu'il explora, ou peu s'en fallut, les régions inhabitées, dans l'espoir d'y rencontrer quelqu'un de plus savant que lui, Comblé, de la gloire que lui valaient ses belles actions et son éloquente parole, il se rendit dans l'antique ville de Sardes, pour y conférer avec Chrysanthe, Mais ce fait est postérieur. Auparavant, il était né à Chrysanthe un fils qu'il avait nommé Edésius, en mémoire de celui qui avait été son maître à Pergame et dont nous ayons parlé. Ce fils, dès l'enfance fut porté comme par des ailes vers toute espèce de vertu : il n'eut pas seulement, comme dit Platon, l'un des deux chevaux, et le poids de son esprit ne l'attirait point vers les choses basses; mais il était entraîné du côté de l'étude et s'y appliquait avec une ardeur excessive. Assidu au culte des Dieux, il s'éloignait tellement de l'humanité que, tout mortel qu'il fût, il risquait de n'être plus qu'une âme. Aussi, son corps avait-il des mouvements d'une incroyable agilité; et, comme un vrai poète, il s'élevait à des hauteurs sublimes. En effet, la familiarité des Dieux lui coûtait si peu de travail et de difficulté, qu'il lui suffisait de placer une couronne sur sa tête et de contempler le Soleil, pour rendre des oracles; et des oracles véritables, écrits dans la plus belle forme de l'inspiration divine. Cependant, il ne savait pas faire des vers et n'était guère fort dans la science de la grammaire : c'était la divinité qui faisait tout en lui. Mais ce jeune homme, sans avoir jamais été malade dans le cours limité de sa vie, mourut vers les vingt ans. Son père montra alors qu'il était vraiment philosophe. Soit que la grandeur de cette perte l'eût plongé dans une sorte d'apathie, soit qu'il se réjouît pour son fils de ce changement de condition, il resta impassible. La mère, à l'exemple de son mari, triompha de la nature féminine elle se renferma dans une douleur pleine de dignité, et s'abstint de toute espèce de gémissements. Après que les choses eurent ainsi tourné, Chrysanthe revint à ses études habituelles; et, tandis qu'au milieu de nombreuses et terribles catastrophes publiques, toutes les âmes étaient agitées par la terreur, lui seul demeura calme et inébranlable : on eût cru qu'il n'appartenait point à la terre. Ce fut à cette époque qu'Hellespontius se rendit auprès de lui. Tous deux tardèrent, d'abord, à entrer en conférence. Mais, une fois qu'ils eurent commencé, Hellespontius fut tellement séduit, qu'abandonnant toutes choses, il se déclara prêt à planter sa tente à côté de Chrysanthe et à redevenir jeune, en se faisant son écolier. Il se sentait honteux, pour ainsi dire, d'avoir passé tant de temps dans l'erreur, et d'être parvenu à la vieillesse, ayant d'avoir appris quelque chose d'utile. C'est à quoi désormais, il appliqua tout son esprit. Quelque temps, après, Chrysanthe ayant dû selon sa coutume, se faire saigner, j'étais présent lorsqu'il en donna l'ordre et que les médecins se mirent en devoir de l'exécuter. Attentif à ce qui allait se passer, je dis qu'il était insensé de tirer à Chrysanthe une si grande quantité de sang, et je fis arrêter immédiatement la saignée, car je n'étais pas inexpérimenté dans la science médicale. Hellespontius, dès la première nouvelle, accourut indigné et gémissant, comme d'un affreux malheur, du danger qu'il y avait à faire au bras d'un homme aussi âgé une saignée d'une telle abondance. Mais, lorsqu'il eut entendu la voix de Chrysanthe et qu'il l'aperçut sain et sauf, se tournant vers moi, il me dit : « La ville entière t'accusait déjà d'avoir joué gros jeu; mais, maintenant, tous se tairont en voyant le vieillard en bonne santé. » Je répondis que je n'ignorais pas de quelle importance avait été la chose. Hellespontius, plus tranquille, rassembla ses livres, comme s'il devait aller étudier avec Chrysanthe mais il sortit de la ville, Il commença aussitôt à souffrir d'un mal d'entrailles; et étant entré dans Apamée (60), ville de Bithynie, il y mourut en conjurant Procope, son compagnon, qui l'assistait à ses derniers moments, de n'avoir d'admiration que pour Chrysanthe. Procope, une fois rendu à Sardes (61) fit ce qu'Hellespontius lui avait ordonné, et rapporta ses paroles à Chrysanthe. Celui-ci, dans la saison suivante de l'année, au commencement de l'été, eut recours au même traitement; et bien que j'eusse recommandé aux médecins de m'attendre comme d'habitude, ils devancèrent mon arrivée ; Chrysanthe leur tendit le bras : ils pratiquèrent alors une saignée; mais elle fut trop ; elle amena bientôt un affaiblissement des membres et des douleurs dans les articulations, et contraignit le malade de se mettre au lit. A ce moment, arriva Oribase. Grâce à lui et à sa science extraordinaire, peu s'en fallut que la Nature ne fût forcée de céder, et que les frictions chaudes et émollientes ne fissent revenir la flamme de la jeunesse dons ce corps glacé. Mais la vieillesse triompha : car Chrysanthe se trouvait dans sa quatre-vingtième année; et cette vieillesse fut, en quelque sorte, doublée par l'excès même d'une chaleur factice. Après quatre jours de maladie, la vie de Chrysanthe eut la fin dont elle était digne. EPIGONUS et BÉRONICIANUS LES successeurs de Chrysanthe, dans l'enseignement de la philosophie, furent Epigonus de Lacédémone et Béronicianus de Sardes (62), hommes vraiment dignes du nom de philosophes. Béronicianus lui, sacrifia davantage aux Grâces, et il a tout ce qu'il faut pour faire l'ornement des assemblées. Puisse-t-il en être ainsi! FIN DU LIVRE
(1) Ancienne capitale
des Séleucides. On la surnommait la Reine de l'Orient |