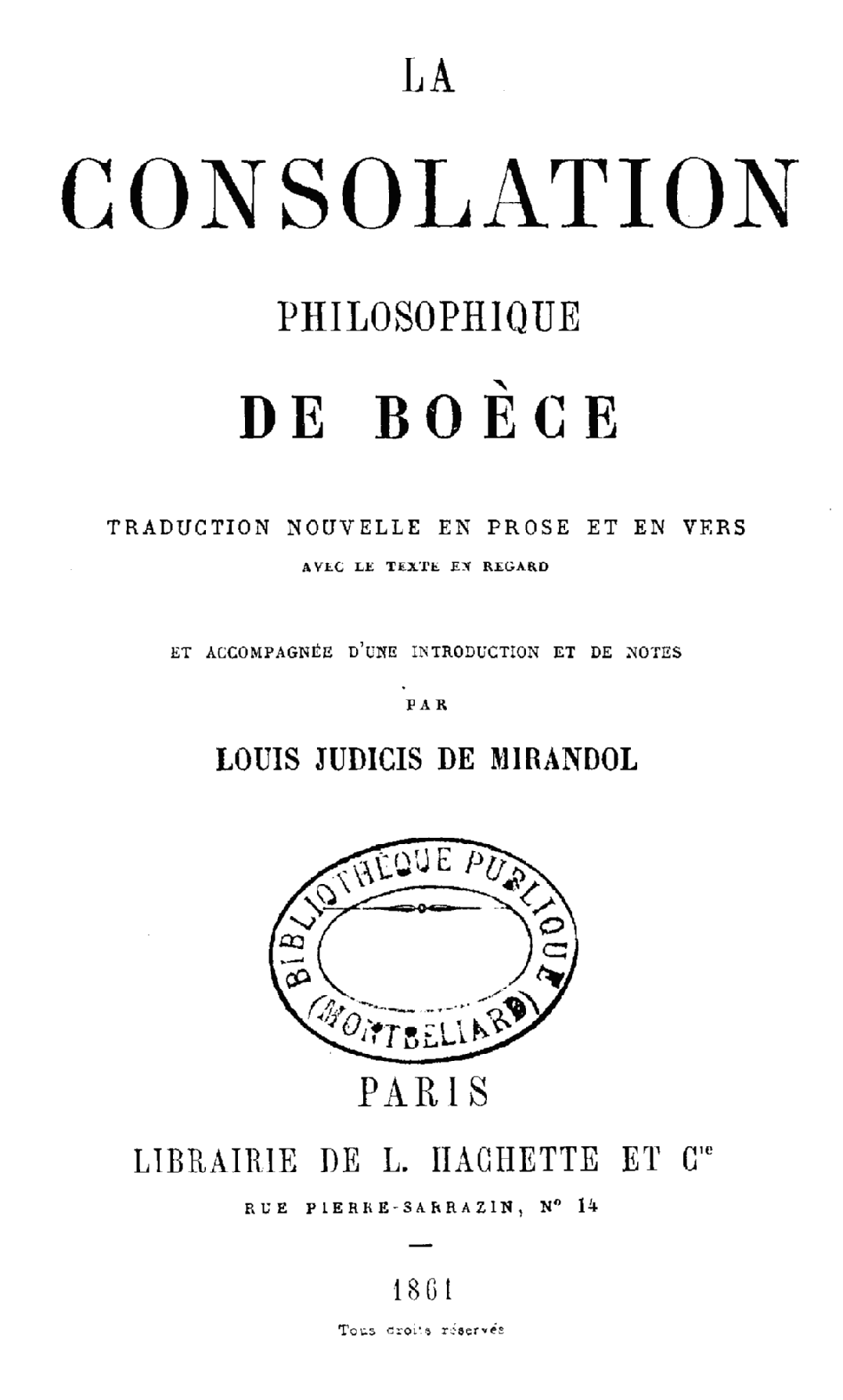|
ALLER A LA TABLE DES MATIÈRES DE BOÈCE
BOÈCELACONSOLATION PHILOSOPHIQUE.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
LIVRE QUATRIÈME.IAprès que la Philosophie, sans que son visage eût rien perdu de son expression grave et digne, eut chanté ces vers d'une voix douce et mélodieuse, tout meurtri encore de la douleur qui avait pénétré jusqu'au fond de mon âme, je ne lui donnai pas le temps de reprendre la parole, comme elle se disposait à le faire, et je m'écriai : « O toi, qui me guides vers la véritable lumière, dans tout ce que tu as dit jusqu'à présent, l'objet divin de tes recherches, aussi bien que la force de tes raisons, ne laisse pas de place au doute ; mais, bien que le sentiment de ce que j'ai injustement souffert les eût, dans ces derniers temps, effacées de mon souvenir, ces vérités ne m'étaient pourtant pas tout à fait inconnues. Cependant, la principale cause peut-être de mon affliction, c'est cette pensée que, sous l'œil d'un Dieu dont la bonté gouverne le monde, le mal puisse exister, et même échapper au châtiment.[1] Cela seul est déjà assez digne d'étonnement, tu en conviens sans doute; mais voici qui est plus grave : tandis que le vice règne et prospère, la vertu non seulement se voit frustrée de toute récompense, mais elle est encore foulée aux pieds des scélérats et traînée au supplice à la place du crime. Que les choses se passent ainsi dans le royaume d'un Dieu qui sait tout, qui peut tout, et qui ne veut que le bien, c'est ce dont on ne peut assez s'étonner ni se plaindre. » Elle alors : « Ce serait, en effet, un incroyable sujet de stupéfaction, et la plus horrible des monstruosités, si, comme tu le penses, chez un père de famille si grand, dans une maison si bien ordonnée, d'ignobles vases s'étalaient à la place d'honneur, tandis que des vases précieux se terniraient dans la poussière ; mais il n'en est pas ainsi. En effet, si nous maintenons entières les conséquences que nous avons tirées de nos principes, celui dont le gouvernement nous occupe t'apprendra lui-même que la puissance appartient toujours aux bons, et que l'abjection et la faiblesse sont toujours le lot des méchants ; que le vice n'est jamais sans punition, ni la vertu sans récompense; que le bonheur est toujours réservé aux bons, et le malheur aux méchants. Il te révélera encore d'autres vérités du même genre, qui imposeront silence à tes plaintes et te rendront la force et le courage. Et maintenant qu'instruit par mes leçons tu sais en quoi consiste la vraie félicité et en quel lieu elle réside, je vais rapidement toucher tous les points qu'il me paraît nécessaire d'examiner d'abord, puis je t'indiquerai la route qui doit te ramener à ta demeure. Je donnerai même à ton esprit des ailes pour s'élever dans l'espace. Affranchi de toute inquiétude, c'est sous ma conduite, par mon sentier, sur mon char, que tu retourneras sain et sauf dans ta patrie. II
Pour monter jusqu'au ciel j'ai des ailes de
flamme[2]
Elle dépassera,
dans son hardi voyage,
Les astres radieux ;
Elle escortera Mars, fidèle satellite,
Lasse de contempler ce multiple miracle,
C'est de cet empyrée
éclatant
de lumière
Lorsque tu reverras cet océan
de vie
Puis, si lu veux encor contempler les ténèbres III—Par le ciel! m'écriai-je, tu me fais là de magnifiques promesses ! Je ne doute pas pourtant que tu ne sois en mesure de les tenir; mais puisque tu as excité ma curiosité, hâte-toi de la satisfaire. —Pour commencer, dit-elle, je te ferai voir que les bons sont toujours en possession de la puissance, et que les méchants n'ont que la faiblesse en partage;[5] ces deux propositions se prouvent l'une par l'autre; le bien, en effet, étant le contraire du mal, s'il est démontré que la puissance est l'attribut du bien, il est évident que la faiblesse est celui du mal ; et si le mal a pour caractère distinctif la fragilité, il est clair que le bien doit être solide. Mais pour donner plus de poids à ma démonstration, je me servirai tour à tour des deux propositions, demandant mes preuves tantôt à l'une, tantôt à l'autre. Deux choses sont nécessaires à l'homme pour la réalisation d'un acte quelconque, savoir la volonté et la puissance; que l'une des deux lui fasse défaut, il est incapable de rien exécuter. La volonté absente, on n'entreprendra pas ce qu'on ne pense même pas à vouloir, et sans le pouvoir d'exécuter, la volonté ne sert de rien. Aussi, quand tu vois un homme former un projet qui n'aboutit pas, tu peux être assuré que la force lui a manqué pour atteindre son but. — C'est évident, dis-je, et il n'y a rien à répondre à cela. —Mais si tu en vois un autre réaliser le projet qu'il avait conçu, pourras-tu douter de sa puissance? — En aucune façon. — Il faut donc l'admettre : un homme est fort dans les choses qu'il peut, et faible dans celles qu'il ne peut pas. — J'en conviens, dis-je. — Fort bien, reprit-elle; mais tu t'en souviens, nous avons conclu des propositions précédentes que tous les efforts de la volonté humaine, si variés que soient ses désirs, tendent vers le bonheur. —Je me souviens, dis-je, que ce point a été aussi démontré. — Te rappelles-tu encore que le bonheur c'est le bien proprement dit, et que, par suite, désirer le bonheur, c'est désirer le bien? —Je n'ai pas besoin de me rappeler cette vérité, dis-je, elle est toujours présente à mon esprit. — Donc, tous les hommes indistinctement, méchants ou bons, s'efforcent avec une égale énergie de parvenir au bien? — Sans doute, dis-je, cela va de soi. — Mais il est certain que par l'acquisition du bien, on devient bon. — Cela est certain. — Les bons obtiennent donc ce qu'ils désirent? —Il me semble ainsi. — Et si les méchants atteignaient le bien qu'ils poursuivent, ils ne pourraient plus être méchants? —Assurément. — Donc, comme les bons et les méchants aspirent au bien, et comme les premiers l'obtiennent à l'exclusion des seconds, la puissance des bons ne peut pas être mise en doute, non plus que la faiblesse des méchants. — En douter, dis-je, serait s'avouer incapable de saisir la vérité des choses et la conséquence d'un raisonnement.—Maintenant, dit-elle, supposons deux hommes, obéissant au même instinct et visant au même but; si l'un, par des moyens naturels, y arrive pleinement, tandis que l'autre, ne pouvant se servir de ces moyens naturels, et réduit à en employer d'autres désavoués par la nature, manque le but tout en ayant l'air d'y toucher, lequel de ces deux hommes jugeras-tu le plus puissant? — Je crois entendre ce que tu veux dire ; je souhaiterais cependant que tu t'expliquasses plus clairement. — L'action de marcher, dit-elle, est naturelle à l'homme.[6] Tu ne le nieras pas? — Assurément non, répondis-je. — Tu ne doutes pas non plus que les pieds ne soient le moyen naturel de cette fonction? — Je n'en doute pas non plus. — Eh bien! si un homme marche à l'aide de ses pieds parce qu'il le peut, et qu'un autre, privé de ce moyen naturel, essaye de marcher sur ses mains, lequel des deux faudra-t-il à bon droit considérer comme le plus puissant? — Poursuis ton raisonnement, dis-je, car il est incontestable que celui qui peut se servir d'un moyen naturel est plus fort que celui qui ne le peut pas. — L'objet, reprit-elle, que se proposent également les bons et les méchants, c'est le souverain bien ; or, les bons le poursuivent par un moyen naturel, qui est la vertu; quant aux méchants, c'est par les passions les plus diverses, ce qui n'est pas le moyen naturel d'arriver au souverain bien, qu'ils s'efforcent de l'atteindre. N'est-ce pas ton avis? — Bien certainement, répondis-je, et de plus, la conséquence est évidente. Car des points que j'ai accordés il résulte nécessairement que les bons sont puissants et que les méchants sont faibles. — Fort bien! Tu vas plus vite que moi, et je reconnais à cette ardeur, sujet ordinaire d'espérance pour les médecins, que la nature chez toi reprend son nerf et son ressort. Mais puisque te voilà si vif à comprendre, je vais presser et accumuler mes arguments. Vois combien est évidente la faiblesse des méchants, puisqu'ils ne peuvent atteindre le but, même alors qu'un instinct naturel les guide et les entraîne, pour ainsi dire, malgré eux. Que serait-ce donc si la nature, au lieu de marcher devant eux, leur refusait son aide si efficace et presque irrésistible? Rends-toi bien compte de l'impuissance absolue des scélérats. Ce ne sont pas des prix de peu de valeur, comme ceux que l'on décerne dans les jeux publics, qu'ils ambitionnent et qu'ils manquent; c'est au bien le plus précieux, le plus élevé de tous, qu'ils sont dans l'impuissance d'atteindre ; et le projet dans lequel les malheureux échouent, c'est celui-là même qui jour et nuit les occupe : or, c'est en cela que se montre la puissance des gens de bien. En effet, si un homme, marchant à pied, parvenait à la dernière limite des terres qu'il soit possible de parcourir, tu penserais sans doute que c'est l'homme le plus vigoureux à la marche ; de même, celui qui touche le but final de tout désir, but au delà duquel il n'y a plus rien, doit nécessairement te paraître plus puissant que tous les autres. D'où il faut conclure, par un raisonnement inverse, que tout méchant est dénué de toute force. Et en effet, pourquoi abandonnent-ils la vertu pour suivre le vice? Est-ce par ignorance des véritables biens? Mais qu'y a-t-il de plus faible au monde que l'aveuglement de l'ignorance? Connaissent-ils le but qu'il faut poursuivre? Mais alors leurs passions les entraînent hors du droit chemin; et, ici encore, ils montrent leur faiblesse par leur intempérance, qui les rend incapables de résister au vice. Est-ce en connaissance de cause et de propos délibéré qu'ils abandonnent le bien pour tourner au mal? Mais dans ce cas, ils cessent non seulement d'être forts : ils cessent absolument d'être. Car ceux qui renoncent à la fin commune de tout ce qui existe, cessent pareillement aussi d'exister. On s'étonnera peut-être de cette proposition, que les méchants, qui forment la majorité du genre humain, n'existent pas; il en est ainsi pourtant. Que les méchants soient méchants, ce n'est pas ce que je nie; mais je nie qu'ils existent purement et simplement.[7] En effet, de même que tu appellerais un cadavre « un homme mort, » et ne pourrais l'appeler simplement « un homme, » de même, j'accorderai, si l'on veut, que les vicieux sont des méchants; mais qu'ils existent dans le sens absolu, on ne m'en fera pas convenir. Ce qui existe, en effet, c'est ce qui garde les lois de la nature et s'y conforme; toute créature qui s'en écarte, renonce au principe de vie qui est en elle. Cependant, diras-tu, les méchants peuvent quelque chose. Je ne dis pas le contraire, mais ce pouvoir qu'ils ont procède, non de la force, mais de la faiblesse. En effet, ils peuvent le mal, et ils ne le pourraient pas s'ils avaient conservé la puissance des gens de bien. Et c'est précisément cette possibilité de faire le mal qui prouve le plus clairement leur impuissance. Car si le mal n'est rien, comme je l'ai démontré il n'y a qu'un instant, les méchants ne pouvant que ie mal, on doit conclure qu'ils ne peuvent rien. — C'est évident. — Et, pour mieux te faire comprendre à quoi se réduit cette possibilité, rappelle-toi que nous avons dit tout à l'heure que nulle puissance n'est comparable à celle du souverain bien. — Je m'en souviens, dis-je. — Mais le souverain bien ne peut pas produire le mal. —Non certainement. — Continuons : y a-t-il quelqu'un au monde pour croire que les hommes peuvent tout? —Non, à moins d'être insensé. — Et cependant ils peuvent faire le mal. —Plût à Dieu, m'écriai-je, qu'ils n'eussent pas ce pouvoir! — Donc, si celui-là seul qui peut le bien peut tout, et si ceux qui peuvent même le mal ne peuvent pas tout, ces derniers, évidemment, ont moins de puissance que l'autre. De plus, je t'ai prouvé que toute puissance est au nombre des choses désirables, et que celles-ci se rapportent toutes au bien comme à leur fin naturelle et suprême. Mais la possibilité de commettre le crime ne peut pas se rapporter au bien ; donc elle n'est pas désirable. Or, toute puissance étant désirable, il est évident que la possibilité de faire le mal n'a rien de commun avec la puissance. De tout ce qui précède ressort, sans doute possible, d'un côté, la puissance des bons, de l'autre, la faiblesse des méchants, et l'on voit combien Platon avait raison de le dire : « Le sage seul peut faire ce qu'il veut;[8] les méchants, à la vérité, peuvent se livrer à leurs fantaisies; mais pour ce qui est du véritable objet de leurs désirs, ils n'ont pas le pouvoir d'y atteindre. » Ils suivent, en effet, tous leurs caprices, dans la persuasion où ils sont que ce qui leur plaît doit leur procurer le bonheur qu'ils souhaitent; mais leur espoir est déçu, parce que le crime ne conduit pas à la félicité. IV
Enivrés
d'orgueil et de gloire V« Vois-tu dans quelle fange se vautre le vice et de quel éclat resplendit la vertu? En quoi il apparaît qu'elle obtient toujours sa récompense, et que le châtiment ne fait jamais défaut au crime. En effet, la fin qu'on se proposé dans une action peut être justement considérée comme la récompense de cette même action. C'est ainsi qu'à celui qui court dans le stade s'offre pour récompense la couronne en vue de laquelle il court. Mais j'ai fait voir que la béatitude est ce même bien que tous les hommes ont en vue dans leurs actions. Le bien même est donc comme la récompense commune proposée à leur activité. Mais le bien ne peut être enlevé aux bons. En effet, on ne pourrait plus appeler bon celui qui ne serait plus en possession du bien, et c'est pourquoi la récompense n'abandonne jamais la vertu. Donc, à quelques fureurs que se laissent emporter les méchants, la couronne du sage ne saurait ni tomber de son front, ni se flétrir. En effet, la gloire qui décore les gens de bien et qui leur appartient en propre, ne peut leur être ravie par la méchanceté d'autrui. S'ils avaient reçu cet heureux présent d'une main étrangère, il pourrait leur être enlevé, ou par le premier venu, ou par celui-là même qui l'aurait donné; mais comme ceux qui le possèdent ne le doivent qu'à leur propre vertu, ils ne peuvent le perdre qu'en cessant d'être vertueux. Enfin, comme toute récompense n'est désirée que par la raison qu'on la regarde comme un bien, un homme en possession du bien peut-il être considéré comme privé de récompense? Et de quelle récompense s'agit-il? De la plus belle, de la première de toutes. Rappelle-toi en effet ce corollaire dont précédemment je t'ai fait voir l'importance, et fais-toi ce raisonnement : « Le bien étant la même chose que le bonheur, il est clair que tous les gens de bien, par cela même qu'ils sont tels, sont heureux. Mais ceux qui sont heureux sont dieux par cela même. Donc, la récompense des honnêtes gens, récompense que le temps n'altérera jamais, que personne n'a le pouvoir d'amoindrir, que le vice ne pourra jamais ternir, consiste à être changés en dieux. Cela étant, le sage ne peut douter non plus du châtiment inévitable infligé aux méchants. Car le châtiment étant l'opposé de la récompense comme le mal est l'opposé du bien, il est nécessaire qu'à la récompense du bien corresponde, comme contrepartie, le châtiment du mal. Donc, si les honnêtes gens trouvent leur récompense dans leur honnêteté même, il faut que les méchants trouvent leur supplice dans leur méchanceté. Et, en effet, quiconque est frappé d'une peine, est parfaitement convaincu qu'il est affligé d'un mal. Si donc les méchants voulaient se rendre justice, comment pourraient-ils se croire exempts de châtiment, lorsque les maux les plus cruels les accablent, et qu'ils en sont, je ne dis pas affectés, mais infectés jusqu'à la moelle? » Vois encore, par opposition à la récompense des bons, quel est le châtiment infligé aux méchants. Tu as appris de moi que tout ce qui existe est un, et que l'unité est le bien. Par conséquent, tout ce qui existe est identique au bien ; par conséquent encore, tout ce qui s'écarte du bien cesse d'exister; d'où il suit que les méchants cessent d'être ce qu'ils étaient. Mais ils étaient hommes, comme le prouve la figure qu'ils ont conservée. Donc, dès qu'ils ont tourné au mal, ils ont perdu même leur qualité d'hommes. Mais, de même que la vertu seule peut élever les hommes au-dessus de l'humanité, il faut que le vice ravale les malheureux qu'il a dépouillés de leur qualité d'hommes, au-dessous même de la condition humaine. Par conséquent, l'être qu'ont dégradé ses vices ne peut plus être considéré comme un homme. Cet envieux, tout prêt à s'emparer du bien d'autrui, même par la violence, ne ressemble-t-il pas à un loup?[10] Ce plaideur hargneux et intraitable, qui use sa langue dans les cris de la chicane, peut être comparé à un dogue. Ce fourbe qui, pour dépouiller ses victimes, se plaît à leur tendre des pièges dans l'ombre, est le portrait du renard. Ce furieux qui rugit a les instincts du lion. Ce poltron, ce fuyard qui a peur de son ombre, est semblable à un cerf. Ce paresseux, ce lourdaud toujours endormi, mène la vie d'un âne; ce capricieux aux goûts fantasques et mobiles, ne diffère en rien d'un oiseau. Ce débauché toujours plongé dans les plus immondes voluptés, me représente un porc et ses crapuleux plaisirs. Et c'est ainsi que le malheureux qui déserte la vertu cesse d'être un homme, et que, faute de pouvoir devenir un dieu, il se voit transformé en bête. VI
Au gré
des vents, au gré
des eaux, VII— J'avoue, dis-je, et je reconnais qu'on peut dire avec raison que les méchants, tout en conservant la forme humaine, sont néanmoins, à ne regarder que l'état de leur âme, transformés en brutes. Mais leur férocité et leur scélératesse s'acharnent à la perte des gens de bien, et je ne voudrais pas qu'ils eussent une telle licence. — Ils ne l'ont pas non plus, répondit-elle, et je le prouverai en son lieu. Cependant, qu'on retire aux scélérats ce prétendu pouvoir, et les voilà déchargés d'une grande partie de leur peine. Et en effet, bien que cette proposition puisse paraître incroyable, les méchants sont nécessairement plus malheureux lorsqu'ils réalisent leurs projets, que lorsqu'ils sont dans l'impuissance de les mener à fin. Car, si c'est un malheur pour eux de vouloir le mal, c'en est un plus grand de pouvoir le commettre, puisque autrement leur volonté, cause première de leur infortune, resterait sans effet. Aussi, comme chacune de ces trois facultés est un malheur, c'est être trois fois malheureux que de vouloir, pouvoir, et commettre le mal. — Je me rends, dis-je; mais je voudrais de tout mon cœur qu'ils fussent affranchis le plus tôt possible de ce malheur, en perdant le pouvoir de nuire. — Ils en seront affranchis, répondit-elle, plus tôt que tu ne le souhaites peut-être, et qu'ils ne le croient eux-mêmes. Car, dans le cours d'une vie si rapide, rien n'arrive assez tardivement pour que l'attente puisse en paraître longue, surtout à une âme immortelle. Ces espérances démesurées, ces présomptueuses machinations des méchants sont souvent déjouées par une fin soudaine et imprévue qui est en même temps la fin de leur misère. Si le crime, en effet, est une cause de malheur, celui-là sera nécessairement plus malheureux qui sera plus longtemps criminel, et, à mon sens, l'infortune des méchants serait au comble, si la mort ne venait enfin mettre un terme à leur méchanceté.[11] Car si ce que j'ai dit de l'infortune des méchants est vrai, il est évident qu'un malheur est infini, quand il est éternel. — Voilà, dis-je, une conséquence singulière et difficile à admettre; je reconnais pourtant qu'elle se lie naturellement aux prémisses que je t'ai accordées. — Tu as raison, reprit-elle; mais quand on répugne à admettre une conséquence, il faut prouver ou que quelqu'une des propositions précédentes est fausse, ou que de leur rapprochement ne peut résulter une conclusion nécessaire; autrement, les propositions antérieures une fois accordées, il n'est plus possible d'en contester la conséquence. Au reste, ce que je vais ajouter te paraîtra tout aussi surprenant, bien que ce ne soit aussi qu'une déduction rigoureuse des propositions qui précédent. — Qu'est-ce donc? demandai-je. — Je prétends, répondit-elle, que les méchants sont plus heureux quand ils subissent la peine de leurs crimes, que lorsqu'ils échappent aux coups de la justice.[12] Et je ne veux pas dire pour le moment, ce que l'on pourrait croire tout d'abord, que le châtiment corrige le vice, que la crainte du supplice ramène les coupables dans le bon chemin, et que l'exemple engage les autres à fuir le mal; c'est par une autre raison que je considère l'impunité comme un surcroît de malheur pour les méchants, sans me préoccuper, d'ailleurs, de leur amendement possible ni de l'efficacité de l'exemple. — Et quelle autre raison peut-il y avoir que celle-là? demandai-je. — N'avons-nous pas reconnu, reprit-elle, que les bons sont heureux et les méchants misérables? — Sans doute, répondis-je. — Si donc l'on mêle quelque bien à l'infortune d'un misérable, ne sera-t-il pas plus heureux que celui dont la misère est absolue, abandonnée à elle-même, et sans mélange d'aucun bien? — C'est mon avis, dis-je. — Et ce même misérable, privé de tous les biens, si l’on ajoute un mal de plus aux maux qui causent son infortune, ne sera-t-il pas beaucoup plus malheureux que celui dont la misère est soulagée par quelque bien qu'il reçoit en partage? — Pourquoi non? dis-je. — Or, les méchants, lorsqu'ils sont punis, acquièrent un bien d'une certaine espèce, je veux dire le châtiment même, qui, au point de vue de la justice, est un bien; et, au contraire, lorsqu'ils échappent au supplice, ils sont affligés d'un mal de plus, j'entends l'impunité même, qui, de ton propre aveu, est un mal, puisque c'est une injustice. — Je ne puis en disconvenir. — Donc les méchants sont bien plus malheureux quand ils jouissent d'une impunité injuste, que lorsqu'ils reçoivent une juste punition. Mais si la punition des méchants est un acte de justice, leur impunité est une injustice ; c'est clair. — Qui pourrait le nier? — Personne ne niera non plus, reprit-elle, que tout acte de justice soit certainement un bien, et toute injustice un mal. — Ces propositions, dis-je, ne sont que les conséquences des principes précédemment établis. Mais dis-moi, je te prie, ne réserves-tu pas d'autres supplices aux âmes après la destruction du corps? — Oui, assurément, et de très grands. Dans ma pensée, les uns, les plus rigoureux, sont de véritables châtiments ; les autres, tempérés par là clémence, ont pour objet la purification des âmes.[13] Mais je n'ai pas l'intention de traiter présentement ce sujet. Toujours est-il que je t'ai amené à reconnaître que cette puissance des méchants, qui te causait tant d'indignation, est absolument nulle; que tu te plaignais à tort de leur impunité, puisque jamais ils n'échappent au châtiment de leurs mauvaises actions ; que cette liberté de mal faire, dont tu hâtais le terme de tous tes vœux, est de courte durée ; qu'ils sont d'autant plus malheureux qu'ils en jouissent plus longtemps, et que rien n'égalerait leur infortune s'ils en jouissaient toujours ; qu'enfin l'impunité qui les épargne en violant là justice, est un plus grand malheur pour eux que ne le serait un juste châtiment; d'où j'ai tiré cette conséquence qu'ils ne sont jamais si cruellement punis que lorsqu'ils semblent ne l'être pas. — Lorsque je pèse tes raisons, dis-je, elles me paraissent les meilleures du monde; mais, si j'en reviens à l'opinion des hommes, quel est celui qui consentira, je ne dis pas à les admettre, mais même à les entendre? — Tu dis vrai, répondit-elle; leurs yeux, accoutumés aux ténèbres, ne peuvent soutenir l'éclat de la vérité; et ils ressemblent à ces oiseaux dont la nuit illumine le regard, tandis que le jour les aveugle; voilà pourquoi, moins attentifs aux lois générales de la nature qu'à leurs propres impressions, ils considèrent comme un bonheur le pouvoir de commettre le crime ou d'échapper au châtiment. Mais vois plutôt ce qui a été décrété par la loi éternelle. Conforme-toi aux principes les plus purs de la morale; tu n'auras pas besoin de recevoir ta récompense de la main d'un juge : tu te seras adjugé toi-même le meilleur lot. Si, au contraire, tu t'abandonnes au vice, ne cherche pas ton bourreau hors de toi-même : c'est toi qui t'es précipité dans l'abîme. C'est ainsi que lorsque tu regardes tour à tour la terre sordide et le ciel à l'exclusion de tout autre objet, tu crois être, selon le point de vue, tantôt dans la fange, tantôt au milieu des astres. Le vulgaire, il est vrai, ne fait pas attention à ces choses ; mais quoi ! prendrons-nous exemple sur ces malheureux que nous avons dit être semblables aux bêtes? Et parce qu'un homme qui aurait perdu la vue et qui ne se souviendrait pas d'en avoir jamais eu l'usage, se croirait pourvu de toutes les perfections humaines, devrions-nous pour cela tenir pour aveugles ceux qui voient clair? Le vulgaire ne m'accorderait pas non plus cette autre proposition, quoiqu'elle s'appuie comme les précédentes sur les arguments les plus solides, à savoir que ceux qui font le mal sont plus malheureux que ceux qui en sont victimes. — Je serais curieux, dis-je, de connaître ces arguments. — Nies-tu, reprit-elle, que tout méchant soit digne de châtiment? — Certainement non. — En outre, tout méchant est malheureux; à cet égard les preuves abondent. — J'en conviens. — Donc, tu ne doutes pas qu'un homme digne de châtiment ne soit malheureux? — Sans doute. — Supposons maintenant que tu sièges sur un tribunal; lequel croirais-tu devoir punir de celui qui a commis le mal ou de celui qui l'a subi? — Je n'hésite pas à répondre, dis-je, que je donnerais satisfaction à la victime par la punition du coupable. — Donc, l'auteur de l'offense te paraîtrait plus malheureux que l'offensé? — Cela va de soi, dis-je. Ainsi, par cette raison et par d'autres qui s'appuient sur le même principe, il est clair que si la méchanceté engendre nécessairement la misère, ce n'est pas le mal qu'on souffre qui est un malheur, mais celui que l'on fait. — Aujourd'hui cependant, dit-elle, les avocats se règlent sur l'opinion contraire. C'est en faveur de ceux qui ont souffert quelque grand dommage qu'ils s'efforcent d'émouvoir la compassion des juges, et pourtant les coupables ont des droits plus légitimes à la pitié ; ce n'est pas avec colère, mais bien avec un sentiment de tendre commisération, que leurs accusateurs devraient les conduire au juge, comme on mène les malades au médecin,[14] afin que leur infirmité morale trouvât sa guérison dans le supplice. Le zèle des défenseurs en serait singulièrement refroidi, ou, s'ils voulaient absolument se rendre utiles à leurs clients, ils n'auraient qu'à se charger du rôle de l'accusation. Je dis plus, si les coupables eux-mêmes pouvaient encore, par quelque échappée, entrevoir la vertu qu'ils ont abandonnée, s'ils savaient que les souillures de leurs vices seront purifiées par les angoisses du châtiment; au prix de la vertu qui leur serait rendue, ils tiendraient pour rien ces angoisses, et on les verrait répudier les bons offices de leurs défenseurs pour se livrer à la discrétion des accusateurs et des juges. C'est pour celte raison qu'il n'y a pas de place pour la haine dans le cœur du sage. En effet, quel autre qu'un insensé peut haïr les bons? et, à l'égard des méchants, la haine n'est pas plus raisonnable. En effet, si, comme la fièvre est une maladie du corps, le vice est une maladie de l'âme ; et si ceux qui souffrent dans leur corps nous semblent dignes, non de haine, mais de pitié, à plus forte raison, loin de les persécuter, devons-nous plaindre les malheureux que tourmente le vice, cette maladie mentale plus terrible que toutes les infirmités physiques. VIII
A quoi bon déchaîner
ces discordes fatales?
Des serpents, des lions, des tigres et des
ours
Vous différez de mœurs,
d'esprit et de maximes,
Où
sont de vos fureurs les motifs suffisants? IXJe pris alors la parole : « Je comprends, dis-je, le genre de félicité ou de malheur qui, selon qu'ils le méritent, est le partage des bons et des méchants. Mais dans les hasards de la fortune, telle qu'on l'entend d'ordinaire, je vois la part du mal comme du bien. Certes, il n'y pas un sage qui, à l'exil, à la pauvreté, à l'ignominie, ne préférât la richesse, la considération, la puissance et le bonheur de vieillir en paix dans sa patrie. La sagesse, en effet, remplit sa tâche avec plus d'éclat et d'autorité, quand elle peut communiquer en quelque sorte sa propre félicité aux peuples qui ont le bonheur d'être gouvernés par elle. Ajoute à cela que la prison, les fers et les autres châtiments inscrits dans les lois ne doivent revenir qu'aux méchants, puisque c'est contre eux qu'ils ont été décrétés. Aussi, quand je vois que, par un renversement étrange, les gens de bien sont traînés au supplice à la place des scélérats, et que les méchants s'emparent des récompenses dues à la vertu, ma surprise est extrême, et je désire savoir de toi les raisons d'une si déplorable confusion. Je m'en étonnerais moins, sans doute, si je croyais que tout ce désordre fût l'effet du hasard ; mais non, et c'est là ce qui met le comble à ma stupeur : le monde est gouverné par Dieu. Or, comme il est constant que tantôt les bons sont bien traités, tandis que les méchants pâtissent; que tantôt, au contraire, les bons sont dans la détresse et les méchants au comble de leurs vœux, jusqu'à preuve du contraire, en quoi Dieu diffère-t-il du hasard? —Il n'est pas étonnant, répondit-elle, que le inonde, aux yeux de quiconque ignore les lois qui le régissent, offre quelque apparence de trouble et de confusion. J-a raison de cet ordre admirable peut t'échapper, mais, puisque c'est un Dieu bon qui gouverne le monde, tu dois être convaincu que tout s'y passe régulièrement. X
Celui qui ne sait pas que l'Ourse
Lorsque, par la Terre effacée,
Que du Corus l'aveugle rage
C'est le nouveau, c'est le mystère
XI— J'en conviens, dis-je; mais comme c'est à toi qu'il appartient de développer les causes des phénomènes obscurs et d'expliquer ce qu'ils ont de mystérieux, je te prie de vider la question et de m'éclairer sur un sujet qui me trouble étrangement. » Elle me répondit avec un léger sourire : « Tu me proposes la question la plus difficile à éclaircir ; elle n'a pas de fond pour ainsi dire : la matière est inépuisable. Pour une difficulté tranchée, il en surgit aussitôt mille autres, comme les têtes de l'hydre, et l'on n'en peut venir à bout qu'à l'aide du feu le plus pénétrant de l'esprit.[17] Il ne s'agit de rien moins, en effet, que d'une enquête à poursuivre sur l'unité absolue de la Providence, sur le cours du Destin, sur les cas imprévus, sur la prescience divine, sur la prédestination et sur le libre arbitre, toutes choses dont tu sens toi-même la difficulté. Mais comme leur connaissance p«ut concourir à ta guérison, malgré le peu de temps qu'il me reste, je ferai en sorte de t'en donner un aperçu. En revanche, quelque plaisir que tu prennes à la musique et à la poésie, je serai forcée de t'en sevrer pour quelque temps. Il faut, avant tout, que je t'expose dans un ordre rigoureux toute une série d'arguments. — Comme tu voudras, » répondis-je. Alors, passant à un autre sujet, elle commença ainsi : « La génération de toutes choses, les changements successifs qui se produisent dans la nature, tous les mouvements enfin que l'on y remarque, tirent leurs causes, leur arrangement et leurs formes de l'immutabilité de l'intelligence divine. Celle-ci, retirée et comme retranchée dans son unité, gouverne néanmoins le monde par des moyens multiples. Au simple point de vue de sa divine intelligence, l'action de Dieu se nomme Providence; au point de vue des mouvements et des effets qu'elle produit, c'est ce que les anciens nommaient le Destin.[18] Que la Providence et le Destin diffèrent, c'est ce qu'il est facile de reconnaître en considérant l'action de l'une et de l'autre. La Providence, en effet, c'est cette divine intelligence qui, placée au faîte de toutes choses, les règle toutes : le Destin n'est qu'une certaine disposition nécessaire des choses variables, et le moyen dont la Providence se sert pour assigner à chaque objet la place qui lui convient. La Providence, en effet, embrasse à la fois tous les êtres, si divers, si innombrables qu'ils soient : quant au Destin, c'est l'un après l'autre qu'il met les êtres en mouvement, et les distribue sous la forme qui leur convient à travers l'espace et le temps. Aussi, quand l'intelligence divine embrasse d'un seul regard, comme une unité, cet ensemble d'êtres qui se déroulent dans le temps, il faut l'appeler la Providence; mais quand cette unité se divise pour se répartir dans le temps, il faut dire le Destin. Encore qu'il y ait de la différence entre les deux, pourtant l'un dépend de l'autre. En effet, les modes successifs du Destin dépendent de l'unité de la Providence. Comme l'artiste arrête d'abord dans son esprit la forme de l'œuvre qu'il veut créer, et l'exécute ensuite en réalisant, par une série d'opérations successives, l'idée qu'il avait conçue complète et d'un seul jet; de même, la Providence divine arrête du premier coup et d'une manière irrévocable ce qu'elle se propose de faire; puis, par le ministère du Destin, elle exécute son plan à diverses reprises et dans la succession des temps. Soit donc que certains esprits de nature divine viennent en aide au Destin,[19] soit qu'il ait à ses ordres l'âme, la nature tout entière, les mouvements des corps célestes, la puissance des anges et la fertile adresse des démons ; soit enfin que toutes ces puissances réunies, ou quelques-unes seulement, concourent à la marche du Destin, il n'en est pas moins certain que la Providence, toujours une et immuable, est comme le moule de tout ce qui doit se faire, et que le Destin représente seulement l'enchaînement mobile et la succession dans le temps des choses décrétées une fois pour toutes par la Providence. Il suit de là que tout ce qui est subordonné au Destin l'est également à la Providence, puisque celle-ci commande au Destin lui-même ; tandis qu'au contraire certaines choses qui dépendent immédiatement de ia Providence échappent à l'action du Destin. Ce sont celles qui, étant plus immédiatement rapprochées de la divinité, demeurent immuables, et sont en dehors de la sphère mobile du Destin. Supposons, par exemple, un certain nombre de cercles concentriques tournant autour du même point : le plus rapproché du centre participe de l'unité du point centrai, et devient lui-même, relativement aux autres, comme un point autour duquel ils se meuvent ; le cercle le plus distant, au contraire, décrit dans sa révolution une courbe plus étendue, et embrasse d'autant plus d'espace qu'il est plus éloigné du centre indivisible ; tandis que la circonférence qui adhérerait de toutes parts à son point central, ne Ferait qu'un avec lui et cesserait de s'étendre et de se mouvoir au dehors. Par la même raison, pour peu qu'un être s'éloigne de l'intelligence, qui est le centre de tout, le Destin l'enveloppe dans le cercle déjà plus grand de ses révolutions; et toute chose est d'autant plus indépendante du Destin qu'elle se rapproche davantage de Dieu, ce pivot de tout l'univers; toute chose qui adhère de tout pointa l'Intelligence suprême, immuable de sa nature, est immobile comme elle, et échappe à la domination du Destin. Ainsi, ce que le raisonnement est à l'intelligence, l'être engendré à l'être absolu, le temps à l'éternité, la circonférence au centre, voilà précisément ce qu'est l'ordre variable du Destin comparé à l'unité immuable de la Providence. C'est cet ordre du Destin qui fait mouvoir le ciel et les astres, qui maintient l'harmonie entre les éléments, et qui établit entre eux un échange alternatif de qualités et de formes. Tous les êtres lui doivent leur naissance, et ceux qui périssent, il les renouvelle par la multiplication féconde d'êtres semblables; c'est lui encore qui règle les actions et le sort des hommes par des causes intimement liées l'une à l'autre ; et comme ces causes ont leur origine dans une Providence immuable, il faut nécessairement qu'elles soient immuables elles-mêmes. De cette façon, le monde est parfaitement gouverné, puisque l'unité, qui est l'essence même de l'intelligence divine, produit les causes dont l'enchaînement est indestructible, et que cet enchaînement immuable retient à son tour les choses créées qui, sans cela, flotteraient au hasard. Que vous ne puissiez vous rendre raison de cet ordre admirable, et que le monde vous paraisse livré au trouble et à la confusion, il n'en suit pas moins que chaque chose va dans le sens de sa nature, qui la dirige vers le bien. Et, en effet, rien ne s'accomplit en vue du mal, pas même par le fait des méchants; car, ainsi que je l'ai surabondamment prouvé, c'est le bien qu'ils poursuivent; et s'ils s'en écartent, c'est par erreur de jugement. Jamais, en effet, l'ordre qui émane du souverain bien ne saurait détourner une créature de son principe. « Mais, diras-tu, peut-on imaginer une confusion plus inique que celle qui a pour résultat de répartir indistinctement les biens et les maux, les joies et les peines, entre les bous et les méchants? Quoi donc! les hommes ont-ils l'esprit assez sain pour que le jugement qu'ils portent sur ceux qu'ils estiment bous ou méchants soit nécessairement conforme à la vérité? Leurs sentiments sur ce point sont souvent contradictoires, et tel qui paraît aux uns digne de récompense, dans l'opinion des autres mérite le dernier supplice. Mais je veux qu'il se rencontre un homme assez judicieux pour discerner les bons d'avec les méchants. Pourrait-il, pour me servir d'une expression que, d'ordinaire, on applique seulement aux corps, reconnaître le tempérament intime des aines? Ce serait aussi merveilleux que de deviner, sans l'avoir appris, pourquoi, dans l'état de santé, des aliments doux conviennent aux uns, des aliments amers aux autres, et pourquoi, dans l'état de maladie, ceux-ci se trouvent bien de remèdes anodins, ceux-là d'un traitement héroïque. Mais le médecin qui sait diagnostiquer les cas divers et les tempéraments dans la santé et dans l'état de maladie, n'est nullement surpris de ces anomalies. Or, en quoi consiste la santé des âmes, sinon dans la vertu? Qu'est-ce que leur maladie, sinon le vice? Et qui peut leur conserver les biens qu'elles possèdent ou les délivrer de leurs maux, sinon le conseiller suprême et le médecin des âmes, c'est-à-dire Dieu? Oui, c'est Dieu qui, du haut de sa Providence, observant et voyant tout, distingue le traitement qui convient à chacun et le lui applique avec intelligence. Cet insigne miracle du Destin qui confond notre ignorance, en voici tout le secret : c'est qu'un Dieu l'opère en connaissance de cause. Car, pour me borner, relativement à la profondeur de Dieu, aux quelques considérations accessibles à la raison humaine, tel qui te paraît le plus juste et le plus intègre des hommes est jugé bien autrement par la Providence à qui rien n'échappe ; et notre ami Lucain nous le dit:[20] « si la cause du vainqueur eut les dieux de son a côté, celle du vaincu avait Caton pour elle. » Donc, tout ce que tu vois arriver ici-bas contrairement à ton attente, est conforme à l'ordre régulier des choses; c'est dans tes idées seulement qu'il y a désordre et confusion. Je suppose pourtant un homme de mœurs assez irréprochables pour mériter au même degré l'estime de Dieu et celle de ses semblables; mais cet homme a l'esprit faible; vienne l'infortune, peut-être cessera-t-il de pratiquer la vertu, qui aura été impuissante à lui conserver le bonheur. Dans ce cas, la sagesse divine le ménage, car l'adversité pourrait le rendre pire, et Dieu lui épargne des maux qu'il ne serait pas capable de supporter. Un autre s'est élevé à la perfection de la vertu ; sa sainteté le rend presque l'égal de Dieu : la Providence se fait scrupule de l'affliger de la moindre disgrâce; elle ne souffre même pas que son corps soit éprouvé par la maladie ; car, ainsi que l'a dit un sage encore plus autorisé que moi : De l'homme aimé des dieux le corps est plein de force.[21] Souvent encore il arrive que la direction des affaires publiques est confiée aux gens de bien, afin qu'ils puissent mettre un frein aux excès des méchants. A quelques-uns la Providence, selon la trempe de leur âme, envoie un mélange de biens et de maux; elle aiguillonne ceux-ci de peur qu'un bonheur trop prolongé ne les corrompe; elle permet que ceux-là soient plus rudement frappés, afin que leurs vertus s'affermissent par la pratique et l'habitude de la patience. Ceux-ci craignent plus que de raison des maux qu'ils peuvent supporter; ceux-là méprisent témérairement des peines qui excèdent leurs forces; c'est pour amener les uns et les autres à se mieux connaître que Dieu les afflige. Il en est qui se sont fait un nom respecté dans le monde au prix d'une mort glorieuse; d'autres, inébranlables au milieu des supplices, ont prouvé au reste des hommes que la vertu est invincible au malheur. Or, que toutes ces vicissitudes soient le résultat d'un ordre parfaitement réglé, et qu'elles tournent à l'avantage de ceux mêmes qui en sont l'objet, il n'est pas permis d'en douter. C'est en vertu des mêmes causes que tantôt le bien, tantôt le mal, arrive aux médians. Pour ce qui est de leurs maux, personne n'en est surpris, parce que tout le monde s'accorde à penser qu'ils lès méritent. De plus, leur châtiment a ce double avantage de détourner les autres du crime et de les corriger eux-mêmes. A l'égard de leur félicité, elle est pour les gens de bien une leçon assez éloquente; elle leur apprend ce qu'ils doivent penser de la Fortune, qui se fait si souvent la complaisante des méchants. Une autre raison, selon moi, de cet ordre de choses, c'est qu'il y a des hommes d'un naturel si fougueux et si déréglé, que la misère pourrait les irriter encore et les pousser au crime. Ce sont des malades à qui la Providence administre des richesses en guise de médicaments. Celui-ci, sentant sa conscience souillée de méfaits et se comparant lui-même à sa fortune, craint peut-être de perdre tristement des biens qui font sa joie. Il réformera donc ses mœurs, et, de peur de perdre ses trésors, il se corrigera de ses vices. Quelques-uns tombent dans une infortune méritée pour avoir mésusé de leur bonheur. D'autres ont reçu le droit de punir, tant pour éprouver les bons, que pour châtier les méchants. Car s'il ne peut exister aucune alliance entre les bons et les méchants, ces derniers ne peuvent non plus s'accorder entre eux. Et comment |e pourraient-ils, lorsque chacun d'eux, torturé par ses remords, est en guerre avec sa propre conscience, et n'exécute presque jamais un dessein qu'aussitôt il ne se repente de ce qu'il a fait? De là ce suprême miracle, dont la Providence a donné plus d'un exemple, que des méchants ramènent d'autres méchants à la vertu. Ceux-ci, en effet, se voyant maltraités par des scélérats, les prennent en haine et retournent au bien parce qu'ils ne veulent pas ressembler à des gens qui leur font horreur. La Divinité seule a ce pouvoir de transformer le mal en bien, de s'en servir à propos et d'en faire sortir des effets salutaires. Car il y a un ordre général qui embrasse toutes choses ; ce qui s'en écarte d'un côté y rentre toujours de l'autre, afin que dans le royaume de la Providence, rien ne soit laissé au hasard : Mais un Dieu seul pourrait expliquer ces mystères.[22] Il n'est pas donné à l'homme, en effet, de saisir par la pensée tout le mécanisme de l'œuvre divine, ni de l'expliquer par des paroles. Contentons-nous de savoir que le Dieu créateur de toutes choses les ordonne et les dirige toutes vers le bien, et que, du même coup, il s'assimile et retient près de lui tous les êtres créés par lui, et se sert des évolutions nécessaires du Destin pour éliminer le mai du domaine où s'exerce sa divine puissance. Aussi, regarde à l'ordre établi par la Providence, et tu verras que ces maux qui te paraissent inonder la terre ne sont absolument rien. Mais je m'aperçois que ton esprit, accablé par la gravité de cette matière et fatigué par la longueur de mes raisonnements, attend avec impatience les distractions de la poésie. Goûte donc à ce doux breuvage ; tu y puiseras des forces pour me suivre plus loin. XII
Veux-tu rendre hommage à la
prévoyance
Quel astre égaré,
chassé
de sa voie,
Bien que chaque étoile,
au bout de sa course,
Toujours en deux parts la lumière
et l'ombre
De l'astre inconstant la marche varie
Le chaud et le froid, le sec et l'humide
Le tiède
Printemps de fleurs se couronne ;
Tout ce qui respire et vit sur la terre
Si tout marche ainsi, si tout suit sa voie,
De tout ce qui vit éternelle
Source,
Qu'en ligne directe un moment s'allonge
Ce pacte d'amour, cette sympathie
On verrait bientôt
périr
toute chose, XIII« Vois-tu maintenant la conséquence de tout ce que j'ai dit? — Quelle conséquence? demandai-je. — Que toute fortune est également bonne, répondit-elle. — Et comment cela peut-il être? m'écriai-je. — Remarque, reprit-elle, que la fortune, soit favorable, soit contraire, a pour objet, tantôt de récompenser ou d'éprouver les bons, tantôt de punir ou de corriger les méchants : dans tous les cas, elle est bonne, puisqu'elle est évidemment ou juste ou utile. — Cela n'est que trop vrai, répondis-je, et si je songe à ta Providence et au Destin tels que tu viens de me les représenter, ton raisonnement s'appuie sur les preuves les plus solides. Néanmoins, si tu le veux bien, nous le mettrons au nombre des opinions incroyables dont tu parlais tout l'heure. — Pourquoi? demanda-t-elle. — Parce que c'est une façon de parler ordinaire, et même des plus usitées, qu'il y a pour certains hommes une mauvaise fortune. — Veux-tu que je me rapproche un moment du langage vulgaire? De cette façon, je te paraîtrai moins étrangère aux idées qui ont cours chez les hommes. — Comme tu voudras, dis-je. — Eh bien ! à ton avis, ce qui est utile n'est-il pas bon? — Sans doute. — Mais la fortune qui éprouve ou qui corrige est utile. — Je l'avoue. — Donc, elle est bonne. — Pourquoi non? — Eh bien! c'est précisément la fortune de ceux qui, affermis dans la vertu, luttent contre l'adversité, ou qui, s'arrachant au vice, s'élancent dans la voie de la vertu. — Je ne-.puis le nier, dis-je. — Et la faveur de la fortune, quand elle est la récompense des honnêtes gens, est-ce là ce que le vulgaire appelle la mauvaise fortune? — Non certes; il la regarde, au contraire, et il a raison, comme le premier des biens. — Et l'adversité, qui est le juste supplice des méchants, le peuple la regarde-t-il comme un bien? — Au contraire, elle est à ses yeux le pire des malheurs qui se puisse imaginer. — Vois donc si, en suivant les idées du vulgaire, je n'en suis pas venue à une conséquence des plus incroyables? — Quoi dune? demandai-je. — Il résulte, en effet, des points accordés que la fortune des hommes qui possèdent, poursuivent ou atteignent la vertu, est dans tous les cas toujours bonne; et qu'au contraire, celle des malheureux qui persévèrent dans le vice est dans tous les cas toujours mauvaise. — Cela est vrai, dis-je, quoique personne n'ose en convenir. — C'est pourquoi, reprit-elle, l'homme sage ne doit pas se laisser abattre quand il s'agit d'entrer en lutte avec la Fortune, pas plus qu'un brave ne doit murmurer lorsque retentit le signal du combat. En effet, le péril même de la lutte est l'occasion, pour l'un, d'acquérir de la gloire, pour l'autre, de s'affermir dans la sagesse. La vertu même ne doit son nom qu'à la vigueur avec laquelle elle résiste aux assauts de l'adversité.[27] Vous tous, en effet, qui êtes en marche vers la vertu, ce n'est pas à l'abondance des richesses ou à la corruption des plaisirs que vous allez ; c'est une plus rude guerre que vous faites à l'une et à l'autre fortune; ne vous laissez ni abattre par la mauvaise, ni amollir par la bonne; tenez-vous fermes et inébranlables entre les deux.[28] En deçà ou au delà de ce point intermédiaire, on trouve une félicité méprisable, non pas la récompense d'un vertueux effort. En un mot, il dépend de vous de vous faire la fortune que vous voudrez. En effet, quand la mauvaise fortune, comme vous l'appelez, n'exerce ou ne corrigé pas, elle punit. XIV
Atride, après
dix ans de guerre [1] Quoique l'existence de la Providence divine soit incidemment reconnue dans cette phrase, l'objection n'allait à rien moins qu'à annuler cette concession de pure forme. Cette objection, en effet, avait paru sans réplique à Épicure et aux sectes philosophiques qui, de près ou de loin, se rattachaient au système de ce philosophe. Aussi, certaines écoles n'hésitaient-elles pas à soutenir que si Dieu existe, il ne daigne pas sortir de son repos éternel et qu'il abandonne au hasard le gouvernement de l'univers. Cette pensée, qu'on rencontre souvent, non seulement chez les philosophes, mais chez les poètes de l'antiquité, n'a été exprimée nulle part avec autant de précision et d'énergie que dans ces vers d'Ennius, cités par Cicéron dans son traité de la Divination : Ego Deum genus esse semper dixi et dicam Coelitum, Sed eos non curare opinor quid agat hominum genus ; Nam si curent, bene bonis sit, malis male, quod nunc abest. « J'ai toujours dit et je dirai toujours qu'il y a des dieux au ciel, mais mon opinion est qu'ils ne s'inquiètent pas de ce que font les hommes ; car s'ils s'en inquiétaient, les bons seraient heureux, les méchants malheureux, et aujourd'hui il n'en est pas ainsi. » [2] Il y aurait un rapprochement intéressant à établir entre cette pièce de vers et un passage du Phèdre de Platon où Socrate, s'attachant à déterminer les différents caractères de l'enthousiasme, définit ce qu'il entend par les ailes de l'âme et décrit les voyages que font les âmes humaines autour des planètes avant leur incarnation. Boèce s'est évidemment inspiré de ce morceau. Il s'en faut bien pourtant qu'il soit arrivé au doux éclat et à la mystique grandeur des images qu'on admire dans son modèle. [3] La planète de Saturne : Frigida Saturai sese quo stella receptet. (Virg., Géorg,, lib. I, v. 336.) [4] « Or, le chef suprême, Jupiter, s'avance le premier, conduisant son char ailé, ordonnant tout, et gouvernant toutes choses. » (Platon, Phèdre, trad. de V. Cousin.) [5] Tout ce chapitre n'est guère qu'une paraphrase du dialogue de Polus et de Socrate dans le Gorgias de Platon. [6] Imitation de ce passage : Socrate. Peux-tu voir autrement que par les yeux? — Thrasymaque. Non. — So. Entendre autrement que par les oreilles? — Thr. Non. — So. Nous pouvons donc dire avec raison que c'est là leur fonction? — Thr. Oui.... — So. Les yeux pourraient-ils s'acquitter de leur fonction s'ils n'avaient pas la vertu qui leur est propre, ou si, au lieu de cette vertu, ils avaient un vice contraire? — Thr. Comment le pourraient-ils? —So. Ne peut-on pas en dire autant de toute autre chose? — Thr. Je le pense, — So. Voyons ceci maintenant. L'âme n'a-t-elle pas ses fonctions dont nulle autre qu'elle ne pourrait s'acquitter, comme penser, agir, vouloir, et le reste? — Thr. Cela est vrai— — So. L'âme n'a-t-elle pas aussi sa vertu particulière? — Thr. Oui. — So. L'âme, privée de cette vertu, pourra-t-elle jamais s'acquitter bien de ses fonctions? — Thr. Cela est impossible. — So. C'est donc une nécessité que l'âme qui est mauvaise pense et agisse mal ; au contraire, celle qui est bonne fera bien tout cela. — ThR. C'est une nécessité. — So. Mais ne sommes-nous pas demeurés d'accord que la justice est une vertu et l'injustice un vice de l'âme? — Thr. Nous en sommes demeurés d'accord. — So. Par conséquent, l'âme juste et l'homme juste vivront bien, et l'homme injuste vivra mal. — ThR. Cela doit être, d'après ce que tu as dit. — So. Mais celui qui vit bien est heureux ; celui qui vit mal est malheureux. — Thr. Assurément. — So. Donc le juste est heureux, et l'injuste malheureux. (Platon, Républ., liv. Ier, trad. de V. Cousin.) [7] Ce n'est pas sans quelque hésitation que nous nous sommes décidé pour ce sens. A première rue, les mots pure atque simpliciter semblent se rapporter au verbe nego ; mais le sens général de la proposition exige, nous le croyons, qu'on les rattache au verbe esse qui précède ; c'est ainsi qu'un peu plus loin esse et absolute ne peuvent se séparer, et confiraient le sens que nous avons dû adopter dans la phrase précédente. Voici, en d'autres termes, la pensée un peu subtile qu'a voulu exprimer Boèce : « De même qu'un cadavre n'est pas un homme, mais un homme mort, de même, ceux dont nous parlons ne sont pas des hommes, mais des hommes méchants. Ils n'existent donc pas purement et simplement, puisque chez eux l'accident est inséparable de l'essence. » [8] Socrate. Ne sommes-nous pas convenus que l'on ne veut point la chose qu'on fait en vue d'une autre, mais celle en vue de laquelle on la fait? — Polus. Sans contredit. — So. Ainsi on ne veut pas simplement tuer quelqu'un, le bannir, lui enlever ses biens ; mais si cela est avantageux, on veut le faire. Car, comme tu l'avoues, on veut les choses qui sont bonnes ; et celles qui ne sont ni bonnes ni mauvaises ou tout à fait mauvaises, on ne les veut pas. Puisque nous sommes d'accord là-dessus, quand un tyran ou un orateur fait mourir quelqu'un, le condamne au bannissement, ou à la perte de ses biens, croyant que c'est le parti le plus avantageux pour lui-même, quoique ce soit en effet le plus mauvais, il fait alors ce qui lui plait, n'est-ce pas? — Pol. Oui. — So. Fait-il pour cela ce qu'il veut, s'il est vrai que ce qu'il fait est mauvais? Que ne réponds-tu? Pol. Il ne me paraît pas qu'il fasse ce qu'il veut. — So. Par conséquent, j'avais raison de dire qu'il est impossible qu'un homme fasse dans une ville ce qui lui plaît, sans avoir néanmoins un grand pouvoir ni faire ce qu'il veut. (Platon, Gorgias, trad. de V. Cousin.) [9] Les traits les plus saillants de ce petit tableau sont empruntés au portrait du tyran qui termine le livre VIII de la République de Platon. [10] Le fond de ce passage appartient encore à Platon. On en peut voir le développement dans le Timée. Il y a pourtant cette différence que Boèce ne prend l'idée de la dégradation de l'homme et de son assimilation à la brute qu'au point de vue allégorique, tandis que Platon la donne pour l'expression de la réalité et prétend l'élever à la hauteur d'un dogme philosophique. Il est vrai que, pour Platon, l'assimilation de l'homme à la bête, ou plutôt l'incarnation de l'âme humaine dans la brute ne devant s'effectuer qu'après la mort et à titre exprès de châtiment, l'allégorie n'était pas de mise; toujours est-il qu'il faut savoir gré à Boèce de n'avoir pas voulu se risquer sur ce terrain dangereux, et de n'avoir emprunté à la théorie du maître que ce qui pouvait renforcer sa propre argumentation sans trop exciter l'étonnement du lecteur. Cette réserve de Boèce en pareille occasion est d'autant plus louable, que la théorie dont il s'est inspiré n'est pas proposée par Platon comme une hypothèse plus ou moins vraisemblable qu'on puisse sans grand inconvénient rejeter ou admettre. Loin de là, Platon s'y complaisait si bien, qu'il y revient longuement dans le Phédon, qui contient, on peut le dire, le dernier mot de l'enseignement de Socrate. Il faut donc conclure de cette observation que Boèce n'était pas aussi dépourvu de sens critique qu'on a bien voulu le dire, et qu'il n'était pas toujours disposé à jurer in verba magistri. [11] Cette pensée remarquable se rencontre dans le Gorgias, mais sous forme d'insinuation et enveloppée dans des termes qui n'offrent que peu d'analogie avec ceux dont se sert Boèce. [12] Socrate. Je pense, Polus, que l'homme injuste et criminel est malheureux de toute manière, mais qu'il l'est encore davantage s'il ne subit aucun châtiment, et si ses crimes demeurent impunis ; et qu'il l'est moins, s'il reçoit des hommes et des dieux la juste punition de ses fautes. — Polus. Tu avances là d'étranges paradoxes, Socrate. Quoi ! un homme que l'on surprend dans quelque forfait, comme celui d'aspirer à la tyrannie, qu'on met ensuite à la torture, qu'on déchire, à qui l'on brûle les yeux ; qui, après avoir souffert dans sa personne des tourments sans mesure, sans nombre, et de toute espèce, et en avoir vu souffrir autant à ses enfants et à sa femme, est enfin mis en croix, ou enduit de poix et brûlé vif; cet homme sera plus heureux que si, échappant à ces supplices, il devenait tyran, passait sa vie entière, maître dans sa ville, libre de faire tout ce qui lui plaît, objet d'envie pour ses concitoyens et pour les étrangers, et regardé comme heureux par tout le monde? ……… —So. Procédons de cette manière. Porter la peine de son injustice, et être châtié à juste titre, n'est-ce pas la même chose, selon toi?—Pol. Oui. — So. Pourrais-tu me nier que tout ce qui est juste, en tant que juste, est beau? — Pol. D me paraît bien que cela est ainsi, Socrate. — So. Considère encore ceci : Lorsque quelqu'un fait une chose, n'est-il pas nécessaire qu'il y ait un patient qui corresponde à l'agent? — Pol. Je le pense. — So. Ce que le patient souffre n'est-il pas la même chose que ce que fait l'agent?... —Pol. Assurément. — So. Quiconque châtie à bon droit ne châtie-t-il pas justement? — Pol. Oui. — So. N'avons-nous pas avoué que tout ce qui est juste est beau? — Pol. Sans contredit. — So. Ce que fait la personne qui châtie et ce que souffre la personne châtiée est donc beau. — Pol. Oui. — So. Mais si c'est beau, c'est en même temps bon ; car le beau est ou agréable ou utile. — Pol. Nécessairement. — So. Ainsi ce que souffre celui qui est puni est bon. —Pol. Il paraît que oui. (Platon, Gorgias, trad. de V. Cousin.) [13] « Dans ce passage, dit le commentateur Vallinus, Boèce, qui n'était pas seulement chrétien, mais catholique, reconnaît que les méchants sont condamnés, les uns à des peines éternelles, les autres à de longs tourments en expiation de leurs péchés, qui ne peuvent être effacés que par le feu. » La plupart des autres commentateurs, anciens et modernes, citent également ce passage à l'appui de l'opinion accréditée qui fait de Boèce un disciple et un martyr de la foi catholique. Il n'est pourtant pas permis d'ignorer que la croyance au Purgatoire, c'est-à-dire a un lieu d'expiation temporaire après la mort, est de beaucoup antérieure à l'avènement du christianisme, et que cette croyance n'a même été reçue qu'assez tard dans l'Église catholique comme article de foi. (Voy. le Dictionnaire de Théologie de Bergier.) Pour nous en tenir à Platon, nous pourrions citer nombre de passages de ses dialogues où le dogme du Purgatoire est formellement énoncé, et notamment le mythe célèbre d'Er l'Arménien, qui termine le livre X de la République. Nous nous bornerons à extraire du Phédon le passage que Boèce paraît avoir eu plus particulièrement en vue : « Tel est le séjour des morts. Quand chacun d'eux est arrivé dans le lieu où le démon les conduit, on juge d'abord s'ils ont mené une vie sainte et juste. Ceux qui sont trouvés avoir vécu de manière qu'ils ne sont ni entièrement criminels, ni entièrement innocents, sont envoyés à r Achéron ; ils s'embarquent sur des nacelles, et sont portés au lac Achérusiade où ils habitent; et, après avoir subi la peine des fautes qu'ils ont pu commettre, ils sont délivrés, et reçoivent la récompense de leur» bonnes actions, chacun selon son mérite. Ceux qui sont trouvés incurables, à cause de l'énormité de leurs fautes, qui ont commis d'odieux et de nombreux sacrilèges, ou des meurtres contre la justice et la loi, ou d'autres crimes semblables, l'équitable destinée les précipite dans le Tartare, d'où ils ne sortent jamais. Mais ceux qui sont reconnus avoir passé leur vie dans la sainteté, ceux-là sont délivrés de ces lieux terrestres, comme d'une prison, et s'en vont là-haut, dans l'habitation pure au-dessus de la terre. » (Platon, Phédon, trad. de V. Cousin.) [14] Platon dit dans le Timée : « Il faut admettre que la maladie de l'âme est la privation d'intelligence ; or, on est privé d'intelligence de deux façons : par la folie, ou par l'ignorance. Il faut donc appeler maladie toute affection de l'une ou de l'autre espèce qu'un homme éprouve. » (Trad. de V. Cousin.) Dans le Sophiste, l'ignorance est la laideur de Pinte, et la méchanceté la maladie de l'âme. Or, pour cette maladie, comme pour toutes les autres, il faut recourir au médecin ; seulement, dans ce cas, le médecin se nomme le juge. Les stoïciens avaient adopté ce principe que tous les vices sont des maladies et que leur remède c'est la répression pénale. Sénèque a développé cette thèse dans le chapitre v de son Traité de la colère. Vauvenargues s'est aussi exercé sur ce sujet : « Mais, dira quelqu'un, si le vice est une maladie de notre âme, il ne faut donc pas traiter les vicieux autrement que les malades. —Sans difficulté ; rien n'est si juste, rien n'est plus humain ; il ne faut pas traiter un scélérat autrement qu'un malade, mais il faut le traiter comme un malade. Or, comment en use-t-on avec un malade? par exemple, avec un blessé qui a la gangrène dans le bras? Si on peut sauver le bras sans risquer le corps, on sauve le bras; mais si on ne peut sauver le bras qu'au péril du corps, on le coupe, n'est-il pas vrai? Il faut donc en user de même avec un scélérat : si on peut l'épargner sans faire tort à la société dont il est membre, il faut l'épargner ; mais si le salut de la société dépend de sa perte, il faut qu'il meure; cela est dans l'ordre. » (2e Rép. aux conséq. de la nécessité, t. I, p. 215. —Edit. Gilbert.) [15] Imitation de ces vers de Sénèque, dans l’Hercule furieux :
Quid juvat durum properare Fatum?
« A quoi bon hâter les rigueurs du Destin? toute cette multitude répandue sur la terre immense ira rejoindre les mânes, et fera voile sur les flots paresseux du Cocyte. » [16] Le peuple grossier des villes et des campagnes croyait que certaines formules magiques avaient le pouvoir de faire descendre la lune du ciel. Carmina vel cœlo postant deducere lunam. (Virgile, Bucol., Ed. viii, v. 69.) Aussi, pendant les éclipses, faisait-on grand bruit au moyen de bassins et d'ustensiles de cuivre, afin d'empêcher la lune d'entendre ces conjurations funestes. Juvénal dit en parlant d'une femme bavarde :
Verborum tanta cadit vis,
« Ses paroles se précipitent avec une telle abondance qu'on dirait un carillon de bassins et de clochettes. Qu'on laisse en repos l'airain et les clairons ; a elle seule elle pourrait tirer la lune d'embarras. » (Sat. vi, v. 440, sq.) [17] Hercule ne parvint à détruire l'hydre de Lerne qu'en appliquant une torche ardente sur la plaie chaque fois qu'il abattait une des têtes de ce monstre, Boèce poursuit sa comparaison jusqu'au bout. [18] C'est la pure doctrine de Platon, développée par l'école d'Alexandrie. Dans la disposition générale de la première partie de ce chapitre, et dans l'agencement même de l'argumentation, Boèce paraît avoir suivi Proclus, dont le traité intitulé : De la Providence et du Destin, est une exposition complète et méthodique des idées répandues çà et là dans les dialogues du maître. Le texte original du traité de Proclus a péri, et nous ne connaissons cet ouvrage que par la traduction latine de Guillaume de Meerbecke, éditée pour la première fois en 1819 par M. V. Cousin. Nous transcrivons ici l’argumentant ou résumé en latin que M. V. Cousin a mis en tête de ce précieux livre; on y retrouvera en substance toutes les idées énoncées par Boèce : « Recte definitur Providentia ipsa operatio ipsius boni, quippe cujus idea ab idea boni separari nequeat. Bonum vero atque unum eadem. Mens autem, intellectus, Νοῦς, inferior est uno et bono ad quod semper intendit. Ergo et Providentia quae ab uno et bono proficiscitur, est autem supra mentem, intellectum, Νοῦν, indeque dicitur Πρόνοια. Fatum Providentia est delapsa in mundum, dux et praeses causarum et legum quibus summa rerum ad boni normam regitur. Fatum autem quod a bono pendet, pendet et Providentia ; dum contra Providentia, quae ipsum bonum est in actu, supra Fatum eminet. Quidquid igitur Fati est, est et Providentiae. Cogitari vero potest aliquid quod, quum in mundum non cadat, Fati vim effugiat, et uni Providentiae subjectum sit, quam certe nihil omnino effugere potest, quippe omnino nihil bono et uno potest carere. » « C'est avec raison qu'on définit la Providence le bien lui-même en exercice, parce que l'idée que nous nous en faisons est inséparable de l'idée du bien. Mais le bien est la même chose que l'unité. L'intelligence, l'esprit, le Νοῦς, ne vient qu'après l'unité et le bien, et tend toujours à s'en rapprocher. Donc la Providence, qui procède de l'unité et da bien, est supérieure à l'intelligence, à l'esprit, au Νοῦς, et pour cette raison on lui donne le nom de Πρόνοια. Le Destin est la Providence appliquée au monde, le principe primordial des causes et des lois par lesquelles l'univers est gouverné conformément au bien. Mais le Destin, par cela même qu'il est subordonné au bien, est également subordonné à la Providence, tandis que la Providence, qui est le bien en exercice, domine le Destin. Donc tout ce qui appartient au Destin appartient aussi à la Providence. Mais on peut imaginer quelque chose qui, n'étant pas soumis aux lois du monde, échappe à l'action du Destin et n'obéisse qu'à la Providence, à laquelle rien ne peut échapper entièrement, puisqu'il n'est rien qui puisse se passer du bien et de l'unité. » [19] Ce passage est assez obscur, et nous n'en avons trouvé dans aucun commentateur une explication satisfaisante. Platon s'était contenté de faire administrer le monde, sous la direction suprême de la Providence, par des génies intermédiaires, des démons, comme il les appelle, et par des forces particulières nées du mouvement des astres. A ces ministres de la volonté divine, Boèce a voulu adjoindre d'autres agents, et il laisse sa pensée dans une obscurité où il est bien difficile de se reconnaître. Qu'est-ce que ces esprits de nature divine qui viennent en aide au Destin? Sont-ce les démons de Platon? On pourrait le croire, s'ils n'étaient pas désignés un peu plus loin. Qu'est-ce que cette âme dont le Destin emprunte aussi le concours? L'âme du monde apparemment; mais il eût été bon de le dire. Que faut-il entendre encore par cas mots virtus angelica? Cette expression se rencontre plus communément chez les écrivains ecclésiastiques que chez les auteurs profanes ; mais loin d'y trouver, à l'exemple des commentateurs, une preuve du christianisme de notre auteur, nous y voyons plutôt une nouvelle preuve de son paganisme. Chrétien, en effet, et chrétien du sixième siècle, il n'aurait eu garde de réunir dans une même proposition des idées aussi disparates. Une pareille confusion eût été considérée à bon droit par les théologiens ombrageux de l'époque comme un scandale et une hérésie. Ammien Marcellin, Symmaque l'épistolaire, et, selon toute apparence, Martianus Capella étaient païens. On trouve pourtant, dans leurs livres, bon nombre d'expressions créées ou revendiquées par les écrivains ecclésiastiques. Dans le conflit, si vif alors, des idées et des systèmes, ces expressions étaient devenues comme une monnaie courante dont l'empreinte première tendait de jour en jour à s'effacer. Au reste, et pour nous borner à la critique du mot qui nous occupe, nous savons par le témoignage de saint Augustin (Cité de Dieu, liv. IX, ch. xix, et liv. X, ch. i), qu'en certains cas les philosophes platoniciens de son temps, et entre autres Labéon, se servaient du mot ἀγγελοι pour désigner les génies intermédiaires entre les hommes et la divinité. Saint Augustin proteste vivement contre cette prétendue synonymie entre les ἀγγελοι du christianisme et les δαίμονες de Platon, et réfute les raisons qui l'avaient fait admettre par l'école d'Alexandrie. Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins établi que le mot ἀγγελοι faisait partie du vocabulaire philosophique. Proclus l'emploie fréquemment pour désigner de simples messagers de Dieu, et Jamblique lui reproche, non sans aigreur, cette intrusion dans la langue philosophique d'expressions empruntées à la théologie des Barbares : οὐ γὰρ ὁ τρόπος οὗτος τῆς θεωρίας, ἀλλὰ βαρβαρικῆς ἀλαζονείας μεστός, κ. τ. λ. (Cf. J. Simon. — Histoire de l’école d'Alexandrie, t. II, p. 134.) Reste pourtant à savoir quel sens Boèce donne à ce mot. Évidemment, il entend par là des êtres différents des démons, ou des démons d'une espèce particulière, autrement sa phrase pécherait par tautologie. L'explication de cette difficulté nous est encore fournie par saint Augustin. Il nous apprend en effet, dans sa réfutation d'Apulée et de Labéon (Cité de Dieu, ibid.), que les platoniciens distinguaient de bons et de mauvais génies, et que, quand ils voulaient désigner les premiers, ils les appelaient εὐδαίμονες ou ἄγγελοι. Suivant cette définition, Boèce, par ces mots angelica virtus, entend parler des démons bienfaisants, et c'est à bon escient, et conformément à la langue de son école et de son temps, qu'il emploie cette expression. Pour suivre de plus près le texte de notre auteur, nous avons traduit les mots latins par les mots français correspondants, quitte à en déterminer le sens dans une note.
[20]
Nec quemquam jam ferre potest
Caesarve priorem « Dès ce moment César ne peut plus souffrir de supérieur ni Pompée d'égal. Lequel des deux prit les armes à meilleur droit? Question insoluble ! Chacun d'eux se couvre d'une autorité auguste : le parti du vainqueur eut pour lui les dieux; celui du vaincu, Caton. » (Pharsale, liv. I, v. 123, sq.) [21] Sauf Badius Ascensius qui, on ne sait pourquoi, attribue à Hermès Trismégiste le vers incorrect cité par Boèce (il s'y trouve une faute de quantité), tous les anciens commentateurs sont d'avis qu'il ne peut appartenir qu'à un Père de l'Église. Ils ne voient pas d'autre moyen d'expliquer l'hommage que la Philosophie rend, en termes, à la vérité, bien remarquables, me quoque excellentior, à l'autorité du poète. C'est toujours l'effet de la même préoccupation. Nous croyons que nous avons simplement ici une de ces sentences dogmatiques, vénérables par leur antiquité, que l'école d'Alexandrie faisait remonter aux anciens oracles, et dont elle autorisait volontiers son mysticisme, comme M. V. Cousin l'a si bien démontré dans sa belle étude sur les commentaires inédits d'Olympiodore. A l'appui de cette remarque, nous citerons un passage significatif du Second Alcibiade de Platon. Après avoir rapporté une formule de prière attribuée à un ancien poète qu'il ne nomme pas, Socrate dit à son interlocuteur : « N'est-ce pas pour cette raison que le poète dont il a été question, et qui en savait plus que nous. » «Αρ' οὖν οὐχὶ εἰδώς τι πλεόν ἡμῶν ὁ ποιητὴς.... « N'est-ce pas là tout à fait le me quoque excellentior de Boèce? [22] Vers de l’Iliade, ch. XII, 176. [23] Boèce traite ici, sur un ton un peu plus élevé, le même sujet que dans le morceau poétique qui termine le livre II. Nous avons déjà remarqué (voir la note 57, livre II) que cette idée de l'amour considéré comme principe conservateur du monde remonte à la plus haute antiquité. Il paraît qu'elle n'a rien perdu de son crédit dans la patrie de Platon, car nous la retrouvons dans une des pièces d'un recueil de poésies publié l'année dernière à Athènes, par M. Rizo Rangabé. Voici comment s'exprime le poète : « Avec quelles extases pieuses mon âme perdue dans le vague éther, comprend alors ce réciproque amour qui fait que les astres gravitent les uns vers les autres, et que le nuage s'endort tranquille sur le sein frémissant des mers ! » (Trad. de M. Yemekiz.) Nous devons la communication du texte de ce passage à la bonne grâce de M. Yemeniz, consul de Grèce à Lyon, qui a publié dernièrement dans la Bévue des Deux-Mondes un travail remarquable sur les poètes grecs contemporains. [24] Il s'agit ici de Vesper et Lucifer, deux noms par lesquels les poètes désignent la planète de Venus, selon qu'elle paraît dans le ciel avant le lever, ou après le coucher du soleil. Ces noms correspondent à notre étoile du soir et à notre étoile du malin. Boèce donne à entendre que l'heure de l'apparition de cet astre est déterminée par son amour alternatif pour la nuit et pour le jour, alternus amor. Nous ne nous flattons pas d'avoir rendu aussi clairement qu'il l'eût fallu cette idée un peu cherchée. [25] « Toutes les fois que les éléments dont je parlais tout à l'heure, le froid, le chaud, l'humide et le sec, contractent les uns pour les autres un amour réglé et composent une harmonie sage et bien tempérée, l'année devient fertile et salutaire aux hommes, aux plantes et à tous les animaux, sans nuire à quoi que ce soit. » (Platon, le Banquet, trad. de V. Cousin.) [26] Traduction de ce vers orphique : Ζεὺς βασιλεὺς, Ζεὺς ἀρχὸς ἁπάντων, ἀρχικέραυνος. [27] Virtus, vertu ; vires, vigueur. Le même rapprochement étymologique n'est pas possible en français ; mais on peut remarquer que, dans notre langue, comme dans le latin, le mot vertu a parfois le sens de force.
[28]
Rebus angustis animosus atque
« Dans l'adversité, montre-toi ferme et courageux ; d'un autre côté, si le vent de la Fortune gonflait par trop tes voiles, tu ferais sagement de les serrer. » (Horace, Odes, liv. II, x.)
[29]
Nunquam Stygias fertur ad
umbras « Jamais les ombres du Styx n'ont vu arriver au milieu d'elles un illustre héros. Vivez en hommes de cœur, et les cruels destins ne vous entraîneront pas aux rives du Léthé ; mais lorsque votre dernière heure et votre dernier jour seront consommés, la gloire vous ouvrira la route des cieux. » (Sénèque, Hercule sur l’Œta.)
|