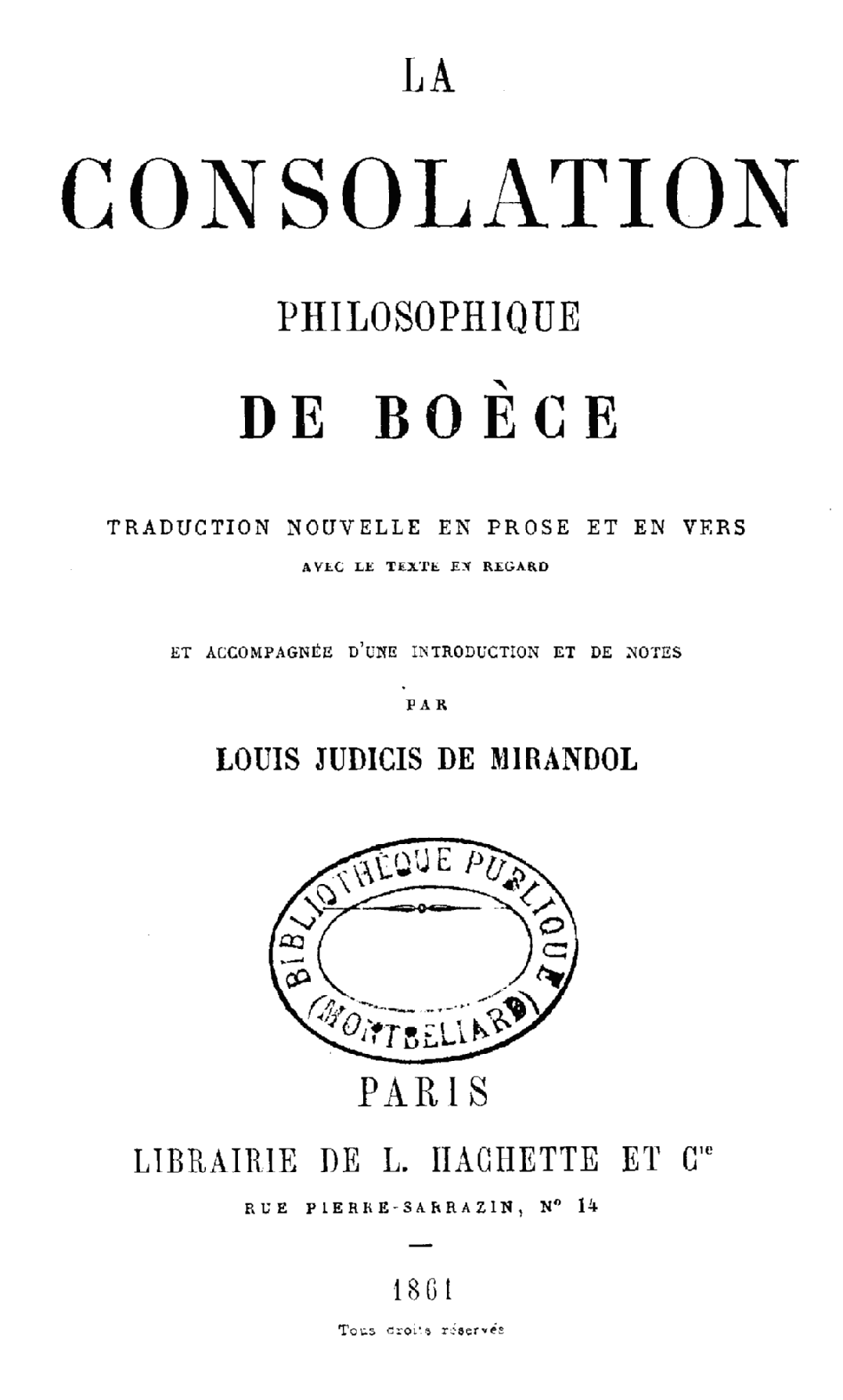|
ALLER A LA TABLE DES MATIÈRES DE BOÈCE
BOÈCELACONSOLATION PHILOSOPHIQUE.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
LIVRE TROISIÈME.IElle avait fini de chanter que je l'écoutais encore avidement, et que je demeurais immobile, l'oreille tendue au charme de cette mélodie. Puis, quelques instants après. : « O toi, lui dis-je, souveraine consolatrice des âmes découragées, quel soulagement ne dois-je pas, tant à la gravité de tes maximes qu'à la douceur de tes chants! Oui, dès ce moment je me sens assez fort pour braver les coups de la Fortune. Aussi, ces moyens de guérison que tu disais un peu trop violents pour moi, non seulement je ne les redoute plus, mais dans mon vif désir de t'entendre, je les implore avec instance. » Elle alors : « Je m'en suis doutée, dit-elle, à la muette attention avec laquelle tu dévorais mes paroles. J'attendais que ton âme fût dans cette disposition, ou plutôt, c'est moi qui l'y ai mise. Car si le breuvage qu'il me reste à te présenter, au premier contact brûle les lèvres, quand on l'a bu, on n'en sent plus que la douceur. Mais si déjà, comme tu le dis, tu désires m'entendre, de quelle impatience ne serais-tu pas dévoré, si tu savais où j'ai dessein de te conduire? — Où donc? demandai-je. — A la véritable félicité, dit-elle. Ton âme l'entrevoit comme à travers un rêve, mais tes yeux sont tellement fascinés par ses apparences, que tu ne peux la contempler elle-même. — Parle, repris-je alors, et montre-moi sans plus de retard cette véritable félicité. — Je le ferai volontiers pour l'amour de toi, répondit-elle. Mais d'abord, j'essayerai de montrer et de déterminer les éléments de bonheur qui te sont mieux connus ; cette revue une fois faite, tu pourras, en tournant les yeux du côté opposé, reconnaître l'image de la véritable béatitude. II
Avant d'ensemencer un terrain en jachère,
Le miel paraît
plus doux après
l'absinthe amère
Du brillant Lucifer l'étoile
à
peine luit
T'a courbé sous le joug; renonce à
l'esclavage : IIIAlors le regard fixe, et comme retirée dans le sanctuaire de ses pensées, elle commença en ces termes : « Tous les hommes, si divers que soient les soucis qui les travaillent, s'efforcent d'arriver, par des routes différentes, il est vrai, à un seul et même but : la béatitude. J'entends par là ce bien suprême, au delà duquel, une fois qu'on le possède, il n'y a plus rien à désirer. Il représente donc la somme de tous les biens et les résume tous ; s'il lui en manquait un seul, il ne serait plus le souverain bien, puisqu'en dehors de lui, il y aurait encore matière à désir. Il est donc évident que la béatitude est la perfection du bonheur résultant de la réunion de tous les biens. C'est là le but, comme je l'ai dit, que par divers chemins tous les mortels s'efforcent d'atteindre. En effet, par un instinct naturel, tous les hommes aspirent au vrai bonheur; mais ils sont entraînés vers les faux biens par l'erreur qui les fourvoie. Les uns, s'imaginant que le souverain bien consiste à ne manquer de rien, s'évertuent à entasser des trésors; d'autres, persuadés qu'il réside dans ce que les hommes honorent le plus, recherchent les dignités pour s'attirer la vénération de leurs concitoyens. Il en est qui placent le souverain bien dans la souveraine puissance ; ceux-là veulent régner eux-mêmes, ou s'efforcent de s'accrocher à ceux qui règnent. Ceux qui le voient dans la célébrité se hâtent de rendre leur nom glorieux dans les arts de la paix ou dans ceux de la guerre. Le plus grand nombre pourtant le rapporte à la joie et au plaisir, et lui donne pour dernier terme l'ivresse de la volupté. Pour certains, ces avantages se transforment indifféremment en moyens et en but. Ainsi on voit des hommes désirer la richesse en vue de la puissance et de la volupté, et d'autres rechercher la puissance en vue de la richesse ou de la gloire. C'est donc à l'acquisition de ces biens et de tous ceux qui leur ressemblent que tendent les vœux et les actions des hommes. Il en est ainsi des hauts emplois et de la popularité, parce qu'on croit y gagner une certaine illustration; ainsi du mariage et de la paternité, qu'on recherche pour la satisfaction qu'on en espère. Quant aux amis, ce trésor, le plus sacré de tous, doit être mis au compte, non de la fortune, mais de la vertu. Pour tout le reste, on ne le prend que comme instruments de puissance ou de plaisir. Il est clair encore que les avantages du corps se rapportent à ceux que je viens d'énumérer. La force et une haute taille semblent promettre la puissance; la beauté et la légèreté, la renommée; la santé, le plaisir. Bien évidemment ces divers avantages ne sont désirés qu'en vue de la béatitude. Car c'est dans l'objet de ses préférences que chacun fait consister le souverain bien. Mais, d'après notre définition, le souverain bien est la même chose que la béatitude. Donc, pour chacun, la béatitude consiste dans la condition qu'il préfère à toutes les autres. Ainsi, tu as en quelque sorte sous les yeux, les diverses formes de la félicité humaine, c'est-à-dire la richesse, les honneurs, la puissance, la gloire et la volupté, u C'est pour s'être arrêté à ces seuls points de vue, qu'Epicure, très conséquent d'ailleurs avec lui-même, a mis le souverain bien dans la volupté, parce qu'en effet tous ces avantages semblent n'avoir pour objet que de procurer des jouissances à l'âme. Pour en revenir aux préoccupations de l'homme, tout obscurcis que soient ses souvenirs, il veut pourtant rentrer dans le souverain bonheur ; mais comme un passant aviné, il ne reconnaît plus le chemin de sa maison. Et par le fait, crois-tu qu'ils soient dans l'erreur, ceux qui travaillent à ne manquer de rien? Assurément la meilleure condition pour jouir de la béatitude serait un état où l'on posséderait tous les biens en abondance, où l'on ne manquerait de rien, où, par conséquent, on se suffirait à soi-même. Se trompent-ils encore ceux qui considèrent ce qui est excellent comme l'objet le plus digne de vénération et de respect? Non, sans doute. Car ce ne peut être une chose vile et méprisable que ce souverain bonheur auquel presque tous les mortels s'efforcent d'atteindre. Est-ce qu'au nombre des biens il ne faut pas compter la puissance? Quoi donc! la faiblesse et l'impuissance seraient-elles le partage de ce qui prime incontestablement toutes choses? Ne faut-il faire nulle estime de la gloire? Mais ces deux qualités sont inséparables : ce qui est excellent est nécessairement aussi très glorieux. Après cela, que la béatitude soit exempte de soucis, de tristesse, de peines et d'afflictions, à quoi bon le dire, puisque dans les choses mêmes les moins importantes, ce que nous voulons, c'est le plaisir de les posséder et d'en jouir? Or ce sont là les avantages que les hommes veulent s'assurer; et s'ils désirent les richesses, les honneurs, la domination, la gloire et les plaisirs, c'est qu'ils croient se procurer par là la satisfaction de leurs besoins, la considération, la puissance, la célébrité et la joie. C'est le bonheur évidemment que les hommes recherchent par des voies si différentes; en quoi se manifeste clairement l'énergie invincible de la nature, puisque, si diverses, si contradictoires que soient leurs idées, ils s'accordent néanmoins à poursuivre un même but : le bonheur. IV
Je veux te chanter, puissante nature !
Le lion punique, indolent esclave,
Mais qu'un sang vermeil, enivrant breuvage,
Il brise sa chaîne, il bondit, il vole,
L'oiseau babillard, au fond du bocage,
En vain d'un geôlier
la main caressante
Mais qu'en sautillant derrière
ses grilles
Graines et fruits d'or, de dépit
il souille,
L'ormeau terrassé
sous un bras robuste
Aux mers du couchant, sous l'ardente nue,
Son char éclatant revient tous les jours. V« Et vous aussi, mortels dégénérés, vous conservez, bien faible il est vrai et pareil à un rêve, le souvenir de votre origine ; et votre pensée, si peu clairvoyante qu'elle soit, entrevoit confusément la béatitude, cette véritable Gn de l'homme; de là vient que tout à la fois un instinct naturel vous guide vers le souverain bien, et que nombre d'erreurs vous en écartent. Examine, en effet, si les moyens par lesquels les hommes se flattent d'arriver à la béatitude sont capables de les conduire au but. Si l'argent, les honneurs et le reste peuvent procurer un bonheur qui ne laisse rien à désirer, je l'avouerai moi-même, il est des hommes que la possession de ces biens peut rendre heureux. Mais si ces avantages ne peuvent tenir ce qu'ils promettent, s'il y manque plusieurs conditions essentielles, n'est-il pas évident qu'ils ne présentent qu'une fausse image de la béatitude? Je le demande à toi tout le premier, à toi qui naguère regorgeais de richesses. Au milieu de tous ces trésors, est-ce que ton âme n'a jamais été troublée par le ressentiment de quelque injure? — Certes, ré-pondis-je, je n'ai jamais joui d'une telle sérénité que j'aie été un seul jour exempt de tout chagrin ; du moins, je ne m'en souviens pas. — Ta peine ne venait-elle pas de l'absence de quelque chose que tu aurais voulu voir près de toi, ou de la présence de quelque autre chose dont tu eusses voulu être débarrassé? — C’est cela, dis-je. — Donc tu désirais la présence de l'une de ces choses et l'absence de l'autre. — J'en conviens. — Mais, reprit-elle, un désir, c'est un besoin. — Assurément, répondis-je. — Et l'homme qui éprouve un besoin, se suffit-il de tout point à lui-même? — En aucune façon. — Tu reconnais donc que tu n'avais pas ta suffisance au milieu de cet encombrement de trésors? — Pourquoi le nierais-je? répondis-je. — Donc la richesse ne peut faire qu'un homme n'ait besoin de rien et te suffise à lui-même; c'est pourtant ce qu'elle paraissait promettre. Une autre considération très importante, à mon avis, c'est que l'argent n'a pas cette vertu de ne pouvoir être enlevé de force à ceux qui le possèdent. — Je l'avoue, dis-je. — Et comment ne l'avouerais-tu pas, lorsque chaque jour le plus fort dépouille le plus faible, sans que celui-ci puisse l'empêcher? D'où naissent les procès, sinon des répétitions exercées par ceux qui ont été, en dépit de leur volonté, spoliés de leur argent, ou par force ou par ruse? — C'est vrai, répondis-je. — Chacun aura donc besoin, reprit-elle, d'une protection empruntée au dehors, qui lui assure la possession de son argent? — Qui peut le nier? dis-je. — Or, on n'aurait pas besoin de cette protection, si l'on ne possédait pas d'argent que l'on pût perdre. — Cela est hors de doute. — Donc les choses sont interverties, puisque le riche, que l'on supposait être en état de se suffire à lui-même, a besoin au contraire de l'assistance d'autrui. Et par quel expédient affranchira-t-on la richesse de tout besoin? Est-ce que les riches ne peuvent avoir faim? Est-ce qu'ils ne peuvent avoir soif? Est-ce que les membres des gens à écus sont insensibles au froid de l'hiver? Mais ils possèdent, diras-tu, le moyen d'apaiser leur faim, de repousser la soif et le froid. Soit; la richesse en ce cas rendra le besoin plus supportable, mais elle ne le supprimera pas tout à fait. En effet, si le besoin, gouffre toujours béant, et qui demande toujours, est assouvi par la richesse, encore faut-il que l'on éprouve toujours quelque besoin que l'on puisse assouvir. Je n'ajouterai pas que la nature se contente d'un rien et que l'avarice n'a jamais assez. C'est pourquoi, si la richesse ne peut supprimer les besoins, si elle en crée même de son fait, comment croire qu'elle puisse procurer la suffisance? V
Pourquoi donc, avare stupide, VII« Mais les dignités donnent à qui elles échoient de la considération et de l'honneur. Quoi donc! est-ce que les magistratures ont la propriété de faire pousser les vertus dans l'âme de ceux qui en sont revêtus, et d'en extirper les vices? Non, certes; d'ordinaire, elles ne suppriment pas, elles mettent plutôt en lumière la corruption des mœurs, d'où vient que nous nous indignons de les voir si souvent aux mains des scélérats ; et c'est pourquoi Catulle, sans égard pour la chaise curule où siégeait Nonius, donne à ce personnage le nom de Scrofule.[1] Ne vois-tu pas combien les dignités ajoutent à l'ignominie des méchants? Leur infamie, en effet, frapperait moins les veux, si les honneurs ne la produisaient pas au grand jour. Et toi-même, est-ce que les dangers de toute sorte auxquels tu t'exposais ont jamais pu t'obliger à considérer comme ton collègue un Décoratus,[2] en qui tu avais reconnu l'âme d'un misérable bouffon et d'un délateur? Nous ne pouvons, en effet, juger dignes de respect, à cause de leurs honneurs, des hommes que nous jugeons indignes de ces honneurs mêmes. Lorsqu'au contraire tu remarques un homme recommandable par sa sagesse, est-ce que tu peux nier qu'il soit digne de respect, digne même de la sagesse qui est en lui? Nullement. La vertu, en effet, possède une dignité qui lui est propre, et qu'elle communique sur-le-champ à ses fidèles. Or, comme les honneurs que confère le peuple n'ont pas cette propriété, il est clair que par eux-mêmes ils sont dépourvus de dignité et d'éclat. A ce propos, il y a une remarque encore plus importante à faire : c'est que, si un homme est d'autant plus abject qu'il est méprisé par plus de gens, les dignités, dès lors qu'elles ne rendent pas respectables ceux qu'elles exposent à plus de regards, ne font qu'aggraver l'opprobre des méchants. Mais ce n'est pas sans en pâtir elles-mêmes ; car les méchants rendent la pareille aux dignités, en leur communiquant la contagion de leur infamie. Maintenant, pour te convaincre que la véritable considération n'a rien de commun avec ces vains honneurs, je suppose qu'un personnage, plusieurs fois honoré du consulat, soit conduit par le hasard chez des nations barbares; les charges qu'il a exercées lui vaudront-elles le respect de ces barbares? Or, si c'était là un effet naturel des dignités, cet effet se produirait constamment sur tous les points de la terre : de même que le feu, partout et toujours, conserve sa chaleur. Mais, comme cette vertu ne leur est pas propre, et qu'elles ne la tiennent que de l'opinion erronée des hommes, elles s'évanouissent aussitôt qu'elles se montrent à des gens qui ne les considèrent pas comme des honneurs. Voilà pour les peuples étrangers ; mais chez les nations même où on les a vues s'établir, est-ce qu'elles durent toujours? La préture, magistrature autrefois si puissante, n'est plus aujourd'hui qu'un vain nom,[3] et un fardeau ruineux pour qui a le cens de sénateur. Celui qui pourvoyait à l'approvisionnement du peuple, fut longtemps regardé comme un personnage considérable;[4] qu'y a-t-il aujourd'hui de plus abject que cette charge? C'est que, comme je l'ai déjà dit, ce qui n'a par soi-même aucun éclat, tantôt brille et tantôt s'éclipse au gré de l'opinion. Donc, si les dignités ne donnent pas la considération, si plutôt elles se salissent au contact des méchants, si les révolutions des temps peuvent leur ôter leur splendeur, et l'opinion des peuples leur prix, comment croire qu'elles possèdent par elles-mêmes quelque beauté qui vaille un désir, et, à plus forte raison, qu'elles puissent en communiquer aux hommes? VIII
Fier d'étaler
aux yeux un luxe éblouissant, IX« La royauté du moins et la faveur des rois peuvent-elles donner la puissance? —Je ne dis pas non, quand leur bonheur dure jusqu'à la fin de leur vie; mais l'antiquité et notre siècle même fournissent cent exemples de rois dont la félicité s'est changée en catastrophes. O la rare puissance qui n'est pas assez puissante pour se conserver elle-même! « Que si l'autorité royale donne le bonheur, ne faut-il pas admettre que, dès qu'elle s'affaiblit, ce bonheur diminue, et que l'infortune commence? Mais si loin que s'étende la domination de chaque roi, la plus grande partie des nations se trouve nécessairement en dehors de son empire. Or, là où s'arrête la puissance qui donne le bonheur, se glisse l'impuissance qui fait le malheur : par conséquent, dans la part faite aux rois, c'est fatalement la misère qui domine. Un tyran qui avait fait l'épreuve des dangers de sa condition, représentait les terreurs de la royauté par l'image effrayante d'un glaive suspendu au-dessus de sa tête. Qu'est-ce donc qu'un pouvoir qui ne peut se soustraire aux morsures des soucis, ni éviter les dards acérés de la crainte? Certes, les rois eux-mêmes voudraient vivre sans inquiétude, mais ils ne le peuvent pas; et ils sont fiers de leur pouvoir! Le crois-tu puissant l'homme qui veut au delà de ce qu'il peut; qui ne marche qu'entouré de satellites; qui craint plus encore qu'il n'effraye;[5] l'homme enfin dont le pouvoir ne se manifeste qu'autant que ses serviteurs le veulent bien? « A quoi bon m'étendre sur les favoris des rois, après avoir démontré que la royauté elle-même est si pleine de faiblesse? Le maître, dans la prospérité, ne les épargne pas toujours, et souvent ils sont entraînes dans sa chute. Néron ne laissa à Sénèque, son familier et son précepteur, que le choix de son supplice. Papinien, après de longues années de crédit à la cour, fut livré par Antonin au glaive des soldats. Encore, tous deux avaient-ils voulu renoncer à leur puissance. Sénèque même avait insisté auprès de Néron pour se retirer en lui abandonnant ses richesses.[6] Mais le fardeau qu'ils portaient devait les écraser, et ni l'un ni l'autre ne put faire ce qu'il voulait. Quelle est donc cette puissance que redoutent ceux qui la possèdent, qui ne garantit pas du péril ceux qui la recherchent, et qu'on ne peut fuir quand on veut s'en défaire? Trouverez-vous du moins quelque assistance auprès de ces amis que donne, non pas le mérite, mais la fortune? Non. L'homme que votre bonheur a fait votre ami, votre malheur vous le rendra hostile. Or, est-il un fléau plus redoutable qu'un ennemi qu'on loge dans sa maison? X
Savoir se vaincre et maîtriser
son âme,[7]
XI« Et la gloire ! que souvent elle est mensongère et honteuse! De là cette exclamation si bien fondée du poète tragique:[8]
Combien de vils mortels, ô
courtisane ! ô Gloire !
Nombre de misérables, en effet, ont arraché un grand nom à l'engouement aveugle du vulgaire; peut-on rien imaginer de plus honteux? Des éloges accordés à faux, doivent faire rougir ceux qui les reçoivent. S'ils sont la récompense du mérite, que peuvent-ils ajouter à l'opinion que le sage a de lui-même? Ce n'est pas, en effet, sur l'approbation du vulgaire qu'il fonde son bonheur, mais sur le témoignage sincère de sa conscience. Que si l'on trouve beau de propager sa renommée, pour être conséquent il faut reconnaître qu'il est honteux de ne pas l'étendre. Mais comme, ainsi que je l'ai déjà remarqué, il n'est pas possible que le nom d'un homme ne soit pas ignoré du plus grand nombre des nations, il suit de là que la gloire que tu décernes à un individu lui fait défaut dans la plus grande partie de la terre. Au surplus, je n'accorde pas la moindre attention à la faveur du vulgaire, laquelle d'ordinaire n'est ni judicieuse ni constante. « Qui ne voit aussi combien est vide, combien est frivole ce qu'on appelle la noblesse? La rapportez-vous à l'illustration du nom? Elle est le fait d'autrui. Qu'est-ce, en effet, que la noblesse, sinon une distinction qui a sa source dans les belles actions des ancêtres? D'autre part, si l'illustration s'acquiert par la louange, ceux-là seuls sont illustres dont on fait l'éloge. Conséquemment, à défaut d'illustration qui te soit propre, ce n'est pas celle d'autrui qui t'en donnera. Pour finir, s'il y a quelque chose de bon dans la noblesse, à mon avis, c'est uniquement l'obligation qu'elle devrait imposer aux nobles de ne pas dégénérer de la vertu de leurs ancêtres. XII
Enfants de l'empyrée
exilés
sur la terre,
A la terre il donna les hommes ; les étoiles
Si de tous les mortels le ciel est la patrie, XIII« Que dirai-je des plaisirs des sens, dont la poursuite est toujours accompagnée d'inquiétude et la satiété de remords? De cruelles maladies, des souffrances intolérables, tristes fruits du libertinage, voilà tout ce qu'ils rapportent aux malheureux qui s'y livrent. Au fond, quelle sorte d'agrément peut-on y trouver? je l'ignore. Mais que les voluptés aient toujours une fin déplorable, c'est ce dont chacun peut se convaincre en se rappelant ses excès. Que si les hommes peuvent être heureux par la volupté, il n'y a pas de raison pour dénier le même bonheur aux brutes,[9] dont l'instinct vise uniquement à l'assouvissement des appétits sensuels. Les joies du mariage et de la paternité seraient assurément dignes d'un honnête homme ; malheureusement, on l'a dit avec trop de vérité, certain personnage a trouvé des bourreaux dans ses fils.[10] Je n'ai pas besoin de te dire tous les soucis que donnent les enfants dans toutes les conditions possibles; tu l'as éprouvé naguère; tu en souffres encore aujourd'hui. En cela, je pense avec mon Euripide :[11] Qu’un homme privé d’enfants trouve son bonheur dans son infortune. XIV
Toute volupté meurtrit XV« Il est donc hors de doute que ces divers chemins, loin de se diriger vers la béatitude, s’en écartent,[12] et qu’ils ne peuvent conduire au but qu’en les suivant on se flattait d’atteindre. Et encore, que d’épines! que de mauvais pas! Je vais te le prouver en peu de mots. Voyons travailleras-tu à amasser des trésors? tu en dépouilleras ceux qui les possèdent. Ambitionneras-tu l’éclat des dignités? il te faudra supplier ceux qui en disposent, et toi qui vises à éclipser les autres, tu devras t’humilier et t’avilir par la prière. Désires-tu la puissance? Exposé aux embûches de tes sujets, tu vivras au milieu des périls. Cours-tu après la gloire? La route est rude, difficile; mille terreurs t'y suivent. Tu passes ta vie dans les plaisirs? Mais quel dédain, quel mépris n'a-t-on pas pour l'esclave de ce qu'il y a de plus vil et de plus fragile au monde, le corps? Et ceux qui se prévalent des avantages du corps, combien est faible, combien est précaire la supériorité qui les rend si confiants! Surpasserez-vous jamais les éléphants en grosseur, les taureaux en force? Devancerez-vous les tigres à la course? Voyez l'étendue du ciel, sa solidité, la rapidité de ses évolutions, et cessez enfin de donner votre admiration à des choses qui la méritent si peu. Ce sont là pourtant les moindres merveilles du ciel ; ce qu'il faut surtout admirer, c'est l'intelligence qui le gouverne. Quant à l'éclat de la beauté, comme il passe vite ! comme il dure peu ! moins éphémères sont les fleurs du printemps. Si les hommes, comme dit Aristote,[13] avaient les yeux de Lyncée, et que leurs regards pussent percer tous les obstacles, est-ce qu'à l'aspect des viscères qu'il renferme, le corps même d'Alcibiade, si charmant à la surface, ne semblerait pas d'une hideuse laideur? Ta beauté n'est donc qu'apparente ; ce n'est pas à la nature que tu la dois, mais à la faiblesse des yeux qui te regardent. Mais surfaites tant qu'il vous plaira les avantages du corps ; toujours est-il que cet objet de votre admiration peut en trois jours être détruit par le feu, si peu vif pourtant, de la fièvre. On peut conclure de tout cela que des choses incapables de donner ce qu'elles promettent, et qui ne résument pas en elles l'universalité des biens, ne peuvent, par aucune route certaine, nous conduire à la béatitude, ni nous la procurer par elles-mêmes. XVI
C'est l'ignorance, hélas ! mortels présomptueux,
Sur le sommet des monts qui de vous tend ses rets
Vous avez pénétré
les secrets de la mer ;
Sur quels bords luit la pourpre aux éclatants
reflets ;
Mais le souverain bien, ô mortels aveuglés,
Insensés
! Que le Ciel, ardent à
vous punir,
Puis, à
bout de courage, et ployant les genoux, XVII« Mais en voilà assez sur ce sujet. Si, grâce à mes leçons, tu es, en état de distinguer clairement sous son masque la fausse félicité, le moment est venu de te montrer la véritable.[15] — Je vois bien, dis-je, que les richesses ne peuvent mettre à l'abri du besoin, que la royauté ne donne pas la puissance, ni les dignités la considération, ni la gloire la célébrité, ni les voluptés le vrai plaisir. — Mais en vois-tu la raison? — Je crois l'entrevoir, comme on entrevoit le jour par une étroite ouverture; mais je voudrais en être plus assuré, l'apprenant de ta bouche. — Elle est très facile à comprendre : c'est que les hommes séparent par ignorance ce qui de soi est simple, indivisible, et substituent ainsi le mensonge à la vérité, l'imparfait au parfait. Penses-tu qu'un homme, à qui rien ne manquerait, ne posséderait qu'une puissance incomplète? — Non, certainement, répondis-je. — Tu as raison ; car si, parmi les choses qu'il possède, il en était une seule qui laissât à désirer, de ce côté, il aurait nécessairement besoin de l'assistance d'autrui. — Assurément, dis-je. — Donc, se suffire à soi-même et être puissant n'est qu'une seule et même chose. — Je le pense aussi. — Un semblable état te paraît-il à dédaigner? N'est-ce pas, au contraire, le plus digne de respect? — Il n'y a pas à cet égard de doute possible. — Eh bien ! à la faculté de se suffire à soi-même et à la puissance ajoutons la considération, et regardons ces trois qualités comme n'en faisant qu'une. — J'y consens, car il faut bien convenir de la vérité. — Quoi donc, reprit-elle, ce nouvel état te paraît-il voué au mépris, à l'obscurité, et non pas plutôt à la célébrité la plus éclatante? Remarque que si, comme tu en es convenu, il représente l'absence de tout besoin, la puissance suprême et la considération absolue, la célébrité, à laquelle il n'aurait pu atteindre, ne saurait lui manquer sans qu'il parût, par cela seul, méprisable à certains égards. — Je ne puis nier, dis-je, que la célébrité soit une des conditions d'un pareil état. — D'où je conclus que la célébrité ne diffère en rien des trois qualités dont il a été question. — La conclusion est juste. — Mais un état où l'on ne manquerait de rien, où l'on pourrait tout par ses propres forces, où l'on serait illustre et considéré, ne procurerait-il pas encore la joie la plus pure? — Je ne puis même imaginer d'où pourrait s'y glisser le moindre sujet de chagrin. — Il faut donc reconnaître qu'on y jouirait d'une joie parfaite; c'est une conséquence nécessaire de ce qui précède. Mais une autre conséquence tout aussi rigoureuse, c'est que la faculté de se suffire, la puissance, la renommée, la considération et le plaisir, si différents que soient ces noms, ne constituent qu'une seule et même chose. — On ne peut le nier, dis-je. — Donc, c'est la sottise des hommes qui divise ce qui est un et simple de sa nature ; et de là vient qu'en s'efforçant d'acquérir une partie d'un tout qui n'a pas de parties, ils n'obtiennent ni cette partie, puisqu'elle n'existe pas, ni le tout, puisqu'ils n'y visent point. — Comment cela? demandai-je. — Le voici, dit-elle. L'homme qui court après la richesse pour éviter la pauvreté, ne se met pas en peine de la puissance ; il se résigne au mépris et à l'obscurité ; il se prive même souvent des plaisirs les plus innocents, dans la crainte de perdre l'argent qu'il a entassé. Mauvais moyen ; il ne peut se dire affranchi de tout besoin l'homme qui se voit privé de toute action sur les autres, dévoré par l'inquiétude, accablé sous le mépris, enseveli dans l'obscurité. D'autre part, l'homme qui ne désire que la puissance, prodigue ses trésors, dédaigne les voluptés, et ne fait nul cas des honneurs et de la gloire que la puissance ne rehausse pas. Mais tu vois aussi à combien d'avantages il renonce. Il arrive, en effet, que souvent il manque du nécessaire ou que les soucis ne lui laissent aucun repos ; et comme il ne peut se soustraire à ces inconvénients, il perd ce qu'il désirait par-dessus tout, la puissance. La même observation s'applique aux honneurs, à la gloire, aux voluptés. Car ces biens divers ne formant qu'un tout indivisible, l'homme qui en poursuit quelqu'un à l'exclusion des autres, ne peut même atteindre le seul qu'il désire. — Mais quoi ! demandai-je, si quelqu'un voulait acquérir tous ces biens à la fois?... —. Celui-là viserait à la souveraine béatitude; mais la trouverait-il dans des choses qui, je l'ai démontré, sont incapables de donner ce qu'elles promettent? — Non, dis-je. — Ce n'est donc pas dans les choses qui, prises isolément, semblent renfermer tous les biens désirables, qu'il faut chercher la béatitude. — J'en conviens, répondis-je, et l'on ne peut rien dire de plus vrai. — Tu connais maintenant, reprit-elle, les dehors de la fausse félicité et ses causes. Tourne maintenant dans le sens opposé les yeux de ton esprit, et aussitôt, comme je te l'ai promis, tu découvriras le véritable bonheur. — Certes, répondis-je, un aveugle même l’apercevrait; tu me l'as montré tout à l'heure en me dévoilant les causes de la fausse félicité. Si je ne me trompe, en effet, le véritable et parfait bonheur est celui qui procure la suffisance de toutes choses, la puissance, la considération, la célébrité et la joie. Et la preuve que j'ai compris toute ta pensée, c'est que chacun de ces biens équivalant à tous, le bonheur qu'il peut réellement donner équivaut, je le reconnais sans hésiter, à la suprême béatitude. — O mon cher disciple ! que tu es heureux de penser ainsi, pourvu toutefois que tu ajoutes ceci.... — Quoi? demandai-je. — Crois-tu que les biens périssables de ce bas-monde puissent procurer un état de ce genre? — Je ne le pense pas, répondis-je, et tu as assez bien démontré le contraire pour que toute nouvelle preuve soit superflue. — Ces avantages ne donnent donc à l'homme que les apparences du vrai bonheur, ou tout au plus certains biens toujours imparfaits, mais ils ne peuvent lui procurer la véritable et parfaite félicité. — J'en conviens, dis-je. — Eh bien ! puisque à présent tu sais distinguer le vrai bonheur de celui qui n'en a que l'apparence, il te reste à apprendre à quelle source tu peux puiser ce vrai bonheur. — C'est précisément là, dis-je, ce que depuis longtemps je désire si vivement savoir. — En ce cas, si, comme le veut mon cher Platon dans son Timée, il faut, même dans les circonstances les moins importantes, implorer l'assistance divine,[16] que devons-nous faire, à ton avis, pour nous rendre dignes de découvrir la source de ce véritable bonheur? — Il faut, répondis-je, invoquer le père de toutes choses; c'est un devoir de rigueur au début de toute entreprise. — C'est bien penser, » dit-elle, et aussitôt elle chanta de la sorte : XVIII
Père,
nous adorons ta sagesse profonde![17]
XIX« Puis donc que tu sais distinguer le bonheur parfait d'avec le bonheur imparfait, il ne s'agit plus, je pense, que de te montrer où réside cette perfection du bonheur. Mais, avant tout, il faut rechercher si quelque bien, semblable à celui que tu as défini tout à l'heure, peut exister dans la nature; autrement nous pourrions prendre pour la vérité quelque chimère de notre imagination. Mais on ne peut nier qu'un bien de cette espèce existe et qu'il soit comme la source d'où découlent tous les autres. En effet, tout ce que l'on dit être imparfait n'est jugé tel que relativement à la perfection qui y manque. D'où il suit que si, en quelque genre que ce soit, un objet paraît imparfait, il faut nécessairement qu'il y ait un objet parfait dans le même genre. Et en effet, si l'on n'admet pas l'idée de perfection, d'où viendrait l'idée d'imperfection? c'est ce qu'on ne peut môme imaginer. Il est clair encore que la nature ne commence pas par créer des êtres incomplets et inachevés; elle débute par des ouvrages parfaits, irréprochables; et pour produire des ébauches, il faut qu'elle soit vieillie et épuisée. Donc, si, comme je l'ai prouvé il n'y a qu'un instant, il existe un certain bonheur fragile et imparfait, on ne peut douter qu'il n'y en ait un parfait et solide. — La conclusion, dis-je, est rigoureuse et inattaquable. — Voyons maintenant où réside cette parfaite félicité. Que Dieu, le premier de tous les êtres, soit bon, c'est ce qu'atteste l'assentiment unanime des hommes. En effet, si l'on ne peut rien imaginer de meilleur que Dieu, peut-on douter que ce qui est meilleur que tout le reste, ne soit bon par soi-même? Mais de plus, la raison démontre, et cela d'une manière invincible, que la bonté de Dieu est de telle sorte qu'elle est identique au bien absolu. Car, s'il en était autrement, Dieu ne serait pas le premier de tous les êtres ; il y aurait en effet au-dessus de lui un être en possession du bien absolu, antérieur à lui par conséquent, puisqu'il est clair que les êtres parfaits ont précédé ceux qui ne le sont point. C'est pourquoi, pour ne pas argumenter à perte de vue, il faut reconnaître que le Dieu souverain résume en lui la plénitude et la perfection du bien. Mais nous avons établi que le souverain bien n'est autre chose que la vraie béatitude. Il faut donc reconnaître aussi que la vraie béatitude réside dans le Dieu suprême. — J'admets cela, dis-je; il est absolument impossible d'y contredire. — Vois maintenant, je te prie, à quelle sainte et irréfutable conclusion tu arrives, en admettant avec moi que le Dieu souverain résume en lui le souverain bien. — Comment donc? répondis-je. — Garde-toi bien de supposer, ou que le créateur de toutes choses a reçu du dehors le souverain bien, qu'il résume manifestement en lui, ou qu'il le possède virtuellement, mais de telle sorte que Dieu et la béatitude, c'est-à-dire le possesseur et la chose possédée, forment deux substances distinctes. En effet, si, dans ton opinion, Dieu avait reçu ce don du dehors, tu aurais le droit de conclure la supériorité de celui qui donne sur celui qui reçoit. Or, nous reconnaissons, comme nous le devons, que Dieu est placé infiniment au-dessus de tout ce qui existe. Que si ce bien suprême se trouve virtuellement en lui, mais à l'état de substance distincte, le Dieu dont nous parlons étant le créateur de toutes choses, quel serait l'auteur d'une combinaison si étrange? L'imagine qui pourra. Enfin, un objet différent d'un autre objet ne peut-être celui-là même dont on reconnaît qu'il diffère. Donc ce qui, par essence, diffère du souverain bien, ne peut pas être le souverain bien ; or, on ne peut penser de la sorte à l'égard de Dieu, puisqu'il est constant qu'au-dessus de Dieu il n'y a rien. Aucune substance, en effet, ne peut être meilleure que son principe; c'est pourquoi l'on peut conclure avec toute certitude que l'être dont procèdent toutes choses est aussi, par essence, le souverain bien. — Parfaitement raisonné, dis-je. — Mais le souverain bien est la même chose que la béatitude; c'est un point accordé. — En effet, dis-je. — Donc, reprit-elle, il faut nécessairement reconnaître que Dieu est la béatitude même. — Je ne puis contester ni les prémisses ni la conséquence que tu en tires. — Voyons, dit-elle, si l'on ne pourrait prouver plus solidement encore la même proposition, par cet argument que deux souverains biens, qui différeraient l'un de l'autre, ne pourraient coexister. En effet, de deux biens différents, il est clair que l'un ne peut être la même chose que l'autre; donc tous deux sont incomplets, puisque chacun est dépourvu de ce qui constitue l'autre. Mais ce qui est incomplet ne possède pas l'absolu, c'est clair; donc des biens qui seraient absolus ne pourraient pas différer de nature. Or, nous avons admis que la béatitude et la divinité sont la même chose que le souverain bien; par conséquent, la suprême béatitude est la même chose que la suprême divinité. —On ne saurait, dis-je, arrivera une conclusion plus juste, plus solidement raisonnée, ni plus digne de Dieu. —J'irai plus loin, dit-elle, et je veux, à la façon des géomètres, tirer des démonstrations qui procèdent certaines conséquences qu'eux-mêmes nomment porismes,[24] et que j'ajouterai comme corollaires. Puisque c'est par l'acquisition de la béatitude que les hommes deviennent heureux, la béatitude étant la même chose que la divinité, il est évident que c'est l'acquisition de la divinité qui donne le bonheur. Mais par la même raison que la justice fait le juste et la sagesse le sage,[25] la divinité doit nécessairement transformer en dieux ceux qui l'ont acquise. Donc tout homme heureux est un dieu. Il n'existe à la vérité qu'un seul Dieu par essence; mais rien ne s'oppose à ce qu'il y en ait un grand nombre par participation. — Voilà, dis-je, une proposition brillante et merveilleuse, de quelque façon que tu la nommes, porisme ou corollaire. — J'en sais une autre, incomparablement plus belle, qui se rattache aux précédentes par la logique la plus rigoureuse. — Laquelle? demandai-je. — Comme en apparence la béatitude renferme plusieurs conditions distinctes, est-ce la réunion de ces conditions différentes qui donne un corps à la béatitude elle-même, ou, dans le nombre, s'en trouve-t-il une qui constitue exclusivement la substance de la béatitude, et à laquelle se rapportent toutes les autres? — Je souhaiterais, dis-je, que tu me fisses comprendre cela en entrant dans le détail des choses. — Ne regardons-nous pas, demanda-t-elle, la béatitude comme un bien? — Certes, répondis-je, et comme le bien par excellence. — Tu peux donner, dit-elle, cette qualification à tout, car la suffisance de toutes choses est considérée aussi comme le bien par excellence, et aussi la souveraine puissance, et la considération, et la volupté et la gloire. Mais quoi? le bien proprement dit, la suffisance, la puissance et le reste, tous ces avantages, dis-je, sont-ils comme des membres distincts de la béatitude, ou se rattachent-ils à elles comme à une souche commune? — Je vois bien le problème que tu proposes; mais ta solution, je voudrais la connaître. — Voici tout le secret, répondit-elle. Si tous ces avantages étaient des membres de la béatitude, ils seraient réciproquement différents les uns des autres. Tel est en effet le caractère distinctif des parties, que c'est de leur diversité même que résulte l'unité d'un corps. Or, j'ai prouvé qu'ils ne sont à eux tous qu'une seule et même chose. Ce ne sont donc pas des membres, car, dans cette hypothèse, la béatitude consisterait dans l'assemblage d'un seul membre; ce qui est absurde. — Cela, dis-je, n'est pas douteux, mais j'attends la fin. —Mais on sait que tout le reste se rapporte au bien proprement dit. En effet, si on désire la suffisance, c'est qu'on la regarde comme un bien; si la puissance, c'est qu'elle passe pour un bien encore. On peut en conjecturer autant de la considération, de l'illustration et du plaisir. Donc, tout désir a pour fin et pour cause unique le bien.[26] En effet, rien de ce qui, ni en réalité, ni en apparence, ne contient quelque bien, ne saurait exciter la convoitise. Et, au contraire, qu'une chose ne soit pas bonne de sa nature, pour peu qu'elle semble l'être, on la recherche comme si elle l'était en effet. D'où il résulte que c'est très justement qu'il faut considérer le bien comme la fin, le fond et la cause de toutes les convoitises. Or, l'objet en vue duquel on désire quelque chose est, au bout du compte, le but réel du désir. Par exemple, si, pour raison de santé, quelqu'un veut monter à cheval, ce n'est pas tant l'exercice de l'équitation qu'il désire, que l'effet salutaire qu'il en attend. Ainsi, comme c'est en vue du bien qu'on recherche tout le Teste, l'objet immédiat du désir en est moins le but réel que ne l'est le bien lui-même. Or, nous avons reconnu que les hommes ne désirent rien qu'en vue de la béatitude; donc la béatitude est l'unique objet de leur recherche. D'où il résulte très clairement que le bien proprement dit et la béatitude ne sont qu'une seule et même substance. — Je ne vois pas comment on pourrait penser différemment. — Mais j'ai prouvé aussi que Dieu et la véritable béatitude ne sont qu'une seule et même chose. — Cela est vrai, dis-je. — On peut donc conclure avec certitude que le souverain bien, à l'exclusion de tout le reste, est la substance même de Dieu. XX
Voici le but! venez, misérables
esclaves
L'or que roulent les eaux du Tage et de l'Hermus,
L'or gît
honteusement enfoui sous la terre : XXI— Je me range à ton avis, dis-je, car toutes tes démonstrations se tiennent par l'enchaînement le plus étroit. » Elle alors : « A quel prix estimerais-tu l'avantage de connaître la nature même du vrai bien? — A un prix infini, répondis-je, puisqu'en même temps j'aurais le bonheur de connaître Dieu, qui ne fait qu'un avec le vrai bien. — Eh bien! cette connaissance, je vais te la procurer par un raisonnement inattaquable, pourvu que tu m'accordes comme définitivement acquis les principes précédemment établis. — C'est chose convenue, dis-je. — N'ai-je pas prouvé, reprit-elle que les objets convoités par le vulgaire ne peuvent être des biens véritables et parfaits, par la raison qu'ils diffèrent les uns des autres? qu'en outre, comme ils se font mutuellement déf.iut, ils ne peuvent procurer une félicité entière et absolue? N'ai-je pas prouvé encore que le vrai bien n'existe qu'à une condition, c'est-à-dire si toutes ses variétés se confondent sous une seule forme et, dans un même effet, de sorte qu'il ne soit pas possible de séparer la suffisance de la puissance, de la considération, de la gloire et du plaisir, parce qu'eu effet, si tous ces avantages ne se réunissent pas en un seul, ils ne valent pas la peine qu'on les désire? — Tu as prouvé tout cela, dis-je, et à cet égard, il n'y a pas de doute possible. — Donc, des avantages distincts ne sont pas des biens; confondus, ils le deviennent; cela étant, ne faut-il pas, pour qu'ils deviennent des biens, qu'ils passent à l'état d'unité? — Il me semble ainsi, dis-je. — Mais, à ton avis, tout ce qui est bien demeure-1-il tel, ou non, lorsqu'un autre bien vient s'y joindre? —Il demeure tel, sans doute. — Il faut donc, par la même raison, m'accorder que l'unité et le souverain bien ne sont qu'une seule et même chose. Et en effet, il n'y a qu'une substance là où les effets sont naturellement les mêmes. — Je ne puis nier cela, dis-je. — Eh bien, reprit-elle, as-tu remarqué que tous les êtres persistent et conservent l'existence aussi longtemps qu'ils gardent leur unité, mais qu'ils périssent et se dissolvent aussitôt que leur unité cesse? — Comment cela? — Chez les êtres doués de vie, par exemple, lorsque le principe vivifiant et le corps ne font qu'un et restent unis, cela s'appelle un animal; mais lorsque l'unité est détruite par la séparation de l'un et de l'autre, il est clair que l'être périt lui-même et n'est plus un animal. Chez l'homme même, tant que ses membres restent unis et ne composent qu'un seul corps, la forme humaine se reconnaît ; mais dès que les diverses parties de son corps se disjoignent, se séparent, et rompent l'unité, il cesse d'être ce qu'il était. On pourrait ainsi passer en revue toute la création et se convaincre que chaque être conserve l'existence tant qu'il est un, et que dès qu'il cesse d'être un, il périt. — Si je regarde, dis-je, la plupart des êtres, je suis tout à fait de ton avis. — En connais-tu un seul, poursuivit-elle, qui, pour peu qu'il obéisse aux lois de sa nature, néglige le soin de sa conservation, et souhaite sa destruction et sa mort? — Si je considère les animaux qui possèdent, dans une certaine mesure, la faculté de vouloir et de ne pas vouloir, je n'en trouve aucun qui, sans y être contraint d'ailleurs, renonce à l'instinct qui l'attache à la vie, et coure de lui-même à sa destruction. Car tous les animaux veillent soigneusement à leur conservation, fuient la mort et tout ce qui peut leur nuire. Mais que puis-je t'accorder à l'égard des plantes, des arbres et des corps complètement inanimés? je n'en sais trop rien. — Tu ne peux avoir cependant aucun doute à ce sujet, lorsque tu vois les petits végétaux et les arbres naître dans les lieux qui leur conviennent, et où, autant que leur nature le comporte, ils sont le moins exposés à se dessécher et à mourir. Les uns, en effet, croissent dans les plaines, d'autres sur les montagnes; ceux-ci dans les marais; ceux-là s'attachent aux rochers; d'autres enfin prospèrent dans les sables arides ; tous, si la main de l'homme les dépaysait, se flétriraient. Mais la nature donne à chacun ce qui lui convient et veille à ce qu'il puisse vivre jusqu'au terme prescrit. N'admires-tu pas que tous se servent de leurs racines comme d'autant de bouches enfoncées dans la terre, pour pomper leurs aliments, et à travers la moelle transforment leur sève en bois et en écorce? N'admires-tu pas que les parties les plus tendres, comme la moelle, soient toujours cachées au centre de la tige, et recouvertes d'une solide enveloppe ligneuse, défendue elle-même contre les intempéries du ciel par une écorce qui semble être placée là pour supporter tout accident? Quel soin, d'ailleurs, ne prend pas la nature de multiplier les graines pour propager les espèces ! Ne sait-on pas que les plantes sont comme des machines organisées, non seulement pour durer pendant un laps de temps déterminé, mais pour durer sans fin en se reproduisant? Et toutes les choses que l'on croit dépourvues de sentiment ne recherchent-elles pas de la même manière ce qui leur est propre? Pourquoi la flamme monte-t-elle verticalement, emportée par sa légèreté? pourquoi la terre, entraînée par son poids, gravite-t-elle en sens contraire, sinon parce que ces directions et ces mouvements conviennent à leur nature? Et c'est tout simple : tout ce qui convient à un objet le conserve; tout ce qui lui est antipathique, le détruit. Les corps durs, comme les pierres, sont composés de molécules fortement adhérentes, résistantes, et difficiles à désunir. Les liquides, comme l'air et l'eau, se divisent, à la vérité, sans effort, mais les parties qu'on a séparées ne tardent pas à sa rejoindre. Pour ce qui est du feu, il est absolument indivisible. Et je ne parle pas ici des mouvements volontaires d'une âme ayant conscience de ce qu'elle fait, je parle seulement des opérations naturelles, comme celle qui produit la digestion des aliments sans que nous y songions, ou la respiration pendant le sommeil, sans que nous en ayons connaissance. Car chez les animaux eux-mêmes, l'attachement à la vie ne procède pas du principe volontaire de l'âme, mais bien d'un instinct purement naturel. Souvent, en effet, la volonté, obéissant à des motifs impérieux, embrasse la mort, bien que la mort répugne à la nature ; et, au contraire, l'œuvre qui seule peut assurer la perpétuité des espèces sujettes à la mort, l'œuvre de la génération, cet appétit constant de la nature, rencontre quelquefois un frein dans la volonté. Tant il est vrai que l'amour de soi provient, non d'un mouvement raisonné, mais d'un instinct naturel. La Providence, en effet, a doté ses créatures de la plus puissante cause de durée en leur donnant le désir instinctif de durer autant que leur nature le comporte; c'est pourquoi tu ne peux aucunement douter que tous les êtres qui existent ne tendent instinctivement à conserver l'existence et à éviter ce qui peut leur nuire. — J'avoue, dis-je, que je vois maintenant avec certitude une vérité qui longtemps m'avait paru douteuse. — Mais, reprit-elle, un être qui aspire à la durée de son existence, aspire aussi à l'unité de ses parties, car, cette unité détruite, il ne survivrait pas un moment. — C'est vrai, dis-je. — Donc, tous les êtres aspirent à l'unité. — C'est accordé. — Mais j'ai prouvé que l'unité est identique au souverain bien. — J'en conviens. — Donc, tous les êtres aspirent au souverain bien, qu'on peut dès lors définir ainsi : le souverain bien n'est autre chose que ce que désirent tous les êtres. — Il est impossible, répondis-je, d'imaginer rien de plus vrai. En effet, ou tous les êtres ne tendent à rien, et, privés de l'unité, qui est pour ainsi dire leur tête, ils flotteront au hasard et sans guide; ou, s'il y a réellement un but vers lequel ils se précipitent à l'envi, ce but ne peut être que le bien suprême. » Elle alors : « O mon élève ! tu me rends trop heureuse ! Ta pensée a touché la vérité comme un trait bien dirigé touche le milieu de la cible ; mais, en même temps, tu as vu clairement ce que tout à l'heure tu disais ignorer. — Et quoi donc? demandai-je. — Ce qu'est la fin réelle de toutes choses, répondit-elle : c'est, en effet, ce qui est désiré par tous les êtres ; et comme nous avons conclu que l'objet de leurs désirs est le souverain bien, il faut nécessairement convenir que la fin de tous les êtres est le souverain bien. XXII
Si, pour la vérité
d'un saint amour épris,
Apprends à
ton esprit que tous ces vains trésors
Complice de l'oubli, le corps, grossier fardeau,
J'interroge un enfant : son savoir me confond.[28] XXIII— Je suis complètement de l'avis de Platon, dis-je, car tu me fais souvenir de choses que j'avais par deux fois oubliées : d'abord, quand ma mémoire s'est altérée au contact de ce corps terrestre; puis, quand je l'ai tout à fait perdue, succombant moi-même au poids de mes chagrins. — Eh bien, reprit-elle, si tu réfléchis aux propositions que tu viens de m'accorder, tu ne tarderas pas à te rappeler une chose que, de ton aveu, depuis bien longtemps tu ne sais plus. — Qu'est-ce donc? demandai-je. — Je veux parler des ressorts qui font mouvoir ce monde. — Je me souviens, répondis-je, que j'ai confessé mon ignorance à cet égard ; mais bien que je soupçonne déjà ce que tu vas dire, je désire l'entendre plus explicitement de ta bouche. — Il n'y a qu'un instant, reprit-elle, tu ne faisais nul doute que le inonde fût gouverné par" la Providence. — A présent encore, répondis-je, je n'en doute pas, et je n'en douterai jamais ; et les motifs de ma conviction je vais les exposer en quelques mots. Ce monde, formé d'éléments si divers et si antipathiques les uns aux autres, ne se serait jamais constitué en un seul corps, si une intelligence unique n'avait pris soin de réunir ces forces opposées ; et cette union même, combattue par tant de causes réciproquement contraires et hostiles, ne tarderait pas à se rompre et à se dissoudre, si la même intelligence qui l'a formée ne prenait à tâche de la maintenir. La nature ne procéderait pas avec un ordre aussi constant, ses mouvements de seraient pas aussi réguliers en ce qui touche les climats, les saisons, les effets à produire, leur durée et leurs modes, s'il n'y avait quelqu'un qui, immuable lui-même au milieu de ces changements continuels, fait mouvoir tout ce qui existe. Or, quel que soit cet être à qui la création doit la durée et le mouvement, je lui donne le nom qu'ont adopté tous les peuples : je le nomme Dieu. — Puisque tel est ton sentiment, reprit-elle, il me semble qu'il te reste peu de chose à faire pour conquérir la suprême félicité, et retourner sain et sauf dans ta patrie : mais revenons à notre propos. Dans la béatitude, n'avons-nous pas compris la suffisance, et ne sommes-nous pas tombés d'accord que la béatitude est la même chose que Dieu? — C'est vrai. — Donc, pour gouverner le monde, Dieu n'a besoin d'aucun secours étranger; car, s'il en avait besoin, il ne se suffirait pas pleinement à lui-même. — La conséquence est nécessaire, dis-je. — Il dirige donc tout par lui seul. — On ne peut le nier. — Or, il a été démontré que Dieu n'est autre chose que le bien. — Je ne l'ai pas oublié. — C'est donc par le bien qu'il dirige tout, puisqu'il dirige tout par lui-même, et que nous avons reconnu qu'il est lui-même le bien ; il est comme le timon et le gouvernail qui préserve la machine du monde de tout ébranlement et de toute cause de destruction. — Je suis complètement de ton avis, répondis-je, et tout à l'heure, sans en avoir la certitude, je prévoyais que c'était là que tu voulais en venir. — Je te crois, reprit-elle, car je trouve tes yeux déjà plus prompts à discerner la vérité; mais ce que je vais ajouter te la fera voir avec moi tout aussi clairement. — Qu'est-ce donc? demandai-je. — Dieu, dit-elle, ainsi que nous avons raison de le croire, se servant du bien comme d'un gouvernail pour diriger toutes choses, et toutes choses, comme je te l'ai enseigné, tendant naturellement au bien, peut-on douter qu'elles ne se laissent volontairement gouverner, et qu'elles n'obéissent spontanément aux lois de celui qui les dirige, puisqu'elles se trouvent avec lui en rapport étroit d'intention et de convenance? — Cela doit-être, répondis-je; autrement, ce serait là un malheureux régime ; car il s'y trouverait des rebelles à soumettre au lieu de sujets soumis à protéger. — Il n'y a donc rien qui puisse, sans manquer aux lois de sa nature, aller à l'encontre de Dieu? — Rien, répondis-je. — Si quelque créature l'essayait pourtant, penses-tu qu'elle obtiendrait quelque avantage sur celui à qui nous avons attribué à bon droit la pleine possession de la béatitude? —Non, dis-je, elle serait tout à fait impuissante. — Il n'y a donc rien qui veuille ou qui puisse résister à ce bien suprême. — Je ne le pense pas, dis-je. — Donc, reprit-elle, c'est le souverain bien qui conduit tout avec puissance et règle tout avec douceur. — L'ensemble de tes raisons, les conclusions que tu en as tirées, et surtout le langage dans lequel tu les exposes, me charment au point que je rougis des bruyants éclats auxquels s'est parfois emportée ma sottise. — Tu as appris dans la fable comment les Géants tentèrent l'assaut du ciel; cependant ils furent repoussés, comme il convenait, avec une vigueur toute divine. Mais veux-tu que nous mettions les arguments aux prises? Peut-être que de ce choc jaillira une vive étincelle de vérité. — Comme il te plaira, dis-je. — Que Dieu soit le maître de toutes choses, personne n'en peut douter. — Tout homme dans son bon sens, répondis-je, ne saurait faire là aucune difficulté. — Or, il n'est rien que ne puisse faire celui qui peut tout.[30] — Rien, dis-je. — Dieu peut-il donc faire le mal? — Non, assurément. — Alors le mal n'existe pas, puisque celui-là même ne peut pas le faire qui peut tout. — Est-ce pour te jouer de moi, m'é-criai-je, que tu embrouilles à plaisir cet inextricable labyrinthe de raisonnements où les mêmes portes te servent indifféremment pour entrer ou pour sortir? Pourquoi mettre la confusion dans une série de raisonnements admirable et d'une divine simplicité? Tout à l'heure, en effet, prenant la béatitude pour point de départ, tu l'assimilais au souverain bien et tu la faisais résider dans le Dieu suprême; puis, tu affirmais que Dieu est le souverain bien et la parfaite béatitude, et tu me gratifiais enfin de cette conclusion, qu'on ne peut devenir heureux sans devenir Dieu. Ensuite, tu as ajouté que la substance du bien est aussi celle de Dieu et de la béatitude, et tu as dit que cela seul est le bien qui est convoité par toute la nature; tu as soutenu encore que Dieu dirige le monde par le gouvernail de sa bonté, que tous les êtres lui obéissent volontairement, et que le mal n'existe pas naturellement; et toutes ces propositions, tu ne les as pas puisées en dehors de ton sujet, mais tu les as développées successivement en les prouvant les unes par les autres au moyen d'une série de démonstrations tirées de leur propre fonds et pour ainsi dire domestiques. » Elle alors : « Je ne me suis nullement jouée de toi ; avec l'aide de Dieu que j'ai invoqué en commençant, je suis venue à bout de la plus noble entreprise. C'est, en effet, une des propriétés de la substance divine, qu'elle ne sort pas d'elle-même et qu'elle n'y admet rien d'étranger; mais, selon la comparaison de Parménide, Figurant de tout point une sphère parfaite,[31] elle fait rouler le globe de ce mobile univers tout en restant elle-même immobile. Que si j'ai pris mes arguments, non pas en dehors, mais clans le cœur même de la question, tu n'as pas lieu de t'en étonner, puisque tu sais, sur la foi d# Platon, que nos discours doivent avoir une certaine parenté avec les sujets que nous traitons.[32] » XXIV
Heureux qui du bien suprême
Le jour qu'Eurydice expire,
Le cerf, du lion sauvage
Le poète
chante encore;
Dans sa navrante folie,
Là,
dans sa tristesse amère,
Il dit la mort d'Eurydice,
Cerbère
aux pieds du poète
Là,
sur la roue infernale,
Enfin : — « Ta douleur me touche,
« Mais je
t'impose une épreuve :
Vainement Pluton ordonne :
Méditez
bien cette histoire, [1] Scrofule ne se dit pas au singulier. Ici, pourtant, il était impossible d'employer le pluriel. Le lecteur, nous l'espérons, voudra bien nous pardonner un solécisme que nous n'aurions pu éviter qu'en recourant a une expression plus éloignée du texte. Voici l'épigramme de Catulle à laquelle Boèce fait allusion : Quid est, Catulle, quid moraris emori? Sella in curuli Struma Nonius sedet : Per consulatum pejerat Vatinius. Quid est, Catulle, quid moraris emori? « Pourquoi, Catulle, tardes-tu à mourir? Nonius Scrofule siège sur me chaise curule, et Vatinius se parjure par son consulat. Pourquoi, Catulle, tardes-tu a mourir? » (Epigr., lii.) Joseph Scaliger, dans son savant commentaire sur Catulle, reproche aigrement à Boèce l'inadvertance qu'il aurait commise en prenant pour un sobriquet de l'invention de Catulle un surnom général, cognomen, qui était commun à tous les membres d'une des branches de la famille des Nonius. Sitzmann réfute à son tour Scaliger. Nous n'entrerons pas dans cette discussion, qui serait ici sans objet. [2] On trouve dans le recueil épistolaire de Cassiodore une lettre de Théodoric a un certain Décoratus qualifié Adjutor Magistro Officiorum: Lieutenant du Maître des Offices. Ce personnage est probablement le notre. Nous n'avons d'ailleurs aucun renseignement sur le fait particulier auquel Boèce fait ici allusion. [3] Sous la République, et même longtemps après l'établissement de l'Empire, les préteurs exerçaient une juridiction importante, et possédaient des attributions très étendues. Mais peu à peu, leurs prérogatives furent si bien réduites, qu'il ne leur resta plus que celle de se ruiner pour donner des spectacles au peuple. Les chevaux du Cirque les dévoraient : Praeda caballorum Praetor, dit déjà Juvénal (Sat. XI, v. 193). Les choses en vinrent au point que personne ne voulait plus de cette onéreuse dignité, et qu'il fallut recourir aux mesures les plus tyranniques pour l'imposer aux sénateurs. Voici sur ce sujet un passage très instructif que nous empruntons à un livre excellent : « Bien qu'il n'y eût plus, comme dans l'ancienne République, d'intérêt de popularité à dépenser son patrimoine pour amuser la populace de Rome et briguer les dignités électives, les sénateurs, les clarissimi, continuèrent à être astreints à des prodigalités désormais inutiles pour eux. On leur imposa l'obligation d'accepter la dignité de préteur, et on multiplia même les prétures jusqu'à en avoir deux à Rome et trois à Constantinople. Il y eut la préture Flavinienne, la préture Constantinienne, et la préture triomphale. Le successeur de Constantin en devait même encore ajouter deux. C'étaient autant d'impôts détournés, car le préteur n'avait plus d'attributions, ni politiques, ni judiciaires, et chaque préteur avait son tarif de dépenses obligatoires dont le montant était destiné à entretenir les spectacles et les jeux publics de l'hippodrome. Aussi, cette coûteuse dignité de préteur devenait-elle l'épouvantail de tous les gens de condition. On quittait Rome ou Constantinople uniquement pour éviter d'attirer les regards du sénat et du prince, dont l'un désignait, et l'autre confirmait les préteurs. Il fallait poursuivre les clarissimi dans les provinces à grand renfort de police, comme des déserteurs. La fuite fut punie d'une forte amende; et en attendant, le trésor faisait, au compte des contumax, les avances des dépenses qui leur étaient imposées. Constantin avait tout prévu, même la mort des préteurs, et dans ce cas le fils dut succéder de droit a la dignité comme aux charges. » (A. DE Broglie, L'Eglise et l’Empire romain au IVe siècle.) [4] La charge de Préfet de l'annone, Praefectus annonae, était en effet très considérable sur le déclin de la République et dans les premiers temps de l'Empire. Pompée la remplit avec éclat, et c'est même à cette occasion, au rapport de Dion et de Plutarque, que le surnom de magnus lui fut décerné par le peuple. C'est sans doute par allusion à cette particularité historique que Boèce applique cette même épithète de magnus aux anciens préfets de l'annone. Auguste ne dédaigna pas d'exercer par lui-même cette magistrature, et il ne s'en démit que dans les dernières années de sa vie. Mais il en fut des attributions des préfets de l'annone comme de celles des préteurs; elles furent transférées, dans ce qu'elles avaient d'important, au Préfet du prétoire, et les titulaires devinrent de simples juges de police : leurs fonctions se réduisirent à la fixation du prix du pain et à la vérification des balances des boulangers. La formule d'institution de ces magistrats déchus se trouve dans le recueil de Cassiodore. (Var. vi, 18.) [5] Necesse est multos timeat quem multi timent. « C'est une nécessité qu'il craigne beaucoup de gens celui que beaucoup de gens craignent, (Laberius.) « Craint de tout l'univers, il vous faudra tout craindre. » (Racine, Britann., acte IV.) [6] Tacite nous a transmis (Annal, liv. XIV, ch. liii et liv) le discours plus ou moins authentique que Sénèque aurait adressé à Néron en cette circonstance, ainsi que la réponse du jeune empereur. [7] Imitation un peu prolixe de cette strophe d'Horace :
Latius regnes avidum domando « Dompte ta convoitise et tu étendras plus loin ton empire que si tu ajoutais à la Libye les rives lointaines de Gadès; que si l'une et l'autre Cartilage n'obéissaient qu'à toi seul. » (Odes, liv. II, ii.) [8] Euripide, dans Andromaque. [9] « Quant à la première place, tous les bœufs, tous les chevaux, et toutes les autres bêtes sans exception, ne la réclameront-elles point en faveur du plaisir, parce qu'elles s'attachent à sa poursuite? » (Platon, Philèbe, trad. de V. Cousin.) La même pensée se trouve dans Sénèque : « Adjice quod multa quae bona videri volunt, animalibus quam homini pleniora contingunt. Illa cibo avidius utuntur ; senere non aeque fatigantur.Virium illis major est et aequabilior firmitas. Sequitur ut multo feliciora sint homine. Nam sine nequitia, sine fraudibus degunt. Fruuntur voluptatibus, quas et magis capiunt, et ex facili, sine ullo pudoris aut pœnitentiae metu. » « Ajoute à cela que les animaux jouissent de la plupart de ces prétendus biens plus complètement que l'homme. Ils mangent avec plus de voracité ; les plaisirs de l'amour les fatiguent moins. Leur force est plus grande et mieux répartie ; d'où il suit qu'ils sont beaucoup plus heureux que l'homme. Ils vivent, en effet, exempts de malice et de crimes ; ils jouissent des plaisirs, qu'ils possèdent plus pleinement, avec plus de facilité, et sans avoir à craindre ni honte ni repentir. » (Lettre LXXIV à Lucilius.) [10] Les commentateurs s'accordent à voir ici une réminiscence de ce vers d'Evenus cité par Plutarque et Artémidore : 'Ιδὲ ὅση λύπη παῖς πατρὶ πάντα χρόνον. « Vois combien de chagrins un enfant cause en tout temps à son père. » Mais ce rapprochement ne donne aucune lumière sur le personnage auquel Boèce fait allusion. [11] La Philosophie peut, en effet, revendiquer Euripide pour un de ses disciples. On sait que ce poète avait suivi assidûment les leçons d'Anaxagore, qu'il avait répandu dans la plupart de ses pièces la doctrine de son maître, et qu'on peut lui reprocher, comme à Voltaire, d'avoir mis dans la bouche de ses personnages trop de sentences philosophiques. Il y mettait même la physique, car c'est à propos de quelques vers de sa tragédie d'Oreste, où le chœur analyse, d'après Anaxagore, les éléments constitutifs du soleil et de la lune, que Socrate, dans son apologie, se défendant de professer les mêmes doctrines, dit que le premier venu peut, pour une drachme, aller entendre ces belles choses au théâtre. Voici les vers de l'Andromaque dont Boèce donne une traduction abrégée :
…………………… Πᾶσι ἀνθώποις ἄρ' ἠν [12] Ceux de nos lecteurs qui voudront vérifier l'identité quelquefois parfaite des doctrines morales du Portique et de celles de l'Académie n'auront qu'à comparer ce chapitre avec la lettre LXXVI de Sénèque à Lucilius. Ils trouveront dans cette dernière pièce la plupart des pensées exprimées ici par Boèce, et souvent dans les mêmes termes. [13] On ne connaît pas l'ouvrage d'Aristote auquel Boèce a emprunté ce passage. [14] Perse a enfermé la même idée dans ce vers d'une admirable concision : Virtutem videant, intabescant que relicta. (Sat. III, v. 33.) [15] L'idée-mère de ce chapitre, c'est-à-dire la réduction à l'unité de tous les avantages que les hommes considèrent comme autant d'éléments distincts du bonheur, a été magnifiquement développée par Platon dans le Philèbe. L'argumentation entière de Boèce se retrouve dans ce beau dialogue, mais préparée par d'autres moyens et ordonnée sur un antre plan, ce qui rend tout rapprochement partiel à peu près impossible. [16] « Socrate. C'est à toi, Timée, de commencer, lorsque tu auras obéi à la loi en invoquant d'abord les dieux, comme cela est convenable. « Timée. Oui, Socrate, tout homme un peu raisonnable implore l'assistance divine ayant de commencer une entreprise quelle qu'elle soit, grande ou petite. A plus forte raison, nous qui avons entrepris d'expliquer l'univers. » (Trad. de V. Cousin.) [17] Ce morceau poétique n'est qu'un résumé rapide du système cosmogonique développé dans la première partie du Timée. La concision de Boèce dans cette pièce et dans plusieurs autres également rebelles à la poésie, a répandu sur les idées qu'il a entrepris de mettre en vers une obscurité qu'on ne se flatte pas d'avoir complètement dissipée dans la traduction, malgré le parti qu'il a bien fallu prendre de paraphraser certains passages. Ceux de nos lecteurs qui seraient curieux de se rendre un compte bien exact de la théorie de Platon, devront relire en entier l'admirable dialogue où elle est exposée. Une analyse, même très serrée, nous mènerait trop loin. Nous nous bornerons à rapprocher quelques passages où l'imitation est le plus directe. [18] « Disons la cause qui a porté le suprême ordonnateur à produire ou à composer cet univers. Il était bon, et celui qui est bon n'a aucune espèce d'envie. Exempt d'envie, il a voulu que toutes choses fussent, autant que possible, semblables à lui-même. Quiconque, instruit par des hommes sages, admettra ceci comme la raison principale de l'origine et de la formation du monde, sera dans le vrai. » (Platon, Timée, trad. de V. Cousin.) Sénèque avait retenu cette pensée, comme on le voit par ce passage de sa lettre LXV à Lucilius : « Quaeris quid sit propositum Deo? Bonitas. Ita certe Plato ait : quae Deo faciendi niundum causa fuit? Bonus est. Bono nulla cujusquam boni invidia est : fecit itaque quam optimum potuit. » « Tu demandes quel a été le motif déterminant de Dieu? Sa bonté. Platon dit formellement : Quelle raison a porté Dieu à créer le monde? Il est bon. Un être bon est incapable d'envie ; voilà pourquoi il a fait le monde le meilleur possible. » Nous ne pouvons résister au désir de citer ici les réflexions pleines de sens et empreintes d'un profond sentiment religieux que ce passage remarquable a inspirées à l'illustre traducteur de Platon : « Voilà des lignes bien simples et bien profondes et qui appartiennent en propre à Platon. Avant lui, l'idée la meilleure que l'esprit humain se fût encore formée de Dieu, était celle d'une intelligence, le Νοῦς d'Anaxagoras. Anaxagoras expliquait par le Νοῦς comment le monde a été formé tel qu'il est, ordonné et harmonique dans toutes ses parties. Platon explique pourquoi le monde a été ainsi formé, et il en donne la vraie raison, à savoir une intelligence douée de bonté, qui se complaît à se répandre hors d'elle-même, et à communiquer ses divins attributs. De là l'expression de père, que Platon donne en cet endroit à l'auteur de l'uni vers. « ................ Chez Aristote, ce caractère de bonté semble manquer à Dieu. Dans la Métaphysique (liv. XII), la bonté de Dieu est déduite de sa nécessité. Si le premier moteur immuable est nécessaire, il est bon ; ce qui ne veut pas dire qu'il possède l'attribut moral de la bonté, mais qu'il possède le bien, le bonheur parfait. Ainsi, tout bonheur vient de Dieu, qui en est le principe suprême ; mais Aristote ne dit pas que Dieu le répand lui-même par sa volonté. « Plus tard, au sein du christianisme, s'est élevée une autre doctrine, bien différente de celle de Platon, et qui a prétendu et prétend même encore être la seule doctrine chrétienne orthodoxe ; je veux parler de la doctrine d'Ockam, qui, à force de revendiquer la volonté divine, la sépare presque de l'intelligence et de la bonté, et fait créer le monde à Dieu tel qu'il est, uniquement parce qu'il lui a plu de le faire ainsi, par un acte entièrement arbitraire, sans regard à l'idée du juste et du bien. Mais c'est prétendre que Dieu a fait le monde par un acte de vouloir destitué de tout penser, ce qui est impossible, absurde, impie. Dieu n'est qu'en tant qu'il pense, et sa pensée éternelle, c'est l'idée même du bien, du juste, etc.; c'est avec sa pensée, avec ses idées, au sens platonicien, qu'il veut et qu'il agit; et, en agissant, il les imprime à ses œuvres. Le monde est donc empreint des idées, c'est-à-dire des pensées de Dieu. I^e monde réalise le plan divin, le plan que Dieu a suivi et voulu suivre en formant le monde, par cette grande et dernière raison, à savoir, que Dieu est bon. Ainsi, deux mille ans après Platon, nous pouvons dire encore : « Quiconque instruit par des hommes sages, admettra ceci comme la raison principale de l'origine et de la formation du monde, sera dans le vrai. » (V. Cousin, Rem. sur le Timée.) M. V. Cousin a-t-il qualifié trop sévèrement la sécheresse de cœur qu'il reproche à quelques-uns de nos théologiens? Qu'on en juge par le passage suivant du Platon expliqué du P. Hardouin : « Le vrai Dieu, qui est un agent sage et libre, a d'autres vues que l'effusion de sa bonté, ou plutôt de ses dons, dans la création de l'univers : Il a surtout sa gloire en vue. S'il comble les hommes de bienfaits en créant le monde pour eux, c'est pour en être adoré, aimé, servi. » (Op. var., p. 274.) Ainsi, à la bonté de Dieu est substitué le soin de sa gloire. Après avoir comparé ces lignes avec celles de Platon, n'est-on pas en droit de demander qui est le vrai chrétien, du théologien ou du philosophe? [19] « Si le monde est beau, et si celui qui l'a fait est excellent, il l'a fait évidemment d'après un modèle éternel.... Le monde a donc été formé d'après un modèle intelligible, raisonnable, et toujours le même ; d'où il suit, par une conséquence nécessaire, que le monde est une copie. » (Platon, Timée, trad. de V. Cousin.) [20] Nous ne pouvons transcrire ici la longue dissertation dans laquelle Platon cherche à établir la triple nature de l'âme humaine, ou, pour parler comme lui, l'existence de trois âmes humaines, auxquelles il assigne pour sièges trois parties différentes du corps : la tète, la poitrine et le ventre, selon leurs penchants, leurs aptitudes et leurs fonctions. De ces trois âmes, une seule, celle qui réside dans le cerveau, est immortelle ; les deux autres ne sont donc, à proprement parler, que des principes d'un ordre inférieur, dont l'activité ne survit pas au corps lui-même. Ce sera tout profit pour nos lecteurs que d'étudier cette singulière conception dans Platon lui-même. [21] Même observation pour ce passage, dont il faut lire les développements dans Platon. [22] On aurait pu dire, en serrant le texte de plus près : « Tu les mis sur des chars » (curribus aptans). On a reculé devant cette figure qui n'eût certainement pas été comprise du lecteur. Boèce l'a également empruntée à Platon, qui en fait un fréquent usage, comme le prouvent ces trois passages du Timée : « Il (Dieu) dit, et dans le même vase où il avait composé l’âme du monde, il mit les restes de ce premier mélange, et les mêla à peu près de la même manière.... Avant achevé le tout, Dieu le partagea en autant d'à mes qu'il y a d'astres, en donna une à chacun d'eux, et faisant monter les âmes comme dans un char, il leur fit voir la nature de l'univers et leur expliqua ses décrets irrévocables. » « Et comme il y a sur la terre toutes sortes d'éminences que la tête en roulant n'aurait pu franchir, et des cavités d'où elle n'aurait pu sortir, ils (les démons) lui donnèrent le corps comme un char pour la porter. » « Ces dieux, imitant l'exemple de leur père, et recevant de ses mains le principe immortel de l'âme humaine, façonnèrent ensuite le corps mortel qu'ils donnèrent à l'âme comme un char. » (Trad. de V. Cousin.) [23] « Celui qui passera honnêtement le temps qui lui a été donné à vivre retournera après sa mort vers l'astre qui lui est échu et partagera sa Félicité. » (Platon, Timée, trad. de V. Cousin.) [24] Πόρισμα, proposition déduite d'un théorème. [25] Ce raisonnement paraît emprunté au passage suivant du Gorgias : « Socrate. Celui qui a appris le métier de charpentier est-il charpentier ou non? — Gorgias. Il l'est. — So. Et quand on a appris la musique, n'est-on pas musicien? — Gor. Oui. — So. Et quand on a appris la médecine, n'est-on pas médecin? En un mot, par rapport i tous les autres arts, quand on a appris ce qui leur appartient, n'est-on pas tel que doit être l'élève de chacun de ces arts? — Gor. J'en conviens. — So. Ainsi, par la même raison, celui qui a appris ce qui appartient a la justice est juste. » (Platon, Gorgias, trad. de V. Cousin.) [26] « Socrate. Est-ce qu'il y aurait des hommes qui désirent les mauvaises choses, tandis que les autres désirent les bonnes î Ne te semble-t-il pas, mon cher, que tous désirent ce qui est bon? — Ménon. Nullement. — So. Mais, à ton avis, quelques-uns désirent ce qui est mauvais? — Mén. Oui. — So. Veux-tu dire qu'ils regardent alors le mauvais comme bon ; ou que, le connaissant pour mauvais, ils ne laissent pas de le désirer? — Mén. L'un et l'autre, ce me semble. —So. Quoi! Ménon, juges-tu qu'un homme connaissant le mal pour ce qu'il est, puisse se porter à le désirer? — Mén. Très fort. — So. Qu'appelles-tu désirer? Est-ce désirer que la chose lui arrive? — Mén. Qu'elle lui arrive, sans doute. — So. Mais cet homme s'imagine-t-il que le mal est avantageux pour celui qui l'éprouve, ou bien sait-il qu'il est nuisible à celui en qui il se rencontre? Mén. Il y en a qui s'imaginent que le mal est avantageux; et il y en a d'autres qui savent qu'il est nuisible. — So. Mais crois-tu que ceux qui s'imaginent que le mal est avantageux, le connaissent comme mal? — Mén. Pour cela, je ne le crois pas. — So. Il est évident, par conséquent, que ceux-là ne désirent pas le mal, qui ne le connaissent pas comme mal, mais qu'ils désirent ce qu'ils prennent pour un bien, et qui est réellement un mal ; de sorte que ceux qui ignorent qu'une chose est mauvaise, et qui la croient bonne, désirent manifestement le bien, n'est-ce pas? — Mén. Il y a toute apparence. » (Platon, Ménon, trad. de V. Cousin.) La même argumentation se retrouve plus longuement déduite dans le Gorgias. [27] Dans le système de Platon, l'oubli presque complet des connaissances acquises dans le cours d'une existence antérieure est le résultat inévitable de l'union de l'âme avec le corps. L'âme tend toujours à s'élancer vers les hautes régions dont elle est descendue ; mais le corps, dominé par ses appétits grossiers, la ramène brutalement aux choses de la terre. Ce n'est qu'après sa séparation d'avec ce compagnon incommode que l'âme peut prendre de nouveau son essor, et rentrer dans la possession de ses connaissances antérieures. Cette doctrine est développée avec une poétique éloquence dans la première partie du Philon. Toutefois, si pernicieuse que soit l'influence du corps, la tyrannie qu'il exerce sur l'âme n'est pas si absolue, que celle-ci, en s'isolant dans la contemplation d'elle-même, ne puisse retrouver par l'effet de sa propre énergie quelques-unes des vérités éternelles qu'elle a sues autrefois, et que les misères de sa condition présente lui ont fait oublier. C'est la possibilité de ce retour à la science originelle que Boèce a voulu exprimer, et cette idée encore, il l'a empruntée à Platon, comme on le verra ci-dessous par la note 86. [28] Allusion au célèbre épisode du Ménon où Socrate amène un jeune esclave intelligent, mais illettré, à résoudre de lui-même une série da théorèmes géométriques. Ce passage est trop étendu pour que nous puissions le transcrire ici. Nous ne pouvons qu'y renvoyer le lecteur. [29] Voici dans son entier le passage capital du Ménon auquel Boèce fait allusion ici, et dont nous avons déjà dit un mot dans la note 36 du Ier livre. « Ce sont des prêtres et des prêtresses qui se sont appliqués à pouvoir rendre raison des choses qui concernent leur ministère ; c'est Pindare, et beaucoup d'autres poètes, j'entends ceux qui sont divins. Pour ce qu'ils disent, le voici : examine si leurs discours te paraissent vrais. Ils disent que l'âme humaine est immortelle ; que tantôt elle s'éclipse, ce qu'ils appellent mourir ; tantôt elle reparait, mais qu'elle ne périt jamais ; que pour cette raison il faut mener la vie la plus sainte possible : « car les âmes qui ont payé à Proserpine la dette de leurs anciennes fautes, elle les rend au bout de neuf ans A la lumière du soleil. De ces c âmes sortent les rois illustres, célèbres par leur puissance, s Ainsi l'âme étant immortelle, étant d'ailleurs née plusieurs fois, et ayant vu ce qui se passe dans ce monde et dans l'autre et toutes choses, il n'est rien qu'elle n'ait appris. C'est pourquoi il n'est pas surprenant qu'à l'égard de la vertu et de tout le reste, elle soit en état de se ressouvenir de ce qu'elle a su antérieurement ; car comme tout se tient, et que l'âme a tout appris, rien n'empêche qu'en se rappelant une seule chose, ce que les hommes appellent apprendre, on ne trouve de soi-même tout le reste, pourvu qu'on ait du courage, et qu'on ne se lasse point de chercher. En effet, ce qu'on nomme chercher et apprendre, n'est absolument que se ressouvenir. » (Platon, Ménon, trad. de V. Cousin.) Dans l'ensemble du système psychologique de Platon, ce point de doctrine était réellement fondamental ; et, bien que le passage que nous venons de citer se distingue entre tous les autres par une forme plus particulièrement dogmatique, le même principe philosophique se retrouve en bien d'antres endroits de l'œuvre de Platon. Il tient une place importante dans le Phédon, où Socrate, quelques instants avant de mourir, le développe avec complaisance comme la conséquence et la confirmation du dogme de l'immortalité de l'âme. [30] Que le mal existe ou n'existe pas en fait, c'est un thème philosophique sur lequel la discussion ne sera pas de si longtemps close. Mais que le mal n'existe pas dans l'intention, voilà ce qu'il n'est pas aisé de soutenir. Aussi n'est-ce pas ce qu'a voulu dire Boèce, quoi que prétendent certains commentateurs qui n'ont pas vu qu'il y avait ici matière à distinction. Ce qui les a abusés, sans doute, c'est que Boèce a dit précédemment, comme Platon l'avait dit avant lui, que les méchants ne renient jamais le mal ; pourtant, cette pensée, expliquée comme elle l'est par ce qui précède et par ce qui suit, ne se prête pas à l'équivoque. Les méchants, il est vrai, ne désirent pas le mal pour lui-même, mais pour le bien qu'ils en espèrent, et si, pour arriver à ce bien, il faut manquer à la loi morale ou aux droits d'autrui, ils y manquent. Dès lors, s'ils peuvent se faire illusion, c'est sur le but, non pas sur les moyens. Or, là est la moralité de l'intention, et, par suite, la responsabilité des méchants. S'il en était autrement, si l'intention ne précédait pas nos actes, ils n'auraient par eux-mêmes ni mérite ni démérite, et nos désirs, indépendants de notre volonté, ne seraient plus que les instincts dont parle Dante :
Che sono in voi si come studio in ape
« ... qui sont en vous, comme est dans l'abeille le désir de composer le miel ; or, cette volonté instinctive ne mérite ni éloge ni blâme. » (Purgat., c. xviii, v. 57, sq.) Boèce croyait à la valeur intentionnelle des actes, par conséquent à notre responsabilité, et c'est parce qu'il avait cette croyance, qu'il a consacré un livre entier de ce traité à la défense du libre arbitre. [31] C'est dans le Sophiste de Platon que Boèce a trouve ce vers de Parménide. En représentant Dieu sous l'image d'une sphère, Parménide se montrait le fidèle continuateur de la doctrine de son maître Xénophane. « Xénophanes, paulo antiquior Anaxagora, unum esse omnia (dixit), neque id esse mutabile, et id esse Deum, neque natum usquam, et sempiternum, conglobata figura. » « Xénophane, un peu plus ancien qu'Anaxagore, enseignait que toutes choses ne sont qu'une seule et même substance ; que cette substance est immuable, qu'elle est Dieu ; qu'elle n'a jamais eu de commencement, qu'elle durera toujours, et qu'elle a la forme d’un globe. » (Cicéron, Acad., xxxvii.) Pourquoi cette forme plutôt qu'une autre? Parce qu'elle est la plus parfaite de toutes. C'est l'avis de Platon : « Dieu donna au monde la forme la plus convenable et la plus appropriée à sa nature; or, la forme la plus convenable à l’animal qui devait renfermer en soi tous les autres animaux ne pouvait être que celle qui renferme en elle toutes les autres formes. C'est pourquoi, jugeant le Semblable infiniment plus beau que le dissemblable, il donna au monde ht forme sphérique, ayant partout les extrémités également distantes du centre, ce qui est la forme la plus parfaite et la plus semblable à elle-même. » (Platon, Timée, trad. de V. Consor.) Ceux de nos lecteurs qui aiment à suivre une idée dans toutes ses évolutions, retrouveront celle-ci avec plaisir dans le livre II du Traité de la nature des Dieux, de Cicéron. Nous aurions pu rapporter ici le passage ou le stoïcien Balbus reprend en sous-œuvre la démonstration de Platon ; mais, outre que la citation serait un peu longue, nous préférons donner place à quelques lignes remarquables dans lesquelles M. V. Cousin détermine le sens métaphorique du mot qui nous occupe, avec la finesse et la sûreté de critique qui lui sont habituelles. « L'épithète de sphérique est tout simplement une locution grecque qui désigne la parfaite égalité et l'unité absolue qui ne conviennent qu'à Dieu, et dont une sphère peut donner quelque image. Le σφαιρικὸς des Grecs est le rotundus des Latins. C'est une expression métaphorique comme celle de carré pour dire parfait, expression aujourd'hui triviale, mais qui alors, à la naissance des notions mathématiques, avait quelque chose de relevé et se trouve dans la plus noble poésie. Simonide dit : un homme carré des pieds, des mains et de l’esprit, pour dire un homme accompli, métaphore employée aussi par Aristote. Il n'est donc pas étonnant que Xénophane, poète aussi bien que philosophe, écrivant en vers, et peu capable de trouver les expressions métaphysiques qui répondaient à ses idées, ait emprunté à la langue de l'imagination l'expression qui pouvait le mieux rendre sa pensée. » (Fragm. philos., t. I.) [32] « Le plus difficile en toute chose est de trouver un commencement conforme à la nature. Après avoir distingué la copie et le modèle, il faut distinguer aussi les paroles et reconnaître qu'elles ont de la parenté arec les pensées qu'elles expriment. » (Platon, Timée, trad. de V. Cousin.) [33] Telle est aussi la dernière espérance de Junon, dans Virgile : Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo. (Enéide, lib. VII, v. 312.)
|