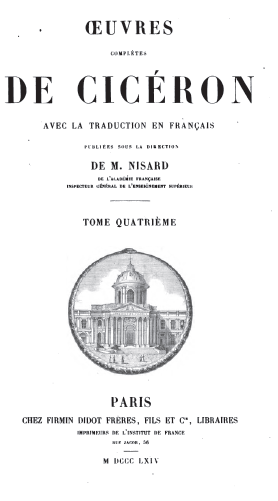|
I. .. . . . Quia pertinet ad
mores, quod ἦθος illi vocant, nos eam partem philosophiae de moribus appellare
solemus, sed decet augentem linguam Latinam nominare moralem; explicandaque vis
est ratioque enuntiationum, quae Graeci ἀξιώματα vocant; quae de re futura cum
aliquid dicunt deque eo, quod possit fieri aut non possit, quam vim habeant,
obscura quaestio est, quam περὶ δυνατῶν philosophi appellant,
totaque est
λογική, quam rationem disserendi voco. Quod autem in aliis libris feci, qui sunt
de natura deorum, itemque in iis, quos de divinatione edidi, ut in utramque
partem perpetua explicaretur oratio, quo facilius id a quoque probaretur, quod
cuique maxime probabile videretur, id in hac disputatione de fato casus quidam
ne facerem inpedivit. Nam cum essem in Puteolano Hirtiusque noster, consul
designatus, isdem in locis, vir nobis amicissimus et his studiis, in quibus nos
a pueritia viximus, deditus, multum una eramus, maxime nos quidem exquirentes ea
consilia, quae ad pacem et ad concordiam civium pertinerent. Cum enim omnes post
interitum Caesaris novarum perturbationum causae quaeri viderentur iisque esse
occurrendum putaremus, omnis fere nostra in his deliberationibus consumebatur
oratio, idque et saepe alias et quodam liberiore, quam solebat,
et magis vacuo
ab interventoribus die, cum ad me ille venisset, primo ea, quae erant cotidiana
et quasi legitima nobis, de pace et de otio.
II. Quibus actis Quid ergo? inquit ille, quoniam
oratorias exercitationes non tu quidem, ut spero, reliquisti, sed certe
philosophiam illis anteposuisti, possumne aliquid audire? -
Tu vero, inquam, vel audire vel dicere; nec enim, id quod recte
existimas, oratoria illa studia deserui, quibus etiam te incendi, quamquam
flagrantissumum acceperam, nec ea, quae nunc tracto, minuunt, sed augent potius
illam facultatem. Nam cum hoc genere philosophiae, quod nos sequimur, magnam
habet orator societatem; subtilitatem enim ab Academia mutuatur et ei vicissim
reddit ubertatem orationis et ornamenta dicendi. Quam ob rem, inquam, quoniam
utriusque studii nostra possessio est, hodie, utro frui malis, optio sit tua.
Tum Hirtius: Gratissumum, inquit, et tuorum omnium simile; nihil enim umquam
abnuit meo studio voluntas tua. Sed quoniam rhetorica mihi
vestra sunt nota
teque in iis et audivimus saepe et audiemus atque hanc Academicorum contra
propositum disputandi consuetudinem indicant te suscepisse Tusculanae
disputationes, ponere aliquid, ad quod audiam, si tibi non est molestum, volo.
An mihi, inquam, potest quicquam esse molestum, quod tibi gratum futurum sit?
Sed ita audies, ut Romanum hominem, ut timide ingredientem ad hoc genus
disputandi, ut longo intervallo haec studia repetentem. Ita, inquit, audiam te
disputantem, ut ea lego, quae scripsisti. Proinde ordire. Considamus hic.
III. . . . quorum in aliis, ut
in Antipatro poeta, ut
in brumali die natis, ut in simul aegrotantibus fratribus,
ut in urina, ut in
unguibus, ut in reliquis eius modi, naturae contagio valet, quam ego non tollo,
vis est nulla fatalis; in aliis autem fortuita quaedam esse possunt,
ut in illo
naufrago, ut in Icadio, ut in Daphita; quaedam etiam Posidonius (pace magistri
dixerim) comminisci videtur; sunt quidem absurda. Quid enim? si Daphitae fatum
fuit ex equo cadere atque ita perire, ex hocne equo, qui cum equus non esset,
nomen habebat alienum? aut Philippus hasne in capulo quadrigulas vitare
monebatur? quasi vero capulo sit occisus. Quid autem magnum aut naufragum illum
sine nomine in rivo esse lapsum? (quamquam huic quidem hic scribit praedictum in
aqua esse pereundum); ne hercule Icadii quidem praedonis video fatum ullum;
nihil enim scribit ei praedictum. Quid mirum
igitur ex spelunca saxum in crura eius incidisse? puto enim, etiamsi Icadius tum
in spelunca non fuisset, saxum tamen illud casurum fuisse. Nam aut nihil omnino
est fortuitum, aut hoc ipsum potuit evenire fortuna. Quaero igitur (atque hoc
late patebit), si fati omnino nullum nomen, nulla natura, nulla vis esset et
forte temere casu aut pleraque fierent aut omnia, num aliter, ac nunc eveniunt,
evenirent. Quid ergo adtinet inculcare fatum, cum sine fato ratio omnium rerum
ad naturam fortunamve referatur?
IV. Sed Posidonium, sicut aequum est, cum bona gratia
dimittamus, ad Chrysippi laqueos revertamur. Cui quidem primum de ipsa
contagione rerum respondeamus, reliqua postea persequemur. Inter locorum naturas
quantum intersit, videmus; alios esse salubris, alios pestilentis, in aliis esse
pituitosos et quasi redundantis, in aliis exsiccatos atque aridos; multaque sunt
alia, quae inter locum et locum plurimum differant. Athenis tenue caelum, ex quo
etiam acutiores putantur Attici, crassum Thebis, itaque pingues Thebani et
valentes. Tamen neque illud tenue caelum efficiet, ut aut Zenonem quis aut
Arcesilam aut Theophrastum audiat, neque crassum, ut Nemea potius quam Isthmo
victoriam petat. Diiunge longius. Quid enim loci natura adferre potest, ut in
porticu Pompeii potius quam in campo ambulemus? tecum quam cum alio?
Idibus potius quam Kalendis? Ut igitur ad quasdam res natura loci pertinet
aliquid, ad quasdam autem nihil, sic astrorum adfectio valeat, si vis, ad
quasdam res, ad omnis certe non valebit. At enim, quoniam in naturis hominum
dissimilitudines sunt, ut alios dulcia, alios subamara delectent, alii
libidinosi, alii iracundi aut crudeles aut superbi sint, alii a talibus vitiis
abhorreant,—quoniam igitur, inquit, tantum natura a natura distat, quid mirum
est has dissimilitudines ex differentibus causis esse factas?
V. Haec disserens, qua de re agatur, et in quo causa
consistat, non videt. Non enim, si alii ad alia propensiores sunt propter causas
naturalis et antecedentis, idcirco etiam nostrarum voluntatum atque adpetitionum
sunt causae naturales et antecedentes. Nam nihil esset in nostra potestate, si
ita se res haberet. Nunc vero fatemur, acuti hebetesne, valentes inbecilline
simus, non esse id in nobis. Qui autem ex eo cogi putat, ne ut sedeamus quidem
aut ambulemus voluntatis esse, is non videt, quae quamque rem res consequatur.
Ut enim et ingeniosi et tardi ita nascantur antecedentibus causis itemque
valentes et inbecilli, non sequitur tamen, ut etiam sedere eos et ambulare et
rem agere aliquam principalibus causis definitum et constitutum sit.
Stilponem, Megaricum philosophum, acutum sane
hominem et probatum temporibus illis accepimus. Hunc scribunt ipsius familiares
et ebriosum et mulierosum fuisse, neque haec scribunt vituperantes, sed potius
ad laudem; vitiosam enim naturam ab eo sic edomitam et conpressam esse doctrina,
ut nemo umquam vinulentum illum, nemo in eo libidinis vestigium viderit. Quid?
Socraten nonne legimus quem ad modum notarit Zopyrus physiognomon, qui se
profitebatur hominum mores naturasque ex corpore, oculis, vultu, fronte
pernoscere? stupidum esse Socraten dixit et bardum, quod iugula concava non
haberet, obstructas eas partes et obturatas esse dicebat; addidit etiam
mulierosum; in quo Alcibiades cachinnum dicitur sustulisse. Sed haec ex
naturalibus causis vitia nasci possunt, extirpari autem et funditus tolli, ut is
ipse, qui ad ea propensus fuerit, a tantis vitiis avocetur, non est id positum
in naturalibus causis, sed in voluntate, studio, disciplina. Quae tolluntur
omnia, si vis et natura fati ex divinationis ratione firmabitur.
|
TRAITÉ DU DESTIN
I...... Cette question appartient à la doctrine des mœurs (ἦθος
pour les Grecs); ce nom de doctrine des mœurs est celui que
nous donnons d'ordinaire à cette partie de la philosophie; mais,
pour enrichir notre langue, on peut être reçu à l'appeler la
morale. Il faut aussi faire connaître la nature et les règles
des propositions que les Grecs nomment axiomes. Lorsqu'elles
ont l'avenir pour objet et pour matière, ce qui peut être ou n'être
pas, il est fort embarrassant de se prononcer sur leur valeur; c'est
la question philosophique des possibles (περὶ δυνατῶν), question toute du ressort de la logique,
que j'appelle l'art de raisonner. Dans mes livres de la Nature
des Dieux et de la Divination, j'avais suivi la méthode
académique, qui laisse les deux sentiments opposés se produire dans
toute leur force, sans interruption, et permet ainsi à chacun de
reconnaître facilement quelle opinion semble la plus vraisemblable,
et de se déclarer pour elle. Mais aujourd'hui une circonstance
fortuite m'empêche d'introduire cette méthode dans mon traité du
Destin. J'étais à Pouzzol en même temps que Hirtius, consul désigné,
l'un de mes meilleurs amis, et qui cultivait alors avec beaucoup
d'ardeur l'art qui a rempli ma vie. Nous étions le plus souvent
ensemble, occupés surtout à rechercher par quels moyens on pourrait
ramener dans l'État la paix et la concorde. César était mort, et de
tous côtés il nous semblait voir des semences de dissensions
nouvelles; nous pensions qu'on devait se hâter de les étouffer, et
ces graves soucis occupaient à eux seuls presque tous nos
entretiens. Nous n'eûmes point d'antre pensée en plus de vingt
rencontres; mais un jour où nous trouvâmes plus de liberté, et où
nous fûmes moins empêchés par les visiteurs que d'ordinaire, les
premiers moments de notre entrevue furent donnés à nos
préoccupations habituelles, et à cet échange en quelque façon obligé
de nos pensées sur la paix et le repos public.
II. Quand nous eûmes achevé, Eh bien! me dit Hirtius, les exercices
oratoires, que vous n'avez pas abandonnés, j'espère, ont donc cédé
la première place à la philosophie? j'aimerais à vous
262 entendre en traiter quelque
point. — Je suis prêt, lui répondis-je, à vous satisfaire, ou à vous
entendre vous-même. Mais vous avez bien raison de penser que je n'ai
point renoncé à ces exercices oratoires qui ont redoublé votre zèle,
m'a-t-on dit, alors que déjà votre ardeur était extrême; et
d'ailleurs, les sujets qui m'occupent maintenant ne sont pas de
nature à affaiblir, mais plutôt à vivifier l'éloquence. Je vois
entre elle et le genre de philosophie que je cultive une fort
étroite alliance; l'orateur empruntée l'Académie la finesse et la
force de la pensée, et lui rend en retour l'abondance et les
ornements du langage. Je crois être assez initié aux secrets de ces
deux arts; c'est donc à vous de me dire aujourd'hui quelle sorte de
fruits vous voulez goûter.— Vous ne pouvez rien m'offrir déplus
agréable et je reconnais la votre exquise bonté, toujours si prompte
à satisfaire mes vœux. Mais je sais ce que vous pensez de
l'éloquence; plus d'une fois j'ai pu jouir de votre talent, et
j'espère en jouir encore; tandis que vos Tusculanes viennent de
m'apprendre que vous avez adopté l'habitude académicienne de
discuter et réfuter quelque proposition que ce fût. Je voudrais en
faire l'essai, et vous donner un sujet, si vous le permettez. — Tout
ce qui peut vous être agréable, lui dis-je, est fait pour me plaire.
Mais, vous le savez, ce n'est pas un Grec que vous allez entendre,
c'est un homme qui ne se hasarde pas avec trop de confiance à ce
difficile exercice, et qui depuis longtemps a été distrait de ces
études. — Je saurai vous entendre comme je sais vous lire, me
répondit-il. Commencez donc....
Lacune considérable.
III...... Examinons ces exemples. En ce qui touche les uns, comme le
poète Antipater, l'influence du solstice d'hiver sur la naissance,
la maladie simultanée de deux frères, l'urine, les ongles, et tant
d'autres du même genre, il faut reconnaître une certaine sympathie
naturelle que, pour ma part, je suis loin de nier; mais je n'y vois
point la marque de la fatalité. Pour ce qui regarde les autres, on y
rencontre certainement quelques coups du sort, comme dans les
aventures de ce naufragé, d'Icadius et de Daphitas. Posidonius même
(j'en demande pardon à mon maître) me semble en tirer quelques-uns
de son cru, car il en est, il faut bien le dire, qui sont de toute
invraisemblance. Quoi, si la destinée de Daphitas était de tomber de
cheval et de mourir de sa chute, fallait-il l'entendre d'une chose
qui n'avait du cheval que le nom? L'oracle avertit Philippe de se
défier d'un quadrige: raisonnablement était-il question du quadrige
gravé sur la garde de l'épée de son meurtrier? Est-ce d'ailleurs
cette garde d'épée qui lui a donné la mort? Est-ce donc un événement
bien merveilleux que ce naufragé, dont on ne nous dit pas le nom,
soit tombé dans un ruisseau? et cependant, au rapport de notre
auteur, c'est dans les flots que l'oracle l'avait condamné à périr.
Quant à l'histoire du brigand Icadius, je déclare que je n'y
aperçois aucun effet du Destin: car Posidonius ne nous dit pas qu'on
lui ait rien prédit. Qu'y a-t-il d'étonnant qu'une pierre se soit
détachée de la caverne pour lui rompre les jambes? Je crois que,
quand même Icadius n'aurait pas été dans la caverne, la pierre n'en
fût pas moins tombée. Car, ou il n'y a absolument rien de fortuit,
ou cet accident peut s'expliquer par le hasard. Voici la question
que je fais, et qui s'étend fort loin: supposons que le Destin n'ait
aucune influence, qu'il n'existe pas, qu'il n'en soit pas
263 même question, et que tous
les événements, ou presque tous, arrivent par hasard, fortuitement,
sans motif assignable, les choses se passeraient-elles autrement
qu'elles ne se passent maintenant? A quoi bon le Destin, quand on
peut, sans y recourir, expliquer toutes choses ou par la nature ou
par le hasard?
IV. Mais en voilà assez sur le livre de Posidonius; il nous serait
peu bienséant d'en poursuivre trop loin la critique: revenons aux
pièges de Chrysippe. J'attaquerai d'abord le fameux chapitre de la
sympathie, et je prendrai ensuite chacun des autres à partie. Nous
voyons combien il y a de différence entre les climats; les uns sont
salubres, les autres pestilentiels; ici l'on rencontre des
tempéraments lymphatiques; les humeurs regorgent; plus loin, il n'y
a que maigreur et sécheresse. Ou n'aurait jamais signalé toutes ces
variétés de climat. A Athènes, l'air est vif,et l'on croit que c'est
ce qui donne tant d'esprit aux Athéniens; à Thèbes, il est épais, et
les Thébains sont lourds et robustes. Cependant ce n'est pas cet air
vif qui amènera un disciple à Zenon, à Arcésilas ou à Théophraste,
et cet air épais n'engagera pas un athlète à rechercher plutôt la
victoire à Némée qu'aux jeux Isthmiques. Imaginez tout ce que vous
voudrez, vous ne parviendrez pas à me prouver que c'est l'influence
des lieux qui me fait promener sous le portique de Pompée plutôt
qu'au champ de Mars, avec vous plutôt qu'avec tout autre, aux ides,
et non pas aux kalendes. La nature des lieux a donc une certaine
influence, mais qui est incontestablement restreinte; il en est de
même de l'influence des astres; je vous accorderai, si vous le
voulez, qu'on en voit quelques effets, mais très-certainement elle
ne s'étend pas à toutes les choses humaines. Mais, nous dit
Chrysippe, ne remarquez-vous pas combien les goûts et les caractères
des hommes offrent de variété? les uns aiment ce qui est doux, les
autres ce qui a un peu d'amertume; les uns sont voluptueux, colères,
cruels, présomptueux; les autres ont pour ces vices un éloignement
naturel. Ainsi donc, puisque d'homme à homme l'on trouve tant de
différences, n'est-il pas conséquent de rapporter tous ces
tempéraments divers à des causes opposées?
V. Ce raisonnement de Chrysippe prouve qu'il ne comprend pas de quoi
il s'agit, et quelle est la position de la question. Car, de ce que
les hommes éprouvent certaines inclinations déterminées par des
causes naturelles et précédentes, il ne s'ensuit pas que nos
volontés et nos impulsions propres soient déterminées par de
semblables causes. S'il en était ainsi, rien ne serait en notre
pouvoir. Nous avouons qu'il ne dépend pas de nous d'avoir l'esprit
lin ou épais, d'être débiles ou robustes; mais qui voudrait conclure
de là qu'il n'est pas même en notre pouvoir de nous asseoir ou de
nous promener, prouverait qu'il ne sait ce que c'est que de tirer
une conséquence. Car s'il est vrai que des causes naturelles nous
rendent ingénieux ou lourds d'esprit, forts ou débiles, il ne
s'ensuit en aucune sorte que des causes irrésistibles nous
déterminent à nous promener ou à nous asseoir, par exemple, et
règlent à l'avance toutes nos actions. Stilpon, ce philosophe
mégarique, était, à ce que l'on nous rapporte, un homme fort
ingénieux, et jouissait, de son temps, d'une assez belle renommée.
Nous pouvons voir, dans les propres écrits de ses amis, qu'il
éprouvait une vive inclination pour le vin et les femmes;
264 et ce n'est pas pour le
décrier qu'ils en parlent, mais plutôt pour le louer; car ils
ajoutent qu'il avait tellement dompté et subjugué cette nature
vicieuse par la force de la discipline, que jamais homme au monde ne
le surprit dans l'ivresse ou agité de mauvaises passions. Bien
mieux, ne savons-nous pas le jugement que porta un jour de Socrate
le physionomiste Zopyre, qui faisait profession de connaître le
tempérament et le caractère des hommes à la seule inspection du
corps, des yeux, du visage, du front? Il déclara que Socrate était
un sot et un niais, parce qu'il n'avait pas la gorge concave, parce
que tous ses organes étaient fermés et bouchés; il ajouta même que
Socrate était adonné aux femmes; ce qui, nous dit-on, fit rire
Alcibiade aux éclats. Les dispositions vicieuses peuvent être
produites par des causes naturelles; mais les détruire et les
déracinier complètement, à ce point que l'âme où elles régnaient
d'abord en soit à jamais affranchie, ce n'est pas là le fait de la
nature, mais l'œuvre de la volonté, de l'énergie, d'une constante
discipline, toutes choses qui sont anéanties, si l'on parvient à
établir l'empire du destin sur le fondement de la divination.
|
|
VI. Etenim si est divinatio,
qualibusnam a perceptis artis proficiscitur? (percepta appello, quae
dicuntur Graece θεωρήματα). Non enim credo nullo percepto aut
ceteros artifices versari in suo munere, aut eos, qui divinatione
utantur, futura praedicere. Sint igitur astrologorum percepta huius
modi: “Si quis verbi causa oriente Canicula natus est, is in mari
non morietur.” Vigila, Chrysippe, ne tuam causam, in qua tibi cum
Diodoro, valente dialectico, magna luctatio est, deseras. Si enim
est verum, quod ita conectitur: “Si quis oriente Canicula natus est,
in mari non morietur”, illud quoque verum est: “Si Fabius oriente
Canicula natus est, Fabius in mari non morietur.” Pugnant igitur
haec inter se, Fabium oriente Canicula natum esse, et Fabium in mari
moriturum; et quoniam certum in Fabio ponitur, natum esse eum
Canicula oriente, haec quoque pugnant, et esse Fabium, et in mari
esse moriturum. Ergo haec quoque coniunctio est ex repugnantibus:
“Et est Fabius, et in mari Fabius morietur”, quod, ut propositum
est, ne fieri quidem potest. Ergo illud: “Morietur in mari Fabius”
ex eo genere est, quod fieri non potest. Omne ergo, quod falsum
dicitur in futuro, id fieri non potest.
VII. At hoc,
Chrysippe, minime vis, maximeque tibi de hoc ipso cum Diodoro
certamen est. Ille enim id solum fieri posse dicit, quod aut sit
verum aut futurum sit verum, et, quicquid futurum sit, id dicit
fieri necesse esse et, quicquid non sit futurum, id negat fieri
posse. Tu, et quae non sint futura, posse fieri
dicis, ut frangi
hanc gemmam, etiamsi id numquam futurum sit, neque
necesse fuisse
Cypselum regnare Corinthi, quamquam id millensimo ante anno
Apollinis oraculo editum esset. At si ista conprobabis divina
praedicta, et, quae falsa in futuris dicentur, in iis habebis, ut ea
fieri non possint [ut si dicatur Africanum Karthagine potiturum],
et, si vere dicatur de futuro, idque ita futurum sit, dicas esse
necessarium; quae est tota Diodori vobis inimica sententia.
Etenim si illud vere conectitur:
“Si oriente Canicula natus es, in mari non moriere”, primumque quod
est in conexo: “Natus es oriente Canicula”, necessarium est (omnia
enim vera in praeteritis necessaria sunt, ut Chrysippo placet
dissentienti a magistro Cleanthe, quia sunt inmutabilia nec in
falsum e vero praeterita possunt convertere); si igitur, quod primum
in conexo est, necessarium est, fit etiam, quod consequitur,
necessarium. Quamquam hoc Chrysippo non videtur valere in omnibus;
sed tamen, si naturalis est causa, cur in mari Fabius non moriatur,
in mari Fabius mori non potest.
VIII. Hoc
loco Chrysippus aestuans falli sperat Chaldaeos
ceterosque divinos,
neque eos usuros esse coniunctionibus, ut ita sua percepta
pronuntient: “Si quis natus est oriente Canicula, is in mari non
morietur”, sed potius ita dicant: “Non et natus est quis oriente
Canicula, et is in mari morietur.” O licentiam iocularem! ne ipse
incidat in Diodorum, docet Chaldaeos, quo pacto eos exponere
percepta oporteat. Quaero enim, si Chaldaei ita loquantur, ut
negationes infinitarum coniunctionum potius quam infinita conexa
ponant, cur idem medici, cur geometrae, cur reliqui facere non
possint. Medicus in primis, quod erit ei perspectum in arte, non ita
proponet: “Si cui venae sic moventur, is habet febrim”, sed potius
illo modo: “Non et venae sic <cui> moventur, et is febrim non
habet.” Itemque geometres non ita dicet: “In sphaera maximi
orbes medii inter se dividuntur”, sed potius illo modo: “Non et sunt
in sphaera maximi orbes, et ii non medii inter se dividuntur.”
Quid est, quod non possit isto modo
ex conexo transferri ad coniunctionum negationem? Et quidem aliis
modis easdem res efferre possumus. Modo dixi: “In sphaera maximi
orbes medii inter se dividuntur”; possum dicere: “Si in sphaera
maximi orbes erunt”, possum dicere: “Quia in sphaera maximi orbes
erunt”. Multa genera sunt enuntiandi nec ullum distortius quam hoc,
quo Chrysippus sperat Chaldaeos contentos Stoicorum causa fore.
Illorum tamen nemo ita
loquitur; maius est enim has contortiones orationis quam signorum
ortus obitusque perdiscere.
IX. Sed ad
illam Diodori contentionem, quam περὶ δυνατῶν appellant, revertamur,
in qua, quid valeat id, quod fieri possit, anquiritur. Placet igitur
Diodoro id solum fieri posse, quod aut verum sit aut verum futurum
sit. Qui locus attingit hanc quaestionem, nihil fieri, quod non
necesse fuerit, et, quicquid fieri possit, id aut esse iam aut
futurum esse, nec magis commutari ex veris in falsa posse ea, quae
futura, quam ea, quae facta sunt; sed in factis inmutabilitatem
apparere, in futuris quibusdam, quia non apparet, ne inesse quidem
videri, ut in eo, qui mortifero morbo urgeatur, verum sit “Hic
morietur hoc morbo”, at hoc idem si vere dicatur in eo, in quo vis
morbi tanta non appareat, nihilo minus futurum sit. Ita fit, ut
commutatio ex vero in falsum ne in futuro quidem ulla fieri possit.
Nam “Morietur Scipio” talem vim habet, ut, quamquam de futuro
dicitur, tamen ut id non possit convertere in falsum; de homine enim
dicitur, cui necesse est mori. Sic si diceretur: “Morietur noctu in
cubiculo suo vi oppressus Scipio”, vere diceretur; id enim fore
diceretur, quod esset futurum; futurum autem fuisse ex eo, quia
factum est, intellegi debet. Nec magis erat verum “Morietur Scipio”
quam “Morietur illo modo”, nec magis necesse mori Scipioni quam illo
modo mori, nec magis inmutabile ex vero in falsum “Necatus est
Scipio” quam “Necabitur Scipio”; nec, cum haec ita sint, est causa,
cur Epicurus fatum extimescat et ab atomis petat praesidium easque
de via deducat et uno tempore suscipiat res duas inenodabiles, unam,
ut sine causa fiat aliquid, ex quo existet, ut de nihilo quippiam
fiat, quod nec ipsi nec cuiquam physico placet, alteram, ut, cum duo
individua per inanitatem ferantur, alterum e regione moveatur,
alterum declinet. Licet enim Epicuro
concedenti omne enuntiatum aut verum aut falsum esse non vereri, ne
omnia fato fieri sit necesse; non enim aeternis causis naturae
necessitate manantibus verum est id, quod ita enuntiatur: “Descendit
in Academiam Carneades”, nec tamen sine causis, sed interest inter
causas fortuito antegressas et inter causas cohibentis in se
efficientiam naturalem. Ita et semper verum fuit “Morietur Epicurus,
cum duo et septuaginta annos vixerit, archonte Pytharato”, neque
tamen erant causae fatales, cur ita accideret, sed, quod ita
cecidit, <serie> certa causarum casurum, sicut cecidit, fuit.
Nec ii, qui dicunt inmutabilia esse,
quae futura sint, nec posse verum futurum convertere in falsum, fati
necessitatem confirmant, sed verborum vim interpretantur. At qui
introducunt causarum seriem sempiternam, ii mentem hominis voluntate
libera spoliatam necessitate fati devinciunt.
Sed haec hactenus; alia videamus.
X.
Concludit enim Chrysippus hoc modo:
“Si est motus sine causa, non omnis enuntiatio, quod ἀξίωμα
dialectici appellant, aut vera aut falsa erit; causas enim
efficientis quod non habebit, id nec verum nec falsum erit; omnis
autem enuntiatio aut vera aut falsa est; motus ergo sine causa
nullus est. ” “Quod si ita est, omnia, quae
fiunt, causis fiunt antegressis; id si ita est, fato omnia fiunt;
efficitur igitur fato fieri, quaecumque fiant.” Hic primum si mihi
libeat adsentiri Epicuro et negare omnem enuntiationem aut veram
esse aut falsam, eam plagam potius accipiam quam fato omnia fieri
conprobem; illa enim sententia habet aliquid disputationis, haec
vero non est tolerabilis. Itaque contendit omnis nervos Chrysippus,
ut persuadeat omne ἀξίωμα aut verum esse aut falsum. Ut enim
Epicurus veretur, ne, si hoc concesserit, concedendum sit fato
fieri, quaecumque fiant, (si enim alterum utrum ex aeternitate verum
sit, esse id etiam certum et, si certum, etiam necessarium; ita et
necessitatem et fatum confirmari putat) sic Chrysippus metuit, ne,
si non obtinuerit omne, quod enuntietur, aut verum esse aut falsum,
non teneat omnia fato fieri et ex causis aeternis rerum futurarum.
Sed Epicurus declinatione atomi vitari necessitatem fati putat.
Itaque tertius quidam motus oritur extra pondus et plagam, cum
declinat atomus intervallo minimo (id appellat ἐλάχιστον); quam
declinationem sine causa fieri si minus verbis, re cogitur
confiteri. Non enim atomus ab atomo pulsa declinat. Nam qui potest
pelli alia ab alia, si gravitate feruntur ad perpendiculum corpora
individua rectis lineis, ut Epicuro placet? Sequitur enim, ut, si
alia ab alia numquam depellatur, ne contingat quidem alia aliam. Ex
quo efficitur, etiamsi sit atomus eaque declinet, declinare sine
causa. Hanc Epicurus rationem induxit ob eam rem, quod veritus est,
ne, si semper atomus gravitate ferretur naturali ac necessaria,
nihil liberum nobis esset, cum ita moveretur animus, ut atomorum
motu cogeretur. Id Democritus, auctor atomorum, accipere
maluit, necessitate omnia fieri, quam a corporibus individuis
naturalis motus avellere. |
VI. Si vous admettez une divination, il faut nous dire sur quelles
observations certaines elle repose; j'appelle observations certaines
ce que les Grecs nomment théorèmes. Je ne croirai jamais que
sans leur secours il soit possible d'exercer aucun art, et en
particulier l'art de prédire l'avenir. Les astrologues ont donc
certaines règles que l'expérience leur a fournies, celle-ci, par
exemple: «Celui qui est né au lever de la Canicule ne mourra pas
dans la mer.» Prenez bien garde, Chrysippe, de trahir vous-même
votre propre cause, que vous avez à soutenir contre les rudes
attaques de Diodore, un vigoureux dialecticien. Si l'on doit tenir
pour vraie cette proposition générale: «Celui qui est né au lever de
la Canicule ne mourra pas dans la mer,» il faudra conséquemment
reconnaître la vérité de celle-ci: «Si Fabius est né au lever de la
Canicule, Fabius ne mourra pas dans la mer.» Conséquemment encore,
il impliquerait contradiction de dire: «Fabius est né au
lever de la Canicule, et Fabius mourra dans la mer;» et comme on
suppose comme certain que Fabius est né au lever de la Canicule, il
impliquerait aussi contradiction de dire: «Fabius existe, et Fabius
mourra dans la mer.» Cette dernière énonciation: «que Fabius existe,
et qu'il mourra dans la mer,» renferme donc à la fois une
contradiction et une impossibilité. Donc lorsque vous dites: «Fabius
mourra dans la mer,» vous parlez d'une chose qui est impossible.
Donc enfin, tout ce que l'on dit de l'avenir, contrairement à la
vérité, est impossible.
VII. Mais c'est là, Chrysippe, une conséquence que vous n'acceptez
nullement, et c'est sur ce point que Diodore vous livre le plus
terrible combat. Selon lui, il n'y a de possible que ce qui est vrai
actuellement, ou sera vrai un jour; et il soutient que tout ce qui
doit être sera nécessairement, et que tout ce qui ne doit pas être,
est impossible. Vous prétendez, vous, que ce qui ne doit pas être
est cependant possible; qu'il est possible, par exemple, de briser
ce joyau, quoique pourtant on ne doive jamais le rompre; et vous
tenez qu'il n'était point nécessaire que Cypsélus régnât à Corinthe,
quoique depuis mille ans l'oracle d'Apollon eût prédit son règne.
Mais si vous ajoutez une foi entière à ces prédictions divines, vous
serez contraint d'avouer que tout ce que l'on dit de l'avenir,
contrairement à la vérité,
265
est impossible; comme si l'on disait, par exemple: «Scipion
l'Africain sera maître de Cartliage;» vous conviendrez aussi que
lorsqu'on prédit l'avenir tel qu'il doit être, lorsqu'on parle d'un
événement qui véritablement arrivera, l'événement devra
nécessairement arriver. Mais ce sont là toutes les maximes de
Diodore, qui sont ennemies des vôtres. Si l'on doit tenir pour vraie
une proposition de cette sorte: «Celui qui est né au lever de la
Canicule ne mourra pas dans la mer,» et si ce qu'affirmé la première
partie de la proposition est nécessaire (tout ce qui est vrai dans
le passé est nécessaire; Chrysippe en convient lui-même, malgré le
sentiment de son maître Cléanthe; car ce qui est fait est immuable;
le vrai dans le passé ne peut plus devenir le faux); si,
disons-nous, ce qu'affirmé la première partie de la proposition est
nécessaire, la conséquence est pareillement nécessaire. Chrysippe
n'admet pas cette nécessité dans tous les cas. Mais cependant si une
cause naturelle s'oppose à ce que Fabius meure dans la mer, il est
impossible que Fabius périsse dans la mer.
VIII. Voilà qui embarrasse fort Chrysippe; que répond-il? que sans
doute les Chaldéens et tous les devins se trompent en employant
cette forme de proposition, et qu'ils ne doivent pas dire: «Celui
qui est né au lever de la Canicule ne mourra pas dans la mer,» mais
plutôt: «II n'est pas d'homme qui soit né au lever de la Canicule,
et qui doive mourir dans la mer.» 0 plaisante hardiesse! pour ne
point prêter le flanc à Diodore, le voilà qui veut apprendre aux
Chaldéens à énoncer leurs théorèmes. Mais si les Chaldéens
doivent introduire dans leur langage la négation absolue de
certaines liaisons de choses, au lieu d'affirmer absolument la
liaison de certaines choses, pourquoi la médecine, la géométrie et
tous les autres arts ne suivraient-ils pas la même méthode? Le
médecin, en première ligne, ne donnera pas au fruit de son
expérience la forme suivante: «Celui dont le pouls bat de telle
façon, a la fièvre;» mais il dira plutôt:» II n'y a point d'homme
dont le pouls batte de telle façon, et qui n'ait la fièvre.» Le
géomètre ne dira pas non plus: «Les grands cercles de la
sphère se coupent par le milieu,» mais bien: «Il n'y a point sur la
sphère de grands cercles qui ne se coupent par le milieu.» Enfin il
n'est pas au monde une seule proposition qui ne puisse se
transformer de telle sorte qu'au lieu d'affirmer une liaison, on nie
un rapport. Et ce n'est pas la seule transformation qu'on puisse
faire subir à l'énoncé des théorèmes. Nous disions d'abord:
«Les grands cercles de la sphère se coupent par le milieu;» nous
pouvons dire: «S'il y a des grands cercles sur la sphère;» ou bien
encore: «Puisqu'il y a des grands cercles sur la sphère.» On peut
donner vingt formes diverses à une proposition, mais, de toutes, la
plus bizarre est celle dont Chrysippe espère que les Chaldéens se
voudront contenter par amour pour le Stoïcisme. Le malheur est que
pas un d'eux ne veut apprendre ce beau langage; car il est plus
difficile d'étudier tous ces détours et ces finesses, que d'observer
le lever et le coucher des astres.
IX. Mais revenons à la question des possibles, si vivement débattue
par Diodore; et demandons-nous quelle valeur logique il faut
attribuer au possible. Diodore prétend qu'il n'y a de possible que
ce qui est vrai actuellement ou le deviendra un jour. Penser ainsi,
c'est déclarer qu'il
266
n'arrivera rien qui ne soit nécessaire, et que tout ce qui est
possible est actuellement réel, ou le sera un jour; ce qui implique
que l'on ne peut pas plus changer ce qui doit être que ce qui a été.
Toute la différence, c'est que l'on voit clairement que le passé est
immuable; tandis que l'on ne croit pas toujours qu'il en soit de
même de l'avenir, qui parfois se dérobe. Lorsqu'on voit un homme
atteint d'une maladie mortelle, on reconnaît que véritablement il
mourra de cette maladie; mais si un médecin nous en disait autant
d'un malade moins gravement attaqué, et qu'il dit vrai, la mort n'en
arriverait pas moins certainement. Il est donc clair que l'on ne
peut rien changer à l'avenir, et que les faits y sont immuablement
marqués. Quand je dis: «Scipion mourra, «j'affirme une chose
qui, bien que future, ne peut en aucune sorte n'être pas vraie; car
je parle d'un homme qui nécessairement doit mourir. Si l'on avait
ajouté: «Scipion mourra de nuit dans son lit, de mort violente,» on
aurait dit vrai, car on aurait affirmé une chose qui devait être; et
la preuve qu'elle devait être, c'est qu'effectivement elle est
arrivée. Cette proposition: «Scipion mourra,» n'était pas plus vraie
que celle-ci: «Il mourra de telle mort;» Scipion devait
nécessairement mourir, mais tout aussi nécessairement il devait
mourir de telle façon; et cet événement futur: «Scipion sera tué,
«n'était pas plus douteux que ne l'est aujourd'hui ce fait accompli:
«Scipion a été tué.» Cela étant, il n'y a plus de raison pour
qu'Épicure redoute le Destin, demande à ses atomes d'en affranchir
le monde, leur prête un mouvement de déclinaison, et s'engage en
même temps en deux difficultés inextricables: l'une de supposer des
faits qui n'ont point de cause, ce qui va directement contre ce
principe: «Rien ne se fait de rien,» principe défendu par tous les
physiciens et par Épicure lui-même; la seconde, d'admettre que de
deux atomes portés dans le vide, l'un suit la ligne directe, et
l'autre de lui-même s'en écarte. Épicure peut fort bien accorder que
toute proposition est vraie ou fausse, sans craindre pour cela que
tout arrive nécessairement par l'effet du Destin. Ce n'est pas en
vertu de causes éternelles, et qui aient leur racine dans l'ordre
nécessaire du monde, que cette proposition est vraie: «Carnéade
descend à l'Académie,» et cependant elle n'est pas vraie sans cause;
mais il y a une différence entre les causes fortuites qui influent
sur la production d'un fait, et les causes efficientes qui le
déterminent, en vertu de l'ordre immuable de la nature. Il a
toujours été vrai qu'Épicure mourrait à soixante-douze ans, sous
l'archonte Pytharatus; cependant il n'y avait point de causes
fatalement nécessaires pour qu'il en fût ainsi: mais, puisque
l'événement est arrivé, de tout temps il est certain. Ceux qui
disent que l'avenir est immuable, et que ce qui doit être ne peut
pas ne pas être, sont loin de conclure que par conséquent le Destin
gouverne le monde; ils ne font qu'expliquer la force des termes.
Mais ceux qui admettent une série de causes éternellement
enchaînées, dépouillent l'homme de sa volonté libre, et le font
l'esclave du Destin. J'en ai dit assez sur ce point; passons à
d'autres.
X. Voici comment Chrysippe raisonne: «S'il y a quelque mouvement
sans cause, on ne peut pas dire que toute proposition (ἀξίωμα,
dans la langue des Dialecticiens) soit ou vraie, ou fausse. Car ce
qui n'a pas de cause efficiente n'est ni
267 vrai ni faux. Mais
toute proposition est ou vraie ou fausse. Donc il n'y a
point de mouvement sans cause. Cela étant, tout ce qui
arrive est l'effet de causes précédentes. S'il en est
ainsi, tout arrive fatalement. Il est donc démontré que
le Destin préside à tous les événements du inonde.» Je
répondrai d'abord que, me fallût-il nier avec Épicure
que toute proposition soit ou vraie ou fausse,
j'aimerais mieux en venir à cette extrémité, que de
recevoir en ma croyance le dogme de la fatalité
universelle. Encore le sentiment d'Épicure mérite-t-il
d'être discuté; mais celui de Chrysippe est de tous
points insoutenable. Aussi l'habile Stoïcien emploie
tous ses efforts à démontrer qu'il n'est point de
proposition qui ne soit ou vraie ou fausse. D'un côté,
Épicure appréhende qu'en accordant ce principe, il ne
lui faille accorder aussi que tout arrive fatalement,
car il lui semble que si l'une des deux alternatives est
vraie de toute éternité, elle est par conséquent
certaine; certaine, elle est nécessaire, et voilà le
Destin reconnu. D'autre part, Chrysippe se trouve fort
empêché, si l'on ne convient que toute proposition est
ou vraie ou fausse, à démontrer que la fatalité règle
tout, et que les événements futurs sont de toute
éternité déterminés dans leurs causes. Mais Épicure
croit échapper à la fatalité par la déclinaison de ses
atomes. Voilà un troisième mouvement: à ceux que
produisent la pesanteur et le choc, il faut ajouter
cette déclinaison infiniment petite,
ἐλάχιστον,
dit Épicure. Mais voilà un mouvement sans cause; si Épicure
ne le déclare pas expressément, au fond il est forcé d'en convenir.
Car si un atome vient à dévier, ce n'est pas qu'il ait été poussé
par un autre: comment deux atomes pourraient-ils s'entrechoquer,
puisque, d'après Épicure lui-même, ils sont tous emportés par la
pesanteur, suivant une ligne droite et perpendiculaire?
Non-seulement ils ne s'entrechoquent point, mais ils ne se touchent
même jamais. Donc bien certainement admettre les atomes et leur
déclinaison, c'est admettre un mouvement sans cause. Épicure a
imaginé cette déclinaison, parce qu'il craignait que si la pesanteur
emportait seule les atomes d'un mouvement naturel et nécessaire, il
n'y eût aucune action libre, l'âme étant contrainte de suivre
toujours l'impulsion originelle des atomes. Aussi Démocrite,
l'inventeur des atomes, a-t-il mieux aimé soumettre toutes choses à
la fatalité, que de soustraire ses corpuscules à leurs mouvements
naturels. |
|
XI. Acutius Carneades, qui docebat posse
Epicureos suam causam sine hac commenticia declinatione defendere.
Nam cum docerent esse posse quendam animi motum voluntarium, id fuit
defendi melius quam introducere declinationem, cuius praesertim
causam reperire non possent; quo defenso facile Chrysippo possent
resistere. Cum enim concessissent motum nullum esse sine causa, non
concederent omnia, quae fierent, fieri causis antecedentibus;
voluntatis enim nostrae non esse causas externas et antecedentis.
Communi igitur consuetudine sermonis abutimur, cum ita dicimus,
velle aliquid quempiam aut nolle sine causa; ita enim dicimus “sine
causa”, ut dicamus: sine externa et antecedente causa, non sine
aliqua; ut, cum vas inane dicimus, non ita loquimur, ut physici,
quibus inane esse nihil placet, sed ita, ut verbi causa sine aqua,
sine vino, sine oleo vas esse dicamus, sic, cum sine causa animum
dicimus moveri, sine antecedente et externa causa moveri, non omnino
sine causa dicimus. De ipsa atomo dici potest, cum per inane
moveatur gravitate et pondere, sine causa moveri, quia nulla causa
accedat extrinsecus. Rursus autem, ne omnes physici inrideant
nos, si dicamus quicquam fieri sine causa, distinguendum est et ita
dicendum, ipsius individui hanc esse naturam, ut pondere et
gravitate moveatur, eamque ipsam esse causam, cur ita feratur.
Similiter ad animorum motus voluntarios non est requirenda externa
causa; motus enim voluntarius eam naturam in se ipse continet, ut
sit in nostra potestate nobisque pareat, nec id sine causa; eius rei
enim causa ipsa natura est. Quod cum ita sit, quid est, cur non
omnis pronuntiatio aut vera aut falsa sit, nisi concesserimus fato
fieri, quaecumque fiant?
XII. Quia futura
vera, inquit, non possunt esse ea, quae causas, cur futura sint, non
habent; habeant igitur causas necesse est ea, quae vera sunt; ita,
cum evenerint, fato evenerint. Confectum negotium, siquidem
concedendum tibi est aut fato omnia fieri, aut quicquam fieri posse
sine causa. An aliter haec enuntiatio vera esse non potest: “Capiet
Numantiam Scipio”, nisi ex aeternitate causa causam serens hoc erit
effectura? An hoc falsum potuisset esse, si esset sescentis saeculis
ante dictum? Et si tum non esset vera haec enuntiatio: “Capiet
Numantiam Scipio”, ne illa quidem eversa vera est haec enuntiatio:
“Cepit Numantiam Scipio.” Potest igitur quicquam factum esse, quod
non verum fuerit futurum esse? Nam ut praeterita ea vera dicimus,
quorum superiore tempore vera fuerit instantia, sic futura, quorum
consequenti tempore vera erit instantia, ea vera dicemus. Nec, si
omne enuntiatum aut verum aut falsum est, sequitur ilico esse causas
inmutabilis, easque aeternas, quae prohibeant quicquam secus cadere,
atque casurum sit; fortuitae sunt causae, quae efficiant, ut vere
dicantur, quae ita dicentur: “Veniet in senatum Cato”, non inclusae
in rerum natura atque mundo; et tamen tam est inmutabile venturum,
cum est verum, quam venisse, nec ob eam causam fatum aut necessitas
extimescenda est. Etenim erit confiteri necesse: “Si hoc enuntiatum:
"Veniet in Tusculanum Hortensius" verum non est, sequitur, ut falsum
sit.” Quorum isti neutrum volunt; quod fieri non potest. Nec nos
impediet illa ignava ratio, quae dicitur; appellatur enim quidam a
philosophis ἀργὸς λόγος, cui si pareamus, nihil omnino agamus in
vita. Sic enim interrogant: “Si fatum tibi est ex hoc morbo
convalescere, sive tu medicum adhibueris sive non adhibueris,
convalesces; ” item, si fatum tibi est ex hoc morbo non
convalescere, sive tu medicum adhibueris sive non adhibueris, non
convalesces; et alterutrum fatum est; medicum ergo adhibere nihil
attinet.”
XIII. Recte genus
hoc interrogationis ignavum atque iners nominatum est, quod eadem
ratione omnis e vita tolletur actio. Licet etiam inmutare, ut fati
nomen ne adiungas et eandem tamen teneas sententiam, hoc modo: “Si
ex aeternitate verum hoc fuit: "Ex isto morbo convalesces", sive
adhibueris medicum sive non adhibueris, convalesces; itemque, si ex
aeternitate falsum hoc fuit: "Ex isto morbo convalesces", sive
adhibueris medicum sive non adhibueris, non convalesces”; deinde
cetera. Haec ratio a Chrysippo reprehenditur. Quaedam enim
sunt, inquit, in rebus simplicia, quaedam copulata; simplex est:
“Morietur illo die Socrates”; huic, sive quid fecerit sive non
fecerit, finitus est moriendi dies. At si ita fatum erit: “Nascetur
Oedipus Laio”, non poterit dici: “sive fuerit Laius cum muliere sive
non fuerit”; copulata enim res est et confatalis; sic enim appellat,
quia ita fatum sit et concubiturum cum uxore Laium et ex ea Oedipum
procreaturum, ut, si esset dictum: “Luctabitur Olympiis Milo” et
referret aliquis: “Ergo, sive habuerit adversarium sive non
habuerit, luctabitur”, erraret; est enim copulatum “luctabitur”,
quia sine adversario nulla luctatio est. Omnes igitur istius generis
captiones eodem modo refelluntur. “Sive tu adhibueris medicum sive
non adhibueris, convalesces” captiosum; tam enim est fatale medicum
adhibere quam convalescere. Haec, ut dixi, confatalia ille appellat.
XIV. Carneades
genus hoc totum non probabat et nimis inconsiderate concludi hanc
rationem putabat. Itaque premebat alio modo nec ullam adhibebat
calumniam; cuius erat haec conclusio: “Si omnia antecedentibus
causis fiunt, omnia naturali conligatione conserte contexteque
fiunt; quod si ita est, omnia necessitas efficit; id si verum est,
nihil est in nostra potestate; est autem aliquid in nostra
potestate; at, si omnia fato fiunt, omnia causis antecedentibus
fiunt; non igitur fato fiunt, quaecumque fiunt.” Hoc artius
adstringi ratio non potest. Nam si quis velit idem referre atque ita
dicere: “Si omne futurum ex aeternitate verum est, ut ita certe
eveniat, quem ad modum sit futurum, omnia necesse est conligatione
naturali conserte contexteque fieri”, nihil dicat. Multum enim
differt, utrum causa naturalis ex aeternitate futura vera efficiat,
an etiam sine aeternitate naturali, futura quae sint, ea vera esse
possint intellegi. Itaque dicebat Carneades ne Apollinem quidem
futura posse dicere nisi ea, quorum causas natura ita contineret, ut
ea fieri necesse esset. Quid enim spectans deus ipse diceret
Marcellum eum, qui ter consul fuit, in mari esse periturum? Erat hoc
quidem verum ex aeternitate, sed causas id efficientis non habebat.
Ita ne praeterita quidem ea, quorum nulla signa tamquam vestigia
extarent, Apollini nota esse censebat; quo minus futura! causis enim
efficientibus quamque rem cognitis posse denique sciri, quid futurum
esset. Ergo nec de Oedipode potuisse Apollinem praedicere nullis in
rerum natura causis praepositis, cur ab eo patrem interfici necesse
esset, nec quicquam eius modi.
XV. Quocirca, si
Stoicis, qui omnia fato fieri dicunt, consentaneum est huius modi
oracla ceteraque, quae a divinatione ducuntur, conprobare, iis
autem, qui, quae futura sunt, ea vera esse ex aeternitate dicunt,
non idem dicendum est, vide, ne non eadem sit illorum causa et
Stoicorum; hi enim urguentur angustius, illorum ratio soluta ac
libera est. Quodsi concedatur nihil posse evenire nisi causa
antecedente, quid proficiatur, si ea causa non ex aeternis causis
apta dicatur? Causa autem ea est, quae id efficit, cuius est causa,
ut vulnus mortis, cruditas morbi, ignis ardoris. Itaque non sic
causa intellegi debet, ut, quod cuique antecedat, id ei causa sit,
sed quod cuique efficienter antecedat, nec, quod in campum
descenderim, id fuisse causae, cur pila luderem, nec Hecubam causam
interitus fuisse Troianis, quod Alexandrum genuerit, nec Tyndareum
Agamemnoni, quod Clytaemnestram. Hoc enim modo viator quoque bene
vestitus causa grassatori fuisse dicetur, cur ab eo spoliaretur. Ex
hoc genere illud est Ennii:
Utinam ne in nemore
Pelio securibus
Caesae accidissent abiegnae ad terram trabes!
Licuit vel altius:
“Utinam ne in Pelio nata ulla umquam esset arbor!” etiam supra:
“Utinam ne esset mons ullus Pelius!” similiterque superiora
repetentem regredi infinite licet.
Neve índe navis
ínchoandi exordium
Coepisset.
Quorsum haec
praeterita? Quia sequitur illud:
Nam numquam era
errans mea domo ecferret pedem,
Medea, animo aegra, amore saevo saucia,
non ut eae res
causam adferrent amoris.
|
XI. L'esprit ingénieux de Carnéade apprit aux Épicuriens comment ils
pouvaient défendre leur sentiment sans recourir à cette déclinaison
chimérique. Il attribue à l'âme le pouvoir de produire certains
mouvements volontaires, qui sont incontestablement plus raisonnables
que la déclinaison épicurienne, dont on ne peut, après tout,
alléguer aucune cause. Avec la thèse de Carnéade, il est facile de
répondre à Chrysippe. On lui accorde qu'il n'est aucun mouvement
sans cause; mais on nie que tout ce qui arrive doive s'expliquer par
des causes efficientes et antécédentes à la fois, car il ne faut
point chercher les causes de la volonté en dehors d'elle. C'est par
un abus de langage que nous disons qu'un homme veut ou ne veut pas,
sans cause; quand nous parlons ainsi, ce sont les causes externes et
antécédentes que nous entendons exclure, et non
268 toute espèce de cause. Quand
nous disons qu'un vase est vide, nous n'exprimons pas la même idée
que les physiciens lorsqu'ils affirment qu'il n'y a pas de vide dans
la nature: ce que notre langage signifie, c'est que le vase ne
contient pas d'eau, par exemple pas de vin, pas d'huile. Tout
pareillement, lorsque nous disons que l'âme agit sans cause, nous
entendons sans cause externe et précédente, mais non pas sans cause
absolument. A ce compte on pourrait dire de l'atome lui-même qui est
emporté dans le --vide par son propre poids, qu'il se meut sans
cause, puisque son mouvement n'est déterminé par aucune cause
externe. Mais les physiciens, nous entendant prononcer ces mots
d'effets sans causes, vont se rire de nous; hâtons-nous de
distinguer, et de leur dire: Il est compris dans la nature même de
l'atome que son propre poids l'entraîne; et c'est là la cause de son
mouvement. Par une raison semblable, il ne faut pas chercher de
cause externe au mouvement volontaire de l'âme; car la nature du
mouvement volontaire implique qu'il soit en notre puissance et
dépende de nous; il n'est donc point sans cause, car la cause que
vous cherchez, c'est sa nature même. S'il en est ainsi, on peut
très-certainement accorder que toute proposition est vraie ou
fausse, sans être obligé de convenir qu'en conséquence tout arrive
fatalement.
XII. Non pas, répond Chrysippe; parce qu'aucun événement futur ne
peut être vrai, qui n'ait dans le présent des causes en vertu
desquelles il arrivera un jour; tout événement est donc
nécessairement lié à ses causes, et tout ce qui est vrai à l'avance
se produit fatalement. — Tout serait bientôt dit sans doute, s'il
fallait accorder ou que le Destin gouverne tout, ou qu'il y a des
effets sans causes. Mais, je vous le demande, cette proposition:
«Scipion prendra Nurnance, «ne peut-elle être vraie qu'à la
condition qu'une série infinie de causes ait de toute éternité amené
cet événement? Imaginez qu'on l'ait exprimée six cents siècles
avant, eût-elle été fausse? Si alors il n'était pas vrai de dire:
«Scipion prendra Numance,» il n'est pas vrai de dire aujourd'hui,
après la ruine de cette ville: «Scipion a pris Numance;» car
est-il possible qu'un fait se soit accompli, dont il n'ait pas été
vrai de dire: II s'accomplira? Ce que nous appelons vrai dans le
passé, c'est ce qui a été réel à une certaine époque; et en même
sorte, nous appelons vrai l'événement futur qui sera réel dans l'un
des moments de l'avenir. Ainsi donc, si l'on doit dire que toute
proposition est ou vraie ou fausse, il ne s'ensuit pas que tout,
dans le monde, soit produit par des causes immuables et éternelles,
et que chaque événement arrive forcément tel qu'il devait arriver.
Il y a des causes fortuites qui donnent de la vérité aux
propositions de ce genre: «Caton viendra au sénat,» et qui ne
sont point comprises dans la nature des choses, ni dans l'ordre
éternel de l'univers. L'avenir est tout aussi certain que le passé;
mais cette certitude n'entraîne ni la nécessité ni le Destin.
Incontestablement, si cette proposition: «Hortensius viendra à
Tusculum,» n'est pas vraie, on doit admettre qu'elle est fausse;
mais les Épicuriens prétendent qu'elle n'est ni vraie ni fausse, ce
qui est absurde. Nous ne nous laisserons point embarrasser non plus
par le sophisme paresseux (ἀργὸς λόγος), comme
l'appellent les philosophes; car, s'il fallait l'en croire, nous
nous tiendrions dans une inaction complète. Voici sous quelle forme
on le présente: «Si votre des-
269
tinée est de guérir de cette maladie, appelez un médecin ou n'en
appelez pas, vous guérirez. Par la même raison, si votre destinée
est de ne point guérir de cette maladie, appelez un médecin ou n'en
appelez pas, vous ne guérirez point. Or, il est évident que l'un ou
l'autre est dans votre destinée. II est donc inutile d'appeler un
médecin.»
XIII. C'est avec raison qu'on a nommé cet argument le sophisme
paresseux, parce que, en vertu du môme principe, on supprime
absolument toute action. On peut même, sans parler du Destin, mais
sans rien ôter à la force de l'argument, le proposer de cette sorte:
«Si de toute éternité il est vrai que vous devez guérir de cette
maladie, appelez le médecin ou ne l'appelez pas,
Tous guérirez. Et, par la même raison, s'il est vrai de toute
éternité que vous ne guérirez pas de cette maladie, appelez le
médecin ou ne l'appelez pas, vous ne guérirez point;» et la suite.
Chrysippe réfute ce sophisme. Il y a, dit-il, des choses simples, il
en est d'autres naturellement liées. Si je dis: «Socrate mourra tel
jour,» je parle d'un fait en lui-même, simple, isolé. Socrate n'a
rien à faire, rien à éviter, il mourra certainement ce jour-là. Mais
si l'on dit à l'avance: «Œdipe naîtra de Laïus,» on ne peut ajouter:
«que Laïus ait ou non commerce avec une femme;» car les deux choses
sont nécessairement liées, et Chrysippe les appelle confatales;
car on déclare à la fois que Laïus aura commerce avec sa femme,
et que de ce commerce Œdipe naîtra. C'est comme si l'on disait:
«Milon luttera aux jeux Olympiques,» et que quelqu'un reprît:
«Ainsi, soit que Milon ait un adversaire, soit qu'il n'en ait point,
il luttera,» il serait dans l'erreur; quand on dit: «il luttera,»
c'est une de ces propositions que nous appelons liées, car il n'y a
pas de lutte sans adversaires. Tous les sophismes de ce genre se
réfutent par la même distinction. Appelez le médecin, ou ne
l'appelez pas; pur sophisme; car l'appel du médecin est tout autant
que la guérison dans l'arrêt de la destinée. Ce sont là des
conditions nécessaires, que Chrysippe, comme je l'ai dit, appelle
confatales.
XIV. Carnéade n'approuvait nullement les arguments de ce genre, et
pensait que ce fameux sophisme était fort inconsidéré. Il attaquait
les Stoïciens d'une autre manière, sans recourir à aucune subtilité.
Voici comment il raisonnait: «Si tout arrive en vertu de causes
externes et efficientes, tous les événements sont enchaînés
naturellement dans un tissu que rien ne peut rompre. S'il en est
ainsi, la nécessité produit tout. Mais alors rien n'est en notre
pouvoir. Or, il y a certainement quelque chose en notre pouvoir.
Mais tout serait déterminé par des causes externes et efficientes,
si tout arrivait fatalement. Donc tout ce qui se fait ne se fait
point fatalement.» Il est impossible de donner à ce raisonnement une
forme plus pressante. Supposez que l'on veuille retourner
l'argumentation, et dire: «Si tout événement futur est vrai de toute
éternité, en cette sorte que tel il doit arriver, tel il arrivera
certainement, il faut en conclure que tout ce qui se fait est le
résultat nécessaire d'une série de causes naturellement enchaînées;»
on ne prouverait absolument rien. Il y aune grande différence entre
une série de causes naturelles qui, de toute éternité, rendent
certain un événement futur, et la connaissance fortuite que l'on
peut 270 avoir à l'avance de
la certitude d'un fait, sans, pour cela, qu'il se rattache aune
série infinie de causes naturelles. Aussi Carnéade affirmait-il
qu'Apollon lui-même ne pouvait prédire d'autres événements que ceux
dont l'ordre de la nature comprend les causes, et qui doivent en
être le résultat nécessaire. A quelles marques ce dieu aurait-il pu
reconnaître que Marcellus, qui fut trois fois consul, devait périr
dans la mer? Cet événement était vrai de toute éternité, mais il
n'avait pas de cause déterminante dans l'ordre de la nature.
Carnéade allait jusqu'à dire qu'Apollon ne pouvait connaître le
passé, quand il n'en restait plus de traces; à plus forte raison
l'avenir lui était-il impénétrable. Comment savoir ce qui doit
arriver, ajoutait-il, si on ne lit l'avenir dans les causes qui le
préparent? Apollon n'a donc pu prédire le parricide d'Œdipe, car il
n'y avait dans la nature des choses aucune cause essentielle en
vertu de laquelle il dût nécessairement donner la mort à son père;
en un mot, Apollon n'a pu faire aucune prédiction de ce genre.
XV. Ainsi donc si les Stoïciens, qui admettent la fatalité
universelle, doivent, pour être conséquents, croire à de tels
oracles et à tout le cortège de la divination, tandis que ceux pour
qui les événements futurs sont vrais de toute éternité, peuvent se
soustraire à ces conséquences; n'est-il pas évident que ces derniers
sont dans une condition bien meilleure que les Stoïciens? Ceux-ci
sont étroitement pressés; ceux-là au moins peuvent respirer et
trouver plus d'une issue. Ils accordent sans doute que rien ne peut
se faire sans une cause suffisante; mais le Destin n'y gagne rien,
si cette cause ne doit point être rattachée à la série sans fin des
causes naturelles. La cause est ce qui produit véritablement son
effet: par exemple, une blessure est cause de la mort;
l'indigestion, de la maladie; le feu, de la chaleur. Il ne faut
point entendre par cause tout ce qui précède un fait, mais seulement
ce qui le précède d'une manière efficiente. Je vais au champ de
Mars, mais ce n'est point là la cause qui me fait jouer au jeu de
paume; Hécube n'est pas cause de la ruine de Troie, parce qu'elle
met au monde Pâris; Tyndare n'est pas cause du meurtre d'Agamemnon,
parce qu'il engendre Clytemnestre. A ce compte, un voyageur bien
vêtu serait cause qu'un brigand va le dépouiller. On peut mettre
dans la môme famille ces vers d'Ennius:
«Plût au ciel que sur le
mont Pélion la hache n'ait jamais abattu le pin navigateur!»
Il
pouvait remonter plus haut: «Plût au ciel que le mont Pélion n'eût
jamais porté d'arbre!» plus haut encore: «Plût au ciel qu'il
n'y eût jamais eu de mont Pélion!» Il pouvait enfin remonter de
proche en proche à l'infini. Continuons:
Et que le premier
vaisseau, sorti de ces forêts, n'eût jamais paru sur les flots!...»
A quoi bon rappeler ces anciens événements? parce qu'ils précèdent
cette triste aventure:
«Sans eux Médée, ma triste maîtresse,
n'aurait point fui la maison paternelle, l'esprit déchiré, blessée
au cœur par ce cruel amour;»
mais évidemment, ce ne sont pas là les
causes de l'amour de Médée. |
|
16. Interesse autem
aiunt, utrum eius modi quid sit, sine quo effici aliquid non possit,
an eius modi, cum quo effici aliquid necesse sit. Nulla igitur earum
est causa, quoniam nulla eam rem sua vi efficit, cuius causa
dicitur; nec id, sine quo quippiam non fit, causa est, sed id, quod
cum accessit, id, cuius est causa, efficit necessario. Nondum enim
ulcerato serpentis morsu Philocteta quae causa in rerum natura
continebatur, fore ut is in insula Lemno linqueretur? post autem
causa fuit propior et cum exitu iunctior. Ratio igitur eventus
aperit causam. Sed ex aeternitate vera fuit haec enuntiatio:
“Relinquetur in insula Philoctetes”, nec hoc ex vero in falsum
poterat convertere. Necesse est enim in rebus contrariis duabus
(contraria autem hoc loco ea dico, quorum alterum ait quid, alterum
negat), ex iis igitur necesse est invito Epicuro alterum verum esse,
alterum falsum, ut “Sauciabitur Philocteta” omnibus ante saeculis
verum fuit, “Non sauciabitur” falsum; nisi forte volumus Epicureorum
opinionem sequi, qui tales enuntiationes nec veras nec falsas esse
dicunt aut, cum id pudet, illud tamen dicunt, quod est inpudentius,
veras esse ex contrariis diiunctiones, sed, quae in his enuntiata
essent, eorum neutrum esse verum. O admirabilem licentiam et
miserabilem inscientiam disserendi! Si enim aliquid in eloquendo nec
verum nec falsum est, certe id verum non est; quod autem verum non
est, qui potest non falsum esse? aut, quod [266] falsum non est, qui
potest non verum esse? tenebitur <igitur> id, quod a Chrysippo
defenditur, omnem enuntiationem aut veram aut falsam esse; ratio
ipsa coget et ex aeternitate quaedam esse vera, et ea non esse nexa
causis aeternis et a fati necessitate esse libera.
XVII. Ac mihi
quidem videtur, cum duae sententiae fuissent veterum philosophorum,
una eorum, qui censerent omnia ita fato fieri, ut id fatum vim
necessitatis adferret, in qua sententia Democritus, Heraclitus,
Empedocles, Aristoteles fuit, altera eorum, quibus viderentur sine
ullo fato esse animorum motus voluntarii, Chrysippus tamquam arbiter
honorarius medium ferire voluisse, sed adplicat se ad eos potius,
qui necessitate motus animorum liberatos volunt; dum autem verbis
utitur suis, delabitur in eas difficultates, ut necessitatem fati
confirmet invitus. Atque hoc, si placet, quale sit videamus
in
adsensionibus, quas prima oratione tractavi. Eas enim veteres illi,
quibus omnia fato fieri videbantur, vi effici et necessitate
dicebant. Qui autem ab iis dissentiebant, fato adsensiones
liberabant negabantque fato adsensionibus adhibito necessitatem ab
his posse removeri, iique ita disserebant: “Si omnia fato fiunt,
omnia fiunt causa antecedente, et, si adpetitus, illa etiam, quae
adpetitum sequuntur, ergo etiam adsensiones; at, si causa adpetitus
non est sita in nobis, ne ipse quidem adpetitus est in nostra
potestate; quod si ita est, ne illa quidem, quae adpetitu
efficiuntur, sunt sita in nobis; non sunt igitur neque adsensiones
neque actiones in nostra potestate. Ex quo efficitur, ut nec
laudationes iustae sint nec vituperationes nec honores nec
supplicia”. Quod cum vitiosum sit, probabiliter concludi putant non
omnia fato fieri, quaecumque fiant.
XVIII.
Chrysippus
autem cum et necessitatem inprobaret et nihil vellet sine
praepositis causis evenire, causarum genera distinguit, ut et
necessitatem effugiat et retineat fatum. “Causarum enim”, inquit,
“aliae sunt perfectae et principales, aliae adiuvantes et proximae.
Quam ob rem, cum dicimus omnia fato fieri causis antecedentibus, non
hoc intellegi volumus: causis perfectis et principalibus, sed causis
adiuvantibus [antecedentibus] et proximis”. Itaque illi rationi,
quam paulo ante conclusi, sic occurrit: si omnia fato fiant, sequi
illud quidem, ut omnia causis fiant antepositis, verum non
principalibus causis et perfectis, sed adiuvantibus et proximis.
Quae si ipsae non sunt in nostra potestate, non sequitur, ut ne
adpetitus quidem sit in nostra potestate. At hoc sequeretur, si
omnia perfectis et principalibus causis fieri diceremus, ut, cum eae
causae non essent in nostra potestate, ne ille quidem esset in
nostra potestate. Quam ob rem, qui ita fatum introducunt, ut
necessitatem adiungant, in eos valebit illa conclusio; qui autem
causas antecedentis non dicent perfectas neque principalis, in eos
nihil valebit. Quod enim dicantur adsensiones fieri causis
antepositis, id quale sit, facile a se explicari putat. Nam quamquam
adsensio non possit fieri nisi commota viso, tamen, cum id visum
proximam causam habeat, non principalem, hanc habet rationem, ut
Chrysippus vult, quam dudum diximus, non ut illa quidem fieri possit
nulla vi extrinsecus excitata (necesse est enim adsensionem viso
commoveri), sed revertitur ad cylindrum et ad turbinem suum, quae
moveri incipere nisi pulsa non possunt. Id autem cum accidit, suapte
natura, quod superest, et cylindrum volvi et versari turbinem putat.
XIX. Ut igitur',
inquit, “qui protrusit cylindrum, dedit ei principium motionis,
volubilitatem autem non dedit, sic visum obiectum inprimet illud
quidem et quasi signabit in animo suam speciem, sed adsensio nostra
erit in potestate, eaque, quem ad modum in cylindro dictum [268]
est, extrinsecus pulsa, quod reliquum est, suapte vi et natura
movebitur. Quodsi aliqua res efficeretur sine causa antecedente,
falsum esset omnia fato fieri; sin omnibus, quaecumque fiunt, veri
simile est causam antecedere, quid adferri poterit, cur non omnia
fato fieri fatendum sit? modo intellegatur, quae sit causarum
distinctio ac dissimilitudo.” Haec cum ita sint a Chrysippo
explicata, si illi, qui negant adsensiones fato fieri, †fateantur
tamen eas non sine viso antecedente fieri, alia ratio est; sed, si
concedunt anteire visa, nec tamen fato fieri adsensiones, quod
proxima illa et continens causa non moveat adsensionem, vide, ne
idem dicant. Neque enim Chrysippus, concedens adsensionis proximam
et continentem causam esse in viso positam, [neque] eam causam esse
ad adsentiendum necessariam concedet, ut, si omnia fato fiant, omnia
causis fiant antecedentibus et necessariis; itemque illi, qui ab hoc
dissentiunt confitentes non fieri adsensiones sine praecursione
visorum, dicent, si omnia fato fierent eius modi, ut nihil fieret
nisi praegressione causae, confitendum esse fato fieri omnia; ex quo
facile intellectu est, quoniam utrique patefacta atque explicata
sententia sua ad eundem exitum veniant, verbis eos, non re
dissidere. Omninoque cum haec sit distinctio, ut quibusdam in rebus
vere dici possit, cum hae causae antegressae sint, non esse in
nostra potestate, quin illa eveniant, quorum causae fuerint,
quibusdam autem in rebus causis antegressis in nostra tamen esse
potestate, ut illud aliter eveniat, hanc distinctionem utrique
adprobant, sed alteri censent, quibus in rebus, cum causae
antecesserint, non sit in nostra potestate, ut aliter illa eveniant,
eas fato fieri; quae autem in nostra potestate sint, ab iis fatum
abesse . . . .
XX. Hoc modo hanc
causam disceptari oportet, non ab atomis errantibus et de via
declinantibus petere [269] praesidium. “Declinat”, inquit, “atomus”.
Primum cur? aliam enim quandam vim motus habebant
a Democrito
inpulsionis, quam plagam ille appellat, a te, Epicure, gravitatis et
ponderis. Quae ergo nova causa in natura est, quae declinet atomum?
aut num sortiuntur inter se, quae declinet, quae non? aut cur minimo
declinent intervallo, maiore non? aut cur declinent uno minimo, non
declinent duobus aut tribus? Optare hoc quidem est, non
disputare. Nam neque extrinsecus inpulsam atomum loco moveri et
declinare dicis, neque in illo inani, per quod feratur atomus,
quicquam fuisse causae, cur ea non e regione ferretur, nec in ipsa
atomo mutationis aliquid factum est, quam ob rem naturalem motum sui
ponderis non teneret. Ita cum attulisset nullam causam, quae istam
declinationem efficeret, tamen aliquid sibi dicere videtur, cum id
dicat, quod omnium mentes aspernentur ac respuant. Nec vero
quisquam magis confirmare mihi videtur non modo fatum, verum etiam
necessitatem et vim omnium rerum sustulisseque motus animi
voluntarios, quam hic, qui aliter obsistere fato fatetur se non
potuisse, nisi ad has commenticias declinationes confugisset. Nam,
ut essent atomi, quas quidem esse mihi probari nullo modo potest,
tamen declinationes istae numquam explicarentur. Nam si atomis, ut
gravitate ferantur, tributum est necessitate naturae, quod omne
pondus nulla re inpediente moveatur et feratur necesse est, illud
quoque necesse est, declinare, quibusdam atomis vel, si volunt,
omnibus naturaliter . . . . |
XVI. Les partisans de Diodore disent qu'il faut reconnaître une
grande différence entre le fait qui est seulement la condition de
l'existence d'un autre fait, et celui qui détermine nécessairement
cette existence. On ne peut appeler cause ce qui ne produit pas, par
sa propre vertu, l'effet dont il est réputé cause; on ne peut donc
appeler 271 cause ce qui est
simplement la condition de l'existence d'un fait; mais seulement ce
qui, par sa seule présence, produit nécessairement l'événement dont
il est cause. Avant que Philoctète eût été mordu par un serpent
venimeux, quelle cause y avait-il dans la nature des choses pour
qu'il fût abandonné à Lemnos? Mais, après cette morsure, son abandon
eut une cause prochaine et très-rapprochée de l'événement; c'est la
nature de l'événement qui nous en dévoile la cause. Cependant, de
toute éternité, cette proposition fut vraie: «Philoctète sera
abandonné dans une île;» et il fut toujours impossible que de vraie
elle devint fausse. Car il est nécessaire que, entre deux
contradictoires (j'appelle ici contradictoires deux propositions
dont l'une affirme une chose que l'autre nie), il est nécessaire,
disons-nous, qu'entre deux propositions de ce genre, malgré le
sentiment d'Épicure, l'une soit vraie, et l'autre fausse; ainsi, de
toute éternité, cette proposition: «Philoctète guérira, était
vraie,» et celle-ci: «Il ne guérira pas,» était fausse. A
moins toutefois que nous ne voulions nous ranger à l'opinion des
Épicuriens, qui soutiennent que de telles propositions ne sont ni
vraies ni fausses; mais bientôt, rougissant d'une telle absurdité,
ils viennent à dire,ce qui est plus absurde encore, qu'en opposant
deux propositions contradictoires, il faut avouer que l'une des deux
est vraie; mais que, à les considérer isolément, ni l'une ni l'autre
ne sont vraies. Il est difficile de croire que l'impudence et
l'ignorance de la logique puissent aller plus loin. Comment ne
voient-ils pas que déclarer qu'une proposition n'est ni vraie ni
fausse, c'est avouer qu'elle n'est pas vraie, partant qu'elle est
fausse? ou bien qu'elle n'est pas fausse, partant qu'elle est vraie?
La maxime défendue par Chrysippe, que toute proposition est ou vraie
ou fausse, me semble donc au-dessus de toute contestation; et l'on
doit en conclure que certaines choses sont vraies de toute éternité,
sans être pour cela le résultat d'une série infinie de causes
naturelles et l'œuvre de la fatalité.
XVII. La vérité est, si je ne me trompe, que, entre les deux
doctrines opposées des anciens philosophes, l'une qui établissait le
gouvernement absolu du Destin et l'empire de la nécessité, et dont
les principaux partisans furent Démocrite, Heraclite, Empédocle et
Aristote; l'autre qui affranchissait de cet empire les mouvements
volontaires de l'âme; Chrysippe, en arbitre conciliateur, a voulu
partager le différend par la moitié, mais a penché pour ceux qui
ôtent aux mouvements de l'âme les liens de la nécessité.
Malheureusement il s'embarrasse dans son langage, il prête bientôt
le flanc aux partisans de la fatalité, et leur donne des armes
contre lui-même. Choisissons, pour nous en convaincre, une des
premières questions que j'aie traitées, celle du consentement. Les
anciens philosophes, qui admettaient la fatalité universelle,
disaient que le consentement est nécessaire et forcé. Ceux qui
professaient le sentiment contraire niaient l'empire de la fatalité
sur le consentement, et prétendaient que si l'on soumettait le
consentement au Destin, on le rendait inévitablement nécessaire.
Voici comme ils raisonnaient: «Si tout arrive fatalement,
tout se fait en vertu de causes externes et efficientes; si notre
propre impulsion est dans cette condition-là, tout ce qui vient
ensuite de notre impulsion y est en même sorte,
272 par conséquent le
consentement s'y trouve. Mais si la cause de notre impulsion propre
n'est pas en nous, l'impulsion elle-même n'est pas en notre pouvoir.
S'il en est ainsi, rien de ce qui suit l'impulsion ne dépend de
nous. Donc, notre consentement et nos actions ne sont pas en notre
pouvoir: d'où il résulte que la louange et le blâme, les honneurs et
les supplices sont des contresens.» Mais ce sont là des conséquences
absurdes, dont il est vraisemblable de conclure que tout ce qui se
fait ne se fait pas fatalement.
XVIII. Chrysippe, qui rejette la nécessité et qui veut cependant que
rien n'arrive sans causes antécédentes, établit une distinction
entre les causes,pour éviter la nécessité et retenir le Destin.
Parmi les causes, dit-il, les unes sont parfaites et principales,
les autres auxiliaires et prochaines; c'est pourquoi quand je dis
que tout arrive en vertu de causes antécédentes, je n'entends pas
que ce soient des causes parfaites et principales, mais seulement
des causes auxiliaires et prochaines. Il répond ainsi à l'argument
que je rapportais tout à l'heure: «Si tout se fait par le Destin,
dit-il, il en résulte bien que tout se fait en vertu de causes
antécédentes, mais non pas que ces causes soient principales et
parfaites; il suffit qu'elles soient auxiliaires et prochaines.
Elles ne sont pas en notre puissance, il est vrai; mais on ne doit
pas en conclure que notre impulsion n'est pas eu notre puissance.
Cette conclusion ne serait fondée que si nous parlions de causes
parfaites et principales; alors seulement, ces causes n'étant pas en
notre puissance, il serait vrai que notre impulsion ne nous
appartiendrait pas non plus. Ainsi donc l'argument que je combats
n'a de force que contre ceux qui admettent à la fois le Destin et
l'efficacité nécessaire des causes; mais il ne prouve rien contre
ceux qui, tout en recevant des causes antécédentes, ne les font ni
principales ni parfaites.» Quant à la difficulté qui reste encore,
lorsqu'on rattache le consentement à des causes précédentes,
Chrysippe pense qu'il la résoudra facilement. Voici de quelle
manière: «Quoiqu'il ne puisse y avoir de consentement sans une
perception qui nous remue, cependant, dit-il, la perception n'est
que la cause prochaine et non pas efficiente du consentement, qui se
trouve alors dans une condition dont nous avons déjà parlé: il ne
peut se produire sans l'excitation d'une cause étrangère, (car il
n'y a point de consentement sans perception; mais il se produit
comme se meut un cylindre et un sabot. (C'est la comparaison
familière de Chrysippe.) Il faut que l'on chasse le sabot pour qu'il
tourne; mais une fois lancé, il continue à tourner de sa propre
impulsion.»
XIX. «Celui qui chasse le sabot le met en mouvement, mais ne lui
donne pas sa volubilité.» Ainsi, toujours selon Chrysippe,
l'objet de la perception imprime et grave en quelque sorte son image
en notre âme, mais notre consentement reste en notre pouvoir; notre
volonté reçoit, comme le sabot, une impulsion du dehors; mais c'est
en vertu de sa propre nature, et spontanément, qu'elle suit cette
impulsion. Si quelque événement arrivait sans cause antécédente, il
serait faux que le Destin réglât tout; mais s'il est raisonnable
d'accorder que tout fait a sa cause qui le précède, comment se
défendre de cette conséquence légitime que tout se fait par le
Destin? pourvu toutefois que l'on ne perde jamais de vue la
distinction qui a été établie entre 273 les causes. — Voilà les explications de Chrysippe. Ceux qui
prétendent que le Destin ne détermine pas notre consentement, et qui
nient en même temps que le consentement ne puisse se produire que
provoqué par une perception, ceux-là soutiennent véritablement une
autre thèse; mais ceux qui accordent que le consentement est
toujours provoqué par la perception, et qui cependant veulent
soustraire le consentement à la loi du Destin, me semblent fort
n'avoir pas d'autre sentiment que Chrysippe. Celui-ci, tout en
décidant que la cause prochaine et déterminante du consentement est
la perception, n'accorde pas qu'elle en soit la cause nécessaire;
et, lorsqu'il prétend que tout se fait par le Destin, il n'entend
pas que tout arrive en vertu de causes antécédentes et nécessaires.
Ceux qui, sans admettre le Destin, accordent qu'il n'y a de
consentement qu'à la condition d'une perception antérieure,
conviendront facilement que si l'on entend par Destin seulement la
préexistence d'une cause comme condition indispensable d'un fait, à
ce compte le Destin règne partout. On voit donc clairement que les
deux doctrines, lorsqu'elles s'expliquent, aboutissent aux mêmes
conclusions, et que si elles diffèrent dans les termes, au fond
elles expriment la même pensée. Voici en peu de mots toute la
question: D'abord y a-t-il une distinction entre les causes? et
peut-on dire que, dans certains cas, les causes préexistantes ne
laissent rien en notre pouvoir, et déterminent nécessairement leurs
effets; tandis que dans d'autres circonstances, maigre l'influence
des causes externes, nous sommes toujours les maîtres de suivre la
direction qui nous! plaît? Les deux partis s'accordent à établir
cette distinction; mais les uns pensent que tout ce qui se passe en
nous en vertu de causes préexistantes, et sans qu'il soit en notre
pouvoir d'y rien changer est l'œuvre du Destin, tandis que ce dont
nous sommes maîtres lui échappe.
XX. C'est ainsi qu'il faut résoudre la difficulté, au lieu d'appeler
à son aide des atomes errants et déviés. L'atome décline, dit
Épicure; et d'abord pourquoi? Je sais que les atomes ont un certain
mouvement d'impulsion (πλήγη) selon Démocrite; de
gravité et de pesanteur, selon vous-même, Épicure. Quelle est donc
cette nouvel le cause naturel le qui donne aux atomes un mouvement
de déclinaison? Est-ce que les atomes tirent au sort pour savoir
lequel déclinera, lequel conservera la ligne directe? Pourquoi cette
mesure infiniment petite de déclinaison, et non pas une plus grande?
et pourquoi seulement ce degré insaisissable, et non pas deux ou
trois degrés? C'est là trancher les questions, mais non les
résoudre; car vous n'expliquez la déclinaison de l'atome, ni par une
impulsion qu'il recevrait du dehors, ni par l'influence
qu'exercerait sur lui le vide dans l'immensité duquel il est
emporté, ni par un changement survenu dans l'atome lui-même. Il
renonce tout à coup à suivre la direction que lui imprime son
mouvement naturel; pourquoi? sans raison; vous n'en donnez aucune.
Et cependant Épicure croit mettre au monde quelque chose qui en
vaille la peine, quand il produit cette ridicule invention qui
répugne au bon sens. Pour moi, il me semble que si le Destin, et
mieux encore l'aveugle fatalité, la nécessité absolue de toutes
choses, ont un défenseur, et la liberté un ennemi, c'est bien ce
philosophe qui déclare qu'on ne peut échapper à la fatalité qu'en
recourant à cette déclinaison chimérique. Je veux
274 bien supposer qu'il y ait des
atomes, ce qui ne me sera jamais démontré, cette déclinaison n'en
restera pas moins éternellement inexplicable, si les atomes ont reçu
naturellement de leur gravité une impulsion qui les entraîne
nécessairement de haut en bas, parce que tout corps pesant, qui ne
rencontre pas d'obstacle, se meut et tombe par une loi nécessaire;
il faut aussi que le mouvement de déclinaison soit imprimé
nécessairement par la nature à certains atomes, ou même à tous,
s'ils le veulent.
Lacune considérable.
|
|
274
NOTES SUR LE TRAITÉ DU DESTIN.
I.
Ratioque enuntiationum, quœ Grœci.... Les Grecs appelaient
axiomes les propositions relatives aux événements futurs. Il
y avait deux opinions célèbres sur la nature des possibles:
celle de Chrysippe qui soutenait qu'un événement, pour être
possible, n'a pas besoin d'être actuellement réel, ou de devoir
l'être un jour; et celle de Diodore qui prétendait que tout
événement qui n'est pas arrivé ou ne doit pas se produire est
impossible, et que par conséquent il n'y a de possible que ce qui
sera. Entre ces deux opinions Cicéron avait choisi, sans qu'on en
voie trop la raison, celle de Diodore. Il l'écrivait à Varron, de sa
maison de Tusculum: «Sachez que sur la question des possibles je
suis du sentiment de Diodore. C'est pourquoi, si vous devez venir,
apprenez qu'il est nécessaire que vous veniez; mais si vous ne devez
pas venir, votre arrivée ici est dans l'ordre des choses
impossibles.» Ep. famil., ix, 47.
Totaque est logicœ.
La question des possibles appartient à la logique. Aristote en a
traité dans le livre de l'Interprétation. Il est facile de
voir qu'elle a un grand rapport avec la question plus grave du
Destin. Les possibles sont ce qu'on appelle dans la
philosophie moderne les futurs contingents.
Hirtiusque noster consul désignatus.
Cicéron donnait des leçons d'éloquence à Hirtius et Dolabella. Il
dit lui-même: «Hirtium ego et Dolabellam dicendi discipulos habeo,
cœnandi magistros. Puto enim te audisse, si forte ad vos omnia
perferuntur, illos apud me declamitare, me apud eos cœnitare.»
Ep. famil., ix, 16.
Et magis vacuo ab interventoribus die.
Cicéron est le seul auteur latin qui se soit servi du mot
interventor, dans la signification que nous lui donnons. Ce mot
ne se trouve même que dans ce seul endroit de ses ouvrages. Dans
Lampride (Commod. c. 4), et dans le droit romain, il a
d'autres acceptions. (Note empruntée à M. J. V. Le Clerc.)
II.
Cum hoc genere philosophiœ.... magnam habet orator socieiatem.
Il faut rapprocher de ce passage la déclaration faite par
Cicéron dans son livre de l'Orateur, que c'est à ses études, et a
son système philosophique surtout, qu'il doit son talent et ses
succès oratoires. «Fateor me oratorein, si modo sim, aut etiam
quicumque sim, non es rhetorum officinis, sed ex Academiæ spatiis
exatifisse.» Orat. c. 3.
Sed quoniam rhetorica mihi.
Nous avons suivi la leçon: «rhetorica mihi vestra,» qui est
donnée par quelques manuscrits, et qui nous paraît incontestablement
la vraie
Indicant le suscepisse Tusculanœ disputationes.
«J'ai osé tenir des conférences philosophiques, à la manière des
Grecs; et dernièrement, après que vous fûtes parti de Tusculum,
comme plusieurs amis s'y trouvaient avec moi, j'essayai mes forces
dans ce genre. C'est ainsi que ces déclamations d'autrefois, où
j'avais pour but de me former an barreau, et dont j'ai continué
l'usage plus longtemps que personne, fout place aujourd'hui à des
déclamations de vieillard. Je faisais donc proposer la thèse sur
laquelle on voulait m'entendre; je discourais là-dessus, assis ou en
me promenant...... Celui qui voulait m'entendre disait son
sentiment, moi ensuite je l'attaquais. Telle était, vous le savez,
la méthode de Socrate, qui la regardait comme le plus sûr moyen de
parvenir à démêler où est le vraisemblable. Tuscul. I, 4.
Sed ita audies, ut Romanum hominem.
Avant Cicéron les Romains s'étaient peu occupés d'études
philosophiques, et n'y avaient que médiocrement réussi. Si l'on
excepte Lucrèce, dont le talent poétique a donné un éclat immortel
au plus méchant des systèmes, on ne compte guère dans la littérature
philosophique que de pauvres auteurs, comme Amalinius, et de
pitoyables ouvrages dont nous sommes heureusement privés, et que
Cicéron qualifie très-sévèrement eu plusieurs endroits de ses
Dialogues.
III.
Consideramus hic. L'ouvrage est interrompu. Quelle est
au juste l'importance de la partie qui nous manque; il serait
impossible de le dire. La suite du discours nous apprend que, dans
cette première partie, Cicéron avait développé et discuté plusieurs
questions. Il est certain que les arguments présentés par Posidonius
en faveur du Destin y étaient exposés, et le texte reprend au moment
où Cicéron dit avec retenue et finesse ce qu'il faut penser de ces
arguments. — Posidonius d'Apamée, qui s'était fait citoyen de
Rhodes, avait été l'un dus maîtres de Cicéron, qui conserva toujours
avec lui des relations fort suivies.
Ut in Antipatro poeta.
«Le poète Antipater, surnommé le Sidonie, toutes les années, le jour
de sa naissance 275 seulement,
éprouvait un accès de fièvre. Parvenu à un âge très-avancé, il
mourut de cette maladie périodique, le jour même qui ramenait ce
double anniversaire.» Val. Max. 1, 8, ext. 16.— Pline, ii,
51.
III. Ut in brumali die natis. Cicéron dans le traité de la
Divination, 11, 14, parle de certains phénomènes physiques qui
arrivent régulièrement le jour du solstice d'hiver mais il ne nous
dit rien de l'influence que ce jour était censé avoir sur la
destinée des hommes, et nous n'en trouvons de mention dans aucun
auteur de l'antiquité.
Ut in simul œgrotantibus fratribus.
Ce fait nous a été conservé par saint Augustin. «Cicéron, dit ce
Père, raconte qu'Hippocrate, célèbre médecin, a laissé par écrit
qu'il avait vu deux frères tomber malades en même temps, empirer et
guérir ensuite simultanément, et que ce phénomène lui avait fait
soupçonner que ces deux frères étaient jumeaux. Posidonins,
philosophe stoïcien très-adonné à l'astrologie, assurait que ces
deux frères avaient été conçus et étaient nés sous la même
constellation.»
De Civil. Dei,
v, 2.
Ut in urina, ut in unguibus.
Il existe un ouvrage intitulé
οὐρομαντεία,
c'est-à-dire l'art de deviner par l'inspection de l'urine— La
figure, la couleur, les taches des ongles servaient de matière aux
conjectures des devins. Celse nous apprend que depuis longtemps déjà
les médecins en tiraient des pronostics, et les regardaient comme de
véritables symptômes. Voyez Pline, Hist. Nat., xxvi, 6.
Ut in illo naufrago.
Ce naufragé était un homme à qui l'oracle avait prédit qu'il
périrait dans les flots, cl qui, après avoir couru de grands dangers
sur mer, vint par étourderie se noyer dans un ruisseau.
Ut in Icadio, ut in Daphita.
Cicéron nous apprend plus loin à peu près tout ce que nous savons du
brigand Icadius, appelé Εἰκαδίος par Suidas «Daphitas
était sophiste, il avait un esprit mal fait et méchant. Un jour il
se rendit à Delphes, et par dérision il demanda à Apollon s'il
pourrait retrouver son cheval, quoiqu'il n'en eut jamais eu.
L'oracle répondit qu'en effet il trouverait un cheval, mais qu'il en
tomberait, et mourrait de sa chute. Comme il s'en retournait fort
content d'avoir trompé l'oracle, il tomba entre les mains du roi
Attale, qu'il avait souvent attaqué dans ses écrits satiriques, et
qui le fil précipiter du haut du rocher qui s'appelait le Cheval.
Le sophiste fut ainsi puni d'une démence qui allait jusqu'à
mépriser les Dieux.» Val. Max. i, 8, ext. 8.
Pace magistri dixerim.
Il
faut se rappeler que Cicéron avait reçu les leçons de Posidonius.
«Et principes illi Diodolus Philo, Antiochus, Posidonius, a quibus
institut! sumus.» Nat. Deo., i, 3.
Philippus hasce in capulo quadrigulas.
«Un oracle avait averti Philippe, roi de Macédoine, de se défier
d'un quadrige; qu'il y allait de ses jours. Le roi fit défendre les
quadriges dans tout son royaume, et évita toujours de passer près
d'un lieu de Béotie qui s'appelle Quadrige; et cependant il
ne put éviter le péril dont il était menacé. Car sur la garde de
l'épée avec laquelle Pausanias le tua, il y avait un quadrige
ciselé. «Val. Max. i, 8, ext. 9.
IV. Ad Chrysippi laqueos revertamur. Chrysippe est
généralement reconnu pour le plus subtil dialecticien de
l'antiquité, et, à défaut d'autres preuves, les chapitres suivants
de ce traité mettraient assez en évidence toute son habileté dans ce
genre d'escrime. On disait que si les Dieux avaient à se servir de
la dialectique, ils n'en emploieraient point d'autre que celle de
Chrysippe.
V. Stilponem, Megareum philosophum. Stilpon de Mégare nia la
valeur objective des idées de rapport, et la vérité des jugements
qui ne sont point identiques. Il fit consister le caractère du sage
dans l'apathie ou l'impossibilité. Tennemann. Voyez
sur Stilpon, Plutarque Ad Coleten, xiv, 174. Diog.,
H, 119.
VI. Cum Diodoro, valente dialectico. Diodore était un
dialecticien de l'école de Mégare; c'est lui qui avait reçu de
Ptolémée Soter le surnom de Κρόνος. Diogène Laërce
prétend que c'était un terme de mépris que lui adressait le roi,
étonné de le voir demeurer court devant Stilpon qui lui proposait à
résoudre des arguments captieux Diog. Laer. ii,11.
Si Fabius, oriente Canicula.
«Quand les Romains voulaient
dans leurs exemples parler d'une personne libre, ils employaient le
nom de Fabius. Cicéron, de Divinat., n, 34: «Q. fabi, te
mihi in auspicio esse volo.» Dans le traité des Topiques, 3:
«Si ita Fabice pecunia legata est a viro.» Quand ils
voulaient désigner un esclave, ils nommaient Manius. Caton, de Re
rustica, 141: «Cum divis volentibus, quodque bene eveniat,
manda tibi, Mani.» Turnèbe.
VII. Tu, et quœ; non sint futura posse fieri. Plutarque, à la
fin de son traité des Contradictions des Stoïqurs démontre
aussi que la doctrine de la fatalité admise par Chrysippe ne peut
s'accorder avec sa théorie des possibles. Voici le passage,
traduit par Amyot: «La doctrine touchant les choses possibles que
met Chrysippos, répugne directement contre celle de la destinée. Car
si le possible n'est pas, selon ce que dit Diodorus, ce qui est, ou
qui sera véritable, mais tout ce qui est susceptible de pouvoir
être, encore que jamais il ne doive être, cela est le possible: il y
aura beaucoup de choses possibles qui ne seront pas par destinée
invincible, inexpugnable, et qui est par-dessus toutes choses; ou
bien il faut qu'il détruise toute la force et puissance de la
destinée: ou bien, s'il est ainsi comme veut Chrysippos, ce qui sera
susceptible de pouvoir être tombera bien souvent en impossible, et
tout ce qui est vrai sera nécessaire, étant compris et contenu de la
plus grande nécessité de toutes; et tout ce qui est faux,
impossible, ayant la plus grande et plus puissante cause répugnante
à lui pour pouvoir être véritable. Car celui auquel il est destiné
de mourir en la mer, comment est-il possible que celui-là soit
susceptible de mourir en terre? Et comment est-il possible que celui
qui est à Mégare vienne à Athènes, étant empêché par la destinée?»
Necesse fuisse Cypselum regnare Corinthi.
Cypsélus était fils d'Eélion et de Labda. Cette princesse était de
la famille des Bacchiades, qui,depuis plusieurs siècles, exerçaient
à Corinthe le souverain pouvoir; mais étant venue au monde boiteuse
et difforme, aucun de ses parents ne voulut s'unir à elle, et elle
fut obligée de se choisir un époux dans une autre maison que la
sienne. Éétion, fils d'Echécrate, ne se montra pas si difficile que
les Bacchiades. Il accepta la main de Labda, et en eut un fils
auquel il donna le non de Cypsélus. Celui-ci, devenu grand, s'empara
de l'autorité à Corinthe, chassa les Bacchiades, et transmit le
trône à ses descendants. Longtemps avant la naissance de Cypsélus,
l'oracle avait annoncé en termes énigmatiques la révolution dont il
fut l'auteur; et les Bacchiades, à qui l'oracle avait été adressé,
n'en comprirent lien le sens que quand l'événement leur en eût donné
l'intelligence. Voyez Hérodote, v, 92. (Note empruntée à M. J. V. Le
Clerc.)
VIII. Falli sperat Chaldœos. Les Chaldéens étaient regardés
comme les plus anciens astronomes et les premiers astrologues. A
l'époque de Cicéron, tous ceux qui se mêlaient d'astrologie, de
quelque pays qu'ils fussent, étaient nommés Chaldéens.
IX. Morietur noctu in cubiculo suo Scipio vi oppressus.
Scipioa Émilien fut trouvé mort dans son lit le lendemain d'une
contestation fort violente qu'il eut avec Flaceus,
276 Carbon et Gracchus. Avant
cette mort étrange, il était plein de santé. Le bruit s'accrédita
que Carbon l'avait fait périr. Cicéron en parle dans une lettre à
Pétus, et l'on voit ici qu'il y ajoute une foi entière. D'autres
pensaient que Scipion avait été empoisonné par sa femme Sempronia,
sœur de Graccbus.
Nec magis necesse mori Scipionem, quam illo modo mori.
Nous avons adopté magis au lieu de minus, selon la correction
proposée par Ramus.
Ut sine causa fiat aliquid. Épicure
ne donnait aucune raison du mouvement de déclinaison des atomes.
X. Tertius quidam motus oritur. Épicure admettait trois
espèces de mouvements, à ce que nous apprend Plutarque; le mouvement
perpendiculaire, ,κατὰ σταθμὴν; le mouvement de
déclinaison, κατὰ παρέγκλισιν, et le mouvement
déterminé par le choc κατὰ πληγήν. Démocrite n'avait
jamais songé à la déclinaison, imaginée par Épicure; et n'admettait
qu'une sorte de mouvement primitif en ligne perpendiculaire,
impulsion naturelle qu'il nommait πληγή.
XIV. Marcellum eum, qui ter consul fuit.... Le Marcellus dont
il est ici question était petit-fils du célèbre Marcellus qui prit
Syracuse l'an de Rome 541. Il périt dans un naufrage peu avant la
première guerre punique. Voyez de Divinat. 5, in Pison.
19.
XVII. Inquo sententia...... Aristoteles fuit.
Gassendi, à qui nous devons des éclaircissements si précieux sur la
philosophie d'Épicure, pense que Cicéron s'est trompé en mettant
Aristote au nombre des partisans de la nécessité. Il prétend que ce
philosophe n'a admis que la nécessité hypothétique ou
conditionnelle. (Note empruntée à M. J. V. Le Clerc.)
In assensionibus quas prima oratione tractavi.
Cicéron parlait du consentement dans la première partie de
l'ouvrage, qui est perdue pour nous. Ce chapitre et les deux
suivants nous font assez connaître quelle doctrine il pouvait
exposer sur ce sujet, et avec quel esprit il le traitait.
XVIII. Chrysippus autem, quum et necessitalem improtaret.....
Aulu-Gelle nous a conservé les raisonnements dont se servait
Chrysippe pour concilier la liberté de l'homme et la fatalité; comme
il avait eu très-probablement les ouvrages de Chrysippe sous les
yeux, le résumé qu'il nous présente est d'un grand prix pour
l'histoire des sectes anciennes, et peut être rapproché avec quelque
intérêt du traité de Cicéron, si malheureusement mutilé. L'analyse
d'Aulu-Gelle forme le second chapitre du sixième livre des Nuits
Attiques: en voici la traduction:
«Comment Chrysippe a pu établir l'influence et la nécessité du
Destin, et laisser cependant à l'homme la liberté de ses jugements
et de ses résolutions.
«Voici à peu près en quels termes Chrysippe, ce prince de la
philosophie stoïcienne, définit le Destin, que les Grecs nomment
πεπρωμένην, ou εἱμαρμένην. «Le Destin
est, dit-il, la série ou plutôt «la chaîne éternelle, et qu'on ne
peut rompre, de toutes choses au monde, chaîne qui se replie et
s'enveloppe en des orbes sans fin, tous dépendants les uns des
autres.» Je joins ici les propres paroles de Chrysippe autant que ma
mémoire peut me les rappeler, afin que l'on ait la liberté de
recourir au texte si l'on trouve de l'obscurité dans ma traduction.
Voici le passage tiré du quatrième livre de la Providence (περὶ
προνοίας):
Εἱμαρμένη, φυσικὴ σύνταξις τῶν ὅλων ἐξ ἀιδίου τῶν ἑτέρων
τοῖς ἑτέροις ἐπακολουθούντων, καὶ μετὰ πολὺ μὲν οὖν
ἀπαραβάτου οὔσης τῆς τοιαύτης συμπλοκῆς.
«Les philosophes des autres sectes attaquent ainsi la définition et
la pensée de Chrysippe. Si Chrysippe est convaincu, disent-ils, que
tout est gouverné et décidé par le Destin, qu'on ne peut échapper à
son empire, et qu'il n'y a place pour aucun événement en dehors de
ses tourbillons; il ne faut point s'indigner contre les fautes et
les crimes des hommes, il ne faut point les imputer à leur propre
volonté, mais à la nécessité et à la violence que leur fait le
Destin. La fatalité la plus absolue règne en despote sur le monde,
elle ordonne et dispose tout; par conséquent les supplices infligés
par les lois aux coupables sont pleins d'iniquité, puisque ce n'est
point de leur libre mouvement que les hommes se portent au crime,
mais qu'ils y sont entraînés par le Destin.
«Chrysippe répond par une foule de distinctions et d'arguments
subtils; voici en résumé tout ce qu'il a écrit sur la question:
«Quoiqu'il soit vrai que des causes prévalentes déterminent
nécessairement tous les événements du monde, qui sont enchaînés par
la loi du Destin, cependant nos âmes ne sont soumises à cette loi
que conformément à leur nature propre et à leurs qualités
originelles. Si naturellement elles sont douces et bonnes, le
Destin, qui fond sur elles de toute sa puissance, ne les peut
contraindre qu'à des actions bienveillantes ou tout au moins
inoffensives. Mais si leur génie est rude, ignorant, grossier, si
les arts et la discipline ne les aident ni ne les retiennent, que le
Destin les frappe seulement d'un coup léger, qu'il les épargne même,
leur emportement naturel, leur perversité native les précipite dans
des erreurs et des fautes qui se succèdent sans relâche. Et s'il en
est ainsi, c'est en vertu de cet enchaînement naturel et nécessaire
des choses qu'on appelle Destin. Car c'est une sorte de nécessité
irrésistible qui entraîne les mauvaises âmes, de leur propre
mouvement, en des fautes et des erreurs sans lin. Pour le faire
entendre, Chrysippe se sert d'un exemple qui est bien choisi et fort
ingénieux. De même, dit-il, que celui qui lance un cylindre de
pierre sur un terrain incliné lui donne effectivement le premier
branle, mais qu'ensuite le cylindre poursuit sa course, emporté par
sa propre impulsion, et cédant à sa mobilité naturelle; ainsi la loi
de la nécessité et l'ordre des destins influent d'une manière
générale sur les causes et les principes de nos actions; mais nos
desseins, nos conseils, nos actions elles-mêmes demeurent toujours
au pouvoir de notre volonté, et reçoivent l'empreinte des qualités
de notre âme.» Il dit ensuite en propres termes, et conformément à
ce que nous venons de rapporter: «De là cette maxime des Épicuriens:
Les hommes sont eux-mêmes les artisans de leurs maux. «Ainsi
tout ce que nous souffrons vient de nous; nos infortunes sont la
conséquence de nos fautes. Nous sommes malheureux, parce que nous le
voulons.» En conséquence, Il soutient qu'on ne doit ni écouter ni
souffrir ces méchants ou ces lâches qui osent, lorsqu'on les
surprend en flagrant délit, lorsqu'on les convainc de quelque crime,
recourir au dogme de la fatalité, comme un coupable cherche un asile
dans le temple des Dieux, et prétendre qu'on ne doit pas imputer
leurs détestables actions à leur perversité, mais au Destin. Le plus
sage et le plus ancien des poètes a dit le premier: «Quel reproche
insensé les mortels font aux Dieux! ils disent que leurs maux
viennent de nous; et c'est leur perversité qui seule, et sans la
complicité du Destin, est la source de leurs infortunes.»
«Cicéron, dans son livre du Destin, déclare que cette
question est une des plus obscures et des plus embarrassées, et il
exprime l'opinion que Chrysippe est loin d'en avoir résolu les
difficultés. Chrysippe, dit-il, se donne toutes les peines
imaginables pour concilier la fatalité universelle et la liberté de
nos actions; mais on l'arrête par ces redoutables objections.»
Revertitur ad cylindrum.
Voyez pour la comparaison du cylindre la note précédente.
XX. A Democrito impulsionis. Voyez le chapitre 10, et la note
sur les mouvements des atomes. |
|
|
|