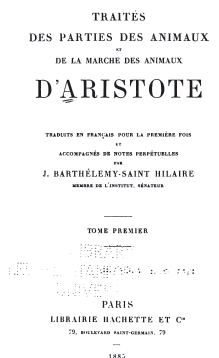
ARISTOTE
PARTIES DES ANIMAUX
PREFACE.
Livre I
PARTIES DES ANIMAUX
PRÉFACE
|
TRAITÉS DES PARTIES DES ANIMAUX ET DE LA MARCHE DES ANIMAUX D'ARISTOTE TRADUITS EN FRANÇAIS POUR LA PREMIÈRE FOIS ET ACCOMPAGNÉS DE NOTES PERPETUELLES PAR J. BARTHELEMY-SAINT HILAIRE MEMBRE DE L'lNSTlTUT, SÉNATEUR ---------------- TOME PREMIER PARIS LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie 79, BOULEVARD SAIMT-GERMAIX, 79 ---- 1885 A LA MÉMOIRE D'EMILE LITTRÉ L'AMI DE TOUTE MA VIE
JE CONSACRE CETTE TRADUCTION D'ARISTOTE où J'AI CITÉ BIEN SOUVENT SES ADMIRABLES TRAVAUX SUR HlPPOCRATE ET SUR PLINE
BARTHÉLEMY-SAINT HILAIRE
PRÉFACE Place du traité des Parties des Animaux dans le système zoologique d'Aristote; caractère de cet ouvrage de physiologie comparée; analyse de ses quatre livres; la physiologie avant Aristote ; physiologie de Platon dans le Timée ; successeurs d'Aristote : Cicéron, Celse, Sénèque, Pline, Rufus, Galien, Oribase, Mundino, Vésale, Faloppe, Eustachi, Ambroise Paré, Fabrice d'Acquapendente, Harvey, Descartes, Thomas Willis, Linné, Buffon, Vicq d'Azyr, Bichat, Haller, Cuvier, Jean Muller, Agassiz, Claude Bernard, M. H. Milne-Edwards; résumé de l'histoire de la physiologie; définition de l'histoire naturelle; divisions de la zoologie générale, en zoologie descriptive, anatomie comparée, et physiologie comparée; ordre respectif de ces trois sciences ; l'anatomie est la première ; la physiologie est la dernière ; elle devient surtout expérimentale ; ressources actuelles de la science; deux erreurs peuvent la compromettre, le transformisme et l'athéisme; objections contre ces deux théories décevantes; rapports de la philosophie et des sciences; conclusion sur Aristote et sur la physiologie comparée. Quelle place le traité des Parties des Animaux tient-il dans la zoologie d'Aristote ? Marquons-le tout d'abord ; nous marquerons ensuite la place que ce traité occupe dans II l'histoire de la science, dont il est le fondement et dont il a préparé tous les progrès. Selon le témoignage même de l'auteur, le traité des Parties vient après l'Histoire des Animaux, et il précède le traité de la Génération, complément de toutes les investigations antérieures, de même que, dans l'ordre de la nature, l'acte de la génération est la fonction suprême de l'être animé, qui ne s'est développé que pour transmettre la vie, qu'il a reçue sous une certaine forme, à des êtres qui la perpétueront sous la même forme que lui. Placé ainsi entre la description des animaux, telle qu'Aristote l'a conçue, et la théorie de leur reproduction, le traité des Parties n'est pas moins qu'une œuvre de physiologie et d'anatomie, considérées dans toute la série animale. Sans doute, cet ouvrage, composé il y a vingt-deux siècles, est pour nous beaucoup moins instructif que ceux qui de nos jours justifient le beau titre de physiologie comparée et d'anatomie comparée, en nous apprenant où en est actuellement la science qui s'efforce de pénétrer le mystère de la vie ; mais le traité des Parties, tout ancien qu'il est, quelque insuffi- III sant qu'il puisse paraître, n'en mérite pas moins pour toujours cette pieuse vénération que les fils reconnaissants doivent à des ancêtres sans lesquels ils n'eussent rien été. Un regard impartial et respectueux jeté sur ce passé reculé peut en outre nous servir à prévoir quelque chose de l'avenir et des conquêtes que la science se promet encore ; car celles qu'elle a déjà faites lui enseignent la voie qu'elle est tenue d'adopter pour en faire de nouvelles, et pour ne point s'égarer. Physiologie comparée, anatomie comparée ! Ces mots sembleront peut-être bien ambitieux quand on les entend attribuer à cet antique monument. Mais il n'y a point à s'y tromper : si le génie grec n'a pas inventé le mot, il a fait la chose; ce qui est mieux. Le traité des Parties le prouverait, fût-il isolé ; mais, loin d'être seul, il n'est qu'un fragment d'un vaste système. Sans parler du Traité de l'Âme, qui est une. théorie du principe vital depuis la plante jusqu'à l'homme, Aristote a fait une foule d'opuscules physiologiques, parmi lesquels le traité des Parties est seulement le plus significatif de tous. Tels sont les traités de la Sen- IV sation et des choses sensibles, du Sommeil et de la veille, y compris les rêves, du Mouvement dans les animaux, de la Longévité et de la brièveté de la vie, de la Jeunesse et de la vieillesse, de la Respiration dans tous les êtres doués de cette faculté, de la Marche des animaux, sous ses aspects divers, progression bipède et quadrupède, vol, ondulation, reptation, natation, etc. Tous ces traités, et quelques autres dont nous ne connaissons que les titres, sans savoir ce qu'ils renfermaient, ne sont-ils pas, précisément, de la physiologie comparée ? Aristote n'a-t-il pas appuyé cette physiologie sur une anatomie, qui est moins étendue et moins exacte que la nôtre, mais qui était tout aussi curieuse de la vérité et tout aussi attentive ? N'avait-il pas fait des descriptions et des dessins anatomiques, qui malheureusement ne sont pas arrivés jusqu'à nous, mais auxquels il se réfère sans cesse, pour éclaircir ce qu'il décrit et pour parler aux yeux en même temps qu'aux intelligences? D'autres traités encore, comme celui de la Nutrition, sont également perdus. Mais ce nombre extraordinaire d'œuvres conservées V et d'œuvres que le temps nous a ravies, atteste que nous n'exagérons pas, en parlant de la physiologie comparée d'Aristote, comme nous le ferions d'un cours professé par quelque membre de notre Institut national, dans un de nos établissements publics. Voyons en effet ce qu'est le traité des Parties, et résumons-en les principaux traits. Le premier de ses quatre livres est entièrement consacré à la question de la méthode en histoire naturelle. Cette discussion préliminaire est indispensable au frontispice d'un ouvrage où l'on se propose de passer en revue les fonctions principales des animaux, et d'expliquer le mécanisme de toutes celles qui leur sont communes. Il y a très peu de naturalistes parmi les Modernes qui aient songé à prendre ce soin, quelque utile qu'il soit ; c'est que, pour en sentir l'importance, le naturaliste doit être philosophe ; et quand on voit Aristote s'empresser, avec tant de sollicitude et de sagesse, d'établir la méthode qu'il va suivre, on se rappelle que c'est lui qui est le père de la logique. Les règles qu'il trace sont encore celles qui dominent la science, VI non moins vraies, après tant de siècles d'épreuves, qu'au moment même où il les a découvertes et pratiquées. La première de ces règles, c'est que l'histoire naturelle doit, pour connaître la vie chez les animaux, étudier les fonctions et les organes par lesquels ces fonctions s'accomplissent, et non pas les espèces d'animaux où on les observe. En s'attachant à étudier les espèces, on se perdrait dans le dédale de répétitions, qui deviendraient bientôt aussi obscures que fastidieuses. Si, après Aristote, on interroge à travers les âges les plus célèbres représentants de la science, Galien, Mundino, Vésale, Fallope, Eustachi, Paré, Harvey, Haller, Cuvier, Jean Muller, et, parmi nos contemporains, M. Henri Milne-Edwards, on se convainc que cette règle n'a rien perdu de son empire. Elle résulte de la nature des choses et elle régit souverainement la science, toutes les fois que la science se rend compte d'elle-même, et qu'elle veut prudemment s'enquérir de ce qu'elle fait. Mais pourquoi est-il préférable de choisir les fonctions plutôt que les espèces ? La réponse est bien simple : c'est VII que le nombre des fonctions est fort restreint, tandis que les espèces sont à peu près innombrables ; remarque déjà très juste dès le temps d'Aristote, et qui le devient chaque jour davantage, à mesure que le nombre des espèces s'accroît de manière à désespérer toutes les classifications. Pour les fonctions, au contraire, le champ est limité, et nous n'avons pas à craindre qu'il s'étende indéfiniment. Nutrition, circulation, respiration, sécrétion, génération, etc., fonctions de vie végétative; nerfs, sens, mouvements, voix, intelligence, instincts, fonctions de vie animale ou de relations, voilà tout le cercle, ou peu s'en faut, dans lequel se meuvent nécessairement la physiologie comparée et l'anatomie comparée. Ce cercle ne saurait être changé. Dans notre xixe siècle, Cuvier est d'accord avec son prédécesseur : mouvement, sensations, digestion, circulation, respiration, voix, génération, sécrétions et excrétions, telles sont les divisions de son admirable ouvrage d'Anatomie comparée. Ne reconnaît-on pas les divisions qu'Aristote a posées ? A cette première règle, il en joint une autre, VIII qui est beaucoup plus compréhensive, et qui s'adresse à la science dans son domaine immense et dans toutes ses applications. Cette règle fondamentale prescrit d'observer les faits avant de tenter l'explication des causes, parce qu'il n'y a de théories certaines que celles qui s'appuient sur des observations bien faites. Pour nous, cette recommandation est une banalité ; mais ce n'en était point une au quatrième siècle avant notre ère, en face des sciences telles qu'on les cultivait alors. Placer l'observation avant tout est un axiome tellement évident et reconnu qu'il semblerait assez inutile d'en rappeler l'origine et l'usage. Néanmoins, tant que les Modernes, peu soucieux d'un passé à qui ils doivent tant, s'obstineront à se faire gloire de ce précepte, qui daterait de Bacon soi-disant, il sera bon de réveiller un souvenir qui remonte au génie grec, et qui ne devrait plus lui être contesté, ne fût-ce que pour l'honneur de l'esprit humain, toujours identique à lui-même, et toujours conséquent. Troisième règle, non moins sûre et non moins féconde que les précédentes : il faut IX considérer les êtres dans ce qu'ils sont en eux-mêmes, c'est-à-dire dans leur essence et leur organisation, et non dans leur matière, comme le faisaient les premiers philosophes, avant que Démocrite et Socrate n'eussent imprimé à l'étude de la nature une direction meilleure, en cherchant à bien définir les êtres. A ce point de vue, Cuvier n'est encore que l'écho du naturaliste grec, quand il déclare que la forme du corps vivant lui est plus essentielle que sa matière (Règne animal, tome I, p. 11, édit. de 1829) ; et quand il divise les animaux en quatre types selon leur organisation intime, et qu'en dépit des éléments matériels, il fait rentrer les crustacés dans l'embranchement des mollusques. Ces trois règles excellentes doivent toujours faire loi, et l'on ne s'en écarte qu'au risque d'inévitables faux pas. Au-dessus de ces règles et en dehors d'elles, voici une théorie très vraie et très profonde, que la science de notre époque ferait bien de recueillir, et qui devrait toujours lui servir de flambeau. Sur le point d'aborder une étude qui était non seulement toute neuve pour la X Grèce, mais qui, par son inépuisable fécondité, restera perpétuellement neuve pour l'homme, Aristote proclame qu'il n'y a pas de hasard dans la nature ; qu'elle ne fait rien en vain, et qu'on ne perd jamais sa peine à en scruter les secrets. Selon le mot sublime d'Héraclite, Dieu est partout dans l'univers ; et sa puissance infinie éclate dans le plus infime des êtres, comme dans les plus parfaits de ceux qu'il a créés, en quantité incalculable. Rien n'est à négliger dans le spectacle merveilleux que la nature offre de tous côtés à nos regards intelligents; le naturaliste a le devoir de ne dédaigner quoi que ce soit dans l'ensemble des choses, où tout a un sens et une fin prodigieusement sage. Aussi, en terminant ce premier livre du traité des Parties, Aristote, tout austère qu'il est, épanche-t-il son cœur et son admiration dans les plus belles pages peut-être qu'ait inspirées ce sujet. Elles ont été citées plus d'une fois ; elles le seront encore bien souvent. Mais pour de telles vérités exprimées en un langage qui brille d'autant plus qu'il est plus sévère et plus concis, l'éloge est superflu. Il faut lire le XI morceau original en son entier, et le méditer à jamais. Il n'emprunte rien à l'éclat et à la magnificence du style, parce que le style, quelque précieux que soit son concours, s'efface et disparaît devant des sentiments si hauts. C'est comme un hymne qui s'élance de l'âme du philosophe, et qui dépasse la poésie elle-même dans ce qu'elle a de plus noble. Pour trouver un enthousiasme égal, mais moins savant, c'est dans le Cœli enarrant des Psaumes qu'il faudrait aller le chercher. Platon, même dans le Timée, ne s'est peut-être pas élevé jusqu'à ces sommets, où l'on ne voit guère qu'Aristote à côté de David, et où nous sommes tout surpris de les rencontrer au même niveau, quoique dans des sphères si différentes. Après l'exposé de la méthode et avec le second livre, commence l'étude de physiologie comparée, qui doit remplir le reste de l'ouvrage. Il débute par des généralités sur les éléments matériels dont est composé le corps de tous les animaux; l'auteur, revenant à une distinction qu'il a indiquée ailleurs (Histoire des Animaux, livre I, ch. 1, § 1), montre que XII les parties homogènes, ou similaires, sont faites en vue des parties complexes ou non-similaires, c'est-à-dire en vue des membres et des viscères, où les mouvements se passent, soit au dehors, soit à l'intérieur de l'animal. Les parties similaires, telles que les os, la chair, les nerfs, le sang etc., proviennent, selon Aristote et selon la chimie de son temps, des quatre éléments, terre, eau, air et feu, combinés dans des proportions diverses, et avec leurs propriétés particulières, chauds ou froids, liquides ou secs, pesants ou légers. Les parties non-similaires et complexes, comme le bras, la jambe, le visage, le tronc avec tout ce qu'il renferme et protège, sont les instruments des actes que l'animal accomplit. Les parties non-similaires restent toujours les mêmes dans leur totalité, tandis que les parties similaires, dont l'assemblage constitue les parties complexes, ont des qualités variables, selon les fonctions auxquelles elles doivent servir. Les unes sont molles ; les autres sont dures et résistantes; celles-ci sont liquides et visqueuses; celles-là sont cassantes et friables. XIII Les parties similaires ont cet avantage, sur les parties non-similaires, qu'elles sont le siège de la sensibilité; et la sensibilité est, au moins autant que la nutrition et le mouvement, le caractère essentiel de l'être animé. De là, le rôle immense du cœur, réceptacle du sang contenu dans les veines, centre de toute sensation et principe de tous les mouvements. Le cœur est à la fois une partie similaire, ainsi que le sont tous les autres viscères; mais il est, de plus, une partie non-similaire, par sa forme et sa configuration. Ce sont surtout les parties liquides qui sont nécessaires a la vie de l'animal, puisque, sans elles, il n'y aurait pas de développement possible. La qualité des parties liquides varie beaucoup; et par exemple, le sang est plus ou moins pur, plus ou moins léger, plus ou moins chaud, d'un animal à un autre, et aussi dans un même être, selon qu'on le prend dans des conditions diverses, et, par exemple, dans les parties supérieures du corps ou dans les parties inférieures. Plus épais et plus chaud, le sang donne à l'animal plus de vigueur ; plus léger et plus froid, il lui donne XIV plus d'intelligence; ceci peut être observé chez l'homme, et jusque chez les insectes, tels que les abeilles, qui n'ont pas de sang, mais qui ont un fluide analogue. L'auteur attache une telle importance au sang et à sa température qu'il institue toute une discussion sur la chaleur et le froid, sur le sec et l'humide. Les animaux n'ont pas tous le même degré de chaleur; et selon leur constitution et selon le milieu ambiant, air ou eau, ils en ont plus ou moins. Le sexe et l'âge causent encore des différences, qui peuvent être plus ou moins prononcées. Aristote, pour répondre aux préoccupations scientifiques de son époque, s'applique donc à bien définir ce qu'il faut entendre par un corps plus ou moins chaud, un corps plus ou moins froid, sec et liquide. Mais, au milieu do tous ces détails, il ne perd pas de vue l'objet qu'il poursuit ; et il rapporte au sang toutes ces théories, qu'il ne borne pas aux animaux et qu'il étend aux plantes. Les végétaux tirent directement de la terre par les racines leur nourriture, qu'ils y trouvent ton! élaborée; mais l'animal doit élaborer XV la sienne par le travail successif de la bouche, des dents, de l'œsophage et de l'estomac, où le sang se forme pour nourrir toutes les parties du corps, grâce à l'action du cœur et des veines. Aussi, Aristote croit-il devoir faire l'analyse minutieuse de ce liquide, et il la pousse aussi loin que le permettaient des connaissances chimiques encore bien vagues. Le sang se compose le plus ordinairement de fibres, qui, plus ou moins abondantes, font qu'il peut se coaguler, ou qu'il se coagule imparfaitement. Trop aqueux, le sang rend l'animal timide ; plus fibreux, il lui communique énergie et courage; témoins les taureaux et les sangliers. Outre les fibres, le sang contient de la lymphe en plus ou moins grande quantité. Ce début de la chimie organique est bien remarquable, tout imparfait qu'il est; il convient d'y arrêter notre attention quelques instants. Aujourd'hui, on en sait long sur la composition du sang; et en partant de l'état actuel de la science, nous mesurerons aisément tout l'intervalle qu'elle a parcouru, de- XVI puis le temps où la physiologie grecque essayait ses pas chancelants. Mais, d'abord, il faut reconnaître que le philosophe ancien a compris le rôle général du sang comme nous le comprenons maintenant. Pour nous, comme pour lui, le sang reste le fluide nourricier ; et quelque avancées que soient dans notre siècle la chimie organique, l'anatomie et la physiologie des artères et des veines, du poumon et des vaisseaux lymphatiques et chylifères, nous ne pensons pas autrement qu'Aristote sur le but dernier et la cause finale de tout cet étonnant mécanisme. Mais si nous en savons infiniment plus que lui, un jour viendra, ne l'oublions pas, où nos successeurs en sauront infiniment plus que nous, parce que « l'intelligence de l'homme, comme le dit Pascal, se lassera plus tôt de concevoir que la nature de fournir », ou, comme le dit Agassiz, parce que « la nature cache d'inépuisables richesses dans l'infinie variété de ses trésors de beauté, d'ordre et d'intelligence. » Pour Cuvier, à l'ouverture de ce siècle, le sang, observé sur le vivant, est un liquide XVII d'un beau rouge, d'une saveur douceâtre, et un peu salée, d'une odeur fade et particulière; il est légèrement visqueux; sa température habituelle est de 30 à 32 degrés; d'autres naturalistes disent de 36 à 40 degrés chez l'homme, et de 42 chez les oiseaux. Il contient des molécules rouges, de forme lenticulaire dans l'espèce humaine ; ces molécules sont la partie colorante. Une fois hors de l'animal, le sang se sépare en deux parties : le sérum, liquide jaunâtre, composé de plusieurs sels ; et le caillot, ou cruor, qui se partage également en deux parties : l'une, qui se dissout dans l'eau en la colorant de rouge ; la seconde, qui ne se dissout pas et qui est la fibrine. Chimiquement, le sang se résout presque en totalité dans les éléments les plus généraux du corps animal, carbone, hydrogène, oxygène, azote, puis fibrine et gélatine, albumine, chaux, phosphore, fer qui lui donne la couleur rouge, graisses, huiles, etc. Il a en lui les éléments de tous les solides et de tous les liquides du corps; il l'entretient par la nutrition et par les sécrétions ; et il se renouvelle lui-même par la digestion. (Cuvier, XVIII Anatomie comparée, première édition, t. IV, p. 179, XXIVe leçon; et Règne animal, t. 1, pp. 23 et 24, édition de 1829.) Depuis un demi-siècle et depuis Cuvier, la chimie organique a pénétré plus avant dans cette étude; et par l'emploi du microscope, toujours plus puissant, elle a découvert une foule de faits nouveaux. Le liquide nourricier, comme on appelle toujours le sang, est en quelque sorte une chair coulante ; il est la matière première de tous les tissus et de toutes les sécrétions. Sur cent parties, il se compose de soixante-dix-neuf d'eau, de dix-neuf d'albumine, une de sels divers, de quelques millièmes de fibrine et de matière colorante. Il contient des globules d'une excessive petitesse, dont les uns sont rouges, et les autres blancs. Les dimensions et le nombre des globules varient beaucoup suivant les espèces, les sexes, les âges, le tempérament, la chaleur ; dans l'homme, ils n'ont guère plus d'un cent vingt-quatrième de millimètre ; ils sont plus forts chez les reptiles et les batraciens. Composés d'un noyau central et d'une enveloppe, ils présentent en général la figure de XIX disques aplatis. On a pu, par des procédés plus ou moins sûrs, en compter cinq à six millions par millimètre cube. Les globules blancs sont beaucoup moins nombreux et beaucoup plus gros ; pour les distinguer, on les nomme des leucocytes, et les globules rouges sont nommés des hématies. Relativement aux globules rouges, les blancs sont à peine un sur quatre ou cinq cents. On ne sait pas si les globules blancs se changent en rouges ; mais ils semblent avoir des mouvements que n'ont pas les autres. On suppose qu'ils viennent de la lymphe ; et ce sont eux, à ce qu'il paraît, qui causent la formation du pus, quand le sang est altéré par blessure ou maladie. Il y a même des globules plus petits encore que les rouges et que les blancs ; ce sont les globulins, dont la fonction n'est pas bien connue. La quantité de sang renfermée dans l'organisme est environ le douzième du poids total du corps chez l'homme. Le sang artériel et le sang veineux ne sont pas identiques absolument ; et le veineux contient plus de gaz acide carbonique. Il n'est pas besoin de pousser plus loin ces XX rapprochements ; ceux-là font voir quelle distance sépare l'état présent de la science et son début. Mais le mérite d'Aristote n'en est pas diminué; c'est lui qui, le premier, a signalé l'étude du sang aux investigations scientifiques, et ce qu'il en a dit est exact, quoique nécessairement incomplet. Du sang, il passe à la graisse, et il en expose non moins bien l'origine et la fonction. La graisse est un produit du sang et une surabondance d'aliments. C'est là ce qui fait que les animaux qui n'ont pas de sang n'ont pas non plus de graisse. Il ne faut pas confondre la graisse et le suif, qui, tout en se ressemblant beaucoup, n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés. Le suif est spécialement la graisse des animaux chez qui manquent les deux rangées de dents, c'est-à-dire qui n'ont d'incisives qu'à la mâchoire inférieure, remplacées en haut par un bourrelet calleux, et qui de plus ont des cornes à la tête; ce sont les ruminants, sauf quelques espèces. Il y a cette différence entre la graisse et le suif, que la graisse ne se coagule pas, et qu'en séchant elle ne s'égrène pas comme XXI lui. On la trouve dans les animaux qui ont les deux rangées de dents, qui n'ont pas de cornes sur la tête et qui sont fîssipèdes. Quand la graisse et le suif sont en quantité modérée dans les animaux, ces matières contribuent à leur santé et à leur force ; en quantité trop grande, elles leur nuisent. Si tout le corps n'était que graisse, il serait insensible, et il périrait bien vite. Les animaux trop gras vieillissent plus rapidement; ils sont généralement peu féconds, parce que la portion de sang qui devrait se convertir en liqueur séminale a tourné à la graisse, d'où ne sort presque aucune excrétion. Telle est la théorie aristotélique sur la graisse. Écoutons encore ici la science actuelle, comme nous venons de l'écouter sur le sang. D'abord, elle a adopté tout ce qu'a dit Aristote, sans insister peut-être autant que lui sur la distinction, très réelle pourtant, de la graisse et du suif. Pour nous aussi, la graisse est un des nombreux produits du sang; elle est le résidu des matières non consumées dans le corps de l'animal par XXII l'oxygène qu'il a respiré; elle est ensuite résorbée et brûlée au fur et à mesure des besoins de l'économie. Elle est formée chimiquement de trois éléments au moins, l'oléine, la stéarine et la margarine ; elle sert à protéger les organes comme une sorte de coussin placé entre eux pour empêcher les frottements. Cette fonction est évidente dans quelques parties du corps, telles que le fond de l'orbite oculaire, la fosse temporale, la plante du pied. La graisse contribue à conserver la chaleur et à faciliter la digestion et la respiration ; chez quelques espèces, elle est comme une réserve alimentaire, qui les sustente à certains instants de leur existence, entre autres l'hibernation. Elle est inégalement répartie dans le corps ; et elle s'accumule dans certaines places, le mésentère, les reins, les épiploons, le péritoine, le dessous de la peau, etc.; elle forme dans quelques animaux des queues énormes, des bosses proéminentes, du lard. Déposée dans de petites vésicules sphéroïdales, qui s'introduisent dans le tissu cellulaire ou connectif, il y a peu de produits aussi répandus XXIII qu'elle dans les organes. Ces vésicules, invisibles à l'œil nu, ont à peine six centièmes de millimètre. Les proportions de margarine, de stéarine et d'oléine varient avec les animaux, et avec les âges, les aliments, les climats. La stéarine est fusible par une faible chaleur, 45 degrés environ ; elle est insoluble dans l'eau, tandis que l'oléine reste fluide à la température ordinaire. La graisse contient soixante-dix-neuf parties de carbone, onze d'hydrogène, quatre d'oxygène, et quelques autres corps simples. Sa couleur est ordinairement blanche; sa consistance et son odeur sont très variables. Dans les cétacés, où elle abonde, elle est presque liquide. Elle augmente beaucoup dans l'animal par le repos et par la castration ; il y a des espèces où son poids égale ou dépasse même la moitié du poids de la bête. Les petites vésicules ou gouttelettes de graisse, se réunissant les unes aux autres, composent des gouttes plus grosses, qui ont beaucoup de réfringence, observation qu'Aristote avait déjà faite. On ne sait pas précisément comment la graisse se forme, et c'est XXIV Claude Bernard lui-même qui confesse cette ignorance. Dans ces derniers temps, on avait cru que la graisse se trouvait déjà formée dans les végétaux; que de là, elle passait toute faite dans le corps des herbivores, et, enfin, de ceux-ci, aux carnassiers, qui les mangent. Mais il reste prouvé, par des observations plus exactes, que la graisse ne vient pas d'une source végétale, et que c'est l'organisme vivant qui la produit, comme tant d'autres sécrétions glandulaires, par exemple, le miel et la cire, fabriqués par les abeilles, qui sont des animaux à sang blanc. Par ces quelques détails, on peut encore juger des progrès obtenus, pour cette analyse comme pour celle du sang, depuis que la chimie organique s'est occupée des matières animales. Après le sang et la graisse, Aristote analyse la moelle, autre produit du sang. Dans les os, la moelle est onctueuse ; elle se rapproche de la graisse chez les animaux gras ; chez les animaux qui ont du suif, elle lui est assez semblable, comme dans les ruminants, XXV tandis que, chez les animaux fïssipèdes, qui ont les deux rangées de dents, elle est plutôt graisseuse. La moelle du rachis a plus de consistance, parce qu'elle doit être continue dans tout le parcours de la colonne vertébrale. La plupart des animaux ont de la moelle ; mais ceux dont les os sont très forts et très compacts, ont très peu de moelle, ou semblent même n'en avoir pas du tout. Chez les animaux aquatiques, la moelle ne se trouve que dans l'arête, qui remplace le rachis; et cette moelle a quelque chose de collant qu'elle n'a pas dans les autres espèces. En résumé, la moelle est une sécrétion du sang dans les os et dans les arêtes. La physiologie moderne n'a pas étudié la moelle autant qu'elle a étudié la graisse et le sang ; elle n'a pu la réduire encore en ses molécules organiques. Nos observations sont cependant beaucoup plus nombreuses que celles d'Aristote. Nous distinguons d'abord les os où se montre la moelle ; il n'y en a presque point dans les os plats, et elle y est rougeâtre ; elle ne forme une masse continue que dans les os longs, où elle est molle, jau- XXVI nâtre, avec beaucoup de cellules à noyaux multipliés. L'embranchement des vertébrés est le seul qui ait de la moelle; et encore cet embranchement n'en a-t-il pas tout entier. Il n'existe pas de cavités médullaires dans les cétacés, les phoques et les tortues. Les os des oiseaux, qui sont vides, et faits surtout pour contenir de l'air, ne présentent pas de moelle. Dans l'homme, la matière médullaire est chargée d'un rôle considérable : « C'est en elle, dit Cuvier, que réside le pouvoir admirable de transmettre au moi les impressions des sens extérieurs et de porter aux muscles les ordres de la volonté. » Elle sert de conducteur au fluide nerveux entre l'encéphale et les nerfs de la sensibilité et du mouvement, comme l'ont si bien établi les expériences de Charles Bell (1811), de Magendie (1822) et de Longet (1841). La moelle épinière, continuation du bulbe rachidien, est entourée, comme le cerveau, de trois membranes très-fines, dure-mère, arachnoïde et pie-mère, qui servent à la fixer dans le canal du rachis. Ainsi que l'encéphale, elle est composée de XXVII deux substances, la grise et la blanche, unies en cylindre; mais, contrairement au cerveau, c'est la substance blanche qui, dans la moelle, recouvre la grise. Sur le parcours de son cordon, la moelle épinière a des renflements et des dépressions ; elle est divisée en deux moitiés par deux sillons profonds. A chaque paire de trous vertébraux, elle donne naissance à une paire de nerfs qui se ramifient dans tout le corps, et qui se partagent, selon les lieux de la colonne dorsale, en nerfs cervicaux, dorsaux, lombaires et sacrés. Elle donne également naissance au grand sympathique et à sa chaîne de ganglions symétriques deux à deux, qui pénètrent dans les viscères et les vaisseaux. Aussi, la moelle épinière a-t-elle une action énergique et compliquée sur les fonctions de relations et sur les fonctions végétatives : mouvements volontaires, sensibilité, respiration, hématose, circulation, nutrition, sécrétions de tout genre, chaleur, etc. Chez l'homme, elle- part du trou occipital pour descendre jusqu'à la seconde vertèbre lombaire, où commence la queue de cheval, re- XXVIII liée au coccyx par le ligament coccygien. Au-dessus du trou occipital, elle se continue dans l'encéphale par la moelle allongée. Les anatomistes les plus habiles ne sont pas encore bien fixés sur le point précis de son origine. On le voit donc, pour ces trois théories de la moelle, de la graisse et du sang, la science contemporaine est bien plus avancée que la science de l'Antiquité. Mais la méthode reste la même absolument. La route n'a pas dévié ; elle n'est que plus longue, et les siècles qui suivront le nôtre la prolongeront à leur tour, sans en atteindre plus que nous le terme inaccessible. Par une transition assez naturelle, que signale Aristote lui-même, il passe de la moelle épinière au cerveau, dont il apprécie les fonctions, sans du reste les bien discerner. Quoique la moelle soit le prolongement de la masse encéphalique, Aristote conteste que leur nature soit la même, comme on l'affirmait de son temps. A ses yeux, leur objet est différent. Le cerveau, qui est presque entièrement privé de sang, est destiné à refroidir l'animal, XXIX tandis que la moelle contribue bien plutôt à sa chaleur. Le cerveau est, par sa position, isolé de toutes les parties du corps qui sont sensibles; mais essentiellement chargé de conserver l'animal, il est le siège de l'âme. Comme il doit faire contrepoids à la chaleur que développe le cœur avec le sang, il est tout simple que les animaux qui n'ont pas de sang n'aient pas non plus de cerveau ; tel est le cas des polypes. Si donc, pour les animaux exsangues, on parle de cerveau, ce n'est qu'une analogie assez éloignée ; ces animaux ont peu de chaleur, précisément parce qu'ils n'ont pas de sang. Pour que le cerveau puisse remplir sa fonction propre de réfrigération, la nature a fait que les veines secondaires, parties de la grande veine et de l'aorte, se terminent à la méninge, dont le cerveau est enveloppé. Au lieu de grosses veines en petit nombre, qui auraient pu transmettre trop de chaleur, la nature a répandu tout autour du cerveau de nombreuses veines, petites et très fines, qui n'y roulent qu'un sang pur et léger, au lieu d'un sang épais et lourd. C'est peut-être aussi par la même cause que les fluxions, XXX provenant du phlegme et de la lymphe, partent en général du cerveau et de la tête. Le refroidissement de ces parties hautes provoque alors une disposition qui ressemble assez à la production de la pluie dans l'atmosphère, où la vapeur qui s'élève de la terre, arrivant à l'air froid placé au-dessus, s'y condense et retombe en eau. Mais Aristote s'arrête dans ces détails et les renvoie à la pathologie, qu'ils concernent plus que la zoologie. C'est le cerveau qui est la principale cause du sommeil; quand les animaux à station droite éprouvent ce besoin irrésistible, ils se couchent ; et ceux qui n'ont pas ce genre de station sont tout au moins forcés de baisser la tête. Le cerveau est matériellement composé de terre et d'eau ; et l'on peut remarquer, en le faisant cuire, qu'il devient sec et dur, ainsi que les autres matières composées des mêmes éléments que lui. L'homme est de tous les animaux celui qui a l'encéphale le plus gros proportionnellement à son. corps. Le cerveau des hommes est plus gros que celui des femmes. C'est aussi l'homme qui a XXXI le plus de sutures au crâne ; la femme en a moins. Dans la physiologie moderne, le cerveau est peut-être de tous les viscères celui qu'on a étudié le plus soigneusement. On conçoit bien cette prédilection, en songeant aux fonctions de l'encéphale et à la multiplicité des éléments qui le forment. Mais il serait à la fois trop long et bien inutile de montrer toutes les différences et toute la supériorité de nos théories actuelles. Pour le cerveau, ces théories sont encore plus étendues et plus précises que pour le sang, la graisse et la moelle. On ne recommencera donc pas des rapprochements trop faciles ; et nous nous bornerons à poursuivre l'exposé des théories d'Aristote. Dans Tordre de ses idées sur les parties similaires, il lui faut étudier la chair, ou l'organe correspondant chez les animaux qui n'ont pas de chair proprement dite. La chair est le siège du toucher, qui est le plus général des sens et le seul indispensable. La nature peut ne pas faire les autres sens ; mais elle devait nécessairement faire celui-là. On le retrouve dans tous les animaux sans excep- XXXII tion ; et dans ceux qui ont la chair à l'intérieur, comme les huîtres, et dans ceux qui ont la chair au dehors, comme l'homme, les quadrupèdes, les oiseaux, les reptiles, les poissons, etc. Entre les os et les veines, qui viennent après la chair et qui sont aussi des parties similaires, il y a ceci de commun que pas un os n'est isolé dans le corps, pas plus qu'il n'y a de veine isolée. Tout os tient à un autre os ; toute veine tient à une autre veine. Des deux côtés, c'est un ensemble et un équilibre où tout s'enchaîne et se pondère. Un seul os n'aurait pas permis de flexion ni de mouvement; un seul os percerait les chairs, ainsi que le ferait une épine. Le principe des os, c'est le rachis, de même que le principe des veines, c'est le cœur. Des tendons, des cartilages et des nerfs joignent les os les uns aux autres; au dedans du corps, les os soutiennent les chairs, de même que, dans les préparations de la sculpture, des étais intérieurs soutiennent la terre-glaise que modèle l'artiste. Parfois, les os sont faits pour la protection des organes ; et c'est ainsi que les côtes envelop- XXXIII pent et recouvrent tous les viscères, groupés autour du cœur. Si le ventre n'est pas recouvert par des os, c'est afin que les aliments qui le gonflent puissent s'y loger sans y causer de gêne ; c'est surtout pour que la gestation des femelles et le développement des fœtus puissent s'y passer tout à l'aise. Les grands vivipares ont une charpente osseuse très forte et très solide. En Lybie et dans les régions chaudes, où les animaux sont en général plus féroces et plus gros, leur ossature est en proportion de leur corps, qui est fait pour la lutte et le combat. Les os des mâles chez les carnassiers sont plus durs que les os des femelles. Parmi les animaux aquatiques, le dauphin, qui est vivipare, a des os et non pas des arêtes. Les poissons ovipares n'ont que des arêtes et non des os. Les os des serpents se rapprochent assez de l'arête des poissons ; mais dans les très grandes espèces de reptiles, ce sont de véritables os, parce que des étais puissants leur sont nécessaires à l'intérieur, comme pour les grands quadrupèdes. Chez les sélaciens, la nature des os du rachis tient le milieu entre l'arête et le XXXIV cartilage. Môme chez les vivipares ordinaires, bien des os sont cartilagineux, là où il faut que la partie solide soit assez molle et assez spongieuse pour ménager les chairs, par exemple les oreilles et le bout du nez. Le cartilage et l'os sont au fond de même matière ; mais le cartilage n'a jamais de moelle; et de plus, il est gluant. D'autres matières dans le corps se rapprochent beaucoup des os: ce sont les ongles, les soles, les pinces, les cornes, les becs, les dents, etc., donnés à l'animal pour sa défense et pour son alimentation. On aurait encore h parler de la peau, des membranes, des poils, des plumes et des parties correspondantes chez les diverses espèces ; mais ces détails trouveront leur place plus loin, de même que l'analyse de la liqueur séminale et du lait trouvera la sienne quand il sera question de la génération. Ici finit pour Aristote l'étude physiologique des parties similaires ou élémentaires des animaux; et il passe à l'étude des parties complexes et non-homogènes, commençant par l'homme, ainsi qu'il l'a fait dans l'His- XXXV toire des Animaux. Pour justifier cet ordre, il donne deux raisons, qu'il a déjà présentées : l'homme est de tous les êtres celui qui nous est le mieux connu; et en second lieu, il est le seul à participer du divin, ou du moins il a le privilège d'en participer plus que tout autre être animé. 11 est le seul qui ait la station droite, et il jouit des cinq sens, répartis et placés chez lui mieux que dans aucune autre espèce. L'ouïe est à la circonférence de la tête, et la vue est en avant, parce qu'on entend de toutes parts, et que l'être animé doit voir par devant lui pour diriger son mouvement. Chaque sens, sauf le toucher, est double, parce que le corps a deux moitiés, la droite et la gauche. Cela est évident pour l'ouïe, pour la vue, pour l'odorat; ce l'est moins pour le goût, qui est une sorte de toucher ; mais la langue elle-même se partage en deux moitiés accolées. Chez les animaux autres que l'homme, les sens ne sont pas moins bien disposés. Ainsi, les oreilles des quadrupèdes sont dressées et mobiles pour mieux recueillir les sons. Les oiseaux n'ont pas proprement d'oreilles ; mais XXXVI ils ont les conduits auditifs. Les quadrupèdes ovipares à écailles ont la même organisation. Si, parmi les vivipares, le phoque n'a ni conduits auditifs, ni oreilles, c'est qu'il est un quadrupède manqué. La vue est peut-être de tous les sens celui qui est organisé le plus parfaitement et avec le plus de prévoyance. Hommes, oiseaux, quadrupèdes vivipares et ovipares, tous sont pourvus d'appareils protecteurs de la vue. Tantôt deux paupières mobiles peuvent couvrir les yeux; il y a même jusqu'à trois paupières chez les oiseaux et les quadrupèdes ovipares. Des mouvements rapides et souvent tout spontanés font agir les paupières. Dans les animaux qui en ont une troisième, cette paupière joue non pas d'en bas ou d'en haut, mais du coin interne de l'œil. Les oiseaux de proie ont la vue excessivement perçante, parce que cette faculté de découvrir les choses de très loin leur est nécessaire pour leur subsistance. Les oiseaux de terre qui volent mal, comme les gallinacés, ont une vue bien moins longue, parce qu'ils n'en ont pas un besoin absolu pour se procurer leurs aliments. XXXVII Les poissons et les insectes n'ont pas de paupières; leurs yeux, qui sont durs, peuvent par cela même se passer de protection ; mais il y a de ces animaux qui ont, par compensation, des yeux mobiles. Quant aux poissons, le liquide, où ils se meuvent, les empêche de voir de loin ; et leurs yeux sont faits de telle manière qu'ils ont en quelque sorte une paupière transparente à demeure, pour que l'eau ne les offense pas. Après quelques remarques sur les cils et les sourcils, Aristote s'arrête plus longuement à étudier le sens de l'odorat et l'organisation du nez. La trompe de l'éléphant, qui est le nez de cet animal et en même temps sa main, le frappe beaucoup ; il la décrit dans ses divers emplois, soit pour saisir les choses, soit pour respirer. Après l'éléphant, l'auteur considère ce que sont les narines chez les reptiles et chez les oiseaux, qui ont les conduits olfactifs sur leur bec. D'autres animaux en grand nombre n'ont pas de narines, parce qu'ils ne respirent pas ; mais ils n'en éprouvent pas moins, grâce à d'autres appareils, la sensation des odeurs. XXXVIII Au-dessous des narines, se trouvent les lèvres, chez tous les animaux qui ont du sang et des dents; mais, dans les oiseaux, le bec remplace tout à la fois les dents et les lèvres. L'homme a des lèvres molles et charnues, qui protègent sa denture et qui contribuent à la beauté de son visage. Elles servent en outre à la parole presque autant que la langue; car, sans elles, il serait impossible de prononcer certaines lettres. La langue a donc ainsi deux usages ; elle sert à la perception des saveurs, en même temps qu'elle sert aux articulations du langage. Chez presque tous les animaux qui vivent à terre, la disposition de la langue est la même; elle est placée sous le palais. Outre que la langue de l'homme est molle et humide, afin de mieux sentir les saveurs, elle est douée d'une grande mobilité ; et quand cette qualité n'est pas tout ce qu'elle doit être, il en résulte des défauts de prononciation qu'on appelle bégaiement ou bredouillement. La langue doit avoir aussi une certaine largeur; et de là vient que ceux des oiseaux à qui l'on apprend à répéter certains mots, les prononcent d'autant mieux que leur XXXXIX langue est plus large. Au contraire, les quadrupèdes ont une voix de peu d'étendue, parce que leur langue est dure, peu détachée et trop épaisse. Parmi les oiseaux, ce sont les plus petits qui ont le plus de chant; ils savent se comprendre les uns et les autres à la voix ; et l'on peut croire qu'ils s'instruisent mutuellement à chanter. Chez les ovipares terrestres, la langue ne sert pas à la voix, parce qu'elle n'est pas assez libre et qu'elle est trop dure. Les serpents et les lézards ont une langue longue et bifurquée, comme s'ils avaient une double sensation des saveurs. Chez les poissons, la conformation de la langue est très imparfaite ; ils ont cependant la perception des saveurs, quoique les aliments traversent très rapidement la bouche, de peur que l'eau n'y entre du même coup. De plus, la langue des poissons n'est presque pas détachée; et l'on a quelque difficulté à la reconnaître, même en leur ouvrant la bouche. Pour le crocodile, l'organisation est encore plus singulière; sa langue est collée à la mâchoire d'en bas ; et cette mâchoire est immobile, contrairement à XL ce qu'elle est chez le reste des animaux, où c'est la mâchoire d'en haut qui ne se meut pas. Quelques animaux aquatiques ont le palais tellement charnu qu'on pourrait croire que c'est là qu'ils ont leur langue ; il n'en est rien ; de leur lourde langue, il n'y a que l'extrémité qui soit un peu détachée. Dans les crustacés, dans les mollusques et dans quelques insectes, la langue est très enfoncée dans la bouche, ou dans l'organe qui leur tient lieu de bouche. 11 y a des animaux de divers ordres qui ont la langue tellement forte qu'elle peut percer les corps les plus durs et les plus résistants ; quelques insectes ont une langue qui fonctionne comme un véritable aiguillon. Ici se termine le second livre du traité des Parties, et l'on peut déjà s'assurer si c'est bien là ce que les Modernes entendent par la physiologie comparée. Mais continuons à écouter Aristote, tout en abrégeant le plus possible les détails qui vont suivre ; ils achèveront la démonstration. Le troisième livre complète ce qui avait été commencé dans le second sur la bouche et les dents, qui, dans beaucoup d'animaux, sont XLI des armes de défense aussi bien que des instruments d'alimentation. Les crocs sortant de la bouche et les cornes placées sur la tête ne servent qu'à la lutte ; les mâles les ont toujours plus solides que les femelles, qui souvent môme en sont tout à fait privées. Chez les poissons, les dents sont réparties quelquefois sur la langue et sur le palais, afin de diviser au passage les aliments, qui ne peuvent être broyés, parce qu'ils ne font que traverser la bouche. Quand la bouche doit servir au combat et à la défense, elle est beaucoup plus ouverte que quand elle doit simplement servir à la respiration, à l'alimentation ou au langage ; trop étroite, la bouche ne pourrait mordre ; la morsure est toujours en proportion de l'ouverture de la gueule. Les oiseaux de proie, à serres puissantes, ont le bec recourbé, à la même intention. Le bec est toujours adapté au genre de vie, très dur et tout droit chez les oiseaux qui frappent les arbres ; mince chez les oisillons qui vivent de graines et de fruits; long, large et dentelé chez ceux qui mangent de l'herbe ou qui sont ordinairement dans l'eau. XLII. La bouche, les dents, les crocs, les becs sont dans la tête ; les cornes sont au-dessus. Il n'y a de cornes véritables que chez les vivipares à doubles pinces ou solipèdes ; elles leur servent à la défense et à l'attaque. Les solipèdes sans cornes à la tète, comme le cheval, se défendent par la rapidité de la course et par les ruades ; c'est aussi la vélocité de la fuite qui sauve les cerfs tandis que leur bois leur est parfois nuisible. Mais la nature a généralement fait les cornes pour le bien de l'animal qui les porte, droites ou recourbées. Elle a eu bien raison de placer les cornes sur la tête, quoi qu'en dise Ésope; dans toute autre partie du corps, elles n'eussent été que gênantes. Il n'y a que le cerf dont les cornes soient complètement pleines et qui les perde périodiquement; chez les autres animaux, les cornes sont persistantes, et elles sont creuses jusqu'à une certaine hauteur; mais la pointe est toujours solide et dure. De tous les animaux pourvus de cornes, c'est la gazelle qui est le plus petit. En général, ce sont les ruminants qui ont des cornes, comme si la nature, en leur enlevant une XLIII rangée de dents, avait voulu leur procurer un dédommagement. Au-dessous de la tête, vient le cou, lequel n'a pas été donné à tous les animaux, parce que tous n'ont pas de poumons. Dans le cou, on distingue surtout l'œsophage, qui porte les aliments de la bouche à l'estomac, et le pharynx, qu'Aristote prend pour l'instrument de la respiration et de la voix, et qu'il confond assez souvent avec le larynx ou trachée-artère, voyant d'ailleurs très bien que la trachée-artère ne peut servir de passage aux aliments secs ou liquides. Pour empêcher que les aliments ne fassent fausse route, la nature a imaginé l'épiglotte ; elle ne se trouve que chez les vivipares qui ont un poumon, et qui n'ont ni écailles ni plumes. Les principaux viscères du tronc sont le cœur et le foie. Ils sont les premiers à apparaître dans les embryons ; on les distingue déjà dans les œufs après trois jours seulement d'incubation, et on les retrouve dans les fœtus venus longtemps avant terme. Tous les animaux qui ont du sang ont un cœur ; et chez eux, c'est le cœur et non la tête comme XLIV on l'a cru, qui est l'origine des veines, où le sang est renfermé. Le cœur est placé vers le centre du corps, plutôt en haut qu'en bas, la pointe un peu en avant. Le milieu du cœur est épais et creux; il est plein de sang; et c'est lui qui envoie le sang dans tous les vaisseaux, comme le montre l'anatomie, soit dans l'animal adulte, soit dans le fœtus. On a voulu attribuer ces fonctions au foie au lieu du cœur ; mais l'observation des faits atteste que le foie a une tout autre destination. Chez l'homme, le cœur est placé à gauche, afin de réchauffer la partie gauche, qui est toujours un peu plus froide ; le cœur est en quelque sorte un animal dans l'animal. Il n'a pas d'os; mais parfois cependant on trouve un os dans le cœur de quelques chevaux et de quelques bœufs ; cette exception tient peut-être à la grosseur de ces bêtes. Chez les grands animaux, le cœur a trois cavités ; il n'en a que deux chez les petits, ou même une seule. Deux veines principales, la grande veine et l'aorte, sont en relations avec le cœur ; le sang n'est pas identique dans les deux. Les cavités droites du cœur ont plus de sang et un sang XLV plus chaud que les cavités de gauche; c'est aussi le sang le plus pur. Selon les espèces, le cœur varie de grosseur ou de petitesse, de mollesse ou de dureté. Ces différences influent beaucoup sur le caractère de l'animal ; les gros cœurs font les animaux lâches ; plus petits ou moyens, ils font les animaux braves. La grandeur ou l'étroitesse des cavités cardiaques a aussi de l'importance. De tous les viscères, le cœur est celui qui supporte le moins une lésion quelconque ; on peut bien le voir en observant les cadavres des animaux immolés dans les sacrifices. Les reins, le foie, le poumon, la rate sont malades bien plus fréquemment que le cœur. Les deux veines qui aboutissent au cœur se ramifient de là dans le corps entier, en vaisseaux de plus en plus petits, portant partout le sang et la vie, avec la chaleur et la sensibilité. La grande veine est plus importante que l'aorte. On pourrait comparer cette répartition du fluide sanguin à ces canaux d'irrigation qui fécondent les vergers bien cultivés ; la nature, aussi, a canalisé le sang. C'est ce qui apparaît très nettement à travers la peau XLVI des personnes maigres ; on le voit encore bien mieux à la moindre blessure, puisque le sang jaillit dans toutes les parties du corps, pour peu qu'on se coupe ou qu'on se pique. Il y a même des maladies, où, sans lésion extérieure, le sang exsude de toutes parts. Le poumon, non loin du cœur, sert, dans les animaux qui ont cet organe, à faire pénétrer en eux l'air du dehors. Les poissons sont pourvus de branchies à la place du poumon ; et c'est l'eau qui les rafraîchit, au lieu de l'air. Certains animaux aquatiques, tels que la baleine, le dauphin et les cétacés souffleurs, respirent par un évent. Bien que le poumon s'élève et s'affaisse par l'entrée et la sortie de l'air, ce n'est pas lui, comme le supposent quelques naturalistes, qui fait battre le cœur ; le battement vient du cœur lui-même. Le poumon varie beaucoup de nature et de volume dans les différentes espèces. Quelques animaux l'ont plein de sang et très gros ; chez d'autres, il est petit et spongieux. Les vivipares l'ont plus développé que les ovipares ; chez les lézards et les tortues, il se gonfle beaucoup par l'afflux de l'air, ainsi que dans XLVII les oiseaux; mais il n'est pas considérable; et aussi, ces animaux boivent-ils en général très peu. Si les poumons et les reins sont divisés en deux parties bien distinctes, le foie et la rate ont des divisions moins marquées. Pourtant on doit penser que ces viscères ont, ainsi que les autres, deux parties qui correspondent à la droite et à la gauche du corps. Le foie et la rate servent l'un et l'autre à la digestion, de même que les reins servent à la sécrétion de l'urine. La rate ne semble pas aussi nécessaire que le foie; chez quelques animaux, par exemple les quadrupèdes ovipares, elle est tellement petite qu'on a peine à la reconnaître; chez d'autres, elle devient facilement malade par la surabondance de la sécrétion. Les animaux qui ont un poumon plein de sang ont en général une vessie, chargée de recevoir l'urine que les reins ont sécrétée. Ceux qui ont des plumes, des écailles ou des carapaces, n'ont pas de vessie, parce qu'ils boivent fort peu, et qu'en eux la sécrétion du liquide est presque nulle. Les tortues font exception ; celles de mer ont une vessie fort XLVIII grande ; celles de terre en ont une plus petite. Les reins manquent dans un assez grand nombre d'espèces d'animaux. Mais dans ceux qui ont cet organe, des canaux partent de la grande veine ou de l'aorte pour y aboutir; d'autres canaux partent des reins eux-mêmes pour aboutir à la vessie, où converge le liquide qui doit être expulsé. Ordinairement, le rognon droit est placé un peu plus haut que le gauche. De tous les viscères, ce sont les reins qui ont le plus de graisse ; non pas précisément en eux-mêmes, parce qu'ils sont trop compacts et trop serrés, mais dans la région qui les environne. Le rein droit en a moins que le gauche. La graisse ou le suif, en s'accumulant autour des reins, surtout chez les moutons, causent des maladies mortelles. Dans l'espèce humaine, les reins sont assez souvent sujets à des affections fort douloureuses, qui causent aussi la mort. Les animaux qui ont du sang ont également un diaphragme, destiné à séparer la région du cœur et celle du ventre, afin que l'âme sensible ait un siège plus calme et a l'abri de toutes les perturbations que subissent les par - XLIX ties inférieures. C'est là une des précautions les plus admirables de la nature. Le diaphragme est plus charnu vers les côtes, où il s'attache ; il est plus mince vers son milieu, afin de se prêter plus facilement à toutes les impulsions qu'il reçoit, notamment à celle du rire, privilège de l'homme parmi tous les animaux, dont aucun ne rit. Les viscères qu'on vient d'énumérer sont revêtus de membranes qui les garantissent contre toute atteinte, et qui sont assez légères pour ne pas les gêner. L'encéphale et le cœur, qui sont les plus importants des viscères, sont, par cette raison, pourvus des membranes les plus fortes. D'ailleurs, les viscères ne se retrouvent pas dans les mêmes conditions chez tous les animaux. Ils varient beaucoup de formes et de dimensions, tout en remplissant des fonctions identiques. Ces différences sont remarquables pour le foie, la rate, et surtout pour l'estomac. Les animaux vivipares qui ont lu double rangée de dents n'ont qu'un seul estomac ; mais d'autres animaux qu'on appelle ruminants, et qui n'ont pas les deux rangées de dents, ont plusieurs estomacs, pour achever L la digestion de leurs aliments, qui sont d'ordinaire très secs et très durs. Les ruminants à cornes, ou sans cornes comme le chameau, sont pourvus de quatre estomacs chargés d'une élaboration successive et lente. Les oiseaux, qui, par organisation, sont privés de dents, ont un estomac spécial, qu'on appelle le gésier, et qui remplit l'office de la bouche. Parfois, le gésier même est précédé d'une sorte de vestibule, qui est le jabot. Les poissons ont des dents ; mais comme elles ne leur servent pas à broyer les aliments, c'est aussi leur estomac qui se charge du travail que la bouche n'accomplit pas. Les intestins, qui succèdent à l'estomac, offrent comme lui des variations nombreuses ; ils sont plus ou moins compliqués, plus ou moins longs, plus ou moins droits. Sur leur trajet, on distingue plusieurs parties, entre autres le côlon, la partie dite aveugle ou cœcum, le jejunum, etc. Les intestins droits et courts provoquent un renouvellement plus rapide du sentiment de la faim. Il y a un point de l'intestin, point d'ailleurs très difficile à déterminer, où l'aliment, après avoir servi à LI la nutrition, dépose un excrément, qui n'est plus utile et qui doit être rejeté. Dans un des estomacs des ruminants se trouve cette substance qu'on appelle la présure ; ce n'est que du lait qui se caille, parce qu'il est extrêmement épais. Quand l'estomac est unique, le lait, beaucoup plus léger, ne .s'y caille pas ; et il ne produit pas de présure. Le quatrième et dernier livre du traité des Parties continue cette étude des intestins, en comparant leur structure dans les quadrupèdes ovipares, dans les reptiles et dans les poissons. Puis, l'auteur passe à la bile, qui tantôt se trouve dans le foie, et tantôt dans une vésicule à part. Certains animaux, le cheval, le mulet, l'âne, le cerf, le daim n'ont pas de bile ; parmi les poissons de la haute mer, le phoque et le dauphin n'ont pas de fiel. Quelquefois cette variation se montre dans un même genre; ainsi, il y a des hommes qui n'ont pas de bile ; entre les moutons, les uns n'en ont pas du tout, tandis que d'autres en ont surabondamment. La bile n'a pas d'autre objet que de purifier le sang ; c'est une excrétion salutaire. Toutefois, il est bien probable LII que les animaux vivent d'autant plus longtemps qu'ils sont moins bilieux. L'étude sur les intestins s'étend aussi à l'épiploon, et au mésentère, qui tous deux servent, dans une certaine mesure, à la digestion des aliments. Il semblerait que la suite naturelle de toutes ces observations serait l'étude des organes de la génération ; mais le sujet est si important qu'il faut le remettre à un ouvrage où il devra être traité à part, et tout au long. En attendant et pour compléter ce qui précède, Aristote, qui s'est occupé jusqu'ici des animaux pourvus de sang, passe aux animaux qui n'en ont pas; et il décrit en détails, aussi exacts que nombreux, l'organisation et les viscères, des mollusques, des crustacés, des testacés, des oursins, des holothuries, des éponges, des acalèphes, des téthyes, qui sont presque des plantes, et enfin l'organisation des insectes, avec ou sans aiguillon, à l'extérieur ou à l'intérieur, par devant ou par derrière, insectes qui volent ou qui rampent, qui marchent ou qui sautent.
Ici et par une transition peu
justifiée, l'au- LIII
teur revient à l'homme pour noter en lui certaines particularités
très caractéristiques, entre autres la main, dont il explique la
destination beaucoup mieux que ne l'avait fait Anaxagore, qui avait
attribué à l'organisation des mains l'intelligence de l'homme, au
lieu de voir simplement dans la main l'instrument docile de cette
intelligence. Enfin, l'auteur se répétant encore revient sur
l'organisation des ovipares, reptiles, oiseaux et poissons; et
l'ouvrage finit brusquement par un court chapitre sur l'autruche,
animal équivoque, qui est une sorte de demi-quadrupède et de
demi-oiseau. Tel est l'ensemble du traité des Parties ; telles sont les recherches dont il est rempli. Pour peu qu'on l'ait lu avec attention et im- LIV partialité, l'hésitation n'est plus permise à quelque faible degré que ce soit. D'un bout à l'autre, c'est de la physiologie comparée; et comme le dit fort bien un critique d'Aristote, M. Lewes, qui n'est pas suspect de flatterie ou de complaisance : <r Voilà le premier essai « pour fonder la biologie sur l'anatomie de « tous les êtres animés. » (Aristote, p. 323). Désormais cette démonstration est acquise ; et la science ne peut, sous peine de s'ignorer elle-même, ignorer que c'est là, dans la Grèce, au temps d'Alexandre, la source d'où elle est sortie, et où elle doit toujours remonter pour mesurer les accroissements qu'elle a pris, gage de ceux qu'elle doit recevoir encore. Nous n'insisterons donc pas; mais avant de montrer ce que la physiologie est devenue depuis Aristote, il faut indiquer dans quel état elle se présentait avant lui. Pour l'Histoire des Animaux, il n'y a dans la philosophie grecque aucun précédent ; il n'en est pas tout à fait de même pour le traité des Parties, du moins en ce qui touche la physiologie de l'homme. Platon avait, sous certains rapports, et dans une certaine mesure, de- LV vancé son disciple, sans d'ailleurs créer la science, à laquelle il ne sut pas donner de fermes assises, tout en l'entrevoyant. Il ne faudrait pas exagérer la valeur physiologique du Timée; mais le tort ne serait pas moindre de la déprécier sans justice. Après avoir invoqué pieusement les dieux, Timée essaie d'expliquer l'origine des choses, l'organisation de la matière, et peut-être aussi la création. Dans un langage solennel et presque poétique, qui du reste ne prétend qu'à la simple vraisemblance, il descend du Dieu suprême aux divinités inférieures, et de là aux choses de la terre, et enfin à l'humanité. Ce qui le frappe par-dessus tout, c'est l'union de l'âme et du corps ; c'est l'obscur et essentiel enchaînement de la vie morale et de la vie physique. Il décrit le corps humain à grands traits, et il passe en revue, sans beaucoup d'ordre, tous les organes et tous les membres : d'abord la tête et le visage, puis les sens, siège des perceptions de plaisir et de douleur. De la partie supérieure du corps, il en vient aux parties moyennes, et il parle du cou, du tronc, du diaphragme, du cœur, du LVI poumon, de la trachée-artère, du foie et de la bile, de la rate, du bas-ventre, des os, de la chair, de la moelle, de la peau, des cheveux, des ongles, de la respiration, du sang nourricier, du tétanos, de l'épilepsie, de beaucoup d'autres sujets analogues, et enfin de la génération. Pour préparer dans l'homme l'harmonie des deux principes, qui se combattent en lui tout en y étant conjoints, il dit quelques mots des maladies de l'âme, plus dangereuses que celles du corps ; et il finit en plaçant ces théories sous la protection du Dieu très bon et très grand, dont il à tenté de comprendre les œuvres. Tous les sujets abordés par Timée sont donc les sujets mômes qu'Aristote a traités avec plus de soin et d'étendue ; mais ce qui manque à Platon, c'est l'esprit scientifique. Il s'abandonne à des intuitions purement rationnelles, qui l'écartent de l'observation scrupuleuse des faits. C'est pour servir des opinions préconçues qu'il contemple les choses de l'univers et celles du monde où nous vivons. Ce n'est pas le moyen de dissiper les ténèbres ; et cependant, du milieu de cette LVII confusion, sortent fréquemment des éclairs éblouissants qui dénotent le génie de l'auteur, et qui font regretter qu'une méthode plus sévère ne Tait pas guidé. Quelques aperçus pleins de profondeur témoignent de ce qu'il durait pu faire dans une meilleure voie. Mais la gloire de Platon est ailleurs, et elle reste incomparable dans le domaine où il l'a conquise pour jamais. Ainsi, dans l'école où Aristote est resté vingt ans un silencieux disciple, il trouvait des pressentiments qui ont pu susciter son ardente admiration pour les merveilles de la nature, et éveiller en lui l'idée d'une science nouvelle; mais cette science, si elle était possible, était loin d'être réalisée; il n'y avait encore que quelques matériaux d'un futur édifice, peu nombreux et presque informes. C'est Aristote seul qui a construit la science, en lui assurant des bases immuables, en lui assignant sa méthode, en fixant ses principes et ses limites, en recueillant un grand nombre des faits qui la constituent, depuis le plus éminent des êtres animés jusqu'à ceux qui se distinguent à peine de la planté. Après cet LVIII enseignement, la science n'a plus qu'à se développer dans la carrière qu'il lui a ouverte, et à imiter, toutes les fois que des circonstances favorables le lui permettent, l'exemple venu de l'Antiquité. Dans l'école péripatéticienne elle-même, la physiologie, inaugurée par le maître, ne paraît pas avoir fait le moindre progrès. Théophraste s'occupe exclusivement des plantes ; il les étudie aussi largement qu'Aristote avait étudié les animaux. Ainsi que lui, et sans doute sous son inspiration, il distribue son sujet selon les exigences de la méthode bien comprise : d'abord la description des phénomènes, et en second lieu leur explication, ou, pour prendre les termes mêmes qu'emploient les deux philosophes grecs, l'histoire et les causes. L'école Alexandrine ne semble pas non plus s'être livrée à la physiologie comparée, tout en consacrant bien des recherches aux sciences voisines. Érasistrate, petit-fils d'Aristote, et Hérophile, l'un et l'autre contemporains de Théophraste, sont d'illustres médecins, que Celse et Galien citent souvent ; ils ont fait en LIX pathologie et dans la physiologie de l'homme des découvertes qui ont rendu leurs noms immortels, à défaut de leurs œuvres; mais fidèles à la médecine, ils ne la désertent pas ; et la physiologie générale leur échappe, quelque attrayante qu'elle pût être sous la conduite d'Aristote, vénéré à Alexandrie et à Athènes presque autant qu'il le fut par notre Moyen-âge. Varron, le plus savant des Romains et surnommé le polygraphe par excellence (polygraphissime), a écrit sur une foule de sujets, dont Cicéron, son ami, nous a laissé une assez complète nomenclature dans ses Académiques (livre 1, ch. III); mais malgré des labeurs variés et persévérants, la curiosité de Varron a omis l'histoire naturelle ; il avait pu connaître cependant les œuvres d'Aristote par Tyrannion et Andronicus de Rhodes. Ces œuvres ont été certainement connues de Cicéron, quoiqu'il n'en cite expressément aucune. Cicéron avait traduit le Timée de Platon, et sa traduction nous est restée en grande partie ; mais ce n'est pas la physiologie platonicienne qui lui a appris tout ce qu'il dit de LX l'homme, de sa main, des principaux organes de son corps, de sa station droite, de sa supériorité sur tous les autres êtres (De natura Deorum, livre II, ch. XLVII à LXI). C'est à Aristote qu'il doit toutes ces notions, qui semblent l'intéresser vivement. Il fait une mention expresse d'un passage de l'Histoire des Animaux sur les grues ; mais il n'est pas à douter qu'il ait possédé aussi le traité des Parties, bien qu'en énumérant les emprunts faits, selon lui, par Rome h la Grèce, il soit muet sur les sciences naturelles. Celse, au temps d'Auguste, compose un ouvrage d'une régularité et d'une solidité qui, même parmi nous, sont fort rares ; mais dans ses huit livres, il ne fait absolument que de la pathologie. S'il traite de la tête, du cou, de la gorge, de l'œsophage, de l'estomac, des viscères, des os, c'est pour décrire et combattre les affections morbides dont ces organes peuvent être atteints. C'est dans cette vue exclusive qu'il expose sa pharmacopée et sa chirurgie; il veut rester strictement médecin. S'il fait un peu de physiologie, c'est celle de l'homme; et il ne s'est LXI pas détourné, non plus que ses devanciers, jusqu'à celle des animaux. On peut remarquer une abstention semblable dans Sénèque. Ses Questions naturelles n'embrassent pas l'organisation animale. Il se borne aux grands spectacles que le Ciel nous présente, et aux phénomènes principaux qui se passent à la surface de notre terre, les volcans, la crue des fleuves, l'altitude des montagnes ; il n'est pas allé plus loin, si toutefois ce n'est pas le temps qui nous a privés de ce que Sénèque avait peut-être écrit sur le reste de la nature. Le silence se serait moins compris de la part de Pline. Pour rassembler les nombreux documents de son ouvrage, que, par une locution grecque, il appelle à bon droit une Encyclopédie, il prend de toutes mains, et. très largement d'Aristote, qu'il cite fréquemment, qu'il traduit, qu'il commente, et qu'il admire de toutes façons. Le plus souvent il se contente de l'Histoire des Animaux ; mais il a recours aussi au traité des Parties. Son défaut bien connu, c'est de chercher à piquer la curiosité de ses lecteurs et de ne s'intéresser LXII qu'aux faits extraordinaires. Dans sa crédulité, qui accepte les opinions extravagantes du plus ignorant vulgaire, il ne repousse pas les récits les plus invraisemblables. Aux faits exacts que lui fournit Aristote, il mêle, sans aucun discernement, les faits les plus faux et les plus impossibles. On concevrait donc que la physiologie comparée ait touché assez peu un esprit porté moins à la science qu'à l'anecdote. Sans contredit Pline est fort instruit; sa vaste compilation, dont les XXXVII livres comprennent le tableau de la nature depuis les phénomènes célestes jusqu'aux minéraux, reste infiniment précieuse par tous les renseignements qu'elle nous a conservés; mais elle n'est pas scientifique. L'auteur est un grand écrivain ; mais c'est toujours un lettré, et jamais un savant. Quoi qu'il en soit, après avoir dépeint, à sa manière, tous les animaux, de l'homme à l'insecte, il en arrive à traiter des parties de leur corps (livre XI, ch. XLIV et suiv.); et il fait, dans cette intention, une véritable analyse de l'ouvrage d'Aristote, sans d'ailleurs le nommer expressément. La tête, les cornes, les LXIII cheveux, le cerveau, les oreilles, le visage, les yeux, les dents, la langue, le cou avec le larynx, l'épiglotte et le pharynx, la colonne vertébrale, le cœur, le foie, la bile, l'estomac, les reins, la graisse, la moelle, les os, les nerfs, les artères, le sang, la peau, les poils, les mamelles, le lait, la main de l'homme et ses doigts, les pieds des animaux, leur voix, etc., etc., il parcourt tous ces sujets sur les pas de son modèle, avec peu d'ordre, mais avec des connaissances de détail qui vont quelquefois au delà de celles d'Aristote, et qui prouvent les faibles progrès que la physiologie comparée avait faits en quatre siècles. Dans le livre que Pline a consacré à l'homme, le septième de son Histoire naturelle, on trouve les premières traces et le cadre assez complet d'une science que le xixe siècle se flatte d'avoir inventée, l'anthropologie. Enfin Pline sait parler de l'homme, de sa misère et de sa grandeur, avec une vérité pénétrante et une éloquente tristesse que Pascal seul a surpassées : « Tantum nudum et in nuda humo... vagitus... ploratum... lacrymas... flens animal, caeteris imperaturum. » LXIV Vers le temps de Pline et un peu ayant .Galien, Rufus d'Éphèse, habile médecin, qui était Grec malgré son nom latin, se rendit célèbre par des travaux d'anatomie qui doivent tenir une assez grande place dans l'histoire de la science. Il ne nous reste de lui, outre des fragments nombreux, que trois traités : sur les maladies de la vessie et des reins, sur les noms des Parties du corps humain, et sur la goutte. C'est le second de ces ouvrages qui seul a quelque intérêt pour la physiologie, dont nous essayons ici de re-tracer les destinées. Évidemment, ce traité des noms des Parties a été inspiré par celui d'Aristote, que Rufus cite à propos du lobe de l'oreille. C'est un manuel très clair et assez bien classé dans tous ses détails, qui s'adresse aux étudiants, et qui se rapproche beaucoup dés manuels de notre temps. L'analyse y est très développée et généralement exacte, un peu minutieuse, mais précise. Elle donne une bonne opinion des études médicales au temps de Trajan, sous le règne de qui. Rufus a vécu, puisque Galien le nomme parmi les médecins les plus récents. Rufus LXV avait disséqué des singes, ainsi qu'il nous l'apprend; mais, d'après les faits consignés dans ses œuvres, il n'y a pas de doute qu'il a disséqué aussi des cadavres humains. On attribue à Rufus la distinction des nerfs de mouvement et des nerfs de sensibilité ; mais Rufus, lui-même, rapporte cette belle découverte à Érasistrate. (Voir l'édition de Rufus de Daremberg-Ruelle, 1860, page 185.) Avec Galien, on rentre dans la science pure, d'où Pline était sorti ; mais comme avec Celse et Rufus, cette science est exclusivement médicale; elle ne s'attache qu'a la physiologie de l'homme. Du reste, Galien a su développer beaucoup pour son époque cette branche de la médecine. Fils d'un père qui joignait à une grande richesse une instruction non moins grande, formé de très bonne heure par une éducation excellente, doué des qualités les plus distinguées et les plus souples, excessivement laborieux et curieux en tout genre, passionné pour la philosophie autant que pour l'art médical, Galien réunissait toutes les conditions d'un succès facile et durable, qui, pour quelque temps, en a fait l'égal d'Hip- LXVI pocrate. Contemporain de Marc-Aurèle, il a été son médecin, celui de Commode et de Septime-Sévère. Il a très probablement vécu même après cet empereur (211 ap. J.-C), sans, qu'on sache au juste à quel âge il est mort. Né à Pergame, en Mysie, il quitta fort jeune sa patrie, y revint à plusieurs reprises, vécut quelques années à Rome, et voyagea dans la plupart des provinces de l'Empire, où il fut en relations suivies avec tous les savants et les philosophes de son temps, comme le montrent les vives polémiques où il se plut, un peu trop souvent, à s'engager avec eux.
Ses œuvres, dont nous n'avons qu'une
portion, sont extrêmement volumineuses. Aussi a-t-il dû, dans un
livre spécial, se donner la peine de nous apprendre lui-même selon
quel ordre et selon quel esprit il fallait les lire. Mais une seule
de ses œuvres doit nous arrêter ; elle est intitulée : « De l'usage
des Parties dans le corps de l'homme. » C'est une reproduction, un
peu prolixe, de l'ouvrage d'Aristote, réduit à la physiologie
humaine. En dix-sept chapitres, ou livres, d'inégale longueur,
Galien étudie la main et le bras,
LXVII les membres abdominaux, les organes alimentaires,
les organes de la respiration et de la voix, l'encéphale avec les
sens, les yeux, la face, le cou, l'épine dorsale, les organes de la
génération, les nerfs, les artères, les veines ; et il termine cette
étude par un élan d'admiration pour la sagesse et la bonté de la
nature. Les sentiments de Galien et ses idées sont donc tout
Aristotéliques ; et il était assez difficile qu'il en fût autrement,
puisqu'Aristote avait vu la vérité, et que c'eût été s'écarter
d'elle que s'écarter de lui. Le plus souvent, Galien est de l'avis d'Aristote, et c'est ainsi que, dans ce qui est relatif à l'organisation de la main humaine, il se prononce avec lui contre Anaxagore, qui s'est trompé en prenant l'effet pour la cause. Mais LXVIII d'autres fois, Galien réfute Aristote, comme il le fait à propos des ongles, dont, à l'en croire, Aristote n'a pas bien compris l'office. La plus forte divergence entre les deux naturalistes, c'est que l'un, en sa qualité de médecin, a surtout considéré l'homme, et que l'autre, plus philosophe encore que physiologiste, a cherché à étudier la question de la vie dans toute sa généralité. Galien ne s'est pas élevé a cette vue d'ensemble ; un médecin n'y était pas tenu. Néanmoins on peut trouver assez étrange qu'il ait omis une étude si rapprochée des siennes, quand on le voit se livrer à des études bien plus éloignées, comme la logique, à laquelle il paraît avoir donné beaucoup de temps et beaucoup de labeur, satisfaisant son goût pour les théories subtiles et captieuses. Dans un ouvrage considérable sur la Méthode thérapeutique, Galien agite la question générale de la méthode, et il discute la méthode de Platon dans le Sophiste et le Politique, en même temps que celle d'Aristote dans le traité des Parties, qu'il cite en le nommant. (Galien, édition de Kühn, t. X, p. 26, Leip- LXIX sig, 1821.) En fait de méthode, il n'approuve pas plus le maître que l'élève ; Aristote avait combattu la Dichotomie Platonicienne ; et pourtant Galien, qui la combat comme lui, le critique vivement, et avec peu de justesse, à ce qu'il semble. Il trouve qu'Aristote n'exprime pas sa pensée assez nettement; il le blâme de ses hésitations, et il lui reproche de ne point oser se prononcer. En ceci, Galien commet une erreur manifeste ; car il est impossible d'être un adversaire plus déclaré de la méthode de division que ne l'est Aristote. Qui voudrait s'en assurer n'aurait qu'à lire un chapitre du traité des Parties. Il est vrai que Galien, tout en parlant de la méthode en général, pense surtout à la méthode en médecine ; mais c'est oublier un peu trop qu'il est logicien. La méthode recommandée par Aristote et pratiquée par lui est la vraie, et il n'y a point lieu de la changer. Galien aurait pu la garder, tout en repoussant la méthode de la division par deux. Oribase, né à Pergame comme Galien, avait fait par ordre de l'empereur Julien, dont il était le médecin et l'ami, une immense Col- LXX lection médicale, dont une partie seulement est arrivée jusqu'à -nous, dix-sept livres sur soixante-dix. C'est un assemblage d'extraits empruntés aux médecins les plus fameux des derniers siècles de l'Antiquité et des premiers siècles de notre ère. La seconde partie, qui regardait l'anatomie et la physiologie de l'homme, est perdue; et il est difficile déjuger de ce qu'elle pouvait ajouter aux théories d'Aristote et à celles de Galien ; mais probablement la physiologie comparée avait échappé à Oribase comme à presque tous les médecins, ses prédécesseurs. (Voir l'édition d'Oribase de Daremberg, Bussemaker et Molinier, 8 vol. in-8, 1833-1857.) Avec Oribase, on pourrait dire avec Galien déjà, finit l'Antiquité scientifique. Dès cette époque, le génie grec est en décadence, comme l'Empire ; et bientôt l'invasion des Barbares vient achever la ruine que la corruption du Paganisme avait commencée. Dans ces longs siècles de stérilité, la physiologie comparée est oubliée, à peu près autant que le sont d'autres sciences plus utiles ; il faut attendre environ mille ans, pour que la lumière repa- LXXXI raisse, au milieu de ces lourdes ténèbres qui pèsent sur le Moyen-âge, et qui ne se dissipent peu à peu qu'à partir du xiie et du xiiie siècles. Mais avant de quitter le sol fécond et sacré de la Grèce, il faut lui rendre un nouvel hommage et rappeler en quelques mots ce qu'étaient les germes qu'elle avait enfantés, et qu'elle léguait au monde dans le champ de la physiologie comparée. Cette science avait été, comme tant d'autres, fondée par Aristote, trois cent trente ans au moins avant l'ère chrétienne, on a vu sur quelles bases solides et inébranlables. L'esprit humain n'y ajoute rien dans les temps qui s'écoulent d'Alexandre le Grand à Justinien ; du premier pas, Aristote s'était tellement avancé que personne n'a pu marcher à sa hauteur. L'histoire naturelle demeure donc immobile au point où son génie l'avait conduite. Aucun savant, pas même Pline, n'avait été en état de recueillir cet héritage et de le faire fructifier. Tout au plus, quelques médecins portés, par l'art qu'ils cultivent, à étudier la physiologie, s'occupent-ils de celle de l'homme ; mais ils ne vont pas jusqu'aux LXXII animaux; ils accumulent un grand nombre d'observations dans le domaine qui est le leur ; ils n'en sortent pas ; et quoique très frappés, comme Aristote, des perfections de l'organisation humaine, l'organisation non moins merveilleuse de la vie chez les autres êtres animés ne leur dit rien ; ils s'enferment dans leur cercle, qui est encore très vaste et surtout très pratique, mais qui est bien étroit, comparativement à l'infinitude de la vie « dans l'ample sein de la nature. » Telle est la part de l'Antiquité. Pour rencontrer, dans les siècles qui la suivent, un monument de quelque valeur, il faut arriver, par l'intermédiaire des Syriens et des Arabes, à la Renaissance du xiiie siècle, prélude de la vraie Renaissance du xvie Au milieu d'un mouvement immense, Albert le Grand (1193-1280) occupe la place principale. Il étudie et enseigne Aristote d'après les traductions d'Avicenne (980-1037) et d'Averroës (1120-1198), et d'après celles de Michel Scolus, le protégé de Frédéric II, les unes faites sur l'arabe, les autres faites directement sur le grec, plus ou moins bien compris. Il semble LXXIII que c'est surtout à Avicenne qu'Albert le Grand demande la forme de son ouvrage, si ce n'est le fond, qui est toujours tiré d'Aristote. Comme Avicenne, il paraphrase ; il ne commente pas ; et à son exemple encore, il réunit les trois traités d'Aristote en un seul : « De animalibus. » Sous sa main, l'Histoire des Animaux, le traité des Parties et celui de la Génération ne forment plus qu'un tout systématique de ce qu'on savait alors de plus scientifique sur le règne animal. On ne pouvait pas rendre de service plus signalé à la science de ces temps. Aristote peut sembler aujourd'hui, si on le juge superficiellement, être bien incomplet; ses lacunes sont de toute évidence, comme elles sont de toute nécessité ; mais, en dépit de quelques erreurs fort rares, quelle heureuse fortune, au siècle de Saint-Louis, dans les limbes où l'on était encore plongé, d'écouter un maître tel qu'Aristote ! Quelle mine inépuisable d'instruction ! Que de vérités ! Que d'observations exactes ! Quelles vues sur la beauté, la grandeur, la magnificence, la sagesse de la nature, « dans sa haute et pleine majesté ! » Voilà ce qui dut exciter puissamment le zèle LXXIV d'Albert le Grand et attirer les disciples qui se pressaient à ses leçons. Nous ne saurions trop louer ces efforts héroïques dans un temps où tout était si difficile ; ils sont souvent dédaignés par ceux qui ne les comprennent pas ; mais, en soi, ils sont dignes de la plus sérieuse estime. Sans doute, il aurait valu beaucoup mieux étudier la nature plutôt que son interprète, quelque autorisé qu'il fût. Mais il ne faut attendre des diverses époques de l'humanité, non plus que des individus, que ce qu'elles peuvent accomplir. La Grèce, par son génie propre, et aussi par la faveur des circonstances, s'était astreinte dès son début à la discipline sévère de la science ; l'observation régulière des faits était née avec ses premières écoles de philosophie, pour atteindre presque aussitôt à la perfection, avec Hippocrate, avec Aristote et tant d'autres. Le génie moderne, à son berceau, ne devait pas être aussi bien partagé ; son éducation était à refaire tout entière ; il dut se mettre à l'école, à peu près comme on y met les enfants qui commencent à s'instruire. Notre Moyen-âge a été cette pénible initiation; et si, à cette heure, l'intel- LXXV ligence moderne est si forte, c'est qu'elle a eu le bonheur de recevoir son premier enseignement de la Grèce, et d'avoir pour précepteur des hommes tels qu'Albert le Grand, Saint-Thomas et leurs laborieux contemporains. On ne peut pas dire qu'Albert ait fait faire à la physiologie comparée et à la zoologie de véritables progrès, bien qu'on lui doive quelques ouvrages originaux, un entre autres sur la Nature des Oiseaux, « De Natura avium. » Mais s'il n'a rien ajouté à ce que lui transmettait la tradition, c'était déjà beaucoup de conserver et de ressusciter ce précieux dépôt ; et l'on peut affirmer qu'Albert a contribué autant que personne à la rénovation qui, depuis six siècles, n'a pas cessé de grandir de jour en jour, et qui a soutenu l'esprit moderne, de sa débile enfance à l'Age adulte et viril qui fleurit sous nos yeux. Albert le Grand est un de ces instituteurs dont le nom reste à jamais respecté; la reconnaissance ne doit pas lui être ménagée, chaque fois que l'occasion de la lui exprimer s'offre à nous. C'est à l'influence d'Albert le Grand qu'il faut rapporter en partie le mouvement d'études LXXVI qui se manifeste après lui ; on en trouve les traces évidentes dans les ouvrages de cette époque obscure, parmi lesquels un des plus remarquables est celui de Mundino Mundinus, Ramondino , professeur de Bologne, mort en 1326. Cet ouvrage, qui est intitulé : « De omnibus humani corporis interioribus membris anathomia », a régné deux cents ans dans les écoles. C'est un manuel pour les élèves en médecine qui fréquentaient les cours de Mundino ; il est parfaitement composé ; et, dans une suite de chapitres concis et très clairs, il donne des notions exactes sur les principaux viscères de l'homme, mésentère, estomac, rate, foie, vessie, veine du chyle, reins, conduits spermatiques, matrice, testicules, ventre, mamelles, muscles, cœur, poumons, trachée-artère, bouche, langue, tête, crâne, dure-mère, cerveau, oreille, et enfin les os, dont l'auteur porte, d'après Avicenne, le nombre total à deux cent quarante-huit, de même qu'il porte le nombre des muscles à cinq cent vingt-neuf, d'après Galien. Nous n'avons pas à en dire davantage de cette œuvre de Mundino, parce qu'elle est sim- LXXVII plement de l'anatomie humaine, et non de la physiologie comparée. Mais nous devions la signaler et la saluer au passage, pour nous arrêter un peu plus aux savants hommes, qui, dans le xvie siècle, ont été, après Zerbis, Achillini, Bérenger de Garpi, Sylvius, etc., les précurseurs et les représentants de la science moderne. Tout était prêt pour cet enfantement définitif; car il était inévitable qu'après avoir si longtemps commenté Aristote, on l'imitât, et qu'à son exemple, on se mît à étudier la nature, à côté et au-dessus des écrits que le philosophe lui avait consacrés. C'était là encore l'œuvre de disciples qui se montraient fidèles, tout en dépassant de beaucoup le maître qui les avait formés. Vésale est l'homme de génie qui, entre tous, trace le plus brillamment la carrière nouvelle, avec une admiration sincère pour les Anciens, mais avec une indépendance absolue. Il a pu composer, dans une existence courte et agitée (1514--4564-), des ouvrages d'anatomie dont Boerhaave et Albinus, deux siècles après lui, se faisaient encore un devoir de donner une superbe et utile édition. LXVVIII. Né à Bruxelles, instruit aux écoles de Louvain, de Paris et aux Universités italiennes, Vésale s'est surtout appliqué à l'anatomie humaine, qu'il a analysée depuis les os jusqu'au cerveau et aux organes des sens, en accompagnant de planches nombreuses et exactes des descriptions qui auraient pu s'en passer, grâce à leur clarté. Médecin de Charles-Quint à qui il dédiait, bien jeune encore (4542), son livre célèbre : « De corporis humani fabrica, » médecin aussi de Philippe II, qui eut à le défendre contre les persécutions aveugles de l'Inquisition, Vésale, forcé à l'exil et à de lointains voyages, mourait sans avoir pu donner au monde tout ce qu'il avait promis. Il n'a eu le temps de rien faire, ni pour l'anatomie comparée, ni pour la physiologie générale; mais des travaux tels que les siens rayonnent au delà [de leur sphère spéciale ; et la méthode qu'il appliquait à l'organisation de l'homme n'avait plus qu'à s'étendre au reste de l'animalité. On ne parlera ici des travaux de Fallope et d'Eustache qu'avec la même réserve. Ce sont l'un et l'autre de très habiles anatomistes, qui LXXIX ont mérité par leurs découvertes d'attacher leur illustre nom à des parties de l'organisme humain. Fallope (Fallopio) élève de Vésale, professeur dans plusieurs Universités italiennes et à Padoue, est mort avant quarante ans (1563). Eustache (Eustachi), adversaire de Vésale, et professeur à la Sapience (mort en 1590), a fourni une vie plus longue et non moins remplie. Ils ont porté tous deux dans leurs dissections une adresse et une exactitude supérieures. Fallope passe pour un des premiers qui, dans les temps modernes, aient eu recours à la vivisection ; il ne l'a pas précisément inventée, puisqu'il paraît certain qu'Hérophile, grand anatomiste aussi, la pratiquait déjà dans l'école d'Alexandrie. Mais Fallope a employé ce moyen d'investigation jusqu'à cette extrême limite où elle devient un crime ; si l'on en croit un horrible aveu, venu de lui-même, il aurait disséqué tout vivants des criminels que lui livrait la justice du Grand-Duc de Toscane. (Biographie universelle de Michaud, 2e édition, p. 360, 2e colonne; article Fallope.) Ni dans Vésale, ni dans Fallope, ni dans Eustache, ni dans Syl- LXXX vius, on ne trouve de physiologie comparée et d'anatomie comparée, à l'état de sciences distinctes, bien qu'ils établissent tous de fréquents rapprochements entre l'homme et les animaux. A qui revient la gloire d'avoir pressenti, si ce n'est inauguré, ces deux sciences à la fin du xvie siècle et au début du xviie ? Est-ce à notre Ambroise Paré ? Est-ce à Fabrice d'Acquapendente, l'élève et le successeur de Fallopio à Padoue, ou même à Koiter, de Nuremberg? Paré mourut en 1590; Koiter en 1600, et Fabrice vingt ans plus tard, en 1619. Ambroise Paré est le plus savant des anatomistes français de son temps. Chirurgien des rois Henri II, Charles IX, Henri III, son principal ouvrage : « Briève collection de l'administration anatomique » ne concerne que l'anatomie humaine, aussi complète dans ce livre qu'elle pouvait l'être à ce moment. Mais dans un autre ouvrage de moindre importance, Ambroise Paré fait de la physiologie comparée. Cet ouvrage a pour titre : « le Livre des animaux et de l'excellence de l'homme. » Sur vingt-et-un chapitres, les quatre derniers sont LXXXI consacrés à l'homme exclusivement. Dans l'Antiquité, Aristote aussi avait pris l'homme pour type, et il avait rapporté à cette organisation plus parfaite celle des animaux secondaires qu'il connaissait. Paré a surtout étudié le squelette de l'homme comparativement à celui des quadrupèdes et des oiseaux, comme l'avait déjà fait Belon. C'était là une vue féconde ; mais ce n'était pas encore un système. Il n'y a non plus rien de systématique dans les travaux de Koiter, élève de Fallope et d'Aldrovande, quoiqu'il ait disséqué et représenté les squelettes d'assez nombreux animaux. Il ne fait encore que des notices séparées ; mais ces détails suggéraient assez aisément l'idée de les comparer entre eux, et de rassembler régulièrement tous les éléments de la science nouvelle. Le progrès est beaucoup plus sensible dans Fabrice, et la physiologie comparée est bien près de revêtir par ses mains la forme qui lui appartient. En étudiant diverses fonctions, la vue, l'ouïe, la voix, Fabrice parcourt la série animale pour élucider ce qui concerne l'homme ; mais c'est dans ses deux ouvrages : « De totius LXXXII animalis tegumentis » et c De motu locali animalium secundum totum » que se trouve sa physiologie comparée. Il est vrai que ces deux sujets n'étaient pas tout à fait neufs; le premier avait été indiqué, et le second, spécialement exposé par Aristote dans son étude sur la Marche des Animaux. Fabrice n'a fait que le continuer. Mais il avait en outre préparé un recueil qui devait s'appeler : « Totius fabricœ animalis theatrum. » Pour cet ouvrage projeté, il avait fait graver trois cents planches, qui ne se sont pas retrouvées après sa mort, comme se sont retrouvées celle d'Eustache, publiées un siècle et demi plus tard par Lancisi. A ces différents titres, Fabrice d'Acquapendente, quarante ans professeur à Padoue, peut être regardé comme un des pères de la physiologie comparée dans les temps modernes. Ainsi, l'idée complète de la science n'a été entrevue et presque conquise que deux mille ans après Aristote. Mais si la nouvelle science n'a pas reçu dès lors le nom qui deviendra sa consécration incontestée, son principe est reconnu ; son domaine est déterminé, et il ne sera plus possible de le lui disputer, LXXXIII lorsqu'un savant plus heureux en prendra définitivement possession.
Il y a de très beaux noms au xviie
siècle parmi les physiologistes, médecins ou philosophes, Harvey,
Descartes, Thomas Willis; mais c'est de l'homme qu'ils se
préoccupent beaucoup plus que des animaux. Harvey (1578-1638),
médecin de Jacques 1er et de Charles Ier, s'est immortalisé en
expliquant, comme on le sait, la circulation du sang, soupçonnée par
Servet, par Césalpin et quelques autres. Mais en physiologie
comparée, il n'a fait qu'un assez court traité sur la génération des
animaux. Comme Aristote, qu'il admire beaucoup (Naturae
diligentissimus investigator), il étudie à peu près uniquement l'œuf
de la poule, en profitant des observations de Fabrice. Sur
soixante-douze Exercices, comme il les appelle (Exercitationes
anatomicœ, Amsterdam, 1651), il en consacre soixante-trois aux
oiseaux; il donne ensuite quelques chapitres à la génération des
vivipares, parmi lesquels il ne distingue guère que l'espèce des
Cervidés ; et il termine son travail par une théorie sur la chaleur
animale et sur l'humidité originelle
LXXXIV des êtres animés.
D'ailleurs, son exposition est excellente, concise et parfaitement
claire, comme le fameux traité « De motu cordis et sanguinis
circulatione » (1628-1649). Harvey avait aussi rédigé un opuscule
sur la locomotion des animaux ; mais le manuscrit, qu'il n'avait pas
eu le temps de publier, a disparu après sa mort. L'éclatante et juste renommée du « Discours de la Méthode » a effacé les labeurs secondaires ; mais ils n'en sont pas moins importants, et l'on a démontré l'influence que les idées physiologiques de Descartes ont exercée au xviie siècle (M. le docteur Bertrand de Saint-Germain, 1860). Comme on devait s'y attendre, Descartes se préoccupa de l'homme par-dessus tout ; les animaux ne laissent pas que de l'intéresser ; mais dans son existence trop courte (1596-1650), il n'a pu achever toutes les recherches qu'il méditait. LXXXV Thomas Willis, d'Oxford (1622-1665), s'est signalé par son anatomie et sa pathologie du cerveau. Il a fait aussi une théorie de l'âme des bêtes (De anima brutorum), et il a tenté quelques comparaisons entre les diverses espèces d'animaux. Mais c'est une exagération de voir dans ces essais l'origine de l'anatomie comparée, telle qu'on l'entend aujourd'hui. Ainsi, le xviie siècle n'a pas eu la gloire de donner à cette science une organisation systématique ; mais ce siècle brille de tant d'autres gloires qu'il peut se passer de celle-là, que ni Willis, ni Descartes, ni Harvey, ne lui ont assurée. Le xviiie siècle n'a pas eu davantage cet honneur, du moins dans sa première moitié, bien qu'il ait produit alors de grands médecins et de grands naturalistes, Boërhaave, Linné, Buffon, Haller (Albert). Boërhaave se contenta d'être le premier des médecins et des chimistes de son temps (1668-1738). Linné est surtout un nomenclateur de génie, qui soumet à un ordre jusque-là inconnu les éléments épars de l'histoire de la nature. Buffon, livré entièrement à la description des animaux, ne parle presque jamais d'anatomie LXXXVI ni de physiologie. Il consacre de persévérantes et profondes études à la génération; mais il ne la considère que dans l'espèce humaine, et la question générale disparaît pour lui. Il croit même que l'anatomie doit rester étrangère àr l'istoire naturelle; et, à l'entendre, « c'est « seulement lorsque dans l'intérieur du corps « de l'animal il y a des choses remarquables, « soit par la conformation, soit par les usages « qu'on en peut faire, qu'on doit les ajouter « ou à la description ou à l'histoire. » Par là, Buffon ne veut pas nier les droits que peuvent avoir l'anatomie comparée et la physiologie comparée à devenir des sciences indépendantes ; mais il n'y applique pas ses sagaces recherches; et, sans ignorer ces sciences, il ne les cultive point. Il leur rend d'ailleurs un service éminent en réunissant dans le jardin du Roi, confié à son administration, et avec l'aide de Daubenton et de Mertrud, plus d'animaux, vivants ou conservés, qu'on n'en avait jamais vu dans aucune collection. L'anatomie et la physiologie y ont trouvé des matériaux abondants, et les musées anatomiques qui en ont été tirés sont peut-être les plus riches du LXXXVIII monde. C'est là dans la vie de Buffon une page non moins belle que toutes les pages si éloquentes qu'il a écrites. Albert de Haller (14708-1777), anatomiste, botaniste, poète, savant presque universel, s'est illustré surtout par un traité de physiologie en huit volumes in4 (1757-1776), écrit en un excellent latin, et attestant non moins d'érudition que de connaissances physiologiques. Haller en publiait une seconde édition quand il mourut ; elle avait pour titre : « De partium corporis humani prœcipuarum fabricâ « functionibus, opus L. annorum. » « Cet ouvrage, dit Cuvier, a étonné le monde savant, par la précision du style, par le détail immense où il entre de la structure des parties, par la discussion approfondie de toutes les opinions émises jusque-là sur leurs usages, et par des renvois exacts et prodigieusement nombreux à tous les passages des auteurs« où il est question des moindres matières relatives à cette science. Il a produit une révolution heureuse et a fait bannir ces vaines hypothèses dont la physiologie semblait être demeurée le domaine. » (Biographie LXXXVIII universelle de Michaud, article Haller). Après quelques considérations sur la méthode, Haller traite successivement de la fibre ou tissu cellulaire, des membranes, de la graisse, des vaisseaux artériels, veineux et lymphatiques, du sang, des humeurs, de la respiration, delà voix, des muscles, des sens internes et externes, de l'intelligence, de la volonté, des fonctions de nutrition, de la génération, du fœtus, de la vie de l'homme en général, et enfin de la mort. On le voit par cette simple nomenclature, ce sont toujours les mêmes matières qu'Aristote, qui n'est peut-être pas assez apprécié par Haller, avait exposées, soit dans ses Opuscules, soit dans le Traité des Parties et dans celui de la Génération. Le cadre avait été dès l'origine si bien tracé qu'un changement n'était plus possible ; mais Haller a rempli ce cadre, très vaste encore dans ses limites, beaucoup mieux que personne avant lui; et il a donné un exemple dont ses successeurs ne peuvent plus s'écarter. Quoique Haller se soit borné à la physiologie humaine, il a fait cependant quelques excursions, et il a touché à LXXXIX la physiologie comparée en étudiant le développement du poulet dans l'œuf, et celui du fœtus dans le quadrupède, les monstres, le cerveau et l'œil des oiseaux et des poissons, etc. Mais ces travaux, quelque estimables qu'ils fussent, ne formaient pas un système; et la physiologie comparée attendait toujours un législateur. D'ailleurs, la physiologie, si profondément analysée dans l'homme, aidait et conduisait h des vues plus générales. Haller admirait la nature, comme Aristote, et il en parle de même que lui : « Sola nova est, sola fida, nunquam satis colitur, nunquam frustra. » Mais il n'a pu explorer qu'une portion de tant de merveilles ; l'organisation humaine a suffi pour absorber sa prodigieuse activité, que, seule peut-être, a dépassée celle de Leibniz. Vicq d'Azyr (1748-1794), par des travaux plus brillants que solides, avait provoqué des espérances qu'il n'a pas pu tenir. Membre de l'Académie des sciences et de l'Académie française, on avait cru voir en lui le successeur de Buffon, pour la science et même pour le style ; il n'en fut rien, et le nom de Vicq d'Azyr est à cette heure presque tombé dans l'oubli. XC Par ses études de médecine, il avait été amené à concevoir un cours d'anatomie comparée et de physiologie comparée, dont il n'a esquissé que quelques parties, avec peu de régularité et de méthode. C'est dans trois de ses Discours sur l'anatomie qu'on peut recueillir une idée de ses projets. Il comptait étudier les principales fonctions au nombre de neuf: ostéologie, irritabilité, circulation, sensibilité, respiration, digestion, sécrétions, génération et nutrition. Il n'a pu réaliser ce plan, qui n'est pas très bien ordonné, et les quelques traits que nous conserve le Tableau de son cours ne le font que médiocrement connaître. Il n'est guère présumable qu'un tel cours, s'il eût été professé, eût pu être très utile. (Œuvres de Vicq d'Azir, tome IV, p. 42 et suiv., et article de Cuvier dans la Biographie universelle de Michaud.) Le génie de Bichat était assez puissant, pour qu'on pût tout attendre de lui ; mais, frappé par une mort prématurée, à 31 ans à peine (1802), il n'a laissé qu'un ouvrage durable, son Anatomie générale, et des regrets, qui ne sont pas encore éteints. Lui, sans XCI doute, aurait su étendre un système de physiologie humaine au reste des êtres animés, si toutefois la médecine ne l'eût pas, comme bien d'autres, disputé à l'histoire naturelle. Si nous avons parlé ici de médecins qui ne se sont occupés que de la physiologie de l'homme, qu'on ne s'en étonne pas. Notre organisation étant la plus parfaite de toutes, elle sert, bien comprise, à faire mieux comprendre les autres. Comme le pensait Aristote, c'est de la physiologie humaine que dérive la physiologie comparée ; et voilà comment la médecine, qui, avec le secours de l'anatomie et de la physiologie, ne doit songer qu'à l'hygiène de l'homme, peut immensément servir l'histoire générale de la vie, tout en ne l'étudiant d'abord que dans une de ses manifestations qui est à la fois la plus accomplie et la plus lumineuse. Dans Cuvier, au début du xixe siècle, nous ne trouverons qu'un naturaliste ; mais ce naturaliste est sans contredit le plus grand depuis Aristote, et l'on peut présumer que bien longtemps encore il restera supérieur à tout ce que les siècles qui suivront le nôtre XCII pourront ajouter à ce qu'il a fait. Dans une existence qui n'a pas été fort longue (1769-1832), et qui fut distraite par une foule de devoirs étrangers à la science, Cuvier a pu cependant élever quatre monuments, dont un seul suffisait à l'immortaliser : son Anatomie comparée, son Règne animal, ses Recherches sur les ossements fossiles, et son Histoire naturelle des poissons. Ces quatre ouvrages, sans compter bon nombre de Mémoires particuliers, ont frayé des voies nouvelles à la science, ou lui ont conféré à certains égards une régularité et une exactitude dont elle manquait jusqu'alors. Avant Cuvier, l'anatomie comparée n'était guère qu'un nom, même après l'ouvrage de Blumenbach (1794); il l'a constituée définitivement, en la limitant aux fonctions principales, et en l'appuyant sur les observations les plus minutieuses et les plus précises. Pour le Règne animal, il a été un nomenclateur plus instruit que Linné, envers lequel il professe la plus grande estime ; il a fait reposer la classification des êtres sur leur structure mieux analysée. Ses Recherches sur les ossements fossiles ont créé de toutes pièces XCIII la paléontologie, et son Discours sur les révolutions de la surface du globe a été le point de départ de progrès inattendus, qui ont dépassé de beaucoup les théories de BufTon sur la terre. Enfin, l'Histoire naturelle des poissons est la plus complète de toutes les monographies sur cette partie de la création. Cuvier n'a pas eu le temps de faire un traité spécial de physiologie comparée ; mais tous ses ouvrages supposent cette science, sans que dans aucun il l'ait abordée directement. (Voir la lettre à Mertrud, p. 22). C'est donc de son Anatomie comparée que nous nous occuperons presque uniquement. Lorsque Cuvier la publia en cinq volumes, il n'avait que trente ans. C'est une œuvre de génie, par la multiplicité des détails, par l'ordre imperturbable dans lequel ils se déroulent, par la clarté, la justesse, la profondeur, la variété des vues, par la vigueur et la beauté d'un style magistral, qui n'a rien de la sécheresse scientifique. D'abord Cuvier essaie de définir la vie, afin de faire mieux concevoir la nature des organes par lesquels la vie s'exerce et se manifeste. XCIV Les fonctions qui composent l'économie animale sont, d'après lui, de trois ordres : les unes, telles que la sensibilité et la locomotion, font des animaux ce qu'ils sont, en opposition à la plante immobile et insensible ; les autres les font vivre ; et les dernières les perpétuent par la reproduction. L'organe général de la faculté de sentir est la substance médullaire, dont on ne connaît pas encore les molécules organiques, mais qui, ramifiée en filets ou nerfs partant de quelques centres principaux, se distribue dans tout le corps. L'organe général du mouvement est la fibre musculaire ou charnue, qui se contracte, sous l'empire de la volonté, par l'intermédiaire du nerf. Les muscles sont attachés à des parties dures, soit intérieures, soit extérieures. Selon les espèces, ces parties sont recouvertes par les muscles, ou elles les recouvrent. L'ensemble des parties dures est ce qu'on nomme le squelette, qui renferme toujours les viscères, et qui détermine la forme extérieure de l'être. L'animal ne perçoit l'action du dehors sur lui que par les nerfs, communiquant librement avec le faisceau commun de la moelle épinière, dont l'ex- XCV trémité antérieure tient au cerveau. Parmi les sens, le toucher est le seul qui appartienne à tous les animaux, et qui agisse dans presque toute la surface du corps de chacun d'eux. Les autres sens ne semblent être que des modifications de celui-là, et ils sont presque toujours situés à cette extrémité du corps qui contient le cerveau. C'est par le moyen des deux facultés de sentir et de se contracter pour se mouvoir, que les animaux éprouvent et satisfont leurs besoins. Le plus irrésistible de tous est celui de la faim, qui rappelle sans cesse à l'animal la nécessité de fournir de nouvelles matières à sa nutrition. C'est la plus compliquée de toutes ses fonctions, et celle qui exige le plus d'organes pour la combinaison ou la décomposition des fluides que le corps produit à la suite de la digestion, « Dans cette transformation de fluides gît le véritable secret de cette admirable économie, » qui aboutit en dernier lieu à la génération, destinée à transmettre la vie, de l'individu à un être pareil à lui. Après cette exposition générale, Cuvier pré- XCVI sente l'analyse des différences qu'offrent les animaux dans chacun de leurs systèmes d'organes. C'est là précisément l'objet de l'anatomie comparée. Ainsi, pour les organes du mouvement, il y a tantôt un squelette intérieur, articulé et revêtu par la chair ; tantôt les os manquent; et, à leur place, ce sont des coquilles qui recouvrent la peau, au dedans de laquelle sont les muscles ; parfois même, il n'y a aucune partie dure qui puisse servir de levier ou de point d'appui. Les différences dans les sens extérieurs ne sont pas moins marquées ; le nombre des sens varie, ainsi que leur degré d'énergie ; la vue et l'ouïe font assez souvent défaut; les trois autres sens, mais surtout le toucher et le goût ne paraissent jamais manquer. Les organes de la digestion offrent deux grandes différences dans leur disposition totale : ou les intestins n'ont, comme chez la plupart des zoophytes, qu'une seule ouverture qui sert tout à la fois à l'entrée des aliments et à l'issue des excrétions ; ou bien, il y a deux ouvertures distinctes, aux extrémités d'un canal unique. Le chyle, qui est produit par l'action des organes digestifs sur XCVII les substances alimentaires, le sang, dont la circulation est double ou simple, dans les animaux qui en ont une, la respiration par le poumon ou par des branchies, selon l'élément ambiant, la voix avec ou sans glotte, la reproduction gemmipare, vivipare ou ovipare, et enfin l'état du jeune avant qu'il ne devienne apte à perpétuer son espèce, telles sont les différences principales qu'on peut observer dans toute la série des animaux. Après avoir montré les rapports qui existent entre les divers systèmes d'organes et leur solidarité mutuelle, pour composer l'unité et l'harmonie dans la vie des êtres, Cuvier divise encore les animaux en deux classes, les animaux à sang rouge, et les animaux à sang blanc. Parmi les vertébrés, on distingue les animaux à sang chaud et les animaux à sang froid : d'une part, les mammifères et les oiseaux, et d'autre part, les reptiles et les poissons. Les invertébrés comprennent les mollusques, les crustacés, les insectes, les vers et les zoophytes. Ces neuf grandes classes, réduites à quatre embranchements, se divisent elles-mêmes en XCVIII familles d'un ordre inférieur, que Cuvier décrit les unes après les autres, depuis- les mammifères jusqu'aux coraux, qui se trouvent placés au dernier rang de l'animalité. Il n'est pas nécessaire de suivre l'auteur dans ces détails. C'est d'après ces principes, où l'on peut retrouver bon nombre des théories d'Aristote, que le naturaliste français construit le spacieux édifice de son Anatomie comparée, où il étudie successivement les organes du mouvement, fibre musculaire et os, dans le tronc, dans le membre pectoral, dans le membre abdominal, chez les invertébrés aussi bien que chez les vertébrés ; puis, les organes des sensations, de la digestion, de la circulation, de la respiration et de la voix, et enfin, les organes de la génération et des sécrétions. Dans cette revue de tant d'êtres et de tant de choses, Cuvier, a l'exemple d'Aristote, commence toujours par l'homme, et de l'homme il va aux mammifères, aux oiseaux, aux reptiles, aux poissons, pour descendre encore à des êtres de plus en plus imparfaits, notant partout les ressemblances et les diversités. Sur de telles bases, ce système est inébran- XCIX lable. Conforme à Tordre même de la nature, il doit désormais être le fondement de l'histoire naturelle ; et il a été plus ou moins reproduit dans tous les ouvrages dont notre science peut s'honorer. On peut affirmer, sans la moindre partialité, que la science n'a jamais rien vu de plus beau, depuis qu'elle observe le monde des êtres animés, plus difficile encore à comprendre qu'à classer. L'anatomie comparée a été le plus constant objet des labeurs de Cuvier ; il en avait commencé l'étude dès sa première jeunesse, comme il nous l'apprend lui-même; et il l'a toujours continuée avec une persévérance infatigable. C'est même pour guider cette science et pour la compléter qu'il a composé son ouvrage du Règne animal, où il a classifié tous les animaux d'après la structure que l'anatomie lui avait révélée. « Il a fait marcher de front l'anatomie et la zoologie, les dissections et le classement, » de manière à féconder les deux sciences l'une par l'autre. Le Règne animal, publié quinze ou vingt ans après l'Anatomie comparée, est conçu sur les mêmes principes, vérifiés et fortifiés par des C observations de plus en plus étendues et profondes. Dans une Introduction développée, Cuvier traite tour à tour les questions des méthodes en histoire naturelle, de l'organisation des êtres vivants, animaux et végétaux, des éléments chimiques du corps animal, des forces qui s'y trouvent, des fonctions et des organes que ces forces mettent en jeu, et enfin de la distribution du règne animal. On a contesté à Cuvier la division de ses quatre embranchements. Tantôt on les a niés d'une manière absolue ; tantôt aux types qu'il avait reconnus, on a prétendu en ajouter ou en substituer quelques autres. Ce sont là des questions qu'il convient de laisser éclaircir aux naturalistes; mais ce qui paraît incontestable, c'est le principe fondamental sur lequel Cuvier s'est appuyé, et qu'il a invariablement maintenu jusqu'à ses derniers travaux, à savoir que la classification des êtres animés doit reposer uniquement sur leur organisation. Tout autre principe est arbitraire ; celui-là seul correspond à la réalité, telle que la nature la présente aux regards de l'observateur. La question se réduit alors à un point défait, CI sur lequel il doit toujours être possible de se mettre d'accord. Les vertébrés sont-ils construits comme les mollusques ? Les insectes sont-ils davantage construits comme les mollusques et les vertébrés? Et enfin, les zoophytes ne sont-ils pas construits tout autrement que les trois embranchements qui les précèdent? Est-il possible de découvrir entre les animaux un caractère plus distinctif que leur conformation intime et essentielle? La raison avec Cuvier n'hésite pas à répondre que c'est là le vrai et seul principe, et qu'on n'enfreint cette loi supérieure de toute classification qu'en s'exposant aux plus graves erreurs, et en écoutant l'imagination au lieu de la science. Aussi, depuis la classification de Cuvier, aucun des systèmes qu'on a risqués ne mérite-t-il de remplacer le sien, qui ne fait appel qu'aux données les plus certaines de l'anatomie. De là vient que Cuvier repousse la théorie de l'échelle des êtres, dont il n'est pas plus partisan que ne l'était Buffon. Il ne nie pas toutefois que cette théorie, si on la restreint dans certaines limites, ne contienne quelque vérité. Il remarque qu'en considérant un or- CII gane isolément, et en le suivant dans toutes les espèces d'une classe, on le voit se dégrader avec une uniformité singulière. Dans des espèces môme où cet organe n'est plus d'aucun usage, on l'aperçoit encore en partie, et comme en vestige, « en sorte que la nature semble ne l'y avoir laissé que pour ne point faire de saut. » Mais Cuvier ne croit pas, comme l'ont pensé quelques naturalistes, qu'on puisse ranger les êtres en une série unique, qui les comprendrait tous, sans exception, commençant au plus compliqué et finissant au plus simple, de telle manière que l'esprit passerait de l'un à l'autre sans presque apercevoir d'intervalle et par nuances insensibles. L'échelle des êtres, ainsi entendue, ne paraît à Cuvier qu'une chimère. « Tant qu'on reste dans les mêmes combinaisons d'organes, ces nuances délicates s'observent bien en effet; les animaux semblent formés sur un plan commun ; mais du moment qu'on passe à des combinaisons d'organes différentes, il n'y a plus de ressemblance en rien, et l'on ne peut plus méconnaître l'intervalle ou le saut le plus marqué. » CIII Dans les questions de cet ordre, on doit s'en rapporter à Cuvier plus qu'à personne. Les considérations décisives qui l'ont conduit ont d'autant plus de force et d'utilité aujourd'hui que des doctrines nouvelles ont poussé cette hypothèse infiniment plus loin qu'on ne la poussait de son temps. La regrettable confusion que l'échelle des êtres apportait déjà dans l'histoire naturelle, n'est rien en comparaison du chaos dont elle est menacée par le transformisme Darwinien. Cuvier sans doute prévoyait ces aberrations, quand il combattait si vivement les idées de Lamarck, qui en sont l'origine. Un dernier point à signaler dans le génie de Cuvier, c'est son admiration passionnée de la nature, égale à celle que ressentaient Aristote, Linné et Buffon. Pas plus que ces esprits supérieurs, il n'a peur des causes finales ; à tout instant il les suppose, alors même qu'il ne les invoque pas. Il n'en fait d'ailleurs qu'un usage discret, comme il convient en histoire naturelle et dans toutes les sciences particulières ; mais en présence des phénomènes si frappants de la vie, en scru- CIV tant les moyens diversifiés à l'infini que la nature emploie pour produire infailliblement les mômes résultats, sensibilité, mouvement, nutrition, il reconnaît l'empreinte évidente d'une intention intelligente, et il n'hésite pas à le proclamer, ainsi que le faisait Anaxagore, dès les premiers temps de la philosophie grecque. « En demeurant toujours, dit-il, dans a les bornes que les conditions nécessaires « de l'existence prescrivaient, la nature s'est « abandonnée à toute sa fécondité dans ce que ces conditions ne limitaient pas; et sans sortir jamais du petit nombre de combinaisons possibles entre les modifications essentielles des organes importants, elle semble s'être jouée à l'infini dans toutes les parties accessoires. Pour celles-ci, il ne faut pas qu'une forme, qu'une position quelconque soit nécessaire; il semble même souvent qu'elle n'a pas besoin d'être utile pour être réalisée ; il suffit qu'elle soit possible, c'est-à-dire qu'elle ne détruise pas l'accord de l'ensemble. Aussi, à mesure que nous nous éloignons des organes principaux et que nous nous rapprochons de ceux CV qui le sont moins, trouvons-nous des variétés plus multipliées ; et lorsqu'on arrive à la surface, où la nature des choses voulait que fussent précisément placées les parties les moins essentielles et dont la lésion est la moins dangereuse, le nombre des variétés devient si considérable que tous les travaux des naturalistes n'ont pu encore parvenir à en donner une idée. » Voilà ce que disait Cuvier dès son premier ouvrage. Trente ans plus tard (1829), dans tout l'éclat de sa gloire, il tenait le même langage. Vantant l'heureuse influence qu'exerce sur les intelligences la culture des sciences naturelles, il ajoutait : « Une fois élevé à la contemplation de cette harmonie de la nature irrésistiblement réglée par la Providence, que l'on trouve faibles et petits les ressorts qu'elle a bien voulu laisser dépendre du libre arbitre des hommes ! Que l'on s'étonne de voir tant de beaux génies se consumer si inutilement pour leur bonheur et pour celui des autres ! Je l'avoue hautement, ces idées n'ont jamais été étrangères à mes travaux, et j'ai cherché de tous mes moyens CVI à propager cette paisible étude. » (Anatomie comparée, 4e édition, ire leçon, p. 58 ; et Règne animal, édit. de 1829, p. 20.) En parcourant ces nobles pages, ne croit-on pas entendre Aristote célébrer, en un style plus austère encore et plus fier, les joies ineffables que procure au philosophe la contemplation des choses éternelles dans les cieux, et des choses périssables dans la nature, telles qu'elles se dévoilent aux fortunés mortels qui savent les aimer et les comprendre. (Voir le ch. V du 1er livre du traité des Parties.) Mais ce légitime enthousiasme égare peut-être Cuvier quand il veut faire de l'histoire naturelle l'école de la logique, et lui réserver le secret de la méthode. L'histoire naturelle n'a point à revendiquer une tâche qui ne lui appartient pas. La logique et la méthode la dépassent; il ne faut les demander qu'à la philosophie, qui a le devoir exclusif de donner à toutes les autres sciences leurs principes les plus généraux et les plus essentiels. Confondre ainsi les choses, c'est les dénaturer; les frontières des sciences doivent être respectées aussi bien que celles des États ; et là, CVII pas plus qu'ailleurs, personne ne gagne à des usurpations. Mais nous aurons plus tard à revenir sur cette question, et nous essaierons de l'approfondir davantage. A côté des travaux de Cuvier, ceux de ses contemporains et de ses rivaux, quelque estimables qu'ils puissent être, pâlissent et s'effacent. Geoffroy Saint-Hilaire (Etienne) (1818), Lamarck, Blainville (1829), Meckel (1828), Jean Muller et une foule d'autres, n'ont fait que reproduire les idées du maître, ou se sont perdus en s'éloignant de ses traces. L'ouvrage de Meckel sur l'Anatomie comparée est plein de solidité ; mais il est douteux qu'il eût été possible sans celui de Cuvier, que Meckel avait traduit. L'imitation est toujours permise, et elle est souvent fort louable, quand elle sert à propager la vérité ; mais elle ne compte guère dans l'histoire, puisqu'elle est sans originalité, et qu'elle ne fait point avancer la science d'un seul pas. Le Manuel d'anatomie comparée de Siebold et de Stannius (traduction française de 1850) doit être mentionné, parce qu'il est fort savant, CVIII et surtout parce qu'il est un des premiers ouvrages de ce genre où les doctrines Darwiniennes sont appliquées à la classification et à l'étude des animaux. La prééminence attribuée à la cellule en est le caractère distinctif. Le Nouveau manuel est divisé en deux parties : celle des invertébrés et celle des vertébrés. Les invertébrés, dont les types sont très variés et les limites peu tranchées, sont répartis en cinq groupes : les protozoaires, dont la forme est irrégulière et l'organisation purement cellulaire, les zoophytes, les vers, les mollusques et les arthropodes. Les protozoaires eux-mêmes se divisent en ordres et en familles; et quelque indistincts que soient leurs organes, M. de Siebold étudie en eux d'abord l'enveloppe extérieure, puis le système musculaire avec les organes locomoteurs, le système nerveux et sensitif, l'appareil digestif, la circulation et la respiration, les sécrétions, et enfin les organes de la génération. Ces études deviennent de plus en plus claires, à mesure qu'elles s'adressent à des êtres de plus en plus élevés, des polypes et des acalèphes, aux crustacés, aux arachnides et aux CIX insectes. Quant aux vertébrés, ils sont partagés en quatre classés : poissons, reptiles, oiseaux et mammifères. Pour chacune de ces classes, l'auteur suit la même méthode : téguments, muscles, nerfs avec les sens, digestion, appareil de circulation, appareil respiratoire, sécrétions, et en dernier lieu, organes génitaux. Il y a donc tout à la fois, dans l'ouvrage de M. de Siebold, une classification et une anatomie comparée. Cuvier avait séparé l'anatomie et la classification, et il faisait très bien de les distinguer; mais il est possible aussi de les réunir avec une clarté suffisante, comme l'ont fait MM. de Siebold et Meckel, qui tiendraient plus de place dans la science si Cuvier ne les avait pas précédés. Notre siècle compte beaucoup de physiologistes célèbres ; mais après tous ceux dont il vient d'être question, nous n'en citerons plus que deux, morts assez récemment, Agassiz et Claude Bernard. Les travaux d'Agassiz se rapportent surtout h l'histoire naturelle ; ceux de Claude Bernard sont presque entièrement physiologiques. Mais quelque différents qu'ils CX soient, ils intéressent à peu près également l'histoire de la science, telle que nous avons à la considérer. Agassiz (1807-1873), né en Suisse près de Morat, appartient à la France et à l'Amérique, autant qu'à son pays natal. Il a passé une bonne partie de sa vie aux Etats-Unis; et dans ses dernières années, il avait pu explorer le Brésil, où l'avait appelé la munificence d'un monarque, protecteur éclairé des sciences et savant lui-même. Les œuvres principales d'Agassiz sont ses Recherches sur les poissons fossiles (en français), ses Études sur les glaciers, et son Histoire naturelle des Etats-Unis, dont l'introduction est son Essai sur l'espèce et la classification en zoologie. Ce dernier ouvrage, publié en 1859, a été, dix ans après, traduit de l'anglais dans notre langue, sous les yeux et avec la collaboration de l'auteur. Bien qu'assez court, il donne une haute et complète idée des mérites d'Agassiz, qui a été un naturaliste immensément instruit et actif, et, comme on l'a très bien dit, « un savant de premier ordre, un profond philosophe, un de ces hommes qui honorent CXI l'humanité, » par leurs lumières et plus encore par leur caractère. Après une existence dévouée exclusivement aux investigations les plus assidues et les plus sagaces, avec une indépendance absolue, sans système préconçu, sans dogmatisme, et sous l'inspiration seule de la réalité, Agassiz en arrive à cette conviction inébranlable que, dans dans le règne animal, l'espèce est un fait essentiellement naturel, et qu'elle n'est pas une invention de l'esprit humain. Il croit que les genres, les familles, les ordres, les classes et les embranchements ne sont pas moins réels que l'espèce elle-même. Il est persuadé que ces divisions, admises h divers degrés par tous les naturalistes, n'ont rien d'artificiel, et qu'elles représentent, par une approximation plus ou moins exacte, le plan même de la création, tel qu'il est donné à notre infirmité de le concevoir. « Quand, dit-il, nous croyons inventer des systèmes scientifiques, quand nous croyons classer la création par la seule force de notre raison, ne ferions-nous a que suivre humblement et reproduire, à l'aide d'expressions imparfaites, le plan dont les CXII fondements furent jetés à l'origine des choses ? Sous l'effort incessant de nos pénibles études, est-ce seulement le développement de ce dessein original qui se découvre à nous, alors qu'accumulant et coordonnant nos fragments de connaissances, nous nous imaginons mettre de l'ordre dans le chaos? Cet ordre est-il le laborieux produit de l'habileté humaine ? Ou bien est-il tellement inhérent aux objets eux-mêmes que le naturaliste soit, sans en avoir conscience, amené, par l'étude des choses, à établir les sections sous lesquelles il range les animaux, et qui ne sont après tout que les têtes de chapitre du beau livre qu'il s'efforce de déchiffrer? » Agassiz n'hésite pas à déclarer que cet arrangement, fruit de nos labeurs scientifiques, est fondé sur les rapports naturels plus ou moins bien aperçus, et sur les relations primitives de la vie animale ; en un mot, que les systèmes combinés par les maîtres de la science ne sont que la traduction, dans la langue de l'homme, des pensées du Créateur. Cette opinion, venue d'un savant tel qu'Agassiz, doit nous paraître CXIII d'autant plus grave que d'autres naturalistes, non moins autorisés, ont soutenu des opinions toutes contraires. Buffon a prétendu qu'il n'y a dans la nature que des individus, et que les genres, les ordres et les classes n'existent que dans notre imagination. (Discours sur la manière d'étudier l'Histoire naturelle, édit. de 1829, tome 1, p. 79.) Il n'en admire pas moins la nature, et il l'étudié aussi passionnément qu'Agassiz ; seulement « il craint que nous ne portions dans la réalité des ouvrages de Dieu les abstractions de notre esprit borné, et que nous ne lui accordions, pour ainsi dire, qu'autant d'idées que nous en avons. » C'est par un scrupule de pieuse vénération que Buffon a proscrit des méthodes qui sont trop étroites pour embrasser l'universalité des choses, et pour les classer selon leurs vrais rapports. Agassiz n'a pas ressenti de ces scrupules exagérés ; et ses théories sont plus fermes et non moins religieuses que celles du naturaliste français. Il ne croit pas plus que lui qu'aucune méthode, ni qu'aucune classification, puisse jamais reproduire complètement la totalité des êtres dans leur ordre véritable CXIV et dans leurs relations naturelles. Mais il soutient que nous pouvons, par le spectacle de l'univers, découvrir une pensée qui se manifeste dans les animaux plus clairement encore que partout ailleurs. Le suprême honneur de l'intelligence humaine, c'est de s'adapter aux faits et de parvenir à interpréter les pensées de celui qui les a créés. C'est en partant de ce principe supérieur, résultat d'une patiente et attentive expérience, qu'Agassiz essaie de démontrer, par les arguments les plus pratiques, que, dans le règne animal, nous devons trouver le témoignage éclatant d'une intelligence infinie. « L'univers, dit-il excellemment, peut être considéré comme une école où l'homme apprend àconnaître ses rapports avec les autres êtres, et avec la cause première de tout ce qui a est. » II se défend avec la plus sincère loyauté d'introduire dans sa démonstration aucun argument étranger à son sujet, et il se reprocherait d'avancer des conclusions qui n'en découleraient pas immédiatement. Force lui est cependant de regarder toute liaison intelligible et intelligente que nous observons CXV entre les phénomènes, comme une preuve directe d'un Dieu qui pense, aussi sûrement que l'homme manifeste sa faculté de penser quand il constate cette liaison naturelle des choses. Il se flatte de prouver par là que la préméditation a précédé l'acte de la création ; et il voudrait en avoir fini, une fois pour toutes, avec les théories désolantes et fausses qui nous renvoient aux lois de la matière, pour avoir l'explication de toutes les merveilles de la vie; a et qui, bannissant Dieu, nous laissent en a présence de l'action monotone, invariable, « de forces physiques, assujettissant toutes choses à une inévitable destinée. » Nous n'espérons pas que les démonstrations d'Agassiz aient vaincu le matérialisme, de manière à le bannir à jamais de la science ; mais nous pensons qu'il a opposé à cette décevante doctrine des arguments irréfutables, auxquels on ne répondra pas, parce qu'ils sont la vérité même, et parce que le silence est plus facile que la discussion et la victoire. Ces arguments, tirés tous de l'histoire naturelle sans exception, sont au nombre de trente et plus. Agassiz les expose un à un avec tous CXVI les développements nécessaires, sans être jamais prolixe, et sans s'écarter un instant de l'objet qu'il poursuit. Nous ne pouvons l'accompagner dans cette énumération péremptoire, ni même dans le résumé qu'il en fait pour la rendre plus succincte et plus décisive ; mais nous devons indiquer deux ou trois de ses arguments, pour qu'on juge de leur nature et de leur portée. Le premier et le plus général, c'est d'abord la diversité des types d'animaux existant simultanément dans des conditions identiques. La plus petite nappe d'eau, soit d'eau douce, soit d'eau de nier, le moindre coin de terre contiennent une énorme variété d'animaux et de plantes. La botanique et la zoologie conviennent que cette variété est extrême entre les plantes et les animaux qui vivent dans une même région. Les agents physiques, au milieu desquels ils subsistent, peuvent-ils être regardés comme la cause de cette diversité ? Tous les physiciens, qui savent que la nature de ces agents est purement spécifique, répondront qu'il est absolument impossible que les forces matérielles aient produit à un certain instant CXVII une action qu'elles ne dussent pas produire plus longtemps. Or, tous les géologues avouent qu'il y a eu, dans l'histoire de la terre, une période à laquelle aucun animal n'existait encore, bien que, dans ce temps, la constitution du globe et les forces physiques fussent les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, la corrélation des êtres animés et des circonstances ambiantes est de tel caractère qu'elle révèle une pensée. Ces rapports ont été établis, déterminés, réglés par un être pensant, pour chaque espèce, dès le commencement du monde; et la persistance de ces rapports à travers toutes les générations qui se sont succédé en est une preuve nouvelle. Quand on prétend faire venir les êtres vivants de l'influence des forces physiques, comment ne voit-on pas que l'effet est hors de toute proportion avec la cause, et que l'action même des agents matériels sur les êtres organisés suppose l'existence préalable de ces êtres ? De ce premier argument, Agassiz conclut qu'il ne peut pas exister un rapport génésique quelconque entre les forces brutes et les êtres organisés. Débarrassé de cette idée fausse, il CXVIII parcourra sans peine le vaste champ des relations véritables que ces forces ont avec les êtres vivants. De là, un second argument, qui est l'inverse du premier et qui n'est pas moins démonstratif. Si les êtres animés sont diversifiés dans des circonstances identiques, leurs types restent identiques dans les circonstances les plus différentes. A-t-on jamais vu aucun changement de structure dans les individus d'une même espèce, sous quelque zone qu'ils vivent, polaire, tempérée, tropique, antarctique? L'identité est absolue dans tout ce que la structure a de réellement important, de dominant et de compliqué ; s'il y a quelque différence, ce n'est que dans des détails d'un ordre très-secondaire. Quelle logique de supposer que les mêmes causes physiques produisent des résultats si dissemblables ! Ce qui est affecté par les causes physiques, c'est l'extérieur seul, la peau, le pelage, les plumes, les écailles, ou encore la taille et le volume, la rapidité ou la lenteur de la croissance, la fécondité, la durée de la vie, etc., etc. Mais tout cela n-t-il rien à voir avec les caractères essen- CXIX tiels des animaux ? Est-ce là, entre les agents physiques et les animaux, autre chose qu'une simple corrélation résultant du plan général de la création ? Autres arguments non moins clairs et non moins décisifs : unité de plan dans des types d'ailleurs profondément divers, correspondance dans les détails de la structure chez des animaux entre lesquels il n'existe aucun autre rapport, affinités de degrés différents et de nature diverse, existence simultanée aux périodes géologiques les plus reculées de tous les types généraux de l'animalité, gradation de structure sans qu'il y ait cependant progression continue, distribution géographique, identité de structure entre les types les plus largement disséminés, similitude de structure d'animaux vivants dans une même région, et lien que constitue cette similitude entre les animaux des régions les plus distantes, rapports du volume et de la structure des animaux avec les milieux ambiants, fixité des particularités spécifiques, relations des êtres organisés avec le monde extérieur, rapports entre individus, dualisme sexuel, ses conditions CXX révélées par l'embryologie, durée de la vie, génération alternante, succession des animaux et des plantes dans les temps géologiques, localisation des types dans les âges passés, limitation de certaines espèces à des périodes zoologiques particulières, parallélisme entre la succession géologique des animaux et des plantes et le rang qu'ils occupent de nos jours, parallélisme entre la gradation de la structure et révolution embryonnaire, animaux et plantes parasites, combinaisons dans le temps et dans l'espace des divers rapports qui s'observent chez les animaux, Age primitif de l'humanité; telles sont les questions qu'Agassiz agite et résout, avec une autorité qui vient tout ensemble de sa compétence et de son érudition, ayant lui-même observé tout ce dont il parle, et connaissant non moins bien tout ce que les autres en ont dit et en ont pensé. Avant lui, beaucoup de ces sujets avaient été traités littérairement avec une rare éloquence; lui, il les a traités avec une rigueur scientifique et une abondance de faits qui suppriment à peu près toute sérieuse contradiction. Agassiz en tire cette conclusion générale, à savoir « que CXXI la combinaison dans le temps et dans l'espace de toutes ces conceptions profondes « manifeste de l'intelligence, et prouve irrésistiblement la préméditation, la puissance, la sagesse, la grandeur, la puissance, l'omniscience, en un mot, la providence et l'intervention immédiate du Créateur ». A deux mille ans et plus d'intervalle, on reconnaît toujours la voix d'Anaxagore, proclamant, le premier entre tous les philosophes, que l'Intelligence régit l'univers; on reconnaît toujours la voix d'Aristote, proclamant, après Anaxagore, que la nature ne fait rien en vain. La seule supériorité de notre siècle, guidé par Agassiz, c'est qu'il peut, dans la contemplation de cette grande vérité, s'appuyer sur une science dont on ne combat désormais les décisions que par l'aveuglement d'un parti pris, rebelle à l'observation de tous les faits. Telle est la première partie de l'ouvrage d'Agassiz, consacrée tout entière à déterminer la notion de l'espèce et à en faire ressortir la signification. La seconde partie s'applique à la classification. L'auteur définit d'abord ce qu'on doit entendre par les types ou embran- CXXII chements du règne animal, par les classes, les ordres, les familles, les genres et les espèces. L'équivoque dans l'emploi de ces termes lui semble un obstacle aux progrès de la science, et il les précise, autant qu'il le peut,àù l'usage de ceux qui doivent s'en servir. Puis, il se livre à l'examen des différents systèmes de classification qui se sont produits, au nombre de vingt environ, depuis Linné jusqu'à l'heure actuelle. Il approuve et adopte les quatre embranchements de Cuvier, qu'il regarde comme le plus grand naturaliste de tous les temps. Quant au Darwinisme, il le blâme presque sans réserve, tout en rendant pleine justice à Darwin, pour ses travaux en paléontologie et en géologie. Aux yeux d'Agassiz, cette doctrine, telle qu'elle a été développée par ses adeptes, est contraire aux vraies méthodes de l'histoire naturelle; elle est pernicieuse et fatale. Le succès bruyant qu'elle a obtenu ne doit pas nous séduire. Le Darwinisme n'est qu'une théorie à priori; il n'a pas plus de fondement que la Philosophie de la nature, sortie de l'école de Schelling; « c'est une doctrine qui, d'une conception ration- CXXIII nelle, descend aux faits ; et ne recueille des faits que pour soutenir une idée. » Agassiz se console du mal que cause cette doctrine en pensant qu'elle passera de mode, comme tant d'autres systèmes aussi arbitraires. Elle n'est en rien le développement légitime des acquisitions de la science moderne, et elle ne prévaudra pas contre elle, en niant, non sans orgueil, les traditions et les observations les plus certaines sur la fixité immuable des espèces depuis leur première apparition. Toutes ces vues d'Agassiz, neuves et hardies, ont une valeur considérable ; elles relèvent de la philosophie presque autant que de l'histoire naturelle. Si elles n'ont pas exercé sur le monde savant toute l'influence qu'elles nous semblent mériter, c'est peut-être uniquement parce que l'auteur ne leur a pas donné une forme assez didactique. Il faut bien dire aussi que le spiritualisme énergique qui les a dictées n'est pas actuellement en vogue ; mais on peut être assuré que la science reviendra bientôt dans des voies meilleures, qui sont celles qu'Agassiz a suivies et recommandées. Claude Bernard (1813-1878) s'est mu dans CXXV une sphère bien différente. Le ranger parmi les matérialistes, ce serait peut-être lui faire tort ; mais il serait encore moins juste de le mettre dans le camp opposé. Il s'est lui-même prononcé si peu nettement, chaque fois qu'il a effleuré ou côtoyé ces graves questions, qu'il est presque impossible d'éclaircir ses obscurités ; on peut les croire involontaires, et il est présumable qu'il ne s'est jamais décidé bien parfaitement entre les deux opinions. Les incertitudes de ses théories tiendraient alors aux irrésolutions de sa pensée. Mais si l'on s'en rapporte sur ce point délicat à l'appréciation enthousiaste de ses disciples, ce serait le matérialisme qui devrait le réclamer pour un des siens, et même pour une de ses gloires incontestées. C'est là certainement un excès de zèle de la part de ses élèves les plus fameux ; mais leur maître en est responsable en partie, puisqu'il n'a jamais désavoué les interprétations auxquelles se prêtent ses théories par trop douteuses. D'ailleurs, cette restriction n'enlève rien au mérite des découvertes de Claude Bernard. Il a expliqué mieux qu'on ne l'avait fait jusque-là les fonctions de CXXV plusieurs viscères dans l'homme, et l'action des toxiques sur notre organisation. Il a, en outre, porté, dans ses analyses et dans ses expériences, une exactitude et une précision qui peuvent toujours servir de modèles. En discutant le problème qui fait le fond de toute physiologie, Claude Bernard n'hésite pas à confondre la vie avec les forces brutes de la matière. A l'entendre, il n'y'a aucune différence entre les principes des sciences physiologiques et les principes des sciences physico-chimiques. Cependant, il a si bien senti l'importance essentielle de cette question qu'il a expressément essayé de définir la vie. Y a-t-il réussi mieux que Bichat et que Cuvier? Là où ces grands esprits avaient reconnu deux principes, Claude Bernard est-il dans le vrai en n'en voyant qu'un seul ? Pour notre part, et avec Agassiz, nous répondons que Claude Bernard se trompe, et que l'hypothèse de l'unité est en opposition flagrante avec les faits les plus solidement établis par la science contemporaine, pour les organismes vivants, et pour les organismes éteints que nous révèle l'histoire de la terre. Désormais, on ne CXXVI saurait dans ces matières nier deux vérités également certaines : la première, que nous avons déjà indiquée, c'est que la vie est apparue sur notre globe à un moment donné avant lequel elle n'y était pas ; la seconde, c'est que, dans les phénomènes physiologiques impartialement observés, il en est qui ne s'expliquent que par la présence d'une force absolument distincte des forces matérielles, lesquelles ne suffisent pas pour nous expliquer les effets de celle-là. Comme corollaire de cette confusion des forces vitales et des forces physiques, Claude Bernard résume sa définition en disant que « la vie est la force évolutive de l'être. » Mais, ou cette définition ne signifie rien, ou bien elle signifie le contraire de ce que l'auteur croit y trouver. Si c'est la vie qui détermine les évolutions de l'être et son développement, c'est qu'elle est antérieure à ces évolutions, et qu'elle s'en distingue, puisqu'elle en est cause. Les actions physico-chimiques exercent leur influence sur un être qui ne vient pas d'elles, qui tour à tour les subit et les modifie, mais qui les précède. Loin de dire avec Claude Ber- CXXVII nard que « la vie n'est qu'une modalité des forces générales de la nature, » il faut affirmer que la vie est une puissance à part, accordée à certains êtres et refusée à d'autres, qui a ses lois spéciales et sa destination propre, et qui est déjà tout entière dans les embryons les moins formés, pour les amener par degrés à la forme définitive qu'ils doivent prendre. En dépit de déclarations sur lesquelles, ce semble, il n'y avait pas à revenir, Claude Bernard adopte assez souvent le langage du spiritualisme, et il parle lui aussi des « propriétés vitales de l'organisme » et des « phénomènes de la vie. » Est-ce une simple concession de mots ? Est-ce une pensée plus arrêtée ? Le savant se conforme-t-il sans réflexion aux habitudes de la langue vulgaire ? Ou est-il entraîné par la force irrésistible de la vérité, qui se fait jour malgré lui ? Il serait assez difficile de le savoir ; c'est un secret qu'il n'a pas livré à ses lecteurs ; nous ne nous flattons pas de le pénétrer. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que, tout en étant partisan de la cellule et admirateur de ses prétendues merveilles, Claude Bernard admet néanmoins qu'il y a CXXVIII dans ce mystère insondable « une idée préconçue », et il distingue dans toutes les fonctions organiques deux côtés, qu'il nomme l'un, le côté idéal, et l'autre, le côté matériel. C'est précisément ce qu'avait toujours soutenu Agassiz, avec qui le naturaliste français serait fort surpris de se trouver d'accord. Claude Bernard va même jusqu'à reconnaître deux ordres de sciences : les sciences de l'esprit et les sciences de la nature ; et il voudrait faire de la physiologie le trait d'union entre les unes et les autres. L'intention est fort bonne; mais à quelle condition la paix proposée se fait-elle ? A la condition que la psychologie disparaisse et se fonde dans la physiologie, comme si l'objet et les procédés de la science psychologique n'étaient pas absolument autres que les procédés et l'objet de là physiologie. Sur ce terrain, où la lumière de la conscience projette un jour éblouissant, la confusion est impossible pour un ferme regard; celui de Claude Bernard a défailli comme tant d'autres, même plus philosophiques que le sien. Il ajoute bien que « la raison et le libre arbitre sont les actes les plus mys- CXXIX térieux de la vie animale et peut-être de la nature entière » ; mais il ne tire de ce fait révélateur aucune conséquence, et il persiste dans une erreur peu digne d'un observateur tel que lui. Chose plus étonnante ! Claude Bernard ne paraît pas avoir défini mieux la science où il a excellé, quand il charge la physiologie « de régir les manifestations de la vie. » Evidemment, la physiologie ne régit pas ces manifestations; elle se borne à les observer et h les décrire. Ce rôle est assez beau et assez épineux ; il n'est que faire d'y ajouter de nouvelles et inutiles difficultés. On dirait que le physiologiste dispose de la vie, et qu'il peut arbitrairement en créer et en changer les phénomènes. C'est là une conception qui n'a rien de scientifique ; car alors la science serait le roman des choses ; ce ne serait pas la représentation fidèle de la réalité. Qu'on croie, avec Agassiz et avec les plus savants philosophes, qu'une pensée divine est déposée dans l'univers, ou qu'on nie résolument cette pensée, il n'importe guère à la science, qui ne doit d'abord qu'observer les faits, CXXX et qui n'obtient de réels progrès que par cette sage méthode. Mais la science prétendant gouverner la nature, c'est une imprudence qu'il faut laisser à l'idéalisme le plus audacieux, se substituant au créateur. Notre esprit ne fait pas la nature ; il la contemple telle qu'elle est. Si, en présence de l'infini, dont la nature est le reflet, nous pouvons quelquefois sentir notre force, nous sentons bien plus souvent encore, pour ne pas dire toujours, notre irrémédiable impuissance et notre disproportion incommensurable. Ce qui peut expliquer, si ce n'est justifier, cette étrange hypothèse de Claude Bernard, c'est que, pour lui, la physiologie n'est pas une science naturelle; elle est seulement expérimentale; en d'autres termes, la vie ne se manifesterait à nous que par les expériences auxquelles nous soumettons les êtres vivants; sans ces expériences, nous n'en saurions absolument rien. Que l'expérience soit fort utile à la science, tout le monde en convient ; mais préférer l'expérience à l'observation, ce serait une méprise des plus dangereuses et des moins excusables. L'expérience ne précède pas l'ob- CXXXI servation ; tout au contraire, elle la suit. L'observation, quelque attentive qu'elle soit, ne laisse que trop souvent des doutes et des indécisions ; c'est pour les dissiper que le savant doit recourir à un autre procédé. Il règle alors à son choix les conditions dans lesquelles il circonscrit et fait agir le phénomène. Mais le phénomène réel, que le savant cherche à comprendre, ne vient pas de lui ; il ne vient que de la nature. L'expérience n'a même aucun sens si on ne la conçoit pas ainsi; car autrement l'expérimentateur ne ferait que retrouver dans l'expérience le phénomène qu'il y aurait mis, en l'imaginant lui-même. Ce serait un travail parfaitement vain et un leurre ; sans la nature, qui fournit préalablement le fait tel qu'il est, il n'y aurait pas même besoin d'explication. La physiologie, se flattant de régir les manifestations de la vie, est donc une complète illusion. Cuvier l'a dit : ce L'expérience contraint la nature à se dévoiler, » quand l'observation, qui a pour but de la surprendre, l'a trouvée rebelle et n'a pu la vaincre. Claude Bernard a-t-il davantage raison quand, au lieu de la physiologie elle-même, il juge son CXXXII histoire et son état présent ? Est-il bien sûr que la physiologie soit née de nos jours ; et qu'elle en soit encore à chercher ses fondements et ses méthodes ? N'a-t-elle trouvé jusqu'ici que des linéaments à peu près informes ? Est-il plus exact de lui donner pour précurseurs Lavoisier et Laplace, en compagnie de Bichat? Claude Bernard a une vive admiration pour Bichat, tout en trouvant qu'il est anatomiste plus que physiologiste; mais parfois aussi il le range avec Descartes, Leibnitz, Cuvier et bien d'autres, parmi les adversaires qu'il croit devoir combattre. Est-il plus équitable d'oublier, parmi les physiologistes, un homme tel que Haller? Est-ce que Haller n'avait pas écrit un siècle auparavant ? Et s'il n'a pas fait de découvertes égales à celles de Claude Bernard, ne mérite-t-il point que son nom soit conservé et respecté par ses successeurs ? Est-ce Magendie, qui vers 1820, a rendu la physiologie expérimentale ? Et Harvey, dans le xviie siècle, n'avait-il pas fait de véritables expériences, ingénieuses et décisives, sur la circulation du sang? Non ; ce n'est pas de nos jours que a la « physiologie a pu commencer à entrevoir son CXXXIII véritable problème et ses destinées ; non, son avènement ne sera pas une des gloires de notre siècle. » En toute justice, il faudrait bien plutôt restituer cette gloire au siècle précédent. Ce qui est vrai, c'est que, de notre temps, le problème de la vie est singulièrement agrandi, par tous les travaux dont les fossiles ont été l'objet, et par les explorations qui ont scruté les diverses régions du globe et les profondeurs des mers. Mais ce problème de la vie, auquel Claude Bernard assigne une date si récente, est à peu près aussi ancien que tous ceux que poursuit la science. Lorsque, dans le Traité de l'Ame, Aristote part de la vie dans la plante, et qu'il en suit les manifestations successives depuis le végétal jusqu'à l'homme, n'est-ce pas là poser la question aussi nettement que nous la posons aujourd'hui ? Les faits qui nous servent à résoudre cette question « la plus complexe de la nature entière » sont beaucoup plus nombreux. Soit; mais sont-ils différents ? Pour se multiplier indéfiniment, changent-ils de nature? La génération, qui, de l'aveu de Claude Bernard, est la fonction la plus mystérieuse de la physio- CXXXIV logie, n'a-t-elle pas été étudiée à fond par Aristote, dans un ouvrage qui, à lui seul, suffirait pour glorifier à jamais son génie ? La physiologie, prise dans sa généralité, n'est donc pas tout à fait aussi jeune qu'elle se le figure ; et c'est précisément parce qu'elle est passablement vieille qu'elle peut arriver à des découvertes du genre de celles qui ont illustré Claude Bernard. Seulement, le problème de la vie est d'un tel ordre que l'homme l'agitera sans cesse et ne le résoudra jamais. Claude Bernard dit lui-même que « l'origine a des choses est impossible à découvrir » ; mais la science s'en approche de plus en plus, à peu près comme ces lignes mathématiques qui ne peuvent jamais se joindre, même en les supposant prolongées à l'infini. - Enfin, Claude Bernard critique vivement la philosophie, quand, selon son expression, elle se permet d'entrer « dans le ménage de la science. » Nous ne faisons ici qu'indiquer cette controverse. Plus tard, nous la traiterons avec des développements plus opportuns ; mais pour voir clairement les relations de la philosophie et de la science, on n'a qu'à se rappeler CXXXV les services rendus par Aristote à l'histoire naturelle, ou par Théophraste à la botanique. C'est la philosophie qui a créé les sciences exactes, et c'est elle qui doit les guider pour toujours. Peut-être l'erreur de Claude Bernard vient-elle de ce qu'il incline aux doctrines d'Auguste Comte, en même temps qu'à celles de Darwin. 11 croit à la mutabilité des espèces, comme il croit aux trois phases de l'esprit humain. Il nomme ces phases, poésie, philosophie et science, au lieu de les nommer théologie, métaphysique et positivisme. Mais, quoi qu'il en pense, la science n'est pas si nouvelle. Pour savoir son âge, on n'a qu'à le demander à Hippocrate, môme avant Aristote. Si l'esprit humain a débuté par la poésie, avec Homère, voilà tout au moins deux mille trois cents ans qu'il fait de la science sous sa vraie forme ; et nous pouvons nous en tenir à cette date vénérable. Nos ancêtres sont les Grecs ; nous ne faisons que ce qu'ils ont fait avant nous, de même que nos descendants continueront ce que nous aurons déjà continué avant eux. Qu'on ne s'étonne pas si nous nous sommes CXXXVI arrêtés si longtemps à Claude Bernard, qui ne s'est jamais occupé de physiologie comparée. Mais ses divers travaux, sur quelques points de la physiologie humaine, ont jeté beaucoup d'éclat; ils exercent encore une puissante influence, qui durera peut-être ; ses découvertes sont des conquêtes très-honorables pour la science; et bien qu'elles soient assez limitées, elles ont percé le mystère de quelques-uns des phénomènes qui nous intéressent plus particulièrement. Claude Bernard a joui d'une grande réputation parmi ses contemporains ; et l'on a pu un instant nourrir l'espoir qu'il allait renouveler la physiologie dans toutes ses parties; lui-même a pu partager cette espérance et avoir cette ambition. Qu'en pensera la postérité, qui commence à pouvoir le juger ? C'est là une question que nous ne nous permettons pas de trancher. Avec Claude Bernard, nous voilà presque parvenus au terme extrême de cette revue historique ; elle nous a semblé utile, même dans sa nécessaire brièveté, pour montrer les progrès qu'a faits la science depuis qu'Aristote l'inaugurait dans le Traité des Parties. CXXXVII. Afin d'achever cette esquisse, il ne reste plus qu'à s'adresser à un auteur encore vivant, pour préciser à ce moment même le point où en sont la physiologie et l'anatomie, héritières de tout le passé. Entre tant d'autres naturalistes, nous choisirons le plus exact et le plus complet, M. Henri Milne Edwards, leur doyen et leur chef respecté. Son ouvrage est intitulé : « Leçons sur la physiologie et l'anatomie « comparée de l'homme et des animaux. » Commencé en 1857, il n'a été achevé qu'en 1884, avec le quatorzième volume. C'est un résumé fidèle, qui n'a rien omis de la richesse actuelle des deux sciences qu'il a réunies. Il sera sans doute le dernier mot du xixe siècle, qui, avant de finir, ne pourra pas faire un meilleur ni plus clair exposé de tous les faits qu'ont accumulés jusqu'ici l'anatomie et la physiologie, soit sur l'homme, soit sur les animaux. La méthode est d'une régularité irréprochable, ainsi que le style; et il est très-peu de livres qui, à tous égards, soient faits aussi bien. L'histoire de la science y est partout utilement mêlée à la science môme; et sur chaque question, on y peut apprendre au prix CXXXVIII de quels patients efforts l'esprit humain a conquis tout ce qu'il sait aujourd'hui. M. Milne Edwards n'a rien innové dans l'ordre des matières qu'il étudie ; et après une première leçon sur le mode de constitution du règne animal, et sur les tendances de la nature dans la création des êtres animés, il parcourt en 140 leçons consécutives les divers éléments et les diverses fonctions du corps, le. sang et la respiration, la circulation dans les artères, dans les capillaires et dans les veines, la transsudation, le système lymphatique, l'absorption, la digestion, la nutrition et la reproduction ; puis, parmi les fonctions de relation, la locomotion, le système nerveux, les sens, les fonctions mentales et la volition. L'ouvrage se termine par des considérations d'ensemble, analogues à celles qui l'avaient commencé. Sans donner aux questions générales et aux principes plus de place qu'il ne convient en histoire naturelle, M. Milne Edwards est trop éclairé et trop sage pour les passer sous silence. II les touche dans la juste mesure, et il se prononce avec une fermeté et une précision CXXXIX qui ne laissent rien à désirer. La constitution du règne animal ne s'explique, pour lui, comme pour Agassiz, que par l'intervention d'un Créateur. La vie, loin d'être la résultante des forces chimiques et physiques, les coordonne et les harmonise. La force vitale précède les instruments dont elle se sert; elle est l'organisatrice de la matière pondérable; les fonctions emploient les organes, qui leur obéissent. Ce qui domine dans l'être organisé, c'est son essence et non sa partie matérielle. La nature varie ses moyens à l'infini, tout en en usant avec la plus stricte économie, pour arriver pas à pas à la perfection relative qu'elle doit atteindre. M. Milne Edwards ne croit pas plus que Buffon, Cuvier ou Agassiz, à la chaîne des êtres, bien qu'il admette une sorte de subordination, et que dans toutes ses analyses, il débute par les êtres les plus simples pour -monter jusqu'aux plus complexes. Il défend aussi les quatre embranchements de Cuvier, sans les supposer toutefois absolument invariables. D'abord, adversaire décidé du Transformisme, il semble que plus tard il ait jugé cette doctrine avec un peu moins de sévérité ; CXL mais il ne va pas jusqu'à faire descendre les espèces vivantes des espèces fossiles; et il marque avec soin les différences qui séparent les types actuels des types évanouis. M. Henri Milne Edwards termine son ouvrage par des conseils dont toutes les sciences peuvent faire leur profit, non moins que l'histoire naturelle. Il proclame que « l'étendue du domaine de l'esprit humain est incalculable; » mais il lui recommande la plus vigilante circonspection, pour diminuer de plus en plus la portion d'ignorance à laquelle il est condamné pour toujours. Avec M. H. Milne Edwards on ne peut que donner les mains à ces réserves prudentes, que l'infini imposera éternellement à l'ambition et à l'infirmité de notre intelligence. Notre course dans le passé est finie ; mais avant de porter nos regards, peut-être téméraires, sur l'avenir, toujours couvert de ténèbres, nous voulons jeter un dernier coup d'œil en arrière et résumer en quelques mots l'inventaire de nos trésors, afin de mieux discerner ce qui pourrait encore les accroître. D'abord, on voit, par le tableau que nous CXLI venons d'esquisser, que la physiologie et l'anatomie n'ont pas souffert autant de lacunes et d'intermittences que la zoologie descriptive. Commencée dans le Traité des Parties, la physiologie n'a cessé presque à aucune époque d'être cultivée, et même de se développer. Au contraire, la zoologie descriptive, tout admirable et toute claire qu'elle est dans l'Histoire des Animaux, n'a jamais été bien comprise par l'Antiquité après Aristote. L'exemple de Pline et d'Elien montre ce qu'elle devenait dans cette recherche puérile de faits curieux et extraordinaires. Elle avait perdu le sens des fortes traditions de son berceau ; elle n'était plus que de la littérature d'un goût équivoque; et l'on aurait dit qu'elle ne prétendait qu'amuser et distraire des lecteurs incapables d'attention et d'étude. Avortant dès ses premiers pas, quelque fermes qu'ils fussent, la zoologie avait été tout à fait négligée durant de longs siècles ; et elle n'avait reparu qu'avec les Commentaires d'Albert le Grand, sous le règne de Saint Louis. Après un éclat passager, elle était retombée dans l'oubli pendant deux cents ans. Enfin elle CXLII n'avait tendu à renaître qu'avec le xvie siècle ; et même alors, malgré l'initiative de Belon, de Rondelet et de quelques autres, elle était de l'érudition plutôt que de la science réelle ; sa marche était peu méthodique et mal assurée. Ce n'est qu'au xviiie siècle, avec Linné, Buffon et Cuvier, qu'elle devait retrouver la voie magistralement ouverte par la Grèce. Il y a moins de ces hésitations et de ces langueurs dans les destinées de la physiologie et de l'anatomie. Aristote, qui en avait été le père, en même temps qu'il l'était du reste de la zoologie, a eu dans cette branche de l'histoire naturelle des héritiers et des successeurs intelligents, jusque dans sa famille ; Erasistrate, son petit-fils, a été un très-habile anatomiste. L'Ecole d'Alexandrie, à laquelle il appartenait, ainsi qu'Hérophile, a entretenu et fécondé assidûment les principes hippocratiques ; elle les a même élargis ; mais quoiqu'elle ait pratiqué surtout la médecine et l'anatomie pathologique, elle a servi efficacement les sciences voisines, qui étendent au Règne animal les recherches plus limitées dont l'homme est l'objet. Celse, Rufus, Galien, CXLIII et tous les médecins fameux auxquels Oribase emprunta son utile recueil, témoignent, par de solides monuments, que la science est restée, autant qu'elle l'a pu, fidèle aux enseignements du passé. Elle est éminemment remarquable dans Galien; et pour son traité de l'Usage des Parties, c'est aux théories d'Aristote qu'il emprunte les siennes. Les études anatomiques cessent avec toutes les autres, quoique moins complètement, par la fermeture des écoles païennes sous Justinien. La science grecque, mutilée et obscurcie, passe aux mains des Arabes, qui la transmettent par l'Espagne et les Croisades à l'Europe chrétienne ; et grâce à eux, si l'héritage n'est pas très-bien conservé, du moins il ne périt pas, comme l'atteste l'ouvrage estimable de Mundino, au début du xive siècle. A dater de cette époque, et bien que ce soit toujours de la seule organisation humaine qu'on s'inquiète, les découvertes les plus belles se succèdent continuellement jusqu'à l'état actuel. La physiologie marche de pair avec l'anatomie, quoiqu'elle soit de beaucoup plus difficile, parce que la vie, qui est le mouvement même, est bien CXLIV moins observable que la forme, qui est immobile et qui ne varie pas. Au point où la science est si glorieusement et si péniblement parvenue, a-t-elle dit son dernier mot ? Evidemment non, par cette raison péremptoire qu'elle a un sujet absolument inépuisable, dans la diversité infinie des êtres et des combinaisons organiques que produit la nature. La science a toujours devant elle une perspective de progrès sans bornes ; c'était sa condition dans le passé ; ce sera sa condition dans un avenir qui n'aura pas de fin. Mais a toutes les époques, quelque brillantes et quelque assurées que soient les conquêtes de la science, elle trouve un sérieux avantage à se rappeler quelquefois à elle-même ce qu'elle est, ce qu'elle possède et ce qui lui manque. Un examen de conscience ne lui nuit jamais ; et les sciences ont d'autant plus de motifs de se l'imposer que leur domaine devient plus étendu et plus compliqué. Il est vrai que, quand les sciences se prennent à réfléchir sur leurs méthodes et leurs procédés, elles mettent de côté leur objet propre pour un objet étranger. Mais en compen- CXLV sation, elles entrent dans la sphère des questions générales, c'est-à-dire des questions philosophiques. C'est uniquement à cette école que chaque science particulière peut apprendre la place qui lui revient dans l'universalité des choses, telle qu'il est donné à l'esprit de l'homme de la contempler et de la parcourir. Rarement, les sciences spéciales s'élèvent jusqu'à ces théories supérieures, bien qu'elles s'y rattachent par les liens les plus intimes et par des racines fécondes ; mais c'est à leur grand dommage qu'elles négligent ou ignorent la source commune d'où elles sortent toutes également, depuis la plus sublime jusqu'à la plus humble. Si Aristote n'était pas philosophe, il n'eût pas été le législateur de tant de sciences, qui, sans lui, seraient peut-être encore à naître, ou qui du moins seraient désordonnées et confuses. Qu'est-ce donc que l'histoire naturelle dans l'ensemble des choses, et que faut-il entendre par cette expression ? Elle ne vient pas d'Aristote. C'est Pline peut-être qui l'a employée le premier ; son encyclopédie prend ce titre, et elle est, en effet, une histoire de toute la na- CXLVI ture. Après un premier livre, qui est une table des matières dressée par Fauteur lui-même et très-bien faite, le second livre est consacré à une définition du monde, dont Pline discute l'unité et la forme, et qu'il prend pour la Divinité, en lui donnant la terre-pour centre. Les quatre livres suivants décrivent notre globe, ses régions, ses climats et ses habitants ; cinq autres livres décrivent les animaux, de l'homme à l'insecte; onze livres traitent des plantes; dix autres traitent des remèdes que nous pouvons tirer des différents êtres; enfin, les cinq derniers livres traitent des métaux et des minéraux. De cet énoncé succinct, il ressort que c'est une description générale de la nature que Pline a tentée ; et c'est si bien son intention qu'en achevant son œuvre, il s'écrie: « Salut, ô nature ! mère de toutes choses, daigne m'être favorable, à moi qui seul, entre tous a les Romains, t'ai complètement célébrée ! » (Pline, édit. Littré, tome 11, p. 570). La prétention était légitime pour un citoyen de Rome ; elle ne l'était pas autant si l'on regardait la Grèce ; car, longtemps avant Pline, CXLVIII Aristote avait fait aussi dans ses nombreux ouvrages une exposition complète de la nature, sans d'ailleurs préciser aussi nettement l'objet et les limites de son entreprise encyclopédique, qui est beaucoup plus originale que celle de Pline, si elle est moins régulière et moins systématique. Pour Linné, pour Buffon, pour Cuvier, et pour M. H. Milne Edwards, l'histoire naturelle conserve toujours cette immense ampleur ; et si l'on en excepte l'astronomie, elle comprend toutes les sciences qui étudient le monde extérieur, à côté du monde de l'esprit. Parfois cependant, l'expression d'Histoire naturelle reçoit une signification plus restreinte; et alors elle ne concerne que le règne animal, au lieu des trois règnes. Mais les savants n'acceptent pas cette limitation, qui n'est reçue que dans le langage usuel, où l'on n'exige pas plus de correction. On ne peut observer les animaux, quelles que soient leurs diversités, que sous trois aspects : ou dans leur forme extérieure et leurs mœurs, ou dans leur structure interne, ou l'action vivante de leurs organes, accom- CXLVIII plissant les fonctions auxquelles ils sont destinés. L'étude de la forme extérieure est l'objet de la zoologie descriptive ; celle de la structure intérieure est l'objet de l'anatomie ; celle des fonctions vitales est l'objet de la physiologie. Chacune de ces trois divisions principales pourrait se subdiviser en sections moins importantes; on les a peut-être trop prodiguées dans ces derniers temps; elles n'ont pas pour nous d'intérêt particulier, et nous passons. Si, par suite des progrès obtenus depuis deux siècles, on sépare nettement aujourd'hui les trois sciences qui se partagent le règne animal, elles sont presque tout à fait confondues dans l'œuvre d'Aristote; quelque pénétrante que fût l'analyse du philosophe, il ne l'a point poussée jusqu'à ces distinctions, qui nous semblent aujourd'hui aussi claires qu'indispensables. Il se trouve beaucoup d'anatomie et beaucoup de physiologie, mêlées à la description, dans son Histoire des Animaux, ainsi que dans ses deux autres grands traités, des Parties et de la Génération. Il avait fait en outre plusieurs ouvrages d'anatomie, que com- CXLIX plétaient des dessins ; mais ne distinguant pas les trois sciences, il étudiait simultanément la forme, la structure et les fonctions. Au début delà science, cette confusion était il peu près inévitable, et on doit l'excuser d'autant mieux qu'elle n'a pas empêché la constatation des faits. Pourtant, elle a eu ce résultat fâcheux qu'Aristote n'a pas établi de classification méthodique entre les espèces, assez nombreuses déjà, qu'il observait avec tant de sagacité. Il a pris du langage vulgaire les dénominations par lesquelles on désignait les animaux ; et il s'est contenté généralement de ces appellations, qui n'étaient pas fausses, mais qui ne représentaient point un ordre scientifique. Le besoin de la classification n'était pas senti alors comme il l'est de notre temps, où il n'est plus loisible de décrire les animaux sans les ranger systématiquement, selon leurs ressemblances ou leurs oppositions. On peut bien à son gré débuter par les plus simples, comme le fait le Darwinisme, pour en venir aux plus compliqués ; ou bien à l'inverse, commencer par ces derniers pour finir par les autres. Mais quelque marche qu'on CL choisisse, il faut toujours adopter un arrangement qui éclaircisse les idées et facilite les investigations. Comme le dit Cuvier : « Toutes « les recherches dans les sciences naturelles « supposent qu'on a les moyens de distinguer sûrement et de faire distinguer à autrui les corps dont on s'occupe ; autrement, on serait sans cesse exposé à confondre les êtres innombrables que la nature présente. L'histoire naturelle doit donc avoir pour a base un grand catalogue dans lequel tous les êtres, portant des noms convenus, puissent être reconnus par des caractères distinctifs, et soient distribués en divisions et subdivisions où l'on puisse les chercher. » (Règne animal, p. 7, édit. de 4829). C'est d'après cette considération pratique que Cuvier classe le règne animal, d'abord dans les quatre embranchements qui le comprennent en entier, et ensuite, dans toutes les subdivisions qui, selon lui, reproduisent autant que possible la réalité avec ses variétés infinies. En dépit du génie de Cuvier, la classification reste une question toujours pendante et controversée, comme nous le fait bien voir la CLI critique d'Agassiz. Mais un mode de classification quelconque est absolument nécessaire, tout le monde le reconnaît ; et si l'on discute sur les détails, on n'en est pas moins unanimement d'accord sur l'utilité du principe. La science trouvera-t-elle quelque jour la solution de ce problème ? Une classification définitive pourra-t-elle jamais être acceptée par le monde savant ? Il est permis d'en douter, en présence des dissentiments qui ont régné jusqu'ici entre les naturalistes les plus fameux et les plus autorisés. Quoi qu'il en puisse être, sans la classification, qui est la condition essentielle et le fil conducteur de la zoologie descriptive, le règne animal serait un chaos inextricable, qui lasserait bientôt notre curiosité la plus ardente. Des trois sciences qui doivent y introduire l'ordre et la lumière, quelle est la plus importante ? Quelle est celle qui doit précéder et diriger les deux autres? Cuvier n'hésite pas à attribuer la prééminence à l'anatomie ; c'est par l'anatomie qu'il inaugurait ses immortels travaux, et il ne l'a pas un instant négligée dans sa vie laborieuse; c'est sur cette base, CLII constamment affermie, qu'il a voulu fonder tout le reste. En ceci, on ne saurait être d'une autre opinion que Cuvier. Son autorité suffirait pour nous décider; mais une autorité encore plus haute, celle de la raison, tranche la question. La forme extérieure étant ce qui frappe d'abord nos sens, les hommes s'en sont tenus longtemps à cette notion sommaire. Mais la science ne pouvait pas s'en contenter; et comme la forme du dehors dépend de l'organisation intérieure, dont elle n'est que le vêtement et la surface, c'est à cette organisation même qu'il faut s'attacher pour savoir ce qu'est essentiellement l'animal. Qu'y a-t-il de plus dissemblable extérieurement que les quadrumanes, les carnassiers, chiroptères ou plantigrades, les amphibies et les cétacés? Cependant, comme tous ces animaux offrent un caractère commun, qui est d'avoir des mamelles, il faut les réunir dans une seule et même classe, celle des mammifères; et c'est l'anatomie qui fait éclater la ressemblance qui les rapproche, bien que les uns vivent sur la terre, tandis que les autres vivent dans le liquide, ou parcourent l'air comme les oiseaux. CLIII C'est donc par l'anatomie que la science doit se conduire ; c'est à l'anatomie de fournir les matériaux d'une classification qui n'ait rien d'arbitraire. Si, chronologiquement, la forme extérieure est la première à se montrer, elle doit, au point de vue de la raison, n'occuper que le second rang. L'anatomie, qui, dans la réalité, ne vient qu'après la notion de cette forme, la précède rationnellement. Bien des fois, Aristote a insisté sur ces rapports intervertis du temps et de la raison, du phénomène et de la substance, de la figure et de l'essence. Il aurait certainement appliqué ses formules habituelles aux relations de la zoologie descriptive et de l'anatomie, si, de son temps, la question eût été ce qu'elle est devenue dans le nôtre ; niais nous pouvons être assurés qu'il accordait a l'anatomie autant d'importance que Cuvier lui-même ; et s'il ne s'est pas prononcé aussi décidément, c'est que la science, alors moins avancée, n'en éprouvait pas le besoin. Quant à la physiologie, elle ne peut venir qu'en dernier Heu, après l'anatomie et après la description. Quand on connaît la forme du CLIV dedans et celle du dehors, il reste à savoir coin ment ces organes et ces viscères fonctionnent effectivement, quels sont les résultats de leur mécanisme prodigieux, et comment se manifeste la vie secrète qui les anime et pour laquelle ils sont faits. L'analyse de la vie dans tous ses phénomènes, extrêmement délicate parce qu'elle est en quelque sorte fugitive, n'a pas cette fixité que présente l'anatomie. Les deux caractères principaux de la vie animale sont la sensibilité et le mouvement, on l'a bien souvent répété, depuis Aristote et depuis le Traité de l'Ame; c'est par là que ranimai se distingue de la plante, qui n'a que les facultés de se nourrir et de se reproduire, et qui n'est ni sensible ni mobile. Cependant, la physiologie n'a pas été aussi retardée que le supposait Claude Bernard ; mais l'étude en est éminemment ardue ; des trois sciences qui composent la zoologie générale, elle est la plus profonde, et, par conséquent, la moins développée. Malgré tous les efforts de l'esprit humain, la vie demeure un mystère impénétrable; et tout ce que notre siècle peut se flatter d'avoir appris de plus nouveau en ce CLV genre, c'est que la vie n'est apparue sur notre planète qu'à un moment donné, avant lequel elle n'était pas. Certaines conditions des milieux ambiants ont été nécessaires pour qu'elle se montrât tout à coup, sans que rien l'eût annoncée. Mais ce qui prouve irrésistiblement que la vie ne dépend pas de ces conditions exotériques, c'est que ces conditions, bien qu'elles restent, à cette heure, les mêmes qu'à l'origine, sont impuissantes à produire la vie ; et que, depuis la création des êtres animés, aussi loin que la science peut remonter ou descendre dans ces abîmes, tout être vivant, sans qu'il y ait à cette loi une seule exception, a tenu, avant de vivre, à un corps de la même forme que le sien, et vivant avant lui. Ainsi que le dit Cuvier, l'être animé a tenu à un parent; ou, selon la formule aristotélique : « L'homme engendre l'homme ». Il y a donc eu « un moment créateur, » selon la belle expression de Littré. Mais depuis ce moment unique, qui recule et se perd dans un inaccessible lointain, la vie ne s'est jamais produite une seconde fois dans sa condition primordiale ; elle a été simplement transmise, dans CLVI des organismes qui étaient aussi parfaits à l'origine qu'ils le sont aujourd'hui, et dont la succession imperturbable nous confond de plus en plus d'étonnement et d'admiration. L'on sent partout la vie; nulle part, pas même en nous, on ne peut la saisir directement et la soumettre à l'observation continue et méthodique, comme on y soumet l'organisation matérielle. On ne la surprend que dans ses manifestations, qui trop souvent sont douteuses, et qui changent sans cesse, en nous révélant plus ou moins clairement le principe qu'elles cachent sous leurs multiples apparences. C'est sans doute cette insurmontable ignorance qui aura porté la physiologie à se faire une science expérimentale, au lieu de se borner à être une science d'observation, comme le sont l'anatomie et la zoologie descriptive. L'expérimentation a de très grands avantages ; mais elle a aussi ses dangers, que la sagesse de Cuvier a signalés plus d'une fois. « Dans quelques sciences, disait-il, on examine des phénomènes dont on peut à l'avance régler toutes les circonstances; mais il y a d'autres sciences, notamment la physiologie, où les CLVII phénomènes se passent dans des conditions qui ne dépendent pas de celui qui les étudie, Dans ces sciences, il n'est pas permis de soustraire successivement les phénomènes à chaque condition et de réduire le problème à ses éléments, comme le fait l'expérimentateur. » On est contraint de prendre le problème tout entier avec toutes ses conditions à la fois; et on ne peut l'analyser que par la pensée. Ceci est vrai surtout quand on essaie d'isoler les phénomènes complexes dont se compose la vie d'un animal ; car si un seul de ces phénomènes est supprimé, la vie entière s'anéantit. Cuvier ne proscrivait pas, pour cela, les expériences, ni peut-être même la vivisection ; mais il avertissait les savants que ces procédés sont périlleux, et il les mettait en garde contre l'abus. A-t-on respecté suffisamment ces prudents avis ? Nous ne savons, mais ce qu'on peut croire, c'est qu'il est toujours hasardeux de préparer soi-même une réalité factice, parce qu'on est trop disposé à la substituer à la réalité initiale qu'on n'a pas pu comprendre. C'est le fait d'une circonspection bien rare de ne pas voir dans l'expérience CLVIII qu'on a imaginée plus qu'elle ne contient, et de la circonscrire scrupuleusement au cas réservé. Du reste, la vie ne se trouve pas exclusivement dans les animaux, elle est aussi dans les plantes ; et de là vient que, considérée à la fois dans les deux règnes, elle donne Heu à une science appelée d'un nom aussi nouveau qu'elle, la Biologie. On peut apercevoir déjà quelques linéaments de cette science dans le Traité de l'Ame d'Aristote, qui est une théorie du principe vital chez tous les êtres animés. Mais la physiologie botanique n'apporte que très-peu de secours à la physiologie générale, et quoique les plantes aient des fonctions communes avec les animaux, il ne faudrait pas forcer des ressemblances qui embarrasseraient la science, loin de lui être utiles. Pour toutes les parties de l'histoire naturelle, comme pour les autres sciences, nous possédons aujourd'hui cent fois plus de ressources que n'en avaient les siècles qui nous ont précédés. Le nombre des observateurs est beaucoup plus grand qu'il n'a jamais été, et il s'augmente continuellement ; les communi- CLIX cations libérales qu'ils se font mutuellement leur sont aussi profitables que faciles. On peut s'entendre d'un bout à l'autre de la terre en un temps aussi rapide que la pensée ; une découverte de quelque valeur est instantanément connue de ceux qu'elle peut intéresser. Les Académies, les corps savants de toute sorte dans tous les pays civilisés, rivalisent de zèle et de publicité ; les collections publiques et privées s'accumulent pour chacune des branches du savoir; les instruments les plus ingénieux ajoutent leur coopération docile et sûre à toutes les facultés de l'intelligence. En un mot, les richesses surabondent de tous côtés. Mais si l'on peut s'en applaudir, on peut aussi craindre l'excès de tant de moyens d'information. Les détails se multiplient avec une telle profusion qu'il est a redouter que l'esprit ne s'y perde et ne succombe sous un poids toujours accru. C'est un écueil de plus en plus menaçant, qui cause l'inquiétude de bien des naturalistes. On peut espérer que la science finira par éviter cet écueil, qui est trop réel, comme Buffon le lui conseillait, voilà déjà plus d'un siècle ; mais pour le moment, et peut-être pour assez CLX longtemps encore, elle risque de s'y attarder et de s'y affaiblir. C'est une activité un peu aveugle, une anarchie qui provoquera plus tard un remède, et la dictature de quelque nouveau système. On se fatiguera de tant de diversions minutieuses qui détournent nos regards sur des points très-secondaires, et qui nous empêchent de saisir l'ensemble des choses, qui, en définitive, est seul digne de nos labeurs et de notre raison, puisque la science ne vit que de généralités. Sans doute, il est excellent de limiter l'observation pour la rendre plus exacte, et pour lui assurer les conséquences et l'autorité qu'elle doit avoir; mais, afin que la spécialité même acquière tout son prix, il faut toujours qu'elle se rattache à quelque chose de plus compréhensif. Cette nécessité s'impose en histoire naturelle peut-être plus encore que dans aucune autre science. Ce sont uniquement des genres — et des espèces que la zoologie considère ; ce ne sont jamais des individus, et il n'y a pas»-de biographies dans le royaume de l'animalité. Voilà comment, lorsqu'on parle de zoologie descriptive, d'anatomie, de physiologie CLXI il est toujours sous-entendu qu'il s'agit de la classification générale de tous les animaux, ou de leur anatomie comparée, ou de leur physiologie comparée. L'étude de l'homme, de sa physiologie et de son anatomie particulières, est fort intéressante, parce qu'elle nous touche immédiatement, et surtout parce qu'elle éclaire, à tous les degrés, l'élude des organisations inférieures. La science doit, selon nous, commencer par l'homme; mais elle ne peut se borner à l'homme et s'y renfermer, puisque la nature ne s'y borne pas. A la fin de notre siècle, le inonde savant est hanté par deux théories, ou plutôt par deux erreurs, qui peuvent être fort nuisibles, et dont il devrait se défendre prudemment : le transformisme d'une part, et d'autre part, l'athéisme, qui en est sorti fatalement. Ces entraînements désastreux dévoient la science et lui font perdre un temps précieux, en attendant qu'elle sache s'y soustraire pour revenir a la vérité trop méconnue. Plus haut, on a cité les objections qu'Agassiz oppose au transformisme ; il les emprunte toutes h la zoologie. Mais il en est d'autres qui CLXII ne sont pas moins fortes, et qu'on j>eut soulever au nom de la méthode et de la logique. Est-il un fait plus frappant et moins niable que la fixité présente des espèces ? Ces espèces ont-elles changé d'une façon appréciable depuis quatre mille ans qu'on les observe ? En remontant aux témoignages les plus anciens, en interrogeant les poètes, les historiens, les naturalistes ; en interrogeant, comme des témoins encore plus irrécusables, les débris fossiles que garde le sol, ou les ossements conservés par la piété humaine, découvre-t-on la moindre dissemblance entre les animaux qui vivent côte à côte avec nous, et les animaux de même espèce qui vivaient aux époques les plus reculées ? La sélection pratiquée par l'homme dans quelques circonstances modifie des détails d'organisation; mais de ces altérations superficielles et peu persistantes, conclure que les espèces peuvent se transformer les unes dans les autres, et que, par exemple, des quadrupèdes pourraient devenir, ou peuvent avoir été, des mollusques, c'est une rêverie, qu'on ne serait pas trop surpris de rencontrer dans un conte de fées; mais dans la science, CLXIII dont les fondements ne sont que l'observation et l'analyse, ces fantaisies, imitées des Mille et une Nuits, ne sont pas très-sérieuses, et l'on n'aurait pour elles que du dédain, si elles ne portaient point des conséquences aussi redoutables que fausses. Ce qu'il y a de vrai dans la théorie de la cellule, surtout depuis les beaux travaux d'Ernest de Baër (1827), c'est que, chez tous les mammifères, l'embryon, fécondé par l'union des sexes, débute par une molécule à peu près imperceptible, germe de tous les développements ultérieurs. C'est une cuticule, c'est un ovule, qui, comme l'œuf des oiseaux, porte en soi tout ce qui rend possibles les progrès de la vie et la nutrition du jeune. Ce fait, qui a été si bien démontré pour les mammifères, s'étend aux autres animaux supérieurs, et, si l'on veut même, à toute l'animalité, bien que ce ne soit pas encore prouvé pour les espèces hermaphrodites ou gemmipares. Mais si Ton concède ce premier point aux partisans de la cellule, ils doivent en retour avouer que les cellules ont beau être d'apparence identique, «Iles n'en sont pas moins essentiellement dif- CLXIV férentes dans leur contenu, quel qu'il soit, puisque l'évolution en fait sortir les êtres les plus dissemblables. Notez que ce second fait n'est pas moins incontestable que le premier. A quoi bon, dès lors, identifier, dans une promiscuité imaginaire, les espèces actuellement si distinctes, puisqu'on est forcé de différencier tout aussi profondément les cellules elles-mêmes? Que gagne-t-on à nier d'abord la différence, puisqu'il faut ensuite la reconnaître et la subir ? Si nos faibles regards pouvaient pénétrer dans l'enceinte ultra-microscopique des cellules, sarcode ou protoplasma, ils y verraient le même spectacle qui nous éblouit dans l'organisme actuel des êtres visibles. Les cellules, à quelque degré de ténuité qu'on veuille les réduire, nous offriraient, si elles s'ouvraient pour nous, les mêmes diversités, les mêmes ordres, les mêmes familles, et, en descendant toujours, les mêmes espèces. Seulement le phénomène se produirait comme dans le ciron de Pascal, sur une échelle moindre, et tellement insaisissable qu'il faudrait renoncer à toute observation un peu positive. Lo transformisme pourrait-il se sous- CLXV traire à cette extrémité, où la science disparaît ? Et ce néant est-il le but auquel il aboutit ? Ainsi, présence de la vie venue dans les cellules les plus informes par voie de transmission, et dissemblance radicale entre les cellules, tout aussi prononcée pour elles qu'entre les adultes les plus complètement formés, -voilà deux évidences, qu'on peut braver obstinément, mais qu'on ne détruit pas. Le transformisme n'est donc qu'une de ces idées à priori qu'on a tant reprochées h la métaphysique, et dont la science prétend s'abstenir avec la plus légitime réserve. Elle fait très-bien de vouloir fuir Va priori et de le répudier; mais, à son insu, elle s'en sert peut-<Hre plus fréquemment qu'elle ne le pense. Dans la métaphysique, ou philosophie première, si bien définie par Aristote, qui l'appelle de son vrai nom, la science des causes, certains principes universels, c'est-à-dire des axiomes, sont indispensables; et on ne les proscrit que faute de comprendre leur rôle nécessaire pour les démonstrations de tout ordre. Mais dans les sciences spéciales, les idées à priori doivent être soigneusement éli- CLXVI minées, pour céder la place à de simples généralités, résultant de l'observation qu'elles résument. Bien des fois cependant, la science s'est méprise, et elle a laissé de côté le réel, pour conférer à des préventions et à des hypothèses une faveur qu'elles ne méritent pas. Là mode peut régner dans les sciences aussi bien que dans des régions moins éclairées et moins sévères; elle y fait plus de mal ; mais heureusement elle n'y est pas beaucoup plus durable. Elle y est même d'autant plus inconstante que la science recherche avant tout la vérité, et que, si elle s'en éloigne pour quelque temps, elle y est bientôt ramenée par sa propre nature, par tous ses penchants instinctifs, et par la réalité. Le transformisme, quand on le prend pour l'explication de l'origine des êtres, est une de ces modes, qui n'a eu déjà que trop de durée, mais qui disparaîtra comme d'autres, séduisantes et frivoles autant que lui. Un des torts les moins pardonnables du transformisme, c'est donc de substituer, au inonde qui est sous nos yeux, la chimère d'un inonde entièrement faux. Il semble que le spectacle que l'homme contemple ici-bas pendant CLXVII son éphémère existence, est par lui-même assez beau et assez vaste, non-seulement pour suffire à notre passion de savoir, mais aussi pour dépasser de beaucoup toutes les énergies de notre intelligence. L'étonnement causé à nos esprits par les phénomènes naturels n'est pas moins vif aujourd'hui que quand jadis Aristote y trouvait la source première de la philosophie et de la réflexion. Mais le transformisme est venu changer tout cela ; au lieu de la nature qui subsiste immuablement devant nous, et qu'on étudie depuis quelques milliers d'années, parce qu'on a foi dans sa stabilité, il nous propose une nature qui échapperait à toute observation, à toute étude, à toute science, si elle était aussi variable et aussi fuyante qu'il veut la faire. N'est-ce pas remonter, par une autre voie, jusqu'à ces antiques systèmes qui admettaient le flux universel des choses et la perpétuelle mobilité de tout ce qui est ? Le vieil Héraclite soutenait qu'on ne peut se baigner deux fois dans la même eau du fleuve qui s'écoule. Le transformisme contemporain ne met plus la mobilité dans l'eau courante, qui se dérobe, en se jouant de nous ; il la met CLXVIII dans ces formes et ces constitutions des êtres qui nous semblent, à bon droit, être fixées pour toujours, et que nul œil humain n'a jamais vues autrement qu'elles ne sont présentement. En allant plus loin encore qu'Héraclite, n'est-ce pas faire concurrence à ces élucubrations de l'Inde, qui confondent tous les êtres dans un être unique, et qui imaginent des métempsychoses sans fin, mêlant indistinctement toutes les existences, par l'impuissance d'en discerner réellement aucune ? Est-ce donc une gloire enviable pour la science du xixe siècle que de se mettre au niveau des Bouddhistes de l'immobile Orient ? Les Bouddhistes n'ont pas inventé la cellule; mais ils ont poussé le rêve des transformations jusqu'à la limite extrême que les promoteurs les plus audacieux du Darwinisme n'ont pas encore franchie; ils ont tout englobé dans cette masse confuse et sans forme des trois règnes identifiés et amalgamés, où le monde animal ne se reconnaît môme plus, et où il sombre comme tout le reste. Est-ce bien la peine que le Darwinisme recueille tant de faits, tant d'observations, tant de renseignements précieux et CLXIX savants, pour en étayer une conception que les plus ignorants des hommes avaient trouvée cinq ou six siècles avant notre ère, et sur laquelle ils ont bâti leurs doctrines abstruses et extravagantes ? Le transformisme s'enorgueillit d'être un immense progrès. N'est-il pas, tout au contraire, un déplorable recul vers des insanités qui pouvaient sembler à jamais mortes et réprouvées ?
L'arrière-pensée que caresse le transformisme, c'est de faire sortir
la vie du concours fortuit et inconscient d'éléments purement
matériels. A l'en croire, quelques-uns des corps simples, qui sont
l'étude de la chimie, se seraient un jour rencontrés, on ne nous dit
pas par quelle cause, disparue depuis cette époque ;et de leur
contact fécond, aurait jailli tout à coup l'étincelle inextinguible.
Mais s'il en a été ainsi, si en effet la vie a surgi par hasard du
rapprochement de forces physiques, pourquoi ces forces
auraient-elles cessé leur action, après cet instant pour toujours
évanoui? Pourquoi n'agissent-elles plus à cette heure, devant nous,
comme elles agissaient alors? C'est la question que faisait
Agassiz, il CLXX
y a vingt ans ; on n'y a pas répondu, parce qu'on ne peut pas y
répondre, si ce n'est par des hypothèses inacceptables. L'analyse
spectrale, découverte tout récemment, pour l'honneur de notre
siècle, est venue apporter aux arguments d'Agassiz une confirmation
inattendue. Il n'est plus permis de supposer que les forces et les
éléments physiques aient été à l'origine autres qu'ils ne sont à
cette heure, soit sur notre globe, soit sur les autres corps qui
font aussi leurs révolutions dans l'espace. La vie est donc une
force, sut generis, essentiellement différente des forces physiques;
elle ne vient pas de ces forces, et elle les créerait bien plutôt
qu'elle ne serait créée par elles. Une raison saine peut-elle douter, pur exemple, que la reproduction des êtres, perpétuant les espèces, ne soit préparée par la nutrition, qui, à son tour, est le ternie d'une série de phénomènes sans lesquels elle n'aurait pas CLXXII lieu ? Cet enchaînement de faits liés entre eux pour aboutir à une fin préconçue qui se réalise, n'est-ce plus là ce qui s'appelle de l'intelligence ? Ce qu'on dit de la reproduction «t de la nutrition ne peut-on pas l'appliquer non moins justement à tout le jeu de l'organisation animale? Le rôle des os, des muscles, des tendons, des ligaments, des nerfs, des vaisseaux, des viscères de tout ordre, n'est-il donc pas aussi évident ? La solidité des unes, la flexibilité des autres, la circulation des fluides, les absorptions, les sécrétions, n'ont-elles plus d'objet? Le suprême honneur de l'esprit de l'homme ne consiste-t-il pas à démonter tous ces rouages délicats, pour y surprendre, pièce à pièce, les mystérieux desseins d'une pensée intelligente, devant laquelle la nôtre se sent comme anéantie? Le bon sens ne s'écrie-t-il plus avec Voltaire :
« L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer On a vraiment quelque honte de tant insister sur des vérités si simples ; et cela, à la fin de notre xixe siècle, au milieu des découvertes ac- CLXXIII cumulées dont la science se glorifie ! Mais comment se peut-il que l'intelligence humaine, qui s'enivre si aisément de ses succès, ne voie pas qu'elle aussi n'est qu'une partie de la nature ? N'y-a-t-il plus au monde quelque chose d'intelligible ? Et l'intelligible ne suppose-t-il pas nécessairement l'intelligent ? Cet univers est-il une énigme sans mot ? Que devient la science, lorsque, fîère de comprendre quelques vains détails, elle refuse au tout, que ces détails composent, ce qu'elle accorde à d'infimes parties? L'orgueil, d'un côté, ne compense pas la défaillance, de l'autre; et c'est trop de se montrer tout à la fois si présomptueux et si inconséquent. Anaxagore, Socrate, Platon, Aristote, Je judaïsme, la chrétienté, et, plus près de nous, Descartes, Linné, Buffon, Cuvier, se sont-ils donc trompés ? Notre jugement, ou plutôt le jugement de quelques savants de nos jours, l'emporte-t-il sur celui de ces puissants esprits, appuyé sur tant de génie, sur tant de réflexion et de sagesse, sur tant d'observations, confirmant de sublimes instincts, qui n'ont rien eu d'un aveugle enthousiasme ? CLXXIII La science redoute les causes finales; et c'est parfois un louable scrupule qui les lui fait craindre. Oui, sans doute, on en a abusé. Mais est-ce là un motif pour les repousser dans tous les cas ? Si l'on invoque l'intervention de la Providence à tout propos, pour résoudre les difficultés les plus vulgaires ; si, devant un phénomène qu'on n'a pu tout d'abord expliquer, on se décourage, et qu'immédiatement on ait recours au Deus ex machina du poète, ce n'est qu'une faiblesse; et la science doit se l'interdire. Elle peut se fier à sa virilité; et en ceci du moins, elle ne se méprend pas ; car il est donné à l'homme de beaucoup obtenir par de constants efforts et d'apprendre toujours davantage. Mais savoir, n'est-ce pas connaître la cause ? N'est-ce pas connaître la fin de la chose qu'on étudie ? Aristote est le premier, entre tous les penseurs, qui ait proclamé aussi résolument la croyance aux causes finales ; et après tant de siècles, après tant de controverses, elle n'a rien perdu de son importance, ni de son opportunité. Elle est aussi neuve à présent qu'elle le fut jamais ; elle est de celles qui ne vieillissent point. Serait-elle CLXXIV devenue fausse parce que, de jour en jour, elle est plus ancienne, et qu'elle continue de se vérifier ? Le témoignage d'Aristote doit avoir pour nous une double autorité, que lui confèrent le génie et l'indépendance d'esprit la plus entière. Dans le passé du savoir humain, Aris-tote tient une place unique; et selon toute probabilité, l'avenir ne lui donnera pas de rival. On peut ne pas partager toutes ses opinions; mais aujourd'hui qu'on les apprécie mieux qu'auparavant, on doit reconnaître que jamais un entendement aussi fécond n'a paru dans les annales de la science. L'influence dominatrice qu'il a exercée sur l'Antiquité, et sur tout le Moyen-âge, a été légitime autant que bienfaisante ; et nous qui en savons beaucoup plus qu'il ne pouvait en savoir, nous n'en sommes que plus pénétrés d'admiration et de gratitude, en voyant ce qu'il a su et ce que nous lui devons. Son histoire naturelle, mieux connue, est faite pour augmenter encore ces sentiments, qu'on éprouve même sans être un partisan du Péripatétisme. Qui se croirait le droit de récuser un tel génie ? CLXXVI. La nature, qui existait sous ses yeux, n'est-elle pas toujours celle qui existe sous les nôtres ? Pouvons-nous la juger dans son caractère essentiel autrement que lui ? Et quand cet esprit incomparable déclare qu'il la trouve pleine de sagesse, quand il y découvre une providence, irons-nous élever notre voix contre la sienne, qui, d'ailleurs, est d'accord avec les plus grandes voix que le monde ait entendues et écoutées ? Il faudrait, pour se prononcer en sens contraire, une outrecuidance que nous n'avons pas ; et si, sur quelques points, on peut se séparer d'Aristote, sur ce point-là, il faut être à ses côtés et combattre avec lui. Ajoutons que l'indépendance d'Aristote n'est pas plus douteuse que son génie ; il n'a obéi et ne pouvait obéir qu'à la conviction la plus libre. De nos jours, bien des savants ne s'aperçoivent pas qu'ils dérivent vers l'athéisme, qui est en vogue, par réaction passionnée et par haine rétrospective contre les idées religieuses. Depuis deux mille ans tout à l'heure que le christianisme s'est propagé, l'idée de Dieu, obscurcie dans le monde ancien, a envahi le monde moderne avec une force et une CLXXVII clarté invincibles, amenant d'immenses avantages pour la civilisation et l'humanité, mais en même temps suscitant des abus dont toutes les choses humaines sont entachées. L'intolérance a régné pendant de longs siècles ; et c'est à peine si, dans le nôtre, elle s'est relâchée de ses exigences et de ses rigueurs. Beaucoup de nobles esprits se sont révoltés héroïquement contre elle; mais la réaction ne devait pas être moins excessive que la persécution provocatrice. De croyances qui étaient exagérées dans leur application, si ce n'est dans leur principe, on est passé à des croyances tout autres, qui ne sont guère plus modérées et qui ont le malheur d'être fausses. La philosophie du xixe siècle, grâce surtout à M. Cousin, s'est dégagée de cet abîme creusé par le siècle précédent; mais la science s'y est aventurée, bien qu'elle n'y fût pas tenue, et que de telles questions ne soient pas de sa compétence. Dans la civilisation grecque, où il n'y a point eu de livres sacrés ni d'orthodoxie, l'âme d'Aristote a été à l'abri de l'oppression et de la licence ; il a vécu dans ces libres et pures régions qui sont l'atmosphère CLXXVIII naturelle de la philosophie ; et si jamais homme fut en mesure de voir la vérité et de la dire, c'est bien le précepteur d'Alexandre, et l'auteur de l'Histoire des Animaux. Etendue d'intelligence et perspicacité sans égale, impartialité absolue, voilà les deux qualités qui le recommandent et l'imposent, non pas à la foi du genre humain, qui ne doit accepter d'autre joug que celui de la raison, mais à son attention perpétuelle et bienveillante. Aristote ne s'est donc pas trompé en professant que l'univers a un sens et que les phénomènes qu'il nous offre ont une fin intelligible ; nous ne nous trompons pas plus que lui en pensant ce qu'il a pensé. L'idée de Dieu, dont certains savants ont une sorte d'horreur, n'est pas exclusivement religieuse ; elle est surtout philosophique, on peut en croire Descartes ; et, comme dirait Kant, c'est un postulat de la raison, le plus nécessaire de tous les postulats. L'idée de Dieu n'est pas davantage exclusivement chrétienne. La philosophie grecque, dans sa pleine liberté, l'a connue dès ses premiers temps, avec Xénophane, Héraclite et Anaxagore. L'école plato- CLXXIX nicienne, inspirée par Socrate, et le Péripatétisme l'ont, à certains égards, approfondie autant qu'elle peut l'être ; et ils en ont tiré à peu près toutes les conséquences pratiques qu'elle renferme, soit pour l'explication du monde extérieur, soit pour la moralité humaine. La science contemporaine pourrait donc, sans être suspecte de complaisance pour la superstition, accepter aussi, après de tels garants, l'idée de Dieu, et tout au moins ne pas la combattre, ni directement, ni par voies détournées. Après l'instinct de la conscience, qui, spontanément et dans l'élan de sa foi, croit à un être infini et tout-puissant, au-delà des êtres particuliers, la réflexion, qui n'est que la philosophie même, confirme et éclaircit cette impression, qui est d'abord obscure, tout énergique qu'elle est* Pour achever et pour relier le faisceau de toutes les données éparses de l'observation et de la science, la raison a le besoin impérieux de concevoir une cause universelle et une unité indéfectible à cette variété sans limite ; il faut un point d'arrêt, comme le déclarait Aristote. L'intelligence finie de l'homme est très-loin de tout comprendre, CLXXX en dépit d'une orgueilleuse présomption, que désavoue la vraie philosophie ; mais elle comprend assez les choses qu'elle atteint pour s'assurer qu'elles viennent d'un auteur.qui les a créées, qui les ordonne et qui les maintient, et surtout pour s'assurer que cet auteur de tous les êtres a une infinie puissance. La réflexion dans ce qu'elle a de plus attentif, de plus profond, de plus scientifique, est ainsi en parfaite harmonie avec la spontanéité du genre humain; et, chaque jour, se vérifie cette sage parole que, si un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. Ceci ne veut pas dire que les sciences n'ont à faire que des traités Bridgewater, à la louange incessante de la puissance et de la bonté divines. Ce n'est pas là leur objet; cependant, comme l'intervention de Dieu n'est pas plus méconnaissable dans le détail des phénomènes que dans leur ensemble, la science s'égare quand elle en arrive à des négations particulières qui contredisent l'affirmation universelle. Ce ne sont plus là, nous le répétons, des questions scientifiques, ce sont des questions CLXXXI de philosophie. S'il est vrai que la science ne peut pas s'en abstenir complètement, du moins ce ne sont plus tout à fait les siennes. Chaque science, dans son domaine spécial, étudie un certain ordre de faits qu'elle a le devoir de recueillir et d'élucider. Mais par cela même, les sciences ne sont, chacune à part, que des fragments du tout, qu'elles décomposent du mieux qu'elles peuvent ; et cette analyse, poussée aussi loin qu'on le suppose, appelle toujours une synthèse, sans laquelle elle n'aurait presque plus de valeur. Aussi les sciences, sauf leur utilité pratique, ne sont, à vrai dire, que des curiosités qui instruisent l'esprit, mais qui ne le satisfont pas pleinement, parce qu'il voit toujours au delà de chacune d'elles le problème total dont elles ne sont que des solutions partielles. L'effroi que la métaphysique cause à quelques savants est vraiment puéril. Aux yeux de la raison, la métaphysique, ou la philosophie générale, est la première de toutes les sciences, bien qu'elle n'ait rien de pratique selon la remarque d'Aristote ; elle est la science des sciences ; et prétendre s'en passer est une tentative aussi CLXXXII vaine que de nier le système du monde et l'ordre universel. Claude Bernard défendait à la philosophie, non sans amertume ni sans quelque colère, " d'entrer dans le ménage de la science ». (Revue des Deux-Mondes, 4865, p. 661.) Le célèbre physiologiste se trompait. La philosophie n'a point à envahir les sciences ; elle n'a point à y pénétrer, en en forçant l'entrée, attendu que, par sa nature même, elle est toujours et nécessairement mêlée au ménage de la science. N'est-ce pas la philosophie qui doit poser et résoudre les questions de méthode ? N'est-ce pas elle qui est chargée d'étudier la part que l'esprit de l'homme apporte toujours dans les édifices scientifiques qu'il construit? N'est-elle pas chargée aussi d'étudier certaines idées générales que les sciences admettent et emploient sans examen, et dont elles ne sauraient manquer sans se détruire elles-mêmes ? Par exemple, les idées de substance, de cause, de temps, d'espace ? Quand la zoologie se rend compte de la méthode qu'elle s'astreint à suivre, ainsi qu'Aristote le fait dans le premier livre du Traité des Parties, est-ce là CLXXXII encore de l'histoire naturelle ? La question de la méthode ne se reproduit-elle pas dans toute autre science, avec la même indépendance que dans la science zoologique ? Ne faut-il pas une science occupée spécialement de cette question capitale, qui intéresse au premier chef le domaine scientifique tout entier ? Cette science, distincte de toutes les autres, en ce qu'elle les précède, les enveloppe et les dirige, n'est-ce pas la philosophie? La bannir des sciences, ne serait-ce pas les condamner à marcher à l'aventure? En est-il une seule qui consentît à n'avoir point de méthode ? Ce besoin est si réel, que chaque science, dès qu'elle a fait assez de progrès, se replie sur elle-même, et tente de se faire sa philosophie particulière. Mais alors la science quitte le champ qui lui est propre, et c'est elle a qui entre dans le ménage » de la philosophie, loin que ce soit la philosophie qui entre dans le sien. La philosophie n'a garde de s'en plaindre, parce qu'elle sait de reste ce qu'elle est, ce qu'elle a été et ce qu'elle doit être à jamais. Comme elle vise à embrasser la totalité des choses, dans les limites de notre incurable CLXXXIV infirmité, elle n'a point à craindre qu'on la dépouille et qu'on usurpe sur elle. Les ombrages que la science conçoit, sans motif, à son égard, ne l'inquiètent pas. Surtout elle ne les ressent point à son tour; et au lieu de s'irriter qu'on vienne à son aide, elle provoque et elle accueille tous les concours. Les informations secondaires que les sciences lui apportent rentrent dans son vaste cadre, qui renferme tout, et lui permettent de le remplir de mieux en mieux. Ce rapport de la philosophie aux sciences est si vrai qu'au début, quand l'esprit humain essaie ses premiers pas, la philosophie comprend toutes les sciences sans exception ; elle est la science unique. L'histoire nous en offre deux exemples, un peu différents, mais également décisifs : celui de la Grèce et celui de l'Inde. Au temps de Thaïes et de Pythagore, l'intelligence grecque ne connaît que la philosophie, réunissant en elle seule tout le savoir des hommes. Bientôt les sciences éclosent de son sein inépuisable ; elles se particularisent de plus en plus, à mesure que l'observation étend ses analyses sur le monde. Déjà en CLXXXV Grèce, les sciences, très-nombreuses, se ramifient du tronc commun. Elles le sont bien davantage chez nous, qui les avons héritées des Grecs; et elles se multiplient sans cesse par nos labeurs, s'écartant, une à une, de l'unité primitive, mais y tenant toujours par des liens indissolubles. Dans l'Inde, les sciences ont été moins, heureuses ; elles n'ont jamais pu sortir du giron de la philosophie; elle est restée à toute époque la seule science que l'esprit Hindou ait conçue ; il l'a cultivée avec un zèle dont la Grèce même n'a point dépassé l'ardeur. Les ascètes Brahmaniques n'ont pas eu la force de produire des sciences spéciales ; ils en sont demeurés à la science totale, avec ses inévitables obscurités, qu' accroît encore l'esprit de la race, incapable d'observer quoi que ce soit de la nature extérieure, et s'abîmant dans l'extase, où il s'observe lui-même tout aussi mal. Pour la Grèce, la philosophie a été une mère féconde ; dans l'Inde, elle a été stérile, et n'a rien enfanté qu'elle-même, charmée et enivrée de ses trésors, que d'autres ne sont point venus augmenter. Mais dans lu Grèce et dans l'Inde, la philosophie est la CLXXXVI source supérieure et la racine de tout savoir. Cette relation de la philosophie aux sciences n'a point changé ; à cette heure, elle est dans notre temps ce qu'elle était dans ces temps reculés, et ce qu'elle sera pour jamais. Voilà ce que les sciences doivent se dire pour ne point se laisser aller à ces sentiments d'hostilité qu'on cherche quelquefois à leur inspirer contre la philosophie. Cette discorde, qui n'est pas sage, risquerait d'être funeste, soit aux sciences, qui ne sauraient se passer de la philosophie, qui les éclaire, soit à la philosophie, que les sciences complètent si utilement. D'ailleurs, cette prédominance de la philosophie n'a rien d'oppressif. Ce n'est pas davantage une prétention orgueilleuse; c'est une simple priorité, résultant du rapport nécessaire que Dieu a mis entre l'esprit de l'homme et le monde où il nous a placés. Le premier regard que l'homme jette sur la nature ne peut lui fournir que la vue superficielle de l'ensemble des choses; c'est une vue totale, qui est confuse, parce que tout y est compris et mêlé. Plus tard, les différences et les distinctions se marquent indéfiniment pour CLXXXVII des yeux moins éblouis ; mais l'impression initiale ne s'efface point ; et c'est toujours à la totalité que doit se rattacher l'intelligence de plus en plus instruite, parce que les grands et essentiels problèmes sont là, et que ces problèmes généraux servent à résoudre tous les autres. Ce sont aussi les plus difficiles de tous; et l'esprit de l'homme, qui se sent si faible devant leur grandeur incommensurable, y reçoit une leçon d'humilité dont la philosophie profite, mais dont les sciences ne profitent peut-être pas toujours autant qu'elle, bien qu'elles en aient le même besoin. Ces dernières considérations semblent s'adresser surtout au temps présent. Pourtant elles ne sont pas aussi neuves qu'on serait tenté de le croire ; on peut en trouver l'équivalent dans la lecture d'Aristote ; et quand on se rappelle son admiration réfléchie pour les œuvres de la nature, et ses théories sur la philosophie première, on peut supposer sans témérité qu'il pensait et qu'il a dit à peu près tout ce que nous venons de dire. Pour lui aussi, la philosophie est la plus haute des sciences, parce qu'elle est la plus générale. Il CLXXXVIII en a fait dans sa Métaphysique une austère peinture, à laquelle les Modernes ne peuvent rien ajouter ; et il a décrit la « Perennis quœdam philosophia » aussi clairement que Leibniz a pu le faire, après deux mille ans d'expérience de plus. Aristote a même tellement prisé le savoir permis à l'homme, qu'il soupçonne que les Dieux pourraient en être jaloux, si jamais une basse jalousie approchait de l'âme des Dieux. Mais Aristote ne s'est pas perdu sur ces sommités lumineuses; et personne dans tout le passé n'a tiré autant d'applications pratiques de la science des principes et des causes. On ne saurait énumérer trop souvent toutes les sciences qu'il a fondées, et que le monde a cultivées après lui : logique, rhétorique, poétique, psychologie, physique, météorologie, métaphysique, histoire naturelle, anatomie, physiologie, etc. Aurait-il créé tant de sciences, s'il ne se fût tout d'abord appuyé sur la philosophie, qui a doublé les forces de son génie, sa profondeur et son exactitude, sa solidité et son étendue ? Dans le champ de la physiologie comparée, on vient de voir ce qu'il a fait ; les germes LXXXIX qu'il a semés à pleines mains ne se sont développés que bien longtemps après lui ; et il a été tellement en avance sur l'esprit humain, qu'il a fallu une vingtaine de siècles pour qu'on se mît enfin à son niveau. Ce serait certainement un enthousiasme aveugle que de nier ses lacunes, et les erreurs qu'il a inévitablement commises. Mais quelque justes critiques qu'on puisse en faire, nous ne devons jamais oublier qu'il a ouvert la carrière ; et qu'ici comme ailleurs, il a été le premier et par cela même le plus grand des physiologistes. 11 serait souverainement inique de refuser aux Modernes la gloire qui leur revient ; mais ils n'ont fait que suivre la voie qui leur avait été tracée. Leurs progrès sont considérables ; l'ouvrage même d'Aristote est là pour le prouver ; mais on peut douter que, sans lui, ces progrès eussent été possibles; et il est équitable de lui faire aussi sa part. Pour des juges non prévenus, cette part peut passer encore pour la plus belle, même au milieu des splendeurs de la science contemporaine.
Paris, Mai 1885. |