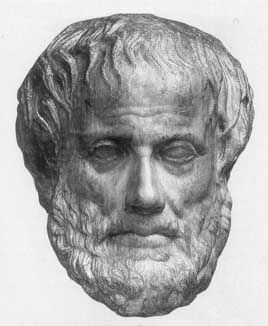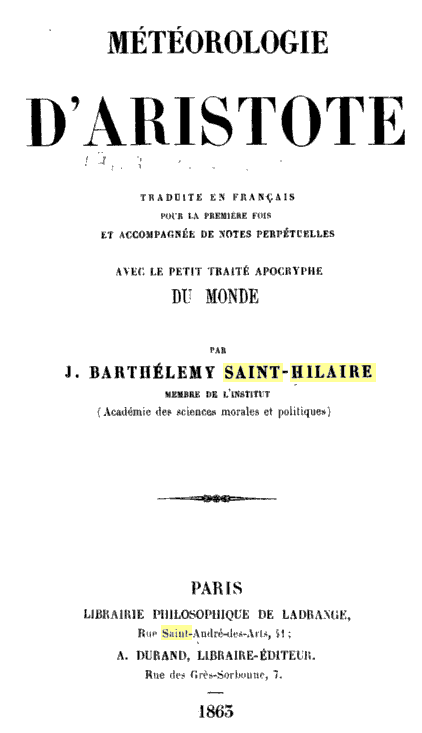|
TABLE DES MATIÈRES DE LA MÉTÉOROLOGIE table des matières de l'œuvre d'Aristote
ARISTOTE
MÉTÉOROLOGIE.
PRÉFACE
DISSERTATION SUR LA COMPOSITION DE LA MÉTÉOROLOGIE ET DU PETIT TRAITÉ DU MONDE.
PRÉFACE A LA MÉTÉOROLOGIE D'ARISTOTE. La Météorologie d'Aristote est trop peu connue; sa valeur scientifique et historique; travaux qui l'ont préparée et rendue possible. — Analyse de la Météorologie d'Aristote; place assignée par lui à la météorologie dans l'ensemble de l'histoire naturelle. Éléments du monde terrestre ; propriétés des quatre éléments et leur situation respective. Météores des parties les plus élevées de l'atmosphère : comètes; voie lactée. Météores inférieurs; rosée; gelée blanche; pluie; neige; grêle. Formation générale des eaux ; considérations sur les mers et les continents; salure de la mer. Théorie des vents et configuration de la terre ; théorie des tremblements de terre. Météores optiques : halo, périhélie, arc-en-ciel. Quatrième livre de la Météorologie d'Aristote. — Esquisse du la météorologie dans son état actuel; ses progrès, ses travaux, ses instruments, son étendue. Les Météores de Descartes, intermédiaire entre la science moderne et l'antiquité. — Importance scientifique de la Grèce impuissance du génie oriental; les Grecs, dès le temps d'Aristote, ont su observer et expérimenter; preuves de cette assertion tirées de la Météorologie d'Aristote et de sa Physique. — Avenir de la météorologie actuelle; ses devoirs purement scientifiques. La Météorologie est un des ouvrages d'Aristote qui méritent le plus d'être connus et qui le sont le II moins. Les philosophes l'ont négligée, parce qu'ils n'ont presque rien à y apprendre sur les sujets spéciaux qui les occupent, et parce que les météores ne les regardent pas. Les savants l'ont en général presque autant ignorée, quoique avec moins de droit; et ceux qui en parlent en ont fait si peu d'usage qu'ils semblent ou la dédaigner ou ne pas la comprendre. Cependant la Météorologie d'Aristote doit tenir dans l'histoire de la science un rang considérable, à la fois par sa date et par les théories qu'elle renferme. Aristote n'est pus le père de la météorologie, comme on l'a dit quelquefois; il a bien soin lui-même de nous en avertir, en discutant les opinions des météorologistes antérieurs à lui. Mais s'il n'a pas absolument fondé la science des météores, son ouvrage est le seul qui représente auprès de nous l'état de la météorologie trois siècles et demi avant l'ère chrétienne; et je m'assure que, si l'on veut y regarder de près et avec impartialité, on sera étonné de tout ce qu'on savait déjà à une époque aussi reculée. On sera frappé surtout de l'excellente méthode qu'a suivie le philosophe, et l'on se relâchera de bien des préventions contre lui et contre l'antiquité.Il ne faut pas oublier non plus que, depuis le siècle d'Alexandre jusqu'à la Renaissance, Aristote III a fait loi en météorologie, comme en tout le reste. Pendant près de deux mille ans, l'humanité n'a guère été qu'à son école ; et à moins de professer pour l'esprit humain, durant celte longue période, un inexcusable mépris, il faut bien tenir quelque compte d'un livre qui a exercé une domination si durable. Il n'est pas probable qu'il ne renferme que des erreurs ; et pour peu qu'il présente quelques parcelles de vérité, et surtout quelques bons exemples, il est utile de les recueillir; la science ne peut que gagner à se rappeler ses origines et à en garder le souvenir reconnaissant. Il est donc à espérer que les météorologistes de notre temps ne seront pas sans curiosité pour le plus ancien et le plus illustre de leurs prédécesseurs ; ils n'auront peut-être pas à tirer grands enseignements pas moins; car c'est de là qu'est partie la science pour arriver au point où elle en est de nos jours. Il n'est pas besoin d'être philosophe de profession pour s'intéresser aux progrès de l'intelligence humaine, surtout quand ils sont aussi manifestes ; et tout esprit éclairé peut prendre goût à ce spectacle, qui est à la fois attachant et fécond. Pour faire mieux sentir la valeur de la Météoro- IV logie d'Aristote, je ne remonterai pas plus haut que lui. On possède trop peu de documents sur les travaux qui ont précédé les siens; et quoique le cadre de la science fût dès longtemps fixé, quand il l'a étudiée à son tour, c'est encore dans Aristote lui-même qu'on peut trouver les indications les plus certaines et les plus étendues. Enlisant son ouvrage, on verra, par les discussions qu'il soulève, qu'on avait déjà beaucoup travaillé, depuis deux ou trois siècles, c'est-à-dire depuis Thalès. Aristote a certainement mis à profit toutes ces recherches; mais il serait à peu près aussi inutile que difficile de savoir précisément ce qu'elles étaient; et puisque son livre est l'unique monument que le temps ait épargné, je me home à le considérer à part de tous les autres, que nous ne connaissons que par des débris. D'abord Aristote, en écrivant sur le sujet particulier de la météorologie, s'est souvenu qu'il était philosophe, et il a essayé de rattacher cette étude à toute l'histoire de la nature, telle qu'il la concevait et telle qu'il l'avait constituée. Je n'affirme pas que les liens qu'il établit entre la météorologie et les sciences voisines, la physique, la physiologie, la zoologie, la botanique, soient bien étroits et bien légitimes; mais, à ses yeux, la météorologie n'était pas V isolée, et il a montré, d'ailleurs plus ou moins exactement, les rapports qu'elle soutenait avec l'ensemble de ses investigations si vastes et si solides. Le météorologiste n'est pas tenu à ces considérations générales; mais le métaphysicien ne peut les omettre, bien qu'il n'ait pas à s'y arrêter beaucoup à propos d'une science telle que celle-là. Le second pas que fait Aristote est aussi louable que ce premier. Modeste comme il l'est toujours, il nous apprend, dès le début, que bien des philosophes avant lui avaient réuni sous le nom de météorologie, unanimement adopté par eux, l'étude d'un certain nombre de phénomènes qui se passent dans notre atmosphère et même dans notre globe, et qui sont soumis à des lois moins régulières que ceux des sphères supérieures, où tout semble obéir éternellement à un ordre admirable. Aussi, devant la difficulté du sujet qu'il aborde, il ne se flatte pas de le pénétrer tout entier. « Bien des faits, dit-il, resteront inexplicables; mais quelques-uns seront expliqués avec une clarté suffisante; « et le philosophe se contente de cette demi-conquête, à laquelle encore la science de nos jours en est trop souvent réduite. Aristote, comme on le verra bientôt, n'a pas convenablement tracé les limites de la météoro- VI logie, et elles n'ont pas dû rester aussi larges qu'il les avait faites; peut-être avait-il été entraîné sans le savoir par les exemples qu'il avait sous les yeux et qu'il a suivis sans les trop examiner. Mais cette erreur n'a pas été commise sans réflexion, et quoiqu'il eût été digne de son génie de la rectifier, on conçoit qu'il l'ait acceptée de la tradition, à une époque où la plupart des sciences étaient encore très mal circonscrites, indécises et obscures comme tout ce qui commence. Pour se rendre bien compte des phénomènes météorologiques, Aristote expose quels sont, suivant lui, les principes et les éléments généraux du monde terrestre, qui comprend non pas seulement le globe sur lequel l'homme habite, mais en outre tout l'espace qui s'étend entre la terre et la lune, ou plutôt la région supérieure, dont il n'est pas possible de fixer précisément les bornes. Cet espace, à partir de la masse terrestre qui flotte elle-même dans l'air, et dont la forme est sphérique, est occupé par quatre éléments superposés les uns aux autres, selon la diversité de leurs poids. En premier lieu et comme la plus pesante, la terre qui est immobile au centre; au-dessus d'elle, l'eau, tant celle de la mer que celle des continents; au-dessus de l'eau, l'air qui VII peut passer à l'état aqueux dans certains cas, de même que l'eau peut se convertir en air également ; enfin le feu, ou une espèce de feu, différent du nôtre, qui se tient au-dessus de l'air, et qui est le produit du mouvement circulaire de la région supérieure en contact avec l'air placé au-dessous d'elle. Tels sont les quatre éléments qui forment notre monde; telle est leur position respective dans l'ordre de leur pesanteur, avec toutes les variétés et les espèces qu'ils offrent à notre observation attentive. Par-delà ces quatre éléments, qui occupent une place indéterminée dans l'étendue, Aristote admet l'existence de l'éther, qui remplit les espaces célestes, et qui n'est ni air ni feu. Le rôle de l'éther est peu précis ; et il ne semble pas qu'il intervienne dans les phénomènes de la météorologie. Aristote ne se fait pas la moindre illusion sur l'importance de notre globe, tout en le prenant pour le centre du monde. Il revient à plusieurs reprises et avec une sorte d'ironie, sur sa petitesse relative, dont on est convaincu quand on le compare aux astres dont il est entouré. Sa distance au soleil est énorme; mais sa distance aux étoiles fixes est bien plus immense encore. Notre terre n'est donc qu'un point dans l'univers, qui n'a pas été fait pour elle ; VIII et le philosophe insiste sur celte vérité, comme s'il voulait indirectement combattre les préjugés de son temps, sans d'ailleurs les réfuter de front. Tous les météores, quels qu'ils soient, sont produits par l'action des quatre éléments, et surtout par l'action de l'eau et de l'air, à laquelle vient se joindre celle de la chaleur du soleil. Ainsi, l'eau s'évapore sans cesse, et elle monte sous cette forme dans les régions plus hautes de l'atmosphère, pour en redescendre bientôt sous des formes diverses que la météorologie étudie en détail. La vapeur visible ou invisible, qui s'élève de l'eau, n'est pas seule à former l'air; car l'air renferme aussi une autre partie non moins importante que la vapeur, à savoir la sécrétion, qui s'échappe de la terre ferme. Ainsi, l'exhalaison, en comprenant par ce nom commun la vapeur et la sécrétion, est double ; elle est sèche et fumeuse, quand elle vient de la terre; elle est vaporeuse et humide, quand elle vient de l'eau. Il y a donc comme un courant perpétuel, qui va du centre du globe aux extrémités de l'atmosphère, et qui de ces extrémités revient au centre. Joignez-y, outre la chaleur des rayons solaires, le mouvement universel, dont Aristote a essayé de poser les lois dans sa Physique, et vous aurez toutes IX les causes et toute la matière des météores qui s'accomplissent, ou qui se font apercevoir, au-dessous de la sphère de la lune. Do ces météores, les uns sont substantiels; les autres ne sont que des apparences et des jeux de la lumière. La pluie, la neige, la grêle, la rosée, sont du premier genre; le halo, le parhélie, l'arc-en-ciel, sont du second. Aristote commence par les météores qui se passent dans les régions les plus éloignées; et il fait d'abord la théorie des comètes. Aujourd'hui que l'on connaît un peu mieux ce mystérieux phénomène, la théorie des comètes ne fait plus partie de la météorologie ; et voilà plus de deux cents ans que Descartes reprochait à Roberval de prendre encore les comètes pour des météores. Désormais, ce sont des planètes d'une nature particulière, mais dont la course, tout excentrique qu'elle semble, n'en est pas moins réglée, puisqu'on a pu déjà prédire avec certitude le retour périodique de plusieurs d'entre elles. Suivant Aristote, la comète était un météore qui s'enflammait dans les parties les plus élevées de l'atmosphère, comme s'y enflamment presque tous les autres ; et la queue, qui est parfois si brillante, était tout à fait analogue au phénomène du halo, et causée X comme lui par la lumière du soleil. D'ailleurs, Aristote, qui se montre peu content des explications données avant lui sur l'apparition des comètes, n'est guère plus satisfait de l'explication qu'il propose ; et il veut simplement démontrer que sa théorie n'a rien d'impossible, et que les comètes peuvent bien être le produit de l'exhalaison, qui prend feu à de très grandes hauteurs. Mais il avait d'autant plus de droit à être écouté de ses contemporains, qu'il avait lui-même étudié le phénomène de très près, et qu'il cite deux observations personnelles qu'il avait faites avec une rare sagacité, et qui confirmaient celles des astronomes Égyptiens, si renommés dans le monde grec. La même méprise qui fait qu'Aristote compte les comètes parmi les météores, le mène à y ranger aussi la voie lactée. A l'en croire, la voie lactée est comme la chevelure d'une multitude d'astres accumulés dans cette portion du ciel. Ces astres ont des queues, comme en ont les comètes ; et de là, l'apparence qu'ils offrent à nos regards. Avant Aristote, Anaxagore et Démocrite avaient donné de la voie lactée une explication plausible, du moins en partie; et pour eux, elle n'était que la lumière de quelques étoiles, brillant d'un éclat qui leur est propre, et qui, XI protégé par l'ombre de la terre, n'était point éteint par la splendeur du soleil, comme le sont beaucoup d'autres astres. Aristote répondait avec raison que, si la lumière de la voie lactée dépendait ainsi de celle du soleil, elle devrait varier avec la course de cet astre, tandis qu'au contraire elle est toujours fixée dans la même partie des cieux. Cette objection était péremptoire contre une partie de la théorie de Démocrite et d'Anaxagore. Mais Aristote aurait pu adopter la part de vérité qu'elle renfermait, et prendre la voie lactée pour ce qu'elle est en effet, un amas d'étoiles plus rapprochées entre elles que toutes les autres. On ne pourrait pas dire d'ailleurs que le philosophe eut observé ce phénomène avec moins d'attention que les comètes. Pour le faire bien comprendre à ses lecteurs, il les renvoie d'abord aux démonstrations rigoureuses qu'il adonnées, dans ses ouvrages spéciaux d'astronomie, sur la grandeur du soleil comparativement à la (erre, sur sa distance qui, toute prodigieuse qu'elle est, l'est beaucoup moins cependant que celle des fixes; et il en conclut que le cône obscur que la terre peut former à l'opposé des rayons solaires, ne doit pas atteindre les étoiles placées à de telles distances, et que pour XII elles, la nuit, telle qu'elle est sur notre globe, ne peut jamais avoir lieu. Puis, à ces démonstrations astronomiques, il joint des dessins et des cartes qui montrent l'aspect du ciel dans les parties qu'occupe la voie lactée, le cercle qu'elle décrit et les bifurcations qui la divisent.
Avec la voie lactée, Aristote termine ce qu'il
avait à dire des météores qui se produisent dans les bautes régions et sur les
limites extrêmes de notre atmosphère terrestre, et il passe à des phénomènes
plus voisins de nous, ou comme il le dit, « aux météores du premier lieu
au-dessus de la terre. » Après quelques considérations sommaires sur l'océan
atmosphérique, qui a ses flux et ses reflux tout comme l'autre, et, sur la
formation des nuages et du brouillard, Aristote décrit et explique
successivement les météores les plus ordinaires, la rosée et la gelée blanche,
la pluie, la neige, la grêle, à laquelle il s'arrête plus particulièrement. Il
en note avec grand soin les circonstances principales, telles que l'observation
les donne, et il consigne une foule de faits, que la météorologie actuelle fera
bien de consulter, en se rappelant qu'Aristote vivait sous le climat de la
Grèce, le seul qu'il ait connu. Ces phénomènes étant exposés, il procède à la
XIII
théorie des vents, qui exercent tant d'influence sur toutes les modifications de
notre atmosphère. Mais, auparavant, il croit pouvoir se permettre une digression
sur la formation des eaux à la surface du globe terrestre. Celte digression est
une des parties les plus importantes de toute la Météorologie; et, bien qu'elle
suspende un peu le cours de la pensée générale, elle est tellement belle qu'il
serait fort à regretter qu'Aristote, par un scrupule de régularité, se la fût
interdite. Il traite d'abord de l'action des montagnes, sur les condensations
des vapeurs, et il n'a pas de peine à prouver que les plus grands fleuves
prennent toujours leurs sources au pied des montagnes les plus hautes. De là,
des détails géographiques, qui sont loin d'être tous exacts, tant s'en faut,
mais qui prouvent du moins qu'Aristote se tenait au courant de toutes les
découvertes de son siècle, quelqu'incomplètes d'ailleurs qu'elles puissent nous
paraître. Puis, c'est ici que vient se placer une admirable étude, digne, j'ose
le dire, de notre Cuvier, sur les rapports des mers et des continents, les
empiétements continuels et réciproques des eaux sur la terre ferme et de la
terre ferme sur les eaux, Elles sont complétées par une longue théorie sur la formation de la mer, dont notre globe est entouré, et sur cette singulière propriété de la salure. Il faut lire toute cette théorie dans Aristote lui-même ; elle n'est pas irréprochable, comme on peut s'y attendre ; mais il n'y a guère lieu de s'en étonner, quand on se rappelle que le problème n'est pas encore résolu de nos jours. Je ne note donc dans cette discussion que quelques points principaux. Aristote tient contre Démocrite pour la stabilité de l'état actuel des mers; cet état doit remonter au XV commencement même du monde, et rien ne peut faire présumer qu'il doive changer jamais. La mer n'a pas de sources à la manière des fleuves ; mais entre elle, les fleuves et l'atmosphère, il s'est établi, dès l'origine, comme une sorte de circulation où les eaux marines en s'évaporant fournissent la matière des pluies, et où la pluie fournit la matière des fleuves, qui rendent à la mer ce qu'ils ont reçu, attendant bientôt d'elle qu'elle le leur rende de nouveau. Tel est le mécanisme véritable de la nature, et les lois réelles auxquelles elle obéit. Cette explication, toute simple qu'elle est, aie grand mérite pour Aristote d'être conforme aux faits ; et il faut la préférer à toutes les fables débitées sur ce sujet, que la poésie accueille volontiers, mais que la science doit sévèrement proscrire. Démocrite et Empédocle ne se sont pas astreints à cette méthode rigoureuse ; et voilà comment leurs théories peuvent être plus d'une fois tournées en ridicule, au lieu d'être prises au sérieux. La salure de la mer tient certainement à la présence d'un corps étranger, qu'on peut isoler dans certains cas. par des expériences délicates, et qui ne se retrouve plus dans le liquide que forme la vapeur XVI condensée de l'eau de mer. Ce liquide venu de l'évaporation est potable, comme peut le devenir l'eau de mer elle-même, après qu'elle a été filtrée au travers de certaines matières. L'eau de mer est plus lourde de beaucoup que l'eau douce. Une foule de faits le prouvent. Les navires qui viennent de la mer dans les fleuves et les rivières, sont forcés de s'y alléger, parce qu'ils y enfoncent davantage. Des œufs qui surnagent sur de l'eau qu'on sale fortement, ne surnagent plus dans de l'eau ordinaire. Enfin, il est, à ce qu'on rapporte, un lac, dans la Palestine, où l'on peut se baigner sans que le corps enfonce dans l'eau ; et celte eau est excessivement chargée de sel. Mais Aristote revient à la théorie des vents, dont il s'était un instant écarté, et il y consacre trois chapitres entiers qui peuvent compter parmi les meilleurs de tout son livre, par l'abondance et l'exactitude des faits, et sans doute aussi par leur nouveauté dans le temps où il écrivait. Aristote me paraît avoir compris la cause des vents presque aussi bien que nous pouvons aujourd'hui la comprendre. Il les rapporte à l'exhalaison qui traverse l'atmosphère, et à la chaleur du soleil. Il ne dit pas précisément, comme nous le ferions XVII maintenant que le vent est une rupture dans l'équilibre de l'atmosphère; mais il est bien près de le dire, et il est évidemment dans le chemin de la vérité, se raillant de ceux qui se figurent encore les vents tels que les poètes et les peintres les représentent. Le principe moteur des vents se trouve dans les hautes parties du ciel; la matière en est fournie par l'exhalaison sèche, qui sort de la terre. La cause vient donc d'en haut, et la matière vient d'en bas. La violence des vents et les propriétés qui les distinguent dépendent beaucoup des lieux où ils soufflent. La terre habitable n'est qu'une portion de notre globe entier. Cette portion assez restreinte n'est pas ronde, comme la font certaines descriptions imaginaires qui ne reposent pas sur des observations suffisamment positives. La terre habitable forme réellement deux zones, l'une en deçà, l'autre au delà de l'équateur, et séparées par la zone torride, où les hommes ne peuvent plus vivre à cause de la chaleur étouffante de ces contrées. Loin que la terre habitable soit ronde, elle est au contraire beaucoup plus étendue en un sens que dans l'autre; et il y a bien plus de longueur des Colonnes d'Hercule à l'Inde, de l'ouest à l'est, que de la Scythie à l'Éthiopie, du nord au sud. La terre XVIII habitable a donc une longitude et une latitude. Cette configuration générale de la partie habitée de notre globe doit servir à nous expliquer la position et l'origine des vents. Ainsi, le vent du sud ne vient pas, comme on aurait pu le croire, du pôle opposé à notre pôle boréal; il vient de la zone torride et ne la dépasse pas. De l'autre côté de l'équateur, la même disposition se reproduit; pour ces régions inconnues, le vent du sud part de la zone brûlante comme dans les nôtres ; et le vent du nord doit venir d'un pôle que nous ne voyons pas, mais qui n'en existe pas moins. Les vents généraux se divisent en deux grandes classes, vents du nord et vents du midi; ils se divisent aussi quoique d'une manière moins tranchée, en vents d'ouest et vents d'est. Outre ces quatre vents principaux, on en distingue encore plusieurs autres qui tiennent plus ou moins de ces directions, et qu'on peut rapporter soit aux levers du soleil en été et en hiver, soit à ses couchers dans les mêmes saisons. Cela revient à dire que les vents soufflent de tous les points de l'horizon à peu près. Mais il a fallu, pour les distinguer, établir ces grandes divisions, dont on faisait usage bien avant Aristote, et qu'il a précisées mieux que que personne à l'aide de cartes et de dessins. XIX Par une erreur analogue à celle que nous avons signalée plus haut sur les comètes et la voie lactée, Aristote présente ici une théorie des tremblements de terre, qu'il rattache étroitement à sa théorie des vents. Si l'air cause par ses perturbations tant de mouvements dans notre atmosphère, il n'en produit pas moins dans le sein de notre globe et dans ses profondeurs. Il agit même avec d'autant plus de force que le feu intérieur de la terre lui communique une puissance nouvelle en le dilatant; et de là, ces effroyables commotions qui bouleversent parfois la surface du globe terrestre, et qui ont laissé des témoignages irrécusables, soit sur les continents, soit même au milieu des eaux. Anaxagore, Anaximène et Démocrite ont essayé d'expliquer ces terribles phénomènes; mais leurs théories sont purement arbitraires et ne s'appuient pas assez solidement sur les faits bien observés. Par exemple, Anaxagore prétend que c'est l'éther qui, par sa nature, tendant toujours à monter, vient frapper la terre en dessous et dans sa partie concave. Ainsi heurtée, la terre éprouve un tremblement. Mais vraiment cette théorie est par trop naïve. Il n'y a pas de bas et de haut comme Anaxagore le suppose. Le haut n'est pas le lieu où nous habitons, et XX le bas n'en serait pas le contraire. Comme l'horizon varie sans cesse à mesure qu'on se déplace à la surface du globe, il est clair que ce globe est sphérique; et nous retrouvons sur tous les points le bas et le haut, puisque partout les corps graves tombent vers le centre de la terre, et que les corps légers s'élèvent dans l'air qui nous entoure. Ainsi, la prétendue secousse que la terre recevrait dans le système d'Anaxagore, n'est pas possible; et, de plus, il faudrait que le tremblement se fit sentir dans toute la masse. Or, c'est là ce que les faits contredisent; car les tremblements de terre sont limités à certains lieux, et peut-être même à certaines saisons. L'explication de Démocrite ne vaut pas mieux que celle d'Anaxagore. Si on l'en croyait, le tremblement de terre ne serait pas autre chose que le mouvement des eaux intérieures, accrues et gonflées par les eaux pluviales, ou se précipitant de lieux trop pleins dans les lieux qui ne le seraient pas assez. Quant à Anaximène, il suppose quelque chose d'aussi étrange dans les entrailles de la terre. Selon lui, la terre se dessèche intérieurement quand il fait très chaud à sa surface; elle se fend alors au-dedans, et lorsque ensuite elle est saturée par les eaux qui s'y engloutissent, des blocs énormes se détachent et XXI leur chute cause ce qu'on nomme le tremblement de terre. Mais Anaximène ne voit pas que, s'il en était ainsi, la terre, affaissée sur elle-même, devrait déjà présenter dans une foule de lieux des enfoncements immenses, et que les tremblements de terre devraient toujours aller en diminuant; car la terre aurait fini par se tasser tout entière. J'ai tenu à rappeler ces théories avec quelques détails, pour montrer qu'Aristote avait toute raison de les repousser et de leur préférer la sienne, qui, sans être non plus très exacte, l'était cependant infiniment plus que celles qu'elle devait remplacer. Comme Aristote attribuait les tremblements de terre à l'action des vents, ou des gaz souterrains, ainsi que nous dirions aujourd'hui, il ne trouve pas de difficulté à passer de la théorie des tremblements de terre à celle de l'éclair, du tonnerre, de la foudre, de l'ouragan et de la trombe. Dans tous ces phénomènes, il voit l'action diverse, mais au fond identique, de l'exhalaison, sous la double forme qu'il lui a reconnue, sèche et fumeuse, ou vaporeuse et humide. Il n'est que faire d'insister sur les erreurs que commet en tout ceci la météorologie ancienne. L'électricité, qui joue un si grand rôle dans tous ces faits atmosphériques, n'a été bien connue que vers la XXII fin du siècle dernier. On aurait donc tort de s'étonner de toutes ces méprises qui ont duré si longtemps, et qui ne se sont dissipées que devant des expériences décisives et toutes récentes. Ce n'est pas la sagacité qui a manqué aux anciens ; mais pour en savoir plus qu'eux, il a fallu que, par le progrès des âges, on découvrît un nouvel agent naturel, qu'ils avaient toujours ignoré. Pour achever le cercle de la météorologie, Aristote n'a plus qu'à expliquer les phénomènes que cause la lumière et qui ne sont au fond que des apparences, je veux dire le halo, le parhélie, les verges lumineuses, et surtout l'arc-en-ciel. Je m'arrêterai plus particulièrement à cette dernière théorie, qui, sans être complète, comme on peut bien le supposer, fait toutefois le plus grand honneur au philosophe. D'abord, Aristote n'hésite pas à déclarer qu'il n'y a dans le phénomène de l'arc-en-ciel qu'un simple effet de réfraction. Il paraît qu'il avait entrepris de longues et minutieuses observations sur les miroirs, et il avait remarqué que, dans une foule de cas, surtout quand les facettes des miroirs sont extrêmement petites, le miroir reproduit la couleur sans reproduire la forme. Il part de ce principe pour af- XXIII firmer que les gouttelettes des nuages font, à l'égard de la lumière du soleil, l'office de miroirs, et qu'elles la réfractent, sans que la figure même de l'astre y soit reproduite. Ce qui prouve bien que c'est là l'explication générale de l'arc-en-ciel, c'est que l'arc-en-ciel se montre ailleurs que dans les nuages. Ainsi, on le voit souvent dans l'eau que font jaillir les rames des matelots ; on le produit même à volonté en jetant quelques gouttes d'eau d'un lieu couvert d'ombre dans un lieu exposé au soleil. Il suffit que le soleil, le spectateur et les gouttes d'eau soient dans une certaine position, pour que l'arc-en-ciel apparaisse aussitôt. L'arc-en-ciel n'a que trois couleurs bien tranchées, le violet, le vert et le rouge. Le jaune, qui s'y montre aussi parfois d'une manière assez frappante, ne résulte que du contraste des couleurs voisines. Cette action mutuelle des couleurs les unes rapprochées des autres, est bien connue des brodeurs et des teinturiers, et ils ne s'y laissent pas tromper dans leurs délicats travaux. Pour l'arc-en-ciel, l'effet qui produit le jaune est à peu près de cette espèce. Parfois, il y a deux arcs-en-ciel au lieu d'un seul; mais dans le second, les teintes sont toujours plus pâles; et en outre, elles sont rangées dans un XXIV ordre inverse; le premier arc-en-ciel, ou le plus petit, a d'abord du violet, puis du vert, puis du rouge ; l'arc-en-ciel extérieur a au contraire d'abord du rouge, puis du vert et du violet, à partir de la circonférence du dedans pour aller à celle du dehors. Une particularité fort remarquable de l'arc-en-ciel, et qui le distingue du halo, c'est qu'il ne forme jamais qu'un demi-cercle sans arriver à un plus grand développement. A mesure que le soleil s'élève sur l'horizon, pour parvenir au méridien, l'arc-en-ciel décroît, et il s'agrandit de plus en plus, à mesure que le soleil décline ; mais en aucun cas, il ne peut dépasser la demi-circonférence. Aristote s'attache à démontrer ces deux propositions par des figures géométriques, dont malheureusement la tradition ne nous a pas été exactement transmise, et que nous ne pouvons reconstruire d'une manière satisfaisante. Mais peu importe que ce résultat particulier soit obtenu plus ou moins complètement ; ce qui doit nous intéresser en ceci et provoquer notre admiration, c'est qu' Aristote ait pu déjà pousser l'explication de l'arc-en-ciel à ce point de l'appuyer sur des preuves de cet ordre. Certainement il est très inférieur à Descartes, qui a enfin donné la démonstration tout entière; mais au temps de XXV Descartes, la science comptait deux mille ans de plus; et elle possédait, grâce à ses progrès, une multitude d'instruments que l'antiquité n'avait pu connaître ni employer. Avec les théories que je viens de passer en revue, nous trouverions, nous autres modernes, que la météorologie est terminée; mais pour Aristote elle ne l'est pas encore tout à fait, et aux trois livres qui précèdent il en joint un quatrième et dernier, renfermant, sur l'état et les transmutations des différents corps, des considérations qui appartiennent bien plutôt à la chimie. Dans le système d'Aristote, cette élude complémentaire se rattache très directement, je ne dis pas très justement, à la météorologie. L'exhalaison et la sécrétion agissent sur les substances que la terre contient et qui la forment, comme elles agissent sur les substances plus légères qui l'enveloppent. Des quatre propriétés des éléments, deux sont actives, le froid et le chaud; deux sont passives, le sec et l'humide. Le froid et la chaleur, combinant ou désagrégeant l'humide et le sec, forment tous les corps si variés que nous observons, et qui servent si merveilleusement à notre intelligente industrie. Décrire ces corps, se coagulant ou se liquéfiant sous l'action du chaud et XXVI du froid, se solidifiant ou se mettant en fusion, durs, mous, rigides, flexibles, ductiles ou réfractaires, etc., c'est encore l'œuvre de la météorologie; et voilà comment Aristote traite de toutes ces matières, après avoir traité des météores proprement dits ; il croit que cette étude est une préparation indispensable à celle des substances, soit homogènes, soit non-homogènes, dont se composent les plantes et même les animaux. Je ne veux pas disculper Aristote de la confusion qu'il commet ici; et déjà dans l'antiquité, huit ou neuf cents ans, il est vrai, après lui, on s'était aperçu qu'il y avait là les matériaux d'une science nouvelle encore mal définie, mais très distincte de la météorologie. Au temps d'Aristote, on ne sentait pas le besoin de faire cette division, que n'exigeaient point des faits assez nombreux et assez bien déterminés. On ne reconnaissait que quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, dont les combinaisons suffisaient à former tous les corps quels qu'ils fussent. Aujourd'hui, nous comptons près de soixante-dix corps simples, et la liste n'est pas close. Mais pour les plantes et les animaux en particulier, nous n'admettons guère plus d'éléments que n'en admettait Aristote. Ces éléments ne sont XXVII pas les mêmes que ceux du philosophe ; mais comme nous les retrouvons presque tous aussi dans l'atmosphère, Aristote n'est pas si coupable de les y voir comme nous, et de rattacher par là cette série de phénomènes à la météorologie, où nous ne les comprenons plus (01). Maintenant qu'on doit voir assez clairement comment Aristote a conçu la météorologie et comment il l'a traitée, on peut se donner le spectacle des progrès de la science, en comparant son état actuel à cet antique état où elle nous apparaît dans les œuvres du philosophe. Aujourd'hui, elle est d'abord mieux circonscrite, et elle ne sort pas de ses limites; elle est infiniment plus riche en faits bien constatés; elle possède une foule de procédés, d'instruments, de machines, qu'elle a successivement acquis; elle fait de vastes emprunts à des sciences limitrophes, surtout la chimie et la physique, qu'elle ne contient plus dans son trop large domaine; elle explique à peu près tous les phénomènes qu'elle considère. Mais au fond elle est toujours restée ce que nous la voyons dans Aristote. Le chemin qu'elle XXVIII a fait est plus long; mais c'est toujours le même, et elle n'a pas essentiellement changé la voie où le maître l'avait mise. Voici les traits principaux du cadre où la science se meut à présent (02). Le premier point dont elle s'occupe à peu près comme le faisait Aristote, c'est la chaleur qui joue un rôle immense dans l'atmosphère tout aussi bien que dans le reste de la nature; et pour connaître le degré de la chaleur dans toutes les variations météoriques, elle emploie le thermomètre, inventé il y a moins de trois cents ans, sans doute par Galilée. La source principale de la chaleur, c'est le soleil; et la météorologie peut négliger sans inconvénient la portion à peu près imperceptible que la terre recèle dans son sein, et qui, à travers de corps mauvais conducteurs, lui vient du feu central, reste de l'incandescence primitive du globe. On a observé la température avec un soin minutieux, à toutes les heures de la journée, sous toutes les latitudes; et il a été constaté que, par la présence ou l'absence du soleil XXIX au-dessus de l'horizon, il y avait partout chaque jour un maximum et un minimum. On a ainsi déterminé la température moyenne des différents lieux de la terre, soit pour la journée, soit pour l'année entière, suivant le changement des saisons et l'obliquité plus ou moins grande des rayons solaires. Bien plus, en s'élevant sur les montagnes, ou dans des ballons, on a pu conjecturer la température des couches supérieures de l'atmosphère, et l'on a su qu'elle diminue à mesure qu'on monte plus haut, dans une proportion qui varie avec les latitudes, les saisons et l'heure du jour. Pour les espaces célestes, cette température paraît être excessivement froide. C'est la chaleur, qui, en agissant dans l'atmosphère sur certains points plus ou moins que sur certains autres, y cause ces perturbations qu'on appelle les vents. Tant que la densité de l'air est partout la même, l'atmosphère reste en repos; mais dès que cet équilibre est rompu par une cause quelconque, il en résulte ce mouvement que tout le monde connaît, et dont les effets sont parfois terribles, tout en restant d'ordinaire très bienfaisants. La météorologie n'a guère eu à modifier les divisions des vents telles qu'Aristote les avait établies. Seu- XXX lement elle les a multipliées davantage, et elle les a poussées jusqu'à des précisions qui reposent sur les degrés des angles que la direction des vents fait, soit à l'est soit à l'ouest, avec le méridien. Celte direction est indiquée du reste à la surface de la terre par les girouettes, comme les nuages indiquent la direction des courants supérieurs. La vitesse des vents est plus difficile à mesurer que leur direction ; aussi la science antique n'avait-elle pu s'en occuper que très peu ; mais la science moderne a des anémomètres, qui remplissent plus ou moins bien leur objet, d'ailleurs fort délicat. On a fait pour la direction moyenne des vents ce qu'on avait fait pour la moyenne température, et l'on sait assez précisément quels vents soufflent généralement dans les diverses localités. On a reconnu de plus à la surface de notre globe certains vents réguliers et continus, par exemple, les alizés, qui courent perpétuellement de l'est à l'ouest, mais seulement entre les tropiques, et par suite de la chaleur considérable du soleil sous cette zone, combinée avec le mouvement plus rapide de la rotation de la terre. D'autres vents, qui sont encore réguliers, tout en l'étant moins, règnent dans quelques contrées, notamment les moussons de l'Océan in- XXXI dien, dépendant à la fois et de la configuration relative des continents et des mers, dans cette partie du globe, et de la marche du soleil. Tels sont encore dans la Méditerranée les vents que, depuis Aristote, on s'est habitué à nommer Étésiens, parce qu'ils reviennent chaque année à des époques à peu près fixes, comme celles des moussons. Telles sont les brises régulières de terre et de mer, qui soufflent alternativement le matin et le soir, par la réaction réciproque de la terre sur les eaux et des eaux sur la terre. Enfin, les vents possèdent les propriétés physiques des contrées d'où ils viennent. Les vents qui soufflent de la mer sont en général humides, et ceux qui soufflent des continents sont secs. Les vents du sud sont chauds, ainsi que ceux qui viennent du grand désert et des grandes plaines, tandis que ceux du nord, au contraire, sont froids comme le pôle d'où ils sortent. Connaissant une fois l'action générale de la chaleur, et un de ses principaux effets, le vent, qui lui-même devient cause d'une multitude d'effets secondaires, la météorologie étudie l'atmosphère dans sa nature propre ; et, grâce à la chimie et à la physique, elle y découvre les choses les plus curieuses. L'atmosphère, plus dense dans ses couches infé- XXXII rieures que pressenties supérieures, a une hauteur limitée, qu'on a calculée bien des fois, et qui ne peut pas aller à plus d'une vingtaine de lieues, retenue autour de notre globe par l'attraction qu'il exerce sur elle. Elle se compose de deux corps principaux, les gaz et les vapeurs, qu'avait pressentis Aristote en admettant une double exhalaison. Les gaz restent toujours à l'état élastique et aériforme, tandis que les vapeurs passent, sous l'influence de diverses circonstances, à l'état liquide. Les gaz qui se trouvent dans l'atmosphère sont en très petit nombre; il n'y en a guère que deux, l'oxygène et l'azote, dont les proportions, trois quarts pour le second et un quart pour le premier (21 et 79), restent constantes. La quantité de vapeur d'eau au contraire varie notablement suivant l'état de l'atmosphère. Les gaz et les vapeurs ont cette propriété commune de se dilater en tous sens, avec une force d'expansion considérable, selon la chaleur, et selon la pression à laquelle ils sont soumis, et de se pénétrer réciproquement. C'était un point très important de connaître les variations de la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère; et de là, l'hygrométrie tout entière, formant une partie spéciale de la météorologie, et em- XXXIII ployant toute une série d'instruments spéciaux. Avec les hygromètres, la science constate les maxima et les minima journaliers, les variations annuelles de l'humidité, les conditions hygrométriques des différentes parties de la terre et des différentes couches de l'océan atmosphérique, l'influence des vents sur l'évaporation des liquides plus ou moins lente, etc. Armée de tous ces moyens d'observations et d'études, la science donne l'explication des météores aqueux : la rosée et la gelée blanche, les brouillards, dont elle mesure les vésicules presque imperceptibles, qui finissent par former les nuages, aux différents états de condensation où nous les voyons, Cirrus, Cumulus et Stratus, la pluie, et la neige aux flocons de figures si variées et si régulières. Aristote avait déjà pensé à estimer la quantité de pluie qui tombe annuellement; mais ces observations, très limitées de son temps, et sans doute peu comprises, ont reçu dans le nôtre autant d'étendue que les observations de la chaleur et de l'humidité atmosphérique. On mesure avec une satisfaisante exactitude les quantités d'eau tombées dans une seule averse, ou tombées annuellement sous les différentes latitudes, aux différentes hauteurs, selon les vents et les saisons, sur les côtes de la mer ou dans l'intérieur des conti- XXXV nents. En un mot, on sait à peu près la distribution des pluies dans le monde entier. Si les vents et les hydrométéores sont causés par la chaleur, ils ont à leur tour la plus grande et la plus constante influence sur la température de notre atmosphère, et ils déterminent en grande partie les anomalies qu'elle présente. De là, tout une suite d'observations sur la distribution de la température. L'état du ciel exerce une action immense; et, selon qu'il est couvert ou serein, on conçoit que l'intensité de la chaleur varie en proportion. Elle ne varie pas moins selon qu'il pleut ou ne pleut point, selon qu'il y a du vent ou du calme, etc. Les températures extrêmes que l'on a observées et où l'homme peut encore vivre, sont séparées par plus de cent degrés, depuis 47° au-dessus de zéro jusqu'à 56° au-dessous. Les extrêmes se trouvent dans l'intérieur des continents; sur les côtes, la différence est moindre. De là, des climats marins et des climats continentaux, des lignes très- variables à la surface de notre globe, où les hivers sont également froids et les étés également chauds (isochimènes, isothères), et d'autres lignes non moins variables où la température moyenne annuelle est la même (isothermes); de là, les pôles du froid et du chaud, qui XXXV ne coïncident pas avec les pôles géographiques ni avec l'équateur; de là, les décroissements réguliers de la température, à mesure qu'on s'élève en altitude, et les amoindrissements de la végétation; de là, les limites des neiges éternelles, changeant avec, les latitudes et les climats, etc., etc., etc. Au temps d'Aristote, on se bornait à reconnaître trois zones, qu'on avait grand'peine à délimiter entre elles : la zone habitable, terminée au nord par une zone qui ne l'était pas à cause du froid, et au sud par une autre zone qui l'était aussi peu à cause du chaud. Ces distinctions, qui sont encore demeurées dans le langage ordinaire, n'étaient pas suffisantes; mais la science s'en contentait à ses débuts. Une série d'observations essentielles, que l'antiquité n'a pas même soupçonnées et que les modernes ont poussées très loin, ce sont celles qui concernent le poids de l'atmosphère. On conçoit facilement que, selon l'humidité ou la sécheresse, la chaleur ou le froid, le beau ou le mauvais temps, ce poids varie sans cesse ; et il est de la plus haute importance de s'en assurer, parce que ces oscillations perpétuelles du poids de l'atmosphère peuvent révéler à l'avance, et avec grand profit, les perturba- XXXVI tions heureuses ou redoutables qui vont survenir. L'instrument qui indique ces oscillations, c'est le baromètre, que tout le monde connaît et qui a rendu tant de services à la science, depuis deux cent cinquante ans que Toricelli l'a inventé. Les observations qu'il permet sont d'un ordre encore plus délicat que celles du thermomètre, et il est malaisé de se figurer toutes les précautions qu'elles exigent, d'abord dans la construction de l'instrument lui-même, et ensuite dans l'emploi pratique qu'on en fait. Le baromètre a, comme le thermomètre et plus que lui, ses variations diurnes qui, malin et soir, ont un maximum et un minimum, à quatre heures et à dix heures du soir, à trois heures trois quarts et neuf heures et demie du malin. L'oscillation diurne varie avec les latitudes, et l'on en a mesuré l'amplitude avec la plus scrupuleuse précision; car il s'agit toujours de quantités excessivement petites. On n'est pas d'accord sur les causes de ces variations régulières du poids de l'atmosphère. Mais ces divergences des théories n'ont pas nui à l'exactitude des observations, qui se sont multipliées encore plus, s'il est possible, que les observations de la chaleur. La hauteur moyenne du baromètre est à peu près la même par toute la surface du globe au bord de la XXXVII mer; elle est moindre sous l'équateur; elle augmente avec la latitude jusque vers le trentième et quarantième degré, et à partir de ce point, elle diminue progressivement jusque dans les contrées le plus septentrionales. Cette hauteur, qui change avec les saisons, est plus grande en hiver qu'en été. Mais outre ces oscillations régulières et périodiques, qui indiquent en quelque sorte les marées de l'océan aérien, il y a des oscillations irrégulières et subites qui tiennent à des causes puissantes et passagères. Ces causes sont d'abord les vents, qui changent la pression atmosphérique, et l'accroissent quand ils sont de l'est et du nord, et la diminuent quand ils sont du sud et de l'ouest. Une autre cause plus généralement connue, c'est la pluie, dont l'approche fait baisser d'ordinaire le baromètre, sans qu'il y ait en Ire ces deux faits la corrélation étroite et nécessaire que le vulgaire y suppose. En troisième lieu, les tempêtes, qui sont les perturbations les plus profondes de l'équilibre atmosphérique, s'annoncent par des oscillations considérables et rapides du baromètre, qui semble affolé. Ce sont alors les vents qui se livrent les plus rudes et les plus redoutables combats; selon la nature de ceux qui l'emportent tour à tour, le délicat instrument nous montre toutes les XXXVIII péripéties de la lutte, qui est quelquefois bien longue ; et son état normal ne se rétablit que quand enfin un des vents est vainqueur de ses rivaux et règne sans partage. Si la science moderne a conquis tant de données certaines sur le poids de l'atmosphère, sur son humidité, sur sa composition physique et chimique, et sur sa chaleur, elle n'en possède pas moins sur les phénomènes électriques. Il y a toujours de l'électricité dans l'air, même par les temps les plus sereins; les nuages orageux en sont chargés; la pluie est presque toujours électrique; l'évaporation l'est bien davantage encore, dès qu'il s'y mêle quelque décomposition chimique, et c'est le cas le plus ordinaire. La rosée et les brouillards développent de l'électricité, comme la pluie; mais c'est surtout dans les orages qu'elle s'accumule, et elle produit alors : l'éclair, étincelle électrique résultant de la précipitation instantanée de la vapeur d'eau, allant d'un nuage à l'autre ou du nuage à la terre; le tonnerre, qui n'est que le bruit du déplacement de l'air causé par l'étincelle et l'irruption violente de l'air environnant dans le vide subitement formé; le grésil et la grêle, dont la théorie fort difficile est encore incomplète, malgré les efforts de Volta ; les trombes, XXXIX dont les effets sont si désastreux pour les travaux de l'homme, etc., etc. Si, pour expliquer les phénomènes électriques de l'atmosphère, la météorologie doit s'adresser à la physique, c'est sur elle qu'elle s'appuie encore pour les phénomènes optiques; et comme la théorie de la lumière est une des plus positives et des plus avancées depuis les découvertes de Newton, la météorologie peut se rendre compte d'abord de la transparence de l'atmosphère, de la couleur bleue de l'air, du crépuscule et de l'aurore, de la scintillation des étoiles, du mirage; puis, des couronnes lumineuses et des halos, résultant de particules glacées qui flottent dans l'air; des anthélies et des parhélies; et enfin de l'arc-en-ciel, le plus frappant et le mieux expliqué de tous ces phénomènes. La météorologie étend même le cercle de ses études jusqu'aux aurores boréales, qui peut-être ne lui appartiennent point, non pas seulement parce qu'elles se rapportent au magnétisme terrestre, mais encore parce qu'elles semblent ne plus être situées dans notre atmosphère. On peut en dire autant, soit des étoiles filantes, qui dans ces derniers temps ont été étudiées mieux qu'elles ne l'avaient jamais été, par des observateurs XL infatigables(03), soit des aérolithes, dont l'origine n'est pas encore bien expliquée. Il y a enfin certains phénomènes problématiques que la science ne considère plus et qu'elle laisse désormais à la crédulité populaire. Tel est à peu près l'ensemble de la science météorologique au xixe siècle. Sans doute, elle a fait, depuis le temps des Grecs, d'immenses progrès, bien qu'elle soit encore très loin de donner tout ce qu'on exige d'elle avec plus ou moins de raison; sans doute on doit convenir que, depuis trois siècles, elle n'a pas cessé de marcher, et qu'elle réalise tous les jours les plus précieuses acquisitions, grâce à la multiplicité, à la patience, à la sagacité des observations. Mais tout en reconnaissant bien volontiers ses succès, je n'en maintiens pas moins que, d'Aristote jusqu'à nous, c'est une simple progression dans une voie toujours la même. Elle présente, il est vrai, une déplorable lacune pendant près de deux mille ans, c'est-à-dire depuis l'affaiblissement de l'esprit grec, la décadence de l'Empire romain et le cataclysme de l'invasion barbare, jusqu'à cette époque, XLI si bien nommée, de la Renaissance, où en effet l'intelligence humaine, servie par les plus heureuses découvertes, a pris tout à coup une activé si énergique qu'on a pu croire à une vie nouvelle. C'est que la météorologie a subi, comme le reste du savoir humain, celte longue éclipse ; mais elle a été une des premières à sortir de l'ombre ; et l'on peut voir par le livre de Descartes sur les Météores tout ce qu'elle avait appris déjà au XVIIe siècle, à côté de tout ce qu'elle conservait encore de la tradition. Descartes est toujours, sans le savoir, un disciple d'Aristote. Dans les dix chapitres ou discours qui composent son ouvrage, c'est le cadre très peu rectifié du philosophe ancien; ce sont en grande partie les mêmes sujets, et parfois aussi les mêmes théories : d'abord la nature des corps terrestres ; puis les vapeurs et les exhalaisons; le sel, et notamment celui qui est contenu dans l'eau de mer; les vents; les nuages; la neige, la pluie et la grêle; les tempêtes et la foudre avec tous les autres feux qui s'allument en l'air ; l'arc-en-ciel ; les couronnes, ou cercles qu'on voit quelquefois autour des astres; enfin les parhélies, ou l'apparition de plusieurs soleils. C'est presque l'ordre même d'Aristote; et sauf quelques éliminations très légitimes, les comètes, la voie lactée et XLII les tremblements de terre, on se croirait encore dans la science grecque, améliorée mais non changée par un grand génie et par des recherches plus précises. Descartes est une heureuse transition entre l'antiquité et les temps modernes. Je ne dis pas que celle louange l'eût beaucoup flatté ; mais il n'est pas toujours aussi novateur qu'il le croit. Depuis Descartes, la météorologie est devenue ce qu'on vient de voir, et il n'est pas à présumer qu'elle veuille le désavouer pour un de ses ancêtres les plus illustres et les plus sérieux. C'est donc à la Grèce qu'il faut justement rapporter la gloire d'avoir fondé la science et de l'avoir même poussée fort loin, dans l'espace de deux ou trois cents ans d'investigations originales, que couronnent celles d'Aristote. C'est un grand mérite sur lequel on ne saurait trop insister; et puisque l'occasion s'en présente, je n'hésite pas à revenir sur les services prodigieux que le génie grec a rendus à l'esprit humain, et en particulier à l'esprit moderne. Je ne veux pas étendre le cercle outre mesure; et je me renferme dans ce qui concerne uniquement la météorologie. Si nous remontons, par hypothèse, à l'origine des choses, on peut conjecturer que la science des XLIII météores a été nécessairement une de celles dont l'homme a dû s'occuper le plus tôt, lorsque, délivré des premières luttes, il aura eu quelque loisir pour observer et comprendre la nature au milieu de laquelle il vivait. Les phénomènes qui se passent dans l'atmosphère frappaient continuellement ses yeux; mais de plus, ils l'atteignaient dans sa personne; et comme ils sont dans une variation perpétuelle, il était bien impossible qu'ils échappassent longtemps à la sagacité curieuse qui est un des instincts de notre intelligence. D'abord, l'homme u'avait eu qu'à se défendre contre leurs influences, ou à les tourner à son profit; plus tard, il put essayer de s'en rendre compte ; et comme ils forment une classe assez distincte de faits dans la nature, on put aisément les grouper en un système. Voilà comment, même avant Aristote, on les réunissait sous un nom commun, qui les séparait de tous les autres. Qui a eu la gloire d'inventer ce nom, et par là de déterminer la science? C'est ce qu'on ne sait pas; et l'histoire, tout en voulant être juste, est impuissante ici comme elle l'est dans tant d'autres cas, même pour des temps moins reculés. La science une fois distinguée et circonscrite, quoiqu'elle le fût assez mal à ce début, n'a plus eu XLIV qu'à poursuivre ; et le germe s'est développé avec une régularité et une vigueur qui attestent que ceux qui, les premiers, l'avaient conçu, ne s'étaient pas trompés. Aujourd'hui, à la distance où nous sommes placés, au milieu de toutes les richesses scientifiques dont nous sommes comblés, nous nous sentons très peu enclins à être reconnaissants ni même équitables envers les inventeurs primitifs de toutes choses; et il est des historiens de la météorologie, par exemple, qui ne mentionnent même pas Aristote et les travaux des Grecs (04). Ces commencements des sciences nous semblent une chose toute simple, et nous n'en savons pas le moindre gré à qui nous les devons. C'est cependant la chose difficile par dessus toutes ; et si l'on veut se donner la peine d'y réfléchir quelques instants, on se convaincra que le génie grec, dont le nôtre n'est que le docile continuateur, s'est placé dans la science, et nous a placés avec lui, à une hauteur incomparable. Je me remets en mémoire ce qui s'est passé dans l'Inde ; et je vois alors, par un contraste étonnant, toute la supériorité de la Grèce. Certes ce n'est pas l'intelligence qui a manqué à la race des Aryas, XLV sœur de toutes nos races européennes. Depuis les Védas jusqu'aux systèmes de philosophie indépendante et même irréligieuse, depuis le brahmanisme jusqu'aux sectes bouddhistes encore actuellement florissantes ; depuis les épopées et le théâtre jusqu'à la grammaire, ce chef-d'œuvre qu'aucun peuple n'égalera jamais, que de monuments divers, dignes de la plus haute estime, malgré de trop réels défauts ! Et cependant au milieu de tant de trésors, et en dépit de si puissantes facultés, pas un seul monument de science ! Pas même l'ébauche d'une science quelconque ! J'ajoute que pour la météorologie, qui doit ici nous intéresser spécialement, ce n'est pas apparemment le climat qui a fait faute ; et si quelque part les phénomènes météorologiques sont remarquables, réguliers et terribles, c'est dans la presqu'île de l'Inde, et surtout sur les bords du Gange. Cependant l'esprit hindou, quelque bien doué qu'il fût, n'a pas un seul instant songé à se demander comment ces phénomènes se produisaient, quels rapports ils avaient entre eux, et comment on pouvait arriver à les comprendre, si ce n'est à s'en préserver. Pour lui, ils sont demeurés dans la confusion universelle, d'où il ne les a jamais tirés, perdus dans l'obscurité de toutes choses, et ne XLVI se détachant pas plus que le reste de cette vague synthèse où tout est enveloppé, mais où rien ne se définit pour s'éclaircir. Dans la Grèce, au contraire, on a de très bonne heure observé les faits pour eux-mêmes, et on ne les a pas uniquement sentis dans leurs influences utiles ou fâcheuses. Sous un climat moins instructif, qu'on me passe ce mot, on a bien vite saisi les caractères des phénomènes avec leurs affinités réciproques; et comme le vaste lieu où ils se passent était toujours le même, et que ce lieu est au-dessus de la terre, on a créé la science des météores, qui pouvait devenir profitable autant qu'elle était curieuse. Après quelques tâtonnements inévitables, on y a appliqué une méthode excellente, et aux observations conduites avec une précision réfléchie, on a joint des expériences. En un mot, la Grèce a su découvrir et employer la méthode véritable dans les sciences, et spécialement en météorologie. A cet égard, les modernes ont fait plus, qui le nierait? Mais ils n'ont pas fait mieux ; et quel que soit leur orgueil, exalté par les conseils de Bâcon et par ses flatteries, il faut bien qu'ils avouent, en présence des preuves les moins récusables, que les anciens ont su observer, et même qu'ils ont expérimenté comme XLVII nous, si ce n'est aussi bien que nous. Ils nous avaient devancés sur cette route, qui est la seule assurée; nous n'avons fait qu'y marcher plus loin qu'eux, en recueillant leurs exemples et leur héritage ; mais nous ne l'avons pas ouverte. Comme cette assertion, tout exacte qu'elle est, devra sembler un paradoxe à bien des esprits prévenus, je tiens à la justifier, et je ne puiserai pas mes preuves plus loin ni ailleurs que dans la Météorologie d'Aristote. Elles y surabondent, et je n'aurai que l'embarras de choisir. Avant de présenter sa théorie personnelle sur les comètes, Aristote expose les théories de ses prédécesseurs, parmi lesquels se trouvent les hommes les plus fameux et les plus honorés, Anaxagore, Démocrite, et les Pythagoriciens. Je ne recherche pas si l'explication d'Aristote vaut mieux que les leurs, et s'il a raison de nier que les comètes soient des corps planétaires, ainsi que le supposaient les premiers philosophes. Mais comment les combat-il, et que prétend-il opposer à leurs systèmes ? Des faits, et rien que des faits, qui convenablement observés réfutent et renversent, selon lui, leurs hypothèses. Ainsi, on prétendait que les comètes ne se montrent jamais qu'au nord et à l'époque où le soleil approche XLVIII du solstice d'été. Aristote rappelle que la grande comète qui parut au temps du tremblement de terre en Achaïe et de l'inondation maritime, sous l'archontat d'Aristée, s'était montrée à l'occident équinoxial et l'hiver; il rappelle en outre que l'on avait déjà vu une foule de comètes au sud, et que si la comète signalée sous l'archontat d'Euclès, fils de Molon à Athènes, dans le mois de Gamélion, était en effet au nord, le soleil était à ce moment au solstice d'hiver et non point au solstice d'été. Démocrite croyait que les comètes résultaient quelquefois de la conjonction de deux astres, et que c'était de cette rencontre que venait l'apparence qu'elles offrent. Aristote répond particulièrement à Démocrite que, s'il en était ainsi, ce n'est pas quelquefois mais toujours que le phénomène devrait se produire, quand deux astres sont en conjonction. Il invoque le témoignage des Égyptiens, qui ont observé bien souvent des conjonctions, soit de planètes entre elles, soit de planètes avec des étoiles fixes, et qui n'ont pas signalé de comètes par suite de ces conjonctions. Aristote cite en outre son propre témoignage ; et il atteste avoir vu lui-même deux fois la planète de Jupiter occulter une étoile de la constellation des Gémeaux, sans que cette con- XLIX jonction produit du tout l'effet d'une comète. Aristote se croit donc en droit de conclure, d'après ces faits, qu'il pourrait appuyer de bien d'auIres, que les comètes ne sont pas des planètes comme on l'a dit, et il s'efforce de substituer à ces hypothèses une explication plus conforme à la réalité et plus plausible que celle qu'il repousse. Même procédé pour démontrer que Démocrite se trompe encore dans son explication de la voie lactée. J'en ai déjà touché quelque chose un peu plus haut ; mais j'ajoute ici qu'Aristote reproche à Démocrite, et aux autres philosophes qui partageaient ses opinions, de ne point observer suffisamment le ciel, de même qu'ils n'avaient pas en géométrie et en astronomie les notions nécessaires (Livre I, ch. 8, § 18.) C'est encore par des arguments de la même espèce, qu'Aristote réfute la théorie d'Anaxagore sur la grêle (Livre I, ch. 12, § 13.) Il y oppose des faits qui, dans cette théorie, demeurent inintelligibles ; et pour lui-même, il se fait gloire de ne s'appuyer que sur les faits les plus certains, quoique parfois très extraordinaires. Ainsi, la grêle est bien de la glace ; et cependant, elle tombe beaucoup plus souvent au printemps, en automne et en été qu'en hi- L ver, et surtout que pendant la gelée. Cette circonstance peut étonner; mais elle est réelle. Il faut donc l'expliquer, si on le peut ; et il ne servirait de rien de se la dissimuler et de la négliger, quoiqu'au premier coup d'oeil elle paraisse peu naturelle. On résoudra par des observations aussi patientes, mais plus difficiles, le problème de ces lentes mutations qui se font à la surface de notre globe. Il y a des gens qui, pour expliquer les empiétements réciproques et alternatifs des continents et des mers, croient devoir se jeter dans les considérations les plus hasardeuses sur l'origine même de l'univers (Livre I, ch. 14, §§ 17 et suiv.) Mais il n'est pas prudent de porter ses regards si loin et de risquer de telles méprises. La terre n'est qu'un point imperceptible en comparaison du monde ; et il serait plaisant d'attribuer à l'immensité des choses les révolutions si restreintes que subit notre petit globe. Tout ce que nous avons à faire, c'est de l'observer lui-même, et de borner là nos recherches et nos prétentions. Analysons soigneusement ce qui se passe sous nos yeux et de notre temps ; interrogeons les récits des voyageurs; recueillons les traditions des peuples ; et de toutes ces données réunies et contrô- LI lées par notre raison, tirons des conclusions sur l'état présent du globe et sur son état passé. La Grèce a éprouvé des déluges partiels comme celui de Deucalion ; écoutons ce que les habitants de ces contrées peuvent encore nous en dire. L'Égypte s'est formée peu à peu par les apports du Nil ; elle s'est successivement accrue de proche en proche, comme l'atteste Homère, qui ne connaissait que Thèbes et n'a pas connu Memphis, parce que cette partie de la contrée n'était pas encore sortie des eaux. Au temps de la guerre de Troie, l'Argolide n'était qu'un grand marécage, et la Mycénie était une terre fertile, comme le dit l'Iliade; aujourd'hui, c'est tout le contraire. Le Palus Méotide s'emplit tous les jours par les alluvions qu'y déversent les fleuves, et le Bosphore présente la même surélévation de son canal. Constatons avec un soin vigilant toutes ces observations ; elles seules peuvent nous révéler ce qu'a été jadis notre terre, en nous instruisant précisément de ce qu'elle est aujourd'hui. Des philosophes avaient soutenu que la mer a des sources comme en ont les rivières et les fleuves. Aristote leur objecte que les faits sont absolument contraires à cette hypothèse (Livre II, ch. 1, § 6), et que ces prétendues sources de la mer sont encore LII à trouver. Eu observant l'état actuel des choses, on peut se convaincre que l'équilibre des eaux dans notre monde est permanent. La mer reçoit régulièrement tout ce qu'elle perd ; l'eau des fleuves sans nombre et celle de la pluie compensent l'évaporalion. Il n'y a pas d'autres sources que celles-là pour la masse liquide dont la mer est formée. Elle a été ce qu'elle est dès l'origine des choses, et l'ordre merveilleux que nous admirons dans ces grands phénomènes a dû commencer avec le monde lui-même. Voilà ce que nous dit l'observation, et ce que nous permet de conjecturer une induction légitime, qui sort des faits bien analysés. Dans la théorie des vents, telle qu'on l'imaginait avant lui, Aristote trouve des erreurs comme il en a trouvé dans la théorie de la mer ; et c'est à l'aide du même moyen qu'il repousse ces erreurs et qu'il essaie de les remplacer par des vérités démontrées. Il a recours au témoignage décisif des faits (Livre II, ch. 4, § 10.) Il attribue d'une manière générale la cause des vents à l'exhalaison sèche et à la chaleur solaire ; et remarquant qu'ils varient de fréquence et d'intensité, avec les saisons de l'année et avec les alternatives même de l'exhalaison, il en conclut que les deux phénomènes se tiennent étroitement, LIII et que les vents n'ont pas des sources à la manière des fleuves, ainsi que bien des gens se le figuraient de son temps. Le seul rapport réel qu'on puisse établir entre les fleuves et les vents, c'est que les uns et les autres s'accroissent également dans leur cours (Livre II, ch. 4, § 26) ; et de même que le volume des eaux augmente à mesure que la rivière descend, de même le souffle du vent est beaucoup plus faible au point d'où il part qu'au point où il arrive et où il cesse. La périodicité régulière de certains vents, comme les Étésiens par exemple, prouve assez que le soleil est la plus grande cause de ce phénomène, puisque ces vents ne soufflent que quand cet astre est dans une certaine position relativement à notre terre, et qu'ils sont en général beaucoup moins forts la nuit que le jour. Pour s'expliquer comme il convient la position des vents, il faut se faire une juste idée de la surface de la terre. Mais, ainsi que je l'ai dit plus haut, Aristote démontre que de son temps on en a une idée tout à fait fausse, quand on représente comme ronde la partie habitable de notre globe. Il n'y a que la zone tempérée où l'homme puisse vivre; il ne peut habiter ni la zone torride, ni la zone glaciale. Si la partie habitable forme des deux côtés de LIV l'équateur une bande qui a beaucoup plus de longueur que de largeur, la raison le conçoit aisément; mais à la raison, il faut joindre le poids bien autrement évident des faits. Les voyageurs s'en sont convaincus en parcourant les terres et les mers (Livre II, chap. 5, § 13); et d'après les mesures de leurs itinéraires multipliés, la longitude est à la latitude dans le rapport de 5 à 3. La terre, prise dans sa totalité est bien en effet convexe et sphérique, et comme on l'a vu, il est facile de s'en assurer en remarquant que partout l'horizon se déplace. avec le spectateur lui-même (Livre II, chap. 7, § 5); mais il faut distinguer entre la terre dans sa masse et la terre considérée dans cette partie restreinte où l'homme peut établir son séjour. Un peu plus haut, j'ai fait assez bon marché de la théorie d'Aristote sur les tremblements de terre, tout en la trouvant préférable à celles de ses devanciers ; mais il est juste de remarquer en outre qu'il fait tous ses efforts pour donner à sa théorie le fondement des faits les mieux observés et les plus nombreux. Il interroge toutes les circonstances et toutes les conditions dans lesquelles les tremblements de terre se produisent : les heures du jour, les époques de l'année, la configuration des lieux, LV les éruptions des volcans, les signes précurseurs, les bruits souterrains, les inondations consécutives, etc. Il interroge les récits de tous ceux qui ont observé le phénomène et en ont parlé avec quelque précision (Livre II, chap. 8 tout entier.) En un mot, il recueille autant de faits qu'il peut; et c'est à cette lumière qu'il prétend marcher. Enfin, on pourrait, dans cet ordre de preuves, rappeler la théorie de l'arc-en-ciel, appuyée sur des figures de géométrie et sur des dessins; je n'y reviens pas, et ce que j'en ai dit a dû suffire pour la bien caractériser sous le rapport de la méthode. On le voit donc : Aristote a recommandé l'observation des faits tout aussi vivement que Bâcon a pu le faire deux mille ans après lui ; et pour sa part, il a appliqué ses préceptes autant qu'il l'a pu. La Météorologie vient de nous en offrir une foule d'exemples concluants ; et l'on pourrait en signaler d'aussi nombreux et de tout pareils dans ses autres ouvrages. On peut de plus affirmer à sa louange que, pour lui, l'observation n'est pas la pratique instinctive d'un génie heureusement doué ; c'est une méthode profondément réfléchie, dont on use d'abord pour soi-même, et qu'on oppose ensuite à ses adversaires ; c'est la mesure commune à laquelle on LVI rapporte toutes les explications et toutes les théories; elle les juge toutes sans exception, et c'est elle seule qui a le droit de condamner ou d'absoudre. A cet égard, il est impossible à l'esprit humain d'avoir des principes ni meilleurs ni plus hauts. La seule différence, c'est qu'on peut s'en servir plus ou moins bien ; il n'y a pas lieu d'ailleurs de s'étonner que les premiers essais n'aient pas été aussi heureux que ceux qui ont suivi. Des mains novices ne sont jamais bien assurées. Mais le point capital était de se dire qu'avant tout il faut observer les réalités; et voilà comment la Grèce a eu la gloire de fonder les sciences et comment l'Inde, tout intelligente qu'elle est, ne les a jamais soupçonnées. En présence de telles démonstrations, on aurait, ce semble, assez mauvaise grâce à nier encore que les anciens ont observé. La Météorologie d'Aristote nous prouve non moins certainement qu'ils ont pratiqué l'art des expériences. J'en indiquerai quelques-unes que j'ai déjà eu l'occasion de signaler en passant. Le philosophe veut prouver que la salure de la mer tient à la présence d'un corps étranger, quelle que soit d'ailleurs la nature propre de ce corps ; et voici l'expérience qu'il conseille. Qu'on façonne un LVII vase en cire et qu'on le bouche bien hermétiquement; qu'on le fasse descendre dans la mer, de façon que l'eau n'y puisse faire irruption. Au bout d'un certain temps, on trouvera dans ce vase ainsi fermé un liquide potable, qui aura pénétré par les pores de la cire. La partie potable de l'eau de mer aura pu filtrer, parce qu'elle est plus ténue; quant à la partie plus grossière, qui est le sel, elle n'aura pu s'introduire dans le petit vase, et elle sera restée dehors. C'est comme un crible, qui laisse passer les plus petits grains et rejette les plus gros (Livre II, chap. 3, § 35.) Je ne réponds pas de l'efficacité de l'expérience indiquée par Aristote ; et je n'ai pas plongé un vase de cire dans de l'eau de mer pour m'assurer qu'en effet une partie potable se sépare ainsi de la partie saumâtre. Mais ce qu'on doit affirmer, sans aucune hésitation, c'est que voilà bien une expérience dans le sens précis où la science moderne entend ce mot; c'est un phénomène absolument factice préparé par l'observateur, en vue du problème qu'il cherche à résoudre. C'est là expérimenter dans toute la force de ce terme. On en peut dire autant de cette autre expérience plus facile et très réelle, qui avait le même objet et LVIII que j'ai aussi mentionnée antérieurement. En fait, l'eau de mer est plus lourde que l'eau douce; les navires chargés enfoncent moins dans la première que dans la seconde. On peut se le prouvera soi-même par une expérience fort simple. Qu'on mette des œufs dans de l'eau ordinaire, ils iront au fond. Mais qu'on charge cette eau d'une certaine dose de sel, et l'on verra que les œufs finiront par y surnager, à mesure qu'elle sera devenue plus épaisse par le corps qu'on y aura fait fondre (Livre II, ch. 3, § 38. ) C'est bien là encore une expérience proprement dite. L'observateur produit une eau de mer factice ; et comme il l'obtient en y ajoutant un corps étranger, il en peut conclure que c'est également un corps étranger qui donne à l'eau de mer naturelle le goût particulier qu'elle a, et surtout sa lourdeur. Telles sont les deux expériences formelles que je trouve dans la Météorologie, sans affirmer d'ailleurs qu'on n'y puisse pas encore en découvrir d'autres. Mais si l'on sort de la Météorologie, on s'aperçoit que ce procédé puissant est assez fréquemment employé par Aristote, bien qu'il ne soit pas élevé par lui à la hauteur d'une méthode, comme l'observation directe des faits. Ainsi dans la Physique, voulant LIX prouver que le vide ne peut pas exister, il recommande l'expérience suivante ( Physique, livre IV, ch. 12, § 2. ) Plongez un morceau de bois dans un vase plein d'eau, et vous verrez que ce corps déplace un volume d'eau égal à son propre volume. Le même phénomène qui se passe dans l'eau doit se passer aussi dans l'air, bien que dans ce cas il ne soit plus perceptible à nos sens. Mais dans le vide, que pourra déplacer le morceau de bois? Rien ; car le vide n'est pas un corps, comme le sont l'eau et l'air. Je ne soutiens pas, bien entendu, la force de cette argumentation contre l'existence du vide; mais je fais remarquer que c'est à l'aide d'une expérience, fort neuve alors, qu'Aristote tâche de prouver que le vide est impossible. Ce n'est pas d'ailleurs la seule qu'il allègue ; et il en indique encore trois autres qui, sans avoir la même fin, ont le même caractère. Deux de ces expériences étaient invoquées en un sens contraire par les partisans du vide. Des outres pleines de liquide tiennent encore, disait-on, dans le même tonneau que le liquide remplirait à lui seul ; un vase plein de cendre reçoit encore autant d'eau que s'il était vide. Les défenseurs de la réalité du vide en concluaient que, dans ces deux circonstances, les corps se contractent LX et que par conséquent il| y avait préalablement dans ces corps, du vide que la contraction fait disparaître (Physique, livre IV, ch. 8, §§ 6 et 8.) Enfin la troisième et dernière expérience que je veux emprunter à la Physique, est celle des vessies remplies d'air qu'on mettait au fond de l'eau, et qui s'élevaient à la surface, dès qu'on les lâchait, emportant avec elles des poids plus ou moins lourds qui y étaient attachés (Physique, livre IV, ch. 13, § 4.) Aristote prétendait tirer de là un argument contre la possibilité du vide, qui devrait tendre à s'élever en haut avec bien plus de force encore que l'air renfermé dans les vessies. Je me borne à la Météorologie et à la Physique, et je crois que mon assertion est suffisamment démontrée. Toutefois je ne doute pas que l'on pût trouver encore bon nombre de témoignages tout à fait analogues dans plusieurs autres ouvrages d'Aristote. Je les laisse à présent de côté, sauf à y revenir dans une occasion plus convenable. Mais on doit avouer déjà, en présence de ceux-là seuls que je viens de rapporter, que les anciens ont connu, même de très bonne heure, l'expérimentation; et que ce n'est pas pour la science une gloire aussi récente et aussi originale qu'on l'a cru depuis Bâ- LXI con. Seulement, je dois avouer aussi que chez les anciens, l'expérimentation ne tient pas la place qu'elle a plus tard occupée, et qu'elle occupe de plus en plus dans les travaux contemporains. En voyant ce que c'est que l'expérimentation, on comprend aisément qu'elle n'a dû venir qu'en seconde ligne. Elle est en quelque sorte une observation indirecte; et il est assez naturel que l'esprit humain débute par observer d'abord les faits qui posent devant lui, avant de songer à créer, dans certaines vues particulières, des faits qui n'existent pas et qui doivent éclairer les autres. Observer avec quelque exactitude, c'est déjà un pas immense que bien des peuples n'ont pas su faire ; expérimenter en est un second, moins ardu à franchir, quand on a franchi le premier; et voilà comment les Grecs, pères d'une grande partie de nos sciences, ont découvert et pratiqué les deux procédés dans la mesure que nous venons d'indiquer, et qui correspond au degré même de civilisation où le monde en était alors arrivé. Pour terminer cette préface, je n'ai plus qu'à présenter une dernière remarque sur la météorologie moderne comparée à celle des anciens. Aujourd'hui, ce qu'on demande surtout à la science des météores, c'est de nous avertir des changements que l'atmo- LXII sphère va subir et qui peuvent nous être si utiles ou si nuisibles. On exige que la météorologie soit surtout applicable aux besoins et aux travaux de la société. Si elle ne prédit pas le temps, elle paraît à peu près vaine ; et elle descend dès lors par un injuste dédain au rang de simple curiosité. Celte opinion est excessive, bien qu'elle ait été partagée par plusieurs savants qui comptent parmi les plus autorisés de notre temps; et de là, viennent contre la météorologie des préventions que causent ces exigences trop peu fondées. Chez les anciens et notamment dans Aristote, il n'y a rien de pareil; et il ne paraît pas qu'on se soit jamais préoccupé de tirer quelque parti des observations météorologiques. C'est une différence profonde entre les anciens et nous; et elle me semble tout à leur avantage. La science n'a pas à s'inquiéter d'être utile ; elle doit uniquement chercher à être vraie; et c'est une tâche déjà bien lourde. On aurait tort sans doute de renoncer absolument aux applications profitables des vérités qu'on a la fortune de découvrir; mais ce n'est pas l'objet essentiel de la science; et ce but secondaire, quand elle se laisse aller à le poursuivre témérairement, l'éloigne de ses voies et l'égaré. Les faux pas qu'elle commet dans celte route, qui LXIII n'est pas la sienne, tendent à la discréditer non pas seulement auprès du vulgaire, mais en outre auprès des esprits les plus sérieux. On triomphe des mécomptes et des prédictions fausses de la météorologie, comme si elle était réellement chargée de faire des prédictions, et comme si c'était son devoir d'assurer aux agriculteurs et aux marins, la sécurité et le succès de leurs labeurs et de leurs voyages. La météorologie est imprudente de se laisser séduire aux demandes indiscrètes qu'on lui adresse. Elle a bien assez d'étudier la nature si complexe des phénomènes qui lui ressortissent; qu'elle laisse à d'autres le soin d'en tirer des enseignements pour la pratique de chaque jour. Quant au reproche si souvent fait à la météorologie de n'être pas une science constituée, parce qu'elle ignore encore beaucoup de choses, et qu'elle ne peut pas même dire encore au juste ce qu'est un nuage, on peut voir que ce blâme, provoqué peut-être par les méprises dont je viens de parler, est bien peu mérité. L'analyse que j'ai donnée de la Météorologie d'Aristote et de la météorologie contemporaine, montre de reste la réalité et l'étendue de la science, soit qu'on la considère à son point de départ, soit qu'on la considère à sa période actuelle. LXIV C'est bien là une science constituée, s'il en fût, avec un domaine spécial et un sujet très déterminé, avec des instruments et des procédés qui ne sont qu'à elle. Que si la météorologie ignore encore une bonne partie de ce qu'elle cherche à savoir, c'est là le sort commun et inévitable; elle est imparfaite comme tout ce qui est humain. Mais elle a aussi la consolation générale, qui est de se dire qu'elle en sait déjà beaucoup, et que ses acquisitions passées lui répondent d'un avenir certain. Toutes les sciences en sont là; et les mathématiques elles-mêmes, qui se croient si parfaites, ne cessent de faire continuellement de nouvelles découvertes. Il n'y a pas de motif pour que la météorologie soit une exception. Montmartre, 4 octobre 1862. (01) Voir plus loin dans la Dissertation spéciale ce qui est dit de la composition de la Météorologie et des liens par lesquels le IV. livre s'enchaîne indissolublement aux trois premiers. (02) Je tire l'analyse qui va suivre des ouvrages très justement estimés de M. Kooratz, professeur de physique à l'université de Halle, qu'on peut regarder comme le représentant de la science, dans ce qu'elle a de plus autorisé et de plus complet. (03) On peut citer au premier rang de ces observateurs M. Coulvier-Gravier, qui a consacré déjà près de cinquante ans de sa vie à l'étude de cet unique phénomène. (04) M. Kastner, qui n'est pas le seul.
|